07/10/2015
KR'TNT ! ¤ 250 : WHITE HILLS / FALLEN EIGHT / SCORES / HELL OF A RIDE / LIZARD QUEEN / PANTHERES NOIRES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 250
A ROCK LIT PRODUCTION
08 / 10 / 2015
|
WHITE HILLS / HELL OF A RIDE / SCORES / FALLEN EIGHT / LIZARD QUEEN / BLACK PANTHER PARTY |
|
ERVIN TRAVIS NEWS
Non, nous n'avons pas oublié Ervin Travis depuis l'été, mais les nouvelles qui tombent sont décevantes. La guérison se fait attendre. Courage Ervin, nous sommes avec toi ! |
AU 106/ROUEN/02 – 05 - 2015
WHITE HILLS
WHITE LIGHT WHITE HILLS
Gros buzz en Angleterre autour des White Hills. Kris Needs parle de sonic blast et ailleurs, les critiques britanniques ne tarissent plus d’éloges sur ce couple de new-yorkais qui pond des tas d’albums depuis 2007. On peut dire que les Rouennais ont de la veine, puisque voilà White Hills programmé en première partie de Mudhoney, par un beau soir de mai, au 106.
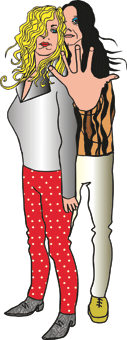
Pendant que joue le groupe de première partie, on voit Ego Sensation et Dave Weinberg se promener dans le grand hall. Il semblent venir prendre la température. Contrairement à ce que montrent les photos de presse, Dave est petit et Ego le dépasse d’une bonne tête. Ils ont tous les deux de vraies dégaines de rock stars. Dave porte une crinière abondante et souligne ses yeux au khôl. Ego est l’une de ces blondes américaines terriblement sexy qui savent mettre une libido en état d’alerte. La petite papoterie d’après concert permit de découvrir en Dave un personnage timide et très fin.
— You’re getting big in Englandde !
— Are we ?
— You’re lucky, cause the Brits usually don’t like ze American bands.
— Are they ?
— Shoure ! Ze Brits don’t like ze Amricans at all !
— Oh I know. We use to call England Little America.

L’idéal bien sûr est de voir ces deux oiseaux jouer sur scène. Ils proposent un frichti à base de groove de basse, de séquenceurs et de guitare stoner. On pense à Hawkwind pour le terreau et à Nebula pour les échappées. Ego drive ses grooves binaires avec une régularité édifiante. La difficulté avec ce genre de cut, c’est de rester dans le tempo. Quant à Dave, il semble se comporter comme Miles Davies : il attend que l’orchestre groove pour entrer dans la danse. Et quand il y entre, c’est pour arracher le cut du sol et l’envoyer voyager dans l’espace. Ce qui nous ramène à Hawkwind. Ces gens-là furent en leur temps des experts du décollage par la transe hypnotique. Ce groupe mythique ordinairement composé de sept à huit personnes aurait très bien pu fonctionner en trio, car Dave Brock, Lemmy et Simon King fabriquaient la transe.

White Hills fait partie de ces groupes inclassables qui savent créer un univers de toutes pièces. Ils savent se donner les moyens de leurs ambitions. On voit bien que le petit Dave suit une vision et qu’il cherche à se démarquer en jouant une musique originale qui ne doit rien au hard, ni au garage et encore moins à l’électro. Mais comme Alan Vega et Dave Brock, il ouvre de nouvelles voies. Un journaliste lui demandait récemment s’il s’intéressait aux groupes de la scène new-yorkaise contemporaine et Dave embarrassé lui répondait qu’il n’en connaissait pas. Le seul nom de groupe qui lui venait à l’idée était celui d’Oneida, qui eut sa petite heure de gloire dans les années 90, et encore, il fallait creuser pour trouver les disques.

Chou blanc aussi avec Grand Mal.
— Sometimes you sound like Gland Mal.
— Who ?
— Gllland Mâââl !
— Could you spell it, please ?
En fait, Dave semble vivre complètement déconnecté de l’environnement musical en général. Ça ne semble pas l’intéresser. Voilà qui est bon signe, car ce sont en général les gens parfaitement sûrs de leur art qui ne s’intéressent pas aux autres. Toute la litanie des influences l’ennuie considérablement. Souvenez-vous de Marcel Duchamp : il ne se reconnaissait aucune influence.

Sur scène, Ego et Dave jouent des morceaux longs d’environ quinze minutes. Il est certain que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Plus tard au bar, on entendait des gens leur reprochaient d’être «trop bourrins» ou d’abuser des machines. Mais Ego et Dave surent aussi capter l’attention d’une écrasante majorité de gens qui virent en eux un duo éminemment original et attachant. Ce qui posa d’ailleurs un problème aux têtes d’affiche, les vétérans de Mudhoney qui malgré leur grande efficacité allaient passer pour des ringards, avec leur vieux garage cousu de fil blanc.
Ego et Dave jouent la carte du rock, la vraie, celle d’une quête perpétuelle de renouvellement. Si on fait référence à Hawkwind, on ne s’enlise pas, car ce groupe a toujours su cultiver sa modernité. Réécoutez les cinq premiers albums d’Hawkwind, et vous verrez trente-six chandelles.
Alors évidemment, aussitôt après leur set, on s’est précipité au mershandising.
— This is ze new albumme ?
— Oh yeah ! This one just came out !

Ego s’était attachée une petite bourse autour de la taille. Elle y enfournait les billets. On retrouve sur «Walks For Motorists» quelques moments du set qu’il faut bien qualifier de magiques, comme par exemple «No Will», monté sur un pur jus de doom des cavernes inter-galactiques. Voilà un cut ravagé par d’énormes montées de basse. En écoutant ça, on pense bien évidemment à la façon dont Jim Dickinson faisait subitement monter la basse dans certains de ses mixages. Stupéfiant ! On se gave de ces infra-basses qui remontent à la surface pour s’abreuver d’adrénaline. Retrouvailles aussi avec «Lead The Way», un grand moment du set, au cours duquel le petit Dave cherchait à atteindre l’extension parabolique du groove de doom. Il s’en allait chercher ça dans une sorte de no-man’s land et jouait sur sa Les Paul des phrasés condamnés au néant. Dans cette musique, toute lumière disparaît, comme au plus profond des océans. Ne subsiste que la sensation d’une épaisseur, celle du doom. Et Dave nous embarque dans une mélasse surnaturelle de solo qu’il répand avec une lenteur inquiétante et qu’il agace de wha-whateries persistantes, histoire de rendre l’ambiance à la fois originale et irrespirable. Pour qui aime le heavy doom pétrificateur et le solo qui coule comme un camembert oublié sur le balcon en plein mois d’août, c’est un véritable paradis. On trouve sur cet album deux autres merveilles. Tout d’abord «Wonderlust» monté sur un solide de groove de basse d’Ego et visité par un solo épouvantablement furibard. Ego joue ses grooves binaires comme si elle montait à l’assaut d’un rempart, les cheveux au vent. L’autre perle rare est ce «Life Is Upon You», chanté à deux voix dans une atmosphère fantomatique, avec des chœurs qui renvoient aux Dolls et à «Sympathy For The Devil» - Your life’s upon you - What do you say, répond-elle.

Leur premier album s’intitule «Glitter Glamour Atrocity». Avec «Under Skin Or By Name», le petit Dave nous propose un bruitage antique qui évoque les rives de la Mer Noire en des temps très reculés. Et puis il s’énerve et enfonce ses clous dans les paumes du sauveur. Mais on sent bien chez lui une facilité à se perdre. Pas facile de vouloir réinventer le prog d’Heroïc Fantasy. Dans «Spirit Of Exile», il tente de forcer le passage à coups de do you feel it, mais il n’a ni la puissance d’un Dave Brock, ni la Silver Machine. Il utilise aussi «Love Serve Remember» pour chercher un passage. Il y crée les conditions de la heavy prog. Franchement, ce petit mec a le génie du son contrevenant. Il sonne même comme un Vulcain en chambre. Aujourd’hui, avec un bon ordi et une Les Paul, on fabrique des univers. Et pour bien asseoir sa réputation, il claque le morceau titre de l’album aux gros accords de rock américain. C’est lui qui décide. Que vous soyez content ou pas, c’est pareil. Il crée des univers pour y faire son festival.

Album après album, le petit Dave s’impose comme un immense guitariste. Pour en avoir le cœur net, il suffit d’écouter «Heads On Fire» paru en 2007. On tombe immédiatement sur «Radiate» et c’est l’effarence automatique. Il crée les conditions d’un monde violent balayé par des vents terribles et il part en solo lévitatoire. Au beau milieu de ce cyber-espace fabriqué de toutes pièces, son solo luit comme le regard jaune du diable. Il s’enfonce ensuite dans le heavy blues pour «Oceans Of Sound» et profite de cette escapade pour partir en vrille. Son solo intraveineux se disperse dans la poussière du néant. Mais tout ceci n’est rien en comparaison de «Vision Of The Past Present & Future». Il installe une sorte de violence extraordinaire, celle d’un Etna engloutissant Pompéi toute entière. Ce petit mec représente une menace pour la civilisation occidentale. Il semble donner des fêtes orgiaques dans son cyber-châtö. Il s’installe au creux de l’athanor et jette au large une exceptionnelle fournaise d’exaction multi-directionnelle. Il conduit le vertige au sommet des monts lointains. Plus loin, il opère un brusque retour à l’extrême violence avec «Eternity» qu’il baptise d’un claqué d’accord dévastateur. C’est un vrai carnage d’excavation. Il avance en territoire inconnu, mu par son énergie new-yorkaise. Son riff démolit tous les a-prioris. Il œuvre au cœur de l’atome du son. Il fait le bruit d’un escadron et après un faux arrêt, il repart de plus belle. Seigneur !
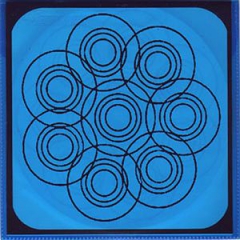
On ne trouve que quatre cuts sur «Abstractions And Mutations». Le petit Dave s’amuse toujours avec ses machines et sa guitare. Le cut qu’on retiendra sera très certainement «Midnight In America», monté sur un gros pounding urbain visité de loin en loin par des stridences cadencées. Le petit Dave adore déployer ces longs solos gras à la surface du groove. Il adore lâcher sa purée à fleur de peau de l’oracle de Delphine.

White Hills pose un problème. On aimerait croire que chaque album se ressemble, et pourtant, on tombe chaque fois sur quelque chose de plus aventureux, comme par exemple sur l’album «White Hills» à pochette orange paru en 2010. Écoutez «Dead» et vous comprendrez qu’il s’en fout. On peut penser ce qu’on veut de ses disques, il fait son truc dans son coin et se moque du qu’en-dira-t-on. Il donne sa chance au son. Tu veux te barrer ? Barre-toi ! Et le son se barre. Mais pas n’importe comment. Avec une sorte d’ultra-puissance de beat drivé dans l’essence d’un absolu de la destruction. «Country Sevens» ? Même chose. Ses notes de guitares filent comme des astéroïdes vers le fond de l’univers. Ce mec est capable de pondre un groove astéroïdal chaque matin. On ne peut pas suivre. Allez voir sa discographie. C’est infernal. Il est encore pire que Ty Segall ou Wild Billy Childish. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire, c’est d’être un peu long pour ses mises en bouche. Exemple : «We Will Rise». On a le temps d’aller se resservir un verre avant que ça ne se mette en route. Plus loin, il lance «Polvere Di Stelle» avec un riff de guitare ultra-classique. Si on a douze minutes à perdre, on peut décider de le suivre. On le verra alors se détacher lentement de la terre et partir à la dérive dans une traînée de son extraordinaire. On reste sur l’idée que le petit Dave est un étrange mélange de forcené visionnaire et de geezer fragile et délicat.

«H-p1» fait sans doute partie de ses meilleurs albums. Dès l’ouverture, on subit l’attaque sauvage de «The Condition Of Nothing». C’est un bombardement d’ions soniques pur et dur. Pas de quartier pour les canards boiteux. Il grille tout sur son passage pendant qu’Ego envoie des gros coups de basse. Le petit Dave semble même devenir fou, il joue à toute blinde, on ne l’avait encore jamais vu dans cet état. Il semble qu’il sache bâtir la structure d’un cyber-cöchemard à la K Dick. Et puis il revient se poser sur son perchoir de faucon, comme si de rien n’était. Le petit Dave aurait-il les pouvoirs d’un mage ? Avec «No Other Way», on retombe sur la même ambivalence : voilà un cut solide monté sur un riff d’acier bleu, mais ça peut durer des heures. Même si on apprécie ce son, il faut savoir s’armer de patience. Ce qui n’est absolument pas le cas avec «Paradise» car c’est de l’hypnotic. Le petit Dave nous embarque dans son monde sans qu’on offre la moindre résistance. Il s’aide au synthé et connaît le secret des antiques dynamiques. Il fait de nous ce qu’il veut. Il revient ensuite au heavy rock avec «Upon Arrival» et c’est reparti. Son riff engloutit tout, et lui avec. Il crie dans le chaos des vagues mais on ne l’entend quasiment plus. Voilà encore une énormité, un cut qui nous dépasse et nous domine, comme jadis les cathédrales et leurs gargouilles dominaient le bas peuple pour le maintenir dans la crainte du jugement dernier. Dans cet épouvantable chaos, le petit Dave fait entrer un sableur et il prend un solo qui s’auto-dévore d’extase. On voit tout exploser en plein vol. On peut dire qu’on ne s’ennuie pas en sa compagnie. Quand on rencontre ces gens-là, on ne se doute jamais de ce qu’ils sont. On n’a absolument aucune notion de leur envergure. Chez eux, tout est tellement extrapolé qu’on ferait parfois mieux de se taire. Mais attention, ce fabuleux album n’est pas fini. Il faut écouter «Monument» si on ne veut pas mourir idiot. On y entend des trompettes coincées à la poterne des badernes. Avec cette supra-présence du son, on réalise soudain que le petit Dave s’adresse directement à l’intellect. Et ça repart au gros riff cavaleur pour le morceau titre de l’album qui ferme la marche du cortège. Le petit Dave y chante le texte imprimé à l’intérieur de la pochette, un sacré texte : «No truth. No freedom. Always consuming forever wasting. Channel changing, never satisfied. Over populated. Now is the time, sound the cry. Mother earth, human kind. No balance, never satisfied. No value, no change. Always the same. All the hatred & resistance. The hypocrisy of nations. All the glory, all the gold. All the slaves been bought & sold. Mother earth, human kind. No balance, bleeding dry.» En quelques lignes, le petit Dave dit toute la décadence du monde moderne. Voilà sa vraie puissance. Vous ne croiserez pas beaucoup de disques qui ont cette résonance.

«Frying On This Rock» s’ouvre sur un cut étrange : «Pads Of Light». Un cut répétitif, voire même obtus et têtu, aussi borné qu’un adjudant de la légion. Comme d’usage, le petit Dave s’invente un espace dans lequel il circule. Comme l’indique son titre, «Robot Stomp» est un stomp basé sur l’hypnose de l’ange Gabriel. Effet saisissant. On pourrait même qualifier ça d’interminable réussite. Le beat semble se tordre la cheville à chaque pas, ce qui fait la force de sa particularité. Finalement, on se sent bien dans l’univers du petit Dave. Il s’y passe toujours des choses très intéressantes. Dans ce cas précis, il s’amuse tout bêtement à battre le record mondial de la transe hypnotique. Tout aussi passionnant, son «You Dream You See», un spécimen de heavy doom monté sur une bassline à ressorts. Voilà encore un archétype voûté digne des grands architectes du Bosphore. Et comme si ça ne suffisait pas, notre petit Dave part en solo dans la mélasse. Il pourrait prétendre au trône de roi du cyber-Stoner, laissé vacant par Dave Wyndorf de Monster Magnet. Mais sa réserve naturelle l’en empêchera et il continuera d’enregistrer ses petits disques sans prétention.
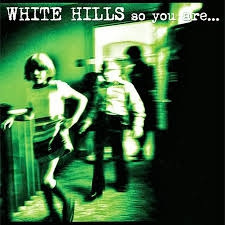
Sur leur avant-dernier album «White Hills. So You Are... So You’ll Be» se niche une merveille extraordinaire : «Forever In Space (Enlightened)». Voilà encore un cut hors normes, monté sur un beat profond, un cut chargé de tout le mystère de la voie lactée et des ésotérismes soniques du monde entier, un cut secoué d’assauts féroces, des diableries ingérables, d’élans vertigineux et des glissades de wha-wha à l’orient de l’épaule d’Orion, par delà la porte de Tannhäuser. Le petit Dave s’y entend pour créer les conditions d’espaces secoués d’aggravations larvées. S’il terrifie un peu, c’est qu’il ouvre une sorte d’infini. On craindrait presque de pouvoir se perdre dans ses disques. C’est sur cet album qu’on peut entendre «So You Are So You’ll be» joué en concert, une belle machine digne d’Hawkwind, percluse de séquences, comme si Dikmick œuvrait dans l’ombre. Il semble que le petit Dave soit sous perfusion de macédoines de son, pendant qu’Ego tient bon la rampe du beat. Et comme toujours, il entre dans le lard de son cut en prenant un solo d’une violence infâme.
Signé : Cazengler, white (ass)hole
White Hills. Au 106, Rouen. 2 mai 2015
White Hills. Glitter Glamour Atrocity. White Hills Music 2007
White Hills. Heads On Fire. Rocket Recordings 2007
White Hills. Abstractions And Mutations. White Hills Music 2007
White Hills. White Hills. Thrill Jockey 2010
White Hills. H-p1. Thrill Jockey 2011
White Hills. Frying On This Rock. Thrill Jockey 2012
White Hills. So You Are... So You’ll Be. Thrill Jockey 2013
White Hills. Walks For Motorists. Thrill Jockey 2015
02 / 10 / 15 – MOISSY-CRAMAYEL
LES DIX-HUIT MARCHES
HELL OF A RIDE / SCORES
FALLEN EIGHT

Pas les Trente-neuf Marches de John Buchan, diaboliquement mis en scène par Alfred Hitchckock, quoique pour comprendre la signification occulte de ce roman, vaut mieux se reporter à l'article d'isiaque dévoilement écrit par Jean Parvulesco, seulement les Dix-huit. Mais un nom qui sied à merveille pour une salle de spectacle spécialisée dans le rock-métal qui tue. Au moins les oreilles. Me suis retrouvé tout seul, lorsque j'ai annoncé que le soir-même j'allais écouter du hard. Etrange ce dégoût dont est victime le rock dur. En les années soixante-dix les head-bangers avaient déjà mauvaise réputation. Passaient pour les beaufs de la famille rock. Des bourrins étanches à toute sophistication, au cerveau aussi mou qu'une éponge à bière. Le temps à passé, le hard s'est transformé en métal, mais je connais beaucoup de rockers purs et durs qui ne mettraient jamais, au grand jamais, un seul de leurs deux pieds, au Hellfest. A croire qu'ils craignent de se retrouver en Enfer, en plein milieu d'un pandémonium de démons assassins. Alors que l'assistance de tous les concerts du genre auxquels j'ai assistés, était particulièrement policée et respectueuse. Certes si vous vous fiez à la meurtrière thématique des inscriptions et dessins arborés sur les t-shirts – sang, mort, vitesse, violence - vous regrettez de ne pas avoir précautionneusement pris une assurance-vie. C'est décevant, celles et ceux qui exhibent si fièrement leurs oripeaux mortuaires sur leur poitrines ne sont ni des goules échappées des cimetières et affamées de chair fraîche ni des zombies en quête de prosélytisme carnassier, simplement des fans avides d'échanges et d'informations.

Doit y avoir une alerte à la pollution nucléaire car Moissy est désertique. Suis bien rue de Lugny, devant la ferme éponyme, mais à part trois voitures stationnées, pas un bruit dans le quartier. L'escalier aux dix-huit marches est bien là, perdu au fond d'une cour coincée entre plusieurs bâtiments chichement éclairée. Une cohorte de lycéens grillent une dernière cigarette avant d'entreprendre l'escalade. Prix abordables : cinq euros l'entrée pour trois groupes, et tarif réduit pour les abonnés. Accueil souriant. Méfiez-vous cependant, c'est la dix-neuvième marche qui est mortelle. Juste à la porte d'entrée, un mini-relèvement de trois centimètres sur laquelle un client sur deux trébuche avec une métronomique régularité. L'intérieur est surprenant. Vu la grandeur de la bâtisse vous pensez déboucher dans un hall de gare. Non, une pièce carrée, point exigüe, mais pas vraiment immense, un grand bar mais une scène en coin d'autant plus juste que la moitié d'un des murs attenants est occupée par trois énormes et mastocs tonneaux de chantier qui ne servent pas à grand-chose.
FALLEN EIGHT

Lumière éteinte. Silence, vous entendriez un char d'assaut manœuvrer. Ambiance romantique. Au sens primal du vocable : sauvage et désolé. Déserté de toute petitesse humaine. Le batteur est tout seul dans le noir à compter ses baguettes. Belle musique, majestuoso agitato, aurait écrit Beethoven sur le support. Et puis c'est la déchirure. Trois guitare sur scènes et Clément au micro. La vague se gonfle et déferle sur vous. Du rentre dedans, avec un arrière-fond lyrique et symphonique. L'ombre du kraken qui se profile dans l'écume mais qui ne sort jamais tout à fait de l'okeanos. Fallen Eight c'est le porte-clef du bonheur qui est tombé dans l'eau saumâtre du désespoir. Plus que de la musique. Moins qu'un film. Des images mentales obsédantes qui se forment au fond de vous. Comme des tests de Rorschach multicolores. Mais sur la pente descendante du soleil qui se noie dans les profondeurs marines. Bien fou qui croira en sa résurrection. Si ce n'est la créature chanteuse, le batracien du rivage qui crie et screame l'infinie solitude des rendez-vous manqués.

Les guitares dessinent les séquences. Une musique mouvante déposés par vastes aplats ponctués des breaks furieux de la batterie. Vous connaissez le scénario, c'est toujours le même crépuscule, mais à chaque fois vous vous laissez submerger par l'émotion. Bobine de film qui déroule ses paysages. Des formes et des couleurs, Fallen Eight refuse l'abstraction. A part que nous sommes sur un sempiternel générique de fin, les héros ont disparu, les dieux sont morts et les hommes des quantités négligeables quand on les compare à la beauté granitique des stèles qui exhalent les remembrances des cauchemars emprisonnés. Fallen Eight restitue le phantasme de notre viduité, en accentue les contours avec une évanescente précision. Nous ne sommes plus que des filigranes invisibles sur les eaux mouvantes de la fin tempétueuse du monde. Reborn, Worst Nightmare, Final Shot, Alive, les titres sont des invitations à mourir et à vivre comme si notre existence se situait dans l'intermittence de ces limites trouées.

Dernier morceau. Trente minutes, montre en main. Nous voici tirés de notre torpeur germinative. Salves d'applaudissements approbateurs. S'esquivent trop vite. Nous étions si bien dans nos cercueils de survie poétique.
INTERMEDE
Les suivants n'auront pas besoin de chauffer la salle, une véritable étuve, la scène n'est pas grande, mais question lumières les spots s'entrecroisent de partout. Si du côté des pôles la banquise fond, c'est sûrement par la faute des Dix-huit Marches. En tous cas ici, les ours de métal féroce se suivent et ne se ressemblent pas, après le métalcore de Fallen Eight, voici le rock cinglant de Scores.
SCORES

Les Scores sont devenus un groupe. L'étaient déjà, oui. Mais un jeune groupe. Ce qui ne veut pas dire un groupe de jeunes. Ont dix-huit ans certes, tournent depuis trois ans, mais dans le rock il y des groupes de potes qui affichent allègrement pour chacun de leurs membres une cinquantaine bien tassée, mais ils ne dépasseront jamais l'enthousiasme juvénile de beaucoup de ces combos de lycée, qui font du rock avec la même hargne que certains faisaient de la mobylette à la fin des années cinquante. L'arrive un moment, où il faut grandir, montrer que l'on passe au stade des choses sérieuses. Des changements imperceptibles qui se succèdent, mais à un moment ou à un autre, il faut que la différence s'entende.

Des signes qui ne trompent pas. N'ont jamais si bien joué ensemble, font attention à l'un ou l'autre, s'attendent, se respectent, recherchent la cohérence d'un son, chaque partie au service de la production du tout. Ça roule et tourneboule dès Shadows, pas une ombre en trop, le morceau glisse comme la boule de roche sans aspérité de la séquence qui débute Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Tout est au point. Filent droit vers la sortie. S'en sortent mieux que vivants, Escaped nous le confirme. N'y a que Ben qui doit modérer son jeu de micro tournoyant sur cette scène hélas, manifestement trop petite pour de tels mouvements.

L'ensemble sonne moins hard, moins d'effet de doom à la basse et une rythmique beaucoup plus rock and roll et rentre dedans. Scores arrache sec, au coeur de la cible, vite expédié, excellemment reçu par le public qui acclame. Free et Road passent comme des couteaux qui vous traversent le corps. Découpe franche et brutale. Vous coupent en morceaux et vous êtes obligés de dire merci. Et d'en redemander. Mais ils ont encore une arme secrète. Une reprise. L'annoncent fièrement en disant que d'habitude ils n'en font pas. Cela sentirait-il le vieux sabre rouillée de cavalerie. Vue la vélocité du show, on penserait à une reprise de derrière les fagots d'AC / DC. En plein dans le mille, de l'erreur. Visent plus bas. Je parle chronologiquement. A la source même du Heavy Metal. Born To Be Wild de Steppenwolf. Attention, les petits, c'est du lourd. La bêbête mord encore quand on ne sait pas s'y prendre. Du coup j'en avais oublié qu'ils étaient des grands. Ont soufflé toute la salle. Une reprise magistrale. Un de ces charivari, lorsqu'ils ont terminé. Un truc à scotcher un régiment d'highlanders. Phénoménal. J'en avais jamais entendu une version aussi phénoménale depuis, depuis – laissez-moi me souvenir – depuis, depuis Steppenwolf. Je vous parle pas du gars survolté qui fonce sur la scène en hurlant tout émotionné « Putain, j'avais quatorze ans quand j'écoutais çà ! » Rien qu'à sa dégaine, l'on devine le vieux briscard qui s'est farci toutes les campagnes du hardrock depuis le tout début.
Leur reste un dernier morceau. Ils assènent leur plus amer Hammer, mais c'est déjà, adjugé et revendu. Au prix fort. Et tout le monde est satisfait de son acquisition. Le genre de souvenir brûlant que l'on emportera avec soi pour visiter l'autre monde.
ENTRACTE 2
C'est étrange, le public a changé. L'est vingt-trois heures. Moins de jeunes gens et un peu plus d'adultes avec enfants. Le hard serait-il en train de devenir un spectacle familial ? Pourtant avec le matos qui se trimballe sur la scène, l'on devine que les tympans de nos charmantes têtes blondes risquent d'en prendre plein les feuilles. Sans doute une méthode d'éducation indienne : laissons l'enfançon toucher le sein de sa mère et le feu, il s'en souviendra, toute sa vie. Expériences marquantes et initiatrices, que l'on essaie de renouveler toute son existence. Comme je ne connais rien de plus brûlant que la chair humaine et le rock and roll, je me dis que c'est une vraisemblablement une bonne praxix de perpétuation des fans. Arrêtons de le mettre cette-fois-ci en plein dans L'Emile du dénommé Rousseau, les Hell of Fire sont sur scène.
HELL OF A RIDE
C'est juste un mensonge. Plutôt à côté. Le batteur tapi dans sa batterie, les trois guitares qui se font attendre. Arrivent enfin. Rien qu'aux quatre riffs qu'ils ont envoyé durant l'installation, pour vérifier que les fers étaient bien branchés, l'on a compris que l'on n'a pas affaire à des adeptes du son minimal. Au-dessous de la trentaine, l'on n'attend plus que Furious Djej le chanteur. Suis déçu. Je m'attendais à une explosion atomique. Et j'ai droit à du hard somme toute costaud mais tout bien pesé, mélodique. Le lion qui rugit dans l'amphithéâtre. C'est très bien. Ouvre la gueule, montre ses crocs acérés, secoue sa crinière, vous jette des regards mauvais à vous faire faire dans votre toge, OK, totalement d'accord. Mais si au lieu de se jeter sur le premier chrétien qui passe et de le déchirer à belles dents en inondant de sang vermeil le sable de l'arène, s'en va en trottinant gaiement devant la tribune impériale du public, se coucher de tout son long, et entamer un petit roupillon, je vous le dis tout de go, ça ne plaît pas. La chevauchée du diable, moi faut pas m'en promettre. Me faut du meurtre, du crime, de l'innocence bafouée, de l'homicide, de l'assassinat, toutes ces mignonnes délicatesses qui rendent la vie si agréable. Sinon, je crois qu'il y avait une conférence sur la danse de salon au dix-huitième siècle à Melun, ce soir. J'ai dû me tromper d'adresse.

Mais non ! Je vous rassure. Le Furious vient de terminer son petit somme. Ce n'est plus un lion, c'est le Félin Géant de Rosny l'Aîné qui s'est lancé à l'assaut des tribus de voleurs de feu, griffes dehors et dentitions sanglantes. La bestiole bestiale s'est réveillée et le festival des horreurs sans nom débute. Normalement, un chanteur de hard qui se respecte commence à avoir comme un léger enrouement à la fin du set. C'est normal, c'est humain. Le Furious, il est inhumain, Ca s'améliore à chaque morceau. Les deux premiers titres High on Octane et At the Drive-in c'étaient pour faire chauffer la chaudière, dès le troisième elle a explosé et il pleuvra des morceaux de métal toute l'heure suivante. De belles ferrailles tranchantes à souhait qui vous chagrinent le groin et vous ramollissent la moelle épinière. Derrière ça tricote à tout berzingue. Un set carré mais avec les coins qui vous labourent comme des étoiles de ninjas. Remercient les 18 Marches qui continuent leur programmation indépendante en précisant qu'il y a beaucoup de salles qui ferment faute de subventions non poursuivies...

Le set se termine. Plus beaucoup de monde dans la salle. Retrouverai les absents devant la porte en train de tirer la clope et de papoter. A croire qu'ils voient des concerts de rock tous les jours...

Je n'ai pas résisté. J'ai pris leur disque – FAST AS LIGHTNING sans hésiter. Avec un peu de retard puisque le prochain est prévu pour ce mois d'octobre. J'ai pigé le pourquoi des deux premiers morceaux. Nous font un double cadeau. Huit titres électriques. La même chose que le concert. Enregistré à Nancy. La patrie de Blondstone ( z'ont pas l'air d'uriner dans le gasoil dans le patelin, va falloir y faire une virée ). Punchy, équilibré. Réfléchi. Posé. Le tout n'est pas d'empiler les tranches de mortadelle sur la galette. Faut quelqu'un qui sache orienter et profiler ce qu'il y a de mieux pour le groupe. Et puis reprise de sept morceaux en acoustique. Enfin comprenez-moi, de l'acoustique sauvage. Pas tout à fait le Blues Oyster Cult à la flûte de Pan, ou Metallica à la harpe hongroise, si vous entrevoyez ce que je veux dire.
Damie Chad.
( Photos - superbes - de Fallen Eight et Scores de Organikmusic Asso, anciennes photos de Hell Of A Ride prises sur La Grosse Radio – à visiter )
MONTERAU-FAULT-YONNE
LE BE BOP – 03 / 10 / 15
THE LIZARD QUEEN
-
Allongez-vous, cher Damie, et dites-moi ce qui ne va pas ?
-
C'est la nuit, docteur Freudy, je rêve !
-
Hum ! Hum ! Très significatif ! Mais de quoi au juste ?
-
C'est étrange, vous n'allez pas me croire, mais voilà, je suis sur une plage...
-
Avec des cocotiers et Keith Richards qui batifole sur la cime du plus grand d'entre eux, comme dans votre dernier cauchemar ?
-
Pas du tout, doctor Freudy, c'est moi qui suis tout en haut de l'arbre et...
-
Simple complexe d'auto-identification richardsien, très courant chez les rockers, cher Damie.
-
Je ne pense pas docteur, je suis bien en haut de l'arbre, mais je ne suis plus moi, je suis un lézard.
-
Hum ! Hum ! Très intéressant, un lézard arboricole, un anolis carolinensis séminolus, je présuppose.
-
Je ne sais pas doctor, le plus important d'après moi, c'est cette sensation de sur-puissance qui m'envahit, j'ai l'impression de dominer le monde, d'être le roi de l'univers, mais je vois que vous rédigez déjà une ordonnance, est-ce si grave ?
-
Je ne vous cacherai pas que vous êtes en danger, au bord du gouffre le plus profond. Je puis vous nommer le péril qui vous menace, c'est la solitude, en fait votre sentiment de sur-puissance c'est un simple effet de compensation, une sublimation du manque qui vous habite. Pour dire tout sans fioriture, sur votre arbre, tout seul, tout là-haut, vous vous ennuyez, comme un rat mort, ce qui est un comble pour un anolis carolinensis séminolus vivant, nous en convenons.
-
Mais que puis-je faire ?
-
Rassurez-vous, cher Damie, vous n'avez qu'à suivre cette prescription, qui vous coûtera la bagatelle de 528 euros dix sept centimes. Je ne vous fais pas payer la TVA, cher Damie, vous êtes mon plus fidèle client.
-
C'est très gentil doctor Freudy, mais je n'arrive pas à lire votre écriture.
-
C'est très facile, pour vous qui souffrez de solitude, je vous prescris une séance de thérapie, avec ma collègue The Lizard Queen, le cabinet médical se situe à Montereau, au Be Bop. Venez me voir pour le debriefing, dès le lendemain matin. Surtout, pas d'acte manqué, n'oubliez pas votre carnet de chèques.
-
Merci Doctor Freudy, vous êtes mon sauveur. Je vous adore.
-
En psychanalyse, on appelle cela le stade du transfert monétaire, cher Damie. A bientôt.
Voilà pourquoi, chers lecteurs, le soir-même je pénétrais dans le Be Bop de Montereau.
CONCERT
D'abord Cindy, dans sa robe indienne – pas les peaux-rouges criards chers à Jim Morrison - mais de l'Inde hiératique aux multiples divinités incantatoires. Le corps moulé dans son fourreau de fausse soie grège, les cheveux coupés très courts qui la font ressembler à Bessie Smith, lorsqu'elle se tourne de la large échancrure de sa robe, tatouée à même sa peau hâlée, vers le ciel, grimpe la cime d'un arbre exfolié, l'on aimerait être corbeau noir pour couvrir de notre aile d'ardoise le satiné de cette épaule dénudée. Et puis, corneille blanche sur l'épaule d'albâtre de Léa, afin de picorer la blondeur rieuse de ses mèches.
C'est elle qui donne le la du départ, de trois petites notes répétées sans fin sur le clavier. Uppercut dans la mâchoire, Cid chante. Dès la première syllabe, elle s'installe devant, par-dessus les instruments qui font pourtant un boucan de tous les diables. La musique des Doors a de toujours été fortement alcoolisée. Le patron du pub a précautionneusement refermé la porte, nous serons les seuls à bénéficier du tapage nocturne. Le mot important, c'est celui de la nuit. Play loud, c'est le corollaire obligatoire. Avantages collatéraux. Comme l'on dit en temps de guerre. Le rock est une chose, la poésie une autre, tout aussi monstrueuse. Les Doors ont croisé les deux. Les docteurs Moreau de l'île du rock and roll ont créé un drôle d'amphibien, un iguane à la chair savoureuse mais épicée au sang de dragon. C'est comme le dahu, ça se chasse à minuit. Mais pas du tout rigolo. Séminal et ruisselant de foutre. Pour le plaisir, c'est celui de la peur, des terreurs lovecraftiennes, de la menace qui rôde autour de vous et qui attend que vous fassiez le premier pas. Celui qui lui permettra de vous happer et de vous faire passer sur l'autre rive. Break on through to the other side, attention, personne ne sortira d'ici vivant. Derrière Léa, placé de biais, il y a Tristan, tranquille, à la basse. Souriant. Hamlet et le croque-mort réunis en un seul personnage. L'envoie de grands coups de basse comme s'il ramait d'ahan, profondément, le nocher qui vous permet de traverser l'Achéron sur sa barque funèbre. C'est lui qui tamise la lumière crépusculaire qui turn out the light, qui vous emporte, insensible au drame qui se joue.
Jull est sur sa droite, encore plus au fond. Dirige la course, infléchit et ponctue. Décide et dessine les épisodes. La musique des Doors est un long fleuve impétueux. Naufrage à chaque remous, le fond du gouffre, et les crêtes écumantes. Du boulot pour le batteur qui induit tous les chavirages, violents et heurtés. Rebondissements et ricochets à l'infini. Ignore les temps calmes, l'on y sent si fort poindre l'apocalypse annoncée que l'on ne peut s'y fier en toute quiétude. Croisières sur les récifs, je deviens toc-toc sur les étocs. La batterie détonne sur les collines de la folie. Les lézards sont partout et je suis à double-frappe, une fois moi, une fois eux.

Cid récitatif. Ele chante comme si elle méditait à haute voix. Une voie appienne revenue de l'autre côté des tombeaux. Pénètre au cœur des cités mortes. De bronze et d'airain, sépulcrale, qui sonne le glas de nos espérances et qui s'installe en nous comme la nielle des épis de blé promis à la grande faucheuse. Parfois elle crie, elle hurle et l'on se sent comme ligoté au fond d'un puits avec le pendule du conte de Poe qui descend, descend, descend, infiniment, pour nous couper en deux. Parfois elle danse, étrangement cassée en deux comme un angle droit qui n'arriverait pas à se plier jusqu'au bout, comme un cri de souffrance échappée de son corps aux lèvres muettes. L'on peut parler de possession, d'un esprit vaudou qui s'emparerait d'elle et qui ne parvient pas à la maîtriser, elle la marionnette qui tire les fils et qui ne s'en laisse pas conter.

Léa est à ses côtés, fleur de lumière tout près de sa sœur d'ombre. Tant que ses doigts effleurent le clavier, tant que la musique ne s'arrête, même si elle sourdine de loin - comme du fond d'une boîte, lorsque l'ouragan de la voix de Cid la submerge - et à plus forte raison lorsque c'est elle qui mène le tumulte de l'instrumentation qui se déploie majestueusement – ô les lointains gospelliens du rock and roll des Doors – là alors la Léa d'or pallide est la sérénité de la lampe sur le rebord de la fenêtre dans la tempête, et en même temps la tempête mugissante autour de la luciole de la vie qui ne s'éteint jamais. Le sourire de l'ange et la larme du démon.

Si j'étais Alex, avec les quatre autres je me sentirais de trop. J'éteindrais l'ampli et je rangerais ma guitare, parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Prennent toute la place. Mais comme il n'est pas le triste scripteur de cet article, il reste, et se taille la part du lion. Nous met les points sur le i dès le deuxième morceau. Quand il s'agit de rock and roll, un guitariste digne de ce nom, est toujours à sa place. L'est ici comme chez lui, comme dans sa maison, en franglais l'on dirait comme dans Son House, et tout de suite comme son prestigieux devancier il joue la guitare derrière la tête et puis avec les dents. Du genre, vous avez vu, maintenant vous allez entendre. Je ne compte plus les infidélités que j'ai commises envers les deux belles lézardes sur le devant de la scène. Totalement fasciné par le jeu de leur guitariste. Alex April est un grand. Si j'étais Dieu, je l'aurais fait naître trente ans avant pour qu'il puisse gratouiller le dimanche aprés-midi ( en semaine aussi ) chez des arsouilles à la Cream ou à la Yardbirds. Bien sûr, il aura son moment de gloire sur Spanish Caravan, mais je serais tenté de dire que ça ne compte pas, encore que ce parfum de country et cette descente électric blues en plein délire flamenco, je n'avais jamais entendu avec un brio so perfect, mais à la limite, je peux l'imaginer, ou en rêver. Non, là où il m'a cloué au sol, c'est sur les interventions, un espace de six secondes dans le flux montant des camarades et plaf, il vous glisse une impro de trois notes, un gratouillis subliminal, une descente de manche sur des ailes de colombes, et hop, il change la physionomie du morceau. Le tire à lui, en fait son chef d'oeuvre personnel, pour recommencer vingt secondes plus tard. Me demande pourquoi il achète des guitares avec un manche, fait tant de choses tout en bas à ras de caisse, qu'on doit les lui offrir en option gratuite.
Je ne suis pas le seul à avoir flasché, entre les deux sets un jeune lycéen – blouson de cuir, crête banane du meilleur look, badges flashy sur le perfect, vient le voir, l'a tout compris, l'ampli à lampe, les guitares, les pédales le son, et puis cette constatation admirative d'une rare intelligence : « Ce que j'aime chez toi, c'est que tu as ton propre style ! ». Que voulez-vous que j'ajoute de plus ?
Je vais tout de même essayer : The Lizard Queen, un groupe qui pue le rock and roll.

THE LIZARD END
Personne n'a répondu quand j'ai frappé à la porte, alors je suis rentré : la pièce était déserte. Le Doctor Freudy n'était manifestement pas là. J'ai entendu une espèce de crissement sur le sous-main de cuir vert du bureau. J'ai dû y regarder à deux fois, c'était bien un petit anolis carolinensis séminolus qui dardait sur moi ses pupilles angoissées. J'ai déposé mes 528 euros dix sept centimes, doucement à côté de lui et je suis reparti. Avant de refermer la lourde j'ai fixé ses yeux vairons et lui ai murmuré « I can't do anything for you ! » et je lui ai tourné le dos.
Le cœur léger, j'étais enfin guéri. Ma psychanalyse était finie.
Damie Chad.
( Photos de la reine lézarde en tournée en Bretagne )
PANTHERES NOIRES
HISTOIRE DU
BLACK PANTHER PARTY
TOM VAN EERSEL
( Collection : Dans le feu de l'action )
( Editions : L'ECHAPEE / 2007 )
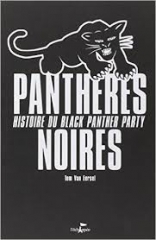
Un petit livre. Mais l'essentiel. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la manière de se dépêtrer de ce monde, et que vous savez déjà depuis longtemps. Depuis que vous avez mis un seul – c'est amplement suffisant – de vos neurones en mode action pensée. Il n'y a pas trente-six solutions. C'est plus simple de faire semblant de chercher, de mimer le désespoir de celui qui n'entrevoit pas la porte de sortie, de se perdre exprès en mille fausses problématiques, d'être volontairement sempiternellement à côté de la plaque. D'égout, celle qui débouche sur la grande évasion. Mais c'est difficile et dangereux. Faut passer par un méchant souterrain. Faut ramper dans les sous-sols, se vautrer dans la fange, oublier son petit confort étriqué, on risque d'y laisser un peu de son sang, et beaucoup de sa vie.
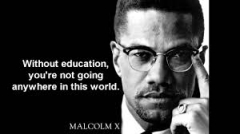
Remarquez, ce n'est pas facile. Pour les nègres aux Etats Unis – ce grand pays démocratique, leur a fallu plus d'un siècle. Encore je suis gentil, je ne compte qu'à partir de la guerre de Sécession. Cent longues années pour pouvoir se regarder chaque matin dans la glace, et se dire, cou-cou, c'est moi ! C'est fou comme je ne suis pas mal. Je ne suis pas affreux comme je l'ai cru si longtemps, je suis afro-américain. Black is beautiful ! N'empêche que ce sont les white peoples qui leur ont filé la pêche et la méthode. Ont commencé par faire le ménage chez eux en renvoyant ad patres le président Kenedy un peu trop scolairement négrophile, puis se sont occupés de la grande lessive, celle qui lave les noirs plus blanc que les blancs, Malcom X en 1965, Martin Luther King en 1968.
L'assassinat de Martin a balayé les doutes des noirs, les limites du réformisme étaient désormais nettement soulignées au stylo rouge ( sang ). Le rêve de l'apôtre de la non-violence fracassé par les balles des tueurs. L'a fallu entrevoir l'adoption du plan B, celui du passage à l'acte, la transgression démocratique suprême, l'emploi de la violence en politique. Contre les flics à la matraque allègrement meurtrière, contre la justice expéditive pourvoyeuse des pénitenciers ( dont les portes se referment sur vous et c'est là que vous finissez votre vie ), une seule solution : la relecture des évènements récents s'imposaient. La pensée de Malcom X montrait le bon chemin. Les émeutes de Watts enseignaient la méthode.

Nous reviendrons prochainement sur Malcom X dont l'itinéraire intellectuel et religieux nous paraît d'une actualité qui va beaucoup plus loin que sa vision de la cause noire. Les dix jours qui embrasèrent les quartiers noirs et pauvres de Los Angeles, posèrent la problématique de la lutte révolutionnaire des noirs américains dans toutes ses contradictions : émeutes anti-racistes ou luttes de classes ? Ce qui est sûr, c'est que depuis le début des années soixante, le combat des noirs se radicalisait. Stokely Carmikael en est l'exemple le plus frappant, passa sans effort de la direction du SNCC ( Student Non-Violent Coordinating Committee ) à l'état major du Black Panther Party créé par Bobby Seale et Huey P. Newton. Le théoricien du Black Power – comme par hasard mari de Miriam Makeba - connaissait une évolution qui le mena du refus de collaboration de classe – cette espèce d'entrisme des intellectuels noirs dans les élites blanches – à l'auto-organisation des populations défavorisées des ghettos.

C'est que le Black Panter Party ne tourna pas trente-trois fois sa cuillère de bois blanc dans sa bouche avant d'édicter ses dix commandements. Les militants du BPP exhibant fièrement leurs armes - conformément à la législation américaine - se mirent à rappeler de façon verbale et policée, et néanmoins fort agressive, les prérogatives du citoyen noir à chacune de leurs interventions. De simples rapports à l'ordre, qui parfois se terminaient en bousculades, voire en fusillades... Mais plus que ces voies de faits sur la voie publique ce fut la nouvelle arrogance des militants qui frappa les opinions. Les noirs ne quémandaient plus, ne s'excusaient plus, ne demandaient plus en levant timidement le doigt le respect de leurs droits, ils les revendiquaient à haute voix, argumentaient en connaissance de cause, désormais ils affirmaient et ils imposaient leur juste vision des choses.

Le BPP ne se contentait pas de jouer les fiers-à-bras dans les rues, ils organisaient les masses, assuraient des cours du soir, faisaient du soutien scolaire, assuraient le petit-déjeuner des enfants avant l'école, revendiquaient la culture noire, ses origines africaines, l'importance primordiale de la main d'œuvre servile dans l'accumulation des capitaux aux USA... Le rôle des paratonnerres est bien d'attirer la foudre. Le BPP reçut l'adhésion de milliers de jeunes noirs enthousiasmés par leur manière de tenir la dragée haute aux blancs. Parmi eux, se glissèrent aussi personnages véreux et indésirables, malfrats, proxénètes, bandits, toute une faune indésirable qui vint parasiter ses actions. Le BPP s'en débarrassait mais ces illégalistes de la mauvaise main ne furent pas sans influence sur une certaine dérive militaro-aventureuse chez de jeunes militants... C'est que le FBI ne chômait pas. Le BPP devint très vite leur bête noire. Les agents du FBI ne se contentèrent pas de rédiger les rapports pour avertir les autorités politiques du danger. Aux techniques préventives d'intimidation, de pression, de chantage sur les militants les plus fragiles, ils ajoutèrent les bonnes vieilles méthodes de d'infiltration et de la division idéologique. Accentuèrent les débats théoriques entre les jusqu'aux-boutistes de l'action militaire et les partisans des actions d'autonomie éducative de fond, privilégiant la ligne illégale tombant sous le couperet provocatif de la loi...

Mais le jour où le BPP franchit la ligne rouge – celle qui permet à un groupuscule d'agitateurs d'accéder au stade de masse organisée, il s'agissait alors de créer une alliance politique entre les gangs des cités et le BPP – le FBI passa à l'élimination physique et directe des militants les plus dangereux et offensifs. Ne prenez pas les policiers pour des brutes sanguinaires, savent être aussi rusés que des sioux sur le sentier de la guerre, cassèrent aussi le BPP de l'intérieur en envoyant de faux courriers aux principaux responsables du mouvement de la part de leurs alter-egos... Rien de mieux qu'une bonne guerre des chefs ( qui en l' occurrence firent preuve d'une énorme naïveté ) pour dégoûter les militants de base. Né en 1966, le BPP n'était plus qu'une coquille vide en 1973...

Certains diront que l'histoire du Black Panter Party est d'ordre strictement politique et n'a rien à voir avec la musique. Les choses ne sont pas aussi évidentes. La colère noire sous-jacente et souterraine qui irradie le blues, se libère dans le rhythm and blues, et trouve une porte de sortie, par derrière – entrouverte par les adolescents des anciens maîtres - pour exploser dans le rock and roll, en quelque sorte récupéré et même annexé par les petits blancs, ceux-là mêmes qui plus tard en Angleterre reviendront aux sources du blues – est désormais retombée. Le livre de Tom Van Eersel court en ses dernières pages jusqu'à notre époque. La révolte s'est enfuie des ghettos, a laissé la place à la drogue ( cette gangrène des gangs ) et aux illusoires mirages des paillettes dorées du showbiz. Si le rock ronronne si fort aujourd'hui, s'il se mord la queue et tourne en rond sur son passé, c'est qu'il n'est plus ensemencé par la fertilité de la black music fourvoyée dans la dance-music... Le rock est une musique de révolte et il faut bien avouer que depuis trente ans les couches populaires noires et blanches se sont assoupies. Sur leurs lauriers. Maintenant elles se retrouvent un peu chauves, car l'idéologie libérale en ont arraché toutes les feuilles, une par une. Et qu'il n'en reste plus.

Cette brève Histoire du Black Panther Party – d'une clarté illuminante - se termine sur un triste constat. Depuis 1966, rien n'a vraiment changé. Les noirs pauvres sont comme les blancs pauvres, deviennent de plus en plus pauvres. D'ailleurs la misère galope encore plus vite dans les têtes. Socialement, la situation empire. Musicalement aussi. Serait peut-être temps de se réveiller. Et de mettre le feu, aux guitares. Et ailleurs aussi.
Damie Chad.
15:38 | Lien permanent | Commentaires (0)
30/09/2015
KR'TNT ! ¤ 249 : STOMPIN' RIFFRAFFS / BRITISH ROCK / JALLIES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 249
A ROCK LIT PRODUCTION
01 / 10 / 2015
|
STOMPIN' RIFFRAFFS / BRITISH ROCK / JALLIES |
BETHUNE RETRO / 29 & 30 Août 2015
STOMPIN' RIFFRAFFS

LE RAFFUT DES RIFFFRAFFS

On ne savait pas encore qu’il s’appelait Nao, mais on voyait bien qu’il était japonais. Petit et bien typé. Et comme il avait cousu un logo Wild Records au dos de son blouson de jean, il semblait logique d’en déduire qu’il jouait dans les Stompin’ Riffraffs, le groupe de rockab japonais programmé à Béthune Rétro. Il se tenait tout près, à la barrière, pour voir jouer ses collègues les Desperados, eux aussi sur Wild. Comme tous ceux qui se trouvaient agglutinés à l’avant, il semblait vraiment apprécier la bonne petite pétaudière des Desperados, et lui peut-être plus encore, car il rigolait. Il semblait vivre un moment tellement intense qu’il l’exprimait naturellement par la rigolade, comme le font sur scène Steve Diggles des Buzzcocks ou encore Kyle Rose Stokes, la bassiste intérimaire des Love Me Nots. On ne voit pas souvent les gens se marrer dans les concerts. C’est dommage, car on y va principalement pour s’amuser. Aller au concert, ou aller en répète, c’est la même chose que d’aller au bac à sable quand on a quatre ans.

Les organisateurs de Béthune Rétro 2015 n’avaient pas mis le paquet sur l’affiche, comme lors les éditons précédentes. Pas de grands noms, mais une multitude de petits groupes piquaient la curiosité, et du coup ça redevenait une affiche alléchante. Ça nous convenait parfaitement, et petite cerise sur le gâteau, il ne pleuvait pas. Il régnait cette sorte de petite canicule continentale qui pousse hélas les pauvres hères desséchés dans les bras de Bacchus.

Il fallut attendre le soir pour voir jouer les Stompin’ Riffraffs. On peut bien l’avouer, on ne savait vraiment pas à quoi s’attendre. Du wild rockab de pacotille ? Du hillbilly asiatique au gingembre ? Du cross-genre à la Delta Bombers ? Du bombast au soleil levant ? De la contrefaçon bien ficelée ? Du boppin’ Guitar Wolf ? Du groove cabaretier de Macao ? De l’exotica de caboulot taiwanais ? On se perdait en conjectures lorsque soudain Nao parut sur scène. Il portait un costume noir à col en lamé. Sa mèche noire lui dégringolait sur le visage. De toute évidence, ce petit mec avait une classe folle. Il tenait une sorte de Jaguar noire et bien entendu, il souriait. Et puis les autres Riffraffs sont arrivées, trois petites japonaises qui portaient des robes courtes en lamé or et des masques noirs. Et bien entendu, elles souriaient. Ce groupe dégageait un lourd parfum d’étrangeté juvénile. Mais dès qu’ils ont commencé à jouer, les choses ont viré à l’énormité. Seuls les Japonais sont capables de transcender les genres d’une façon aussi radicale. Ils vont faire une seule chose dans leur vie, mais ils vont la faire à fond. Bien sûr, ça frise le cliché que d’asséner un truc pareil, mais c’est ce qu’on comprend quand on voit jouer des groupes comme Guitar Wolf ou Thee Michelle Gun Elephant. Ils sont dedans et pas dehors.

Et les mighty Riffraffs mirent leur set en route pour une petite heure de grand spectacle, taillant leur chemin dans un univers de rock exotico-fifties et fabuleusement dense. Nao est à la fois un chanteur excitant, un guitariste qui ne craint pas la mort et un showman hors du commun. Il a une façon terrible de lancer des regards au public, l’épaule relevée et la mèche dans la gueule, avec un sourire qui renvoie directement au génie de Mishima. Il y a quelque chose d’emblématique en lui. Il a cette aisance qu’on retrouve chez les pures rock stars. Il est aussi à l’aise sur scène que le furent en leurs temps respectifs Brian Jones ou David Bowie. On voit bien qu’il est habité par les démons du rock, ça ne fait aucun doute. Il sait se laisser tomber au sol pour partir en solo et se relever juste à temps pour choper le couplet au vol. Essayez, et vous verrez que ce n’est pas facile. Mais ce qui fait la puissance féerique du groupe, c’est la présence rigolarde et le jeu solide des trois rocking girls qui l’accompagnent. Elles ont souri du début à la fin du set, et il ne s’agissait pas du sourire niais qu’affichent les animateurs de jeux télévisés. Cette façon de sourire est l’expression d’une espèce de candeur qui n’appartient qu’aux Japonais. La plus spectaculaire des trois est Saori, la batteuse, perchée sur l’estrade. Elle développe un beat puissant qui se situe aux antipodes du tatapoum auquel nous ont habitués les autres girl-groups japonais. Saori bat le vrai beurre, elle barde son jeu d’élégantes relances et muscle son beat de base à la folie. Par sa classe de batteuse, elle évoque bien sûr l’implacable Doug Wray, le frère de Link. Cette fille, on la dévore des yeux. C’est toujours un plaisir capiteux que de voir jouer une vraie batteuse. Par sa niaque, elle évoque la fantastique batteuse des Magnetix. En plus, Saori sourit et là, on croit rêver. Ses deux copines font elles aussi le show. On avait repéré la petite bassiste dans le public qui assistait au set des Desperados. Très fine, pour ne pas dire plate, et très belle, elle allumait un peu, mais tout à fait involontairement, comme savent le faire les japonaises. Dans sa petite robe en lamé or, elle avait une classe épouvantable. Elle jouait au médiator sur une basse électrique et grattait bien ses gammes. Elle sortait un drive de basse incroyablement souple et vivace. Elle fournissait avec Saori la batteuse la texture d’une section rythmique exceptionnelle. Quelle équipe ! De l’autre côté jouait Miku sur un petit piano électrique, elle aussi explosée de rire sous son masque, vivante, fraîche, du style on est là pour déconner alors on explose tout ! Ces trois filles dégageaient autant d’énergie que Nao le petit prince du Rétro, et dans les moments de pure intensité, Miku quittait son clavier pour venir déconner au bord de la scène avec son theremin. Alors les choses se barraient en sucette, et on assistait à l’une de ces belles montées en température qui font la grandeur des sets, avec un Nao tombé au sol pour placer l’un de ces fulgurants solos dont il avait la secret. Ah si seulement tous les concerts de rock pouvaient être aussi joyeux et aussi dévoyés ! Leur set fut un sans faute. On nota au passage un cut qui ressemblait trait pour trait au «He’s Waiting» des Sonics.

Nao attaqua le dernier morceau en s’approchant du bord de la scène et soudain, il bascula dans le vide ! L’horreur ! Spalssshhh ! Il gisait sur le dos, avec sa guitare encore branchée. Il y eut un blanc de quelques secondes. Franchement, on le croyait mort. Il s’agissait d’une chute de plus de deux mètres sur du pavé à l’ancienne. Deux photographes s’approchèrent du corps à pas de loups. Soudain, Nao se redressa, comme ressuscité, jeta sa guitare sur scène et regagna le backstage par la droite de la scène, comme si de rien n’était. Il avait eu plus de chance que Dan Kroha qui s’était pété la cheville à l’Abordage, en sautant d’une scène haute de trente centimètres.

Il existe un album des Stompin’ Riffraffs sur Wild. On n’y retrouve pas la frénésie du set béthunien, évidemment, sauf peut être sur «Dance Fanny Dance» qui est une espèce de merveille définitive, emmenée aux bouquets de chœurs - Come on now ! - et au pas de charge. C’est dans ce cut qu’on mesure la puissance de leur blast surexcité. Nao multiplie les breaks géniaux et claque son cut au chant mélodique. Il y a vraiment du Frankie Ford en lui, il a ce genre de puissance. L’autre gros cut du disque est «Knock Down», qui sonne un peu comme une descente aux enfers. C’est vrai, cette formulation ne veut rien dire, mais les chœurs de folles créent un climat de démence latent. Ces gens-là ne cassent pas la baraque, oh non, ils préfèrent l’exploser. Nao démonte tout - Knock down go ! - Il y a dix mille fois plus d’énergie chez ce petit bonhomme que chez tous les punks anglais réunis. En l’écoutant chanter «Knock Down», on le revoit blaster sur scène. C’est un personnage de conte fabuleux, une sorte de Kyuzo, le maître d’armes des Sept Samouraïs de Kurosawa. Nao, c’est le Seiji Miyaguchi du rockabilly. On retrouve aussi sur l’album ces instros cavaleurs farcis au theramin. «Buxotic» sonne comme un instro rampant et dérangeant à la Link Wray et la grosse basse de la petite Rie chevrote désagréablement. C’est sur «Linda» qu’on entend le mieux battre cette merveilleuse reine de la relance qu’est Saori la rigolarde. Ces filles n’en revenaient sans doute pas de se retrouver sur une grande scène, dans le Nord de la France et face à un beffroi dressé dans la nuit. On l’entend battre aussi comme une dingue sur «Screaming On Wheels». Elle vaut largement tous les batteurs du monde et en plus, elle ne frime pas. Nao refait un gigantesque numéro de charme avec «You Shake Me Up» et ramène pour l’occasion sa classe qui est celle d’une pure rock star.

Signé : Cazengler, stomping ric rac
Stompin’ Riffraffs. Béthune Rétro. 29 & 30 août 2015
Stompin’ Riffraffs. Stompin’ Riffraffs. Wild Records 2015
BRITISH ROCK
1956 – 1964 : LE TEMPS DES PIONNIERS
CHRISTOPHE DELBROUCK
( Castor Astral / 2013 )

Les rockers sont comme les petits enfants, ils adorent qu'on leur raconte chaque soir la même histoire. Pas celle du petit gentil chaperon rouge qui désobéit à sa maman, mais celle du grand méchant loup qui se jette sur elle pour se, hideusement, goinfrer de sa chair juvénile. Attention, ils la connaissent par cœur, alors ne faut pas trop s'écarter de la terrible aventure. Tant pis pour ceux qui essaient de les faire pleurer sur le sort de la vieille innocente grand-mère, ont intérêt à numéroter leurs abattis. Surtout l'épisode qui se déroule au pays de sa très gracieuse majesté (she's just a fascit pig, selon les dire d'un pure and rosbeef poète ). Avec les amerloques, ils n'osent pas trop moufter, un immense pays, très loin de l'autre côté de l'océan, il y a sûrement un détail qu'ils ignoraient, cinquante états, s'en est passé des trucks et des machines chouettes, là-bas, mais pour the Old England, ce n'est pas du tout la même farine, un mouchoir de poche, vous tendez le bras ( de mer ) et vous y êtes. Alors le Christophe Delbrouck s'il compte nous le faire à l'esbroufe, l'a intérêt à avoir cotisé pour une assurance vie. Un mec douteux, j'en détiens la preuve a-priorique, l'a déjà commis trois gros bouquins, plus un dictionnaire, sur Franck Zappa – ça zappa non, pas très franc du collier – et araignée velue sur le gâteau, un livre sur Crosby, Still, Nash and Young, un choix, vous en conviendrez délétère.
J'accordons qu'il n'a pas lésiné, quatre cents pages, grand format, et que le deuxième tome qui couvre les années 1965 – 1968 incessamment illico presto chez votre teinturier préféré, et que Le Père Fouettard vous apportera le troisième dès le mois du prochain décembre. Prolixe, notre Christophe Delbrouk, surtout qu'en consultant son site j'ai remarqué que parmi une pléthore d'autres activités il avait aussi fait partie du défunt groupe Nasal Retentive Orchestra dont il se promet prochainement d'accabler l'humanité de deux DVD gorgés d'innommables inédits. Nous en dirons tout le mal inutile en temps utile. Rassurez-vous, car pour ce British Rock : 1956 – 1964 : Le temps des pionniers, faut convenir que ce n'est pas mauvais du tout. C'est même très bien. Pas ennuyant pour un penny, un roman. Pour la composition a choisi la méthode opposée à celle du Da Vinci Code de Dan Brown, ne relance pas l'intérêt en fin de chapitre. Se contente de continuer son propos au suivant comme si de rien n'était. Vous fait attendre, avant d'aborder ce que le titre nous annonce. C'est qu'il en connaît des choses. Et des intéressantes. Et des subjuguantes . Un puits de sciences. L'a dû beaucoup lire. N'est pas égoïste, essaie de nous refiler le maximum.

Pourrait nous laisser pour morts au détour du labyrinthe, agonisants sous des tombereaux de détails insignifiants. Mais non, sait où il va. Possède son fil d'Ariane. Je vous refile le nom de la bobine du cordon salvateur. Electrique. L'a tout compris, le rock c'est une simple question d'électricité. N'écoutez pas les écolos qui vous parlerons de guitare éolienne. C'est bon pour les folkleux. Christophe Delbrouck l'a fait son choix. Un homme de goût. 1956 – 1960, deux héros, Vince Taylor et Johnny Kidd.
LES PIONNIERS

Ne pensez pas qu'il leur consacre les trois-quarts des cent-cinquante pages de la période. Une assiettée pas beaucoup plus remplie que celle des autres, la différence c'est la ferveur avec laquelle il en parle. L'intelligence de leur démarche, fût-elle extrémiste et solitaire, et leur farouche volonté à être ce qu'ils sont, à ne pas se laisser rogner les ailes, et surtout à avoir saisi l'essence du rock and roll.
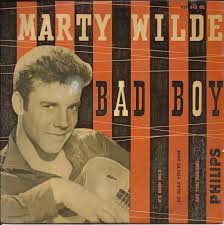
Sont loin d'être les seuls et les tout premiers. En Angleterre – comme partout ailleurs – le rock fut un grand éclair blanc. Qui causa beaucoup plus de dégâts dans les esprits des jeunes gens que l'explosion d'Hiroshima. Mais qui est entré par la petite porte. Sans tambour ni trompette, serait-on tenté de dire, lui qui pourtant fit tant de bruit. L'est tombé comme la foudre. Et beaucoup crurent en toute bonne fois qu'ils avaient reçu la révélation de la grâce. Se sont sentis appelés par le rock. Vous connaissez leur nom, Tommy Steele, Marty Wilde, Billy Fury, Cliff Richard, Shadows, Joe Brown – pour n'en citer que quelques uns. Leurs premiers enregistrements marquèrent les esprits. Apportaient au pays ce que Baudelaire n'avait pas encore réussi à trouver à la fin des Fleurs du Mal. Du nouveau. Du rock. Il est des miracles dont il vaudrait mieux être épargné. Encore faudrait-il prendre conscience des évènements que l'on traverse ou qui peut-être nous traversent. Certains pénètrent dans la cage aux serpents sans peur ni reproche. Par inconscience. Mais une fois ressortis, ils passent à autre chose. Un Tommy Steele fut – non pas un opportuniste – mais un opportuné. The right man, at the right place, in the rigth time. Un baroudeur. Idéal pour les coups durs. Mais la bagarre terminée, il se livra à des activités plus paisibles. Joe Brown ou la facilité du génie, rock sans effort, puis s'en éloigna avec désinvolture. Opérettes, contes de fées, vomitoires pour rockers de la part de ces deux-là. Cliff Richard sur les traces talentueuses d'Elvis, le suivit même sur la mauvaise pente. Hank Marvin, un raid Apache qui par son esthétisante fureur mit le feu aux poudres du rock anglais, après quoi il rentra de lui-même dans la réserve des occasions perdues. Marty Wilde, Billy Fury, chiens féroces qui se laissèrent amadoués par des morceaux de susucre. La punition ne se fit pas attendre : état dépressif généralisé.

Le plus dérisoirement terrible dans cette histoire c'est que si la plupart des rockers se trouvèrent dans l'incapacité intellectuelle ou instinctive de comprendre la signification de ce qu'ils exprimaient, autour d'eux, dans leur entourage proche, l'on fut beaucoup plus avisé. Les pouvoirs publics réagirent au quart de tour. Ces chanteurs épileptiques n'étaient que les messagers des gros bataillons d'une jeunesse prête à toutes les rébellions. Dieu, la patrie et le sexe étaient en danger. Les comités de censure furent très efficaces. La BBC et la télévision se battirent violemment, et résistèrent longtemps, et pas à pas, à l'invasion rock. Le rock anglais doit une fière chandelle au producteur de télé Jack Good qui entreprit tant sur les chaînes privées que publiques une guerre d'usure avec la vieille morale sclérosée issue du puritanisme victorien. Mettait-on fin à son émission, qu'il en montait une similaire tout aussi excitante sur un autre canal... Quant aux maisons de disques, elles s'employèrent, à l'exemple de leurs grandes tantes américaines, à chasser le rock and roll de leurs productions, n'hésitant pas à châtrer par injections répétées de romances doucereuses la virilité des meilleurs rockers. Qui se laissèrent faire, à part les fortes têtes à la Vince Taylor et à la Johnny Kidd.

DANS LES MARGES
Il ne faut jamais désespérer des mauvais garçons. L'en est toujours un certain nombre qui refusent de sucrer leur café noir. Ou de mettre de l'eau dans leur whisky. Des révoltés, des voyous ( de la pire espèce ), les teddy boys et toute une partie de la jeunesse ouvrière, boudèrent les manifestations officielles. Le rock se réfugia dans les arrière-salles des bars, dans les clubs miteux, au fin-fond des provinces et des campagnes. Une situation qui n'est pas s'en rappeler les temps actuels en France. Les groupes locaux et les forcenés à la Johnny Kidd, avaient là un public, désargenté, mais à qui il ne fallait pas en promettre. C'est en ces caves profondes, en ces cavernes lointaines que le rock s'enracinait, s'expérimentait, se modifiait, s'enrichissait... Evoluait-il ou dégénérait-il ? Les débats sont ouverts. Ce qui est sûr c'est qu'il survivait et se préparait à vivre une des pages les plus fameuses de sa légende.
BEAT & BLUES

L'ennemi survient toujours par le côté où on ne l'attend pas. A Londres les maisons de disques avaient réussi à endiguer la bête. Ce fut chez les ploucs de Liverpool que la tarentule se réveilla. De tous les côtés. Trois cents groupes qui grouillaient dans tous les coins de la ville. Des teigneux qui jouaient fort parce qu'ils ne savaient pas faire grand-chose. Mais prêts à faire n'importe quoi pour se sortir d'affaires. Trop, c'est trop. Comme l'on ne pouvait pas faire une troisième guerre mondiale pour s'en débarrasser, l'on trouva une solution qui louchait vers le rapprochement des peuples. L'on prit l'habitude d'envoyer les moins pires ( certains disent les plus fauchés ) outre mer, dans le port de Hambourg. Un pays de cocagne, putes à foison et marins alcooliques. Je me refuse de vous faire languir, les Beatles y firent leur classe de commando rock. Quand ils revinrent de ce pays de matelots soiffards ils avaient gagné le pompon et toutes les filles leur coururent après pour le leur attraper. Eurent de la chance, leur manager Brian Epstein sut surfer sur la vague. Ménagea la chèvre de la rébellion adolescente avec le chou du socialement acceptable. Et puis surtout George Martin un ingénieur du son – un véritable producteur – qui savait tirer les meilleur effet du moindre morceau. L'on ne compte pas le nombre de combos made in Liverpool qui après les Beatles tentèrent leur chance. Toute maison de disques en voulaient un max. Même George Martin qui en coacha à lui tout seul une demi-douzaine. Ainsi naquit le Mersey Beat. Partout en Angleterre. Mais les Beatles ne furent jamais détrônés par ces concurrents qui s'épuisèrent à les poursuivre. Furent pressés comme des citrons par leurs employeurs, quelques tubes, des tournées marathon à n'en plus finir, la voix du chanteur qui se brise, et hop direction les poubelles de l'histoire du rock and roll !
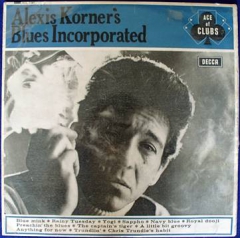
Objection votre honneur. Londres résista. What is it, cette musique de sauvage de campagnards sous-développés ? En la capitale, l'on est un peu plus évolué. On puise directement à la source. Au jazz. Euh, entre nous c'est un peu suranné et ultra-codifié, pas très vivant. Alors l'on descend d'un étage. Au fond du trou chronologique, se trouve le coffre au trésor, la pierre philosophale, le blues ! L'on n'osa pas exhumer le vieux blues rural du delta, ou plutôt on se hâta d'en raviver la teinte, un beau bleu électrique comme les ricains eux-mêmes n'en avaient jamais fait. Ainsi se créa une espèce d'élite clandestine autour de quelques fortes têtes comme Alexis Korner, Graham Bond, John Mayall... Une espèce de colonie bleue ouverte à toutes les bonnes volontés qui se moquait du hit-parade et qui refusait de passer sous les fourches émasculatrices des majors. Les Rolling Stones firent leurs armes dans cette mouvance. Firent plus de bruit que les autres, Sonny Boy Williamson, of course mais le jungle beat de Bo Diddley, les riffs de Chuck Berry et l'électricité de Muddy Waters, faut pas les laisser de côté. Faut même en rajouter. De l'huile sur le brasier. En plus de sacrées tronches, l'air d'être revenus de tout, méprisants, hautains emplis de morgue. Et de crasse. Les cheveux en bataille, les vêtements crados, tout pour inspirer le respect. Et les filles. Beatlemania et Stonemania sont main dans la main en 1963. Les deux groupes occupent les deux premières places, et aucun autre ne les leur ravira. Les Beatles ont su créer leur cocon de survie dans lequel ils sauront s'épanouir, et les Stones ne sont pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par le staff qui les entoure. A tout instant, soyez méchants.

N'y a pas que la musique qui change. Les rockers et les teddies sont supplantés par une nouvelle génération de jeunes gens modernes. Les Mod's écoutent un peu de jazz et beaucoup de chanteurs noirs américains de rhythm and blues. C'est leur musique. Les groupes qui commencent à s'inspirer de cette musique oscillent optent tantôt pour une forte présence de l'orgue, tantôt pour l'avantage aux guitares, comme si cette attitude rhythm'n'blues était le détour obligatoire vers un retour au rock and roll. Dynamisé.
ANIMALS ET AUTRES BESTIOLES

L'on croyait avoir connu le fond de la lie du tonneau avec les Stones, mais ce n'était encore rien. Les Rolling indiquèrent aux anglais et au monde entier la direction du blues, les Animals firent pire. Montrèrent aux amerloques ce qu'était l'essence du blues sauvage. Comment ? Pourquoi ? Je suis incapable de le dire. Peut-être faudrait-il inventer et monter une théorie à la Raymond Abellio qui pondit un traité de six cents pages pour expliciter le dévoilement des savoirs ésotériques au dix-huitième siècle, mais ceci demanderait trop de temps et les fauves en liberté n'aiment guère attendre. Par quel miracle l'âme du blues boueux du delta s'incarna-t-il en Eric Burdon un gamin de Newcastle ( on Tyne ) ? Ce n'était pas uniquement qu'il était particulièrement doué pour chanter le blues, c'était que ce fils révolté des loyaux sujets de sa majesté se permit ce que de Robert Johnson à Muddy Waters aucun des rois du blues n'osa jamais entrevoir dans ses rêves les plus fous. L'ouvrit toute grande, en public et éructa de mille borborygmes. La colère, la haine, la hargne, la folie meurtrière, tous les serpents du blues qui macéraient à l'intérieur des vieux bluesmen, lui, Eric Burdon, il les recracha, les vomit, sur scène à la face du monde. L'entraînait le combo en de sombres ruées hypnotiques, le blues prenait la parole et la gardait. Revendiquait la marge, la révolte, et l'écroulement de la société entière. Les Animals sortirent de leur tanière, plus naturellement sales, plus naturellement crasseux, plus naturellement mal peignés que les Rolling Stones, et commencèrent à mordre à pleine gueule le monde entier. Des irréductibles. L'on essaya de les contenir. L'on employa la vieille tactique : diviser pour mieux régner. L'on surpaya l'organiste pour créer la zizanie. Alan Price sur le départ. Tant pis pour lui, aucune pitié pour les lapins qui rentrent de leur plein gré dans le clapier du showbiz. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Aux USA, Eric Burdon convainquit l'Apollo qu'il était plus noir que les noirs, plus bleu que les nègres. Un électron fou qui dynamita à jamais le self-control britannique. Avec Eric Burdon et ses panthères noires le rock anglais atteignit sa majorité. N'était plus un adolescent retardé à la remorque des amerloques.
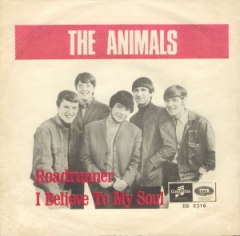
Après les Animals, Christophe Delbrouck ne sait plus où donner de la tête. Vous naît un groupe à tous les coins de la page. Passe un peu vite. S'arrête à peine sur les Nashville Teens – qui accompagnèrent Jerry Lou à Hambourg - et beaucoup sur les Kinks. Revient sur les Stones qui continuent à n'en faire qu'à leur tête. Ne sont pas encore au niveau des Beatles. Se contentent de reprendre des vieux morceaux de blues, mais les rénovent de fonds en combles. Les Scarabées sont à un autre étage. Vous pondent des originaux toutes les trois semaines. L'on se demande où ils vont les dénicher. Tous les groupes reconnaissent leur suprématie. Vivent des jours de grand tumultes. Les filles qui hurlent et les concerts où personne n'entend rien. Sont les rois du monde. En Angleterre, en Asie, en Australie, aux USA, la folie Beatles submerge l'univers. N'en ont pas pour autant la grosse tête. A Londres, Jagger, Burdon, Lennon, discutent d'égal à égal. Le rock and roll prend conscience de lui-même. Ne s'agit plus exactement de musique. L'est aussi une remise en cause du vieux monde. Nous sommes en 1964, et la planète se dirige à marches forcées vers les grands soubresauts de la fin de la décennie...
RETROSPECTIVE

Le livre fourmille de renseignements, quatre cent pages remplies à ras bord, à lire pour tous ceux qui s'intéressent au rock. N'y a que sur les Yardbirds que je le trouve un peu léger, mais sans doute seront-ils traités dans le deuxième tome. A la réflexion les passages les plus intéressants sont peut-être consacrés à ces artistes qui ne sont pour nous que des noms. Frank Ifield n'est qu'une ombre, Cilla Black un fantôme transparent. Tout ce qui s'est passé en Angleterre ne nous est parvenu que par un filtre. Nos média ne pouvaient pas se consacrer uniquement aux britihs, fallait aussi promouvoir les petits yéyés de par chez nous. De ce fait nous ne prêtons pas la même importance que le public anglais à des groupes comme les Hollies ou au Dave Clark Five . Nous les considérons comme des sous-fifres de deuxième catégorie alors qu'ils furent des jalons importants du déploiement historial du rock briton, pas obligatoirement à un niveau strictement musical. Je ne compte pas les surprises agréables comme cette présentation de Dusty Springfield qui est devenue dans notre mémoire une icône un peu poussiéreuse.

Mais je finirai par le commencement. La toute première idole, Lonnie Donegan, and his skiffle group comme dirait Hugues Aufray. Très belle analyse. Un créateur auto-limité, qui n'a jamais voulu aller plus loin que lui-même. S'est contenté de son folk blues du pauvre et est resté ébloui de son propre succès. N''aurait jamais espéré de parvenir là où il était arrivé du premier coup et n'eut même pas l'idée qu'il pouvait poursuivre au-delà. Avait déplacé une montagne et n'a jamais pensé qu'il y en avait une deuxième à repousser. La même attitude que partagèrent les premiers rockers. Ne possédaient pas les moyens d'analyse conceptuels et prospectifs du phénomène qu'ils étaient en train de déclencher. Il en avait été de même aux USA, lorsque l'on voit comment un Elvis Presley s'est laissé manipuler par le Colonel Parker, il y a de quoi méditer. L'aura fallu dix ans pour que les maisons de disques soient mises au pas et décident de laisser la bride au cou de ces groupes qui piaffaient d'impatience et de talent. Ne nous berçons pas d'illusion, ce ne fut que brèves éclaircies intermittentes. Dans cette partie de poker ce furent les majors qui surent en fin de compte être les plus menteurs afin de juguler ces troupes indociles...
Damie Chad.
L'EXCUSE / LONGJUMEAU ( 91 )
25 - 09 - 2015 / JALLIES
Ce n'est pas que l'on cherche une excuse, nous n'en avons point besoin pour voir les Jallies, mais ce vendredi soir s'annonçait sans surprise. Une autoroute dégagée, une place de stationnement à soixante mètres du café, tout était parfait. Et puis entre nous soit dit, le répertoire des Jallies on connaît par coeur, d'ailleurs nous ne l'évoquerons qu'à peine. L'est sûr que l'Excuse est un café un peu spécial. Dans le genre que l'on apprécie. Matinée, après-midi, pas de problème, pouvez venir réviser vos droits et devoirs que vous octroient la Constitution. Personne ne vous en empêchera. Une paix royale. Lecteur, vous avalerez sans être dérangé une seconde les huit cents pages de L'Homme sans Qualité de Robert Musil. Vous y bénéficierez d'un calme et d'une sérénité olympiennes. C'est en soirée que la clientèle change. C'est l'autre France, celle ô combien sympathique des fêtards tous azimuts, celle des échappés du dur labeur quotidien qui s'en viennent trouver en ce rade de centre ville la chaleur humaine qu'ils n'ont guère eu l'occasion de côtoyer durant les heures de labeur. L'Excuse, le soir se transforme en soupape de sécurité sociétale, on boit, on crie, on chante, on s'amuse. L'on repeint le monde en couleur carnaval de Rio. Mais ce vendredi soir, une fois n'est pas coutume, à part nous, les Jallies et quatre cinq consommateurs au comptoir, ce n'est pas la foule. Fred, le patron, le prend avec philosophie. Fréquentation en berne dans tous les troquets de la cité, nous explique-t-il, et il nous profile un cours d'économie d'une limpidité absolue : moins de monde, moins de concerts. N'a pas l'air inquiet, tient bon contre vents et marées, lui il continue, il n'y a qu'à regarder le panneau avec les affiches des groupes qui sont passés dans son établissement.
PREMIER SET
Le grand Phil n'est pas mécontent, les Jallies pour pratiquement lui tout seul, l'est comme les enfants qui n'aiment pas partager leur cadeau de Noël, sous le sapin. Je ne fais plus les présentations, les trois filles devant, les deux garçons derrière. Vous reconnaîtrez les gars facilement, sont les seuls à porter un borsalino. Même que Kross sanglé dans son costume ressemble à un gangster - à cause des demoiselles, à la relecture j'ai supprimé le mot mac, les demoiselles en auraient fait tout un micmac – tout droit sorti des films noirs made in USA, dans les années cinquante. Ça roule pénardos, et même ça rock en roule. Alors que nous n'avons d'oeil que pour les trois mignonnettes, la salle du haut – pas de beaucoup, juste deux marches – se remplit, tout doucettement mais régulièrement. L'on s'embrasse, l'on se serre la paluche, l'on se congratule, peut-être pas en toute discrétion, mais en bas le son est si clair, si net, que cela ne nous gêne en rien. Notons que beaucoup de groupes - dans un passé récent nous les avons vus à l'œuvre - ont eu quelques difficultés avec le sound check. Résonnances indues dans la boîte carrelée, basse de plafond.
DEUXIEME SET
Petit entracte et rebelote illico. Un peu moins rock, davantage swing. Qui s'en plaindrait ? Pas nous. Il y a comme un remous dans la salle du haut. Pas de cris et une espèce de froufroument indistinct. Et brutalement la terrible réalité du monde se rue sur notre swingante quiétude. Le péril jaune grandeur nature. Attila et Gengis Khan en même temps. Qui déboulent et se précipitent dans le mini escalier. Nous n'avions pas vu la catastrophe poindre. Faut dire qu'à la radio, ils n'en ont point causé. Et pourtant, c'est bien une horde mongole qui déferle, tourne et virevolte au grand galop pour finir par se masser, sur la table du billard – fort heureusement – recouverte d'une planche protectrice. Mais que viennent-ils faire ici ? Nos yeux hagards nous obligent à reformuler notre angoissante question métaphysique. Mais que viennent-elles faire ici ? Car ce sont des filles. Des amazones, des guerrières, regroupées autour de leur reine qui lève le bras pour ordonner l'assaut. La lumière jaillit dans le tréfonds du cerveau du grand Phil. Les Indiens d'Inde nous ont enlevé Vanessa en juin dernier, et maintenant ce sont les peuplades sauvages des contrées incertaines de la lointaine Asie qui ont monté un raid pour les kidnapper toutes les trois ensemble. En théorie nous comprenons cette vision des choses, à en prendre une, autant subtiliser les trois, trois trésors valent plus cher qu'un seul. Mais nous n'avons aucune envie de laisser dérober les trois frangines sans lutter jusqu'à la mort pour les retenir. Le Grand Phil et moi, nous sommes prêts à nous opposer à cette harde d'asiates femelles en furie, dussent-elles passer sur la chair de nos corps. Trop tard nous n'avons plus le temps de nous porter à leur secours. La cheftaine a baissé le bras pour lancer l'ordre de l'assaut final. Elle a diaboliquement attendu la fin du morceau, cette fraction infinitésimale où l'orchestre étonné se jauge des yeux pour décider de la suite à donner au numéro précédent. Elles foncent droit vers nos trois sabines qu'elles ne vont pas manquer d'enlever. Mais au lieu de s'en saisir, elles effectuent une transition latérale sur le flanc gauche – la même que celle d'Alexandre à la bataille de Gaugamèles – et se campent – démoniaque surprise, ruse infernale - devant Tom qui coincé contre le mur ne peut plus s'enfuir. Sans doute ont-elles décidé d'éliminer d'abord la population mâle ! ( Perso, j'essaie de prendre mon air féminin, numéro 4 ). Pauvre Tom, ses secondes sont comptées, la cheftaine s'approche de lui et lance un ordre guttural : « Photo ! » Comme par un hasard incroyable j'ai sur moi ma méthode Assimil, Mongol-Français, je traduis immédiatement. Selfie ! Et hop ! Elle se fait tirer le portrait par une de ses lieutenantes, étroitement enlacée à Tom tout souriant. Et elles se retirent à toute vitesse. Pas le temps de dire ouf ! qu'elles ont regagné la rue alors que - la triste et impitoyable vérité historique m'oblige à rapporter le navrant comportement de nos trois damoiselles préférées, on ne le savait pas, mais comme la commune humanité, elles ont des défauts - taraudées par la jalousie qu'elles sont, elles proposent d'être, elles aussi, sur le cliché, mais apparemment la gent tartare n'aime guère partager, et leur proposition n'obtiendra qu'un silence dédaigneux... A la fin du set nous nous pressons autour de Tom pour le réconforter car en guise de baiser d'adieu la grande chef lui a planté un gros smack sur les joues, un coup de tampon amical, à vous envoyer deux jours en observation à l'hôpital. Devant nos insistantes questions - dépourvues de toute malsaine curiosité, vous nous connaissez – il est obligé de nous dévoiler des pans entiers de sa vie secrète de guitariste rock. Ses virées en Russie, jusqu'au fin fond de la Sibérie, où manifestement il s'est constitué un fan club des plus fidèles et des plus opiniâtres. Incroyable, mais vrai. Si elles se sont échappées si vite, c'est qu'elles avaient un train à prendre. Quittaient la France au petit matin.
TROISIEME SET
Nous pensions en avoir terminé avec les émotions. Ce n'était qu'un hors d'œuvre. Faut toujours se méfier de la cinquième colonne. De l'ennemi intérieur. L'intermède russe a donné des idées à Jojo. Remarquez qu'il n'y est pour rien, ce sympathique jeune homme. Mais c'est lui le coupable. C'est de sa faute. Un peu de sa mère aussi, puisque c'est elle qui lui a donné naissance. Ce doit être à peu près exactement un quart de siècle avant que ne débute notre soirée. Les joyeux drilles de l'étage supérieur se sont aperçus à l'occasion de la précédente invasion sibérienne qu'à un mètre cinquante du comptoir, il y avait un orchestre de rockabilly swing. Avec trois jolies minettes en plus. Comme quoi lever les yeux du fond de sa coupe de champagne peut parfois se révéler enthousiasmant.
Et les copains de Jojo, ce ne sont pas des caves. N'en croient pas leurs oreilles, quand, bonnes filles, entre deux morceaux, les Jallies lui fêtent son anniversaire, en trois langues, français, anglais, yaourt, tempo lent et tempo rapide. Sont éblouis par cette dextérité verbale, et tout de go, pour Jojo, saisis d'une saine émulation, ils se transforment en le choeur wagnérien des Maîtres Chanteurs, avec tout de même des relents avinés de fin de troisième mi-temps revus et corrigés par les Pogues, ces pochtrons d'irlandais particulièrement férus en la matière.
L'ambiance monte d'un double cran. Twist généralisé. Jojo est aux prises avec une panthère noire des plus lascives. Fait mine de le griffer, de le mordre, et de le dévorer tout cru. Jusqu'où ne s'arrêteront-ils pas ? Si après elle avait une petite faim pour moi, je ne dirais pas non. Mais non, ce n'était qu'un rêve. Le set se termine sous des applaudissements triomphaux. Ce n'était pas tout à fait un concert, plutôt une superproduction truffée de rebondissements. Avec nos trois Jallies en stars principales. Inoubliables dans leurs rôles. Mais elles sont déjà reparties pour de nouvelles aventures en Vendée...

Damie Chad.
27 – 09 – 2015
LES ÔTONALES DE NANGIS
JALLIES

C'est à côté de la maison. Trois jours de festival. Oui, mais le programme n'est pas folichon. Font avec les artistes locaux et ce n'est pas ce qui existe de mieux. Peut-être en début d'après-midi un bon groupe de reprises rock, mais se fader toute la suite, durant cinq heures pour à dix-neuf heures terminer avec les Jallies, hum-hum, on débarquera juste à sept heures pour croquer la cerise qui n'est pas posée sur le gâteau qui n'existe point.
C'est rempli de monde. Tout âge. Tout public. Un malheur a dû s'abattre sur la contrée. Mine d'enterrement généralisée. Même pas un gamin qui court. Pas un cri. L'on se croirait à la messe, le dimanche matin, un jour de pluie, dans la nef glacée. L'on a vite compris pourquoi. Il y a des super-musiciens sur scène. Pas des amateurs qui sortent le violon du grand-père une fois par trimestre pour que le bois ne moisisse pas. Des vrais, des étudiants, des sérieux qui ne ratent pas les cours, pour courir l'aventure rocksonnière. Sont encore à l'école. Pas n'importe laquelle. Une des plus prestigieuses. Celle de Didier Lockwood. Jouent parfaitement bien. Mieux que bien. Mieux que n'importe qui. Ils ont même un super beau son. Nous avons de la chance. Nous arrivons tard, juste pour les deux derniers morceaux. Mais quel ennui ! Pire que la salle d'attente du dentiste. Une torpeur mortelle s'est emparée de l'assistance. Nangis, ville morte. Pompéi après l'éruption du Vésuve. Cendres et désespoir. Vivement que ça se termine. Rien de plus terrible que le jazz qui court ( en vain et sans trop savoir pourquoi ) après la musique contemporaine. Allez expliquer après de tels abysses d'ennui à la population autochtone que la culture sauvera un jour l'Humanité. Nous avons trouvé la parade, pendant vingt minutes nous engloutissons crêpes à la confiture de fraise et assiettes de petits fours.

Les Jallies sont en train d'installer le matos sur scène. Mais l'orga a pensé à notre bonheur. Après les partoches qui recherchent les difficultés artificielles, nous voici confrontés au binaire primitif. La batucada des Percutés. Faut être franc, c'est nous qui avons du mal à percuter. Serions-nous persécutés ? C'est mou de genou. De la frappe gentillette et proprette. Surtout le deuxième morceau aussi infini et monotone que les dunes du Sahara. Le soir tombe et un vent froid se met à souffler. Les Jallies trépignent d'impatience, dix-neuf heures pile au clocher de l'Eglise voisine. A elles de jouer.
CONCERT

C'est parti pour une heure pile. Mais devant l'enthousiasme de la foule, l'orga autorisera trois rappels successifs. Un peu court. Mais efficace. Une bonne sono, une grande scène, toutes les conditions sont réunies pour un set remuant. Et d'anthologie. Apparemment le voyage en Vendée ne les a pas fatiguées. Rien qu'à entendre la mini balance de deux minutes a capella sur l'intro We are The Jallies, personne ne s'y trompe. Les fillettes sont en forme, et en voix. Se chipent les morceaux en rigolant. A chacune son maximum de tours. Derrière Tom fait vrombir sa guitare – je comprends pourquoi ils aiment cela jusqu'en Sibérie – et Kross penché sur sa contrebasse en a laissé tomber les bretelles de son futal.

Ça déménage sec. Les instrus plus rocky que moi tu mourras, et les filles plus swing que moi tu ne pourras. Les dix commandements du rock réduits à la binarité de l'essentiel. L'important n'est pas de bien jouer – c'est nécessaire et en même temps subsidiaire – le truc rock par excellence c'est de vous emporter, vous loger dans une capsule d'espace temps des plus étroites et de vous emmener en voyage au pays où l'on arrive toujours lorsque l'on est bien. Lorsque la question de savoir si l'on pourrait être mieux ailleurs ne se pose plus, est nulle et non avenue, lorsque ce moment de votre vie, cette infime parcelle du vécu, devient un fragment d'éternité que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. Une jouissance sans pareille, une érotologie platonicienne qui vous permet accéder au monde des formes idéennes. Encore que le rock apporte une dimension supplémentaire. Ne suffit pas d'être maître de son art – vocal et / ou instrumental – faut encore en être pénétré pour qu'il modifie votre profil existentiel. Votre position d'assise dans le monde. Ne s'agit pas d'avoir le look, faut être le look. Art – cet autre mot du faire – et l'attitude – cet autre vocable de l'apparence – doivent se transformer en artitude. Deviens ce que tu es tout en étant ce que tu deviens. Deux postulations en incessante circulation. Partir d'un pôle pour arriver à l'autre. C'est là le secret de l'oubli et de la mort que tu trimballes au fond de toi. Et puis revenir à l'autre pôle. C'est ici l'arcane de la remembrance de soi-même à soi-même. Lorsque l'icône de toi-même devient toi-même et l'icône mnémosyenne de quelques autres. Entrer en soi pour mieux pénétrer en les autres. Se nier pour être au faîte de son incarnation. L'est une autre manière de dire cela : dire qu'en cet instant de grande affinité les dieux sont là. Ce n'est pas pour rien que la paganité philosophique du rock a été traitée de diabolique par diverses instances monothéistes. Comme par hasard, les premiers bluesmen ont eux-mêmes défini et revendiqué leur musique comme celle du diable. C'était une manière un peu naïve de se peindre sous les couleurs non pas de la plus grande adversité, mais sous celles de l'Adversaire, c'est—dire de la créature auto-déifiée. Rock and roll star. Fuck ! Fuck ! Fuck !

Oui, je sais parfois j'élève le sujet ( au moins un demi-millimètre ), mais tout cela n'est que l'application de la musique des sphères au rock and roll. Toute cette logorhée pour retomber sur les Jallies et cette propension naturelle que j'ai déjà à maintes reprises spécifiée, cette faculté qu'elles ont d'emporter leur auditoire, quelles que soient les circonstances. Enchaînent reprises et originaux – je remarquons qu'avec le nombre des concerts qui doit approcher la centaine, l'harmonisation de leurs voix prend de l'ampleur. Ça remue et ça danse de tous les côtés. Faut voir les trognes des participants. Malgré la nuit qui tombe et le vent aigre qui redouble d'effort. Elles ont sauvé les Ôtonales, un véritable printemps. Un renouveau qui durant soixante-dix minutes a balayé la tristesse du monde.

Damie Chad.
( Photos FB : Jallies et Ôtonales )
15:36 | Lien permanent | Commentaires (0)
23/09/2015
KR'TNT ! ¤ 248 : TAV FALCO / SPUNYBOYS / GLAM / ARPEGGIO OSCURO / JOHN LENNON
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 248
A ROCK LIT PRODUCTION
24 / 09 / 2015
|
TAV FALCO / SPUNYBOYS / GLAM ROCK L'ARPEGGIO OSCURO / JOHN LENON |
SILENCIO / PARIS ( 2° ) / 18-09-15
TAV FALCO
TAV ET SES OCTAVES
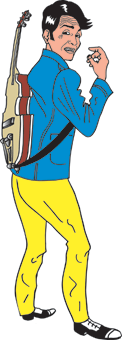
Le problème avec les gens qui sont en avance sur leur époque est qu’on n’en finit plus de les redécouvrir. Deux exemples : Captain Beefheart et Tav Falco. On a la prétention de croire qu’on connaît bien les albums et les historiques, mais il suffit d’un nouvel élément (réédition bien documentée ou travail de traduction - j’ai eu le privilège de traduire le Captain Beefheart de Mike Barnes) pour réaliser qu’on ne sait pas grand-chose. Il ne reste plus alors qu’une seule chose à faire : tout reprendre à zéro, c’est-à-dire tout réécouter, tout revoir et tout relire. Dans les deux cas cités, il faut prévoir du temps, car la somme des œuvres écrites, filmées ou enregistrées est volumineuse. Mais c’est la seule façon d’être à peu près sûr de ne pas passer à côté d’une œuvre importante.
Oui, dans le cas de Tav Falco comme dans celui de Captain Beefheart, il faut bien parler d’une œuvre. Ces deux gaillards sortent de l’ordinaire et du petit monde un peu sclérosé de la culture rock de magazine. S’il existait dans l’univers rock une consécration comparable à celle qui existe dans le monde littéraire, disons que ces deux-là pourraient entrer dans la Pléiade, et, pour Tav Falco, ce serait évidemment de son vivant, honneur suprême. Mais il est tellement éloigné des contingences de la reconnaissance que ce genre d’événement ne saurait même pas le concerner. Si ce genre d’événement était un point précis sur l’échelle du temps, disons une croix blanche tracée à droite sur le grand tableau noir de l’amphi, alors Tav Falco se serait déjà transporté là-bas, à l’autre extrémité du tableau noir. C’est une façon d’illustrer ce qu’il fait depuis toujours : il anticipe et donc se déplace. On croit le trouver là, mais non, il est déjà ailleurs. On le croyait à Memphis et le voici déjà à Paris. Il était à Paris et le voilà déjà à Vienne.

Tav Falco et ses amis ont enregistré une quinzaine d’albums en trente ans. Et ce qui frappe le plus à l’écoute de ses albums et notamment des premiers, c’est l’ahurissante modernité de sa démarche. Tav Falco était fasciné par certains personnages cultes de la scène de Memphis, blancs comme noirs, et il commença à exprimer cette fascination non pas en tant que suiveur ou copieur, mais en se projetant littéralement dans l’avant-garde. Avec Captain Beefheart, il fut le seul à réussir ce prodige. Mais ça lui a coûté très cher, puisque - comme Captain Beefheart - il est resté quasiment toute sa vie dans l’underground, une élégante façon de rebaptiser la précarité. Tav Falco ne possède rien. Pas de villa en Californie ni de résidence à Hawaï. Pas de Rolls ni de manoir dans le Sussex. Pas de yatch aux Bermudes ni de villa en Suisse. Il vit dans une chambre d’hôtel à Vienne. Et c’est une légende vivante, comme prétendent l’être certains de ses collègues milliardaires. Captain Beefheart vivait dans une caravane et il ne put mettre un peu de beurre les épinards qu’en peignant des toiles abstraites à la fin de sa vie. Artiste mille fois culte, il n’a jamais réussi à vivre décemment de ses disques. Comprenez qu’il existe un abîme entre des artistes comme Tav Falco ou Captain Beefheart et des boutiquiers comme U2 ou le Pink Floyd. Ils semblent faire le même «métier», mais les démarches et les destins sont radicalement antipodiques.

Modernité, oui. Ça saute à la figure quand on réécoute le premier album de Tav Falco paru sur le label anglais Rough Trade, «Behind The Magnolia Curtain». En 1981, on l’écoutait parce qu’on l’associait aux Cramps qui nous faisaient redécouvrir le rockabilly, à travers des personnages comme The Phantom ou Hasil Adkins. On assimilait les Panther Burns à un groupe de garage et on les admirait pour leurs reprises de classiques de blues obscurs - le blues qui était et qui reste encore aujourd’hui un continent à explorer. Eh bien, en 2014, on réécoute cet album pour en savourer la modernité. «Behind The Magnolia Curtain», c’est la même chose que «Clear Spot» : un chef-d’œuvre absolu qui ne prend pas une seule ride, un disque dense et tendu, fascinant de bout en bout, dans lequel tout semble déjà dit. En comme c’est luxueusement réédité chez Stag-O-Lee, Tav Falco rédige lui-même les notes de pochette. On a donc l’écrivain et le chanteur-passeur. Oui car Tav Falco est avant tout un passeur. Cet album est bardé de reprises de blues et de rockab féériques. Tav Falco fait exactement le même job que Lux : il déniche et redistribue, mais selon une vision personnelle, avec un vrai son. Il aligne sur ce premier album une série imparable de classiques rockab : «Hey High School Baby» (Benny Joy), «Ooooee Baby» (Ric Cartey), «Come On Little Mama» (Ray Harris) et «She’s The One That’s Got It» (Allen Page), «You’re Undecided» (Johnny Burnette). Mais le coup de génie de l’album, c’est sa version de «Brazil», monstrueusement kitsch pour l’époque, bien swinguée et chantée à la décadence du pauvre, et ce qui fait le souffle de ce coup de Jarnac, c’est la présence dans le studio du Tate County Fife & Drums Corp qui développe un beat énorme et primitif. Tav Falco mélange l’Afrique au Brésil. C’est incroyablement novateur pour l’époque. Au chant, il est complètement à côté, mais l’ensemble force la sympathie et finit même par tétaniser. Personne à part lui n’aurait osé un coup pareil. Il réédite cet exploit avec «Snake Drive», reprise haute en couleurs du classique de RL Burnside montée sur le rumble des fife & drums. Comme il l’écrit lui-même dans ses notes, c’est un «unprecedented cultural happening». Encore plus renversant : «Bourgeois Blues», attaqué à la fuzz, fantastique trivia de garage emmenée par un certain Jim Duckworth qu’on retrouvera un peu plus tard dans le Gun Club. Ils s’offrent même le luxe de trasher une reprise du «Moving On Down The Line» de Jerry Lee. Cet album fabuleux passa quasiment inaperçu en Europe.
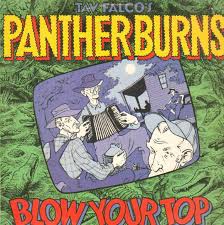
C’est un Français, Patrick Mathé, qui va voler au secours de Tav Falco. Car évidemment, à part New Rose, personne ne veut signer ces énergumènes inclassables et donc difficilement commercialisables. Essayez de faire entrer Tav Falco dans une stratégie de marketing, vous allez voir le travail ! Patrick Mathé fonctionnait comme un fan doublé d’un aventurier et New Rose fit paraître l’année suivante un mini-album intitulé «Blow Your Top» où on retrouvait les mêmes composantes incongrues, mais avec un son plus solide et plus sourd. Ron Miller slappait bien sa stand-up, Jim Duckworth jouait plus psyché, et non seulement Jim Sclavunos battait le beurre mais en plus il produisait. Spectaculaires reprises de «I’m On This Rocket» (Marvin Moore) et de «Bertha Lou» (Dorsey Burnette).
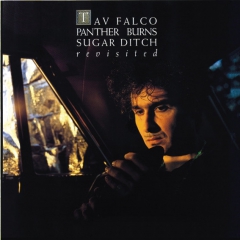
S’ensuivit un autre mini-LP, «Sugar Ditch Revisited», une fois de plus bardé de reprises somptueuses de type «Money Talks» (une démo de Sir Mack Rice sauvée de la poubelle par Jim Dickinson), «Arkansas Stomp» (Bobby Lee Trammell), «Working On A Building» (un vieux classique d’Arthur Big Boy Crudup dont Charlie Feathers était obsédé). Et le festival se poursuivit avec un autre mini-LP, «Snake Rag», sur lequel se trouvaient «Warrior Sam (Don Willis), «Jumper On The Line (RL Burnside - fantastique ambiance de boogaloo rampant) et un «Cuban Rebel Girl» heavy comme l’enfer et que Tav Falco n’aimait pas trop, car il accusait Jim Dickinson de faire sonner les Panther Burns comme ZZTop.

C’est Jim Dickinson en effet qui va veiller le plus souvent sur le destin discographique de Tav Falco. Ce fut une chance pour cet artiste condamné au ténèbres de l’underground. Au moins pouvait-il se consoler d’avoir le support artistique et moral de l’un des meilleurs producteurs du monde qui était aussi le garant de l’authenticité du Memphis Sound, ce dont à cette époque - celle des années 80 - tout le monde se foutait.

En 1987 parait - toujours sur New Rose - un album passionnant de bout en bout, «The World We Knew», doté d’une pochette magnifique. Tav Falco y alignait une nouvelle série de reprises rockab de haut niveau, interprétées avec une confondante originalité : ««Dateless Night» (Allen Page), «It’s All Your Fault» (Bobby Lee Trammell qui fut d’après Roland Janes the wildest he ever saw, et c’est chanté avec l’abandon dandyque - Tav ne cherche jamais la performance vocale, il opte plutôt pour le groove léger et se laisse bercer par les langueurs monotones), «She’s My Witch» (Kip Tyler & the Flips - twisted dirty et grosse ambiance délétère, un idéal de rêve sale), «Mona Lisa» (Carl Mann, son dépouille de pur Memphis sound) «I’m Doubtful Of Your Love» (Benny Joy, infâme lamentation traitée au rythme du tango), mais il y a aussi deux reprises de Mack Rice «Ditch Digging» (hanté par l’esprit des chants des forçats - I’m gonna dig that one - monté sur la contrebasse de René Coman) et «Do The Robot» (aussi récupéré par Jim Dickinson dans la poubelle de Stax). Fantastique reprise de blues avec le «Big Road Blues» de Tommy Johnson qui date des années 20. Tav Falco dit que c’est le son d’une mule tirant une charrette dans la boue. Le chef-d’œuvre de cet album est la reprise de «The World We Knew», un classique de Frank Sinatra que notre héros chante radicalement faux. Tav Falco ne connaît pas les octaves. Puis il rappelle au monde entier qu’il en pince pour le tango et balance «Drop Your Mask» sur un son bien sourd. Évidemment, à l’époque, les gens ne comprenaient rien. C’était perçu comme un gag et Tav Falco risquait de ne plus être pris au sérieux, ce qui ne devait pas le gêner. Il fonctionne un peu comme ces grands peintres modernes qui restent longtemps incompris. À aucun moment, il ne fera l’effort de revenir vers les gens. Il attendra que les gens viennent à lui.

S’ensuit un autre mini-LP, «Red Devil» sur lequel on retrouve «Ditch Digging», «Drifting Heart» (Chuck Berry, un peu tango à gogo), «A Little Mixed Up» (Betty James que Tav Falco entourloupe avec grâce), «Running Wild» (The Nightcrawlers, rockab nerveux aux frontières du tatapoutisme inverti), et «She’s The One To Blame» (Crazy Cavan, bien screamé aux entournures, adroit et bien senti - Tav Falco sait faire le wild cat quand il le faut). La perle du disque est la version du vieux «Tramp» de Lowell Fulson, avec sa petite intro à la Creedence. On a là une belle pièce d’authentique r’n’b, le vrai jerk des ralentis, un hit sur lequel les cowboys de Memphis dansent d’un pas lent et sûr. On se croirait dans une scène de rêve rouge filmée par David Lynch.
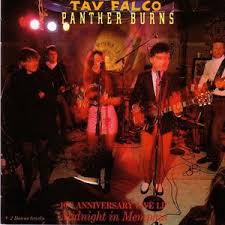
«Midnight In Memphis» est le premier d’une petite série d’albums live officiels souvent très intéressants, car le côté peu cadré et mal rangé des Panther Burns se révèle souvent mieux sur scène. Alex Chilton, Ross Johnson et Doug Easley accompagnent Tav Falco. Ils sortent une version pittoresque de «Shade Tree Mechanic», qui sonne comme du garage baroque de cabaret balinais. Oui, car Tav Falco ne s’intéresse qu’au garage gracile de Louis Feuillade, au swing des grandes œuvres mystérieuses de Jean Marais. Il n’aime que la java de Belphégor, l’immense déviation des Bouges de Mac Orlan. Il sort des reprises irréprochables du «Jungle Rock» de Charlie Feathers et de «Big Road Blues» puis il tape dans «Goldfinger». Il chante merveilleusement faux. Au point que ça fait mal aux oreilles. On n’accepterait ça de personne d’autre que lui. La version du «Memphis Beat» de Jerry Lee est somptueuse et il revient à ses octaves avariées pour «The World We Knew». Puis Tav Falco flingue son set avec «Drop Your Mask». Le tango ne pardonne pas, car les gens ne comprennent pas : non seulement c’est absurde, mais c’est moche.
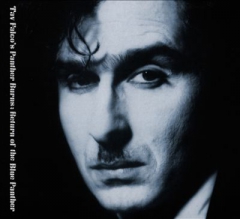
L’album suivant s’appelle «Return Of The Blue Panther». On y entend le beau son de basse produit par René Coman. Belle série de reprises : «I’m Moving On» (Glen Glenn), «You Believe Everyone But Me (Charlie Feathers, pur Memphis sound avec ses gargouillis de guitares dans le fond du studio), «Knot In My Pocket» (Sir Mack Rice), «Rock Me Baby» (BB King, joué avec toute la retenue dandyque), «I Got Love If You Want It» (Slim Harpo, joué à la décontracte et idéal si on apprécie le laid-back), «Love Whip» (du bienheureux Reverend Horton Heat), et on appréciera plus particulièrement ces deux perles de pur garage pantherien : «Girls On Fire» (merveille de garage psyché signée Eugene Baffle, c’est-à-dire l’alter-ego de Tav Falco, pur jus mercurial d’essence patente - George Reineke sait ramoner une cheminée) et «Fun Mob» (belle pop garage qui sonne un peu comme le Plastic Bertrand d’antan qui planait pour lui, mais le génie fantomastique de Tav Falco reprend le dessus. Panther Burns ! Un millésime impénitent et masqué qui se glisse dans la nuit).
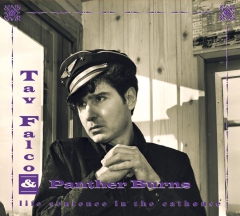
1991 voit arriver dans les bacs «Life Sentence», un album extraordinaire. On sent que Tav Falco est bien décidé à en découdre. Pour preuve ce «My Mind Was Messed Up At The Times». Tav Falco avance sur un beat triomphant. Évidemment, puisque c’est signé Mack Rice. On a les trompettes et tout le bataclan. Eugene Baffle signe «Vampire From Havana», une kitscherie inspirée sur laquelle Alex Chilton joue un killer solo. Et Tav Falco l’acclame. S’ensuivent deux absolues merveilles : «Make Me Know You’re Mine» des Swinging Blue Jeans (effarant d’élégance et swingué à l’ancienne) et «Go On Home» de Sandford Clark, pièce de country émaciée perdue dans un saloon romantique. Eugene Baffle signe une nouvelle pièce de choc, «Auto Sapien», gorgée de fuzz. Pur garage de train fantôme, une véritable leçon de tenue destinée aux garagistes du monde entier. Attention, «Oh Girls Girls» est un mambo. Tav Falco parvient à créer les conditions d’une fantastique extrapolation de garage trash. On est là dans le pur génie - I’ll take the one with the red dress on - C’est embarqué aux clap-hands et devant une telle démence, on s’agenouille et on remercie New Rose d’avoir rendu un tel disque possible. Mais ce n’est pas fini, les gars. L’animal tape dans «I’m Gonna Dig Myself A Hole» d’Arthur Crudup, sur canapé de slap (Ron Easley) et de tap drums (Ross Johnson). C’est le plus bel hommage à Big Boy qui se puisse imaginer. Jim Dickinson joue de la guitare et Alex des maracas. Et ils embrayent sur «Sent Up» de Sir Mack Rice, encore de la démence à l’état pur, on a là la confrérie de choc, Tav/Alex/Ross Johnson/Jim Dickinson. C’est tout simplement effarant d’inspiration. Ces abrutis des labels américains n’avaient vraiment rien compris. Il a fallu que ce soit un Français pas bien riche qui sorte cet absolu chef-d’œuvre ! Incroyable mais vrai. Encore une pièce infernale avec «Baby What’s Wrong» d’Al Green. Nina Tischler donne la répartie et c’est joué au doux du gras. C’est même un modèle de groove - What can I do babe - Puis il boucle l’affaire avec une reprise d’«Only The Lonely», qui relève du romantisme purulent et qui par conséquent dépasse l’idée même du rock. Tav Falco cherche du côté de la note fatale, il flirte avec le piano jazz de cabaret et les nuits de Saint-Germain-des-Prés, mais avec un léger parfum d’européanisme culturel des années trente. Admirable.

C’est un autre Français, Patrick Boissel, qui fit paraître en 1992 les fameuses «Unreleased Sessions» sur son label Marylin. On croit qu’on peut se passer de cet album, mais c’est une erreur. Il vaut largement le détour, rien que pour «The Bug», joué au petit son rockab, avec Jim Dickinson au piano et une trompette par derrière. C’est d’un amateurisme confondant. On trouve aussi une version de «She’s The One That’s Got It» complètement foireuse et une somptueuse version de «Big Road Blues». C’est Fantômas qui chante le blues fantôme. Ross Johnson bat ça en douceur et en profondeur. Le résultat est vaguement hypnotique. Voilà bien le genre de truc qu’on ne trouve que sur les disques de Tav Falvo. On se régalera du beat de «Bourgeois Blues» que traverse une stand-up qui n’est pas en mesure. Mais quel son ! Et surtout quelle ambiance ! Alex Chilton prend des solos de killer qui titube. Grâce au jeu aléatoire de Ron Miller, on obtient une mouture effarante de présence et d’inspiration. Ils tapent aussi dans l’intapable avc «Train Kept A Rolling» des frères Burnette. Ils mettent le train en route, et c’est terrible, car le son est au rendez-vous. Ils sont stupéfiants de puissance motrice. Tav Falco embarque ensuite «Red Headed Woman» comme une bête, Version sauvage et lacustre. Il ne faut plus s’étonner de rien.

Nouveau mini-LP en 1994 avec «Deep In the Shadows», toujours chez Marylin. Nouvelle production géniale signée Jim Dickinson qui met bien la basse en avant et donc on se régale de «Running Wild», car la basse leste les morceaux trop lestes. Chaude ambiance, c’est à la fois libre de ton et catégorique. Extraordinaire walking beast que ce «Cuban Rebel Girl», puis on retrouve le «Poor Boy» de Lee Hazlewood qui se trouvait déjà sur «Red Devil». «She’s A Bad Motorcycle» vient de «The World We Knew», mais c’est une joie que de retrouver cette pièce de trash-bop emmenée par l’empah-pah-outeur from outersapce. Et puis voilà l’une des pièces mythiques de Tav Falco, le fameux «Tina The Go Go Queen», signé Sir Mack Rice, belle pièce de r’n’b rampant. Tav est sûr de Sir. Il est sur le son. Il est même sous le sceau de Sir. On retrouve aussi le fameux «Working On A Building» avec une grosse basse sourde sous le couvert. Bien sûr, tout cela se déroule chez Sam Phillips.
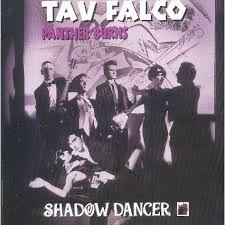
Avec l’album «Shadow Dancer», Tav Falco va mordre le trait et aller un peu plus vers le tango. Il ouvre son bal avec «Invocation Of The Shadow Dancer», pur tango, puis il va droit sur le itchy-kitschy petit bikini de «Funnel Of Love», le redoutable classique de Wanda Jackson. Il paraît évident que cet album ne pouvait pas plaire à tout le monde. Pour corser l’affaire, il y rajoutait des petites rengaines italiennes qui par leur parfum d’exotica, ne pouvaient que faire fuir les amateurs de rock. La merveille de cet album s’intitulait «Have I The Right», joyeux et entraînant, bien battu par Jim Sclavunos. Mais sur le reste de l’album le kisch et le tango régnaient sans partage. C’est à cette époque que les disques de Tav Falco cessèrent définitivement de se vendre. Ils devinrent des piliers de bacs à soldes.
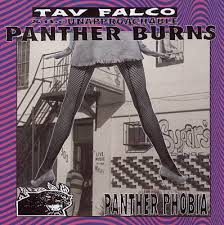
Malheureuse méprise ! En 2000, Tav était de retour avec l’un des albums les plus spectaculaires du XXIe siècle : «Panther Phobia», produit par Monsieur Jeffrey Evans pour le compte d’In The Red Recordings. Tav ouvrait le bal avec «Streamline Train», un cut monstrueux de Memphis sound, battu par Ross Johnson le miraculé. Jack Oblivian jouait de la basse. On avait là le meilleur ramassis du monde. Quelle purge ! Et ça continuait avec une ribambelle d’énormités du genre «She Wants To Sell My Monkey», fantastique brouet d’intrusion cataclysmique, une bête impitoyable. Puis une reprise de Wolf, «Going Home», où Tav Falco semble réinventer le boogaloo en hurlant à la lune. S’ensuivait «Once I Had A Car», heavy comme l’enfer, démenterie corporatiste absolue, fabuleux d’entrain et plombé d’étain ambré. Et ça continuait avec «The Young Psychotics» pulsé aux chœurs de folles - psycho psycho ! - pur génie, désolé de ramener constamment le génie, mais c’est malheureusement le seul mot qui convienne. La basse de Jack O grimpe bien devant, et par derrière, c’est claqué aux vieux accords. S’ensuit une reprise terrible de «Wild Wild Women» de Johnny Carroll, avec l’emportement de bouche garanti, pur jus rockab et là on tombe sur une nouvelle preuve de l’existence de Dieu : la reprise du fabuleux «Cockroach», un instro signé Charlie Feathers. Ambiance démentoïde, c’est joué bien raunchy. Puis on a un coup de chapeau magistral à Rural Burnside avec «Mellow Peaches», on sent l’appel des champs de coton dans l’écho du son, c’est admirable de lourdeur de grattage. Puis voilà le hit d’Eugene Baffle, «Panther Phobia», bien poundé à la basse et monstrueux d’ambition phobique. C’est tellement énorme au plan cabalistique que ça en devient absurdement hypnotique. Si vous cherchez un album de rock parfait, en voilà un.

Le dernier album studio de Tav Falco s’appelle «Conjurations - Séance For The Deranged Lovers». Il date de 2010. Tav y rend de sacrés hommages, puisqu’il y célèbre les masques et ça nous renvoie directement à Paul Verlaine (Masques et Bergamasques), mais aussi et surtout à Marcel Schwob (Le Roi Au Masque d’Or). Tav Falco s’enferme de plus en plus dans le mystère, ce qui lui va bien. «Sympathy For Mata Hari» est un joli stomp des mystères de la chambre jaune. Sur «Administrator Blues», Tav Falco sort sa fuzz comme on sort une épée. Il revient au grand vent d’Ouest du Memphis sound. On y entend aussi pas mal de tangos, et on arrive tranquillement au pied d’un véritable chef-d’œuvre, l’autobiographique «Gentleman In Black», une belle revanche de Tav Falco sur son impopularité. Il se dévoile d’un seul coup de cape - He travels fastest who travels alone - et il lâche à un moment l’aveu suprême - he leaves the people hanging to just sit and stare/ At a few moments of brillance in a lifetime of despair - Rien d’aussi bouleversant sur cette terre que cette confidence.
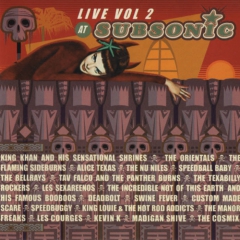
Les admirateurs de Tav Falco n’auront pas hésité une seule seconde à se jeter sur les albums live, car ils savent que les classiques y retrouvent du rouge aux joues. La version de «Brazil» qui se trouve sur l’album «Live At The Subsonic» (pochette ratée) est admirablement swinguée aux drums par un nommé Doug Hodges. Comme il amène bien les montées ! Cette version est assez magique, pleine de boisseaux d’accords généreux. Tav Falco mêle son jeu subtil à celui du guitariste Peter Dark - from New York City ! - et on chavire au son du scintillement de ces fabuleux boisseaux.

On renouvellera l’expérience avec l’album «Live In London At The 100 Club», qui est aussi un gros festival, un double album enregistré avec la formation actuelle (Giovanna, Grégoire Garrigues et Laurent Lanouzière). Belles versions de «Snake Drive», «Ooee Baby», «Brazil», «Funnel Of Love» et il boucle l’affaire avec une version surnaturelle de «Gentleman In Black» et «My Mind Was Messed Up At The Time» de son mentor Sir Mack Rice.
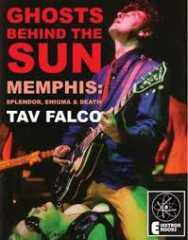
Tav Falco a passé un accord avec le label allemand Stag-O-Lee pour rééditer tous ses albums. C’est une bénédiction, car chaque disque est largement annoté de la main de cet écrivain fabuleux qu’on a découvert lors de la parution de «Ghosts Behind the Sun: Splendor, Egnima & Death», en 2011. Ce qui frappe le plus chez l’écrivain Tav Falco, c’est le souffle. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi recours à un stratagème superbe : le dédoublement de personnalité. Tav Falco se projette dans un alter-ego nommé Eugene Baffle, histoire de mieux se décrire, comme l’avait fait Michel Houellebecq dans «Les Particules Élémentaires». Et petite cerise sur le gâteau, Tav Falco dédie son fantastique ouvrage à Jim Dickinson («D’origine divine, protecteur, inspirateur et camarade. Sa passion pour la musique de Memphis et tout ce qui s’y rattache est indiscutable. Il est toujours présent, c’est sûr, comme l’indique l’épitaphe qu’il a fait graver sur sa tombe : Je ne suis que mort. Je ne suis pas parti.»). Pour mieux expliquer ce qu’est Memphis, il apporte le seul éclairage qui vaille, celui de l’histoire. Il propose une galerie de portraits hallucinants, des soldats de la Guerre de Sécession, des gibiers de potence, des Hell’s Angels, des poètes puis on finit par tomber sur des figures plus familières (et donc plus rassurantes), comme Sam the Sham, Jerry Lee, Sam Phillips et Charlie Feathers. Il donne carrément la parole à Paul Burlinson, qui au long de plusieurs pages, va retracer le parcours fulgurant du Johnny Burnette Rock’n’Roll Trio. Furry Lewis, Howlin’ Wolf et Albert King sont là, bien sûr, salués jusqu’à terre. Tav Falco donne la parole à Jim Dickinson qui évoque Elvis, le rockab et le souvenir de Dan Penn au long de pages qu’il faut bien qualifier de magiques. Puis Tav Falco remonte dans le temps jusqu’à nous et régale bien les admirateurs de Big Star, d’Alex Chilton et des Cramps. C’est l’ouvrage qu’il faut lire si on veut essayer de saisir l’importance du rôle qu’ont joué les musiciens de Memphis dans l’histoire du monde moderne. L’écrivain Falco a du style. C’est un visionnaire élégiaque. Il donne du temps au temps de ses phrases et semble toujours porter un regard détaché sur les choses. À l’image de la photo qui orne la couverture de son livre, sa prose est véritablement hantée.
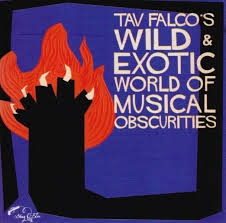
Et c’est pour cette raison qu’il faut rapatrier une compilation intitulée «Tav Falco’s Wild Exotic World Of Musical Obscurities» et récemment parue, car tous les portraits sont signés Tav Falco : Johnny Burnette, Don Willis, Bobby Lee Trammell, Allen Page (sur Moon Records de Cordell Jackson, deux guitares, pas de basse, précise-t-il), Arthur Big Boy Crudup, Benny Joy, rien que pour les rockabillies et ça fourmille d’informations, ça grouille de détails, on a vraiment l’impression qu’il a fréquenté assidûment tous ces gens là. C’est à la fois effarant et passionnant. Et extrêmement bien écrit. Vous ne verrez pas souvent des notes de pochette d’un tel niveau. Mais là où il va encore plus épater la galerie, c’est avec les trois autres faces de ce double album. Sur la face B, il a rassemblé des pièces d’exotica sublimes et comme il les présente et qu’il brosse des portraits terribles des interprètes, alors on les écoute attentivement. Et on découvre des merveilles, des choses qu’on avait déjà entendues comme «Harry Lime Theme» d’Anton Karas (magnifique pièce de jazz guitar), mais aussi des pièces raffinées sorties de sa culture : «Romance Del Barrio» par Los Indios Tacunau («Guitar tangos are particular favorites of mine»), ou «Desde El Alma» par Osvaldo Pugliese («It is said that an Argentine is an Italian who speaks Spanish, ates French and thinks he’s English»). Sur la face C, il a rassemblé quelques classiques de blues d’Elmore James («The Sky Is Crying» - «America is a sad country and that’s what Elmo’s guitar was saying»), de Bobby Blue Bland («Who Will Be The Next Fool Be», Tav Falco en fait le portrait d’une star «astonishingly silver-throated», pour lui c’est la star suprême et il sait le dire), Chet Baker («I’m A Fool To Want You», portrait d’un romantique, l’absolu - à quoi bon vivre si on n’aime pas ?), puis il revient au kitsch avec Fred Buscaglione (un rital qui s’est tué à Rimini au volant d’une pink Cadillac). La dernière face est une collection d’hommages aussi grandioses. Il salue Jimmy Whiterspoon («Sweet Lotus Blossom», mais comme il n’a pas réussi à trouver la version originale, il colle la version des Panther Burns). Puis un hommage bouleversant à Charlie Feathers («Jungle Ferver» - «He reached delirious heights unknown in the annals of American recorded music»), puis coup de chapeau à Alex Chilton («Bangkok», et Tav Falco explique qu’Alex a enregistré ça tout seul). Et il termine sur le plus faramineux des hommages : «Real Cool Trash» coup de chapeau à Baldu des Dum Dum Boys et il donne une belle définition du rock’n’roll qu’on devrait enseigner dans toutes les écoles : «Impulsive repetition, droning guitar & psychedelic riffs, histerical breaks and a finale of demented invocation of all the demons of the night that suspends the lead vocal for an eternity on the treshold of the void.»)
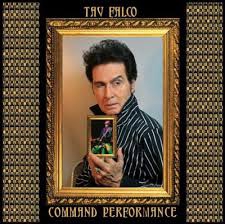
Vient de paraître le nouvel album de Tav Falco, «Command Performance». C’est un disque totalement hanté. À commencer par «Fire Island», «autobiographical from Argentina», monté sur une belle basse et joué au bandonéon. Superbe supercherie ! Tav Falco commente chaque moreau. Il dit de «Whistle Blover» que c’est une «wistfulade to the loss of the true American ethos». Il chante ça à la manière de Bob Dylan. Il indique que c’est un hommage aux héros de notre époque, Snowden et Manning. Puis on passe au pur boogaloo avec «About Marie Laveau», the witch queen of New orleans. On s’en régale - Is that true/ What they say - L’admirable tempo semble cheminer sous la pleine lune. C’est effarant et bien vu à la fois. Avec «Doomsday Baby», Tav s’élève contre les génocides. Il a raison - Insect baby ! - Il ramène le son qui va avec. Puis il rend un fantastique hommage à son ami Alex Chilton - my fallen comrade, a gifted artist and mentor of towering sensibility - En peu de mots, Tav sait brosser des portraits terribles. Il rend bien sûr un hommage à Fantomas avec «Master of Chaos», perdu in the long shadows of evil. Et il en rajoute - The genius of torture, the Lord of terror - Il décrit avec délectation les méfaits de son héros, les flacons d’acide nitrique et de parfum, la comtesse Lejeune et tout le saint-frusquin. Quel fantastique hommage à Fantomas ! Dans la série des hommages, voilà celui rendu à Charlie Feathers, avec «Jungle Ferver» - The canon of my confederate and mentor Charlie Feathers - Il réussit à le saluer, et après des transgressions ineptes, il parvient à rattraper le thème. Franchement, ce disque sonne comme un testament ! S’ensuit un hit, «Memphis Rumble», hommage aux dix-sept années passées à Memphis. On a le son de rêve et les paroles de rêve, le tout ficelé par un artiste de rêve. Puis il reprend «Me And My Chauffeur Blues» avec Mario Monterosso. Il essaie de se mettre au niveau de Memphis Minnie et de Kansas Joe McCay. Il finit bien sûr avec le tango fatal, «Rumbetta».

Tav Falco vient de mettre son univers en images avec un film hommage à Louis Feuillade, «Uriana Descending», tourné en noir et blanc et d’allure très poétique, puisque dans la mythologie grecque, Uranie est la muse qui préside à l’astronomie et à l’astrologie. Tav la nomme the muse of heavens. Ce film était présenté en avant-première au Silencio, un club-galerie installé par David Lynch dans les entrailles de la rue Montmartre. «Uriana Descending» ? Mais c’est du cinéma fantastique à l’état pur, à la fois baigné de lumière expressionniste comme les «Trois Lumières» de Fritz Lang et chargé d’ombre et de mystère. Gina Lee traîne au bord d’un fleuve en Arkansas et des heavy dudes lui tournent autour sur fond de «Jungle Fever». En trois minutes, Tav Falco produit l’essence même du rock américain, gros moulin, gros bras, jupe courte et Charlie Feathers. Cinq minutes plus tard, Gina Lee débarque à Vienne et nous plonge dans une dimension intemporelle, celle d’une ville figée dans le passé. Gina Lee erre longtemps dans Vienne et nous ensorcelle petit à petit, par la seule force de son charme discret. Lorsque Diego Moritz (Tav Falco) l’accoste, c’est évidemment pour lui proposer une mission d’espionne. Alors Gina Lee passe du statut de muse descendue du ciel via Berlin Airlines à celui de Mata-Hari chargée de séduire Von Riegl, le descendant d’un officier SS pour lui soutirer le plan d’un trésor de guerre nazi immergé au fond d’un lac autrichien. Et bien sûr, pour le séduire, il faut apprendre à danser le tango argentin. Tav Falco se fait une joie de l’initier et on assiste alors à une très belle scène de danse. Gina et Von passent une délicieuse soirée ensemble, et au petit matin, Von raccompagne Gina à l’hôtel Orient en calèche. Comme c’est du cinéma muet, les pas des gens et les sabots des chevaux sont illustrés par les bruitages, mais on aura veillé à décaler les bruitages. On entend parfois la voix de Tav Falco et des écrans de texte introduisent les scènes principales. Tout cela fonctionne à merveille, à condition toutefois de bien aimer ce type de cinéma. On ne sort pas indemne du «Napoléon» d’Abel Gance. Eh bien, il en va de même avec «Uriana Descending». Puis le rythme du film va s’accélérer et Von va bien sûr devenir Fantomas. On verra aussi Tav Falco conduire une moto sur les routes autrichiennes et produire une splendide pétarade.

Un concert était prévu un peu plus tard dans la soirée. L’atmosphère intimiste du club convenait merveilleusement bien à un set des Panther Burns. Sur scène, Tav semblait avoir énormément rajeuni. Il y eut des moment où il rigolait comme un gamin. Et il nous fit la grâce de rassembler les personnages de sa mythologie pour une heure trente de bacchanale infernale : Charlie Feathers avec une reprise de «Jungle Fever», Mata-Hari, Fantomas, via «The Master Of Chaos» et même «Marie Laveau» tirée elle aussi du dernier album, cut sur lequel Grégoire Garrigues faisait les chœurs - Is that true/ What they say - Tav mit aussi en perspective les grooves interlopes de «Garden Of Medicis» et de «Ballad Of Rue De La Lune», tirés de «Conjurations». Ambiance spectaculaire, tout le monde dansait. Et puis on le vit danser le tango avec Via Kali et ce fut un vrai moment de féerie Vous ne verrez pas ça chez les Stones. En rappel, Tav revint jouer son vieux «Brazil» et ce fut une fois de plus l’occasion de savourer le fantastique drive de basse de Laurent Lanouzière.

On venait tout simplement de prendre un gros shoot d’oxygène. Comme Lux Interior, Captain Beefheart, Jeffrey Lee Pierce, Ray Davies, Mick Farren ou Bob Dylan, Tav Falco est parti de zéro pour créer un univers complet qui fonctionne à merveille. Tous ces gens ont ceci de commun qu’ils sont écrivains, musiciens, découvreurs/passeurs et pour certains, ils se sont aussi frottés au cinéma avec la réussite que l’on sait. On parle ici de ce qui légitime la rock culture.

Signé : Cazengler, Pantin Burns
Tav Falco. Silencio. 142 rue Montmartre. Paris IIe. 18 septembre 2015
Tav Falco’s Panther Burns. Behind The Magnolia Curtain. Rough Trade 1981
Tav Falco’s Panther Burns. Blow Your Top. Animal Records 1982
Tav Falco’s Panther Burns. Sugar Ditch Revisited. New Rose Records 1985
Tav Falco’s Panther Burns. Shake Rag. New Rose Records 1986
Tav Falco’s Panther Burns. The World We Knew. New Rose Records 1987
Tav Falco’s Panther Burns. Red Devil. New Rose 1988
Tav Falco’s Panther Burns. Midnight In Memphis. New Rose Records 1988
Tav Falco’s Panther Burns. Return Of The Blue Panther. New Rose Records 1990
Tav Falco’s Panther Burns. Life Sentence. New Rose Records 1991
Tav Falco’s Panther Burns. Unreleased Sessions. Marylin 1992
Tav Falco’s Panther Burns. Deep In The Shadows. Marylin 1994
Tav Falco’s Panther Burns. Shadow Dancer. Upstart 1995
Tav Falco’s Panther Burns. Panther Phobia. In The Red Recordings 2000
Tav Falco’s Panther Burns. Live At The Subsonic - France 10.2001. Frenzi 2002
Tav Falco’s Panther Burns. Conjurations - Séance For The Deranged Lovers. Stag-O-Lee 2010
Tav Falco’s Panther Burns. Live In London At The 100 Club. Stag-O-Lee 2012
Tav Falco. Comand Performance. Twenty Stone Blatt 2015
Tav Falco’s Wild Exotic World Of Musical Obscurities. Stag-O-Lee 2014
Tav Falco. Ghosts Behind the Sun: Splendor, Egnima & Death. Creation Books 2011
Tav Falco. Uriana Descending. Avec Via Kali, Peter Reisegger et Tav Falco. 2014

COUILLY-PONT-AUX-DAMES
METALLIC MACHINES / 18 - 09 - 15
SPUNYBOYS

Tiens donc, une commune qui n'a pas cédé au vertiges du politiquement correct comme Tremblay les Gon(z)esses désormais en France et qui porte fièrement son nom à coucher sous les ponts en galante compagnie, les attributs de la virilité vent debout. Mais foin de nos douteuses étymologies, nous sommes en partance vers le local des Metallic Machines – à dix kilomètres de Meaux, derrière le Super U. N'allez pas imaginer une soupente de cinq mètres carrés avec les Harley stationnées sur le trottoir. Rien que dans la cour intérieure il y a déjà une quarantaine de voitures garées. Nous sommes reçus dans une grande pièce, bar, espace, tables, sièges et banquettes. De quoi rendre jaloux les trois-quarts des troquets qui invitent les groupes. Mais ce n'est qu'un début, la pièce réservée au concert est à côté, une véritable salle avec une scène, qui a oublié d'être minuscule, montée sur palettes, idéale pour les combos de rock. Vous pouvez y entasser deux cents personnes sans problème. Grand standing. Rien à voir avec le confinement en abri anti-atomique un jour de guerre nucléaire. Parfait pour les garçons tourbillonnants qui ont l'habitude de jouer grand largue toutes voiles dehors.
CONCERT
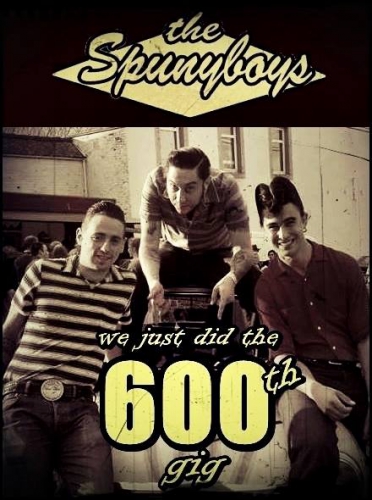
Eddie vérifie l'accordage de sa guitare, Guillaume cherche ses baguettes, Rémi se cale sur le micro. Profitez de ces deux petites dernières minutes de calme. Respirez profondément. Tout à l'heure ce sera trop tard. Trop tard, nous vous avions prévenus. C'est parti. Pour deux heures de folie. Sans interruption. Sinon trois secondes pour se concerter du regard : « C'est quoi maintenant ! » et un déluge de feu vous tombe sur le coin du museau sans que ayez le temps de dire ouf. Les oufs, ce sont les Spuny, doivent avoir le coeur qui tourne plus vite qu'un rotor d'hélicoptère. Ne sont pas le meilleur trio de rockabilly hexagonal par hasard. Même que les Belges et les Néerlandais commencent à les annexer de plus en plus souvent. Mais ceci est une autre histoire. Nous sommes ici à Couilly, et dans un vrai concert, pas dans une découpe de trois sets, une de ces pernicieuses saucissonades habituelles qui permettent aux bistrotiers de remplir la caisse.

Pour ceux qui ne connaissent pas les Spuny, ça commence toujours bien. Comme un conte de Walt Disney. Bien sûr il n'y a pas de princesse. Uniquement le joli sourire de Rémi nonchalamment agrippé au manche de sa contrebasse. Quelques mots gentils, manière de vous accueillir dignement. Pas le temps de vous endormir et de faire de beaux rêves bleus, c'est Guillaume qui sans vous avertir déclenche les hostilités. Deux coups de canons à envoyer un porte-avion par le fond en deux secondes et puis une cascade infinie de breaks qui se bousculent et se mordent l'un dans l'autre avec une vélocité sans pareille. Un peu comme vous tournez les pages d'un livre à toute vitesse pour savoir la fin. Mais lui il ne saute pas une note de la partoche, n'omet même pas une seule ponctuation, vous les assène toutes, sans faillir, pétarades de missiles qui vous transpercent le corps sans rémission. S'il était le seul à se livrer dans son coin à ce cruel jeu de punching ball avec votre âme, vous pourriez lui pardonner. Mais non, Rémi en a profité pour se jeter sur sa contre-basse. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais ce doit être grave. Lui hurle dessus en dansant comme un sioux autour du poteau de torture, et puis sans préavis l'escalade, lui saute sur le giron à pieds joints, enfin s'y niche sur l'épaule comme l'ajasse bavarde sur la plus haute branche, la transforme en poste de guet – au cas où l'ennemi surgirait – l'abat à terre, se vautre sur elle – sont-ce là les derniers outrages ? Non, il la cogne violemment contre la grosse poutre du plafond. Faut bien lui apprendre à vivre. Et à mourir ! Cela ne serait rien, s'il ne poussait le vice à en jouer tranquillement comme s'il tenait délicatement contre le velouté de sa joue gauche un précieux Stradivarius centenaire que lui aurait confié l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Mais vous n'avez pas tout vu. Car non seulement il lui pince les cordes à profusion, les tape et les tire, en parfait unisson avec Guillaume - et avec ce marteau-pilon intraitable, l'a intérêt le Rémi à composer de la dentelle solide, car l'on n'emballe pas les torpilles avec du papier de soie faut les arrimer avec de filins d'acier galvanisés au titane – mais de temps en temps il se lance dans de rapides soli qui swinguent à mort. Reprenons pour ceux qui sont perdus : un, il détruit son instrument avec autant de méthode que Descartes son fameux Discours, deux, il interprète ses morceaux avec la dextérité de Franz Liszt pianotant son pleyel – vous pouvez remplacer Liszt par Jerry Lou si vous préférez, trois, il chante. Et pas qu'un peu, tous les morceaux, n'en laisse pas un seul aux copains. Même si derrière sa caisse Guillaume connaît toutes les paroles par cœur et les récite comme des mantras dévastateurs en dépeçant ses tambours maléfiques. Rémi doit pratiquer la plongée sous-marine en grande profondeur sans masque ni bouteille. Entre deux titres il suffoque comme un phoque asthmatique, souffle court qui s'essaie aux longues inspirations, avale deux goulées d'air frais comme vous deux lampées de café matinal lorsque vous êtes en retard et que vous savez que le patron vous attend sous la pendule avec à la main votre lettre de démission à signer, et hop d'un coup il bloque les amygdales et c'est reparti comme en quatorze, baïonnette au gosier. Comment se débrouille-t-il ? Voix de tête, colonne d'air, profondeurs abdominales et ventriques, je n'en sais rien mais le bougre possède une sacrée technique. Apprise ? Instinctive ? Cochez vous-mêmes la bonne réponse.

C'est que, entendez-vous mugir en vos campagne cette voix qui déchire, les Spuny ils jouent du rock and roll, pas le générique de la petite maison dans la prairie. Mais il est temps de passer la parole – pardon la guitare – à Eddie. N'avons pas eu encore le temps de nous attarder sur lui car les deux autres ostrogoths ce soir ils occupent le devant de l'ampleur sonore. A lui de sa fader le véritable boulot. Attention je n'ai pas dit que les deux quécous se la coulent douce – mais ce soir Eddie est privé de ses éclatantes et métalliques cisailles diluviennes. Bien sûr, il ne peut s'empêcher d'en laisser échapper une par-ci par-là – merveilleuses sur le Goin' Home de Gene Vincent - mais là, il a vraiment trop de taf. Tout est une question de répertoire. Et pour être précis d'appréhension de ce dit-répertoire. Le style des Spuny c'est de l'énergie pure, celle-ci s'obtient de différentes manières. A toute blinde et arrive ce qui arrive, sauve qui peut et chacun pour soi, et vous faites du punk. A toute blinde mais cette fois-ci la rythmique étaye la galerie au fur et à mesure que vous avancez, la découpe du coffrage à la guitare électrique passe en première place, c'est le rock and roll. Passons sur l'amplification sonore, hard, heavy, doom etc... Vous reste une autre solution, plus historiale qui s'en va chercher les racines du rock dans ses origines country, dans sa ruralité rockabilienne, dans l'antique western bop rebopifié à outrance, tout cela pour donner ce mélange explosif mis au point par les Teddies anglais dans les années soixante-dix quatre-vingt. C'est avec cette mouture que les Spuny ont décidé d'offrir en cette soirée à leurs spectateurs en partie composés de bikers aux affiliations ted. La ramification des tribus ( quand ce ne sont pas des églises intégristes ) rock est d'une complexité infinie. Mais ceci est une autre historiette. Sacré turbin pour Eddie. Les deux autres forcenés qui galopent sans frein ni retenue, lui ont refilé le métier à tisser. La section rythmique caracole par-devant et c'est au guitar-héros de tisser la trame de base. Do the bop. Fait le bop. Il articule la syncope originaire. Ce n'est pas un-deux, un-deux, je m'en bats les Couilly-au-pont des dames, Eddie il ne joue pas dans la fanfare municipale à la va comme je te pousse et marche tout droit. La différence est dans le doigté, dans la subtilité. Guillaume et Rémi sortent les lingots du four mais c'est Eddie qui est au laminoir et qui livre le produit fini. Johnny Horton, Ronnie Dawson, Ray Campi, Johnny Cash, George Jones, que du bon, mais encore faut-il les rhabiller pour l'hiver des temps nouveaux qui s'annonce rude. Transformer sans trahir. Recouper sans couper. Adapter et s'adapter. C'est en cela que réside le balancement hypnotique – celui qui emporte mais qui n'endort pas - du pur style teddy. Faut de la sagacité, de la réflexion, des connaissances, de l'intelligence. Tout ce dont – tout ce don - possède Eddie. A revendre. Et son dévouement rythmique fut exemplaire. Le grand jeu. A la furia des deux copains il a apporté l'authenticité sans laquelle tout effort n'est que redite et répétition. Maintenant ce n'est pas 2 + 1, mais un trio de trois qui ramone en parfait unisson. C'est une architecture méditée – à allure d'étoile filante – qu'ils élaborent ensemble, de concert.

Les Spunyboys nous ont gâtés. Nous ont offert un concert d'anthologie. De ceux qui montrent que le cœur brûlant du rock and roll continue d'irradier nos désirs et la sève de nos rêves. One, two, three, four, five, rock'n'roll is still alive !
André Murcie.
GLAM ROCK
LA SUBVERSION DES GENRES
PHILIP AUSLANDER
( La Rue Musicale / La Découverte / 02/2015 )

Nouvelle collection chez La Découverte – les héritiers des Editions Maspéro – et de la librairie parisienne La Rue Musicale. N'ont que deux ouvrages dans leur série un David Bowie et ce volume consacré au Glam Rock. De Philip Auslander. Un professeur à l'université du Kentucky. Comme il est bien connu qu'ailleurs l'herbe est plus bleue, j'achète sans trop regarder. Fatale erreur. Dont je me repens en toute humilité. Mea culpa ! Mea culpa ! Faudra que je pense à en causer deux mots à mon confesseur sur mon lit de mort. J'ai lu quelques milliers de livres dans ma vie, aucun ne m'a plus ennuyé que celui-ci. Et pourtant dès qu'un quelconque bouquin porte sur sa jaquette le mot rock, il bénéficie chez moi d'un a-priori favorable.
SUZI QUATRO

Je commence par le quatrième chapitre. Suzi Quatro ( mathématiquement parlant c'est assez bien vu ) en est l'objet d'étude. Je n'ai rien contre la damoiselle. Un peu garçonnasse – je me mets à l'unisson de l'auteur - j'en conviens, mais l'on sent la chic fille qui en veut. J'avoue que je ne me suis jamais levé la nuit pour écouter ses disques. Ni pour me masturber devant son poster. C'est sûrement une erreur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Philip Auslander. Un grand connaisseur. Vous épluche la discographie au peigne fin. Les chansons une par une. Avec une prédilection pour les reprises. Qui furent en leur native originalité très souvent interprétées par des chanteurs mâles. Vous n'y voyez pas de mal. Philip Auslander y dénote de la perversité. Un garçon qui chante Baby I love You à sa copine reste de l'ordre de la normalité, mais la petite Suzon avec son futal et son blouson de cuir qui reprend Baby I love you, c'est de la transgression. Mélange des genres. S'adresse-t-elle à une fille ou à un mec ? Et l'auditeur qui entend cela, est-ce Suzette qui lui fait agiter sa zézette ou l'idée du mec qui la baise ou le fantasme qu'elle pourrait être le mec qui lui fasse subir les derniers outrages ? Vous ne savez plus à quelle queue de chatte donner votre langue. Pas de panique ( nique, nique, niqueue, niqueue ) la Suzi elle a du répertoire, alors le Philip Auslander il vous refait la démonstration une cinquantaine de fois à la suite.
GLAM DEFINITION
C'est un peu l'idée fixe d'Auslander. Le Glam comme une subversion des genres. Fille ou garçon. L'on ne sait plus. Frontières indéterminées. Ouvertes à tous les trans. Musicalement n'en parle pas trop. Trop d'artistes différents se sont réclamés de ce courant pour qu'il puisse être résumé en quelques mots se dépêche-t-il d'avancer. Ou alors des guitares affûtées qui entrent dedans. Allo, doctor Lacan, ne serait-ce point un lapsus significatif ? Préfère discutailler sans fin des tenues des chanteurs et des réactions du public.
T-REX

Commence par T-Rex. La partie la plus intéressante du livre. Remonte à la période préhistorique de l'artiste lorsqu'il s'appelait Tyranosus Rex. C'était du temps des hippies et du psychedelic. Une époque ancienne. En ces âges reculés Marc Bolan aimait Dame Nature et lisait Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien. Ecrivait de belles paroles moyenâgeuses, un peu évanescentes remplies de gentes pucelles aux licornes biscornues. Ne faut jamais se fier aux apparences. De temps en temps, notre preux chevalier se saisissait d'une guitare électrique et vous balançait quelques riffs soutenus. Et puis en y réfléchissant un peu, un duo de deux hommes, c'est tout de même un peu ambigu. Et puis toute cette idéologie un peu fleur bleue, c'était tout de même un peu féminin...
Et voilà que du jour au lendemain nous assistons à la mort du vieux dinosaure et apparaît une nouvelle espèce qui s'en va triompher lors de cette ère nouvelle de glamaciation. C'est le T-Rex. Vous l'entendez de loin avec ces guitares clinquantes qui vous claquent dans les oreilles. Bye-bye les hippies, Mar Bolan s'inspire des vieux rockabillies et des premiers Stones de l'âge de pierre des premiers blues électriques. Belle musique, mais ce n'est pas le plus important. Faut voir la bête. Un homme, çà ! Vous rigolez, avec son mascara, ses vêtements empruntés à sa femme, et ses paillettes sur les joues ! Une pédale, une tantouze, la honte de ses parents. Et du royaume.
Peut-être, mais des milliers d'adolescents aux désirs inavouables aperçoivent à la télévision, un homme ou peut-être une femme, délicieuse incertitude, qui ressemble à leurs rêves les plus secrets. T-Rex fonde le Glam, il est cette musique qui permet à chacun de vivre selon son genre.
BOWIE THEORIQUE

T-Rex, c'est bien bon, mais il reste au fond de lui un rocker de base. Pourvu que les stratos fusent à plein gaz derrière lui, il est heureux. L'accoutrement, c'est un gimmick qui permet de se démarquer des autres et de gagner plein d'argent. Bowie c'est l'étage au-dessus. Pas vraiment un philanthrope. N'oublie jamais le tiroir caisse. Mais c'est un Artiste. Qui pense. Qui réfléchit. Qui médite sur son art. Qui théorise. S'habiller en femme, quel simplisme ! Son Ziggy poussière d'étoile une créature venue d'un autre monde, mâle ou femelle ? Les avis divergent. Bowie laisse planer l'incertitude. De même quant à sa propre personne qui n'est peut-être qu'un sale personnage de plus. Fernando Pessoa avait bien créé ses poétiques hétéronymes sur papier mais n'avait pas cherché à les incarner dans sa chair. Bowie lui s'avouera tour à tour, du bout des lèvres ou en lapidaires assertions, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. Débrouillez-vous comme vous pouvez.
Le genre de méli-mélo qui enchante Auslander. L'important ce n'est pas d'être ou ceci ou cela. La grande force du Glam assure-t-il c'est de ne donner jamais de réponse franche. C'est dans ce nuage d'incertitudes que le fan accomplira son chemin personnel qui n'appartient qu'à lui. Brouillard de protection et de camouflage qui vous permet de prendre assez de force pour un jour enfin dévoiler à la société entière ce que vous êtes vraiment. Sans oublier toutefois que pour vivre heureux faut savoir vivre caché.
QUEER ÊTES-VOUS ?
Ce que raconte Auslander n'est pas nécessairement idiot. Ce qui est un peu embêtant c'est qu'il analyse un phénomène sociologique qui s'est déployé entre 1971 et 1975 en employant des concepts qui ne se sont installés dans les habitudes mentales de nos contemporains que depuis ces toutes dernières années. Toutes ces théories du genre qui explicitent que les genres féminin et masculin ne sont pas afférents à notre sexe. Tout se passe dans la tête, et ni dans le zizi et ni dans le kiki. Genre de discours qui affolent les bien-pensants et les réactionnaires de tous poils ( au cul ). Par exemple : les cathos de la Manif pour Tous détestent ce genre de ratiocinations sexu-identitaires qui détruisent l'édifice traditionnel des rôles représentatifs des deux sexes dans l'organigramme sociétal.

AFTER GLAM
Ces réflexions Auslanderiennes participent de toute relecture de l'histoire du monde. Toutes les époques relisent le passé avec leurs propres outillages conceptuels. L'est difficile de faire autrement. Mais notre penseur se livre à une véritable annexion du Glam. Le crédite un peu trop d'intentions théorisantes. A notre avis. Limite le phénomène à une simple évolution des mœurs de la société. Et surtout oppose systématiquement paragraphe après paragraphe la modernité artefactienne du glam, dont il dit le plus grand bien, au passéisme de l'idéologie, qu'il qualifie somme toute de très conservatrice, des hippies. Ces théories du genre procèdent quand même beaucoup plus des mouvements de réflexion suscitées par les tentatives d'une vie davantage en relation avec les lois de la nature que des prises en main destinales des individus mis en mouvement par la musique glam.
Le futur du glam, ce fut le no future du punk, comme notre auteur le souligne très bien dans sa conclusion. La révolte pure, et non la remise en question raisonnante de la société. Le livre aurait gagné à n'être qu'une plaquette théorique d'une cinquantaine de pages. En fait, tous les chapitres qui détaillent les carrières de Marc Bolan, Glary Glitter, Alvin Stardust, David Bowie, Bryan Ferry, Roy Wood, Suzy Quatro, au Runnaways et quelques autres sont presque de trop. Superfétatoires. Un comble pour un livre consacré à un mouvement musical.
Damie Chad.
L'ARPEGGIO OSCURO
HERVE PICART
Edition Blanche / 2015
Inutile de vous précipiter chez votre libraire. C'est une rareté. Tirage à limité à cinquante exemplaires. N'y a que les plus grandes institutions de la planète qui l'ont reçue. La Bibliothèque du Congrès aux USA, l'Ancienne Bibliothèque Impériale de Chine, l'Enfer de la Vaticane, la Bibliothèque ( reconstituée ) d'Alexandrie en Egypte, et bien entendu, mais cela ne vous étonnera pas, votre rock blog préféré, KR'TNT !
Nous n'allons pas faire les modestes devant tant d'honneur, nous l'avons mérité. Nous vous en avions déjà causé de L'Arpeggio Oscuro ( arrêtez vos stupides ricanements allusifs à la couleur de la couverture ) dans KR'TNT ! 197 du 10 / 07 / 2014. La mémoire vous revient ! Oui il s'agit de cette sombre histoire qui vous a tenu en haleine tout une année, une fois par semaine, sous le blogue du même nom. Un roman feuilleton que n'aurait pas renié Alexandre Dumas, mais attention au goût du jour, pas une poignée de mousquetaires bravaches et batailleurs, non un truc beaucoup plus subtil, un mystère impénétrable, une malédiction diabolique ourdie depuis plusieurs siècles. Une satanique conspiration à côté de laquelle le carrefour de Robert Johnson ne tient pas longtemps la route.

Les plus fins limiers de nos lecteurs se douteront que nous n'avons pas cité le nom de l'inspirateur des plus grands guitaristes du rock des seventies au hasard. Celui qui mène l'enquête n'est pas le premier Sherlock Holmes venu. S'appelle Vernon Gabriel. Possède une profession honnête, c'est un noble commerçant – je sais, ces deux mots vous paraissent antagonistes - qui vend des guitares – vous voici rassurés. Je n'ai pas parlé de vulgaires poêles à frire japonaises mais de ces perles dont l'orient fut caressée par un Jimmy Hendrix ou un Cliff Gallup, ce ne sont que des exemples. C'est que celui qui tient la plume n'est qu'une de vos idoles, Hervé Picart in person, l'inoubliable kronicoeur de la rubrique Hard, de la légendaire revue Best.
Les grincheux de service diront que tout ce le verbiage qui précède n'éclaire en rien ce fameux Arpeggio tan Oscuro. J'essaie de me mettre à votre portée : vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'extrême fin des sixties courut parmi les amateurs de pop music une affolante rumeur qui affirmait que si l'on passait certains morceaux des Beatles à l'envers d'étranges et incroyables secrets nous seraient révélés. Mon tourne-disque ayant obstinément refusé de tourner dans le sens inverse à celui des aiguilles de Big Ben, je suis incapable – encore aujourd'hui – d'accréditer ou non ces révélations.
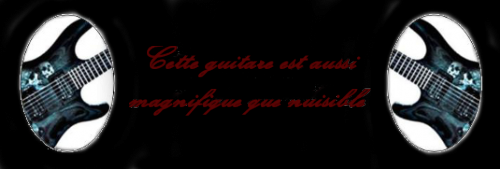
Mais au fait que se passe-t-il vraiment lorsque l'on interprète un morceau de musique en commençant par la fin ? La question peut paraître saugrenue, pas grand-chose affirmeront les rationalistes forcenés. Oui bien sûr. Assurément. A part que si vous rentrez en possession d'un étrange grimoire qui relate une étrange histoire italienne vous risquez... mais la suite se trouve in-extenso sur www.arpeggio-oscuro.fr
Si vous préférez la version papier, vous pouvez éventuellement remplir une demande de prêt à la Bibliothèque du Congrès aux USA. Ce sera long. Alors en attendant, suivez mon conseil, vous feriez mieux de vous jeter sur www.faiseurdeclipse.fr . C'est une nouvelle aventure de Vernon Gabriel, encore plus mystérieuse et encore, beaucoup, mais beaucoup plus, rock and roll !
Damie Chad.
LE ROMAN DE JOHN LENNON
PIERRE MERLE
( Editions Fetjaine / 2010 )

Le roman de John Lennon. Si l'on veut. Au début, ce devait être une vie croisée : celle de John Lennon avec celle de Mark Chapman. Celle de la victime avec celle de l'assassin. Un entre-deux tragique. Ou plutôt une conjonction dramatique. A ceci près que les trente grammes de la balle dum-dum ne fait pas le poids face à la masse de l'éléphant. Qu'elle a pourtant occis. Arrêté en pleine course. N'y a pas grand chose à dire sur Mark Chapman. Alors faut faire durer le suspense. Comme dans un film. Noir, de préférence. Obligation d'éterniser la scène. L'on sait comment cela se termine, au lieu de la garder inutilement pour la fin, on la mettra au début. Ouverture sanglante. Attention à ne pas la bâcler. C'est le morceau d'anthologie. Pas de précipitation. Ménageons la montée d'adrénaline. Quinze heures d'attente devant une porte cochère. Pierre Merle nous en tire cent quarante pages. Reprend les éléments de l'enquête. Un par un. A la loupe. De la précision. Ne nous fait pas le coup des arrière-plans. Pas de coup foireux de la CIA, pas de menées tordues du FBI derrière tout cela. Un détraqué. Même pas un pervers polymorphe, non un dérangé. C'est tout. Certes avec de la suite dans les idées. L'était déjà venu tenter le coup quelques mois auparavant. N'avait pas réussi. Un ratage de sixième zone. Par un raté. L'on a le off : les trottoirs, les badauds, les fans, les gardes, la sécurité. L'a même pris un disque Mark Chapman, pour la dédicace. Un très bel arrêt sur l'image dans la description. Un double brin de fantasy. L'a beau l'agité la pochette le meurtrier, au bout d'une demi-journée, le lecteur risque de s'ennuyer. Heureusement l'on a aussi le in : importation directe dans la boîte crânienne de Mister Chapman. Beaucoup de vide, une seule idée. Pas fausse. Mais banale. La trahison de Lennon. Le prolo devenu milliardaire. Des mots d'ordre révolutionnaires, des chansons incandescentes, et puis plus rien. Une vie de bourge dans un immeuble pour gros richards. Tant de rébellion pour capoter dans le Dakota. Peut vous les décliner sous toutes les couleurs, ses ressentiments, le Chapman. Mais au total, c'est un peu toujours la même chose. Alors pour bien remplir les feuillets, Pierre Merle s'en va fouiller dans la boîte à ordures du passé du citoyen. Joue le Scaduto du pauvre, ouvre le sac de la dérisoire existence de son sujet. Une vie de cloporte. Des parents qui ne s'aiment pas. Une adolescence solitaire. Un petit détour par la religion. Des petits boulots pour lesquels il n'a nulle envie de s'investir. Un mariage décevant. Une vie qui lui échappe. Se réfugie dans le rêve. Un autre monde est possible. Corrigera bientôt de lui-même l'omission du préfixe. Un autre monde est impossible. C'est mieux ainsi, plus près de la réalité. Bien sûr, c'est pire. Une constatation qui s'impose d'elle-même. L'est difficile de tricher avec sa propre vacuité. Se focalise bientôt sur John Lennon. Une obsession, une rancoeur délirante. Faut toujours trouver un coupable pour lui faire endosser la responsabilité de ses propres échecs.

Pan ! Pan ! Pan ! Pan ! Quatre coups de feu, et c'en est fini de John Lennon. De Mark Chapman aussi. L'est en prison depuis trente-cinq ans. Doit trouver le temps long. Doit regretter son geste. Tout le monde s'en fout. Pierre Merle le premier. Le laisse croupir dans sa cellule. Là, le lecteur commencerait à broyer du noir. Mince alors, qu'écrire d'autre ? Reste tout de même une moitié de bouquin à terminer.
La chance des écrivains. De véritables orfèvres. Des orphèvres de la résurrection. Vous ressortent les morts de leur urne comme l'on fait sauter les bouchons de champagne. Et c'est parti pour la saga des Beatles. Tout y est : Liverpool, les Quarrymen, Hambourg, la Beatlemania, Sergeant Pepper et toute la bande, Yoko, le Maharishi, les dissensions, la brouille finale. Séparation, clap de fin. Evidemment le projecteur suit de près Lennon et McArtney. Les autres un peu moins, normal, ne sont-ils pas à eux deux la cheville ouvrière du quartet fabuloso ?
Mais c'est chacun leur tour. Sans Lennon pour donner l'impulsion première, il n'y aurait jamais eu de quatuor. C'est lui qui pousse, qui tire, qui ose. Paul le seconde. Les autres suivent. Parfois ils sont éliminés sans pitié. L'a une revanche à prendre sur la vie, le père qui l'abandonne, la mère qui le met en nourrice chez la tante, et qui s'en va se faire écraser alors que l'adolescent se rapprochait d'elle dans une complicité de plus en plus étroite. De la psychologie à deux sous. L'encaisse tout le Lennon, serre les dents et les poings. Parvient même à en rire, douloureusement. Humour noir et nonsense le sauveront du désespoir.
Au début tout se passe très bien. Une fusée qui monte, monte, monte... Une pharamineuse carrière se dessine à l'horizon qui pour une fois ne recule pas et se laisse très vite atteindre. En 1966, les Beatles sont les grands vainqueurs du moment, entrent en pleine évolution créatrice. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est-là que Lennon nous refait le coup de l'Elvis. Après la pression des jours sans pain, puis celle de l'opulence, c'est la dépression qui arrive insidieusement. Que personne ne voit venir. Surtout pas lui.
C'est qu'il est occupé le Johnny s'en va en guerre. Des disques à enregistrer, le grand amour avec Yoko qui l'initie à l'art contemporain et qui lui donne l'illusion d'être plus intelligent qu'il n'y paraît, et puis la politique qui l'accapare. 69-70, Lennon n'échappe pas aux années gauchistes... Après 66, c'est Paul qui prend la relève, moins d'esbrouffe et davantage de travail, notamment à cause de ce grand escogriffe de John qui prend l'habitude de bosser à l'arrache. Tant et si bien, qu'un jour excédé Paul annoncera l'arrêt du groupe. Un geste dont Lennon pense qu'il aurait su le faire avec davantage de brio et de panache. Mais l'herbe que l'on vous coupe sous les pieds ne repousse pas.
John se retrouve seul. Avec Yoko. Grande gueule qui vient manger dans la main de la déesse mère. Tous deux s'engagent à mort contre la guerre au Vietnam. Militent auprès de la Nouvelle Gauche Américaine, pour la non-réélection de Nixon. L'échec de cette campagne marquera la fin d'une période. Yoko met son mari dehors. Elle sait bien qu'il lui reviendra. L'est libre, mais en liberté surveillée. Quand au bout de dix-huit mois elle battra le rappel reviendra en courant. L'aura eu le temps avec les copains de défonce d'enregistrer Rock'n'roll, le disque nostalgie de ses débuts de rockers. Mais le Teddy est définitivement assagi. Rentre à la maison. S'occupera du bébé. Calme plat pendant cinq ans. Recommence à enregistrer ( avec Yoko ) quand Mark Chapman se met sur son chemin. Revolver au poing.
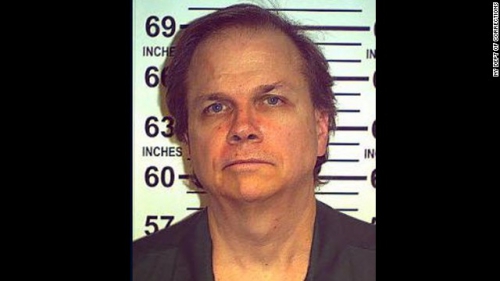
La vie de Chapman semble bien pâlotte comparée à celle de Lennon. Celle-ci nous l'avons résumée en trois paragraphes mais dont chacune des lignes pourrait devenir un roman de cinq cents pages. Tant de personnes rencontrées dans une époque d'une richesse créatrice incalculable ! N'empêche qu'en fin de compte, les dix dernières années de la vie de John n'ont guère été heureuses. Est aussi mal à l'aise à l'intérieur de lui-même que son assassin. Tous deux souffrent du même mal, l'incapacité ontologique de se dépasser. L'un parce qu'il ne s'est rien permis de prendre du monde en restant pelotonné sur son malaise congénital et l'autre parce qu'il s'est servi trop abondamment. L'un manque d'air et l'autre étouffe. Frères dans la déprime et l'inconséquence.
Des derniers chapitres en quelque sorte thématiques du bouquin, Lennon n'en sort pas grandi. Un naïf qui se laisse manipuler par lui-même. Il adore les révélations fracassantes qui ne cassent pas grand-chose. Ses abcès de colère, ses décisions à l'emporte-pièce cachent trop souvent des reculs devant les difficultés, quant à son humour et son ironie mordante ils s'imposent comme les meilleurs paravents de ses lâchetés. L'on a l'impression que Lennon s'est fait voler sa vie, bien avant les coups de feu fatidiques de cette nuit funeste du huit décembre 1980.
A peine trois ans après Elvis. Tous deux disparaissent après les années de pleine gloire. Comme si le sort avait décidé d'enrayer un déclin inéluctable. Mais chez Elvis la mort vient en quelque sorte de l'intérieur, comme une décision qui n'appartiendrait qu'à lui. Fidèle à ses volitions, Lennon a eu besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à quitter cette planète. Servi sans l'avoir demandé. Le destin d'une rockstar.
Damie Chad.
16:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tav falco, spunyboys, hervé picart ; arpeggio oscuro, philip auslander, john lennon



