09/12/2015
KR'TNT ! ¤ 259 : ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS / JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258
A ROCK LIT PRODUCTION
09 / 12 / 2015
|
ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA |

LE PETIT BAIN - PARIS XIII - 01 / 12 / 2015
ASH
LE PANACHE D'ASH
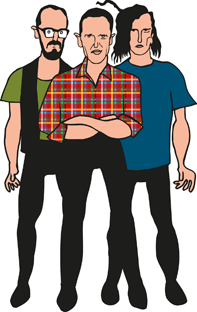
Même dans le cas d’Ash, on peut désormais parler de carrière ! Et même de vingt ans de carrière, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, pourtant, comme dirait le grand Charles, je n’ai-aime que toâ ! Et pourtant, quand Tim Wheeler et ses ceux petits compagnons de bordée déboulent sur scène, on a l’impression qu’ils n’ont pas vieilli. Ils dégagent une sorte de teenage flavour qui nous rappelle que le rock n’est autre que la forme moderne du mythe de la jeunesse éternelle qu’on dit à tort être l’apanage des vampires.

Mais non, il suffit d’aller voir Ash sur scène et de savourer leur ribambelle de hits pop. Ça gicle au plafond de la salle comme des bouquets de feu d’artifice. Ça explose de santé et d’allure. Ces trois Irlandais jouent comme s’ils avaient encore seize ans. Ils jouent, au sens fort du terme. Et le temps a fait d’eux l’un des fleurons du rock anglais. Tim Wheeler est tellement heureux de monter sur scène qu’il sourit à tout bout de champ. Mark Hamilton fait son cirque habituel, jambes écartées, basse en bas et grosse présence, alors que Rick McMurray bat le beurre comme un dieu. Tim Wheeler ne se coiffe plus comme avant. Il plaque ses cheveux vers l’arrière, mais il gratte toujours fièrement sa Flying V, comme au temps où il stoogeait la vieille Angleterre.

Ash peut désormais jouer dans la cour des grands, c’’est-à-dire monter sur scène et aligner une vraie collection de hits, et encore, ils sont gentils, car ils passent pas mal de chansons moins déterminantes. S’ils le voulaient, ils pourraient blower n’importe quel roof. Ils savent créer des moments de pure magie. C’est facile avec un hit comme «Shining Light». Et ils explosent leur fin de set avec «Girl From Mars» que tout le public reprend en chœur. C’est la fête au petit Bain, un bateau qui est en train de devenir, par la qualité de sa programmation, l’endroit de référence, comme le fut un temps la Maroquinerie.

Avec «Trailer/Kung Fu» paru en 1995, les trois gamins d’Irlande allaient devenir les coqueluches de la presse rock anglaise. On était alors encore en pleine Britpop et le son d’Ash arrivait comme un chien dans un jeu de quilles. Dès «Season», on sentait le souffle. Ils prenaient l’Anglais par surprise avec un son de garçons, bien cisaillé à la cisaillade et bardé de bardage. Ils sortaient ensuite l’un de leurs premiers hits, «Jack Names The Planets», balancé aux accords de poids. On sentait en eux une réelle appétence pour le power. Mais il y avait un gros problème avec «Intense Thing» : ce cut était beaucoup trop puissant pour un petit groupe irlandais. Leur truc sentait le charbon actif - She looked so lonely/ Standing on her own - Ils battaient leur final à coups de tempêtes mirifiques et Tim Wheeler hurlait dans les bourrasques.

Avec «Uncle Pat», Ash continuait de s’imposer. Au beau milieu de cette tourmente de distorse outrancière, Tim Wheeler partait en tortille de solo. Comme on le verra par la suite, son vice, c’est le départ en solo. Avec «Petrol», ils typaient un chant qu’on allait appeler le chant pantelant et toutes les puissances du rock étaient au rendez-vous. TimWheeler avait bien compris le mécanisme des explosions mis au point par les Pixies. Plus loin, ils tapaient dans l’insidieux avec «Different Today» et poussaient à l’extrême les logiques de beat et de grondement de basse. Au bout de ce disque se trouvaient les trois titres de «Kung Fu» et notamment «Luther Ingo’s Star Cruiser». Encore un cut beaucoup trop puissant avec lequel ils inventaient un genre qu’on pourrait qualifier de nitro-power pop, celle qui fait vibrer les tympans des pauvres ères qu’on voit traîner non loin des gibets où pourrissent les dépouilles des arsouilleurs.

«1977» est un album dément, l’un des fleurons du rock anglais, tous mots bien pesés. Ce deuxième album est une sorte d’album insurpassable. Ils attaquent avec «Lose Control», une magnifique dégelée de défenestration. Tim lâche ses légions sur les plaines. Quelle fantastique dynamique de guitares ! Et il passe à la heavyness mélodique avec «Goldfinger», l’Absalon Absalon absolu. La tête lui tourne mais il reprend le gouvernail de sa mélodie et ça devient imparablement bon et juteux. Il faut se souvenir de «Goldfinger» comme d’une pierre blanche, celle d’une éminence fondamentale. Le petit Tim sait écrire des hits fondateurs. Et ils tapent dans la stoogerie avec «I’d Give You Anything». Avec ce pilonnage d’accords de fonte brute, ces Irlandais se montrent encore plus stoogiens que les Stooges. Et ils descendent dans les soubassements d’une mélodie désespérée. Le petit Tim passe un solo de whawha et le cut prend feu en fin de partie. C’est plombé, on a là le meilleur sans espoir qui soit. On retrouve «Kung Fu», avec son drive de basse ultra-saturé et l’excellence de la persistance. Le petit Tim explose ça aux oh-oh-oh de power pop. Puis avec «Oh yeah», il replonge dans les profondeurs de sa heavyness. Le petit Tim n’est autre qu’une sorte de Brian Wilson du stoner irlandais. Il crée des ciels glacés et des dérives au septentrion, avec une force de poignet clouté. Il crée un univers unique dans le rock anglais. Ils revient à sa chère power pop avec «Let It Flow», encore une merveille bardée de paliers et d’autorité. On note le port altier du riff et les alarmantes couinades de coins de couplets. «Innocent Smile» se veut puissant comme le tonnerre et indomptable comme l’éclair. Complètement dévastateur ! Wow, quel album ! Chaque cut sonne comme une bombe. Il tombe un son plein comme le déluge d’Ararat explosé au détour de pont. Ce fatidique power trio expatrie le son au fond du blast. On tombe dans l’exceptionnel avec «Angel Interceptor», bardé de coups d’overdrive de son intentionnel et monté sur un énorme fil mélodique - Oooh it’s good to know/ Tomorrow you are coming home/ I feel heaven in you/ Don’t you know - Quelle fantastique énergie ! Il n’y a que Weezer qui puisse s’élever à un tel niveau jubilatoire. Ils tapent dans les puissances des ténèbres irlandaises pour «Darkside Lightside». Leur truc sort du ventre et ça reste dans l’imbattable. C’est même du pur Lovecraft à biscotos qui s’offre un final spectaculaire et terrifiant d’allure.
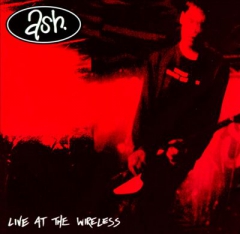
On va retrouver toutes les composantes du génie de «1977» sur un premier album live, le fameux «Live At The Wireless» paru l’année suivante. On retrouve la merveilleuse mélasse d’excellence blasteuse de «Darkside Lightime» que Rick McMurray bat comme plâtre au coin du bois. Ils passent ensuite la belle pop de «Girl From Mars» au foutage foutraque et retombent dans le heavy doom de «Oh yeah». Le petit Tim sait tisser sa toile de fil d’argent dans l’iris d’un soir tombant. Plus loin, ils vont lâcher «I’d Give You Anything», un vrai déluge de magnats du pétrole stoogy. On n’avait encore jamais entendu ça en Angleterre. Le petit Tim cloue la chouette à la porte de l’église maudite. Ils tapent plus loin dans «Goldfinger», l’un des hits d’Irlande les plus puissants qui soient. Quel pachydermisme ! Ils finissant avec une version de «Petrol» explosée à l’harmonie vocale. Ah oui, ils jouent comme des démons pendant que Tim chante comme un ange du paradis. Puis avec «A Clear Invitation To The Dance», Tim devient fou et pousse des hurlements.
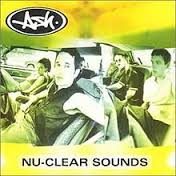
Ils sortent encore un album énorme avec «Nu-Clear Sounds». Dès «Projects», on sent la saturation du son. Ils sortent une mélasse de puissance digne de Monster Magnet. Et voilà une nouvelle bombe avec «Jesus Says», monté sur une fantastique pulsation de chœurs à la Dolls. Voilà une prunerie terrifiante de pataterie, un monstrueux bombardement d’ions soniques bien ronds - Ouh ouhh Ouhhhh - Ces mecs savent briser les murailles. Tout aussi terrific, voilà «Wildsurf», power pop d’ultra puissance, when the Stooges meet Brian Wilson. Encore un coup de génie wheelerien. Il va chercher des contrechants d’excellence explosive et il revient au fil mélodique avec une classe indécente. Quelle merveille ! C’est une sorte d’exaction de sunshine pop ultra débroussailleuse et jouée aux accords des enfers. On n’avait encore jamais entendu une chose pareille. Ils explosent ensuite «Death Trip» au chant de «Maggie’s Farm». Le petit Tim place une diction nitro-active dans l’enfer sonique d’Ash et de cendres. Il œuvre au pur génie iconoclaste et il en a les moyens, le petit bougre ! Et l’infâme Mark Hamilton broie tout ça à coups de basse. Attention à «Numbskull» ! Tim titille ça au gimmick innocent et il revient screamer en armure noire. Il prévient. Et tout s’écroule dans une fracas dévastateur. Il passe du chant à la destruction en règle, de la finesse à la déflagration. Il roule tout dans sa mélasse de farine de distorse et va aux extrêmes définitifs. Il reste encore un énormité sur cet album : «Fortune Teller». Une stoogerie de plus. Tim s’amuse à battre tous les records de garage incendiaire. C’est stoogy dans l’essence du chant. La ville brûle quand joue le groupe et Rick McMurray double la pétaudière en fin de cut.

«Free All Angels» paru en 2001 est le dernier album de l’âge d’or d’Ash. Première énormité : «Shining Light». On a là une pièce de power pop élégante et hautaine, digne des grandes heures de Pimrose Hill. Le petit Tim allie toujours la puissance à l’élégance. Il embarque son monde à l’ingénue libertine des Panzer Divisions. Il enchaîne ça avec «Burn Baby Burn», une puissante dégelée de gelée, encore un cut admirable de puissance de développement, une mainmise sur la marquise. Ces gens-là font ce qu’ils veulent. Il peuvent matraquer jusqu’à plus soif. «Candy» sonne comme un rêve de saturation maximaliste, souligné aux machines infernales de Dante. C’est une véritable mélasse ouatée de psychédélisme irlandais et le festival impitoyable se poursuit avec «Cherry Bomb», pris à l’extrême son d’exaction de power pop ultimate de mate de mythe. Le petit Tim explose tout ça à volonté, comme si Brian Wislon chevauchait les Walkiries. C’est porté au maxi du max de pack. Qui va oser se présenter après ça ? D’autant que Tim dégueule du wha-whatage et il reprend she’s a cherry bomb dans l’enfer d’une fournaise absolue. Il n’existe rien de plus déterminant sur cette terre. Plus loin, il renoue avec le génie en tapant dans «Pacific Palisades». Rick McMurray drumme ça comme une bête. Retour aux Stooges avec «Shark» et ils finissent cet album fumace avec «World Domination», une belle dégelée de gimme gimme more. Le petit Tim adore les dégelées. Il multiplie les occasions et Charlotte fait les chœurs.

Avec «Meltdown», Ash retombe comme un soufflet. Fini la rigolade. Tim nous cocote pourtant «Meltdown» à la pure méchanceté. Il fait bien le coup des couplets à vide sur fond de cocote, mais ça n’explose pas. Par contre, «Orpheus» explose. Tim sort de ses gonds et revient à son chant tordu d’ode d’Irlande. Mais on sent que la niaque d’«Angel Interceptor» a disparu. Avec «Clones», il va faire un tour dans le champs de maïs et on le perd de vue. Est-ce la présence de Charlotte qui plombe le groupe ? Ils semblent avoir abandonné la veine stoogy. Il faut attendre «Vampire Love» pour retrouver la bouillie surpuissante de power pop vampirique à laquelle ils nous avaient habitués. Le petit Tim revient à sa manie de l’explosion, mais sans la fibre d’antan qui se chargeait de mélodies. Il prend un solo furibard et sauve l’album.

«Twilight Of Innocents» est ce qu’on appelle un album foiré. Ils attaquent avec un «Started A Fire» qui sonne comme «I Got You Babe» de Sonny & Cher. Tim balaye ça d’un solo visionnaire. Puis ils nous stompent «You Can’t Have It All» et tapent un refrain lumineux, évidemment. Tim tente de renouer avec la démesure dont il s’était fait le héraut. Mais leur power pop va tomber dans la banalité. Rien ne ressemble plus à la power pop que la power pop. On s’y ennuie à mourir. Aucune étincelle ne veut montrer le bout du nez. Tim et ses amis enchaînent une série de cuts désespérément ordinaires. Tim passe un killer solo dans «Ritual», bien liquide et ravagé de tremblés longs, mais ça ne suffit pas. C’est Mark Hamilton qui mène «Princess Six» par le bout du nez. Il drive tout à la bonne basse - I’m out of my mind/ Cos I need your love - Et ça se termine à la folie garage de yeah yeah yeah oh oh - On voudrait bien qu’Ash fasse encore de gros albums, mais ça doit être difficile de maintenir un tel niveau. C’est évidemment la raison pour laquelle ils ont arrêté d’enregistrer des albums.

«Kablammo» vient de paraître. L’album du retour aux albums ne convainc pas. Avec «Let’s Ride», Tim cherche désespérément à retrouver sa vieille veine, celle des tubes puissants qui éclataient dans l’azur de la pop anglaise. «Let’s Ride» a l’étoffe d’un hit, on sent le retour des grandes eaux d’antan, mais ça reste un amuse-gueule. Il faut attendre «Go Fight Win» pour retrouver un peu de viande. C’est le stomp du retour en grâce d’Ash, l’apanage du power-trio. Ils renouent enfin avec l’art ancien de la belle démonstration de force battue à la diable. La face B bâille aux corneilles et se réveille avec «Shutdown», une power pop pressée qui ne traîne pas en chemin. Hâtons-nous, dit-elle, car le soir tombe !
On retrouve l’essence d’Ash dans les compiles de singles. C’est là que ça grouille. Autant se payer ces compiles, car on y fait le tour du propriétaire.

«Intergalactic Sonic 7’s» devrait monter à bord de la chaloupe en partance pour l’île déserte, car ce double album fonctionne comme un véritable champ de mines. On saute quasiment à chaque cut. Ash groupe imparable ? Allez savoir... Ça démarre avec «Burn Baby Burn», pas de surprise, c’est une dégelée avec un solo à la dentellière des enfers. S’ensuit un «Envy» allumé à coup d’one two three four et on plonge dans l’écume des jours. Tim joue la carte de la niaque maximaliste et il ne rigole pas. Avec «Shining Light», il fait monter la bébête de manière extravagante. C’est explosé de son dans un télescopage de beauté virtuelle à l’horizon. Encore une pétaudière avec «A Life Less Ordinary». Rick McMurray bat comme Vulcain, avec une rage démoniaque. C’est l’occasion idéale pour Tim, alors il emmène ses mélodies exploser au dessus de nos têtes. Pas compliqué : tout est démesuré chez Ash. On retrouve l’effarant «Goldfinger», ils tapent ça du haut des falaises de marbre. Il y a du Phil Spector chez Ash. Quelle clameur et quelle ardeur ! Ils enchaînent avec «Jesus Says» et «Oh Yeah» que Tim amène à la régulière et qui virent à l’énormité. Ici tout n’est que puissance et beauté surnaturelle. On tombe sur un «Candy» pompé dans «Make It Easy On Yourself» et saturé à l’extrême. Oh et puis voilà le retour d’«Angel Interceptor» qui pue le hit planétaire dès la première mesure. Tim amène «Wildsurf» au chant classique et c’est aussitôt explosé en pleine mesure. Ces gens-là ne respectent rien et surtout pas les oreilles. Ils vont à la rencontre de Brian Wilson avec du son plein les poches. On retrouve tous les autres hits à la suite, «Petrol» et «Numbskull», bien sûr. Le disk 2 est aussi éprouvant pour les nerfs. «No Place To Hide» blaste dès l’intro. C’est cisaillé à la base et tous les adjectifs n’y pourront rien. On s’effare de l’insolence de ponts sur-puissants. Quel groupe peut se payer ce luxe, aujourd’hui ? Tim attaque «Where Is Our Love Going» au riff indécis et violent. Puis il passe en mode cavaleur et va chercher des tracasseries d’accords intrinsèques. Ah il tire bien son épingle du jeu, l’animal. Il nous plonge dans le grand maelström de fin du monde démentoïde et c’est battu à la vie à la mort. Encore un cut écrasant de beauté : «Stormy Waters». C’est la power pop la plus heavy de l’histoire du rock, un vrai blasting d’énergie ! Et ils retombent dans la stoogerie de bas étage avec «Melon Farmer». Tim y va comme un Irlandais. C’est chanté à deux voix et ça se perd dans l’outrage fournaisien. Tout est tellement démesuré là-dedans. «Gabriel» est aussi hallucinant d’ampleur. Tim explose la surface du rock. Ils sont terrifiants de démesure et c’est battu comme plâtre. On assiste à l’embolie du beat. «Lose Control» est amené par la pire des menaces - I’m doin’ alright/ Don’t you lose your soul - Ils sont la pire démence qui soit - Out of your mind - le riff plane comme un aréopage de vampires. Et Rick McMurray tape comme un sourd sur «Sneakers». C’est à quatre pattes qu’on sort de cette compile.
Ils décidèrent à une époque de cesser d’enregistrer des albums et de ne faire paraître que des singles. C’est pourquoi on trouve deux volumes de singles parus en 2010, «A-Z Vol. 1» et «A-Z Vol. 2».

Curieusement, on retrouve sur la plupart des singles le son dévastareur, mais sans la démesure qui caractérisait les grands hits ashiens. Il faut attendre «Joy Kicks Darkness» pour vibrer un peu. On a des chœurs de folles dans l’intro et c’est du grand Ash explosé au refrain et des ponts déviants rabattus au beat fatal. Beau single aussi que «The Dead Disciples», joué à la cocote d’expert et monté au chant d’exception. Tim vise les ampleurs considérables - I’m feeling so alive - Il crée un authentique événement d’importance, tant la clameur porte au loin et il chante à l’extrême pourfenderie du chaos - When the show is breeding/ All the ghost are rolling/ When the wall are shaking/ Watch the stars exploding - Pur génie ! Encore une énormité avec «Pripyat» et de la power pop explosive - I listen to the defeaning silence/ In the beautiful lost citadel - On retrouve le grand Tim des envolées. C’est bardé d’images clairvoyantes et plâtré de plâtras de son. Attention à «Command» et à son intro de basse. On a le petit jeu couplet/refrain et les pires jutes d’explosivité. Les refrains coulent comme des fleuves de lave hilare au long des côtes. On tombe plus loin sur «Comin’ Around Again» joué à l’explosivité des descentes. Les couplets clamés sont jetés dans le chaos des refrains et ils nous sortent un final éblouissant. Voilà la puissance du team de Tim. Il balaye tout à la wha-wha et il part en pire vrille qui vaille. S’ensuit une autre dégelée avec «The Creeps». On voit rarement des cuts d’une telle intensité. On sort du commentable. C’est bombardé de Creeps Creeps Creeps.
Ash offre avec le Volume 1 un docu intéressant sur DVD. On suit le groupe en tournée en Angleterre et on voit à quel point Tim et ses deux amis sont décontractés. Sur scène, Tim joue sur une SG blanche. On les voit aussi déclarer la fin des albums. Ils décrètent ne plus vouloir faire que des singles. Et puis à un moment, Tim parle de ses albums favoris, «Abba’s Gold», «Singles Going Steady» des Buzzcocks et «Hot Roks» des Stones. Mais c’est vrai que le singles club est un exercice périlleux. Seuls s’y sont risqués avec eux le Wedding Present et les mighty Wildhearts.

On trouve au moins quatre hits énormes sur le «A-Z Vol.2». À commencer par le wall of sound de «Dare To Dream», gratté en compagnie des anges du paradis. On admire Tim pour ça, justement, pour son goût des apothéoses. Il adore s’installer dans l’enfer d’un mur du son. Il réinvente Spector et le Brill quand il veut. Il développe une puissance qui défie les lois de la nature. Autre hit : «Binary». Tim y retrouve sa belle veine glam. On peut bien parler ici de grandeur suprême du rock anglais - Pumping your heart/ Having your mind delicately blown apart - Énorme ! Toute aussi énorme, voici «Physical World», du vrai Ash sound gratté aux power-chords dévastateurs. Ces trois-là savent blaster un hit avec la même évidence que Slade. «Embers» est aussi du pur jus de power pop explosive. Tim est un entremetteur de power et de pop de premier ordre et en prime, il nous refait le coup de la vrille. Autre monstruosité : «Teenage Wildlife» qui aurait tendance à vouloir sonner comme le «Heroes» de Bowie. Franchement, c’est un hit, mais un hit d’allure planétaire. C’est chanté au meilleur glam d’Irlande et Tim l’orne d’un solo d’encorbellement majeur. C’est terrifiant de grandeur verte. Puisqu’il parle de grandeur verte, justement, voici «Running To The Ocean», encore de la power pop de très haut rang - Coming back to life/ Waking up inside - et il part en solo écarlate dans l’ocean is green, l’ocean is blue. Il faut aussi se gaver d’«Instinct», tendre et dense, avec encore un petit côté Bowie dans le chant. Tim sait naviguer au plus serré, c’est un popster de rang aristocratique.

Le fin du fin, si on aime Ash, c’est de les voir sur scène ou, à défaut, à la télé. Facile si on chope le fameux DVD Tokyo Blitz. On y voit la formation classique avec Charlotte, la perfe de la perfe. Ils sont bien écartés les uns des autres sur scène : Mark Hamilton le bassman fatal, Rick Tape-dur coiffé à l’iroquoise de Travis Bickle, Charlotte en chemisier blanc, Anglaise jusqu’au bout des ongles et au centre Tim la star avec sa Flying V, Tim de hargne et de jambes écartées, Tim d’essence du rock. Il envoie la mélodie de «Life Less Ordinalry» et c’est stupéfiant d’impact. S’ensuit un «Shining Light» qui est le hit absolu. Shining éclate Tokyo qui ovationne Tim la star, le teenage angel du mythe éternel. C’est à pleurer tellement c’est beau sur scène. Tim le sait, il ne joue que des hits, comme les Beatles avant lui. Les profondeurs de «Goldfinger» sont insondables de pur jus. Chaque titre pulvérise tous les hit-parades. «Cherry Bomb» n’a l’air de rien comme ça, mais au refrain, la mélodie nous saute à la gueule. Quand ils jouent «Kung Fu» et «Girl From Mars», ça pogote dans la fosse. «Wild Surf» fait danser Tokyo. Tim rappelle que «Jack Names The Planets» fut leur premier single et «Jesus Says» sonne comme un hit dès l’intro. Ils finissent avec l’effarant «Numbskull».
Et voilà que Tim la star se lance dans une carrière solo avec «Lost Domain». Son père vient de disparaître et il en parle dans «Hospital», une fantastique leçon d’humilité - So I found I was not so strong - Il s’y confesse et c’est poignant - Try to recall the good days gone for evermore/ Try to recall the innocence that I had before - Pour «Do You Ever Think Of Me», il va chercher les très gros effets. Tim est un être en quête d’absolu, ça crève les yeux. Il vise les parapets noyés de brume, au-delà des mondes connus. Il refait son Richard Hawley pour «End Of An Era» et se noie dans un océan d’orchestration. Il explose les limites du Brill et file vers les profondeurs inexplorables de l’univers. Mais il veille à rester indiciblement mélodique. «Medecine» est encore une belle pièce de pop directive et orchestrée à outrance. Tout sur ce disque est ultra-produit, ce qui paraît logique, vu l’étoffe du songwriter. Avec cette chanson fleuve, il va une nouvelle fois très loin. On trouve deux beaux instros sur cet album, dont un «Vapour» joué au sax et au xylo. Tim la star fait de la magie ni noire ni blanche mais lumineuse. Il termine cet album édifiant avec «Lost Domain» et confesse à nouveau ce que chacun ressent lorsque son père jette l’éponge - I think about my father/ And all that I have lost there/ Away away away.
Signé : Cazengler le pot-ash
Ash. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 1er décembre 2015
Ash. Trailer/Kung Fu. Squatt 1995
Ash. 1977. Infectuous Records 1996
Ash. Live At The Wireless. Death Star 1997
Ash. Nu-Clear Sounds. Homegrown 1998
Ash. Free All Angels. Infectuous Records 2001
Ash. Intergalactic Sonic 7’s. Infectuous Records 2002
Ash. Meltdown. Infectuous Records 2004
Ash. Twilight Of Innocents. Infectuous Records 2007
Ash. A-Z Vol. 1. Atomic Heart Records 2010
Ash. A-Z Vol. 2. Atomic Heart Records 2010
Ash. Kablammo. Atomic Heart Records 2015
Ash. Tokyo Blitz. DVD Infectuous Records 2001
04 / 12 / 2015
BUS PALLADIUM / PARIS
THE WAVE CHARGERS
HOWLIN' JAWS
Vendredi soir au coin du feu. Samedi soir à Troyes avec The Twillinger's, a rockabilly band que je n'ai jamais vu. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Pardon, sur du papier à rock'n'roll. Mais dans la vie, c'est souvent comme dans le poème d'Edgar Poe, le corbeau noir du désespoir et de la malédiction s'en vient frapper à votre porte. Les plans les mieux préparés s'effondrent, tel un château de cartes emportées par le vent de la terrible Nécessité. Serais-je donc privé de concert cette semaine ? Orage, ô désespoir, ignominique coup du sort qui tombe comme le tranchant de la guillotine sur mes prévisions saturdiennes. Non ! Il n'en sera pas ainsi, sort funeste, je te niquerai jusqu'à la moelle du trognon. Vu l'heure avancée, me reste dix-sept secondes pour fomenter le plan B. That's all right mama, anyway I can do !
La teuf-teuf mobile a compris. Ce soir les feux rouges, les limitations de vitesse, les passants sur les passages cloutés, ça n'existe pas. Des para(kilo)mètres négligeables. Elle a enfin décroché un rôle qui lui convient dans La Highway Impitoyable, celle dont le sang caillé d'innocents piétons forme un pourpre tapis ordalien de goudron rouge du meilleur effet. Résultat : j'arrive pile-poil, à l'heure. Et même avec un peu d'avance.
THE WAVE CHARGERS

Avec un nom comme ça, je ne me faisais pas trop d'illusion. Des attardés de la première mouture des Beach Boys ( ces amerloques qui avaient piqué leur riff à Chuck Berry ), mais comme le pire est toujours certain, les Wave Chargers m'ont séduit. Pas que moi d'ailleurs, vu la salle qui on-, qui ondudu-, qui ondulala, donc qui donc ondula durant tout le set. Quatre sur scène, dont trois avec des lunettes. Depuis Buddy Holly, nous avons appris qu'il faut se méfier de ces looks d'étudiants sages. Ne sont pas les derniers à lancer le chalut du chahut. Le seul qui n'en a pas – je parle des lunettes, demoiselles déjà gémissantes - c'est Francis, la même coupe de cheveux qu'Eddy Mitchel au début des Chaussettes, mais je ne pense pas que cette référence ait été recherchée, et une guitare d'un bleu pâle délavé, enfin pas une guitare, une Fender, et là ce n'est pas un hasard. En plus, va nous montrer qu'il sait s'en servir. Derrière, c'est Claude à la batterie. L'a le sourire facétieux du singe qui du haut de son palmier lance des noix de coco sur le naufragé épuisé que les vagues magnanimes ont roulé sur la plage salvatrice. Sacré coco, il vise juste, et tire des bordées incessantes. Un mauvais destin a voulu que Samy soit préposé à la basse. Ce n'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il a des attitudes innées de lead guitar, le gars qui fait tout le spectacle, debout, couché, à genoux, incapable de rester en place, prend la pose pour les photos souvenirs. Mais Anne ma soeur ne vois-tu rien venir ? Que nenni, ma soeur, je ne vois que le surf qui poudroie et le roll qui verdoie. C'est Anne en personne qui tient et son propre rôle et sa guitare – encore une Fender – qui lui donne la réplique.

Twang ! c'est parti, un petit Wave Chargers Theme, pour annoncer la couleur. Trailer musical, nous voici replongés en pleines années soixante avec ces guitares chantantes et vrombissantes qui affolaient la population. L'on n'avait jamais entendu ça, c'était fuselé et aérien comme un carénage d'avion, et ça vous emportait dans des galops de tribus apaches sur le sentier de la guerre. L'a fallu quatre ans pour s'y habituer, de par chez nous en notre douce France, ce fut un vent de folie, l'on ne comptait plus les groupes qui affutaient leurs guitares, c'étaient les jours heureux de Globule le phoque, les Guitares, les Champions, les Fingers, les Pingouins, les Mustangs, les Fennecks, les Aiglons, les Lionceaux, les Panthères, et toute la ménagerie avec, pour finir au plus proche de nous, en queue d'hirondelle, les Arondes de Montpellier... en arrière-fond bien sûr Dick Dale, Link Wray, Duane Eddie, Hank Marvin, et plus loin encore, plus secret et moins connu à son époque, le travail studio d'Eddie Cochran...

Y avait de tout dans le rock instrumental des années 60, des génies du manche... et des copieurs, et des faiseurs, et des suiveurs. C'est un rock qui s'est un peu dilué en sa propre parodie. De l'exaltation adolescente d'une jouissance sans entraves l'on est passé au médiocre farniente de l'oisiveté petit-bourgeoise, ambiance shaker lounge cocktails des îles avec coca et sans molotov. La vague blues Stones s'est abattue sur cette jeunesse décadente et l'a roulé au loin tel des fétus de chapeau de paille. Chance pour nous, les Wave Changers restent sur la crête de la lame. Ils ont le son et le mur, autant dire que ça décoiffe sec, roulements de Claude et cavalcades de Francis, va chercher les notes brontosaures qui résonnent graves et écrasent tout sur leur passage, et les notules toutes fines à la Woody Wood Peeker qui vous transpercent les tympans sans pitié. L'alterne les basses de basaltes avec la translucidité des cristaux transparents. Anne s'applique, un peu le rôle du second couteau qui ne passe pas dans les premiers plans de guitare, mais elle construit les contreforts nécessaires au soutènement des édifices qu'échafaude Francis. De l'autre côté, contrepoint parfait d'Anne immobile, Samy s'amuse, s'agite, ressemble au discobole de la statuaire grecque avec cet avantage indéniable, celui du mouvement perpétuel. Sale gamin à qui ses parents ont oublié de refiler sa dose de théralène pour qu'il se tienne enfin tranquille.

Nous font des trucs extraordinaires. Douze mesures de Nous les garçons et les filles et plang l'on part dans un tourbillon apocalyptique. Idem pour le Bambino, le must des années soixante, mais pour attardés mentaux, un truc à la sauce Dalida, mais qu'ils nous servent dans une assiette proto punk sixty, qui dégouline de moulinades déjantées. C'est que tout un set instrumental, faut le tenir. Le public est versatile, s'ennuie vite, faut le surprendre à tous les riffs. Faut savoir ménager les surprises, un What'd I say mouture Chat Sauvage chanté avec l'assistance, qui en deuxième partie est chargée de faire les Realets – entre parenthèses autant les Wave turbinent sec, autant nous ne sommes pas merveilleux sur l'affaire. Participation oui, mais les mystères du swing vocal ne sont pas acquis. Par contre question torsion, rien à redire ça twiste dur, à gauche, à droite, au milieu, tout le monde se contorsionne comme si le sort du monde en dépendait. Et pourquoi pas après tout ! Nietzsche n'a-t-il pas écrit beaucoup de bien sur la folie dionysiaque ?

Z'ont un répertoire qui flirte avec le western et les films sur écran panoramique. Un truc comme Attack of The Mexican Food ou La Revanche de Kuromaku, même sans savoir de quoi ça instrumente, vous dessinez les décors grandioses, les chevauchées prestigieuses et les scènes de combat à vous couper le souffle, l'instrumental sixty possède sa dose de carton twang et d'imaginaire kitch, cela peut être sa faiblesse, mais quand les Wave Chargers sont à la réalisation, vous y croyez dur comme du fer brûlant. Palissades Park c'est le grand huit des sensations,une tourmente de guitares qui vous arrachent le palpitant et vous précipitent dans le vide de l'extase.
J'éprouve un regret, j'aurais aimé les entendre sur Apache, oui m'ont offert en échange Shazam et Kasbah – ah ! l'orientalisme de bazar des années soixante, les sortilèges de l'Orient, les cordes qui vous tressent des tapis volants, et les volutes kiffées des narghilés – mais Apache, pour Claude, pour son entrée de batterie, j'aurais voulu le voir drummer, cela n'a l'air de rien, mais il en faut de la subtilité, et avec sa frappe, toute de roulements, pré-Keith Moon – somme toute peu articulée, si ce n'est dans ses accointances rythmiques avec les paragraphes d'arabesques de la Fender de Francis - je suis sûr qu'il s'en serait dépatouillé avec brio.

Rien ne ressemble plus à une giclée de guitares qu'une autre giclée de guitares. Les groupes de l'époque sont allés chercher des sonorités inaccoutumées un peu partout, fandango, flamenco, musiques arabes et d'ailleurs. Tout cela se retrouvera, plus tard magnifié par Led Zeppelin, n'oublions pas qu'à l'époque Jimmy Page était déjà en embuscade et que ces recherches ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, ni dans les mains d'un manchot. Les Wave Chargers sont des jeunes gens modernes que je devine abreuvés de pulp fiction, de manga, et de séries télé, des titres comme Ho Ku Kai et Kuma Beat, nous emportent dans dans un Japon. Exotic mais pas exotoc.
Sont convaincants, les Wave Chargers. Nous ramènent dans le passé du rock, mais ils en redéfinissent les contours. Ravivent les couleurs. Ne se contentent pas de simples décalcomanies. Inventent des teintes nouvelles. Plus flashy. Un set de plaisir. La salle les acclame à tout rompre. L'ont mérité.
HOWLIN' JAWS

Ah ! Les Howlin, rappelez-vous leur passage à La Mécanique Ondulatoire, même pas un mois, ( voir KR'TNT ! 255 du 12 / 11 / 2015 ) et le souvenir marqué au fer rouge d'une apparition apocalyptique. Les revoici donc sur la scène du Bus Palladium. Je ne suis pas tout à fait un idiot, n'ai pas choisi la soirée au hasard. Après le concert de Smooth and the Bully Boys de la semaine dernière, je n'aurais pas pu supporter du rock mélangé d'eau tiède. Me fallait du pur malt au venin de crotale. N'ayez crainte j'ai eu mon médicament. Mais cette fois, sans malt ni additif aquatique, rien que le poison du reptile. Ultra-cobraïque, flacon noir, avec tête de mort en rouge flamboyant. La pourpre agonistique des Dieux.
Avec leur casquette à hélice, n'ont pas l'air sérieux. Arborent un look de collégiens malicieux. Rayon farces et attrapes, l'inénarable trio, Djivan le grand échalas au coin à côté de sa contrebasse, le cancre Mathieu au fond près de la batterie radiateur, et Lucas le beau gosse de la bande qui scrute sa guitare cahier de mathématique d'un air blasé. Evidemment comme ce sont les trois mauvais garçons de la classe, il y a un max de filles qui s'écrasent sur le devant de la scène. Crient pour attirer leur attention. Peine perdue, sont déjà préoccupés par la préparation de leur prochain mauvais coup. Trop tard, vous ne les arrêterez pas, c'est parti.
Cuttin' Out. Tout de suite l'on sent la différence. Ce n'est pas qu'ils jouent mieux. C'est qu'ils s'expriment davantage. La grâce sauvage d'un tigre féroce vous ne saurez l'apercevoir dans une cage carrée de deux mètres sur deux. A la Mécanique Ondulatoire, la scène était minuscule. Z'étaient comme des lingots d'or tassés dans un coffre-fort. Il avaient le droit de respirer, mais pas davantage, ce qui nous avait surtout permis de nous régaler les yeux du jeu de Mathieu en quelque sorte privilégié par la vaste – toute relative - portion d'espace confisquée par ses tambours. Mais ici sur l'estrade du Bus, il y en a deux qui bénéficient d'une large bande de terrain. Pas de football, disons la surface d'un parterre de jardin. Pas le Pérou, mais une zone d'évolution libre. Ce qui change tout. C'est tout de même mieux d'avoir les coudées franches pour jouer de la guitare et emmener la grand-mère au bois et lui montrer comment l'on se chauffe.

Cuttin' Out donc. Facile d'imaginer la musique des Howlin', Djivan et Mathieu s'occupent de la bétonneuse, vous produisent un mortier précontrain, inaltérable et inattaquable. Un pavement aussi solide que les pierres que les Egyptiens ont assemblé pour former les pyramides. De la belle ouvrage. Que Mister Lucas s'emploie aussitôt à découper en morceaux. Vous la sculpte en moins que rien. Même pas au marteau-piqueur, non au burin. Touche trois fois les cordes et vous comprenez que vous êtes en face d'un grand. Dans le rock, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Pouvez acheter toutes les méthodes que vous voulez et vous payer des professeurs, cela ne sert à rien. C'est inné, le moment exact où vous posez la note. Ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop près, ni trop loin. Ce n'est même pas indiqué sur les partoches ( quand elles existent ). Et Lucas, il pique et repique à la nano-seconde près. Fait de la dentelle sur l'ouragan que lui concoctent les deux autres. Solitaire accompagné.

The Urge, By the Tim, Stranger, les morceaux se suivent et se ressemblent, défilent et exhibent leur différence. Magie du rock and roll, tempo de feu et vol du temps suspendu. Tout est dans le silence. Entre les deux notes assénées par Lucas. Une fraction de temps, et une attente interminable, nul ne sait où il veut en venir, mais nous débouchons à l'endroit précis du chemin qu'il a choisi. Ce ne sont pas des notes qui sortent de sa guitare. Mais des cris, incisifs dont l'écho se promène en nous, mais lui il est déjà ailleurs. Plus haut, et le médiator retombe comme un aigle dans le cœur de Nuage Rouge, ou comme la foudre sur nos âmes transformées en paratonnerre.

Ayez le meilleur guitariste que vous voulez mais cela vous sera aussi inutile qu'une cigarette sans allumette. Vous faut aussi le chanteur. Qu'est devenu Cliff Gallup sans Gene Vincent ? Et ce soir Djivan ne chante pas, il est le pétrel dans la tempête, il se joue des vents et des modulations. Ne passe pas en force. N'assène pas les lyrics à coups de barre à mine. Il les pose. Juste l'écume sur le haut de la vague, mais qui en souligne toutes ses inflexions et toute sa puissance dévastatrice. Les chanteurs de rock ne chantent guère. Sont des metteurs en scène, s'apparentent à des réalisateurs de cinéma. Créent un monde. Interprètent tour à tour une comédie désopilante et puis nous engluent dans un drame sanglant. Les paroles s'impriment sur votre rétine, elles ordonnent des images, parce que la voix du chanteur fait office de lanterne magique. Tout est dans l'attaque, la pointe d'ironie, la levée de voix sardonique, l'hésitation complice, l'incitation au crime, et l'invitation à d'obscures copulations. Un sacré manipulateur de marionnettes le vocaliste rock, sa voix est le fil et vous le pantin articulé subjugué hypnotisé et consentant. Une fois que vous avez compris cela, vous n'avez plus de souci à vous faire. Et Djivan a tout pigé.

L'a quand même une double fonction, l'est aussi le contrebassiste du groupe. Y prend un réel plaisir. La penche du côté par où elle ne tombera pas, s'y vautre dessus comme un ruffian énamouré, mais la remet d'aplomb au dernier moment juste avant de céder à la tentation de lui faire subir les derniers outrages. Elle en miaule de rage comme une chatte insatisfaite qui voit le mâle qui se fait la malle et part en cavale avant d'accomplir son devoir procréatif. Elle aimerait s'étendre sur un djivan du salon en vue d'une plus grande coopération, mais non, alors elle feule de désespoir et clame à tous les échos sa profonde déception.

Mais il y a remède à tout, même à une frustration meurtrière. C'est Baptiste qui se charge de faire briller l'espoir. Sur son estrade il annonce à coups de grosse caisse la vente de l'élixir spermatique de remplacement. Possède une appellation suggestive, rock and roll, et il rocke et il rolle à jets discontinus de toutes ses baguettes. La plainte de la Big Mama est englobée dans un magma germinatif, sous le rocky chapiteau tous les miracles sont permis.

Babylone Baby, Oh ! Well, le set atteint à une dimension pharamineuse. Lucas se surpasse. Avec la chair saignante que lui hachent ses deux acolytes, il vous prépare des boulettes de viande empoisonnée qu'il vous lance à la figure comme on jette des graines salvatrices aux passereaux affamés dans les parcs municipaux en hiver. L'on se rue sur cette persillade, en hurlant. Dans la salle c'est le délire. N'y a plus qu'une foule fusionnelle qui ondoie en mesure. Alors Lucas se plante sur le devant de la scène, cinq secondes pas plus, juste le temps de lâcher les cinq plus vicieuses notes de la soirée, celles qui mordent au bas du ventre, et puis il repart en arrière, perdu en lui-même, en une explication sans fin avec sa Squier guitar.
I'm Mad, You got to Loose, Tough Love – un programme de l'attitude quintessencielle rock – ce sont les trois derniers morceaux que les trois chiens enragés des Howlin'Jaws consentent à offrir à la meute hurlante qui assiège la scène. Fini, terminé, Lucas éteint son ampli. Pas de rappel c'est la règle. Mais quelle énergie ! Nous ont transformé en punching ball et n'ont pas arrêté de nous taper dessus. Non seulement on a aimé, mais l'on en aurait redemandé. C'est ça le rock and roll ! Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Nul n'est parfait. Vive les Howlin' Jaws !
( Les photos correspondent au concert de l'American Tours Festival 2015 )
LA MOUCHE

Rien de plus énervant qu'un essaim de mouches qui bourdonnent autour de votre tête. Sont nombreuses Les Mouches, une bonne douzaine. Avec trombone à coulisse, trompette et clarinette, et tout le bataclan. Un côté cirque pagailleux, un côté festif délirium, une ambiance post-hippie, rock alternatif français. Tout ce que je n'aime pas. Me suis enfui dès le deuxième morceau. Je sais c'est lâche, mais c'est ainsi. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être ont-ils donné un show de toute beauté. Ce qui est sûr, c'est que le public acquis d'avance a dû être comblé. Mais je n'ai pas senti. Me suis fié à mon flair. Et puis après les Howlin' je n'avais plus besoin d'autre chose. Tout ce qui suivrait ne pourrait que se situer à un moindre niveau.
Je n'aime guère ceux qui mettent de l'eau hilarante dans leur rock. Le dosage n'est jamais évident. Faut être, soit trop naïf, soit très fort. Le burlesque est un art difficile. Faut d'abord avoir traversé le noir de la nuit le plus désespéré pour en sentir par delà les éclats de rire les facettes les plus lugubres. Et la bande de joyeux godelureaux sur la scène m'ont paru manqué de cette grotesque expérience métaphysique. Trop sûrs d'eux. Leur manquait d'après moi une certaine fragilité existentielle. Tout ces a-priori sans remettre en cause leur dextérité musicale, même que le guitariste n'est pas du tout venant. Se défend mieux que bien. Ce qui me semble manquer à ce genre de groupe, c'est qu'au milieu de leur syncrétisme, ils ont oublié l'importance des racines rock and roll. Je le répète, je ne suis pas sectaire mais je n'aime que le rock.
Damie Chad.
THE HOWLIN' JAWS
TOUGH LOVE / BYE BYE BABY
DJIVAN ABKARIAN : Double basse – Lead vocal / BAPTISTE LEON : Drums – Back vocals / LUCAS HUMBERT : Guitar – Back Vocals
Recorded Live at BLR Studio / Mixage : Mister Jull – Thibaut Chopin /

Dernier 45 tours des Howlin'. Z'avaient le look anglais sur la pochette du premier, tenue plus décontractée pour celle-ci, sales gosses qui se foutent de votre gueule avec leur casquette à hélice de Spitfire sur la tête. A la limite il n'y aurait pas besoin d'écouter. Avec le précédent, sont parvenus à créer une esthétique, des objets de collection. Le vendent à cinq euros l'unité, vu l'épaisseur de carton et la lourdeur du vinyl, c'est donné.
TOUGH LOVE : c'est du brut, d'ailleurs Baptiste commence à taper sur sa batterie comme une brute et Djivan vous a une gosse voix à le faire passer pour un ogre. Après cela, vous vous laissez emporter par la bête. Sauvage. Martèle du sabot, mais Lucas vous y plante de ces banderilles de guitare si acérées dans le dos que vous avez envie de les dénoncer à la SPA. Fermez les yeux ( mais pas les oreilles ) et vous êtes transportés en 63 en Angleterre quand les Animals et les Them commençaient leur expérimentation sur le blues. Oui mais les Howlin', la vivisection ils la pratiquent sur le rock and roll, et faut avouer que ça saigne. Avec ce Tough Love ils ont toughé le gros lot. Ah cette basse qui broute, ce drummin' qui vous empogne et cette salière de guitare à la nitro...
BYE BYE BABY : encore plus colérique, la guitare qui pique, la voix qui résonne, la batterie qui caracole, une face B qui se profile aussi meilleure que la A, les backin'voices qui plagient la lead, un petit solo de Lucas comme on les aime, quinze secondes et circulez, n'y a plus rien à voir, sold out, Djivan qui s'égosille et s'étrangle de fureur, c'est rempli de petites séquences, comme ces tombeaux égyptiens truffés de chambres secrètes, cherchez et vous trouverez toujours quelque chose que vous n'aviez pas visité avant. Du grand art. L'est pas prête de vous débarrasser le plancher la baby, on ne le dira pas, mais c'est vous qui la retiendrez longtemps sur le pick up.
Rien de pire que le vice. Me suis repassé le volume 1, le Sleepwalkin' et le Bumblebee sur le phono. Si vous voulez mon avis philosophique sur la question, si les Howlin' Jaws avaient huit autres titres de l'acabit de ces quatre, et si l'idée leur venait de tous les réunir sur un trente-trois tours, l'on aurait là un album essentiel du rock français d'aujourd'hui. Wait and see !
Damie Chad.
JIMI HENDRIX
RENAUD EGO
( Le Castor Astral / 1996 )
Il y a des jours où je ne peux pas me regarder dans un miroir. Plus de deux cent cinquante livraisons de KR'TNT et pas la plus minuscule notule sur Jimi Hendrix. Un trou de cette grosseur dans le gruyère, c'est un peu exagéré. Je le comprends, je plaide coupable. Je n'ai aucune circonstance atténuante. Ce petit volume déniché dans la bibliothèque tombe à point nommé pour réparer cette omission criminelle. Peut-être que quand je mourrai, à cause de cette impardonnable faute, le bon dieu me refusera le paradis. Je l'aurai mérité. Mais peu me chaut, en vérité je m'en fous d'être avec les fous, tous les rockers sont des grands pêcheurs, sont tous damnés pour avoir joué la musique du diable, sont parqués au fond le plus noir de l'Enfer. N'y sont pas malheureux, une éternité de concerts et de jam-sessions, que voulez-vous de mieux pour des rockers ? D'autant plus qu'il y a des millions de jeunes filles fautives dont il faudra s'occuper activement afin qu'un peu de réconfort moral leur permette d'oublier leurs turpitudes terrestres. Que ces projets d'avenir et de pieuses intentions ne nous détournent de la vie de Jimi, en cette vallée de larmes.

Tout de même une chose me console : faut attendre la cent quinzième page du bouquin pour trouver un résumé de la vie de Jimi. Très bien fait d'ailleurs, dans l'ordre chronologique et agrémenté de brèves citations d'interviews qui éclairent parfaitement la trajectoire du zèbre. Discographie, bibliographie, filmographies à la suite. Rien de pesant, sélectif et rien que l'essentiel. Je vois poindre la question sur vos lèvres : mais que trouve-t-on donc avant ? Mais la biographie de Jimi Hendix, voyons c'est évident mes chers Watson.
Je sens le trouble qui s'installe dans votre cerveau. Soit vous n'avez rien compris, soit vous avez raté un élément important. Ne doutez point de vous, vous n'y êtes pour rien, tout est de la faute de Renaud Ego. Renaud Ego n'est pas un musicologue averti. Est loin d'être un imbécile. A produit des tas d'ouvrages sur des sujets aussi divers que l'architecture ou l'art rupestre africain, mais ce ne sont-là que des cordes adjacentes de son arc. Avant tout Renaud Ego est un poète. N'a donc pas rédigé un livre sur Jimi, tiré au cordeau. Nous offre plutôt ce que l'on pourrait nommer une transcription poétique du guitariste. Pas un recueil de poèmes sur Jimi, non mais le mystère Jimi - commun à tous les individus, car souvent nos actes répondent à des logiques qui nous appartiennent mais que nous ne révélons à personne – tel qu'il fut appréhendé par ceux qui le côtoyèrent. Pas tout le monde, en choisit cinq, Mae, Carol, Harry, Kate et Jim lui-même. Qui ont accompagné son existence, de la naissance à sa mort. D'où sa propre présence à la fin, car l'on est toujours seul lorsque l'on rend l'âme. Des témoins qui se sont plus ou moins épanchés lors et après la disparition de l'idole. Mais ces témoignages n'intéressent guère Renaud Ego. Sont juste des jalons, des balises enregistreuses qui essaient de comprendre le pourquoi du comportement erratique de Jimi.

Jimi ou la difficulté de vivre. Renaud Egonomise, ne nous fait point l'apologie du vaudou psychédélique, les disques sont là et ne demandent qu'à être écoutés. Non, nous conte l'histoire de Jimi le bluesman. Nous connaissons le musicien étincelant, le sorcier de la guitare, l'artiste accompli qui bouscule les traditions et redéfinit les bases de la guitare rock. Le côté glamour de Jimi, les journalistes à sa traîne, les filles à ses trousses, ses tenues vestimentaires colorées, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Le plus important est caché dans les eaux froides d'une vie éteinte. N'est pas né avec une cuillère d'argent dans les molaires. Noir et de sang indien. La dénomination d'Injun Fender serait celle qui lui conviendrait le mieux. L'est un peau-rouge, un Cheval Fou sur le sentier de la guerre, mais après l'extermination, s'est échappé des réserves. N'est qu'un fuyard qui tente de survivre. Né dans la misère, sociale et affective. L'a très vite compris que pour s'en tirer, il doit décamper au plus vite. A tout prix, par n'importe quel moyen, parachutiste - autant dire traître scout qui sert dans l'armée qui opprime son peuple - et puis plus tard avec sa guitare sur le dos, ce qui peut remplacer un bon cheval.

Joue déjà comme un dieu, mais c'est davantage une malédiction. Les Isley Brothers et Little Richard n'ont besoin que d'un accompagnateur, doué mais qui ne la ramène pas avec ses soli incongrus et tonitruants. Ne sait faire que du bruit pour se faire remarquer. Faudra attendre la rencontre avec Muddy Waters qui lui refile le secret du blues en trois minutes. Suffit pas d'ameuter le quartier. Le silence entre les notes est aussi important que les notes. Peut-être davantage même.
L'a tout compris, l'est prêt. Pour toutes les aventures. Ne ratera pas la chance Chandler. Chas des Animals qui cherchaient à devenir producteur... mais qui n'avait personne à produire. C'est l'Angleterre et en quelques mois la gloire. Ne le sait pas encore mais ce n'est qu'une étape. L'a franchira en toute splendeur. Mais c'est le deuxième pallier qu'il ne parviendra pas à surmonter.

Tout nouveau, tout beau. Eric Burdon, Eric Clapton, le Jimi Hendix Experience, Are you Experienced, une flèche qui monte dans l'azur du ciel et qui semble attirée par des hauteurs vertigineuses. Mais l'on n'échappe pas aux lois de la pesanteur terrestre, les filles, les dealers, les pique-assiettes, Jimi ne sait pas dire non. S'empêtre dans sa célébrité. L'a tout ce qu'il veut. Sauf ce qui lui manque le plus. Lui-même. Un peu de solitude pour se retrouver seul en lui-même. L'a de la ressource, suffit qu'il s'enferme dans un studio pour catapulter de nouveaux chef-d'oeuvres. Qui ne sont pour lui que des hors-d'oeuvres. Porte en lui de multiples possibilités. L'est un artiste, un vrai, un créateur. Et la machine s'enraye, la musique est en lui, mais refuse de sortir. Lui faudrait du temps, de la respiration, un manager à visées moins commerciales, un peu moins de dope, un peu moins de fatigue, et stupidement ce soir-là, un peu moins de narcotique...
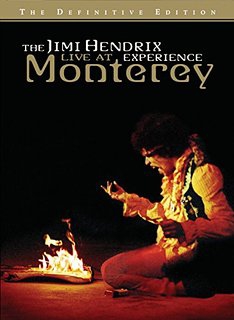
Robert Johnson est mort. On lui a volé sa vie. Toujours à courir devant sa chiennerie de vie qui le rattrape sans cesse. Au tournant, dans les lignes droites et sur le fil rouge de l'arrivée. Jimi Hendrix est mort. S'est fait voler sa vie. N'a pas su la garder pour lui. Difficile quand on ne l'a pas appris dès la naissance. Antonin Artaud dirait : suicidé de la société. Nous, l'on a inventé le mythe du club des 27. Mysticisme de pacotille. Une précaution oratoire en quelque sorte. Je parle pour nous. Nous n'aimons guère les miroirs qui nous ressemblent. Nous aussi, nous nous faisons, nous nous laissons, voler notre existence. Nous aussi sommes des anges exterminateurs, des goules insatiables, qui se repaissent du sang de leur entourage.
L'écriture poétique de Renaud Ego agit comme un scalpel, comme un révélateur. Un très beau livre que je vous engage à lire.
Damie Chad.
04 / 11 / 2015 – FRANCE INTER
TUBES AND CO
REBECCA MANZONI
Ma vie est une souffrance sans cesse renouvelée. Je ne plaisante pas. Je peux même vous donner l'heure. Tous les matins, à sept heures dix-huit minutes exactement. Moi pauvre victime innocente une cruelle torture m'est ainsi infligée à l'instant de mon petit déjeuner. Alors que je trempe généralement ma vingt-septième biscotte dans mon bol de café. Vous livre le nom de ma tortionnaire, Rebecca. Jusqu'à son apparition sur les ondes de France Inter, la seule radio captée sur les ondes du trou géologique provinois, tout va bien dans le monde. Une petite guerre par ci, un attentat par là, les impôts qui augmentent, une épidémie en préparation, des élites qui se remplissent les poches, des dizaines d'usines qui ferment, des sans-logis qui dorment dans la rue, pffft ! des broutilles. Le genre de facéties qui ne vous coupent point l'appétit. Et c'est-là que survient la Manzoni. Ne veut que votre bonheur. Sous prétexte que la musique adoucit les moeurs, elle nous présente selon ses humeurs, un chanteur, une chanson, un style. Ce n'est pas bien long. La plupart du temps, vous avez juste droit à l'intro du morceau, puis elle cause par-dessus. Ce n'est pas bien grave. En règle générale, aux heures de grande écoute les programmateurs de la radio nationale ont des goûts détestables. Ils s'en vantent. Se prévalent d'un label de qualité, une authentique certification NF à les en croire, vous pouvez écouter les esgourdes fermées, l'on vous assure que c'est du bon. Résultats vous avez droit à un, et de préférence une, asthmatique de service qui essaie de couvrir de son maigre filet de voix les éructations funèbres d'une piteuse orchestration électro.
Mais il ne faut jamais désespérer de l'humanité. J'ai évité la mort subite du nourrisson, je ne sais comment. Toute fière, Rebecca Manzoni nous annonce le titre de sa prochaine séquence : Be Bop A Lula !

BE BOP A LULA
De Gene Vincent se hâte-telle d'ajouter. En deux minutes et demie, elle s'en sort plutôt bien, le morceau composé sur son lit d'hôpital, l'accident de moto, parvient même à citer la guitare de Cliff Gallup et les balais de Dickie Harrell, son influence sur le rock européen, notamment anglais et français, et la fin amère dans la solitude et la misère... Crayonne une silhouette, peu, trop peu, à peine esquissée, mais assez toutefois, pour donner au néophyte l'envie de chercher, d'écouter et d'en savoir plus.
Assez rare pour être signalé.
Damie Chad.
00:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ash, the wave chargers, the howlin' jaws, jimi hendrix, be bop a lula
02/12/2015
KR'TNT ! ¤ 258 : RON S. PENO & THE SUPERSTITIONS / SMOOTH AND THE BULLY BOYS / HOT SLAP / MEMPHIS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258
A ROCK LIT PRODUCTION
02 / 12 / 2015
|
RON S. PENO & THE SUPERSTITIONS SMOOTH AND THE BULLY BOYS HOT SLAP / MEMPHIS, TENNESSEE |
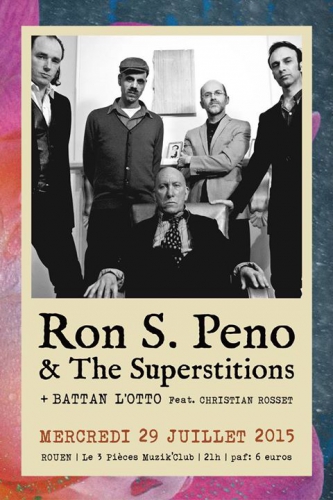
29 juillet 2015
Le Trois Pièces. Rouen (76).
Ron S. Peno & The Superstitions.
Peno Way
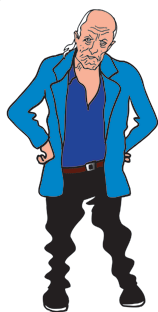
Ça fait bientôt trente ans que Ron S Peno se distingue du commun des mortels par sa façon de chanter et de rechercher de nouveaux horizons. Il serait même du genre à contredire ceux qui affirment mordicus que tout a déjà été dit et que tout a déjà été fait. Ron ne tient absolument pas compte de ce genre d’option fermante. Au contraire, il donne libre cours à son goût pour l’aventure, et comme l’esprit mélodique est très présent chez lui, il semble parfaitement incapable de pondre un mauvais disque, que ce soit avec Died Pretty, les Superstitions ou les Darling Downs. Non pas que ses albums soient tous des classiques de pop moderne, disons plutôt qu’il s’agit de disques intéressants, comme le sont généralement les albums d’auteurs-compositeurs interprètes dont la discographie s’étend sur trois ou quatre décennies et qui ont su créer au fil du temps ce que les Britanniques appellent un solid following. Ron S Peno appartient à la caste des big songwriters de type Chris Bailey, Robert Pollard ou Frank Black. Il propose un singulier mélange de chansons ambitieuses et d’atmosphères soignées. Et comme les gens pré-cités, il ne semble s’inspirer que de lui-même.

On a eu la chance de le voir se produire en France au mois de juillet. Il était descendu à la cave pour un set intense et ultra-convainquant, puis on l’a revu au grand air, lors du joli festival de Binic. Il faut dire que sur scène, Ron est extrêmement bien accompagné. Ses amis australiens ont voyagé avec lui, avec en plus Vinz des Holy Curse à la basse.

Quand on connaît un peu le côté orchestré de ses derniers albums, on s’inquiète un peu de la déperdition scénique, mais Ron parvient à créer une sorte d’équilibre plutôt idéal entre les compos ambitieuses et les choses plus musclées, dans lesquelles il semble chaque fois se jeter à corps perdu. Ron le mélodiste se transforme alors en Ron le shouter et ça prend vite des proportions spectaculaires.

Rien n’est plus facile que de casser la baraque quand on est un bon chanteur. Ron se taille facilement un chemin dans les esprits des néophytes avec des mélodies insistantes et forcément, lorsqu’il tape dans le dur, comme disent les maçons portugais, il entre en territoire conquis.

Il suffit d’écouter «Anywhere And Everything Is Bright», son dernier album, pour se faire une idée précise de ce phénomène. Sur ce disque tout est big : les atmosphères comme les finaux. L’amateur de big atmospherix se prosternera devant «Myself In Thee». Ron y cherche l’échappée belle au beat ramassé et donc il va chercher du chant à de sacrées hauteurs - Uhh Uhh I find myself in thee - On sent là un goût prononcé pour la démesure. L’autre gros cut de l’album, c’est «Call Your Name», très progressif au sens du progress in motion et amené petit à petit à l’horizon d’une authentique démesure. Ron ne semble vivre que pour ça, il lorgne sur le point de non-retour des grandes compos aventureuses. Il sait donner du volume à sa voix et la colorer. Alors, forcément, ça décolle, car ce mec est très doué pour l’overdrive. L’autre belle chanson de l’album est celle qui fait l’ouverture, «Say It Isn’t So», montée sur un beau mid-tempo. Il semble viser le crépuscule de Johnny Cash et descend à la cave de son timbre pour y trouver les grandes langueurs universelles. Voilà un rock encore une fois très ambitieux joué au balladif. Il y règne une élégance formelle - It’s what I say say it isn’t so - Ron captive par la pulpe du chant. On retrouve cette élégance surannée dans «The Other Side» et «Destination Unknown». Il y cherche l’horizon mélodique et fait littéralement jaillir le jus du chant. Avec «Feels So Good», Ron reste dans la même élégance ambiancière. On voit bien que toutes ses compos sont soignées et extrêmement charpentées, chargées de mystère et d’une certaine forme de beauté sauvage. On se régale de «Oh Life», il y fait monter sa petite mayonnaise avec un vrai savoir-faire. Il fait tout à la finesse et au chant précieux, dans un environnement d’arrangements florentins.

En 2011, il enregistrait un autre album avec les Superstitions, «Future Universe». Dès «The Death Of Me», on retrouve cette voix de timbre clair et chatoyant et certains échos renvoient au Bono d’«Atchung Baby». Puis on va de cut prodigieusement océanique («New Blood») en cut titilleur et passionnant («I Wish») pour en arriver à des choses puissantes et radicales qui ne demandent qu’à se répandre dans l’obédience d’un heavy beat («Livewind»). Et puis on tombe sur l’absolue merveille, la perle noire dont rêvait Henry de Monfreid, «Gameplan». Voilà un cut visité par les violons et admirablement visionnaire. Ron voit les mêmes horizons embrasés que Chateaubriand. Voilà bien une pop d’ambition démesurée, une pop attachante, soignée et raffinée à la fois. Ça sonne comme un classique des Tindersticks, c’est effarant de grandeur élégiaque et Ron, en bon spécialiste des ras-de-marée, le fait exploser. On reste dans les grosses ambiances avec «Fall From Above» qui reçoit la visite d’un solo nuptial. On nage là en pleine magie nubienne de dérive du Mékong à l’horizon rimbaldien. Il termine cet album trop riche avec «My Own Fire To Light» qui sonne comme un vieux balladif excitant, doté d’un beau solo au note à note et d’un final éblouissant, chanté à l’éplorée - I get my own device - Fantastique.

Ron doit surtout sa réputation aux vingt-cinq ans de carrière de Died Pretty et aux huit albums enregistrés pendant cette période. Dans les années quatre-vingt, on était tellement obnubilés par les Saints qu’on avait beaucoup de mal à suivre les autres groupes australiens. Et puis un jour, on s’est mis à écouter «Every Brillant Eye» par simple curiosité. Oh ce n’est pas l’album du siècle, loin de là. La face A est complètement transparente et on se réveille avec «Prayer» qui fait l’ouverture du bal de la face B, un cut assez élancé et même grandiloquent qui rappelle le Bono d’avant. Ron chante ça à l’énergie concomitante. Il lance sa prière. En écoutant «Whitlam Square», on comprend que la voix de Ron fonctionne comme un système bien établi, sur un ton élancé et comme privé d’espoir. Il semble que Ron soit animé des meilleures intentions et qu’il soit en quête perpétuelle de démesure. Il boucle l’album avec «From The Dark». C’est exactement le même système de mid-tempo à prétention de promontoire, chanté face à l’océan dans des bourrasques d’orchestrations, un système qu’a d’ailleurs récupéré Richard Hawley. Comme Richard, Ron défie les éléments. C’est un teigneux de promontoire, il peut clamer jusqu’à la fin des temps, comme Peter Hammill. Personne ne pourra l’en empêcher. Il vise une sorte de grandeur épique et derrière, ça suit bien. On a même droit au solo bien glouglouté du bulbe.
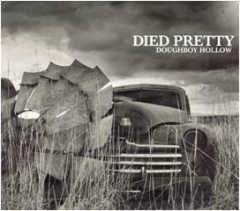
«Doughboy Hollow» paraissait l’année suivante, avec une pochette ornée d’un vieux camion abandonné dans un champ. Ron attaquait avec un «Doused» de belle pop évanescente jouée à l’arpège effiloché. Ron reste dans l’élégiaque. Pas question d’en bouger. On peut dire que «Sweetheart» est le hit de la face A. Ron s’impose par un sens mélodique affirmé et un goût prononcé pour la tragédie. D’autres jolies choses attendent l’esprit curieux de l’autre côté, comme par exemple «Stop Myself», une jolie pièce de pop évolutive, dans la tradition de la grande pop anglaise, ou encore «Battle of Stanmore» qui ne doit rien à celle d’Evermore, mais on se croirait quand même sur Led Zep III. Influence évidente. Avec «The Love Song», Ron reste toujours aussi entreprenant, aussi bien mélodiquement que littéralement. I’m gonna love you, répète-t-il. Le cut final qui s’appelle «Turn Your Head» renvoie directement aux Tindersticks. On retrouve la même ambiance d’élégant malaise. On pense aussi au Bryan Ferry des early Roxy. On nage en pleine décadence et ça fait du bien.
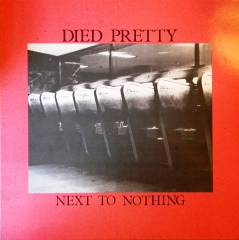
Le premier maxi est sorti chez Closer en 1985 avec une pochette bien lugubre. On y voit une rangée de box de téléphones dans une lumière incertaine. L’image est tellement incongrue qu’au premier abord, on croirait voir des pissotières. Ron et ses amis proposaient déjà à l’époque le slow burning candle d’ambition démesurée dont ils allaient nous abreuver pendant trente ans. Deux hits se nichent sur la face B : «Desperate Hours», fantastique explosion multi-directionnelle, une belle psyché de machine molle tendue aux cris d’assaut et aux conséquences incalculables puisque sa course s’achève dans une fantastique apothéose boréale. Le «Final Twist» qui suit vaut lui aussi largement le détour, puisqu’on y entend Ron ululer au fond du studio et naviguer au long d’atmosphères lourdement dépravées.
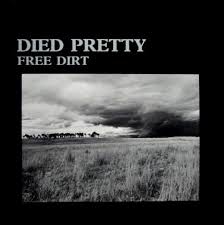
Le premier album «Free Dirt» paraît l’année suivante, orné d’une belle photo de paysage en noir et banc. Chez les Died, les choix graphiques en imposent. Ce premier album est probablement leur meilleur album. On a une face A bien fournie en pop élégiaque («Life To Go (Landsakes)», où la grandeur semble jaillir de la mélasse) et en grandiloquence («Just Skin», bardé d’effets radicaux et de petites atmosphères psyché délibérées et bien senties, quasiment épidermiques - Brett Myers joue un gros solo psyché à l’étranglée). Et puis on tombe sur une face B exceptionnelle qui s’ouvre avec un «Blue Sky Day» puissant que Ron emmène à la force de sa classe. Comme Robert Pollard, il crée les conditions d’une power pop tendue vers l’avenir. On détecte chez lui et ses amis une certaine aura. Même genre de révélation avec «Round And Round», pièce de pop-rock extrêmement solide puisqu’arabisante. C’est Mark Lock le bassman qui embarque «Laughing Boy» pour Cythère en créant les conditions de l’hypnotisme. Brett Myers veille au grain psyché et Ron fait un festival de uh-uuuuhhh uuuhhh, alors le cut décolle de la terre. Ils enchaînent ça avec «Trough Another Door», un balladif musculeux et incroyablement racé, joué à la slide, au léger parfum de Stonesy. Admirable, on ne s’en lasse pas. C’est joué avec détermination et avec un talent fou. Un joli solo sax vient même enrichir le brouet. Les Died savent se montrer anglais dans le dévolu. Quelle prestance !
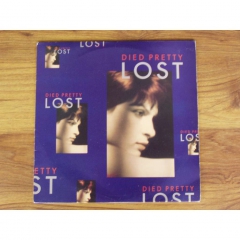
Sur «Lost» paru deux ans plus tard se niche une merveille nommée «Winterland». Ron perd sa voix fine dans un déluge de power pop traversé par une bassline aventureuse. On retrouve des dynamiques de basse qui n’appartiennent qu’à Keith Richards. Brett Myers arrose la plaine en feu pendant que Mark Lock balance son drive aérodynamique. Le «Tower Of Strenght» qu’on trouve en face B a de faux airs dylanesques, par ses côtés ambianciers bien tirés et toujours très soignés. Les Died n’ont vraiment rien à voir avec le fameux rock australien. Notons au passage que Rob Younger produit leurs deux premiers albums. Autre cut visité par Mark Lock : «Out Of My Hands», un cut qui voudrait bien chinoiser dans le psyché. Ron emmène «Caersar’s Cold» d’une voix plaintive, irrémédiablement plaintive. L’autre gros cut de cet album est «Crawls Away», avec son Ah crawls crawls à la Question Mark et un Mark Lock toujours aussi présent. On voit cette pop monter sans efforts dans les highlands.

«Trace» est un album solide, l’un de ceux qu’il faut écouter, si on veut entrer chez Died Pretty par la grande porte. Et pourtant, «Harness Up» aurait tendance à nous faire fuir, à cause du son trop éclatant. On y retrouve Ron en chemise ouverte sur le poitrail, face à l’océan. Par contre, on trouvera un peu plus loin de véritables énormités, comme par exemple «Headaround», monté comme un stomper et qui flirte avec l’hymne californien, sevré de tambourins. Le solo file sous le vent à la note stridente. S’ensuit un «Till We Get It Right» monté en dégringolade d’accords psyché. Ça décolle aussi sec et ça devient vite grandiose. On voit s’écrouler les falaises de marbre dans l’écume des jours. On pense bien sûr à Baby Woodrose, à cause de ce solo liquide qui s’écoule comme un torrent luminescent - Till we till we/ Get it right - Quelle dégelée ! Ron nous propulse en pleine mad psychedelia. Tout y est : le riff de basse et l’ampleur cataclysmique. Nouveau coup d’éclat avec «Through My Heart». Ron pose bien son couplet, yeah ! Il s’appuie sur une belle déconfiture d’accords évolutifs qui tendent tous le cou vers la modernité et baaam, on assiste au départ d’un joli solo psyché. C’est admirable de son et grouillant de saumons écarlates. Encore une authentique merveille : «110 BPM», sacrément bien amenée et même scandée, violemment riffée à la basse. Brett Myers joue son solo en continu à la manière des Stooges, wha-wha et gras-double, ça vire à la pure stoogerie et Ron le voodoo nous hante ça bien. Voilà une bande de puissants sorciers.
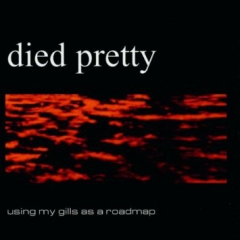
En 1998 paraissait «Using My Gills As A Roadmap», un disque superbe et terriblement ambiancier. Fantastique mise en bouche avec «Slide Song» qui s’impose comme une véritable dégelée de beat étalé à la surface de Saturne. Ron surnage dans la tourmente. On assiste à une sorte de développement atmosphérique. Ron prend ça à la voix blanche. Il cultive la perdition, loin des yeux et loin du cœur, dans le flamboiement d’un ciel de nuages rouges. Avec l’arabisant «She Was», Ron nous embarque pour Cythère. Puis il chante «Stay» d’une voix plaintive de petit bambino alors que flagornent les grosses notes de basse. Il règne dans ce cut une fantastique ambiance longiligne d’extension lumineuse. On reste dans le bel hypnotisme collatéral avec «The Daddy Act», bien marqué au beat et digne du «Soon Over Babaluma» de Can. Voilà un cut bon comme le pain et visité par des spoutnicks. On note l’excellence de la pertinence. «Radio» voudrait bien sonner comme un hymne, alors Ron le fait sonner comme un hymne universel, soutenu par un énorme drive de basse qui lèche la mouille de la crête. Ça explose, eh oui, et la basse se jette dans l’explosion d’octaves. Franchement, «Radio» sonne comme un événement marquant du XXe siècle. Avec «Away», Ron voudrait se faire passer pour un chanteur innocent, mais en réalité c’est un fin renard. Il chante d’une voix de petit garçon, mais ça claque à l’accord impénitent. Ses amis cherchent des noises à la noise.

«Everydaydream» est le dernier album de Died Pretty. On y trouve deux cuts assez percutants. «Misundestood» pour commencer, chanté perché avec, comme on dit dans les bas fonds, du son au cul du camion. Ron va droit sur l’élégiaque, comme il l’a toujours fait, et Brett Myers joue au loin, perdu dans l’écho du temps. Ces gens-là savent sortir un son. L’autre hit du disque c’est «Here Comes The Night» monté sur un beat techno. Ils sonnent somme la forge du Creusot. C’est un fort bon choix. Ce stomper provoque de l’hypnose. Brett Myers voyage allègrement dans les failles du beat alors que Ron chante d’une belle voix mouillée. On trouve d’autres bons cuts sur cet album, comme par exemple «Call Me Sir» joué au beat du heartbeat et «Dream Alone», lancé à l’arpège dévastateur. Ils jouent un beat violateur de traités. Ron adore les transes interlopes. Ça le transporte. Il chante comme un spectre. Les Died Pretty sont bien meilleurs que Primal Scream. Aucun cut de cet album ne vous laissera indifférent. Bien que tapé aux machines, «Brighter Ideas» séduit car Ron chante délicieusement à la queue de cerise arabisante. Idem pour «Special Way», construit comme un paradoxe puisque le parti-pris technoïde s’accommode fort bien d’émissaires pelotonnés. C’est très intéressant, têtu et bienvenu à la fois, jamais ennuyeux.
En parallèle, Ron enregistre des disques avec Kim Salmon. Leur duo s’appelle les Darling Downs. Comment les situer ? Folk intimiste ? Démarche péjorative ? Cult-cult-band la praline ? Dernier bastion des incompris ? En tous les cas, l’abord se veut rêche.
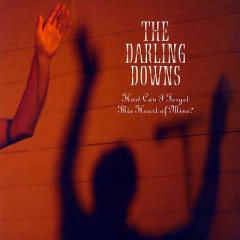
On se souvient d’avoir poussé des jurons à l’écoute de «How Can I Forget This Heart Of Mine», acheté à prix d’or chez l’importateur du boulmich. Ron chante «I’ll be Always There» à l’arpège de collège et «In That Jar» à l’acou mou du genou. Malgré une belle attaque, «Loverslain» plonge dans un clair-obscur dénué de tout intérêt. «Waste My Time» est un cut qui pourrait bien résumer l’album. Rien n’est pire que de perdre son temps. Sur «And They Danced», Ron chante une polka absurde et sonne comme Joan Baez. On le savait raffiné, mais là il exagère.

Ron et Kim posent cravatés pour la pochette de «In The Days When The World Was Wide». Quand on voit ce genre de pochette, on se frotte les mains. L’écoute, c’est une autre histoire. On parviendra à se régaler du «Saved» gratté au banjo qui fait l’ouverture, car il pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc. Puis on va errer de loin en loin, et s’accommoder de la country doucéreuse d’un «Wish You Were Her» qui ne doit rien au Pink Floyd et d’un «Between The Forest And The Trees» qui est un peu plus élancé que la moyenne des balladifs. Kim et Ron sont deux légendes vivantes, et seule la curiosité pousse à écouter l’album jusqu’au bout. On y entend Kim jouer «Higher WhenThey Fall» au feeling pur et tirer de savantes notes de balancement. Finalement, c’est le son du banjo qui leur va le mieux, et ils bouclent avec «Your Face», un joli coup de folk intimiste.
Signé : Cazengler le penaud
Ron S Peno & The Superstitions. Le Trois Pièces. Rouen (76). 29 juillet 2015
Died Pretty. Next To Nothing. Closer Records 1985
Died Pretty. Free Dirt. Citadel 1986
Died Pretty. Lost. Citadel 1988
Died Pretty. Every Brillant Eye. Festival Records 1990
Died Pretty. Doughboy Hollow. Festival Records 1991
Died Pretty. Trace. Columbia 1993
Died Pretty. Sold. Columbia 1995
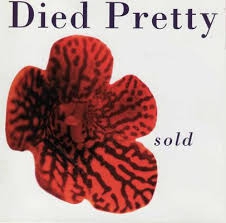
Died Pretty. Using My Gills As A Roadmap. Citadel 1998
Died Pretty. Everydaydream. Citadel 2000
Darling Downs. How Can I Forget This Heart Of Mine. Darling Downs 2005
Darling Downs. In The Days When The World Was Wide. Darling Downs 2013
Ron S Peno & The Superstitions. Future Universe. Public Bookings 2011
Ron S Peno & The Superstitions.Anywhere And Everything Is Bright. Public Bookings 2013
27 - 11 - 2015
LE 3 B / TROYES
SMOOTH AND THE BULLY BOYS

Brr ! La teuf-teuf m'a laissé à trente mètres du 3 B, j'ai toutefois l'impression de traverser la Sibérie aux temps rugueux des mammouths poilus, l'ère des glaciations arctiques serait-elle revenue ? Quand je pense que la planète se mobilise pour le réchauffement climatique alors qu'il serait si simple de transférer le trop plein de chaleur des étés caniculaires dans les saisons froides. Au lieu de s'activer à préparer le troisième guerre mondiale, nos dirigeants chéris feraient mieux de s'atteler à cette noble cause, je ne comprends pas pourquoi mes amis disent que je trimballe des idées stupides dans ma caboche, mais bon, on n'est pas là pour refaire le monde, juste pour écouter Smooth and The Bully Boys. En théorie, car dès que je franchis la porte, la cruelle vérité me crève la vue. Les Bully ne sont pas là ! L'espace-concert s'avère désertique ! Pas le moindre potentiomètre de guitare en vue. Je m'en vais crier famine auprès de Béatrice qui, compatissante, me sert une tasse de café bouillante et salvatrice. Me rassure, les Bully ne sont pas loin, soixante kilomètres, brouillard sur l'autoroute qui vient de Belgique, mais ce n'est pas grave, ils gardent la frite.

En attendant, discussion avec les habitués, l'on pose une chaise dehors devant le café. Ce n'est pas un acte de cruauté mentale envers un pauvre meuble innocent – inutile de lancer une pétition – mais une sage précaution pour réserver une place de stationnement pour la camionnette des Bullys, qui arrivent enfin. Ne sont que trois, mais tout de suite c'est l'invasion. Ils engouffrent en cinq minutes trois tonnes de matos et vous l'installent en douze secondes. Des pros, pas comme vous quand il vous faut trois jours pour monter votre toile de tente à deux places. N'avez pas le temps de finir votre verre que déjà ils sortent leurs instruments de leur couffins protecteurs. Jusque-là, ils ont l'air sympa et terriblement efficaces. C'est alors que survint la catastrophe. En cinq secondes votre préhension du monde peut changer. C'est la faute de Michel, le guitariste, qui nonchalamment sans trop penser à ce qu'il fait vous gratouille deux demi-accords. Manière de vérifier si l'électricité circule dans les cordons. Le Stromboli, vient d'exploser. Ou alors Zeus tonnant, a piqué un éclair de colère, là-haut sur l'Olympe. Un truc à vous glacer le sang. A vous fracturer le cerveau. Une intuition m'illumine, les Bully ne sont pas tout à fait un groupe de western swing.
SANS LE SON
( Pour les âmes sensibles )

Vous préviens tout de suite les torts sont partagés. Et affichés. Le gus de gauche. Ca tombe bien il s'appelle Gus. Noir et rouge. Sang et nuit. Lui et sa contrebasse. Pas une big mama débonnaire. Plutôt sorcière élancée dans une cape couleur de cercueil, rehaussée de criminels motifs stylisés au fil rouge. Flammes de l'enfer au dos, runes énigmatiques par le devant, les cordes sont écarlates comme s'ils elles avaient traîné sur le pont ensanglanté d'un drakkar viking durant un abordage. Michel qui n'est pas un ange est au centre, micro à la hampe ornée de joujoux mexicains, trois têtes de mort ricanantes, vous en retrouvez le motif morbide sur le devant de sa chemise noire, l'est armé d'une Gretsch métallique et comme parsemée de flocons de neige, et puis sur le côté il y a Jean-Armel. Comparé aux deux longilignes gaillards précédents, l'offre l'aspect du petit frère à qui les grands n'arrêtent pas de faire des misères. Lui ont fauché son tabouret, et n'a droit qu'à la portion congrue, une caisse claire, un tom, une grosse caisse, et un truc indistinct derrière qui n'a l'air de servir à rien. C'est le farfadet bondissant. Le korrigan breton, l'a fauché toutes les baguettes magiques de Merlin et l'on ne tardera pas à s'apercevoir qu'il sait s'en servir.
AVEC LE SON
( Pour les âmes trempées sept fois dans les eaux du Styx )

Avant de commencer, ils ont avalé trois godets de jack, cul sec. Tout de suite après, c'est l'assistance qui est restée cul bas. Submersion totale dès les premières secondes. Basse grondante, guitare rugissante, batterie fracassante. Questions : mon premier fait du bruit, mon deuxième fait du bruit, mon troisième fait du bruit, qu'est-ce que c'est ? Du rock and roll ! Qui c'est ? Smooth and the Bully boys ! C'est donc quoi ? Un merveilleux groupe de rock and roll ! Gravissime pâte sonore qui vous englobe et dont vous ne cherchez qu'à rester empêtré comme un fruit confit dans un cake anglais, englouti à jamais jusqu'au bout de votre vie. Musique célestielle de rockers jouée par une légion de damnés. Le diable frape à votre porte et vous le laissez entrer. Se sont partagés les tâches. Gus est proposé au vrombissement de fond, gros porteur prêt au décollage qui lance ses moteurs. Douce musique ! Faudrait trois orchestres symphoniques pour obtenir ce bruissement tonitruant. Le vol de mille frelons fous bourdonnant après la reine des abeilles. Michel lance la foudre. Raid de dix mille hell's angel sur Hollister. Vous sert de ces remontées de riffs à vous retourner l'estomac dans l'œsophage. Quant à Jean-Armel il se contente d'entrer. Mais dans le vif du sujet. Par la porte bardée de fer du château-fort sur laquelle une médiévale armée de soudards porte des coups de boutoirs, à l'aide d'un solide chêne centenaire qu'ils s'amusent à encastrer dans les poutres des vantaux disloqués.

SANS L'ESPACE
Avant d'entrer dans le détail, débarrassons-nous du seul aspect de la soirée qui fâche. Avec la vue d'ensemble du paragraphe précédent, le lecteur averti a déjà compris. Entendu le volume sonore, nous avons affaire à une musique qui ne peut être interprétée pénardos, tranquillement debout, comme quand vous attendez patiemment votre tour au guichet de la poste. Faut de l'espace, difficile d'organiser une course de côtes sur un parking de supermarché. Or le 3 B, le faudrait au cube puissance dix pour que nos trois tigres rugissants puissent nous donner un véritable aperçu de leur savoir faire intégral. Au moins désormais, vous avez un but dans la vie : voir un concert de Smooth and the Bully Boys sur une grande scène. Visionner un film sur votre smartphone, ça ne vaut pas l'écran géant du kinorama. Cette restriction volumique ayant été posée, rapprochons-nous du volcan en éruption.
DON'T TOUCH MY GUITAR

Pas besoin d'y porter vos doigts. Michel se débrouille très bien tout seul. N'a besoin de personne. L'a une relation privilégiée avec. N'est pas non plus partisan du couple unique. L'a plusieurs partenaires, une grosse Gretsch blanche et une autre, orange. Non pas celle d'Eddie Cochran. Un carburateur de Chevrolet 1957, avec un manche un peu maigrelet fixé dessus. Petit manche mais gros son. Filoche sec et vite. L'emmène la salle avec lui pour une épouvantable croisière sur la highway sans retour. Toit ouvrant rabattu, ni vitre, ni portière, tout le monde s'accroche et rugit de plaisir.
Ne se contente pas de passer les riffs en force, sait faire preuve de tendresse incendiaire. Parfois il abandonne sa pose de guitar-hero à la bandoulière sonnante et trébuchante, il saisit l'objet de son désir, le tient à plat et en caresse voluptueusement, mais sur un rythme endiablé, les cordes. Elles en frémissent d'extase les diablesses montées au summum de leur paroxysme. Chattes hurlantes sous des phalanges brûlantes. Et puis hop, d'un coup d'épaule, il reprend la pose conquistador du riffeur à qui il ne faut pas en promettre.
DREAM DRUM

Ce qu'il y a de terrible avec les Bully, c'est qu'indépendamment d'être chacun un super musicos, ils ont compris qu'ils étaient sur scène pour jouer ensemble. Ne pas confondre, réciter tous les trois en même temps sa leçon et bye-bye le boulot est terminé. N'a même pas commencé. Faut un perturbateur. Le rock linéaire, le rock au mètre, le rock carré à angles droits, le rock attendu sans surprise, vous le gardez pour les maisons de retraite.
Non Jean-Armel ne joue pas de la batterie. Il se joue d'elle. Tourne autour d'elle, effectue danse de soleil et danse du scalp. Avec lui la dialectique casse les breaks. D'abord il y a l'entrée de jeu. Une frappe extraordinaire. Une puissance magnifique. Un seul coup et il sépare le jour de la nuit, l'instant présent du passé. Un seul coup et il vous arrache de votre quotidien. Ce lutin possède une bonne âme. Mais ne s'arrête pas. Ensuite il martèle, puis il dégringole les breaks et c'est un chassé-croisé prodigieux avec la guitare. Un riff, un break et rebreak dans le riff et reriff dans le break du riff et ainsi de suite, dix, quinze fois de suite. S'amusent comme des fous, en rajoutent toujours un grand coup pour la route. Se regardent, lâchent un carton rouge, et rigolent comme des damnés.

C'est comme l'apéro à quinze quand chacun remet quinze fois sa tournée. L'on ne sait plus comment s'arrêter. Sont partis sur Peggy Sue, lui refilent un sacré ripolin tout neuf, là-bas à Lubbock le grand Buddy a dû en sortir de sa tombe, et avec tous les squelettes en goguette du cimetière l'a dû se transformer en zombie affamé. Pour une fois qu'on pense à moi, très fort, a-t-il dû déclarer tout heureux, je ne vais pas rater la fête.

Feront subir le même traitement de choc à Mystery Train d'Elvis, en l'aiguillant sur la voie bleue celle qui remonte vers les marécages les plus noirs. Et Mister Jean Armel, tape de partout. Une troisième baguette – aussi opératoire que le troisième oeil des sciences hermétiques - entre les dents, l'esprit du rock and roll s'empare de son esprit. Met le feu à sa batterie et continue à jouer au milieu des flammes.
HAUTE BASSE

Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un épisode de la saga. C'est le Gus qui sort le grand jeu. Nous a déjà régalés de ces petits solos à l'arraché qui font le bonheur des blousons noirs. De ces giclées de notes spermatiques qui annoncent les grands chambardements. Le voici qui se permet l'invention d'un nouveau-sport, le skate-bass, l'exiguïté du lieu en limite la présentation, aussi se contente-t-il de la chevaucher suggestivement, position du kayac lapon, ou gaucho solitaire dans la pampa en feu. Michel est au micro, il moanise, il vitupère, il gronde, il hache et il tomawacke. L'est emporté par une fureur sacrée. Saute sur la grosse caisse. Donne de grands coups de guitares sur la cymbale, puis s'y escrime dessus à grands coups de pieds. Ce qui n'a pas l'air de déplaire à son propriétaire. Plus on est de foutraques... d'ailleurs il lance une baguette à Billy, qui se met à taper à sa guise un peu partout et sans compter les temps, et miracle Jean-Armel rétablit l'équilibre rythmique comme si de rien n'était. Attention, le garçon possède une frappe zéplinesque et une science jazz, tout cela mis au service d'un rockabilly ultra déjanté mais de haute tenue.

DELIRIUM FINAL
Jean-Armel remet le feu à son caisson, s'enfuit au fond du comptoir, en ramène Béatrice et décide de l'initier à l'art subtil de la batterie. Tourne autour d'elle, lui montre d'une main les rudiments et finit par lui mordre les cheveux à pleines dents. Ce n'est pas fini pour la malheureuse au sourire épanoui, l'a l'insigne honneur de tenir sur ses deux bras tendus la guitare de Michel qui lui montre les plans secrets des guitaristes de hard. Gus a fini par subtiliser la bouteille perso de jack de Michel qui pour se venger verse son verre de bière sur la caisse claire de Jean-Armel qui continue à turbiner comme un forcené sur sa crêpière, baptisant avec insistance l'assistance de mousse de gueuze, avant de tout renverser dans un brouhaha final.

Les Smooths ne sont pas des mous. Les Bully, ce n'est pas de la balle qui bulle. Mais ils ont un truc en plus. Un humour dévastateur, une auto-ironie qui induit une sympathie immédiate du public à leur encontre. Dans ce charivari Béatrice la patronne n'a pas perdu la tête. Un groupe de cet acabit, s'appelle revient. N'y a qu'à voir les trognes jubilatoires qui se pressent autour d'eux. Tous les samedis soirs 2016, sont déjà retenus, reste un trou pour le vendredi premier avril juste avant la Suisse et l'Italie. Désolé les copines, mais le soir du 1° Avril, ma soirée est retenue ! Gros poisson. Piranas rock.
Damie Chad.
( Photos : FB : Christophe Banjac )
MEMPHIS
AUX RACINES DU ROCK ET DE LA SOUL
FLORENT MAZZOLENI
( Castor Astral / 2006 )

Je cherchais je ne savais pas quoi dans ma bibliothèque lorsque je suis tombé sur ce petit livre. Memphis, tout le monde connaît la chanson. Remarquez, lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois – c'était en 1964, j'étais encore tout minaud – le truc me paraissait bizarre. C'était en 1964, émission Âge Tendre et Tête de Bois, d'Albert Raisner, l'avait beau sourire de toutes ses ratoches, la gueule du gars ne me paraissait pas franche du collier. Mais quand on sort tout juste de l'oeuf, l'on prend ce que l'on trouve et dans le coin paumé où j'habitais et le milieu où j'étais né, n'y avait strictement rien. Mais revenons à Memphis Tennessee, un morceau présenté par Danyel Gérard, un pionnier malheureux du rock français. L'avait commencé à essuyer les plâtres juste avant tout le monde. Puis l'avait fait comme Elvis. L'était parti faire son service. L'armée, ah ! ça vous forge un homme, mais ça détruit les stars. Quand il était revenu, personne ne l'avait attendu et il y avait des blanc-becs comme Hallyday et les Chaussettes Noires qui squattaient les premières places du hit-parade.
L'avait un peu triché Danyel Gérard. Exactement pour employer les mots de l'époque l'avait adapté. Nous refilait des informations inexactes aurait dit Chuck Berry. L'avait métamorphosé la capitale du Tennessee en un beau jeune homme mystérieux, j'avais du flair, pensai déjà que la télé me manipulait, j'ai écouté la bouche en coeur. C'est le lendemain que j'ai fait mon enquête dans le livre d'anglais de ma soeur et que j'ai découvert le pot aux roses géographique. C'est plus tard que j'ai appris qu'il était plutôt de couleur blues, mais auréolé d'un soleil le plus chaud, very hot Sun pour vous montrer que je sais parler comme les amerloques. C'est que, voyez-vous, comme tous les rockers, I am an extremely pure native from Memphis. Tennessee.

Cette fois-ci c'est Florent Mazzoleni qui s'y colle. Spécialiste patenté de musique noire. Des deux côtés de l'Atlantique, Amérique et Afrique. Perso j'ai beaucoup aimé son gros bouquin, en collaboration avec Gilles Pétard, Motown, Soul et Glamour, dont il raconte la devanture chamarrée et analyse les dessous stratégiques, avec précision et réflexion. Mais délaissons au plus tôt les trottoirs de Detroit City pour arpenter le bitume de Beale Street.
Manière de parler car Beale Street n'existe plus. C'est une spécialité de la ville. Elle a le bulldozer facile. Surtout sur tout ce qui fait du bruit. La municipalité professe le culte du terrain vague. Mieux vaut un tas de gravats qu'une maison de disques peuplée de nègres ou fréquentée par des petits blancs dévoyés. Memphis est la porte du Sud, à la fin de la guerre de Sécession, les esclaves libérés de leurs chaînes y affluèrent. Les armée d'occupation du Nord installèrent les bureaux de régulation de leur situation dans une des plus belles artères de la cité, la fameuse Beale Street... Les armées regagnèrent leurs casernes, les noirs squattèrent l'avenue.
La transformèrent en cour de miracle. Bars, boîtes de nuit, magasins de fringues, jeux, alcool, prostituées, maquereaux, lieu d'amusement, d'exutoire, de défoulement pour tous les noirs relégués dans les quartiers suburbains. Que serait la fête sans musique ? Beale Street devint la rue du blues. Une étape obligatoire pour tous les chanteurs itinérants qui remontaient du Delta vers le nord... C'est à Memphis que W. C. Handy coucha par écrit le fameux Memphis Blues, tant de fois repris depuis... C'est à Memphis que dans les années trente furent enregistrés, dans des chambres d'hôtel, toute la première génération des bluesmen du Delta, Robert Jonhson pour n'en citer qu'un... L'est des dates symboliques, la première session de Jonhson se passe en 1936, c'est en 1935 que naît Elvis Presley...
DIX ANS APRES
L'est des moments où l'Histoire met les bouchées doubles. Le rock and roll blanc n'est pas encore né, mais les noirs mettent les bouchées doubles. Suffit de pousser le bouton. Celui de la radio, nous entrons dans la zone de grande turbulence, entre 1947 et 1949, c'est sur les ondes de WDIA et de KVEM qu'apparaissent le nom de présentateurs destinés à devenir célèbres, Rufus Thomas, Sonny Boy Williamson, B. B. King... Les autorités municipales ont tout fait pour circonscrire les noirs dans les quartiers réservés, et voici maintenant que leur musique s'infiltre un peu partout dans les oreilles blanches. Les temps sont en train de changer, très lentement mais désormais les grands magasins de la ville acceptent de servir le peuple coloré...
DU CÔTE DES BLANCS
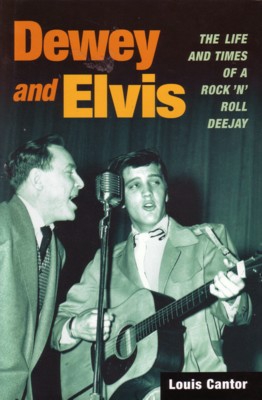
Des fissures apparaissent dans la communauté blanche. Dewey Phillips refuse d'opérer la ségrégation musicale dans son émission Red, Hot & Blue, passe indifféremment sur les ondes de la station WREC des titres de chanteurs blancs et noirs... C'est sur WREC qu'il se lie aussi d'amitié avec un nouveau venu, un certain Sam Phillips, venu d'Alabama et entiché de musique noire. Les deux hommes n'auront pas le même destin, Sam Phillips en fondant sa propre maison de disques Sun gagnera le pactole. L'Amérique respecte les riches. Dewey aura beaucoup plus de mal à survivre, remercié dès 1958 par WREC qui comme toutes les institutions culturelles populaires s'emploie à policer la bête sauvage du rock and roll, il finira dix ans plus tard rongé par l'amertume, l'alcool et les amphétamines. Une existence qui n'est pas sans rappeler celle d'Allan Freed...
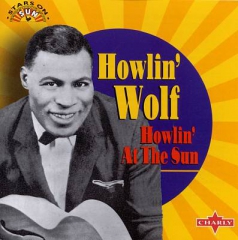
Sam commence petit, suffit de payer pour être enregistré, officie, avec son magnéto, comme les photographes qui se déplacent pour les mariages et les enterrements. L'a quand même d'autres ambitions, devient talent-scout pour Bihari et Chess. C'est lui qui découvre Howlin' Wolf. Une bonne leçon : l'est certain d'avoir déniché un génie, qu'il a dû refiler à Chess, car seule une maison spécialisée peut vendre des disques de chanteurs noirs à un public de noirs. Comprend qu'à Memphis, il n'écoulera jamais de l'or noir, lui faut trouver l'impossible, un merle blanc qui chante aussi bien qu'un noir. Ne le sait pas encore, mais l'oiseau rare niche près de chez lui.
ELVIS & Co

Nous dresse un beau portrait d'Elvis en panthère noire albinos. Un félin sauvage. Le chat des collines. Trop beau pour être vrai. Mazzoleni pose la question métaphysique interdite. Pourquoi le revend-il pour 35 000 dollars à RCA ? Peut-être parce que le fils de prolétaire Elvis est le premier à rejoindre la cage dorée du fameux faux colonel. Quoi qu'il en soit, l'extraordinaire animal n'aura plus jamais la force d'en ressortir, s'enfermera dans son malaise, dans le dégoût de soi, dans l'auto-castration de son propre rêve...

La génération rockab n'a pas tiré le numéro porte-bonheur. Que ce soient Carl Perkins, Billy Lee Riley, Charlie Feathers, Charly Rich, le scénario se répète à chaque fois. Commencent tous par enregistrer un titre énorme, qui deviendra un classique du rock and roll, mais l'histoire miraculeuse n'est pas duplicatable. La deuxième mayonnaise ne prend pas. Le public n'accroche plus. A croire qu'il n'y avait de la place que pour un sur-doué et elle est déjà squattée par Elvis. S'enfuient très vite de chez Sun. Et ne retrouvent pas ailleurs un second souffle pour leur carrière. Ont-ils jeté leur gourme ? Ou Sam Phillips fut-il un véritable sorcier ? Des idées claires, une oreille percutante, dès qu'il était derrière la console, et plus rien dès qu'il s'agissait de gérer une carrière. L'instinct fulgurant du coup qui fait le scoop, l'incapacité d'une stratégie au long cours ? Peut-être au fond de lui, Sam était-il trop entiché de musique noire pour s'intéresser aux carrière de ses petits blancs. Peut-être, en bon américain qui se respecte, l'argent n'avait-il de valeur que s'il était vite gagné. Time n'est-il pas money ? Sans doute y-a-t-il un mystère Sam Phillips.
Nous ne pouvons quitter Sun sans parler de Jerry Lee Lewis. Ses frasques amoureuses lui coûtèrent cher. Le puritanisme anglo-saxon avait perdu une bataille mais pas la guerre. Jerry Lou finit par vaincre la malédiction qui s'acharna sur l'écurie Sun. Mais ceci est une autre histoire qui se passe loin de Memphis. Pas géographiquement.
STAXMANIA
Après la crue, les eaux du fleuve Mississippi regagnent toujours leur lit. Après le déferlement écumeux du white rockabilly, le flot bleu de la musique noire redevint le courant dominant. Mais le vieux blues s'était métamorphosé. Plus rapide, s'appelait désormais rhythm and blues et se fit bientôt précéder des antiques fanfares de la New Orleans, mais avec beaucoup plus de sérieux, bye-bye la fantaisie brouillonne et l'esprit festif, désormais c'était du cuivre massif, un trip sculptural qui vous arrivait sur le coin du museau sans crier gare. Un délice absolu.
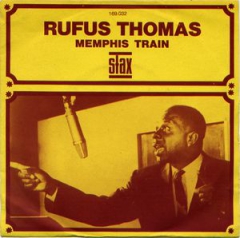
Mais rien n'était plus comme avant. Même si dès le début de l'aventure l'on retrouva chez Stax, Rufus Thomas qui était déjà présent chez Sun. Si Sam Phillips n'enregistra plus d'artistes noirs après avoir découvert Elvis, chez Stax l'on mélangea les individus. Ce fut une aventure humaine sans précédent dans l'histoire de la musique populaire américaine. Noirs et blancs sang mêlés. La couleur de la peau n'était plus une frontière, le talent seul faisait la différence. De 1962 à 1968, ce fut comme un rêve. L'assassinat de Luther King et les émeutes qui éclatèrent dans la ville réveilla les vieux antagonismes... Tout redevenait comme avant. Et même pire, Stax s'adapta aux lois modernes du marché, l'on n'enregistrait plus, l'on produisait. L'argent devint le but, la musique n'était plus qu'un moyen, le vecteur d'un enrichissement personnel... la cupidité devint l'iceberg sur lequel se brisa le Tistaxnic... Pour ceux qui veulent de plus amples détails sur le naufrage, nous renvoyons à notre chronique de Sweet Soul Music de Peter Guralnik in KR'TNT ! 207 du 30 / 10 / 2014, et à celle de Stax en Stock par Cazengler in KR'TNT ! 169 du 26 / 12 / 2013.
AMERICAN DAYS

Chips Moman est un transfuge de chez Stax. Fila un sacré coup de main à Jim Stewart pour les premiers enregistrements marquants du label. Musicien de Gene Vincent et de Johnny Burnette, il assura en quelque sorte la jonction entre la fougue du rock and roll et la transe rythmique de la soul. C'est naturellement vers lui que se tourna Elvis Presley pour l'enregistrement de son dernier chef-d'oeuvre le Fameux From Elvis In Memphis. Le King avait l'oreille, il avait remarqué le panel talentueux de musiciens dont Chips avait su s'entourer pour American, son propre studio d'enregistrement. Faut dire qu'avec un guitariste comme Reggie Young ( c'est simple l'a enregistré avec tous ceux que nous aimons de Johnny Cash à Duane Eddie en passant par Jerry Lou ) et un compositeur comme Dan Penn qui fut le grand manitou des studio Fame à Muscle Shoals, il jouait sur du velours. Si le nom de Dan Penn reste lié à l'émergence du rhythm and blues américain des années soixante, il travailla aussi pour Conway Twitty.
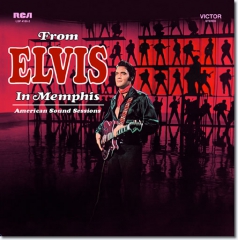
Le nom d'American Studio reste indissolublement lié à l'un des morceaux les plus courts du rock and roll, le fameux The Letter des Box Tops d'où très vite émergea la personnalité d'Alex Chilton. Qui plus tard fondera Big Star et finira par produire le deuxième album des Cramps, Songs the Lord Taught Us... Incessant entremêlement Rockabilly / Rhythm and Blues qui culmine dans le psychobilly meurtrier de Lux Interior...
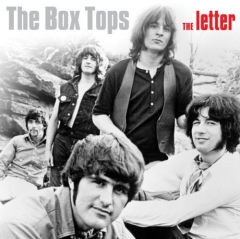
MEMPHIS
J'ai carrément sauté les petits labels sur lesquels Florent Mazzoleni s'étend quelque peu. J'ai fait aussi l'impasse sur Al Green et ses enregistrements sur Hi Records. Lisez par vous-mêmes. Pour ma part j'ai privilégié les figures mythiques du rockabilly, the sunny side of the rock and roll moon. Et ce va et vient entre la musique noire et blanche, chacune des deux allant puiser chez l'autre l'énergie qui lui permettra de se renouveler...

Mais il ne faut pas se voiler la face ( ni la A, ni la B ) : aujourd'hui et depuis trente ans Memphis n'est plus en tête de l'actualité musicale. La ville vit sur son passé. L'on a rebâti à l'identique les studios dont on avait mis bas les bâtiments. Beale Street – le peu qu'il en reste – n'est plus qu'une rue aseptisée réservée aux touristes. Passage obligatoire après la visite de Graceland où le King empâté comme un loukoum adipeux a rendu l'âme.
Memphis est un diamant chatoyant. Memphis est une ville triste.
Damie Chad.
HOT SLAPS
PLAY LEGENDS
ALL I CAN DO IS CRY / BOOGIE BOP DAME / BOPPIN' THE BLUES / BROKEN HEART / DON'T TOUCK MY GREASY HAIR / HONEY DON'T / I CAN TELL / JEANIE JEANIE JEANIE / MATCHBOX / SHAKE RATTLE AND ROCK / ROCKABILLY STAR / TWENTY FLIGHT ROCK.
MARTIN VIVIEN : chant + guitare / DIDIER SEL : contrebasse / FRANKY WANKERS : batterie.
Smaps Records
Premier CD des Hot Slap. Tapent dans le répertoire. Genre de truc piégeux à mort. Difficile de rivaliser avec les standards du genre. Mais quelque part aussi le défi à relever. Le pont de l'épée. Qui tue. Faut être fort pour s'en tirer. Les Hot Slap s'affrontent aux taureaux, ceux qui se prennent par les cornes. Par les cordes. Et ici il en pleut assez pour vous pendre. De désespoir et de jalousie. A l'intérieur de la pochette sont en photo à côté d'une DS, normal ce sont des dieux.

All I can do is cry, commencent tout doux, un frou -frou de termite qui ronge la poutre maîtresse de votre coeur. Le classique des pleurnicheurs, combien de fois l'ai-je entendu interprété ! La plupart des groupes rockab inscrivent dans leur set list ce classique de Wayne Walker qui fut marié à la fille Ernest Tubb, ce renseignement pour situer notre bonhomme qui écrivit quelques incontournables du rockabilly dans sa mouvance country originelle. Les Hot Slaps nous en donnent une version toute rurale, dépouillée de tout trémolo sentimental. Nous transportent en douceur là où ça se passe. Dès le seuil du morceau suivant Boogie bop dame, la donne change. Les mouchoirs sont enfouis dans la poche et l'on met le cap sur les choses sérieuses. Carburation tous azimut, classique teddies toujours prêts à sauter sur la première dame qui remue bien son popotin, et laissez-moi vous dire que les Hot Slaps savent mener la danse, l'on a vite fait de l'entendre. Tout de suite après sans ralentir Boppin the blues, façon de remettre les pendules à l'heure du Sun. Le classique de Perkins – certains le tiennent pour le true rockabilly boy – l'est sûr qu'il a été le premier avec ses frères à mettre le feu au vieux hillbilly du fond des campagnes. Broken heart, plouf, l'on retombe après les deux brûlots précédents dans la ballade country survitaminée au clair de lune des Moonlighters, enlevée proprement. Profitez-en c'est la dernière. Don't touch my greasy hair, certes les rockies sont de grands sentimentaux qui ne feraient pas de mal à une mouche mais il est des petits détails qui les énervent passablement. C'est un titre des WiseGuyz rockers ukrainiens qui nous refont le coup de Perkins qui détestait qu'on lui marchât sur ses pompes de daim bleu. Les Slap vous mettent les poings sur les A de la banane, n'aiment pas être dépeignés et le batteur appuie sur ses baguettes bien fort pour que vous compreniez le message. Juste un problème : le morceau décoiffe un max. Honey don't, un petit hommage au maître dont les Slap se tirent merveilleusement. Faut être rudement au point pour parfaire cet équilibre subtil entre la voix et l'instrumentation. Un petit solo de guitare à vous pourlécher les babines et la contrebasse qui descend et monte de l'échelle sans se fatiguer. On en mangerait. I can tell, une saleté de Mc Daniel alias Bo Diddley, vous avez intérêt que la guitare soit carrée, à la limite un triangle de fourrure – choisissez le grizzli griffu – les Slap ne s'aventurent pas dans la jungle, laissent la cadillac au garage, nous sommes quelques années après l'explosion de Memphis, un peu white rock avec la guitare qui appuie sec et la voix qui virevolte comme un retour de braise ardente, et de ces licks chauffés à blanc à vous faire fondre le bâtonnet ! Jeanie, Jeanie, Jeanie, vous parliez guitare, qui d'autre que le team Cochran pourrait vous emmener à apporter votre tonne de sel, n'est ce pas Didier, Vivien s'amuse, un coup à fond sur sa six cordes et un coup sur les vocales pour emporter le morceau. Matchbox, tant qu'à mettre le feu, autant amener la boîte d'allumettes idoine. Un classique de Perkins et du renouveau rockab anglais des seventies, les Slap brûlent les étapes et allument un incendie. Comme disait le président Mao, une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine du rock. L'incendie ne tarde pas à se communiquer à Shake rattle and rock, de Charle E Calhoun, immortalisé par Bill Haley, tiré au cordeau par Elvis, et qu'ici les Slap saturent de guitares sauvages. Rockabilly star, de Mystery Gang. Un truc moderne qui sonne encore plus authentique que les joyaux de 1956, mais les Slap s'amusent à froisser les guitares. Tout y est, l'uniforme au grand complet, gagnent le concours de la virtuosité. Twenty Flight Rock, l'on finit avec Eddie sur une version ébouriffante qui vous fait la courte-échelle du bonheur jusqu'au vingtième étage de l'empyrée-rock.
Achetez-le. Entrez dans la légende à votre tour.
Damie Chad.
18:08 | Lien permanent | Commentaires (0)
25/11/2015
KR'TNT ! ¤ 257 : YO LA TENGO / JALLIES / MOTÖRHEAD / DAN GIRAUD / JOHNNY HALLYDAY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 257
A ROCK LIT PRODUCTION
26 / 11 / 2015
|
YO LA TENGO JALLIES / MOTÖRHEAD DAN GIRAUD /JOHNNY HALLIDAY |
LA CIGALE – PARIS 18° - 23 / 10 / 2015
YO LA TENGO

La Leçon de Tengo

Ce qui frappe le plus dans un groupe comme Yo La Tengo, c’est la modestie des gens. Et leur intelligence. En trente ans, ce trio originaire d’Hoboken a veillé à n’enregistrer que des bons albums et à cultiver une passion pour le Velvet, les Kinks et Love. Ira Kaplan ne paye pas de mine, c’est vrai, mais il peut jouer comme le pire des garagistes et développer un fil mélodique avec autant de bravada qu’un J. Mascis à l’âge d’or de Dinosaur. Le parcours de ce groupe est remarquable. Comme les Cramps, le trio s’est construit autour d’un couple, Ira Kaplan et Georgia Hubley. James McNew semble être venu le compléter naturellement. Ce trio sent bon l’équilibre et la stabilité, deux conditions nécessaires à une bonne évolution artistique. Chez Yo La Tengo, pas de problèmes d’ego. Ira se pointe sur la scène de la Cigale en T-shirt rayé et en baskets, une ficelle en guise de bandoulière. Georgia joue debout comme Moe Tucker et elle bat le bon beurre new-yorkais. James McNew s’efface derrière sa stand-up et Dave Schramm est venu en renfort avec sa guitare et une pedal steel. Ce sont les anti-rock stars par excellence, ceux qui nous reposent les yeux du spectacle des Motley Crüe et autres marionnettes du Muppet Show californien.

Le trio vieillit admirablement bien. En fait, ils n’ont pas changé en trente ans. Ils continuent de travailler leurs ambiances intimistes et tirent des fils mélodiques à gogo, dans la tradition des balladifs enchantés du Velvet. Pur moment de magie que cette reprise de «The Ballad Of Red Buckets» joué à l’orientalisme psyché d’acou d’Ira - Here it comes again - Yo La Tengo fait partie des groupes dont ne peut guère se lasser. Autre pur moment de magie, la reprise d’«Over You» du Velvet. Ira chante ça sous l’empire d’une authentique fascination pour Lou Reed.

Eh oui, ça fait trente ans que «Ride The Tiger» est paru. Le fameux college rock américain a pris un petit coup de vieux. À l’époque, Georgia s’occupait déjà du design des pochettes. Avait-elle choisi un squelette de dinosaure à cause de J. Mascis ? On trouvait deux énormités et deux belles reprises sur ce premier tir. Ils tapaient dans le «Big Sky» des Kinks avec toute l’harmonie nécessaire, mais c’était surtout la reprise d’«A House Is Not A Motel» de Love qui faisait dresser l’oreille et le poil.

Comme Lorenzo Woodrose, Ira admirait Arthur Lee au plus haut point et il emmenait sa cover vers les hauteurs. Il passait même un solo de fuzz dément et son génie dévastateur commençait à pointer le bout du nez. Puis il y avait «The Evil That Men Do», du destroy-oh-boy à la Ira, l’un des premiers miracles du Tengo, gorgé de bourrasques et de violence. C’est là qu’Ira devenait IRA la bombe. L’autre énormité, c’est «Screaming Dead Balloons». Ira y cherchait des noises à la noise. Il disait à l’époque qu’il faisait du garage juste pour garder son bassiste, un mec qui avait joué dans DMZ. C’était balancé à la bonne palanquée de fuzz malade. Deux autres cuts flattaient l’oreille : «Alrock’s Bells», petite pop pernicieuse à base d’arpèges insistants, très florentine dans l’esprit, et avec «The River Of Water», on voyait émerger de pures rock stars underground.

«New Wave Hot Dogs» paru l’année suivante confirmait les premières impressions. Il y avait dans «House Will Fall Down» une ambiance à la Mary Chain et ça prenait la tournure d’une énormité cavalante. On avait là du pur jus de garage d’Hoboken avec son killer solo transitoire d’exaction de dégoulinade impétueuse, une fantastique avancée à travers la purée de pois de larsen fatidique. S’ensuivait un «Lewis» chanté à la Velvet et le killer solo s’étranglait tout seul. On trouvait encore deux énormités sur ce disque, «A Shy Dog», fantastique de santé compositale. Ira allait passer sa vie à composer des petits hits bénéfiques et tenir éveillées nos oreilles de lapins blancs. Et puis ils sortaient de leur manche «The Story Of Jazz», une fantastique débauche d’extravaganza new-yorkaise, l’une des pires choses qui soient arrivées au disque depuis l’invention de la machine à découdre. Ira la bombe fait ce qu’il veut du monde. Il le fait sauter à coups de power chords pleins de son. On sentait là, dans cet album, poindre un immense devenir. Mais il fallait aussi écouter attentivement «Clunk», car on y retrouvait des virées de guitares dignes de celles des Byrds de l’âge d’or. Sous des faux airs de balladif up-tempo, Ira sortait le gros son. Tout ce qu’Ira touchait se transformait déjà en or.

«President Yo La Tengo» paraît en 1989. On y trouve un beau clin d’œil à Dylan avec «Drug Test» et sa fantastique approche atmosphérique. Ira peut aussi chanter comme Dylan, avec les faux accents de «Like A Rolling Stone». «Orange Sky» est un joli coup de garage plein de rebondissements palpitants et d’influences délétères. Ira la bombe y rocke le rock ric et rac. Le son vient en direct des sixties, avec des temps de rémission et des gargouillis infâmes, des retours de manivelle et des redémarrages en côte, et puis Ira finit par s’énerver pour de bon et il se met à hurler comme une petite fiotte exacerbée. On retrouve sur cet album une version démente de «The Evil That Men Do», jouée au glou-glou impérial et dans la fusion des atomes de fuzz. Pour ceux qui recherchent le psyché du diable, c’est là que ça se passe. Ira s’y révèle l’expert du cauchemar conditionné sonique.

«Fakebook» est leur premier album de reprises. On en trouve deux déterminantes. À commencer par «Andalucia» de John Cale, cut magique tiré de «Paris 1919». Ils prennent d’ailleurs un risque énorme, car la version originale est parfaite. L’autre bel hommage est celui rendu aux Groovies avec «You Tore Me Down», même si Ira tire le son vers les Byrds. Mais il y a sur ce disques pas mal de covers dont on ne voit pas l’intérêt, comme «Emulsified» ou encore le «Speeding Motorcycle» de Daniel Johnston. Ils tapent aussi dans «Tried So Hard» des Flying Burrito Brothers et «Oklahoma USA» tiré du «Muswell Hillibillies» des Kinks. Ira fait bien son Ray, mais il est beaucoup trop humble pour jouer les dandies. Ils terminent avec un clin d’œil à l’un de leurs groupes favoris, NRBQ. Joli choix.

Avec «May I Sing With Me», on entre dans l’âge d’or de Yo La Tengo. Les trois premiers cuts de l’album relèvent du génie pur. «Detouring America With Horns» est un cut sacrément adroit et incisif. Ils partent aux harmonies vocales avec une élégance spectaculaire. S’ensuit l’un de leurs hits les plus connus, «Upside Down», une merveille d’allure sportive, élancée vers l’avenir. C’est vrai, Ira la bombe n’est pas beau, mais quelle beauté intrinsèque ! Avec «Mushroom Cloud Of Hiss», on a la preuve de l’existence d’un dieu Tengo. C’est tendu dès l’intro, monté sur un petit beat dévastateur, avec des descentes de paliers et des enfilades d’écrans bleus et verts. Ils vont vite dans les circonvolutions et Ira finit par entrer dans le cut, c’mon ! Il se met en colère - make up your mind c’mon ! - Il screame comme un démon, alors ils règne sur l’Amérique d’Hoboken des hobos de boo-boo - Oh c’mon ! On retrouve leur grande puissance mélodique dans «Some Kinda Fatigue». Ira vise l’infini des horizons, oh il n’en peut plus, il ne tient plus debout. S’ensuit un «Always Something» gorgé de pure énergie garage de coups de reins d’Hoboken. Georgia bat ça sec et Ira la bombe joue le drone des enfers.

Deuxième album de l’âge d’or avec «Painful» et ses deux pures énormités cabalistiques : «Double Dare» et «Big Day Coming». Il est bien certain que l’attaque de «Double Dare» restera dans les annales. On sent le hit dès la première mesure. Voilà qu’arrivent les power-chords de franche atonalité, accompagnés d’un petit serpent de distorse vénéneuse, et un ange du paradis nommé Ira vient poser là-dessus une voix qui renvoie aux Beatles. Et on se retrouve avec un extraordinaire cocktail béatificateur sur les bras. Quant à Big Day, c’est saturé de son à l’excès. C’est bien le son dont rêvent tous les groupes. On tombe ensuite sur «I Heard You Looking» et voilà que s’ouvre un fantastique espace mélodique qui se développe au thème récurrent, alors ça prend très vite des ampleurs universalistes, et que fait Ira ? Il se donne les coudées franches et ça grandit dans le plus pur des naturalismes mélodiques, avec des petits torticolis de notes grasses qui n’en finissent plus d’élever le débat, car c’est là et nulle part ailleurs que se joue le destin d’Ira la bombe, dans l’ultime processus d’élévation de l’homo sapiens d’Hoboken visité par la muse du génie sonique, alors Ira s’en va se perdre dans ses bourrasques pachydermiques et graciles à la fois, dans un vent lumineux comme un diamant, dans un réel absolu de fuzz paranormale et ça vire à l’émeute de riot des villes de rues de rime de rage et c’est tellement tellurique que l’ingénierie de l’outrance s’en étrangle. Avec ses violentes montées de fièvre, Ira invente un genre nouveau : la rémona de la rémoulade de Gévaudan. Un petit conseil à tous les guitaristes de garage : écoutez Ira la bombe.

Le troisième album de l’âge d’or s’appelle «Electr-O-Pura», certainement l’album le plus dense et le plus indispensable du trio. On a là le son de gens extrêmement intelligents. Ils attaquent avec la lancinance merveilleusement belle de «Decora» et un son reconnaissable entre tous, un son de rêve. «Flying Lesson» met un sacré bout de temps à démarrer, mais quand ça démarre, ça démarre. Ira joue ça comme un dératé proto-grunge. Il gratte ses sales notes purulentes qui entrent dans la mélodie comme un chien dans un jeu de quilles. Rien qu’avec ces deux titres, on se sent gavé comme une oie. Oh mais vous ne connaissez pas Ira ! Il va vous gaver jusqu’à l’overdose méningitique. En effet, «Tom Courteney» monte directement au cerveau. C’est éraillé au solo d’Ira, comme un coup de scie sur l’émail de bidet de Mrs Robinson et Ira titille sa note perlée à l’outrance d’un kid cramoisi par le désir. Ce cut est tout simplement gaulé comme un hymne, une sorte de hit panygérique taillé pour la route vers la gloire, cheveux au vent et peau hâlée, dents blanches et pap-palapalap aux lèvres. En face B, on tombe sur l’autre mamelle du génie tengo, «The Ballad Of Red Buckets», attaqué dans la torpeur de l’intimisme mélodique excessif. Alors voilà que s’ouvre un horizon crépusculaire et que s’élève une arche de cristal perlé de buée. Ira tire des notes qui redressent la tête comme des cygnes de Villiers, il chante au meilleur duveteux d’emblématique et si ce n’est pas du génie, alors qu’est-ce que c’est ? Il faut aussi l’entendre dans «Bitter End» doubler le chant d’ingénue libertine de Georgia d’un vieux solo immonde. Spectaculaire ! Pure électrocution d’électropura purgative de purgatoire. On croit que c’est fini, mais non, car le dernier morceau de l’album est la huitième merveille du monde. «Blue Line Swinger» tient à un fil, mais un fil mélodique qui se met en branle, cette bonne vieille branle inéluctable, celle qui mène droit au sonic orgasmatic. Ira la bombe joue le rock hédoniste, à la pure joie du cœur de veau. C’est véritablement effarant d’envolée préraphaélite, dans l’esprit des transparences d’un Gustave Moreau agenouillé devant l’astre du Babylone de Joséphin Péladan le pédalant et Ira rentre au chant doux sur le tard. Il crée tout simplement de la magie et la basse gronde derrière. C’est le pire décollage d’extase qui se puisse concevoir ici bas. Ira va gratter ses notes à la folie dans un chaos de court-circuits.

Le double album «Genius + Love» propose des miettes, mais quelles miettes, my friend ! Ira commence par faire le con dans «Evanescent Psychic Pez Drop» en plaçant un killer solo d’une rare virulence. Ils font aussi une reprise du «Too Late» de Wire, prolongée d’une belle envolée à la Wedding Present. Ils retapent dans John Cale avec «Hanky Panky Nohow» et c’est du gâteau, car ils montrent une belle fidélité à l’esprit original du cut. «Up To You» est un outtake d’Elect-O-Pura, un groove horizontal bien profilé sous le vent. Avec «Somebody’s Baby», Ira la bombe passe à la power pop avec une classe indécente. Il fricote une marmite d’éclat majeur - She’s alrite - Si on aime se faire péter les ornières à coups de pop, alors c’est le cut qu’il faut écouter. Il faut entendre Ira monter par dessus toute sa mélasse incendiaire. Ils font une belle reprise d’«I’m Set Free» du Velvet. Sur le disc 2, on retrouve leur vieux «From A Motel 6» monté sur un riff violent et bien tapé par Georgia la bête. Elle le tatapoume admirablement. Elle fait au mieux, comme toutes les mères de famille, mais avec ce souci des autres que n’ont pas les bonhommes. Et Ira fait ce qu’il a toujours fait dans sa vie, il mène la sarabande de l’excellence. Ils droppent aussi une belle reprise du «Blitzkrieg Bop» des Ramones.
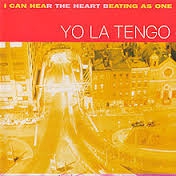
«I Can Hear The Heart Beating As One» est le dernier album (double) de l’âge d’or, car Ira la bombe va finir par s’assagir. Deux cuts énormes attirent les papillons de nuit, à commencer par «Sugarcube», un cut truffé de distorse jusqu’au trognon, mélodique en diable, expert et profilé, né pour gagner, décidé comme un hymne et doté d’un élan vers le futur. Et puis en face B, on tombe sur «Deeper Into Movies», pop de lévitation perpétuelle. On y sent une dynamique de la grandeur unilatérale et on retrouve les brutales montées de fièvres inventées par Ira la bombe, la fameuse rémona de rémoulade de Gévaudan. Il a ce sens de la folie qu’on adore par dessus tout. Ira la bombe peut allumer un brasier comme Ron Asheton ou Dave Wyndorf. Il connaît tous les secrets de la frénésie sonique, et en plus, il en use et il en abuse.

Avec la reprise de «Little Honda», ils font le mix Beach Boys/Mary Chain de rêve. Même son, même chant têtu et buté et mêmes ouvertures de chant sur le faster it’s alrite. Quelle magnifique extrapolation du mythe pop de l’Amérique des sixties ! En face 3, on tombe sur «Center Of Gravity», un petit chef-d’œuvre de good time music à la Brazil. Et sur la dernière face se tapit «We’re An Amrican Band» travaillé au beau groove d’Hoboken.

En 1998, ils passent un après-midi en compagnie du copain Jad Fair pour enregistrer «Strange But True», une collection de 22 chansons courtes dans lesquelles Jad Fair raconte des histoires complètement incongrues, comme par exemple «Retired Grocer Conducts Tiny Mount Rushmore Entirely Of Cheese». Jad y raconte que l’épicier est en retraite depuis une semaine et il s’amuse à sculpter un Mont Rushmore dans du fromage. Puis il ajoute un décors fait de haricots. Dans «X-Ray Reveals Doctor Left Wristwatch Inside Patient», Jad raconte que le chirurgien a oublié sa montre inside of me. Il est content que ce ne soit qu’une montre et non un cuckoo clock. Dans «Retired Woman Starts New Career In Monkey Fashions», Jad raconte que la retraitée fait des fringues trop petites et qu’elle deviendra riche si elle trouve un singe qui a de l’argent. Dans «Ohio Town Saved From Killer Bees By Hungry Vampire Bats», on entend les killer bees et l’horreur des vampire bats. Dans «Nevada Man Invents Piano With 21 Extra Keys», Jad raconte l’histoire du mec qui rajoute des touches au piano : 109 touches au lieu de 88. L’ensemble est surprenant.

Un nouveau coup de génie se niche sur «And Then Nothing Turned Itself Inside-Out». Il s’agit bien sûr de «Cherry Chapstick». Ira la bombe rallume la mèche. C’est terrifiant d’allure et de maîtrise, bardé de classe. Ira la bombe s’en va exploser au firmament de la magie pop avec des ti ti ti tup et un solo de trasher. Il est avec Ron Asheton le killer définitif. Il bouffe toute la magie du rock toute crue et lance ses mélodies à l’assaut de nos imaginaires. Le solo de fin est l’un des plus violents de l’histoire du rock. Encore une pièce bien énervée avec «You Can Have It All». Georgia chante par dessus les pah pah pah d’Ira qui finit par monter à l’assaut du Brill en embrayant sa distorse. Voilà encore un album magique qu’il faut écouter à tête reposée. Ils mettent aussi le cap sur le groove plus résolument, comme on peut le constater à l’écoute de «Our Way To Fall», doté d’une mélodie enchanteresse. Typical Tengo. Très beau aussi, le dernier morceau de l’album, «Night Falls On Hoboken». On l’écoute parce que c’est Tengo. Il s’y passe des choses !

On trouve pas mal de jolis grooves sur «Summer Sun». «How To Make A Baby Elephant Float» lévite à la note xylotique. Ce groove de rêve est chanté au mou de veau. Ils ressortent leur vieille science du groove ambiancier pour «Don’t Have To Be So Sad». Ira y révèle un charme irrésistible. C’est magnifique dans l’intention et joué au sableur dans la douceur du temps. On retrouve nos surdoués favoris dans «Winter A Go Go», doté du meilleur son de basse et de xylo. On se régale aussi de «Season Of The Shark», belle pièce de pop fine et charmante - Just look around - Ira sait chanter le charme discret de la pop de la bourgeoisie. Ils se tapent quand même un petit brin de délire avec «Let’s Be Still». Ira rejette dans la compote ses vieux thèmes mélodiques. Et Georgia boucle ce bel album tendre avec «Take Care» et un heavy claquage de balladif.
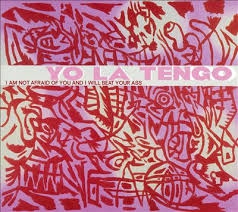
«I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass» propose au moins deux classiques intemporels. Pour commencer, une belle pièce de rock hypnotique avec «Pass The Hatchet I Think I’m Goodkind». On note le jeu de batterie incroyablement riche de Georgia. Quant à James, il joue les imperturbables. C’est un sacré seigneur des anneaux. L’air de rien, Georgia n’en finit plus de relancer la machine. L’autre gros coup se niche en fin de face 4 : «The Story Of Yo La Tengo». Pur jus de Tengo. Il leur faut du temps, alors ils se donnent du temps, mas pas n’importe quel temps, ils veulent du temps immaculé pour créer ces ambiances chargées d’ambre et d’or qui vont éblouir le monde. Et en prime, Ira joue comme un diable. Parmi les autres gros cuts de l’album, on compte «The Race Is On Again», joué au son des early Byrds et au bon beat élancé de Californie. Autre belle pièce de pop : «Sometimes I Don’t Get You» chanté à la voix éponge et pianoté comme dans un rêve de gloire.

«Popular Songs» paru en 2009 est un double album - un de plus - proposant ce qu’on appelle des chutes. Dès «Here To Fall», on est en pris dans la nasse, car voilà un cut sous-tendu d’élégance de garage d’Hoboken. Ira peut gérer n’importe quelle effraction cosmopolite. Il place aussi un solo magique dans «Avalon Of Someone Very Similar». Quand Ira se met en colère, ça donne «Nothing To Hide». Et Georgia devient la mère tape-dur. On y retrouve leur effroyable qualité d’unisson et la fiévreuse distorse qui coule sur les doigts comme une crème tiède et délicieuse. On tombe de l’autre côté sur «If It’s Time», un groove effarant de prescience, car à cheval sur le Brill et Motown. On reste dans le charme discret de la bourgeoisie d’Hoboken pour «All Your Secrets» qui buñuellise en converse d’élégance duveteuse et de touches de finesse. C’est même cousu de fil blanc par une ligne de basse à l’aise et brodé d’un shuffle à l’Anglaise. Tout est beau chez les bons Samaritains d’Hoboken. Ils restent ces excellents conducteurs d’émotivité qu’ils furent à leurs débuts. «More Stars Than There Is In Heaven» est encore un balladif de rêve intense. On en n’attend pas moins d’un doux génie comme Ira la bombe. Et sur la quatrième face, on tombe sur «And The Glitter Is Gone», un puissant thème de grain à moudre. Voilà encore l’un de ces longs cuts qui n’en finissent plus et qui se révèlent hélas propices à toutes les dérives.

Encore un coup de maître avec «Fade» paru en 2013. Un arbre géant remplit la pochette et on les voit tous les trois, minuscules insectes au pied de l’arbre. En écoutant ce disque, on trouve bizarre qu’Ira la bombe ne soit toujours pas considéré comme l’un des artistes majeurs de son temps. Pour s’en convaincre, il suffit tout simplement d’entrer dans le groove hypno d’«Ohm». Au fil des secondes, on voit la petite magie blanche de Tengo se répandre sur la terre. Ira la bombe ramène son vieux jus de distorse et le cut vire à la transe soufiste. On tournoie dans les dimensions intermédiaires. C’est un bonheur. Arthur irait même plus loin en invoquant une sorte de bouleversement de tous les sens. Voilà encore un cut absolument somptueux. On y retrouve tout le bien-fondé du rock américain. La fête se poursuit avec «Is That Enough». Ira sort sa voix de laid-back pour l’occasion et chante à la ramasse sur le plus duveteux des airs. Il a le côté magique de Lou Reed, mais avec un côté plus softah. Ça va loin, car la chose est belle à pleurer et même violonnée. Ira chante au coin de l’éclat majeur d’une voix incroyablement chaude et juste. Ce mec a du génie, qu’on se le dise. Il faut s’habituer à cette idée. Plus loin, il revient aux vieilles ambiances noisy du Tengo avec «Poddle Forward». C’est leur pré carré, leur terre d’élection : le mid-tempo battu sec par Georgia avec un Ira qui se perd dans la noise dévoyée. C’est tout simplement admirable d’ingénierie du son. Avec «Stupid Things», on se rapproche encore du cœur de Tengo qui est la beauté harmonique à l’état le plus pur. Pure merveille aussi que ce «I’ll Be Around» qu’Ira gratte à coups d’acou exacerbés. Tout l’art d’Ira ira au ciel. Attention, «The Point Of It» vaut aussi le détour. Dès l’abord du couplet, ça sonne comme un hit. Ira va tout de suite chercher l’accent vainqueur et il roule la suite dans la farine du chat perché. Quelle aventure ! Ce mec ne s’arrête jamais. Il n’en finit plus d’enchaîner les instants d’instantanéité fatale où la beauté télescope l’esprit, où la mélodie se fond dans l’ouate. Rien d’aussi dépouillé dans la manière de travailler ce fil mélodique d’argent qu’on voit briller au soir d’une vie de tourment. Et Tengo finit avec une nouveau coup de Jarnac, un «Before We Run» embarqué aux violonnades. On les sent vraiment décidés à en découdre avec la postérité. Ils mènent le même genre de combat que Killing Joke, mais avec des sons très antipodiques.

«Stuff Like That There», c’est très exactement le set de la Cigale. On y retrouve le fabuleux «Ballad Of Red Bucketts» échappé d’«Electr-O-Pura», joué au laid-back californien d’Hoboken. Ils reprennent aussi «Deeper In The Movies» échappé d’«I Can Hear The Heart Beating As One», mais sans le gros son d’antan. L’acou règne sans partage sur cet album. Si on aime bien Tengo, on se pourlèche les babines de «Rickety», un groove softy joué sous le boisseau, en douceur et en profondeur. C’est même peut-être un peu trop calme. Il tapent dans les Cure avec «Friday I’m In Love». Ils cuisinent Robert Smith à la sauce Velvet. Le hit de l’album se trouve en face B. Il s’agit bien sûr de l’excellent «Automatic Doom» chanté à l’harmonie d’unisson moelleux et duveteux. C’est une merveille d’équilibre spirituel, une beauté absolue, une huître qu’on voit briller dans l’écrin rouge d’un soir d’été. Ira chante «Awhile Away» à la pointe de l’extrême délicatesse de glotte. C’est un bonheur sangloté. Sur cet album, ils softisent tout, même Parliament avec «I Can Feel The Ice Melting».

Pour ceux qui ne veulent s’embarrasser avec ce gros tas d’albums, il existe une solution radicale : la compile «Prisoners Of Love» . Tout y est. C’est un vrai panoramique : «Sugarcube» (purée de mélasse, son de court-jus, magie filetée, le son de nos meilleurs amis), «Little Eyes» (édifiant de délicatesse), «Our Way To Fall» (merveilleusement spongieux, tellement laid-back que la voix n’ose se poser), «From A Motel 6» (guitare folle sur canapé softy, groove tellement ambivalent qu’on s’en inquiète), «Tom Courtenay» (le hit de la brigade légère, l’éclat des géants de cette terre, pur sun zoom spark beefheatien), «I Heard You Looking» (magie évanescente, sauvagerie à tous les étages), «Big Day Coming» (monté sur une saturation dégoulinante de jus de beat), «Drug Test» (Ira chante comme un héros), «Season Of The Shark» (balladif de rêve absolu, chaleureux, intime et d’une beauté suprême), «Upside Doswn» (violent et puissant, gorgé de ferveur adolescente et d’excitation), «Blue Line Swinger» (un hymne digne des grandes heures de Todd Rundgren), «The Story Of Jazz» (insondable profondeur du génie pop, merveilleuse dégelée, limpide et heavy en même temps) et «By The Time It Gets Dark» (chanté au plus doux du soft - Ira la bombe va plus loin que Nick Drake qui est malheureusement incapable de tendresse).
Signé : Cazengler, Yo la Twingo
Yo La Tengo. La Cigale. Paris XVIIIe. 23 octobre 2015
Yo La Tengo. Ride The Tiger. Coyote Records 1986
Yo La Tengo. New Wave Hot Dogs. Coyote Records 1987
Yo La Tengo. President Yo La Tengo. Coyote Records 1989
Yo La Tengo. Fakebook. Restless Records 1990
Yo La Tengo. May I Sing With Me. Alias 1992
Yo La Tengo. Painful. Matador 1993
Yo La Tengo. Electr-O-Pura. Matador 1995
Yo La Tengo. Genious + Love. Matador 1996
Yo La Tengo. I Can Hear The Heart Beating As One. Matador 1997
Yo La Tengo. Little Honda. Matador 1997
Jad Fair & Yo La Tengo. Strange But True. Matador 1998
Yo La Tengo. And Then Nothing Turned Itself Inside-Out. Matador 2000
Yo La Tengo. Summer Sun. Matador 2003
Yo La Tengo. I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass. Matador 2006
Yo La Tengo. Popular Songs. Matador 2009
Yo La Tengo. Fade. Matador 2013
Yo La Tengo. Stuff Like That There. Matador 2015
Yo La Tengo. Prisoners Of Love. Matador 2005
Sur l’illustration, de gauche à droite : Georgia, Ira la bombe et James.
21 / 11 / 15
COUILLY PONT AUX DAMES
METALLIC MACHINES
JALLIES

Malade comme un chien toute la semaine. Dois m'en remettre aux bons soins du Grand Phil pour qu'il me tire des griffes de la mort. Possède le remède miracle. Voilà pourquoi nous fonçons à toute allure, dans la nuit noire et venteuse sous les assauts d'une pluie cinglante, vers la clinique locale de Couilly-Pont-aux Dames, réparations toutes marques. Troisième fois que je me rends à Couilly et tous les lecteurs attendent une fois de plus que je me livre à quelques spirituels jeux de mots bien gras sur le nom de cette charmante localité. C'est là bien mal me connaître, ce soir ce n'est pas le pont glissant, tournant et culbutant des Dames que nous empruntons, mais c'est avec trois vraies demoiselles que nous avons rendez-vous, aussi m'abstiendrai-je de toute plaisanterie habituelle un tant soit peu grivoise. Les rockers savent se tenir. De véritables gentlemen. Si vous ne me croyez pas lisez ci-dessous la vie du légendaire leader de Motörhead.
Le GPS a dû se tromper de chemin, mais nous arrivons avec une demi-heure d'avance sur l'horaire prévu. Les trois tourterelles, perchées sur de haut tabourets, entourées de l'équipe entière des Meccanos Machinistes, à leurs petits soins, pépient autour des assiettes de chips. En guise de gouttes d'eau, elles engloutissent de longs verres baignés d'un liquide écarlate que certains poivrots du dimanche matin s'obstinent à baptiser de la belle appellation incontrôlée de sang du seigneur.
En tout cas, les Machinistes ne sont pas sexistes. Nous invitent, le Grand Phil et itou, à partager le repas qu'ils ont préparé pour accueillir dignement les trois mésanges bleues. Une exquise succulence, une énorme marmite de macaronis crémeux accompagnée d'un chaudron magique de cuisses de pigeons de toute tendresse. N'avaient pas dû manger depuis trois jours, nos grivettes, se ruent sur ses mets royaux comme des vautours affamés, puisent sans relâche à pleines louches dans la fricassée et les assiettes de pâtes défilent à toute allure... Comme disait ma grand-mère, une sainte femme, celles-là, vaut mieux les avoir en photo qu'à table.
Ensuite nous partons pour le Louvre. Nos colombes repues sont de véritables artistes. S'adonnent à la peinture. Enfin je comprends le mystère du regard de la Joconde. Futé le Léonard de Vinci, a dû apercevoir, à travers une faille de l'espace temps, nos trois bergeronnettes peinturlurer le pourtour de leurs yeux à l'Eye Liner. Na plus eu qu'à recopier après.
Nos trois cigognes nous quittent pour aller se changer à l'étage... Les deux pièces se remplissent d'un joyeux brouhaha, le monde arrive, le concert peu commencer.
CONCERT

Sont là eux aussi. Tom et Kross. Ont bien aménagé leur coup. Démarrent sans prévenir. Vous n'avez pas voulu nous voir. L'on compte pour du beurre, eh bien, vous allez nous entendre. Tous deux penchés sur leurs instruments, ne regardent personne, l'on n'aperçoit que leurs chapeaux noirs, de véritables tueurs de la mafia occupés à une triste besogne. Devant dans la volière, c'est l'affolement, plus le temps de se lisser les plumes et de faire les belles. Mais elles n'ont aucune envie de se laisser distancer. Prennent leur envol en deux battements d'ailes, un triangle parfait d'oies sauvages en partance pour la grande migration, la traversée des océans dans les embruns des tempêtes et les souffles brûlants des déserts de feu.

Pas mal, mais les gars sont devant et ne ralentissent en rien. Course poursuite. Jamais les Jallies n'ont descendu leurs sets à une vitesse aussi vertigineuse. Ça ronfle de tous bords. Tom ne joue pas de la guitare. Il pilote un hors-bord, l'on croirait entendre une Gitane Testi des années soixante, débridée cela va de soi, lancée en pleine course à deux heures du matin, avec les mégaphones interdits rajoutés, pour le seul plaisir de réveiller quarante mille habitants en dix minutes, attaque de spitfires en piqué, c'est Kross qui fait tournoyer sa contrebasse noire sur elle-même comme une hélice de moteur emballé, l'arrête d'un coup sec pour mieux lui taper sur les cordes, l'en sort des sons caverneux, puis il lui étripe les cordes à pleins doigts et on a l'impression qu'elle barrit comme un éléphant dont le cornac serait atteint d'une crise de démence.

Ne soyez pas inquiets pour nos oisillonnes. Avec la provision de vitamines qu'elles ont gobée tout à l'heure, elles ont de l'énergie à revendre. Entament la chasse à trois, se relaient dans les couplets, ne sont-elles pas le trio Jallies ? Et très vite c'est à chacune son tour de mener le train. Dans sa délicieuse jupe rose à fil mauve Leslie démarre en flèche, à la pink Thunderbird, vous descend les classiques à la kalachnirock, en force, droits d'équerre à la Esquerita, elle screame à fond these boots de Nevers pour une escrime primale. La Vaness n'est pas en reste, elle bat la charge sur la caisse claire, avec tant de violence que le pauvre tambour essaie de se défiler sur la droite, alors d'un geste rageur elle le retire violemment sur sur sa gauche comme un chariot de machine à écrire. Céline souffle dans son rumble kazoo comme si elle jouait du saxophone. S'est débarrassée de son écharpe pour mieux nous écharper. Nous vrille les oreilles et l'on en redemande. S'entraident, se soutiennent, n'en restent que deux pour les chœurs lorsque l'une chante, mais font autant de bruit que la maîtrise de Radio-France dans le Die Irae du requiem de Mozart.

Mais ce soir les boys ont décidé de montrer qui sont les hommes. Tom énervé par ses trois nanas ne se retient plus. Casse une corde de sa guitare, pas question de la changer, possède une deuxième Durandal tout près de lui, s'en saisit et pris d'une véhémence subite la porte à sa bouche et lui inflige un solo hendrixien du meilleur effet. Elle en frétille d'aise de toutes ses frettes. La salle est prise d'une frénésie orgasmatique. Vanessa relève le défi. D'abord une goulée de picrate qui gratte, une inhalation de clope ramonante, juste pour le plaisir de transformer son gosier en toile émeri, sur laquelle elle se râpe à dessein la voix. Rauque and râle, chaque note comme une balle traçante. Une torpille qui vient vous cueillir sous la ligne de flottaison avant de vous exploser le caisson. Heureusement que Céline est là, elle passe la caresse du swing sur vos écorchures, malédiction, elle vous tamponne avec du gros sel, et vous nettoie à l'acide chlorhydrique. Carpe diem, ces deux mots de l'antique sagesse épicurienne sont tatoués au bas de la nuque de Leslie. Je croyais qu'ils étaient une invitation au plaisir, mais ma traduction était une erreur, elle vous balance deux derniers rock avec une telle violence, que vous comprenez que vous n'êtes plus qu'une carpette bien aplatie sous ses pieds rageurs. Le genre de traitement qui n'a pas l'air d'intimider Kross qui aligne les soli rageurs avec une constance méritoire. Résultats du match mixte : une partie endiablée. Un petit rappel et c'est fini. Sous les acclamations. Un de leurs meilleurs concerts.
THE END
Des fous furieux. Des hystériques. Si elles continuent, sur ce rythme, va falloir retenir des places en maison de repos. Les rossignolettes sont allongées sur la scène. Sont assaillies de partout. Surtout par des filles, je remarque que les gars plus attentionnés leur laissent le temps de reprendre souffle. Pour la majorité des spectateurs, c'est la première fois qu'ils assistaient à une soirée Jallies, chacun voudrait en emporter un petit morceau chez soi. Les disques s'envolent et s'arrachent. Des stars qui paraphent sans interruption...

Plus tard je rejoins le Grand Phil dans sa voiture. Excellente médicamentation, lui dis-je. Oui, mais il ne faut pas en abuser, me répond-il. J'ai cherché, mais à l'heure où j'écris ces lignes je n'ai encore ressenti aucun effet indésirable. A part peut-être une légère sensation d'accoutumance.
Damie Chad.
31 – 10 - 2015
LAGNY – SUR – MARNE
local des loners
JALLIES
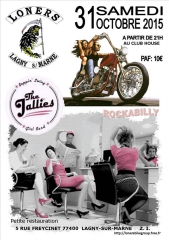
En cette soirée de Samain, nous enfourchons notre balai pour voler jusqu’à Lagny-sur-Marne, au milieu de la zone industrielle. Les ténèbres nous enveloppent. Où nous sommes-nous donc fourvoyés ? Sauvés. Au loin, un feu sert de phare dans la nuit désolée, et nous atterrissons enfin au local des Loners. Quelques têtes connues. Et les Jallies. Plus besoin de se demander pourquoi on est là.

Le temps de discuter et à 10 heures, c’est parti. Un premier set. Elles commencent piano, puis telles le feu, elles prennent de plus en plus d’ampleur. Le feu couvait. Il devient feu de broussailles, puis feu de prairie, incendie de forêt, avant que l’éruption volcanique ne jaillisse des Jallies. Les puissances chtoniennes du rock-swing-abilly se sont toutes données rendez-vous dans cette ancienne usine pour jaillir de terre. Rien ne peut résister à ce flot chantant bouillonnant. Et surtout pas le public qui écoute, charmé par ces sirènes montées sur les dragons de la musique. Brasier, raz-de-marée qu’elles entretiennent à plaisir en allant chercher les spectateurs, en les interpellant, en les piquant au vif.

Deuxième set. D’emblée mené tambour battant. C’est tout de suite l’explosion. Elles ont décidé de ne pas nous laisser respirer. Et il ne faut pas compter sur Tom et Kross pour les ramener à la raison. C’est à qui frappera le plus violemment nos oreilles. Un solo de caisse claire, un riff de guitare. Personne ne veut lâcher le morceau. Ils cherchent à se conquérir une place que nos trois belles ne leur accordent qu’avec parcimonie Plus de trente morceaux de ce combat qui vient culminer en un Jumps, giggles and shouts qui transporte le public.

Un concert qui envoie. Et pourtant. Devant nos airs incrédules, elles persistent à nous dire qu’elles n’avaient pas dormi depuis 48 heures. L’envie irrépressible nous prend alors de les retenir, de les empêcher de dormir pour qu’elles gardent cette belle énergie qui roule, torrentielle, depuis les cimes de leur chant jusqu’à la mer de nos oreilles avides, pour le bonheur d’écouter toujours ces Queens of rock’n’roll.

Philippe Guérin
( Toutes Photos Jallies : Philippe Guérin )
MOTÖRHEAD
24 HISTOIREs POUR LEMMY
THOMAS FLETTOUR / KARINE MEDRANO / JEAN-PIERRE JAFFRAIN / PIERRE MIKAÏLOFF / PATRICK FOULHOUX / JEAN-LUC MANET / DAVID BOLDIN / GIUGLIETTA / MERLE LEONCE BONE / MAX WELL / MATHIAS MOREAU / STEPHANE GRANGIER / STANISLAS PETROVSKY / OLIVIER KERAVAL
ALAIN FEYDRI / JEAN-ERIC PERRIN / FREDERIC PAULIN / PIERRE DOMENGES / STEPHANE PAJOT / HUGUES FLECHARD / DENIS ROULLEAU / STEPHANE LE CARRE / JEAN-NOËL LEVAVASSEUR / PATRICK CAZENGLER
( Camion Blanc / Octobre 2015 )
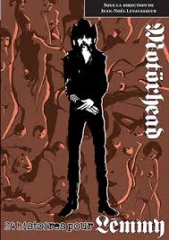
Lemmy. Pas Escudero, l'autre. Avec deux M comme Monstruoso Maximo. Le rocker dans toute sa splendeur. L'a pris l'image d'Epinal et a décidé de l'incarner. A fond. Toute la surface. Pas un centimètre carré de blancheur innocente. Que du noir, le plus sombre. Personne n'a réussi à faire mieux. A part Jerry Lou qui a fait pire. Que voulez-vous c'est la loi de dégénérescence de l'Humanité. Les fils ne dépassent jamais les pères. Le principe d'entropie de Carnot. Heidegger nous l'a explicité, n'y a rien de plus fort que l'origine pour estimer l'essence d'un phénomène. Mais ne nous éloignons pas de notre mauvais sujet. Revenons à notre mouton noir. L'animal est mal choisi, Lemmy c'est plutôt le monstre du labyrinthe, celui qu'aucun Thésée ne serait jamais parvenu à vaincre. Imaginez un antique dinosaure, un tyranosus vivant, un méchant gros lézard échappé de la préhistoire qui s'en viendrait vivre parmi nous, au cœur de nos cités, pour les détruire. Les quatre chevaliers de l'apocalypse réunis en une seule personne. Vous voulez du sang, du meurtre, de la violence, de la musique qui tue, alors écoutez un disque de Motörhead. Pour les plus courageux, risquez-vous dans un de leurs concerts. Si vous êtes du genre prudent qui tenez à vous documenter avant de tenter l'expérience, prenez ces Vingt-quatre Histoires pour Lemmy. Un diamant noir. Taillé dans le carbone.
S'agit pas de raconter sa vie. La bio, avec les dates, les lieux, les noms de comparses, la discographie au cordon vous la trouverez ailleurs. Ici l'on vous donne un aperçu. Une idée, au sens platonicien du mot. Une représentation de l'univers mental et existentiel de la Bête. Celle qui dépasse toutes les autres d'une tête. La six cent soixante septième. Celle dont la Bible n'avait même pas osé prophétiser l'existence. L'inenvisageable par mésexcellence. Le parfait rocker dans toute son horreur, dans toute sa laideur, dans toute sa bêtise crasse. Un peu comme cette boutique russe au slogan inimitable : vous ne trouverez pas plus cher ailleurs.

Pour beaucoup, en un premier temps, le rock and roll, c'est comme le teddy bear d'Elvis Presley, une grosse peluche soyeuse, douce au touché, qui dégage un agréable parfum. Vous en mangeriez. Vous en raffolez. Mais au bout de quelques mois, le super jouet duveteux s'est transformé en un horrible nanan, une loque infâme et informe, un chiffon gluant de bave et de transpiration, une harde innommable, dégoutante et puante. Un haillon répulsif. Votre entourage essaie de le passer à la machine à laver, de l'engloutir au fond de la poubelle, de l'éliminer dans la chaudière du chauffage central. Mais c'est trop tard, vous le défendez contre ceux qui voudraient vous l'arracher, vous vous y cramponnez, vous le plaquez contre votre corps, vous le cachez sous vos aisselles poilues, vous le collez contre votre sexe libidineux, vous l'aplatissez contre votre anus mordoré, vous êtes comme le bébé dépendant de sa charpie excrémentielle, la bouche collée, en liaison permanente, à son biberon bubonique infesté de cent mille microbes ( qui vous immunisent de vous-même ), bref vous êtes devenu un accro du rock and roll. Un irréductible accrock. Et comme vous vous laissez gouverner par vos plus mauvais instincts, de tous vos chouchous favoris, vous préférez le plus pourri. Pas Johnny le Rotten, qui a fini piteusement à faire le pitre dans une émission de télé-réalité, non vous choisissez guidé par cet instinct de malinois malin qui caractérise la perversion du fan de base, le pire de tous, Lemmy Kilmister. Vous mettez un poulpe vomitif dans votre moteur, un turbo Motörhead homologué kérosène destructif.
Kilmister, déjà rien que le nom, c'est grave. Deux étymologies possibles selon les philologues les plus respectables : viendrait en droite ligne de Mister Kill, un peu comme si en français vous vous appeliez Monsieur Meurtre, ou alors de Mister Kilt, le t serait tombé au seizième siècle, contraction des plus communes de la langue anglaise, ce qui expliquerait la propension de l'individu à aller farfouiller sous les jupettes des groupies qui ne portent jamais de culottes, comme vous l'explique la moindre édition du quotidien populaire Sun.

Lemmy, le lémure, ces émanations ectoplasmatiques qui sortaient des tombes romaines, qui s'en venaient jouer avant l'heure aux zombies de la New Orleans et que l'on repoussait, en tapant comme un fou, toute la nuit, sur des vases d'airain. Douceurs musicales qui sont à la base de la musique de Mortörhead et des lignes de basse de Lemmy Kilmonster avec lesquelles il pêche le cachalot au filin d'acier torsadé et rocksado. Ce Lemmy, vous en conviendrez aisément, est un cadeau que la magnanimité du Ciel a offert aux écrivains. Un sujet en or. Vous décapuchonnez votre stylo et l'encre noire coule d'elle-même. Une inspiration divine. Il y a toujours une horreur ultime à révéler au sujet de notre héros. N'y a même pas à gratter. Les pustules dégorgent toutes seules d'horreurs, du pus qui pue, du sang qui sent, du suint de groin... Se sont regroupés à vingt-quatre, qu'y pouvons-nous, si ce n'est de remarquer qu'en notre vallée de larmes le dieu du Mal a deux fois plus d'apôtres que le Christ – ce qui est une indication des plus tristes quant aux propensions morales de cette lamentable humanité inhumaine dont nous faisons partie. Montrez du doigt, à la race humanoïde entière, le soleil lumineux, le Sol Invictus d'Aurélien, et elle ne verra que le revolver avec lequel vous vous apprêtez à lui tirer dessus...
Bref vingt-quatre histoires brèves. Très noires. Bien sûr vous avez le choix, l'innocence bafouée, le meurtre prémédité, l'assassinat passionnel, ne poussez pas il y en aura pour tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants ( ces deux dernières catégories d'abord ) pas question d'oublier non plus le chat et le frigidaire. Je vous l'accorde ce sont des victimes innocentes mais attendues. Certes vous ne voudriez tout de même pas que les méchants soient punis et les gentils récompensés. Ridicules sensibleries ! De plus, totalement impossible, dans l'univers impitoyable de Lemmy, les gentils n'existent pas. Ne se risquent pas à glisser un pied dans cette horreur impitoyable. Donc disais-je du menu fretin. L'on trouve du plus costaud sur l'étal de la boucherie. Des ombres pas très nettes échappées des pyramides égyptiennes et les Grands Anciens de Lovecraft – l'aurait dû s'appeler Hatecraft – qui sortent des abîmes comme vous de votre salle de bain chaque matin. A part qu'ils n'ont aucune envie d'aller faire des courbettes et des risettes à leur patron. Vous faites la moue, vous êtes une forte tête. Vous ne croyez point aux dieux des chaos rampant et galopant. Des histoires de bonne femme. A dormir debout. Niveau Belle au Bois fainéantant au lit et Petit Chaperon Rose. Alors, avant de refermer cet océan de stupre ( sexes à éjaculations féroces ) et de mort, l'on vous a réservé le meilleur pour la fin, la vingt-quatrième horreur - de la main de notre Cat Zengler préféré et à nous – qui replace la saga lemmynienne selon des perspectives, historiales pour le siècle précédent, médiatiques pour notre époque de franche bêtise et de froide terreur. Un truc truculent. Vous riez. A en mourir. Esthétique du grotesque néronien.

Une dernière précision pour les lecteurs de bonne volonté qui se seraient égaré par mégarde sur notre blogue : la musique de Lemmy Kilmister et de son farouche Motörhead n'entretient aucune relation formelle avec les Concertos Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Excusez-nous, ce n'est que du rock and roll. Yes, but we like it.
Damie Chad
FEELING
DAN
Préface de BOBBY MICHOT
( Editions Révolution Intérieure / 2007 )
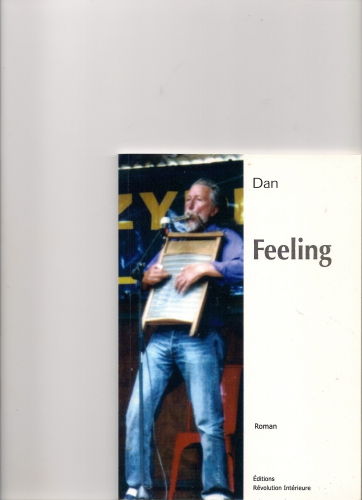
Vous êtes peut-être comme moi. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes, vous ne connaissez pas. A part King Creole et la Jambalaya de Hank Williams... J'exagère un peu, Bobby Michot est un musicien de la Nouvelle-Orléans – genre de gars aussi à l'aise sur un accordéon que sur un violon – un nom pour les amateurs de cajun et de zydéco. L'est souvent venu en Europe et en France, notamment au Festival des Baroudeurs, c'est par là en Creuse que je subodore qu'il a dû rencontrer Daniel Giraud. Vous êtes ici en terrain de connaissance, le Giraud nous a donné un texte ( in KR'TNT ! N° 3 du 05 / 11 / 2009 ) sur son premier concert à Marseille, au tout début de la carrière de Johnny Hallyday, la première fois qu'il quittait sa famille à tout juste douze ans... Mauvaise influence, depuis cette soirée fatidique Dan Giraud a écrit une quarantaine de livres et enregistré deux CD de blues...
Ne confondez pas Dan et Dan. Se ressemblent beaucoup. Le premier, Giraud, a écrit le bouquin, le deuxième a donné son prénom pour le titre. Dan Evans pour ceux qui veulent vérifier ses papiers d'identité. N'existe pas en vrai. Un clone de l'auteur qui s'imagine une vie parallèle. Un héros de roman. Vécu, spécifiera-t-il sur la page de garde. N'imaginez ni une longue introspection, ni La Recherche du temps perdu. Quarante-deux pages, pas une de plus. Mais bien remplies. Z'attention dès les premières lignes, la sonnerie est inhabituelle. Ce n'est pas écrit en français. Nous l'avons toutefois échappé belle. Daniel Giraud est aussi célèbre chez les sinologues de gros calibre pour ses superbes traductions de poëtes de l'Empire du Milie. Ne connaît pas plus le chinois que vous et moi, mais il se débrouille comme il peut. Dictionnaires et une certaine appétence préférentielle pour les philosophies orientales du rien. Restez zen, ne nous a pas fait le coup du texte en idéogrammes. C'est presque du français, c'est du cajun. Les constructions de phrase de guingois, et le vocabulaire un peu à côté de nos acceptions nationales. N'ayez crainte, l'on s'y fait assez vite.
Ce n'est pas une lubie. Mais son héros – le fameux Dan Evans – est né là-bas, c'est donc un déraciné de partout. N'est pas à la recherche de son identité non plus. Pas le genre de gars qui mettrait un drapeau tricolore sur son profil de facebook. D'abord parce que la France a retiré ses billes de la Louisiane depuis plus de deux siècles, ensuite parce qu'il a plutôt l'impression de faire partie de la grande famille internationale des oubliés, des pourchassés, des laissés pour compte. Ces prolétaires de tous pays qui n'ont pas encore réussi à s'unir contre les forces astringentes du Capital et des prisons coercitives des Etats... Mais le prêche politique, ce n'est pas son genre. Vit sa vie, en toute simplicité, washboard dans les mains pour courir de bal en bal, alcools, rires et jolies filles... Ces dernières plus rares maintenant que le cap de la cinquantaine est dépassé. La tête bien faite, aussi à l'aise dans le tourbillon frénétique de ces corps juteux et de toutes les couleurs qu'un alligator local dans le bocal du marais.
La tête bien pleine aussi, les poètes de la Beat Generation et les écrivains cajuns inconnus dans nos campagnes sont ses références. Pas celle du journaliste de France-Culture qui l'interviewe, ce qui nous vaut une scène finale hilarante... Pas un roman comique, même si la Gaya Scienzia est à l'honneur en ces pages truculentes. Sont aussi pleins de hargne, les deux Dan. Pas tant contre Kaltrina. Que peut-on faire contre un ouragan ? Sinon rien. Mais pour les hommes beaucoup. Surtout pour les pauvres. Surtout pour les noirs pauvres. L'est par exemple inutile de les tirer à coups de fusil comme des poules d'eau pendant que l'autre moitié des escadrons de police est en train de piller les magasins. Quarante deux pages mais aussi débordantes de joies et de colère que les eaux du Mississippi qui emportent les digues.
Un livre, pour tous les amateurs de blues zingué au zydéco.
Damie Chad.
JOHNNY HALLYDAY
avec PHILIPPE MANOEUVRE
LA TERRE PROMISE
( Fayard / Novembre 2015 )
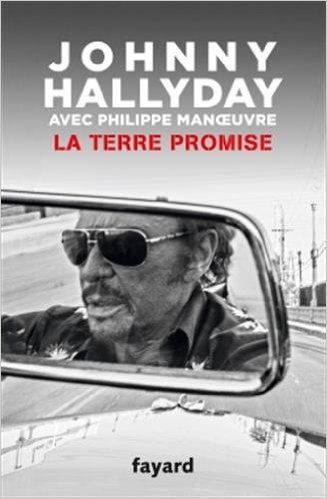
Un livre de Johnny Hallyday. Enfin presque. N'est pas un styliste reconnu de la belle prose françoise, le Johnny. En est le premier conscient. Les boss de la mafia ont leurs porte-flingues, Johnny a choisi son porte-plume. N'a pas pris un jeune fou aux images décapantes. L'a opté pour la sécurité, le rédac-chef de la grande revue rock française. Non, pas Disco-Revue. L'autre, Rock & Folk. Philippe Manoeuvre, in person, tout heureux de profiter de l'aubaine. Un voyage de quinze jours, tous frais payés, aux Amériques, qui se permettrait de refuser une telle aubaine ? L'est pas idiot Manoeuvre, sait bien que l'on achètera le livre qu'il aura écrit pour Hallyday, et point pour lui, alors il se fait tout petit, n'est plus le rédac-chef du magazine amiral de la revuistique rock nationale, se déguise sous un nom de code : sera le Scribe, le serviteur fidèle qui prenait note des désidérata du pharaon-maître.
Johnny. Possède ses milliers de fans. Qui représentent sa caution démocratique. Ce qui ne l'empêche pas d'être un des personnages les plus haïs de France. Dans les années soixante, l'était le jeune coq braillard triomphal, le chef de la bande de tous les coquelets admiratifs, et les mâles attitrés de la tribu se demandaient quel stupide plaisir prenaient les poulettes à se faire sauter par ce tendron à peine issus de l'œuf. Dans les années soixante-dix, ce fut un déluge de feu qui s'abattit sur lui. Les carrières se dessinaient, l'armée des forts en thème se fadaient le boulot quotidien, le patron qui tient les cordons de la bourse, les horaires de bureau, les petites payes, et pour les plus heureux les médiocres tirages de livres qui n'intéressaient personne. Et puis de l'autre côté il y avait Johnny qui s'acharnait à casser les voitures de luxe, qui claquait un argent fou, qui voyageait aux quatre coins du monde, qui tournait des films, qui faisaient tous les jours de sa vie ce que vous rêvez de perpétrer toutes vos nuits. Jalousie et ressentiment, les plus viles postulations de l'âme humaine, ainsi que Nietzsche l'a théorisé.
Dans les années quatre-vingt, la fausse indifférence que l'on accordait à ce jeune voyou se mua en rancœur détestable. L'était trop tard pour s'attaquer au chanteur alors on dénigra son quotient intellectuel. L'on se riait de lui, l'on se moquait de la construction de ses phrases – vraisemblablement parce que les membres de l'intelligentsia soit-disant si instruite n'avait jamais entendu parler d'anacoluthe – on l'interviewait en lui posant des questions sur des sujets qui n'étaient manifestement pas dans ses centres d'intérêt. L'état gentil Johnny, l'aurait pu leur demander à brûle-perfecto le nom du bassiste qui accompagnait Muddy Waters sur I got my mojo workin, mais non, préférait rester humble et ne pas étaler sa science.

Inébranlable comme un roc(k) ! Dans les années quatre-vingt-dix fallut se résoudre à l'accepter comme faisant partie des personnages indéboulonnables de l'imaginaire national. Au millénaire suivant, carpettes et hypocrites, peut s'essuyer les pieds sur les paillassons médiatiques. La vengeance est un plat de jubilation qui ne se partage pas.
Mais tous ceux-là ne comptent pas. Sont des quantités négligeables et méprisables. N'aiment pas le rock. Leur avis est nul et non advenu. C'est à la fin des années soixante que se produisit entre Hallyday et le public rock, un hiatus dont les effets se perpétuent de nos jours. Toute une génération nouvelle, post-soixante-huit découvre le rock se branchant directement sur le phénomène hippie et psychédélic. Oubli total de la première génération d'artistes rock. Relégation dans le dédain le plus total des pionniers, américains, anglais et encore plus français. Beaucoup périrent, Johnny s'en sortit tant bien que mal. Des hauts et des bas. Tantôt des flamboyances rock, tantôt l'accolade à la rock variétoche radiodiffusable. Le médiocre de sa production jetant le doute et l'opprobre sur le meilleur.
N'a pourtant pas renoncé à ses rêves de tout jeune rocker, Monsieur Hallyday. Maintenant qu'il court sur ses soixante-dix balais peut tout se permettre. Comme une tournée aux Etats-Unis. Treize dates sur le continent américain. Un pari audacieux. Un truc qui ne rapportera pas d'argent, sans en perdre non plus. Une aventure dont le souvenir devra être perpétuée dans les stèles de marbre de la mémoire humaine. En termes plus simples, un livre qui relatera l'ensemble de l'Odyssée. D'où la nécessaire présence de Philippe Manoeuvre et même d'un photographe officiel dont les clichés sont sensés immortaliser les moments les plus forts. Les photographies de Dimitri Coste ne sont malheureusement pas servies par la porosité du papier. Le blanc et noir se résorbe en un gris sombre tout terni, peu appétissant...
Donc Johnny en tournée. Deux poids, deux mesures. L'avion privé pour le Roi et le staff, la route et les poids-lourds pour les techniciens. Idem pour les étoiles des hôtels. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne... Maintenant c'est bien Johnny le patron, tout repose sur lui. Ne s'est pas embarqué sans biscuit. Possède un atout-maître : ses musiciens, forment un groupe, le groupe qui lui manque depuis des années. Et qui tiendra ses promesses. Le scribe s'émerveille sur l'organe de Johnny ( non, demoiselles ) vocal, trompettant, tonitruant, un baryton chargé de tendresse, de hargne, de colère, de volupté, empreint d'une intensité dramatique telle qu'il transforme le plus passable des lyrics en répartie mélodramatique shakespearienne, solitude et désespérance humaines pétries de chair et de sang, compréhensibles même pour des oreilles américaines.
Certes Johnny passe dans de petites salles d'une capacité moyenne de deux mille places, mais le public est là, une trentaine de fans venus de France, la communauté française expatriée, mais aussi beaucoup d'américains attirés par quelques articles louangeux de presse locale. Succès à chaque concert. Beaucoup de professionnels admiratifs du personnage de Johnny qui en impose par sa science innée de la scène et son punchy show, ce qui n'est pas toujours de l'avis de l'idole qui habituée aux grands plateaux des stades pense que parfois le spectacle tourne à l'amateurisme... Johnny est son critique le plus féroce. Le scribe est pourtant formel, il interroge tous les participants, se répandent en éloge, ceux qui le suivent depuis plusieurs années sont unanimes : ont beaucoup appris avec le boss même s'ils ont auparavant travaillé avec des étoiles confirmées du rock américain.

Johnny n'a pas écrit une ligne mais a beaucoup parlé. Manoeuvre rapporte ses paroles. Que vous aimiez ou non Johnny, vous reconnaîtrez qu'elles sont basées sur de longues et indéniables expériences. Valent leur pesant d'or apollinien, et de plomb saturnien aussi. Le plus étonnant c'est le jugement que Johnny porte sur sa carrière. L'est le dernier des brontosaures. N'y a que les Stones qui sont dans une situation identique. Sont les derniers rockers. D'ailleurs le rock est mort depuis longtemps. Avec Eddie Cochran et Gene Vincent, qu'il cite à plusieurs occasions. Avoue aussi son admiration pour Lonnie Donegan et Johnny Rivers...
Parle d'après lui-même, de sa situation, mais vit un peu trop dans l'empyrée mythique d'une carrière semi-centenaire, lorsqu'il demande à ce qu'on lui cite des noms d'autres rockers, Manoeuvre se tait, ne répond rien, pourtant rien qu'en France, Jake Calypso, Spunyboys et Howlin' Jaws, pour ne citer que ces trois-là, ne nous semblent pas frayer dans la chansonnette à trois sous... Sont moins célèbres que lui, mais question attitude rock and roll, pour l'instant il n'ont pas encore versé de l'eau dans leur vin...
Et puis, la tournée terminée, Hallyday file enregistrer ce qui est aujourd'hui son avant-dernier album, Rester Vivant, qui a beaucoup déçu... lui qui a sans arrêt le mot rockabilly à la bouche devrait parfois porter un regard plus aigu et une oreille plus attentive sur ses productions... L'est prisonnier de son entourage, de son mode de vie, ne donne plus des sets de rock and roll, mais de grands spectacles qui étouffent toute authenticité. La terre promise, faut savoir y arriver nu.
Sur ce, dans notre France contemporaine, j'ai davantage d'estime et de sympathie pour Johnny Hallyday que pour la plupart de nos hommes politique, médiatiques et culturels à la Bernard Henry-Lévy. L'est quand même beaucoup plus rock.
Damie Chad.
18:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yo la tengo, jallies, motörhead, dan giraud, johnny hallyday


