10/10/2018
KR'TNT ! 388 :OTIS RUSH / SEASICK STEVE / FERMETURE ADMINISTRATIVE DE LA COMEDIA / SPUNY BOYS / THE CACTUS CANDIES / ROCKAMBOLESQUES ( 3 °
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 388
A ROCKLIT PRODUCTION
11 / 10 / 2018
|
OTIS RUSH / SEASICK STEVE FERMETURE ADMINISTRATIVE DE LA COMEDIA SPUNYBOYS / CACTUS CANDIES ROCKAMBOLESQUES ( 3 ) |
TEXTE + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Le rush d’Otis Rush
Le pauvre Otis Rush vient de tirer sa révérence. Les amateurs de Chicago blues le connaissent bien. Il est l’une des figures de proue de cette école du blues inaugurée dans les années cinquante par Muddy Waters et Little Walter et qui au bout de quarante ans, a fini par tourner en rond et générer de l’ennui. Dommage, car la première vague fit autant de ravages dans les imaginaires britanniques qu’en firent les rockabs de Sun. Bo Diddley, Muddy Waters et Little Walter ont joué, dans l’histoire du rock blanc, un rôle aussi capital que ceux d’Elvis, de Johnny Cash et de Jerry Lee. Muddy Waters et Sam Phillips, même combat. Ces gens-là ont tout inventé.
Comme tous ses collègues installés à Chicago, Otis Rush vient lui aussi du Deep South. Il arrive à Chicago au début des années cinquante et comme Magic Sam, il débute sur Cobra Records. Dans une interview récemment parue, Syl Johnson nous révèle qu’il a déniaisé Magic Sam en lui montrant comment jouer les classiques de Muddy Waters. Puis comme tout le monde à Chicago, Otis va trouver Leonard le renard pour enregistrer quelques singles sur Chess. Parcours classique et terrain d’élection des industriels de la compilation.
Bref, Otis zone, jusqu’au moment où Mike Bloomfield s’intéresse à lui : c’est l’album Mourning In The Morning enregistré en 1969 à Muscle Shoals. Quel album ! Pur jus de Soul de blues ! Pochette superbe, avec un Otis prêt à bouffer le monde. Pour son premier album, il bénéfice de la présence d’une grosse équipe. Il joue pas mal de cuts de Bloomy, à commencer par «Me», l’un des hits d’Electric Flag. Roger Hawkins nous bat ça sec. Le son est au rendez-vous et Otis peut screamer son blues. Il joue bien liquide, comme Bloomy. Tiens, encore du Bloomy avec «Working Man». Otis le joue classique et incendiaire. Il module ses uuuhhh et ses ouuuhhh. Quel fucking moduleur ! Attache-toi au mât car il chante comme une sirène ! Il reste dans l’admirabilité des choses avec «You’re Killing My Love», toujours signé Bloomy et passe plus loin au heavy blues avec «Gambler’s Blues» où l’on note deux choses : l’excellence de la prestance et la pertinence de la prescience. On trouve hélas un petit moins de viande en B. Il faut en effet se contenter d’un «My Love Will Never Die» chanté à l’éplorée. Otis sait parfaitement faire pleurer sa voix et couler un bronze du blues. Il passe des grattages de guitare insistants et terriblement intrigants. Il boucle l’album avec un autre cut de Bloomy, «Can’t Wait No Longer’», histoire de bien enfoncer son petit clou. Cette union Otis Rush/Bloomy/Muscle Shoals est l’une de plus admirables de l’histoire du blues.
Screamin’ And Cryin’ paraît en 1974. Otis y va. On le sent partant dès «Looking Back». C’est un fervent gratteur de gras des bas-côtés. Il sait faire chialer sa note. On retrouve le bon gros heavy blues dans «You’re Gonna Need Me». Ce vieux crabe de zone B Sunnyland joue du piano. Otis s’arrache bien la paillasse pour chercher des effets, il hurle à la lune et fait son défroqué. C’est un spécialiste du charbon ardent. Il le fait pour de bon, il pousse des petits cris de poulet, ça baigne dans la fiente et les waoooh. Quelle rigolade ! Il prend «It’s My Own Fault» au doigt bien plat, il se prosterne devant les bénitiers, c’est un convaincu. En fait, il ne fait que taper dans des classiques, mais il n’a rien de la fulgurance d’un Buddy Guy. On sent toutefois une fantastique présence dans des reprises comme celle d’«Every Day I Have The Blues». Otis se met en quatre pour un huit de trèfle. Il prend «A Beautiful Memory» au heavy blues de la dégoulinade de morve, ça coule dans la manche, à travers les poches, c’est du gras, Il joue incroyablement gras, cet enfoiré fait couler son blues partout. Il est le roi du liquide qui tâche.
Magnifique pochette que celle de Cold Day In Hell : Otis transpire comme un diable coincé dans un sauna. Il démarre en trombe avec «Cut You A Loose», mais ça va trop vite, beaucoup trop vite. Il part ensuite dans un délire de petites notes lumineuses avec «You’re Breaking My Heart». Il dit à sa poule : tu me brises le cœur. On a beau chercher un hit sur cet album pourtant paru sur Delmark, on n’en trouve pas. Et si Otis Rush ne servait à rien ? Pour éviter toute dérive, il est conseillé de redoubler d’attention et de bien dresser l’oreille. Hélas, les choses se gâtent avec le morceau titre. Otis fait son Albert, non pas le King, l’autre, le Collins. Il joue avec les températures. Il verse des larmes de crocodile. Impossible de le prendre au sérieux.
Belle pochette que celle de Right Place Wrong Time paru en 1976. On y admire le port altier d’Otis, un port qui rappelle celui des anciens princes d’Éthiopie. Enregistré en 1971 chez Capitol, Right Place Wrong Time est en fait son deuxième album. Il ne parut qu’en 1976, après qu’il ait dû racheter les bandes. Pauvre Otis, il n’en finissait plus de zoner. Il attaque cet album sauvé des eaux avec «Tore Up», un joli coup de boogie blues à la Albert Collins. Il tisse une merveilleuse dentelle de blues dans «Right Place Wrong Time» et trousse l’«Easy Go» à la hussarde. Ce type est un génie fluide. Il ne se refuse aucune cascade d’eau claire. Il faut l’entendre dans «Three Times A Fool». Sa voix n’a rien de plus mais c’est à l’attaque de guitare qu’il va se distinguer du commun des mortels. De l’autre côté se niche «I Wonder Why», un instro de classe aristocratique. Otis y fourre ses petites digonnades de notes versatiles. C’est un expert du petit doigt qui aiguillonne. Par contre, «Your Turn To Cry» est du pur jus de slow blues joué aux giclées flamboyantes. Sacré Otis, il sait orgasmer son blues à longs jets radieux. Il dispose d’une arme fatale : le toucher de rêve. Pas mal d’Anglais du blues boom l’ont pompé, c’est évident. Avec «Take A Leak Behind», Otis va chercher le slow-blues à l’éplorée. Il sait tirer ses phrasés au-delà de toute complaisance. Il sort un son poignant. Ses notes se tortillent adorablement, il les titille avec cette volupté cabalistique qui n’appartient qu’aux anciens princes d’Éthiopie. Faramineux personnage !
Il attaque Troubles Troubles avec le fameux «Baby What You Want Me To Do» de Jimmy Reed. C’est joué bien sec, mais ça devient trop austère. Nous voilà chez Sonet, en plein âge classique du Chicago blues. Donc pas de surprise. Dans «Whole Lotta Lovin’», Otis attaque une vieille descente à la Dust My Blues et semble vouloir se réfugier dans le classicisme à tout crin. Et voilà qu’il chante «You Been An Angel» avec la voix de Stan Webb ! Incroyable ! On note l’excellence du battage de cymbales dans «You Don’t Have To Go» et on se régale du morceau titre car c’est du heavy blues circonstancié.
La pochette de Tops paru en 1988 ne met pas Otis en valeur. Il porte un chapeau et il paraît légèrement empâté. Si on veut retrouver l’Otis qu’on admire, il faut aller voir la photo qui se trouve au dos de la pochette. Il s’agit là d’un album live enregistré à San Francisco. Avec «Crosscut Saw», il met les pieds dans le territoire du gros Albert. C’est drôlement gonflé. Il joue ça au meilleur velouté de poireau. Il passe de sacrés paquets de notes et chante au doux du ton. Il sort un son de rêve sur «Feel So Bad». C’est quasiment du Bloomy. Il y lance une attaque en règle, une pure bénédiction d’électricité latente. Il y a plus de modernité dans le blues d’Otis, Horatio, qu’il n’y a de particules dans ta philosophie. Le «Gambler’s Blues» qui ouvre le bal de la B vaut largement le détour. Otis nous joue ça au mieux des conditions du blues. Ce mec est l’un des grands fluides de son temps. Son jeu enjôle et finit par captiver. Il revient au solo fin et vivace après un couplet désespéré. Il finit avec «I Wonder Why» qu’il prend à la Earl Hooker. Il ajoute de la finesse à la finesse, alors ça touche profondément les points sensibles. Otis joue titille la perfection. Il fait couiner chaque note comme une nympho.
Comme bon nombre de ses congénères, il débarque chez Alligator en 1991. Il y enregistre Lost In The Blues, un album assez moyen, même si «Hold That Train» qui ouvre le bal fait illusion. Otis revient à sa chère vieille dégoulinade. Il essaie de sonner comme le gros Albert, mais ce n’est pas gagné. On l’encourage. Vas-y Otis ! Vas-y ! - Oh you train conductor - Bruce Iglauer le voulait, Bruce Iglauer l’a eu. Mais on retrouve toujours les mêmes vieux coucous comme «Little Red Rooster» et ce «Please Love» qui sonne comme Dust My Blues. Par contre, Otis négocie son «Trouble Trouble» à la meilleure langue fourchue du blues. Il va chercher le bon timbre de chant.
Ian McLagan joue du piano sur Ain’t Enough Comin’ In paru en 1994. On écoute «Don’t Burn Down The Bridge» avec délectation, car c’est bien nappé d’orgue. Otis fait le job. C’est une reprise du gros Albert. Il reprend ensuite le «Somebody Have Mercy» de Sam Cooke. Il est dessus, avec une fantastique énergie. Rien de mieux qu’un vieux coup de Cooke. Fantastique ! Mais hélas, on passe à travers les autres cuts de l’album. Il nous ressert l’inévitable «It’s My Own Fault», et «Ain’t Enough Comin’ In» un boogie blues têtu comme une bourrique. Plus loin, il revient à son cher Sam Cooke avec «Ain’t That Good News». C’est du gospel. Otis le chauffe bien. Il boucle avec «As The Years Go Passing By», un blues de gras double. Il sort un joli son sur sa Strato blanche, mais il reste atrocement classique. Dommage qu’il manque de fantaisie.
Signé : Cazengler, Otis rêche
Otis Rush. Disparu le 29 septembre 2018
Otis Rush. Mourning In The Morning. Cotillon 1969
Otis Rush. Screamin’ And Cryin’. Black And Blue 1974
Otis Rush. Cold Day In Hell. Delmark Records 1975
Otis Rush. Right Place Wrong Time. Bullfrog Records 1976
Otis Rush. Troubles Troubles. Sonet 1978
Otis Rush. Tops. Demon Records 1988
Otis Rush. Lost In The Blues. Alligator Records 1991
Otis Rush. Ain’t Enough Comin’ In. This Way Up 1994
Otis Rush. Any Place I’m Going. House Of Blues 1998
Steve la gerbe
On a un problème avec Seasick Steve : vraie barbe ou fausse barbe ? Comme le fait Mitsuhirato dans Le Lotus Bleu, on voudrait lui tirer la barbe pour savoir si c’est une vraie. Car au fond, on se pose tous la question suivante : Seasick Steve est-il un vrai bluesman ou un coup monté par la CIA ? On se méfie de ce genre de plan ‘roots’ comme de la peste. Les magazines de rock anglais lui consacrent plus de pages qu’ils n’en ont jamais consacré à Muddy Waters. Alors, il n’existe que deux moyens d’en avoir le cœur net : écouter les disques et le voir sur scène. Oui, je dis bien LES disques, car l’animal est prolifique : 8 albums en 8 ans. Comme tout le monde, il a besoin de blé.
Il sort Dog House Music en 2006. Dès «Yellow Dog», on voit que Steve la gerbe a tout pigé. Il part en vrille dans le pire jive de blues de cabane branlante qu’on ait vu ici bas. Ça continue avec «Things Got Up». On voit bien qu’il s’implique pour de vrai. Il fait du primitif à la petite semaine. Il introduit «Fit My Wings» en marmonnant : «I’m gonna plug the thing». Il gratte son banjo et sonne comme un puriste, un tenant du primitivisme invétéré. Il va même chercher des effets auxquels personne n’avait jamais pensé, pas même John Hammond. Steve la gerbe fait son truc. En trois cuts, il semblerait que la messe soit dite. Et puis, on va commencer à voir apparaître les crevasses. Son «Dog House Boogie» sonne comme du T. Rex. Il fait du glam à barbe. L’idée est tellement saugrenue qu’on ne moufte pas. Il joue «Save Me» aux instruments anciens, et même très anciens. Il bat tous les records olympiques de primitivisme. Il s’entiche de vieilles racines. Aurait-il du génie ? On flirte avec l’idée à l’écoute d’«Hobo Me». Il gratte ses vieux accords à sec, comme s’il enfilait une chèvre. Pas de fioritures, pas d’effets à la con. Il revient au primitivisme éhonté avec «My Donny» qu’il claque à sa sauce. Il va chercher une sorte de vieille démesure de bord du fleuve. Il claque ses notes et chante dessus. Il force l’admiration car il gratte tout à l’ongle mort du zombie et s’affiche comme un féroce primitif. C’est une façon comme une autre de dire qu’il sème le doute pour mieux brouiller les pistes.
L’année suivante paraît Cheap, un album qu’il enregistre avec the Level Devils. Steve la gerbe ressort toutes ses vieilles ficelles de caleçon. Il multiplie les effets d’annonces et fait couiner son rocking chair à l’intro de «Rocking Chair». Il cherche à créer une ambiance et la plombe au stomp. Pour «Hobo Blues», il nous fait le coup de la jew harp. Mais il est affreusement convainquant. C’est bardé de tout ce qu’il faut pour rendre l’amateur de blues blanc heureux. Son «Hobo Blues» force l’admiration blanche. Puis il va commencer à raconter sa story dans «Story #1». Avec «Love Thang», il tente de se faire passer pour un vieux black de Chicago. Il propose des cuts comme «Dr Jekyll & Mr Hyde» et «8 Ball» qu’on retrouvera sur de futurs albums. Il raconte une deuxième story en reniflant bien fort, pour que tout le monde entende. La morve c’est roots. Il en fait un peu trop. Autour de lui, des fayots enregistrent tous les bruits. Avec «Xmas Prison Blues», on finit par se poser des questions. On voit bien qu’il picore dans la basse-cour comme une poule amputée du cerveau. Il va partout et ramasse des trucs ici et là. Alors le voilà en taule, sans même savoir de quoi il parle. Il fait ensuite un petit numéro à la Tom Waits avec «Love Song» et termine avec l’excellentissime «Rooster Blues», mais le conseil qu’on pourrait donner serait d’écouter Howlin’ Wolf.
Il revient un an plus tard avec I Started Out With Nothning And I Still Got Most Of It Left. Dans «Started Out With Nothing», il précise qu’il n’avait rien pour démarrer. On est tous bien contents de l’apprendre. Comme dirait Diaghilev à Cocteau : «Étonne-moi !». C’est ce que Steve la gerbe cherche à faire avec «Walkin Man». On voit bien qu’il s’intéresse plus au bord du fleuve qu’aux beaux matelots que convoitait Cocteau. Attention à «St Louis Slim». C’est superbement claqué au bord de caisse et Steve s’y glisse comme une anguille à barbe. C’est un sacré renard. Il exploite toutes les possibilités - Well Alrite ! - C’est joliment explosé à la relance de tambourin. Voilà un cut énorme de frappe qui impose un respect total. Avec «Thunderbird», il tâte de l’énormité du son. C’est même tellement énorme qu’on se pose des questions. Vraie ou fausse énormité ? Mais dès qu’il attaque son boogie des enfers, on adhère. Grinderman l’accompagne sur «Just Like A King». On sent nettement la présence des vétérans de toutes les guerres. Ils sont là pour un heavy blues terminal. Steve est malin, il amène ça comme un petit boogie blues sans avenir et puis ça se met à chauffer. Qui sème le trouble récolte la tempête, disait Shakespeare.
Sur Man From Another Time paru l’année suivante se niche une authentique énormité : «Seasick Boogie» - Now here’s the boogie part - Il sait pulser l’un des meilleurs boogies du monde. Mais on sent pointer le museau du caméléon. Il attaque en effet l’album par un hommage à Bo : «Diddley Bo». C’est bien vu et même trop bien vu - The one string diddley bo - il fait un cours ! Son truc est cousu de fil blanc comme neige. On ne sait plus trop quoi penser. En écoutant «Happy (To Have A Job)», on découvre qu’il adore le misérabilisme. On commence à se demander s’il ne prend pas les gens pour des cons. Il tape dans le registre très primitif du gospel blues avec des oooh oooh oooh Lord qui n’appartiennent qu’aux blacks. Et ça dégénère avec «Man From Another Time» : il sonne comme un groupe de Los Angeles. Quelle arnaque ! Il se retrouve avec ça dans le blues des gros propriétaires. Sur «Never Go West», il se fâche. Il ramène son meilleur guttural. Mais ça ne vaut pas Left Lane Cruiser. Il bouffe vraiment à tous les râteliers. Pauvre Steve, on l’oblige à rester sincère. «Dark» est certainement l’un de ses plus beaux coups. Il tape dans l’introspectif - I like my own company/ That way it’s easier at least for me - et il finit avec l’impressionnant I like the dark. Il finit par s’imposer avec «Wenatchee», un cut solide et doté d’une belle dynamique de blues moderne - Oh Wenatchee don’t shed no tears - Et il claque «My Home» au bottleneck. On l’y sent plein d’entrain et il redevient convainquant. Il devrait s’appeler Steve en dents de scie.
Un an plus tard paraît Songs For Elisabeth. On y retrouve «8 Ball», un vieux groove de big band sur-produit. C’est fini le temps des guitares fabriquées à la main et le coup de la vieille Buick de 1918. Il joue le Chicago blues et glisse des petits solos libidineux. Plus loin, il ressort «Dr Jekyll & Mr Hyde» et retrouve son vieux son de one-man band à gros beat déterminant. Mais c’est très prévisible. Il a un son, c’est certain, mais on revient systématiquement à la question de base : sa barbe est-elle vraie ? Avec «My Home», il semble très content d’avoir retrouvé son créneau. Il revient au festival de slide et ce cut sauve le disque. Il enchaîne avec un excellent «Ready For Love». Il joue bien de la slide, il est même très athlétique, il peut jouer longtemps, en extension, comme un joueur de volley-ball. Il sait parfaitement distinguer les nuances. Il fait tout ce qu’il peut pour sonner primitif. Il peut vraiment rootser comme un cake. Si on aime le roots, on se goinfre.
Ses albums continuent de sortir avec une belle régularité. Nous voici rendus en 2011 pour You Can’t Teach An Old Dog New Tricks. Il démarre avec «Treasures», un beau boogie blues ralenti à la Led Zep et soudoyé au banjo. Il se fond dans la population. Il coule son bronze en plein air et n’hésite pas à recourir à des coups de violons opportuns. Le morceau titre est un véritable stomp à la Left Lane Cruiser. Admirable ! Il reste dans le vieux boogie avec «Don’t Know Why She Love Me But She Do». Steve la gerbe sait draguer les bergères, pas de problème. Il passe John Lee Hooker à la moulinette et tente de se faire passer pour un violent boogie man ! C’est vrai qu’il a un son. Son boogie retentit comme un clairon. Avec «Have Mercy On The Lonely», il fait son vieux black du fleuve. Il est effrayant de mimétisme. On irait même jusqu’à croire que les blacks n’ont jamais existé. Il est un peu comme John Hammond, il veut faire mieux que les blacks, et ça, mon gars, ce n’est pas possible. Steve la gerbe pue un peu l’arnaque. Il ôte le pain de la bouche des blacks. Avec «Whisky Ballad», il passe directement au folk anglais. On le voit une fois de plus bouffer à tous les râteliers. Il pourrait nous berner indéfiniment, mais on l’a démasqué. Attention à «Back In The Doghouse» ! C’est énorme ! Quel son ! Il sait aussi allumer une pétaudière. C’est édifiant. Il peut défenestrer le blues. Trop stupéfiant pour être honnête ! Il y a trop de son. Et avec le dernier cut, «It’s A Long Long Long Way», il se prend pour Johnny Cash ! Et là, il exagère.
Au dos de la pochette d’Hubcap Music, on le voit gratter l’une de ses guitares artisanales. John Paul Jones l’accompagne sur cet album, alors forcément, on a du son. Ça commence avec «Down On The Farm» emmené au boogie sauvage. Luther Dickinson joue aussi sur cet album. «Self Sufficient Man» sonne comme un heavy boogie à la Led Zep. Vue imprenable. Steve la gerbe sait brosser le son dans le sens du poil. Il connaît toutes les ficelles du gros blues élastique, comme on peut le constater à l’écoute de «Keep On Keepin’ On». Il essaye désespérément de se forger un style original, mais c’est compliqué. Avec «Over You», Steve la gerbe la joue primitif du bord de fleuve et John Paul Jones l’accompagne à la mandoline. Ah ils ont l’air fin, tous les deux. Encore une belle pièce : «Freedom Road». C’est un boogie tribal balayé à la slide. Steve la gerbe développe un fantastique espace de boogie - He walked the freedom road - et il finit à la John Lee Hooker. C’est Luther qui joue lead sur «Home». Luther sait doser le killérique. Il a l’habitude de ce genre d’entreprise. Mais l’album se termine avec une vraie putasserie : «Coast Is Clear», un cut de rock FM orchestré aux trompettes de la renommée.
En 2015, on avait dans Classic Rock un très bel article de Nick Hasted sur Steve la gerbe, avec une très belle photo en pleine page. Même en examinant l’image au compte-fil, il était impossible de savoir si la barbe était vraie ou fausse. Pas la moindre trace d’adhésif ou d’élastique sous l’oreille. Dommage, car son histoire paraissait intéressante, pleine de rebondissements et de bonne dèche à la sauce américaine. Mais les zonards américains n’auront jamais la classe de nos clochards. Entre Steve la gerbe et le Boudu sauvé des eaux, le choix est vite fait. Au moins, la barbe de Michel Simon est une vraie barbe. On ne rigole pas avec ces choses-là. Le clochard, c’est sacré. Ce serait l’insulter que de le considérer comme un animal de cirque.
Sonic Soul Surfer paraît en 2015. On voit sa Buick de 1918 sur la pochette et au dos, on le voit sur son tracteur. Il essaye de se faire passer pour un agriculteur ! Il démarre avec un merveilleux groove de boogie blues intitulé «Roy’s Gang». Luther Dickinson joue aussi là-dessus. On a un vrai son avec du tac tac de bord de caisse. Dad Dickinson aurait bien apprécié cette escapade de Luther, d’autant qu’elle est montée au beat irrépressible. Steve la gerbe redevient un crack. Il sait dépoter le naphta. Mais il n’est hélas pas aussi incendiaire que Left Lane Cruiser. Son «Dog Gonna Play» est beaucoup trop orchestré pour être honnête. Il passe au violon cajun avec «In Peaceful Dreams». Il continue de bouffer tous les râteliers. Il adore les râteliers. C’est son vice. Ce coup de cajun pue l’arnaque. Il pompe Eddie Cochran pour son «Summertime Boy» et repart en goguette dans le boogie crépusculaire avec «Swamp Dog». Voilà pourquoi on ne peut pas lui faire confiance. Si on aime le crépusculaire, il vaut mieux écouter Mark Lanegan. C’est d’un autre niveau. Steve la gerbe refait du John Lee Hooker avec «Sonic Soul Boogie» et nous speede ça à outrance. Il est vraiment très fort à ce petit jeu, il sait rechampir une façade. Il peut aller jusqu’à l’overdose de boogie et même nous filer la gerbe. Il slide son «Barracuda» d’entrée de jeu. Il le stompe à l’os de la mortadelle. Il adore enfoncer des clous dans la paume du saveur. Son vieux stomp est cousu de fil blanc comme les neiges du Kilimandjaro. Mais les gens adorent ça.
Évidemment, si on va le voir jouer sur scène avec un gros a-priori, c’est compliqué. Mais la curiosité finit par l’emporter, et qui plus est, il attire pas mal de monde, puisqu’il remplit une grande salle. Et donc le voilà en Normandie, avec sa fausse barbe et deux copains, dont un vieux batteur lui aussi affublé d’une longue barbe blanche. Vraie ou fausse ? Allez savoir... Ils jouent tous les trois assis, ce qui semble logique, vu la moyenne d’âge. Musicalement, c’est exactement ce qu’on a sur les disques, un savant mélange de blues bien blanc joué au bottleneck, de guitares primitives taillées dans les troncs d’arbres, des vieux tatouages, des grommellements de style I swear to God, des vannes de vieux romanichel, des coups de roots bien ficelés, une technique de jeu indiscutable, et quelques belles montées de fièvre où on les voit enfin lever leurs culs de leurs chaises pour jouer le boogie-blues du Deep South. Steve la gerbe raconte à un moment qu’une voiture électrique qu’il n’a pas entendu arriver l’a percuté, sur le parking d’un super-market, et comme il s’imagine que son histoire a de l’intérêt, il en fait profiter toute la salle. Il fait le show comme il peut, mais il est vrai que certains cuts, comme par exemple «Shady Tree» ou pire encore, «Barracuda» accrochent bien l’oreille. Il termine en jouant le morceau titre de son nouvel album Can U Cook sur une guitare rudimentaire à une seule corde. Cet homme possède une botte secrète et il sait s’en servir pour harponner un public. L’un dans l’autre, on passe une excellente soirée, et au fond, on se fout de savoir si sa barbe est fausse et si son blues est vrai.
Signé : Cazengler, la gerbe tout court
Seasick Steve. Le 106. Rouen (76). 2 octobre 2018
Seasick Steve. Dog House Music. Bronzerat 2006
Seasick Steve & the Level Devils. Cheap. Bronzerat 2007
Seasick Steve. I Started Out With Nothning And I Still Got Most Of It Left. Warner Music 2008
Seasick Steve. Man From Another Time. Atlantic 2009
Seasick Steve. Songs For Elisabeth. Atlantic 2010
Seasick Steve. You Can’t Teach An Old Dog New Tricks. Play It Again Sam 2011
Seasick Steve. Hubcap Music. Fiction Records 2013
Seasick Steve. Sonic Soul Surfer. Bronzerat 2015
INQUIETANT !
J'avais prévu pour ce dimanche soir 7 octobre me rendre à la Comedia pour assister au set des Walter's Carabine.
Walter's Carabine,  dégoûté.
dégoûté.
On est triste de vous annoncer que le concert de demain, qui était prévu à la Comédia, est annulé en raison d'une fermeture administrative... Un grand merci à la Préfecture de Police qui fait fermer les petites salles ou il reste encore un peu de vie dans cette ville de macronistes à la con..
Et cette annonce qui est tombée vendredi soir sur Menil.Info :
Fermeture administrative de la Comédia (Montreuil)
La préfecture vient de signifier une fermeture administrative de 30 jours
à la Comédia, café-concert de Montreuil.
A LA COMEDIA TOUS LES PRIX SONT LIBRES
Les groupes/artistes viennent de tous les horizons (Paris, banlieue, province, mais aussi Angleterre, Espagne, Canada, Argentine, Ukraine, Russie, Japon, Mexique...). Tous sont plus ou moins confirmés ou pas.
Peu importe. Depuis 2014, la programmation a déjà une longue histoire. L’été a été endiablé par Korso Gomez (Arg.) et les Ruffianz (Can.), les punks londoniens Blatoidea et Maid of Ace (déchainées les filles !), les ukrainiens de Zrada et les locaux Breakout, Stygmate, Mercenaries venus soutenir le lieu dans sa lutte.
La Comédia tient du métissage qu’aurait engendré l’union d’une startup du néolithique et d’un astroport de la périphérie galactique. Créée et gérée par Roy, un low tech manager à la présence très impressionniste, elle vit, sonorisée dans la pénombre par un grincheux, par tous ceux qui donnent un coup de main pour faire vivre le lieu, l’entretenir ou lui refaire une belle façade, enfin grâce à un public plutôt hétéroclite (de la tribu de "nez percés" aux baroudeurs des concerts parfois mal guenillés mais plutôt bienveillants), avec ses éternelles figures, comme Néo, toujours en fugue de son hôpital, et un chien qui, irrémédiablement, passe son temps là.
La Comedia, Lieu underground ? Lieu éphémère ? Bien plus !
Pour certains un port d’attache dans le quartier, pour d’autres un corridor explosif où tous se lâchent, souvent un lieu de passage, d’échange et de convergence (de lutte ou de soirée), pour certains aussi un lieu d’échouage mais toujours en douceur.
Nous avons tous besoin, un jour ou l’autre de ce type de lieu, de création alternative mais aussi de vie alternative en soi. Une démarche qui pourrait aussi intéresser d’autres lieux menacés par les "mises aux normes", pas simplement réglementaires quand on observe la tendance, pseudo friches industrielles et lieux éphémères biens aseptisés....
La Comedia est en friche, elle le restera même aux normes, éphémère comme la vie qu’elle accueille, mais il faut qu’elle le reste !
Alors venez vivre la divine COMEDIA !
*
Fermeture administrative de la Comédia (Montreuil)
Il fallait malheureusement que cela arrive un jour, et ce n’est même plus surprenant, vu le climat actuel à Paris : La Comedia Montreuil., l’un des derniers bastions libres et joyeux de la culture alternative / punk parisienne, est obligée de fermer pendant un mois, à compter d’hier soir (même si le concert prévu hier s’est déroulé coûte que coûte), sur décision administrative, et ce jusqu’au 2 Novembre. les habitué-e-s ont pu constater que les travaux ont déjà été engagés depuis cet été pour la remise aux normes des lieux, sans attendre que les flics et la préfecture ne s’en mêlent. Mais quand il s’agit de couper les vivres à la scène punk / hardcore, aux mouvements politiques et sociaux d’opposition au pouvoir en place lorsque ils ne sont pas de droite, il n’y aura jamais assez de remise en norme possible, jamais de délai : il s’agirait de se conformer alors à la gentrification de Paris, de nos banlieues, de nos rues, l’uberisation de nos vies et de nos soirées. Il faudrait arrêter la révolte, il faudrait enfiler des chemises unies et danser sur de l’électro pop prête à consommer, et consommer des boissons alcoolisées à outrance "avec modération", pour faire semblant d’oublier le quotidien que le capitalisme nous impose. Ne serait-ce pas d’ailleurs ce capitalisme lui-même qui nous pousse à l’oubli de soi via la productivité infernale et les spiritueux ?
Au-delà de la fermeture d’un lieu de concert, qui sort des cadres conventionnels de la culture des bars, c’est également un problème humain : Le propriétaire du bar ainsi que l’ingé son qui intervient à la majorité des concerts se retrouveront sans revenus ce mois-ci.
Une cagnotte en ligne sera très vite postée pour aider la Comédia dans ses travaux qu’elle va forcément devoir continuer puis approfondir, et je l’espère pour aider financièrement les deux personnes sans revenus pour ce mois. Je ne manquerais pas de la relayer.
En attendant, soyez attentifs.ives, toujours plus, à ce qu’il se passe : alors que de plus en plus de monde organise des concerts à Paris, se bouge à son échelle pour que vive et prospère la scène punk / hardcore, ses enjeux politiques, sociaux et culturels, l’Etat et la bourgeoisie posent leur véto sur nos lieux de vies pourtant inexistants aux yeux de leurs sociétés. Mais nous sommes une société qui leur échappe, nous échappons à leurs modes de consommation, à leur vision de la culture, de la politique, de la vie. Alors ils s’y opposent avec les moyens légaux à disposition, bien entendu fortement en leur faveur.
Même si dans le cas de la Comédia, il ne s’agit pas d’une fermeture définitive, il s’agit en revanche clairement d’une menace, une de plus, sur ce lieu, et les autres bastions de résistance qu’il reste dans la capitale et autour.
Que crève leur monde, que crève le capitalisme. Que se noient dans la nuit leurs soirées nauséeuses.
*
Ne soyons plus passifs.ives face à la gentrification de nos vies, réapproprions-nous nos lieux, notre scène, nos rues. N'oubliez pas que sans lieux tels que la Comédia, réellement ancrées dans le DIY, dans une démarche politique et alternative, tenus par des personnes passionnées et motivées même quand l'Etat cherche à les écraser et les invisbiliser, il ne peut PAS y avoir ces concerts, ces rencontres et cette chaleur humaine qu'on aime tant à la Comédia.
"hardcore is politics". Mais le punk en général aussi. Nique l'apolitisme.
Prenez soin de vous.
Deux textes extraits du FB : LE DICTIONNAIRE DE L'EMOTION
*
Lien pour participation financière : 5000 euros nécessaires pour l'insonorisation de la Comedia :fr.ulule.com/divinecomedia1
O4 – 10 – 2018 / FONTAINEBLEAU
LE GLASGOW
SPUNYBOYS
J'avais prévu ce jeudi soir une croisière jaune. Pour voir les Jones. A bord d'une jonque chinoise. Amarrée à flanc de quai parisien. Mais le destin en a décidé autrement. Sous la forme de Sergio Kazh – le fer de lance de l'équipe du magazine Rockabilly Generation – les Spunyboys opèrent un débarquement surprise au Glasgow – je ne verrai pas les Jones, pas des bleus, ont opéré aux côtés des Flamin' Groovies et une carte de visite longue comme la liste de mes défauts. Lorsque vous prononcez le mot Spunyboys devant moi c'est comme les loups qui ne sauraient désobéir à l'Appel de la Forêt. De Jack London, mais le titre original The Call of the Wild correspond mieux davantage à l'esprit des prestation spunybosiques.
Comme par hasard à peine entrés dans le Glasgow, les premières personnes que nous apercevons sont la famille Kazh casée aux meilleures places – parce que le Glasgow question Ecosse c'est plutôt petits pois tassés dans une boîte de conserve, ne sont pas seuls, la charmante et détonnante Daytona Charmed les accompagne. Les Spunyboys se font attendre - se prendraient-ils pour des jolies filles – le set commence enfin à dix heures pile ( atomique ) et tapantes. Une question métaphysique taraude cependant la nombreuse assistance pendant qu'ils prennent place, mais pourquoi donc Rémi a-t-il changé de contrebasse ? Et qu'est-il arrivé à la nouvelle ? Pourquoi porte-telle ces deux longues bandes de scotch noir sur son flanc gauche ? Ce garçon si gentil serait-il en train de se transformer en big mamas' serial killer ?
THE SPUNYBOYS
I got it ! Avec ces trois mots vous prenez possession du monde. Et les Spuny ne s'en privent pas. Ça commence bien. Rémi tournoie galamment autour de son up-right. Quelle grâce, quelle légèreté, la soulève, cette autruche au long col, comme une plume de colibri et l'emporte dans un tourbillon frénétique, serions-nous à la Cour de Vienne lors du grand-bal donné par le grand-duc, hélas les rêves princiers s'achèvent parfois tragiquement, Rémi s'incline vers le micro et l'horreur du rock'n'roll déferle sur nous : Big blues eyes, long black hair / Dimpled Cheek and she's so square, vous crache les mots au batteur à oeufs, y passe même le poulailler en entier, She' got it / Ooooh baby she's got it / Ooooh baby she's got it / I can't do whitout her / , l'on n'a jamais su ce que la charmante babe tenait entre ses mains, mais les Spuny nous ont envoyé de ces saccades d'énergie à vous saccager les neurones. Eddie se joue de sa guitare, procède par giclées, de dynamites. Vous instille à chaque fois trois notes givrées au froid absolu dans la moelle épinière. Avec Guillaume, ils ont inventé un jeu pervers, jamais trop, toujours plus, le manque par surabondance, un tour de passe-passe étonnant, tout est dans la fulgurance, Guillaume vous martèle trois coups très rapides, un je vous ouvre l'occiput, deux j'écrabouille la cervelle, trois je remballe le tout, quatre je m'arrête, n'ai plus rien à faire de vous, Eddie a pris le relais, une note poignard dans le cœur, une autre dans l'épigastre, une dernière dans le sexe pour les sensations, c'est fini je passe mon tour et sur ce Guillaume vous refait son hachis parmentier, à peine a-t-il fini que Eddie vous rappelle qu'il opère sans anesthésie. Le pire c'est que ce duo se joue à trois. A quatre pourrait-on dire car Rémi a double boulot : chant / basse / chant / basse, répétez trente fois à voix haute et vous ne savez plus si c'est le chant ou la basse qui précède l'autre. Les boys à toute vitesse, ont inventé le groove rockabilly, le groovrockbilly, un vaisseau de guerre non identifié, qui se déplace avec une célérité supersonique. C'est le cas de le dire, vous en prenez plein les oreilles, d'autant plus que Rémi distribue ses interventions phoniques en deux lots, un background de base, phonèmes explosés qui fusent en folles suites éructées en émissions spasmodiques, sur lequel il surajoute à intervalles plus ou moins réguliers des appels retentissants, un cri primal qui vous glace le sang et vous brûle l'âme, communion dansante avec le public qui ondule comme des forcenés soumis à des vibrations indépendantes de leur volonté. Un rockab qui vire vers ses racines bleues et noires, pour ne pas dire tribales, nous n'en voulons pour assentiment que ces morceaux de fièvre et de hargne bâtis sur l'imparable et intraitable pulsion du jungle beat bo diddleyen. Malgré son exiguïté la salle se transforme en piste de danse, ceux qui jerkent et s'entrechoquent tout seuls et les couples qui lindy hopent à qui mieux-mieux. Corolles de sourires épanouis sur toutes faces.
Nous nous permettons d'interrompre notre compte-rendu pour répondre à l'Association Loi 1901, déclarée d'utilité publique des Amis de la Contrebasse : oui à plusieurs reprises nous avons assisté de pénibles scènes : oui Rémi se couche dessus ou dessous sa big mama en d'effroyables postures qui ne sont pas sans évoquer de honteuses copulations contre-nature, oui par trois fois il a tenté de la kidnapper et de s'enfuir avec, l'a été rattrapé de justesse alors qu'il était en train de franchir le seuil, oui il la soulève et la brûle en la maintenant contre les spots brûlants, oui il ne lui laisse jamais le temps de respirer, oui il la tape, oui il la frappe, oui il la knockoute, oui, oui, oui, nous cochons toutes les cases. Mais ce n'est pas tout. Ont commis un crime irréparable. A l'instigation d'un individu venu d'ailleurs, répondant au nom d'Olivier, qui les a entraînés, tous les trois, à jouer du Led Zeppelin, et chose immonde ils y ont pris du plaisir, ni plus ni moins qu'un morceau phare du Dirigeable, le fameux Rock'n'roll qu'ils ont éjaculé durant au moins dix minutes ( question de faire durer la jouissance ) vous auriez vu la guitare d'Eddie couiner comme si on la sciait en deux, et Guillaume lançant ses baguettes en une course-poursuite avec le mur du son, l'Olivier piaillant de toutes ses forces comme s'il était en train de s'étrangler lui-même et la pauvre big mama obligée de soutenir ce rythme insoutenable, l'on se demande encore comment elle y est parvenue, faudra l'inscrire au livre des records et envoyer son maître cruel en prison s'il s'avisait à recommencer un jour.
Pratiquement trois heures de concerts, un unique et très court entracte, une folie, une tuerie, une majorité de filles, une ambiance d'armageddon, les Spunies sont en train de réinventer le rockabilly, poussent les murs, et abomination suprême, en perpétuent et en accroissent l'esprit.
Damie Chad.
DADDY WORKS SO HARD
THE CACTUS CANDIES
Z'ont soigné la présentation, si vous détestez le hillbilly achetez-le pour la pochette, d'un pimpant vert cactus, une brassée de foin frais, de foin freight, ressemble à ses 45 tours à gatefold de carton épais, rescapés des lointaines enfances in the end of the fifties, avec dessin rigolo pour attirer les garnements, ici pas princesse, mais un fermier bricolo qui ne sait plus où donner de la tête et des bras.
Julien Fournier : lead guitar / Max Kermacoret : drums / Lil'lOu Hornecker : vocal & rhythm guitar / Max Genouel : upright bass / JP Cardot : piano
Records Freight 001 / BLR Studio : april 2016.
CD à l'intérieur sur la page gauche :
That chick's too young to fry : de Tommy Edwards en 1940, repris par Louis Jordan en 1946 : interprétation très datée, vous la jouent à l'ancienne, entre animateurs télés américains et bande-son de dessin animé. Ça cartoone par devant et mine de rien, ça pulse par derrière. Z'ont dû s'amuser comme des petits fous à l'enregistrer. Daddy works so hard : de Lil'lOu, tout de suite c'est plus sérieux, la guitare rebondit comme une balle de ping-pong, et miss Hornecker s'y entend un max pour vanter les mérites de son papa, plus que convaincante. Ecoutez aussi le solo de guitare vaut son pesant de clous rouillés, plantés de travers, mais c'est eux qui tiennent le mur. Crawfish crawl : de Link Davis qui joua sur Chantilly Lace de Big Bopper : les boys sont gentils laissent Lil'lOu se reposer, on la regrette reléguée dans les chœurs, mais les gars se la pètent grave, font ça si bien qu'on aurait tendance à les croire sur parole, le poisson vous a un goût de bonne farce louisianaise, un truc à se pourlécher les babines, ne pas rater sous aucun prétexte. I wanna be free : franchement rock, une orchestration qui hache ( d'abordage ) menu, Lilhou tire le train à toute blinde, Cardot va y laisser un cardan s'il continue à foncer comme un madurle sur son piano, chacun nous parachute une petite démonstration de ce qu'il sait faire, et ma foi ils le font très bien. Let the teardrops fall : de Pasty Cline : faut du culot pour s'attaquer à ce genre de faisanderie, les gars derrière clopinent doucement et Lil'lOu vous mène le rodéo comme une pro. Elle a de ces inflexions de voix à vous faire fondre et de ces arrachés à vous perdre la tête. Plantation boogie : de Lenny Dee ( 1955 ) : pas question de se planter sur le boogie, surtout quand vous avez une rythmique jazzeuse qui imite Bill Haley, vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous êtes, mais vos n'avez aucune envie de sortir de ce foutoir. Et Cardot qui jerry Leese dès que vous avez le dos tourné ! Dark moon : Elvis et Chris Isaac l'ont reprise mais l'original est de Nathan Ned Miller et date de 1961. Lil'lOu vous sort sa plus belle voix de velours et en même temps ses griffes – acérées - les gars derrière ne mouftent pas, se font tout petits, z'avez l'impression que la musique a la tremblotte. Un truc qui vous donne envie de rêver à la fausse douceur du monde. Food plan boogie : de Dave Mc Enery qui fut un cowboy chantant des western musicaux : vous dites cowboys et les gars rappliquent, z'ont laissé leur cowgirl préféré à la maison, et ils font les malins, Cardot vous pond un petit rag de derrière les fagots. Z'ont la bouche en cœur, le reste je ne sais pas. The donkey song : enregistré par Rose Maddox – une des chanteuses préférées de Lil'lOu – et ses frères : attention on change de registre, il y a ceux qui jouent au cowboys et celle qui vous file un western entier rien que dans sa voix, parfois elle sonne comme des coups de feu, pointillés musicaux, pour que vous preniez conscience que vous êtes touché. Don't trade : de Noack Eddie, ( 1954 ), les plus grands country men comme Lefty Frizzel et Johnny Cash ont repris ses morceaux : ça honky tonke et ça honky tangue comme jamais, piano nostalgique, voix mélancolique et rythmique langoureuse, que voudriez-vous de plus ? Turn the cards slowly : la deuxième chanson que Pasty Cline enregistra pour Coral : Lil'lOu reprend la main, encore plus en forme que la fois précédente, l'on se demande si l'on est dans un saloon ou dans un clandé, mais l'est sûr que l'on ne s'ennuie pas. Little boy sad : de Walker Wayne mais interprétée par Johnny Burnette en 1961 : les boys vous azimutent la berceuse et Lil'lOu se charge de remonter le moral à ce garçon triste, lui secoue un peu les puces d'une façon comminatoire de temps en temps, que voulez-vous dans les grandes occasions, on ne mégote pas sur l'énergie. Run along little girl : de Tommy Cassel ( 1958 ) qui fut un habitué du Louisiana Hayrade : d'ailleurs on flirte avec le country traditionnel, le gars qu'a tout connu ( et tout perdu ) qui vous fait la leçon de la vie à la petite fille. La guitare poinçonne des bulles d'air. Closing time : Onie Weeler fut harmoniciste et chanteur, Bear Family a sorti un double CD, avis aux amateurs, il a enregistré chez Sun entre 1953 et 1957 : on n'a pas d'harmonica, c'est dommage, alors les gars y vont de tous leur chœur, Max Genouel, chante comme un vieux baroudeur du country, la guitare sautille en douceur, Cardot nous expose les années trente et Genouel vous conduit jusqu'au bout de la piste, sans problème.
45 R. P. M : à extraire de sa pochette :
Daddy works so hard : reprise à l'identique.
Humdinger : de Tommy Collins, lui a eu droit un coffret de cinq CD chez Bear Family, enregistra le classique Watcha Gonna do en 1954 : plus vrai que nature, nasillent tous comme s'ils étaient coincé du nez, parfois Lil'lOu s'échappe et boppe un peu pour notre plus grand plaisir.
Un seul regret : n'avoir pas été là caché sous la console, ont dû s'amuser comme des fous à recréer l'old style. Comme au bon vieux temps ! Le pire c'est que ça nous rajeunit !
Damie Chad.
ROCKAMBOLESQUES
FEUILLETON HEBDOMADAIRE
( … le lecteur y découvrira les héros des précédentes Chroniques Vulveuses
prêts à tout afin d'assurer la survie du rock'n'roll
en butte à de sombres menaces... )
EPISODE 3 : VISITES NOCTUNES
( Vivace Vivace )
PIZZA PARTIE
La porte s'est ouverte très lentement, l'on sentait que le visiteur tenait à faire durer le suspense et mettre nos nerfs à dure épreuve. Et brusquement l'inconnu apparut en pleine lumière.
-
Ah ! Ah ! Vous ne vous attendiez pas à me voir ! Surprise ! Oui c'est moi ! L'avait un sale sourire sardonique aux lèvres l'homonculus.
-
Monsieur le Président de la République, déclara avec onction le Chef, vous nous ferez bien l'honneur de prendre place à notre table et de partager notre modeste repas. N'ayez crainte Monsieur le Président de la République, nous vous offrirons la part de Molossa.
Je crus que le Président allait avoir un infarctus, s'est arrêté net, l'est devenu tout rouge comme un camion de pompier, puis tout blanc comme un cadavre. Je jurerais qu'il vacilla, donna l'impression d'un homme attaqué par un cancer foudroyant, mais il se reprit et vint se planter devant le Chef qui exhala un rond de fumée qui monta vers le plafond pour redescendre aussitôt et se glisser autour de son cou à la manière d'une fraise sur les portraits d'Henri II.
-
Moi, vingt-cinquième président de la République, venais ici en ami, et en catimini de mon service de sécurité personnel, dans le but de vous interdire de vous occuper du meurtre de Marie-Odile de Saint-Mirs, cette affaire ne regarde pas le Service Secret du Rock'n'roll, mais devant votre insolence je vous avertis que de retour à mon bureau, je signe le décret de dissolution du dit service. Entendu ?
-
Reçu cinq sur cinq Monsieur Le Président de la République, toutefois je suis au regret de vous avertir que par ce courrier apporté hier matin par un fonctionnaire plénipotentiaire de l'Union Européenne, la responsabilité du SSR est passée sous la coupe du Conseil de l'Europe. Nous ne dépendons plus de vous, voici la copie du décret, Monsieur le Président de la République, je ne doute pas que vos services en aient reçu un exemplaire similaire. Toutefois Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand plaisir que nous partagerons notre repas avec vous.
-
Ne jouez pas au plus malin avec moi ! Je vous aurai prévenu. Désintéressez-vous de cette affaire. Quant à vos pizzas, vous pouvez vous les foutre au cul !
Il y eut cri d'horreur à vous glacer le sang. Le Chef faillit en avaler son Coronado. Molossa s'en mordit la queue. Moi aussi. ( Je veux dire que moi aussi je mordis la queue de Molossa ). Cruchette offusquée bondit comme une tigresse à qui vous arrachez ses petits de la mamelle. Splah ! Splash ! Le Président reçut une pizza brûlante sur chaque oreille ! L'était pas beau avec la sauce tomate et les tranches de chorizo collées sur ses joues.
-
Des pizzas dans mon cul, et du bio par-dessus le marché ! mais c'est une honte Monsieur le Président de la République ou pas, ne répétez plus jamais de telles insanités, Papa ne m'a pas élevée pour entendre proférer des gros mots, sortez tout de suite Monsieur le Président, vous êtes un monstre ! Vous devriez avoir honte !
-
Je vous prie de m'excuser Mademoiselle, je crains en effet de m'être emporté, au revoir. Je vous présente mes respects.
Et à notre grande surprise le Président sortit sans demander son reste. Le Chef ralluma un Coronado.
-
Nous voici débarrassés d'un invité peu aimable, je vous remercie de votre intervention Cruchette, vous êtes une véritable fée du logis. En attendant que vous confectionniez deux nouvelles pizzas – quelle odeur succulente – il me faut donner quelques détails à l'agent Chad sur la prochaine mission, extrêmement délicate, dont je vais le charger.
MISSION NOCTURNE
Délicate ! À marcher sur des œufs ! Casser une vitre pour m'introduire dans la maison des parents de Marie-Odile n'était pas difficile. Mais une fois dedans, c'est une autre affaire. La lumière de ma lampe électrise que je tamise de mes doigts dirigée vers le plancher n'éclaire que fugitivement Molossa qui avance sur ses pattes de velours encore plus discrètement qu'un vol de papillon. Le rez-de-chaussée était désert, pas étonnant à trois heures du matin. Pourvu que les marches du l'escalier ne craquent pas, chance elles sont recouvertes d'un épaisse moquette. Quatre portes sur le pallier. Pas le droit de me tromper, Molossa se plante devant l'une et me regarde. Puis-je lui faire confiance ? Elle a du flair et a longuement humé le siège de Marie-Odile dans la teuf-teuf, j'entrebaille délicatement la porte, les volets ne sont pas fermés, la lumière blafarde de la lune m'indique que la pièce est vide. J'entre, Molossa est restée sur le pallier tapie dans l'ombre, prête à m'avertir et le cas échéant à intervenir. Je farfouille méthodiquement, une penderie emplie de vêtements de filles, un nounours sur le lit, un portrait de Picasso sur le mur, l'encyclopédie en vingt sept volumes de l'Art Conceptuel dans la bibliothèque. Pas de doute, c'est bien la chambre de Marie-Odile, j'explore le tiroir du bureau, un bric-à-brac infâme : crayons, stylos, compas, double-décimètre, ciseaux, scotch, trombones, punaises, rien ! Si une feuille dans la corbeille à papier, pliée en deux, je n'ai même pas le temps de l'examiner, je l'enfourne dans ma poche, quelqu'un monte les escaliers, pourquoi Molossa ne m'a-t-elle pas prévenue, des voix se précisent et tout à coup, j'entends distinctement :
-
Oh, Marie-Sophie tu as vu un chien !
-
Mais non Marie-Ange ce n'est pas un chien, c'est Molossa !
-
Qu'est-ce quelle est jolie, regarde comme elle aime les caresses !
Je n'en crois pas mes oreilles. Tant pis je risque le tout pour le tout et je sors sur le pallier. Maintenant je n'en crois pas mes yeux, Molossa fait la fête à deux ravissantes fillettes trop occupées pour se rendre compte de ma présence. Sophie lève la tête et m'aperçoit :
-
Regarde Marie-Ange, il y a un monsieur !
-
Mais non, ce n'est pas un monsieur, c'est Damie !
-
Ah oui, suis-je bête je ne l'avais pas reconnu.
-
Euh ! Excusez-moi, demoiselles, vous savez qui je suis ?
-
Bien sûr, vous êtes le fiancé de Crocodile !
-
Le fiancé de Marie-Odile votre grande soeur !
-
Ne faites pas semblant, on a la preuve dans notre chambre, venez on va vous montrer ! Dépêchez-vous, plus vite !
-
Chut vous risquez de réveiller vos parents !
-
Mais non depuis que Crocodile est montée au ciel, ils prennent plein de cachets le soir pour dormir. Nous on en profite pour s'amuser pendant la nuit, parce que le jour, ce n'est pas rigolo, ils passent leur temps à pleurer. Entrez Damie, asseyez-vous sur le lit on vous apporte l'album. C'est un secret, Crocodile ne voulait pas que Papa et Maman le sachent, elle le cachait tout au fond de notre coffre à jouets.
Et hop elles me tendent un gros album de photos. J'ai failli pousser un cri en voyant la page de titre : A DAMIE MON AMOUR. Mais mon étonnement n'est pas fini. Des photographies de moi et de Molossa, sur toutes les pages. A vue de nez au moins deux cents. M'a fallu plus de trois heures pour tout examiner. Moi, de face, de dos, de profil, de trois-quart, marchant dans la rue, au volant de la teuf-teuf, sur la terrasse de chez Popol, de temps en temps des petits cartons ''Damie t'es beau'', ''Damie t'es chou'', ''Damie je t'aime'', ou alors ''Molossa la plus belle chienne du monde du plus beau garçon du monde'', ma modestie légendaire m'oblige à ne pas tout recopier. Je remarque toutefois qu'elles ont été prises au télé-objectif. Un réveil sonne dans la chambre voisine :
-
Il vous faut partir Damie, Papa et Maman, ne tarderont pas à se lever, Crocodile nous a fait jurer de ne jamais leur dire son secret, s'ils vous voient, ils ne seront pas contents.
-
Je m'échappe les mignonnettes !
-
Oui mais n'oublie pas de revenir nous voir !
RETOUR DE MISSION
Le Chef m'écoute. Cruchette admet que c'est une belle histoire romantique, qu'heureusement que Marie-Odile soit morte avant de m'avoir vu dans mon costume framboise, très beau, mais qui m'enlaidissait, que certainement alors elle ne m'aurait plus aimé... pendant qu'elle pérore le Chef médite les yeux mi-clos, la fumée de son Coronado forme d'étranges arabesques dans l'espace :
-
Agent Chad, vous n'avez rien ramené d'autre que cette abracadabrante histoire à l'eau de rose !
-
Non Chef, rien de rien !
-
Et cette feuille de papier que vous teniez dans votre main lorsque vous avez entendu les deux fillettes ?
-
Je l'ai fourrée dans ma poche, la voici, blanche des deux côtés.
-
Oui Damie, blanche comme ces linceuls dont on enveloppe les morts ! Cruchette, pourriez-vous me repasser, sans la roussir, ce précieux document que cet énergumène d'agent Chad a froissé dans sa poche comme un malappris. Une jeune fille lui tend un message depuis la tombe et il ne prend même pas la peine de le lire !
Cruchette se mit immédiatement au travail, nous dûmes convenir qu'elle maniait le fer à repasser avec une dextérité sans égale. Au bout de deux heures elle nous tendit le résultat de son travail, la feuille semblait sortir tout droit de sa ramette. Nous l'examinâmes longuement, nous l'éclairâmes violemment, nous la mîmes contre une vitre exposée au grand soleil, nous la caressâmes du bout des doigts afin de déceler une moindre déclivité qu'aurait pu laisser la mine d'un crayon quelconque, de guerre lasse je l'emmenais à un laboratoire de spectographie quantique, le résultat de l'analyse se révéla décevant : aucune inscription d'aucune sorte n'avait jamais été apposée sur cette feuille. La mort dans l'âme je revins au QG, et tendis au Chef le compte-rendu détaillé des opérations effectuées sur la feuille. Le Chef le lut et le relut au moins quarante fois. Au bout de vingt minutes un sourire se dessina sur ses lèvres. Je compris qu'il n'allait pas tarder à allumer un Coronado, ce qu'il fit sans se presser.
-
Agent Chad, vous avez aperçu cette feuille de papier dans la corbeille à papier de Marie-Odile, et vous vous en êtes emparé.
-
Affirmatif Chef !
-
Agent Chad filez immédiatement au domicile des parents de Marie-Odile. Abattez sans sommation toute personne qui s'opposerait à votre intrusion. Et ramenez-la moi tout de suite !
-
Oui chef, j'y cours, mais quoi au juste ?
-
La poubelle, triple idiot.
Lorsque je suis arrivé devant la maison. Les volets étaient tous fermés. J'ai sonné en vain. Un voisin est sorti : '' Un gros camion de déménagement est arrivé ce matin, ils ont tout vidé, ils n'ont rien laissé, je peux le certifier j'ai aidé le père à fermer les fenêtres. L'a fait monter sa femme et ses deux fillettes dans la voiture, et ils sont partis. Je comprends qu'ils aient voulu changer d'air après la mort de leur aînée !''
( A suivre )
14/03/2018
KR'TNT 365 : DENISE LASALLE / THOUSAND WATT BURN / OSCIL / SPUNYBOYS / KING BISCUIT TIME
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 365
A ROCKLIT PRODUCTION
15 / 03 / 2018
|
DENISE LASALLE THOUSAND WATT BURN / OSCIL SPUNYBOYS / KING BISCUIT TIME |
TEXTE + PHOTOS SUR :
http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Oh Denise doo be do I’m in love with you
Plutôt que de chanter les louanges de Denis, Deborah Harry aurait dû chanter celles de Denise. Deborah devait forcément connaître Denise LaSalle, cette Soul Sister aussi puissante qu’Aretha. Oui, c’est exactement la même : génie vocal, histoire de vie, longévité, capacités compositales, elles ont énormément de points communs. Si vous allez chercher les infos dans votre wiki préféré, vous verrez qu’elle est née dans le Deep South comme Aretha et que sa famille a émigré vers le Nord, comme celle d’Aretha. Detroit pour Ree, et Chicago pour Den. Et pouf, Chess, mais Denise, comme Fontella Bass, refuse de se faire plumer par Leonard. Elle préfère enregistrer sur Westbound, un petit label de Detroit plus discret mais moins rapace. Non seulement Denise a du génie, mais elle a aussi du caractère, et ça la rend infiniment sympathique. Et les vingt-cinq albums qui illustrent sa carrière n’en finissent plus de renforcer cette impression.
Denise LaSalle vient de casser sa pipe. On ne le verra pas en couverture des magazines pour m’as-tu-vus, car elle n’est pas très connue en Europe. Et comme l’élégance ne fait plus recette, elle n’avait de toute façon aucune chance de plaire. L’occasion est par conséquent trop belle de remédier à ce fâcheux constat en rendant un hommage panoramique à cette femme qui fut, comme le disent si bien les Anglo-saxons, larger than life.
Longévité veut aussi dire discographie à rallonges. Comme tous les grands artistes noirs de sa génération, Denise LaSalle est passée d’un label à l’autre, au fil des modes : première époque raw r’n’b sur Westbound, puis avec l’âge d’or de la diskö, elle passe chez ABC et MCA, avant de revenir en 1983 dans le giron du Saint des Saints, c’est-à-dire Malaco, pour y enregistrer une dizaine d’albums absolument somptueux. Attention, ces époques sont toutes les trois affreusement consistantes. Un mauvais disque chez Denise ? Ha ha ha ha, comme disent ceux qui se croient malins en riant bêtement, mais c’est tout simplement inimaginable.
Si on tape dans la période Westbound, autant taper dans le dur. Il s’appelle A Good Thing Better. The Complete Westbound Singles 1970-1976 et comme son nom l’indique c’est sorti sur Westbound, via Ace Records. C’est à la fois de la dynamite et l’une des meilleures compiles de Soul de tous les temps, richement documentée par Tony Bounce, Ace-man de choc. Ce disk de ding-a-dong propose 24 cuts, c’est-à-dire les 12 singles qu’enregistra Denise avant son premier album. Ça fourmille littéralement de coups de génie, tiens, par exemple ce slowah atmosphérique intitulé «What Am I Doing Wrong». C’est joué et orchestré à outrance, on a là une merveille absolutiste. Ou encore «Good Goody Getter», extraordinaire shuffle de petit popotin, tu danses au coin du juke, elle prend sa petite voix Motown et fait sa coquine avec du getter de rêve, c’mon ! À ce stade des opérations, on peut se demander pourquoi Aretha et pas Denise ? La réponse est évidente : Aretha avait Wexler, c’est aussi simple que ça. Westbound ne pouvait pas rivaliser avec Atlantic. Et pourtant, Denise défonce la rondelle des annales avec «Hung Up Strung Up», c’est aussi hot que du Stax, on a là un classique pur embarqué au pire drive de bassmatic qui se puisse imaginer ici bas. Encore un slab de heavy r’n’b avec «Keep It Coming», une véritable bénédiction de juke, bassmatic devant toutes, solo de trompette. Elle enfile les hits comme des perles, «Now Run And Tell That» sonne comme une révélation, elle saupoudre ses petits hey mr playboy d’oh yeah bien sentis. Nouveau monster hit avec «Man Sized Job», embarqué au rumble de shuffle no more. Hit de juke admirablement cadencé, aussi puissant que du early Ike & Tina. On reste dans l’effarance de la latence avec «What It Takes To Get A Good Woman», même aplomb et même assise qu’Aretha, même popotin de tous les diables, elle a vraiment largement de quoi rendre un homme heureux. Elle tape dans les Detroit Emerald avec «Do Me Right». On nage en plein rêve. Cette compile de singles tue les mouches. Une fois encore, c’est pulsé à l’énergie black et les cuivres jouent le thème, alors Denise y va franco de port et elle couine ses syllabes. Tout est très spectaculaire, ici, on se croirait à la Piste aux Étoiles. Avec «Get Up Off My Mind», on entre dans la période Muscle Shoals. David Hood claque le groove de bassmatic, c’est atrocement bon et Roger Hawkins bat le beat tribal africain. Encore un hit hallucinant de classe, bardé de renvois de chœurs à la Aretha, c’est la fête au village. Avec «The Best Thing I Ever Had», elle passe au slowah d’émancipation, elle règne sur la terre comme au ciel. Elle passe au r’n’b moderne avec «My Brand On You» et rameute tout le génie de Muscle Shoals pour «Any Time Is The Right Time», hanté par des chœurs géniaux. Avec «Here I Am Again», elle passe à la diskö, mais pas n’importe laquelle, celle de Barry White. Il fallait bien qu’elle bouffe. Bien sûr, les gens lui ont craché dessus, mais Denise est une reine. Elle chante comme si elle éclairait le monde. Elle shoote toute l’énergie de la Soul dans la diskö, comme le fit Aretha à la même époque. Elle chante à la vie à la mort. C’est sa force. À la fin de cette compile somptueuse, on entend des pubs radio : «The body & Soul of the Miss LaSalle ! The exciting sound of the Miss LaSalle !»
Ado, Denise veut écrire des romans. Pas facile. Alors elle se met à écrire des chansons. Elle trouve le nom de LaSalle dans un magazine et pouf, c’est parti mon kiki. Elle travaille dans un bar de Chicago et rencontre Billy The Kid Emerson. Impressionné par sa voix, Emerson la branche sur Chess. Chess la trouve bonne, oui, mais pas encore assez bonne.
Denise comprend qu’elle doit redescendre dans le Sud pour s’épanouir artistiquement. Elle ne choisit pas n’importe qui : Papa Willie. Ouvrez la pochette de son premier album Trapped By A Thing Called Love et vous tomberez sur un texte magnifique signé Denise : «J’ai écrit beaucoup de chansons dans ma vie, mais les paroles n’ont aucun intérêt si la musique n’est pas bonne. Je suis arrivée à Memphis avec quelques paroles et des lignes mélodiques, mais ce génie nommé Willie Mitchell (Papa Willie I call him) a donné vie à mes paroles. Willie a tous ses arrangements en tête, il n’écrit rien, et la façon dont il communique avec ses musiciens est fantastique. Ils l’aiment et le respectent. Ils essaient de jouer le mieux possible - everyone tries hard to get the music down just right - Je dois tout mon succès à Papa Willie qui l’a rendu possible.» Et elle finit en dédiant cet album à Papa Willie et à Gene Bow-legs Miller. Sur l’album, on retrouve un paquet de singles, évidemment, ces énormités que sont «Now Run And Tell That», «Good Goody Getter» et «Do Me Right», purs shoots de jerk de gros popotin, Denise swingue le booty comme Ree, elle chante sous le boisseau de Papa Willie, c’est puissant des reins et parsemé de cris de folle, avec un son admirable d’entrain et de subtilité cuivrée. On retrouve aussi l’immense «Heartbreaker Of The Year» et «Hung Up Strung Out». Elle fait aussi une cover du «If You Should Loose Me» de Barbara Lynn. Force est d’admirer sa classe, elle claque sa Soul aux gémonies, c’est nappé d’orgue et digne de Fame. Elle termine cet album passionnant avec une compo de Carole King, «It’s Too Late». Ça sonne comme un hit, ce qui semble logique.
C’est le DJ Al Perkins qui l’a mise en contact avec Armen Boladian, boss de Westbound Records, l’un des grands labels de Detroit sur lequel on retrouve les Ohio Players, les Detroit Emeralds et Funkadelic.
Elle embraye sur On The Loose. Un fantastique portrait d’elle cadré serré orne la pochette. Ses yeux noisette se plantent dans les vôtres et deux petites rides encadrent une bouche rieuse. Une autre photo d’elle orne le verso de la pochette, mais en pied. Denise a de l’embonpoint, comme Ree à la même époque, mais à part Laura Lee et Madeline Bell, a-t-on déjà vu une Soul Sister maigre comme un clou ? Non, évidemment. Cet album tient lui aussi par la force des singles qu’on y retrouve, à commencer par «A Man Size Job», énorme groove popotin. Denise ne rigole pas avec le popotin, c’est son truc. Elle sait manier le beat. Elle passe au funk avec «What It Takes To Get A Good Woman» et nous plonge dans l’heavy Memphis Sound, c’est digne de Stax et claqué aux riffs de fonk. Avec «Harper Valley PTA», un hit de Jeannie C. Riley signé Tom T. Hall, Denise passe à la country pop de Soul, et elle manie ça en experte, elle tient bien la distance, un peu à la manière de Dylan. Franchement, elle excelle dans tous les genres, comme on le voit avec «What Am I Doing Wrong», grosse compo d’elle qui sonne comme du pathos anglais et qu’elle reprend en retour de manivelle wha-wah. Elle injecte un gros shoot de gospel batch dans «Breaking Up Somebody’s Home». Elle chouchoute sa Soul à outrance et n’en finit plus de rivaliser de grandeur pulmonaire avec Ree. On trouve d’autres merveilles en B, notamment ce «Your Man And Your Best Friend» qui groove joliment sous le boisseau et «I’m Over You», sublime slowah sevré de gospel choir experience, qu’elle prend aux accents de féminité chaleureuse. Elle finit avec un nouvel archétype du heavy groove de Memphis Sound, «I’m Satisfied». Les gens d’Hi savent sortir un son : accents funky, guitares subtiles, oui, Mabon Hodges joue comme un dieu.
Dernier album sur Westbound : Here I Am Again. Belle photo de pochette. Celle qui orne la pochette de la compile Westbound pré-citée provient de la même session : Denise est tout simplement radieuse, superbement coiffée. Elle porte une robe rouge très décolletée et croise les bras, comme si elle se sentait nue. Le morceau titre sonne un peu diskö de charme, mais Denise règne sur la terre comme au ciel. Elle fait tout simplement de la Southern Diskö, comme en font de leur côté Millie Jackson et Candi Staton. Et puis elle revient à sa chère démesure avec «Share Your Man With Me», monté sur un beat bien épais, et joué comme dans un rêve. C’est du Aretha, mais estampillé Deep South. Denise chante ça à la retenue, et God, c’est épouvantablement bon ! Elle reste dans la Soul de r’n’b à la Aretha avec «I Wanna Do What’s On Your Mind». Elle tartine sa Soul avec un persévérance qui en dit long sur sa soif de vivre. En B, elle explose tout avec «My Brand On You», elle chante ça à la Denise Westbound, et croyez-moi, ça ne court pas les rues. C’est un hit de juke à l’état le plus pur. Et elle entame sa carrière de rappeuse avec l’excellent «Anytime Is The Right Time» - Some folks say/ The night time is the night time - Mais Denise affirme que c’est tout le temps le right time. Le right time de quoi ? Mais de baiser, bien sûr. Au cas où on ne l’aurait pas encore compris Denise est du cul, c’est-à-dire dans la vie. Elle soutient sa thèse avec une puissance hallucinante. Les mecs qui lui tombaient dans les bras avaient intérêt à assurer. Elle finit avec l’excellent jump d’«Hit And Run». Elle finit souvent ses albums en beauté. Ahhh Denise...
On entre avec Second Breath dans la période ABC/MCA. Il ne faut surtout pas cracher dessus, car même marqués par l’époque, ces albums tiennent sacrément bien la route. Aretha et d’autres grandes Soul Sisters sont aussi passées par là, et elles ont réussi l’exploit de rester dignes, grâce à leur génie vocal. Le ton des pochettes change aussi, Denise devient une sorte une reine de la nuit, plantureuse et sexy, mais jamais vulgaire. Elle chante essentiellement le cul et la drague, c’est-à-dire la vraie vie. Elle compose quasiment tout ce qu’elle chante et n’en finit plus d’accumuler des hits. Tiens, par exemple, «Freedom To Express Yourself» : elle y rappe son diskö beat. En tant que grande dame, elle peut se permettre toutes les fantaisies. Shake your booty, alors oui, mais avec elle. Elle enchaîne avec un hit de r’n’b intitulé «Get Your Lie Straight». C’est admirable de puissance charnue. Elle chante ça à pleine voix et ne supporte pas les mensonges. Elle revient toujours à son fantastique appétit de r’n’b, comme si elle voulait se montrer invaincue sur ce terrain. Dans «Sweet Soul», elle le prévient, get ready, caus’ I’m comin’ through you. Et voilà qu’elle repart sur un groove violonneux à la Marvin Gaye, «I’m Back To Collect» ferait bander un mort, elle shoote des harmoniques de What’s Goin’ On dans sa diskö de charme. C’est une fois encore admirable de tenue, joué et chanté au maximum de toutes les possibilités du genre. Elle démarre sa B en force avec «I Get What I Want», un extraordinaire shoot de r’n’b heureux de vivre, élégant et libre, un r’n’b qui circule dans les rues d’une ville lumière à l’âge d’or de la vie. Avec le morceau titre, elle prévient son mec qu’elle a trouvé le second souffle - I’ve got a brand new style/ Oooh I’m brand new baby - Elle est fantastique. Dans «Hell Fire Loving», elle affirme qu’elle peut réveiller un mort et pomper un jeune garçon a sec. Elle est tellement investie dans son art qu’on la croit sur parole. La voilà épuisée dans «Sit Down And Hurt Awhile». Elle n’a plus de forces - Let me sit down/ I just don’t believe I can make it baby - Elle souffre trop. C’est vrai, on devient dingue quand on souffre trop. Et elle termine cet album effarant avec une country-song de Soul fabuleusement inspirée, «Two Empty Arms».
La voilà au bord de sa piscine pour The Bitch Is Bad. Cet album vaut le détour, ne serait-ce que pour les quatre vénérables énormités qui s’y prélassent. Tiens, on commence avec «Fool Me Good», un groove à la Marvin - Aw sugar/ Just fool me good - Elle règne sans partage sur l’empire du groove de pool. Et en B, elle enchaîne trois super-monsters : «Move Your Body», «A Love Magician» et «One Life To Live». Avec le premier, elle tape dans le meilleur diskö-funk de l’époque. Elle fait de chacun de ses albums un véritable événement, c’est bourré de son et de classe black. Quel cut de fonk, rien ne peut la freiner ! Love Magician est du big ball sound à la Aretha - Aah he works magic/ Magic with my body - Et le troisième vaut pour un slowah séculaire, elle s’y élève comme Aratha, à la seul force de sa glotte d’acier. Et puis elle revient au pur sexe dégoulinant avec «Love Me Right». Elle y prend son pied, mmmmm.
Under The Influence paraît sous une pochette de satin mauve. Cette fois, elle enregistre chez Ardent, à Memphis. Elle démarre l’A en trombe avec «Party», gros shoot de diskö-funk. Denise gère ça bien, elle pousse des cris de relance et derrière, les Hot Buttered Soul font des chœurs de rêve - Hey ! - Elle n’en finit plus de relancer, elle épuiserait un régiment de hussards. Quelle énergie ! Avec «Let’s Stay This Way», elle passe au slowah de séduction suprême. Elle propose à son mec de ne rien changer, c’est vrai elle a raison, quand tout va bien, il ne faut toucher à rien. Elle chante comme une femme comblée. Ce n’est pas une vue de l’esprit, ça s’entend. Elle démarre sa B avec «Workin’ Overtime», un groove universaliste balayé par un puissant souffle d’Americana. Elle y aménage de sacrés paysages - You ain’t got nothing left - Son mec travaille tard le soir, il ne bande plus et elle trouva ça bizarre - The same old shit - Peut-on faire confiance à un mec ? Jamais.
La pochette d’Unwrapped présente les défauts de l’époque. Les graphistes manquaient alors d’imagination. On voit une main arracher une peau de zèbre rose et Denise apparaît souriant dans l’ouverture. Le «Think About It» d’ouverture de bal d’A donne le ton : diskö-funk, mais bien rebondi. On y entend d’ailleurs le drive de basse de «Miss You». Il n’y a pas de petits profits dans l’art du pompage. Elle sauve l’A avec l’excellent «Too Little In Common To Be Lovers», un slowah océanique. Elle gère ça aussi bien qu’Aretha, à coups de goodbye baby bien sentis. Elle tape en B une reprise de «Do Ya Think I’m Sexy» sur laquelle on passera, pour cause de mauvais souvenirs et elle termine avec un medley superbe de trois slow-grooves languides. Aw, Denise, que deviendrait-on sans toi ?
La voilà en reine de Broadway sur la pochette d’I’m So Hot. L’album vaut le détour pour une raison principale : le gospel batch de «May The Funk Be With You». En fait, elle fait du gospel batch diskoïdal, aussi puissant que celui de Candi Staton. On trouve aussi deux hits diskö sur l’album, «Try My Love» et «Tear For Fear». Denise se situe au cœur de son époque, et le pire, c’est qu’elle est bonne. En pure cerbère, elle grogne en rythme sur le diskö beat. «Tear For Fear» sonne comme un hit alerte et vivifiant. Impossible de calmer Denise, elle saute sur dance-floor et bouge son cul comme Aretha dans son restaurant. On trouve aussi en B un slowah d’une rare sensualité intitulé «Sometime». C’est incroyablement bien chanté. Elle vire à l’universalisme des I de baby, comme toutes les grandes Soul Sisters de sa génération.
Fin de l’époque MCA avec Guaranteed. Denise n’est pas à son avantage sur la pochette. Comme Aretha, elle est tombée dans les pattes d’une coiffeur qui ne l’a pas arrangée. On trouve un peu de diskö en A, mais comme chante avec une classe renversante, alors on danse avec elle. C’est la moindre des choses. C’est en B que se joue le destin de l’album, et ce dès «Got Myself A Handyman», tapé au bon vieux heavy groove. La voilà de retour sur son vieux terrain de prédilection. Denise adore le beat lorsqu’il est heavy, c’est-à-dire bien gros. Elle enchaîne avec une invitation lubrique, «Make Love To Me One More Time», à laquelle il est difficile de résister. Pas besoin de faire un dessin. On a là un groove bien balancé des reins, admirablement orchestré et soutenu par des chœurs de rêve. C’est d’autant plus torride qu’elle soupire d’aise - Darlinnng... - Voilà encore un cut d’une rare sensualité. Et elle passe sans prévenir au diskö-funk des enfers avec «ERA (Equal Rights Amendment)». Elle fait tout simplement du heavy Funkadelic. Attention, ce n’est pas fini : voilà «I’ll Get You Some Help», une merveille incroyablement dansante, elle y fait un festival, c’est l’un des r’n’b les plus dansants de l’histoire. Elle dégage tellement d’énergie qu’on pourrait qualifier sa Soul d’éruptive, elle s’y montre joyeuse, c’est infernalement bon, dansé jusqu’à l’os du beat, et c’est rien, comparé aux faits réels.
Comme d’autres géants de la Soul, Denise rejoint Malaco en 1983. Bobby Blue Bland, ZZ Hill, Latimore et Johnnie Taylor font partie de ces géants. Malaco incarne un autre âge d’or de la Soul du Deep South, à la suite de Fame, de Stax et d’Hi.
Son premier shoot de Malaco s’appelle A Lady In The Street. Sur la pochette, Denise téléphone. Avec le morceau titre, on entre de plein fouet dans le big Malaco Sound System, soft groove élégant bien équilibré et richement orchestré. On s’en pourlèche les babines. Denise chante comme une vraie pro. Et puis avec «Don’t Mess With My Man», elle avertit la poufiasse qui louche sur son mec - I got news for you babe/ You better check this out - Denise ne plaisante pas avec ce truc-là - I tell you mama/ I can make you all understand - En B, elle tape un «Down Home Blues» au heavy blues de Malaco, coco. Il y met tout son poids, c’est idéal et grandiose. Et avec «Come To Bed», elle propose une invitation au voyage. C’est admirable de deniserie, mais avec de la classe, du satin noir et un parfum discret. Pour attirer le mâle, elle fait sa Marvin.
Elle retrouve sa parure de Diskö Queen pour la pochette de Right Place Right Time. Elle duette avec Latimore sur le morceau titre. Ils se situent dans la veine des duos mythiques de Motown, pas de doute. Avec «He’s Not Avaliable», elle passe au heavy funk des enfers. Admirable fonkah boot de Malaco. Quel son ! Et les filles derrières font : «He’s on the telephone !» Denise n’a pas de pot, elle tombe toujours sur des mecs qui lui bourrent le mou. En B, elle revient au heavy blues avec «Your Husband Is Cheating On Us». Encore une histoire de cul qui tourne mal. Denise s’intéresse beaucoup à la psychologie des hommes - He’s lying/ He’s a cheater - Elle n’est pas tendre avec l’husband - He’s not a good man - Et puis avec «Keep Your Pants On», elle tape dans Sam Dees, mais sur un beat à la Proud Mary très typé Tina. C’est excellent, on a là un joli shoot de rock de Soul cuivré et bardé de chœurs du Deep South, les meilleurs du monde. Elle prend ensuite le heavy groove de «Bump And Grind» au timbre fêlé, avec une diction à la Millie Jackson. Ah, on peut dire qu’elle chauffe sa petite affaire avec un art consommé.
Joli portait de Denise pour la pochette de Love Talkin’. La ressemblance avec l’Aretha d’une certaine époque est frappante. C’est probablement l’un de ses meilleurs albums, avec une B littéralement explosive : elle l’attaque avec le morceau titre, une sorte de groove de rêve éperdu, puissant et lascif, liquide et gorgé de suc - For life honey/ You and me - Elle passe plus loin au heavy stomp de Soul avec «Too Many Lovers», signé George Jackson. Elle nous drive ça à la poigne de fer. Que deviendrait-on sans elle ? Aretha et elle sont nos mères nourricières, ne l’oublions pas. Denise se fond littéralement dans le génie sonique de Malaco. Elle boucle avec «My Tu-Tu», un hit cajun comme pas deux, admirable d’exotisme louisianais et monté sur un beat salvateur. Oh, il faut aussi écouter le «Talkin’ In Your Sleep» qui ouvre le bal de l’A, car c’est un chef-d’œuvre de heavy funk diskoïdal, avec Jimmy Johnson dans les parages. Rien qu’avec cette supercherie, Denise sauve l’honneur des années quatre-vingt. Elle nous propose tout simplement le beat de fer dans un gant de velours, un son dont on n’ose même pas rêver. Elle passe ensuite au heavy Mississippi blues avec «Someone Else Is Steppin’ In», incroyable slab de steppin’ out. Elle reconnaît qu’elle était folle - I was a fool - Il fallait voir de quelle façon il la traitait. Sur cet album, hormis la voix de Denise, il n’y a que du son. Rien que du son.
Pochette plus graphique pour Rain & Fire qui, une fois encore, se présente comme un album classique digne des grandes discothèques. Rien de tel qu’un Southern boogie emmené à tire-d’aile comme «I’m Sho’ Gonna Mess With Yo Man» pour se mettre en appétit. David Hood embarque ça sur un drive de bassmatic élastique et ça vire au festival Muscle Shoals. Au dos, Denise se coiffe comme une lionne, un peu à la Tina. Elle continue de taper dans les compos du légendaire George Jackson avec «What’s Going On In My House». C’est l’avantage d’enregistrer chez Malaco : on y paye George pour composer. Quel fabuleux groove de charme ! Il faut bien dire que TOUTES les compos de George Jackson tapent dans le mille. L’Association Denise/George se situe exactement au même niveau que d’autres associations mythiques du genre Burt/Dionne ou encore Jimmy Webb/Thelma Houston. On est dans le nec plus ultra de l’excellence. Elle récidive en B avec «Dip Bam Thank You Mam», fabuleux groove jacksonien cuivré de frais. Denise l’attaque à l’Aretha et Jimmy Johnson nous barde ça de tortillettes incisives. Elle boucle le bouclard avec «Is He Lovin’ Someone Else Tonight», un slowah magnifico de Malaco coco, joué au petit bonheur la chance du Southerner. Denise nous le distille savamment, au gré du vent chaud qui caresse les fucking champs de coton.
Alors attention, It’s Lying Time Again et Holding Hands With The Blues proposent exactement les mêmes morceaux, et pourtant, c’est sorti sous deux pochettes Malaco différentes. Malaco nous prend pour des gogos ? Hélas oui. Notre géante adorée tape «It’s Lying Time Again» au heavy shuffle de groove. Elle chante ça comme Albert King ou Aretha, avec du raunch plein la bouche. Elle entre dans la caste des imparables. Back to the heavy blues avec «It Makes Me So Mad». Denise n’a aucun souci avec le blues. Elle y va franco de port. Mais ça la rend folle, chaque fois qu’elle le voit dans les parages. Encore du haut de gamme avec «You’ll Never Get Your Hooks On My Man». Tout est bon chez Denise, miam miam. En B, elle tape dans Joe Tex avec «Hold On» et revient à la pop de Soul avec «Love Break». Cette femme nous épuise.
Attention, voilà un album énorme : Hitting Where It Hurts. «Don’t Cry No More» donne le ton : joyeux et quasi-calypso. On note la belle santé du beat raffiné. C’est tout simplement un fantastique hit de r’n’b monté sur un riff hypnotique. Elle rend un hommage somptueux à Sam Cooke avec une version musclée de «Bring It On Home To me». Elle fait le choix audacieux d’un beat grrovy et ce n’est pas la dernière fois qu’elle nous fait le coup. En B, elle revient à George avec «Eee Tee», comme si elle voulait passer aux choses sérieuses. C’est joyeux, solide et bon comme le pain chaud du petit matin - My man loves me/ He loves me from his heart/ Yes he does - C’est un énorme standard de r’n’b. Encore un fantastique hit de r’n’b avec «If You Don’t Do Me Right», joliment dansant et ultra-orchestré. Denise a du pot, elle a derrière elle tous les cocos de Malaco. Le «See Saw» qui suit n’est pas le hit connu, mais une pop atmosphérique si bien chantée qu’on dit amen. Elle revient à George avec «You Gotta Pay To Play» : solide, en place, chœurs de rêve, nous voilà au faite du Deep Southern Soul System.
La pochette de Still Trapped est un peu difficile. Denise n’y est pas à son avantage. Comme Aretha, elle est passée chez un coiffeur de traves. Mais l’album est superbe. On y retrouve toute l’équipe de Muscle Shoals, David Hood, Jimmy Johnson et Roger Hawkins, avec George Jackson qui fait des backings sur «Wet Match». Franchement, que peut-on espérer de mieux ? Avec «Trapped 1990», on glisse dans le plus admirable des slow-grooves. Dorothy Moore chante derrière. On a là une fantastique épopée sensorielle. Denise fait ce qu’elle veut des lapins blancs, de toute façon. Elle les emmène avec «Paper Thin» dans le meilleur beat de slowah de Malaco et rallume les lampions pour un coup de jerk intitulé «Chain Letter». Elle nous rappe ça au talking blues et part en funk de Soul avec toute la puissance des Temptations. Fascinant ! En B, dans «I’m Loved», elle s’extasie sur le fait d’être aimée, et elle a raison, car ça sonne juste. «Kiss It» est beaucoup plus diskoïdal, mais elle fait des folies de son corps. C’est une femme libérée, une extraordinaire rosace effervescente. Et soudain, voilà qu’elle tape dans Al Green avec «Love And Happiness». Cette merveilleuse pêcheresse greene bien son groove, elle en fait un groove de rêve écarlate joué sous le boisseau ardent du dieu des blancs qui n’a rien compris aux blacks. C’est battu au beat d’Al, une merveille d’équilibre et d’intelligence humaine et cette diablesse se fond dans un océan de crème au chocolat.
Sur Love Me Right, on trouve une nouvelle énormité signée Jackson : «Fast Hands And Dirty Mind». Encore un fabuleux groove de r’n’b emmené à fière allure. Tout aussi jouissif, voilà «Don’t Jump My Pony». Elle montre une fois encore qu’elle sait driver un beat dans le bon sens. Il ne faut pas lui raconter d’histoires, Denise n’est pas née de la dernière pluie. Les cocos de Muscle Shoals sont encore là, garants du meilleur son local. Un son si parfait qu’il est impossible de s’en lasser. Et Denise continue de chanter comme l’une des plus grandes Soul Sisters d’Amérique. Elle revient à son cher George avec «Don’t Pick It Up». Qui saura dire la classe des cuts de George Jackson ? Hein qui ? C’est d’une élégance qui bat tous les records. Une élégance pulpeuse, pulsée des reins, good timey - If you can’t carry it babe - «Ahhhh comme elle bonne !» (dit avec l’emphase crapuleuse de Jean-Pierre Marielle dans Les Galettes de Pont-Aven, cette fabuleuse ode à la vraie vie). Avec «Love Me Right», il est clair que Denise sort sa meilleure compo pour honorer les dieux de la Soul. Oui, il existe forcément des dieux de la Soul, sinon comment pourrait-on expliquer l’existence d’une femme aussi douée que Denise LaSalle ? En B, elle revient à George avec l’excellent «Too Many Hungry Mouths Around The Table», un heavy grrove d’une importance considérable. Elle maintient le cap du très grand album avec «You Can’t Get Nothin’ Straight Between Us». C’est très impressionnant. Trop de qualité ? Il faut juste se contenter d’écouter et surtout ne pas se poser de questions ou ramener des formules dont raffolent les cons, du genre «trop de qualité tue la qualité».
Avec Trapped, on entre dans ce que les disquaires appellent les tardifs. Denise approche de la soixantaine, mais elle ne faiblit pas. Elle retape dans son vieux hit «Trapped By A Thing Called Love», dans une ambiance à la Bobby Bland. Elle tape ça au talking blues et les gens applaudissent. Sacré public ! Les gens l’adorent. Elle fait sa Millie Jackson. Alors elle chauffe la salle et les gens exultent. Avec «I Was Telling Him About You», elle renoue avec l’excellence du groove, mais au-delà de toute espérance. Elle retape dans le vieux «Hold On» de Joe Tex en mode gospel batch et revient au heavy groove de génie avec «You Gotta Pay To Play». Hit signé George Jackson, alors no problemo. C’est immensément bon, claqué au dessus de la surface du r’n’b, subtil mélange de fonk, de Soul et de heavy groove bien monté en température. Elle accepte tout, le cash, American Express & co. Elle tape dans Sam Cooke avec «Bring It On Home To Me» en mode funky. Étonnant parti-pris. Elle rend hommage au père fondateur à sa façon. Elle revient à George avec «Too Many Lovers» et elle l’arrache du sol d’entrée de jeu. Avec George, on ne rigole plus. Voilà un hit de r’n’b assez fondamental. Denise le charge au maximum des possibilités, elle y va au guttural de chef de guerre, elle croit en George, alors ça se transforme en hit séculaire.
Dernier coup de Malaco avec Smokin’ In Bed. Denise est dans son lit. Attention, c’est chaudard ! À commencer par «Never Been Touched Like This». Elle rappe. Elle mah-mahte sur fond de groove technologique. Le pire, c’est que ça marche, ça accroche comme un hameçon dans la gorge d’une carpe qui ne demandait rien à personne. Ce groove ensorcelle - I love what you do baby - L’autre énormité nichée sur cet album s’appelle «The Night He Called It A Day», slab de pop rock de juke à la Dionne Warwick. Denise est une aubaine pour l’humanité, mais visiblement, l’humanité n’est pas au courant. Elle chante à la seule force de sa féminité talentueuse. Dès qu’elle tape dans les grosses compos, elle s’élève merveilleusement. Le morceau titre reste du pur jus de Malaco. Derrière Denise, les filles envoient la purée habituelle. Ça groove sec à Jackson, Mississippi - My man is smoking in bed - Tout un programme. Pas question de rater ça. Retour à George avec «Blues Party Tonight» - Tell BB King don’t forget to bring new kicks/ It’s gonna be alrite tonite/ At the blues party tonite - Elle cite aussi Johnnie Taylor et Bobby Rush, wow ! Et Little Walter ! Elle revient au gospel batch avec «Goin’ Through Changes». Elle se sert du gospel pour laver tous ses péchés. C’est de bonne guerre. Au temps de Corneille, on se battait pour moins que ça. Et puis il faut l’entendre éclater «Why Am I Missing You» au firmament des slowahs. Elle travaille bien son groove au corps et cette diablesse tape dans le mille à chaque fois. On dirait qu’elle a fait ça toute sa vie.
Beau portait de Denise sur la pochette de Still The Queen. Denise pourrait se contenter d’avoir du charme, mais elle continue de chanter comme une Soul Sister de très haut rang, et ce dès le morceau titre d’ouverture de bal. Fabuleux shoot de funk ! Elle écrase tout sur son passage, impérieuse, the queen is back ! Well give it up baby ! Elle n’a pas besoin de réclamer sa couronne. Elle enchaîne avec un slowah enchanté, «Dirty Freaky Man». Il semble parfois que dans les carrières des grands artistes black, les tardifs soient les meilleurs. En tous les cas, ça se vérifie avec Gladys Knight, Aretha et Denise. Back to the hot r’n’b avec «You Should Have Kept It In The Bedroom». Il y a là de quoi réveiller tous les morts du Chemin des Dames et que quoi recoller le bras coupé de Blaise Cendrars. Fantastique énergie, Blaise et Denise même combat ! C’est rythmé aux clap-hands. Quel festin ! Elle rejoue la carte fatale du heavy blues avec «What Kind Of Man Is This». Elle chante à outrance. Tiens, encore un violent slab de slut de r’n’b : «Funky Blues Kind Of Mood». Effarant de grandeur apoplectique, on est dans la cour des grands de Memphis, man ! Elle nous roule ça dans sa farine, la meilleure du comté. Elle chauffe à coups répétés de guttural et attaque tous ses couplets à la syllabe vibrée. Elle est admirable de A à Z et quand on écoute «Who Needs You», on se dit : «Ah comme les choristes sont bonnes !». Elles réchauffent bien le cœur de Denise. Elle chante comme une reine éternelle. Retour à George avec «In A Midnight Mood In The Middle Of The Day». Heavy groove d’ooh baby. Il plane sur ce cut un sacré parfum de légende. Denise semble surfer sur une vague d’argent et c’est pouetté au bassmatic. Elle termine avec le gospel de la séparation, «There’s No Separation». Elle s’engage politiquement - There’s no separation of church and the state - Diable, comme les Américains peuvent être vieux jeu.
Il semble que Pay Before You Pump soit le dernier album qu’elle ait enregistré. Pochette un peu vulgaire, mais les chansons elles ne le sont pas. On est tout de suite effaré par la puissance du beat. On la voit avaler le beat d’«It’s Goin’ Down» et passer à la pire heavyness avec «I Need A Working Man». Heavy as hell ! Elle est tout simplement démente, elle crée une fournaise sous le boisseau et semble réinventer la heavy Soul, elle drive le beat, c’est admirable de démesure, elle chauffe son cut avec toute la puissance d’une reine antique, tout à la poigne de fer. S’ensuit un fantastique schloof de boogie blues, «Mississippi Woman». Elle rend hommage au dieu Hooky, c’est joué au boogie blast d’accord traînard. Et voilà un cut idéal pour les apéros qui dégénèrent : «Hell Sent Me You». Ça glisse vers le dance-floor, La reine a pris un coup de vieux, mais elle reste géniale. Elle explose même le dance-floor. C’est d’une santé insolente, avec un groove orchestré aux marimbas. Elle revient au heavy blues avec «Walking On Beale Street And Crying», elle walk up and down looking after BB King et revient danser avec «I’m Hanging On». Cette diablesse bat absolument tous les records de cordialité, elle nous sort là un coup de pop joyeuse et elle pousse des cris. Elle fait sa mère maquerelle de club avec «I Tried» et il faut se dépêcher d’en profiter, car après c’est fini. Il ne reste plus que les asticots.
Signé : Cazengler, Denis le sale
Denise LeSalle. Disparue le 8 janvier 2018.
Denise LaSalle. Trapped By A Thing Called Love. Westbound Records 1972
Denise LaSalle. On The Loose. Westbound Records 1972
Denise LaSalle. Here I Am Again. Westbound Records 1975
Denise LaSalle. Second Breath. ABC Records 1976
Denise LaSalle. The Bitch Is Bad. ABC Records 1977
Denise LaSalle. Under The Influence. ABC Records 1978
Denise LaSalle. Unwrapped. MCA Records 1979
Denise LaSalle. I’m So Hot. MCA Records 1980
Denise LaSalle & Satisfaction. Guaranteed. MCA Records 1981
Denise LaSalle. A Lady In The Street. Malaco Records 1983
Denise LaSalle. Right Place Right Time. Malaco Records 1984
Denise LaSalle. Love Talkin’. Malaco Records 1985 (= My Toot Toot)
Denise LaSalle. Rain & Fire. Malaco Records 1986
Denise LaSalle. It’s Lying Time Again. Malaco Records 1987
Denise LaSalle. Holding Hands With The Blues. Malaco Records 1987
Denise LaSalle. Hitting Where It Hurts. Malaco Records 1988
Denise LaSalle. Still Trapped. Malaco Records 1990
Denise LaSalle. Love Me Right. Malaco Records 1992
Denise LaSalle. Trapped. 601 Music 1997
Denise LaSalle. Smokin’ In Bed. Malaco Records 1997
Denise LaSalle. Still The Queen. Ecko Records 2002
Denise LaSalle. Pay Before You Pump. Ecko Records 2007
Denise LaSalle. A Good Thing Better. The Complete Westbound Singles 1970-1976. Westbound 2013
PARIS / 06 – 03 – 2018
LE QUARTIER GENERAL
THOUSAND WATT BURN
OSCIL
Sur le sentier de la guerre rock il ne faut pas s'étonner si l'on se retrouve au Quartier Général, ameublement spartiate, peu de chaises, quelques tables, de rares banquettes, par contre luxe suprême en temps de grand froid, un fumoir à l'étage inférieur, peu commode pour écouter les groupes, public nombreux pour un lundi soir, massé devant la scène. Trois combos de mecs avec à chaque fois, une fille en tête de file. Vous n'en verrez que deux, la brune et la blonde.
THOUSAND WATT BURN
Suis venu pour eux, et me voici en pleine crise d'angoisse, si jeune et déjà rattrapé par le syndrome d'Alzheimer, j'aurais juré qu'ils étaient trois comme les Mousquetaires, j'ai beau compté sur mes doigts et me frotter les yeux, les voici quatre comme les Cavaliers de l'Apocalypse. J'ai trouvé l'intrus, je livre son nom aux services de renseignements, Will, et je complète la fiche : bassiste de son état. Voici donc notre trio transformé en quatuor, depuis à peine un mois, puis-je révéler. Mais taisez-vous, la cérémonie peut commencer.
Elle – la grande prêtresse noire – effleure d'un geste lent son bol tibétain, la batterie émet quelques râles à croire qu'elle entre en agonie, et derrière un froissement majestueux de guitare prend son jeu. Surviennent les notes noires et profondes de la basse et la musique gonfle comme un cobra royal qui se dresse de toute sa hauteur. Une vibration tellurique emplit la salle et se déploie tel un cauchemar maléfique.
Immobile, debout devant le micro, en une pose hiératique, sorcière dans une ample robe de bure noire, sa longue chevelure noire qui fait office de lourde écharpe, et ses lunettes aux grands verres aussi larges que deux pleines lunes de nuit de sabbat goethéen. Et la nuit tombe sur le monde. Elle hurle et les monstres froids et gluants de la démence et des terreurs folles quittent leurs sombres cavernes originelles. Viols de vampires, strettes de strénogoïs et vols erratiques de ptérodactyles efflanqués dans les aubes livides.
Un chant d'opéra, qui porte en lui décors d'effrois, rideaux de peur et coulisses de terreur. Plus qu'un chant, de longs spasmes doomiques, qu'elle extirpe du fond de sa gorge, qu'elle libère d'on ne sait quels cachots souterrains, elle n'est déjà plus elle, elle tape du pied, d'un mouvement pratiquement instinctif, une espèce de défense auto-réflexive du corps qui se défait, expulse et exile de telles horreurs innommables. Une attitude qui sans en être une copie n'est pas sans rappeler la tenue de Janis Joplin sur scène. Mais les temps ne sont pas les mêmes, régnait alors une atmosphère de fête libératrice... notre époque ressemble davantage aux âges noirs du Kali Yuga dans lequel l'éternité n'a plus de futur.
Lorsqu'elle s'arrête – vous savez ces profondes inspirations toute pantelantes entre deux vomissements – l'on prête attention à l'orchestre qui tisse écrins de somptueux requiems, brocarts de noirceurs, linceuls d'agonie, et suaires de goules sanglantes. Musique lourde moins striée des stridences de la guitare car funébrélisée des rondeurs de la basse. Atmosphère de châteaux en ruines ensevelis sous les frondaisons de chênes multi-séculaires aux branches tordus comme des corps de suppliciés. Et la voix reprend comme immenses et vastes lames de larmes qui se brisent sur de désastreux récifs. Une houle immense qui s'avance, emporte tout, détruit tout. Sans rémission.
Thousand Watt Burn, brûle tout sur son passage, un feu glacé, une fournaise froide comme l'enfer de vos meilleures intentions. Neige carbonique. Mais notre prophétesse s'accroche au micro pour lancer les imprécations ultimes, vingt fois elle reprend le combat, comme possédée d'une étrange transe envoûtante.
Et le rituel sacré s'achève. Quelque part une pierre de la pyramide du monde se lézarde... le public qui acclame et félicite ne le sait pas encore. Il vaut mieux pour lui.
OSCIL
Elle porte un perfecto et une robe pied-de-poule flashy-chic, quand je suis arrivé et que je l'ai aperçue je n'ai pas deviné qu'elle était dans un groupe, trop classe avec ses cheveux mi-longs qui encadrait ses yeux bleus – légendaire flair de rocker en faillite – mais quand elle a quitté son perfecto et gardé sa robe – hélas, pas l'inverse - pour se poster devant le micro l'a bien fallu me rendre à l'évidence. J'avoue que j'ai lamentablement séché sur le premier morceau, incapable de dire de quoi il s'agissait, pas vraiment du rock, pas vraiment autre chose, le deuxième était un plus net. Les trois zigotos à ses côtés commençaient à s'en prendre à leur instrument de belle manière, des pointures à leurs façons. Remarquez que sur le moment, j'ai éprouvé un énorme regret, celui de ne pas avoir les pleins pouvoirs divins et de disposer une section de cuivres autour d'Ingrid. Elle a de la voix, l'en fait un peu ce qu'elle veut, la flexibilise, la pirouettise, l'attise, la jazzise et la rytm'n'bluise, à sa guise. Oscil oscillerait-il entre plusieurs genres ?
Ben non, z'ont fini par trouver leur voie. Z'avaient dèjà la voix alors se sont resserrés sur elle, les musicos ont tissé un back-ground aussi touffu que la jungle de Bornéo, se sont amusés à un jeu cruel dangereux, une note de trop et le tigre de la batterie lui tomberait dessus comme un python qui se laisse couler de la cime d'un baobab sur sa victime, un demi-bémol erratique et la guitare-tigre lui arracherait une jambes ou un bras, un fa-dièse en moins et la basse orang-dégoûtant s'apprêterait à lui-faire subir les derniers outrages, vous ne pouviez que prendre en pitié et pleurer sur le sort funeste réservée à cette petite-fille confrontée à de tels défis, sans droit à l'erreur, perdue à tout jamais.
Deuxième erreur de la soirée. Ingrid aussi à l'aise au milieu de cette bande de malappris que sur sa chaise-longue au bord de la piscine, ah ! les méchantes bébêtes voulaient s'amuser, elle allait leur montrer qu'elle était la plus futée de la futaie. On croyait l'avoir entendue chanter, ce n'était qu'une illusion, disons qu'elle chantonnait, qu'elle fredonnait, qu'elle flûtait ( une demi-baguette ) et brusquement de sa petite robe à motifs émotifs gris et blanc, elle a sorti son organe, une voix de lionne à qui vous venez de tuer son petit, z'avez intérêt à courir vite et à ne pas vous retourner, et les trois musicos ont compris que leur vie en dépendait, vous auriez vu le concours de vitesse, Flo qui drumait sur sa batterie comme s'il descendait les pentes vertigineuses de l'Anapurna en ski, l'on ne voyait que ses bâtons qui tournoyaient autour de ses bras, Vince, sa barbe emmêlée dans les cordes de sa guitare, vous dégoupillait les riffs à la manière d'un ouvreur d'huîtres un soir de Noël, trente quatre notes à la seconde, et Aubry qui malaxait sa basse tel un catcheur en train de jeter sur le public les boyaux de son adversaire qu'il vient d'étriper vivant sur le ring. Un sauve-qui-peut généralisé, mais en un ordre parfait, se talonnaient certes, mais jamais sans se marcher dessus. Un ballet sonore réglé au centième de millimètre, et Ingrid qui n'arrête pas de clamer toute sa féminine hargne, qui vous claque de sa voix de bronze et vous barbaque la chabraque de son gosier d'airain. Le public suit en hurlant et en applaudissant.
Z'ont bien tenu une heure à ce rythme-là. Z'ont aligné des syncopes d'un funk-rock-jungle du meilleur bois précieux dont ils se chauffent, et puis se sont arrêtés, tout sourires, Ingrid aussi fraîche qu'un gardon dans les eaux froides d'un torrent de montagne, nous a remerciés d'une voix toute fine, est descendue de la scène pour se saisir de son perfecto. Le style.
FIN IMPROMPTUE
Il y a bien un troisième groupe sur l'affiche. Crash Mighty, se sont dépêchés d'investir la scène dès le set des Oscils achevé. Mais je n'en parlerai pas. Ce n'est pas que je les hais, ce n'est pas que je les ai déjà chroniqués dans la livraison 357 du 18 / 01 / 2018, simplement que j'ai détalé au plus vite comme un caribou à bout d'abus, c'est que voyez-vous les Rockers sont de dangereux oiseaux de proie qui partent en chasse dès que la noirceur de la nuit s'étend sur le monde, peut-être un jour vous raconterais-je, si vous êtes sages, la suite de mes nyctalopiques errances fastueuses dans les ténèbres du Mal, en attendant remettez-vous Thousand Watt Burn, pour calmer vos impatiences.
Damie Chad
THOUSAND WATT BURN
Attention artefact. Objectif objet réalisé. Avis à la tribu des collectionneurs collectant les collectors, existe en deux teintes, pourtour de la pochette en bistre ou en bleu. Aucune indication de noms, de lieu, de titres, de dates hormis l'image. Rond blanc, comme masque funéraire cambodgien, cerclé de noir, avers du disque d'un noir de cercueil, là aussi, nulle inscription.
Je ne résiste pas à vous le re-chroniquer ( voir la livraison 358 du 25 / 01 / 2018 ), mêmes titres non indiqués. My Darling : transportés en trois coups de batterie dans une autre dimension, une guitare cathédrale et une voix de voûte grégorienne qui vous prend à la gorge avant de se mettre à marouler comme un chat abandonné sur un toit brûlant, plus tard elle feule et râle et même quand elle murmure vous avez la chair de poule. Eblouissance terminale, avec une pression orchestrale énorme qui annonce le train suivant. Come to me : lancé à toute vitesse, fait la course avec le Dirigeable, la guitare fonce mais c'est la voix qui emporte le convoi. Un beau cyclone de cymbales pour accompagner le roulement. Ah ! ce your mind miaulé à mort, mais qu'est-ce qu'elle veut, lui bouffer l'âme toute crue ? She loves a girl : ( moi aussi, mais ce n'est pas pareil, toutefois pas plus naturel quand on y pense ) Bon pas le temps de philosopher, c'est reparti comme en quatorze, z'ont apparemment une tranchée à prendre, arrêt brutal, plus personne à tuer. C'est dommage. Listen : un vieux fond de blues kramé au kérosène, musique au lance-flamme et voix en tapis de bombes. N'oublient même pas la fumée qui sourd des ruines, pour la fin vous avez l'impression qu'un troupeau de mille éléphants s'avance sur vous dans la manifeste intention de vous écrabouiller et de vous réduire en huile de palme pour la confection des pots de nutella. Les enfants adoreront. C'est comme cela que l'on fabrique les asociaux, les inadaptés, et les légions de révoltés.
Damie Chad.
*
* *
Journée de la femme, leitmotiv peu wagnérien en boucle sur les média, si les dieux du rock existent, ils vont nous balayer toutes ces simagrées institutionnelles en un tour de main, nous passer le torchon et la serpillère javellisée sur toutes ces rodomontades hypocrites... Bien sûr que du haut de leur Olympe ils veillent au grain, et rétablissent l'équilibre paritaire, la nouvelle tombe sur les téléscripteurs en plein après-midi, ils nous envoient ce soir :
08 – 03 – 2018
,à FONTAINEBLEAU, au GLASGOW,
THE SPUNYBOYS
trois des gars des plus juteux et des plus gouteux du rock'n'roll. Marteau sur l'enclume, c'est la vingtième fois qu'ils viennent semer l'orage et la foudre dans le pub bellifontain, est-il nécessaire de préciser que le public a répondu en masse à l'appel sauvage, the Call of the wild pour parler comme Jack London. Dans le fond à gauche, si vous vous penchez bien, vous reconnaîtrez les silhouettes de Sergio Kahz et de Maryse Lecoultre en mission secrète pour Rockabilly Generation News, à ses côtés ce blouson rouge appartient à Bryan Kazh, jeune pousse du rockabilly dont nous reparlerons bientôt.
Sont là, Rémy arborant sa monstrueuse banane – monument capillaire qui devrait être classé par l'Unesco en tant qu'insigne culturel d'exception - et son sourire charmeur, Guillaume le visage cisaillé de ses favoris angulaires qui sont de véritables accroche-coeurs féminins, et Eddie. Qui nous la joue rock and roll star. Absent. Et la foule, tassée comme grains de sucre dans un stick, qui scande son nom sur l'air des lampions, surexcitée. Le voici enfin qui descend négligemment les escaliers, grand seigneur qui rejoint ses gens - valetaille adorante, damoiselles émoustillées, et piqueurs rockers impatients de courir après le gibier de la grande chasse que tout le monde pressent royale.
Ecouter les Spunyboys vous renvoie à votre incomplétude humaine. Il vous manque une oreille. Car ils sont trois et vous n'en possédez que deux. Que voulez-vous nul n'est parfait. Prenons un exemple au hasard : les Spunyboys, justement ils sont là devant nous. Ne sont pas comme les autres groupes de rockab. Chez eux il n'y a pas d'espace. Même pas courbe comme chez Einstein. Sont du genre, premier atome d'hydrogène avant le big band. Concentrés à l'extrême. Chant, contrebasse, batterie, guitare, ne forment qu'un. La sphère parménidienne par excellence. Vous n'y rentreriez pas un grain de poussière. Alors avec vos deux pavillons éléphantesques ( éléphantasques si vous préférez, barrez la mention inutile ) vous repasserez. Les autres groupes, reste toujours un interstice, une fissure à lézard, un trou de souris, une niche à chien, une grotte à ours, une balzacienne rue du chat-qui-pêche, que sais-je ! bref assez d'espace pour que vos deux tympans puissent se promener à l'aise dans toutes les directions et isoler les instruments un à un, suivre celui-ci, vous obnubiler sur celui-là, vous détourner de ce dernier, mais avec les Spuny, vous pouvez prêter l'ouïe tant que vous voulez, ils ne vous la rendront pas. Mélange homogène.
Inutile de vous lamenter car écouter les Spuny c'est accéder à une plénitude musicale extatique. Pas de quoi glisser un feuillet à cigarettes ( ou à autre chose ) mais en contrepartie, vous les entendez tous les quatre. Sont trois mais comme dans les grandes surfaces vous en achetez trois – profitez-en ce soir l'entrée est libre – et vous en avez un quatrième gratis. Des malins, des vicieux. Même quand ils donnent toute la gomme, tous ensemble, ils se ménagent une place de stationnement à usage exclusif. Pas grand-chose, même pas trois secondes, ici c'est Guillaume qui rattelle sa batterie, z'avez l'impression qu'il jette trois cadavres dans une fosse commune ( et vous aimez cela ), là c'est Eddie qui vous électrifie les parties génitale à la gégenne vincent, maintenant c'est Rémi qui vous frictionne l'épiderme avec la pommade empoisonnée de sa voix, et le voici encore qui arrête si brusquement de tirer sur les cordes de sa contrebasse que vous sentez votre cœur s'arrêter. Ad vitam quasi aeternam !
Et pas besoin d'être un amateur chevronné de rockabilly pour ressentir cela. Le public du Glassgow est à majorité festive. De la bonne musique qui envoie, ne demande pas plus. Ne dissèque pas son plaisir. Les boys savent y faire. Vous renvoient la pression à cent à l'heure. Quelques mots suffisent à Rémi pour créer la grande connivence des grands soirs. N'a pas un grand espace pour faire tourner sa contrebasse comme les ailes des moulins de Don Quichotte, n'en fait pas pour autant le cachotier, y grimpe dessus, matelot de vigie hissant l'étendard sémaphorique de son corps, la pose du Christ mis en croix qui se démène de bien peu pieuse manière, la foule se referme sur lui lorsqu'il s'allonge de tout son long sur les éclisses, tout en continuant à jouer avec autant de justesse que le premier violon du Berliner Orkestra. Quoiqu'il nous faille reconnaître qu'il y met davantage de fougue délirante que de grave componction.
Eddie fait l'unanimité. Contre sa chemise. Personne n'échangerait la sienne avec son chiffon blanc. Par contre, il vous fait de telles sérénades – flor de cuchillo – disait Federico Lorca en su cancion del jinete, que votre petite soeur adorerait qu'il vienne nous donner aubade tous les soirs sous son balcon, pour la discrétion, ne pas compter sur lui, vous délivre de ces giclées spermatoïzidales de notes à faire rougir un archevêque. Guillaume ne reste pas en reste. Le plus grand cogneur de grosse caisse de toute l'Europe. Vous fricasse un boom-boom en introduction comme s'il bazardait deux bombes atomiques sur la maison d'un voisin qu'il n'aime pas, suivies de ce bruit qui ne ressemble à rien mais reconnaissable entre mille, cette espèce de brève rumination métallique de cloche de vache dont vous entrechoquez les cornes pour en tirer des étincelles.
Deux sets. Le premier de folie. Le second de furieux. Les gens qui dansent partout, des sommets éblouissants, Teddy Boy Rock'n'roll l'hymne ted par excellence, le I'm down d'Esquerita – comment oublier l'envolée little richardienne de Rémi - plié pile à la démesure du phrasé syncopalement ultra rapide des Spuny, un véritable travail d'artiste. Un Important Words de Gene Vincent dynamité de fond en comble sans rien perdre de l'authentique tristesse originelle, et plus tard cette série de jumpin'countries, cowboys, saloons et winchesters crépitantes...
Quittons les spuny acclamés comme des héros, entourés de filles extatiques, rock'n'roll quoi !
Damie Chad.
10 / 03 / 2018
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
LOCAL METALLIC MACHINEs
KING BISCUIT TIME
Toujours m'esbaudit le body de courir à Couilly-Pont-Aux-Dames, à ma connaissance il n'est pas une autre localité hexagonale qui ait réussi à exprimer en sa brève appellation l'attrait sexuel qui aimante l'hominidé mâle à s'irrésistiblement porter vers l'hominienne femelle. J'arrête mes salades salaces, toutefois quoi de plus naturel que je givre de jive grivois quand arrive le temps de tremper son biscuit dans l'origine du monde bleu.
KING BISCUIT TIME
Cuite et recuite à la sauce au bleu, la plus vieille émission hebdomadaire de blues du monde. Première gigue en direct sur les ondes de KFFA à Helena en 1941, dans l'Arkansas pas très loin de Memphis ( Tennessee ). King Biscuit Time diffusée à l'heure des repas fut un instrument idéal de propagation du blues dans l'Amérique noire. Et par contre-coup blanche. King Biscuit Time fut un marqueur privilégié de la transition du blues rural du Delta au blues électrique de Chicago.
Quatre-vingt ans plus tard, le nom d'un groupe Seine & Marnais qui s'inscrit dans le vecteur du blues électrique cousin incestueux du rock'n'roll. Pas des débutants, ont déjà roulé leur bosse, certains, notamment Sébastien Bizière et Bruno Lombard, dans les Spykers, groupe orienté rockabilly qui, sans surprise, ménageait quelques interludes bleus dans leur répertoire, ce que nous avions chroniqué en notre livraison 164 du 21 / 11 / 2013 lors de leur passage en première partie de Marcos Sendarrubias.
Premier concert pour le King Biscuit Time, ne sais comment ils ont trastégé mais le local des Metallic Machines est rempli à ras-bord – l'est sûr que l'accueil est super-sympa – et le public ne décollera pas de devant le combo une seule seconde de tous les deux sets. Vu les applaudissements chacun à dû trouver les gâteaux succulents. Que voulez-vous les chocolatines avec deux barres de chocolat, c'est obligatoirement meilleur. King Biscuit Time applique cette double recette. Possèdent deux guitaristes solistes, avec Bruno Lombard à l'harmonica cela en fait trois. Ne croyez pas que les deux autres pointent au chomdu.
Automatic pour lancer la machine bleue. C'est du spongieux à souhait, à chaque pas que vous faîtes z'avez un alligator qui pointe son museau à fleur d'eau, pas très rassurant, mais l'on garde le cap sans faillir. L'on gagne très vite la terre ferme avec It's Hot, c'est vrai que c'est chaud, brûlant même. Faut maintenant détailler. S'est installé à la meilleure place, vue montante sur les rotondités avenantes et charnues de Miss Metallica collée au mur. Une véritable invitation au voyage, qui doit l'inspirer. Un homme discret Marc Rodeschini, souvent caché par la haute silhouette de Bruno Lombard, mais l'on n'est pas prêt de l'oublier. L'a le son bleu, idéal. Une basse puissante, flexible, chaloupée, prenante et souple, rien à voir avec le bruit de fond qui vous embrume la tête, au contraire, cinglante comme un fouet et onctueuse comme une caresse. Vous enveloppe sans vous oppresser, relève du courrier à toute heure, de jour et de nuit, avec une telle assurance-vie rythmique, les copains sont certains qu'ils peuvent prendre tous les risques. A ses côtés Sébastien Bizière, Sébas bastonne à la batterie. L'est l'homme du premier et du dernier recours. Le phare durant la tempête, avant et après aussi. On l'interroge du regard, on lui fait signe du bras et tout de suite il lance la foudre ou vous ralentit la voiture à volonté. File la mesure de trois coups de baguette et accompagne les copains dans la démesure. L'a fort à faire car les autres briscard ne sont pas venus pour mâcher des chamallows. Déjà deux solistes – qui parfois poussent le vice à soleliser en même temps, genre le fil barbelé qui s'en vient s'enrouler autour de la ronce, en prenant soin de ne pas arracher les pétales de la rose bleue. Chacun leur style. D'abord Thierry Leroux, casquette New York sur la tête, l'a un truc, ne se sert que d'un tiers de sa guitare. Le bas de caisse et le haut du manche, de temps en temps un petit tour juste pour vérifier s'ils sont encore là. Son endroit de prédilection c'est au plus bas des frettes et sur le dernier micro. Deux solutions, quand il est sur le bas du manche, il vous poinçonne de ces petites notes à la B. B. King, des espèces de plaintes répétitives qui vous vrillent les tympans, les soutient un quart de seconde de moins que B. B. car il a une préférence pour les dégelées ultra-rapide, descend sa main droite de dix centimètres et vous ne voyez plus ses doigts qui vous envoient de ces grésils enflammés et suffocants qui mettent l'auditoire en joie. Au tour de Patrice Corbière. Une dégaine incroyable avec sa casquette visière sur la nuque, il s'approche du micro et dès qu'il a plaqué deux accords toute la solitude du blues vous tombe dessus. Attention, il est inutile de vous suicider de désespoir, suffit de suivre ses agiles pognes sur le manche pour être à la fête. Un style à l'opposé de la manière de Thierry. Vous avez eu le feu. Voici l'eau. Pas celle qui éteint les incendies. Elle coule mais pas du tout innocemment. Elle grouille de piranhas et de barracudas, au moment où vous vous y attendiez le moins, leurs têtes surgissent du flot bleu et vous arrachent un morceau de chair. Parfois elles s'obstinent, reviennent incessamment à l'assaut et vous bouffent par morceaux jusqu'au squelette. Et le public crie de joie.
La guitare blues c'est excellent mais avec l'harmonica c'est comme si vous rajoutez une vipère dans votre lit. Un sacré instrument. Vous tient dans la paume de Bruno Lombard, l'en a une collection pour toutes les tonalités dans l'énorme valise jaune posée sur le devant de la scène, un jouet d'enfant, et en quelques secondes il obtient des stridences d'enfer à rendre Satan jaloux. Pas étonnant que le blues ait été surnommé la musique du diable, Bruno Lombard y perfore dedans ses orgues à bouche à pleines dents, des fournaises riffiques vous tombent dessus, certes l'a du coffre et du souffle mais au paroxysme de l'action il vous semble qu'il va expirer, rendre son âme, là sur le champ tout de suite, mais non, le retire de ses lèvres pour se jeter sans tarder sur le micro et lancer imprécations vindicatives, déclarations de guerre au monde entier, et admonestations sexuelles à la gent féminine, I wanna Be Your Man, Devil Woman, She's Dangerous, I want to be Loved, Scratch my back, le blues ne fait jamais dans la dentelle, même quand il se plaint Help Me, Baby Please don't Go, Time to Cry, cette musique est emplie d'une séminale énergie frustre et sans équivoque. La voix puissante de Bruno Lombard martèle les mots, vous crache le blues en pleine figure, vous ensaigne la cruelle désillusion assumée de la vie.
Le King Biscuit Time est généreux, à eux cinq z'ont de quoi remplir les bocaux, les morceaux sont entrelardés de solos de guitare, d'harmo et de chant jusqu'à la gueule, n'en jetez plus, il en reste encore, pas le temps de s'ennuyer, deux sets menés à train d'enfer, des charges héroïques de Sonny Boy Williamson ( Rice Miller ) aux virevoltes folles de Little Walter. Premier concert et déjà – ce qui est le plus important - un son à eux. Le groupe s'impose. Vous tire la moelle des os, vous emmène jusqu'au bout nervalien des nuits blanches et des petits matins noirs.
Terminent sous une nuée d'applaudissements frénétiques et un orage de clameurs appréciatives. Dans la boîte à gâteaux ne reste plus rien, l'on a tout raflé jusqu'aux miettes. Le roi des biscuits nous a refilé des biscuits de rois. Take a good time, babe !
Damie Chad.
11:16 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : denise lassalle, thousand watt burn, oscils, spunyboys, king biscuit time
18/05/2016
KR'TNT ! ¤ 282 : THE KING KHAN & BBQ SHOW / MISS VICTORIA CROWN / SOUTHERNERS / SPUNYBOYS / THE DISTANCE /BETH DITTO
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 282
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
17 / 05 / 2016
THE KING KHAN & BBQ SHOW
MISS VICTORIA CROWN / SOUTHERNERS
SPUNYBOYS / THE DISTANCE / BETH DITTO
BOURGES – 06 / 05 / 2016
WILD AND CRAZY COSMIC TRIP FESTIVAL
THE KING KHAN & BBQ SHOW
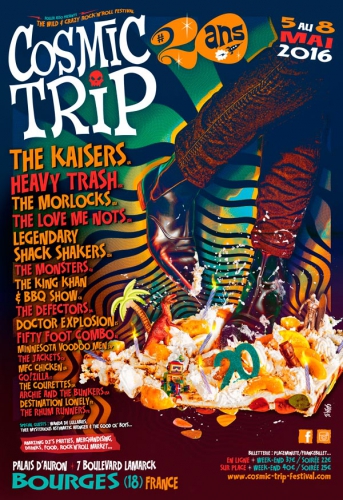
God save the King Khan & BBQ Show !

Il se pourrait bien que King Khan & BBQ soient nos héros du XXIe siècle, les Dupont & Dupont du garage, les Butch Cassidy & le Kid du trash, les Edmond & Jules de Goncourt des temps modernes, les Mandrake & Lothar de la pétaudière, les Boule & Bill dont on a toujours rêvé, les Blake & Mortimer de l’underground, les Laurel & Hardy du Grand Guignol de notre belle époque. En vérité, ces trashers qu’on croit sortis de la cuisse de Jupiter sont tombés du ciel. Eh oui, à l’origine des temps, nos amis étaient des Spaceshits, c’est-à-dire les merdes de l’espace, un combo canadien affreusement puant dans lequel il convenait de marcher du pied gauche.
Qui d’autre que Long Gone John pouvait sortir des albums des Spaceshits ? Tim Warren ne s’y serait jamais risqué. On ne parle même pas d’Estrus qui se réfugiait derrière une orthodoxie trash-punk frisant la rigidité protestante. Quels albums ! On en frissonne encore, vingt ans après.

«Winter Dance Party» parut en 1997. C’est un disque de débutants, très bordélique et surtout mal produit. Il faut attendre «That’s The Way» pour reconnaître la patte de BBQ, cette espèce de trash-rock monté en épingle à coups de yeah yeah yeah. Autre belle pièce, «Cassie», doté d’une bassline d’excellence et gorgé d’énergie. Ils drainent le limon rockab dans le grand jus garage. Ils font aussi une reprise d’un grand classique rockab, «The Raging Sea» de Gene Maltais. De l’autre côté, vous trouverez une belle dégelée de garage infernal, «Showdown On 3rd St». On sent une tendance à poppiser dans les brancards. Ils poppisent de plus belle avec «At The Drive In», monté dans les octaves, avec toute cette énergie de bas étage qui va ensuite les caractériser. Leur «Betty Page» tombe dans la pure pop de rang princier et ils finissent avec un fantastique coup de boogaloo, «Bacon Grease», effervescent et admirablement bien drivé.

«Misbehavin’» percute nettement plus. Ils attaquent avec un superbe «Can’t Fool With Me» et un riff piqué aux Beatles et enchaînent avec «We Know When Girls Are» presque stoogy, époque Williamson. Et paf, c’est parti ! Dans «C’mon Let’s Suicide», BBQ sort son meilleur doo-wopping et pose des jalons pour le futur. Dans «Won’t Bring You Back», ils tapent des chœurs à la Yardbirds. Wow ! Quel album, avec un son tout en profondeur et une énergie considérable. Encore un cut majeur avec «Jungle Beauty» et son ambiance touffue digne du Douanier Rousseau, et ce son qui semble fourmiller d’idées de son ! La fête continue de l’autre côté avec «Turn Off The Radio», trash-garage haut de gamme et BBQ pousse sa voix haut dans le ciel. Ils passent à la pure violence garage, celle des Pretties, avec «Piss On Your Grave». Ils sont dessus, à la goutte de stupre près, ils lancent même des accélérations de basse et des ponts déments. Ils n’en finissent plus d’effarer. Ils bouclent leur bouclard avec «Tell Me Your Name», bien vu car pris à l’étau des deux voix, l’une colérique et l’autre qui rappelle au calme.
BBQ et King Khan se sont ensuite installés en Europe et chacun a suivi son petit bonhomme de chemin. Tagada tagada pour BBQ avec son doo-wop et ses ballades Sun enchantées, en one-man band de luxe (eh oui, car trop doué), et clip clop clip clop comme dans Zorro Est Arrivé pour King Khan, avec ses colliers de dents de tigre du Bengale, son casque à pointe et sa grosse Bertha, c’est-à-dire les Shrines.

Et le jour où nos deux héros ont décidé de réunir leurs efforts, alors le ciel nous est tombé sur la tête, comme au temps des gaulois. On les voit cavaler dans la rue, bras dessus bras dessous, sur la pochette de leur premier album, «The King Khan & BBQ Show», qui reste probablement l’un des plus disques les plus importants de l’histoire du rock, par son souffle, sa science du désossé et l’édifiante aisance avec laquelle ils réinventent l’art du garage. En gros, ils vont d’un coup de génie à l’autre. Ça commence avec «Waddin’ Around», un gros mid-tempo battu au tambourin de pied, riche de son et des harmoniques du grand BBQ, doo-wopper expert qui monte à l’octave frémissante, alors que derrière lui, l’aimable King Khan wap-doo-wappe et tire des notes épouvantablement malsaines de grandeur épistémologique. Dès lors, on comprend que le royaume du garage leur revient de droit. «Fishfight» est devenu au fil du temps l’un de leurs classiques. On a là du pur jus de garage farci d’incursions enragées et gluantes. On les voit braqués tous les deux comme deux travailleurs de la mer sur leur beat diabolo et King Khan joue à lancer des petits phrasés arrogants, pendant que BBQ officie à la cisailleuse. Ils flirtent avec le stomp. Ils incarnent tout ce qui fait la grandeur du garage. Deux guitares et un tambourin au pied : voilà le son. On remonte dans les nues de l’apogée avec «Hold Me Tight», monté sur un beat têtu et revanchard, sevré de sale niaque, vraiment narquois, du genre auquel il ne faut jamais tourner le dos, car sait-on jamais, chargé d’accords de contrebande grattés à la sauvette, et le tout se noie dans les retours d’Hold Me Tight. King Kahn opère des raids dans la fournaise à coups de notes de bas de manche. On monte encore d’un cran dans la pulpeuse excellence avec «Got It Made», et là, on assiste au spectacle du génie vocal de Mark Sultan, alias BBQ. Ce genre de cut s’appelle un tube planétaire. Il remonte au sommet d’un détour mélodique pour tournicoter un effet magique en forme de virevolte. Il est aussi voluptueux que Dion DiMucci ou les Flamingos. Il va chercher l’onctueux au moment le plus stratégique de l’assaut su ciel. Quel enchanteur ! À ce moment-là, il est bien certain que King Kahn doit frémir dans sa culotte. S’ensuit une véritable ode à la vérité funeste, à l’amoralité aristocratique avec «Take Me Back» - I don’t want no Cadillac car/ I don’t need no big cigar/ I don’t need to be a rock star/ I play on my old guitar - Ils s’y mettent à deux et postillonnent leur crédo dans le micro, et soudain, King Khan part en solo vitupéré d’avance. Inutile d’espérer que ça va se calmer. Avec «Pig Pig», ils nous replongent le museau dans le plus jouissif des brouets, dans ce garage véritablement endiablé. King Khan y mène le bal des urgences - C’mon baby c’mon girl - Il joue pointu et chante à l’absolu du garage-punk dévoyé. Les voilà de nouveau penchés sur leur beat comme deux vautours sur une charogne. Encore un éclair garage de génie avec «Lil Girl In The Woods», bardé de toutes les dynamiques de la descente à la cave, d’awites déliquescents et d’échanges à la titube. Ah la dégaine du cut, il faut voir ça ! Bien balancée des hanches et chantée à la morgue de la rue Morgue. Ils se payent même le luxe de chanter «Outta My Mind» avec la hargne la plus sournoise des sixties. C’est le swing des faubourgs joué à la régalade, un mélange d’accords clairs type Shadows et de gimmicks torturés dans les caves de la Sainte Inquisition. King Khan fait issir les moelles de ses gimmicks. Mais en réalité, ils pulvérisent toutes les formules. Ils réinventent le garage. Et dans «Mind Body And Soul», ce diable cornu de King Khan passe un solo de génie à l’orientale. Ce mec est doué, au delà de toutes les espérances. Il rivalise de delirium avec le Cyril Jordan qui montait jadis la fin de «Jumping Jack Flash» en mayonnaise d’arpèges.

Leur deuxième album s’appelle «What’s For Dinner». Sur la pochette, Marc Sultan porte un turban pour faire le sultan et King Kahn porte l’incroyable perruque rose qu’il arborait à cette époque sur scène. Cet album moins dense que le précédent propose quand même quatre raisons de se prosterner jusqu’à terre. «Treat Me Like A Dog» pour commencer, entêtant et enragé, une sorte de garage désossé que BBQ tape des deux pieds et qui serait capable de faire danser tous les squelettes des catacombes. Puis «Zombies» - I don’t give a fuck ! - Et là on voit King Khan piquer une belle crise de colère. Le cut file avec l’évidence de l’éclair et l’apparat du génie trash. On trouve de l’autre côté un autre classique garage, «Captain Captain», gratté dans les règles de l’art, doté d’un petit éclat de démesure, chanté avec une sorte d’élégance qui titube au bord d’un abîme de décadence. On se régalera aussi de «The Ballad Of», un balladif étrange et soutenu, visité par la grâce, une incroyable mélasse lumineuse bardée de descentes de blues en La. Dommage que le reste de l’album ne soit pas du même niveau.

Pour leur troisième album, «Invisible Girl», ils se payent les services du peintre Johnny Sampson pour la pochette. King Khan et BBQ y figurent en forme de créatures sous-marines. L’affreuse pieuvre BBQ tient le fille invisible dans ses tentacules et sur la pochette intérieure, on voit que King Khan coiffé de son casque à pointe vole au secours de la malheureuse. C’est sur cet album qu’on trouve «Animal Party», l’un des hits du siècle, chanté à la dépouille extrême - Who’s there ? Groin Groin ! Mr Pig ! - Les invités viennent faire la fête et comme ce sont des animaux, ils s’annoncent par les cris qui les caractérisent - I say who’s there ? Hi han Hi Han ! - Et BBQ reprend le chant par dessus et cette façon qu’ils ont de décharner le son avec leurs deux guitares. Pur génie ! Le morceau titre vaut lui aussi le détour, avec un son jingle-jangle bien tambouriné du pied et mélodiquement magique. Ces deux mecs sont capables de nous édifier au plus haut point. De l’autre côté, King Kahn nous rappelle dans «Truth or Dare» qu’il est l’un des rois du killer solo et «Lonely Boy» sonne littéralement comme un hit de Beach Boys. Nos deux héros ne reculent devant aucune extravagance.

Johnny Sampson peint aussi la pochette du quatrième album «Bad News Boys» qui nous montre nos deux héros en singes royaux installés dans un trône à deux places. L’album est moins capiteux que les précédents, mais ça reste d’un niveau nettement supérieur à la moyenne. On les retrouve arc-boutés sur le beat dans «Alone Again» et ils truffent la couenne du cut de doo-bah-doos. Avec «Illuminations», ils jouent toujours comme des jumeaux en grattant leur ramalama de concert, avec un sens inné du doo-wop. Le seul hit du disk fait l’ouverture du bal de B : «When Will I Be Taned». Ils reviennent à l’âpreté du grattage des origines et King Khan passe l’un de ses meilleurs solos éclairs. Avec leur gratté raclé et leur beat sévère, ils incarnent tout simplement l’art suprême du garage.

Quelle joie de les retrouver sur scène après tant d’occasions manquées (auto-destruction d’un set au Gibus, deux concerts complets à la Méca). Ils jouent dans la Jungle Room du Cosmic, ce qui permet de les approcher. Trois sets sont prévus dans la soirée, en alternance avec les groupes programmés sur la grande scène. King Kahn apparaît en tenue de grand apparat et s’assoit sur une petite banquette pour jouer aux cartes. Le premier set est flingué. Il ne se passe rien. On revient pour le deuxième set. BBQ branche sa guitare. Ils portent tous les deux leurs atroces costumes SM, ceux qu’ils portent sur la pochette intérieure de leur dernier album, avec des perruques blondes. King Khan ventripote de mieux en mieux. Il accorde une vieille guitare noire, et soudain, ça part. On prend «Fishfight» en pleine gueule. Assis, BBQ joue les locos et secoue la tête en rythme. Ces deux mecs ne plaisantent pas. Ils tapent dans le garage le plus explosif qu’on puisse imaginer. Ils enchaînent leurs standards et redeviennent l’espace d’une demi-heure les incontestables rois du grand tapage cabalistique. Il fait une chaleur à crever dans le Jungle Room, mais dans les premiers rangs tout le monde saute et danse. C’est l’hystérie collective. Impossible de rester en place. Nos deux héros réveillent tous les bas instincts. Une fille essaie de baisser le calbut de King Khan. Le set prend des proportions orgiaques, c’est le paradis sur la terre, ces deux mecs dégoulinent de génie et on se goinfre de leur énergie. Quelle incroyable maîtrise de l’apocalypse !

King Khan reste concentré. On le voit passer ses accords avec soin et doubler au doo-bee-doo wha le chant magique de BBQ. On pense à un archer mongol en train d’ajuster sont tir, monté sur un cheval lancé au triple galop. Oui, King Khan a cette maîtrise. Quant à BBQ, c’est l’inverse, tout son corps bat le beat, la peau de grosse caisse rebondit en continu sous les coups de pédale, il gratte sa petite guitare comme un possédé et secoue violemment la tête pour lancer les cuts qu’il ne chante pas. Ces deux mecs sont dedans jusqu’au cou. Avec les Monsters, c’est que vous verrez de mieux aujourd’hui sur scène. Aucune trace de frime chez eux, au contraire, ils tournent tout le manège rock en dérision, et de ce fait, ils deviennent intouchables. Comme les Cramps, les Dolls et les Monsters, ils ont réussi l’exploit d’entrer dans la catégorie supérieure du rock, celle du Grand Guignol. Tout avait été dit et redit dans les sixties et les seventies, avec les Stones de Brian Jones, les Stooges de Ron Asheton, les Groovies de Roy Loney et Cyril Jordan, les early Who, Screamin’ Jay Hawkins, tous ces monstres sacrés mirent nos imaginaires à feu et à sang. Il fallait donc passer au stade supérieur. King Khan et BBQ n’ont certainement pas ce genre de prétention, mais ils passent de fait.

Signé : Cazengler, King Kon & BabaKool
The King Khan & BBQ Show. Wild And Crazy Cosmic Trip Festival. Bourges. 6 mai 2016
Spaceshits. Winter Dance Party. Sympathy For The Record Industry 1997
Spaceshits. Misbehavin’. Sympathy For The Record Industry 1999
The King Khan & BBQ Show. ST. Hazelwood Records 2005
The King Khan & BBQ Show. What’s For Dinner. In The Red Recordings 2006
The King Khan & BBQ Show. Invisible Girl. In The Red Recordings 2009
The King Khan & BBQ Show. Bad News Boys. In The Red Recordings 2015

TROYES – 14 / 03 / 16
BE BOP ROCKABILLY / PARTY 3
MISS VICTORIA CROWN
SOUTHERNERS / SPUNYBOYS

Vous n'y pouvez rien. Dans la vie, certains gars sont plus malins que d'autres. Penchons-nous avec une précision d'entomologie humaine aguerrie sur le cas de Billy. A priori, un rocker parmi tant d'autres, comme il en existe des milliers en France, des millions dans le monde. Oui, mais il a un truc. Pas en plume, en plus. L'organise des concerts de rockabilly. Un par an, pas plus, un sage qui a compris qu'en toutes choses la modération est un plaisir suprême.
Vous le plaignez, vous pensez aux groupes qu'il faut payer, à la salle qu'il faut louer, la Sacem à régler, la buvette qu'il faut tenir, les affiches et la pub à régenter... vous tremblez pour lui, vous vous demandez s'il rentrera dans ses frais, vous glissez son nom dans vos prières, vous brûlez un cierge à l'Eglise rien que pour lui. De bonnes intentions totalement inutiles. Billy, vous le faites rire, le cachet des musiciens, il en rigole, la salle il s'en moque, la buvette, il ne commande même pas une Orangina. Billy, lui ne s'occupe que de l'organisation. Vous ne comprenez pas.
Je vous explique. Non, ce n'est pas un esclavagiste qui fait bosser les copains gratos pour la cause. L'a juste un deal. Voici trois années la municipalité l'a contacté. Monsieur Billy, au secours, l'on est dans le caca jusqu'au cou, nous voulons organiser un spectacle de rockabilly, est-ce que vous accepteriez de nous aider, s'il vous plaît, nous aimerions que vous vous chargiez de la programmation. Et depuis trois ans, Billy vous offre un spectacle de rockabilly, clef en main. Qui ne lui coûte rien. Si ce n'est le plaisir de composer le programme.
Un véritable chef d'orchestre, des rockabilly bands Billy pourrait vous en citer trois centaines, sans prendre le temps de réfléchir, alors sa programmation il mijote aux petits oignons, l'a la patience d'un maître japonais d'Ikebana, l'on aimerait se promener dans ses neurones pour comprendre comment il mêle les senteurs et les épices, on rêverait qu'il nous invite à son Cat No Yu intérieur, cette variante typiquement rockab du Cha No Yu de l'Empire du Soleil Levant, on l'imagine tel Des Esseintes devant son orgue composant sa symphonie rock and roll pour le bien-être futur de notre humanité.
Cette année Billy nous a offert une composition pastorale, d'un doigté inimaginable, Victoria Crown, Southerners, Spunyboys, je pressens qu'un commentaire est nécessaire pour que vous vous hissiez à la subtilité de cette offrande : d'abord les jeunes pousses – vous noterez cette adresse diabolique qui met en premier le futur – en position médiane les racines originelles – notez ensuite cet honneur rendu aux vétérans à qui est dévolue la tâche de succéder à leurs successeurs, un renversement des valeurs dune témérité purement nietzschéenne – et en final, les plants robustes qui assurent la perpétuation de l'espèce – la présence confirmative de la stricte continuation, sur la plus haute marche du podium afin d'anticiper la survie de leur implication strictement immédiate. Billy nous a décliné l'éternité en mélangeant ses déclinaisons temporelles.
Béatrice ferme le 3B. L'est temps pour l'équipe habituelle, de se rendre au travers du vieux Troyes, en groupe, en ligue et en procession au lieu de recueillement adéquat, la Chapelle Argence. Waouh! Le style ! Vaste cour intérieure cernée d'une austère architecture, plus belle, plus grande, plus classe que la Place des Adieux de Napoléon du Château de Fontainebleau. Tout au fond, l'auvent vitré, avec le personnel qui vérifie les sacs des dames et vous palpe les poches au cas où vous cacheriez un dangereux terroriste sous le mouchoir. Sourire des hôtesses de la billetterie et les huissiers sérieux comme le premier moutardier du pape qui vous tamponnent le poignet avant de vous tenir les battants de la porte. Le grand luxe sécuritaire de notre frileuse société.
Rokers, teddies, bikers, près de trois cents amateurs s'entassent sur le devant de la vaste scène. Tout un manipule fait le siège de la buvette, trop tard Billy présente Miss Victoria Crown.
MISS VICTORIA CROWN

Pur mensonge. N'est pas là. Vous ne croyez tout de même pas que l'on va vous offrir la diva, comme cela, tout de go. Pour le moment, vous vous contenterez des boys. Pas longtemps, trente secondes le temps d'un générique et la voici qui se précipite dans sa robe de roses rouges rehaussées de son fond noir vers le micro. Un regard mathématique sur la réalité musicale ne saurait être une hérésie. Cinq sur scène, que vous disposerez en plusieurs sous-ensembles inclusifs : la vieille garde, Thierry aux drums et Vincent à la rythmique, les deux complices Nico et Zio au plus près l'un de l'autre, sourires complices échangés à tous moments, changez de braquet, Vincent, Thierry et Zio en arrière fond, et Victoria et Nico dans le médaillon en forme de coeur tout devant, gros plan sur Nico, Gretsch rouge et beauté de prince avec par éclair la mise en évidence d'une ressemblance persistante dans son évanescence avec l'Eddie Cochran romantique de certains shootings réalisés pour sa carrière cinématographique interrompue si brutalement, enfin focale toute sur Miss Victoria, reine de la fête.

Pratiquement deux ans que nous ne l'avions vue, l'a grandi, gagné en assurance, une aisance incroyable, enchaîne les morceaux avec une facilité déconcertante, ne passe plus en force comme quand elle avait à peine treize ans, se joue des difficultés, rebondit de swing en swing. C'est que les quatre gaillards derrière ne lui laissent aucun répit. Le son s'est rock and rollisé à mort, je désigne les fautifs de cette mutation : Zio et Nico. Zio qui slappe à mort, commence par installer son son de contrebasse si particulier, cette masse sonore qui vous enveloppe comme un rayon de lumière chaude et une fois que vous êtes englué dans ce bien-être d'abeilles vrombissantes, il lance la danse rythmique, accrochez-vous au petites branches, car c'est rapide, pas d'arrêt, point de ralentissements ni de brusques freinages, une espèce d'ouragan infini, quand il ne touche plus les cordes vous avez l'impression que le temps s'arrête que votre coeur est en suspend mais non, de deux grandes claques il vous redonne à profusion cet oxygène bondissant dont il vous a privé deux secondes.

Nico est au boulot. En quelque sorte tout repose sur lui, les autres tissent, lui il dessine les motifs. L'est le responsable de l'animation, quand un orchestre dégomme à fond, l'ennui et la monotonie peuvent survenir, tout devient question de doigté, c'est au guitariste d'insuffler la différence, de creuser et d'infléchir, de souligner et de rehausser le relief. Dispose de peu de temps mais il convient d'agir à bon escient, la patte de l'ours qui happe et arrache le poisson de l'onde écumeuse du torrent qui dévale le flanc de la montagne. Un travail d'orfèvre, peu d'espace entre le tempo de l'orchestre et la voix de Victoria, mais ces quelques secondes Nico sait les remplir judicieusement. Un style qui n'est pas sans rappeler les guitares crépitantes et entêtantes de Bill Haley. Toujours là, qu'il dessine le riff d'entrée ou qu'il intervienne en bref soli flamboyants, quelques notes, concises, mais d'une précision telles que vous vous dites que c'est exactement cela qu'il fallait, le lick qui tue, proprement et sans bavure, une maîtrise d'égorgeur professionnel qui vous saigne l'âme et vous entaille la gorge sans répandre une goutte de sang. Le plus terrible c'est quand on réalise sa jeunesse et qu'il a encore dans les mains une marge de progression infinie.

Vincent et Thierry sont comme en arrière, tous deux usent d'une même stratégie. Celle de la discrétion. Si vous n'y faites pas gaffe, ne sont pas du genre à s'imposer dans vos oreilles. Maintenant si vous êtes futé de la feuille, vous vous rendez vite compte de leur présence obsédante. Sont là, tout contre, comme ces serviteurs zélés dans les cocktails qui vous remplissent le verre sans que vous vous en aperceviez. Ne vous refilent pas du bas de gamme, le drummin' de Thierry vous martèle les tempes avec tant de précision que vous avez l'impression d'un massage thaïlandais, le genre de gars qui cogne en douceur et vous étend sur le plancher et vous croyez vous prélasser dans un édredon en plumes d'oie.

Quant à Vincent l'a opté pour la frénésie hypnotique, le regard du serpent qui vous endort malgré le sourire fourchu qui tressaute sur ses lèvres. Avec ces deux-là, la chanteuse est tranquille, le moindre cafouillage ressort de l'impossible.

Ce n'est pas poli, j'ai fait passer les messieurs d'abord, c'est que la demoiselle se défend très bien toute seule. N'a pas peur de s'attaquer aux icônes. Un peu de Brenda Lee, envoyé au saut du lit, et tout de suite un Jambalaya en guise de déjeuner, rythme et humour, vous en reprendrez une seconde assiette, mais un That's All Right qu'elle mitonne à sa manière, ni blues, ni rock mais très Crown, rapidité et facilité, un titre en français, L'Homme à la Moto ( de Leiber et Stoller ), préfère ne pas évoquer comment Zio et Nico vous font pétarader la Ducati, un superbe Three Steps To Heaven – à la demande spéciale de Billy – une belle version qui frôle la ballade country qui laisse présager que la voix de Miss Victoria s'en peut batifoler dans d'autres tessitures que celles dans lesquelles elle se complaît depuis ses débuts. D'ailleurs tout de suite elle retourne à un petit Boogie Woogie Bugle Boy des Andrews Sister et splank ! le piège se referme sur Nico qui adore sa guitare.

Exigé au micro pour chanter en duo, Jackson – c'est sur ce titre que Johnny Cash fit sa demande en mariage à June Carter – tout un symbole, dont notre couple se tire avec honneur, l'on remarque toutefois le soulagement de Nico dès qu'il a ses parties de guitare à assurer... Sur ce Victoria enchaîne un Folsom Prison Blues suivi d'un Rave On ravageur et du programmatique These Boots are Made For Walkin. Et la salle entière marche comme un seul homme. My Crazy Dream une des rares compos du set qui ne dépare pas l'ensemble, un Rollin' and Tumblin' bluesy à souhait et c'est la fin avec un Tainted Love qui emporte la foule et pour rappel un Great Balls of Fire tonitruant qui soulève l'enthousiasme général. Merci Jerry Lou. Victoire totale pour Victoria.
( Photos : Pascal Seher )

( Photos : Pascal Mitchellcity : Billy + Nico : )
THE SOUTHERNERS

Billy s'est fait plaisir. L'a invité sa jeunesse sur scène. Les Southerners qu'il suit depuis 1981. Ne calculez pas dans votre tête, vous vous feriez mal. La formation originelle. Les vétérans du rock, l'emploie même une appellation moins glorieuse, mais plus affectueuse, Billy, les papies du rock, qu'il répète par deux fois. Les Southerners n'en semblent guère offusqués, sont juste venus pour montrer ce qu'ils savent faire. N'ont pas endossé leur drape jacket de Teddy Boys, juste les tuniques rouges et bleues avec les étoiles du Sud. Nous apprécions les gens qui ne renient pas leur drapeau.

Vivi à la batterie, Michel à la rythmique sur votre gauche, Pascal en figure de proue très légèrement en avant, sa contrebasse en position très latérale, tout très près Thierry à la lead, un pas en retrait comme s'il ne voulait pas se montrer. N'ayez crainte, vous allez l'entendre. Rentrent dans le vif du sujet avec Eileen, tout de suite vous comprenez, Southerners c'est le teddy bop des teddies boys, cette pumpin' music qui se désarticule en quinze secondes, un squelette désossé et ricanant qui entrechoque ses côtelettes et vous entraîne dans une joyeuse danse macabre. C'est que le bop ne meurt jamais, l'est même le symbole de la survivance du rock and roll, le bop c'est le boogie qui se coupe en deux et qui miraculeusement à chaque coup de hache qui lui tranche la tête reprend miraculeusement vie, à chaque fois que vous y portez le coup mortel qui devrait définitivement l'achever il rebondit sur ses pieds et vous entraîne dans sa sarabande infinie.

Catapulte sur scène, P'tit Loup s'empare du micro. Les Southerners possèdent deux chanteurs. P'tit Loup est son propre clapper boy. Il chante, comme tout le monde en rugissant du gosier, mais aussi sans proférer une parole, lorsque Pascal s'empare du vocal. Pourrait en remontrer à bien des hip hoppers, lui, c'est l'homme élastique, s'écrase sur scène tel un avion qui rate son atterrissage, vous penseriez à appeler les pompiers, mais non, se relève je ne sais comment d'une étrange torsion reptatrice du torse, le voici sur pied six secondes, le temps de se cramponner au micro et de prendre des poses à la Gene Vincent, de véritables flashs mémoriels, mais déjà bondissant aux quatre coins de la scène.

Pink & Black un vieil hot dog brûlant de Sony Fisher, suivi d'un Hot Rod Man de Tex Rubinowitz, juste pour nous mettre en appétit. P'tit Loup nous avertit, un léger amuse-gueule pour nous mettre en bouche. L'on se demande comment ils vont pouvoir passer la vitesse supérieure au train où ils filent. Allongent le galop comme pour une chasse à courre au renard avec Tally Ho d' Ernie Nolwin, le bop boppe à rallonge, les Southerners nous emportent dans un raid à la Quantrill, une de ces chevauchées sans foi ni loi, qui forment l'ossature de tout western qui se respectent.

Ne vous ai encore rien dit de Pascal, de son chant. J'adore, vous prend un de ces airs patibulaires à vous faire creuser votre tombe pour y échapper. Hors-la-loi sans pitié, crache ses lyrics comme les colts des frères Jesse James leur plomb mortuaire. Frappe sur sa big mama comme s'il servait une mitrailleuse gatling gun, le rictus démoniaque de Lee Van Cleef sur son profil. Certains pensent que le rock and roll est une musique just for fun, cela se peut, je ne le nie pas, mais Pascal appuie là où ça fait mal, fait ressortir son vieux fond de méchanceté, son passé trouble et le monde de violence que fut la gestation de l'Amérique. Forme un couple terrible avec son comparse P'tit Loup. Pascal le méchant, P'tit Loup le truand, un gangster qui vous escamote vos royalties sans que vous y preniez garde, le gars qui bouge tellement bien qu'il emporte vos dernières illusions, non jamais vous n'atteindrez à cette féline souplesse de mouvement ni à la justesse de ce chant qui tombe à pic, comme un coup de pioche dans vos oreilles et qui vous déchire le tympan.

Ne vous affolez pas le Bon n'est pas loin. Virtuose de la guitare. Thierry, vous abat un travail de titan, faut entendre son engin couiner, saute de note en note comme un kangourou géant, vous construit des lignes harmoniques à vous arracher les amygdales, l'explore des sentiers inouïs, fait tinter les grelots du rockabilly comme jamais. Parfois il court rejoindre Michel et les voici face à face, le temps de se rendre compte de l'assise rythmique octroyée par l'ondoyante Fender de Michel infatigable.

Maintenant faut avouer qu'il n'y aurait pas de bop sans batterie et Vivi nous colle sur ses drums un hachis de tambourinade à faire frémir les murs.

P'tit Loup nous prévient. Vous n'allez peut-être pas apprécier le morceau suivant. Sait parfaitement que dans la salle se trouvent un maximum de puristes. Mais qui oserait ne pas aimer Eric Burdon. Pleuvent les premiers accords bluesy de The House of the Rising Sun, la voix profonde de P'tit Loup subjugue l'assistance et tout à coup le standard part en live, boppé à mort, survitaminé à la dynamite. Une version ultra speedée, durant laquelle le soleil n'aura jamais le temps de se lever sur les décombres de nos jours.

C'est la fin, l'apothéose, le tohu-bohu, Pascal rejoint le public avec sa contrebasse, pour suivre P'tit Loup lui aussi sorti du bois qui s'en vient hurler à la lune noire du rockabilly parmi l'assistance en délire. Un Motorbike à fond la caisse, un Rockabilly Rebel repris par tout le monde et deux Burnette pour finir en beauté, un Tear it Up à verser des larmes de sang et un Train Kept A Rollin' qui nous emporte dans les affres bestiales du délirium tremens. Les papies du rock nous ont mis à genoux. Ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de les voir, se demandent s'ils ne viennent pas de rêver.

( Photos : Sergio Kazh )
SPUNYBOYS

Trois tout seuls sur la vaste scène. Ne rutilent guère avec leurs instruments blancs et leurs chemises marron clair. Sacrée gageure que de passer après les Southerners. N'ont pas l'air émus. Sont sûrs d'eux. Juste le temps de prendre la mesure de la grande scène, un plaisir pour nous de les voir ainsi et non dans l'enclos restreint d'un café. Ça change tout. D'un coup l'on se croirait à Vienne, aux temps de l'Empire autrichien, Rémi s'est saisi de sa big mama et lui fait traverser la scène comme s'il ouvrait le bal avec, lovée dans ses bras, une chaste princesse tourbillonnante dans son ivoirine robe d'opaline emportée sur les sentiers de la perdition charnelle dans l'enivrement méphistophélesque d'une valse diabolique.

Les Spuny nous la jouent subtil. Les trois pointes du rockabilly – aussi acérées que le trident de Poseidon – alliée à la fragmentaire syncope de la rythmique Ted. Bien sûr cette dernière s'accélère à volonté, pouvez passer par les différentes étapes, transique, extatique, hypnagogique, mais les Spuny ont aussi une autre tactique, manient la syncope comme un alexandrin, ne coupent pas à répétition au milieu de la divine césure aussi attendue que l'omnibus de 16 heures 05, préfèrent démantibuler, plier en les charnières les mieux inconvenues, pianoter forte sur des cahin-caha distordus, découper des patterns sémantiques réputés insécables, bref laisser grand ouvertes les portes à l' inspiration du moment. Genre de fantaisie que vous ne vous permettez que si vous dominez parfaitement votre instrument. Peut-être pour signifier cela, Rémi se perche-t-il au sommet de sa contrebasse. Joue à l'ibis en équilibre sur sa seule patte, la slappe comme le pivert entêté, ou tournoie sur lui-même comme un vol d'hirondelles autour de la manche d'un épouvantail... Mais non, ne confondez point le jeu avec les amusements, la musique avec le show, même si tous deux sont indissociables et chacun nécessaire à l'autre.

La largeur de l'estrade permet d'isoler chacun de nos mousquetaires. Ne sont pas quatre, ce dernier serait totalement inutile, et puis chacun joue si serré que l'on se demande où il pourrait caser la moindre note. Au centre Guillaume officie, batterie sur piédestal, le roi sur son trône. Un drummin' prononcé et racé. Ne tient pas le rythme, construit une armature symphonique, englobe la production de ses partenaires, leur construit des caisses de résonance, des cages d'or massif ou d'osier tressé et torsadé. Les morceaux défilent, mais il semble n'en tenir aucun compte, comme s'il composait ses propres séquences autonomes. Bien sûr il leur forge des écrins d'orichalque usinés au micron près, mais sa frappe déborde, comme s'il donnait un véritable concert, avec mouvements andante peligroso époustouflants. Faut appréhender cette beauté physique de la frappe, l'est tapi derrière ses fûts et brusquement il surgit, requin qui troue la surface des vagues pour s'emparer de sa proie, et le voici, s'écroulant sur ses caisses les bras en croix pour arrêter le grondement métallique de ses cymbales. L'éclairagiste a compris, à chaque fois il darde notre drummer d'un spot blanc illuminescent qui accentue l'aspect prédateur de son affalement de squale affamé.

Eddie ne reste pas dans son coin, vient souvent se planter au milieu du plateau, à l'intersection des diagonales sonores, encore un sacré musicien. Ne me dites pas qu'il joue de la guitare, non il s'exprime, il compose du son. Un jeu étonnamment moderne, l'a décomposé la musique en deux plots d'égales intensité, la note et le silence. Le tout est de les rapprocher au maximum, faire en sorte que ne subsiste entre eux que le minimum d'espace. Un jeu en quelque sorte quantique, ne trace point une ligne mélodique, détermine des éminences de sons qui fusent comme d'eux-mêmes, ne prend jamais le temps de leur laisser achever leur courbe descendante. Le tigre qui saute dans le cercle enflammé que tient le dompteur c'est celui-la qui vous intéresse, pas le précédent qui a fini son exercice et qui rejoint son tabouret. Eddie dévore l'espace qui sépare et relie le bruit au silence. Les oreilles distraites ne savent différencier en musique l'espace du silence, l'est étonnant que ce soit un musicien de rockabilly – cette musique par excellence si fruste ( sic ) - qui entreprend cette démarche expérimentale que l'on pourrait qualifier de bruitiste, si l'on part du principe que le bruit inharmonique est la matière brute de toute musique. Pendant que Rémi s'en ira batifoler dans la salle, je garderai toujours un oeil sur Rémi et une esgourde sur Guillaume, ces deux lascars se livrent à une joute contrapuntique des plus fraternelles. La règle est d'une simplicité absolue et d'une efficience titanesque, s'agit de ne laisser à l'autre que le minimum vital d'expression. Non pas dans le but stupide de se pavaner en première ligne pour écraser le copain mais pour lui donner la possibilité de s'emparer avec d'autant plus de force de la moindre parcelle de temps libre. C'est pour cela que la musique des Spunyboys possède cette efficacité meurtrière qui reste leur marque de fabrique.

Ne pensez pas que Rémi, se contente de passer le sel ou de saupoudrer le sucre sur les crêpes. Hormis le fait que sa contrebasse se paie le luxe de monter au plafond de temps en temps, elle a sacré un boulot à effectuer la big mama. N'est pas à la maison de retraite. Sert de contrechant à la voix de Rémi – elle, dans sa robe blanche, apporte le fluide noir d'un son polylithique, qui s'insinue dans le phrasé de son maître. Rémi tire les cordes et s'en détachent comme des tentacules polyrithmiques qui viennent s'entrecroiser avec sa voix. Une flexion de plus en plus assurée, distincte, qui ne mâchouille pas de l'american chewing-gum. Apporte une clarté irrévérencieuse dans les lyrics, détache les mots comme des balles de fusil. Tireur d'élite qui place à tous les coups dans le coeur de la cible, en plein milieu de la tonitruance des deux acolytes. L'amène par un jeu plus élastique, le liant nécessaire à l'éclosion du groove. C'est qu'un rockab qui oublierait de swinguer se pétrifie très vite dans l'ennui des immobilités stériles, des lenteurs d'escargots paresseux. Les Spuny sont devenus une terrible machine de précision, chacun semble tirer à hue et à dia dans son coin, mais leur musique se déplace à une vitesse indépassable. Ne visent pas la célérité en elle-même pour elle-même, c'est la cohérence de leur démarche qui produit cette sensation de catapulte énergisante. Vous décrassent le répertoire, révisent le turbo et vous requinque le rockab comme personne d'autres. Respect aux vieux hits d'autrefois, mais avec un carénage qui ne s'interdit pas les fulgurances d'aujourd'hui.

Billy a bien intuité son programme. L'a tout compris. Rémi en rajoute une couche, Rockers, Bikers et Teddies, trois musiques différentes, mais un seul rock and roll. Après le rappel, les Boys offrent encore un étourdissant et érotikon Going Home de Gene Vincent, qui introduisit le rock and roll en douce France. Un bel hommage pour un groupe qui commence à entrevoir une notoriété européenne.

Une soirée heureuse. Trois groupes valeureux, trois cents participants, tout le monde repart content. Plus rien à ajouter. Si le meilleur pour la fin. Merci Billy.
( Photos : Lolo Fiore )
Damie Chad.
THE DISTANCE

in ROCKHARD N° 165
( Mai 2016 )
Cette notule pour signaler les deux pleines pages consacrées par RockHard à The Distance, ce groupe que nous avions tant aimé à Roissy-en-Brie à la fin du mois de mars dernier ( voir KT'TNT ! 275 du 31 / 03 / 2016 ). Vous n'oublierez pas non plus la kro de leur dernier CD Radio Bad Receiverde Charlélie Arnaud en fin de numéro. Une belle interview de Mike ( guitare et chant ) par Charlélie Arnaud qui permet de revisiter le parcours du groupe depuis sa fondation.
Mike insiste sur ses origines prédilictive grunge, tout en étant très conscient – et en cela il rejoint l'analyse de son interviewer – de la caractéristique du son du groupe. Une subtile alchimie entre le grunge, hardrock et rock. Mais je ne déflorerai pas davantage la teneur des propos échangés, vous laisse découvrir le plaisir addictif de découvrir par vous-même.
Ce qui est sûr, c'est que The Distance est un groupe à surveiller. A ne pas quitter du coin de vos deux yeux. Ces gars-là ont l'intelligence du rock and roll dans la peau. Promettent beaucoup mais ont déjà donné des preuves suffisantes de leur inscription dans le futur du rock. A suivre intensément.
Damie Chad.
BETH DITTO
DIAMANT BRUT
( Michel Jalon / 2012 )
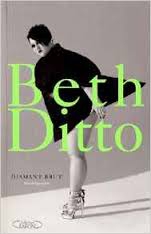
Rencontre de poids dans le bac à soldes. Le nom me disait vaguelettement quelque chose. Avais déjà croisé ce nom, quelque part, il y a longtemps, peut-être dans la rubrique télégrammes de Rock & Folk. Gossip, oui c'est cela, pour être franc à part les Gossips de Stéphane Mallarmé présentés par Lloyd James Austin, je ne connaissais rien d'autre. J'ai suffoqué de honte en lisant le dos de la couverture, groupe punk américain, j'étais au-dessous de tout. Comment un trou encore plus grand que celui de la couche d'ozone dans ma culture rock ? j'ai rougi comme une jeune mariée s'apprêtant à passer le seuil de la chambre nuptiale, de retour à la maison me suis précipité sur You Tube pour combler la faille incommensurable de mon ignorance.
Punk, je veux bien, mais si vous désirez ma pensée profonde, je classerais cela dans la série pseudo ersatz de R'n'B, jolie voix de fille sur un accompagnement binaire des plus primaires, guitare + batterie, pas de cuivre... mouais c'est du rock. Pour les premières communiantes, qui n'ont jamais quitté le couvent. Et qui dorment en chambres séparées pour ne pas céder aux tentations saphiques. J'allais passer outre, j'ai ouvert le titre au hasard, page 29, et j'ai tout de suite été happé par la première phrase : « Quand on a l'accent du Sud, il est difficile de prononcer quoi que ce soit en une seule syllabe. » Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai tout de suite compris que je plongeais au coeur de l'Amérique Profonde. Pour être très précis dans un roman de William Faulkner ou d'Erskine Caldwell.

Beth Ditto est née en 1981 en Arkansas. Autant dire le trou du cul du monde. En deux siècles d'existence, à part Johnny Cash, l'état n'a jamais rien produit de bon. Mentalité réactionnaire, arriérée, conservatrice et rétrograde. Dans les années soixante les jeunes se cachaient au fond des bois pour écouter des disques de rock et danser. Deux genres d'activité hautement répréhensibles. Dernier détail d'importance, une chape de plomb religieuse imprègne les consciences. Puritanisme obscurantiste obsédant...
N'a pas choisi la bonne famille non plus, la petite Beth. Foyer éclaté et dissocié. La mère collectionne amants de passage et ponte régulière d'enfants. Ne critiquez pas, c'est la règle communautaire du quart-monde. On copule sans pilule et ça pullule. Les dames accueillent les compagnons de passage et n'ont pas le temps de s'occuper des mioches. On s'en débarrasse en les confiant à la tante, à le grande soeur, à la grand-mère. Les gamins dorment au mieux sur les divans de la salle de séjour, au pire sur le plancher. Les oncles sont libidineux et s'occupent très activement de l'éducation des petites filles et des adolescentes. Ne vous inquiétez pas pour les petits garçons les grands frères ou les cousins se chargent des initiations. Un peu gênant, mais c'est ainsi depuis des générations. Ne vous plaignez pas, la justice se retournera contre vous. Les psychologues appellent cela la théorie de la patate chaude – ici elles sont brûlantes - vous transmettez à votre progéniture ce que vous-même avez subi. Dans la nature rien ne se perd. Tout se conserve. Surtout les mauvaises habitudes.
Beth n'a pas de chambre à elle, ni de lit, ni d'habits personnels sinon un vieux T-shirt. Mais ce n'est pas ce qui lui manque le plus. Son problème c'est la privation d'affection. Se raccroche comme elle peut à sa mère et à sa tante enfermées dans leurs propres pathologies affectives et narcissiques. Alors elle comble le vide, avec ce qu'elle trouve. Chez maman pas grand-chose à se mettre sous la dent, chez la tantine des paquets de gâteaux à foison, mauvaise bouffe à bon marché dont elle se goinfre. N'aura jamais la taille mannequin.
Des rondeurs enveloppantes. La grasse du parfait boudin. Situation idéale pour se faire rejeter par les élèves à l'école, au collège, au lycée. La solitude est une armure qui vous rend plus fort. Elle aiguise votre lucidité et développe votre sens critique. L'on prend le temps pour choisir ses amis. L'on développe un sixième sens qui permet de voir au-delà de l'écorce du paraître. Mais c'est au contact des autres que l'on apprend à se connaître soi-même. Beth tâtonnera, son petit ami Anthony est gentil, mais on est loin de la fureur amoureuse, quand son amie Jennifer lui révèle que son copain Jeri ne met aucune ardeur à l'embrasser, elle prend toute la mesure de sa propre homosexualité. Lui faudra encore du temps avant de passer à l'acte.
L'est autre chose qui vient de rentrer en elle. La musique. L'a toujours aimé chanter. Avec Anthony elle monte le groupe Little Miss Muffet. Ne restera pas dans les anales, mais cette expérience lui permet de rencontrer ceux qu'elle appellera sa deuxième famille : Jeri, Kathy, Nathan et Jennifer qui s'éloignera doucement... Au fin fond de l'Arkansas, le rock est une denrée rare, Beth suit l'actualité musicale avec quelques années de décalage, elle qui était fan de Mélanie et de Mama Cass se met au Grunge grâce à Nirvana et devient fan du mouvement Riot Grrrls ( voir KR'TNT ! 277 du 14 / 04 / 2016 ). Cette rencontre idéologique sera déterminante pour Beth, aura le féminisme chevillée au corps, n'aura plus honte de son obésité, s'accepte comme elle est et devient vis-à-vis du monde très vindicative. La meilleure des défenses reste encore l'attaque.
Kathy a choisi son université : à Olympia, dans l'état de Washington, la ville d'éclosion du mouvement Riot Grrrl et du label Kill Rock Stars. Un an plus tard ils sont tous les quatre réunis dans cette ville qui leur paraît mirifique. De jeunes punks traînent un peu partout, lors d'une soirée elle rencontre Tobi Vail des Bikini Kill et ancienne compagne de Kurt Cobain, saine émulation qui les emmène à créer Gossip. Le groupe fait ses concerts sur la région d'Olympia et serait probablement restée inconnue si la chance ne s'était manifestée. Carrie Brownstein de Sleater-Kinney les invite en tournée avec eux.
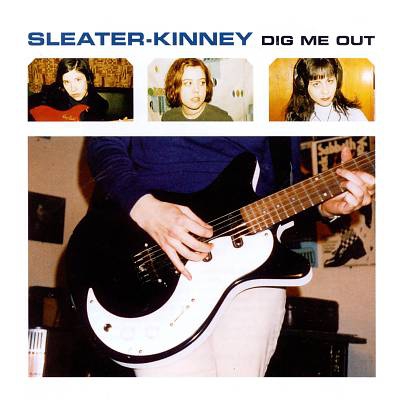
Sleater-Kinney est un groupe de la mouvance Riot Grrrls, trois beaux brins de filles, accrochées aux ferments des idéologies libertaires du punk, qui décline un rock pop propre sur lui, un peu châtré de toute virile violence, bien envoyé, bien balancé, mais tout de même dépourvu de tout vertige suicidaire. Le chaînon manquant qui nous explique pourquoi Gossip pourra se revendiquer de l'étiquette punk. Gossip a la surprise de tourner devant des publics de 2000 à 3000 personnes. Expérience irremplaçable. La petite Beth se révèle être un gros animal de scène.
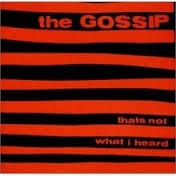
Le conte de fée ne s'arrête pas là : Kill Rock Stars ( KRS ) leur propose d'enregistrer un album et les aiguille sur l'agent qui s'occupe des tournées de Sonic Youth et de Sleater-Kinney. Ont bien vécu, se sont bien amusés, mais le retour à la maison est moins glorieux. Survivent à Olympia en travaillant dans des magasins de fringues ou la restauration. Jobs précaires qui ne rapportent guère.

Le second album Movement permettra à Gossip de tourner en Ecosse. Gossip se retrouve à Portland, une grande ville d'Oregon. C'est le retour du bâton pour Beth, tous les manques de l'enfance refont surface, les paillettes du rock ne cachent pas tout. Dépression, mutilation. Elle en arrive même à ne plus peser que soixante-cinq kilos, elle qui voisinait avec le quintal. Son état catatonique empire et nécessite une hospitalisation. S'en remettra. Kathy quitte le combo en 2005. Gossip change de direction, le groupe se professionnalise. Le nouvel opus Standing In The way of Control entre dans les charts...

ACCEPTATION
L'autobiographie ne va guère plus loin. Le groupe continuera de tourner un peu partout aux USA et en Europe. Les succès s'enchaînent... une pop de plus en plus sucrée. Ditto annoncera son arrêt en février 2016. L'a d'autres centres d'intérêt. Après tout elle n'est qu'une femme. Attirée par les fanfreluches et obnubilée par le rayonnement de son apparence physique. Pose nue sur les couvertures des magazine de mode, crée sa marque de prêt-à-porter, sa gamme de maquillage, fournit des musiques à Dior, collabore avec Jean-Paul Gaultier... un drôle de chemin, du grunge au capitalisme. Précipite-toi compagnonne, le vieux monde est devant toi. L'était une chanteuse, l'est devenue un produit. L'a son créneau commercial.

Le discours féministe recyclé à l'encan de l'artifice modal. Tout se vend puisque tout s'achète. Une bonne fille, l'a offert un super mobil-home à sa maman, l'est marraine d'une association pour les petites filles malheureuses, décomplexe toutes les grosses nanas, s'est mariée avec sa copine, est devenue un segment de ce discours politiquement correct totalement insupportable... Fillettes, arrêtez de vous plaindre, Beth est la preuve incontournable qu'avec un peu de ténacité, toute une chacune parvient à surmonter ses handicaps... Jeu publicitaire très subtil, l'a été modelée en reine de laideur. Elle est la belle et la Beth en même temps. Deux femmes objets pour le prix d'une. Parfait exemple des dérives individualistes du mouvement Riot Grrrls...

C'est fou comme la société post-industrielle parvient à récupérer ses propres déchets sociaux et à vous les transformer en articles de consommation courante à l'usage des masses décérébrées. Dans le film Soleil Vert on donnait les morts à manger aux vivants, aujourd'hui vous achetez la révolte en barquettes rockcocalatées aseptisées, inoffensif pour le système, mais conséquences dévastatrices sur le cerveau : vous persuade que vous valez autant que votre reflet que vous apercevez dans le miroir de votre chambre d'ado et dans les écrans complaisant du marketing. Comme tout le reste, le rock peut devenir un produit édulcoré, et même une marchandise aux effets édulcorants. Kill the rock stars si vous voulez, mais ne les remplacez pas par une armée de clones pailletés.
N'y a plus qu'un maigre espoir. Qu'un jour la Beth se réveille.
Damie Chad.
15:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : the king khan show & bbq show, miss victoria crown, the southerners, spunyboys, the distance, beth ditto


