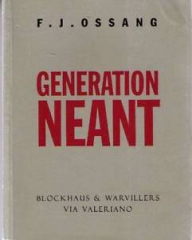18/11/2015
KR'TNT ! ¤ 256 : EAGLES OF DEATH METAL / L7 / HOT SLAP / BLUE TEARS TRIO / SPUNYBOYS /OL' BRY / F. J. OSSANG / VINYLS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 256
A ROCK LIT PRODUCTION
19 / 11 / 2015
|
EAGLES OF DEATH METAL L7 / HOT SLAP / SPUNYBOYS / OL' BRY / F.J. OSSANG / VINYLS |
C'est une ancienne kronic de l'ami Cat Zengler qui date du 18 juin 2015 parue dans la deux cent quarantième livraison de KR'TNT ! Pas besoin d'expliquer pour quelle raison nous la remettons en ligne cette semaine. Il semble que dans notre monde le rock and roll dérange encore. Etrange force symbolique de cette musique qui est aussi un art de vivre et de résistance ! Cette livraison 256 est dédiée à tous ceux qui n'assisteront plus à un concert.
LE TRIANON - PARIS 18° - 09 / 06 / 2015
EAGLES OF DEATH METAL
LES AVENTURES DE
BOOTS ELECTRIC ET DE BABY DUCK
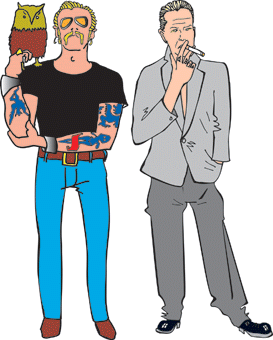
Boots Electric se recoiffe d’un coup de peigne vers l’arrière du crâne. Quelle étuve !
— Bonsoâr paris ! Don’t you know ? I loooooove you !
Boots Electric roule un énorme pelle au public.
— Hey Paris, tu veux danser avec Boots Electric ? Alors, enlève ton blouson et rejoins-moi sur la piste !
Quel héros fantastique ! Boots Electric est le Travolta du rock moderne, un tortilleur de cul coiffé comme un greaser et tatoué comme un taulard. Il porte la moustache en croc du docker et les Ray-ban oranges de Peter Fonda dans «Easy Rider». Son costume de scène ? Marcel, jean moulant délavé, bretelles et santiags des bars interlopes. Il plaque en prime des power-chords sur sa grosse guitare blanche, comme Sylvain Sylvain jadis au temps béni des Dolls. Boots Electric ? Pur rock’n’roll animal. Aussi racé et ambigu que pouvait l’être Lou Reed en 1967 - waiting for my man/ twenty-six dollars in my hand.
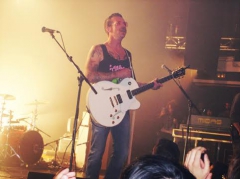
— I came to LA to make rock n roll !
Wow ! Le plancher de la salle du Trianon se met à onduler. Paris saute en l’air.
— Along the way I had to sell my soul !
On se croirait dans l’océan en pleine tempête. Les cœurs chavirent ! Paris tombe sous le charme fatal de Boots Electric. Eh oui, ma poule, tu vois bien que c’est du cock-rock.
— I made some good friends that make me say/ I really wanna be in LA.
Tempête ? Fête païenne ? Rituel antique ? Émeute urbaine ? C’est tout cela à la fois. Et même beaucoup plus car derrière Boots Electric, Baby Duck bat le beat du marteau-pilon. Coiffé comme un G.I. en partance pour le Mékong, il frappe le menton en avant, en pur idéaliste de l’extrémisme. Il redouble de violence tribale. Il frappe comme un damné. Il veut sonner comme ces terribles batteurs de cadences des galères de l’antiquité. Il s’agit cette fois non pas de couler la flotte perse à Salamine, mais de prendre Paris d’assaut. Tu veux du beat, Paris ? Baaaam ! Écarte les cuisses, Paris ! Baby Duck redouble de violence. Et comme il ne parvient toujours pas à écrouler les colonnes du temple, un séide vient battre à côté de lui. Double dose de beat turgescent ! Des poules se pâment ici et là ! D’incroyables brunes en lunettes noires et jeans taille basse ondulent au balcon. Babylone, baby ! Babylone’s burning !
— I take the city in the dead of the night.

Pendant que Baby Duck met Paris à genoux, l’énorme Darlin’ Dave Catching roule ses riffs dans une stupéfiante mélasse gluante de distorse. Cet ogre au crâne luisant porte une barbe blanche de Père Noël et une grosse chemise à carreaux de bûcheron canadien. Il joue sur une Flyin’ G et sort un son mirobolant. Il connaît tous les secrets des coups de hanche et sait esquisser à la perfection les pas du desperado. Paris voit bouger l’ogre sur scène et n’en revient pas d’assister au spectacle d’une telle classe. L’ogre monte au micro comme s’il montait à l’assaut d’un rempart et bave ses chœurs avec la mine contrite d’un Saint-Sébastien percé de flèches.
— I’m burning gas until I feel alright.
Et Paris danse ! Paris chavire. Paris tangue. Paris chancelle. Paris adore. Boots Electric galvanise Paris. Il l’emmène danser la farandole sous la boule à miroirs d’un temple imaginaire. Alors Paris ne résiste plus. Paris se livre. Paris s’enivre. Paris se désinhibe. Paris bascule dans l’autre camp. Paris découvre la vraie vie.
— Clowns to the left of me, jokers to the right.

Boots Electric pose sa guitare pour danser. Paris lui tend les bras. Danse avec moi ! Boots Electric travolte et virevolte. Il chaloupe et offre son cul à Paris. Shake your booty ! Il vire tout le pathos du rock. T’es viré le pathos ! Seule compte la rigolade. On est là pour prendre du bon temps, pas vrai les gars ? Sex and drugs and rock’n’roll ! Alors danse Paris, danse ! Et Paris redanse de plus belle. Paris n’avait plus dansé comme ça depuis quand ?
— Here I am, stuck in the metal with you !
Ça tourne à la carmagnole du diable. Au grand carrousel de la fin du monde. Ça saute toujours plus haut. Paris rebondit sur un plancher qui menace de céder. Dance Kalinda boum ! Dance to the Music ! Dancing with the Eagles of Death Metal ! Dancing the night away ! Dancing with myself ! Le tumulte bat son plein. Boots Electric mène la danse. De l’autre côté de la scène, le bassman McJunkins devient fou. Il court en tous sens, le visage noyé dans ses mèches de cheveux. Le beat l’emporte, il en est à la fois l’acteur et la proie. Cruel destin !
— Just make believe.
Le pauvre Trianon n’avait pas vu un tel ramshackle depuis belle lurette. Paris transpire à grosses gouttes. Des femmes galbées comme des amphores hantent le bar. Boots Electric n’en finit plus d’allumer Paris. Il est à la fois Joel Grey, le Maître de Cérémonie de «Cabaret» et Roy Sheider, le chorégraphe de «All That Jazz», deux coups de Jarnac signés Bob Fosse. Il est aussi le Chaucer Pasolini des «Contes de Canterbury» et le trafiquant Fassbinder du «Le Mariage de Maria Braun». Boots Electric ? Entertainer number one, baby ! Grand-prêtre du rigodon. Meneur de sabbat. Grand ordonnateur des danses de Saint-Guy. Matelot échappé d’un chapitre de «Querelle de Brest» de Jean Genet. Transfuge des Village People passé au meilleur rock d’Amérique. Clin d’œil à deux pattes et incarnation des vieux mythes patiemment dépouillés par Jean Cocteau. Boots Electric injecte dans le gros cul de Paris un énorme shoot de modernité, tellement énorme que ça vire instantanément au classicisme. Il se dégage du set un mélange de déjà-vu et de nouveauté, capiteux mélange qui caractérisait déjà les sets et les disques des Queens Of The Stone Age, l’autre mamelle de cette fascinante scène californienne. Eagles Of Death Metal ? Baby Duck déborde d’imagination. Il sait trouver LE nom qui sonne bien. Au temps de la rue Keller, on entendait l’album «Death By Sexy» tourner en boucle chez Born Bad. Et pour cause. Cet album fonctionne comme un traquenard. On s’y gave de chant tremblé monté sur des gros romps d’accords vénaux. Boots Electric et Baby Duck y bardent un «Don’t Speak» d’accords pompés dans le premier album de Black Sabbath et posent par dessus un chant maniéré jusqu’à la nausée. Il traitent «Shasta Beast» au petit falsetto de proximité et jouent avec la perversité comme d’autres jouent avec le feu. Et puis il faut entendre au moins une fois dans sa vie cet étonnant «Nasty Notion», pris au chat perché de velours, encore une jolie pièce de rock interlope qui se glisse entre deux genres avec l’horrible aisance visqueuse d’une anguille.

Leur premier album s’appelait «Peace Love & Metal». Ils jouaient déjà la carte de la provocation et truffaient leur heavy-glam de viande rouge. Dès «I Only Want You», on sentait l’odeur de l’album classique, avec ce ramassis d’accords secs et de soupirs indignes de la morale chrétienne. Ils se montraient experts dans la pratique des petits beats comprimés, ceux qu’affectionnaient particulièrement tous les pauvres hères de la scène post-punk des années quatre-vingt. Boots et Baby Duck revenaient aussi vite que possible aux bons beats râblés et livraient avec «So Easy» une sorte de glam à l’esprit de Seltz. Et Baby Duck nous battait tout ça au tribal amérindien. Avec «English Girls», ils proposaient ce qu’il faut bien appeler un classical Eagles Death-Metaller chanté à la gnognote dépravée. C’est sur cet album qu’on trouve l’irrésistible reprise du «Stuck In The Middle With You» de Stealers Wheel, avec un Middle transformé en Metal. Mais c’est «Already Died» qui nous sonnait vraiment les cloches. Il s’agissait là d’un cut effarant d’ingéniosité sonique, emmené au miel de chant et porté aux nues par une distorse panaméenne. Ils nous emmenaient là dans leur logique de l’isthme, la fine langue de terre qui sépare deux océans. D’un côté l’océan classique et de l’autre la modernité. Ces deux farfouilleurs de génie allaient puiser aux racines du blues en chantant comme le fantôme de Marc Bolan.

Leur troisième album plonge encore plus profondément dans le spongieux de la consanguinité. «Heart On» restera dans l’histoire du rock pour un cut intitulé «How Can A Man With So Many Friends Feel So All Alone». Le velouté du chant insidieux s’y élève au rang d’œuvre d’art. On songe immédiatement aux grandes heures de Jack Bruce dans «Disraeli Gears». Peu de gens osent s’aventurer dans une telle direction. Baby Duck y atteint la pure excellence harmonique de tremblé psyché. Il flirte avec le génie - Left with nothing at all. Les autres gros cuts de l’album sont «Pussy Prancin’», chanté au mitoyen pervers de voix humides et «I’m Your Torpedo», un joli stomper du bout de la nuit battu au tribal et chanté à l’ambivalence. On y retrouve tout ce qu’on aime, le soin du son, l’impact de l’idée, le fléchage du talent et le don du dedans.
Signé : Cazengler, Eagle of Death Mental
Eagles Of Death Metal. Le Trianon. Paris XVIIIe. 9 juin 2015
Eagles Of Death Metal. Peace Love & Metal. AntAcidAudio 2004
Eagles Of Death Metal. Death By Sexy. Downtown Music 2006
Eagles Of Death Metal. Heart On. Ipecac Recordings 2008
Le Bataclan fut une salle magique. J’y mis les pieds la première fois en 1977 pour le concert qu’on peut bien qualifier d’historique des Heartbreakers. Et la dernière fois, pour le fantastique concert des L7. Maintenant, c’est devenu un lieu de mort. On chiale en pensant à tous ces pauvres gens fauchés comme les blés. Les concerts de rock avaient un caractère sacré. Rien ne sera plus jamais comme avant.
BATACLAN / PARIS XI / 17 – 06 - 2015
A L'ENFER DU PARADIS ( avec L7 )

Un Bataclan plein à craquer. Paris est venu fêter le retour des Californiennes. Autant dire qu’il règne dans cette salle au passé chargé une ambiance exceptionnelle. On sent un public venu chercher sa dose, comme au bon vieux temps des grands concerts. Finalement, rien n’a changé, l’électricité dans l’air reste la même qu’au temps des concerts de Captain Beefheart à Bornemouth, des Pink Fairies à Londres ou des Heartbreakers au Bataclan. Let’s go where the action is, comme dirait un compilateur chez Kent. Une ovation les salue quand elles arrivent sur scène.
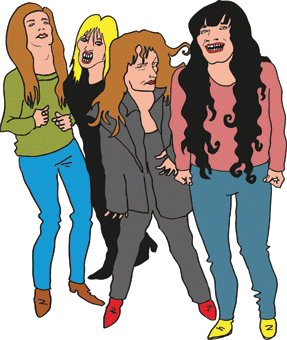
Suzi Gardner, habillée en noir et coiffée d’un stetson noir salue Paris. Jennifer Finch s’est teint les cheveux en rouge. Elle passe une basse aérodynamique en bandoulière. Dee Plakas prend place sur son estrade et voilà qu’arrive Donita Sparks, fine et blonde, vêtue d’un gilet noir et d’un jean vert d’eau. Elle brandit une Flying V. On sent que ça va barder. Voilà encore l’un de ces petits rock’n’roll animals dont l’Amérique est si prodigue. Et bam, «Deathwish» tombe sur la foule comme l’une des sept plaies d’Égypte. Le son est là, immédiatement. On sent les vétérantes de toutes les guerres et bien sûr de toutes les polémiques. Elles sonnent merveilleusement bien les cloches. Elles font leur numéro de cirque et ça gigote dans la fosse. Il règne dans l’étuve du Bataclan une atmosphère de rêve. Des punks s’embrassent sur la bouche et des gamines sautillent comme des zébulons. Suzi, Donita et Jennifer chantent à tour de rôle, mais Donita reste la patronne. Entre deux cuts, elle s’arrose les cheveux. Les filles enfilent les hits comme des perles, «I Need» avec ses petits chœurs pevers, «Shove» et le bombast de «Shitlist», tout y passe. Ces morceaux datent de vingt ans et ils gardent tout leur jus. En attendant un peu après le concert, on verra les filles sortir une par une pour rejoindre le bus garé devant la salle. Et comme c’est d’usage, elles se prêteront au petit jeu des photos avec les fans. Quand on approche Donita Sparks de près, on est frappé par sa classe. Elle incarne l’Américaine de rêve au regard clair et à la voix cassée. On voit sa dent en or et son sourire carnassier. D’évidence, elle ne fait pas semblant. Tout en elle n’est que rock’n’roll, avec ce léger soupçon de démesure qui caractérise si bien les rockers américains.

Leur premier album paru en 1988 sur Epitah fit illusion le temps de deux morceaux. À commencer par «Bite The Wax Tadpole», doté d’un très gros son. On voit rapidement sourdre des idées, comme cette queue de solo à l’étranglée qui troue le mur du son, suivi plus loin d’un autre encore plus atrophié et qui semble couler comme un filet d’acide dans la raie d’un cul. Ces folles cherchent des noises à la noise, c’est indéniable. Elles maintiennent l’illusion avec «Cat O Nine Tails». Elles sortent un vrai son et on connaît beaucoup de groupes qui auraient aimé en faire autant. Mais ensuite, les choses se dégradent. Derrière le rideau du son, les idées brillent par leur absence et la pauvre Donita Sparks chante souvent comme une casserole. Un cut comme «Runnin’ From The Law» est aussi mal foutu que les mauvais cuts des Runaways.

Si on ne collectionne que les albums énormes, il faut sauter sur «Smell The Magic» paru en 1990. Ce disque bat tous les records de monstruosité sonique. Exagération ? Commencez par écouter cette ouverture de bal des vampires qui s’appelle «Shove», montée sur un riff hendrixien et chanté au trash baveux. On se croirait à Londres en 1967. C’est du pur jus de blues rock. Les filles ont tout compris. Une riff de blues rock bien senti passe toujours comme une lettre à la poste, tous les guitaristes du monde le savent. Et elles agrémentent ça d’un solo à la coulante. Il faut voir comme elles déboîtent le cornet, comme elles vérolent la posture, comme elles arrachent la mainmise ! Quelles fabuleuses poulettes ! Elles jouent le rock du ventre, le rock viscéral, elles visent l’origine du monde, la spirale du Père Ubu, l’amorce du grand tourbillon tel que dessiné par Alfred Jarry. Et ça continue avec un «Fast & Frightening» d’une puissance sans égale, monté au beat rapide et orné des coulures de solos infernaux. Elles fonctionnent comme un bélier, la poterne ne tient pas longtemps. Elles démontent tout sur leur passage. Les solos raniment les morts sous les remparts. Donita roule des r et le cut file au ras du sol. Monstrueux. Suite du carnage avec «(Right On) Thru» perforé par un solo de wha-wha et joué au mur du son. Idéal pour s’exploser la tête au casque. Rien ne peut freiner ces Californiennes, surtout quand elles attaquent «Deathvision». Elles progressent dans la plaine comme une division infernale. Le solo coule entre les jambes et file se fondre dans l’embrasement du crépuscule. Il n’existe rien d’aussi démentoïde. Voilà encore un cut en forme d’exaction modèle. Excellent jusqu’à l’os du jambon. Ces filles sont folles. Elles démarrent «Till The Wheels Fall Off» en trombe, évidemment. Elles flirtent un peu avec le son hardos, mais non, qu’on se rassure, elles restent dans le high speed rock’n’roll. À ce niveau d’intensité, on est obligé de conclure qu’elles sont possédées par le diable, ce qui les rend automatiquement sympathiques. Elle savent se tenir. Donita chante ça à la hurlette et c’est tenu à l’accord de rock bien jaune et bien visqueux. Mais tout cela n’est rien à côté de «Broomstick» - I got a broomstick baby - Elles tapent là dans le heavy de l’énormity, celui des dingoïdes. Elles décapitent tous les archétypes. Elles sortent un son qui coule comme l’acier liquide d’un four Bessemer. Elles inventent l’aciérie du trash-blues, les pluies d’étincelles soloïdales, le trashoïdal élémentaire, et Donita refait une passe de solo à la Wayne Kramer. Elles nous emmènent dans leur monde. Elles pourraient apprendre le rock à pas mal de groupes. Si on aime ce qui fume et ce qui tend vers l’infini, alors il faut écouter cet album. Elles donnent une belle leçon de punkitude avec «Packin’ A Rod». Rien qu’avec ça, elles balayent tous les groupes de Los Angeles d’un seul revers de la main. Elles déboîtent les clavicules de Salomon. Ce disque est une métaphore de l’envergure. On entend un solo de rêve dans «Just Like Me», encore un cut touillé dans la bouillasse. Chez L7, on trouve tout ce qu’on aime : les vols planés d’accords mortifères et le goût de la dévastation. Elles finissent avec «American Society» - I don’t wanna drown in American society yaeh yeah - traversé par un solo sinusoïdal et il faut voir comme ces cocottes cocotent.

Pas facile de revenir en studio après un album comme «Smell The Magic». Elles tentent pourtant le coup deux ans plus tard avec «Bricks Are Heavy». On y trouve une pure énormité : «Shit List», un cut qu’elles bombardent à la basse fuzz. On y entend un vrai solo à la déglingue et des chœurs déments - Shit list ! Slit list ! - Donita part en vrille au chant et cherche des noises à la noise. L’autre gros cut de l’album s’appelle «Slide», où elles sortent des chœurs à la Buzzcocks. Donita revient rouler des r dans «Scrap», petite pièce de heavyness exceptionnelle et elles restent dans la heavyness pour «Diet Pills» et ses solos chargés de soufre. Ça court-circuite dans la centrale. Ça perfore les couches d’ozone. Mais force est d’admettre que cet album ne vaut pas le précédent.

Retour en force en 1994 avec «Hungry For Stink». Dès l’intro d’«Andres», pas compliqué, elles te plongent le museau dans la distorse. De là à penser que ces filles ont le génie du son, il n’y a qu’un pas qu’on franchit allègrement. Voilà ce qu’il faut bien appeler du bombardé de mid-tempo tourmenté et soulevé par des vagues géantes de chœurs - Oooh Oooh ! - S’ensuit un «Baggage» de heavyness maximaliste qui s’en va exploser au sommet de l’Everest. Il semble que Donita ne vit que pour les extrêmes. Et ça part en solo, mais pas n’importe quel solo, un solo courbaturé de fuzzeries malveillantes. Rien d’aussi radical que cette heavyness compressée dans la purée par des reines du trash. L’autre énormité de cet album s’appelle «Questioning My Sanity». Après une intro de riffage de bonne augure, le questioning en question se révèle im-pa-rable. Donira la sparkeuse explose tout au riff vengeur. Voilà un cut terrible, grandiose et bourré de son. Plus on entend dire du mal des filles et plus on les adore. «Riding With A Movie Star» sonne exactement comme une énormité dévastée d’avance. Donita n’insiste pas. Elle laisse filer les nappes d’orgue - Get Out ! - Elle n’y croit pas mais elle participe au carnage d’un instro tatapoumé. Quelles fulgurantes chipies ! Attention à «Fuel My Fire» ! Voilà un cut étonnant de violence sonique. Suzi Gardner chante. Elle sort un pur punk-rock de girls, sans retour, comme la rivière. On pourra qualifier le solo de forestier car il prend feu. Ces filles sont des diablesses. S’ensuit un «Freak Magnet» heavy as hell. Voilà le vieux coup de grunge ultra-saturé qu’on attendait. Ces quatre filles sont folles et elles cultivent l’art du solo vrilleur à la Jeff Beck. Elles ont vraiment tout ce qu’il faut pour rendre un homme heureux, non ?

On retrouve Donita, Suzi Gardner et Dee Plakas sur «The Beauty Process» paru en 1996. Attention, c’est encore un album énorme. Avec «Drama», on retrouve le meilleur son d’Amérique. Encore un cut victime de l’élongation des ailes du son. Le solo sort en glougloutant du robinet du diable et ça repart au cahot sur les pavés des mauvaises intentions qui luisent aux lueurs du four béant d’Hadès, dieu des enfers. Ces dames dégagent. Avec «Off The Wagon», elles se positionnent largement au dessus de la moyenne. Elles sont magnifiques d’essence adventiste. Elles avancent dans le bleu d’acier urbain avec une audace digne des troupes d’élite. Elles tapent dans le cœur du process et elles enchaînent avec un «I Need» monté sur des crises ambulatoires et balayé par des solos désordonnés. Encore une pure énormité. Une de plus. Mais le pire est à venir, à commencer par «The Masses Are Asses», et le grand retour au son d’ivoire de la tour maudite. Elles cognent sur le bulbe et foncent au ras du bitume. Ça sonne comme un leitmotiv soutenu aux chœurs de dingues et le solo traverse le cut comme un paquebot fellinien. Pur génie. Et ça continue avec «Bad Things» bardé de retours de flammes. Elles cocotent comme des folles et Donita vitupère comme une possédée. Jamais une fille n’a chanté avec autant de mauvaiseté dans l’interjection. Pire encore : «Must Have More», heavy as hell, véritable purée de son brûlante. Ce cut glisse comme une infamie. Attention, «Non Existant Patricia» a l’air pépère, mais les filles l’explosent au final, à coups de cornes de brume. L7 est certainement l’un des groupes les plus intéressants d’Amérique. Ce que vient confirmer «Lorenza Giada Alessandra», nouveau coup de génie, nouvelle explosion de violence riffique horrifique. C’est du Bowie nucléaire, une pure latence de la démence. Donita pousse le bouchon de Bowie beaucoup trop loin et ça tourne à l’émeute.

Comme Suzi Quatro et Cheap Trick avent elles, les filles sont allées enregistrer quelques titre au Japon. On les retrouve sur «Omaha To Osaka» - Hello Osaka ! - et paf, elles envoient «Andres» dans les dents de l’empire du soleil levant et ça tourne à la pétaudière inexorable. Elles sont déchaînées. Avec «Fast And Frightening», on assiste à une véritable explosion du beat de cocotage. Leur énergie effare au plus haut point. On se régale aussi de la fantastique attaque de «Little One». On imagine que les Japonais n’avaient jamais entendu pire punk-rock. Elles finissent ce mini-set japonais avec un «Lorenza Giada Allesandra» tout aussi spectaculaire. L’autre moitié de l’album est enregistrée à Omaha et on entend Donita cisailler «Bad Things» comme une damnée. C’est incroyable ce qu’elle cocote bien, la cocote. Leur version de «Must Have More» est heavy as hell et elles jouent «Death Wish» au heavy dub de guitares. Suzi Gardner part en solo liquide. Franchement, ces filles sont excellentes, au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Suzi joue des incursions seigneuriales et l’ensemble sonne comme un blast tentaculaire explosif. Donita drive le beat féroce de «Drama» comme une vraie driveuse. Elle sait hurler dans la fournaise et garder le cap sous le vent brûlant. Le solo coule comme d’habitude, c’est-à-dire comme un fleuve de lave en pleine éruption, et ça coule, ça coule, et ça remonte même les pentes. Ces filles sont folles ! Elles finissent le set d’Omaha avec «Shit List», du pur jus de garage épouvantable, plombé au bass drum et traversé de part en part par des solos atrocement vénéneux.

«Hollywood Palladium» est un album live un peu énervé qui pue l’occasion ratée. Elles auraient pu sortir un live du niveau de «No Sleep Till Hammersmith», mais leur live sonne beaucoup trop bourrin, comme on dit dans les cercles hippiques. Elles attaquent avec un «(Right On) Thru» solide et bien tapé, mais Dee Plakas n’est pas Denise Dufort, l’âme de Girlschool. On sent bien qu’elles n’ont ni dieu, ni maître, ni grunge, ni riot grrrrl. Donita Sparks fait son truc No club, lone wolf. We were considered grunge but somehow in history we’re not in that gang. We’re not riot grrrl. We’re not that gang. It’s weird. We were always our own thing - On assiste à un gros guitar interplay entre Donita et Suzi Gardner dans «Broomstick». On tombe un peu plus loin sur le point fort de l’album, «Freak Magnet». Quelle énergie ! Elles nettoient tout sur leur passage. D’une certaine manière, cet album est dense et il paraît bien illusoire de vouloir échapper à leur rouleau compresseur. On trouve deux jolies choses en face B, «Deathwish», pour commencer, empli de toute la détermination du monde. On sent bien les enfonceuses de poternes patentées. Et puis «Shove» qui sonne comme un classique seventies, pas loin du «Time Has Come Today» des Chamber Brothers, sans doute à cause des chœurs qui font «shove !»
Signé : Cazengler, L76
L7. Bataclan. Paris XIe. 17 juin 2015
L7. L7. Epitaph 1988
L7. Smell The Magic. Sub Pop 1990
L7. Bricks Are Heavy. Slash 1992
L7. Hungry For Stink. Slash 1994
L7. The Beauty Process. Slash 1996
L7. Live. Omaha To Osaka. Man’s Ruin Records 1998
L7. Hollywood Palladium. Easy Action 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Donita Sparks, Suzi Gardner, Jennifer Finch et Dee Plakas
ROUEN / HOT SLAP / BLUE TEARS
07 / 11 / 2015 – LES TROIS PIECES
08 / 11 / 2015 - LE VINTAGE
RUMBLE IN ROUEN
HOT SLAP

Hey rocky tu crois ça possible un wild rockab week-end in Klacos-city ? Hey rockah, tu crois ça possible un boppin’ ballroom blast in Rotomagot ? Les dieux du bop ne s’embananent pas avec les détails, s’ils décident de stormer l’embassy, rien ne pourra les full-stopper. Et ça démarre par un beau vendredi soir de fall à la cave, pour une séance de basement bop orchestrée par les Hot Slap qui portent bien leur nom. Avec Dédé et son trio, les junkies du slap sont servis. Double dose ! Endroit idéal pour un shoot de bop, c’est ultra-concentré et bien hot car pas d’air, et la stand-up fait swinguer les vieilles briques qui en voient pourtant des vertes et des pas mûres, mais rien ne vaut un bon coup de retour aux sources. Prends ton temps, take it easy, amigo, tu vas l’avoir ton fix de swing, il va te monter droit au cerveau, tu vas voir. Les Hot Slap jouent vite et bien, ils tapent dans les évangiles du rockab, ils tapent dans Carl comme d’autres tapent la belote, ils redonnent une nouvelle chance à «Honey Don’t» et à «Matchbox» qu’ils jouent serré dans les virages, et si Carl traînait dans les parages, c’est sûr qu’il serait là, dégoulinant de sueur au premier rang en train de snapper comme un mad pink pedal pusher. Dédé incarne le rockab, il est dedans comme ce n’est pas permis et ses deux amis, Martin, le chanteur Gretscheur et Franky le drummer l’aident à pulser du bop comme s’il en pleuvait. Tout le monde le sait bien, dans un trio de rockabilly, le slap dicte sa loi. Tout le monde sait bien que sans James Kirkland, Bob Luman aurait roulé sur trois pattes. Tout le monde sait bien que Ray Campi doit plus sa légende à sa fuckin’ stand-up qu’à sa voix et que Ron Weiser doit absolument tout à Ray qui venait bopper dans son salon pour accompagner le pote Mac. Dédé, c’est l’œil du cyclone, il diffuse l’essence même de la sauvagerie du rockab, le son, rien que le son, le stomp des pionniers. Ah c’est sûr, Martin est dessus et il joue comme un crack. Avec une rythmique aussi parfaite, c’est du gâteau et il fait le cake, la cave swingue et les corps sweat, ça boppe et ça dig le bop. Ils croquent dans Cochran, histoire de rester dans le pré carré de la classe infernale, et ils vont même aller jusqu’à rendre hommage à son héritier spirituel, le petit chanteur des Wise Guyz d’Ukraine dont ils reprennent l’imparable «Don’t Touch My Greasy Hair», cover qu’on retrouve d’ailleurs sur le Hot Slap Disk, brillamment intitulé «Play Legends». Quelle aventure ! Ils tapent dans le jive ukrainien comme ils tapent dans le stomp d’Ubangi, et Martin truffe ça de solos dévastateurs. Les attaques au chant sont des modèles du genre. Ils sont dessus, comme l’aigle royal sur la belette.

C’est l’hot étuve dans la cave et ils enfilent les hits du bop comme des perles. La machine est bien rodée et les Hot Slap vont pouvoir aller stormer les salles à l’étranger, c’est prévu. Ils sont désormais à l’abri des déconfitures et des critiques, car Martin sait chanter avec autorité et poser sa voix d’accent tranchant sur une belle rythmique dépouille. Dédé et son batteur rendraient n’importe quelle star du rockab heureuse. Mais attention, ces mecs sont dangereux. Ils posent des bombes. Quoi ? Mais oui, quand ils tapent dans «Boogie Bop Dame», leur set explose. Voilà la pure folie rockab, le cœur de l’atome sauvage. La preuve ? Elle est aussi sur leur album. Tout ceux qui par goût ou par lassitude veulent se faire sauter le caisson n’ont qu’à essayer. On trouve aussi sur l’album le «Boppin’ The Blues» du grand Carl. Voilà encore une vraie dégelée, car ils boppent sec ce classique à la cloche de bois. Martin le truffe d’un chorus saturé de son. Ils tapent aussi une reprise des Mystery Gang - un groupe hongrois qui fit crépiter Crépy - avec un «Rockabilly Star» qui ne se voile pas la face.
BLUE TEARS TRIO
Le lendemain, un petit bar situé à deux pas de la cave accueillait le Blue Tears Trio pour deux sets de quatre-vingt dix minutes. Overdose assurée pour les junkies du slap, tant mieux car comme dirait Ian Fleming, on ne vit que deux fois.
Les Blue Tears proposent aussi un set de pur rockabilly. Ils ne cherchent pas à écrouler le bar, ils travaillent à la viet, sur la distance, avec un son qui pourrait servir de modèle tellement ça swingue. Il semble qu’ils se bonifient à chaque concert. On a vraiment cette impression qu’ils sont chaque fois plus fins et plus denses que la fois précédente. Mais où s’arrêteront-ils ? Seul le diable le sait. Didier joue lui aussi sur une Gretsch blanche, la fameuse White Falcon qui fait rêver tous les guitaristes de rock. Il mène le bal pendant trois heures et il roule à la décontracte, car il s’appuie sur une section rythmique de rêve. Il pourrait même jouer les yeux fermés, car derrière lui règne l’infaillibilité des choses. Et même plus, car Frank et Aymé s’amusent à bricoler des montées de fièvre, histoire d’amener un peu de relief sur un set que guette le danger du faux plat en roue libre. Un critique d’art appellerait ça du très grand art. Ils combinent à merveille le bop de base et la gestion des climats, et si on suit leur cirque à la trace, alors le set devient captivant. On voit trop de sets classiques nivelés par l’orthodoxie. Bon nombre de groupes programmés à Béthune Rétro passent ainsi à la trappe, victimes de leur vice routinier. Ils misent sur la culture du public, et c’est une grave erreur, car les érudits du rockab ne courent plus les rues. Les disquaires sont d’ailleurs les premiers à admettre que leurs clients se raréfient. Alors pour déjouer toutes les avanies - Avanie et Framboise comme dirait Boby - les Blue Tears misent sur le double concentré de tomate. Leur truc c’est de frapper les imaginations et de redonner une nouvelle vie à cette vieille culture délavée par le temps et les intempéries. Le fait de jouer dans un bar renforce encore l’impact du set. Ils sont mille fois plus présents dans cette salle bien ramassée que sur la place du soixante-treizième où un vent cruel dispersait leurs maigres efforts. Et bien sûr, il suffit qu’ils tapent dans le «Coming Home» de Johnny Horton pour faire sauter les pompes à bière. On goûte à ce moment-là le fruit d’une sacrée expérience mâtinée de passion purulente. They rock this town, pas de doute. Ils tapent aussi dans l’intapable avec «Love Me» du Phantom, et ça passe comme une lettre à la poste, car Didier évite de se rouler par terre, ce qui viendrait à l’esprit de tout autre repreneur - et le mec des Sure-Can Rock en particulier. Un set de cette qualité devient irréel au bout de trois heures. Mais qui s’en plaindrait ? C’est comme un manège, lorsqu’on est gosse, on aime bien les tours gratuits. Il faut souhaiter à tous les amateurs de rockab de voir un tel double set. Et surtout de mettre le grappin sur le 25 cm qu’ils viennent d’enregistrer à Honfleur, car on y retrouve la dépouille de rythmique qui fait les grands singles de rockabilly.

Ils attaquent avec un «Shadow My baby» swingué jusqu’à l’os du genou, bien sec et comme trié sur le volet. Pas un seul gramme de gras là-dedans. S’ensuit le fameux «Love Me» joliment bien amené au slap. Bien sûr on a tous en tête la version originale, mais ils imposent leur vision de la chose qui est bonne, car encore une fois, c’est pris à la pure dépouille et Didier va chercher quelques beaux accents renégats au fond de son gosier. On trouve aussi deux autres reprises de choc, le «Right String Baby» - but the wrong yo-yo - du bon Carl et l’imparable «One Hand Loose» du tip top daddy Charlie Feathers dont on ne se lassera jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, ils balancent en ouverture de face B une solide compo intitulée «Rockers Gang» qui s’appuie sur la meilleur des sections rythmiques et bien sûr Didier en profite pour placer un solo d’une indécente légèreté. Vous n’en feriez pas autant ?
Signé : Cazengler, rocâblé
Hot Slap. Le trois Pièces. Rouen (76). 7 novembre 2015
Hot Slap. Play Legends. Smap Records 2015
Blue Tears Trio. Le Vintage. Rouen (76). 8 novembre 2015
Blue Tears Trio. Million Tears. 2015
13 / 11 / 2015 – LE 3 B – TROYES
SPUNYBOYS

Faut suivre les groupes. En découvrir de nouveaux – abondance de biens ne nuit pas - mais ne pas abandonner les déjà-vus sur le bord herbeux du chemin. La route du rock est longue et étroite. Ne mène pas obligatoirement au paradis de la célébrité mondiale ou aux cérémonies souvent faisandées du Hall of Fame. Mais si nous voulons conserver notre musique vivante, faut soutenir les combos qui se battent pour perpétuer la flamme.
Ce qui est certain, c'est qu'avec les Spuny, l'on ne prend pas beaucoup de risque. C'est un peu comme quand vous jouez au poker avec des cargaisons de quintes-flush dans les revers de votre veste ou au double-six avec des dés truqués. Vous êtes sûr de remporter la mise. Nous ne devons pas être les seuls à penser ainsi car le 3 B est plein à ras-bord. Il y a même des parisiens qui sont descendus dans la capitale de l'Aube pour assister au concert.
THE BOP THAT JUST WON'T STOP

C'est un album de Gene Vincent paru en 1956, chez Capitol, surtout prévu pour l'exportation, et dont le titre fut repris en 1974, pour l'une des toutes premières rééditions de la firme américaine après la mort du Screamin' Kid. Je l'emploie ici, car ce soir, d'après mon oreille les Spunyboys ont joué davantage bop que rock. Spunybop en quelque sorte. Encore reste-t-il à définir ce qu'est le bop. Hypocritement serais tenté de dire, la même chose que le rock. Avec un petit truc en plus, ajouterais-je vite pour ne pas me faire huer. Un rien du tout, un minuscule fragment de seconde qui précipite le retard du contretemps. Un espace surajouté qui fait toute la différence. Le balcon de quinze centimètres de large de la cuisine qui vous augmente le prix de l'appartement de trente pour cent. Une élasticité respiratoire qui ralentit tout en propulsant. Un cœur qui bat plus lentement mais en accentuant le ressenti de la cadence. Vous imaginez ce que les Spuny peuvent se permettre de broder sur un tel programme. Batterie-contrebasse, la section rythmique a de quoi s'amuser. Quant à la guitare n'imaginez pas qu'elle fait la tête de son côté en refusant de participer à ce balancement binaire très légèrement claudiquant. C'est dans l'irrégularité toute régulière du rythme que se déploie un espace trapéozïdal, le quatrième côté du rectangle rythmique biseauté, dans lequel elle peut à l'envi faire preuve de son élasticité, de sa plasticité. Attention, pour jouer bop, faut des musiciens qui ne soient pas manchots et qui se connaissent. La surprise est à tous les étages mais il ne faut surtout pas se laisser surprendre, sinon l'on tombe dans les plans foireux.
CONCERT

Avec les Spuny ça tombe bien. Se dirigent allègrement vers leurs six cent cinquantième concerts, se connaissent mieux que bien, et sont prêts à toutes les déclinaisons. D'autant plus que ce soir le public est à dominante ted, ce rockabilly typiquement british réinventé à la fin des années soixante-dix, qui entremêle sans le dire explicitement des réminiscences souterraines de skiffle avec un appuyé binaire beaucoup plus électrifié que l'original américain. La guitare n'a ni le droit de rugir, ni de feuler, ni de miauler, juste le balancement hypnotique de la croupe du léopard qui ondule dans la grâce féline de sa dangerosité.

Ne vous étonnez pas si Eddie est concentré. Doit s'immiscer entre le jeu de ses deux acolytes. Avec le monde collé au poteau devant lui, doit lui manquer de l'air pour respirer. C'est que dès qu'il est à la guitare sa personnalité est victime d'un étrange dédoublement de la personnalité. Classieux et teigneux. Ne laisse jamais l'occasion d'être vindicatif et jusqu'au boutiste. Balance des boulons de cinquante à la fronde. Un par un. Dans l'intention évidente de vous faire du mal. Le problème c'est que vous ne pouvez pas lui en vouloir. La beauté du geste excuse tout. Ne jette pas à tout vent. Procède d'une chorégraphie mentale. La musique est une affaire de proportion et le rock de sauvagerie. Vous marie les termes de cette contradiction avec le savoir faire d'un pasteur qui unit un couple d'amoureux à l'Eglise. Aux douceurs de l'harmonium succèderont les flonflons du baston conjugal mais il vous assemble le feu et la dynamite avec un tel brio, que c'en devient une partie de plaisir. Luxe, tonitruance et volupté aurait dit Baudelaire. Mais quel est cet énergumène sur sa contrebasse perché ? Non, ce n'est pas qu'il cherche spécialement à se faire remarquer, c'est naturel chez lui. Ses parents ne lui ont jamais appris que ce n'était pas un perchoir, mais un ins-tru-ment-de-mu-si-que-pré-ci-eux que l'on époussette avec un chiffon de soie chaque soir avant de se coucher et le matin avant le petit déjeuner. En plus en indignes géniteurs pour ne pas être dérangés ils l'ont collé à longueur de journée devant la télévision en lui passant en boucle les cassettes filmées des shows de Bill Haley. Ça lui est monté à la tête, et du coup il escalade à tout propos sa big mama aux jointures fatiguées. Souvent il la fait tourner en bourrique, accroché à son flanc, il l'entraîne dans une valse statique et méphistophélesque. Se permet aussi quelques gracieusetés facétieuses, s'en sert par exemple pour défoncer le crâne d'Eddie ou alors essaie en franc camarade de l'étrangler d'une clé meurtrière en refermant l'articulation de son genou autour de son cou. Tout à l'heure il se vautrera de tout son long sur le comptoir ( pendant la folie la vente continue ) la contrebasse reposant sur son abdomen. Tout ce qu'il y a de plus sérieux et gentil comme garçon. Poli, gentil respectueux. Mais dès qu'il voit une contrebasse l'est atteint de fureur dionysiaque. Les Spuny seraient-ils un groupe de forcenés bipolaires ?

La question est angoissante mais la réponse d'une extrême concision. Oui. Si vous n'êtes pas convaincus prenez le temps de regarder Guillaume. En théorie, il a tout pigé. Le temps, le contretemps, le boum / silence / boum / silence. Mais il vous l'exécute en vitesse accélérée. Boum / Boum / Boum / Boum, le silence, il le respecte mais sans perdre de temps ( et sans perdre le temps ). Encore un bon copain. Le pauvre Rémy n'a pas terminé son dernier lyric que déjà il embraye sur le titre suivant. Les Spuny, ils ont l'air de vouloir achever le morceau à peine l'ont-ils commencé. Ce n'est pas qu'ils sont pressés de finir mais ils ont un petit Charlie Feather à vous caler dans les gencives, ou un vieil Horton de derrière les fagots à vous faire entendre. A la sauce Spuny, bien sûr. Haché menu et épicé à la tartare. Terrible efficacité.

C'est à l'interset que l'ambiance se plombe. Des messages sont arrivés sur les portables et des nouvelles alarmantes circulent sur le Bataclan... Les Spunyboys mettent le turbo pour le deuxième set, le temps de reculer pour une heure encore la terrible réalité. Mais la fête est gâtée. Fêlure imperceptible dans le cœur. Un dernier Matchbox réclamé par l'assistance pour clore la session. N'y aura pas de troisième set. Tout le monde a envie de rentrer à la maison... Inquiétude générale. Certes, ce n'est que partie remise. Nous reverrons un jour ou l'autre les Spunyboys, en une conjoncture beaucoup moins glauque, mais ce soir, l'on a l'impression d'avoir perdu un peu d'innocence. Hard times are comin'. Rock and Roll fever never die.
Damie Chad.
( Photos : FB : Christophe Banjac )
14 / 11 / 2015 – TROYES
TROYES TATTOO SHOW
OL' BRY

C'est au Cube nous avait-on dit. Alors on est allé au Cube. Je vous entends avec vos sous-entendus sur le goût immodérés des rockers pour les apéritifs-cubes. Du genre le sky au mètre cube. Devant de si basses insinuations je préfère ne pas répondre. Arrivés devant le Cube, nous avons poussé un cri d'horreur. Au moins mille cinq cents personnes devant les portes de verre du bâtiment, la foule parquée dans le labyrinthe des barrières métalliques et la police qui filtre les entrées. Stationnement en catastrophe et galopade jusqu'à la billeterie, charmante jeune fille blonde dans sa cage de verre. Le concert des Ol' Bry, non jamais entendu parler, ce soir c'est un illusionniste. En attendant c'est nous qui perdons nos illusions. Mister B vérifie sur son portable. C'est pourtant la bonne adresse et la bonne date ! Devant cet épais mystère, je prends la situation en mains. Je démarre et je me dirige en brûlant les feux rouges vers le 3 B, sis à cinq cent mètres de là. Non je ne vais pas m'en jeter un derrière la cravate pour me remettre de mes émotions, mieux à faire, je file réveiller mon réseau dormant.
L'appellation n'est pas des mieux appropriées, le réseau dormant ne dort guère. Fait même la fête toute la nuit. Au premier étage d'une maison devant laquelle je gare la teuf-teuf à chaque soirée organisée par le 3B. Une vingtaine de jeunes gens qui trinquent, crient, éclatent de rire, chahutent, écoutent des musiques innommables, le tout en gardant les fenêtres systématiquement ouvertes. Perso, je les trouve sympas. Leurs voisins je ne sais pas. Je les hèle depuis la rue, me confirment l'adresse, la date, et le cube ( magique ). La teuf-teuf repasse les feux rouges en sens inverse, nous tombons sur une escouade d'hôtesses en goguette qui nous livrent la clef du mystère. L'existe un Hall B !
Nous traversons les stands tattoo en courant. Beaucoup sont fermés. Certains encore ouverts, l'accunpuncture graphique possèdes ses acharnés. Enfin nous voici devant le podium où officient les Ol' Bry. Nous retrouvons l'escouade des habitués du 3 B.
OL' BRY
Faut d'abord nous accoutumer à l'acoustique, aller chercher la voix d'Eddie tout là haut dans les structures métalliques et les briques du plafond. Et puis opérer nous-mêmes le mixage des instruments dont les vibrations sonores s'éparpillent un peu de tous les côtés. Cette ré-initialisation de l'oreille interne effectuée, l'on peut enfin s'adonner à l'écoute du concert.

Tout nouveau, tout jeune, tout beau. Thomas, sur son mini kit de batterie. Réduction à l'essentiel. Caisse claire et semi-grosse caisse Gretsch. Une charley sur laquelle il ne met pas tous les Watts, joue principalement en rythmique. Frappe légère mais juste. Diego le surveille du coin de l'oeil pour les passages les plus périlleux où la syncope s'en vient batifoler gaiement dans les breaks. Thomas passe les gués sans désagrément même lorsque la déclivité de la pente s'accentue. C'est que les OL'Bry c'est un peu les montagnes russes, l'on saute du Sinatra-swing au rockabilly le plus sauvage, du doo-wap le plus allègre au blues le plus appuyé. C'est le fil rouge de la guitare de Diego qui permet de descendre et monter les pentes à toute vitesse. Medium jazz, avec cette pulsation noire agrémentée d'une pointe latine si besoin, Diego Yagin Parada possède toutes les parades nécessaires à ces différentes acclimatations. D'autant plus qu'il est fortement épaulé par Rémy au sax. Bien sûr que le sax fait sa star, attendez que je vous plante mon solo, et puis je vous laisse vous débrouiller tout seuls, quand je me tais. C'est le rôle rutilant et habituel du saxophone. Ecoutez-moi pendant que j'astique le cuivre, et essayez de survivre quand je me claquemure dans le silence. Mais Rémy a horreur de se retirer dans sa tour d'ivoire. Intervention continue. Pousse sa note au gros grain de sel sans interruption. Souffle perpétuel. Parfois en sourdine, et le son du saxo se mélange alors si bien au pizzicato de la guitare que les deux instruments se confondent et n'en forment plus qu'un. Un duo qui ne tourne pas au duel. Superbe et pharamineux. L'on oublierait d'écouter les autres. J'aimerais être un ingénieur du son du prochain disque pour mixer ces deux vouivres entrelacées en avant.

Thierry est aux choeurs. Ah ! le velouté de cette voix sur les wap doo wap ! Une tendresse de satin, rehaussée de profondeurs de ventre de contrebasse à faire fondre les dessous féminins. Une parfaite illustration sonore de L'Insinuant de Paul Valéry « Ô courbes, méandres / Secrets du menteur / Je veux faire attendre / Le mot le plus tendre », humidités des lingeries féminines... Mais ne nous égarons point. Dans son costume lamé, Eddie est au micro. Tient sa guitare haut perchée, la manipule sans ménagement, sa voie est tracée, elle est au service de sa voix. Eddie tourbillon. Eddie papillon qui nous brûle les ailes. Sait tout faire. Et l'orchestre épouse ses caprices, adopte des allures de big forty band puis de combo rockab des appalaches perdues, un peu de typique avec Baila Conmigo, un My Babe à la vaquero texano, un Bim Bam comme deux paires de gifles, un boppin'and shakin' enlevé comme un tapis volant, un Rainin'in my Heart à pleurer et un Im going home à vouloir rester jusqu'au bout de la nuit à entendre encore et encore de ces petites splendeurs qui vous réconcilient avec la vie. Mais non, c'est la fin, l'orga tapote son chrono, il faut arrêter de vivre.
Faut laisser la place à l'effeuilleuse de service. Je sais bien que c'est l'automne, mais l'on aurait préféré une demi-heure supplémentaire de Ol' Bry. On les reverra. Soyez sans crainte.
Damie Chad.
F. J. OSSANG
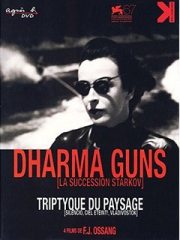
Né en 1956, F. J. Ossang fut le chanteur du groupe M. K. B. Fraction Provisoire ( Messageros Killers Boys ), mais il est également poète, écrivain, cinéaste. Nous lui devons notamment le bréviaire de la génération punk française, le roman Génération Néant publié en 1993 et le film Dharma Guns présenté au festival de Venise en 2010. Nous donnons ici, les chroniques de trois de ses premiers livres parus en en 1993 et 1994, répertoriés dans les N° 4, 6 et 7 des mois de juin, août et septembre 1995, dans Alexandre, mensuel de Littérature Polycontemporaine. Avis au lecteur : rock métaphysique.
GENERATION NEANT
F. J. OSSANG
( Blockhaus & Warvillers / 1993 )
Toujours retour.
Essentiel du poète à disposer de l'impétueuse nécessité d'inscrire l'ordre catatonique des choses violentées. L'interruption n'est plus de mise, seule compte l'absolue perversion des visages émaciés hurlant à l'autre ( de lui à son miroir dans la suspecte vision du malsain ) l'intime déraison de l'apocalypse survenu.
Parce que l'outrage photogénique resplendit plus encore dans le cercle verbal, ellipse du tracé, raccourci du ténébreux dans l'irrespect des esquisses du monde épelé. Qu'épelé le concert des questions sans interrogation, la ponctuation n'existe pas dans l'excès des phrases, seuls se dévisagent les interdits.
« Les plaintes et les pardons ne servent plus à rien, il n'y aura ni pardon, ni salut. Les dieux sont morts et leurs fantômes sont des radiations mortelles.
La continuité des lignes semble s'être rompue pour toujours. Il reste des emblèmes funéraires, et le trouble que procurent les dessous féminins.
Apatrides transeuropéens. Revenants. Revenants néant. Nous sommes les revenants de la Génération Néant »
( F. J. Ossang )
Epitaphe / épigraphe du livre, Ossang réalise dans Génération Néant la synthèse illuminée du lent inexorable. Cercueil intraduisible porté à même la matière de celle dont on recouvre le corps bien longtemps après qu'on ait subi la métamorphose et ne soit plus que reste vitrifié, les textes s'abjurent devant l'atrocité malade du monde de l'enfermement. Le nôtre pas seulement, mais bien celui-ci, dénoncé par Artaud et les autres. Ceux que l'enfer a bouffés avant de régurgiter l'ultime trace à se prendre dans la gueule.
« La mer est sauvage. Même s'il est possible de détruire une partie de sa faune et de sa flore, les abysses demeurent insondables. Les aviateurs l'ont appris à leurs dépens : ils savent aujourd'hui que le ciel est comme le miroir de la mer profonde, et que l'enfer ne renonce jamais, il veilleen deçà de l'image. Qui oserait mettre en doute l'existence du Triangle de l'Enfer... »
( F. J. Ossang )
Êtrémité enfin acquise, comme refluée dans l'éventaire des rognures à se mettre sous la dent; un livre à posséder.
Eric Morandi ( Alexandre 7 / Septembre 1993 )

AU BORD DE L'AURORE
F.J. OSSANG
( Editions Warvillers / 1994 )
F. J. Ossang is not an unknown soldier. Son précédent roman, Génération Néant, est à la génération punk ce que l'Anabase fut aux dix mille. Time to take a cigaret. Messagero Killer Boy. Voici les temps à venir. Après le no future. Il faut survivre. Encore reste-t-il à savoir sur quel bord de l'aurore on tente de forer son trou. Exit or indoor. Au bout de la nuit le sommeil est-il occidenté ou orienté ? Européen sous nos latitudes. Au bord oublié de l'Europe. Run ! Run ! Run ! Paris, Madrid, Lisboa. Rock and roll. Litt&rature. Tout est pourri, Johnny. Le pistolet du sexe dans la braguette d'Elvire. Film. Bonnie and Clyde. Se vouloir soi F.J. Ossang. Se vomir. Se reconstituer Ange de l'Angoisse. Les friends ne sont jamais au rendez-vous. Juste le couple androgynique. Aller au peep show pour se regarder vivre. Le gai savoir n'est pas joyeux. Nada destructor. Le taylorisme de la middle-class européenne n'évincera pas Vince Taylor. Mais à l'aise dans leur racket les desesperados font les commissions de la culture. Casa Velasquez à Madrid, c'est un peu comme la villa Medicis en Italie. Les fastes romains sont simplement remplacés par los Caidos ( traduisez les vaincus ). I do not just be a rock'n'roll star. Il est minuit Docteur Misère. Ne pas commencer comme James Dean. Ne pas finir comme Marlon Brando. Entre les deux. L'Histoire. L'histoire européenne. La colonne Durruti. L'aigle viennois. Baiser mais pas biaiser. Droit. On the line. On the road. Suivre. Poursuivre. Refuse l'attrape couillon. Se débattre avec l'esthétique de sa propre fureur. Bander son énergie, sa vie, son vit. Etre encore. Malgré tout. Par-dessus tout. Kick out the jams. Foutre en l'air. Foutre partout. Le corps comme ultime expérience de l'esprit. Vivre bite et ne pas mourir. Tristan chanteur de groupe. Iseult sa groupie. L'occident n'a-t-il inventé que l'amour ? Break on through. To the other door. Dernière page. Ultime rage. Promesse folle d'aller de l'avant. Petits matins blêmes. Lendemains qui chantent. A l'W rien de nouveau. Le livre se ferme. Le jour se lève. C'est un grand livre. Evangiles du désespoir. Apparition d'aube.
Damie Chad( Alexandre 4 / Juin 1995 ).
AU BORD DE L'AURORE
F.J. OSSANG
( Editions Warvillers / 1994 )
La pureté n'est-elle pas dans l'impureté ? Ne faut-il pas descendre au tréfonds de l'impur pour toucher le pur ? Dernier héros desesperados dans cette Europe en décadence, signant sa décomposition. Elle, l'impure à la chair blanche, lui, le terroriste de l'écriture essayant en train d'écrire en vain un roman. Tout est mort, nevermore, rien n'est plus. La mystique de la chair encore et encore revisitée, l'acte charnel est ce qui reste après le néant. Il est des Cantos qui naissent de ces chants de chair, rock and roll, sexe et drogue, les illuminations de l'orgasme toujours recommencées. Pute ou Madone, pourquoi choisir ? Elle est l'au-delà de la chair et l'au-delà du bien et du mal. L'écriture comme un orgasme, le cinéma, l'image tuée par le fric, misère du fric. Pourquoi dire que ce monde est, s'il le hait, nevermore, no future, extrémité de l'Europe. La péninsule ibérique, dernier rêve, rien que des voyages dans le temps, toujours plus d'espace.
Beatriz Gutierrez ( Alexandre 6 / Août 1995 )
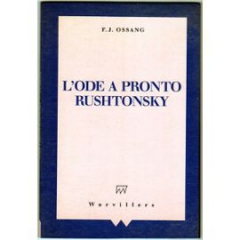
L'ODE A PRONTO RUSHTONSKY
F. J. OSSANG
( Warvillers / 1994 )
Froide comme la morgue où repose mon ami. Ce corps de jeune fille dénudée morte. Scalpel. Autopsie. Pronto rush on sky. Il était le dernier Messagero Killers Boys. Lamento. Pronto. Ode gronde. Ode grande. Poème nu. Dix jours de corps froid dans un tiroir de l'institut. Un viento triste entre los ramos de los olivos. Mort. Parti seul. Volontaire. Commando suicide. Un seul objectif. Le pôle intérieur du nord perdu. Olivier. Imputrescible. Qui résiste mille ans. Et ce corps cassé. Jeté au bas des nervures de fer de cette gare sin partenza. Retour avant l'enfance. Pronto s'est extrait du monde. Pose et envol. Les feuillets d'Ossang. Hommage. Point d'orgue. Tombeau. In memoriam.
Damie Chad. ( Alexandre 4 / Juin 1995 )
LES 100 VINYLS
INCONTOURNABLES
PHILIPPE MANOEUVRE
JERÔME SOLIGNY

C'est le stiker qui m'est entré dans l'oeil, le gauche pour ceux qui aiment les précisions historiques. Le premier disque d'Elvis Presley ! J'ai tout de suite pensé qu'ils avaient fait un duplicata des deux premières chansons enregistrée par Elvis dans un photomaton à son. Celui que Jack White a offert aux mille premiers premiers acheteurs pour le disquaire Day. Aux States, je préfère ne pas vous parler de ma rage à moi qui n'avais au fond de mes poches trouées même pas assez de monnaie pour m'acheter une bouée afin de traverser au plus vite l'Atlantique à la nage. Sûr j'aurais eu l'air un peu ridicule avec mon flotteur gonflable, dans le magasin de disques, mais j'aurais pris un canard ce qui m'aurait donné l'air vaguement Chuck berryen. Mon honneur de rocker en aurait été sauvé.
Les jours sont passés et ma colère retombée. Et là sans crier gare, dans ma librairie provinoise préférée ( il n'y en qu'une ) le stiker planté dans mon oeil gauche ! Mon coeur commençait à me faire mal, mais c'était mon bonheur. Me suis approché tout tremblant de fièvre. Que voulez vous, n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Circus. Premier désenchantement, c'est un disque souple à peine protégé par le cellophane d'emballage. Z'auraient au moins pu mettre une pochette papier. C'est alors que je n'ai pas fini de m'étonner, ce n'est pas Elvis Presley qui est marqué dessus mais Philippe Manoeuvre. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas spécialement connu pour ses talents de chanteur. En tout cas moi, je déchante. Et Jérôme Soligny en petit en dessous. C'est ça la hiérarchie, le rédac-chef de Rock & Folk en gros et la piétaille journalistique en arrière-garde. Je réalise, mais non ce n'est pas un disque, c'est la couverture du bouquin LES 100 VINYLS INCONTOURNABLES.

Soyons juste, à l'intérieur dans la troisième de couverture, vous trouverez la réplique inexacte du premier single d'Elvis chez Sun : That's All Right / Blue Moon of Kentucky. Attention les collectionneurs : fond jaune, petit trou central, pas de logo Sun, mais l'ombre de Presley micro penché. Une tirage unique, il vous en coûtera une quinzaine d'euros maximum, mais vous l'avez déjà, puisque c'est sorti... voici un an. Réassort tardif ou nouveauté en retard ?
Mais le contenu du bouquin ? Pas de quoi se défenestrer de plaisir. Refermez votre lucarne. Faut comprendre. Ce n'est pas un livre pour les rockers purs et durs. Le grand public est visé. Et pas n'importe lequel. Celui de la FNAC. Croyez-vous que ce soit un hasard si Philippe Manoeuvre cite dix fois de suite son magasin préféré ? Nous tirerait la larme de l'œil. Nous fait le coup de la nostalgie. Quand il était jeune et qu'il venait fouiner dans les bacs de la ? Fnac ! Ouï ! très bien vous commencez à comprendre. Moi j'imaginais qu'il serait plutôt aller rendre visite à l'Open Market, mais tout le monde peut se tromper. Non ce n'est pas une erreur – ni orthographique, ni typographique – le tréma sur le i de Ouï. S'agit de la radio, la soit-disant radio-rock française. Un peu trop pop à mon goût. C'est là que Philippe Manoeuvre présente son émission rock, toutes les semaines, fait écouter des vinyls à la population émerveillée. Pas bestiou pour deux sous le Manoeuvre, deux sponsors rien que pour son bouquin, la radio pour la pub et la Fnac pour la vente. Du coup, on débouche le champagne pour deux anniversaires, les soixante ans du rock and roll et les soixante ans de la Fnac. Merveilleux hasard qui tombe pile poil. Dans le tiroir-caisse. Il n'y a pas de petits profits ! Il n'y a que de grosses entreprises.

En avant la music, maestro ! Donc une sélection de cent trente-trois tours étalés sur soixante longues années. Enfin presque, parce que ces vingt dernières années l'on ne se bouscule pas au portillon. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'est vrai que dans notre pays le rock a tendance à s'évaporer des préférences du public. Du grand, celui qui suit les modes. N'ayez crainte l'on ne donnera pas le micro au rock sauvage des bars exaltés et des salles enfumées. Ne faut tout de même pas exagérer, déjà pour les premiers rockers on les calfeutre, à deux par page, faut attendre les Beach Boys pour qu'un groupe ou artiste ait droit à une pleine page. Même Elvis n'a droit qu'à une page et demi.
Z'ensuite tout le monde est là. Tous ceux que l'on attend, Beatles, Dylan, Stones, Zeppelin, Who, Doors, Bowie, Pink Floyd, rien à dire, les incontournables, les marronniers, les séquoias. Ceux qui traversent la chaussée devant vous, sans crier gare, dès que vous empruntez l'autoroute. Pour certains qui passent deux fois, John and Paul, ne vous gênez pas, enfoncez l'accélérateur au plancher et ne les ratez pas. A la place d'honneur sur le siège du condamné faites monter par exemple, au hasard, Johnny Thunder et Gene Vincent. Les pauvres gars ils n'ont pas eu de quoi acquitter le péage. Et pourtant plus rockers qu'eux, tu meurs. D'ailleurs ils sont morts.
De bonnes surprises tout de même, Booker T and the MG, Dr Feelgood, Ian Dury, ceux-ci nous agréent, les seconds couteaux du rock and roll qui sont systématiquement chargés des missions de la dernière chance. Les commandos de l'ombre qui vivent sur l'ennemi et ravissent le coeur des fans.
Oui mais aussi des insanités sans nom, Chic ( sans Sheila ), ABC, Depeche Mode, U2, Air... le genre de truc infâmes et informes que vous n'emporterez jamais sur une île déserte. Sur un continent surpeuplé non plus. L'on a tout de même échappé à NTM et Daft Punk ( très crétin mais du tout punk ). Z'ont fait aussi un effort : pour Led Zeppe ils ont choisi le III, moins attendu que le II mégalomaniaque ou le IV aussi majestueux qu'une crue du Mississippi. Pour James Brown pas de Live à l'Apollo, un truc plus rare, Soul On Top, qui était passé un peu inaperçu par chez nous en 1970.
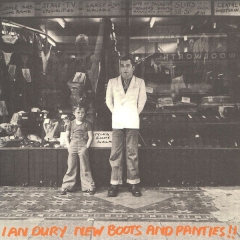
Un genre de bouquin qui ne révolutionnera pas la critique rock ! Un peu comme ces glaces qui s'étalent dans la devanture du marchand de cornets, sans dès. De belles couleurs qui donnent envie de gerber dans le caniveau rien qu'à les voir. Et puis d'autres au parfum subtil ou vigoureux dont vous ne vous lasserez jamais. C'est cela le rock and roll, vous ne savez jamais si c'est de l'arnaque ou du forever. Mais en réalité, l'on s'en fou, l'on sent fort, c'est tout de même du rock and roll. Et puis, surtout ne pas oublier le disque d'Elvis. My happiness !
Damie Chad.
22:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eagles od death metal, l7, hot slap, spunyboys, ol' bry, philippe manoeuvre, f. j. ossang, eric morandi, beatriz gutierrez
11/11/2015
KR'TNT ! ¤ 255 : DESPERADOS / DERELLAS / JON AND THE VONS / HOWLIN'JAWS / ELVIS PRESLEY / JEAN COCTEAU / JOHN LEE HOOKER/
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 255
A ROCK LIT PRODUCTION
12 / 11 / 2015
|
DESPERADOS / DERELLAS JON AND THE VONS / HOWLIN' JAWS / ELVIS PRESLEY / JEAN COCTEAU / JOHN LEE HOOKER |
BETHUNE RETRO / 29 & 30 Août 2015
DESPERADOS DE LA MEDUSE
— Dis min tio Quiquin, ya les Desperados qui jouent à Béthune !
— C’est des bières ?
— Maiiis non ! C’est des Amerloques ! Y sont sur Wild !
— C’est qui Ouald ?
— Oh ben c’est une maison de disques sérieuse ! Le directeur y s’appelle Reb Kennedy et j’connais même un chti gars qu’a fait le diji à sa cérémonie d’mariage ! Tu vas voir, min tio Quinquin, ça va bien te plaire ! Allez, grimpe !
Bébert démarre sa mobylette - rrrrommm tha-tha-tha - et Quinquin monte sur le porte-bagages. L’engin démarre péniblement et dégage un gigantesque nuage de fumée puante. Ils prennent le virage tout doucement et s’élancent pour attaquer le faux plat à la sortie de Nœux-les-Mines. Rrrrommm tha-tha-tha !
Sur la route qui conduit à Béthune, une Harley ralentit et roule un moment à leur hauteur. Un biker aux bras couverts de tatouages leur lance :
— Hey les péquenots ! ‘Pouvez pas rouler droit et rester sur la gauche ? Vous vous êtes arsouillé la gueule ou quoi ?
— Oh chest bon ! Chest pas passe que t’as une grosse moto qu’y faut nous chercher des poux ! Digage ou j’te fais bouffer tin kapio !
Et derrière Quinquin ajoute :
— Attends té, té vas vir, té vas printe une guiffe !
Le biker éclate de rire et accélère. Il disparaît en souplesse.
Les deux amis entrent dans Béthune et roulent au pas vers le centre-ville. Des bonnes femmes gueulent sur leur passage, à cause de l’odeur.
— Mais y roulent à quoi ces deux-là ?
Ils passent devant les voitures de collection garées en épi le long du trottoir.
— Oh ben t’as vu les carettes ! Nom d’un p’tit bonhomme ! Ça doit ben plaire aux cocottes des carettes pareilles !
— T’as ben raison min tio Quinquin, mais ça doit coûter cher d’essence ! Ma bécane elle coûte ren ! C’est moi qui distille l’carbu !
Ils vont jusqu’à la place du 73e et garent la mobylette entre deux Ford customisées. Des touristes approchent pour photographier la mob. Un type aux cheveux blancs interpelle Quinquin :
— C’est un modèle de quelle époque ?
— Oh ben y doit ben dater d’pépère !
Bébert et Quinquin vont s’installer à une terrasse de café, juste en face de la scène dressée au fond de la petite place. Quinquin lève le bras :
— Garchon ! Armet les verres !
— Qu’est-ce que j’vous sers ?
— Ben deux Secret des Moines !
Comme il fait beau, toutes les filles ont les bras nus.
— Oh ben dis donc min tio Bébert, t’en auras pas une qu’a pas des tatouages !
— Y paraît qu’chest la nouvelle mode ! Toutes les cocottes y s’font tatouer la couenne et min pauv’ Quiquin, t’as pas idée d’jusqu’où y peuvent aller !
Sur scène, DJ Boulle annonce les Desperados :
— Dans quelques minutes, vous allez pouvoir applaudir les Desperados ! Ouaissss ! Y viennent de Los Angeles ! Ouaissss ! Merci Béthune ! Ouaissss !
Bébert et Quinquin attaquent leur huitième tournée. Ils retrinquent :
— À nous guifes, min tio Quinquin !
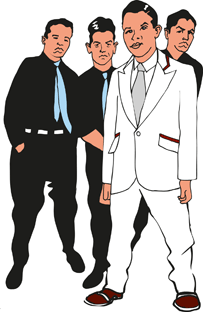
Soudain, Lou Ferns arrive sur scène avec une guitare en bandoulière. Les trois autres arrivent et wham bam, ils envoient une première giclée de rockab bien énervé.
— Vens min tio Quinquin, on va les r’garder d’tout près ! Y sont biaux !
Sur scène, les Desperados boppent comme des démons. Ils dégagent une énergie considérable. Ils envoient un «You Had Your Chance» sauvagement déblayé du plancher - Don’t you want my heart now ! - Ils tapent dans le rockab de base mais quelle base de rockab de base, min tio kiki ! Bébert saute en l’air.
— Oh ben le slap y court comme le furet !

Les Desperados sont très jeunes mais ils impressionnent par leur assurance. Le guitariste David Espinoza semble un peu tendu. Ils envoient un «Gave My Heart» digne des meilleures secouades de beat de bop de bête, ça pulse au sun goes down et ça waohutte dans le temps d’un départ en solo. Ils ont cette rage de vaincre qui va les sortir de l’ordinaire. Lou Ferns chante admirablement bien. Bébert twiste comme un beau diable à la barrière et s’exclame :
— Oh ben qué bestiau c’ui-là !
Sur scène le petit stand-up man a enlevé ses lunettes noires. Il bat sa coulpe sur «She Said Alright», un vrai cut de casse, un bop d’exaction primesautière. Ces mecs y vont dare-dare, ils ne traînent pas en chemin et ne s’embarrassent pas avec les détails habituels. Ils ont même un cut crampsy, «Living A Lie». Ils allient là le beat binaire des Cramps au chant perverti. Ils inspirent le respect, comme Aretha.
Bébert et Quinquin dansent la Saint-Guy au pied de la scène.

Les Desperados redoublent d’énergie pour «Dame Tu Amor» monté sur un beat tendu et visité par un beau brin de folie. Le petit guitariste tendu enfile un solo d’envolée flying-rocket et ça repart à la cloche de bois du bon beat. Lou Ferns profite de l’occasion pour se rouler par terre. Ils ont vraiment le côté mousseux de la bière qui accueille le rescapé du Sahara. Ils swinguent leur pulsatif avec une évidente pugnacité.
Bébert et Quinquin font comme Lou Ferns, ils tombent par terre, mais ce n’est pas pour les mêmes raisons. Des rockab des premiers rangs les aident à se relever.
— Eh ben la gars vous zavez pas l’air frais !
— Garchon ! Armet les verres !
Les Desperados attaquent «Let’s Have A Party» au forceps et le rockab jaillit dans l’azur de l’immaculée conception. Ils développent un beat sacrément secoué du combiné, la pulsion ne doute de rien, c’est sa grande force. Ils tapent dans l’intense de l’immanence. Les Desperados noyautent l’atome du beat. Ils envoient un «Let’s Have Some Fun» magnifiquement carrossé, bien profilé sur le vent, terrible car drivé au gimmickage. Ils y développent ce qu’il faut bien appeler une intense rumeur de menace rampante.
— Oh ben relève-toi min tio Bébert ! Tu vas rater la fin !

Lou Ferns annonce un dernier cut et semble attristé par la mollesse de l’accueil. Les Desperados finissent leur set et disparaissent dans le backstage.
Bébert relève son tio Quinquin et le tire en le tenant sous les aisselles jusqu’à la terrasse. Il commande deux bières. La serveuse refuse :
— Vous voyez pas qu’il a son compte ?
— Ah ben j’boira sa part !
— Vous n’croyez pas que vous avez vot’ compte, vous aussi ?
— Ah ben dis min tio donzelle ! Ché pas té qui va m’faire la leçon d’morale ! Ale l’cu comme une mante à prones !
— Ah ben soyez poli !
Elle s’en va et le patron du bar arrive, l’air mauvais :
— Allez dégage ! Emmène ton pote et dégagez d’ici ! Ouste !
Bébert charge Quinquin sur son épaule et le transporte jusqu’à la mobylette. Il l’assoit sur le porte-bagages et sort des tendeurs de la sacoche. Il enfourche sa mob et passe les tendeurs dans le dos à Quinquin pour les crocher sur son ventre. Il démarre doucement - rrrrommm tha-tha-tha - mais une nuée de touristes lui barre le passage pour faire des photos. Excédé, Bébert accélère et fonce dans le tas.
— Oh mais il est complètement taré celui-là !
Les gens s’écartent et Bébert part en zigzaguant dans une rue en pente. Il prend de la vitesse et débouche sur un boulevard en contre-bas. Un camion arrive et Bébert ne peut pas freiner, parce que les freins ne marchent plus depuis longtemps. Bammmm ! Le camion percute l’engin et nos deux amis font un vol plané d’au moins vingt mètres. Comme ils ne portent pas de casques, ils subissent le même sort qu’Eddie Cochran, dont le crâne avait roulé au sol sur plusieurs mètres. Ils montent directement au paradis. Au moins comme ça, ils ne coûteront pas un rond à la Sécu.
— Où qu’on est min tio Quinquin ?
— Ah ça j’en chais foutre ren !
— ‘Coute ! On dirait du rockab !
Ils marchent dans une sorte de nappe de fumée blanche qui leur arrive à hauteur des genoux. Ils tombent sur un portail en or au dessus duquel est inscrit «Bienvenue les amis». Ils le franchissent et débouchent dans une sorte de parc enchanté. Des petites tables rondes sont installées ici et là, sur lesquelles sont servis des verres de bière. Et sur scène, un trio de rockab joue «Rockabilly Boogie».
— Ah là, min tio Quinquin, j’te parie qu’on est au paradis, passe que les bestiaux qu’y sont là-bas, c’est Johnny Burnette Rock’n’Roll Trio !
Ils s’installent à une table. Quiquin n’en revient pas :
- Oh ben dis, c’est des Secret des Moines ! On n’est-y pas vernis !
Signé : Cazengler desperadis rouge
Desperados. Béthune Rétro. 29 & 30 août 2015
Desperados. Don’t Be Broken. Wild Records 2015
HAPPY BAR / LE HAVRE ( 76 ) / 25 – 10 - 2015
HELAS POUR LES DERELLAS
— Hey Rob ! Le public en veut une autre ! Magne-toi, s’ils s’énervent, ils vont tout casser !
— J’en ai pour une minute, referme la porte, s’il te plaît...
Robbie baisse les yeux et croise la regard vitreux de la groupie qui est en train de lui sucer la queue.
— Here I come baby... Aaaahhhh...
C’est fini. Robbie se reboutonne.
— Comment tu t’appelles, mon petit ?
— Ludella Gore, sucké.
— Reviens me voir après le rappel, je vais te présenter Luca.
Robbie se retourne vers le grand miroir encadré d’ampoules et s’adresse un clin d’œil. Il balaye d’un geste lent une longue mèche noire tombée sur la joue. Il porte sur son image un regard profond, comme s’il voulait une fois encore jauger l’insondable puits de son assurance et tester la présence de sa force intérieure qui est celle d’un géant bienveillant. À ce petit jeu introspectif, Robbie est le plus honnête des ogres. Il ne se raconte jamais d’histoires.
Il sort de la loge et remonte le petit couloir jusqu’à la coulisse. Son guitar tech lui tend la fameuse Gibson blanche, sa guitare fétiche. Robbie fait un signe de tête et le régisseur bondit sur la scène du Zénith :
— Vous en voulez encore ?
Le public hurle. Alors le régisseur jette un peu d’huile sur le feu.
— Je n’ai pas bien entendu...
Une ovation lui répond.
— Whoooooahhhhhhhhh !
— Puisque vous en voulez encore, les voici ! Boys and girls, here come the... DeRellas !
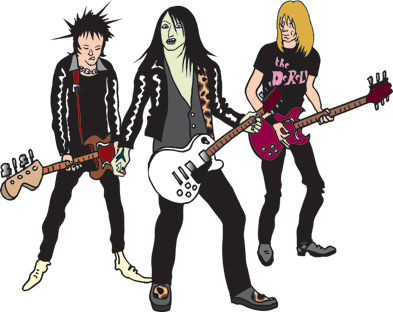
Les quatre musiciens reviennent s’installer sur scène dans un chaos de hurlements, de pieds tapés et de claquement de mains. Franchement, depuis les grands concerts des sixties, on n’avait plus revu une chose pareille. Les bouncers de la sécurité passent leur temps à tirer par dessus les barrières des corps évanouis pour les faire évacuer sur le côté. La pression passe le cap de la tolérance.
Sur scène, Robbie Tart promène lentement son regard d’ogre doux sur la marée humaine. Il met la main à l’oreille comme s’il se trouvait à l’orée du bois pour guetter les cris des animaux. Robbie est à la fois un géant du rock et le géant des vieilles légendes anglaises, celles qui remontent au temps où les Romains appelaient les habitants de l’île les Angles. Il fascine autant que Ian Anderson en 1968, à l’aube de Jethro Tull, ou qu’Alice Cooper maniant le fouet, au temps de «Love It To Death». Sous son épaisse tignasse de cheveux corbeau, Robbie arbore un faux air de Tiny Tim croisé avec Fagin, the Artful Dodger de Dickens. Ce visage aux traits épais abrite l’anse d’un regard à la fois perçant et rieur qui confère à sa physionomie une singulière mobilité.
Il se rapproche du micro...
— Thank you ladies and gentlemen, we’re the DeRellas from London and now it’s time to get a little more fun but before we start it all over again we’ve got to thank you ladies and gentlemen for comin’ down here tonight and now here we come so let’s kick out some good ol’ rock’n’roll... Hank ya !
Seb DeRella tatapoume un vieux drumbeat d’antho à Toto et Robbie pince de ses gros doigts aux ongles peints en noir les deux cordes graves sur le manche de la Les Paul.
— The night we met I knew I needed you so...

Et ils envoient la plus spectaculaire reprise de «Be My Baby» qui se puisse imaginer ici bas. Il semble que le Zénith soit au bord de l’explosion nucléaire. Les DeRellas atteignent ce niveau extrême de puissance et de classe qui télescope de plein fouet l’une des légendes les plus vitales de l’histoire du rock, celle de Phil Spector. Ça nous renvoie aussi au temps où tremblaient les colonnes du temple, lorsque la Revue d’Ike & Tina Turner attaquait «I Want To Take You Higher» de Sly Stone. Ça dégoulinait littéralement de légendarité.
Le lendemain, les DeRellas cuvent à bord de l’avion qui les emmène au Japon. Robbie sirote son cognac en songeant déjà à la façon dont il va saluer ses plus gros fans, les Japonais - Hello Osaka ! Goodbye Paris ! - Son gros cœur se pince à l’idée de l’accueil qu’il va recevoir sur scène. Pas de meilleur public au monde, se dit Robbie. Ce sont eux les japonais qui ont accueilli les Runaways comme des stars alors qu’on les méprisait à Los Angeles et à Londres. C’est aussi au Japon qu’on vénérait Suzi Quatro, Johnny Thunders et Cheap Trick. Ces éternels adolescents que sont les Japonais sont restés friands de glam-punk. À l’aéroport, ils sont des milliers à brailler DeLellas ! DeLellas ! DeLellas ! Une limousine les emmène à Shinjuku, au fameux Hilton Tokyo Hotel et là dans le grand hall, des ambassadeurs du show-business local les accueillent avec des manières de prélats. Ils sont aussitôt pris en main par des hôtesses expertes en art de vivre, mais vous connaissez la chanson. Robbie et ses amis n’offrent aucune résistance. Ils se laissent entraîner dans le tourbillon rimbaldien réservé aux grands de ce monde.

Avant de monter sur scène, Robbie et ses amis sirotent quelques verres de saké en compagnie des habituels veinards inscrits sur la guest-list. On voit pas mal de célébrités, des acteurs de passage à Tokyo, des rockers américains, toujours à la limite du m’as-tu-vu, comme par exemple ce funeste trio composé d’Alice Cooper, de Joe Perry et de Johnny Depp, et des gens du monde de la mode. Un courtisan s’approche de Robbie :
— Les DeRellas devraient sortir un Live In Japan !
Robbie plonge son regard dans celui du donneur de conseils.
— On hésite encore, amigo. Ce sera plutôt in Live On Mars, if you see what I mean...
Seb DeRella déambule à travers la faune des invités. Il porte le cheveu jaune salement décoiffé et un blouson de cuir noir à franges. Comme Robbie et les deux autres, il est né rock star. Pas besoin de le voir jouer pour savoir que c’est un vrai batteur. C’est écrit sur son visage. Et pas n’importe quel batteur ; un batteur anglais, spécialiste du jeu dépouillé.
Sur scène, ils déclenchent une tempête en attaquant «Freak Show». Robbie fait ses grimaces de bateleur et c’est plus qu’il n’en faut pour provoquer l’hystérie générale. Timmy saute en l’air avec sa basse et de l’autre côté, Luca fait aussi le show. On voudrait le voir comme un Johnny Ramone, mais il est plus Sweet que Ramone. Il gratte sa vieille SG à cornes et le visage masqué par sa frange, il exprime sa hargne par une belle succession de rictus. Luca sonne comme le meilleur glamster d’Angleterre et il bouge sur scène comme Fred Sonic Smith. Même classe et même orgueil seigneurial.

Trois jours plus tard, les DeRellas jouent à guichets fermés au Madison Square Garden de New York. Quelle affiche ! Les Dolls reformés et les Vibrators font leur première partie. Assis dans sa loge, Robbie feuillette les magazines américains qu’une attachée de presse vient de lui ramener. Il est en couverture de Time et de Newsweek. Son manager entre sans frapper.
— Hey Rob ! Alice Cooper, Rod Stewart et Keith Richards sont là, dans le couloir. Ils insistent pour venir te serrer la pince !
— Oh non pas eux... Dis-leur que j’ai mal aux dents. Vas plutôt me chercher Knox et David Johansen qu’on se poile un peu. Et ramène quelques bouteilles de Moet bien fraîches, je sais que David adore ça.
Sur scène, il règne la même ambiance qu’au temps des grands concerts des Stones. Le public américain est là pour prendre du bon temps, et les DeRellas ne sont pas avares, bien au contraire. Vous voulez du heavy glam anglais ? Alors voilà «London A Go-Go» ! Explosion ! Vous voulez de la nostalgie fatale ? Alors voilà «Baby Baby», ce vieux hit des Vibrators. Ré-explosion et retour brutal dans le monde réel, celui d’un petit bar du Havre. Mais au fond, on ne sait pas exactement qui revient se fondre dans le monde réel : le narrateur ou les DeRellas qui jouent une fois encore pour une poignée d’admirateurs ? On ne sait plus dans quel sens se franchit la frontière qui sépare la fantômisation des choses du monde réel. Est-ce bien le moment de s’interroger, alors que les quatre Anglais font claquer au vent havrais l’étendard du glam anglais ? Ils jouent à un mètre de distance et cette proximité ajoute encore à la confusion ! Tout cela paraît tellement irréel. Rêve-t-on aussi ses pensées ? Est-ce en dormant qu’on bricole des éloges ? Est-ce dans le rêve éveillé qu’on s’enivre de respect pour les très grands artistes ?
Signé : Cazengler, DeRellaminé
DeRellas. Happy Bar. Le Havre (76). 25 octobre 2015
DeRellas. Hollywood Monsters. Crushworld Records 2009
DeRellas. Slam! Bam! Key Production 2014
06 / 11 / 15
LA MECANIQUE ONDULATOIRE
JON AND THE VONS
HOWLIN' JAWS

Bastille. On ne la prend pas, mais vu la conjoncture on devrait. En tout pas ce soir, on n'a pas le temps. Sortie du métro, direction La Mécanique Ondulatoire. Rue de la Roquette – une pensée émue pour le l'album photo Roquette Rockers de Ken Pate édité en 1976 – vendredi soir beaucoup de monde dans les cafés, phénomène parisien habituel mais à chaque fois des plus surprenants quand on vient de Provins la belle endormie... qui n'est pas prête de se réveiller... Un groupe de malotrus bloque l'entrée de La Mécanique – le grain de sable dans l'engrenage – pas de panique ce sont les Howlin' qui prennent le frais.
En règle générale les quatuors à cordes qui passent à la Méca sont un peu électrifiés et bruyants. Bar à bière pour les buveurs au rez-de-chaussée, les opérations ondulatoires sont sises au sous-sol, une belle cave voûtée comme l'on en voit dans les films sur les vampires cryptophiles. Longue et étroite, un comptoir à gobelets plastifiés au fond, et l'avant occupé par une scène peu surélevée et surtout pas bien large.
JON AND THE VONS

Réussissent tout de même à se caser tous les cinq. Sont facilement repérables dans leur sweat-shirt verts à grosses bandes noires, ressemblent aux frères Dalton entassés dans une geôle pas prévue pour les familles nombreuses. Ne sont pas des échappés d'une bande dessinée, seraient plutôt des adeptes du retour dans le passé, early sixties. Garage band remisé dans la cave aux souvenirs. Oui mais quand le présent s'avère d'un gris terne et tenace la reviviscence des jours anciens peut sembler nécessaire. Jon est au micro, sur lequel il l'a adapté une bouteille plastique d'eau minérale – est-elle remplie de ce seul liquide peu astringent ? en tout cas aucun poisson rouge n'y batifole – à laquelle entre deux couplets il s'alimente grâce à une sonde. Tuyau siphon qui ondule, nous sommes à la mécanique et tout baigne dans l'ordre logique des vases communicants. Mais arrêtons de nous préoccuper des fuites d'eau. Surtout que Jon and the Vons font du garage, mais pas les finitions pour les voitures de luxe. Pas du genre à paraffiner les enjoliveurs. Flash and Crash dès le deuxième morceau, pour vous renseigner sur la méthode désirée, à toute vitesse et à grands coups de marteau. Brut de décoffrage. Sixties, si vous voulez mais un peu à la Ramones, moins lyrique pour l'épaisseur du son que les faux frangins mais on the speed. Le set s'envole après My Brother the man, une joyeuseté des Fuzztones qui décolle. De là où je suis l'on ne voit que les guitaristes, la basse de Julien qui prend de plus en pleur d'ampleur au fur et à mesure que le show avance. Max est invisible, mais ce n'est pas grave, sait se faire entendre, mouline salement sur ses drums, Jon et sa Dan Electro monopolise un peu l'attention, mais il ne faut pas longtemps pour comprendre qu'il faut surtout zieuter un max la télécaster de Fred. Griffée de partout, preuve qu'il ne la ménage pas. J'ai gardé la dernière place pour Sally. Cheveux court, et yeux turquoises ( l'on dirait deux papillons bleus ) : de temps en temps les boys lui laissent un semblant d'espace – faut bien que les filles s'expriment - pas pour un véritable solo, non, mais son orgue met en évidence l'articulation des morceaux.

Une flopée de fans s'agitent par devant, connaissent les morceaux par cœur, invectivent Jon et sont dedans à mille pour cent. Notamment un frère jumeau de Brian Jones qui secoue sa crinière blonde, entouré d'une troupe de mods plus vrais que nature. Avec un tel soutien Jon and the Vons vont couper les joncs de nos émotions. Carburent encore plus vite et plus fort. Un Let's Make it Pretty Baby – sont des dénicheurs de vieilleries qu'ils ripolinent au goût du jour – un We're Pretty Quick qu'ils ont shobé dans un bac à soldes de l'inventaire 66, et... ils paraissent les premiers surpris que ça s'achève si vite. Ont déjà décroché de leurs instrus lorsqu'ils s'aperçoivent que dans le public survolté personne ne comprend que c'est la fin de la partie, alors ils nous offrent un petit rappel que nous n'avons même pas eu le temps de demander. Deux minutes de bonheur et l'histoire se termine là.
Vous vouliez du rock, vous voici servis. Vous trouverez difficilement mieux. Le rock asséné avec le tranchant de la lame. Expédition punitive. Pour le plaisir. Pour le plus grand bien de tous.
HOWLIN' JAWS

Pas le temps de nous ennuyer. Jon et et ses sbires n'ont pas fini de déménager que les Howlin' montent à l'assaut de la scène. Baptiste visse ses cymbales avec la célérité d'un Ouvrier Spécialisé sur une chaîne de chez Renault, Lucas malmène sa guitare tourné contre le mur et Djivan tire sans regarder sur la corde de sa contrebasse. Le geste auguste de l'Héraclès de Bourdelle bandant son arc. Les dieux ne le lui pardonneront pas. L'on change de groupe, et de public. Les mods se sont éclipsés, sans dire un mot. Sont immédiatement remplacés par une foule de jeunes gens, beaucoup d'étudiants, et d'étudiantes ce qui ne gâte rien. La cave est pleine, une souris n'y retrouverait pas son trou. Ce n'est pas grave, les trois matous sont sur scène, et le grabuge commence.

La colère des dieux ne tarde pas à se manifester. Djivan sera touché le premier. La malheureuse corde de la big mama se barre. C'est Djivan qui fait une aussi sale mine que les Perses à Salamine. Un trio de rock sans contrebasse et sans chanteur c'est un peu comme peu comme le fameux couteau de Lichtenberg, le canif sans lame auquel il manque la lame. L'air de rien les deux acolytes s'essaient à quelques variations harmoniques tandis que Djivan s'affaire sur son outil qui gît lamentablement à terre. Pas de panique, quand le rock faillit, il reste le fanal rouge du blues pour vous indiquer la marche à suivre et Lucas – première fois qu'il chante sur scène – fait craquer sur sa guitare les jointures d'un vieux morceau de Creedence. Ouf sauvé ! Djivan a réinstallé sa corde à sauter et c'est reparti comme en quarante. Pas pour très longtemps, Lucas agite désespérément sa planche à tricoter pour qu'on vienne lui changer sa corde cassée. Heureusement que la télécaster de Fred est restée sur scène. Sauvés ! Non, n'en sont pas encore quitte avec la force mauvaise de l'ananké mythologique. C'est autour de Baptiste qui hurle pour demander une clef à batterie. Cogne tellement fort que les peaux semblent flotter comme des tranches de mortadelles dans leur sachet de cellophane. Ce coup-ci, nous avons épuisé la coupe du malheur. A la lecture de ce paragraphe vous imaginez la catastrophe. Le bal des bras cassés, le set maudit, la malédiction honteuse, le souvenir cuisant, le concert raté. Pftt ! Pftt ! Erreur sur toute la ligne. Trois épiphénomènes qui n'entravèrent en rien la tornade dévastatrice des Howlin'Jaws.

Ultime précision avant d'entrer dans la fournaise. Les Howlin' Jaws proviennent du rockab. Mais ce ne sont pas des puristes à l'oreille faisandée. Pas tout à fait des adeptes du western swing. Il y a longtemps qu'ils ont soufflé sur les anciennes bougies. Ne s'éclairent plus qu'à l'électricité. Sont plus près des Who première mouture que de Gene Autry. Les Howlin Jaws ce sont les hurlements de l'énergie et les incisives du rock and roll.

A première oreille ils interprètent des morceaux, peu de reprises, beaucoup d'originaux. Mais ce ne sont que des alibis. Font seulement du rock and roll. De temps ils s'arrêtent, se passent un peigne dans les cheveux et recommencent illico. C'est leur coquetterie, jouent comme des sauvages mais refusent d'être dépeignés. Le dandysme est une dimension occulte de notre musique. Les Howlin c'est de la broderie au marteau-piqueur, faut écouter Lucas pour comprendre, tonnerre et staccato, les notes une par une et le son comme des bouffées délirantes. La foudre qui vous broie et puis l'éclair qui dessine des zig-zag uniquement parce que c'est plus beau avec de la couleur. Teinte péril jaune. Quant à Baptiste, quand il a acheté sa caisse à bruit, s'est trompé de notice d'utilisation. L'a emporté celle du marteau-pilon. Plus celle de la mitrailleuse à balles ricochantes. Possède l'art des rafales insistantes. L'a toujours l'impression d'avoir un coup de retard, alors il vous en refile trois pour le même prix. C'est sur cette espèce de catapulte-tam-tam que Djivan se règle. N'en fait qu'à sa tête, quand je veux – le plus souvent possible – comme je veux – le plus fort possible. Et par-dessus le tintouin, il chante. Genre je lâche une bombe sur la centrale nucléaire car je ne sais pas faire autrement.

Le plus terrible c'est la résultante de l'action conjointe de ces trois mousquetaires. Les spectateurs ont disparu. Engloutis dans un gigantesque conglomérat pogoïque. N'y a plus qu'un entremêlement sans fin de corps qui s'entrechoquent. Aucune brutalité, mais une immense vague de jouissance festive. Parfois Lucas s'avance jusqu'au bord de la scène se cambre et lâche quelques riffs de sang et de sueur. L'aimerait bien se jeter dans ce magma brûlant, mais l'a un fil à la patte, le cordon ombilical du rocker, et il revient vers son ampli et de dépit il émet quelques embardées électrifiées qui font hurler la foule.
Du rock vivant. Qui refuse d'entrer au musée. Les Howlin' Jaws sont comme ces groupes anglais des sixties, entés sur les racines mères du rock and roll et du blues, et qui en ont fait autre chose. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est l'esprit.
Ont tout donné. Arrêtent au bord de l'épuisement. Une dernière clameur et tout se tait. Personne n'aurait idée d'en exiger un chouïa de plus. Sont remerciés de toute part. La salle se vide. Total respect.
Damie Chad.
( Photos Howlin' Jaws FB : GUENDALINA FLAMINI PHOTOGRAPHER
prenez le temps d'admirer son travail, sa passion )
ELVIS
BALLADE SUDISTE
DENIS TILLINAC
( Librio 186 / 1997 )
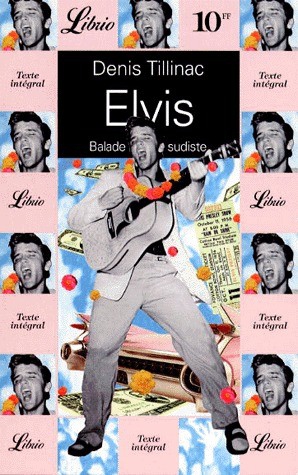
Denis Tillinac n'est pas un gauchiste. C'est son droit le plus absolu. N'est pas né avec une cuillère en bois dans le gosier, cette dernière caractéristique explique vraisemblablement ses choix politiques. Fut un compagnon de Chirac – dans sa jeunesse il était naturellement gaulliste – fut tout de même de ceux qui décidèrent d'apporter une aide franche et massive à Nicolas Sarkozy lorsqu'il brigua pour la deuxième fois le mandat de la présidence de la République. Ecrit dans Le Figaro, Valeurs Actuelles et Marianne. Se présente volontiers comme un homme qui ne partage pas les valeurs de gauche. Serait à ranger dans la catégorie des conservateurs bourrus, des réactionnaires populistes. Aime le rugby et le foot-ball. Pour ma part j'ai toujours eu l'impression que la profession de l'amour du sport vous déclasse un homme beaucoup plus que la couleur de ses chaussures. Opinion toute personnelle que j'émets sans réserve. Bref vous le comprenez, Denis Tillinac ne fait pas partie de mes héros. Toutefois je suis comme tout un chacun, plein de contradictions, même si je ne partage pas ses idées, je ne dédaigne pas me pencher sur ses écrits. L'être humain est ainsi constitué que souvent ses productions sont supérieures à sa propre personne. Ce n'est pas un hasard si j'évoque en début de cette chronique sur Elvis Preley le caractère et le parcours de l'homme qui écrivit ce livre.
L'est une zone d'ombre dans la vie de Tillinac – elle n'est sombre que pour lui-même et je n'en aurais point parlé si lui-même n'y faisait à plusieurs reprises référence dans son texte. Faut le comprendre, né en 1947, l'a vingt ans et des poussières en mai 68, et cela fait déjà un bail qu'il adore Elvis Presley. L'a commencé par Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Dick Rivers. Comme tout le monde de sa génération serais-je tenté de dire. Ensuite l'a suivi la démarche logique, des intercesseurs l'est passé à l'Initiateur. Coup de foudre immédiat à la première écoute. Ne s'en remettra jamais. A tel point que trente ans plus tard l'est obligé de le raconter dans ce récit.
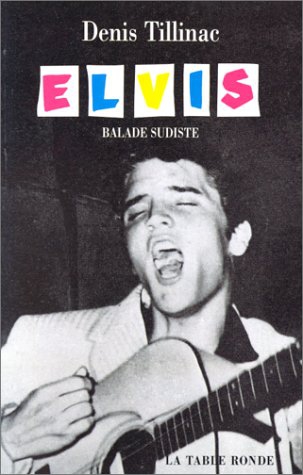
N'a suivi que son instinct. L'évidence : Elvis is the King. Point, barre. Circulez, il n'y a rien à voir. N'est tout de même idiot le Denis, l'est même intelligent et il se pose des questions. Comment lui, l'homme d'ordre, d'identité terroirtoriale, et de tradition a-t-il pu s'enticher d'un artiste qui quelque part, métaphoriquement parlant, est le symbole même de cette chienlit – essayez de percevoir et de goûter à sa juste valeur dans l'emploi de ce mot la signifiante racine hounddoggienne - que dénonçait le Général pour siffler la fin de la récréation festive du joli mois de mai.
Maintenant s'il fallait éliminer tous les gens de droite qui aiment le rock and roll, ce serait un sacré boulot. Ne serait-ce qu'en commençant par les artistes. Oui, mais Denis Tillinac est un homme de son époque. L'en a souffert à tous les étages. Rez-de-chaussée : le rock est une musique sauvage de rebelles or Denis se classait parmi les traditionalistes. Premier palier. De compression : le jeune homme qui se sent un peu décalé par rapport à l'immense majorité de sa génération est en proie à un trouble insidieux. Porte Elvis aux nues. Mais l'Elvis des années 54 – 58. Les disques Sun et avant le départ pour le service militaire. L'Elvis du début des sixties lui semble une reculade. Little Sister, c'est bien mignon, c'est même un parfait bibelot, mais quand l'on compare à Jimmy Hendrix et Janis Joplin, l'est difficile de convaincre les copines que le roi du rock c'est lui.
Lui faudra grandir. Et peut-être pire, lui faudra vieillir, pour convenir que la période early sixties c'est de la bonne came. Mais à ce moment le cauchemar ne fait que commencer : alors qu'il pense monter les marches qui mènent au deuxième étage, ne voilà-t-il pas qu'il s'aperçoit qu'il est sur un escalier roulant qui descend. L'escalade devient épuisante. Elvis lui tend-il la main - exemple le NBC show dans son costume de cuir noir - qu'il le repousse vers le bas en entonnant la prochaine bande-son de son futur navet...
Rien de pire que de ne plus croire en son dieu. Notons que le cas de Tillinac n'est pas extraordinaire. Les fans déçus de Presley se comptent par millions. Mais les cocus du destin aiment bien se raccrocher au mythe de l'amour éternel. La vie à deux est une affaire de concessions nous apprennent les psychologues du couple. Alors Tillinac décide de remonter à la naissance de son amour. Plus loin que le petit Denis à qui un copain fait écouter Jailhouse Rock, au tout début de l'origine, à Graceland, à Memphis, à Tupelo, à la Nouvelle-Orleans. Peut pas descendre plus loin. Le livre retrace donc ce double voyage de Tillinac, à l'intérieur de lui-même, and in the deep south des Etats-Unis.
Le livre a été écrit en 1994, voici plus de vingt ans. Etrangement durant ces deux décennies la gloire de Presley ne s'est pas démentie. S'est même amplifiée. N'est pas rare de rencontrer des admirateurs du big Boss qui révère avant tout la dernière période, l'Elvis bouffi sous perfusion médicamenteuse qui ânonnait son gospel de variétoche faisandée. L'est vrai que le moindre morceau d'Elvis vous file le frisson, soit il est grand, soit il est pathétique. Et aucun chanteur ne parviendra à être aussi pathétique qu'Elvis. La carrière d'Elvis décrit une parfaite parabole. La trajectoire sans défaut d'un corps qui tombe. La chute fatidique de la Maison d'Usher, mais le coucher d'un soleil est aussi beau et peut-être même plus grandiose que son aurore matutinale. Victorieusement fui le suicide beau, nous a averti Stéphane Mallarmé.

C'est comme les grandes glaciations, faut faire avec. Et même pire, faut vivre avec. Car le fan survit à l'idole. L'est même de son devoir d'en prolonger l'existence. Sur les routes du Sud, de ville en ville Denis Tillinac se coltine avec la légende d'Elvis Presley. Sa mort n'est pas la partie la plus terrible de l'histoire. C'est celle de sa survie qui passe mal. Faut trouver des excuses et des explications. Presley cadavérisé par son succès, le brave gars qui se fait bouffer par son entourage et son impresario. Un jeune boy qui voulait être beau et célèbre. Qui réussit son rêve. Et qui se trouve incapable d'en forger un autre. Le King s'ennuie. S'enferme dans sa vie. L'est dans une impasse. La highway ne s'enfonce pas plus loin dans le désert. Elle est le désert. Victor Ségalen signale que le premier voyage autour du monde fut aussi le plus désenchanté, le plus désespéré : il n'existait plus d'extrême lointain sur notre planète, ni dans la vie d'Elvis. No future, Elvis fut le premier punk.
Terrible à entendre : très tôt Elvis n'est plus Elvis. Une marionnette obéissante aux mains du colonel. Plus bête que méchant, Mister Parker, l'aurait fallu un Napoléon de la stratégie méta-commerciale mondiale, et Elvis a récolté un bateleur, un Monsieur Déloyal du Cirque, prêt à scier le trapèze où triomphe son artiste. Et Elvis qui voue à son geôlier la reconnaissance du pauvre qui baise les mains du patron qui lui verse un salaire de misère. Notre auteur se faufile dans la tête d'Elvis, l'essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Rien, du vide, creuse caboche. Le sentiment de mal-être a été refoulé. S'accumule, telle de la mauvaise graisse dans les replis onctueux du corps. Tillinac n'y peut croire. L'a besoin de trouver une once d'humanité dans le pantin téléguidé qu'est devenu Elvis. Lucy de Barbin sera désignée pour ce rôle. Une jeune fille qu'Elvis a connu dès 1953 et à qui il aurait laissé espérer la vie commune. Jusqu'au bout, jusqu'aux derniers jours de son séjour terrestre. A pleurer. Lucy n'est-elle qu'une mythomane qui se serait inventée une seconde vie pour ainsi dire à crédit et schizophrénique ? Denis Tillinac élude le problème. En plus Lucy possède à ses yeux un atout magistral. L'est – son nom le prouve – d'ascendance française. Enfin un élément qui réconcilie Elvis avec la vraie vie et qui établit un pont entre la diablerie rock and rollienne et l'idéologie droitiste et identitaire de l'auteur. Lucy est la lampe dans la tempête, celle qui jette une lueur apaisante sur le naufrage d'Elvis Presley et qui dénoue les contradictions tillinaciennes.
L'avait déjà essayé d'établir une solution en opposant le protestantisme étriqué de l'Amérique blanche et puritaine au catholicisme de la ferveur noire dans ses églises, elles aussi d'obédience réformée... Faute de viande l'on ronge les os, mais un Presley en quelque sorte catholisé à son insu par son amour du gospel en devenait pratiquement un citoyen de la fille aînée de l'Eglise papalement universelle. Ce n'est pas que Tillinac soit un esprit particulièrement religieux, mais en rattachant d'une manière forcée, acrobatique et symbolique, Elvis à la tradition de la France il mettait un terme à ses propres déchirements personnels.
Tout cela en filigrane. Tillinac est trop doué pour avancer avec aux pieds les sabots boueux des intentions secrètes. Les traces qu'il laisse sont légères, mais néanmoins persistantes pour ceux qui comme nous refusent d'être dupes des agissements de leur auteur. Cette Balade Sudiste est à lire, c'est un véritable écrivain qui nous parle d'Elvis. Nous évoque Elvis mais aussi William Faulkner et Erskine Caldwell, tous trois, illustres fils du Sud. Si en 1883, Ernest Renan éprouvait le besoin de nous faire part de sa Prière sur l'Acropole, un siècle plus tard, Tillinac nous offre sa méditation à Graceland. Signe que les temps ont changé. Le rock and roll serait-il devenu pour nos générations aussi important que le legs spirituel de la Grèce ?
Damie Chad.
ETONNANT COCTEAU
Ne s'agit point dans cet articulet des Cocteau Twins célèbre groupe écossais mais de Jean Cocteau, le poète. Les amateurs de rock ne sont pas ignorer le fameux jungle-salon de Graceland. Peut-être est-ce le sommet du kitch. Dans sa visite du manoir du King, Tillinac ne s'attarde guère sur ce monument tarzanesque de mauvais goût. Perso j'adore, mais là n'est pas le problème. Je n'y pensais point lorsque la semaine écoulée je vins à visiter la maison de Jean Cocteau sise à Milly-la-Forêt. Dans le bureau une pile de disques rappelle que dans sa jeunesse Jean Cocteau fut batteur dans un groupe de jazz. Ses écrits sur cette musique sont à lire :
« Soudain l'orchestre ressuscite, les morts qui dansent s'éveillent de l'hypnose et le Lindy Hop les secoue. Sur quelle herbe ont-ils marché ? Sur la marihuana, l'herbe qui se fume et qui grise. Ces grosses négresses en cheveux et ces petites filles dont la poitrine se cabre et dont pointe la croupe, le chapeau placé comme une gifle, deviennent un lasso que les noirs déroulent et enroulent à bout de bras ( … ) Le drummer est un nègre d'origine indienne. Il roule son tonnerre et jette ses foudres, l'œil au ciel. Un couteau d'ivoire miroite entre ses lèvres. Près de lui les jeunes loustics d'une noce de campagne se disputent le microphone, s'arrachent de la bouche des lambeaux de musique saignante et s'excitent jusqu'à devenir fous et à rendre folle la clientèle qui encombre les tables. »
extrait ( le Savoy à Harlem ) de Mon Premier Voyage, 1936.
Mais la surprise survient à l'étage dans le deux-pièces salon-chambre de l'écrivain. Y avait déjà sur la cheminée du bureau les cornes de buffles et d'antilopes mais là nous sommes en pleine jungle. Larges pans de tapisserie léopard, papier peint plus rockab que celui de Jean Cocteau je n'en ai jamais vu !

Damie Chad
JOHN LEE HOOKER
GERARD HERZHAFT
( Editions du Limon / 1991 )
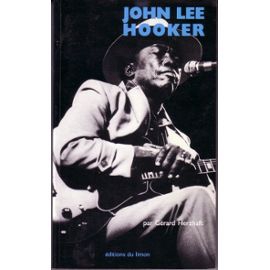
Ah ! Le blues ! Vous voulez que je vous sorte la rengaine, les vieux bluesmen, rejetés, oubliés par le monde entier, le vieux Sud, le racisme, et tout le pataquès. Sortez vos mouchoirs et pleurez. Pas trop. Parce que Gérard Herzhaft – en voici un qui en connaît un rayon de bibliothèque sur le blues, même que les ricains ils ont été jaloux de sa Grande Encyclopédie du Blues ( Fayard ), l'en connaît aussi un sillon d'albums qu'il a abondamment abreuvés de son sang bleu en compagnie de son frère Cisco Herzhaft - il démonte un peu le mythe. Mais pas dans le sens inopportun que vous pourriez croire.
L'histoire commence mal. Quoique à la réflexion l'a tout de même de la chance le bébé John. Né à Clarksdale au coeur du Delta. Ce n'est pas donné à tout le monde. En plus, comble de misère, l'a six ans lorsque son père meurt. Pitié pour la mère qui se retrouve seule avec ses onze marmots sur les bras. Une chance inespérée. Faut savoir rebondir dans la vie. La mama se maque avec un ouvrier honnête, travailleur et bon chrétien. S'appelle Willie Moore, un chic gars qui devient l'idole de ce fiston adoptif. N'a pas que les défauts que je viens d'énumérer le Willie Moore. Toujours prêt à décrocher la guitare pour aller jouer et chanter la musique du Diable dans le voisinage. Avec un si mauvais exemple, le petit John Lee ne pouvait que mal tourner. En plus à la maison il passe du beau monde, Charley Patton par exemple. La voie est toute tracée : sera un bluesman et pas quelqu'un d'autre. Comme la valeur n'attend pas le nombre des années, John Lee fugue à Memphis. L'a douze ans, Willie le ramène au domicile familial. Récidive à quatorze ans, ce coup-ci personne ne le rattrapera.
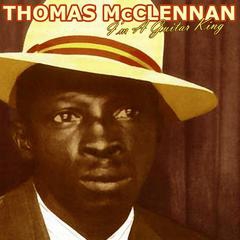
Le temps de l'errance, et de la vache enragée. La route est dure mais les rencontres sont formatrices. Tommy Mc Clennam lui apprend le métier. Très modestement le grand John Lee Hooker ne le répètera jamais assez : son jeu sur les cordes, sa manière de poser la voix, l'a tout copié sur Tommy Mc Clennam. Suivra aussi Tony Hollins, inconnu aujourd'hui, mais c'est lui qui posera les bases du Chicago Blues. A Memphis ( Tennessee ), il fait la manche avec un certain B.B. King qu'il quitte à la recherche d'une improbable célébrité à Cincinnati ( le Kid ). N'y rencontre de bon que l'amour de Martha avec qui il file droit à Detroit, en 1943.
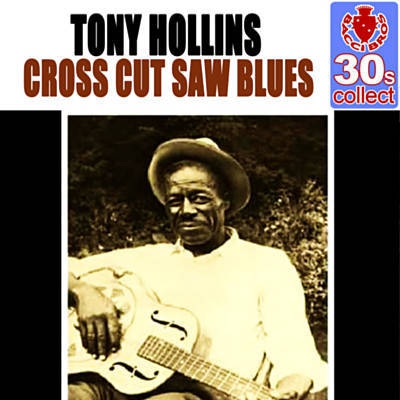
Usines, plein emploi, bonne paye ( n'exagérons pas, comme le disait le grand économiste Einstein, tout est relatif ). Travaille le jour. Joue la nuit dans les cabarets de la dernière chance. Qui lui sourit enfin cinq années plus tard. Nous sommes en 1948 et il vient de dépasser la trentaine... Le label Sensation lui offre l'occasion de l'enregistrer. Et commence même par le payer.
BOOGIE CHILLEN
Enfin l'occasion de montrer ce qu'il a dans le ventre. L'y va franco. Pas de chichi, pas de chiqué. Une ligne droite à fond de train. Pour la romance, la mélodie, la tristesse et la nostalgie, vous repasserez. John Lee Hooker invente le blues qui a la hargne. L'annonce la couleur dès le titre, ce n'est pas du blues, c'est du boogie. La voix qui gueule, la guitare électrique qui rythme, et le pied qui scande le plancher. Ça fuse, mais ce n'est pas marrant. Une musique qui véhicule des wagons d'angoisse. Âpre et sans fioriture. Les temps sont sans pitié.
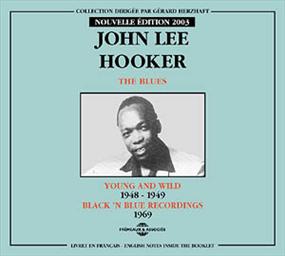
Succès immédiat. John Lee tient le bon bout. De 1948 à 1953, il grave ses meilleurs morceaux. Na pas la tête qui tourne. Sait très bien que l'opulence ne durera pas. Fait feu de tout bois. Enregistre un peu partout. Les labels lui courent après, et lui ne néglige aucune occasion. Peu à peu la mer se retire. N'en est pas aigri pour autant. L'a fait son temps. Analyse la situation avec philosophie. Les jeunes noirs des ghettos se détournent du blues qui leur rappellent trop la honte de l'esclavage.
PETITS BLANCS
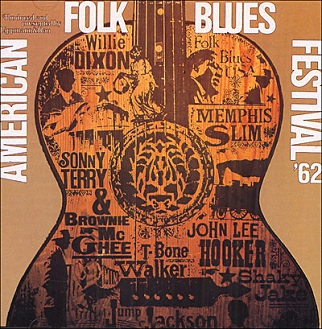
Vend beaucoup moins de disques mais tourne sans trop de problème. La voie de garage si l'on a le courage d'affronter la situation en face. C'est alors que l'incroyable survient. L'Amérique n'aime plus le blues, mais l'Europe en raffole. Pourquoi ? Comment ? Au juste personne n'en sait rien. Mais les faits sont têtus. Un public de jeunes blancs ovationne les vieux bluesmen noirs que personne n'écoute plus chez eux. Ont du mal à y croire. C'est le temps des légendaires tournées de l'American Blues Folk Festival. Lorsque les applaudissements crépitent, se questionnent, ne serait-on pas en train de se payer leur gueule de vieux négros. Se rendent à l'évidence, ces petits blancs si respectueux sont des plus sincères. Et en plus, sont connaisseurs, veulent du blues, de l'authentique, pas un truc abâtardi. John Lee possède une intelligence rare : comprend instinctivement ce que les spectateurs veulent de lui. Se radine seul, une chaise et sa guitare. Un tabac.
REBONDS
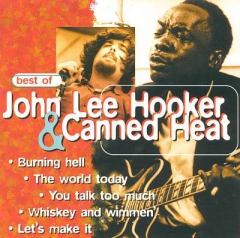
Du coup sa carrière aux States est relancée. D'autant plus qu'au British Boom Blues anglais qui a sensibilisé les amateurs européens, un mouvement similaire se déroule aux States avec Canned Heat. Et ce n'est qu'un début. Après les fous de blues, ce sont ceux qui détiennent le haut du pavé : les marteaux du rock qui s'entichent du boogie blues de John Lee. N'aime pas trop cela. Les morceaux interminables de vingt minutes avec une palette de musiciens prestigieux qui pondent tour à tour leur solo un tantinet prétentieux l'ennuient. Quelques réussites dans le lot et même deux ou trois chefs-d'œuvre, mais John Lee n'est pas dupe. Les albums se vendent et puisque le public en redemande pourquoi se priver des royalties qui permettent de payer maisons, voitures, confort, et de faire vivre la famille sur un pied d'aisance inespérée au chaud soleil de la Californie... Partira dans l'autre monde en 2001, à quatre-vingt trois ans, à peu près le nombre d'albums qui auront été mis sur le marché de son vivant... S'éteint dans le respect unanime. L'est devenu une institution. N'y a que son vieux compagnon B. B. King qui parviendra à susciter une sympathie plus large... Si une vague de vague vous submerge l'âme, remettez-vous une bière, un whisky ou un scotch, ou encore mieux Dimples ou Boom-Boom. Ça casse la baraque...
LE BLUES
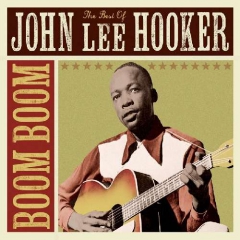
Comme quoi les histoires bleues se terminent parfois très bien. John Lee Hooker aura finement manoeuvré. Les matous, n'oubliez pas que le blues est parfois matois. Prune bleue à l'eau de vie rugueuse sur le gâteau, Gérard Herzhaft nous donne une autre version de l'origine du blues. Un peu d'Afrique – difficile de faire autrement – mais beaucoup du Texas, à l'origine peuplé de vaqueros mexicains qui grattaient leurs guitares au rythme alangui de leurs chevaux. Z'auraient échangé lors de leurs pérégrinations avec la génération des songsters itininérants qui précédèrent et côtoyèrent les bluesmen...
Damie Chad.
PS : for fans only : le texte de Gérard Herzhaft est suivi d'une discographie de soixante pages établie par Marc Radenas. Un régal. Pour ceux qui kiffent les casse-têtes. N'oubliez pas qu'elle ne dépasse pas l'année 1990.
04/11/2015
KR'TNT ! ¤ 254 : VIGON / JC SATAN / JALLIES / BRITISH ROCK ( II) / SIXTIES / BLUES PHILOSOPHIE
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 254
A ROCK LIT PRODUCTION
05 / 11 / 2015
|
VIGON / JC SATAN / JALLIES BRITISH ROCK ( 1965 - 1968 ) : C. DELBROUCK UN AUTRE VISAGE DES SIXTIES BLUES : THE DEVIL / PHILOSOPHIE DU BLUES |
|
POUR ERVIN !
Vous connaissez tous Ervin Travis et son show hommage à Gene Vincent. Vous savez aussi certainement qu’il est très malade, a dû arrêter sa carrière, et galère un max pour se soigner, en raison de la maladie (Lyme) et de l’aspect financier de la chose…. dans lequel il interprétait les Grands standards des années 50. Un CD du groupe est sorti « The best of Rock and Roll ». (et passer un agréable moment d’écoute), achetez le CD. L’argent est reversé intégralement à l’asso’ « Lyme Solidarité Ervin Travis » pour aider Ervin à se soigner. pour en savoir plus, passer commande, etc |
LE MERIDIEN / PARIS ( 13 ) / 31 – 10 – 2015
LA VIGUEUR DE VIGON
On retourne voir chanter Vigon au Méridien et on a parfois l’impression, au cours de ce spectacle qui dure trois fois une heure, d’atteindre les limites d’un système qui est celui du star-system. Non pas que Vigon soit une star, mais il fait définitivement partie des légendes vivantes. Par star-système, on entend la scénarisation des légendes, la façon d’utiliser un lieu à un certain rythme pour continuer à tirer profit d’un nom.

L’avantage est qu’on peut voir Vigon dans des conditions idéales. Il chante à quelques mètres de la table où l’on nous dépose aimablement les cocktails les plus exotiques qu’on va d’ailleurs siffler goulûment sans trop se demander à quoi va ressembler le trajet retour sur l’autoroute - La vie est courte, ne l’oublions pas - Cette proximité avec Vigon paraît chaque fois irréelle, surtout quand on considère que Vigon fait partie des géants de cette terre. Il a su se monter l’égal de Wilson Pickett ou de James Brown dont il reprend les early hits avec une fougue d’étalon sauvage. Quand on voit Vigon chanter «Papa’s Got A Brand New Bag», on comprend qu’il ne fait pas semblant. Il incarne cette soul à la perfe. D’ailleurs, chanter Papa à la perfe, ce doit être à peu près tout ce qu’il sait faire dans la vie. Vaut-il mieux chanter Papa à la perfe que d’assembler des voitures sur une chaîne de montage ou faire le grouillot dans une banque ? Chacun est libre de ses choix. Ou plutôt tributaire de son destin. Destin heureux que celui de Vigon ? D’apparence, oui, mais il faut bien veiller à rester dans cette image de Soul shaker en lunettes noires et ne pas se poser de questions périphériques. Il devait exister UN seul chanteur de soul en France et c’est tombé sur lui. Il faut voir avec quel panache il assume cette destinée ! Vigon capable de chanter de la petite variète à la mormoille ? On ne se pose même pas la question. C’est comme si on avait demandé à Lux Interior d’enregistrer un duo avec Elton John. Dans certains cas, il vaut mieux éviter d’insulter l’intelligence des gens. Vigon incarne Vigon avec une constance spectaculaire et c’est tout ce que le public attend de lui. Shout, mon vieux Balama !

Il existe dans l’histoire de la soul assez de classiques pour occuper un homme passionné comme Vigon jusqu’à la fin de ses jours. On a même parfois l’impression qu’il les connaît tous, ces hits qui pullulent, de Stax à Atlantic, en passant par Motown, Vee-Jay, Specialty, Imperial, Chess, Duke ou King. Il chante depuis cinquante ans et on imagine qu’il a passé tous les bons disques au peigne fin. Oui Vigon reste exceptionnel sur scène. Chacun de ses gestes est aussi inspiré que sa façon de chanter. Il swingue la soul avec le métier d’un vétéran de toutes les conquêtes de l’Empire, il n’a rien perdu de sa niaque de fauve, il sait chauffer un couplet au bon endroit et faire dérailler sa voix le temps d’une syllabe. Rappelons tout de même que ce qui fait la grandeur de la soul, c’est précisément un son hanté par l’animalité du peuple noir. Et on parle ici d’animalité comme on parlerait ailleurs d’aristocratie et de rang. Vigon reste un homme d’un âge certain au port altier. Il est assez haut et on s’épate de le voir déplacer sa silhouette vers le bar entre deux sets. Il file comme le vent. Et puis il a ce franc sourire de crooner de choc. Il a exactement le même genre de classe que celle qui fit la grandeur d’Elvis. Vigon a un charme fou et c’est un artiste exceptionnel. Lors des ponts musicaux, il danse les poings fermés et arbore un rictus de vainqueur. C’est à ces petits signes révélateurs qu’on distingue les vraies stars des fausses. Vigon doit sans doute son salut à un rendez-vous manqué avec la gloire. Cela veut dire qu’il n’est pas tombé dans le piège où sont malheureusement tombés la plupart de ses contemporains, Dutronc et Gainsbourg ayant comme lui réussi à conserver leur intégrité intellectuelle et artistique. Mais pour ça, il faut aussi être particulièrement puissant, et Vigon l’est, ça ne fait pas de doute. Lors de ses petites interventions hors chant, il donnerait presque une image simpliste de lui, celle du pauvre petit Marocain toléré chez des Français repus de colonialisme larvaire, mais quand il chante, il redevient ce Soul man légendaire qui est, avec Vince Taylor, celui qu’on a le plus admiré à l’aube des temps parisiens. Il est d’autant plus le Soul man légendaire de nos rêves adolescents qu’il reprend seul le fatidique «Soul Man» de Sam & Dave. Ah il faut voir avec quelle niaque de poings serrés et de renfermement ! Chaque fois qu’il attaque un hit de cette époque, Vigon semble en effet s’absenter pour entrer dans le jardin magique qu’il a lui aussi découvert quand il était ado, mais dont il n’est jamais ressorti, sauf pour vivre comme monsieur tout le monde, pour remercier le public qui l’applaudit ou pour discuter le petit bout de gras avec les amis qui viennent le saluer au bar. Ne vous souvenez-vous pas de ces vieilles photos de Vigon et les Lemons qui paraissaient ici ou là, dans les Rockers de Jean-Claude Berthon ou, on ne sait plus, dans les pages jaunes des premiers numéros de R&F ? Vigon chantait torse nu sur la scène du Golf. Pur rock’n’roll animal ! Encore mieux : pour son audition devant Henri Leproux, Ronnie Bird lui avait prêté son backing-band. Si ça ne s’appelle pas de la légende, alors qu’est-ce que c’est ?
Ce spectacle au Méridien ne présente pas que des avantages. Il relève aussi de l’inconvénient. Eh oui, la légende se noie parfois dans le spectacle. Vigon est pourtant accompagné par une équipe au dessus de tout soupçon, les Dominos, mais on se retrouve dans une ambiance de cabaret parisien, avec des rites propres à ce genre d’endroit. Des gens peuvent y manger pendant que chante l’artiste. On peut aussi y danser comme dans une fête de mariage. Pour choyer un public de gens aisés, il faut aussi installer une atmosphère bon enfant et faire rire de temps à autre. Pour ça, le chef d’orchestre des Dominos est l’homme de la situation. C’est un multi-instrumentiste talentueux qui adore déconner. Lorsqu’il présente les neuf membres de l’orchestre (deux claviers, guitare, basse à vent, batterie et quatre cuivres), il provoque une franche hilarité, aussi bien dans le public que sur scène car il raconte des conneries grosses comme lui et vaguement surréalistes. Sur l’intro de «Proud Mary», on le voit claquer les accords sur sa Telecaster en singeant Keith Richards, mais ça ne fonctionne pas du tout, car il est beaucoup trop court sur pattes. Alors il se rattrape en sortant ici et là des anecdotes qui sentent bon le corps de garde : «Vous savez ce que répondait sa mère quand Moustique lui demandait qui était son père ? Qu’elle ne savait pas parce qu’à ce moment-là elle dormait...». Mais il en fait parfois en peu trop. Toute la difficulté, comme disait Cocteau, est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin. En prime, le maître de cérémonie chante très bien, ce qui tombe à pic car Vigon sait se mettre automatiquement en retrait. Il ne semble pas avoir de problèmes d’ego, ce qui ajoute encore à sa grandeur. Vigon participe aussi aux petits échanges humoristiques avec le maître de cérémonie et parfois, ça frise le très mauvais goût. Quand on lui demande de monter sa queue, Vigon défait sa pompadour et tire sur une longue mèche de cheveux noirs : Voilà ma queue ! Mais au fond, tout cela reste bon enfant et le public, curieusement très mélangé, vibre chaque fois que Vigon annonce un hit des temps anciens, comme par exemple «Mustang Sally» ou le «Twist And Shout» des Isley Brothers. On voit des femmes d’un certain âge taper des mains comme des adolescentes. Rien de tel qu’un vieux hit pour remonter en un éclair jusqu’au temps béni des boums. Vigon est encore plus irrésistible dans ses duos et notamment le fabuleux «My Girl» qu’il partage avec Muriel, l’épouse du maître de cérémonie, elle aussi spectaculairement douée pour le chant. On la verra plus loin reprendre seule le vieux «What A Beautiful World» de Louis Armstrong avec une réussite troublante. Dans le cours du deuxième set, on fait aussi monter sur scène une jeune métis aux yeux clairs pour chanter «The Dock Of The Bay» d’Otis en duo avec Vigon. Elle se montre étrangement douée. La scène qui se déroule sous nos yeux relève du miracle, car leur duo est d’une beauté à couper le souffle. Au moment où elle quitte la scène, Vigon annonce au public qu’il n’y a pas eu de répétition. C’est une intervention spontanée.

Le danger de ce genre de spectacle est que souvent les classiques se transforment en interminables pièces participatives. Vigon et le maître de cérémonie demandent au public de reprendre des refrains en chœur. Alors ça peut durer longtemps, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour chauffer un public, mais il faut aussi se souvenir que c’est le principe de base du gospel et que rien n’est plus enthousiasmant qu’une salle qui reprend une chanson en chœur. Ce spectacle présente un autre petit défaut : avec le temps qui passe, on éprouve de plus en plus de difficultés à supporter les vieilles resucées de «Ready Teddy» ou de «Blue Suede Shoes», et même des hits de Little Richard comme «Keep A Knockin’». surtout lorsque c’est amené par une question du genre : Est-ce que vous aimez bien le ouakenrôle ? En vérité, Vigon est extrêmement bien entouré sur scène. Il peut jouer des juke-boxes de luxe pour un public argenté. C’est une façon comme une autre de retrouver une cohérence. On ne cherche même pas à se demander ce que ça donnerait dans un bar mal famé de Saint-Ouen ou d’ailleurs. On est au Méridien. C’est là où les choses doivent se passer et la force de ce spectacle réside dans sa logique.
Signé : Cazengler, ravi(gon)
Vigon. Le Méridien. Paris XVIIe. 30 octobre 2015
JC SATAN
LE 106 - ROUEN – 31 / 11 2015
PAPA JC SATAN SANG LOUIE

C’est en voyant ou en revoyant JC Satan sur scène qu’on mesure l’écart. Ce fameux écart auquel on se confronte depuis cinquante ans. Quel écart ? Mais oui l’écart, le grand écart, le bel écart, l’écart late qui n’est jamais en retard, l’éKartoum en uniforme rouge, l’ékarting de cabosserie, l’écarwash de Mercury, l’écart aux mille visages des mille et un concerts d’un Bagdad fantasmatique, l’écart qui hante et qui frappe par sa cruelle justesse, ce fameux écart qui existe entre le disque et le concert, comme si le groupe qu’on voyait sur scène n’était pas le même que celui qui enregistrait en studio.

Dans le cas de JC Satan, c’est frappant. Leur quatrième album qui est pourtant bon paraît bien gentil en comparaison de ce qui se passe sur scène. Si on veut goûter à la sainte anarchie du rock, alors il faut voir JC Satan sur scène, car c’est là et nulle part ailleurs qu’ils la génèrent et qu’ils la dégénèrent.

On voit le petit Arthur monter sur scène torse nu avec sa peau luisante couverte d’une myriade de tatouages, sa guitare blanche et une bouteille de Jack et dès l’ouverture du bal, il réinstalle le chaos, exactement le même genre de chaos qu’installèrent avant lui le MC5, les Stooges ou les Cramps. Oui, c’est frappant, on pense immédiatement au MC5 et à cette explosion sonique qui caractérisait leurs sets au Grande Ballroom. C’est un phénomène qu’on pourrait qualifier de fusion, un paquet qui arrive d’on ne sait où et qu’on prend en pleine figure. Ce groupe perpétue une tradition de l’excellence, il développe cut après cut ces dynamiques infernales qui font les concerts inoubliables. Cette matière à la fois sonique et visuelle n’existera jamais sur aucun disque, et encore moins sur You Tube. L’explosion se produit à la racine même de la scène, dans le tumulte assourdissant des vagues d’assaut, dans la clameur du pillage et dans les lueurs dansantes du brasier. Un vrai concert de rock relève de la barbarie des temps modernes, mais une barbarie qui se met au service du plaisir des sens, une barbarie qui redéfinit chaque fois ce qu’il faut bien appeler une éthique du rock. Quand on a vu des milliers de concerts, on ne peut plus se satisfaire de petits sets bien ordonnés et inoffensifs. On ne rêve plus que d’outrance et d’oreilles qui sifflent. Arthur qui se jette au sol avec sa guitare, c’est exactement la même chose qu’un Lux qui rampe par terre avec son micro dans la bouche ou qu’un Iggy qui sort sa bite et qui don’t care. Arthur et ses amis savent créer les conditions de la fournaise ultime, ils ont percé tous les vieux secrets alchimiques de la heavyness, une tradition qui remonte à Blue Cheer et à Sabbath, ils dépècent le cadavre encore tiède du stoner pour se goinfrer de ses entrailles, ils ré-injectent un effarant shoot de modernité dans ce son hérité des seventies, ils inventent des dynamiques infernales pour réanimer l’antique capharnaüm, et tout ça bien sûr avec l’énergie du diable, la seule qui vaille en ce bas monde, celle qui embarque les Stones à la fin de «Sympathy For The Devil» ou Mitch Ryder dans «Devil With A Blue Dress».

En plus, le set se déroule dans des conditions idéales : c’est la nuit d’Halloween avec son cortège de zombies et de vierges noires, et ses projections d’extraits de films gore. Paula monte sur scène masquée et drapée d’une cape noire. Elle évoque Salieri, le messager du diable, dans l’Amadeus de Milos Forman. Il ne manque plus que les volutes d’encens pour que la cérémonie ressemble à cette fameuse messe noire du chanoine Docre que nous décrit longuement Huysmans dans «Là-bas». Derrière son clavier, figé comme un épouvantail de Tadeusz Kantor, les orbites peintes en noir, l’admirable Dorian déverse ses nappes dans la marmite en ébullition. Et dans son coin, la petite Ali bombarde le chaos à coups de lignes de basses vibrionnantes qu’elle tricote et retricote avec une niaque digne de celle d’un Bob Venum, du temps où il jouait de la basse dans les BellRays. Et tout ça est martelé par une sorte d’Hadès à visage d’ange, un monstre de frappe sorti tout droit des 120 Journées de Sodome du grand Pasolini.

Il faut le brailler bien fort sur tous les toits : JC Satan est ce qu’on peut voir de mieux actuellement en France. Aucun groupe n’est de taille à rivaliser avec un tel brouet. JC Satan plonge trop profondément dans les racines du rock, dans cette terre humide et malsaine où réside l’essence même du rock, l’animalité dans sa forme la plus primitive. Si on a surnommé Iggy l’iguane, ce n’est pas par hasard. Si Hasil Adkins mangeait du serpent au petit déjeuner, ce n’est par hasard. Si God Hilliard baise à trois avec un serpent dans The World’s Greatest Sinner, ce n’est pas non plus par hasard.

Mais ce qui fait l’écrasante supériorité d’un groupe comme JC Satan, c’est la qualité des chansons. En cinq ans, ils ont enregistré quatre albums, et ce ne sont pas des petits albums underground à la mormoille, du style de ceux qu’on range dans des armoires Ikea et dont on oublie jusqu’à l’existence. Non, au contraire, ce sont des albums qu’on se surprend à réécouter, histoire d’être bien certain que les mots ne dépassaient pas la pensée, lorsqu’on en parlait ici et là. «Together After Love» et «Adventure Boat» sont bel et bien deux hits dignes du Velvet, «The Crystal Snake» sonne bel et bien comme une merveilleuse descente aux enfers. L’impression générale que dégagent ces quatre albums est celle d’une grande modernité de ton et d’idées qui s’appuie sur un son d’une orthodoxie irréprochable. Avec JC Satan, la messe est dite, mais encore une fois, il est indispensable de les voir jouer sur scène pour mesurer l’ampleur du phénomène. A-t-on déjà vu des groupes de ce niveau en France ?

Leur quatrième album vient de sortir, sous une belle pochette noire. Ceux qui auront choisi le vinyle auront droit à un magnifique livret de photos grand format : ce sont les portraits des cinq protagonistes en flammes. Stupéfiant ! Depuis les portraits de Richard Avedon - et notamment celui d’Andy Wharhol avec les cicatrices des coups de feu sur la poitrine - on n’avait jamais rien revu d’aussi expressif. Ils ouvrent ce festin des dieux avec un «Satan II» qui redéfinit les règles de la pétaudière infernale. Ils misent sur l’explosivité des choses avec une sorte de démesure que les plus frileux d’entre-nous jugeront peu catholique. Leur musique sent bon le moyen-âge des peaux luisantes et couvertes de stigmates. L’un des atouts majeurs de JC Satan est de savoir psalmodier des chants païens à deux voix, du type «I Could Have Died», un cut ambivalent bardé de prolongements évasifs et ambiancier au possible. On sera profondément déstabilisé par «Don’t Joke With The People You Don’t Know», car c’est amené comme une messe de moines gothiques qui officient probablement au fond d’une crypte lointaine et ça vire en un stoner de dieu que viennent tourmenter des tortillettes de basse dévoreuse. C’est leur manière de renouer avec une pente fatale pour les ambiances soigneusement orchestrées et faites pour marquer l’imagination au fer rouge. Chaque cut est un cut à idée forte. Ces gens-là sont beaucoup trop doués. Leur souhaiter la gloire qu’ils méritent ? On ne ferait même pas ça à son pire ennemi.
En face B, ils nous mettent à l’épreuve avec «I Will Kill You Tonight», un cauchemar amené insidieusement sous la forme d’un groove de charme. C’est l’expression d’une liberté de ton, d’un refus définitif des contingences et des limites - Hey comme here I will show you my garden just outside - C’est chanté à deux voix, par le duo hanteur Paula/Arthur - I dig you a big hole and I will burry you still alive - Arthur ne plaisante pas. Il est plus sérieux que Quentin Tarentino qui fait enterrer Liv Ullman vivante par Michael Madsen sous douze mètres de terre, en sachant bien qu’elle réussira à s’en sortir. Quand on écoute «Don’t Work Hard», on s’émerveille de ce son musclé et enveloppé de gigantesques haillons de chorus qui semblent flotter dans la tourmente d’un grand vent de peste. Tout aussi déroutant, voilà «Ingrid», au son volontairement altéré, comme perdu dans le passé, aussi douloureux qu’un souvenir auquel on voudrait échapper mais qui revient systématiquement. Cette chanson est aussi perfide que la découverte d’un grenier oublié. Ils finissent cet album en demi-teintes avec un haut fait d’armes intitulé «The Greatest Man», chanté à la mode antique, ou du moins à l’idée qu’on se fait de la mode antique. En tous les cas, ça sent l’âpre roussi des fléaux bibliques, et là, ils passent sans crier gare au mode heavy tentaculaire - Naked I’m born an naked I’m dying - On se croirait dans le cratère de Dave Wyndorf, car la progression de la heavyness est d’une crédibilité à toute épreuve. Désormais, c’est JC Satan qui distribue les cartes, principalement la treizième, celle de l’arcane sans nom, et celle du pendu et de l’Appel aux Survenants. On se gave de cette mélasse d’heavyness au fumet macabre de vent de mort villonesque et prions dieu pour que tous nous veuille absoudre.
Signé : Cazengler, JC Santon
JC Satan. Le 106. Rouen (76). 31 octobre 2015
JC Satan. JC Satan. Animal Factory 2014
CLUB HOUSE LONERS
LAGNY-SUR-MARNE / 21 – 10 - 15
JALLIES
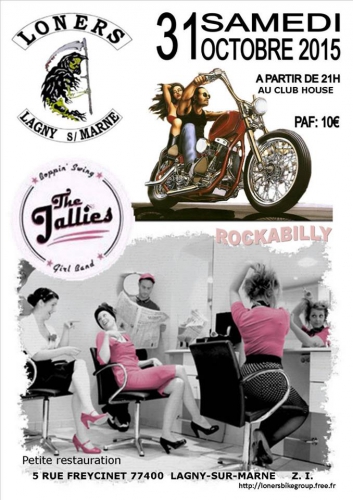
Grand plaisir de retrouver les Loners. Le tonneau en feu devant le club-house, les motos exposées, l'accueil chaleureux et souriant. N'ont pourtant pas le coeur à rire, Tonio est passé sur l'autre rive. Un brother Loner for ever qui s'en va. N'aurait pas aimé que l'on soit trop triste... Pas mal de monde, ce soir. Bikers, rockers, visiteurs, la grande famille des habitués. Les jolies Jaillies nous tombent dans les bras. Sont fatiguées, crevées, brisées, moulues, foutues, elles évoquent des nuits de fête sans sommeil, à deux encablures du cimetière. L'on s'apprêterait presque à préparer une pétition pour remettre le concert à plus tard. Heureusement que les deux gars là, sont solides, placides, tranquilles, que l'écume festive n'a pas ébranlés d'un demi-pouce. Ten o'clock dépassé, l'est temps d'arrêter de discuter et d'entrer dans l'arène. Le grand Phil n'en croit pas ses yeux, même pas un petit remontant alcoolisé sur le devant de la scène. Que des petites bouteilles plastique d'eau claire, rigoureusement alignées comme les manifestants d'une ligue de tempérance ! Je vous rassure, seront vite délaissées pour boissons ambrées ou rubescentes.
CONCERT
Miracle. L'on s'attendait à Mesdames de Récamier épuisées, alanguies sur la caisse claire, souffreteuses, maladives, blanchâtres, et les voici exubérantes, pimpantes, pétulantes, empressées, joyeuses, bourdonnantes autour des micros telles des abeilles mutines affairées dans la ruche. C'est parti. A toute vitesse, la strato de Tom qui vrombit et la la double bass de Kross qui pétarade. N'ont pas envie de ralentir dans les courbes, ce soir ce sera à fond les manettes et le pied sur l'accélérateur. Débrouillez-vous pour ne pas être sur les passages cloutés quand elles arrivent, car les chouchounettes ne savent pas se servir du frein. Ignorent même qu'il y en a un, ou font semblant de ne pas le savoir, car cette nuitée s'annonce plus que speedée.

Premier morceau, la salle applaudit. Ce n'est pas par politesse. De satisfaction, car le son est là, qui dès les premières notes vous enveloppe de son manteau et ne vous lâchera plus jusqu'à la fin. Réverb sur les murs, éclat vocal sur les murs de l'étroit local. Ça sonne comme à Carcassone quand le vent résonne sur les murailles métallophones. Et les trois chipies entonnent tour à tour les titres sur lesquels elles ont jeté leur dévolu. L'ensemble file bon train ( à la Johnny Burnette ), nous font le coup, c'est si bon que vous n'avez rien compris. Nous non plus. L'on n'est tout de même pas tombé de la dernière pluie du rockabilly, et le répertoire des Jallies, les reprises comme les originaux, on connaît par coeur. Oui mais elles ont bossé comme des dromadaires depuis la dernière fois. Discrètement mais efficacement. La façon d'aborder les parties chorales n'est plus la même. Au background accompagnateur, l'est des instants cruciaux où elles rajoutent des duos de contre-chant à pleine voix et cela vous booste et vous turbote l'ensemble.
Se sont aussi rendu compte que derrière elles, il y avait deux matelots qui souquaient ferme à la manœuvre. Les trois reinettes ont posé un regard de princesses compatissantes sur ces deux malheureux, une fois dans la mâture pour rajouter de la toile, une fois à la pelle devant la chaudière pour augmenter de la vitesse, les ont davantage intégrés dans leur set de scène, ce n'est plus, débrouillez-vous les petites fourmis travailleuses pour que tout soit en ordre et convenablement bien rangé, nous les cigales notre destin est de chanter à qui mieux-mieux pour ravir le public. Les mettent désormais à contribution, ne disent rien, ne commandent rien, n'exigent rien, de vive voix, mais sans le dire on les entend : allez Tom, un lick de guitare juste à cet endroit précis pour souligner mon envolée sur le demi-vers qui suit, allez Kross un staccato pour soutenir le rebond de ma caisse claire. Evidemment c'est moralement condamnable ; c'est un peu comme les cercles de qualité mis en place dans les entreprises pour que les employés améliorent d'eux-mêmes la production en mettant davantage la main sur le millepatte du travail. Mais le résultat est indéniable. C'est encore mieux qu'avant, plus péchu, plus fourchu, plus crochu. Ça vous accroche, ça vous scotche et ça vous taloche. Les trois sucrettes, elles, elles en sont survoltées. Exemple, le gazou de Céline, c'était un gimmick en plus, un truc sympa et divertissant, maintenant c'est un instru à part entière, les garçons piochent derrière comme des forcenés à Perchman, et sur leur boucan de tous les diables elle vous plante un véritable solo de Jéricho à décrocher les posters sur le mur. Plus question de gazouiller : vous ici je vous croyais au kazoo.
Entracte. L'on tremble. Peut-être ont-elles tout donné. Leur resterait-il un soupçon de force ? Celle-ci sera-t-elle encore à leurs côtés ? Le premier set c'était parti pour quatorze titres comme en quatorze. Dix-huit pour le second. Et la victoire au bout. Se rechargent-elles au radium ou à l'uranium ? Rayonnent d'une énergie inépuisable. Au fond de la salle il y a bien des danseurs qui s'agitent, mais devant les rangs sont serrés et tout ouïe. Il y a des concerts que l'on entend et ceux que l'on écoute car ce qui est ventilé dans votre cerveau s'apparente plus à de la volupté qu'à de l'amusement. L'est des titres qui sont suivis d'ovation. Remerciements et agréments. Parce que l'interprétation a mordu sur quelque chose d'indéfinissable, mais qui est au-delà de ce à quoi l'on a droit à s'attendre. Lorsqu'elles plantent leurs canines dans un morceau, les trois félinettes, elles vous le déchirent de belle manière. Sculpture sonore et sanglante. Art nouveau. Swing cruel. Sans appel. Mais avec rappels. Vous dépècent le bestiaux et font craquer les os. La Vaness, tigresse sans pitié qui ne prend même pas le temps de respirer, Leslie, panthère rousse qui se repaît de lymphe torride, Céline, ocelot au timbre soyeux qui camoufle de terribles griffes rétractiles et meurtrières, vous hachent le beef d'éléphant tout menu. Beaux sourires, grâce naturelle. Mais l'envie d'en découdre et le désir de pousser à chaque fois le jeu et le feu un peu plus loin. Plus les deux gars qui les incitent au crime, ne faut pas leur en promettre. Exsudent de temps en temps des rugissements. Afin qu'on ne les oublie pas. Mais il y a peu de chance. Kross et Tom sont les flammes de cette fournaise dont les fillettes sont les braises ardentes. Qui ne s'éteignent jamais. Avec le public qui souffle dessus pour qu'elles rougeoient encore plus fort.
Terminé. Les meilleures roses ont une fin. Beau concert, belle soirée. Ce soir les sourires des Jallies seront dédiés à Tonio. Pouvais pas offrir de plus beau bouquet.

Damie Chad.
BRITISH ROCK
1965 – 1968 : SWINGING LONDON
CHRISTOPHE DELBROUCK
( Le Castor Astral / Septembre 2015 )
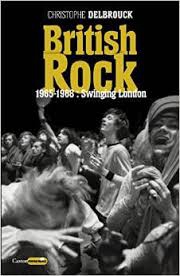
La suite du tome 1 ( voir KR'TNT ! 249 du 01 / 10 / 2015 ) qui couvrait les années 1956 – 1964. Le temps des pionniers est bel et bien fini. Morts et enterrés. Ont bien raté le coche. Bizarrement c'est lorsque les groupes anglais se risquent aux USA que l'on aperçoit le mieux les raisons de cette disparition. Certes ils n'ont pas su s'adapter aux nouveaux courants mais c'est surtout qu'ils essuyèrent sans aucun paravent de protection les foudres du système. La deuxième génération se heurtera en Great Britain et aux USA aux mêmes intransigeances. Faudra plusieurs années avant que les ricains acceptent de recevoir les angliches. Même pas discerne-t-on dans un premier temps, une touche de jalousie musicale ou un sursaut de vexation nationaliste : en 1965 les Etats-Unis ne revendiquent pas d'être la patrie originelle du rock and roll et encore moins du rhythm and blues, ces éructations de sauvages à la peau trop bronzée pour être honnêtes. Ce sont les ligues de vertu et de tempérance qui tirent à boulets rouges au canon de morale sur cette musique dépravée. Remarquez, elles ont trouvé toutes seules avant même que les rockers en aient pris tout à fait conscience le triangle des Bermudes du rock, sa diabolique trilogie, sex, drugs and rock'and roll. C'est surtout le sexe qui les chatouille désagréablement. Attention aux paroles suggestives et aux gestes libidineux. Radio, télévision et presse montent la garde. Pour le moment les barrières de sacs de sable qu'elles érigent tiennent bons, mais l'on est toujours trahi par soi-même. Nos pépés-la-pudeur- refoulée avaient oublié l'essentiel : l'ennemi intérieur est le plus dangereux. Les digues vont s'écrouler de par leur propre faiblesse. L'est encore un monstre plus terrible que le rock and roll, plus paradisiaque que la drogue, plus jouissif que le sexe. Je vois à votre langue pendante l'impatience qui vous transperce, vous attendez la révélation, pour aussitôt vous en procurer un carton plein. Je ne vous ferai point davantage languir, mais sachez que cette denrée si voluptueuse, qui vous fournit la plus grande sensation et réalité de puissance, réside en la chose même par laquelle vous vous la procurez. Pas rare, mais précieuse puisque vous en avez quelques traces au fond de vos poches. Les hindoux l'appellent la merde de Shiva, le dieu à cent bras qui vous rend la monnaie de vos pièces. L'argent.
En effet l'arrive un moment où la vente massive de disques importés d'Angleterre suscite chez les jeunes américains le besoin irrépressible de voir leurs musiciens préférés s'agiter en nature devant leurs yeux éberlués. Veulent les toucher en chair et en os à la télévision mais surtout, en vrai, sur scène. L'organisation des tournées s'apparente à la manne du désert. Organisateurs de spectacles, annonceurs publicitaires, maisons de disques et imprésarii sentent que le vent souffle enfin de leur côté. Si j'osais, je dirais qu'ils se font des citrouilles en or. Mais comme je suis poli je me contenterai de suggérer que devant les bénéfices générés par nos rock and roll stars, les ligues de vertueuses tempérances détourneront pudiquement les yeux de ces avalanches de gros biftons. Les mauvais esprits susurreront qu'elles n'ont pas fermé leur portefeuille. Je leur laisse endosser la paternité de leurs sous-entendus vénaux...

C'est toujours sympathique de dire du mal des amerloques mais soyons justes. Les anglais eux aussi essaieront d'étouffer dans l'œuf le déploiement de cette jeune vermine qui sape les fondements les plus sains de leur glorieuse nation. Z'ont des comités de surveillance qui scrutent les lyrics. Ecrivez que vous pénétrez dans l'épicerie du coin de la rue et ils vous accusent d'introduire votre anatomie contondante dans celle de votre voisine accueillante, si vous notez que roulez à fond la caisse ils subodorent que cette dernière représente un joint d'herbes très toxiques. Bref vous avez intérêt à faire gaffe, idem pour vos actes quotidiens. Attention à vos lectures et à votre vie privée, si vite publique...
Pourtant ils se sont bien battus. Et au pays du dollar, et au pays de la livre sterling. Ont très vite compris que l'on n'arrêtait pas l'incendie du rock and roll en le combattant directement. Alors ils ont employé la séculaire technique du contrefeu. Vous aimez le rock, très bien, vous aurez de la variété. Vous adorez Little Richard, vous aurez Fabian. Moins âpre au goût mais si sucré que vos fifilles ne pourront plus s'en passer. Et ils ont enfermé les vilains rockers dans l'abîme très profond avec le couvercle de la bonne conscience solidement arrimé par dessus. Croyaient avoir repoussé l'armageddon pour mille ans de plus, mais ces saletés puantes avaient réussi à creuser une galerie et le mal avait irradié à des milliers de kilomètres, in the old England. Et voilà que les enfants de ces lointains ancêtres se préparaient à envahir une nouvelle fois le pays de l'Oncle Sam. Sur place, les anglais continrent un moment le phénomène, proposèrent des alternatives aux Rollings Stones, aux Animals, aux Pretty Things, des mièvreries à la Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich, des cucuteries à la Herman's Hermits et multitudes d'autres drôleries. Parvinrent même à canaliser la moitié du public adolescent sur ces cadavres pas du tout exquis. Oui mais la bouteille à moitié pleine restante refusa de pactiser avec ces ersatz, ces récalcitrants ne voulaient pas la peau du tigre empaillé en descente de lit, désiraient chevaucher le fauve, quitte à ce qu'il leur dévore une ou deux jambes. Quant au jeu auquel ils avaient envie de s'amuser avec la bébête poilue à même le plancher de la chambre je vous laisse en décider.

Le phénomène prenait de l'ampleur. Le bateau de la bienséance avait un trou dans la coque. Ce n'était plus une simple question de divergence musicale, aux Etats Unis, la guerre du Vietnam changeait la donne. La situation nouvelle bousculait les vieux status quo. De l'entertainment l'on passait à la politique. L'acide lysergique définissait d'étranges, insolites et scandaleux horizons, musicaux, et mentaux. Fallait regarder les choses autrement, en plus grand, en plus beau, en plus conscient. Suffisait plus d'acheter le bon disque. Fallait changer de vie.
La faute aux anglais. Christophe Delbrouck l'explique magnifiquement. A force d'imiter le blues, nos cadors d'outre-manche l'ont tellement étrillé, tarasbicoté, refaçonné qu'ils lui ont totalement refait le portrait. Méconnaissable. L'ont rallongé, l'ont sonorisé à haut volume, l'ont repeint de super couleurs hyper pimpantes, lui ont fait un bébé dans le dos qui s'est appelé le psychédélisme. Le problème c'est que les enfants ça pousse trop vite. Vous n'avez pas le temps de leur confier toute l'expérience de votre vécu que déjà ils volent de leurs propres ailes et vous laissent croupir dans votre coin, refusent l'héritage que vous leur prépariez.
C'est en Californie que la jeunesse met ses théories en pratique. Les premiers hippies apparaissent, se servent abondamment dans les valises de la beat géneration. C'est le temps de la multiplicité des champ du possible, refusent guerre et violence, font le choix d'une vie de liberté. Sexualité, hallucinogènes, sexualité, féminisme deviennent les vecteurs d'une plus grande appétence et ouverture au monde.

L'est un chanteur qui personnifie à lui tout seul toutes ces mutations : Eric Burdon le leader des Animals, le seul blanc qui fut capable de faire évoluer le blues en ses racines les plus noires. L'étouffe tant et tant dans l'Angleterre des mid-sixties qu'il émigre aux Etats-Unis. Traverse l'été de l'amour par toutes les pores de sa peau. A compris avant tous les autres qu'une révolution est en marche. Elle ne sera pas aussi sociale que ses racines de prolétaire de Newcastle l'auraient espéré, mais plus que les américains il saura prendre le pouls du phénomène californien et le traduire en sa musique. Comme par ce hasard qui fait si bien les choses c'est son bassiste en rupture de son trip américain qui mettra en selle Jimi Hendrix. Chas Chandler libère l'énergie de Jimmy Hendrix. Lui donne confiance en ses talents qui sont immenses. Hendrix sera cet amerloque qui vient montrer aux anglais comment rénover la quadrature des douze mesures du blues. Le fait éclater, l'égorge, le découpe en morceaux, mais il pare la carcasse de la bête d'une telle énergie vaudou qu'il la transforme en puissance irradiante. Entre Burdon et Hendrix ce sont les pôles de l'électricité qui se sont inversés.

L'extrémisme sonore des Who est dépassé par Hendrix. Les guitars héros peuvent se rhabiller. Page, Clapton, Green, Beck sont mis au défi. Des gars comme Steve Winwood ou Van Morisson ont définitivement une case de retard. Mais la course s'organise. Chacun dans son coin peaufine sa revanche. C'est Clapton, le moins fou de tous, le plus sage, le plus introverti, celui que l'on attend le moins qui tirera le premier feu d'artifice. L'est salement aidé par son bassiste Jack Bruce et son batteur Ginger Baker. Ignorer l'aide derrière les consoles et aux instruments de Félix Papajardi serait un crime que nous ne commettrons pas. Cream sera une splendeur. Le premier power trio où chacun des trois musiciens est d'abord au service de lui-même et ensuite du groupe dans le respect mutuel du travail des deux autres. Le contraire d'Hendrix qui part toujours en avant et que ses deux acolytes suivent sans faillir mais en restant toujours derrière. Pour la suite des aventures faudra attendre le Père Noël qui vous apportera le tome trois sous le sapin.

En attendant il y a de quoi se régaler avec ce deuxième volume. Le rock and roll éclate en ces trois années charnières comme un fruit valéryen de grenadier trop mûr. Les groupes se suivent et se chevauchent. L'en sort par centaines. Christophe Delbrouk les passe en revue, un par un. Il y en a même un dont je n'avais jamais entendu parler ( ne me demandez pas lequel, j'ai déjà oublié son nom ! ). Instructive lecture ! Perso je ne vous cause que de ceux qui m'intéressent. Mais n'ayez crainte je ne vous quitterai pas sans avoir éviter les jumeaux frétillants. Scarabées et Pierres Roulantes.
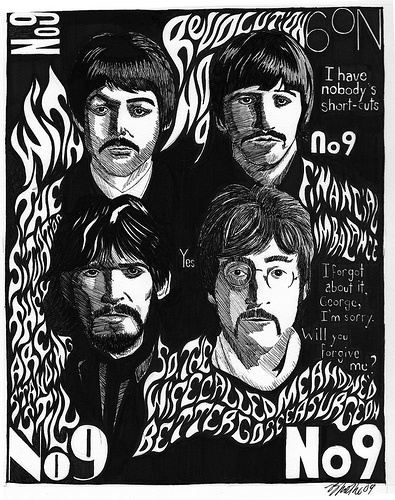
Avec Revolver et George Martin, les Beatles découvrent les infinies possibilités du studio. Le rock perd sa simplicité originelle. S'ouvre à tout : musique classique, pré-classique, harmonies, bruitisme, atonalité, dodécaphonisme, toujours dans le cadre de morceaux sagement définis par un début, un milieu et une fin même si l'on tire un peu sur l'élastique, qu'on le découpe et que l'on rafistole les lambeaux dans le désordre. Revolver ouvre le bal. Sergent Pepper Lonely Heart Club Band introduit le rock dans une autre dimension, celle de la pop, classieuse et réflexive. Le double blanc marque le reflux. A l'opposition classique et duale Lennon-Maccartney, Delbourg substitue la triangulation John / Paul / George, ce dernier tirant la couverture vers une vision beaucoup plus mysticiste du monde. Jusqu'à ce que la farce du Maharishi se déchire et que chacun des membres renvoyé à lui-même se trouve obligé de tracer ses propres limites. Lennon s'exprimera de la manière des plus explicites dans Revolution Number 9. Opte pour la non-violence. La paix, l'amour mais pas la guerre. Alors que toute une partie de la jeunesse se radicalise politiquement il trace les frontières de son pays imaginaire et refuse l'engagement. La révolution sera intérieure ou ne sera pas. Ce faisant il enferme le rock and roll dans la cage dorée de sa réussite.

Les Stones reviennent d'ailleurs. De deux mille années-lumières loin de la maison. Ont fait comme tout le monde. Ont pataugé dans la délicieuse choucroute du psychédélisme. Ont subi les pires attaques du système pour conduites moralement répréhensibles et possession d'illicites produits, les autorité les ont choisis pour cible privilégiée. La justice de leur pays s'intéresse à eux mais ils ne lui font pas confiance. Le gros de l'orage passé, retournent à leurs fondamentaux. Le gros rock qui tache et troue la nappe. Street Fighting Man est à l'unisson de la vague de contestation qui bouscule le vieux monde. La jeunesse s'enflamme, les universités deviennent des chaudrons en ébullition, la France s'offre un joli mois de mai...
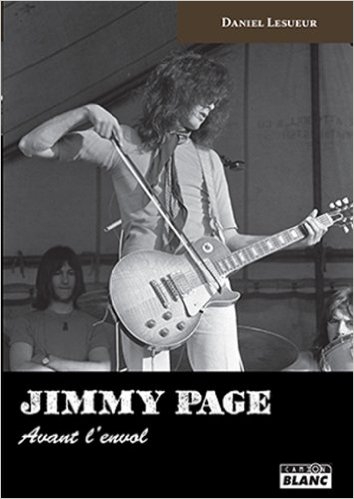
L'on connaît la suite, mais le livre s'arrête en ce moment crucial où toutes les contradictions s'aiguisent et s'apprêtent à se résoudre. Jimmy Page refonde les Yardbirds, la nouvelle mouture n'est qu'un brouillon. Le hard rock reste à définir, le prog lance ses premières offensives. L'évolution est musicale, mais Christophe Delbrouck montre que le mouvement vise à l'émergence d'une nouvelle culture. De plus en plus de musiciens s'alimentent à d'autres sources que le legs strictement musical des générations précédentes. C'est d'ailleurs ce qui précipitera la mise hors-circuit du rock des pionniers qui provient d'un milieu plus populaire. La poésie alimente les nouvelles sensibilités. Surréalisme, dadaïsme, romantisme et symbolisme irriguent les consciences. Ce qui fut une démarche sauvage et instinctive se teinte d'une modalité réflexive. Les causes se sont multipliées mais le refus de la rébellion s'estompe, ne s'agit plus de s'opposer mais de construire, à la fureur adolescente se joint la tentative de bâtir un monde parallèle, un univers de mots et de musique qui soit une alternative efficiente à l'étroitesse mortifère d'une société qui réfrène l'imagination et le désir de vivre en dehors de ses carcans utilitaristes.
Aussi passionnant à lire qu'un roman dont vous êtes, sinon le héros, du moins l'enjeu.
Damie Chad.
UNE JEUNESSE ALLEMANDE
( Documentaire 2015 )
précédé de THE DEVIL
JEAN-GABRIEL PERIOT
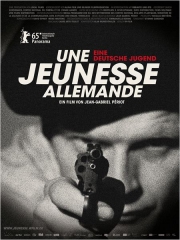
Un complément idéal à la fin de l'article précédent. S'agit de deux films, tous deux construits à partir de documents d'époque mais assemblés avec tant d'intelligence et un tel sens inné de l'esthétisme pour le premier que vous êtes en droit de les considérer comme des films de création à part entière, nonobstant le fait que Jean-Gabriel Périot se détermine lui-même en tant que cinéaste politique et non comme un cinéaste militant. Remarquez que vu la situation politique actuelle vaut mieux afficher une positon de neutralité quand l'on aborde des sujets si explosifs.
Surtout le second qui met directement les pieds dans le plat démocratique. Aborde la question du terrorisme. Un dossier d'actualité brûlant. Certes il évoque une ancienne histoire qui s'est terminée par la défaite totale et l'élimination physique de ses principaux acteurs. Encore que le film ne remette pas en cause la thèse officielle du curieux suicide collectif de ses membres emprisonnés et n'accorde le moindre mot à celle largement partagée par les média démocratiques de l'époque d'une intervention des services secrets. Raconte donc l'histoire de la fameuse Fraction de l'Armée Rouge, la Rote Armee Fraktion beaucoup plus connue sous le nom de Bande à Baader.
Un groupe d'étudiants politisés d'obédience marxiste comme il en existait tant au milieu des années soixante dans le monde. En Allemagne la situation est un peu spéciale, si comme dans tous les pays occidentaux la jeunesse est en pleine effervescence contestataire les séquelles du nazisme imposent à la société de fortes rigidités conservatrices qui se heurtent avec d'autant plus de force aux aspirations libertaires de la génération qui suivit la défaite de 1945. Les échauffourées avec la police atteignent leur point culminant lors de la visite du Shah d'Iran. Les manifestants agressés par les hommes de main iraniens ne comprennent pas que ces derniers soient protégés par les policiers qui s'attaquent à leur cortège. Suite à ce coup de force une frange du mouvement de protestation se radicalise et décide de franchir le pas qui sépare les menées agitatrices du passage à la lutte armée.
La Rote Armee Fraktion fut démantelée à deux reprises mais elle parvint à renaître à chaque fois de ses cendres. Elle commit plusieurs attentats destructifs et meurtriers, exécutant notamment le représentant du Patronat Allemand et le Directeur de la Dresdner Bank... Le film ne couvre surtout que les dix premières années de l'existence du groupe terroriste. Il donne aussi la parole aux autorités policières et gouvernementales qui organisèrent sa liquidation physique.
Jean-Gabriel Périot ne porte aucun jugement. Le film se situe en-deçà de toute considération morale. Laisse à chacun des spectateurs le soin d'en tirer l'enseignement qu'il souhaite, chacun connaît la situation mondiale économique et politique d'aujourd'hui. Un film froid sur une thématique brûlante ! Silence abasourdi dans la salle lorsque la séance s'achève.
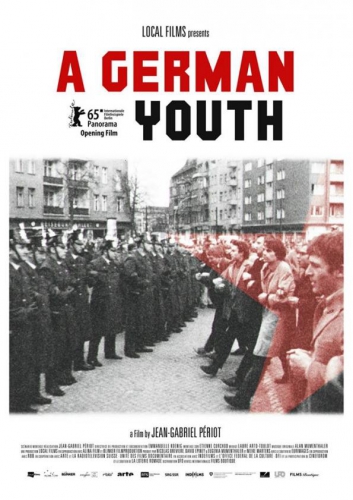
Les années soixante furent tumultueuses : si toute une partie de la jeunesse choisit ce que l'on pourrait nommer un combat de libération culturelle dont la musique rock fut un des vecteurs principaux, il ne faut pas oublier que d'autres jeunes gens en colère optèrent pour des contestations s'inscrivant dans un cadre beaucoup plus frontalement politique, voire d'une extrême radicalité. Une Jeunesse Allemande est là pour le rappeler.
THE DEVIL
( Court-Métrage 2014 )

The Devil est un court-métrage présenté juste avant les aventureuses menées de la Rote Armee Fraktion. Jean-Gabriel Périot utilise la même méthode : un montage de documents d'époque. Mais ici la brièveté de l'oeuvre possède la force d'un uppercut de Cassius Clay. Plus qu'un film, j'aurais pour ma part tendance à parler de poème. Jugez-en par vous-même, vous le dénicherez facilement sur le Net.
Un sujet plus proche de ceux abordés dans KR'TNT ! Met en scène, la colère noire qui présida à la montée en puissance du mouvement des Black Panthers aux Etats-Unis. Des images choc, un oratorio de la révolte et de la rébellion. Des mots, des discours, des slogans scandés comme des victoires. Contre le racisme, pour la révolution. Les fameux dix points du programme des Panthères réduits en un condensé sans appel.
Une couleur du blues plus noire que d'habitude.

UNE ETHIQUE DE L'ERRANCE SOLITAIRE
( Editions de L'Epervier / 2012 )

Philosophie du Blues, je l'ai pris davantage pour le blues que pour la philosophie. Je ne connaissais pas Philippe Paraire, spécialiste de la culture Nord-Américaine, nous avertit une très brève bibliographie, mais aussi auteur d'un livre sur Brassens, impardonnable faute de goût. J'ai tout de même lu, et ne l'ai pas regretté.
Une thèse intéressante. Certes le blues est une vieille histoire qui n'intéresse plus grand-monde. A part les rockers qui aiment à farfouiller dans les racines noires de leur addiction préférée. Pas du tout d'accord, Mister Philippe Paraire. L'est un partisan de la vieille logique matérialiste : les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous traduis cela sommairement : blues, rock, rap : même combat.
Départ l'histoire du blues. Je n'insiste pas. Vous savez. Question musique oui, mais là n'est pas vraiment son propos même s'il vous explique comment accorder une guitare en open tuning, même s'il vous traduit des tas de lyrics, même s'il aborde, par un biais ou un autre, une centaine de bluesmen. Non, nous présente le personnage du bluesman comme le chevalier bleu et errant dont l'action et l'exemple vont conquérir le monde. Ce qui n'est pas un signe d'une réelle amélioration des sociétés depuis un siècle et demi.

A la fin de la guerre de Sécession, les esclaves confinés jusqu'à lors dans le périmètre clos des grandes plantations se voient soumis à un nouvel état de fait : sont atomisés en de maigres lopins de terre dispersés dans les campagnes. Ne sont plus esclaves, sont des serfs attachés à la glèbe. Des lois contraignantes leur interdisent de s'éloigner de leur métayage. N'ont pas gagné grand chose au change. Les gratteurs de guitare seront ceux qui refuseront de rester prisonniers de leurs fermages. Sont des crève-la-faim en perpétuel déplacement. Passent de ferme en honky tonk, de bordel en barbecue de samedi soir... Ne sont pas des intellectuels mais les paroles de leurs chansons véhiculent une vision de la vie tirée de leur précaire existence... Toujours sur les routes, toujours dans l'incertitude, dans l'impossibilité de se fixer, de lier de véritables liens d'amitié ou amoureux.
Avec le temps les choses s'amélioreront. Un peu. Pas beaucoup. Les noirs d'aujourd'hui se retrouvent davantage au chômage ou en prison que les blancs d'Amérique. Dans leur immense majorité, ils font partie de la catégorie des pauvres. Les boulots les plus durs et les salaires les plus légers leur sont réservés.
Jusque là, Philippe Paraire n'apporte rien de neuf. On le savait déjà. Mais il devient diablement intéressant lorsqu'il dresse un parallèle entre les noirs et l'état actuel de la jeunesse européenne. Avec la disparition de l'Etat Providence les jeunes générations sont soumises à une errance semblable à celle exprimée par les bluesmen. La crise les prive d'un emploi stable, recherche épuisante de petits boulots, de stages bidons, de caution pour avoir accès à un logement, tout se délite, le couple s'effiloche au profit d'une sexualité erratique, et misère des misères, tous comme dans les vieilles rengaines bluesy, l'espoir s'enfuit et avec lui la possibilité d'une révolte salutaire...

C'est cette vision de notre monde que développe Philippe Paraire. L'en profite au passage pour analyser le contenu des paroles des vieux blues et en fixer les beautés et les limites. Si bien que son ouvrage peut servir d'introduction à tout néophyte qui rechercherait quelques précises notions sur le blues. Mais le plus important c'est cette généalogie de l'attitude blues qu'il retrace. N'établit pas de frontière précise entre le blues et le rock. L'essence du rock and roll s'inscrit selon lui dans une même détermination. Sont deux musiques de la marge, une marge sociale qui s'élargit de plus en plus par les mauvais temps qui courent.
Un livre comme nous les aimons. L'historiographie est nécessaire mais elle devient très vite une science morte si elle n'aide pas à expliciter le présent. L'important ce n'est pas de savoir le numéro de matrice de tel ou tel enregistrement. Ce genre de recherche hormis un plaisir égotiste de collectionneur patenté relève de l'inanité si elle n'est pas arque-boutée à une mise en pratique efficiente quant à la réalité de notre vécu.
Le lecteur distrait entreprendrait une pertinente réflexion s'il mettait en relation l'éthique de l'errance solitaire dévoilée par Philippe Paraire avec la pratique collective de la colère bleue exposée dans le court-métrage de Jean-Gabriel Périot que nous évoquons rapidement dans l'article précédent.
Damie Chad.
21:34 | Lien permanent | Commentaires (0)