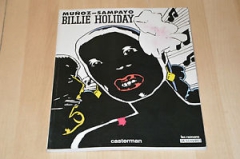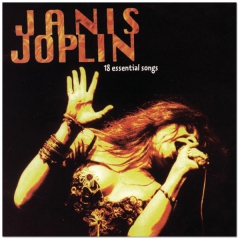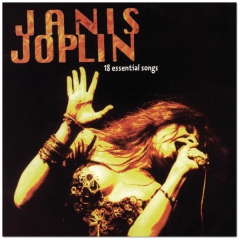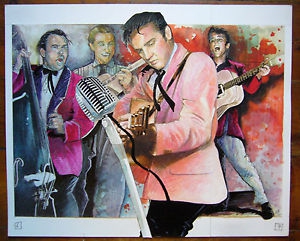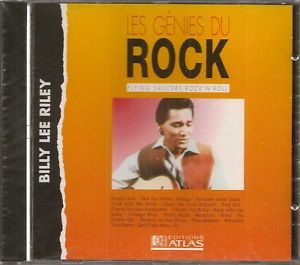20/01/2016
KR'TNT ! ¤ 265 : DAVID BOWIE / RENE MILLER TRIO / VINCE TAYLOR / BILLIE HOLIDAY / CULTURE ROCK
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 265
A ROCK LIT PRODUCTION
21 / 01 / 2016
|
DAVID BOWIE / RENE MILLER TRIO VINCE TAYOR / BILLIE HOLIDAY CULTURE ROCK |
BOWISTITI
Janvier 2015, gare de Rouen. Il promenait sa gueule enfarinée au long des présentoirs de magazines. Les médias s’étaient emparés de Bowie. Cette beauté cadavérique s’affichait en couverture de tous ces pauvres magazines qui ne servaient plus à rien. Bowie était né illusion, et il repartait illusion, décorant par le design de sa grâce l’ultime stade de la futilité des choses.
Pendant tout le trajet, il fut incapable de reprendre la lecture de cette grosse bio d’Aretha qu’il avait emportée. Sa pensée courait après le vif-argent, c’est-à-dire le souvenir d’une sorte d’enchantement musical qui datait de plus de quarante ans. Il laissa son regard errer sur les campagnes blafardes qu’éclairait péniblement le jour naissant. Comme ce fut le cas pour bon nombre de gens de son âge, la trilogie «Hunky Dory»/«Pin Ups»/«Ziggy Stardust» avait laissé en lui une sorte d’empreinte magique.
Nous vivions alors l’âge d’or du glam britannique. En ce temps-là, les journalistes anglais firent de Bowie une sorte de demi-dieu. C’était bien le moins qu’ils pussent faire. Nous assistâmes effarés à la naissance puis au sacrifice de Ziggy Stardust. Nous n’en étions plus au stade du raffinement ni du dandysme dont nous nous gargarisions tous alors, mais au stade de la pure intelligence. Comme Dylan, Bowie nourrissait une vision. Comme Dylan, il réussit miraculeusement à se protéger de la pression médiatique pour continuer à exister artistiquement. Et comme Dylan, il allait réussir à bâtir une œuvre à l’échelle d’une vie. Et comme Dylan, il n’allait hélas jamais réussir à retrouver l’éclat de son âge d’or.

ABSOLUTE BIGORNEUR
Wham bah-bah-bah bam ! David Pinup traverse la Tamise, remonte Charing Cross Road, tourne dans Shaftesbury et reprend à gauche pour enfiler Wardour Street jusqu’au Marquee. Vrooaar ! La béquille de son scooter frotte au sol et sème dans son sillage de belles gerbes d’étincelles. This is the swingin’ London, baby. Teenage vitesse en deux roues, parka, mocassins et quête d’un Graal électrique. Here comes the nightssssssss, surtout bien tirer sur l’alangui du nightssss de Van Morrison, yuuuu-yuuuuu, bien laisser la mélodie se faufiler dans l’entre-jambe du taille basse en tartan, et voir enfin la fumée de sa clope dessiner une arabesque dans l’infinie décrépitude du crépuscule de l’Empire britannique. Yeah, la nuit tombe sur Londres et les vampires wham bam se fondent dans la nuit. Magnifique de blancheur cadavérique, David Pinup arpente la rue, suivi d’un air de sax - oh it makes me want to die.
Pourtant petit marquis, David Pinup vient se prosterner devant Syd Barrett dont l’Emily Play lui plait. Oh oui, il assiste à la barrettisation des choses. Il sait qu’un jour, il n’y aura pas d’autre jour - There is no other day - Ah si Syd le dit, alors... Mais Good Lord j’essaierai quand même, je tenterai le chant d’accent frêle d’un Lord à la dérive mais qui surtout ne laisse rien paraître... Oh je ferai tinter des médailles grandiloquentes sur un accord de guitare à l’agonie... Oh je porterai l’art psychédélique jusqu’au bout de la décadence vidée de tout son sang et je ferai renaître des cendres le phénix d’une beauté irréelle. Il tend les bras vers le ciel - Soon after dark Emily cries - Comme j’aime à me laisser couler au fond des ténèbres glacées de Soho ! Et il jette toute sa déchéance génétique dans la balance du destin.
— Ah tu veux fixer le temps, petit marquis ?
— Qui es-tu ?
— La Forme Des Choses...
— What ya mean ?
— Shape Of Things !
— Aw je vois, Shapes of things before my eyes ! Viens, viens, my lonely frame prodigieusement moderne dans les lumières de Londres ! Viens viens que je te réinvente, que je te sacralise, viens que je te hérisse d’épis pareils aux miens et que je redore tes ailes de fringuant Yardbird ! David Pinup lève l’oiseau magique à bout de bras et le jette en l’air pour qu’il s’élève et qu’il disparaisse, à l’image de toute chose.
— Ainsi finira-t-on tous, murmure le petit marquis, hantés et dévorés par la nostalgie.
Il décide enfin d’entrer dans le Temple. Quel jour somme-nous ? Oh vendredi ! Friday on my mind ! David Pinup chante d’une voix de nez pointu. Il colle comme l’alpaga des grands soirs à la peau de la mélodie - Monday morning feels so bad - La terre entière a chanté ça, car c’est le chant d’espoir des ouvriers, oh cette semaine qui n’en finit plus, monday, tuesday, wens’day et la fièvre maligne monte dans le chant, un héros apparaît, semblable à ces milliards de kids qui se déversent dans les rues chaque vendredi soir - Gonna have fun in the city - David Pinup s’électrocute sur la chaise du destin, wow, dans ses veines bat l’easybeat, il est en cette seconde précise l’un de ces heroes qu’il chantera quelques années plus tard, il joue avec la violence pop et les zones de béatitude mélodique, il sait que cette magie inventée par Harry Vanda et George Young peut couvrir d’or n’importe qui - Tonight I spend my bread - Et conduire aux portes de la renaissance - Tonight I lose my head - Rock’n’roll suicide !
— Où suis-je ? Il semble paniqué.
— Anywho, lui répond la mélodie décadente.
— Oui mais who ?
— Anyway, lui redit la voix de gorge lubrique.
— Wait !
— No way ! Anywhere !
Tout le monde sait que les Who n’ont pas le temps. Alors David Pinup les chante d’une voix de gorille échappé des jupes de Victoria. Il colle si parfaitement à la folie des Who qu’il va les voir jouer sur scène chaque vendredi - I can go anyway/ Way I choooose - On jerke dans le magasin de porcelaine secoué par un tremblement de terre. Au Marquee, le marquis saute dans des dégaines et s’arroge la modernité des temps. Whooo ! Whooo ! Il recherche le stade ultime de l’exaspération, de l’outrance atrocement mal contenue, il souffre comme l’orgasme qui menace d’exploser dans les mains d’une reine dévoyée. David Pinup s’enivre de l’effluve des Who et de tout ce rock qui n’en finit plus de jaillir en giclées laiteuses dans le satin mordoré des nuits londoniennes. Il sait au plus profond de lui - Deep inside my heart, comme dirait Dylan - qu’en dépit de son essence errante, l’Anyway Anywho Anywhere brillera comme un phare dans la nuit et s’imposera dans l’histoire des hommes comme un poids lourd de conséquences.
La brume quand point le matin retire aux vitres son haleine. David Pinup pourrait chanter Aragon, mais il lui préfère Rosalyn. Il lui demande même des comptes. Rosalyn, tell me where you been, arrghhh ! Il a vu Phil le faire, alors il le fait à son tour. David Pinup vénère Phil et Vince Taylor parce qu’ils sont les seuls à oser s’habiller en blanc sur scène. À ses yeux, ils apparaissent comme des demi dieux. D’ailleurs Ziggy va naître aux pieds de Vince Taylor. En dépit de toutes ses certitude aristocratiques, David Pinup ne peut pas s’empêcher de poser cette question désespérée : Do you really love me ? L’amour de Phil est plus fort que tout. David Pinup comprend instinctivement cette sauvagerie. Il est devant et il voit Phil et Viv ramper sur scène - I’m on my own/ Nowhere to roam - Le beat Don’t Bring Me Down se dresse pour l’éternité. Il fécondera d’autres imaginaires, dans d’autres civilisations, bien après que nous soyions tous redevenus poussière. Comme Phil, David Pinup recherchera les cris de véracité rentrée, il tordra le bras d’une syllabe ici et là pour qu’elle couine comme une mijaurée, et ils plongeront le chant du rock dans l’enfer de la volonté sacrée. On verra aussi le petit marquis secouer ses cuisses et agiter ses guêtres. Alors, le coup d’harmo lui coulera dans le dos comme une giclée de semence. Comme Phil, le petit marquis organisera - I wander round/ Feel off the ground - la meilleure orgie des sens de tous les temps. Ah il faut le voir poser son down...
Puis il pissera à la raie du temps en compagnie de Ray. David et Ray n’en finiront plus de se lamenter aristocratiquement - Won’t you tell me where have all the good times gone ? - On assistera là à une sorte d’expertise de la décadence du won’t tell me, et cette expertise s’étendra jusqu’à l’horizon. Et puis quelque part dans la culotte du temps viendra rôder une fuzz. Alors tout redeviendra ineffablement médusant et sexuel. Mais qu’on ne se méprenne pas, ces gens-là ne sortent jamais l’artillerie, non, ils sont beaucoup plus virils puisqu’ils suscitent à coups de reins, dans le secret d’un art superstitieux. David Pinup ahane si bien qu’il évoque le râble d’un blaireau maté. Il assène ses coups fantastiques d’on the ground et il donne de la fuzz à la fuzz comme d’autres donnent du temps au temps. Hanté par le génie de Ray Davies, David Pinup roule comme un carrosse à travers la nuit des temps.
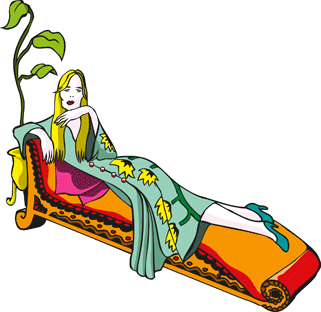
HUNKY PANKY
Les brumes d’automne léchaient les murs lépreux du manoir victorien de Hadden Hill, à Beckenham, une localité sise dans les faubourgs de Londres. Hunky Panky s’y tenait reclus, fuyant les assommantes vulgarités de la foule et la brûlante morsure des échecs.
Londres venait de réprouver The Hype, un groupe d’avant-garde qu’il comptait emmener au sommet des charts, épaulé par Mick Ronson et Tony Visconti. Ce cuisant échec l’avait profondément meurtri. L’aimable Hunky Panky renfermait comme l’huître la perle une nature à la fois quintessenciée et nubile.
Il gisait là, répandu sur une bergère vénitienne tendue de pourpre duveteuse, le regard embué de morosité. Il fuyait l’impitoyable nuisance des petites misères. Il caressait ses cheveux qui avaient la clarté de l’or pâle. Il sombrait dans des torpeurs hantées par de sourdes clameurs puis, pour éviter que son ennui ne devînt sans borne, se reprenait en songeant à de nouvelles chansons parées de scintillements mystérieux et pervers.
Il préparait ainsi «Hunky Dory», son prochain album. Pour attiser le brasier de sa mélomanie, il se laissait volontiers hanter par le spectre de Syd Barrett dont les couplets au fumet spécial, les mélodies aux charmes délirants, les contines aux accents dépravés achevaient d’irriter sa cervelle ébranlée.
Oh ce n’était pas tout. Il avait goûté à l’immense privilège de voir Vince Taylor sur scène. L’Anglais parut sur scène affublé d’une robe blanche. Pour les fidèles massés à ses pieds, il incarnait la résurrection. Hunky Panky vénérait Vince Taylor, un personnage suprêmement atypique qu’un solide abus de stupéfiants avait rendu emblématique. Au nombre des demi-dieux, Hunky Panky comptait aussi The Legendary Stardust Cowboy, une âme errante qu’on vit s’éloigner dans l’infini d’une lamentable désuétude.
Immergé dans l’eau stagnante de ses adorations, Hunky Panky sentait monter en lui le levain de touffeurs androgynes qu’exaspérait encore le camaïeu évanescent de sa tenue. Une robe d’homme moulait son corps d’éphèbe décavé. Celle-ci s’ornait d’un motif japonais représentant un boisseau de renoncules tendancieuses distribuées par une longue tige. Cinq boutons ciselés dans l’écaille de tortue fermaient cette robe sublime par le devant.
Hunky Panky prenait de longues poses accablées et mornes. Il levait une tasse diaphane et goûtait à petites gorgées un thé parfumé et bistre acheminé d’Orient par d’antiques caravanes. Autour de lui, les meubles sculptés dans des bois violets et fumés d’amarante imitaient les contractions du plaisir et les volutes des spasmes.
Hunky Panky grattait finement les douze cordes de sa guitare et parait son immense solitude de chansons d’un grand raffinement. Il désirait qu’elles fussent parfaitement aptes à tuer l’ennui, ce mal qui rongeait implacablement les jours. Il venait d’épuiser toutes ses ressources, notamment celles que prodigue la littérature. Il avait abusé, à s’en griser, des imprécations suroxygénées de Nietzsche, sucé jusqu’à la moelle les éditions complètes d’Aleister Crowley, une œuvre rongée par des syphilis et des lèpres, tout cela dans les âcres tourbillons des spirales haschichines. Il lui fallait revenir à des exhalaisons plus civilisées. Il n’entrevoyait qu’un seul moyen d’y parvenir : il lui fallait composer des chansons rares et précieuses qui brilleraient de l’éclat de topazes brûlées.
Angela Barnet, une Américaine au corps bien découplé et aux membres d’airain traversait la pièce. Elle évoluait, parée d’une robe de soie dont le frou-frou imitait le bruit d’un ruisseau. Il régnait à Hadden Hill un lourd parfum d’hédonisme.
En passant languissamment les accords de «Changes», Hunky Panky éprouvait la piquante satisfaction qu’éprouve le stratège à voir ses manoeuvres couronnées de succès. Il brassait avec les douze cordes de sa guitare un extravagant fouillis de notes lumineuses, et chantait d’une voix pincée, volatile et fruitée :
— Oh yeah, Mmmmm... Je ne sais toujours pas ce que j’attendais... Et le temps passait tellement vite...
Sa voix commettait de délicieux écarts :
— Un million d’impasses... Chaque fois que je croyais que c’était dans la poche, je sentais que ça n’allait pas...
Entre deux passades d’accords, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses, il laissait un gémissement glisser le long de pentes éhontées. Il débouchait alors sur une ample phrase musicale, ouvrant soudain une échappée de panorama absolument immense.
— Ch-ch-ch-ch-changes... Tourne-toi et affronte le stress... Ch-ch-changes... Je ne veux pas devenir meilleur...
Achevé, ce magnifique spécimen de self-encapsulo manifesto brillait comme une pierre rare, de celles qu’on voit luire au front des reines antiques peintes par Gustave Moreau. En se retirant comme la marée, «Changes» laissait Hunky Panky épuisé, ahanant sur un rivage imaginaire.
Il concevait «Hunky Dory» comme une généreuse brassée d’hommages. Il en destinait un à Warhola, ce peintre d’origine polonaise établi à New-York et dont le génie sérigraphique commençait à éclabousser les cimaises d’Amérique. Voulue maniérée à l’extrême, cette chanson modestement intitulée «Andy Warhol» s’ouvrait sur une longue note errante bientôt mariée à un voluptueux accord de flamenco. Les grandes pompes suivaient, pareilles à ces cortèges qu’on voit défiler les jours de funérailles nationales et le couplet déroulait son cours, aussi vibrant qu’une note argentine. Hunky Panky se voulait si sincère dans son hommage qu’il s’étranglait presque, au moment de psalmodier le refrain :
— Andy Warhol a l’air d’un cri... Je l’accroche sur mon mur... Andy Warhol, écran d’argent... Je ne distingue rien du tout...
Il achevait chaque morceau le corps renversé à l’arrière, secoué de spasmes, comme frappé par cette singulière maladie qui dévaste les races à bout de sang. Mais voyant ses chansons sauter allégrement par dessus les bornes de la musicalité, il reprenait des forces. Il se redressait lentement et passait d’un geste las à l’œuvre suivante.
«Oh You Pretty Things» se présentait comme un boogie et s’arrêtait bien vite au seuil d’un couplet dépenaillé qu’une mélodie d’une saveur fatale emportait aussitôt. Et le refrain s’écoulait alors de la gorge de Hunky Panky comme une fontaine d’eau bleue :
— Oh, you pretty things... Ne savez-vous pas que vous rendez fous vos pères et vos mères ?
Il écrivait des refrains à caractère sacerdotal qu’il ajustait comme des parements sur de féériques apothéoses. Il lui arrivait de perdre connaissance. Il revenait à lui un peu plus tard. Il ramassait sa guitare, échappée de ses mains pâles, pour s’attaquer à la chanson suivante.
Issue des profondeurs ondoyantes de sa gorge, «Life On Mars» surgissait comme une grande composition à dimension cosmique et tragique à la fois. Conçue comme un hommage à Frank Sinatra, «Life On Mars» déployait, ainsi que le corbeau d’Edgar Poe, d’immenses ailes noires marbrées de reflets bleus.
D’œuvre en œuvre, Hunky Panky étendait son empire, le corps parcouru de frissons répétés et majestueux. D’une lenteur anémique, comme privée de forces et déjà harassée, une rengaine nommée «Quicksand» s’élançait pour s’en aller plonger dans un océan de désespoir. La voix d’Hunky Panky revenait parfois à la lumière, révélant ses accents dorés et craquelés. Il poussait sa plainte avec une grâce infinie, se complaisait aux affres d’un faisandage sommaire et ralenti. Son art blet atteignait aux sommets de la déliquescence. Il lâchait en soupirant des paroles charnues et molles qui sentaient le fauve. Sa voix épousait toutes les nuances de la perversité, elle modulait des paroles opaques, sulfureuses et comme jaunies de bile. Sa voix hissait vers la cime de l’art de douloureuses imprécations aux lueurs vitreuses et morbides. Elles jaillissaient de ses lèvres en jets fiévreux et aigres. Son esprit saturé de littérature, d’art et de décadence l’emmenait si haut qu’il paraissait se détacher du genre humain. Chanson après chanson, il bâtissait une œuvre désespérée et érudite. Il établissait dans un recoin d’ombre le nid d’un enchantement singulier et incantatoire.
Hunky Panky sentait qu’il s’épuisait. Il peinait à reprendre souffle, mais il lui fallait encore rendre hommage à Bob Dylan. Rassemblant ses dernières forces, il s’élança hardiment. Il attaqua «Song For Bob Dylan» d’une voix de nez pincé, retrouvant le secret perdu des arcanes dylaniennes.
Ayant rendu un bel hommage au peintre Warhola, il se sentit dans l’obligation saluer le Velvet Underground, une formation new-yorkaise qui exerçait sur lui une réelle fascination. Se sentant faible, il s’inspira à la hâte de «White Light/White Heat» pour interpréter «Queen Bitch» à la volée. Hunky Panky balançait ses épaules et martelait ses paroles :
— Je suis au onzième étage... Et je regarde les voitures qui circulent.
Ses pieds chaussés d’une feutrine de Syrie battaient sèchement le tempo. Quelques bouffées de chaleur lui rougissaient les pommettes. Il battait ses accords d’une main ferme et un sang barbare irriguait des veines que les excès avaient rendues poreuses. Le refrain recelait ce petit goût de vacherie musquée. Des coquetteries vocales l’humectaient d’une pluie d’essences félines sentant la jupe :
— Elle porte des fripes en satin qui bruissent... Une redingote, et un chapeau haut de forme... Oh God, je pourrais faire beaucoup mieux !
D’un geste lent, il chassa le voile qui commençait à lui obscurcir les sens, car il restait à explorer les corridors de la folie avec «The Bewlay Brothers». Il se préparait à fouailler les tensions exagérées de son cerveau, lesquelles avaient singulièrement aggravé sa névrose originelle et épuisé le sang déjà frelaté de sa race. En interprétant «The Bewlay Brothers», Hunky Panky allait s’enivrer sans limite des magies du style et attiser le délicieux sortilège de la note rare.
— Dans les coulisses d’où jaillissaient des aboiements... Nos dents de cuivre brillaient... Nous nous dressions dans l’ombre, oh... Et nous disparûmes.
Il poussait le couplet à se jeter dans l’insondable repos d’un néant béant, puis il levait d’une voix ample le rideau sur un horizon lustré de lumière blafarde. Hunky Panky passait des brassées d’accords magnifiques et bizarres. Il atteignait des régions mélodiques inexplorées, jouant sur sa guitare des combinaisons de notes évaporées d’une nature démente et sublimée. «The Bewlay Brothers» brillait d’une flamme liquide et sale. Cette immense chanson paraissait dégager une lumière d’un beau vert argenté. Elle scintillait d’un authentique éclat lunaire.
Aux dernières notes de ce morceau mirifique et spectral, Hunky Panky ressentit une violente douleur à la poitrine. Il savait que la vie le quittait. Rassemblant ses ultimes forces, il tituba jusqu’à la haute fenêtre et l’ouvrit. Son corps se prostra subitement. Il s’affaissa, privé d’air, sur la barre d’appui de la fenêtre.
En mourant, Hunky Panky donna naissance à Ziggy Stardust.
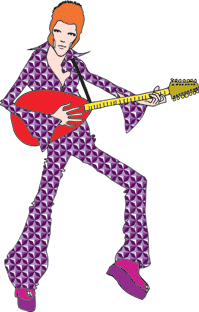
SANTA MONI CAT
Friday on my mind at the Santa Monica Civic Auditorium ! «Ziggy’s first american tour !» lit-on dans la presse. La sono du Civic envoie «L’Ode À la Joie» de Beethoven rouler sur la foule. Stephen Della Bosca se pince le bras au sang quand il voit arriver Ziggy Stardust sur scène. Comme tous les kids californiens agglutinés au pied de la scène, Stephen encaisse un choc d’une rare violence : le choc du futur. À la suite de Ziggy, the Spiders From Mars débarquent sur scène dans leurs space suits. C’est comme de voir le corps d’une femme nue pour la première fois : la fulgurance dépasse les facultés d’assimilation.
L’expression British rock star paraît même désuète en de telles circonstance. Stephen est bouleversé, ces fuckers de journalistes anglais ont menti ! Fucking liars ! Ziggy Stardust brille d’un tout autre éclat. Il est bien au-delà de tout ce qu’on a pu raconter ! Il réinvente le rock, exactement de la même façon qu’Elvis l’avait inventé. En une seconde, Stephen comprend que Ziggy ramène sur scène des trucs nouveaux, la bisexualité, c’est-à-dire la provoc ultime dans ce monde d’hommes qu’est le rock, puis l’indicible menace du Clockwork, directement puisée dans la mythologie Kubricko-Burgessienne. Et surtout un parfum enivrant de futurisme. On ne parle même pas de la beauté, qui fulgure tant qu’elle paraît logique, comme offerte en prime.
Sous un haircut rouge carotte luit d’un pâle éclat son visage fardé de blanc. Il porte une guitare acou en bandoulière et s’approche du micro. Bam ! «Hang On To Yourself» sans transition, la plus élégante des intros pour un set qui va transformer quelques vies, dont celle d’un Stephen qui frémit comme un étalon sauvage, planté dans ses boots argentées - Com’on com’on/ You’ve really got a good thing going - Ziggy le trépigne au com’on com’on et Ronno des Batignolles riffe au petit trot la charge de la brigade légère - We’re theee Spiders from Marchhhh ! - C’est un coup à tomber à genoux, Ronno vrille la voûte du Civic et de l’autre côté Trevor Bass Boulder broute le beat avec la mine peu avenante d’un charognard cosmique. Pourtant sevrés de miracles par Walt Disney, les kids californiens n’en reviennent pas. Stephen se sent désaxé pour la première fois de sa vie. Il sent son orbite se dématérialiser. Une bouche le suce, une vie nouvelle lui glace le sang. Ce qu’il éprouve défie les normes du plaisir. Oui, car Ziggy s’adresse à l’intellect - You’re the blessed, we’re the Spiders From Mars - Dans les villages de Palestine, le Christ ne procédait pas autrement. Il s’adressait lui aussi à l’intellect. Stephen dévore Ziggy des yeux. Jamais encore il n’avait senti une telle animalité chez un mec. Ziggy contrôle le moindre de ses mouvements, le battement de paupière comme le pas - Ziggy played guitah, jamming good with Weird an’ Gilly - Le public ovationne Ziggy qui raconte l’histoire de Ziggy. Il joue de la guitare de la main gauche dans les Spiders - Became the special man - Et la magie se répand sur le Civic. Ronno claque son Sol et son Si mineur avec une telle indécence que ça devient le passage d’accords le plus célèbre du monde. Ronno joue au gras des marquis, avec la plaisante lourdeur d’un bras chargé de dentelles et de bijoux. Sous son casque de cheveux platine, il challenge la suprématie de Ziggy, d’autant qu’il s’est peint les lèvres en rouge.
Ah yeah fait Ziggy et dans la précipitation, il scande - I still don’t know what I was looking for - Il déroule ce magnifique délibéré d’essence princière qu’est «Changes» - Tchooo tchoooo tchoooo tchoooo Changes - qui laisse la Californie sans voix car jamais une telle épopée n’était encore alors arrivée jusque là. En empruntant cette chanson à Hunky Panky, Ziggy délie la dragée haute d’une civilisation usée jusqu’à la corde. Ronno monte au micro et approche sa bouche de celle de Ziggy pour chanter avec lui. Chacun dans le public semble se réajuster mentalement au fil des cuts. Personne n’était préparé à un tel spectacle. Ziggy pointe le doigt vers l’espace - Sailors fighting in the dance hall/ Oh man ! - et il enchaîne avec l’infinie délicatesse de «Life On Mars». Il se fond dans les encorbellements cristallins de motifs corinthiens et d’arabesques mauresques que dessine Ronno sur les cordes de sa Les Paul en or massif. Ziggy tend la main. Five ? Oh yeah - Pushing thru the market square - «Five Years», beaucoup trop anglais pour venir de la planète Mars. D’autant qu’il voit des boys, des toys, des electric irons and Teevees, alors c’est louche. Stephen s’en émerveille, lui qui est d’un naturel si inquiet. Ronno fait monter sa mayo jusqu’à la prolifération orgasmatique - So many people d’encorbellement majeur.
C’est le moment que choisit Ziggy pour emmener tout le monde dans le cosmos - Grand control to Major Tom - fantastiquement gratté à l’accord, et Ziggy recrée la pop dans une dérive interstellaire - Planet earth is blue and there’s nothing I can do - Tant de beauté à l’image d’une infinie détresse. Ziggy décrit en quelques phrases l’absolu de la solitude : être perdu dans l’espace, sans aucune chance de pouvoir regagner la terre. Il invente le romantisme futuriste. Les Californiens ne sont pas préparés à une telle épreuve. Ils ne savent rien de la souffrance. Ils ne vivent que dans une quête éperdue de plaisir - Can you hear me ? - Personne ne répond. Ni dans la salle ni dans l’espace. Comme Ziggy, Stephen sait que les carottes sont cuites. Sans l’arrivée providentielle de Ziggy, jamais il n’aurait pu réfléchir à une telle chose : la solitude qui précède la mort. Ziggy salue rapidement Andy Warhol et Jacques Brel avec «My Death», deux ombres qui passent largement au dessus d’une Californie notoirement inculte et les Spiders redescendent dans l’enfer du psych-out anglais pour touiller une monstrueuse version de «The Width Of A Circle», hit underground d’un certain David Bowie. Ronno joue au gras double de l’agressivité maximaliste. Ziggy se campe sur ses pattes de Spider, le temps que passe la tourmente. Il souffle sur le Civic un vent de folie de force V du type de ceux que levaient les Standells en leur temps.
Ziggy porte sa touche bisexuelle à incandescence avec «Queen Bitch». Les coup de hanches qu’il donne en disent long sur l’aisance avec laquelle il lève des michetons dans les bars - I’m the space invader ! - «Moonage Daydream» tombe comme une chape sur le Civic et pourtant, il s’agit là d’une nouvelle prière - Keep your electric eye on me babe - Ziggy far-oute le Civic. Stephen vibre de tout son corps. Mais son état empire encore lorsque Ziggy attaque «John I’m Only Dancing» car Ziggy atteint là les sommets du dévoiement, il va même jusqu’à s’étrangler dans son trémolo - Don’t get wrong - Il pousse jusqu’à la perversion extrême. Et après avoir présenté Mick Ronson on guitah, il attaque une version somptueuse de «Waiting For The Man», battant toutes sortes de records au passage, dont ceux de l’ambiguïté androgyne à la Fellini et de l’instigation sauvage, car il vaut bien à lui seul une horde de cannibales affamés.
Ah des gens réclament du rock ? Ziggy leur jette «The Jean Genie» en pâture et donne carte blanche à Ronno qui pétrit ses riffs avec une rare violence. Il joue comme un vrai lad de Hull, faut pas lui marcher les pieds ni lui dire un seul mot de traviole. Ziggy s’ébroue et crache du snow white et du New York a gogo - And everything tastes nice - Avec les Spiders survoltés, ça prend des allures extravagantes, Ronno riffe serré, on assiste à un looks like a man et ça rampe dans les reptiles, Ziggy swingue ses chimney stacks ouuuh ouuuuh, les Californiens n’en peuvent plus - Jean Genie let yourself go ! - Stephen frise l’overdose, s’il mourait à cet instant précis, ce serait fantastique. Ziggy chante à pleine bouche de pipe. Rien ne pourra plus l’arrêter - Loves to be loved, loves to be loved - Et la bulle pop explose en plein vol avec «Suffragette City». Ziggy fait aux Californiens le plus beau des cadeaux : la pop du Palace Pier bardée d’amphètes - hey man ! - Ziggy secoue sa crête orange et balance le plus célèbre des refrains - Oh don’t lean on me man/ Cause you can’t afford the ticket/ I’m back on Suffragette City - Les Spiders jouent comme des diables, Ronno glisse dans les coulures du soufflet et c’est le break que guette la terre entière - Ohhh, Wham Bham Thank You Maaam ! Stephen assiste médusé à l’apothéose du glam anglais.
En sortant du Civic, il sent l’air chaud envelopper son corps en nage. C’est à cet instant précis qu’il décide de changer de nom. Il s’appellera désormais Ygarr Ygarrist et viendra donner une deuxième chance aux terriens avec un groupe originaire de Plutonia, dans la Xavia Zeee Galaxy, les fameux Zolar X. Ils joueront régulièrement à l’English Disco de Rodney Bigenheimer et se montreront parfaitement dignes de «The Rise And Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars» en enregistrant de beaux album de glam pur.
Signé : Cazengler, drôle de zig(gy)
David Bowie. Disparu le 10 janvier 2016
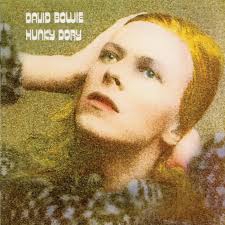
David Bowie. Hunky Dory. RCA 1971
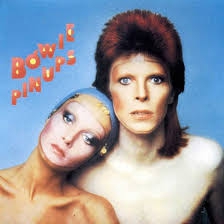
David Bowie. Pin Ups. RCA 1973
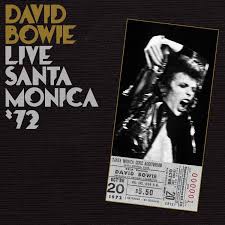
David Bowie. Live Santa Monica 72. Virgin Records 2008
TROYES – 16 / 01 / 16
MIDWAY SHOOTER BAR
RENE MILLER TRIO
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, alors on y va, en courant. En plein cœur de la bonne ville de Troyes. Vous avez perdu, ce n'est pas au 3 B, mais pas très loin, au Midway. Nous arrivons en avance. Pas question de perdre une note. Surtout une bleue. Les musicos finissent de manger confortablement installés sur un canapé. Au Midway les chaises sont rares mais les divans profonds et moelleux sont agrémentés de tables basses. Déco américaine typique sur les murs. René Miller, le fera remarquer durant son tour de chant, l'on se croirait chez soi, dans une grande pièce. Avec son borsalino et ses mains dans les poches, il ressemble à un gangster d'un film des année cinquante. En plus vous avez droit à une version originale puisqu'il parle sa langue natale. L'est en France depuis vingt ans, mais comme tout le monde connaît un peu d'anglais, il n'a pas eu à s'adapter...
L'on sent que l'envie de jouer le démange, pas le genre de gars à faire attendre le public. Une petite cigarette sur la terrasse et les voici tous les trois en place. Le bar s'est rempli doucement, moitié amateurs de blues et moitié fans de rockabilly...
CONCERT

Ben Body est à la contrebasse, le bras sur le manche et les doigts en attente sur les cordes. David Chalumeau a déballé ses harmonicas, toute la gamme posée dans l'ordre alphabétique près de lui. René s'est assis, le restera toute la soirée, telle l'image d'Epinal des bluesmen sur le perron de leur baraque en planches disjointes du Mississippi, l'a gardé son chapeau – étrangement il en paraît beaucoup plus jeune. Placidement il tire son étui à guitare, et l'en sort la plus merveilleuse des poêles à frire. Une guitare à résonateur bleutée comme un dos de requin. Nous prévient en son idiome qu'ils vont jouer essentiellement du blues, et après un regard ironique et appuyé sur le confederate flag, un peu de country aussi. No comment. Chacun appréciera l'humour de la situation à sa guise.

N'ont pas douze tonnes de Marshall derrière eux. Trois petits amplis de rien du tout. Celui de René Miller, vous l'employez chez vous pour ne pas réveiller les voisins. Brut de blues. Tout dans le souffle et les doigts. Pas de surenchère, ici, il faut jouer au plus près sans tricherie. Pas une question de son, mais de présence.
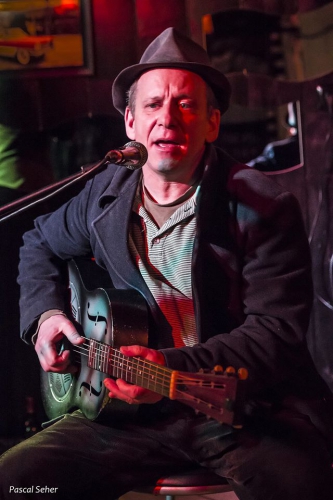
La guitare et la voix. Faut savoir les associer. Contrairement à ce que son nom laisserait supposer, le résonateur ne résonne pas. Il sonne, n'installe pas une profondeur sur laquelle le chant pourrait se vautrer comme sur un coussin rempli d'eau chaude. Le métal scalpe, il clinque et cliquette, c'est la voix qui dépose les harmoniques. Mais elle doit d'abord surmonter le clappement sec de l'acier, lui rabaisser le caquet comme l'on recourbe de la main vers le sol la tête du reptile qui voulait vous mordre. Faut être blues et shouter, ne pas passer en force, mais s'imposer une fois, deux fois, mille fois, autant de fois que nécessaire faut pousser son holler et retomber tout de suite dans la syncope du silence. Piquer du nez et reprendre de l'altitude.

Mais ce n'est pas tout. Reste le plus important, le doigt qui se glisse sous le manche au ras de la caisse et le cylindre du slide qui fait glisser les notes, les arrache et les gicle, en accentuent le feulement métallique tout en leur imprimant une onctueuse acidité. Le grain grinçant de sable qui enraye la machine tout en lui permettant de changer de dimension. La main gauche armée de ses deux médiators ne chôme pas mais c'est le bottleneck qui permet le basculement rythmique du blues, l'escalier qui descend alors que l'on monte, cette impression d'être aspiré par la vase du Delta alors que l'on se sent aggripé par le septième ciel. De la jouissance. Pas celui du mauvais dieu des églises.

David Chalumeau est à l'harmo. Monte en douce dans le wagon. Mais après plus question de le faire descendre, notre hobo. S'accroche à l'échelle et ne lâche plus la note. Pas de coupure, pas de zébrure, pas de déchirure. Joue à souffle continu. Ce n'est pas le train sifflera trois fois et se taira. N'est pas pour la stridence qui vous hache l'oreille en petits morceaux avec les oignons crus par-dessus. L'est pour la perceuse vicieuse qui vous troue le tympan et s'enfonce en avant sans jamais marquer de pause. Le serpent déroule ses anneaux, mais le bout de la queue n'apparaît que lorsque René Miller achève son morceau. Toujours par surprise. Brutalement. Une balle dans la tête et l'on passe au suivant. Et David Chalumeau se dépêche de choisir un nouvel harmonica.

Ben Body n'a pas ce souci. Toujours la même contrebasse. Suffit de suivre et d'impulser. N'a pas droit au déraillement. Les deux autres peuvent foncer devant, il est le gardien du phare. S'y réfèrent sans arrêt, l'est derrière, mais c'est lui qui guide même si Miller découvre le chemin et fonce en avant, Chalumeau est emporté dans sa cavalcade, mais Ben Body assure la logistique. A toutes les étapes l'on se retourne, mais il est là; imperturbable, le roc dans la tempête.

Deux sets, des incontournables du blues, un Crossroad démentiel, la guitare pour ainsi dire nue de René nous aide à comprendre l'attrait diabolique de ce morceau et pourquoi Robert Johnson est plus grand que son mythe. Du trapèze volant, sans filet. Une prédilection pour Mississippi John Hurt, son Frankie folk country bluesifié à mort, l'a la voix rèche qu'il faut pour cela. Un Higway 61 ( non revisité ) de Big Joe Williams, et un In my Time of Dying de Josh White, du blues comme il en ruisselle dans le grand fleuve. Un régal, live. Des compos comme Baby Roll, mais aussi des reprises plus modernes, ce Come Together des Beatles transformé en vieux blues déchiqueté à la Howlin Wolf – l'est vrai que Lennon s'était inspiré d'un peu trop près du You Can't Catch Me de Chuck Berry – puis ce qu'il annonce être l'hymne national « unofficial » du Canada, le Hallelujah de Leonard Cohen interprété un peu à la dernière manière de Johnny Cash, et surtout ce Sympathie for the Devil, d'autant plus fort et splendide que réalisé avec une formation pour ainsi dire à minima. Hyper bien chanté. Le morceau découpé jusqu'à l'os. Frisson sur la peau garanti. De quoi vous donner envie de lire les œuvres complètes d'Anton Lavey.

Et pour finir, en ultime rappel, une surprise, en français s'il vous plaît. Ne proposez pas de titre. Aznavour, un For Me Formidable, du temps il essayait de rivaliser avec les big bands d'Amérique. S'en tire joliment et avec le sourire. Applaudissements nourris. Le blues n'est pas toujours triste. Surtout pas celui du René Miller Trio, tonique et revigorant. Nous emportons un disque, comme un trésor, nous vous le chroniquerons bientôt.

Damie Chad.
( Photos : FB : Pascal SEHER )
ALIAS VINCE TAYLOR
LE SURVIVANT
( Editions DELVILLE / 1976 )
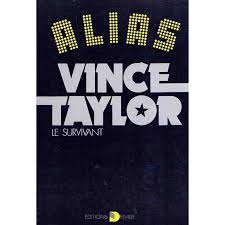
En 1976, l'on s'est précipité dessus comme les barbares sur l'Empire Romain. Enfin des nouvelles fraîches de Vince Taylor ! L'on n'y croyait plus. Pas trop en tout cas. Que Vince qui baragouinait un français approximatif ait pu rédiger son autobiographie laissait rêveur. D'autant plus que les trois premiers chapitres trahissaient la patte du romancier. Avec la collaboration de Jacques Guiod, c'était écrit en tout petit sur la page de titre. Le choix du rewriter n'était pas mauvais. Jacques Guiod a traduit plus d'une centaine de livres, principalement des ouvrages de science-fiction, les auteurs les plus prestigieux, je ne citerai à titre d'exemple que Robert Silverberg, d'autres babioles aussi, pour rester dans un domaine qui touche notre rêve américain nous mentionnerons la présentation des photographies des Indiens d'Edward Sheriff Curtis. Science-fiction, Vince Taylor, Ziggy Stardust David Bowie, les connexions s'opèrent d'elles-mêmes... Jacques Guiod était l'homme approprié pour ficeler coupures de presse et confidences de Vince en un tout cohérent.
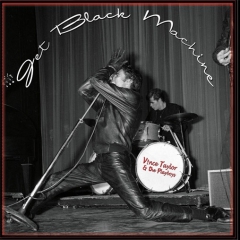
Ne s'agit pas ici d'accuser Vince Taylor de mensonge. Toute vérité n'est qu'une reconstruction du réel. Au mieux on peut l'asséner de toute bonne fois. Mais ceux qui croient en leurs Dieux – idem pour les fans qui se prosternent devant leurs idoles - sont au minimum des naïfs. Au pire des idiots. Vince Taylor était trop intelligent pour ne pas douter de lui-même. Ne nous fait-il pas l'aveu au détour d'une phrase de nous révéler que ce qu'il vient de raconter n'a peut-être pas été vécu !
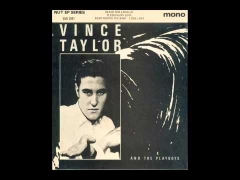
Inutile de délaisser le bouquin et de faire comme s'il n'était qu'un ensemble d'approximations fumeuses auxquelles l'on ne saurait accorder un crédit quelconque. D'abord parce que Vince donne pour tout le début de son existence des informations à l'époque inédites, que des enquêtes ultérieures corroboreront, mais surtout parce que se dessine en creux un portrait psychologique de Vince qui n'est pas sans intérêt.
Cette bio était censée préparer un des incessants comeback de Vince. Au premier plan de l'actualité. Dans sa tête sûrement. Pour son entourage l'on devait être plus dubitatif. L'on était passé au plan B, sauvons le rocker Vince Taylor, avant qu'il ne soit trop tard. Le plus étonnant c'est que de page en page, Vince Taylor s'y présente alternativement, sous son meilleur jour comme sous sa pire caricature.
L'a un côté vantard un peu énervant. Monsieur qui sait tout et qui a toujours raison. Peut prophétiser si les conseils qu'on lui prodigue et qu'il suit tourneront au fiasco ou seront des avancées décisives de sa carrière. Comme les premières années, la chance finit toujours par lui sourire, le lecteur lui pardonnera volontiers ses roublardises. L'on ne critique pas une équipe ( fût-elle constituée d'un seul membre ) qui gagne. N'insiste guère sur ses passages à vide en Angleterre, les mentionne, mais une fois qu'ils sont surmontés. C'est de bonne guère. In hoc signo Vinces. Si c'est écrit sur les paquets de cigarettes nous n'y pouvons rien. Peut-être était-ce un avertissement des Dieux, que la gloire s'envole facilement en fumée...
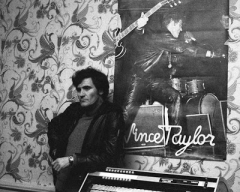
Rend fidèlement compte de son triomphe en notre douce France. Et peut-être même peut-on discerner en ses souvenirs heureux la prise de conscience que son incroyable succès repose sur une terrible méprise. Il apparaît à ses propres yeux comme le rocker par excellence, dans toute sa splendeur, des sets d'une sauvagerie inimaginable et d'une beauté absolue qui traumatisent littéralement la société française. Question rock, c'est une réussite parfaite. La France le gobe comme Proust sa madeleine. Mais ce n'est pas la coquillette sucrée de Marcel qui est l'héroïne du roman. Elle n'est qu'un adjuvant nécessaire mais contingent de ce qu'elle révèle. Idem pour les shows de Vince, n'intéressent – à part une poignée d'exaltés – the french population qu'en ce qu'ils dévoilent, mettent à nu, les désirs profonds et inavouables de la société, ceux d'une exigence d'une libération définitive des corps et des esprits.
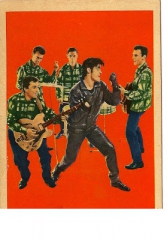
Rompez les chaînes – Vince a pris l'habitude d'en brandir une sur scène - des esclaves, le retour du refoulé ne se fera pas attendre. Vince vous permet de vous débarrasser de votre culotte, mais à la fin de l'explosion libératrice c'est lui qui sera rejeté comme une vieille chaussette ( noire).
Vince ne dérogera pas à son chemin. Ses deux premières années de par chez nous tournent à l'émeute, c'est de la folie pure. Lorsque Barclay apurera les comptes de son investissement financier et qu'il retira ses billes, Vince n'en continue pas moins sa sente folle. Si le monde s'assagit, il comblera le déficit en prenant la folie à son compte. Tout se détraque dans sa tête. L'alcool et les produits n'y seront pas pour rien, mais nous les tiendrons pour des péripéties extérieures à la grande décision nervalienne de Vince Taylor, celle d'assumer du dedans, la folie de laquelle les spectres du dehors se détournent avec horreur.

Lui qui a connu le rock et les palaces se retrouvent seul. Les filles qui ne l'abandonneront jamais ne comptent pas. Se laissent pousser les cheveux. Vit dans la rue. Mais ce n'est pas le plus terrible. L'a perdu son statut de rocker. L'est devenu un hippie. Comparé à cette déchéance êtrale, les séjours en hôpitaux psychiatriques sont de la petite crème. Des broutilles. Les conte avec une certaine complaisance. Traverse l'enfer. Mais il en ressort vivant. A la fin du livre il dresse le bilan de sa vie. L'a été beaucoup trahi. Les seuls qui ne l'ont pas abandonné sont les rockers. Les Teddies en Angleterre, les rockers en France. Notamment la légendaire figure de Johnny de Montreuil. Le logent, le nourrissent, lui filent de l'argent, lui passent des copines, veillent sur lui. Préparent son retour... Des anges... noirs dont il dresse un portrait apocalyptique. Des réprouvés, des rejetés. Nés dans la misère et la violence. Des durs car les faibles ne survivent pas. Mais fidèles en amitié. Ne connaissent pas la pitié mais peuvent vous soutenir indéfectiblement. Avec eux, c'est à la vie, à la mort. Et jusqu'à après la mort. Cela s'appelle la vengeance...
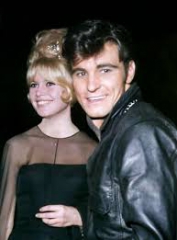
Désolé pour les féministes. Comme dans les sociétés guerrières les filles passent après les gars. Sont là pour servir et se taire. Brunes ou blondes elles comptent pour du beurre. A Baratter. Une constance chez Vince. L'a honoré à la va-vite des tas de meufs. Macho, phalo et tout ce que vous voulez. L'était doué d'un irrésistible sex appeal. N'avait point besoin de se forcer. S'offraient. Consentantes. Soumises. N'allait pas non plus refuser ! Mais cette pression de femelles énamourées le dégoûtent. Gare à celles qui s'accrochent. N'hésite pas à les frapper si elles ont encore envie. Cette violence n'est pas réservée aux groupies anonymes un peu trop chaudes. Nombreuses seront ses compagnes qui auront droit à quelques mémorables corrections. En rejette la faute sur sa première épouse qui s'adonnait en cachette aux joies du striptease... Les contradictions du puritanisme anglo-saxon apparaissent au grand jour... Se dit assoiffé de pureté et s'étend longuement sur son aventure sentimentalo-érotique avec une nymphette de treize années. L'on n'est pas très loin des chaudes accointances de Jerry Lou avec sa petite cousine Myra et de la cour troubadourienne d'Elvis avec l'infante Priscilla... Très sexuellement incorrect. Qui de nos jours, en ces temps hypocrites d'ordre moral, aurait le courage de révéler sa vie intime avec autant de netteté !

Frelaté et fascinant. Authentique et outrancier. A la relecture, quarante après, ce bouquin est un magnifique artefact rock and rollien. Nous paraît même avoir gagné en force. En fait c'est notre époque qui s'est affaiblie. On a pris l'habitude de passer un peu vite sur ce livre. On a trouvé l'excuse, son manque de fiabilité et son imprécision chronologique. Mais à la lecture, si l'on prête l'oreille à la petite musique rock and roll qui s'en dégage, il n'est pas dépourvu d'un charme vénéneux. Prenez-y garde, le poison agit lentement. Mais sûrement.
Damie Chad
( Photo : Vince +jukebox / SITE ROLLCALL à visiter )
BILLIE HOLIDAY
MUNOZ & SAMPAYO
( Casterman / 2015 )
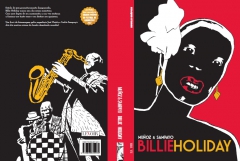
Centenaire de la naissance de Billie Holiday. Ca tombait bien, chez Casterman ils avaient dans les cartons l'album de Munoz et Sampayo sur Billie. Se sont dépêchés de le rééditer. A leur décharge, faut rappeler que les deux argentins sont pour ainsi dire des auteurs maison et que la boîte les édite sans désemparer depuis trente ans. Carlos Sampayo est un authentique amateur de jazz, l'a aussi participé à un Fats Waller avec le dessinateur Igort d'origine italienne - qui de son côté a commis un Sinatra - l'a même rédigé une Historia del Jazz. Vous l'avez compris Sampayo se charge des scénarii et José Munoz dessine. Dans sa jeunesse Munoz a travaillé avec un autre italien très célèbre, Hugo Pratt, le père de Corto Maltese... Italie, Argentine, jazz, Billie Holiday, Sinatra, quand j'aurai ajouté que Munoz et Sampayo ont réalisé un Carlos Gardel, prince du tango, nous pourrons certifié qu'il n'y a pas de hasard, uniquement des rencontres. Et comme notre monde vu depuis les étoiles est encore plus petit qu'on ne le pense, c'est la compagne de Jacques Tardi – duquel vous avez lu ses Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, héroïne anarchisante... - Dominique Grange – créatrice de Les Nouveaux Partisans – en quelque sorte l'hymne de la Gauche Prolétarienne – qui opéra la traduction des bulles. Pas étonnant que tous ces personnages se soient sentis en osmose avec la rage qui habitait Billie Holiday. Une même exigence artistique et un même sentiment de révolte politique les animent.
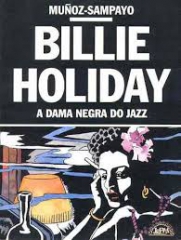
Suffit de regarder la couverture pour tout comprendre. Pourrait s'intituler la négresse rouge au camélia blanc. L'on vous résume la bio de Billie avant que vous ne commenciez, avec des photos d'époque. C'est que la suite est un peu embrouillée. C'est l'histoire de Billie mais dans le désordre. Trente ans qu'elle est morte. La radio en parle, les journaleux recherchent des documents et les témoins se souviennent. Ceux qui l'ont croisée sans même savoir qu'elle était Billie Holyday et ceux qui ne le savaient que trop. Les images arrivent dans le désordre, comme les coups de pied lorsque l'on vous passe à tabac, ou alors comme quand vous avez trop bu et que la tête vous tourne, ou alors comme quand le sang tape un peu trop dur dans vos veines sous l'effet de l'héroïne.
Billie vous offre le cocktail de sa vie. Difficile de l'avaler d'un trait. Trop d'amour, trop de sexe, trop de fric, trop de haine, trop d'injures, trop de mépris, trop de drogue, trop de trop. La vie est un cauchemar et la mort une épouvante. Entre les deux vous faites comme vous pouvez. Ne pensez pas à vous enfuir les issues sont fermées. Barrées. Obstruées. Bouchées. A la Reine. Cadenassées. La règle du jeu est simple. Les flics sont les bumpers et vous êtes la boule. De couleur noire. Cela à son importance car les arbitres ne seront jamais de votre côté. De toutes les manières, il n'y a pas d'arbitre. Billie connaît les règles du jeu. Elles sont simples. Tous contre vous. Vos ennemis. Et vos amis aussi. Du moins ceux qui devraient être vos amis. Les pigs sont partout. Même autour de votre lit de mort. Les honnêtes citoyens sont bien gardés. Les mauvais encore plus. Le répit ne peut venir que des anonymes. Mais ils n'ont aucun pouvoir, un sourire, une déférence. C'est tout. Je me demande si cela peut-être positif. Cela vous rembobine peut-être plus dans votre solitude. Dans votre désespoir.
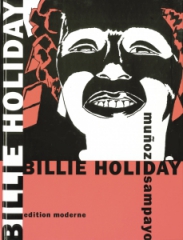
Mais à chacun sa citadelle. Celle de Billie s'appelle le Pres. Ne sera pas imprenable. La mort finira par planter son drapeau noir sur la plus haute de ses tours. Avant il y avait eu la dépression, la folie peut-être. On n'a jamais su. Une forme particulière de schizophrénie. Ou alors quelque chose de plus difficile à cerner. Un repli. Le silence. Le mutisme. L'a été un des plus grands du jazz. C'était le miel de l'Hymette qui coulait de son saxophone. Comme la parole de Platon. Mais un jour il a arrêté. De vivre. Mais avant, de jouer. Soufflait bien un peu pour gagner sa croûte. Mais n'y faisait plus attention. Sans cœur, sans joie. Parce qu'il faut le faire. La corvée de vaisselle. L'on s'en passerait aisément, mais là ce n'est pas possible. S'appelle Lester Young et c'est l'ami de Billie Holiday. Son amant. Mais peut-être pas de chair. Personne n'en sait rien. Son amant d'âme de dame, oui cela est sûr. A eux deux ils sont la citadelle. Deux miroirs qui se renvoient leur reflet. Et puis rien d'autre. Cela suffit. Ne se comprennent pas nécessairement. L'important ce n'est pas d'avoir la compréhension intime de l'autre. Ce sont les autres, tous les autres qui vous ont désignés comme seuls horizons possibles. Vous ont condamnés à aller l'un vers l'autre. Naturellement. Lorsque vous ne pouvez allez nulle part vous ne pouvez rencontrer quelqu'un uniquement dans cet espace de nulle part. Pas de quoi pavoiser. Mais une grande tendresse, qui vous happe l'un vers l'autre. Et qui vous zappe des autres.
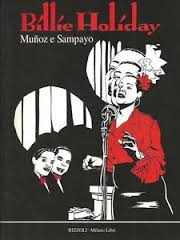
La mort du Pres fut un drame pour Billie. Ne le voyait plus beaucoup, ne jouaient plus ensemble, mais l'était toujours présent. En elle, près d'elle. Avec la mort de Lester, Lady Day s'est trouvée confrontée à la brutalité de l'existence. N'avait plus son bouclier de protection. Sans Young, la vie ne valait plus la peine. Billie absorbe la violence du monde dans son corps, et elle aussi devient violence. Lui faut émettre de la violence pour opposer une force au moins aussi forte à celle qui la submerge. Jeu de miroir mais la glace est cassée.
Ensuite plus rien ne peut l'atteindre. Ni les vivants ni les morts. Même quand elle est encore vivante, même quand elle est déjà morte. Encore morte. Il n'y aura pas de sorcellerie vaudou. Le fil est coupé. Personne ne le renouera. Allez vous recueillir sur sa tombe. Le cœur gonflé d'amour et de regret. Cela ne sert à rien. C'est tout juste bon à consoler votre chagrin à vous. Pas le sien. Egoïsme des hommes. Solitude d'une femme.
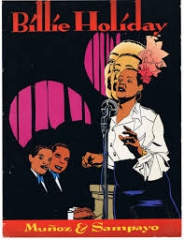
Sa conscience est plus vaste. Ce n'est pas sa propre existence qui lui fait mal. Ne s'en tire pas si mal que cela. Ce sont les blessures de tout un peuple qu'elle porte en elle. L'a bâti la cause stirnérienne de son moi sur rien. Elle l'a bâtie sur les autres. Tous couchés et si peu debout. Quelques uns et personne d'autre. De quoi subir tous les découragements du monde. Son âme était blessée mais la blessure était en dehors d'elle. Une situation qui n'est pas sans rappeler la double postulation du poète Joë Bousquet, blessé d'amour et de guerre. En la même époque. Mais le drame de Joë Bousquet fut personnel, individuel – même si la grande secousse cataclysmique de 14 – 18 en fut la première pourvoyeuse – celui de Billie Holiday est empêtré dans une trame collective qui se retire d'elle. L'alcool, le sexe et la drogue pour colmater les interstices.
Sampayo a découpé son récit en lanière. Un peu comme ces fouets qui s'abattaient sur les dos des esclaves. Munoz a adapté le dessin. L'a suivi le même processus créatif que son scénariste. Certes l'est difficile de décider si pour lui, le blanc de ses vignettes représente la béance d'ombre du vide et le noir la contrefort de la vie animée gorgée de sang chaud qui tente de faire barrage au néant, ou alors au contraire, si pour lui, le noir est le fond d'opacité du destin et les taches de blanc les battements d'ailes de la vie qui tenterait d'échapper à cette noirceur programmée.
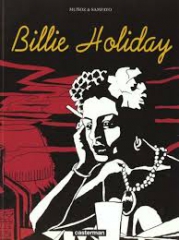
Dans les deux cas, ce n'est qu'un jeu d'ombre sans lumière. Un combat de noirs qui se battent dans un tunnel à coups de boulet de charbon. Tournez les pages du livre rapidement, les formes s'estompent, se détache juste une lutte mouvante entre le blanc et le noir. Entre les noirs et les blancs. Jamais un auteur de bande dessinée n'aura autant réussi à effectuer la coïncidence suprême, celle de la matérialisation graphique du dessin avec ce qu'il sensé raconter et exprimer. Une véritable calligraphie orientale, selon laquelle le geste du pinceau trace le signe qui détermine le sens de l'œuvre. Jamais le dessin n'aura été aussi près de cet art suprême qu'est la musique car le frémissement seul de la voix de la chanteuse suffit à indiquer les émotions qu'elle s'emploie à nous faire partager. Même si l'auditeur n'entend un traître mot de la langue dans laquelle elle chante, il entend parfaitement la signification exacte et universelle que le vibrato de la voix impose. Sculpture vocale, art total, qui se passe de tout commentaire superflu.
Pour ceux qui ne comprendraient pas, la couverture s'avère explicite. Un peuple symboliquement décapité en faisant taire cette voix dans laquelle perçaient d'étranges fruits. La lame rouge de sang. Et la tête soleil noir, cou coupé.
Damie Chad.
CULTURE ROCK
L'ENCYCLOPEDIE
DENIS ROULLEAU
( Flammarion / 2015 )
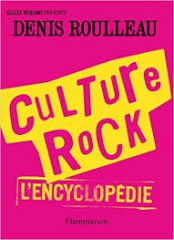
Je n'arrivais plus à y mettre la main dessus. Jamais en rayon dans les librairies que je visitais. Lorsque j'ai remarqué la couverture souple, au regard j'ai pressenti la parenté, oui mais en 2011 elle pépiait d'un jaune canari éclatant, et là s'étale un rose quasi-fuchsique, s'offrait aussi en format un moindre qui lui refilait l'apparence d'un missel du dimanche ( ô Satan que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ! ), exactement comme ces petits volumes qu'Hölderlin et toute la génération romantique trimballaient dans leurs poches durant leurs nobles pérégrinations. Réédition en cette fin d'année 2014, avec quelques centimètres de plus, augmentée et mise à jour, par son auteur Denis Roulleau.
Quand vous l'ouvrez, vous n'êtes pas dépaysé. Vous vous croyez dans votre blog-rock favori. Les mêmes couleurs criardes que celles qui badigeonnent les livraisons de KR'TNT ! Même que parfois vous devez écarquiller les mirettes comme des soucoupes volantes pour déchiffrer le texte. Spécialement un marron macrameux à dominante parmentière terreuse. L'esthétique punchy de mauvais goût du rockabilly dans toute sa splendeur. Sauf que ( de rat coupée ) les pionniers et les fifties ce n'est pas sa timbale de Jack.
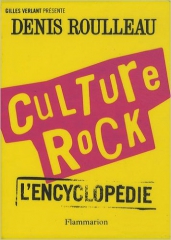
Si vous pensez trouver tous les gentils rockers sagement alignés à la queue leu leu alphabétique, vous vous trompez, certes vous avez droit à une encyclopédie-rock, mais c'est le versant culture qui sera privilégié. Culture et Rock, deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, s'exclameront les grincheux de service. Mais ce sont là gens de chagrine et étroite intelligence. Auxquels nous n'accorderons qu'un regard de mépris compatissant. L'est bizarre de voir combien beaucoup de nos contemporains s'accordent à rétrécir les champs du possible. Encore que ( de renard hendrixien ) ici, encyclopédique ne signifie point universel. Le livre est avant tout destiné à un public français. Pas au sens nationaliste du terme, mais culturel. Entendez par ce vocable que Denis Roulleau explore et explicite les différents canaux et éléments qui ont permis à tous les petits frenchies que nous sommes d'entrer, un jour ou l'autre, par telle ou telle capillarité sympathique et osmosique, en relation avec cette musique d'importation sauvage qu'est le rock and roll.
C'est comme à la piscine municipale. Le meilleur moyen d'apprendre à nager c'est de tomber par mégarde des quinze mètres du plongeoir meurtrier directement dans le grand bain. Vous êtes pénardos chez vous, et schploff ! sans avertissement un titre vous étreint. Le boa constricteur du rock s'est jeté sur vous, désormais jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes perdu pour la communauté humaine, vous êtes devenu un rocker. Mais il y a des pétochards qui ont besoin d'une approche moins abrupte, demandent conseil au maître-nageur qui roulent de rassurantes mécaniques sur le bord des bassins. Vous êtes comme Dante ( une bonne pâte littéraire ) qui pour visiter les Enfers a eu besoin de Virgile pour la traversée des cercles peuplés de ces malheureux qui en leur terrestre existence se sont adonnés aux pêchés capiteux. Vous éprouvez la nécessité d'un intercesseur, d'un coach-rock pour vous guider en ce monde de sentes obscures, de pentes fatales.
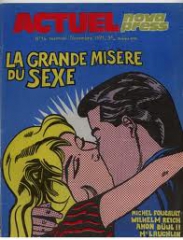
Alors David déroule le Roulleau des opportunités à saisir de toute urgence. La presse tout d'abord puisque le premier article est dévolu à Actuel. Qui n'a pas eu entre ses mains ses pages colorées, ultraviolettes, et salades de fruits composées d'orange sanguine et de jaune citron mielleux, n'a rien vu. N'ont rien lu, non plus ceux qui se jetaient dessus. Mais c'était beau. Un magazine qui jetait l'encre dans les sujets tabous ( quoique le Special Cul du journal Tout ! à l'époque c'était vraiment culotté ), les gauchistes le lisaient en cachette, en public ils se méfiaient, le jugeaient un peu décadent. Pas vraiment léniniste. J'en profite pour évoquer Le Parapluie, un peu surfait à mon humble avis. Tant qu'il y était et vu le temps pluvieux, l'aurait pu ajouter L'Escargot Folk. En tout cas Rock'n'Folk, Best, Extra, JukeBox, Xroad et le premier d'entre eux le légendaire Disco-Revue qui essuya les plâtres. Mais un journal sans plumes c'est comme un oiseau sans ailes, les journalistes rock possèdent donc leur stèle Laurent Chalumeau, Alain Dister, Philippe ( grandes ) Manoeuvre, Yves Adrien, Eudeline, Philippe Garnier, et tous ceux qui s'appliquèrent à créer une écriture rock française, un art difficile, notre langue préférant de par son origine latine les grands drapés cicéroniens. Lisez, dans un tout autre ordre d'idée, une page d'hommes aussi peu marqués par le rock and roll que le général Charles de Gaulle et le Connétable Winston Churchill, pour comprendre hors de tout contexte l'avantage, dû à ses facultés plastiques, de l'idiome anglo-saxon. D'ailleurs le mieux serait peut-être que vous jetassiez un coup d'oeil chez les pères fondateurs d'outre-mer comme Greil Marcus, Nick Cohn, Nick Kent, Richard Meltzer, Lester Bang et l'ancêtre symbolique à tous Hunter S. Thompson, le grand inspirateur du journalisme rock gonzo. Le gonzo c'est le gonze insupportable qui se ramène là où l'on n'a qu'un besoin modéré de sa personne, et qui malheureusement ramène tout à sa petite personne. Bref le gars insupportable qui ne se prend pas pour la moitié d'un étron de chien ou de Dieu ( c'est un peu la même chose mais ce dernier sent un plus mauvais ), un égonze surdimentioné. Arrangez-lui une interview au paradis avec Elvis et vous aurez de la chance si par hasard il mentionne le nom du Memphis kid dans son article. Car Elvis est sûrement le rock, mais la star c'est celui qui pond l'article.
Attitude terriblement rock quand on y pense. Toutefois le rock ne se réduit pas à son écriture, alors Denis développe aussi le Roulleau des pellicules. Celles des photographes et des cinéastes. Et même celui des peintres rock qui peignent d'ailleurs de préférence au cran d'arrêt. N'oublie pas les salles de spectacle, les promoteurs, les tourneurs, les roadies, les ingénieurs du son, toute la faune spécialisée qui gravitent autour des musicos, sans faire l'impasse sur la quincaillerie qui marche avec, guitares, amplis, lunettes, Perfecto et tout le reste de la brockante...
Un malin le Denis Roulleau, les articles sont assez courts, dépassent généralement la Denis-page mais excèdent rarement la double pangée et avec les photos et les encadrés punaisés de ci de là, l'a toujours la possibilité de se retrancher derrière le manque de place si vous le trouvez le pépère un peu court. Sinon, c'est bien fait. Se débrouille pour refiler un max d'informations sans trop se prendre au sérieux. Juste ce qu'il faut pour rester crédible. Essaie de terminer sur une pirouette manière de mettre le lecteur dans sa poche.
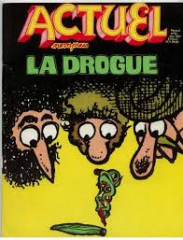
N'y a que deux artistes qui possèdent leur pré carré pour ne pas dire une concession à leur nom dans le bouquin, les Doors et Woody Guthrie. Tous les autres apparaissent uniquement quand ils ont participé à un événement mémorable dont ils ne sont pas obligatoirement la vedette. Manière de remettre chacun à sa place, le rock relégué dans les combles, sous les toits, et la culture ( rock ) dans les appartements de prestige. Une fois n'est coutume ! Veut sans doute nous prouver que les rockers ne sont pas des béotiens. Certes s'ils n'écoutaient pas cette musique de sauvage ils n'auraient point besoin de rechercher tant d'alibis, ma bonne dame.
Je ne saurais que trop le conseiller à ceux qui veulent toujours en savoir plus. Qui ne se contentent pas de la beauté d'un phénomène, qui aiment à en saisir la signification. Cette fausse encyclopédie qui ne repose sur aucun projet de savoir hégémonique et dictatorial leur donnera les clefs qui ne permettront d'accéder ni la connaissance infuse ni à la vérité révélée. Juste l'indication d'un passage que l'on se doit d'emprunter. A vous de vous débrouiller pour la suite.
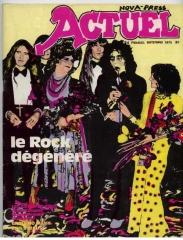
En haut à gauche de la couverture l'est écrit « Gilles Verlant présente ». Le livre lui est d'ailleurs dédié. Gilles Verlant est mort prématurément en 2013. L'a été l'initiateur de la série radiophonique L'Odyssée du Rock, de très courtes émissions qui présentaient un titre rock agrémenté d'un commentaire purement anecdotique. Le rock vu avec les grosses lunettes sex, drugs and rock. Il se peut que certains d'entre vous soient tombés chez des soldeurs sur des caisses pleines d'un de ses derniers livres Les Miscellanées du rock ( chez Fetjaine ), le genre d'ouvrage tape-à-l'oeil ( et au porte-feuille ) auprès duquel un article de Match acquiert la densité d'un traité d'Emmanuel Kant. Ne vous laissez donc pas rebuter par cette mention verlantaise sur la couve de Culture Rock. Sont de conception antithétique. Les Miscellanées sont des eaux stagnantes. Des marécages qui vous engluent dans une représentation que je qualifierai de rock pipi caca. Alors que ce Culture Rock vous ouvre les mille chemins de la rock-culture.
Damie Chad.
15:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david bowie, rené miller trio, vince taylor, billie holiday, culture rock
13/01/2016
KR'TNT ! ¤ 264 : PRETTY THINGS / JIM AND THE BEAMS / CACTUS CANDIES / JANIS JOPLIN / ROCK'N'ROLL
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 264
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
14 / 01 / 2016
PRETTY THINGS
JIM AND THE BEAMS
THE CACTUS CANDIES
JANIS JOPLIN / ROCK'N'ROLL
LE PETIT BAIN / PARIS ( 13 ) / 19 – 12 – 2015
PRETTY THINGS
OH YOU PRETTY THINGS
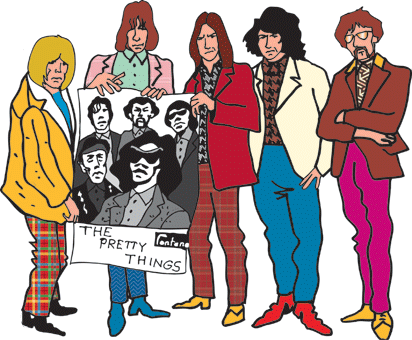
Tout le monde sait que David Bowie se faufilait jusqu’au premier rang pour voir de près les Pretty Things. Tout le monde sait aussi qu’il leur a dédié «Oh You Pretty Thing» (sur «Hunky Dory») et qu’il a repris «Rosalyn» et «Don’t Bring Me Down» (sur «Pin Ups»). Comme le rappelle John Lydon dans «Anger Is An Energy», les Pretties étaient bien meilleurs que les Stones. D’ailleurs, David Gilmour en rajoute une couche : the Pretties made the Stones look tame. On se souvient tous que «Parachute» fut classé meilleur album de l’année par Rolling Stone. Vous savez aussi que les Pretties furent bannis à vie de Nouvelle Zélande. Et malgré tous ces titres de gloire, Phil May et Dick Taylor errent toujours dans les ténèbres de l’underground. Ce qui nous arrange, car on n’aimerait pas être obligés d’aller les voir jouer au Stade de France.

Vous verrez les Pretties dans des petites salles, ici et là, parfois dans des bleds improbables comme Cléon, à côté de Rouen. Il y a de cela deux semaines, ils jouaient au Petit Bain, une péniche accostée au pied de la Grande Bibliothèque. Eh oui, les Pretties mangeaient à la cantine du Petit Bain, dans la plus conviviale des ambiances. On était au bar. Phil, Dick et toute la bande mangeaient juste à côté, à deux mètres.
Un mec d’un certain âge se trouvait assis à côté de nous au bar. Comme il nous avait vu serrer la pince de Dick puis de Phil, il nous demanda :
— C’est les Pretty Things ?
— Non, c’est les Animals !
Ça a failli mal tourner. Les gens n’ont plus d’humour.

Phil May sourit toujours, malgré une récente alerte. Dick Taylor trimballe toujours sa dégaine de prof de philo à la retraite, mais attention, quand il est sur scène, il joue comme un démon. Il a un son et semble jouer avec plus de hargne aujourd’hui qu’à l’âge d’or des Pretties. Pendant le concert, on entendait des gens s’interroger sur son âge, avec une légère pointe d’ironie dans le ton. Évidemment, si on a soixante-dix ans et qu’on monte sur scène pour jouer du garage, on s’expose. Ça fait jaser dans les villages. Mais cinquante après, Dick Taylor joue toujours «Rosalyn» et «Don’t Bring Me Down» avec la même ferveur, et il nous refout exactement la même chair de poule qu’en 1965. C’est vrai qu’on adorait aussi «The Last Time», «My Generation», «Sha La La Lee», «I Can’t Control Myself» et «You Really Got Me», mais «Midnight To Six Man» avait ce petit quelque chose de plus qui générait une sorte de sentiment d’appartenance. On se sentait profondément concerné par le wild beat des Pretty Things. Il y avait là quelque chose qui relevait directement de l’identitaire. Avec Little Richard et Jerry Lee, les Pretties traçaient une sorte de triangle définitif, les frontières d’un monde bien défini qui allait accueillir d’autres héros, du genre Stooges & Sonics, Charlie Feathers & Bo Diddley, et tous ceux qui nous ont aidé à vivre et même à survivre.
Et chaque fois qu’on a revu les Pretties sur scène, il s’est produit le même miracle : l’émergence d’un très fort sentiment d’appartenance. Voilà, c’est le monde qui nous correspond. C’est l’eau du poisson et l’oxygène du cerveau. Quand Phil May est sur scène, il cesse immédiatement de vieillir. Il redevient le soul shaker de haut rang et claque son tambourin, comme si rien n’avait changé depuis 1965.

Les Pretties proposent aujourd’hui un set assez complet. Ils jouent «The Same Sun» tiré du dernier album et quelques bricoles tirées de «SF Sorrow», dont un «Old Man Going» fondu dans «£SD». Ils font deux ou trois blues acou, mais quand ils tapent dans les vieux coucous, je vous garantis que ça monte directement au cerveau. Au premier rang se trouvait le mec qu’on avait vu pleurer d’émotion au concert de Martha Reeves. Un peu plus loin, encastré dans l’angle de la scène, un autre fan des Pretties sembla transfiguré par le bonheur lorsque Phil attaqua «Don’t Bring Me Down». Et quand il a lança Midnight, le souvenir d’un Jean-Yves devenu soudain psychotique vint se glisser dans la pétaudière. C’est vrai qu’on n’avait pas besoin d’être pleins comme des vaches pour jerker comme des cons sur Midnight. Ça faisait partie de l’ordre des choses. Une sorte de réflexe africain.

Bon, on ne va pas repasser tous les albums des Pretties en revue, car on les connaît comme le loup blanc. Par contre, il paraît nécessaire d’évoquer la parution récente d’un «Live At The BBC» plus complet que celui paru précédemment. On a cette fois quatre disques qui couvrent la carrière des Pretties depuis l’époque Fontana jusqu’à l’époque Swansong. Cette rétrospective est cruciale pour deux raisons. Un, c’est l’occasion d’entendre le vrai son des Pretties, car les groupes qui enregistraient à la BBC jouaient leur va-tout et n’avaient pas le droit à l’erreur. On l’a constaté dans le cas des Only Ones, de Bowie, d’Hendrix, des Vibrators et même des UK Subs : leur son est bien meilleur dans les BBC Sessions que sur les albums studio. Et deux, les fans des Pretties boudaient un peu les albums de la période Swansong, à cause du côté boogie trop présent, mais les versions enregistrées pour la BBC vont tous nous réconcilier avec ces trois albums («Freeway Madness», «Silk Torpedo» et «Savage Eye»).
Le disc 1, c’est l’ère classique. Ils tapent dans le swing des caves avec «Big Boss Man». Ils sonnent comme des dieux. S’ensuit «Don’t Bring Me Down» qui est la Mecque du garage. Basse/batterie, montées de fièvre, tout est parfait. Phil fracasse «Roadrunner» avec un talent fou et Vivian Prince fait son petit festival. Tout le monde sait qu’il fut le modèle de Keith Moon. Il fut surtout la source de folie du groupe. Apanage du garage fatal avec «Buzz The Jerk» - You buzz around - Phil chante ça sous le boisseau. Il y a deux versions de «Midnight To Six Man» sur ce disk 1. N’écoutez surtout pas la première qui est un peu ramollo. Avec la deuxième, ils sortent le vrai son. Ils jettent toute la viande dans la balance, c’est gorgé de violence et de passages d’accords définitifs. Phil est la voix du garage - Sure not comes around - Quel blast ! Le «Turn My Head» qui suit vous donnera le vertige. Trop d’énergie. C’est battu comme plâtre. En cet instant précis, les Pretties dominent le monde. On passe à l’époque suivante et on retrouve l’Angleterre magique avec «Defecting Grey» et les scintillements psyché. On ne se doute pas à quel point «SF Sorrow Is Born» peut être explosif ! Quelle évolution dans la révolution ! Rien que pour cette version, il faut rapatrier le coffret. Pour «She Says Good Morning» aussi, car la version est toute aussi dévastatrice. La puissance des Pretties n’en finira plus de vous subjuguer. Et «Balloon Burning» est voyagé de l’intérieur par un solo cavaleur de Dick Taylor. Puis ils passent aux choses sérieuses avec «She’s A Lover» (tiré de «Parachute») et enchaînent avec le heavy shuffle de «Sickle Clowns». C’est l’enfer selon les Pretties - hey hey - voilà le groove de cave visité par un solo beau comme un ange déchu. On reste dans la magie proto-punk avec «Cries FromThe Midnight Circus», le pur jus du pur jus - Can you hear me ! - C’est prodigieusement démentoïde et lié par du gros solo gras - Can you hear me/ I’m telling you games - Le problème, c’est que tout est bon sur ce disk. On ne s’en sort pas.
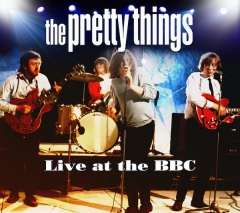
Les disk 2 vous mettra aussi au tapis. Ils attaquent avec un pur hit de génie mélodique, «Peter/Rip Off Train». Il faut voir comme ils explosent le rip off ! Ils restent dans la veine de «Parachute» qui est quand même l’un des fleurons du rock anglais. Ce cut est bardé de chœurs qui claquent au vent. Avec «Love Is Good», on a encore de la pop anglaise incroyablement mélodique. C’est digne des Beatles de l’âge d’or. On a là un départ en refrain qui vaut celui de «Hey Jude». Ils ont exactement la même ampleur que les Beatles. C’est à la fois grandiose et magistral, tout est démesuré là-dedans, les lignes de basse, le solo d’effarance et les relances perpétuelles de bouillonnement évanescent. «Summertime» sonne aussi comme un coup d’éclat, avec ses harmonies vocales claquées au zénith du rock anglais. C’est une fantastique giclée de bluebirds in the sky et de bluebirds in your eyes avec un Pete Tolson qui torche du solo flamboyant. On a là la meilleure pop d’Angleterre. Le «Stone Hearted Mama» qu’on n’aimait pas à l’époque reprend ici des couleurs. C’est dense et sacrément inspiré. Les Pretties jouent avec un sens du beat éhonté. Eh oui, ils swinguent depuis l’origine des temps. Ils reviennent au garage pur avec «Cold Stone» - We’re going down slow ! No rest for me ! - ça sent la punkaillerie de Covent Garden ! Et c’est torpillé par un solo vénéneux. Attention à la version d’«Onion Soup» qui se trouve à la suite... C’est incroyablement dévoyé - I got onions in my soup/ I got zebras in my zoo - On a tout ici, le solo féroce et la basse de jazz, les Pretties rockent à la vie à la mort, ils sortent une version monstrueuse qui explose de jus. Ils retapent même un petit coup de «Rosalyn» histoire d’asseoir leur suprématie, et plus loin, ils explosent «Route 66». Avec une nouvelle version de «Peter/Rip Off Train», ils se montrent carrément dignes de Brian Wilson. Pur génie bardé de guitares.
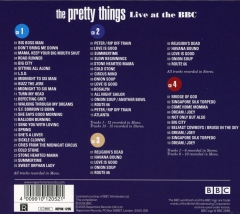
Sur le disk 3, ils tapent dans des cuts de «Freeway Madness» comme «Religion’s Dead». C’est Jon Povey qu’on entend au piano. Phil swinge bien le chant et puis ils s’adonnent à l’un de leurs jeux favoris : l’emballement. Ils visent le final exemplaire. On s’aperçoit avec les morceaux de cette époque que le Pretties explorent des territoires infinis. Ils intensifient jusqu’à la nausée, mais ils tiennent toujours admirablement la distance. On entend sur ce disk 3 une nouvelle version d’«Onion Soup» dans laquelle ils télescopent les ambiances garage et psyché. Ils filent sous le vent et vont chercher les échappées psychédéliques. Ils font aussi une version dévastatrice de «Route 66». Un bon conseil, planquez-vous ! Car ils démolissent tout sur leur passage. Quelle énergie ! Phil fend le vent. Jamais Jagger n’a fendu le vent comme ça. Le piano prend feu. Les Pretties prouvent une fois de plus qu’ils sont de véritables démons. Écoutez aussi cette nouvelle version de «Religion’s Dead», car Phil y écrase les syllabes de Religion pour en faire jaillir le jus. C’est un fantastique exécuteur de basses œuvres. On a aussi une nouvelle version d’«Onion Soup», mais cette fois, elle est complètement explosée aux guitares. C’est même la version la plus guitaristique de l’histoire des Pretties. Quand on aime ce groupe, on écoute ça avec une certaine forme de religiosité. Même dans les longs cuts à rallonges, ils maintiennent un niveau de sauvagerie qui n’a jamais existé chez les Stones. Comparez cette version d’«Onion Soup» avec «Midnight Rambler» et vous en tirerez vous-mêmes les conclusions qui s’imposent.
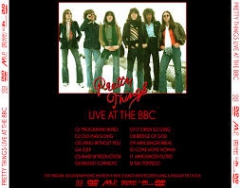
Sur le disk 4, on va se régaler de «Come Home Mama» et de la pure violence du boogie des Pretties. Pas de meilleur groupe anglais sur cette terre. Ils explosent tout à la foison des bouquets d’argent. C’est drivé au beat cavaleur. On a du Phil en pagaille et des filles qui chantent, des tambourins, de l’entrain, des cheveux qui volent, du génie et de l’huile de coude. Quel joli fatras ! Et avec «Dream/Joey», on retrouve ces explosions d’harmonies vocales dignes de celles des Beatles, soutenues par le piano de Jon Povey. Tout dans ce cut est très chanté et très évolué. C’est même totalement extravagant. Phil pousse son bouchon d’unisson très loin et fait tout basculer dans une ambition démesurée. On tombe plus loin sur un autre joli balladif à la Pretties, «Belfast Cowboys/Bruise In the Sky». On le suit à la trace, évidemment, et Phil relance tout à l’unisson. On sent chez lui une réelle fascination pour les Beatles. Les versions de cette époque sont beaucoup plus longues, mais terriblement riches, très fouillées, pleines de chant et d’instruments. Il reste à se taper l’incroyable version de «Singapore Silk Torpedo» tiré de l’album du même nom. C’est Jon Povey qui l’amène avec un thème de piano et ça tourne à la fixette sous acide. En tous les cas, c’est ainsi qu’on vivait ce truc à l’époque et soudain, ils lancent une grosse attaque digne des Who, oui, Phil chante comme Daltrey. On admire les vainqueurs du rock anglais, ça explose une fois encore, c’est battu à la cloche désordonnée par Skip Allan et on voit passer un solo de brute. C’est le festival des cannibales et vient l’extrême apothéose. Phil danse là-dedans, un pied dans le garage et l’autre dans le génie.
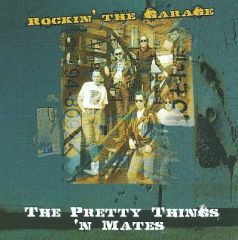
On connaît bien les albums officiels des Pretties, mais quand on va fureter dans les chemins de traverse, on fait de sacrées découvertes. En 2008, nos amis les Pretties enregistrèrent un album de reprises intitulé «Rocking The Garage». Parmi les invités, on comptait des Inmates et monsieur Eddie Phillips, la légende à deux pattes des Creation. Phil et Dick n’y vont pas par quatre chemins : ils tapent dans tous les plus gros classiques du genre, à commencer par «He’s Waiting» des Sonics. L’enfer ! Puis c’est au tour de «Strychnine» de passer à la casserole - Strychnine is good - C’est sûr. Ah vous aimez les Seeds ? Voilà une sacrée version de «Pushing Too Hard». Phil la pushe bien - On me ! - C’est la meilleure niaque d’Angleterre. Un petit coup de «Kicks» (Paul Revere) avant de sauter sur «Candy», version fulgurante jouée aux guitares kill kill kill - I want candy - Ils font du Bo. C’est tout ce qu’ils savent faire dans la vie. Comme leurs amis Keith Grant et Don Craine des Downliners - aussi présent sur cet album - leur raison d’être, c’est le Diddley beat et les loud guitars, le snarl d’effarance et le blasting toxico à gogo. Si vous aimez tout ça, alors ce disk vous comblera. C’est Matthew Fisher qui fait le tu tu tu tu légendaire de «96 Tears». Phil se fond dans le groove du vieux Rudi. Quelle classe ! On peut dire que tous ces mecs, Phil, Dick, Rudi, Sky, Eddie et Gerry auront créé un monde. Et quel mondo bizarro, amigos ! Phil fait son cry cry cry qui nous renvoie au temps béni des surboums endiablées, quand on jerkait comme des branleurs dans nos petits futs à carreaux et dans nos boots à élastiques. Les Pretties font même une accélération de fin de cut qui pourrait bien incarner le désordre mental, tel qu’on l’entend dans les théories scientifiques. Voilà encore une belle pièce de snarl : «Let’s Talk About Girls». Phil est dessus, comme l’aigle sur le putois. C’est lui le shark des Dents de la Mer. Il bouffe les Chocolate tout crus. Et paf, on s’y attendait, voilà les Standells avec Good Guys. Le dandysme des voyous. Phil ? Oh ça lui va comme un gant de cuir noir. Mais tout cela n’est rien à côté de la version d’«I’m A Man» qui suit. C’est la perle noire de cet album intenable. Eddie Phillips sort de sa retraite et vient faire son vautour du larsen. Il attend pour placer sa note mortelle comme au temps béni de «How Does It Feel To Feel». On l’entend, il est là, il monte en puissance, oh Eddie, héros fantasque ! Et il prend un solo de psyché a-po-ca-lyp-tique. Il nous plonge au cœur de la mythologie du rock anglais, dans la racine du hêtre. Eddie Phillips déclenche toutes les alertes. C’est d’une puissance pénultième qui dépasse notre pauvre langue française.
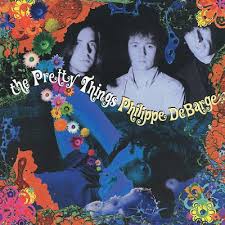
Une autre merveille est passée à la trappe et c’est Mike Stax, l’éditeur d’Ugly Things, qui s’est dévoué pour sortir sur son label le fantastique album que les Pretties ont enregistré avec leur ami français Philippe Debarge en 1969, entre «SF Sorrow» et «Parachute». Phil et son ami Wally Waller n’en finissaient plus de composer des petits chefs-d’œuvre de pop psychédélique et il suffit d’écouter «You’re Running You & Me» sur cet album pour en avoir une petite idée. C’est du psyché à l’état pur, le cru de base, l’essence de la pureté du son d’Angleterre. Victor Unitt joue dans sa cage. Il est agacé. Il se cogne aux barreaux. Il joue n’importe quoi dans la violence de son animalité. Phil fait des backings déments. On assiste là à l’éclosion du psyché du diable. Autre énormité : «Eagle’s Son». Phil fond sa voix dans cette panacée d’avancée glauquissime. C’est l’intrusion du psyché gluant dans la vulve anglaise, c’est fondu aux voix extrêmes, terrifiant d’allure et d’allant, pulsé dans l’exégèse de la genèse et Vic vient jouer là-dedans comme un chien galeux dans un jeu de vieilles quilles vermoulues. Que voulez-vous de plus ? Avec «Graves Of Gray», on est dans le pur Parachute des échos de voix mordorées. Le cut d’ouverture est lui aussi somptueux, tambouriné à outrance et visité par un serpent de fuzz signé Victor Unitt, le guitariste récupéré dans le Edgar Broughton Band et qu’on va entendre faire des siennes sur «Parachute». Justement, dans «Alexander», ils amènent les fabuleuses harmonies vocales de «Parachute». Vic sort un son métal d’ersatz d’étain que lustrent les backing de Phil. «I’ll Never Be Me» se noie dans l’énormité du son. Aucune chance de survie et les Pretties réservent le même sort à «Monsieur Rock (Ballad Of Phillip)». Offrez-vous la version vinyle, car la pochette est à l’image du disque : somptueuse.
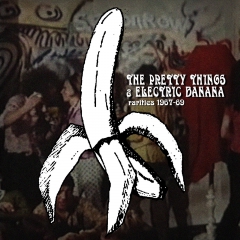
Autre merveille passée à la trappe : «The Electric Banana Sessions (1967-1969)», qui date de la même époque que l’album enregistré avec Philippe Debarge. D’ailleurs on retrouve «Alexander» et «Eagle’s Son» sur cette compile. On a deux versions de chaque titre : la version chantée et la version instro. Inutile de vous dire que les versions instro valent le détour. C’est à ça qu’on voit les groupes qui savent jouer. Chez les Pretties, tout n’est que luxe, punch et volupté. Wally Waller broute «Alexander» à la basse. C’est Twink qui beurre la foison. Dans «I’ll Never Be Me», on subit le violent assaut d’une intro de basse, puis la SF sorrowtisation des choses. Les Pretties sonnent comme des heavy Beatles, ça édifie les édifices. Qui d’autre qu’eux aurait pu inventer un tel concept ? On voit rarement un tel scintillement de cymbales. Dans «Eagle’s Son», on assiste à l’explosion des chœurs. Il y a de l’épinard dans leur psyché. Phil et ce démon de Wally chantent sous le vent. Ils sont terrifiants de longilignité et d’allure solaire, au sens de l’ancienne Égypte psychédélique des disque d’or du temple d’Amon. Et comme si cela ne suffisait pas, Dick Taylor joue le pire solo de pourriture psyché qu’on ait vu ici bas. Encore un classique immémorial avec «Blow Your Mind». Wally devient nerveux à la basse et Dick virevolte comme un poulet décapité, il joue dans les coins, se cogne dans la distorse, ils sont vraiment tarés de jouer comme ça au télescopage dans ce délire foutraque de psyché britannique. Bizarrement, la version instro est encore plus alarmante. Et ça continue avec «Rave Up». Phil et Dick savent torcher le cul de la démence. Il n’existe rien d’aussi sauvage, à part peut-être «Come See Me». Ils attaquent «I See You» au prog anglais des Moody Blues et ça atteint rapidement des proportions spectrales extravagantes. On ne saurait espérer plus beau psyché d’excavation d’albâtre et d’ambre à la carbonara. Avec «Street Girl» ils renouent avec la sauvagerie, ça pète à la pétouille, c’est gratté à la gratouille, pulsé à la pulsouille d’arsouille, brisé à la brisouille, c’est incroyablement excitant, c’est chanté à la menace et traité au psyché de rêve. Dick suit Phil partout. Ils sortent une sorte de psyché de caprice des dieux - Hey sweet girl - Phil relance toujours ses troupes à l’assaut d’une gloire qui se refuse à eux comme le ferait une pute mal formée au métier. On se régale du jeu de Dick dans «A Thousand Ages From The Sun», il ne laisse aucun blanc derrière Phil. ll joue en continu avec une sorte de candeur antique. On tombe ensuite sur le fameux «Walking Down The Street» repris par les A-Bones. C’est jerké jusqu’à l’os. Et ils finissent avec «Danger Signs», du British beat de la pire espèce, le pur jus des Pretties des origines, digne de Motown et de toutes les caves de boum, comme si Motown se fondait dans la cave. Insurpassable.
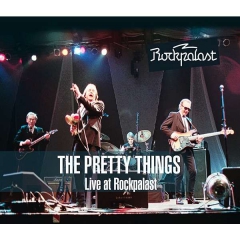
Cette année, les fans des Pretties sont comblés car vient aussi de paraître un double DVD «Live At Rockpalast». On y trouve trois concerts filmés en Allemagne en 1998, 2004 et 2007. Au fil des trois sets, on voit le line-up changer : en 1998, c’est encore le line-up de «Parachute» : Phil, Dick, Wally, Skipper et Jon Povey. Le line-up de 2007 a évolué : Phil, Dick, Wally, Frank Holland et le petit batteur Jack Greenwood. Depuis, Wally a quitté le groupe et le jeune George Woosey l’a remplacé. Les trois concerts sont solides. C’est du full blown-Pretties, tel qu’on a pu l’apprécier en France ces dix dernières années. Les attaques de Dick sur «Roadrunner» et «Route 66» restent des modèles incomparables. En 2007, ils font encore «Baron Saturday» sur scène et Dick le chante toujours merveilleusement bien. Mais ils ne retrouvent pas la magie du Baron original enregistré à Abbey Road : Twink était assis incroyablement bas derrière son kit, les épaules jetées vers l’arrière, il jouait avec une sorte de nonchalance sidérante pendant que Phil et Jon Povey jouaient les percus (Twink remplaçait Skipper qui était resté en France avec une poule). Ils font aussi une fantastique version de «Midnight Circus». Dommage qu’ils ne jouent plus ces vieux classiques aujourd’hui. Ils finissent le set de 2007 avec «Rosalyn» - Yeah Rosalyn/ Tell me where you been ! Ça dure quasiment quatre heures. On ne s’ennuie pas une seule seconde.
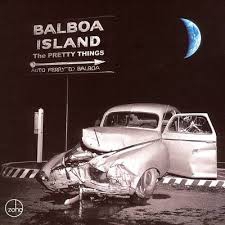
En plus de tout cela, les Pretties continuent d’enregistrer de nouveaux albums. Petit coup d’œil sur «Balboa Island» paru en 2006. C’est là qu’ils tapent dans le blues d’acou et qu’ils commencent à rendre hommage à Robert Johnson. Ils ont une fantastique approche, Dick Taylor sait jouer au bottleneck. Leur «(Blues For) Robert Johnson» vaut le détour, de même que «Living In My Skin», pure bluesy motion contemporaine. Ils passent au heavy boogie avec «In The Beginning» et délivrent un final explosif contre-balancé aux chœurs d’artichauts. On retrouve la terre ferme avec «Mimi» qui est du pur jus de Bo. Dick ne s’embarrasse pas, le Diddley beat passe partout. Cet album est donc une sorte de fourre-tout, car on y trouve aussi une reprise de Dylan et un gospel. On a clairement l’impression qu’ils s’amusent comme des gosses. Mais on retrouve la magie des Pretties vers la fin avec «Dearly Beloved», une beautiful song à l’Anglaise, imprévisible et magistrale qui sonne comme un hit dès l’intro.
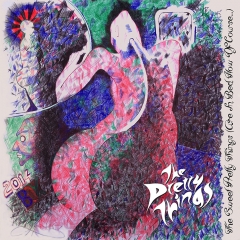
À l’intérieur de la pochette de leur dernier album, «The Sweet Pretty Things (Are In Bed Now Of Course)», on voit leurs vieux amplis Selmer rescapés des sixties. Et ils démarrent avec «The Same Sun», une énormité psyché bardée d’écho et digne de «Parachute». Ils donnent le ton. Avec «And I Do», on a une fantastique bouillasse de chœurs. Les Pretties ont appris à créer les conditions de la grandeur épique. C’est trop riche, beaucoup trop riche. Comment faire pour apprécier un son si plein ? Ils nous désemparent. Ils reprennent «Renaissance Fair», tiré du grand «Younger Than Yesterday» des Byrds et le «You Took Me By Surprise» de Sky Saxon. C’est du très grand art. On sent la poigne des vétérans de toutes les guerres. En prime, on a un solo de wha-wha vertigineux. Ils restent dans la pop de rang royal avec «Turn My Head». On réalise une fois de plus qu’ils naviguent au même niveau que les Beatles, mais en plus, ils s’arrangent toujours pour bricoler des fins grandioses.

Comme dessert, nous avons un coffret. Et quel coffret ! «Bouquets From A Cloudy Sky» est tout simplement le coffret de l’île déserte. Bien sûr, comme dans tous les coffrets, on trouve des conneries, des espèces de posters et des repros de documents à caractère anecdotique, mais dans celui-ci, vous aurez un gros livre signé Mike Stax, qui est certainement le meilleur spécialiste des Pretties (il suffit de se plonger dans la collection d’Ugly Things dont les premiers numéros proposaient des interviews de John Stax, Phil May, Wally Waller, etc.). On a là cent pages bourrées à craquer de photos des Pretties dont bien sûr des inédites. Et Stax conclut son histoire ainsi : «They’re still the art school outsiders, immune to fashion, immune to commerce, immune to compromise, filling out our grey streets with bouquets from a cloudy sky.» Et incrustés dans l’épaisseur de la deuxième et de la troisième de couve du livre, on trouve quatre disques : deux audio et deux DVD. Alors, attention, car là on ne rigole plus. Les deux disques audio proposent des rareties, comme par exemple une version ultra sauvage de «Mama Keep Your Big Mouth Shut», des cuts tirés de l’album sur-produit «Emotions», mais sans les effets qui ont coulé l’album. En écoutant «Bright Lights Of The City», on voit SF Sorrow se préfigurer. Wally composait déjà avec Phil. S’ensuit une version r’n’b de «Out In The Night» que Phil termine en apothéose en yeah-yeahtant. On entend aussi un truc incroyable : une cover du «Why» des Byrds enregistrée à Hyde Park par Nick Saloman, alias The Bevis Frond. Les Pretties semblent faire les Byrds mieux que les Byrds ! Voilà du pur chaos psychédélique. Et c’est peut-être là où on peut tracer un parallèle entre les Pretties et Moby Grape : même destin de groupe surdoué et poissard, même sens des harmonies vocales et même classe. Avec «She Says Good Morning», on sent bien que les Pretties sont au sommet de leur art. Quel son ! Et on retrouve le fameux «Alexander» qui est en fait une véritable machine de guerre. On a vraiment l’impression qu’ils démontent la gueule du rock. On ne se lasse pas de ce tourbillon d’harmonies vocales. On rencontre rarement un tel mélange de puissance rythmique et d’effervescence harmonique. On trouve aussi sur ce premier disque une version live de «SF Sorrow Is Born» enregistrée en Hollande. Des gens réclament «Don’t Bring Me Down» et Phil répond : «We got a cut from our new LP, SF Sorrow is Born !» Cette version est battue à la vie à la mort et jouée à la meilleure psychedelia du monde. Dick veille au grain et Wally voyage dans le son. Terrifiant ! On trouve aussi sur ce disque des cuts de l’album enregistré avec Philippe Debarge et, miracle, les démos de «Parachute». Rien que pour ça, on peut investir. Wally et Phil vivent à l’époque à Westbourne Terrace et ils enregistrent leurs démos sur un Revox. On entend donc tous les hits de «Parachute» joués et chantés à deux, au mieux des harmonies vocales et des coups d’acou. Wally gratte ses notes magiques. Tous ceux qui ont vénéré «Parachute» doivent vraiment écouter ça. C’est la genèse de l’album. Wally gratte à la finesse de l’extrême glissé. Il faut bien parler de génie, ici. Ils jouent aussi «Cries From The Midnight Circus» dans leur piaule. C’est invraisemblable de rootsisme. On est aux racines du mythe. Ils font ça à deux avec du tchi-ki-tchik et ça marche. La menace rôde.
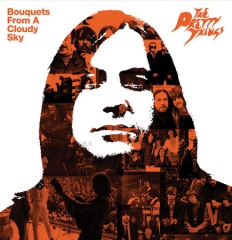
D’autre merveilles guettent l’amateur sur le disque 2. À commencer par d’autres démos post-Parachute inédites. «Seen Her Face Before» est une pop incroyablement mélodique et ambitieuse. Pour «Everything You Do Is Fine», Pete Tolson vient jouer du gras à Westbourne Terrace en 1971. On sent une certaine grandeur d’âme chez les Pretties. Ça sonne comme le hit inconnu de l’Arc de Triomphe. Ils jouent «Cold Stone» à la cloche de cendrier. Fabuleuse démo. Pete Tolson est un excellent guitariste, plein d’à-propos. On tombe plus loin sur «Wild And Free». Wally a quitté le groupe, mais il nous reste le jeu de Peter, gorgé de jus. En démo, il joue et il surjoue, c’est un diable. Il fait du gras de jus multiplexe, il joue dans tous les coins, il noie le cut dans le son, mais Phil s’arrange toujours pour rester à la surface. Encore un bel inédit avec «Spider Woman», et on retrouve avec un plaisir non feint «Joey» tiré de «Silk Torpedo». On arrive un peu plus loin à l’époque du retour avec «Rage Before Beauty». Il faut se souvenir que les sessions de l’album ont duré 18 ans. «Holding On To You» est un outtake de l’album. Avec «Chain Of Fools», ils font Aretha. Phil s’en sort avec les honneurs. On finit avec la perle du disque 2 : la reprise d’«Helter Skelter», cut intouchable par excellence. Eh bien si, Phil y touche. Il en fait une version monolithique. Attention, c’est bardé de guitares psyché. Phil le prend sous le menton avec des yeah yeah yeah, il ne hurle pas, il le fait à la Phil - Tell me tell me the answer - C’est un cut qui peut hanter les esprits.
Et la fête continue avec les deux DVD. Le premier est un docu admirable, bardé d’interviews - Dick : I met Keith at 16. Then we met Brian Jones. Brian had already a band - Il parle bien sûr de Keith Richards, avant les Stones. On voit aussi John Stax toujours en vie à Melbourne. Portrait bouleversant de Brian Pendleton qui fut recruté via une annonce dans le Melody Maker - Brian was more of a jazz guitarist - et on saute en l’air en voyant les Pretties jouer «Big Bos Man», le jeu swingy de Viv, le jeu snaky de Phil, le jeu syncopé des jambes de John, le jeu appliqué de Brian et le jeu ultra-gibsonique de Dick. Phil rappelle que Viv fut le premier à quitter son kit sur scène pour ramper avec ses baguettes. Il tapait partout, même sur le dos de Phil qui rampait lui aussi -He drummed my back ! He did the lot - Oui, Viv Prince fut le premier batteur fou des Pretties. Dick ajoute que Keith Moon était au premier rang - Phil : Viv had this Pretty Things spirit - Et on assiste alors à un vrai show des Pretties filmé en Hollande en 1965, au Blokker Festival, avec les émeutes et les flics, plus les Pretties sur scène donnant une belle leçon de sauvagerie, avec John Stax grimpé sur un piano pour jouer de l’harmo, Viv rampant par terre avec ses baguettes et Phil à genoux complètement out of his brains. Puis on voit arriver les hits, «Rosalyn» écrit par Jimmy Duncan, «Don’t Bring Me Down» écrit par Johnny Dee qui se baladait dans Londres au volant d’une big american car, «Honey I Need», mis il n’y a pas de place pour les Pretties au sommet des charts, car c’est l’époque où les Stones et les Beatles les monopolisent. Viv fait le con, il est viré, et Phil hésite entre Skip Alan et Mitch Mitchell. Skipper est aussi bon que Viv, alors il est pris, et en prime, il fait aussi le batteur fou - He turned absolute lunatic - Voilà «Midnight To Six Man» et surtout «Come See Me», qui restera l’étalon or du garage. On les voit jouer ça dans une rue, on entend les gros coups de fuzz dans Baby I’m your man, et Dick descend aux enfers pour y placer un solo d’antho à Toto. Après «Emotions», Brian disparaît, puis c’est au tour de John Stax qui ne voulait pas jouer de psyché de disparaître. Alors Phil récupère son copain d’enfance Wally et son pote Jon Povey qui jouaient alors dans les Fenmen. Puis c’est la rencontre avec Norman Smith et les sessions à Abbey Road qui vont conduire à «SF Sorrow» - Norman Smith wanted to do with us what George Martin did for the Beatles - Quand ils sont à Abbey Road, Phil explique que d’un côté il y avait le Floyd qui enregistrait Piper et de l’autre les Beatles. Et c’est là où on tombe sur le clip magique : l’enregistrement de «Baron Saturday» à Abbey Road avec l’incroyable jeu dégingandé de Twink, lequel Twink ne restera pas longtemps dans les Pretties, puisqu’il repartira pour de nouvelles aventures avec les Pink Fairies, laissant la place libre pour Skipper, rentré en Angleterre après son escapade érotique avec une Française.
Sur le second DVD, on a le fameux SF Sorrow live at Abbey Road, avec Arthur Brown qui fait le narrateur, Skipper on drums, Frank Holland, Dick et Wally on bass. Et comme dans la version originale, c’est Dick qui chante «Baron Saturday», histoire de nous repropulser, une fois de plus en 1968.
Signé : Cazengler, pretty nothing
Pretty Things. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 19 décembre 2015
Pretty Things. Balboa Island. Zoho 2006
Pretty Things/Philippe DeBarge. Ugly Things Records 2009
Pretty Things & Friends. Rockin’ The Garage. Floating World 2008
Pretty Things. The Electric Babanana Sessions (1967-1969) Enigmatic Records 2011
Pretty Things. Live At Rockpalast. DVD Repertoire Records 2014
Pretty Things. The Sweet Pretty Things (Go In Bed Now Of Course). Repertoire Records 2015
Pretty Things. Live At The BBC. Repertoire Records 2015
Pretty Things. Bouquets From A Cloudy Sky. Madfish 2015
Sur l'illusse, de gauche à droite : Viv Prince, Brian Pendelton, Phil May, John Stax et Dick Taylor.
Le 3B / TROYES / 09 - 01 – 2016
JIM AND THE BEAMS
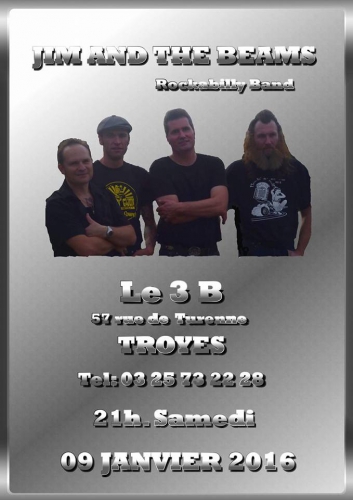
D'habitude la route de Troyes est déserte. De temps en temps l'on croise une automobile juste pour se souvenir que l'on n'est pas le dernier rescapé d'une catastrophe nucléaire sur cette planète. Mais là, ce soir, c'est un défilé ininterrompu de bagnoles qui se suivent à toute blinde et m'éblouissent de leurs phares. A force de rouler dans mes méninges suspicieuses, l'angoissante question du pourquoi de cette mystérieuse affluence routière en provenance de la capitale de l'Aube, je finis par trouver la réponse. Mais oui ! bons dieux paillards de l'Olympe ! comment la vérité ne s'est elle pas révélée un peu plus tôt ? Une évidence. Premier weekend des soldes de janvier. Les fameux magasins d'usine de la cité troyenne. Mon cerveau se met tout seul en pilotage philosophique. Je ne comprendrai jamais mes contemporains : comment peuvent-ils se déplacer en masses compactes pour acheter la mode d'avant-hier et des artefacts confectifs à des tarifs dont l'énormité défie toute concurrence quand on sait leur prix de revient au Bangladesh et autres pays similaires ? Bien sûr il y a les décotes sublimes de trente à cinquante pour cent, voire plus, qui doivent nous rappeler que le reste de l'année, ces mêmes objets nous sont proposés à des sommes prohibitives. Au début du dix-neuvième siècle Pierre-Joseph Proudhon affirmait que la propriété était le vol. Deux cents ans plus tard la situation a évolué, c'est l'appropriation prolétarienne des objets de consommation courante ( ce qui n'a rien à voir avec celle des moyens de production préconisée par notre anarchiste de service ) qui est devenue une entreprise de racket généralisée. Opération main basse sur les portefeuilles des pauvres, consentants. On vous le met jusqu'au trognon, et en plus vous êtes contents, certains d'avoir fait des affaires ! Merci, messieurs les actionnaires. Mais il est temps de déployer la problématique raisonnementale, et point subsidiaire, en son entier : comment peut-on passer son après-midi à Troyes - à gaspiller ses maigres ressources en parures vestimentaires superfétatoires - alors que le soir-même, au 3 B, vous avez un concert de rock and roll gratuit ? L'inconséquence de mes concitoyens m'étonnera toujours.

Comme par hasard ce soir, au 3 B, l'assistance n'est guère pléthorique. La cohorte des habitués mais guère plus. D'autant plus regrettable que l'on a repoussé les murs. Bye-bye les banquettes et les tables carré-mastoc remplacées par des guéridons circulaires. Un espace moins confiné pour les musiciens, et une mini-piste de danse et de déhanchements divers pour les excités. Autre bonne nouvelle nous retrouvons avec plaisir, Jim and the Beams. Comme quoi, doit être écrit sur le grand livre de la bêtise universelle que l'être humain chérit davantage les haricots de sa misère que les poutres de son bonheur.
JIM AND THE BEAMS

Sont là tous les quatre. A tout seigneur tout honneur Jim, droit comme un I majuscule. Une barbe de sapeur. Taillée à la hache. En règle générale les rockers ont toujours un oeil rivé vers le haut, surveillent leur banane, Jim n'a pas ce souci, en possède deux, latérales, une sur chaque joue, ses cheveux longs retombent librement derrière sa tête, une dégaine pas possible. Cyril est à sa gauche à la guitare, électrique comme il se doit. Gretsch rutilante au bout des doigts. Resplendissante. Amarante. Surtout quand on la compare à l'électro acoustique de Jim. Doit aimer les vieilles boiseries, qui ont beaucoup vécu. Une Gretsch. Idem pour José derrière, batterie Gretsch, des gars malins qui ont dû racheter la boîte, ou alors des aficionados. Vince est à gauche, oeil bleu, casquette d'apache en couvre-chef, sa fidèle contrebasse à ses côtés, bois vernis, la classe.

French rockabilly group. Le rockab est une musique à part entière. Embêtante. C'est comme l'omelette ou la crème chantilly. Ou vous la réussissez du premier coup ou vous la ratez, à jamais. Dans le deuxième cas, c'est la déconfiture totale. Sinon, c'est un délice, une merveille, une rareté. Mais c'est comme le paradis, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Quoique entre nous soit dit, ce serait plutôt la porte des enfers. Une véritable fournaise. Si vous ne supportez pas la chaleur, allez écouter les valses de Vienne, parce que ce soir nos quatre lascars ils ont leur idée du rockabilly et ont envie de nous montrer ce qu'ils savent faire.

Un, deux, trois, c'est parti. Jim lance l'attaque. Les cordes du haut résonnent comme le hennissement d'un étalon sauvage qui appelle sa horde dans un défilé des Rocheuses. Et tout de suite c'est le grand galop. Cyril pourrait arriver avec ses gros sabots et prendre la tête. L'est plus subtil. Ne s'impose pas. Il intervient, tout en souplesse, tout en doigté. Fait miroiter des éclats par intermittences. Mais l'on guette ses interventions, du vif-argent, des touches légères mais indispensables. Des éclairs de lumière radieuse – les fameuses taches jaunes des Poésies de Joseph Delorme - qui percent la pénombre. Et puis il y a Vince. La contrebasse s'apparente au piano. L'existe deux sortes de concertistes, ceux qui font vibrer les cordes et ceux qui font sonner le bois. Vous pourriez croire à la manière dont Vince tape ou empoigne la crinière de sa big mama, qu'il est un partisan du vrombissement des élastiques, certes, mais écoutez bien, entendez mieux, c'est beaucoup plus perceptible dans les solos, trop rares, c'est le bois qui chante et claque. Une sonorité de branche cassée, de bûche qui craque et pète quand les flammes de la cheminée l'enserrent, des notes rêches mais prolongées, le genre de sons que Bartok recherchait dans ses quatuors à cordes pour donner sensation de vitesse et d'à-coups successifs, l'onde et les quanta. La lumière de l'oreille.

Reste José. Je le présente en dernier, car il est l'homme heureux par excellence. Hilare, sourire aux lèvres et rire aux gencives. Peut-être un clown triste à l'intérieur. Je ne sais pas mais un drummer de bronze à l'extérieur. L'a beau se marrer ne perd ni le nord, ni le bord de ses cymbales. Ne se contente pas de marquer le rythme, donne de l'amplitude au moindre de ses battements, la pulsation et la chair qui emballe le coeur.
C'est bien de les présenter un par un, mais un combo de rockab se doit d'être un tout organique. Faut un liant, ce sera la voix de Jim. Elle coule ambrée comme un filet de Sky. Balancée, binaire mais jamais monotone. C'est un des secrets du rockab, le rock balance et roule, le roulis et le tangage. S'il en manque un, ou si l'un écrase l'autre et l'empêche d'exister, vous vous sentez mal et vous dégobillez votre quatre heures sur le champ.

Vont nous offrir trois sets. Trois bibelots d'airain rockab comme l'on n'en fait plus. Une large palette mais uniformisée par un goût sûr et souverain, cela oscille comme le prolongement d'une fausse ballade – car trop appuyée – country cowboy, un peu à l'ouest de Johnny Cash, à la nervosité de Crazy Cavan, leurs titres originaux se fondant à merveille dans la cavalcade. D'ailleurs à la fin de chaque entracte, faut voir comme tout le monde se dépêche de rappliquer. Le troisième set se finit en apothéose, Annie aux maracas, Duduche au tambour, et Jean-François au chant en impro, qui s'en tire comme un chef. Jim and the Beams, nous repartons quatre rayons de soleil plantés dans le coeur. Merci les gars.
Damie Chad.
( Photos : FB : Nathalie Gundall )
THE CACTUS CANDIES

Attention, ça pique ! Un nouveau groupe qui monte. Pour le moment stationné dans la région nantaise. Pas des inconnus. Des figures déjà remarquées chez KR'TNT ! Soyons galant, place à la demoiselle. LilOu, elle est jolie, mais ce n'est pas le plus grave, elle possède la voix que vous avez toujours rêvé d'avoir. Nous vous renvoyons à notre chronique de l'album des Pathfinders – sobrement intitulé Pathfinders - ( in Kr'tnt ! 174 )une monstruosité rythm and blues, combien d'aussi réussis en ce genre cuivré ont-ils été enregistrés en France ? Je préfère ne pas répondre. Si vous avez un faible pour le rock rapportez-vous ( in Kr'tnt ! 178 ) à notre chronique du concert fabuleux, toujours des Pathfinders, à Réalmont ( 81 ) le 20 juillet 2014.
Deuxième figure charismatique : Mister Jull, le lead guitar des Ghost Highway, disparus des radars, le maître des studios BLR, et enfin le dénommé Max que je ne connais point et dont je ne vous dirai rien.
Un trio de choc. Commencent à tourner, vous pouvez les retrouver sur leur facebook. Parfois sur scène, peuvent être rejoints par Jean-Pierre ( Boogie-Lou ) Cardot au piano et Gaël à la batterie.

Quel genre de sucreries nous préparent les Cactus Candies ? Du western honky tonk de derrière les fagots, Faren Young and Pasty Cline en ligne de mire pour vous donner une idée. Deux super musicos, je n'oublie pas Lil'lOu qui martyrise sa guitare comme si elle lui brûlait les doigts, mais elle chante avec une telle énergie qu'elle vous emporte au royaume des cowboys sans que vous puissiez vous y opposer. Ni retour en arrière, ni prophétie avant-gardiste, même pas d'aujourd'hui. Intemporel. A suivre. A la trace.
Prometteur.
Damie Chad.
JANIS
LITTLE GIRL BLUE
AMY BERG / 2015
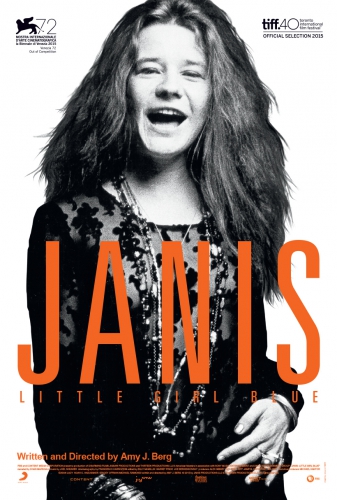
Janis ! Il y a des jours où l'on ne rajeunit pas. Par tous les diables de l'Enfer et toutes les bouteilles de Southern Comfort bues par les assoiffées de la planète, j'ai déjà vu un fiim intitulé Janis. Non pas The Rose avec Bette Midler sorti en 1979 et que je n'ai pas regardé parce que je n'aime pas les ersatz, mais bien avant. En fait un documentaire canadien d'Howard Alk paru en 1974. De lointaines remembrances, étrangement me reviennent les images sûrement les moins intéressantes, la star Janis Joplin de retour dans son collège et visiblement peu heureuse de se retrouver en face de si mauvais souvenirs...
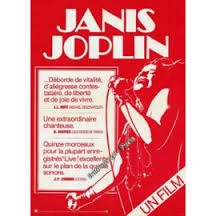
Amy Berg a mis six ans à monter le film. Pas une fiction. Un documentaire. Mais avec des plus qui n'étaient pas disponibles voilà quarante ans pour Howard Alk. A adopté le système de Joe Boyd dans A Film About Jimmy Hendrix de 1973 : les extraits de concert, les interviews de l'artiste, et la parole donnée à tous ceux qui avaient connu Jimmy, famille et musiciens. A l'époque c'était le pied : en plus de l'Injun Fender on avait droit à Little Richard, Pete Townshend, Eric Clapton et Lou Reed, tout cela pour la modique somme d'une place de cinéma à prix étudié pour étudiants désargentés... Mais entre les deux films, il y a une sacrée différence. A l'époque le cadavre d'Hendrix était encore chaud comme de la braise ardente, de nos jours les os de Janis sont refroidis depuis belle lurette... Pour Hendrix et Janis la différence n'est pas bien grande. C'est pour les témoins que la situation tourne au drame. Vous les voyez caracoler sur les images, tout beaux, tout jeunes et plouf, trois seconde plus tard ils répondent aux questions. Sacré coup de vieux. Vous les croisez au coin de la rue, vous faites une prière pour spécifier aux puissances divines que vous ne voulez absolument pas leur ressembler. Horreur des horreurs, les irréparables outrages de l'âge sont passées par là et ce n'est pas joli à contempler. N'y a que David Niehaus – le dernier ( ! ? ) petit ami de Janis qui offre encore une dégaine de jeune homme, minceur macrobiotique et charme irrésistible de dandy. Pas étonnant que lors de leur première rencontre Janis l'ait interpelé en le qualifiant de beau gosse.
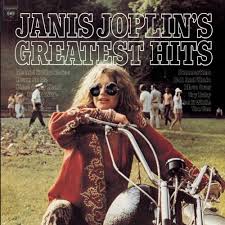
Mais il convient de commencer par le commencement. Le cocon familial. Le foetus agglutineux dont on ne sort que rarement indemne. Amy Berg ne nous ménage pas, la soeur en premier témoignage et un vidéo-clip de la mother pour finir la procession. Laura s'est mise sur son trente-un pour distiller ses sororales analyses. L'anti-Janis par excellence, guindée comme un guidon de vélo, un maintien de bourgeoise consommée, dans son tailleur bleu elle ressemble à sa propre caricature, trimballe sur son visage les stigmates du puritanisme américain. Quant à la mère sans profondeur, toute de noir vêtue, qui lit avec une componction désolée la lettre d'une fan de Janis qui vient d'apprendre la disparition de la chanteuse, l'a un air de croque-mort. L'enterre sa fille une deuxième fois. Car deux précautions valent mieux qu'une, et il ne faudrait pas qu'elle ressorte de sa tombe.
La petite Janis n'a pas de chance, en plus du boulet familial à traîner, l'en a un second, qui la touche de très près, charnel pour tout dire. Elle-même. Peut se regarder dans la glace tant qu'elle veut, le miroir ne lui dira pas qu'elle est la plus belle. Physique ingrat de boulotte mal dans sa peau qui ne s'accepte pas. Une tare congénitale. Notre physique ne serait-il pas la traduction formelle de notre âme ? Va faire en sorte que l'intérieur et l'extérieur correspondent. Prend les mauvaises manières. Exunt la politesse et la sagesse. Jure comme un charretier devient une gamine têtue qui ne renonce jamais à s'opposer au désir de bienséance parentale. Avec l'âge, la situation ne s'améliorera pas, se met à écouter les disques des réprouvés de l'Amérique blanche, Big Mama Thornton, Bessie Smith, Odetta... le blues s'immisce en elle sans qu'elle le sache vraiment. A l'université d'Austin elle se fait remarquer – pas positivement – cette fille du Texas est une adepte affirmée de l'émancipation des noirs... C'est à Austin qu'elle essaie de s'adonner aux vertiges de ce que Rimbaud appelait la vraie vie : alcool, amphétamines, sexe, poésie, musique, revendication féministe... Mais comme tout albatros qui se respecte elle a besoin d'air et d'une vie plus tempétueuse. C'est à San Francisco qu'elle s'enfuit, dans cette grande ville qui ne tardera pas à focaliser les regards de la jeunesse du monde entier, qu'elle se libère et se brûle un peu trop les ailes. Retour chez les parents, ravis de la récupérer, mais elle ne retardera pas à repartir...
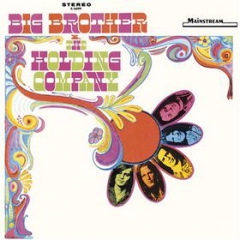
C'est lors de ce second séjour à San Francisco que Janis devient Joplin. La chanteuse folk qu'elle était, la passionnée de country blues trouve enfin le médium qui lui permettra d'exprimer la rage bouillonnante qui lui brûle les entrailles : le rock and roll ! Une musique enfin capable de recevoir et d'accueillir l'amplitude sonore de l'énergie qui l'habite. Et puis de l'expulser hors d'elle afin de la partager avec tous. C'est toute une philosophie de la vie que San Francisco est en train d'expérimenter. Musique, drogues et sexualités sont à envisager comme des vecteurs d'ouverture au monde. Se réaliser soi-même, afin de donner pleinement aux autres. La contre-culture hippie prend son essor.
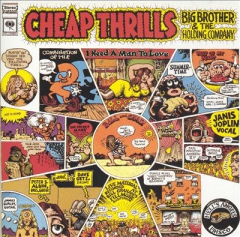
Dans le courant de l'année 1966, Janis devient la chanteuse du groupe Big Brother and the Holding Company. Dès le premier concert il apparaît qu'elle est appelée à en devenir le leader. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur la suite de l'aventure. A l'idéal hippie des garçons s'opposera le désir immodéré de reconnaissance de Janis. Ce n'est pas qu'elle ait les dents longues, aucunement l'idée de faire carrière, mais Janis a besoin d'être rassurée. Une spirale psychologique qui la pousse à s'élever sans cesse vers le haut alors que ce mouvement salvateur et échappatoire qui l'exhausse n'en finit pas de creuser et d'approfondir le gouffre inextinguible qui se creuse en elle. Janis danse sur un volcan. Parfois elle est elle-même le volcan.
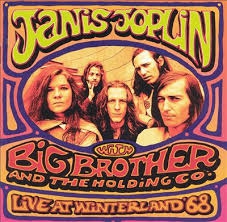
La voir et l'entendre sur scène. Transcende ses accoutrements un peu ridicules aujourd'hui, colliers, perles et cheveux emmêlés, un look négligé soigneusement mis au point et totalement vintage mais quand on compare avec la dégaine d'Amy Winehouse, il n'y a pas photo, l'anglaise a du chien, et l'américaine l'air d'un cocker malheureux privé de ses croquettes. Oui, mais filez-lui un micro et la bête reprend le dessus. Elle vous crache le blues à la gueule, en une seconde elle se métamorphose en une lionne qui cherche le combat. Elle éructe, même chez Bessie il y a toujours un côté geignard et plaintif, ce fonds de commerce du blues des matins blêmes, Janis le désosse, le pulvérise, le blues devient une arme de guerre, tranchante et contondante, une machette à la lame dégoulinant du sang. Se fraye un chemin en force. Rancœurs et frustrations expectorées deviennent des armes de jet qui vous atteignent en plein plexus, sans crier gare. Avec Janis, l'été de l'amour se transforme en celui de la haine qu'elle vous crache à la figure. Sans rémission. Pour la dentelle vous faudra repasser, n'en fait pas ou alors elle la tricote à coups de missiles tomahawks, prends mon blues en plein dans la gueule et sois heureux d'être encore vivant.
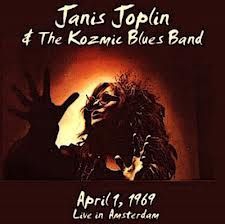
Et illico l'autre rappliqué, le bâtard de son père, le branleur de service, l'ébranleur de sévices, cet enculé de rock and roll, une petite frappe qui vous passe à tabac – vous avez l'impression que l'esprit vous sort des narines comme de la fumée de cigarette, Janis s'en sert pour ponctuer ses coups de reins, et ses coups de freins brutaux, elle en dynamise et dynamite le blues, derrière les musicos sont à son service, ont intérêt à suivre et à ne pas perdre le fil de l'histoire, demi-tour de tête et tout s'arrête la tour de Pise s'effondre, mais tout de suite c'est les bulldozzers qui entrent en action pour repousser les gravats. Janis est le grand opérator, parfois le plateau est envahi de danseurs, faites gaffe à ses coups de pied qu'elle lance pour arrêter la machine. Si vous le recevez dans les roubignoles, pouvez prendre le poste de castrat à la Scala de Milan.
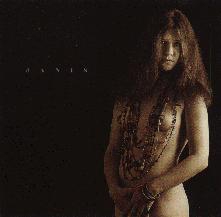
Malgré votre voix de fausset, vous n'aurez pas le prix d'interprétation, sera dévolu à Janis. Elle ne chante pas, elle interprète, elle est la chanson. Endosse tous les rôles, celui de la chatte énamourée qui se retrouve devant la chatière bloquée, et qui étire son miaulement de femelle en manque comme un jour d'ivrogne sans whisky. Elle est la reine qui captive tous les regards. Elle mime avec la voix. Elle dessine avec le gosier. Elle peint à fresque, couleurs violentes et criardes. Pluies torrentielles de joies et torrents de peines, fêtes extatiques et colères explosives.
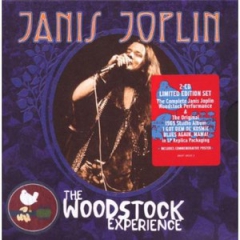
N'a enregistré que trois disques de son vivant, le quatrième sera posthume mais depuis les éditions live n'ont pas manqué. Elle sera présente aux deux rendez-vous mythiques de l'ère hippie, Monterey et Woodstock. Le début et la fin. Les trois coups et la descente du rideau. All the beautifull people à Monterey. Amy Berg en profite pour montrer ce que Janis a volé à Otis Redding. En rock le vol n'est que l'autre nom de l'inspiration. Prédatrice. On ne se refile pas le bébé. On le kidnappe et on le garde. On ne demande pas de rançon. A Monterey Janis est encore une éponge qui apprend. Tout ce qui rentre fait rage de ventre. Ce sera le point ultime de l'initiation. Journée de sacre. Deux années plus tard, c'est une personnalité reconnue qui monte en scène. L'impératrice. Beaucoup plus fragile que l'on ne pourrait l'accroire. Janis a réalisé son rêve. Personna grata incontournable. Faut entrer dans les coulisses du cerveau pour comprendre qu'elle n'en est pas plus heureuse que cela. Elle a monté le gros caillou jusqu'au plus haut sommet de la montagne. Et le rocher est toujours devant elle. Ce n'est pas une question de descente. Ni d'acide, ni de scène, ni de déclin. L'on peut pousser de toutes ses forces, mais en fin de compte l'on se retrouve devant soi. Le problème ce n'est pas la roche tégumentaire que vous repoussez, le problème c'est que vous êtes l'énorme gravier qui vous bloque le passage.
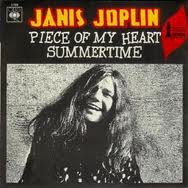
Amy Berg ne suit pas la vulgate communément admise. Selon laquelle l'on devrait se réjouir de l'overdose qui l'emporte assez tôt avant que les stigmates de la déchéance n'apparaissent au grand jour. Détruite par la drogue, rongée par l'alcool, les derniers mois de Janis auraient été une lente dégradation. Certes elle a connu ce passage à vide qui suit les grands moments d'excitation, cette dépression qui vous saisit lorsque vous avez atteint votre but et que vos désirs sont rassasiés. Mais non, Amy Berg s'acharne à démontrer le contraire. Montage serré et plans orientés. L'héroïne a remporté plusieurs victoires, l'a détaché de ses amis, ceux qui tenaient le plus à elle, mais elle aurait fini par dompter le cheval sauvage. La dernière prise aurait été selon les dires de Paul Rothchild le président d'Elektra, sa maison de disques, non pas une rechute, mais un dernier petit plaisir qu'elle se serait octroyée après une bonne et grosse journée de travail au studio. Aurait profité d'un moment de ce moment de solitude dans sa chambre d'hôtel pour se livrer à un innocent retour en arrière sur une partie de sa vie dont elle entendait tourner définitivement la page. N'était-elle pas en attente de David Niehaus, l'homme qu'elle aimait et la rendrait heureuse...
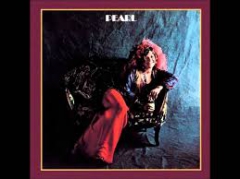
Le plus terrible c'est que les deux alternatives proposées – le soir funeste d'une vie échouée, l'aurore radieuse d'un futur immédiat enchanté – vous nagez en les deux cas en plein chromo. Teinte rose ou lavis noir. C'est toujours la morale puritaniste qui triomphe. La punition de vos actes qui s'abat comme un couperet de guillotine ou la lumière renaissante d'une vie pardonnée. J'ai du mal à entrevoir Janis en gentle born again... L'époque ne s'y prêtait guère, ce phénomène ne se développera vraiment qu'à la fin de la décennie suivante. Le mot d'ordre des septante était de jouir sans entraves. J'ai du mal à entrevoir la prêtresse hippie suivre la courbe repentante de l'égérie du punk. Les discours de Patti Smith sur l'amour que l'on se doit de se porter les uns aux autres me sont aussi insupportables que le fonds de bondieuserie catholique de Ségolène Royal. Avec tout de même le fait que Ségolène n'a jamais enregistré Horses. C'est au choix de son cheval que l'on juge la cavalière.
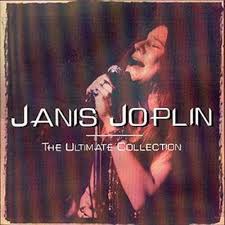
Moins artiste – même si dans ses interview Amy Berg insiste sur le souci collectif de la démarche artistique de Janis – que Patti qui quelque part n'est qu'une intellectuelle frappée par la foudre du rock, Janis est d'une autre nature. Elle est la foudre. Peut éclater en sanglots sous forme de pétards mouillés de temps en temps, mais est capable de lancer des éclairs tonitruants et d'allumer des incendies destructeurs au-dedans de nos têtes. La vie de Janis Joplin ne pouvait pas être un long fleuve tranquille. Si elle avait survécu, sans doute aurait-elle connu un parcours chaotique. Pour renaître de ses cendres le phénix doit d'abord accepter de périr.
Le film est à voir. Indispensable document d'une époque révolue. Nous parle encore de l'âge d'innocence du rock. Une indéniable existence carbonisée, menée à toute allure sur les tambours du blues et du rock and roll. Un sentiment de fête et de délivrance tellement fort que l'on pourrait croire que la réalisatrice nous raconte la fiction d'un monde meilleur.
Damie Chad.
ROCK'N'ROLL
RICHARD HAVERS / RICHARD EVANS
( Fetjaime / 2011 )
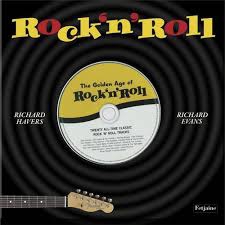
Un titre aussi radicalement concis et essentiel sur l'étalage du bouquiniste, vous conviendrez que c'est tenter l'ours avec un pot de miel. Certes Richard Havers est plutôt connu pour ses livres sur le jazz, qu'il a d'ailleurs parfois réalisés avec Richard Evans. Ce dernier, davantage dans nos cordes. Dans le staff des Who pendant presque quatre décennies. Le genre de carte de visite qui chez KR'TNT ! inspire le respect. Ne nous emballons pas pas, les Editions Fetjaine, ce n'est pas Le Mercure de France. Surfent sur l'actualité. Les sujets qui vendent. Ou alors les niches captives. Public ciblé mais assez nombreux. Sont spécialisés dans le haut de gamme. Prolétarien. Pas trop cher, mais pas le premier prix – du grand format, couverture rigide, photos couleurs et documents d'époque, du texte mais pas les cinq mille pages du Rameau d'or de George Frazer, l'on préfère l'article qui regorge d'anecdotes amusantes ou scandaleuses tout en délivrant un lot d'informations non négligeables. Le connaisseur s'y sent comme chez lui, et le néophyte en ressort ébloui devant tant d'érudition. Si possible, on rajoute un truc en plumes qui mousse, le gadget souvent inutile, le cadeau Bonux qui pousse à l'achat. Cette fois-ci un CD encastré dans la couve, vingt titres incontournables du rock. C'est eux qui le disent, mais comme j'y trouve Be Bop A Lula de Gene Vincent, je me laisse convaincre sans trop de difficulté.
Faut reconnaître que c'est bien fait. Il y a quarante ans, vous auriez froidement abattu vingt-huit personnes pour entrer en possession d'un tel trésor. Ce qui n'était que le début de vos difficultés, car vous auriez dû vous en fader la traduction. N'y avait que les rosbifs assez frappés pour vous pondre un tel bouquin. Et aucun french editor capable de l'inscrire à son catalogue. Aujourd'hui vous le revendriez sans état d'âme à la prochaine brocante du quartier. Un phénomène constitutif de nos temps modernes, un mouvement incoercible dont déjà dans les années soixante-dix le toulousain Raymond Abellio anticipait la venue en attirant l'attention de ses contemporains sur l'incoercible mouvement de dévoilement intégral des théories ésotériques les plus secrètes... Mais cela nous entraînerait trop loin. Vers la fin du dix-huitième siècle, alors que le livre couvre avant tout la glorieuse période des fifties. Ne sait pas trop par où commencer, mais s'achève d'une manière très précise et très symbolique, le 17 avril 1960, date de la mort d'Eddie Cochran.
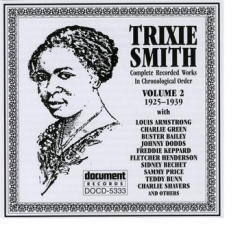
Très bonne fausse bonne question. Quel fut le premier titre de rock and roll engendré en ce bas monde d'infamie qui je le rappelle reste notre lieu de résidence privilégié ? Nos deux compères nous rappellent qu'en 1922 Trixie Smith enregistre My Man Rocks Me, elle ne manque pas de nous apporter à l'instant mais entre parenthèses toutes les précisions indispensables With One Steady Roll, ce qui nous rassure tout de suite sur la manière de s'y prendre de ce monsieur dont le prénom ne nous est pas dévoilé. En tout cas, un fameux enregistrement, très jazzy – je ne sais pas qui tient le tuyau, mais c'est du pur sirop d'érable qui coule de sa bouche. La dame a tout de même enregistré avec ce que l'on ne peut pas appeler des demi-pointures, Louis Armstrong et Sydney Bechet. Les amateurs de fumettes diverse et variées rendront visite sur You Tube aux images d'un autre titre de la demoiselle, Jack, I'm Mellow, very jazz drugs and sex. Nos deux auteurs ne s'arrêtent pas en si bonne compagnie, je vous laisse découvrir leurs propositions sur l'hypothétique et illusoire origine de la musique du diable.

Pour ma part j'opèrerai autrement. Mon bouquin refermé, le nom qui revient le plus souvent, que l'on retrouve régulièrement sous leur plumes comme un inspirateur de vedettes confirmées est celui de Wynonie Harris. L'avait tout pour déplaire Wynonie, l'était noir, se trémoussait tel un désossé d'une manière libidineuse, ne chantait mais hurlait, accélérait le tempo de ses reprises comme s'il était pressé d'en terminer au plus vite, et entre deux mots il choisissait systématiquement le plus salace. Pas très policé, le monsieur. Exercera une très mauvaise influence sur un garçon pourtant parfaitement bien élevé par sa maman. Un certain Elvis Aaron Presley qui s'inspirera fortement du jeu de scène de cet danseur ancien danseur de claquettes. Genou fou qui déclenche la hanche, le mystère de l'appel sexuel de celui que l'on surnommera the Pelvis. La renommée a été injuste avec Wynonie Harris qui décède en 1969, oublié de presque tous. Le book ne se porte pas à son secours, ne lui consacre pas un chapitre. Remarquons que si Little Richard et Chuck Berry ont droit à leur loge d'honneur, Bo Diddley dont l'influence sur le rock de l'époque se révéla manifeste et incontestable est relégué dans la rubrique Chicago...

Difficile d'être exhaustif, nos auteurs ne s'acharnent pas à traquer l'essence du rock, suivent le déploiement commercial de la vague rock tel que les charts de l'époque l'ont révélé. Et l'est vrai que les maisons de disques se sont hâtées d'offrir aux jeunes blancs américains des produits un peu moins acidulés que les ronces noires qui peuplent les rivages du désastre pour parler comme Saint John Perse. Quand l'on se souvient que l'on a même réussi à leur vendre un clone d'Elvis Preley en la pâle personne de Pat Boone, l'on se prend à rêver de l'impact de dissuasion massive que vous fournit la main-mise sur les média de diffusion populaire. Ces gens-là ratissent large et sont capables de pervertir les goûts du public le plus affiné.
J'eusse préféré un article sur Johnny Carroll, mais non ce sera les Everly Brothers. Deux jeunes gens sympathiques aux harmonies que l'on se doit de qualifier de divines, mais beaucoup plus proches du country que du rock and roll. Puisque le livre n'hésite pas à emprunter ces voies tangentielles j'ai décidé de suivre le mouvement et de m'intéresser à deux figures dont je connais les noms, dont j'ai dû écouter en une vie précédente un ou deux de leurs morceaux, mais dont ma mémoire n'a retenu aucun souvenir. Après Elvis, Jerry Lou, Bill Haley et les autres cadors vous connaissez.
FRANKIE LYMON & THE TEENAGERS
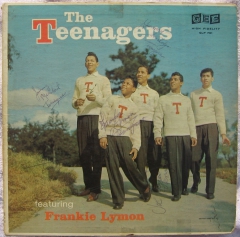
Une bio de rêve. Le petit garçon noir de Harlem qui travaille pour arrondir les fins de mois parentales – celles qui tombent en début de première semaine – qui enregistrera son premier disque à quinze ans, qui fera partie du packaging des tournées Fats Domino, Eddie Cochran, Chuck Berry, et qui décède à l'âge de vingt-six ans – ratant de peu la série des 27 – d'une surdose d'héroïne. Frankie Lymon, ce n'est pas tout à fait sex, drugs and rock'n'roll mais, amours contrariées, drugs and doo wop. La romance à l'eau de rose qui se flétrit un peu trop vite. L'a tout fait pour réussir, même son armée comme Elvis, mais c'est surtout la Tamla Motown qui s'inspirera de son oeuvre. Notamment Les Jackson Five...
Alors pour vous j'ai écouté son titre phare le Why Do Fools Fall in Love enregistré en 1957, c'est mignon pas tout à fait sucré puisque la voix du jeune garçon n'est pas assez ample dans les aigus, derrière les Teenagers swinguent de leur mieux mais le meilleur du disque reste le solo de saxophone. Gentillet et dispensable. Par acquis de conscience j'ai surfé sur You Tube jusqu'à trouver Who Can Explain, je ne retire pas un mot du commentaire précédent. J'aimerais toutefois savoir qui soufflait dans le sax.
On en aura fini avec Frankie Limon quand on aura rappelé que son apparition au Show d'Alan Freed fut interdit de diffusion, car il avait osé esquissé quelques pas de danse avec une adolescente blanche... Pour les amateurs de biopic, l'existe un film sur sa courte carrière.
DANNY AND THE JUNIORS
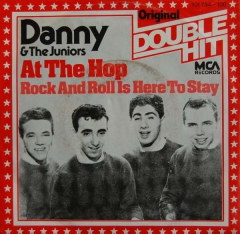
On prend les mêmes et l'on recommence. Mais l'on change de couleur. Des petits blancs de Philadelphie. Un piano omniprésent un peu à la Jerry Lou au service d'un surf rock rapide. Enregistré en 1957 le titre sonne très soixante. Du doo-wop décliné à toute vitesse. Quand on n'a pas une belle voix de baryton, l'on s'en tire en chantant vite. Une esthétique qui vingt ans plus tard sera intuitivement reprise par les groupes punk. Ne nous éloignons pas de notre sujet : les Juniors sont tout de même très propres sur eux. Forment un véritable groupe et même si Danny se suicide en 1983, le groupe tourne encore. Ce n'est donc pas un hasard si deuxième succès s'intitulait Rock and Roll is Here to Stay... En leur jour de gloire eux aussi participeront aux spectacles d'Alan Freed Show, notamment avec... Frankie Lymon.
Eurent aussi leur scandale. Prévisible quand l'on pense qu'ils partageaient lors de leur deuxième tournée avec Alan Freed avec des calibres aussi tordus que Larry Williams et Screamin' Hawkins... A Boston le spectacle tourne à l'émeute et un marin sera retrouvé poignardé... Les Juniors n'auront plus accès aux grandes émissions télévision... Les autorités essaient en fait de s'en prendre à Alan Freed, mais le disc-jockey trop populaire est encore intouchable. Faudra attendre quelques mois pour que la Justice américaine parvienne à le coincer. Scandale des pots-de-vin qui touche aux ententes financières passées entre les médias et les maisons de disques. C'est Alan Freed qui en paiera les pots cassés....
THE BIG BOPPER

Je ne vais pas vous passer tous les artistes en revue. M'arrêterai avec un autre disc-jockey. Qui connut une fin tragique. L'était dans l'avion fatidique qui le trois février 1959 s'écrasa en pleine tempête de neige près de la ville de Moorhead avec à son bord Buddy Holly et Ritchie Valens... Signalons que tout dernièrement vient de mourir le fils du Big Bopper, né deux mois après la mort de son père, dont il interprétait les morceaux en des concerts hommagiaux...
Une riche personnalité excentrique qui n'eut pas le temps de s'épanouir. Se fit un nom en diffusant durant cinq jours d'affilées deux heures et quelques cacahouètes 1831 titres... Après cet exploit digne du Guiness World Records il se mit à composer des chansons et eut bientôt envie de les chanter. Eut juste le temps d'accoucher de deux chefs-d'oeuvre Chantilly Lace popularisé par Jerry Lou et le splendide White Lightning dont nous possédons une merveilleuse version de Gene Vincent et Eddie Cochran chantée en direct à la BBC, hélas la prise s'arrête trop brusquement... Les curieux ne manqueront point de visionner le Runnin' Bear de Johnny Preston, un titre du Big Bopper qui en assure le background vocal avec George Jones...
Tous les amoureux du rock and roll ne manqueront pas de se procurer ce bouquin et pas perdront pas leur temps à en tourner les pages. Un livre sur l'éclosion de cette musique aux USA entre 1954 et 1960. Pas la grande somme sur les pionniers que nous attendons tous. Mais une approche qui ne laisse pas indifférent.
Damie Chad.
17:31 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/01/2016
KR'TNT ! ¤ 263 : LEMMY KILMISTER + MOTÖRHEAD / LEAVING PASSENGER / KLAUSTROPHOBIA / KLONE / ROB SHEFFIELD / ELVIS PRESLEY / BILLY LEE RILEY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 263
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
08 / 01 / 2016
LEMMY KILMISTER + MOTÖRHEAD
LEAVING PASSENGER / KLONE
KLAUSTROPHBIA / ROB SHEFFIELD
ELVIS PRESLEY / BILLY LEE RILEY
( + RAPPEL : Hayseed Dixie
Bloodshott Bill + Subway Cowboys )
LA SAINT-BARTHE-LEMMY
Avec la disparition de Lemmy, c’est une page d’histoire qui se tourne, celle d’un rock anglais sans concession. Lemmy et Mick Farren en étaient les figures les plus connues. Jamais on aurait vu ces deux là chanter «Miss You», «Heart Of Glass» ou «Because The Night» pour se faire du blé. Mick Farren a réussi à mourir sur scène, et Lemmy a bien failli réussir, lui aussi. En tous les cas, il aura piloté sa machine infernale jusqu’au bout.
Pas de chance, le concert du 15 novembre dernier fut annulé par la préfecture de Paris, à cause de l’attaque du Bataclan. Mais Lemmy avait déclaré qu’il voulait jouer et que la seule façon de réagir contre la peur était de monter sur scène. Ce vétéran de toutes le guerres avait hélas raison.
Il ne nous reste plus que les disques et un peu de littérature. Le conseil qu’on peut donner, c’est de lire les quelques livres existants sur Motörhead et notamment ceux dont les auteurs ont l’intelligence de s’effacer pour laisser la parole à Lemmy. C’est là qu’on mesure la hauteur du personnage. Les médias en ont fait une sorte de cro-magnon, mais Lemmy est avant toute chose un homme extraordinairement cultivé et un prodigieux auteur-compositeur. On a avec lui le même problème qu’avec Dylan : si on passe à côté des lyrics, on passe complètement à travers les chansons. Il faut malheureusement faire l’effort de comprendre ce qu’il raconte, car c’est dans da prose qu’il donne sa pleine mesure.
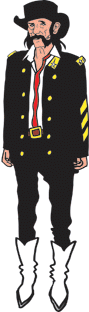
Dans ses interviews, Lemmy répète inlassablement qu’il joue du rock’n’roll et non du hard-rock. Même si on a parfois l’impression que certains morceaux flirtent avec le hard, Lemmy a toujours mis un point d’honneur à échapper aux mauvais amalgames en jouant du Motörhead, qui est une sorte de blast-rock galopant. Tous ceux qui le suivent depuis son premier single («White Line Fever») sur Stiff, ou même avant avec Hawkwind au temps béni de «Silver Machine», savent qu’il s’inscrit dans la filiation blues-rock de la scène anglaise.
On pourrait se contenter d’un seul album qui résume à lui seul la fulgurance de Motörhead. C’est bien sûr «No Sleep Till Hammersmith». Comme la plupart des grands groupes de rock, Motörhead était avant tout un groupe de scène. Comme les Stooges au moment de la reformation, Motörhead nous plongeait dans une atmosphère de fête païenne, dans un chaos d’énergies qui semblaient remonter du fond des âges.
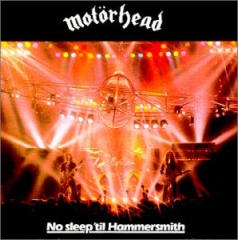
N’ayons pas peur des mots : «No Sleep Till Hammersmith» est probablement l’un des plus grands albums live de l’histoire du rock. Dès «Ace Of Spades», c’est l’enfer sur la terre. Littéralement. On entend arriver la cavalerie de la mort barbare. Dire qu’on adore Motörhead n’a rien d’exagéré. Ces gens-là ont une simili-dimension divine, ne serait-ce que par l’insolence de leur puissance magnanime. Ils tirent «Stay Clean» de l’album «Overkill» et Lemmy chante ça avec conviction. On baigne dans l’adorabilité de la puissance surhumaine et soudain Lemmy part en solo pour une séquence de démence absolue. Sur cet album, tout est spectaculairement bon. Le «Metropolis» qui suit est heavy à souhait. Même chose pour «The Hammer», monté sur un beat enfonceur de clous. Lemmy s’y arrache la glotte au sang. Quelle dégelée, ça claque et ça fouette, ça pète et ça pulse, ça dégage et ça déménage, ça pétarade et ça bombarde, ça tout ce qu’on veut. Ça casse la baraque, ça fout le feu aux poudres et ça défonce tout. Ça ne recule devant rien, ça déblaie les barricades et ça débouche les bronches. Ça écroule les immeubles et ça tue les mouches. Même chose avec «Iron Horse», une chanson en hommage aux Hell’s Angels - It’s called iron horse/ Born to lose - Puis on retrouve le fameux «No Class» et son riff du MC5. Voilà encore une partie de cavalcade effrénée. C’est à tomber avec grand-mère dans les orties. C’est même hallucinant de véracité ergonomique. Et pouf, ils enchaînent avec «Overkill», qui est une véritable abomination. Rien au-dessus de ça. Rien. Voilà la cut intense, carbonisé et tendu à mort par excellence. Insurpassable. Aucun power-trio ne peut rivaliser avec Motörhead. Ils sont foncièrement déstructurants. Ils cognent les neurones comme des boules de billard. Ils tournent à l’énergie rock ultime. Toi la limace, ne viens pas baver sur Motörhead. On trouve à la suite d’autres monstruosités du type «(We Are) The Road Crew», un cut hanté par les hurlements de Lautréamont, version dévastatrice et belle tranche de génie britannique. Ils enchaînent avec «Capricorn» et voilà «Bomber», gros tas d’accords brûlés, ultime et désarçonnant, une chose qui file à toute blinde et qui rougit comme la braise sur laquelle on souffle.
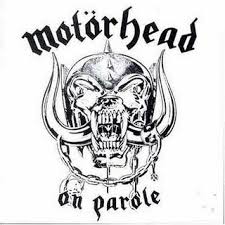
Et pourtant, ce n’était pas gagné. Il suffit d’écouter «On Parole» paru en 1979 pour voir que Lemmy a frôlé la catastrophe en s’acoquinant avec Larry Wallis qui était pourtant le leader des Pink Fairies. Ils font une bonne version de «Motörhead», infestée d’intrusions vénéneuses et Larry tente de créer la légende, comme il a su le faire en reprenant les Pink Fairies sous on aile. Mais les autres cuts de l’album sont un peu mous du genou. Même la version de «City Kids» qu’on trouve sur «Kings Of Oblivion» manque de panache. On comprend que Lemmy ait opté pour une autre formule. Il voulait quelque chose de plus hargneux. La version de «Leaving Here» qui se trouve sur cet album semble complètement retenue. On ne sent aucun abandon. Et Lemmy chante «Lost Johnny» à l’appliquée, accompagné par Larry à l’acou. N’importe quoi !
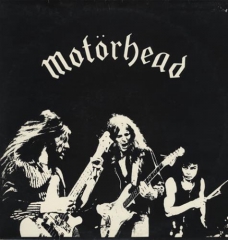
Heureusement, Lemmy rencontre Fast Eddie et c’est parti ! «Motörhead» sort sur Chiswick en 1977. Lemmy doit une fière chandelle à Ted Carroll. C’est aussi la première apparition de Snaggletooth, dessiné par Joe Petagno, et qu’on retrouvera sur quasiment toutes les pochettes d’albums. Lemmy voulait un personnage avec des cornes et un casque, une sorte de logo. Petagno mit les cornes dans le groin et ça donna Snaggletooth. Pour corser l’affaire, il rajouta un filet de bave, fit pendouiller une chaîne, une croix fer nazie et un crâne humain, et sur l’un des clous du casque, il grava une petite croix gammée, histoire de faire jaser dans les villages. Pendant presque quarante ans, on verra Snaggletooth faire des siennes sur les pochettes. Le morceau titre ouvre le bal des vampires. C’est du pur Hawkwind, bien emmené au pumping et Fast Eddie place un solo d’antho à Toto. C’est là qu’ils fondent le mythe. Mick Farren co-écrit «Lost Johnny» avec Lemmy, un cut solide comme l’enfer et riffé avec une belle brutalité. On sent au fil des morceaux que Fast Eddie déploie des ailes de grand guitariste. En B, il plante un décor de cocote pour «Keepers On The Road», un autre cut signé Mick Farren.
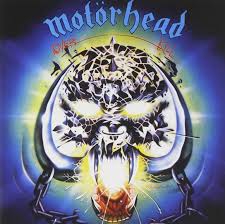
L’album suivant s’appelle «Overkill». Sur la pochette, le pauvre Snaggletooth implose comme une télévision. Survivra-t-il ? Il faudra attendre l’épisode suivant pour le savoir. En tous les cas, le groupe a trouvé son son. Ils attaquent avec le sur-puissant morceau titre, un cut idéal et extrême à la fois, digne encore une fois du MC5, doté de la même énergie, tendu à l’extrême, puissant et noble. Voilà ce qu’il faut bien appeler du rock de cartouchière. C’est chanté à la limite de l’épuisement. Fast Eddie joue comme un héros. Il sort des riffs soniqués du ciboulot et les pousse à l’extrême olympien. Ils sont dans l’orgie et restent imbattables à la course. Ils sont chromés et impérieux. Ils se payent le luxe de deux faux départs. Hallucinant ! C’est sur cet album que se niche l’immense «Capricorn», une pièce de trash rock d’épouvante, saturée d’humidité. On écrit ça un peu à la manière d’Henri Michaux, fasciné par les effets, affamé d’incongruité, perdu dans les limbes des équinoxes. Ce fringuant power-trio nous sort là un véritable fumet d’outre-tombe, et c’est à tomber. Lemmy mâche sa morve et il crache des horreurs. «No Class» est aussi monté sur un riff du MC5. Fast Eddie joue le rock de Detroit. Lemmy hurle comme le petit dernier de la famille des damnés de la terre. Ses verrues tremblent. La sueur ruisselle dans son sillon velu. Et Fast Eddie arrose tout au napalm. S’ensuit l’heavy romp de «Damage Case», un vrai stomp poivré au pilonnage intensif. C’est à la fois fabuleux, pointu et pompé. Ils ont vraiment de la puissance à revendre. Aucune chance de s’endormir en écoutant ça. Retour au big heavy sound des enfers avec «Metropolis». Voilà encore un monument de heavyness, suivi d’un autre classique hirsute, «Limb From Limb» ou Fast Eddie joue une fois de plus comme un dieu.
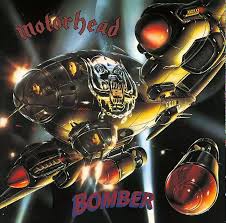
Comme si cela ne suffisait pas, ils sortent un deuxième album en 1979, «Bomber». Lemmy, Fast Eddie et Phil pilotent un bombardier sur le flanc duquel on a peint Snaggletooth, celui de la pochette Chiswick. On tremble pour Snaggletooth. Et s’il se ramassait un obus de DCA en pleine gueule ? «Bomber» pourrait bien être l’un des meilleurs albums studio de Motörhead, en tous les cas, il incarne bien l’âge d’or du groupe car on y entend Fast Eddie faire pas mal de ravages, notamment dans «Stone Dead Forever» qui démarre comme le «Love Song» des Damned. Fantastique prestation ! Fast Eddie restera l’un des plus grands guitaristes de rock anglais. Les cuts qui font la force de cet album sont les prodigieux heavy-blues de type «Lawman». Difficile de faire mieux dans le genre. L’important, lorsqu’on écoute Motörhead, c’est de prendre Lemmy très au sérieux. Sinon, ça ne marche pas. Il faut considérer que Lemmy chante à l’unisson du génie. «Sweet Revenge» est encore plus heavy, comme si cela était possible. Lemmy a su inventer de toutes pièces un véritable univers, avec Snag en tête, le cacochyme, les grosses guitares, la foi et le pâté de foie, le jusqu’au-boutisme des tournées, l’incarnation du rock’n’roll, la provocation nazillarde, le fun trash, les pipes à la chaîne, le m’as-tu-vu des rues - street tough - et l’héroïsme des briques rouges. C’est magnifique. On peut écouter les vingt-deux albums studio de Motörhead sans jamais craindre l’ennui. Incroyable mais vrai. On trouve d’autres monstruosités sur «Bomber», comme par exemple «All The Aces», sauvagement drumbeaté par Philthy Animal. Lemmy en profite pour régler ses comptes. Il ne prend pas de gants. Pire encore que Van Morrison dans «Big Time Operators». C’est magnifique de rage et de volume. Retour au blues-rock des enfers avec «Step Down». On y retrouve Fast Eddie le génie, le roi du festival, l’heavy Eddie God sans personne au-dessus. Eddie prend le cut au chant et fait wow ! C’est à se prosterner, tellement il en impose. Et bien sûr le morceau titre vaut tout l’or du monde, car on a là du punk pur digne des Damned et du MC5, monté sur un riff fabuleux. On pourrait même parler d’une forme de génie apocalyptique. Le riffage de Fast Eddie fonctionne comme le velours de l’estomac, c’est une bénédiction pour les tympans. Sans Fast Eddie, Motörhead ne pourrait pas décoller. Lemmy, oui, d’accord, mais avec Fast Eddie, c’est mieux.
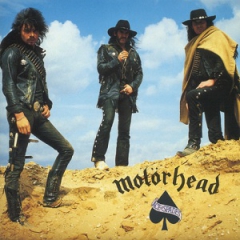
Si vous cherchez Snaggletooth sur la pochette d’«Ace Of Spades», vous le trouverez épinglé sur le cuir d’un Philthy Animal déguisé en desperado. On trouve aussi Snag sur sa boucle de ceinturon. Lemmy et ses deux copains frisent un peu le ridicule, ainsi déguisés, mais bon, comme des gamins, ils adorent se déguiser. Ils attaquent avec un morceau échevelé, monté sur un riff d’Eddie le pyromane. Lemmy en profite pour avancer son meilleur guttural. Mais c’est Eddie qui fait le show, une fois de plus. Il est partout. On admire aussi le travail qu’il fait dans «Love Me Like A Reptile». Il nous barde ça de riffs de toutes les couleurs, de petits retours retors, de tortillettes infectes. Il n’a que deux bras et pourtant il joue comme dix. Il fait aussi des siennes dans cette fabuleuse tranche de heavy blues qu’est «Shoot You In The Back». lls finissent leur face avec un fantastique hommage à Vulcain, le dieu du beat martelé, avec «(We Are) The Road Crew». C’est stompé à la vie à la mort. De l’autre côté, nos trois amis développent la puissance d’une division de Panzers avec «Fire Fire». Motörhead invente là le son de l’avance inexorable, du mur de flammes, de l’enfoncement de la ligne Maginot et Eddie danse dans les flammes, il claque ses riffs fatals - Big black smoke/ Ain’t no joke ! - Autre merveille de heavyness, «The Chase Is Better Than The Catch». Ils stompent comme des brutes et ils bouclent avec «The Hammer» qui sonne comme «Ace Of Spades». Lemmy dérape dans le gras de sa voix chargée et relance des dynamiques épouvantables.
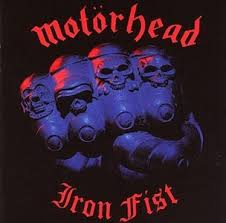
Snaggletooth brille par son absence sur la pochette d’«Iron Fist». Par contre, si on retourne la pochette, on le trouvera sous forme d’un moulage en plastique, avec ses chaînes, ses croix et son crâne. C’est fou ce qu’on s’attache à lui. Voilà un album sans surprise, rempli de grosses cavalcades, de guttural et de coups de suspensif signés Fast Eddie. Avec «Heart Of Stone», on a un pur blast de fournaise - Leave me alone/ Get off the phone/ I’ve got a heart of stone - On y entend Phil pousser des pointes de triplettes de grosse caisse. Lemmy dédie «Go To Hell» à ceux qui le dénigrent et il en rajoute avec «Loser» - I’m a loser/ That’s what they said - Lemmy adore régler ses comptes avec les cons - Now I got their women in my bed - On a là un classique du rock anglais. De l’autre côté, il évoque ses souvenirs du Canada et de cristal meth dans «America» - Lemmy et Mick Farren ont ça en commun : ils se sont fait virer de leurs groupes respectifs, Hawkwind et les Deviants, à la frontière du Canada - Et Fast Eddie continue d’enluminer les morceaux de lueurs incendiaires, comme c’est le cas dans «Shut It Down». Lemmy ressort les crocs dans «(Don’t Let Em) Grind Ya Down» - Sons of bitches/ Evil bastards - Et avec «(Don’t Need) Religion», il s’adonne à l’un de ses sports favoris, la trash-philosophie - I don’t need no Santas Claus !

Sur la pochette d’«Another Perfect Day», Snaggletooth s’est déguisé en mou de veau. C’est assez dégoûtant. Fast Eddie a réussi à se faire virer, à cause du disque enregistré par Lemmy en collaboration avec Wendy O Williams des Plasmatics. Lemmy a du répondant et il embauche Brian Robertson de Thin Lizzy, dit Robbo. Lemmy attaque avec une intro de basse monstrueuse. «Back At The Funny Farm» en bouche un coin ! Cette fois c’est Robbo le seigneur des anneaux qui joue de la guitare. On le retrouve sur «Shine». Il joue comme une belle brute raffinée, ce qui sied parfaitement au brasier. Robbo joue les effarants, il se comporte comme une sorte de génie multiplexe. Il touille bien la déconfiture. Sur «Dancing On Your Grave», les couplets sont du pur jus de Lemmy, gutturaux et prévisibles. Joli retour à la heavyness avec un «One Track Mind» qui ne doit absolument rien aux Heartbreakers. Robbo y prend un solo qui enfonce bien les clous dans les crânes. Lemmy étend encore son empire. Ils tapent ensuite le morceau titre et Robbo embarque Motörhead dans les étoiles. On voit rarement des guitaristes aussi prolifiques. Il est joyeux et gluant à la fois. Motörhead n’avait encore jamais eu un guitariste aussi jouissif. Il répercute les éclairs soniques à l’infini. On pourrait le suivre à la trace. «Got Mine» sonne comme un hit dès l’intro. C’est flamboyant et ça claque au vent. Robbo part bien en vrille. Nouvelle intro superbe de Lemmy pour «Die You Bastard». C’est même un véritable chef-d’œuvre, lorsqu’on s’intéresse aux intros de basse. Lemmy rote et ricane comme le diable, mais le morceau sonne mal, on croirait entendre jouer des hardeux poilus.

Snaggletooth fait la locomotive sur la pochette d’«Orgasmatron». Nouveau changement d’équipe : Philthy et Robbo dégagent, remplacés par Phil Campbell, Würzel et Pete Gill au beurre. Le cut qui croche, c’est «Claw», monté sur un riff qui court comme le furet. Magnifique et absolument éclairant. Pete Gill est un authentique batteur fou. Il sort un beat d’ultra speed-rock pur. Considérons que ce cut fait partie des joyaux de la Couronne d’Angleterre. Oui, car c’est de la pure folie, on voit bien qu’ils sont au bord de l’épuisement. Pareil pour «Mean Machine», ça stompe et ça riffe dans tous les coins. Par contre, «Ridin’ With the Driver» est trop rapide. Trop Motörhead. Le solo est trop vertigineux. Trop porté par le vent. Lemmy s’épuise. Retour aux énormités avec «Doctor Rock», un cut quasiment garage et ils enchaînent avec le morceau titre de l’album, une sorte de hit éternel complètement voodoo et franchement dément, monté sur un riff princier. Les forces des ténèbres y écrasent tout. Voilà le hit suprême de Motörhead, une nouvelle preuve l’existence d’un dieu nommé Lemmy.

Sur la pochette de «Rock ‘N’ Roll», Snaggletooth semble planer comme un ange de miséricorde au dessus d’un champ de bataille moyenâgeux. Non seulement il s’est laissé pousser des dents, mais il tire un langue aussi longue celle d’un bœuf. Philthy retrouve sa place dans l’équipe. Au moins avec ce titre d’album, les choses sont claires : Lemmy a toujours dit et redit aux journalistes qui ont la comprenette difficile qu’il ne jouait pas du hard, mais du rock’n’roll. Le morceau titre qui ouvre le bal de l’album est une belle déclaration d’intention. Lemmy reste égal à lui-même et il laisse défiler ses petits couplets à vide sur le drumbeat. Il enchaîne ça avec «Eat The Rich», belle flambée d’insurrection - C’mon sucker - Lemmy embarque son équipe sur les rails de l’enfer, en vrai Snag rougi par les flammes - C’mon bite my bone - Le tout sur un tempo bien lourd et incroyablement bon. Retour au pur jus de MC5 avec «Stone Deaf In The USA». Voilà bien un cut fidèle et puissant. C’est une fois de plus à tomber, aussi bien par la forme que par le fond. Ils passent quasiment au glam avec «Dogs» et une pluie d’accords quasiment syncopés. Le cut se veut très politique, très anti-américain. Lemmy prend parti. Il ne plaisante pas.
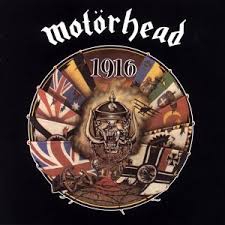
On s’en serait douté. Que peut porter Snaggletooth sur la pochette d’un album intitulé «1916» ? Un casque à pointe bien sûr ! On retrouve l’équipe de «Rock ‘N’ Roll». Ils attaquent avec «The One To Sing The Blues» monté sur un riff bien gras. Lemmy s’ancre définitivement dans le rock anglais à guitares. Dans «I’m So Bad» il multiplie des clichés et rappelle qu’il est un voyou. Par contre, «No Voices In The Sky» accroche par son refrain mélodique. Le cut sonne comme un hymne, c’est bardé d’accords sauvagement hachés et extrêmement british. Dommage que Lemmy n’aille pas plus souvent dans cette direction. Il y excellerait. Il nous gâte avec un longue fin glou-gloutée névrotiquement. C’est le hit de l’album. Il passe à la mad psychedelia avec «Nightmare/The Dreamtime», bardé d’accords sibyllins en lesquels tout est comme en un ange aussi subtil qu’harmonieux. C’est digne du Floyd de Syd Barrett, à la fois comique et sérieux, hanté par un solo psycho-heady rampant. Lemmy n’en finira plus de subjuguer les oies blanches. On y retrouve le grand Lem des acid trips. Il sait de quoi il parle. Avec «Angel City», il passe au pur rock’n’roll de Los Angeles. Il fait rimer ses textes à tous les coins de rues. La musique est ordinaire, ici, mais les textes sont d’une hallucinante concision. Lemmy s’installe au bord d’une piscine et ça fait mal. «Make My Day» est du pur Motörhead qui file tout droit, vrillé par un solo fatal et vicelard, fin comme un petit serpent jaune et qui semble se faufiler entre les gros paquets d’accords. Même chose pour «Shut You Down». On y retrouve ce son unique au monde, ce tout-droitisme exemplaire qui balaye tout sur son passage.
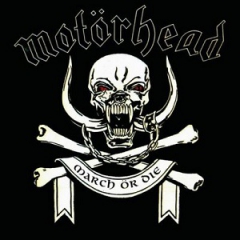
Snaggletooth ne porte plus de casque sur la pochette de «March Or Die». Il s’est transformé en Jolly Rodger, avec ses tibias croisés. C’est sur cet album que Mikkey Dee fait son apparition et le line-up va enfin se stabiliser autour de Phil Campbell et de Würzell. Ils ouvrent le bal avec «Stand» qui sonne comme un appel à la cohérence bombastique. Puis Lemmy rend un curieux hommage à Ted Nugent en reprenant son vieux «Cat Scratch Fever». Il profite de «Bad Religion» pour cracher dans l’œil de satan. Il adore ce genre de cut, il y règle ses comptes philosophiques. On se régale de son son de basse dans «Hellraiser». Jamais encore il n’a eu un son pareil. Mais les choses sérieuses se tapissent dans l’ombre, sur l’autre versant. À commencer par un «Asylum Choir» de fantastique ampleur - The sky, the sky is crushing you/ The walls, the walls are crushing you too - C’est l’un des hits de Motörhead, l’un de ces mid-tempos au beat épais dont Lemmy a le secret. Avec «Too Good To Be True», ils sortent quasiment le même son, mais avec une mélodie chant en plus. La fête continue avec «You Better Run», une sorte de heavy blues à la Muddy Waters - I’m iron and steel/ I’m bad to the bone/ For trouble honey don’t you come alone - Lemmy maîtrise l’art des lyrics percutants. Et puis voilà une nouvelle preuve de son génie : «March or Dïe». Lemmy nous sort le monologue intérieur du troupier - The day has come/ The day has come/ We march to Armageddon/ Hungry for war/ I see the hated enemy/ I see what I was taught to see - Oui, Lemmy s’est mis dans la peau du soudard qui marche vers le champ de bataille, avec l’abattage et la haine aveugle pour seules motivations. Stupéfiant !

Snaggletooth remet son casque sur la pochette de «Bastards». En plus, il a des ailes et deux dagues croisées sous lui. On entend Mikkey Dee sur-développer son drumming dans «Burner». Lemmy en profite, car un bon drumming sur-développé, ça permet de foncer dans la nuit. Dee a même le coup de pied épileptique. Ça va devenir une composante du nouveau son de Motörhead. Même surenchère dans «Death Or Glory». Mikkey Dee sur-pédale au beurre et les guitares duettent tellement dans la fournaise que Lemmy tousse son guttural. Il chante à fendre l’âme. Et voilà que Motörhead se met à faire du boogie avec «Born To Raise Hell». Franchement, on se croirait chez Mott The Hoople ! On retrouve en B le côté tape-dur du groupe avec «Bad Woman», pas trop rapide, touillé dans le brasier et servi avec une pointe de boogie anglais. Dans «Liar», Lemmy fait son cro-magnon pour faire peur à Tounga et au lion des cavernes. Nouvelle surprise avec «I’m Your Man» : ils tapent dans les riffs du «Walk Your Way» d’Aerosmith, ce qui n’est pas vraiment une riche idée. Ils terminent avec «Devils», cocoté limite du hard. Il faut rester prudent, car au dos de la pochette, les imbéciles de la maison de disques ont écrit : File under hard rock, au mépris de toutes les déclarations de Lemmy. Heureusement, le morceau est bon, on y entend de belles parties de guitare mélodiques. On reste dans la magie de Motörhead.
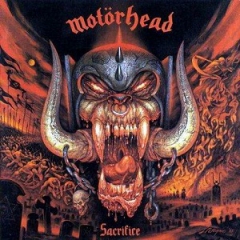
Sur la pochette de «Sacrifice», Snaggletooth revient planer au dessus d’un champ de bataille moyenâgeux. Il a perdu ses croix, mais il bave comme un âne en rut et il a une langue en forme de bite. On sent sur cet album une légère tendance au hard des cavernes. Dans le morceau titre qui fait l’ouverture, Mikkey Dee pousse le saccadé du beat à son extrême. Il tape un nombre incroyable de coups de pieds à la seconde. Il va si vite qu’on n’arrive pas à compter. Puis on retrouve le Motörhead qu’on aime bien dans «Sex & Death». Avec «War For War», Lemmy joue avec l’idée de la barbarie. Il recrée l’état d’esprit du soudard ivre de violence. On sent le poids des bottes cloutées en marche dans les tranchées tapissées d’entrailles fumantes. De l’autre côté, on tombe sur un «All Gone To Hell» ténébreux et chargé de menace. Tout y est lourd et métallique, à l’image d’une chenille de Panzer qui va vous écraser. Ils finissent cet album dur avec «Out Of The Sun» qui sonne comme un hit, puisque Lemmy amène une mélodie dans son refrain et ça devient éclatant.
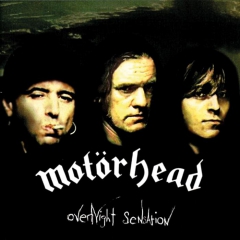
Pas de Snaggletooth sur la pochette d’«Overnight Sensation». On le retrouve cependant au dos, celui de Chiswick, un peu spectral. C’est la mouture définitive de Motörhead qui enregistre cet album en 1996 : Lemmy, Phil Campbell et Mikkey Dee. Würzell a jeté l’éponge. Ça blaste dans les brancards dès «Civil War», monstruosité d’une brutalité implacable, et c’est rien de le dire - The drumming of the civil war/ Outside your window - La ville en feu, l’apocalypse, quoi. Lemmy fait une belle intro de basse pour «I Don’t Believe A Word» et ça chante à deux voix, sauf que Phil chante mal. Lemmy pend les refrains de sa voix la plus barbare. Par contre, sur «Eat The Gun», c’est Mikkey Dee qui se taille la part du lion. C’est monstrueux de vélocité punkoïdale et Phil arrose ça d’un solo au napalm. Le hit du disque, c’est bien sûr le morceau titre. Lemmy y balance une intro de basse boueuse. Et là on assiste au démarrage du plus grand power-trio du monde. Voilà le grand art de Motörhead en plein blast : riff fatal, lignes de basse baladeuses et drumbeatage des clous dans les pattes des crucifiés, avec force et barbarie, Aïe aïe aïe ! Bam bam bam ! To drumbeat or not to drumbeat ! Et Phil part en vol plané de wha-wha, comme s’il n’avait plus rien dans le citron. Ah la brute. Encore un big bang motörheadien avec «Love Can’t Buy My Money», boueux en diable. On tombe plus loin sur «Them Not Me» une puissante pourriture cavalante, du pur jus de Micky Dee. Aucun groupe de rock ne peut descendre dans de telles profondeurs d’apocalypse. Alors, il faut entendre «Listen To Your Heart», car c’est de la belle pop anglaise. Incroyable ! Lem fait de la pop ! C’est une claque au museau des dieux ! Comment ose-t-il ? Quelle supériorité ! Car forcément, le cut est superbe.
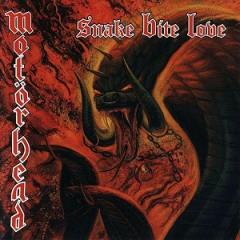
Pour «Snake Bite Love», Snaggletooth se transforme évidemment en cobra colérique. En fait, la grosse surprise de cet album, c’est la photo du groupe qui se trouve au verso de la pochette. Qu’y voit-on ? Lemmy déguisé en Snaggletooth ? Non, mieux que ça : Lemmy rasé. Ce mec est très beau en réalité. Il a une vraie allure de rocker anglais et d’ailleurs, le «Love For Sale» qui ouvre la bal est à cette image, classique et bien en place, monté sur un beat qui se dresse fièrement vers l’avenir. «Dogs Of War» sonne comme du Motörhead vintage, bien emmené au guttu féroce de heavy dude et Mikkey Dee revient faire son festival de pied élastique dans «Take The Blame». Comment fait-il pour battre aussi sec ? On ne se saura jamais. Sauf si on lui demande. Mais l’inspiration brille par son absence sur cet album trop classique. Il refont du Mott avec «Don’t Lie To Me» et il faut attendre «Desperate For You» pour retrouver le fantastique déploiement des troupes de Motörhead et leur puissance de charge. C’est à la fois leur force et leur génie. Et l’album se termine heureusement en apocalypse avec «Better Off Dead». Leur puissance finit par émerveiller les plus blasés. Lemmy ne renonce jamais à pousser une petite pointe.
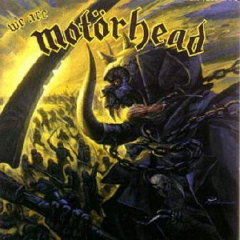
Équipé de sa faux, Snaggletooth participe au combat moyenâgeux, sur la pochette de «We Are Motörhead». Ouverture des hostilités avec un hallucinant «See Me Burning». Ce Mikkey Dee est beaucoup trop fort. En plus, Phil fait des siennes en balançant l’un de ces solos incendiaires qu’aurait adoré Néron. Nos trois héros n’ont jamais été aussi puissants. Ils jouent des cuts brûlés jusqu’à l’os. L’incroyable est qu’ils tapent plus loin dans le «God Save The Queen» des Pistols. Bien sûr, Lemmy ne parvient pas à chanter aussi bien que Johnny Rotten, mais le son est au rendez-vous, n’en doutez pas un seul instant. On se pourlèche les babines avec «Out To Lunch», car c’est aussi bien incendié. Et tellement énorme que ça dépasse nos facultés descriptives. Lemmy va au bout de sa voix et l’affreux Phil intervient bombastiquement. On retrouve du pur jus de Lem dans «(Wearing Your) Heart On Your Sleeve», on baigne dans la friture de l’épaisseur ultime et le voyage s’achève sur le morceau titre de l’album. Magnifique intro de basse du chef sur canapé ingénu monté à la blinde. Encore une merveille lemmique définitive.

Le Snaggletooth qui orne la pochette de «Hammered» est en or massif. C’est le snag d’origine, avec ses croix, sa bave, sa chaîne et son crâne qui pendouillent. Il a une allure d’insigne militaire, et comme c’est écrit en lettre gothiques au dessus et en dessous, on pense bien sûr à cette esthétique de l’armée allemande chère à Lemmy. On trouve quelques cuts seigneuriaux sur «Hammered», à commencer par «Voice Of The War», bien heavy. On sent qu’ils jouent avec le feu des classifications méthodistes. On passe aux choses sérieuses avec «Mine All Mine», monté sur un riff déterminant. On retrouve les lueurs du grand incendie urbain, les riffs palpitants, le solo de pur rock’n’roll conventionnel. Bien britannique dans l’esprit. Phil envoie ses belles giclées et on reste dans l’esprit lemmique pur. Retour au heavy shit de choc avec «Shut Your Mouth», un cut épais et lourd comme de la fonte liquide. Invraisemblable, Lemmy sonne comme un haut-fourneau, il a la résonance d’aplomb et de fumerolles des forges du Creusot. C’est à la fois furieux et bulldozérique. Ici le riff se bat à la masse d’arme - hey hey - Lemmy nage comme un poisson dans la fournaise liquide. Il se dresse comme le géant des enfers. Ah que deviendrions-nous sans lui ? C’est lui le héros des fleuves de lave. «Doctor Love» est un classic rock parfait doté d’une histoire parfaite - And she shakes me in my shoes - C’est monté sur un magnifique support cymbalique de Mikkey. Par contre, ils finissent l’album avec du grindcore speedo-concassique et ça devient insupportable. Avec «Serial Killer», Lemmy fout la trouille.
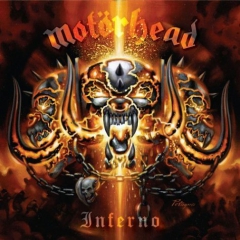
Pour «Inferno», Snaggletooth est à nouveau en guerre. Cette fois, ça se passe à notre époque avec de fantassins casqués et armées de fusils. Il semble que Snaggletooth ait reçu une ogive nucléaire en pleine gueule, car il se disloque. De belles perspectives attendent les visiteurs sur cet album. À commencer par «Terminal Show» dans lequel Lemmy prédit l’apocalypse en faisant rimer tous ses vers. La musique suit. Phil arrose «Killers» de solos toujours aussi rougeoyants. Et voilà «Suicide», épais comme pas deux, somptueux et grandiose, à l’image du grand Lem aux pieds de fonte. Une vraie boue de lave se répand à la surface de la terre et le géant Lem avance dans d’horrible clapotis. Quelle posture magnifique que celle de cet ogre à la moustache en crocs. Ouf ! Changement de rythme avec «In The Year Of The Wolf». Lemmy nous propose un groove boogaloo et un vrai film, puisqu’il nous embarque dans la nuit glacée - Tonight the food is you ha ha ha - Ils finissent cet album fumant avec «Wharehouse Blues» qui est un vrai blues. Un petit conseil : écoutez Phil Campbell plutôt que Clapton. Car on a là du génie à l’état pur.
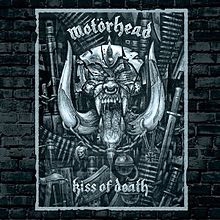
Pauvre Snaggletooth ! Sur la pochette de «Kiss Of Death», il ressemble à un objet de brocante qui aurait pris de violents coups de sabre et qu’on aurait jeté dans un tas de couteaux et de cartouchières. Mais il bave toujours. Chez lui, c’est signe de bonne santé. Lemmy attaque avec «Sucker» - We gonna dance on your grave/ Sucker - Et c’est parti pour un tour de cavalcade effrénée. Lemmy règle les comptes de tous ses ennemis et lâche un cut d’une puissance irradiante. Dans «One Night Stand», il redit sa préférence pour les petites putes américaines et le love at first sight - I been a slut all my life/ Wish every night as a night stand - Pour lui, pas question de s’établir dans une relation. On se plait, on tire un coup et on passe à la suivante. Avec «Under The Gun», il joue la carte de la heavy rockalama. C’est un fantastique appel à la liberté - We all live under the sun/ But we don’t have to live under the gun - Il fait rimer sun et gun, pas mal hein ? En plus c’est gorgé de son. De l’autre côté, il refait son Mott avec «Christine» et on se régale un peu plus loin de «By My Baby», car il y brille des petits éclairs de génie - Outlaw Outlaw - C’est admirablement joué à la saccade motörisée. Le hit du disk se niche en fin de face : «Going Down» - In the name of rock’n’roll/ Fire the sky - Lemmy enfonce ses vieux clous - You can’t mess with Dr Rock/ So don’t you ever try ! - Et il nous achève avec un final hallucinant concassé au riff bancal.
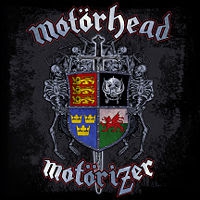
Pour «Motörizer», Snaggletooth se retrouve coincé dans un écusson moyenâgeux, comme si Lemmy voulait enfin le voir anobli. On trouve quelques valeureuses énormités sur cet album, à commencer par «Runaround Man», monté sur un véritable mur du son. Voilà le vrai rock anglais, avec sa queue de solo dément. On a là un son plein comme un œuf. Aucun groupe ne sonnera jamais mieux que Motörhead. Lemmy propose plus loin une belle chanson sur la guerre, «When The Eagle Screams» et «Rock Out» file tout droit, sans discuter. Lem profite d’«One Short Life» pour nous asséner une fantastique leçon de morale. La puissance du groupe tient toute entière dans les textes - If you compromise your integrity/ You should drown in your own blood - On le croit sur parole, car c’est heavy comme l’enfer - No no curse upon my name/ No way I look at a bad guy - Il tient à son honneur - I live without dishonour/ I won’t have to die ashamed - Avec «Buried Alive», Lemmy se croit dans un film de Tarentino. Voilà du pur jus de Motörhead, chanté à l’arrache avec un beat dynamiteur. Mikkey Dee est un vrai con quand il parle mais il bat comme un dieu. Trop bien, même. C’est frappé sec. Hallucinant. Trop doué. Dans la vie, il faut savoir faire des compromis. Avec «English Rose», Lemmy s’épanche. Il faut bien qu’il s’épanche de temps à autre, car il ne peut pas passer sa vie à donner des leçons de morale, même si elles sont pertinentes. On se régalera de la brutalité machiavélique de «Back On The Chain». Lemmy se prend pour un délinquant, il demande à la police de ne pas tirer - We’re just kids with guns - Il parvient chaque fois à convaincre et à entraîner ses textes dans de vertigineuses dynamiques. Sous ses airs un peu frustres, Lemmy fait partie des très grands songwriters. On se gaussera du ridicule de «Heroes», on s’effarera de la vitesse de «This Time Is Right» et on se réconfortera dans les bras de «The Thousand Names Of God», monté sur la même vieille sauce. Ces trois-là ne débandent jamais. Ils adorent montrer qu’ils sont les plus forts, ce qui les rend parfois un peu grotesques. Trop c’est trop. Ginger Baker n’a pas ce défaut.
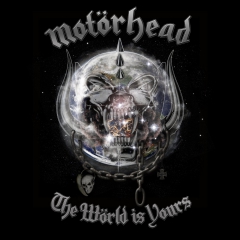
Sur la pochettte de «The Wörld Is Yours», Snaggletooth est une planète qui flotte dans le cosmos. Ce disque est infernal, comme tous les albums du groupe. Motörhead n’en finit plus de ferrailler. «Born To Lose» et «I Know How To Die» sont du pur jus de riffage drumbeaté et chanté à la glotte écarlate. Magnifique partie de batterie de Mikkey Dee sur «I Know How To Die» ! Lemmy a de la chance de l’avoir. Retour au bon vieux boogie avec «Get Back In The Line». C’est un pur album de rock anglais - We are the chosen ones - «Rock’n’roll Music» pue un peu la Stonesy car c’est riffé à la Keef, mais après tout pourquoi pas. «Brotherhood Of Man» frise le grindcore et la clameur des combats. On reste dans le vieux système lemmique, avec un album intense sans aucun déchet, à condition toutefois de bien aimer le bruit et la fureur. Rien de tel que de se faire sonner les cloches par Lemmy Kilmister.
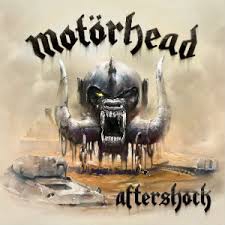
«Aftershock» se passe après la guerre, une fois que tout le monde est mort. Il ne reste plus que Snaggletooth, bien cuirassé et patiné par le temps et les intempéries. Au dos de la pochette, on voit des véhicules militaires ensablés qui rappellent les images de la guerre en Irak. Cet album est probablement l’un des plus victorieux de Motörhead. Lemmy ouvre le feu avec un «Heartbreaker» chargé des pires menaces - Time to get us out of here/ No emotion only fear/ Say your last goodbye - En quelques mots, il crée une tension insupportable, celle de la terreur en temps de guerre. Lemmy scénarise la peur comme personne. Avec «Coup De Grace», il revient à ses vieilles histoires de marginal : si tu ne joues pas le jeu, tu seras rejeté. Puis avec «Lost Woman Blues», il sonne comme ZZ Top. On va de surprise en surprise puisqu’avec «End Of Time», il fait du psychobilly. Il sort exactement le même son que les Mad Sin et il envoie en prime des textes de révolte - Politics religion/ Rotten to the core - Et il prédit que ça se finira dans les ordures - Scratching throught garbage/ At the end of time - Il revient à ses chères confessions de foi avec «Do You Believe» et il redit son attachement au rock’n’roll - Put yout faith behind it/ And You won’t be go far wrong - Le seul moyen de ne pas te planter dans la vie, c’est de faire du rock’n’roll. Pour le prouver, il jette sa vie dans la balance. Encore une merveille en bout de face, «Death Machine» que Phil lèche au lance-flammes sonique. Quel fabuleux guitariste ! De l’autre côté, on plonge dans la meilleure heavyness d’Angleterre avec «Silence When You Speak To Me». Phil vient lécher la sortie du couplet et avec «Crying Shame», ils reviennent au boogie anglais. Ils refont du Mott, mais avec une énergie considérable. On a là du Motörhead d’ampleur joué aux accords de T Rex. En écoutant «Queen Of The Damned», on croirait entendre «Ace Of Spades», c’est dire si c’est bon ! Même beat, même énergie, même pétaudière. Pour «Keep Your Power Dry», Lemmy met sa basse bien en avant dans le mix et ils finissent en apothéose avec «Paralyzed», un cut littéralement incendiaire, au cœur duquel Lemmy hurle Out of time/ We can’t win ! Oui, la mort approche.
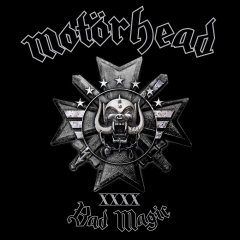
Snaggletooth se retrouve gravé dans une décoration militaire pour la pochette de «Bad Magic». Regardez-le bien, car c’est la dernière fois qu’il apparaît. On peut dire qu’on aura fait un sacré bout de chemin ensemble. Il faut aussi bien profiter de l’album car c’est le dernier. On aura du mal à l’accepter, tant on s’était habitué à aller chercher «le nouveau Motörhead» chez le marchand. C’était comme une routine, comme au temps des Cramps ou des Ramones. En tous les cas, l’album est solide. Lemmy lance «Victory Or Die» comme une attaque et distille ses textes chargés de toute l’horreur de la guerre. On retrouve le bon beat tendu motörisé dans «Thunder & Lightning», mais le beat se tend à se rompre. Dans «Shoot Out All Your Lights», Mikkey Dee refait le con avec sa pédale à ressorts. Lemmy lance un nouvel assaut - Fight fight/ We fight all light - Et Phil coule un petit solo aigre. Lemmy est toujours aussi fasciné par ce qui se passe dans la cervelle du soudard qu’on envoie raser une ville et ses habitants. Il revient ensuite à ses chères professions de foi avec «Electricity» - Electricity deep in your soul - Lemmy s’affirme, il l’aura fait toute sa vie. Il revient de l’autre côté à l’expression de la pure violence barbare, avec «Teach Them How To Bleed», monté sur un gros beat d’évocation guerrière. Il en rajoute une caisse avec «Tell Me Who To Kill», il n’en finit plus de vouloir dessouder dans tous les coins, et son fidèle lieutenant Phil riffe derrière comme un damné. Cette dernière face est noire comme la mort, le «Chocking On Your Screams» fout vraiment la trouille - We all came to watch you/ To watch you die - Lemmy raconte qu’il vient d’une autre planète pour nettoyer la nôtre. Et l’album se termine sur un coup de génie, ce qui n’a rien de surprenant, finalement.
Eh oui, Lemmy ne savait pas qu’il allait tirer sa révérence aussi vite, et donc, le dernier morceau de son ultime album est une sorte d’adieu, et pas n’importe quel adieu, puisqu’il s’agit d’une reprise de «Sympathy For The Devil». C’est une version hallucinante. Phil joue en vrille et il va même jusqu’à wha-whater. Lemmy chante différemment de Jagger, c’est sûr, mais ce texte lui va mieux, c’est même du sur-mesure, car Lemmy semble avoir été de tous les combats et surtout de toutes les diableries.
On se demande ce que Phil Campbell, Mikkey Dee et Snaggletooth vont devenir. C’est un monde qui s’écroule et qui disparaît, l’un des plus riches et des plus vitaux de l’histoire du rock. On essaiera de se consoler en revoyant notre vieux héros et sa gigantesque collection de dagues SS dans «Lemmy», le film que Wes Orshoski lui a consacré en 2010.
Signé : Cazengler, Amatörhead
Motörhead. Motörhead. Chiswick Records 1977
Motörhead. Bomber. Bronze Records 1979
Motörhead. Overkill. Bronze Records 1979
Motörhead. On Parole. United Artists Records 1979
Motörhead. Ace Of Spades. Bronze Records 1980
Motörhead. No Sleep Till Hammersmith. Bronze Records 1981
Motörhead. Iron Fist. Bronze Records 1982
Motörhead. Another Perfct Day. Bronze Records 1983
Motörhead. Orgasmatron. GWR Records 1986
Motörhead. Rock ‘N’ Roll. GWR Records 1987
Motörhead. 1916. Epic 1991
Motörhead. March Or Die. Epic 1992
Motörhead. Bastards. ZYX Music 1993
Motörhead. Sacrifice. Steamhammer 1995
Motörhead. Overnight Sensation. Steamhammer 1996
Motörhead. Snake Bite Love. Steamhammer 1998
Motörhead. We Are Motörhead. Steamhammer 2000
Motörhead. Hammered. Steamhammer 2002
Motörhead. Inferno. Steamhammer 2004
Motörhead. Kiss Of Death. Steamhammer 2006
Motörhead. Motörizer. Steamhammer 2008
Motörhead. The Wörld Is Yours. Motörhead Music 2010
Motörhead. Aftershock. Motörhead Music 2013
Motörhead. Bad Magic. Motörhead Music 2015
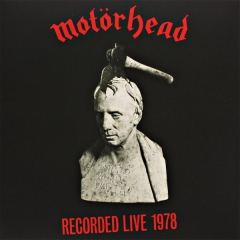
Motörhead. Recorded Live 1978. Ace Records 1983
BLOODSHOTT BILL & SUBWAY COWBOYS
Un petit mot de Will Drifter la voix orgiaque des Subway Cowboys : « je viens de lire le papier Bloodshott Bill. Si, si, il peut être le roi d'une soirée, et ce sont The Subway Cowboys qui vont faire sa première partie à la GAM de Creil le samedi 5 mars 2016! »
Vous avez compris le message : tout malheureux qui ne sera pas présent à Creil le 05 mars, sera condamné à errer éternellement dans les couloirs du métro sans jamais entendre ni Les Subway Cowboys, des honky tonkers de première classe comme l'on n'en fait plus, ni Bloodshott Bill à qui la semaine précédente notre Cat Zengler préféré a tressé de césariennes et rockabilliennes couronnes de laurier.
18 / 12 / 2015 / LE CHAUDRON
LE MEE-SUR-SEINE
KLONE / KLAUSTROPHOBIA
LEAVING PASSENGER
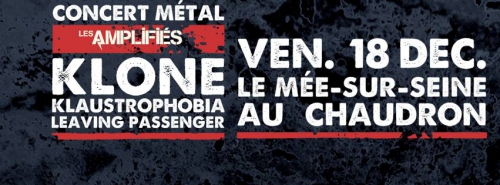
Je possède quelques défauts. Cette première phrase par pure coquetterie et hypocrite modestie. Un rocker est toujours parfait. Ainsi, au contraire de la plupart de mes tristes contemporains je puis me vanter d'une très rare qualité, je suis klaustrophile. Les claustrophobes me font horreur. Aussi n'ai-je pas hésité lorsque je me suis aperçu que Klaustrophobia passait au Mée-sur-Seine, ce vendredi soir. Jugez de mon héroïsme puisque sur la courte notice dévolue aux trois groupes, l'on citait Pink Floyd comme source d'inspiration pour Klone, la tête d'affiche.
Première fois que la teuf-teuf traînait ses pneus au Mée-sur-Seine. Joyeuse cité collée à Melun. Je précise : un labyrinthe infini de cités hachéméliques réservées aux couches populaires. Au moins l'on est sûr que ces hordes barbares n'envahiront pas le centre ville de la préfecture de la Seine & Marne. The rigth thing at the right place et les pauvres seront bien gardés. Je demande par deux fois mon chemin, une chose est certaine, le Chaudron est connu, et à voir les sourires qui illuminent les juvéniles figures, bénéficie d'une aura positive.

Pas très visible, un bâtiment parmi tant d'autres avec entrée latérale plutôt étroite. La partie réservée au concert est assez modeste, le Chaudron est aussi un centre d'activités variées et sociales. Salle d'accueil avec bar, et table vente de disques et T-shirts de Klone, descendez les escaliers pour accéder au Saint des Saints. Vaudrait mieux être nyctalope, aussi noir qu'un fond de chaudron culotté par soixante années de cuissons infernales, vous devez pouvoir y faire mariner deux cents personnes en position debout, pour le moment nous sommes une dizaine à errer lamentablement, quatre jeunes gens occupent la scène et semblent s'apprêter à faire la balance. Le temps de remonter inspecter la discographie de Klone me dis-je, et tout de go je me dirige vers les marches.
Un éclat de guitare retentit derrière mon dos, une jeune excitée se précipite vers l'entrée que je n'ai pas encore franchie : « Dépêchez-vous, ça commence ! » et Yuki – la chanteuse de Klaustrophobia – pénètre en force dans la salle entraînant dans son sillage toute une flopée de jeunes gens hirsutes, revêtus de ces T-shirts démoniaques qui font la joie des hard-rockers. Vingt heures pile, les Leaving Passengers ouvrent le bal.
LEAVING PASSENGER
Les passagers sont jeunes. Ceci n'est pas un reproche. Ce n'est pas obligatoire, mais dans le rock, malgré la vénération et la tendresse que l'on porte à certains vieux briscards, la fougue de la jeunesse reste une denrée de base indispensable. Quant à l'expérience contrairement à ce que prétend l'exigence des propositions d'embauche, vaut mieux l'avoir devant soi, que derrière. Le groupe s'est formé en 2014. Trio de base et Julien au micro.

Scream et Over & Over pour commencer. Bien en place. Musique forte et lente. Pas tout à fait du hard mélodique mais de l'appuyé qui vous pénètre la peau comme un tatouage interne. Chante bien Julien, à pleine voix et avec le volume de sons que produisent ses comparses, faut assurer. C'est que Vince à la batterie, PC à la guitare et Jumar à la guitare poussent fort dans son dos.
Lies On et Running Back, dans le public on apprécie de plus en plus, ça dodeline de la tête, les Passenger nous emportent sur leurs ailes. Du lourd qui vole. Majesté de l'albatros qui se laisse entraîner par les courants souverains.
Wid et IDC, mine de rien dans la carlingue l'on a ouvert le gros tuyau de kérosène, les Passenger prennent de la vitesse. Et tout le monde apprécie. Clap de fin brutale. Le voyage est terminé. On serait bien partis pour une autre croisière, mais non, même pas un rappel. La boîte de chocolat qui vous passe sous le nez et qui ne reviendra pas. Contentez-vous de votre mini-portion, et ne jouez pas les enfants gâtés et capricieux.
Nous ont laissé un bon goût de revenez-y, les Leaving Passenger, on espère les revoir sur une plus longue distance. Prometteurs.

L'association des Amplifiés qui a organisé le concert devrait revoir le découpage chronologique, ce soir trop frustrant. D'autant plus qu'à vingt-trois heures, tout sera terminé. Les nuits des Amplifiés sont-elles plus courtes que les nôtres ?
KLAUSTROPHOBIA
La guitare de Zivan nous maltraite les oreilles. Sur sa basse Alexis nous offre quelques roucoulades de brontosaures énamourés, à la batterie Mickaël attend placidement que les ébats sauvages aient besoin de renfort, mais bientôt n'y tenant plus il se jette dans la mêlée sans tarder. Avec les Klaustro vous n'avez pas besoin de sonotone. Oui mais il manque un petit quelque chose. Presque rien. On a l'avion, mais pas la bombe atomique qui marche avec. Impatience dans le public agglutiné sur le devant de la scène. D'ailleurs une voix stridente parvient à dominer le carnage sonore « Et Yuki ? ». C'est ainsi, l'Homme est un éternel insatisfait, offrez-lui une tempête, il quémande un ouragan. Un vrai, qui soulève sa maison, emporte le toit et éparpille les murs aux quatre coins de l'horizon.

Trois secondes d'attente et la dénommée Yuki bondit sur le micro. Dans son espèce de pull à grosse maille tout mouillé, elle ne doit pas dépasser les quarante kilos, la gringalète. Yeux noirs et cheveux noirs. Plumetés en queue de cheval. D'Attila, vous savez celui sous qui l'herbe ne repoussait pas, là où il avait posé ses sabots. Soyons clair, Yuki ne chante pas, elle glapit. Une espèce de meulement de trépan hideux qui s'efforcerait de vous forer la boîte crânienne. Un ricanement de hyène vorace qui serait en train de sucer les os de votre squelette. Une scie sauteuse qui vous découperait en tranches fines. Et tout de suite, malgré les avis contraires et les mises en garde des autorités médicales, vous vous sentez mieux. Ce n'est pas que vous étiez particulièrement malade avant, mais vous avez l'impression que les portes du paradis s'ouvrent en grand, juste pour vous. Douceur de miel et volupté extatique.
Bien sûr ce n'est qu'une impression. Du ressenti comme aiment à vous le préciser les psychiatres avant de vous envoyer à l'asile des lunatiques pour le restant de vos jours. C'est que le rock est une musique spécialement schizophrénique, côté jardin : sauvagerie des artistes, côté cour : ravissement du fan. Cent pour cent sado en amont et sang pour sang maso en aval. Yuki la grande prêtresse connaît les runes magiques, de quelques gestes démoniaques elle organise des pogos charivariques du meilleur cru. Sur ses injonction toute une jeunesse se rue sur elle-même, s'entremêle, sarabande et imbroglio dans tous les sens.

Remarquons que sur scène l'on ne reste pas inactifs, Zivan s'explique avec sa guitare, l'étrangle et la tord-boyaute jusqu'à ce qu'elle produise d'étranges borborygmes, Alexis nous raconte une messe noire sur sa basse rampante et lui fait réciter les litanies de Nyarlathotep, et Mickaël dompte et plombe sa batterie de coups de Jarnac et de Trafalgar. Le genre de pilonnage apocalyptique sur lequel Yuki virevolte avec l'empressement d'un ptérodactyle affamé. Panthère noire et chasseresse. Yeux de charbon et voix de braise. Péremptoire, lève la main et tout s'arrête, deux dixièmes de secondes avant qu'une nuée de gerfauts ne s'abattent sur vous pour vous rompre le cou.
Trois misérables quarts d'heure, mais un set de toute splendeur. Un moment d'éternité volé à l'enfer, promis à tous les rockers de ce bas monde empli de trop de médiocrité pour nous satisfaire. N'ayez crainte Klaustrophobia vous enferme dans le plus défenestrant des cauchemars. Klaustrophobia : meilleure sera la chute.
KLONE
Je ne m'en cache pas, pour moi le groupe de la soirée ce fut Klaustrophobia. Foutrement rock and roll. L'insolence de la jeunesse. Et la fougue foudre. Tout ce que j'aime, mais les rockers sont des âmes simples. Filez-leur du désherbant ou des amphétamines, pourvu que les bad vibrations soient assurées, ils sont heureux. Maintenant, je dois l'avouer Klone m'a scotché. Klonsthcé, touché, coulé. N'ayez crainte la mauvaise foi des rockers est insubmersible.

Sur les deux premiers morceaux, j'ai ricané. Après les giboulées de Klaustrophobia, ces deux trucs visqueux, une espèce de faux boogie prétentieux aussi pâteux qu'une plâtrée de nouilles, je rigolais. Pas swinguant. Swingluant. Moi qui ai vu Roger Waters et toute la clique en 1972, je trouvais cela très Bling Bling Floyd. Je ne sais pas ( et je ne crois pas ) qu'après les Klaustro ils aient éprouvé le besoin de bopper leur style pour ne pas trop déparer, mais quand ils ont abordé leur troisième opus, la donne a changé.
Cinq sur scène, Aldrick et Guillaume aux guitares, Florent aux drums, Jean-Etienne au chant, Yann au chant, et vraisemblablement Mathieu derrière à la console. La trentaine, plusieurs CD à leur actif, des tournées européennes, le Hellfest, une affaire qui tourne. De la bouteille. Pas à moitié vide, bien pleine.
Le hard est un serpent à deux têtes. Une fulgurante qui mord et pique, et l'autre qui compte sur ses anneaux pour vous étouffer avec lenteur. Métal et progressif. Parfois l'on dit rock et chiant. Klone joue dans la deuxième catégorie. Ont choisi la mauvaise tête de gondole. Oui, mais produit de luxe et biodégradable.
Klone est lent. Au galop des pur-sangs arabes il préfère la majesté des chevaux de parade. Lipizzan viennois, avec la forêt noire confite de cerises ( dans le gâteau ) et l'onctuosité de la crème chantilly. Klone a résolu la relativité einsteinienne du temps. Un morceau de cinq minutes ( montre en main ) de Klone est joué avec une telle lenteur qu'il en dure musicalement trois fois plus ( horloge intérieure en tête ). Mais psychologiquement parlant, il ne vous semblera pas excéder un rockabilly de cent dix secondes.

Klone c'est un orchestre. Avec un chanteur. Les uns bâtissent et dressent les murs. Et l'autre les couvre de fresques dantesques. Les uns envoûtent et l'autre ensorcèle. Vous tient au bout de sa voix. Attaché à ses cordes vocales. Pouvez plus vous en détacher. Fascinant. Aucune pose, aucun geste vaticinatoire, ne déclame pas, ne fait pas son cinéma. Ni muet, ni parlant. L'on se dit qu'il ne va pas tenir tout le concert. Non seulement il ne s'effondre pas, mais à la fin il nous donnera pas moins de trois rappels.
La voix nue. Et ne se prend pas pour un chanteur d'opéra qui barytonne à tue-tête, ni organe malencontreux de castrat, ni trilles volubiles de castafiore. Et pourtant derrière lui, on ne fait pas dans le mezzo-mezzo, la musique est d'une puissance redoutable. On ne peut pas dire que le tempo s'accélère mais il s'amplifie. L'on retrouve dans le parterre les mêmes bousculades qui ont accompagné le tumulte des Klaustro, comme si la charge cumulative de l'orchestre chargeait les protons des fans d'une énergie électrique insoutenable. Public conquis, Yann descend de scène et la foule se retire comme la mer d'Egypte au passage des Hébreux, haie d'honneur et de respect.

Klone subjugue. Sans aucune frime. Du feu mais pas les pompiers. Pas de solo à admirer, pas de prouesse instrumentale mise en avant, les musiciens sont ici au service de leur musique et non à celui de leur égo. Grandeur et simplicité. Pas de fanfaronnade, pas de pantalonnade. C'est beau comme un poème de Victor Hugo. Pas le Hugo romantique et frénétique, mais celui serein et implacable de la Légende des Siècles.
La salle est remplie de lycéens, pas obligatoirement les premiers de la classe, plutôt les énervés qui n'attendent rien du système, et tout le monde écoute avec ferveur ce qui n'empêche ni la fièvre ni le désir de s'éclater contre les vitres d'un monde trop étroit. Klone fait miroiter des étincellements qui réchauffent le sang ardent de l'imagination. Longue ovation finale.
RETOUR A LA MAISON
Minuit pile la Teuf-teuf me dépose à la maison. L'on ne s'est pas pressés. Les Amplifiés auraient tout de même pu rallonger le timing des deux premiers groupes... Je ne me suis pas beaucoup étendu sur les Leaving Passenger. Sans aucun doute parce que Klone a porté à la perfection le style dont ils commencent à maîtriser la première mise en équation.
Rencontré du beau monde, Phil qui prenait des photos et qui rédige des compte-rendus pour le site de hard Pavillon 666 ( sont une quarantaine dispatchés dans les six coins de l'hexagone ) et les membres de Fallen Eight chroniqués lors de leurs concerts aux 18 Marches... qui vont fermer car inaccessibles aux handicapés... Tous les prétextes sont mauvais pour museler le rock and roll. Pot de terre contre pot de taire.
L'EP de Klautrophobia est en retard, logique puisqu'il s'appelle Too Late, mais Fallen Eight organise une grande fête à l'Empreinte de Savigny le temple le vendredi 12 février avec Beast et Nakht... grandes réjouissances en perspective. Gardez le rockin' jusqu'à la prochaine fois.
Damie Chad.
( les superbes photos de Yuki, signées Lov sont d'un concert précédent )
BANDE ORIGINALE
ROB SHEFFIELD
( Le Livre de poche. 32091 / 2011 )
( Publié en 2007 aux USA )
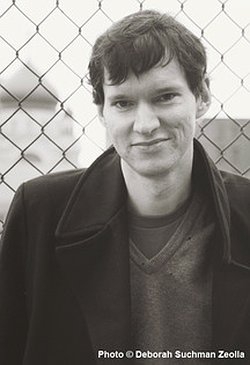
Rob Sheffield n'est pas un anonyme. L'est journaliste à Rolling Stone et a travaillé pour Spin et MTV. S'y connaît donc quelque peu en notre musique, même si son premier roman Bande Originale n'est pas à proprement parler un livre sur le rock and roll. Depuis l'en a écrit deux autres depuis aux titres moins engageants Talking To Girls with Duran Duran et Turn Around Bright Eyes : The Ritual of Love and Karaoke, mais comme nous le conseille Bo Diddley, You Can't Judge A Book Just Looking The Cover.
Deuxième livre d'un contributeur de Rolling Stone que nous chroniquons. Voir Un Long Silence in KR'TNT ! 48 du 15 / 04 / 2010. Mais que de différences entre le vécu de Mikal Gilmore et de Rob Sheffield ! Autant le premier évoquait la face sombre de l'Amérique, autant celui-ci participe de cet optimisme positiviste, ce simple bonheur de vivre, qui reste la vitrine la plus engageante de ce pays. Toutefois une histoire triste. A priori rien de spécialement rock and roll. Serait même tendance pop. Pourtant ce roman à l'instar d'Alphabet City d'Eleanor Henderson ( in KR'TNT ! 202 du 25 / 09 / 14 ) nous plonge dans l'amerloque quotidien d'une jeunesse à jamais touchée par le virus du rock and roll.
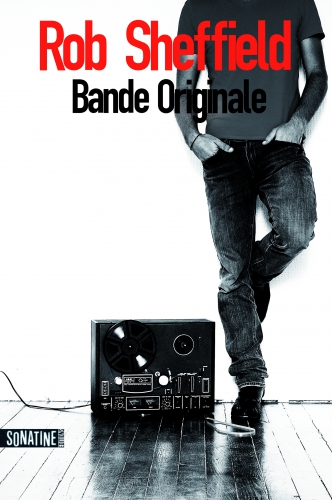
Rob Sheffield n'est pas un rebelle. Originaire de Boston, élevé dans un milieu catholique d'origine irlandaise, l'est un peu québlo dans son corps. Petit, il sert la messe en tant qu'enfant de choeur, plus grand il est étudiant à Charlostteville ( Virginie ). Le bon élève qui mettra du temps à se faire déniaiser par sa première copine... Une vie terne, inintéressante, sauvée par un amour immodéré pour le rock and roll. Et cette étrange manie d'enregistrer des quantités astronomiques de cassettes de ses morceaux préférés. Pour les écouter lui-même et les offrir à ses amis. Le plus étonnant de l'affaire reste que cette manière d'agir ne lui est point personnelle, elle est manifestement partagée par toute une génération. La K7 comme objet transactionnel de relation publique. Et plus, si affinités.
C'est par et grâce à la musique que Rob rencontre Renée. Nouvelle copine et bientôt épouse convolée en justes noces. Nos deux tourtereaux passent le plus clair de leur temps à enregistrer, se tapent des tapes à toutes les heures de la journée. Sinon ils mènent une vie de couple typique de l'américain moyen : bouffe grasse, I support my favorite base-ball team, promenades sans but en voiture, petits boulots, feuilletons et séries préférées on the TV, lecture de magazines, spécialement de couture pour la miss. Rien de bien affriolant. Même aux USA, tout le monde ne peut pas être serial killer ou agent secret de la CIA.

Dans son infinie clémence Dieu les a toutefois sauvés. Renée est DJ sur radio WTJV, et ils passent leurs soirées à assister aux concerts des groupes de rock locaux, produisent des articles pour des fanzines improbables, leur coup de maître sera une interview opérée par Renée des L 7 ( depuis que vous avez lu la chro de notre Cat Zengler préféré, in KR'TNT ! 256 du 19 / 11 / 15, vous n'ignorez rien de ces gentes damoiselles ). Tous deux se revendiquent de leur groupe préféré, Pavement.
Vivent le rock comme une donnée incontournable de leur quotidien. Un aliment de base. Indispensable et habituel. Ne lui attribuent aucune revendication provocatrice anti-sociale. Une attitude typiquement anglo-saxonne. Tant que l'on me laissera tranquille dans mon coin à écouter ce que j'aime, ce sera OK. Pas Corral. Ont bâti leur niche écologique de survie rock et n'en sortent point.
Restent les cassettes. Imaginez un film dont les images ne prennent sens que par la bande-son. Au début de chaque chapitre vous avez la photocopie de la set-list - Side A, Side B - qui se trouvait au dos des boîtiers. Qu'écoutent donc nos amoureux ? De tout. Et même mieux : tout. Du meilleur et du pire. De Dean Martin à Boy George. De Chuck Berry à Big Star. De Jerry Lou à Led Zeppelin. Plus les autres. Tous les autres. Leurs préférences vont au gros rock qui tâche, avec guitares sursaturées en avant. Beaucoup de groupes dont vous lirez le nom pour la première fois. Pas de jazz. Un peu de country. Du rock and roll, d'Elvis Presley à Pearl Jam. Sixties and seventies. Et les groupes de leur temps. Se définissent comme la génération grunge et s'adjugent le label punk. Pas les Pistols, ce que nous nommerions le post-punk, après X et Germ...
La romance pourrait durer longtemps, mais comme dans la première scène de Josey Wales Hors-la-loi, le bon dieu très méchant se dépêche de reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Une embolie fulgurante emporte Renée en moins d'une minute. Cinq ans de bonheur radiés d'un seul coup. La morte saison du chagrin commence... Rob Scheffield nous refait le coup de Love Story...
Ce n'est que dans les dernières pages du bouquin, à l'orée du troisième millénaire, alors qu'il tente de se construire une nouvelle existence, qu'il jette un regard rétrospectifs sur les nineties qui s'éloignent. La nostalgie est un des moteurs auxiliaires et essentiels du rock and roll. Le bon vieux temps de la jeunesse enfuie, le couplet est rabâché. L'époque était moins dure. Flottait un air de liberté qui a disparu avec le siècle. La société nouvelle s'opacifie. La condition féminine se standardise. Des femmes aussi extraordinaires que la Renée perdue ne possèdent plus un un même espace de liberté pour déployer leurs ailes. Ne le proclame pas ainsi mais le sous-entend fortement.
Gravissime. Mais ce n'est pas vraiment grave. Tant qu'il y aura du rock and roll, le rêve recommencera. Eternellement. Ils ont vu mourir l'idole de leur génération – Kurt Cobain – n'en ont pas été surpris, une sorte de non-évènement, tellement tout le monde l'attendait. Battait de l'aile depuis si longtemps que son suicide fut collectivement assumé. Quand votre groupe se nomme Nirvana, personne ne doute de votre vœu le plus cher. Pouvez franchir d'autres portes. Mais vous aurez beau faire, jamais vous ne passerez le seuil de votre deuil.
Rob est le veuf – l'inconsolé – el desdichado à la reine abolie. Il lui reste la tour du rock and roll. Indestructible. Le dernier refuge de la diagonale du fou. Une histoire d'amour triste comme un chien abandonné sur l'autoroute des vacances. Un des plus mélancoliques romans sur le rock and roll que je n'aie jamais lu.
Damie Chad.
ELVIS
LE HENANFF / CHANOINAT
( Jungle / Octobre 2015 )
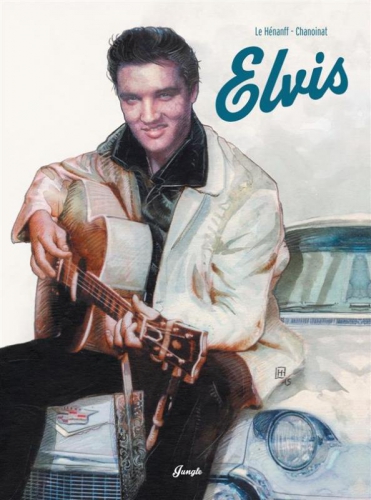
Etrange, aucun fan d'Elvis que je connaisse qui m'en ait parlé. L'est pourtant sorti depuis quatre mois. L'a fallu que ce soit le transistor qui me mette au courant. Pourtant c'est un grand format, du genre je ne passe pas inaperçu et je prends toute la place dans la vitrine. L e Henanff et Chanoinat, les amateurs de bandes dessinées connaissent ces deux corsaires. A eux deux, ils ont publié au moins une quarantaine d'albums. J'ai trouvé une bio de Chanoinat sur le net, un gars qui aime autant Marcel Proust qu'Eddie Cochran ne peut pas être tout à fait mauvais. L'a appris à écrire tout gamin en lisant Bob Morane – le genre de précepteur qui vous porte une ombre jaune sur le cerveau ad vitam aeternam - c'est donc lui qui s'est chargé du texte. C'est le Hénanff qui a dessiné. L'est aussi scénariste mais ses mots à lui, ce sont les couleurs. Un véritable peintre. Pas un rigolo.
Petit aparté. Toujours eu une tendresse particulière pour Mama Cass. J'aurais aimé qu'avec sa voix de fée elle vienne le soir me roucouler quelques berceuses à l'oreille pour m'endormir. Elle ne l'a jamais fait. Mais je ne lui en ai jamais voulu. Quand j'ai appris – ce devait être en juin dernier – que sortait une BD sur sa vie, me suis précipité. Hélas, douze fois hélas, on ne devrait pas dessiner quand on ne sait pas. L'ouvrage était d'une telle pauvreté graphique que je l'ai reposé, même que la libraire était d'accord, aussi effondrée que moi. J'avoue qu'avant d'avoir l'Elvis entre les mains, je craignais d'être déçu. Eh ! Bien non !
Si vous pensez apprendre quelque chose de neuf sur Elvis, passez votre chemin. Une simple biographie chronologique qui reprend les évènements - connus du monde entier – qui ont marqué la carrière du King. Chanoinat a su rester discret. Raconte vite et bien. Narration nerveuse. Un style sec et précis à la Mérimée, l'essentiel. Le nerf, ni la graisse, ni la chair. Pas de glamour, pas de scandale. Fait même l'impasse sur les terribles addictions finales de l'idole. Point pour en tracer un portrait propret et sans bavures, mais dans la sainte trilogie l'a fait le bon choix, sex and drugs c'est parfait, mais le plus important c'est tout de même le rock and roll. Et là vous en prenez plein les mirettes.
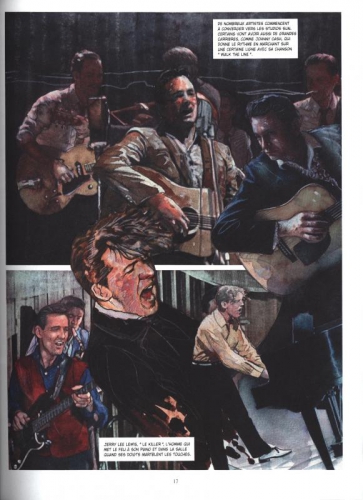
C'est que voyez-vous – et jamais je n'ai employé cette expression à si bon escient - il n'y a pas qu'Elvis Presley dans la vie. Et pour être plus précis, n'y avait pas que le hillbilly Cat dans les fifties. Alors il les convoque tous : Howlin' Wolf, BB King, Rufus Thomas, Arthur Crudup, Bill Monroe, Johnny Cash, Jerry Lou, Roy Orbison, Carl Perkins, Sonny Burgess, Billy Lee Riley, Charlie Feathers, Ronnie Self, Eddie Fontaine, Johnny Carroll, Ray Campi, Gene Vincent, Little Richard, Eddie Cochran, Chuck Berry, Ricky Nelson, Buddy Holly, Fats Domino, Johnny Burnette, Janis Martin, Wanda Jackson, cercle de craie et invocation diabolique, c'est Le Hénanff qui ressuscite les ombres et leur donne vie et couleurs. Un véritable portraitiste, les croque et c'est nous qui savourons. Une toile de maître pour chaque maître es rock and roll. De véritables images pieuses, inspirées à chaque fois de photos, d'affiches ou de pochettes de disques célèbres. Une re-création flamboyante. Pour un peu on en oublierait Elvis !
Mais non, l'est partout. Ses proches, famille, musiciens, Sam Phillips et le Colonel, et puis lui, le plus beau des félins, en scène, les micros, les attitudes, les filles qui hurlent, le tournage des films, les images défilent, pleine plages, des portraits de face, de profil, de haut, en contre-plongée, et des couleurs étonnantes, une dominante sombre mais avec des blancheurs, des douceurs et des teintes flashy-mat à vous brûler les yeux. Des turquoises de bleu, des roses opalescents, des bistres inconnus, des noirs irréductibles, des nuits maltées, des blancs de neige sale. Une symphonie cinématographique. Une beauté filmique qui reposerait sur le traitement énamouré des photographies de plateau.
Sait aussi disposer ses vignettes. Des mises en page qui décoiffent. Un art subtil du découpage. Un as des triptyques. Ne vous ennuie pas, vous surprend. L'arrive un moment où vous ne lisez plus, vous regardez, vous inspectez, vous étudiez, vous analysez. Vous êtes au musée et vous vous enfoncez dans le kaléidoscope mouvementé de la légende presleysienne.
A la fin de l'album, vous avez encore droit à un port-folio, des crayonnés, des prises de vue différentes, des fragments d'un autre montage, d'un autre découpage, d'une autre suggestion. Mais à la place de pénétrer dans la cuisine l'on aurait préféré que cet espace d'une quinzaine de pages ait été imparti au déploiement du scénario de base. Elvis l'aurait mérité. Tant d'épisodes auraient ainsi pu être évoqués. Tout ce qui concerne ses séjours en Californie pour prendre le premier exemple qui me passe par la tête.
Dans le genre de tentative Vie d'un rocker illustre, j'avais adoré le Gene Vincent de Rodolphe & Van Linthout mais l'on est encore dans quelque chose qui s'apparente à la bande dessinée classique. Une espèce de ligne claire électrifiée. Avec cet Elvis, nous sommes au-delà, au-del'art, s'apparente davantage à une oeuvre picturale qui par sa fluidité scripturale aurait intégré tous les codes du reportage de guerre. L'influence séminale de l'existence d'Elvis n'en finit pas de nous surprendre.
Un livre que tous les amoureux d'Elvis, et les passionnés de rock and roll se doivent de posséder.
Damie Chad.
BILLY LEE RILEY
FLYING SAUCERS ROCK AND ROLL
PEARLY LEE / GOT THE WATER BOILING / SWANEE ROCK AND ROLL / ROCK WITH ME BABY / OPEN THE DOOR RICHARD / RED HOT / FLYING SAUCERS ROCK'N'ROLL / I WANT YOU BABY / ROCK WITH ME BABY / COLLEGE MAN / THAT'S RIGHT / SEARCHIN' / ITCHY / NO NAME GIRL / WORKIN' ON THE RIVER / THUNDERBIRD / WOULDN'T YOU KNOW / LET'S TALK ABOUT US.
J'ai failli me faire assassiner. Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas cherché. J'ai le nom du coupable : Billy Lee Riley. L'a agi lâchement. Par procuration. C'est ma famille, le sang de mon sang, la chair de ma chair, qui voulait me trucider. J'étais en toute innocence en train de ré-appuyer, pour la quarante deux ou quarante troisième fois, avec l'émotion je ne sais plus, sur la touche repeat de mon lecteur CD lorsque je me suis vu assailli par une foule vociférante, menaçante et injurieuse. L'est tout de même étonnant qu'il existe encore en plein début du vingt et unième siècle des gens qui ne supportent pas Billy Lee Riley.
La matinée avait pourtant bien commencé. M'étais précipité chez Gérard mon bouquiniste préféré pour palier le manque absolu de nourriture sonore en mon habitation ariégeoise. En la contrée lointaine de l'Ariège, les seuls endroits où vous puissiez vous procurer de la musique potable, c'est uniquement sur les étalages des marchands de livres d'occasion. Doit y avoir trente ans que les ours et les loups ont dévoré le dernier disquaire.
Quand j'ai saisi le boîtier j'ai esquissé une moue de dépit. Zut ! Un reste des Génies du rock des Editions Atlas. Vous connaissez tous ces couvertures jaune-orangé qui souvent n'offrent que des compilations de titres mineurs ou ultra-connus d'artistes prestigieux, qui ne correspondent en rien aux présentations de la carrière de l'artiste sur le fascicule accompagnateur. Oui mais là, chez Atlas n'avaient rien dû trouver au rabais, se sont rabattus sur une licence Charly. Ils ont tapé vraisemblablement dans les albums de réédition The Legendary Sun Performers de 1977, le Sun Sound Special de 1979 et le double CD Red Hot de 1985 et peut-être pour ne pas trop se fatiguer dans le coffret de 3-CD paru en 1992, puisque la compil qui nous préoccupe est sorti en 1993.
Billy Lee Riley est une légende sonique. Et sunique. Fit partie de l'écurie Sun. Ne s'est pas contenté de chanter. L'a été un des piliers de l'équipe qui travaillait avec Jack Clement. Les deux lascars se connaissaient, avaient joué dans les Dixie Ramblers. L'avait tous les talents Billy, guitariste, pianiste, harmoniciste. On le retrouve en tant qu'accompagnateur sur de nombreux morceaux. Chez Sun et plus tard aussi, sera un session man recherché, de Dean Martin aux Beach Boys. L'on a coutume de s'apitoyer sur le sort de Billy. On accuse Sam Phillips, qui aurait préféré lancer la carrière de Jerry Lou et laissé volontairement de côté Lee Riley. Surtout en France où l'on adore les beautifull loosers.
Sam Phillips n'avait pas que des qualités. Ni les reins assez solides, ni l'entregent assez établi, pour pousser à la roue la dizaine des fous furieux de génie qui illuminaient son studio. Lui fallut faire son choix. Facile, un demi-siècle après de refaire l'histoire, qui pour Riley, qui pour Feathers, qui pour Warren Smith... L'on n'en parle peu mais entre Clement et Phillips malgré une confiance musicale et mutuelle de base devait s'opérer un partage des rôles. Dans l'âme du patron, Jack devait être le pôle propositionnel. Cherche et trouve-moi des petits gars qui balancent terrible comme je les aime, et moi Sam je serai le pivot optionnel, le boss qui décide en dernier ressort.
Maintenant à réécouter toute une journée ces enregistrements Sun de Billy, je comprends la préférence de Sam Phillips pour Jerry Lou. Je ne mets même pas en balance la qualité des deux artistes, l'est tout de même un aspect musical qui saute aux oreilles. Les petits hommes descendus de la soucoupe volante de Billy Lee Riley, z'ont beau s'être teints du plus vert le plus éclatant que vous puissiez trouver sur la planète rouge, ils ont l'âme aussi bleue que les noirs. Billy Lee Riley possède des racines bluesy trop facilement discernables. N'a pas trimé pour rien dans les plantations, ne s'est pas plus tard retrouvé chez Stax par hasard, n'a pas enregistré avec Wilson Pickett simplement parce qu'il était un bon musicien, l'a le feeling, la compréhension intuitive du blues. Ecoutez attentivement le phrasé de Billy dans Red Hot, n'est pas loin des arrachages sauvages à la Little Richard. Cette façon de dégobiller les lyrics en apnée totale, ces relances incroyables de couplets en accéléré. De l'équipe de Sun, l'est celui qui s'est débarrassé le plus rapidement, le plus facilement, le plus naturellement, de la coalescence country. Phillips n'était pas un adepte du western swing, recherchait un pêchon beaucoup plus urbain, cette rage rentrée qui habitait un Howlin' Wolf, c'est ce qu'il traquait chez les petits blancs. Maintenant fallait pas non plus exagérer. Fallait savoir rester sur la bonne rive du delta. Un pied à l'intérieur, mais pas les deux.
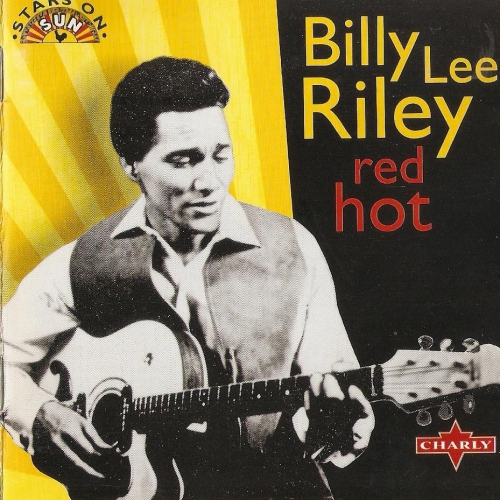
Si vous êtes encore en train de lire ce paragraphe c'est que vous êtes un brin ( je suis gentil ) stupides, puisque vous n'êtes pas en train d'écouter Pearly Lee de Billy Lee Riley. J'arrête là, je ne puis rien faire de plus pour assurer votre bonheur.
Damie Chad.
ERRATUM
Comme tout GSH, il m'arrive de commettre quelques erreurs. Rarement, je vous l'accorde. Mais par une fatale négligence j'ai glissé dans la chronique sur le concert d'Hayseed Dixie de notre Cat Zengler préféré, lors de notre 261° livraison, des photos inappropriées. Revoici donc cette chronique avec les bons clichés.
Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015
HAYSEED DIXIE
L'ACIDE DIXIT DES HAYSEED DIXIE

Gag ou pas gag ? Chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois, au temps où sonnaient les cloches de Jouahandeau. Pour un amateur de blind dates, ce groupe américain est une bénédiction. Les Hayseed Dixie ne jouent que des reprises qu’ils entraînent le plus souvent dans la ronde infernale du plus beau hillbilly des Appalaches. Sur scène, ils font absolument tout ce qu’il faut pour qu’on ne les prenne pas au sérieux, mais en contrepartie ils jouent comme des diables. Il n’est pas besoin d’être musicien pour comprendre que ces quatre mecs sont de très grosses pointures, comme on dit chez les cordonniers.
À une autre époque, on avait découvert Th’ Legendary Shack Shakers à la Boule Noire, et ce soir-là, nous n’étions qu’une petite vingtaine de personnes rassemblées au pied de la scène pour admirer le numéro de cirque de JD Wilkes et de ses copains du Kentucky. Leur numéro consistait à slapper le fameux southern gothic dont on trouve les racines dans les romans de William Faulkner et d’Erskine Caldwell. Les Shakers allaient beaucoup plus loin que les groupes de country-punk, car ils dynamitaient leur son à coups d’harmo et de banjo. Ils dégageaient un souffle extraordinaire qui pouvait ressembler à celui de la liberté absolue, telle que l’ont vécue leurs ancêtres les pionniers. Ces gens qui s’installèrent dans des terres inconnues échappèrent définitivement aux lois de la société et purent inventer les leurs. Ils ne le savaient pas, mais leur objectif qui était de cultiver quelques arpents de terre et de vivre libre cousinait sérieusement avec ce que les piratologues appellent l’utopie.
Les quatre pitres d’Hayseed Dixie vivent à Jackson, dans le Tennessee. Le nom du groupe est une déformation phonétique d’AC/DC, un groupe qu’ils semblent priser puisqu’ils ont déjà enregistré un tribute à AC/DC. Ils terminaient d’ailleurs leur set du 106 avec «Highway To Hell», ce qui n’était pas forcément une bonne idée, car dans leur tas de reprises, ils avaient des choses plus intéressantes, comme par exemple une reprise du Rapsody de Queen assez extraordinaire. On s’imagine que Queen reste intouchable à cause du chant de Freddy Mercury, mais ces gens-là sont suffisamment doués pour en proposer une version spectaculaire. On reconnaissait au passage des cuts célèbres, comme «Ace Of Spades», ou «Watching The Detectives» de l’endivaire Costello. Au moins, l’avantage du blind date, c’est que ça amuse les gens. Comme ces jeux télévisés auxquels on participe sans le vouloir quand il faut composer des mots avec des lettres. Pendant ce temps, on ne fait pas de conneries.

Hayseed Dixie était au 106 dans le cadre des Nuits de l’Alligator, pris en sandwich entre le grand Bloodshot Bill et les vaillants Heavy Trash. Ils surent tirer leur épingle du jeu car ils faillirent voler la vedette à Heavy Trash, grâce à une reprise du thème de Délivrance. Et là on ne rigole plus, car on entre de plain pied dans cette mythologie réactivée jadis par Martin Boorman, celle d’un Deep South sauvage et désertique où rôdent encore des trappeurs édentés. Ces fantômes ne portent plus la fameuse coiffe en fourrure de Davy Crockett, mais des casquettes.

Tout l’univers malade jadis décrit par Faulkner rejaillit de façon spectaculaire dans ce film et tous ceux et celles qui l’ont vu en ont été marqué à jamais. Pas uniquement par les quelques scènes de violence, mais peut-être plus sûrement par cette rencontre dans une cabane au bord du fleuve entre un gosse dégénéré et un type civilisé qui voyant un banjo dans les mains du gosse tente de nouer un dialogue en jouant un thème sur sa guitare. Le gosse l’entend et le rejoue à l’oreille sur son banjo. Alors le civilisé joue une variante et le gosse la reprend immédiatement. C’est là que la magie se produit. Les deux instrumentistes accélèrent le tempo et ça donne «Banjo Duelling». Avec cette séquence, Boorman fait de l’universalisme, la science de tous les rêves impossibles de connexion entre les êtres.

Il semble que la musique soit le seul moyen d’établir cette connexion. Et quand les Hayseed Dixie attaquent ce thème devenu mythique, on ne peut que se prosterner. D’autant qu’ils sont quatre à pouvoir le jouer. Mais c’est Johnny Butten qui mène forcément le bal sur son banjo. Ça pourrait tourner au cliché, mais non, car c’est joué dans les règles de l’art. Et à part eux, qui est capable de jouer le thème de Délivrance ?

Même dans ses rêves les plus fous, Gram Parsons n’aurait jamais imaginé qu’une telle équipe puisse un jour incarner l’Americana. Le chanteur John Wheeler ressemble à un prof d’histoire-géo en vacances en club Med, Jake Byers qui joue sur une grosse basse acoustique se déguise en clown trash-metaller, Joe Hymas qui gratte une mandoline fait le hippie dans sa salopette et le seul qui ne semble pas faire le clown en se déguisant, c’est Johnny Butten avec son banjo et sa casquette de trappeur édenté. Leur set est un mélange assez explosif d’auto-dérision, de talent, d’énergie, de virtuosité et de wild americana.
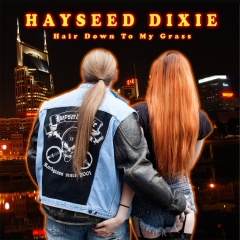
Ils profitaient de cette tournée pour faire la promo de leur nouvel album, «Hair Down To My Grass». Ils proposent une série de reprises pas toujours du meilleur goût, mais on les écoute pour se régaler des parties de banjo de l’ami Butten. Tout est emmené à l’énergie des Appalaches. Le problème est qu’ils reprennent des morceaux de groupes qu’on ne connaît pas forcément, comme Journey, Survivor, les Scorpions ou Pink Floyd. Mais partout règne une sorte d’excellence d’allant et ces quatre mecs astiquent leur beat avec une incroyable frénésie. On tombe sur un vieux coucou comme «The Final Countdown» qui incarne tout ce qu’on a pu détester dans les années 80, mais ils en font un truc nouveau, joué au violon gras de Stephane Grapelli et monté à la pompe manouche, alors ça devient intéressant, d’autant que l’ami Butten vient gratter son banjo du diable. Il joue terriblement vite et reste miraculeusement dans les clous d’une énergie dévoyée. On trouve aussi sur cet album une reprise salée de «We Are The Road Crew» de Motörhead. Banjo man y entreprend une cavalcade hallucinée. Le banjo, lorsqu’il est bien joué, donne toujours une image de la virtuosité excessive. Quand on demande à Johnny Butten d’où il sort sa virtuosité, il répond tout simplement qu’il a appris à jouer du banjo at the age of nine. Pour le «Comfortably Numb» du Pink Floyd, Banjo man refait un véritable festival et semble même crever le mur du son avec un indicible smash énergétique. Il sort le son de la vie, le banjo éclate dans le supersonic rocket-shout. Aucune guitare électrique ne peut rivaliser avec cette frénésie extravagante. Ils bouclent cet album avec «Don’t Fear The Reaper» du Blue Oyster Cult. C’est une fois de plus joué au violon gras et vrillé par un wild drive de banjo sauvage des Appalaches. Banjo man reprend le thème de l’huître qui se prenait pour les Byrds et l’emmène cavaler à travers les plaines du Wyoming et du Dakota tagada, au vent d’allure chargé de parfums sauvages, narines dilatées, énergie de la vie primitive, cavalcade insensée à travers les collines couvertes d’herbes hautes à perte de vue, yaooohh, le banjo bouillonne comme le sang dans les veines d’un homme libre.
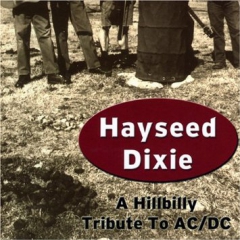
Cet album n’est que la partie visible de l’iceberg. Les Hayseed Dixie ont déjà enregistré une belle série d’albums et Banjo man vient tout juste de remplacer de frère de Joe Hymas, qui jouait bien, mais pas aussi vite que lui. On dit de Banjo man qu’il figure dans le livre Guinesss des records en tant que joueur de banjo le plus rapide du monde. Leur premier album fut un Tribute à AC/DC et même quand on n’apprécie pas vraiment le rock hurlé des Australiens, on écoute l’album des Hayseed avec un réel plaisir. John Wheeler s’impose comme un chanteur extraordinaire dès la première reprise qui est celle de «Highway To Hell». Ils transforment ensuite «You Shook Me All Night Long» en hit de cabane du Midwest. On se croirait dans «Les Portes du Paradis» de Cimino. Encore une belle mainmise avec «Dirty Deads Down Dirt Cheap». Wheeler chante comme un stentor avec un humour à fleur de peau, au milieu d’un véritable bombast d’instruments à cordes, le tout monté sur le tic tac de fond de la grosse basse acou. Il se peut que ce premier album reste leur meilleur album. Wheeler chante aussi «Hells Bells» à la force de la glotte, mais sans hurler, comme c’est le cas dans la version originale. Ils embarquent «Money Talks» au tourbillon des hillbillys. Ces mecs circulent dans les collines à train d’enfer et les solos d’acou sont d’une rare violence. John Wheeler va où le vent le porte. Nouvelle merveille avec «Have A Drink On Me», une petite aventure de bluegrass à la tabasse du beat. Ces mecs repartent inlassablement en patrouille. Ils ne craignent ni le diable, ni l’indien, ni les fauves, ni la mort. Voilà encore un cut fabuleusement fouillé aux violons et bardé de coups d’acou. Franchement on s’épate de tant d’énergie. Tous les groupes de rock devraient écouter cet album, car il renvoie une bonne image de ce que peut signifier le rock lorsqu’il est de bonne humeur. La version de «TNT» fera hennir les goths du coin de la rue, mais tant pis. Et ils repartent ventre à terre à coups d’acou. Avec «Back In Black», John Wheeler fait un vrai numéro de cirque - Yes I’m back, well I’m back/ You know I’m back/ I’m back in black - Ce mec fait ce qu’il veut au chant. Il monte où il veut. Il aménage ses propres paliers et soudain, il emprunte un pont jazzé au slap étrangement fantastique et il revient en envoyant des coups d’acou terribles. Leur énergie nous soûle. Avec «Big Balls», John Wheeler fait l’éloge de ses big balls - I got big balls, she got big balls - et sa voix puissante porte jusqu’à l’horizon.
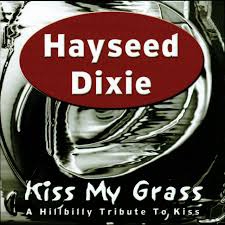
Après le Tribute à AC/DC, ils passent au Tribute à Kiss. Eh oui, ce sont des Américains, et le goût des Américains en matière de musique fait souvent l’objet de bien des moqueries. Quand on écoute «Calling Dr Love», on ne reconnaît pas forcément les clowns de Kiss, car banjo et mandoline mènent la danse. Le truc des Hayseed marche à tous les coups, quelque soit le navet choisi. Ils jouent avec une telle énergie qu’on en redemande. Ils vont même réussir à mettre de la pompe manouche dans «Let’s Put The X In Sex» et la Banjo man d’alors part en vrille. Il transforment aussi «Lick It Up» en rock gitan. On assiste à une belle étude de croisement avec le banjo de Délivrance et soudain, ça part. Banjo man devient fou. S’ensuit un «I Love It Loud» que John Wheeler chante à l’admirabilité des choses. Cet album est particulièrement amusant, car les Hayseed transforment les cuts de Kiss en belles bourrées auvergnates. C’est de bonne guerre.
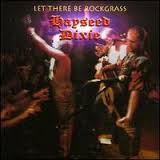
Leur fantastique reprise de «Ace Of Spades» se trouve sur l’album «Let There Be Rockgrass». Lemmy a dû jubiler en entendant ça. Banjo man joue à toute blinde. C’est le banjo du diable - The ace of spades ! The ace of spades ! - On y entend un effarant duel d’effarence entre le banjo et la mando. Ils sortent aussi une reprise de «Walk This Way» d’Aérosmith. Ils traitent le passage rap à la jew harp. Ils traquent le riff dans un coin et ils l’Appalachent sans pitié. Leur truc est sacrément bien ficelé. Autre reprise fumante, celle de «Centerfold» du J. Geils Band. Ce genre de groove leur va comme un gant. John Wheeler le bouffe tout cru, évidemment. L’autre grosse pièce de l’album est «Corn Liquor», emmené par une attaque de banjo démente. On sent la puissance du beat des Appalaches. Musicalement, le banjo reste aussi excitant qu’un bon drive de slap joué sur une stand-up.
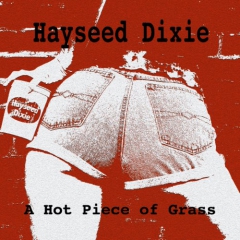
Leur version des «Duelling Banjos» se trouve sur l’album «A Hot Piece of Grass». Pure magie. Quand ça part, ça part en vrille. Ils jouent ce classique imparable comme des démons. Tout est emmené à la vitesse de l’éclair. Attention, ce n’est pas tout. Ils sortent aussi une fantastique version du «Black Dog» de Led Zep. John Wheeler fait son Robert Plant superbement et le banjo illumine le vieux souvenir de Led Zep. Autre bonne surprise : la reprise du «War Pigs» de Black Sabbath. Ils passent Sab à la casserole bluegrass. Il y a chez les Hayseed une énergie autrement plus diabolique que celle d’Ozzy et de ses comparses. Banjo man plante au cœur de «War Pigs» un solo de banjo terrible. Ils proposent aussi une version insidieuse de «Whole Lotta Love». Au chant, John Wheeler est dessus, pas de problème. Quand on dispose d’une vraie voix, on peut taper dans ce genre de vieux coucou sans risque. On trouve aussi dans «Roses» une merveilleuse échappée de banjo exacerbée. Voilà encore un cut larger than life. Les amateurs de bluegrass se régaleront de «Blind Beggar Breakdown», entièrement cavalé au banjo ventre à terre et doté de tous les apanages de l’ardente vélocité.
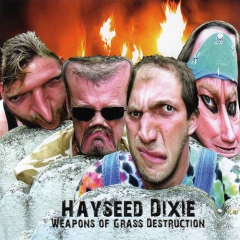
Ah il faut le voir pour le croire : une version du «Holiday In The Sun» des Pistols se niche sur l’album «Weapons Of Grass Destruction». Mais ils la ralentissent pour la rendre méconnaissable. Autre chef-d’œuvre iconoclaste : la reprise du «Strawberry Fields Forever» des Beatles. Décidément, ils ne reculent devant aucune expérience spirituelle. Ils prennent un tempo soutenu et ils utilisent des coups de banjo pour recréer les tons mauves de la vision psychédélique originelle. Leurs soudaines montées en température passent plutôt bien. En fait, ils adorent exploser les lieux communs du rock. Ils finissent d’allumer ce vieux coucou à coups de violon des Appalaches. Comme quoi, rien ne se perd, ni les choses, ni les âmes. L’autre gros coup de cet album est la reprise de «Down Down» des Status Quo. Ils renouent avec le boogie des seventies britanniques. Ils nagent dans l’eau glacée du temps comme des saumons d’Écosse. Et comme d’habitude, leur reprise se veut splendide d’énergie spécifique. Vu qu’ils tapaient dans les Beatles, ils se sentaient obligés de taper dans les Stones. Alors voilà qu’ils reprennent «Paint It Black». Oh, ils sont dessus, comme des sangsues sur les jambes du Capitaine Wyatt. Mais on se régalera surtout de «Hangover Breakdown», joué à la culbute de banjo et pulsé au crash-boum du double carburateur.
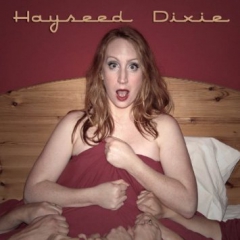
Histoire de dérouter encore plus les curieux, ils firent paraître en 2008 un album SANS reprises intitulé «No Covers». Curieusement, quand ils ne jouent plus de reprises, ça marche beaucoup moins bien. John Wheeler et ses amis composent des petits boogies insignifiants et tout rentre dans l’ordre. Avec «Born To Die In France», Wheeler raconte l’histoire de grand grand-daddy from the First World War. Et lorsqu’ils attaquent «You’ve Got Me All Wrong Baby», ils se prennent carrément pour un gang de power rock. Le pire c’est que ça marche. À force d’écouter les poids lourds du rock FM, ils se prennent eux-mêmes pour des poids lourds. Phénomène purement américain. Ils s’amusent comme des gosses, ne l’oublions jamais.
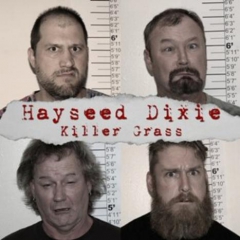
La belle version de «Bohemian Rhapsody» qu’ils jouent en concert se trouve sur l’album «Killer Grass» paru en 2010. John Wheeler lui shoote un énorme boost de rift dans le cul. Ils reviennent à Black Sabbath avec une fastueuse reprise de «Sabbath Bloody Sabbath» embarquée au banjo. Ça vaut tout l’or du monde. On y retrouve l’esprit enlevé, ce goût pour les cavalcades infernales au pied des Rocheuses, au temps où les amortisseurs n’existaient pas encore. Ils enchaînent avec une reprise de «Won’t Get Fooled Again». Le banjo imite l’intro de synthé et ça part sur un beat de basse acou. John Wheeler fait un véritable festival, il bouffe Daltrey tout cru. Comme le duc de Guise, il mène le combat à sa guise. Quand on entend le solo de banjo, on réalise soudain que ces gens-là ne sont pas du genre à s’embarrasser avec les détails. Mais la bonne surprise se trouve sur le deuxième disque de l’album qui est un DVD. On les voit faire le cons dans quelques clips rigolos, et le clou du spectacle, c’est la leçon dans banjo filmée dans le jardin. On y voit les deux frères Hymas jouer sur un banjo : l’un gratte les cordes et l’autre les pince. Puis, Jake Byers vient donner un cours de basse acou. On le voit jouer ses mesures de pompe à sec et c’est assez fascinant. Ce mec joue admirablement bien. John Wheeler vient ensuite pincer les cordes que gratte Byers. Et ils finissent à quatre, offrant le spectacle d’un hallucinant groupe de surdoués. On voit aussi Byers filmé dans la forêt pour un Tutorial : comment enterrer un body dans la forêt. On se croirait chez John Waters. Puis on revient à la magie pure avec un autre Tutorial : comment jouer «Duelling Banjos» avec un joueur de bongo africain. On se prosterne, comme devant l’apparition du prophète.
Signé : Cazengler, AC KC
Hayseed Dixie. Au 106, Rouen. 26 février 2015
Hayseed Dixie. A Hillbilly Tribute To AC/DC. Dualtone Records 2001
Hayseed Dixie. Kiss My Grass. A Hillbilly Tribute To Kiss.
Hayseed Dixie. Let There Be Rockgrass. Cooking Vinyl 2004
Hayseed Dixie. A Hot Piece Of Grass. Cooking Vinyl 2005
Hayseed Dixie. Weapons Of Grass Destruction. Cooking Vinyl 2007
Hayseed Dixie. No Covers. Cooking Vinyl 2008
Hayseed Dixie. Killer Grass. Cooking Vinyl 2010
Hayseed Dixie. Hair Down To My Grass. Hayseed Dixie Records 2015
De gauche à droite sur l’illustration : Joe Hymas, John Wheeler, Jake Byers et Johnny Butten.
22:06 | Lien permanent | Commentaires (0)