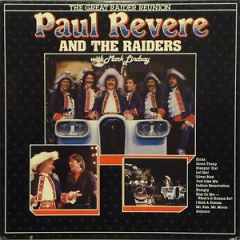01/04/2015
KR'TNT ! ¤ 229. CARL DA SILVA / ERVIN TRAVIS / PAUL REVERE / K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS / ELMORE JAMES / ARTISTE EN PRISON / VIOL COLLECTIF
KR'TNT ! ¤ 229
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
03 / 04 / 2015
|
CARL IS GONE / ERVIN TRAVIS / PAUL REVERE / ELMORE JAMES / K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS ARTISTE EN PRISON / VIOL COLLECTIF |
|
CARL DA SILVA des RHYTHM ALL STARS vient de partir tout seul, comme un grand... En hommage à ce magnifique rocker nous republions un article de Cat Zengler paru dans notre livraison 151 le 04 / 07 / 2013 |
DEUXIEME ROCK'N'ROLL AFTERNOON
CREPY – en – VALOIS / 06 – 06 – 2010
CARL AND THE RHYTHM ALL STARS
( OS ) CARL WILD

Trois ans déjà ! C'est en 2010 que nous avons pour la première fois croisé le chemin de Carl and the Rhythm All Stars. Ils se produisaient sur la petite scène d'une fête rock'n'roll organisée à Crépy-en-Valois, une charmante bourgade située au Nord de Paris. Un trio venu de Hongrie, the Mystery Gang, se pavanait en tête d'affiche. Les Red Cabs ouvraient le bal et Carl passait entre les deux.
Tous ces groupes jouaient en plein jour et en plein air, ce qui n'est jamais l'idéal. Nous avions ce que les météorologistes appellent un temps clément et Carl s'est pointé sur scène en chemisette hawaïenne. On s'attendait donc au set pépère d'un petit jazz-band de banlieue. Ce fut au contraire un set de pur rockabilly, farci d'hommages à Johnny Burnette.
Carl a toutes les cartes en main : le bon timbre, la présence scénique, le jeu de jambes burnettien et l'épilepsie rockab. Il sait se rouler par terre au bon moment, et quand on le voit faire, on se demande vraiment pourquoi les autres ne le font pas. Il y a dans l'essence même du rockabilly une pointe de folie et quand on voit Carl se jeter à terre et piquer sa crise, on voit qu'il l'a parfaitement intégrée. Il est le wild cat par excellence. Il doit être l'un des ultimes boppers sauvages, au sens noble du terme, puisqu'on parle ici de lignée.
Son set sur scène est excellent, c'est même du très haut de gamme, mais ses deux albums emportent tout : les barrages, les a-priori, les moues, les critiques, les poncifs, les clichés, rien ne saurait leur résister. On se plaint du manque de bons disques en France. Petit conseil d'ami, écoutez les deux albums de Carl & the Rhythm All Stars et vous allez danser comme un ours devant les enceintes de votre stéréo, je vous le garantis.

Mettez le premier album dans votre lecteur : «Music To Live». Vous allez voir, dès l'intro de «Don't Stay Alone», Carl beugle comme la victime d'un arracheur de dents. Il jette tout son poids dans la balance. Il se met les tripes à l'air. Il se met en pétard. Il met dans le mille. Il met le paquet. Il met toute la sauce. Il met tout ce que vous voulez mais en attendant, ça bouge. Il laisse sa voix dérailler. Son backing-band est à la hauteur, une vraie bande de sauvages. Comme on dit sur les circuits de cross, ça bourre pleins gaz. Carl ne vous prend pas en traître. Il annonce la couleur : ça va chauffer, les gars.
Pourtant, on ne croirait pas en voyant la pochette. Ils ont l'air bien sages tous les quatre, avec leurs cols de chemises bien à plat sur les revers des vestes. Ils sont bien peignés et souriants comme des représentants de commerce. Carl tient sa guitare comme Johnny Cash, manche pointé vers le sol, et donc on pourrait s'attendre à entendre de la country.
Justement, le deux, «Cry Me A River» est du pur Johnny Cash, avec son backing tagada. Carl mord dans son texte avec un bel appétit. On revient au rockab pur et dur avec «Music To Live» qui donne son titre à l'album. Voilà ce qu'on appelle une petite sauterie slappée à mort. Vous aurez droit à un solo perlé et derrière vous les entendrez bopper comme au temps béni de Meteor. On se croirait vraiment de retour chez Lester Bihari. Attendez la fin du morceau et vous verrez Carl sortir du studio, traverser la rue et aller s'acheter un soda pour se rafraîchir la gorge. Il va aspirer une grande goulée d'air tiède avant de revenir se jeter dans la gueule du loup.
Moment fatidique. Carl rallume le brasier sacré avec «I'm Gone», l'incarnation suprême de la sauvagerie rockab. Il hurle comme un damné, Baby I'm gone !!! et il se roule par terre, agité de convulsions. L'instant est aussi hot, Bob, que la chatte sur un toit brûlant, et derrière, c'est strummé à la guitare, comme chez Warren Smith. Apocalyptique, comme dirait Nostradamus.
On revient au bop avec «Lovely Girl». Ces mecs sont des malades. Rien ne pourrait les calmer. Ils boppent le beat jusqu'à l'os de la stand-up bass et arrosent tout ça de riffages criminels. Ils prennent un malin plaisir à se lancer dans une cavalcade effrénée. Le jus du bop coule de ce disque comme de ce fruit trop mûr qu'on écrase entre les seins de la buraliste fellinienne.
Les bougres vont revenir à Johnny Cash avec le tagada de «Don't Cry Little Guitar». On ne peut pas leur en vouloir, il faut bien des zones de répit, car sinon, on ne tiendrait pas jusqu'au bout. Grand maître du hoquet sauvage, Carl verse dignement sa petite larme. On assiste à un magnifique festival d'arpèges. Ce morceau qu'on croyait insignifiant est en fait un brouet infernal. Carl chante comme une star. Une fois de plus, il met toute son énergie dans le chant. Profitez-en bien, car vous ne reverrez pas de sitôt un artiste de cette trempe.
Quand au bout de quelques morceaux, un disque se révèle aussi bon, je deviens fébrile et j'écoute encore plus attentivement. J'adore sentir ma petite mâchoire se décrocher. Cloc. J'adore crier au génie. Youpi ! J'adore voir crépiter le feu sacré du rockab. Et avec Carl, on se sent en sécurité. Ce mec est parfaitement incapable d'enregistrer un mauvais morceau. Vous voulez parier ? Quatorze titre sur cet album et vous n'en trouverez pas un seul qui soit mauvais.
On se prend «For You» en pleine poire. Ces mecs ne connaissent pas le mot répit. Carl fait dans le sucré, dents de lapin, oh-oh ! Derrière, ils swinguent comme des bêtes. Arrive un solo clair avec son rigodon de notes perlées et oh-ho, Carl explore tous les registres de sa glotte avec une égale réussite et une infinie mansuétude. Comme Orville Nash, George Jones ou Charlie Rich, c'est un chanteur hors pair. Il avait sur scène cette incroyable facilité à poser sa voix. Je me souviens d'avoir cavalé, aussitôt après la fin de set, jusqu'au stand de Rocket, pour acheter ses albums, tellement ce mec m'avait impressionné. Et depuis, je n'ai jamais cessé de les écouter.
Avec «Saturday Night», les Rhythm All Stars nous font le coup du jump blues ultra boosté. Ils déploient cette énergie blanche qui balaie tout sur son passage. L'ami Carl enchante la piste des auto-tamponneuses, on se régale de l'écho bienfaiteur d'un soir de fête où my baby now traîne dans les parages. Oh oh, c'est magnifique d'ingénuité fiftique.
Mais il reste encore des genres à explorer. Avec «Come Back Baby», ils balancent un swamp rock tout vermoulu de primitivisme introverti. Carl hoquette comme Charlie Feathers. Un vrai diable. Avec «Sometimes», ils ouvrent sur un immense ciel bleu et boppent dans les coins. Ils reviennent au tagada avec «Travellin' Blues». Carl fait ce qu'il veut avec sa voix de stentor. En vérité, il nous balade et on adore ça. «Nobody's Guy» est allumé au riff. Encore une monstruosité primitive digne de Dot Records. Carl chante ça par en-dessous, comme s'il voulait se faire passer pour un fourbe et puis soudain il envoie la cavalerie. On se fait embarquer par le beat. C'est superbe et ça claque au vent. «My Mountain» est chanté dans le gras de la voix et on ferme le bal du samedi soir avec une reprise de Johnny Burnette, «Just One More Time», gros son bop montagneux, histoire de revoir une dernière fois l'écrasante majesté du rockab.
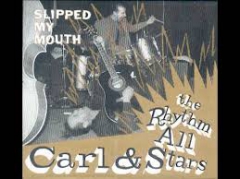
Un bon conseil, ne cherchez pas à écouter l'autre album («Slipped My Mouth») aussitôt après celui-là, surtout si vous avez les artères fragiles ou un souffle au cœur. Comprenez bien que Carl and the Rythm All Stars, ce n'est pas le Pink Flyod.
Admettons qu'une semaine se soit écoulée. Les feux de l'actualité auront nettoyé les esprits avec l'efficacité d'un lance-flammes. Vous aurez complètement oublié les turpitudes du rockab et son cortège de pulsions rachidiennes. Mais en passant devant la pile de disques, la seule vision de la pochette rallumera en vous un vieux réflexe libidineux. C'est avec un filet de bave aux lèvres que vous glisserez le second album de Carl dans le lecteur.
Et vous prendrez «Hot Song» en pleine poire, mais maintenant vous avez l'habitude. Comme dirait Gainsbarre, eau et gaz et frénésie à tous les étages. C'est une orgie de swing malade montée sur plaxmoll. Ils boppent comme ce n'est pas permis. Les slappeurs américains ont vraiment du souci à se faire. Même James Kirkland semble dépassé. Ils couronnent l'amplitude foutraque de ce bouillonnement juteux d'un joli riffage collatéral.
Ce second album est sur Wild records, et là on ne rigole plus. Ils sont allés l'enregistrer en Californie chez Reb Kennedy. Wild records est le dernier bastion californien du rockabilly. Pour ce second album, Carl n'a gardé que son batteur, Pedro Pena. Claude Placet a remplacé Bruno Longo à la guitare (c'est d'ailleurs Claude Placet qui jouait sur scène à Crépy en 2010) et Thibaut Chopin a remplacé Renaud Cans à la contrebasse.
«Too Much Loving» est encore plus pilonné que le Chemin des Dames en 1915. La sauvagerie rythmique dépasse les bornes. Franchement ils exagèrent. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'en rajouter. Le slap passe devant un beau strumming digne des sous-bois de l'Arkansas. Attention, ce morceau risque de vous slapper les neurones de façon irréversible. Carl se révèle le rockab le plus féroce de l'univers. À côté de lui, Jerry Lott (alias the Phantom) n'est qu'un enfant de chœur. Une férocité qui n'empêche pas le sérieux, car il tient les rennes de sa monture comme une star d'Hollywood.
Il chante «Slipped My Mouth» très haut, et on entend des clameurs dignes des milices confédérées jaillissant du bois. Solo break de folie pure et Youuuuihhhh ! Carl pose ses mots avec l'aplomb d'un délinquant juvénile du Tennessee. Et derrière, ça n'en finit plus de strummer. Comme le disque précédent, celui-là n'accorde aucun répit à l'auditeur. Carl embarque son monde et le seul moyen d'en réchapper, c'est de sauter en marche. À vos risques et périls.
Drumbeat d'intro et voilà «Gotta Go». En vrai pro, Carl mouille ses syllabes et plonge ses couplets dans le chaudron. Avec «Tell Me How», on passe à un registre plus jazzy. Ces mecs savent tout faire. On tombe à un moment sur un pont dément suivi d'une coulée de miel. Mine de rien, Carl et ses amis savent créer l'événement. Il sature son chant à fond et nous fait plonger dans le lagon vert d'Hawaï. Pur technicolor. De quoi faire baver Elvis.
Reprise de Bobby Wane, «Long Lean Baby» est un morceau beaucoup plus musclé, plus court sur pattes, plus râblé. On le sent prêt à en découdre. Il est stompé à la sauce bop. Merveilleuse tentative, digne de Ronnie Self, mais en vérité, c'est dix fois plus fin que du Ronnie Self. C'est même, comme le dit si bien Carl, de la dynamite !
«I'm A Man» est la énième resucée de «Folsom Prison Blues». Exceptionnellement, on passe l'éponge. Puis Carl remet le feu à la prairie avec «Really Movin'» et revient aux choses très sérieuses avec «Hello Rhythm», monstrueuse prouesse de vélocité slappée, émaillée de chorus précipités. En un mot comme en cent : épouvantablement bon. D'ailleurs, on ne s'en remet toujours pas.
Une nouvelle rasade de «I'm Gone», le véritable hit de Carl and the Rhythm All Stars, digne du «Tear It Up» des frères Burnette qui sont les héros de notre héros. Il boucle son affaire avec «Another Man» une balade trouée par des cris d'orfraie.
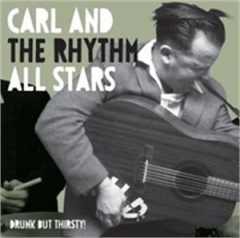
À la dernière minute, nous apprenons par une dépêche AFP qu'un troisième album de Carl & the Rhythm All Stars vient de sortir. Dans le bureau, tout le monde éclate de joie. Nous jetons tous nos chapeaux en l'air. Dehors, derrière les immenses baies vitrées du 60e étage, les gratte-ciels de Manhattan semblent danser le bop sous un soleil radieux.
Signé : Cazengler, le boppé du ciboulot
Carl & the Rhythm All Stars. Music to Live. Sfax records 2006
Carl & the Rhythm All Stars. Slipped My Mouth. Wild records 2008
Carl & the Rhythm All Stars. Drunk but Thirsty. Wild records 2013
ERVIN TRAVIS NEWS
Prochaine soirée de soutien à Ervin, ce samedi 4 avril, en région parisienne.

PAUL REVERE TIRE SA REVERENCE

Si on cherche des informations sur Paul Revere & the Raiders, ce n’est pas dans «Sonic Boom», l’histoire du Pacific Northwest signée Peter Blecha, qu’on va les trouver. Et pourtant, il n’existe pas d’endroit plus propice que celui-ci.
Il n’y a quasiment rien dans ce livre sur Paul Revere. La raison ? Sa vie ne présentait peut-être pas suffisamment de relief pour alimenter la plume d’un historiographe. Une fois de plus, l’analogie avec Auguste Renoir s’impose : l’auguste peintre laisse une œuvre considérable, à la fois qualitative et quantitative, mais son vécu fut tellement ordinaire que les mémorialistes d’alors n’avaient rien à se mettre sous la dent. Même chose avec le pauvre Paul Revere qui a cassé sa pipe en octobre dernier. La platitude de sa vie privée explique certainement l’absence d’hommages conséquents dans la presse musicale. Et pourtant, des hérauts bien rompus soufflent chaque mois dans leurs trompettes de belles oraisons funèbres.
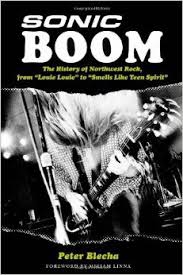
On ne retire du livre de Peter Blecha que deux bricoles. Un, c’est en voyant Jerry Lee sur scène quelque part dans l’Idaho que le jeune Paul vit son destin basculer et qu’il décida de devenir pianiste de rock. Deux, il avait un sens aigu des affaires, car à 18 ans, il était déjà propriétaire de trois salons de coiffure, qu’il revendit pour se porter acquéreur d’une grande salle de restaurant : il cherchait tout bêtement un endroit pour lancer Paul Revere & The Raiders, le groupe qu’il venait de former. Son principal exploit, hormis ses coups dans l’immobilier, fut de découvrir un chanteur en la personne de Mark Lindsay, le kid qui venait livrer le pain au restaurant pour le compte de la boulangerie McClure. Ça ne s’invente pas. D’ailleurs, on voit bien à sa mine que Paul Revere avait du plomb dans la tête. Il n’était pas du genre à tortiller du cul et à se faire plumer comme les Small Faces ou Jimi Hendrix. Il avait la physionomie archétypale du Yankee blond au regard clair des images d’Épinal, celui qui plisse les yeux pour mieux jauger ses semblables et dont l’éclatante blancheur de râtelier éblouit les femmes. Il se coiffait un peu comme un voyageur de commerce avec une raie sur le côté et sa psychologie se résumait à l’éclat de son sourire. Tout en lui sentait l’eau de toilette bon marché et le portefeuille bien garni. L’homme d’affaires chevronné l’emportait sur le rocker et bien sûr sa discographie était à l’avenant.
Une misérable info tendrait à consolider ce portrait inachevé : en 1967, trois des cinq membres du groupe alors en pleine ascension vers la gloire furent virés : Jim Valley, Phil Volk et Drake Levin. Licenciés sans préavis. Pour quelle faute ? Selon une rumeur pour le moins malveillante, Paul Revere les aurait surpris tous les trois à fumer du hash. Ça nous rappelle l’épisode de la visite d’Elvis à la Maison Blanche, lorsqu’il promet à Richard Nixon de l’aider à gagner la guerre contre les drogués. N’oublions jamais que les États-Unis d’Amérique constituent la plus grande réserve de conservateurs et de beaufs du monde - et par conséquent la plus grande réserve d’adolescents en révolte contre ce que Léo Ferré appelait l’Oppression.
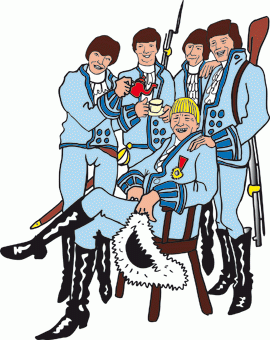
Mais si en Europe on s’intéresse aux disques de Paul Revere & The Raiders depuis des lustres, c’est parce qu’ils furent avec les Sonics et les Wailers d’admirables ambassadeurs d’une scène qu’on appelait au temps de sa splendeur le Pacific Northwest et dont l’origine remonte à 1957, l’année où Bobby Blue Bland, Junior Parker et les Upsetters de Little Richard ravageaient la contrée, mais ça remonte aussi à Richard Berry et à son single magique «Louie Louie» que réclamait le public chaque fois qu’il montait sur scène. TOUS les groupes locaux se mirent à jouer «Louie Louie», y compris les Raiders de 1963. Et tout le son Pacific Northwest vient de là, de ce mélange de pur raunch à la Little Richard et de saxophone, de distorse maximale et d’accords binaires. Le terrible blast des Sonics n’aurait jamais pu exister ailleurs. L’énergie fantastique de la scène grunge non plus. Au moment de l’apogée de Nirvana, un journaliste de Spin avait mené l’enquête, à savoir : pourquoi les groupes de la région de Seattle jouaient aussi fort ? Parce qu’ils devaient paraît-il couvrir le bruit produit par les souffleries de l’usine Boeing voisine. Le Rouletabille américain ajoutait que ces mecs hirsutes et mal coiffés jouaient de la guitare électrique parce qu’ils n’avaient pas le choix. Justement, ils ne voulaient pas passer leur vie dans ces fameuses usines Boeing ou dans les camps de bûcherons qui étaient les seules perspectives d’avenir dans la région. En 1965, les hurlements de Gerry Roslie étaient uniques au monde et ça, Billy Miller et Miriam Linna l’avaient bien compris. Car s’il en est deux qui ont œuvré pour soigner la mauvaise réputation de cette scène perdue au bout du monde, c’est-à-dire au Nord-Ouest des États-Unis, ce sont bien les deux fondateurs de Norton Records. Tout le monde le sait, les Sonics firent passer les Animals et les Stones pour des enfants de chœur, mais on ne le découvrit que beaucoup plus tard. Comme le dit Miriam Linna dans la préface qu’elle a donné à Blecha : «No geographical area of the US serves up such a readily identifiable heap of teenage blast better, faster or louder than the Pacific Northwest». Miriam sait de quoi elle parle : il n’a pas existé d’explosion adolescente plus forte et plus fulgurante et immédiatement reconnaissable que celle du Pacific Northwest. Elle ajoute qu’au cours de ces chaudes soirées de 1957 se déclara un incendie qui allait durer 50 ans - «fifty years of unstoppable, deliciously loud and frantic rock’n’roll.»
Les pochettes des albums de Paul Revere & The Raiders ne passaient pas inaperçues. Pour des raisons évidentes, Paul Revere avait converti ses collègues aux vertus du déguisement. Ils apparurent donc dans des uniformes de l’armée révolutionnaire américaine, celle qui arracha l’indépendance du pays aux Anglais, au XVIIIe siècle. À l’époque, on ne vit même pas le ridicule de leur dégaine, car ne comptait que le son. On peut bien dire que les Raiders furent de sacrés garagistes et que le succès de certains de leurs disques fut amplement mérité. Les Raiders de la première époque étaient des musiciens accomplis et la cerise sur le gâteau se nommait Mark Lindsay, fantastique chanteur du niveau de Dick Dodd ou de Jim Sohns.
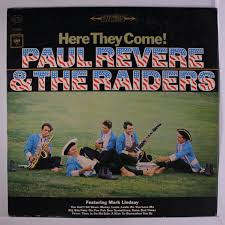
Lorsqu’on examine la pochette de «Here They Come», album paru en 1965, on voit immédiatement que les Raiders ne sortent pas d’une escarmouche avec les Anglais, ni d’un récit d’Hugo Pratt. Ils semblent plutôt participer à une kermesse. D’ailleurs, il ne leur manque que les paniers de pique-nique et les cruchons de cidre. Leurs titres sonnent encore très early-sixties, tout y est très cousu de fil blanc. Ils nous font une belle version de «Louie Louie», que Mark Lindsey introduit au sax. Et dans «Oo Poo Pah Doo», on l’entend screamer out of his brains. On découvre aussi en Drake Levin un guitariste exemplaire. C’est lui qui prend le solo dans ««Sometimes», un balladif superbe qui aurait très bien se retrouver sur le «Got Live If You Want It» des Stones. Mark Linsdey continue à faire des étincelles avec «Gone» où il sonne comme Freddy Mercury. Ils font une belle reprise des Stones, «Time Is On My Side». Bon d’accord, ce n’est pas la voix de Jagger, mais le son est beaucoup plus garage chez les Raiders que chez les Stones qui a cette époque commençaient à ravager l’Amérique.

Et là, en homme d’affaires avisé, Paul le boss va donner l’inflexion à la carrière du groupe qui devient très vite énorme. Whaaah ! Le boss Paul met le turbo. Les Raiders passent à la télé et trois albums sortent la même année, en 1966 : «Just Like Us», «Midnight Ride» et «The Spirit Of 67». Et pour les amateurs de garage, ces trois albums constituent une triplette de la mort du petit cheval. Ce sont des classiques imparables. Ils attaquent «Just Like Us» avec «Stepping Out» et ils sonnent comme les Shadows Of Knight, même pulsation délinquante. Sur «Doggone», Mark Lindsey chante du menton comme Dick Dodd des Standells. Et là, oh stupeur, on s’aperçoit que les autres savent aussi chanter ! Drake Levin prend le micro pour «Out Of Sight» une belle pièce de r’n’b. On a là un vrai white niggah. Quelle polyvalence, baby ! C’est carrément du James Brown. Et paf, on se prend une version de «Baby Please Don’t Go» dans la hure. Qui fait le Van Morrison ? Phil Volk, le bassman. N’allez surtout pas prendre les Raiders pour des branleurs ! Et la fête se poursuit en face B avec «Just Like Me», pure perle de garage délinquant, aussi perfide que celles des Pretty Things, un hit ultime et exaspéré, claqué comme «Louie Louie». C’est l’un des hits garage les plus violents de l’histoire. Tout y est, le riff, la rage et la bave. Drake Levin chante une reprise du «Catch The Wind» de Donavan et il prend bien soin de tordre ses syllabes pour sonner comme Dylan. Puis c’est au tour de Mark Lindsay de faire sa Stonesy avec une reprise de «Satisfaction». Décidément, ces mecs sont assez complets, au moins autant que les Standells qui eux aussi sortaient de sacrées reprises (écoutez «The Hot Ones» et vous allez voir trente-six chandelles). Phil Volk prend «I’m Crying» des Animals. Ce mec impressionne, car après avoir fait le Van Morrison, il fait le Burdon. Wow, quel camaléon ! Il s’en sort avec les honneurs - Lemme cry - Il enroule sa bassline par derrière et le boss Paul joue le beau shuffle d’Alan Price. Tiens, justement, voilà Paul le boss au micro pour «New Orleans» - Down on Creshent street - mais il reste très classique. Nos amis finissent cet album terrible avec «Action» et cette fois ils font les Beach Boys.

On trouve d’autres belles pièces dans «Midnight Ride», comme «Kicks», l’un de leurs classiques. C’est de la pop joyeuse, sautillante, bourrée d’énergie, fraîche et rose comme une saucisse adolescente. Au dos, le mec qui rédige les notes dit que cet album est le «Rubber Soul» américain. Il exagère peut-être un peu. On sent nettement l’influence de Dylan dans «There’s Always Tomorrow». C’est Smitty le batteur qui chante du nez. Drôle de mélange, car c’est une structure dylanesque sur laquelle ils tartinent des chœurs californiens et un solo bien psyché, tout en arpèges psychopathiques. Ça pulse ! Ils passent du cauchemar psychomoteur voulu par Dylan aux déchirures de ciel voulues par Brian Wilson. Le mélange enivre. C’est un rare mix de tension et de bonheur. On trouve un peu plus loin une belle reprise des Monkees, «I’m Not Your Stepping Stone» : tout y est, la relance, la tension et le beat en escalier. En face B se nichent deux perles rares : «Get It On», pur jus de pop sixties tiré par un beat char à bœufs - Try try try until the day you die - Ils sont à leur aise sur ce genre de beat bien besogneux. Ils sont bien plus malsains que les Stones. Le solo putride constitue une véritable insulte à la médecine moderne. Et l’autre coup de Jarnac de l’album, c’est «Louie Go Home», garage sixties américain à l’état le plus pur, avec un chant perdu dans le Midwest et un nappage d’instruments squelettiques, le tout tenu par une ténacité digne de celle des pionniers. Leur garage reste bien groovy et terriblement insidieux, chargé des pires intentions - Wouaaahhh - Les Raiders sont très convaincus de leur prestige et ça s’entend. Quelques énormités sur «The Spirit Of 67», comme «Louise», la sœur de Louie. C’est débarbouillé par un Mark Lindsey pas loin des Pretty Things dans l’intention d’être mauvais et hargneux, avec la morve au nez. Stupéfiante reprise de «Hungry» en face B, un classique signé Barry Mann et Cynthia Weil. C’est du Brill grillé à la poêle à frire du Pacific Northwest - Hungry baby for a girl like you - Ils traitent ça sournoisement et avec une sauvagerie exemplaire. C’est là où Mark Lindsey révèle sa nature de shouter magnifique. C’est ce qu’on appelle un hit poundé. Et Smitty revient au chant pour «Our Candidate», garage pur jus. «The Great Airplane Strike» qui boucle l’album sonne tout simplement comme un classique des Stones.

Et hop on passe en 1967 et Paul Revere a viré les trois vrais garagistes du groupe. Le son va changer, même si Freddy Weller, Joe Jr et Charlie Coe sont de bons musiciens. Ils attaquent l’album «Revolution» avec «Him Or Me» l’un des plus grands hits des sixties, repris par les Groovies et David Gedge. C’est l’âge d’or de la pop américaine. Tout est dans la puissance mélodique. Mark Lindsey y fait des merveilles. Mais sur cet album, on sent une grosse influence des Beatles, comme dans «Reno», où ils s’adonnent à l’excellence d’une démarche imaginative. On les entend musarder. Mais l’album va être ruiné par des slowly but surely. «Gone Movin’ On» est d’une puissance spectorienne, avec la batterie devant et un fort parfum de Beach Boys Sound. On a là des envolées extraordinaires sur fond de trompettes mariachi. Il faut attendre la face B pour sauter en l’air. «I Had A Dream» sonne comme un hit pop. C’était probablement leur intention. Voilà un cut aussi bien balancé que ceux des Lovin’ Spoonful, bien monté aux harmonies vocales et à la décontraction emblématique. Toujours de la belle pop avec «Tighter», et une prod sophistiquée à la Terry Melcher. On ne peut qu’admirer cette californialisation du son. C’est indéniablement la musique des jours heureux. Mais on le voit bien, cet album est moins radical que les précédents.
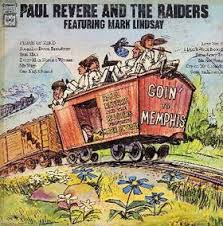
C’est en allant enregistrer un album à Memphis en 1968, que Paul Revere comptait enrayer le déclin de son entreprise. «Goin’ To Memphis» est avant tout un album de Mark Lindsay. Les Raiders passent directement à la bonne soul de familles et on tombe sur un «Every Man Needs A Woman» cuivré jusqu’à plus soif. Au dos de la pochette, Rufus Thomas, Isaac Hayes et David Porter donnent des coups de chapeau à tire-larigot. Oh, mais les Raiders sortent un Memphis Sound parfait. On savait qu’ils étaient de vrais caméléons, mais là, ils dépassent l’entendement. Mark Lindsay chante «My Way» comme un vrai soulman. Justement, ils reprennent le fameux «Soul Man» de Sam & Dave et ils tapent dans l’extraordinaireté des choses. Mark n’a rien à envier aux deux héros de Stax. Par contre, les coups de sax derrière lui ne sont pas bien en place. En face B, ils sortent un «I Don’t Want Nobody» effarant de pression soul. On croirait entendre chanter Edwin Starr. C’est dingue ce que Mark Lindsay peut aspirer à l’âpreté de la soul implorante. Il recherche l’intensité de tous les instants, et il la trouve, comme savent si bien le faire les grands artistes américains. «No Sad Songs» est encore une pièce vraiment digne de Sam & Dave. Ces gens-là savent trousser un hit soul et staxer la mémère. Ils n’ont aucun problème, ni du côté rhythm, ni du côté blues. Mark Lindsay force encore la sympathie avec le sidérant «Cry On My Shoulder» et il revient au heavy sound d’antan avec «Piece Of Mind», où l’on retrouve le bon gras des guitares. Ils bouclent avec un véritable hit de juke, «Goin’ To Memphis», admirablement ficelé, saxé, poundé et emballé.

Ils sortent la même année «Something Happening», un album beaucoup plus pop qui confirme l’inexorable déclin. On a toujours la même équipe (Joe Jr, Freddy Weller et Charlie Coe). Avec «Happening» ils sonnent un peu comme les Beatles, mais après ça se dégrade, car avec «Happens Every Day», ils parlent de candy store et se mettent à sonner comme les Herman Hermits. Ils pataugent dans la pop à pépère. Les pièces de gnognote se succèdent et un fort parfum d’ennui s’élève de la platine. Il faudra attendre «Communication» en face B pour se raccrocher la mâchoire. On retrouve enfin le mordant des Raiders. C’est même une sacrée belle pièce à espaces dilatés, à allers et retours, à redites emblématiques et autres débordements par la droite et par la gauche. On a là un bel alliage de hargne r’n’b et de pulsions psyché mal maîtrisées. Freddy Weller s’amuse comme un gnome dans la forêt de Brocéliande. Ils replongent ensuite dans la mauvaise pop à la Hollies et avec «Good Times», on a même l’impression qu’ils se prennent pour les Zombies. Mais dieux du ciel, Mark Lindsey n’est pas Colin Blunstone ! Par miracle ils finissent avec un «Happening 68» chauffé aux cuivres et qui renoue avec l’excellence de l’appétence pour la pitance.

C’est la fuzz de Freddy Weller qui va sauver «Hard ‘N’ Heavy» paru en 1969. Après deux morceaux de pop inepte, Freddy Weller allume «Time After Time» à la fuzz. Il reprend même le thème de «Satisfaction». C’est un sacré pompeur de Pompéi. Autre belle prestation de Freddy Weller : «Without You», conglomérat garage de guitare acoustique et d’harmo, soudé à la fuzz. Et Mark Lindsay chante comme un crac. Coup d’éclat avec «Cinderella Sunsine». On frappe à la porte. Toc toc toc...
— Excuse me, my name is Mark Lindsey and...
Blow ! On lui claque la porte au nez.
— Hey !
Et il tambourine à la porte...
Ce cut est l’un des hits des Raiders doté d’un fantastique final transgressif brouté à la base fuzz, digne de la fin du «Baby I Love You Won’t You Tell Me Your Name» des Doors. Dans le Pacific Northwest, on savait envoyer la purée. Cette pop a l’air fleur bleue comme ça au débotté du chat botté, mais il faut faire confiance à Mark Lindsey, il sait lever une tourmente. Et ils terminent l’album avec un hit monstrueux, «Call On Me», une pop qui se tient, bien calée sur son train arrière et mélodiquement ambitieuse. C’est même un modèle d’élan pop.

«Alias Pink Fuzz» sonne un peu comme la chant du cygne des Raiders. On les sent dépassés et incapables de se renouveler. Les Raiders proposent un mélange de petite pop et de petit garage insignifiant. On sent parfois qu’ils voudraient sonner comme Love, mais ils sont loin du compte. C’est l’album le plus décevant du groupe et la fin de l’âge d’or.

Le groupe se modernise en simplifiant son nom et devient les Raiders. «Collage» sort un an plus tard. Ce très bel album s’ouvre sur une reprise de Laura Nyro, «Save The Country». Mark Lindsay porte la barbe et produit le groupe. On sent qu’il a mûri. L’époque du fringuant teenager qui sautait partout déguisé en soldat de la révolution américaine est bel et bien révolue. Back to the Pacific Northwest rumble avec «Dr Fine». Mark Lindsay redevient le temps d’un cut le fantastique screamer qu’on adorait et derrière lui joue Freddy Weller, le good time bomber. C’est excellent car insistant. Ils enchaînent avec «Just Seventeen» qui restera l’un des grands classiques du garage excédé qui trépigne. On trouve une autre perle en face B qui s’appelle «Gone Movin’ On», belle pièce de pop énergique emmenée au chant et qui sonne comme un hit des seventies. Les Raiders savent rester dans l’éclat de la légende. Ce cut est digne de ce que faisaient les Beach Boys à la même époque et en plus c’est relancé aux trompettes mariachi. Effarant, c’est sûr et certain. Les Raiders firent partie des meilleurs groupes de pop-rock américains. S’ensuit un «Sorceress With Blue Eyes» assez solide, une sorte de purée psyché descendante dans la meilleure tradition lysergique. Avec «We Gotta All Get Together», ils se prennent carrément pour l’Airplane. On les sent décidés à grimper au sommet des barricades et ils le font à l’orchestration maximale. C’est cuivré à l’excès et magnifique d’élan. Chapeau bas.

On photographie nos amis les Raiders dans le désert pour la pochette d’«Indian Reservation» paru en 1971. Signé JD Loudermilk, le morceau titre de l’album fut dans les seventies un hit qui rendait hommage aux «Cherokee people» - so proud to live so proud to die - Les Raiders enchaînent avec «The Shape Of Things To Come» de Barry Mann et Cynthia Weil, une belle pop de Brill bien intentionnée, mais il leur manque juste une petite chose : l’étincelle qui met le feu aux poudres. Ils tapent ensuite dans un cut de Leon Russell, «Prince Of Peace» et le font sonner comme du bon miam miam Steppenwolf. Mark Lindsay connaît bien le secret du raunchy. Ils bouclent cette première face avec «Take Me Home», un cut signé Terry Melcher, leur vieux producteur. En fait, le cut s’apparente au groove de bon aloi, bien bardé de chœurs d’artichauts de femmes noires, comme on en voyait partout dans les seventies américaines. En face B, ils reprennent le très beau «Eve Of Destruction» de PF Sloan. C’est drôle, dès qu’on leur donne de bonnes chansons, ça fonctionne. Ils terminent avec «The Turkey», le hit de cet album de reprises un peu raté. Mark Lindsay compose et chante ce beau groove foisonnant de percus et de beaux accords glougloutés, percé en son centre d’un joli chorus de guitare aérien. Ce cut salvateur arrache ce pauvre album aux sables du désert.

«Country Wine» sort en an plus tard et ne fait pas de vagues. Les Raiders tentent désespérément d’enrayer le déclin. On trouve sur cet album une belle monstruosité, «Powder Blue Mercedes Queen», grosse pièce de garage seventique montée sur les accords du Spencer Davis Group. Ils renouent passagèrement avec leur légendaire énergie et le gras de la gratte. Le reste de l’album est très pop, et si on l’écoute une fois dans sa vie, c’est déjà pas mal.
Paul Revere et Mark Lindsay reforment le groupe en 1983 pour enregistrer «The Great Raider Reunion», une sorte de Best Of où on retrouve tous les gros hits sixties, «Good Things» (Good thing girl ! bien stompé au beat), «Steppin’ Out» (monté sur la bassline, pop sixties à forte teneur garage), «Let Me» (gros jerk invulnérable) et «Just Like Me» (cut qui a hanté les garages d’Amérique avec son vieux riff à la «Louie Louie»). Sur la face B cavalent «Indian Reservation», «Hungry» et le fabuleux «Him Or Me» qui est l’archétype fondamental de la grande power pop américaine. Les Raiders sont dessus, comme l’aigle sur la belette.

Sur le Greatest Hits Vol 2 des Raiders paru en 1971, on retrouve «Just Seventeen», cette fabuleuse pièce de garage grattée à la surtension, l’un des hits les plus féroces de l’histoire du rock américain. Mais l’un des meilleurs investissements que puisse faire l’amateur de garage, c’est le triple album paru en 2010, «The Complete Columbia Singles». Tout y est et il faut se préparer à danser le jerk, car c’est du triple concentré de tomate. Évidemment, ça ne peut que démarrer avec «Louie Louie» (joué à la trompette, dans une ambiance mambo de fête foraine, quasiment érotique), puis ça continue avec «Louie Go Home» (infectueux et screameux comme un chêne qu’on abat), «Have Love Will Travel» (Classic Pacific Northwest stomper, joliment pulsé à l’orgue), «Sometimes» (magnifico et gluant), «Stepping Out» (garage-punk standello-themmique, incroyablement violent, l’un des hauts-lieux du vertige garage, honey), «Corvair Baby» (magnifique car-song, pour les collectionneurs), «Just Like Me» (monté sur deux accords, perverti à l’extrême, clap-hands, screams, solo apoplectique, garagey à gogo, digne du Really Got Me des Kinks, martelé jusqu’au bout du bout), «Kicks» (forcément bon car signé Barry Mann/Cynthia Weil), «Hungry» (itou, du Mann/Weil solide comme une forteresse imprenable) et «The Great Airplane Strike» (pure Stonesy, fabuleuse de respect). La fête se poursuit sur le disk 2. Attention, ça reste d’une densité extrême, car beaucoup de cuts sont insupportables d’excellence, surtout rapprochés les uns des autres comme ils le sont ici. Top départ avec «Ups & Downs» (Nouvelle giclée de Stonesy, pur jus «Between the Buttons», incroyable mais vrai et c’est produit par Jack Nitzsche, histoire de bien enfoncer les clous), et ça continue avec «Him Or Me» (et là c’est de la triche car on découvre que Terry Melcher a fait venir Hal Blaine, Ry Cooder, Jerry Cole, Jim Gordon et Jim Keltner dans le studio. Pas surprenant que ce hit soit tellement supersonique - c’est le hit sixties parfait, inaltérable, comme peut l’être «When You Walk In The Room» de Jackie DeShannon - puissance et étincelles irisées), «Legend Of Paul Revere» (power-pop scintillante), «Piece Of Mind» (heavy psyché, Mark Lindsay chante comme un black, et finit en hurlant comme Wilson Pickett), «Rain Sleet Snow» (trompettes mexicaines et riff fuzzy, so what ?), «Too Much Talk» (furia fuzz avec une belle couche de crème pop, miam miam), «Don’t Take It So Hard» (pièce magnifique, dotée de tous les atouts poppy), «Cinderella Sunshine» (sous ses allures poppy, c’est un monster hit), «It’s Happening» (pur jus garage fuzz des entrailles de l’Amérique), «Without You» (heavy as hell, magnifique sous toutes les coutures), «Let Me» (on a envie d’ajouter «put it in» pour faire le Dédé - single chargé de poudre, Mark Lindsay s’y affirme comme l’un des grands shouters américains, cut bardé de plans punk dignes des heures noires - Terrifiant) et «Judge GTO Breakaway» (pastiche de Shorty Long et fuzz à tous les étages). Si on en veut encore, il y a du rab sur le disk 3 qui est beaucoup moins agité, mais il vaut quand même le détour. Il faut attendre «Gone Movin’ On» pour retrouver Mark Lindsay en grande forme. Plus loin, on tombe sur la reprise d’«Indian Reservation», le hit de Don Fardon et de Marvin Rainwater, remodelé par John D. Loudermilk. Puis au fil des cuts, on sent que le son s’édulcore. Avec «The Turkey», Mark Lindsay s’accroche encore à ses vieilles racines r’n’b. Il sait ramoner la cheminée d’un cut, pas de doute. Mark Lindsay est un héros méconnu. Les Raiders tapent aussi dans Jimmy Webb avec «Song Seller», mais ça ne fonctionne pas très bien. Au fil des cuts, on les entend sonner comme Dylan ou comme Stevie Wonder et ils finissent sur une admirable reprise des Easybeats, «Gonna Have A Good Time», qui leur va comme un gant.

Pour ceux que le personnage de Mark Lindsay intéresse, il existe une compile sortie récemment, «The Complete Columbia Singles», mais ça tape un peu trop dans la pop orchestrée. Mark Linsday se prend pour Liza Minnelli et il fait son crooner de zone B. Le plus souvent, il flirte avec la soupe, chante des balladifs de garçon coiffeur et il faut attendre «Are You Old Enough» pour renouer avec le r’n’b de jute de juke. Disque incompréhensible. Les Raiders comme les Stones ont connu un âge d’or et le conseil qu’on peut donner est de jeter l’ancre dans cet âge d’or.
Signé : Cazengler, Raider comme un passe-lacet
Disparu le 4 octobre 2014
Paul Revere & The Raiders. Here They Come. Columbia 1965
Paul Revere & The Raiders. Just Like Us. Columbia 1966
Paul Revere & The Raiders. Midnight Ride. Columbia 1966
Paul Revere & The Raiders. The Spirit Of 67. Columbia 1966
Paul Revere & The Raiders. Revolution. Columbia 1967
Paul Revere & The Raiders. Goin’ To Memphis. Columbia 1968
Paul Revere & The Raiders. Something Happening. Columbia 1968
Paul Revere & The Raiders. Hard ‘N’ Heavy. Columbia 1969
Paul Revere & The Raiders. Alias Pink Fuzz. Columbia 1969
The Raiders. Collage. Columbia 1970
The Raiders. Indian Reservation. Columbia 1971
The Raiders. Country Wine. Columbia 1972
Paul Revere & The Raiders. The Great Raider Reunion. ERA Records 1983
The Raiders’ Greatest Hits. Volume II. Columbia 1971
Paul Revere & The Raiders. The Complete Columbia Singles. Collector’s Music Choice 2010
Mark Lindsay. The Complete Columbia Singles. Real Gone Music 2012
Peter Blecha. Sonic Boom. The History Of Northwest Rock. Backbeat Books 2009
Sur l’illustration, de gauche à droite : Mark Lindsay, Joe Jr, Charlie Coe et Freddy Weller. Au premier rang, Paul Revere.
ROCK IN GOMETZ LE CHÂTEL N° 3
28 / 03 / 2015 / ESPACE CULTUREL BARBARA
K'PTAIN KIDD / NITRO BURNERS

La teuf-teuf a couvert la distance en quarante minutes. Pas un hot rod, mais sans carte, ni boussole, ni GPS. From Paris to Gometz-le-Châtel, je vous l'accorde ça a moins de gueule qu' Elvis From Memphis to Vegas. OK, quoique en y réfléchissant bien, la soirée a été sacrément rock and roll. Troisième fois que l'on vient à Gometz et l'on ne regrette pas. Accueil sympa et efficace, bouffe pas chère, et boutique à friandises. Un 45 tours de Gene Vincent, un petit Eddie Cochran de la série Rock Star, et les deux premiers CD d'Ervin Travis introuvables depuis belle lurette. Si j'avais pensé à dévaliser une banque, j'aurais pu prendre quelques autres merveilles au stand d'Hichem, mais stupidement distrait, j'ai oublié. La salle se remplit lentement mais sûrement. Beaucoup de têtes connues, des teddies comme s'il en pleuvait. Doit y avoir un sacré club de danse dans le coin car ça guinche tout son soul et Gegene le DJ n'en finit pas d'aligner les scuds.
K'PTAIN KIDD

Enfin le K'ptain Kidd appareille. Petit équipage. Gilles Tournon à la basse, Stéphane Mouflier qui se prépare à faire du raffut sur ses fûts, et Tony Marlow à la guitare. Pas un de plus. Chemise à jabot et dentelle pour Tony, normal c'est lui le capitaine et marinière pour le reste de l'équipage. Trois, mais pas tout seuls. Je ne parle pas du public qui attend que le vent se mette à déferler de fortes saccades dans les voiles. Plissez les yeux et dans les interstices du réel vous apercevrez le fantôme de Johnny Kidd échappé des limbes de l'enfer qui gesticule sur le roof des souvenirs. Un demi-siècle que Johnny Kidd nous a quittés. Fut le parfait trait d'union entre le rock des pionniers et la première vague du rhythm and blues anglais. Comme beaucoup de ceux qui fraient les nouveaux chemins, son nom fut vite recouvert par la jeune génération suivante. Faudra attendre une dizaine d'années avant que le pub-rock ne le redécouvre... Johnny Kidd fut aux avants-postes du premier rock'n'roll anglais et à l'avant-garde de l'explosion punk. Deux des pages les plus méritoires de l'english rock story.

L'on est loin des roots, loin de la refondation à la Cavan, loin de toutes les revivals, fût-il celui des Stray Cats, le son est ramassé, très électrique, très anglais pour tout dire. Pas de temps pour l'esbroufe. Faut assurer au maximum, serrer au plus près. Pas vraiment de soli, mais des moments de plus grande concentration d'efficacité pour les solistes. C'est à chaque instant que l'on doit être présent, accroître la densité sonore tout en sachant s'en démarquer Participer à une construction commune tout en apposant sa signature. Ce n'est pas un trio qui joue, avec la découpe esthétique des riffs que l'on sculpte et peaufine chacun à son tour. L'on ne s'adonnera qu'une seule fois dans tout le concert à ce parti-pris, comme par hasard sur un instrumental Race At The Ace Café, une compo originale de Marlow, où la guitare sonne et scintille à la Shadows alors que Stéphane et Gilles jouent aux rosiers grimpants sur la colonne fuselée dressée par Tony. K'ptain Kidd joue au plus pressé. Se marquent à la culotte. Stéphane vous envoie de grandes baffes sur ses peaux, comme s'il tapait à grands coups de masse sur le cul d'un éléphant. Gilles, toute sa longue silhouette courbée sur sa basse qu'il tient assez bas, étaye la galerie. Sans lui tout s'écroulerait, à chaque ahan de Stéphane il oppose une plaque blindée lisse et imparable. Tony cimente le tout avec un hachis de riffs démoniaques. Chaque note comme un rivet imputrescible. Vous n'avez qu'à suivre. Vous servent un steak tartare, saignant, cuit sous la selle d'une cavalcade infernale.

Nous jouent l'intégralité de l'album Feeling ( voir KR'TNT 220 du 29 01 / 15 ), le temps de se rendre compte – beaucoup plus que sur le disque – combien l'oeuvre musicale de Johnny Kidd était d'une compacte homogénéité, réemployait souvent les mêmes séquences tout en les diversifiant à outrance. Un morceau de Kidd n'obéit qu'à une seule loi : court à sa fin le plus vite possible. Pas de chichi, pas de chachacha. Pas de temps à perdre dans les mignonneries et les enjoliveurs. Du brut du décoffrage. Mais une pyramide élevée en moins de temps qu'il n'en faut pour l'entendre. Un superbe Restless, un magnifique Growl ( et Tony qui ose se plaindre de son mal de gorge après avoir poussé un grognement d'ours des cavernes dérangé en pleine hibernation par un Neandertalien imprudent ! ).

Prestation exemplaire. La classe et le savoir-faire. Difficile à réaliser, et pas servile. Ne recherchent pas l'identique. Se contentent de l'esprit de l'impact. Un set fulgurant et compacté qui s'achève comme un rêve par le classique des classiques, le Shakin' All Over, qui vous secoue sans dessus dessous comme un coup de poing final.
NITRO BURNERS

Sont placides. Tous les trois sur scène. Attendent tranquilles. Prêts à démarrer. Mais Mimile a encore mimille disques à passer sur sa platine. Va leur chercher une bière pour les faire patienter. Mais ils n'ont pas l'air de trouver cela long. Prennent la vie avec philosophie, pas la moindre trace d'impatience lorsque l'on recherche Mister Jull qui a déserté la sono. Méritent tous les trois le grand prix du stoïcisme pour l'année 2015. Tant qu'ils restent au pré autant les présenter : le grand à la moustache en fer à cheval sagement assis derrière sa batterie c'est Laurent. Le longiligne accroché à sa contrebasse ornée de flammes infernales c'est Phil. Quant au géant qui caresse sa Gretsch c'est Kees.

Commencent calmement ( tout est relatif ). Quatre morceaux étranges, une rythmique rockab, sur un arrière-fond country très prononcé parcouru de réminiscences first sixties. Un peu bizarre, comme des timbres qui refusent de se décoller. Toutefois, une chose est acquise, Kees possède une super belle voix, très américaine, capable de prendre toutes les colorations. Et puis, sans préavis le typhon fond sur vous. Accrochez-vous aux petites herbes, car les Nitro Burners vous envoient des rafales de hot – wild -rockabilly à hautes doses. L'air de rien. Entre deux morceaux, Laurent reste derrière les drums comme s'il était assis à la terrasse d'un café à déguster une boisson anisée dans la chaleur caniculaire, Khees essaie de trouver l'accord parfait sur sa guitare et Phil mime avec de simples gestes dénégateurs des blagues stupides, genre Carl Perkins, non je ne connais pas. Fait si bien l'idiot que l'on est obligés de rire.
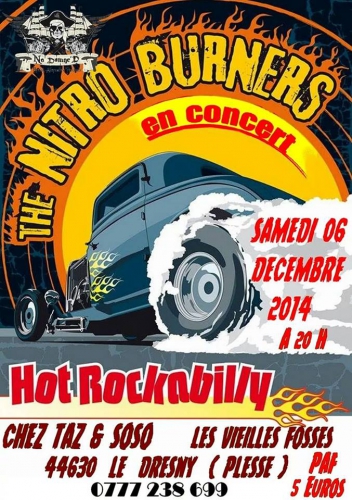
Et ce coup-ci c'est parti pour de bon. Vous dis pas tout ce qui nous tombe dessus. Des cataractes. Du rockab d'enfer, à en veux-tu, en voilà. Vont commencer par une petite série de trente. Un apéritif. A la nitroglycérine. Khees vous les balance comme s'il jetait les meubles de l'appart par la fenêtre du trentième étage. L'est sûr que ça va plus vite. Suffit de ne pas être dessous. Justement nous on reçoit et à voir le public qui s'extasie et crie de joie, tout le monde apprécie.
Phil à retordre de rire ne cache pas son jeu. Se lance dans des solos de contrebasse qui swinguent à mort. L'a couché la big mama sur le devant de la scène, et à califourchon sur ses flancs il nous délivre de satanés décollements de cerveaux reptiliens. Ne stase pas dans le binaire, l'a dû écouter ( pure supposition ) tous les Pastorius de la planète qui jacobisent le jazz pour jouer si fluide reptile et si puissant boa de chauffe. Avec Laurent par derrière qui met la pédale douce sur la grosse caisse et qui s'active sur la chalerston, l'on se croirait au bon temps de la prohibition, mais Khees a tôt fait de faire voler en éclats vos illusions. Nous sommes bien au pays du rockabilly brûlant. N'y mets pas la main, tu y laisseras tes doigts.

Viennent de Nantes et ne sont pas prêts d'y retourner. Sont sur scène, ils y restent. Rajoutent une vingtaine de titres au dernier morceau. Les Nitro ne vous servent pas des demi-portions. Mènent un beat d'enfer. Viennent de faire la première partie de Crazy Cavan. N'ont pas été choisis au hasard, plutôt à la roulette russe. Pas celle pour les fillettes qui se joue au revolver, l'autre qui se pratique au bazookabbilly. Cette musique qui vous arrache la tête et les tripes.
Miracle l'on est encore vivants. Nous ne l'avons pas fait exprès. Nous ont hachés menus aux petits oignons et aux gros gnons. Les Nitro Burners méritent leur sauvage appellation. Ne trichent pas sur la marchandise. Donnent davantage qu'ils ne promettent. Khees a encore quelques munitions en réserve, faut encore suivre les boeufs jusqu'au bout de la nuit...
BILAN
Mémorable soirée, première apparition publique de K'ptain Kidd et découverte de Nitro Burners. Et le seize mai, l'Association French Honky Tonk nous sort le grand jeu avec deux concerts l'après-midi et trois autres en soirée, plus expo voitures and Tutti Frutti habituels, et quelques surprises...
Damie Chad.
( Photos prises sur le FB des artistes )
Blues cafe preSents
ELMORE JAMES
DUST MY BROOM
DUST MY BROOM / LOOK ON YONDER WALL / IT HURTS ME TOO / COMING HOME / THE SKY IS CRYING / I BELIEVE / HAND TO HAND / ROLLIN' AND TUMBLIN / MEAN MISTREATIN' MAMA / I GONE SOMEBODY MORNING / PICKIN' THE BLUES / STANDING AT THE CROSSROAD.( Attention interversion de la playlist )
2003 / Galaxie Music 38251 42.

Très bon choix de titres mais pour les notes de pochette c'est le zéro absolu. Heureusement qu'Elmore James n'est pas un inconnu. N'a enregistré qu'à partir de 1952, oui mais avant il avait fait la route avec Robert Johnson et Sonny Boy Williamson II. Sera le parfait trait d'union entre le blues du delta et Chicago. De santé fragile il meurt d'ennuis cardiaques en 1962, il reste le prince inégalé de la slide guitar.

Dust my broom oh my dear quelle giclée ! La guitare sonne comme le tocsin, la voix vous agonise et derrière la rythmique vous martèle les oreilles, pour son premier enregistrement Elmore se réapproprie le morceau de Robert Johnson et en donne une version qui exprime toutes les colériques frustration du blues. Prodigieux. Look on yonder wall de la slide pianotée, comme vous n'en avez jamais entendue, un truc pas picking des hannetons; la voix qui revendique, l'harmo qui insiste, une sérieuse volée de bois vert sur vos esgourdes. It hurts me too autant les deux premiers morceaux résonnent d'urgence, autant ici l'on rentre dans le blues plaintif, le vent dans les roseaux dirait Yeats, la voix se traîne sur un chemin rockailleux, la guitare défonce le piano qui sur deux mesures se met à jerry lee liser avant de reprendre en sourdine et de honkytiser sans problème. Coming home to you baby et la guitare à bout de bras qu'il balance comme un panier à salade, accrochez-vous la slide vous tombe sur le crâne telle une matraque de policier. Toujours cette manière de ne pas chanter mais de crier pour emporter le morceau de la barbaque qui reste collée à la dent qu'il arrache. The sky is crying toute la pluie tombe sur vous, en douceur, avec lenteur, toute gelée et glaçante, pour que vous soyez empoisonné par cette eau de désespoir métaphysique qui dégouline sur vous. Douche froide de blues infligée dans le cabanon de la vie. I believe intro de guitare qui n'en finit pas, la couche d'espoir que vous tartinez sur votre vie pour vous persuader qu'elle vaut la peine d'être vécue, vous pouvez faire semblant d'y croire, le piano articule ce que la guitare désarticule, désespoir subliminal. Hand to hand main dans la main, pour une note arrachée toute la portée désintégrée, l'on n'écoute plus la voix rien que la guitare qui égrène ses notes comme un épi de maïs que l'on va transformer en farine charançonnée. Rollin' and Tumblin'changement d'ambiance, l'a laissé la gratte dans le placard, les cuivres vous font un medley prophétique un truc incertain entre rythmique jazz cymbalique et symbolique rhythm and blues pré-stax. Fête vocale, la guitare qui se contente de faire le gros dos sur les graves. Matou repu qui vient de croquer une souris. Mean Mistreatin' Mama l'on revient dans la pure orthodoxie du blue, du note à note comme le goutte à goutte à l'hôpital, pas jojo, le blues vous caresse à rebrousse poil, mais c'est ce que l'on aime. De quoi vous plaignez-vous, vous enfonce sa voix comme un coup de couteau dans les reins à chaque reprise. I done somebody wrong rien de pire que l'auto-culpabilisation, trop franc pour être honnête, ne sais pas ce qu'il a fait de mal parce qu'il joue plutôt trop bien, le batteur devait être bûcheron dans sa jeunesse, vous abat sa cognée, imperturbable, du début à la fin du morceau. Grandiloquence dramatique sur laquelle Elmore surfe comme sur les plus hautes vagues du pacifique. Pickin' the blues ne croyais pas si bien dire surfin guitare à la Chuck Berry, instrumental, juste pour vous montrer tout ce que vous ne saurez jamais arpéger sur une guitare, sieste de chat au soleil de l'été et combat de tigres pour convoler en injustes noces avec la femelle. Et pourtant Elmore est patient, ralentit dans les moments forts pour que vous puissiez lui piquer tous ses plans. Ne rêvez pas, vous faudrait être un James Bond de l'espionnage industriel. Standing at the crossroads typiquement Robert Johnsonnien, vous avez beau attendre le bonheur arrive toujours en retard. Le malheur aussi. Elmore vous démontre que le blues est cette musique qui bouche les trous bleus que font méchamment les oiseaux dans le ciel de nos vies incertaines. Elmore et sa guitare vous crachent la leçon à la gueule. Si vous n'avez pas compris, retournez sur vos pas, vous resterez le cocu de votre propre existence. A chacun son dû.
Damie Chad.
ARTISTE EN PRISON
Nous l'annoncions la semaine dernière – en retard, puisqu'au moment où nous écrivions notre notule – Claudius de Cap Blanc avait déjà terminé sa peine. Deux mois de prison. Vous me direz qu'ils étaient amplement mérités. Je partage cet avis.
Voici une dizaine d'années que cet artiste s'est installé en le charmant village ariégeois du Mas d'Azil juqu'alors paisible et sans histoire. Nous ne le lui reprochons pas. L'aurait pu y vivre tranquille et se livrer à de multiples activités courantes. Nous lui aurions laissé le choix : vendre du sang contaminé, envoyer chaque semaine quelques centaines de pauvres diables au chômage, inventer quelques nouveaux impôts, fermer des maternités, que sais-je ? Quand on veut, on peut, et nous ne doutons point de sa réussite s'il avait désiré s'engager dans une de ces nobles causes. Hélas l'esprit de cet homme était tordu. Au lieu de vouer ses forces au progrès de l'Humanité, il a préféré les gaspiller en une entreprise démoniaque qu'il appela : L'Affabuloscope.

Je crois qu'il est de mon devoir moral de définir en quelque lignes cette monstruosité sortie tout droit d'une imagination déréglée. L'Affabuloscope est un gigantesque appareil – s'étend dans les locaux d'une ancienne scierie sur trois étages – que l'on pourrait décrire comme un alambic géant voué à produire du concentré de bêtise humaine. C'est une expérience très déstabilisante que de visiter L'Affabuloscope. Cette chandelle jarryenne géante fonctionne en effet comme un miroir grossissant, ou plutôt comme ces télescopes surpuissants qui vous permettent d'apercevoir les confins de l'univers. Qu'est-ce que l'Homme ? vous demande l'Affabuloscope, et il vous donne obligeamment la solution : un résidu d'imbécillité crasse. La réponse est sans ambiguïté, sans ubuguïté, vous esquissez un sourire pour ne pas paraître idiot, mais en tant que digne représentant de la race humaine, en votre fort intérieur, vous vous défendez en affirmant que c'est de l'humour, que c'est un tantinet exagéré...
Evidemment les autorités ont fermé les yeux. Se vantent de veiller jour et nuit sur notre sécurité, mais dès qu'il faut avancer le prix de location de trois bulldozers pour éradiquer à tout jamais l'œuvre néfaste d'un contempteur du genre humain, elles ne lèvent pas le petit doigt. C'est alors qu'encouragé par cette absence de réaction Claudius de Cap Blanc est passé à la deuxième étape de ses plans machiavéliques qui ne visent qu'à la déstabilisation des représentations idéologiques de notre substrat civilisationnel.
Va agir par surprise. Lui qui a ramené l'Homme à son plus petit commun dénominateur, la bêtise triomphante – décide, peut-être pris de remords, peut-être atterré par sa propre outrecuidance, de couper la pomme en deux et d'en sauver la moitié. Ce sera la Femme. N'a pas tort, ces êtres qui font si bien la vaisselle, le ménage et le repassage, méritent une fervente attention. Comme de loin, rien ne ressemble plus à un être humain féminin qu'un être humain masculin, il pallie cette difficulté en représentant notre fée du logis par ce qui physiologiquement la différencie le plus, cette empreinte vulvaire dont il usera désormais en tant qu'étendard esthétique pour annoncer au monde entier la suprématie de la femellitude humaine. Et voici notre homme déguisé en tatoueur fou qui dépose sur toutes les pierres qui passent à sa portée la marque sexuée de la féminité.

L'Affabuloscope déborde. Désormais vous ne pouvez faire un pas dans les sentiers de randonnées pyrénéennes sans tomber au détour du chemin sur une pierre marquée du signe vulvaire. Etrangement ces vulves schématiques dépourvues de tout système pileux eurent le don d'hérisser les prudes sensibilités des édiles locaux. L'est vrai que dans ce département le plus riche de France, qui traverse une période de prospérité sans précédent, doté d'une économie florissante, nos élus n'avaient rien de plus urgent à faire, plus un seul chômeur, plus de malades, plus de RSA à distribuer, que des riches qui ne savent plus comment dépenser leur argent... Fallait bien trouver un dérivatif à leur inaction forcée. N'avaient plus un chat à fouetter. Faute de mieux se sont rabattus sur ces chattes pacifiques qui proliféraient en rase campagne...
Ont commencé leur chasse à la vulve. Mesquinement. Refus de marquer L'Affabuloscope dans les documents remis aux touristes et autres vexations chichiteuses dont nous ne parlerons pas. Tout citoyen respectueux de la loi serait allé faire pénitence. Mais c'était sans compter sur la perverse ténacité du redoutable Claudius de Blanc Cap. Un jour – en fait en pleine nuit – notre monstre osa porter la main – qu'il sortit de son pochoir – au sein des seins. Il osa – ô le malandrin, ô l'infâme, ô l'iconoclaste – orner quelques rochers caverneux et quelques murs municipaux – de ses horribles signes sexifiés. Et ce crime ignominieux il l'accomplit aux alentours de la grotte préhistorique du Mas d'Azil. Mondialement connue. Le sang – nous ignorons s'il était menstruel – des autorités ne fit qu'un tour. L'on porta plainte. Pour une fois l'on n'attendit pas dix ans. Le criminel fut condamné à plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts et à plusieurs dizaines d'heures de Tig ( c'est coton ). N'a pas voulu céder. On aurait dû le fusiller. On se contenta de le mettre deux mois en prison.

Ce manque de fermeté nous afflige. Deux misérables mois de prison pour le plus grand criminel de tous les temps. Cette mansuétude nous semble suspecte. Surtout que nous n'avons pas encore tout dit sur les méfaits perpétrés par ce rebut de l'humanité. Non, la liste de ces turpitudes n'est pas achevée. Nous vous conterons l'implacable suite de ces actes non notariés dans notre prochaine livraison.
En attendant gloire à nos ardents défenseurs de la salubrité publique ! Que leurs noms soient sanctifiés et resplendissent dans la mémoire des hommes à l'égal de celui de l'auguste et immortel citoyen Pinard qui condamna Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire et Madame Bovary de Gustave Flaubert !
Damie Chad.
VIOL COLLECTIF
L'ordre moral s'installe. Petit à petit. Insidieusement. Médiocrement. La France n'a pas l'âme russe. Exaltée, violente, excessive. Alors qu'un Poutine vous envoie les Pussy Riots en Sibérie d'un coup de plume rageur, par chez nous l'on se contente d'une médiocre pétition, d'un communiqué de presse lapidaire ou d'une lettre de dénonciation au procureur de la République ou au sous-préfet du département. C'est ainsi, c'est notre petitesse nationale.
Même que parfois les autorités n'ont même pas à lever l'annulaire. On leur emmène les coupables sur un plateau, ficelés. Avant – je vous parle d'un temps... - c'étaient les cathos coincés du cul, les ligues de la vertu lobotomisée, les nostalgiques de l'ordre moral pétainiste qui se chargeaient de ce noble boulot de dénonciateurs. Autres temps, autres mœurs, aujourd'hui ce sont les fractions dégagées de la gauche bien-pensante qui abattent la sale besogne. Faut dire que depuis que la social-démocratie a troqué la révolution pour la république, les barricades pour les réseaux sociaux, l'athéisme antique pour la mansuétude religieuse, et la contestation radicale pour la revendication démocratique, les marges de manœuvre se sont considérablement réduites.

Y avait déjà eu un précédent. Les Scorpions – groupe téton, pardon teuton – qui avaient vu une formidable campagne de presse déclenchée à l'encontre de la pochette d'un de leur trente centimètres, Virgin Killers, sorti en 1976 qui représentait une petite fille pré-pubère nue. Fallut attendre plus de trente ans pour qu'en 2008, les censeurs du net en fassent une maladie. Ce fut un énorme scandale. Les Scorpions durent présenter des excuses publiques...

Ce mois de mars 2015, c'est le groupe punk Viol qui fit l'objet d'une entreprise de déstabilisation médiatique. Pour une chanson, Viol, écrite en 2009 qui n'est jamais sortie sur disque et que le combo d'origine nantaise ne chantait plus sur scène depuis plus de trois ans. C'est le groupe pro-féministe Les Effront-é-es qui a lancé l'attaque contre l'obscur combo-punk, rapidement relayée par la Mairie de Paris et le Gouvernement... La Mécanique Ondulatoire qui avait programmé le groupe et qui a très vite senti le vent de l'interdiction se profiler à l'horizon, s'est dépêchée de notifier ses regrets et de décommander le groupe...
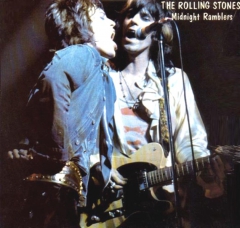
Les Effronté-e-s et leurs étranges alliés objectivement étatiques définissent le titre comme une incitatoire apologie du viol. A ma connaissance l'on n'a jamais accusé ni Mick Jagger, ni Keith Richards, ni Charlie Watts d'apologie de meurtre et de viol pour avoir interprété sur disques vendus à des millions d'exemplaires et devant des centaines de milliers de personnes Midnight Rambler, cette pacifique randonnée noctambulesque qui se termine très mal, n'est-ce pas baby ? Oui mais il est à craindre que les Rolling Stones aient bien plus de tatillons bataillons d'avocats en réserve que l'undergrounal Viol. A vaincre sans péril l'on triomphe sans gloire. Première règle du mortal kombat, si vous voulez être sûr de gagner, choisissez vos ennemis parmi les plus faibles.
Aujourd'hui l'on s'en prend à un groupe de punks inconnus. Rappelons au passage que l'esthétique punk est basée sur la notion d'outrage, de provocation, d'outrance ultime, compulsive manière de culbuter les pesanteurs rétrogrades... Mais ce n'est qu'un début, à droite comme à gauche, il existe des armées de bien-pensants qui rêvent de nettoyer les écuries d'Augias du rock and roll. Trop de cuir, trop de baston, trop de violence, trop de bruit, trop d'incitation à la révolte, trop d'appel à la jouissance, trop de philosophie hédoniste, trop de drogue, trop de sexe. Trop de rock and roll.

Le rimmel des bons sentiments et le fond de teint des louables intentions ne sont que d'hypocrites maquillages qui n'ont pour but que de promouvoir des astreintes de plus en plus larges à la liberté d'expression. Certains croisés du nouvel ordre moral mondial ne sont mêmes pas assez finauds pour s'apercevoir de la manipulation de masse dont ils sont les jouets. Un jour les pièges qu'ils creusent en toute bonne foi se refermeront sur eux aussi. Les idiots utiles ne sont que des denrées idéologiques transitoires, temporairement nécessaires au renforcement coercitif des structures des pouvoirs politiques et économiques qui ne se gêneront pas pour les museler et les interdire à leur tour quand leur heure viendra. Ce sera alors le moment idoine de remettre sur le pick up des regrets Return to the Sender d'Elvis.
Damie Chad.
15:18 | Lien permanent | Commentaires (0)
25/03/2015
KR'TNT ! ¤ 228. ERVIN TRAVIS / NIKKI HILL / SLEATER-KINNEY / ACERIA / LEXA / CHARLIE PARKER / HOWLIN'WOLF
KR'TNT ! ¤ 228
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
26 / 03 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / ARTISTE EN PRISON NIKKI HILL / SLEATER-KINNEY ACERIA / LEXA / CHUCK TWINS CALIFORNIA CHARLIE PARKER / HOWLIN' WOLF |
Ervin news

L'élan de solidarité ne faiblit pas, les lettres d'amitié et les dons parviennent à l'association. Cela ne nous étonne pas. Ervin Travis a durant des années dispensé tellement de bonne musique, de plaisir, de gentillesse et d'amitié que par un juste retour des choses, nombreux sont ceux qui tiennent à lui manifester encouragements et aide.
Ervin, tu as tant donné au rock pour que l'on s'arrête en si bon chemin.
Keep on rockin'...
QUELQUES NOUVELLES PRISES SUR LE
FB : Lyme – Solidarité Ervin Travis
Nous pensons qu’il est temps de vous donner quelques nouvelles d’Ervin !
Privé de tout traitement depuis des semaines en raison des analyses qu’il va passer, son état de santé s'est beaucoup dégradé.
Il ne se lève plus depuis plusieurs jours & quant aux douleurs, elles se sont amplifiées.
Le premier rendez-vous est pour la fin mars. Grâce à vous il pourra déjà se rendre à celui-ci.
Soyez ici toutes et tous remerciés de votre mobilisation et de votre générosité.
Ervin vous transmet personnellement toute sa gratitude
ARTISTE EN PRISON
Plusieurs semaines que nous n'avions point de nouvelles de Claudius de Cap Blanc, nous ne nous inquiétions point. Nous connaissions l'oiseau. Devait se terrer dans son Affabuloscope, en train de mettre la dernière main à une de ses déviantes machines dont il a le secret, ou alors batifolait dans la montagne pour déposer ses pierres vulvères. Un courriel du matin nous apprend que nous faisions erreur. L'oiseau était en cage. Vient de faire deux mois de prison pour avoir « dégradé » les abords de la grotte du Mas d'Azil.
Bref un artiste en prison, dans la France d'aujourd'hui et dans l'indifférence générale ! L'info vient de nous parvenir et nous n'avons point le temps d'épiloguer au moment de charger le site. Nous y consacrerons un article dans notre 229° livraison.
Ceux qui veulent en savoir plus se rapporteront à notre précédent article Vulves à Barreaux de notre 218° livraison, ou à notre feuilleton Chroniques Vulveuses consacré à cette affaire dans les numéros 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166... Autre solution, beaucoup plus directe : le site www.affabuloscope.fr/
Damie Chad.
LA TRAVERSE / CLEON ( 76 )
15 / 11 / 14
NIKKI HILL
NIKKI NIQUE TOUT
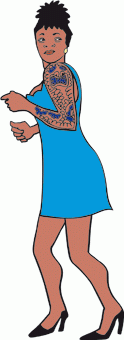
Ce soir-là, Nikki Hill arriva sur scène avec un petit sourire en coin. Une vraie gamine. Elle semblait appartenir à une autre époque, car elle portait un haut en coton clair noué dans le dos, comme ça se faisait dans les années soixante-dix et un pantalon de toile noire moulant passé dans des petites santiags de la même couleur. Elle évoquait ces filles qu’on voyait danser à la Brocherie, un endroit où les Rouennais aimaient passer leurs nuits, il y a de cela cinquante ans. Nikki ramenait sur scène la fraîcheur de sa jeunesse et l’énergie de sa blackitude. Elle offrait en spectacle sa haute silhouette filiforme. Un chignon de cheveux crépus surmontait un visage aux traits parfaits. Par son port altier, elle évoquait les silhouettes de Nina Simone et de Miriam Makeba, mais avec une petite touche narquoise en plus. Elle paraissait extrêmement timide et elle souriait pour donner le change. Un spécialiste comme Charles Denner aurait pu qualifier son corps de parfait. Elle dansait d’un pied sur l’autre et jetait son buste légèrement en arrière, comme si elle toisait effrontément les dieux du rock et de la soul. Son pas de danse relevait d’une certaine forme de sophistication et parce qu’elle était noire, elle en faisait un groove spécial que n’aurait jamais su produire une blanche. Nikki groovait le rock’n’roll avec une élégance certaine. Elle avait appris l’essentiel qui est de conquérir un public en deux morceaux. Sans doute ne le faisait-elle pas exprès, mais toute l’énergie et la grandeur du gospel, de la soul et du rock’n’roll noir américain rejaillissaient à travers elle. Elle semblait vouloir ramener cette grandeur d’antan pour la réinjecter dans les temps modernes. Au travers de son groove têtu se profilaient les fantômes de Little Richard et d’Esquerita. D’ailleurs, en annonçant «Keep A-Knocking», elle déclara : «Little Richard is my favorite !» Woooow ! Dans le feu de l’action, elle dansait comme Sam Moore ou Wilson Pickett, le menton levé et les genoux pliés. Son profil rendu carré par le chignon donnait l’illusion, elle hochait la tête comme Bunker Hill ou Kid Thomas. Elle returbotait le beat en dansant de plus belle et en claquant des mains et des pieds.
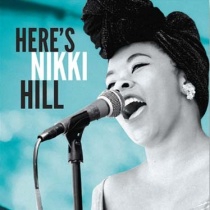
Elle serait originaire de la Nouvelle Orleans, alors l’illusion serait complète, car c’est là que Little Richard fit ses débuts, dans le studio de Cosimo Matassa. Mais ce n’est pas le cas. Nikki Hill vit en Caroline du Nord. À travers sa façon de chanter et d’aller chercher le guttural, elle évoque aussi les géantes qui l’ont précédée, du style Mavis Staples, Sister Rosetta Tharpe & Marie Knight ou encore Etta James. Elle est d’autant plus audacieuse qu’elle embrasse tous les styles à la fois, la soul, le rock’n’roll et la country festive. Pas très évident, car on sait que les touche-à-tout ne sont pas bien vus dans les services de marketing des gros labels. L’industrie du disque a toujours fonctionné selon de sacro-saint principe des étiquettes. Mais Nikki Hill s’en fiche comme de l’an quarante et elle clame bien fort sa passion pour ce qu’on appelle désormais le «roots». Son compagnon Matt Hill apporte le contrepoint raunchy en jouant un rock’n’roll plutôt agressif sur sa Telecaster. C’est probablement la conjonction des deux talents qui produit ce son et cette illusion de grandeur. Les BellRays travaillaient déjà ce son, c’est vrai, mais à l’aune du Detroit Sound. Nikki Hill vise un registre plus ancien qui est celui du rock’n’roll noir américain, le rock’n’roll des origines. D’où le roots. Mais pas n’importe quel roots, Bob, celui de Screamin’ Joe Neal, le roi des monstruosités abyssales, le hurleur suprême qu’un big band complètement allumé accompagnait. Ou de Big Al Downing, l’arracheur de première catégorie. Ou encore de Bunker Hill, le plus grand hurleur malade de l’histoire des pathologies, un dingue qui s’amusait à pousser le bouchon encore plus loin que Little Richard, comme si c’était concevable ! On aurait pu couronner Bunker Hill Screamer 1er, empereur des Hauts de Hurlevent. Ou encore Little Victor qui tripotait lui aussi le bamaloo pour essayer d’imiter Little Richard. Ou encore James Brown et Etta James qui n’étaient pas avares de screams et qui rêvaient eux aussi, à leurs débuts, de sonner comme Little Richard. Un temps béni où certains blacks n’avaient qu’à ouvrir le bec pour incendier une salle de spectacle. The Natchez Burning, baby. Quand Detroit prit feu lors des émeutes raciales de 1967, John Lee Hooker fut tellement fasciné par ce qu’il voyait dans les rues qu’il écrivit «Motor City’s Burning» et dans la foulée, le MC5 l’éleva au rang de chef d’œuvre intemporel.

Nikki Hill transporte tout ça dans sa silhouette de petite shouteuse, on voit bien qu’elle s’est gavée de ce rock surchauffé et qu’elle en distille l’esprit, mais c’est difficile, car elle voudrait égaler les géants et les géantes qui l’ont précédée, et lui manque le petit quelque chose qui fait la différence : le grain de folie. Tout le set de Nikki repose sur la qualité de sa voix. Elle sait forcer, elle sait chauffer un public admirablement inerte, mais elle ne mettra jamais le feu à une salle.

La dernière fois que Little Richard est venu jouer à Paris, ça se passait à l’Olympia. Il arriva sur scène dans une tenue en satin blanc et commença par prêcher pendant une bonne demi-heure. Les loubards de banlieue installés au balcon juste au dessus de la scène n’en pouvaient plus et criaient : «À poil Patrick Juvet !» Mais quand Little Richard s’est rapproché du piano et qu’il a raclé son clavier pour attaquer «Lucile», on est passé d’un coup aux choses sérieuses et tout le monde s’est mis à hurler. Et en une demi-heure, Little Richard a explosé l’Olympia. Pas seulement parce qu’il sort des hits à la chaîne, mais surtout parce qu’il est dingue et depuis toujours hanté par le rock’n’roll. Sur ce terrain, aucun rocker n’a pu rivaliser avec lui - excepté Jerry Lee, bien sûr. Et le rock privé de folie, c’est un peu comme une maison sans bibliothèque ou encore une vie de couple sans pipe et sans rhum : on appelle ça un ersatz.

Alors oui, Nikki Hill fait de l’ersatz, mais elle y met tellement de détermination que les bras nous en tombent. Elle chante, elle danse, et elle s’offre au public qui paie pour ça, alors tout va pour le mieux. Elle aime tellement Little Richard qu’elle a intitulé son premier album «Here’s Nikki Hill», avec son portrait en gros plan, comme sur la pochette du premier album de Little Richard. Pas de fond orange, mais un fond bleu. Au dos, on la voit bras nus avec tous ses tatouages (qu’on ne voyait pas sur scène - peur de choquer un public pépère ?) On pourrait presque dire que son côté sauvage est là, dans les tatouages, et ça la rend éminemment sympathique. Elle attaque par «Ask Yourself», un rock d’arrache bien raunchy et derrière, son mari Matt fait tout le boulot sur sa Telecaster. On assiste à une violente passade de clap-hands et on retrouve à travers ce cut toute l’énergie qu’elle brûlait sur scène. Avec «I’ve Got A Man», elle tape dans le vieux rock de bastringue et une fois encore, Matt fait tout le boulot derrière en grattant sa gratte. Dommage qu’il y ait autant de morceaux lents sur ce disque. Ça lui brise les reins. Même si elle chante bien, Nikki gagnerait l’admiration des foules en rallumant la chaudière, comme elle sait si bien le faire sur scène. L’autre gros cut du disque est «Strapped To The Beat», monté sur un beat rapide qui ne traîne pas en chemin. C’est même du pur jumpy-jumpah et derrière elle un mec se prend pour Lee Allen avec son sax. On a là un magnifique son de bastringue à la revoyure de la ramasse du caniveau des bas-fonds de la déglingue de la pire espèce. Et elle termine avec un beau coup de gospel : «Hymn For The Hard Luck». Façon très élégante de boucler la boucle, quand on sait que TOUT vient du gospel.

Signé : Cazengler, Nikké pour de bon
Nikki Hill. La Traverse. Cléon (76). 15 novembre 2014
Nikki Hill. Here’s Nikki Hill. Deep Fryed Records 2013
LA CIGALE / PARIS 18 / 20 – 03 – 15
SLEATER-KINNEY
SLEATER-KINNEY FAIT CRAQUER LES OS
Qui aurait parié sur les trois post-punkettes de Sleater-Kinney quand est sorti le premier album en 1995 ? Pas grand monde, si ce n’est toute la meute des riot grrrls et le bataillon de vétérantes du MLF. Cette époque fut aussi l’âge d’or du college-rock américain, avec toutes ses manies, ses turpitudes et ses excès. On peut dire qu’on en aura bouffé, du CD indie et on en aura recraché, scchhrrrfff, comme quand on recrache un morceau de fruit véreux. À cette époque, on est même allé jusqu’à voir jouer les Babes In Toyland sur scène, c’est dire à quel point la curiosité peut être un vilain défaut.
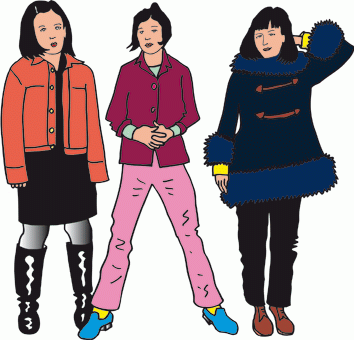
Même si par le son, les trois Sleater s’apparentent à Sonic Youth, elles restent néanmoins à part, ne serait-ce que par le joli vent de folie qui balaye certains morceaux. Carrie Brownstein et Corin Tucker se partagent ce chant très particulier et souvent ingrat. Derrière, Janet Weiss bat le beurre. Notons au passage qu’elle le bat aussi le beurre dans Quasi, l’un des fers de lance de la très grande pop américaine.
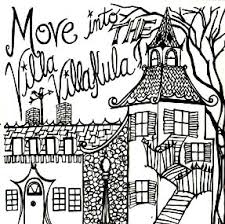
Si leur premier album intitulé «Sleater-Kinney» s’est distingué aux yeux des rock critics américains en 1995, c’est très certainement parce que nos trois chipies sonnaient comme Sonic Youth et il faut se rappeler à quel point l’intelligentsia était friande de Sonic Youth. Corin et Carrie ne faisaient pourtant rien pour se rendre attrayantes. Elles attaquaient l’album avec des cuts hirsutes et mal foutus, mais ça devenait intéressant avec la première crise de colère infantile, celle qu’on entend dans «A Real Man». Ça bascule vite dans l’insanité - I don’t wanna join your club/ I don’t want your kind of love - Corin pique sa crise d’épilepsie et elle s’étrangle. Et c’est là qu’on commence à prendre Sleater-Kinney au sérieux. On retrouve un beau passage de folie douce dans «Her Again». Corin Tucker ferait passer les internées de Sainte-Anne pour des oies blanches. Elle tente même l’implosion à la Nirvana. Elle a le même jus que Kurt, c’est évident. Sur d’autres morceaux, on entend les deux guitares droner comme chez Sonic Youth. Corin chante «Sold Out» dans les Hauts de Hurlevent et ça frise l’insupportable, il faut bien le reconnaître. Par contre, «Lora’s Song» passerait presque pour une vraie perle de garage féminin, car voilà un cut admirable de douceur dévertébrée, au sens de la douceur du sein et du sérieux de la volonté. On sent qu’elles cherchent le hit et qu’elles le frisent.
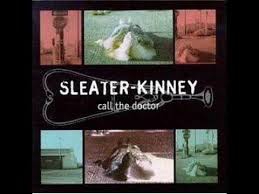
Et puis à partir de là, elles vont se tailler une énorme réputation dans la presse rock américaine. On les considère comme l’un des meilleurs groupes de rock du monde ! Alors elles vont enfiler les albums comme des perles. On trouve pas mal d’énormités sur «Call The Doctor», le second album paru l’année suivante. La marmite commence à bouillir avec «Little Mouth», punk-rock de folles complètement décousu et gorgé d’énergie animale. Et ça continue avec «Anonymous», chanté à la hurlerie perçante et frisant l’insanité. Les filles pulsent un groove de malade et leur double gratté de guitare tient sacrément bien la route. Plus loin, on tombe sur «I Wanna Be Your Joey Ramone» qu’elles envoient valser dans les orties. Corin Tucker sait exploser un cut. Ah la vache ! Elle le fait intentionnellement. Dans la vie, on entend rarement de telles explosivités latérales. Nouvelle expérience nauséeuse avec «My Stuff», chanté avec la volonté bien affirmée de nuire à la civilisation et à l’ordre moral. C’est à vomir, tellement ça dégouline de trash malveillant. Mais ce n’est pas fini. Il faut encore se taper deux horreurs sur ce disque fumant : «I’m Not Waiting» et «Heart Attack». Dès l’intro de «I’m Not Waiting», on note que ça hurle du haut du promontoire. Voilà le rock-rillettes du Mans, un rock énervant et pourtant spontané, joué à la petite énergie nubile, mais cette pauvre Corin est complètement timbrée, on l’entend hurler dans le néant indie, là où personne n’ira l’écouter. Et pourtant, elle continue de hurler. Ah bravo ! L’affaire se corse avec «Heart Attack» qui est monté comme le meilleur des hits jamais imaginé. Ça hurle encore une fois, on croirait entendre une sorcière de Walt Disney, ou pire encore, la gamine possédée de «L’Exorciste», avec sa tête verte qui tournicote à 360°. Cette pauvre fille est possédée par tous les démons poilus et ventrus du trash-rock. On l’entendra hurler du fond des douves jusqu’à la fin des temps.

Elles remettent le couvert avec «Dig Me Out», et ça hurle dès le morceau titre d’ouverture. On croirait entendre Sonic Youth. Cette fille est folle, elle hurle par dessus son hurlement. Corin Tucker cherche la confrontation en permanence. On tombe ensuite sur «Turn It On», une véritable merveille garage, quelque chose de terrible. Elle hurle au chat perche du chien de sa chienne et derrière se développe la meilleure dynamique de rumble garage qui soit ici bas, sur cette terre abandonnée de Dieu. Au fil des cuts, on voit bien que les filles sont torturées par les influences. Elles farfouillent pas mal dans la mormoille, mais ce qui les sauve, c’est qu’elles allument tout aux dynamiques féminines. Dans «Words And Guitar», le chant criard perles les tympans. Elles sonnent comme des folles relâchées dans un pré. Elles crient en liberté. Ce n’est pas glorieux. Avec «Little Babies», elles tentent la pop de juke. Mais leur pop se veut insistante et malade, d’autant que Corin clame comme une conne. Avec «Not What You Want», elles reviennent au garage de folles - Saw Johnny at the store/ I said get the car hit the road - Quel souffle ! Corin laisse filer cette voix qu’elle n’a pas et se campe dans la perspective de l’énormité. Envolée garantie. Elles terminent cet album trépidant avec un «Jenny» digne du Velvet, assez fantastique et assez profond - I am the girl/ I am the ghost/ I am the wife/ I am the one. Débrouillez-vous avec ça.

Elles attaquent «The Hot Rock» en beuglant «Start Together» comme des ânes qu’on encule. On observe dans ce cut de sacrées ribambelles de rebondissements. Fraîcheur et jute sont leurs deux mamelles. Elles se veulent terriblement ravageuses. On sent que Corin bat tous les records mondiaux de détermination. Il suffit d’écouter «Hot Rock». On la voit gratter sur sa Rickenbacker comme une pouilleuse qui gratte ses poux. Ah les parents, quand ils voient ça, ils ne doivent pas être fiers ! Elle fait exploser le cut-out, c’est pas compliqué. Et elles passent carrément à l’apocalypse avec «God Is A Number». Ah pour ça, elles sont douées. Plus ça trashe dans la barbouille et plus ça leur plaît. On entend hurler cette folle géniale de Corin. Quelle écervelée ! Puis elles s’en vont bougner le post-punk avec «Banned From The End Of The World» et on s’amouracherait presque du cut suivant, «Don’t Talk Like», qui sonne comme de la pop jouée à l’accord déviatique. Corin repique sa crise dans «Get Up», qu’elle prend d’une voix brisée et tremblée. On pourrait presque appeler ça de la malveillance psychédélique. En tous les cas, elles cherchent des noises, elles ne savent faire que ça, apparemment. Et chaque fois, elles se remettent en route. Inexorablement. Corin chante «Living In Exile» comme si elle était le Christ cloué sur sa croix. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. D’autant que coule par derrière une belle purée de distorse.
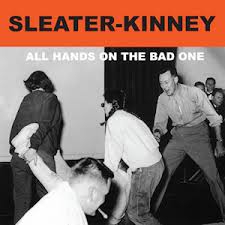
L’album «All Hands On The Bad One» va lui aussi tailler son petit bonhomme de chemin, comme si de rien n’était. Elles attaquent avec «The Ballad Of A Ladyman», une belle pop d’intronisation. Elles cultivent la discordance et bien sûr ça ne peut pas plaire à tout le monde. Elles veillent à rester dans l’esprit du Sonic Youth d’un certain âge d’or, celui d’un concert explosif à l’Élysée Montmartre. Leur petite pop paraît souvent s’énerver toute seule. On les sent même parfois très perturbées, comme dans «Your Decay» - How many doctors will it take/ Ooh Ooh before I desintegrate - Dans «You’re Not Rock ‘n’ Roll Fun», elles s’en prennent à la rock star - Like a piece of art/ That no one can touch - Mais les morceaux désagréables se succèdent et elles ne font rien pour gagner la sympathie du public. Il faut attendre le milieu de la face B pour renouer avec l’intérêt. «Leave You Behind» contient un refrain chanté à deux voix, du plus bel effet. Voilà leur point fort, l’envolée de refrain, à la mortadelle des chœurs mortels. On tombe enfin sur une pure merveille, «Milkshake N’ Honey» qui se passe à Paris - You left your beret behind/ And your croissant is getting cold - Fantastique moquerie pop - Pick up the phone meet at the Sorbonne/ You keep me turning on/ With those French words that I can’t pronounce - Et elles partent en vrille de façon extraordinaire sur Milkshake n’ honey yeah !

Pas mal d’énormités baveuses sur «One Beat» paru en 2002. Elles lancent le morceau titre comme une insulte et Corin chante évidemment comme une harpie. C’est très spécial. Un peu punk de bric et de broc. Elles mettent en place une sorte de monde mal fichu et plutôt ingrat. D’ailleurs «Folk Away» qui suit est insupportable. Et soudain, ça part en trombe, on n’est même pas prévenu. Elles connaissent tous les secrets de la mécanique des fluides. Et voilà du punk-rock de demoiselle hirsute : «Oh». Elles savent trasher un fondement, pas de problème. Elles basculent dans l’affreux et passent un refrain dément. Voilà la clé des Sleater : l’énorme refrain pop qui coule sur les doigts. Notre petite vermine préférée sait aussi faire la Soul Sister. La preuve ? «Step Aside». Elles tapent toutes les trois dans le r’n’b avec une vraie passion pour la démolition - Ladies one time can you feel it ? - Elles en font un vrai blast, c’est braillé à l’extrême du possible. Elles inventent la soul punk et flirtent avec le génie. «Pristina» ? Pfff ! La mère Corin l’explose vite fait. Et elles torchent l’affaire avec un «Sympathy» apocalyptique. Ça gueule, là dedans ! - I’d beg you on bended knees for him - Elles touchent au noyau dur de la véracité, car elles jouent pour de vrai et font rebondir leurs deux accords dans le doom.

«The Woods» est probablement leur album le plus ambitieux. «The Fox» raconte une rencontre entre le renard et le canard. Corin fait le renard et hurle son cri de guerre «land ho !» à la vue du canard. Sacrée chipie, elle ne nous épargne aucune mauvaise blague. Puis elle se remet à chanter n’importe quoi n’importe comment. Elle frise un peu le Beefheart inversé dans «Wilderness». Retour aux affaires sérieuses avec «What’s Mine Is Yours», hurlé direct et monté sur un gros beat de stomp qui vire en vieux trip miteux. Elles bardent «Jumpers» de grosses dynamiques internes. Et comme sur les autres albums, il faut attendre le milieu de la face B pour enfin trouver des hits comme «Entertain», vraie frénésie post-punk sous le boisseau, et «Rolercoaster», qui prend vite de l’ampleur, bien plombé au beat de basss drum. Elles savent monter leur mayo, pas de problème, et donner de l’ampleur à l’ardeur. On ne trouve que deux cuts sur le deuxième disque et notamment un interminable «Let’s Call It Love» perdu dans les causses de Gévaudan.

Elles sont en France pour la promo du nouvel album, «No Cities To Love». L’album n’est pas très bon. Elles n’en finissent plus de concasser et de vinaigrer. Elles pataugent dans la dissonance et ce sont les refrains qui fédèrent tout. On note chez elles un goût insalubre pour les figures de style déplaisantes. Elles montent «A New Wave» sur un thème joué sec à la fuzz et un chant à la cinglette, et c’est à peu près le seul morceau sauvable de la face A. Elles attaquent la suite avec un son post-punk, type manche à balai dans le cul et c’est admirable pour ceux qui apprécient ce genre de son. Mais c’est plat comme une planche à pain, see what I mean ? On est à l’opposé de la sensualité. Elles terminent cet album ingrat avec un hit planétaire, «Hey Darling», dont le refrain emporte la bouche - It seems to me the only thing/ That comes of fame is mediocrity - et ça vire au coup de génie, tellement c’est grandiose et chargé de sens.

On s’en doutait un peu : la Cigale est remplie à ras-bord pour le set des Sleater. On voit que le buzz fonctionne bien - ce buzz qui buzze around the hive - Carrie a changé de coiffure. Elle porte désormais les cheveux mi-longs et ça la féminise incroyablement, elle qui veillait à soigner son look de garçon manqué. Elle porte même une jupe courte et un blouson en cuir noir, des collants noirs et des petites bottines. Elle est incroyablement sexy et terriblement rock’n’roll. On pense bien sûr à la Chrissie Hynde des années de rêve. Janet Weiss reste égale à elle-même, massive et terriblement vivante derrière ses fûts. Corin Tucker porte une robe noire assez habillée et on oublie ses vilaines jambes, car dès qu’elle chante, le miracle s’accomplit. Ces trois filles ont quelque chose que bon nombre de groupes n’ont pas : la fraîcheur de l’innocence. Et un son qui pendant le concert semble unique au monde. On les sent ravies des jouer sur scène. Ça crève les yeux. Elles trépignent d’énergie animale. Carrie et Corin sautent fréquemment toutes les deux avec leurs guitares, face à face, comme des gamines qui jouent à la marelle. Elles donnent au public parisien une vraie leçon de maintien sur scène. Elles jouent admirablement bien le jeu du power trio et les morceaux qui paraissent si ingrats sur disque, prennent sur scène une ampleur considérable. Elles sortent un son énorme. Carrie joue gras sur sa guitare et Corin chante avec une puissance et une présence qui impressionnent. Tout repose sur elle depuis le début. On la soupçonne d’être incroyablement timide, mais quelle performeuse ! Elle peut shouter comme la pire blasteuse d’Amérique. Comme par miracle, leur set balaye tous les préjugés et dépasse toutes les attentes. On voit même Carrie tomber et se rouler au sol avec sa guitare en agitant les jambes. N’oublions pas qu’elle ne porte qu’une jupe courte. Messieurs les guitaristes, prenez note. Le dernier qu’on ait vu se rouler par terre avec une guitare, ce fut Carl, accompagné par ses mighty Rhythm Allstars. Elles font danser toute la Cigale, toute la fosse roule au rythme du flamboyant post-punk des Sleater. Corin et ses deux copines embarquent leur public dans leur univers qui a tous les charmes d’un petit paradis. Et ça tourne au concert idéal. Pas un seul moment d’ennui. Il suffit de les observer et de voir avec quel aplomb et quelle classe elles se campent dans le réel. Rien n’est plus charmant et plus excitant que de voir ces trois filles jouer sur scène.

Pendant une heure trente, elles furent les reines du monde.

Signé : Cazengler, Kinney bien content
Sleater-Kinney. La Cigale. Paris XVIIIe. 20 mars 2015
Sleater-Kinney. Sleater-Kinney. Villa Villakula 1995
Sleater-Kinney. Call The Doctor. Chainsaw 1996
Sleater-Kinney. Dig Me Out. Kill Rock Stars 1997

Sleater-Kinney. The Hot Rock. Kill Rock Stars 1999
Sleater-Kinney. All Hands On The Bad One. Kill Rock Stars 2000
Sleater-Kinney. One Beat. Kill Rock Stars 2002
Sleater-Kinney. The Woods. Sub Pop 2005
Sleater-Kinney. No Cities To Love. Sub Pop 2015

De gauche à droite sur l'illusse : Corin Tucker, Carrie Brownstein et Janet Weiss.
TREMPLIN ROCK / FESTIVAL CONFLUENCES
BE BOP / MONTEREAU / 21 – 03 - 15
ACERIA / LEXA
CHUCK TWINS CALIFORNIA

Je remonte la rue de la Poterie en maugréant. L'ai su trop tard, mais il y avait Ron Hacker, Jackie Hawkins et Big Joe Hunter à Brasies. Un bled perdu du côté de Château Thierry, un raté à vous donner le blues jusqu'à la fin du mois. Faisons bon cœur contre mauvaise fortune. Les petits rockers ont besoin d'un coup de pouce, au lieu de rester à pleurer à la maison, rendons-nous utiles à la survie du rock en regardant de près les jeunes pousses. Doit y avoir un dieu bon, tout là-haut dans le firmament, pour récompenser les bonnes actions, je n'ai pas poussé la porte du pub qu'elle s'ouvre toute seule, devant moi, et bonheur suprême qu'apparaît, toute belle, toute souriante, Céline des Jallies... L'est ici en service commandé. Membre du jury chargé d'élire le groupe qui au mois de mai prochain concourra à la finale qui permettra au vainqueur de participer au festival de musique de Montereau. Ne faites pas comme James Brown qui piqua une grosse colère et demanda un supplément à son cachet déjà substantiel quand il s'aperçut qu'il ne s'agissait pas du festival de Montreux !
CHUCK TWINS CALIFORNIA

Non ce n'est pas que vous vous êtes un peu trop étrillé la barre fixe cette semaine si aucun son ne parvient à votre oreille. Vous dirai pas un iota sur Chuck Twins California. J'en suis d'autant plus triste que je m'étais dit que ce serait mon lot de consolation de la soirée. Un groupe de punk qui promettait d'être saignant ! Eh bien non ! Ils ont fait pire que James Brown. Ça s'est passé l'après-midi, pendant la balance. Z'ont justement balancé un peu trop fort. La rue de la Poterie n'est pas très large et les voisins – comme s'ils ne pouvaient pas déménager - ont un peu l'habitude de téléphoner aux mouches quand les décibels pleuvent. On leur a demandé de baisser le volume. Se sont vexés, et ont remballé leur matos, et se sont cassés aussi sec. Se sont éliminés d'eux-mêmes. N'ont pas voulu jouer le jeu. Ont eu sans doute tort, mais quelque part cette attitude intransigeante est foutrement rock and roll !
ACERIA

Du hard symphonique. Ca me rappellera toujours – je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans... - deux copains qui épiloguaient sur le 33 tours de Deep Purple avec un orchestre symphonique. Ce n'est pas fameux disait l'un, trop mou du genou. Tu veux rire, répondit l'autre, c'est génial, fais comme moi, tu l'enregistres sur cassette en coupant systématiquement la musique classique, c'est super.
Tout cela pour que compreniez que dans mes pensées intimes Aceria partait avec un fort handicap. Ils en ont cumulé d'autres. Le chanteur, c'est le plus âgé de la bande, chante en français, je n'ai rien contre, mais dans les parties lentes, les paroles sonnent trop gentillettes, l'on se croirait dans un disque de Florent Pagny, quand il s'énerve c'est beaucoup mieux. Le malheur c'est que dans le rock symphonique il y a toujours des passages à l'orgue électronique aussi sentimentaux que des chants d'église. D'ailleurs c'est aussi longuet que la messe du dimanche matin. Les morceaux se suivent et se ressemblent. La même structure répétitive. Et puis les intros à la Scorpion ( sans le venin ) sont un peu trop téléphonées.
Faut pas non plus tout voir en noir. Le batteur mouline pas mal du tout, et puis surtout, le guitariste frisé, c'est le vol du bourdon au plus haut du ciel tel que nous le raconte Maeterlinck dans La Vie des Abeilles. Il monte, il monte, il monte et ne redescend jamais. Des envolées qui sauvent le groupe.
Sont jeunes, sont en train d'enregistrer un disque, et on leur souhaite tout le bonheur du monde. But for me, it is not rock and roll !
LEXA ( PAS TOUT SEUL )

S'installent. De temps en temps Belette gratouille sa guitare et l'en sort des accords qui vous réconcilient avec l'humanité. Hélas, quand ils commencent à jouer, c'est tout ce que je n'aime pas dans le rock. Le rock bourrin, le rock festif, le rock franchouillard, sans finesse ni intérêt. A fond la caisse. Mais il est inutile de se presser elle est vide. Sont grands, pas idiots, mais ils amusent la galerie. Trois danseurs déguisés en animaux viennent balourder devant la scène. Pénibles et inutiles. Humour lourd. Ensuite nous font le coup du petit bouchon. Offrent un bouchon de Téquila à qui veut bien. Ne savent pas quoi faire pour gagner notre sympathie. S'ils étaient milliardaires ils distribueraient des billets de cinq cents euros. Que dire d'autre ? Ressemblent à Washington Dead Cats, les mêmes artifices, les mêmes traitements de voix. Décevants.
RESULTATS
Le Be Bop n'a jamais été aussi plein. Chaque groupe a ramené ses fans, et les deux claques n'ont pas failli à leur rôle de supporter. Tristan annonce le vainqueur. ACERIA ! C'est aussi mon choix. Lexa est beaucoup plus au point, en leur propre style. Sont plus vieux, d'une génération antérieure à Aceria. Mais proposent une musique sans avenir. Refermée sur elle-même. Grimée, qui confine au burlesque dans la mauvaise acception du terme. Une caricature qui n'a pas compris que tout masque de carnaval ne recouvre que le néant abyssal des existences. Aceria n'est pas parfait, loin de là, mais il y a dans leur musique des espaces qui ne bouchent pas l'horizon, qui ne sont pas à concevoir comme des manquements mais comme des promesses.
La teuf-teuf me console comme elle peut : « Le grand vainqueur c'est Ron Hacker ! ». Elle a raison. En tout cas, moi je n'ai rien gagné.
Damie Chad.
BIRD
LA VIE DE CHARLIE PARKER
KEN RUSSEL
( FILIPACCHI / 1980 )
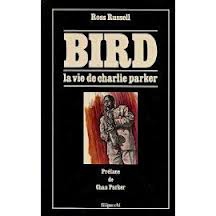
Une biographie de Charlie Parker ? - Point du tout. Un roman. - Bref une vie romancée de Charlie Parker ! - Vous n'y êtes point. Cela Ross Russell l'a écrit et intitulé Sound. - Ne chinoisons pas, un roman biographique. - Ben non, c'est bien la vie de Charlie Parker, mais c'est un roman. Un roman à part entière, un artefact qui ressemble davantage à La Chartreuse de Parme qu'à l'existence contée d'un musicien de jazz. La vie de Fabrice, on s'en moque, par contre le style de Stendhal, ce relâché de satin froissé dictée à la hâte, c'est autre chose ! Que voulez-vous c'est la plume de Monsieur Beyle qui donne un semblant d'existence à son héros, qui entre nous ne se montre pas sous son meilleur jour sur le champ de bataille de Waterloo.
Ross Russel possède un avantage par rapport à l'auteur de Le Rose et le Vert, qui prend un peu son propre rêve pour la réalité d'un songe. N'imagine pas, Ross Russel, il a connu son héros, lui, de près, pas un témoin anonyme qui passait par là un peu au hasard, un véritable acteur qui a participé activement à la saga et au drame. C'est lui qui enregistra les premières véritables faces de Charlie Parker. N'était pas l'ingénieur du son de service commis d'office, mais l'instigateur et l'ordonnateur des séances.

Pourrait en raconter des anecdotes. D'ailleurs il ne s'en prive pas. Même que l'éditeur en met en doute quelques unes en bas de page, et que Chan Parker, la troisième épouse de Charlie, relève la liste des grosses erreurs dans sa préface. Mais il pourrait avoir tout inventé, de la première à la dernière lettre que nous le lui pardonnerions. C'est que voyez-vous ce n'est pas par inadvertance si à la fin du livre Ross Russel met en parallèle le destin de Charlie Parker avec la destinée brisée de Dylan Thomas, l'immense poète anglais, le barde gallois inspiré. Ross Russel est un véritable écrivain, pour lui la force poétique des mots transcende leur peu de ressemblance avec l'illusoire apparence du monde qu'ils semblent dévoiler. L'intention apollinienne de l'aède inspiré dépasse la soi-disant fidèle transcription d'une réalité évanouie.
KANSAS CITY
Elevé par sa mère, et né en 1920 à Kansas City. Ne pouvait pas mieux tomber que dans cette ville du Missouri. C'est une époque fabuleuse, prohibition et grande dépression. Pour l » Amérique en son entier, sauf pour Kansas City. La cité est favorisée par les dieux, son maire véreux – le démocrate Pendergast qui finira en prison - et la pègre locale. Les bars et les boîtes ne sont guère inquiétés par des descentes impromptues de police. L'oasis dans le désert. L'argent et l'alcool coulent à flots. Prostitution, jeux et drogue y prospèrent comme des poissons rouges dans une marre. Le plus sordide des pubs possède sa scène. Les musiciens de jazz locaux et d'un peu partout y trouvent embauche et travail. Kansas City devient un point de ralliement des combos jazz. Le jeune Charlie tombera à quatorze ans dans le chaudron de la potion magique en perpétuelle ébullition.
ENFANT SOLITAIRE
Commence par faire partie de la fanfare de l'école, mais très vite il s'y ennuie. Cela ne va pas assez vite pour lui. L'a l'impression de ne pas avancer. Souffler n'est pas jouer. Veut davantage, savoir moduler comme les disques qu'il écoute ad libitum et les héros à la Lester Young, qui hantent les cabarets interdits... Son prof lui refilerait bien le tuba ( un instrument qui te tue bassement ) dont personne ne veut... alors sa mère compréhensive se saigne aux quatre veines pour lui acheter un saxophone alto. Un rossignol d'occase, déglingué, rafistolé avec des élastiques et du sparadrap. Vous, vous le foutriez tout droit à la poubelle, mais un jeune nègre des quartiers pauvres ne faisait pas autant de chichi. S'escrime dessus, et l'escrime est un sport de combat dangereux, soit vous en sortez vainqueur, soit mort.
L'a quatorze ans quand sa mère trouve un travail de nuit, à l'autre bout de la ville. Une aubaine. Désormais toutes les nuitées il sera dans l'arrière cour des clubs, cherchant à se faufiler en lousdé, I'm the backdoor man. Certains musicos lui entrouvrent les portes en douce. L'aura la chance d'entendre en direct tout le gotha du jazz de l'époque, Count Basie, Walter Page, Jesse Price qui avait accompagné Bessie Smith et Ma Rainey, et l'incomparable Lester Young... par contre pour les conseils faut pas trop y compter dessus. Chacun défend son pré carré musical. L'on ne galvaude pas son savoir. La concurrence est impitoyable. En attendant Charlie y met du sien. Ne coupe pas au plus court, mais les nombreux détours qu'il s'infligera lui permettront un jour de surclasser tous les autres. Pour parvenir au sommet, la ligne droite n'est pas le meilleur chemin.
IGNORANCE
Ce que n'importe quel prof de musique lui aurait appris et explicité en cinq minutes va lui demander des années. En reste tout baba quand il apprend le B. A. BA de la musique. L'existe quatorze tonalités différentes et possibles ( sans compter la quinzième que l'on pourrait comparer au rez-de-chaussée d'un bâtiment sur lequel on élèverait sept étages supérieurs et sous lequel on creuserait sept caves inférieures ) pour jouer un morceau, que vous interprétez par exemple en Fa majeur ou en Fa mineur ou en toute autre modalité de votre choix. Bourrin comme un as de pique, Parker ne cherche pas à en savoir plus. En jazz, l'on n'en utilise que quatre ou cinq, mais lui il va s'apprendre à jouer ses morceaux dans toutes les tonalités sans exception. Cela demande une grande agilité des doigts mais surtout une très forte capacité mémorielle. Imaginez que vous soyez capable de traduire sur le champ et sans hésitation la note de votre plein d'essence, en yen japonais, en nuevo sol péruvien, en yuan chinois, etc... Acrobatie intellectuelle de haut niveau. Mais cela ne se relèvera pas être un jeu gratuit et stérile.

La quintessence du jazz réside dans l'improvisation. S'agit pas de faire n'importe quoi. Sur un thème donné, vous offrez une nouvelle combinaison qui doit rester dans la logique mathématique des rapports de notes. Charlie Parker possède un avantage sur ses collègues, est capable sur n'importe quelle mélodie de vous repeindre la gamme en empruntant des éléments à toute autre modalité de son choix. A ce jeu-là, il sait être subtil, ne remplace pas du début à la fin le La majeur par un Si mineur, ce qui serait trop simple, il emprunte deux ou trois citations à trois tonalités différentes et s'en sert comme, rappel et commentaire, citation et excitation du thème à exposer.
C'est Lester Young qui lui fera comprendre que l'on ne souffle pas avec la bouche dans un instrument à vent, faut s'appuyer sur le diaphragme, et sa colonne d'air le jeune Charlie Parker il la fortifie comme les fûts altiers des propylées du temple d'Ephèse. Est capable de jouer plus fort, plus longtemps et plus diversement que tous ses confrères. Il plane, il survole, sera surnommé Bird, l'Oiseau, au-dessus des tempêtes.
DU SWING AU BE BOP
L'apprenti Charlie Parker débarque dans le jazz dans l'ère déclinante des grands orchestres. Faut être un sacré musicien pour être admis. Mais les picotins d'avoine sont rationnés. Chacun s'exprime à son tour et il y a du monde au portillon. Vous n'avez pas trop de temps pour attirer les oreilles... La crise de 29 précipite le déclin de ces dinosaures géants, les petites formations de cinq à six musiciens sont bien plus rentables. Désormais les solistes peuvent s'étaler à loisir... Et dans le mini-combo, c'est très vite la surenchère, le pianiste, le trompettiste et le saxophoniste essaient de marquer le copain à la culotte, résultat des courses, l'on joue plus fort, plus vite, plus agressif. Et à ce petit jeu, c'est Charlie Parker qui devance ses camarades. Dans les clubs les connaisseurs ne s'y trompent pas, l'on vient pour Charlie Parker même si la nouvelle génération qui joue à ses côtés n'est pas composée de manchots, Dizzy Gillepsie, Art Tatum, Kenny Clarke, forment une troupe d'élite.

Conditions de travail désastreuses. De neuf heures du soir à deux heures du matin, l'on enchaîne les séries, quarante-cinq minutes de musique, un quart d'heure de pose, avec le taulier qui surveille les chronos, mais le boulot terminé, l'on se regroupe dans la boîte la plus accueillante et l'on se lance des défis dans des jams endiablées jusqu'aux aurores.
GOLDEN ERA

Charlie est un grand, l'enregistre des trésors sur Savoy et Dial, le label de Ross Russell. Max Roach et le tout jeune Miles Davis sont à ses côtés... Bird is the King, pour tous et en tout. Bouffe comme deux, fume comme quatre, baise comme huit, boit comme seize, se pique comme trente. Une force de la nature. Pète la forme. Ne s'économise pas. L'on ne compte plus les jeunes jazzmen qui se mettent à l'héroïne pour jouer comme Charlie Bird. Mais ce soleil possède sa face cachée. Ne prend pas le temps. A toujours besoin de quelques dollars pour sa dose. Joue comme un pied. Sort dix minutes faire ses emplettes et quand il revient met la salle à ses genoux, tel un dieu éblouissant.
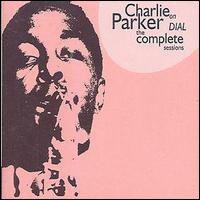
Un génie qui ne s'intéresse qu'à la musique. Tellement pressé et tellement méfiant des pratiques disgracieuses des maisons des disques à l'encontre des artistes noirs qu'il refuse d'apposer sa signature pour pouvoir se faire payer ses royalties. Acculé par la nécessité il finit de passer des contrats à la va-vite avec Verve et Norman Granz. Granz n'est pas un blaireau, Ella Fitzgerald lui doit beaucoup mais il est un producteur qui agit avant tout selon des logiques commerciales. Veut que ses artistes soient admirés par le grand public, il suit les modes et ne se préoccupe guère de ce que ses poulains ont dans le ventre. Vise la quantité, pas la qualité. Au mieux Charlie accompagnera Billie Holiday, au pire il enregistrera avec un orchestre brésilien. Devra se fader tous les airs, toutes les chansonnettes à la mode.
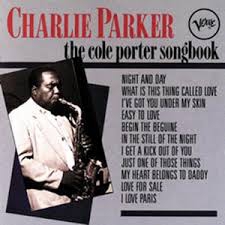
L'HOMME NOIR

L'histoire se termine mal. En cinq ans c'est la dégringolade. Bird ne vole plus, il court après la dope. Grossit et s'enlaidit. Ne peut plus jouer, ne sait plus jouer, ne veut plus jouer. Une longue déchéance. Mais le mal est encore plus profond que ne le laisse présager son apparence de déclassé. L'artiste n'a jamais triché. Sait qu'il est allé jusqu'au bout de lui-même. Et jusqu'au bout de ce qu'il est humainement possible de tirer d'un blues de douze mesures ou de la dernière romance du hit-parade. L'a mené à son terme une certaine forme musicale. Rêve d'apprendre le solfège pour suivre les traces de Stockhausen. S'en sait intellectuellement incapable. Lui qui sait tout juste lire et écrire ne possède pas les bases culturelles suffisantes pour se rendre maître de l'évolution atonale de la musique européenne. N'en veut pas à la terre entière. Mais à cet apartheid social qui depuis des siècles a privé l'homme noir de tout épanouissement. S'est toujours méfié des blancs, à de rares exceptions près il les a souvent considérés comme des arnaqueurs, comme ses ennemis. N'est pas populaire uniquement parmi les musiciens, l'est aussi une étoile du ghetto. Fut le premier à relever le front, à n'en faire qu'à sa tête, a emmené la musique populaire des noirs à un niveau de complexité sans égal. Son attitude sardonique vis-à-vis des patrons blancs des bars et des boîtes, son étalonnage des femmes blanches, préfigurent les combats pour l'émancipation, les colères de Malcolm X et la révolte des Black Panthers. C'est un homme usé qui décède le douze mars 1955. Un pur jazzman, mais une vraie vie de rocker.

Un livre magnifique.
Damie Chad.
HOWLIN' WOLF
MOANIN' AND HOWLIN'
MOANIN' AT MIDNIGHT / HOW MANY MORE YEARS / EVIL ( IS GOING ON ) / FORTY FOUR / SMOKESTACK LIGHTNIN' / I ASKED FOR WATER ( SHE GAVE ME GASOLINE ) / THE NATCHEZ BURNIN' / BLUE BIRD / WHO'S BEEN TALKING / WALK TO CAMP HALL / SITTIN' ON TOP OF THE WORLD / HOWLING FOR MY DARLING / WANG DANG DOODLE / BACK DOOR MAN / DOWN IN THE BOTTOM / SHAKE FOR ME / THE RED ROOSTER / YOU'LL BE MINE / GOIN' DOWN SLOW / THREE HUNDRED POUNDS OF JOY / BUILT FOR COMFORT / KILLING FLOOR.
AAD CD RED 3 / CHARLY RECORDS ( licence CHESS )
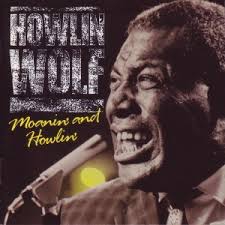
C'était un loup du Delta. A longtemps hurlé avec la meute, Charlie Patton, Son House, Robert Johnson et Sonny Boy Williamson II, est monté à Memphis, a réuni son propre orchestre et est allé pousser la porte de Sam Phillips. Y rencontre Ike Turner qui est en train de bricoler ce qui deviendra le very white rock and roll... Suivra la filière, se retrouvera à Chicago, chez Chess. Le méchant loup est entré dans la horde. N'y aura que Muddy Waters pour lui disputer la place de meneur. Howlin' était trop grande gueule, n'avait pas la sagesse d'un chef, pas assez responsable. Un grand gaillard, joue de la guitare, mais son instrument de prédilection sera l'harmonica. Pour la six-cordes il saura choisir ses gâchettes : Willie Johnson, et Hubert Sumlin. Vont lui gratouiller des tressautements éruptifs qui seront d'admirables toiles de fond pour ses parties vocales. Attention, Howlin' Wolf ne chante pas, il mugit comme un taureau, rugit comme un lion et hurle comme le loup. Possède une ménagerie de fauves affamés dans son gosier. Le titre de cette compilation n'est pas anodin. Beaucoup de morceaux du début et de classiques du blues. Un must.

Moanin' At Midnight, c'est un peu comme un Elvis qui modulerait son Blue Moon mais après avoir pris un rail de cocaïne qui traverserait les States de l'Atlantique à la côte Ouest. Minuit l'heure du crime, n'aie pas peur maman, c'est le loup-garou qui vient t'égorger. Avant de mourir goûte les lampées d'harmonica, elles dégoulinent comme des lampées de sang. How Many More Years, c'est la face B du premier single, interrogation philosophique sur l'évanescence des amours humaines, Howlin' vous décoche un sale accent du deep south, du bout du museau, la bête se bat les flancs avec la queue, et n'a pas vraiment de temps à perdre, tempo piano à l'appui. Evil ( is going on ) planquez-vous sous les tables, la bête n'a pas envie de plaisanter, vous crie ses quatre vérités au téléphone et même à cinq cents kilomètres de lui vous prendriez la chose au sérieux. Ne vous enfuyez pas, le mal est fait. Forty Four, le gars essaie d'être sympa, une rythmique sautillante, mais dès qu'il ouvre la bouche vous n'y croyez pas, trop puissant pour être honnête. Smokestack Lightnin', Tell me Baby, fait du charme, enfin ce qu'il appelle du charme, vous pousse des glapissements aussi vicieux que les yeux baladeurs du loup dans les dessins de Tex Avery, drôle de berceuse, mais au ronronnement de plaisir final, la méthode doit être persuasive. I Asked For Water, c'est le constat final, satisfait et repu, l'a demandé de l'eau elle lui a refilé de la gazoline, ça lui tellement plus qu'il revient à la maison pour faire le plein. Hululements grivois. The Natchez Burnin', l'a foutu le feu à la baraque, pleure sur ses copines qui ont cramé dans l'incendie, soyons sérieux, c'est du blues, l'a perdu sa fiancée pour de vrai. Blue Bird, encore un blues qui égrène ses notes de piano, supplie le petit oiseau de porter un message à la petite Luisa. Dommage, elle a cramé comme un caramel dans le morceau précédent. Who's Is Been Talkin' musique en sourdine, cette fois elle fout le camp, trois coups d'harmo et la voix plaintive qui arrache, la bête hait plus facilement qu'elle ne regrette. Qu'on se le tienne pour dit. Walk To Camp Hall, le blues poisseux comme on l'aime, le loup pris les quatre pattes dans la vase, l'harmo vous ratisse, pas de crainte, l'a chaussé ses bottes de sept lieues et c'est reparti comme en quatorze. Chez Howlin, le blues est toujours revigorant, jusqu'à la guitare qui résonne comme des couvercles de poubelles. Sittin' On Top Of The World, n'en dites pas du mal, il y a du Charlie Watts et du Clapton dans les parages, s'en fout le loup, vous éructe un blues calibré au millimètre près dont on ne l'aurait jamais cru capable. Faut bien apprendre aux englishes qui est le maître de la maison. Howlin' For My Darling, le loup est parmi nous, en goguette, où croyez-vous qu'Eric Burdon ait appris à chanter ? Sur ce morceau-là exactement. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à écouter. Wang Wang Doodle, all night long, pour vous aider à comprendre de quoi ça cause, au-dessous du nombril comme toujours, ce coup-ci c'est les Stones qui ont dû l'écouter cent cinquante mille fois, ce qu'ils ont apporté c'est la prise de son, moins claire, plus fouillis, pour cacher les imperfections. Back Door Man encore une pépite de Willie Dixon pour son louveteau préféré. Qui qu'a pompé sa leçon de chant de coton ? Mister Morrison ! faut avouer que c'était un spécialiste des portes. Ouvertes ou fermées. Spoonful, petit trésor de diamant sorti de la joaillerie Dixon, la voix du loup écrase toute l'instrumentation, exploit d'autant plus formidable que les guitares encadrent le morceau de main de maître. Down in The Bottle chanson d'alcoolique guilleret, profitons-en pour nous appesantir sur la raucité du timbre du loup. Une beauté qui éclipse le jeu de la slide. Shake For Me la babe qui shake, on n'y fait même pas gaffe, il y a la voix du Wolf qui virevolte et l'on n'a d'yeux et d'oreilles que pour elle. Ces trois derniers titres se ressemblent, une instrumentation tout en finesse et la gorge du Wolf qui fait la différence. The Red Rooster, c'est Howlin' qui tient la slide – peut-être pour cela que la voix est comme en retrait - avec Sumlin qui joue le contrepoint. L'en existe une version avec en prime Muddy Waters et Bo Diddley, que je préfère. You'll Be Mine, excité le bestiau, a jeté son dévolu sur la demoiselle et n'en démord pas. Nous on a la bave qui dégouline, va vite l'avaler cette friandise. Goin' Down Slow, le vieux morceau d'Oden joué à la perfection, plus bluesy que lui, vous ne trouverez pas. Un truc d'anthologie, nous en profitons pour nous vautrer sur les volées de larmes du piano de Henry Gray. Tail Dragger encore Henry et ses cinquante nuances de Gray sur l'intro de ce morceau hommagial à Tail Dragger ( que nous avons vu en concert, voir KR'TNT 92 du 09 / 04 / 12 ), les cuivres sont discrets mais superfétatoires. Three Hundred Pounds Of Joy, pas de chance cet encombrant saxophone devient omniprésent. Une erreur discographique, faut pas essayer de sonner comme des yéyés quand on est à la source du pure rock and roll et le roi du blues. Built For Comfort du même tonneau que le précédent. Killing Floor encore la même soupe, mais Led Zeppelin l'a reprise à sa sauce, et je préfère. Parfois les fils dépassent les pères.

Damie Chad.
16:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
18/03/2015
KR'TNT ! ¤ 227. ERVIN TRAVIS / ALLAH-LAS / JALLIES / SONNY TERRY & BROWNIE MCGHEE / JOHN LENNON
KR'TNT ! ¤ 227
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
19 / 03 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / ALLAH-LAS / JALLIES / SONNY TERRY & BROWNIE MCGHEE JOHN LENNON |
Ervin news

Ervin n'est pas au mieux de sa forme. C'est le moins que l'on puisse dire. La solidarité commence à se mettre en place en région parisienne. Une partie des bénéfices du concert de Tony Marlow donné le dimanche 15 mars à la Salle des Fêtes de la Mairie du XIV° a été réservé à l'Association Lyme – Solidarité Ervin Travis. Un autre concert est prévu pour le quatre avril, voir affiche ci-dessus. Nous reproduisons ci-dessous un message du FB de l'Association, afin que chacun puisse selon sa convenance manifester son amitié avec Ervin à qui nous renouvelons notre sympathie et souhaitons courage.
COMMENT FAIRE UN DON ?
Pour les personnes souhaitant faire un don, 3 façons :
PAYPAL
L’adresse mail à utiliser pour faire un transfert à partir d'un compte PP est :
lyme.solidarite.ervintravis@sfr.fr
Merci d’utiliser l’option "paiement à un proche" afin d’éviter les frais de commission. Nous ne sommes pas des vendeurs et ne livrons pas de marchandises.
CHEQUE
l’ordre est «Lyme Solidarité Ervin Travis»
Nous contacter en MESSAGE PRIVE ( sur le FB Lyme – Solidarité Ervin Travis )pour avoir l’adresse d’expédition.
VIREMENT BANCAIRE
Pas encore possible
Toutes les informations nécessaires pour effectuer un virement seront également données sur demande EN MESSAGE PRIVE à cette page dès que nous les auront ( Il faut compter une 10aine de jours à partir de l’ouverture pour que les formalités soient actées & obtenir un RIB. Le compte a été ouvert le 13 mars 2015)
CAEN ( 14 ) - 28 / 02 / 15
LE BIG BAND CAFE
ALLAH-LAS
ALLAH-LA QUELLE HISTOIRE !

— Eh oui, ma bonne dame, quelle histoire, en effet ! Figurez-vous que les petits Allah-las débarquent dans notre bonne ville de Caen !
— Oh lolo ! Ben dis donc ! Ça risque de faire des vagues dans le bol de tripes !
— Ah ah ah ! Comme vous êtes drôle ! Cette vieille barbe de Guillaume le Conquérant va jerker dans sa tombe !
— Et l’église Saint-Jean, vous allez voir, elle va bien pencher pour de bon !
— Oh lolo, quelle affaire ! Ça va Malherber dans le bocage ! Bon alors on se retrouve ce soir au Big Band Café ?
— Ah bah oui ! Vous y montez comment ?
— En autocar. Y fait un encore un peu frais pour monter à Hérouville en mobylette ! Et vous ?
— Je vais demander à mon petit-fils de me conduire, comme ça nous redescendrons ensemble par le dernier autocar et nous pourrons échanger nos impressions ! J’en ai la chair de poule, brrrrrrrrrrr, rien que d’y penser, pas vous ?
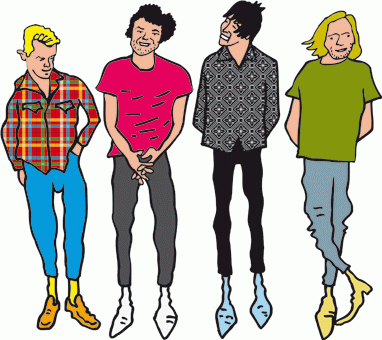
— Bah forcément ! J’ai vraiment adoré les deux albums de ces petits Allah-las, alors vous pensez si je trépigne à l’idée de les voir sautiller sur scène ! Je suis aussi excitée que le soir où je suis allée voir Otis Redding à l’Olympia avec mon mari et mes deux enfants en 1967 ! On avait pris la Simca et hop ! En voiture Simone ! On chantait «Try A Little Tenderness» à tue-tête dans la voiture. Mon mari en était dingue ! Il a même failli nous envoyer dans le décor en beuglant le final les yeux fermés - Gotta gotta gotta - C’est moi qui ai redressé le volant juste à temps ! Quelle rigolade ! Les gosses à l’arrière en pleuraient de rire ! Ils disaient : ‘Ah papa c’que t’es con !’ Au moins il aura eu des bons souvenirs à emmener avec lui là-haut, au paradis, mon pauvre Raymond... Quand j’y repense... Vous vous souvenez de sa disparition ?
— Oh oui, bien sûr... Il est tombé dans un four pendant une ronde de nuit... On a rien retrouvé, même pas ses lunettes qui avaient fondu, comme le reste, dans l’acier en fusion... Affreux...
— Oh mais on ne retrouve jamais rien dans les hauts fourneaux. Il devait avoir trop bu. Il aura sans doute trébuché et plouf ! De toute façon, il se savait condamné. Il avait chopé cette saloperie de silicose, à cause du minerai de fer, comme tous les autres... Pareil que les gars des corons. Il toussait sans arrêt, du matin jusqu’au soir...
— C’est vrai qu’il suffisait de voir l’état des jardins potagers de l’autre côté de la route, à Mondeville, et on avait tout compris. Les pauvres poireaux et les pauvres choux étaient rouges comme des betteraves ! Ah quelle misère ! Bon on ne va pas se laisser aller ! Faut que j’aille faire mes courses et trouver un grrros nonos pour Rogaton, mon petit compagnon !

— Et moi je vais aller au cimetière fleurir la tombe vide de mon cher Raymond. Je vais lui parler des Allah-las, je suis sûre qu’il aurait adoré les voir. On avait tous les disques des Byrds sur Columbia à la maison, vous savez ?
— Oui oui, vous me l’avez déjà raconté vingt fois ! Donc à ce soir vers 20 heures ?
— Couvrez-vous bien, car la météo annonce du gel pour cette nuit ! Nous mettrons nos doudounes au vestiaire, comme ça nous pourrons aller danser le jerk au pied de la scène et applaudir les petits Allah-las.
La pluie avait radouci le temps, ce soir-là. À l’entrée de la salle stationnait la petite troupe de fumeurs habituelle. Les deux amies se retrouvèrent facilement au pied de la scène, car la salle n’était pas comble. Elles durent endurer deux interminables premières parties puis elles virent les petits Allah-las débarquer sur scène pour brancher leurs jolies guitares de collection. Elles admirèrent les boots des deux guitaristes, mises en valeur par de judicieux feux de plancher. Le soliste se glissa sous son ampli Fender, comme on se glisse sous une voiture pour réparer quelque chose.

Le spectacle put enfin commencer. Les petits Allah-las se lancèrent dans l’interprétation appliquée d’une douce série de chansons groovy. Oh, ils n’étaient pas du genre à se rouler par terre. On sentait bien que ces jeunes gens étaient d’un naturel profondément pacifique et que jamais il ne leur viendrait à l’idée d’écraser un moustique. Ils chantaient avec une douce ferveur et grattaient des beaux airs psyché, légers et délicats comme ces libellules qu’on voit danser l’été dans l’air chaud près des étangs. Les deux amies durent poireauter une bonne demi-heure avant de pouvoir commencer à jerker. Elles se penchaient par dessus les retours pour lire la set-list et s’assurer que leurs morceaux préférés y figuraient. Le petit chanteur des Allah-las n’en revenait pas de voir danser les deux mémères à ses pieds. Elles roulaient des hanches et moulinaient l’air de leurs bras nus. Elles semblaient émoustiller le petit chanteur des Allah-las qui se mit lui aussi à rouler des hanches, mais pas trop. Il veillait à bien rester dans le giron du softy-softah psyché de fête foraine.

— Ah quel concert ! Ces petits Allah-las étaient épatants, même s’ils me paraissaient un peu mous du genou ! Je vais aller aux toilettes m’éponger un peu et me rafraîchir !
— Vous avez raison, nous avons toutes le deux le rimmel qui coule ! On ressemble à des filles de joie ! Et puis nous prendrons une bière avant de redescendre. Il nous reste une grosse demi-heure avant le dernier autocar. Tenez, je vous l’offre !
Après un rapide détour par les toilettes, elles s’installèrent au bar devant deux belles pintes.
— C’est tout de même curieux. Je les trouve bien meilleurs sur leurs disques que sur scène, pas vous ?
— Je n’osais pas le dire, mais j’ai ressenti exactement la même chose, Simone.

— Tenez, prenons un exemple : le morceau que j’aime bien sur leur deuxième album, c’est «De Vido Voz» qui sonne exactement comme un tube des Byrds !
— Je préfère «Had It All», ce psyché aristocratique joué à l’arpège et balayé par des vents d’Ouest, comme dans «Eight Miles High», vous voyez ? Ils savent aussi mettre le cap vers le Heurte Of The Sunne ! Ces petits gars sont épatants car ils nous ramènent vraiment à l’âge d’or du psyché californien ! Quel bonheur ! D’ailleurs, dans «Ferus Gallery», ils sont byrdsiens comme cochons ! Chez eux, de toute façon, c’est tout l’un ou tout l’autre !
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire qu’ils sont soit dans les Byrds, soit dans Syd Barrett. Tenez, un morceau comme «501-415», c’est bien du pur Barrett, n’est-ce pas ? On croirait vraiment entendre chanter ce pauvre Syd ! Et «Buffalo Nickel», c’est vraiment digne des Byrds de la première époque, quand David Crosby faisait encore partie du groupe. Quelle science de l’arpeggio ! Ces jeunes gens cherchent vraiment la petite bête en titillant les harmonies vocales. C’est le genre de chose qui me fait perdre la tête, voyez-vous !
— Oh je vous comprends parfaitement, mais il y a sur ce deuxième album une autre perle.
— Ah je vous vois venir... «Follow You Down» ? Je sais que vous préférez le garage... Et j’irai plus loin ! Je vous suspecte d’aimer le garage parce que vos parents tenaient un garage à la Demi lune, pas vrai ?
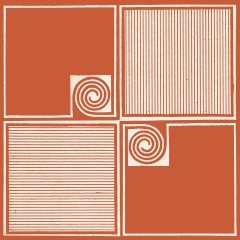
— Alors là bravo ! J’admire votre perspicacité. Mon père avait du noir sous les ongles et il mettait les Them sur le tourne-disque le dimanche midi alors qu’on était à table tous les trois avec maman. Alors forcément, un morceau aussi primitif que «Follow You Down» ne peut que me parler. Et vous avez aussi le dernier morceau de l’album, «Every Girl», avec ses terribles descentes de yeah yeah yeah ! J’appelle ça du sale petit garage merveilleux. Mon père aurait donné sa caisse à clous en échange d’un 45 tours comme celui-là. Et j’aime autant vous dire qu’il y tenait à sa caisse à clous ! Comme à la prunelle de ses yeux !
— Bon, je remets une tournée !
— Mais nous allons rater le dernier autocar !
— Pour une fois qu’on s’amuse ! On trouvera bien une âme charitable pour nous déposer en ville. Barman ! S’il vous plaît, deux grands verres de bière, oui les mêmes. Permettez-moi de vous demander un petit service, jeune homme... Connaîtriez-vous quelqu’un qui serait assez aimable pour nous redescendre en ville ?
— Oh, pas de problème, madame. Je m’occupe de vous trouver un chauffeur, vous inquiétez pas.
— Merci monsieur ! Vous voyez, ma chère, tout s’arrange ! Je tenais quand même à vous faire une confidence. Je préfère nettement le premier album des petits Allas-las... Quand je le passe sur mon lecteur, franchement, je crois entendre un album enregistré en 1965 à Sausalito ! Vous avez entendu les gros tambourins dans «Don’t You Forget It» ? En tous les cas, je peux vous dire qu’ils savent titiller l’oreille d’une dame ! J’ai même établi un troublant parallélisme avec le Brian Jonestown Massacre ! Ça m’est apparu clairement à l’écoute de «Busman Holiday». J’adore ce garage racé qui se profile sous le soleil, on se croirait dans Easy Rider, vous ne trouvez pas ?

— Oh que oui ! Par contre, avec «Tell Me», ils reviennent au bon garage malveillant, tel que l’avait imaginé Van Morrison à Belfast ! J’adore ce riff de basse. On sent que ces petits Allah-las ont écouté les groupes de garage mexicains qui comptent parmi les plus pernicieux, je vous assure !
— Et ce morceau embarqué à l’arpège de Rickenbacker... «Vis-A-Vis», comme c’est beau ! Ça faisait une éternité qu’on n’avait plus entendu des gens capables de rendre hommage aux Byrds. Notez bien que tout cet aplomb et tout ce talent, c’est un peu louche, quand même... Mais je sais que vous préférez le dernier morceau, «Long Journey», avec ses accords glacés et ses écrans psychédéliques, ses riffs noyés de fuzz et ces Down by the river qui font penser aux Stand...
— Mais qu’avez-vous Simone ? Vous venez de pâlir d’un seul coup, comme si vous aviez vu un fantôme...
— Vous ne croyez pas si bien dire... Regardez discrètement le couple, là-bas, à l’autre bout du bar...
— Oui, et alors... Le vieux monsieur avec la dame trop maquillée ?
— Ben oui... C’est... C’est Raymond... J’en mettrais ma main à couper.
— Mais enfin, ça fait quarante ans qu’il est mort ! Il y a une petite ressemblance, en effet, mais de là à imaginer... Mais enfin Simone, où allez-vous ?
Elle ne répondit pas et fendit la foule jusqu’à l’autre bout du bar. Elle se planta devant l’homme :
— Raymond ?
L’homme qui l’avait vue arriver ne cilla pas.
— Pardon ?
— Mais tu es Raymond ! Je te reconnais... Voyons, c’est moi Simone, ton épouse !
— Vous devez faire erreur, madame. Je m’appelle Albert. Vous voulez voir mes papiers ?
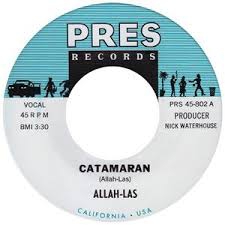
Simone ne répondit pas et fit demi-tour. Elle revint à sa place au bar, siffla le restant de sa pinte d’un trait et sortit prendre l’air. Son amie vint la rejoindre. Puis un type surgit pour leur dire qu’il pouvait les ramener. Il les conduisit jusqu’à une Mercedes garée sur le parking.
— Où voulez-vous que je vous dépose ?
— À l’entrée de la rue Jean Romain, si ça ne vous ennuie pas.
— Aucun problème, c’est sur ma route.
Elles s’installèrent à l’arrière du véhicule.
— Je suis certaine que c’était lui. Voyez ma chère comme la vie est bizarre. On passe une bonne soirée, on voit un bon petit groupe psyché frais comme un gardon et on finit par croiser un fantôme. Je me demande vraiment si tout ça est encore de mon âge !
Signé : Cazengler, l’à la ramasse
Allah-Las. Big Band Café. Caen (14). 28 février 2015
Allah-Las. Allah-Las. Innovative Leisure Records 2012
Allah-Las. Worship The Sun. Innovative Leisure Records 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Matthew Correia (drums), Miles Michaud (chant et guitte), Pedrum Siadatian (guitte) et Spencer Dunham le basman.
THOURY-FEROTTES – 14 / 03 / 15
BAR LE THOURY
JALLIES
Je suis mort. Inutile de rire. Depuis cette nuit funeste du 12 au 13 décembre 2014, si vous désirez la date exacte. Depuis lors les textes signés de mon nom que vous avez pu consulter sur ce site ne sont qu'émanations délétères dues à un ectoplasme de résidus psychiques qui rôdent au-dessus du clavier de mon ordinateur. Un nuage chtonien que le temps s'acharne à grignoter afin de le mieux disperser. Mais ce soir, le mortier sépulcral qui scelle les pierres de mon tombeau d'élite se délite et s'effrite dans le silence. Mon cadavre couché dans sa bière ( une mort subite ) rouvre les yeux. L'énergie du rock and roll recommence à couler dans mon corps froid. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, tels les premiers Dieux lovecraftiens qui s'apprêtent à sortir de l'abîme, je renais à moi-même et mon âme de chair et de sang recomposée hurle de terribles imprécations à la lune qui se voile d'un halo d'effroi. Je suis de retour. Ma mission, en ce bas-monde n'était pas terminée, car je porte gravé à même la paroi de mon cœur tumultueux le talisman d'immortalité des trois roses sacrées dont je suis le hérault. Le devoir m'appelle dans le bourg fantôme de Thoury-Férottes. Vous pouvez avoir les chocottes.

Je ne suis pas le seul. Une véritable malédiction. Chaque fois que je décide d'aller voir les Jallies en concert – un plaisir égoïste qui d'après moi ne se partage pas – la voiture se remplit comme par miracle. Le grand Phil – je veux bien admettre, me sert de chauffeur – mais la copine suspicieuse comme le commissaire Maigret et Richard le jazzeux, devrait y avoir des interdits municipaux qui notifient expressément la non-nécessité métaphysique de leur présence. Enfin qu'y puis-je, trois mois pleins sans avoir vu les Jallies, je suis prêt à faire des concessions pour ne pas perdre de temps et éviter d'interminables discussions sur l'inaliénable droit démocratique de tout un chacun à pouvoir user des éléments indispensables ( eau, air, logement, Jallies ) au bonheur de vivre.
Vous en eussiez eu le coeur chaviré. Les retrouve toutes les trois, pauvres oiselles affamées, pépiant de désespoir, attablées devant une mince tranche de pâté sans croûte et une étroite pointe de calendos crayeux, manifestement le couscous royal distribué à la clientèle n'était pas pour elles. Au Thoury l'on partage l'adage populaire selon lequel c'est le ventre creux que les artistes maudits produisent leurs plus belles œuvres. Ah ! Vous vous prenez pour des cigales, eh ! bien chantez maintenant !
PRESENTATION

Solidarité masculine oblige, commençons par les garçons. L'on ne va tout de même pas céder à tous les passe-droits de ces demoiselles, déjà qu'elles se sont adjugées les premières places d'honneur. Thomas, chemise blanche, jeans et chapeau de feutre noirs, guitare meurtrière en bandoulière. Kross, le nouveau venu, lunettes, contrebasse, tenue, toutes d'un noir suppôt de Satan, n'y a que les pansements enroulés autour de ses doigts qui soient blanc comme l'innocence. Sérieux et virils les gars vérifient leurs instruments, devant les poulettes caquètent. Quelle est la plus belle ? Indéniablement, chacune des trois. C'est comme la règle ( celle de trois ) quand vous gardez un seul élément, ça ne fonctionne plus. Les blondes couettes accroche-rêves de Vanessa, la sombre jupe au-dessus interdit du genou d'albâtre de Céline, la robe candide ocellée de motifs écarlates de Leslie, un poète dirait que tous ces charmes aigus sont autant de preuves et de promesses de la beauté souveraine de ce monde.
PULSATIONS

Trois mois que je n'ai pas vu mes Jallies préférées. C'est vrai qu'entretemps j'ai fait autre chose, je suis mort et ressuscité, mais là je suis cueilli à l'estomac dès les premières notes. We Are The Jallies, Céline ouvre les portes vocales et libère les fauves du swing. Ventres vides mais pleines voix, derrière et à côté les chœurs ratissent large, le morceau devient vite un labyrinthe échevelé, un entremêlement sans fin, faut aussi écouter Kross. Vient du punk, et ça s'entend, pas franchement un adepte de la sardane catalane. Ne cajole la grosse grand-mère que depuis trois mois, mais n'entend pas la faire ronronner en douce comme un chat sur le canapé. Faut qu'elle miaule par devant, comme si on lui marchait sur la queue. N'en a plus de peau sur les doigts, mais il en rajoute à chaque fois. Du scotch autour de ses phalanges meurtries et de la force de frappe sur les cordes. L'a compris qu'il n'est pas là pour étendre le linge. Se partagent les soli avec Thomas. A toi le premier, à moi le second. Saine et saigne émulation. Se lève tôt, Thomas. Pilote une guitare sans frein à disques. Faut que le solo fuse comme un feu follet. Les trois minettes ont compris le message, dès qu'elles sont à la caisse claire, elles accélèrent le rythme et frappent comme des sauvages. Faut envoyer. Direct par avion et pas de poste restante. Les Jallies n'ont jamais été aussi percutantes.

Je jette un regard à Richard, l'ignominieux jazzeux, dans son orbite, sa pupille frétille. Les filles pétillent. Sa main ondule sur la table. Y trouve son compte. Ça part dans tous les sens, mais ça retombe pile à contre-temps sur midi tapante comme la grande aiguille de la pendule. L'est ravi par ces harmonies qui s'interpénètrent, se chevauchent, se mordent à belles dents, et puis s'épurent, se dispersent et se réunissent comme les serpents entremêlés d'un caducée musical.

Un invité de marque. Tristan, prend la guitare sèche. Les premières mesures ne sont pas concluantes, l'électro-acoustique se révèle un peu faiblarde dans l'accompagnement, mais lorsque l'on rentre dans le solo, faut entendre comme il glisse son jeu dans le feu des dieux entretenu par Thomas et Kross, tisse sa toile comme la divine Araknée, c'est le Goodbye Bessie May. Une bricole d'Hendrix, à la sèche et sans wah-wah faut avoir du chien pour jouer si méchant. Recueille une telle salve d'applaudissements le Tristan que les trois Iseult le rappellent pour un deuxième morceau.

L'on pointe ici le mystère de la grâce jallienne. Tout réside dans le traitement architectural des morceaux. Que ce soient les originaux ou les reprises. Tout se passe, non pas dans les arrangements, mais dans ce que je nommerai les dérangements. Au sens clinique de parfum de folie. Je ne sais pas comment ces demoiselles font le ménage chez elles, mais dans leurs musiques elles pratiquent le tohu-bohu appropriatif et le remue-ménage ordonnatif. Détruisent tout en surajoutant. Tellement mignonnettes que l'on ne sait pas laquelle regarder, mais chantonnent si friponnes que l'on ne sait plus laquelle écouter. Se passent le témoin. Céline en forme olympique, Leslie qui chante plus vite que les paroles, Vanessa qui pulvérise le record. Des championnes. Plus tard, après trois ricards, Richard le jazz-hard s'extasiera sur le timbre ( de collection ) de leurs voix. Pas de hasard dans leur bazar, nous parle de cathédrale vocale, avec tympans colorés et chœurs angéliques. N'a pas tort, mais diaboliques conviendrait mieux, car leurs trois organes entrecroisés se livrent à des sarabandes de rubans phoniques qui vous font autant perdre la tête que les mélodieuses sirènes d'Ulysse. GRS, Gymnastique Rythmique, Rock And Roll.

Dès le début du deuxième set, Kross n'a plus de doigts. Tant pis, découvre le jeu de paumes. Davantage d'impact sur les cordes, aucune envie de descendre du ring. De toutes les manières c'est la grosse mémère qui encaisse les coups. Lui résonnent dans la charpente, en font trois fois le tour et ressortent par la fente des S pour venir claquer à nos oreilles. A vous fragmenter le cérumen. Thomas en profite pour vriller quelques licks en piqué, dans le but assassin de nous transpercer le conduit auditif de ses balles traçantes. N'ont rien eu à manger, mais ce soir les Jallies ont bouffé du lion. Les trois femelles devant, qui chassent à mort et les deux mâles derrière qui rugissent pour les encourager.

Le groupe n'a jamais sonné comme ce soir. ( Je dis cela à chaque fois, mais c'est vrai à chaque soirée ). Le même répertoire, mais une surprise à chaque morceau. Se débrouillent pour nous clouer le bec. Céline qui chante comme une diva, Kross qui arpège à tout va, Leslie qui nous envoûte, Thomas qui nous séduit, Vanessa qui nous étonne.
REVELATION
Dans la voiture Richard le jazziste émérite – l'est un fan de Django et des manouches - épanche ses regrets. Des mois qu'on lui signale les concerts de nos trois sorcières du rockabilly-swing, et lui qui faisait le difficile. L'est sous le charme des jouvencelles, leur naturel, leur simplicité, leur espièglerie, leur énergie qui fuse comme des bouchons de champagne. Leur ballet incessant, leur aisance, leur sympathie et cette connivence chaleureuse qu'elles installent avec le public, très vite conquis. Pour le faire râler, avec le grand Phil l'on évoque les concerts passés, la copine sentimentale verse une larme pour Julien, le précédent bassiste, parti pour d'autres aventures. Bref, une superbe soirée, une quintessence rockab-swing qui vous requinque pour la semaine suivante. Fameux fortifiant. Dépasser la dose prescrite est fortement conseillé.
INHUMATION
Juste avant que le soleil ne se lève, je soulève la dure pierre tombale de mon repos éternel. Je descends les longs escaliers du désespoir et me couche sur les cendres indivises de mes ancêtres. Je ferme les yeux et ma respiration s'estompe. Je ne suis pas comme ces pauvres mortels, ces vils cloportes humains, qui s'obstinent à vivre alors que les trois enchanteresses se sont tues. Le monde n'est plus qu'une vaste grotte sombre sans soleil et silencieuse...
Je suis mort. Seul et oublié de tous. Mais je ne me plains pas. Car je sais, qu'un soir ou l'autre, l'appel du devoir retentira, que je rouvrirai mon regard de glace, et que - telle une fusée s'arrachant à l'orbite terrestre, de mon tombeau je jaillirais pour revoir les Jallies.
Ô mon coeur tatoué du talisman sacré
de trois roses diaprées sans épines !
Damie Chad.

( Les photos qui ne sont pas du concert ont été prises sur le FB de Mégapix'elle – elle, photographe douée )
SONNY TERRY & BROWNIE MCGHEE
HARMONICA TRAIN
STRANGER BLUES / I DON'T WORRY / FOUR O'CLOCK BLUES / LONESOME ROOM / BABY LET'S HAVE SOME FUN /NO LOVE BLUES / WINE HEADED WOMAN / BAD LUCK BLUES / MAN AIN'T NOTHIN BUT A FOOL / WOMEN IS KILLING ME / DANGEROUS WOMAN / NEWS FOR YOU BABY / HARMONICA HOP /DOGGIN'MY HEART AROUND / SONNY IS DRUNKIN' / I'M GONNA ROCK YOUR WIG / DANGEROUS WOMAN / I LOVE YOU BABY / HARMONICA TRAIN.
Enregistré : NY 1952 / 1953 / 1954 – Philadelphia 1952.
Past Perfect. Siver Line. 2002. TIM Instrumental Music Company. 220357 / 203.

Encore ramené à l'aveugle – normal pour Sonny Terry – de la deuxième rangée de Cd sur l'étagère inaccessible. Bonne pioche ? Désolé, on est loin des camps de vacances de Perchman... Du blues ? Serais plutôt tenté de dire du country blues en appuyant un maximum sur le premier mot. Peut-être même du folk blues. Dans le mauvais sens du terme. Du genre, chic regardez-nous, les choses se combinent à merveille, par un coup de chance inespérée nous sommes à la mode.
Faut que je me calme, d'habitude je ne suis pas aussi méchant. Surtout que question authenticité historique je n'ai rien à opposer à ces gars-là, qui ont vu le jour en 1911 ( Terry ) et 1915 ( Brownie ). Ne sont pas tout à fait nés dans les profondeurs du delta mais plus haut, à l'est dans les premiers contreforts des Appalaches, ce que l'on appelle le Piedmont. Z'ont tout de même la guigne sur une vie qui n'est pas du gâteau. Brownie Mc Ghee, ne rencontre peut-être pas le diable à un carrefour, mais il en porte la marque, une jambe tordue par la poliomyélite. Quant à son collègue devenu aveugle à quinze ans, il ne pourra même plus se voir pleurer. Mais suffit d'avoir une bouche pour souffler dans un harmonica, le jeune Terry n'a plus que ce jouet pour communiquer avec le monde. Tous deux qui ne se connaissent pas prennent la route. Sonny Terry rencontre une pointure en la personne de Blind Boy Fuller. Guitariste et chanteur. Qui décède en 1941. Juste à temps pour être remplacé par une nouvelle connaissance, Brownie McGhee. Guitariste et chanteur. Two stars are born. Enregistrent dès 1941, mais notre CD nous offrent des sessions postérieures d'une dizaine d'années.
Je ne vais pas vous faire un titre à titre. Pour une raison bien simple. Sont tous parfaits. Le blues comme vous l'avez toujours désiré. Un beat qui balance avec nonchalance. Un harmo qui shuffle comme une Pacific 231 qui aborde les premières pentes des Rocky Mountains sans ralentir, et une guitare qui joue les deux partoches en même temps, les grosses cordes pour tirer en ahanant le lourd seau du chagrin sur la margelle du puits, et les petites qui trottent comme l'insouciance d'un foal fou dans un pré d'herbe verte ( vous permets de traduire blue grass ). Deux belles voix quand elles chantent à l'unisson, et celle de Brownie qui s'écoute avec plaisir. Dix neuf morceaux, dix neuf délices d'oreilles. C'est si bath que l'on a l'impression d'entendre deux fermiers aux francs sourires, deux braves bûcherons aux cœurs sains comme deux tranches de bon pain blanc. Rien à voir avec deux vieux poivrots de nègres vicieux qui passent par la porte de derrière pour aller beurrer la boîte à confiture de votre poupée. Deux mecs tellement honnêtes que ce sont les yankees qui ont acheté leurs disques et fait leurs succès. Pour tromper le client nos deux compères poussent de petits yodels de cowboys à l'entrée des intros. Et puis comme ils savent qu'il ne faut pas exagérer en singeant de trop près les tics des anciens maîtres, retombent tout de suite dans la syncope bluesy lancinante. Savent tout faire, dans le morceau suivant vous la refont en rock and roll, avec un pianiste qui touche et une batterie qui tache.
Z'en êtes qu'à la piste huit et déjà vous savez que vous vous enquillerez tout le reste sans ciller. C'est du blues de tout repos, pouvez l'écouter en vous balançant dans un hamac. Pas le poison qui vous incite à ouvrir le tiroir du buffet pour vous saisir du revolver et vous l'appuyer sur la tempe. Du solide, du revigorant. A tel point que Woody Guthrie a joué avec eux. Du blues qui file la pêche, pas spécialement révolutionnaire, mais avec un enthousiasme communicatif capable de pousser les foules hors de leur léthargie. Vous matraquent des rock à vous faire enfler la banane. Mine de rien, ils arrachent et n'attachent pas leur blues mélodique avec des saucisses de Strasbourg. Prennent des hot dogs de préférence au harissa. Et paf retombent dans un de ces blues alcoolisés, du faux honky tonk pour club de jazz fatigués quand les musicos étirent les notes pour en jouer juste le minimum syndical. Y a même un accordéon – plutôt un dobro qui en imite les sonorités - pour vous faire guincher. La maison ne recule devant aucun sacrifice pour vous satisfaire.
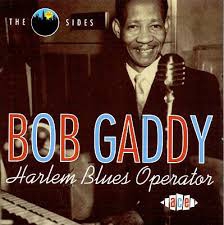
Excusez-moi de faire comme vous, qui louchez sur la plus jeune des filles de la famille lorsque l'on vous présente la digne matrone de la maison, moi dans ces séances c'est le piano de Bob Gaddy qui me fascine. Ce zigue pâteux vous l'auriez incorporé dans les Blue Caps de Gene Vincent pour par exemple baldinguer le piano sur Rocky Road Blues, l'aurait été à son aise comme dans les clubs de New York où il avait ses entrées. Question dates nous sommes en 1952 et 1954, à deux ans des premiers enregistrements du Screamin' Kid. Pas de hasard, uniquement des rencontres.
J'ai fait la fine bouche, m'en resservirais bien une louche. Presque Sonny Terryble et Brownie Mcgheeque !
Damie Chad.
LA BALLADE DE JOHN ET YOKO
( Traduit et adapté de l'anglais
par C. DERBLUM )
( Le Serpent à Plumes / 2005 )
A l'origine Le Serpent à Plume fut une revue. L'œuf du reptile fut fécond. Une maison de d'éditions en naquit. Le petit Quetzalcoalt eut la folie des grandeurs, voulut devenir aussi gros qu'un anaconda amazonien. Ce qui devait arriver arriva. Fut mangé avant d'avaler les autres. Car la forêt amazonienne littéraire est une jungle capitaliste sans pitié. Durant une dizaine d'années ce ne fut que tours de passe-passe, jeux de mécano financier et de monopoly pas très poli. Le petit ophidien qui voulait jouer dans la cour des grands se retrouva aux Editions du Rocher, ses ennemis idéologiques... Il y eut comme un infléchissement de ligne éditoriale... la suite des aventures devint complexe, sociétés mises en faillite, vendues et rachetées, selon des logiques financières qui nous échappent... Fin 2014, Le Serpent à Plumes se retrouve dans les mains d'un de ses premiers créateurs qui en avait été chassé, lors du premier rachat, et qui a dû récupérer la coquille vide pour pas très cher... Je me demande pourquoi je m'occupe tant de ce Serpent plutôt déplumé qui ne prit jamais trop de risques se contentant la plupart du temps d'éditer des auteurs étrangers très connus – c'est ce que les libéraux nomment la prise de risque – ou des auteurs du tiers-monde - c'est ce que les médias officiels appellent le développement de la francophonie - à qui l'on fait miroiter des contrats mirifiquement léonins...
Je ne suis un fan ni du Serpent à Plumes, ni des Beatles, ni de John Lennon. Et encore moins de Yoko Ono. Mais un élégant volume de poche, tout neuf, chez mon soldeur provinois préféré, à soixante huit centimes, qui pourrait refuser ?

La Ballade de John et Yoko, proprement dite, n'occupe qu'une trentaine de pages. Ecrites en 1978, elles participent pleinement des illusions hippies. Peace and Love. John y relate ses fameux bed-in avec sa chérie. Nous explique d'abord qu'il a toujours rêvé d'une femme brune et asiatique. Et plouf, manque de chance, il tomba sur Yoko et son charmant minois japonais. L'amour et la politique font-ils bon ménage ensemble ? Bien sûr que oui, lorsque l'on est aussi populaire que le leader des Beatles. L'est vrai qu'il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. L'a déjà la crémière, sa Yoko chérie, lui manque la carte de résident ad vitam aeternam au pays de l'Oncle Sam. Manifestent depuis sa chambre d'hôtel pour la paix dans le monde ce qui ne fait pas plaisir aux autorités du pays empêtrée dans la guerre du Vietnam... Les journalistes se pressent dans la chambre des tourtereaux. Les réflexions de Lennon sont d'une naïveté confondante. Pas un seul moment il n'entrevoit l'atroce vérité des médias démocratiques qui préfèrent offrir à leur public un panorama sur les deux popotins les plus célèbres de la planète plutôt que de faire réfléchir leurs lecteurs par quelques articles corrosifs sur la nature de la guerre en tant que rouage économique du marché... Se perçoit comme le grand manitou manipulateur, alors qu'il n'est qu'une marionnette que l'on agite pour distraire l'esprit des foules décervelées.
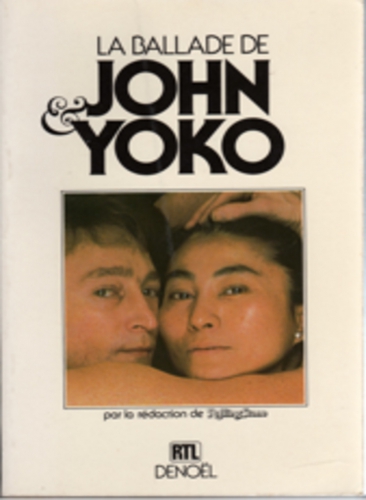
D'ailleurs élude vite le problème dès qu'autorisation de stationner à volonté sur le territoire amerloque lui est donnée. Notre penseur qui s'est dépensé sans compter se retire en sa tour d'ivoire. Retourne au travail – c'est ainsi qu'il le revendique – il s'occupe du bébé. Entre les biberons, il écrit de la poésie. Enfin un peu n'importe quoi. Ce qui lui passe par la tête. Sans queue ni cervelle. Avec caution dadao-surréaliste. Attention nous avons affaire à un intello. Dommage que son Alphabet ressemble aux galimatias que l'on retrouve dans les poèmes d'expression libre des classes de sixième. Nul n'est parfait. Même pas John Lennon. Mais contrairement aux autres, lui il ne s'en est pas aperçu.
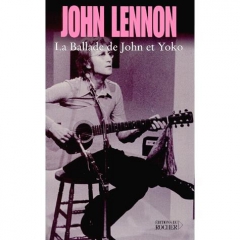
L'a tout de même des projets plus ambitieux. Ce sera Eclats de Ciel. Une oeuvre digne de ce nom. Un projet pharaonique. Un roman. De cent cinquante pages. Avec un début, un milieu, une fin. Une histoire avec deux personnages. Annoncé de cette manière, l'ensemble ne manque pas de cohérence. L'ai lu jusqu'au bout. Pour vous faire plaisir. En fait non, erreur sur toute les lignes. C'est Yoko, la veuve éplorée qui tient à conforter sa maigre pension de retraite et qui étant du genre à ne rien laisser traîner, regroupe quelques textes écrits au fil de la plume, très rapidement, sans vouloir se revendiquer de l'écriture automatique, just a thousand jokes qu'il aimait à lire à haute voix à sa dulcinée, pour éclater de rire de connivence.
De petits récits qui se suivent à la queue leu leu, délire surréaliste pour les premiers, mais au fur et à mesure que l'on avance, la réalité reprend ses droits, à la fin de simples histoires de rencontres éroticoq-amoureuses. Soyons francs, l'est parfois difficile de ne pas rigoler. De l'humour bien british, un vieux fonds de loufoquerie de Nursery Rhymes, une cacophonie cacaphonique réjouissante. Mais aussi de longs passages ennuyeux. Quand l'écriture devient un système, le lecteur ne suit plus. Se fatigue. Les répétitions abracadabrantes produisent un effet lancinant.

De quoi ça parle au juste ? De tout et de pas grand-chose. L'on a l'impression que par-devers les personnages qui n'arrivent jamais à une stabilité existentielle et affective, les phrases tournent en rond, c'est l'écriture qui se mord la queue. Mais qui comme une chienne idiote croit détenir entre ses dents le fil d'Ariane de la création poétique . Critiques de la société et de nos travers individuels sont donnés en prime et ne constituent pas la base idéologique de ces historiettes nombriliques et dépourvues de la chair du monde. Elles furent jetées sur le papier dans ces années de repliement où le couple emmuré vivant dans son bunker relationnel se referma sur lui-même comme les deux valves d'une coquille d'huître autiste. Projets avortés de dérivations personnelles à la dé-pression de Lennon, après toutes les années de pression que fut la carrière tumultueuse des Beatles. Vaut quand même mieux écouter les disques.
Damie Chad.
21:33 | Lien permanent | Commentaires (0)