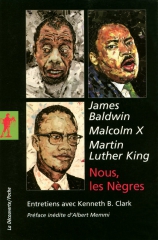31/08/2016
KR'TNT ! ¤ 292 : OBLIVIANS / GENE VINCENT - JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE / HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE / RED'S LYGTH
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 292
A ROCKLIT PRODUCTION
01 / 09 / 2016
|
OBLIVIANS / GENE VINCENT / JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE RED'S LYGHT |
BINIC FOLK BLUES FESTIVAL
( 22 ) - 30 juillet 2006

OBLIVIANS
Obliviande
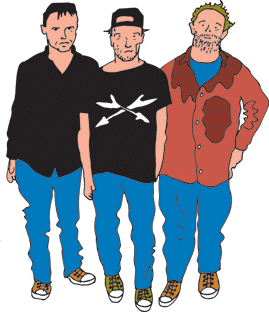
Les trois frères Oblivian sont un peu les frères Dalton du garage américain. À l’époque de leur grandeur, personne n’osait les affronter à OK Coral. Leur principal atout était la polyvalence : Greg, Jack et Eric Oblivian savaient jouer à la fois de la batterie et de la guitare, composer et screamer, ce qui leur permettait d’alterner le lead et de varier les styles.
Comme les Stooges, Jimi Hendrix, le Velvet et les Gories, ils ont aussi commencé par enregistrer trois albums qui sont devenus des albums cultes chez les garagistes : Soul Food, Popular Favorites et Play 9 Songs With Mr Quintron, tout ça sur Crypt. Avec ces trois albums et ceux des Gories aussi parus sur Crypt, la messe est dite. Amen.
Et quelle messe !

À l’époque, ces disques nous brûlaient les doigts. Trop de culte tue le culte. Le festin de Soul Food s’ouvre sur une horreur ultraïque baptisée «Viet Nam War Blues», a fuckin’ smokin’ beast, comme disait à l’époque Tim Warren, un truc aussi puissant et carnassier qu’un crocodile, bâtard, violent, vénéneux, on ne lui trouve aucune qualité. On plonge ensuite dans la pire insanité avec «Big Black Hole», chanté avec du trash plein la bouche, c’est à peine croyable, il faut l’entendre pour croire qu’un truc pareil puisse exister. Berk ! C’est screamé jusqu’à l’os du scream. Dans un concours de scream, Greg Oblivian aurait certainement battu Frank Black. Ils tapent aussi dans l’hypno du North Mississippi Hill Country blues pour «Never Change». Ils ne reculent devant aucun excès. De l’autre côté, on tombe sur ce fantastique classique garage qu’est «Blew My Cool», embarqué au riff sempiternellement effervescent. Voilà le garage désossé et ramené à l’essence du riff. Encore un petit shoot d’adrénaline avec «Bum A Ride», joué au dératé et sacrément agressif, ils tapent dans la hurlette de Memphis avec de jolies interjections orgasmiques. À l’époque, les critiques américains n’avaient qu’un seul mot en guise de commentaire : Gasp !
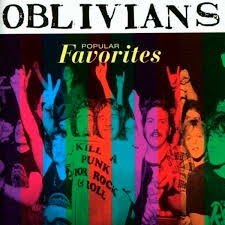
On croit qu’ils vont se calmer avec Popular Favorites. Pas du tout. Ils trash-punkent dès l’allumage avec «Christina». À dégager ! Ils développent une sorte de démesure de l’excès, dans le son, dans le beat, dans le trash. Ils balaient tout. On attend qu’ils explosent. Ils dégagent la pire pulsion primitive qui se puisse concevoir ici bas. Ils shootent une fatale injection de sténo dans la stéréo. Atroce ! Ce disque sonne comme un assaut. Avec «Trouble», on réalise subitement qu’ils se trouvent dans un trip de destruction totale. Ils réinventent même le garage sans le faire exprès. Les choses empirent encore avec «The Leather», un cut rampant, horrible, qui passe sous la moquette, c’est le vrai primitif, celui qui donne le frisson, et comme dans les cauchemars, on ne parvient pas à s’enfuir. Alors t’en veux encore ? Tiens ! «Hey Mama Look At Sis» ! Ce Greg est un psychopathe ! Dans la chanson, il lui dit de regarder ce qu’elle fait. Ça devient insupportable. Il ne la lâche pas. Tiens, et ça, «Strong Come On» ! Du Jack qui se prend pour les Beatles à Hambourg. Mais ils préfèrent nettement la brutalité, avec «She’s A Hole», c’est du sans pitié, du claqué du beignet de riff. Et dans «Bad Man», ils explosent littéralement le désossé, c’est de la soudarderie qui dépasse toutes les bornes. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec des abominations comme «He’s Your Man», saturé de fuzz, ou encore «Pinstripe Willie», trash-punk de la dernière heure. Tout semble définitif sur cet album du non retour.
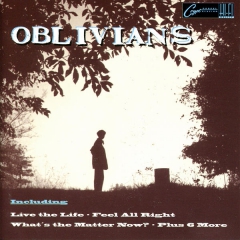
Mais non, car le pire est à venir. Play 9 Songs With Mr Quintron est un disque parfait. Les 9 cuts sont d’épouvantables classiques du garage moderne. On sent même le vent du génie dans «Feel All Right», une vraie merveille de pulsatif définitif. C’est mouliné au riff insidieux, relancé aux raids de Memphis, à coups de I wanna know, et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue il faut voir comme. Avec «I May Be Gone», ça hurle dans les coursives. Voilà un cut possédé par le diable. Si on s’intéresse à la démence pure, c’est cet album qu’il faut écouter. Nouvelle exaction avec «I Don’t Wanna Live Alone», battu et rebattu au riff de fuzz. Voilà la magie des Oblivians. Ils nous sortent le meilleur stomp de Memphis et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue, comme s’il arrosait le stomp de crème anglaise un peu tiède. Ils tapent carrément dans l’exponentiel avec «Final Stretch» et Greg fait son numéro de hurlette des Hauts de Hurlevent. Tout est incroyablement dense et bon sur cet album. Et voilà «What’s The Matter Now», échantillon de Memphis punk explosé au coin du bois. Quelle énergie ! De vrais rebelles. Des invaincus ! Ces mecs sont tout simplement invincibles. Ils sont terrifiants de classe. Ils dépassent encore les bornes avec «Ride That Train». Et là on se dit que c’est trop. Trop de classe, trop d’énergie, trop de son, on voudrait leur dire d’arrêter, mais ils n’écoutent pas, ils explosent tous les standards de manière quasiment automatique. Ils pulsent jusqu’à l’aube et ils enchaînent avec un beat mortel de la mortadelle, «If Mother Know», le garage de la dernière chance, ils plombent le stomp du groove droit dans la grave, énorme et fatidique, pire que la rivière sans retour. Et Mr Quitron nous nappe ça impitoyablement. Ouf, on arrive au dernier cut, «Mary Lou», encore une abomination chantée d’autorité, ils crucifient le cercueil du garage qui va renaître sur la berge du Mississippi, ils sortent pour ça un beat buté et de la hurlette de dératé, et Mary Lou s’en va caramboler le firmament.

Il y a encore deux ou trois choses des Oblivians que tout esprit déviant doit écouter. Par exemple ce Best Of The Worst (93-97), capable de hanter un château d’Écosse. On y trouve un «Indian In Me» joué sur le sentier de la guerre, avec sa dose de référence au National Indian Reservation. C’est aussi sauvage que du Link Wray. On trouve aussi l’effarant «Bald Headed Woman», pur jus de trash-garage joué à la vrille de fuzz dégueulasse. Ils poussent le trash comme grand-mère, d’un coup d’épaule dans les orties. Même chose avec ce fantastique «Don’t Haunt Me» joué à l’admirabilité des choses, ils pataugent dans l’épaisseur d’un garage noyé de distorse, hanté par des cris d’horreur et des solos égarés. On retrouve des exactions comme «Hey Ma Look At Sis» et une version de «Locomotion» joué à la clameur virulente. «The Losing Hand» est l’archétype du trash d’Obliviande, fracassé à l’extrême. On se croirait chez le boucher, dans la pièce du fond. On trouve aussi une cover du «Alone Again Or» de Love et un «Kick Your Ass» enfoncé à coups de talon dans le néant du trou du cul du monde, et d’autre horreurs qu’il vaut mieux éviter d’écouter si on est d’une nature délicate, comme «Mad Lover», «Blew My Cool» ou «Everybody But Me». C’est l’affreux Long Gone John qui sortait ces disques sur son label Sympathy. Ah la canaille !

Il fit aussi paraître deux maxis, les fameuses Sympathy Sessions, avec des filles nues sur les pochettes. Ce n’est que du coup de génie à répétition, de l’overdose de garage fuzz trash joué à deux guitares invertébrées («Never Enough» et «Feel Real Good»), la beauté s’élève du chaos de distorse, il faut avoir vu ce spectacle au moins une fois dans sa vie. Ils font aussi du speed garage explosif et défonceur de rondelle des annales avec «Shut My Mouth». Le solo qui traverse le cut vaut pour une dégueulade de Memphis take.
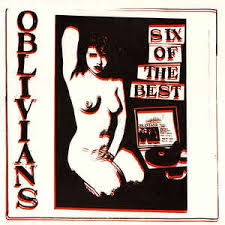
L’autre maxi s’appelle Six Of The Best, et dès «Clones», on tombe de la chaise, car c’est gratté au sec de la dépouille de Memphis. Ils savaient jouer de la guitare tuberculeuse. Ils rendaient aussi hommage aux racines du garage avec un «No Time» vitupéré et esquissaient l’avenir du garage moderne : gras et sale, saturé de crasse de son. «Memphis Creep» ? Laissez tomber, les gras. C’est au-delà du génie. Voilà un modèle de retenue et de tact trash absolument unique au monde. Sans commune mesure avec la mesure. C’est le garage du paradis des fosses à vidange. Ça continue avec l’infernal «Something For Nothing» et «Big Black Hole», pure tranche d’Obliviande fumante, jouée aux accords de gras double avec des wooohh dignes de Little Richard et un killer solo définitivement privé d’avenir.

Les Oblivians se reformèrent en 1993 et enregistrèrent Desperation, un album indispensable pour trois raisons. Un, l’«I’ll be Gone» d’ouverture de bal, du garage pilonné et harcelé par des arsouilleries mélodiques dont est si friand l’ami Greg. «Call The Police» flirte aussi avec le génie, d’autant plus que Mr Quintron et Miss Pussycat sont invités à participer au festin. C’est d’ailleurs Mr Quintron qui chante. On atteint une nouvelle fois les sommets du Memphis garage, c’est soutenu au meilleur beat et bien nappé d’orgue. Mr Quintron chante comme un diable. En B, on trouve la troisième raison : «Little War Child». Voilà la patte de Jack, cette incroyable aptitude à composer des cuts qui sonnent comme des hymnes dès la première mesure. C’est une réalité à laquelle il va falloir s’habituer, les gars : Jack-O est l’un des grands songwriters des temps modernes. On tombe plus loin sur «Back Street Hangout», encore du Jack, du vrai bardé de classe, une danse de décibels décidément dodus au dedans du doute et c’est comme visité par un solo aérien.
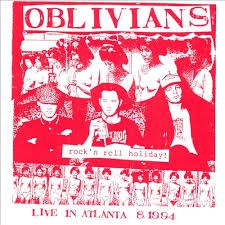
Il existe deux albums live des Oblivians, un Rock’n’Roll Holiday enregistré à Atlanta en 1994 et Barristers Ninetyfive paru en 2009. On s’en doute, c’est dans les deux cas du concentré d’insanité. Ils attaquent leur set d’Atlanta avec «Motorcycle Leather Boy» - Awite ! Let’s rock ! - Greg est complètement fou. C’est bizarre qu’on ne l’ait pas interné, à l’époque. Leur «Viet Nam War Blues» semble monté sur le riff de Death Party. «Love Killed My Brain» est l’un des hits planétaires des Oblivians. Greg le chante au gore de trash et «No Reason To Live» vaut pour un modèle d’insanité qui devrait servir de modèle dans toutes les facultés de médecine. Encore plus explosif, cette version de «Shut My Mouth» joué avec l’énergie du diable, il n’existe pas d’autre explication. Et on retrouve ces coucous inexorables que sont «Blew My Cool», «Shake Your Ass» et un «Nigger Rich» joué dans la pire des démesures, car gratté jusqu’à l’os du raw to the bone. Et ça se termine bien sûr dans la fournaise définitive avec «Never Change». Les Oblivians, ça ne pardonne pas.

Avec Barrister, on retrouve grosso-modo les mêmes excès. Greg hurle son «Losing Hand» à la vieille ramasse d’obliviande carabinée, c’est tellement mal foutu qu’on s’en étrangle de bonheur. Ah si on aime la délinquance juvénile et le foutraque, c’est eux qu’il faut écouter. Leur version de «We’re The Doll Rods» dégueule littéralement de distorse. Et ils battent comme plâtre ce pauvre «Mystery Girl». Ils atteignent là une sorte d’apothéose sauvage, ils clapotent dans leur bouillasse binaire de boudin de sang royal archétypal. Inutile de commenter la version de «Viet Nam War Blues», ni celle de «Pill Popper» qui ouvre la B. Ils sont sans pitié pour les canards boiteux. Jack passe au micro et à la guitare pour «Strong Come On» et il tâte de l’apanage de garage sacré avec «Let Him Try», offrande suprême aux dieux du garage des temps anciens. C’est en effet une reprise des mighty Makers. Il enchaîne cette merveille avec une autre merveille, «Black September», un cut de power-pop signé Jack-O, emmenée à train d’enfer après un faux départ. C’est dans la veine du grand Jack, cet immense songsmith. Il finit avec l’effarant «Clones», dans l’obliviande hachée poussée dans le tourbillon par un phrasé frelon.

Retour à Binic pour une belle tranche d’Obliviande saignante. Nos trois héros entrent dans l’ère de la reconnaissance puisque les voilà hissés en tête d’affiche. Cadre idéal pour ces figures de proue de l’underground américain, car ils jouent devant un public conquis d’avance, ce qui est généralement le cas dans les concerts gratuits. Les gens adorent tout ce qui est gratuit, même si la musique n’est pas d’un abord facile. Pour un néophyte ou un téléramiste, le trash-punk des Oblivians doit paraître un peu âpre. Mais c’est justement ce que cherchent les amateurs, la grosse âpreté, celle qui fait hocher la tête en rythme.

Quelle joie que de revoir arriver Greg Cartwright sur scène, avec sa dégaine de prof de math, et Eric Oblivian, avec sa dégaine de magasinier chez Renault. Derrière eux, l’éternellement jeune Jack bat le beurre pendant la première moitié du set. Ils enfilent leurs hits comme des perles et on sent bien qu’avec l’âge, ils finissent par se calmer. Ça fait tout de même trente ans qu’ils jouent ces classiques insurrectionnels, ne l’oublions pas. Eric et Greg claquent bien leurs accords au beignet de crabe, mais ils semblent vaccinés contre la rage. Ils n’ont plus cette démesure qu’on trouve encore chez les Gories. Quand on suit Greg Cartwright à la trace et donc son parcours discographique avec Reigning Sound, on sait qu’il aspire à des choses plus paisibles, ce qui n’est absolument pas le cas de Mick Collins, si on reste dans le parallèle avec les Gories, ni de Jack Yarber, comme on le voit lorsqu’il arrive au micro et qu’il commence à taper dans ses vieux coucous défenestrateurs comme «Blew My Cool».

Jack est le plus incorrigible des trois. Et on a vraiment l’impression de voir jouer une superstar. Il dégage ce type de rayonnement. C’est Jack qui relance cette prodigieuse locomotive, d’autant que derrière, son copain Greg tape comme un sourd sur les fûts. Chaque fois qu’on les voit jouer, on se dit qu’ils sont le groupe idéal, car en alternant les rôles, ils se débarrassent du problème que peut poser le leadership. Pas la moindre de frime non plus, chez ces gens-là. Ils ont tout bon.
Avant de former les Oblivians avec Eric Oblivian, Greg et Jack jouaient déjà dans les Compulsive Gamblers qu’il reformèrent après le split des Oblivians, en 1996. Un bon conseil, mettez le grappin sur les trois albums des Compulsive, car si vous appréciez le compulsif, vous serez compulsé comme il se doit.
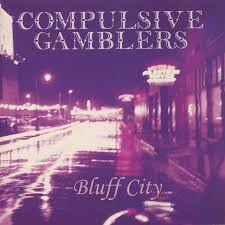
Bluff City et Crystal Gazing Luck Amazing sont leurs deux albums enregistrés en studio et dès Bluff, on sent le trio accompli, à l’immense majorité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Bluff City est le surnom de Memphis, de la même façon que Brum City est le surnom de Birmingham. On trouve une grosse pièce de stonesy sur Bluff, «I Call You Mine». En gros, ça sonne comme «The Last Time» gratté par les Who. Greg brame ça dans la Brum de Bluff. Quelle persévérance dans la latence ! On retrouve en B le fameux «Don’t Haunt Me» joué au heavy groove des familles. On retrouve l’énergie de l’Obliviande dans «X Ray Eyes», pour cette fois une petite pointe d’excellence de la consistance. C’est en plus superbement soloté et avenant en diable. On les sent sans peur et sans reproche, libres comme l’air, bercés par les alizés et avides de bon temps. Il faut aussi écouter «Mystery Girl», rudement bien secoué du bocal et réveillé en sursaut par des clameurs soniques, des petits retours de manivelle et une belle dose de ramasse à la clé de sol.

Crystal Gazing est encore plus énervé. On le voit bien, dès le premier cut, «The Way I Feel About You», riffé à l’Obliviande et chanté à la tendance mélodique. Tout y est : l’impatience, les échappées, les départs de feux et l’ébullition. Deux autres merveilles illuminent l’A : «Negative Jerk», garage punk emmené à train d’enfer, et «Stop And Think Over», magnifique hit de power pop incroyablement lumineuse, une vraie perle rare, bien portée par son élégante bassline. C’est à la fois inspiré, brillant, élancé et sans faille. On est à Memphis, ne l’oublions pas. La B vaut aussi le détour avec des choses comme «I’m That Guy», monté sur les accords de «Gloria». Personne n’ira leur faire des reproches. Ils ont le droit de pomper Gloria. Ils tapent aussi dans un vieux hit de Nolan Strong composé par Miss Deborah Brown, la patronne de Fortune Records, «(I Want To Be Your) Your Happiness». Ils jouent à l’Obliviande caractérisée, ils en sortent une version incroyablement musclée. Cut idéal pour des esprits aussi libres que ceux de Jack et de Greg, et puis on se régale de ce petit départ en solo. Ils sont parfaits. Encore un hit de Jack avec «Rock’n’Roll Nurse», lancinant et vaillant à la fois, slow & hypnotic comme dirait Long Gone Jone.
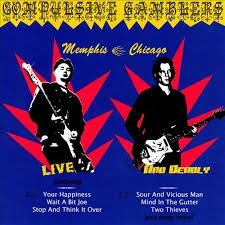
Live And Deadly - Memphis/Chicago vaut le détour, car ça saute à la gorge dès «Your Happiness», reprise du cut de Deborah Brown. Jack et Greg en font un hit ensorcelant. Ils shootent toute leur énergie dans le cul ridé de cette vieille pépite de soul. Rien que pour cette reprise, l’album vaut d’être rapatrié. Attention, ce n’est pas fini. Ils nous font du Question Mark & the Mysterians avec «I’m That Guy». C’est nappé d’orgue, avec de la tension garage - In my room/ All alone - et la montée de fièvre qui va avec - Baby I’m that guy on about - et ils oh-yeatent comme des brutes. Avec «Stop And Think Over It», Greg revient à sa chère power pop. Il laisse échapper des floppées de notes multicolores. Voilà une pop de rêve digne des Nerves. On reste dans l’énormité avec un «Two Wrongs Don’t Make A Right» terriblement alerte, bardé de nappes d’orgue et de gros accords dylanesques. Si ce n’est pas du génie, alors qu’est-ce que c’est ? On voit encore l’immensité du talent cartwrightien s’étendre à perte de vue avec «I Don’t Want To Laugh At You». On sent que Greg a bouffé du Dylan et de la soul. Ça lui ressort par tous les pores de la peau. Il en deviendrait presque visionnaire.
Et si on mettait le nez dans les albums solo de Jack ? Il faut bien dire que Jack-O ne chôme pas depuis 1997. Son palmarès est franchement éblouissant. Dans l’underground, il reste une star et ceux qui le connaissent pour l’avoir vu jouer soit avec les Oblivians à la Maroquinerie, soit avec les Knaughty Knights au Point Éphémère ou avec les Cool Jerks à l’Espace B, oui tous ceux là savent qu’il l’avoir à l’œîl. Partons du principe suivant : sur chaque album solo de Jack-O se niche un hit planétaire.
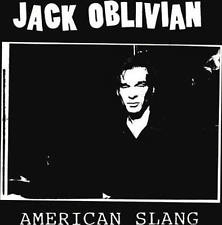
Il a commencé sa «carrière» solo par deux maxis, American Slang et So Low. L’«American Slang» qui donne son titre au premier maxi sonne comme un hymne. Jack-O chante perché, comme s’il reprenait un hit des Dictators. C’est même gonflé par des guitares à la Johnny Thunders. Quel jus ! Scott Bomar joue une belle partie de basse sur «Hustler» et on retrouve le foutraque typique du Memphis Sound. En B, ils tapent un «Got The Funky Blues» au beat tribal à la Captain Beefheart et Jack s’amuse bien avec «Out Of Tune», un groove bien gras et bien râblé.

Sur So Low, on trouve un «Shake It Off» gratté à la sauvage par Greg. Ils sortent là un vrai son primitif, un incroyable désossé de la désaille. Toute la science ancestrale est exacte au rendez-vous. Ils tapent ensuite une belle reprise des Dolls, «Trash» et Jack finit l’A avec un fantastique «Let Me Be Your Chauffeur». En B, on retrouve un léger parfum de Magic Band dans «You Made Me Crazy», très dada dans l’esprit et saxé à la basse du néant.

À partir de là, Jack-O va embarquer avec lui une fière équipe, The Tennessee Tearjerkers et enregistrer de solides albums, comme ce Don’t Throw Your Love Away paru en 2001. Il y rend un fantastique hommage à Dylan avec un cut intitulé «Still Got It Bad», un balladif de poids nappé d’orgue Hammond. Il ne faut surtout pas prendre Jack-O pour un amateur ou un bricoleur du dimanche. Ce mec navigue dans la cour des grands, en compagnie de gens comme Frank Black ou Robert Pollard. L’«Ain’t Got No Money» qui ouvre le bal de l’A est tout simplement claqué au riff royal de Memphis et brouté aux nappes d’orgue. C’est nettement au dessus de la moyenne. «Dope Sniffin’ Dog» relève de l’énormité garagiste, car c’est alarmé du cortex avec des yeah de baryton à la Iggy. Voilà le garage dont Jack-O a le secret, un garage à fort parfum stoogien dans la façon de ramper sur les braises en poussant des yeah miséricordieux. Il revient à sa passion dylanesque en B avec un «Flash Cube» extraordinaire d’élégance. Encore un cut puissant et inspiré. Il tâte plus loin du solide romp de rock avec «Fire» et le farcit de dégelées de guitare fratricides. Ces gens-là savent brûler Rome.

Il continue de faire du Dylanex sur Jack-O Is The Flipside Kid. Le cut se trouve en B et s’appelle «Black Boot». Jack-O sonne tout bêtement comme le grand Bob de l’âge d’or. Mark Sultan l’accompagne à la batterie. On a aussi un coup de génie avec le cut qui donne son titre à l’album : «Flip Side Kid». Il s’agit là d’un rock à vocation de stonesy, mais orienté vers Memphis. On assiste là à l’explosion d’une véritable clameur d’envergure brutale. Jack-O tire ça à la force du poignet et place un solo d’antho à Toto. On retrouve aussi sur cet album des gens comme Jimbo Mathus et Harlan T. Bobo. Les autres hits sont en B, notamment ce «I Live For Today», battu par Mark Sultan. Jack-O y pétrit sa pop flamboyante et rend une nouvelle fois hommage à Bob Dylan. Il reprend aussi le fameux «The Man Who Loved Cough Dancing» de Mr. Jeffrey Evans et en fait une version instro superbe. Jack-O retrouve plus loin son cher débraillé foutraque avec «Night Owl», espèce d’apothéose de good time music et boucle avec une stoogerie de haut rang, «I Want You» joué au reptilien, nappé d’orgue et chanté dans la torpeur d’une profonde inquiétude paranoïaque.

Encore un énorme album avec The Disco Outlaw. Il l’attaque avec «Ditch Road», un fantastique cut de pop rock du Tennessee. Jack-O est un auteur classique qui sait monter des coups fumants. Son cut est imparable, éclairé par le jeu du guitariste John Paul Keith et soutenu par la belle bassline d’Harlan T. Bobo. Tous les morceaux de cet album sont fouillés, chargés de son, bien construits, On goûte la succulence de l’effarance avec «Against The Wall» qui sonne comme un classique avec des vieux relents de «Drop Out Boogie». «Make Your Mind Up» sonne comme un hit pop planétaire. Voilà de quoi notre héros se montre capable. C’est digne des meilleurs jukes et troussé à la hussarde. Il prend ensuite «Sweet Thang» à l’hypno de Memphis, et ça trépide, avec une grâce infernale. Quelle énergie et quelle puissance dévastatrice ! En B, John Paul Keith embarque «Scratchy» dans la clameur d’un solo incendiaire. Ils nous explosent ce vieux classique des sixties. Et ça va se terminer avec «Stop Stalling» bien soutenu à l’orgue et «Walk Of Shame», un nouvel hymne pop. Ce mec n’enregistre que des disques condamnés à l’île déserte.

Encore un maxi avec Saturday Night Part 2 et au moins quatre raisons de le rapatrier. Un, «Mad Love Pt 2», pur jus de garage de Memphis, rythmé au foutoir de grosse caisse et John Paul Keith joue un solo à l’insidieuse. Deux, «Milkshake Baby» qui ouvre la B avec un riffing sauvage et dévoyé, ambiance Cubist Blues, c’est-à-dire groove urbain avec des faux airs d’Alan Vega. S’ensuit la troisième raison, «Make Your Mind Pt 2», joué à la dépouille, à la fois classieux et classique. Et quatre, «Against The Wall Pt 2», toujours dans l’insidieuse, avec ce vieux relent beefhartien et joué au gras double.

Les Tearjerkers entrent dans la légende en 1999 avec l’album Bad Mood Rising. Explosion d’énergie dès «White Lie Black Eye». Ça dégouline de jus. Scott Bomar joue de la basse. Retour à la power-pop de sang royal avec «Stupid Cupid». Ça sent bon le Big Star Sound et la complexité pharaonique de la belle pop américaine. En B, il faut absolument écouter «Head Of The Class Clowns», qui sonne bien dès la première mesure. Voilà le génie garage de Jack Yarber. Il enchaîne ça avec un autre cut brillant, «Earthquake Date», du garage punk dératé monté au riff sur-puissant.
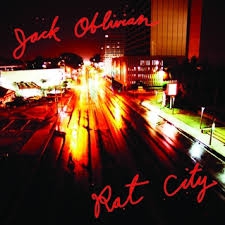
On frôle un peu l’overdose avec tous ces disques, et pourtant on y revient. Tiens ! Voilà Rat City paru en 2011 sur Fat Possum. Ce n’est pas compliqué, on y trouve deux hits, à commencer par celui qui donne son titre à l’album, qui est lancé comme une locomotive et Jack-O se montre une fois de plus imparable et lumineux. Quand on voyait ce mec traîner à l’espace B le jour du concert des Cool Jerks, on n’était pas loin de penser qu’il avait au pire une allure de rock star et au mieux le charisme d’un messie. John Paul Keith joue lead dans «Mass Confusion», monté sur un beau beat funky. Ça pulse comme au temps de l’âge d’or du swamp funk. L’autre hit du disque c’est bien sûr «Kidnapper», doté d’un fort parfum de country rock et finement nappé d’orgue. On y retrouve tout l’allant du rock du Tennessee.
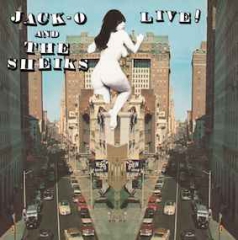
Jack-O se produit maintenant avec une nouvelle formation, Jack Oblivian & The Sheiks, et un premier album intitulé Live. Quatre bombes sur cet album, à commencer par le retour du vieil «American Slang» tiré de son premier mini-album solo. Fabuleux classique de power-pop. Imparable et juteux. Jack Yarber reste avec le temps désarmant de fraîcheur et d’aisance. Avec une telle entrée en matière, la partie est gagnée d’avance. Il ressort aussi l’infernal «Black Boots» digne des grands hits de Bob Dylan. Il éclate ça au ramalama d’accords magiques. Il ressort aussi ses vieux hits, «Night Owl» et «Flash Cube». En B, on retrouve l’excellent «Little War Child», belle tranche de power-pop universaliste. Avec Jack-O, ça joue avec le feu, ça lève le vent, ça file droit au cœur et ça mène au but. Il finit en beauté avec son vieux «Strong Come On» de l’époque des Oblivians.

Jack Oblivian & The Sheiks viennent d’enregistrer un nouvel album, The Lone Ranger Of Love. Eh oui, encore un album surprenant et si dense ! Trois merveilles caractérisées s’y nichent, à commencer par l’infernal «Hey Killer», une pop à la Jack-O pleine d’allant. Il faut l’entendre emmener ça fièrement à l’assaut des hit-parades ! Même chose avec «Downtown», pur Jack-O jive, écœurant de classe garage. On se noie dans une sauce d’obédience obliviande. D’autres gros cuts avec «Blind Love», dégringolade d’exception qui brille dans la nuit comme une idée géniale, et «Boy In A Bubble» qui marque un retour au garage. En B, attention au morceau titre, car il sonne un peu comme «Teenage Head» et un petit serpent de solo gras l’enfile en douce. On se régalera aussi des deux parties de «La Charra» grattée au gratin de menace dauphinoise, c’est joué au harcèlement apache, à petites touches infectueuses. Par contre, avec «Run Like The Wind», Jack tape un groove salubre émaillé de piano à la Aladdin Sane, dans une ambiance digne de Soon Over Babaluma. C’est à la fois exceptionnel et surprenant.

Jack monta les Cool Jerks avec David Boyer des Neckbones et ils enregistrèrent l’excellent Cleaned A Lot Of Plates In Memphis en 2002. On sent chez David Boyer une forte influence des Dolls et des Stones. «Not The Only Girl In Town» sent bon le vieux boogie des Dolls. C’est très inspiré. Ce mec semble totalement fasciné. On pourrait dire la même chose de «Who You Running To», car ça sonne comme un hit des Stones de la grande poque. On sent que David Boyer peaufine ses préférences. Avec «Why Can I», Jack et David passent directement au coup de génie. Ce démon de Jack Yarber ravage tout. Et il vrille la charpente du cut à coup de solo insidieux. Jack est vraiment le roi de la bravado. Encore de l’énormité à gogo avec «Got Damned Again» et un «Certified Fool» embarqué au riff diabolo. Voilà comme sonne le rock échevelé de Memphis, puissant et définitif. Tout l’album est bon. Trop bon. Jack pulvérise «Let’s Go And Rock» et nous fait même friser l’overdose avec «Friend Of A Loner» qui sonne tout simplement comme un hymne.

N’oublions pas l’épisode South Filthy, conglomérat de notables puisqu’on y trouve Monsieur Jeffrey Evans, Walter Daniels et bien sûr Jack Yarber. Trois album, même quatre, si on ajoute l’excellent Melissa’s Garage Revisisted paru en 1999. Leur boogie sent le fauve, on le voit tout de suite avec «It Don’t Take Too Much». Ils semblent possédés par le diable, mais un diable particulier, celui du Tennessee. Le «Rocking In The Graveyard» qui suit semble lui aussi ravagé par des guerres intestines, et c’est monté sur un beat rebondi et noyé dans le gras double. Nos amis les franc-tireurs s’amusent à créer du garage ténébreux, chargé de maladies et très insécurisé. Ils font une surprenante reprise de Marty Robbins, avec «Don’t Worry», bien congestionnée par un solo de déglingue affreusement malsaine. Ces rebs sont très indisciplinés. Dans «The Darker The Berry», la voix de Jeffrey Evans est couverte par une fuzz acariâtre. Ils tapent plus loin dans Lowell Fulson avec un «Bending Like A Willow Tree» assez furieux. Sacré disque. Aucune concession.

Le premier album de South Filthy s’appelle You Can Name It Yo Mammy If You Wanna. Sur la pochette, on voit une pute noire. Image très impressionnante. Les cuts sont à l’image de la pochette, marginalisés d’office. Justement ils attaquent avec un «Bad Girl» foutraque que Walter Daniels vient hanter à coups d’harmo. Quelle santé ! Monsieur Jeffrey Evans renoue avec le génie dès «Hot Dog», joué à la stand-up. C’est du pur rockab de Memphis. Puis il tape dans Wolf avec «Somebody In My Home». Là on ne rigole plus. Jeffrey Evans fait tout le boulot et il wahaoooute à la lune. Il chante du nez et recrée le temps d’un cut l’illusion de la légende de Wolf. Et comme si de rien n’était, il passe à la country magique, celle de Memphis qui ne doit rien à celle de Nashville. Il faut écouter ce «Sandra Lynn’s Blues» pour bien comprendre la différence. Jim Dickinson en parlait d’ailleurs très bien - I’m gonna marry her some day/ Some day - Encore une énormité avec «LA Country Jail» du boogie rock à tomber de sa chaise. C’est crédité Jeffery Lee Pierce et John Schooley y joue de la slide. Notre collectif intrépide reste dans l’excellence du boogie avec «First Train Away From You», une compo signée Jack. Si on aime les tours de magie, alors il faut écouter «Spyder Blues» de Monsieur Jeffrey Evans, un authentique blues de cabane - It’s called spyder blues/ Cripplin’ around my window before the sun - Rien de plus inspiré.
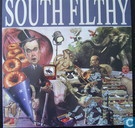
Jack retrouve ses amis Monsieur Jeffrey Evans, Jimbo Mathus, Walter Daniels et tous les autres sur Crackin’ Up, un album bardé de reprises superbes, dont un Wolf qui s’appelle «You Can’t Put Me Out» - I’m so down/ You can’t put me out whoooo-ouuuhhhh - pure énormité. On trouve aussi un fabuleux «Ran Out Of Run» qui sonne comme un classique dylanesque. Monsieur Jeffrey Evans y raconte ses mémoires. Encore du dylanesque avec «Original Mixed-Up Kid» qui est en réalité une reprise de Ian Hunter - Pour la petite histoire rappelons que Guy Stevens voulait monter un groupe qui sonnât à la fois comme Dylan et les Stones, et ce fut Mott The Hoople - Et donc Hunter se mit à pomper Dylan pour composer. Le hit de cet album se niche aussi en B. Il s’agit de «Ol Brush Arbor», un balladif folkah de Monsieur Jeffrey Evans qui tourne à l’enchantement. Et Eugene Chadbourne vient jouer du banjo sur «Flaming Star» - When I see the flaming star/ I know the time has come - Jack prend le micro pour «C’mon Let’s Monkey» et il mène la danse, comme il sait si bien le faire.
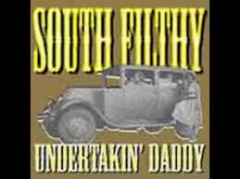
Tiens, encore un sacré disque ! Undertaking Daddy est sorti sur Beast en 2009, oui, sur ce petit label rennais qui fait maintenant tout le boulot. Si vous aimez le boogie foutraque à la sauce de Memphis, alors il faut écouter «The House On Old Lonesome Road», emmené par Monsieur Jeffrey Evans au pas de charge. Voilà du vieux boogie de bois sec tartiné à coups d’harmo. C’est d’ailleurs le seul morceau de l’album sur lequel joue Jack. Ils font ensuite une reprise du cut de Bo que préfère Keef, «Bring It To Jerome». Monsieur Jeffrey Evans en fait du Wolf ! Ils finissant l’A avec deux autres boogies de haute volée de bois vert dont un «Dimples» sacrément secoué du cocotier. Monsieur Jeffrey Evans attaque la B avec un coup de rockab de Memphis, «Watching The 710 Roll By», une espèce de modèle du genre, histoire de rappeler que tout a commencé dans cette bonne ville du Tennessee.

Pendant ce temps, Greg Cartwright n’est pas resté inactif. Il jouait dans des groupes comme des Detroit Cobras et en produisait d’autres comme Mr Airplane Man. Avant de monter de Reigning Sound, Greg s’est amusé à enregistrer un album complètement foireux, «Head Shop». On avait commandé ce disque directement chez Long Gone John, en Californie. Ah la tête qu’on a tiré quand on a écouté ça !

Et puis avec Coco des Ettes, il a monté en 2010 les Parting Gifts et enregistré un album qui nous console de toutes nos peines, Strychnine Dandelion. C’est encore un album de l’île déserte, car les hits y pullulent. Ils chantent à deux «Bound To Let Me Down» et ça donne un cut qui pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc des Beatles, avec sa belle ambiance rondouillette. Une merveille. C’est la pop de rêve que Greg n’avait peut-être pas réussi à sortir avec les Detroit Cobras. Notons au passage qu’on retrouve les deux Black Keys sur cet album. «Starring» sonne comme un hit. C’est un hommage magistral à baby’s in black - And yesterday ain’t coming back/ It’s time to start to think about that - Il enchaîne avec un «Don’t Stop» très punky et infesté de killer solos. Greg les étale dans la poussière, les deux bras en croix. Une vraie furie ! On trouve trois hits monstrueux enchaînés en B : «Don’t Hurt Me Now», chanté au grégorien de haut rang et joué très sixties à l’encorbellement licencieux qui telle la liane enserre la colonne du temple d’Amon. Justement voilà «Hanna», encore du grand art grégorien. Sa pop a quelque chose de profondément infectueux, il faut bien le reconnaître. Elle finit toujours par nous avoir - That’s how it’s gonna stay ! - Et le festival se poursuit avec «I Don’t Wanna Be Like This», une fantastique échappée belle de pop visionnaire. Goûtez donc la puissance du refrain, c’est joué à grands coups de reins, ça jute dans l’énormité et voilà encore un hit intemporel ! Il faut aussi écouter le cut qui donne son titre à l’album, car il dérouterait n’importe quel cargo. Et le «This House Ain’t A Home» qui referme la marche est lui aussi de qualité supérieure.
Signé : Cazengler, obli terré
Oblivians. Binic Folk Blues Festival (22). 30 juillet 2016
Oblivians. Soul Food. Crypt Records 1995
Oblivians. Popular Favorites. Crypt Records 1996
Oblivians. Rock’n’Roll Holiday. Negro Records 1996
Oblivians. Play 9 Songs With Mr Quintron. Crypt Records 1997
Oblivians. Barristers Ninetyfive. In The Red Recordings 2009
Oblivians. Desperation. In The Red Recordings 2013

Oblivians. Never Enough. Sympathy For The Record Industry 1994
Oblivians. Six Of The Best. Sympathy For The Record Industry 1995
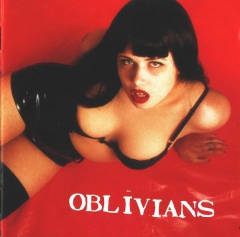
Oblivians. Sympathy Sessions. Sympathy For The Record Industry 1996
Oblivians. Best Of The Worst (93-97). Sympathy For The Record Industry 2000
Jack Oblivian. American Slang. Sympathy For The Record Industry 1997
Jack Oblivian. So Low. Sympathy For The Record Industry 1998
Greg Oblivian & The Tip Tops. Head Shop. Sympathy For The Record Industry 1998
Compulsive Gamblers. Bluff City. Sympathy For The Record Industry 1999
Tearjerkers. Bad Mood Rising. Sympathy For The Record Industry 1999
Walter Daniels, Oblivians & Monsieur Jeffrey Evans. Melissas’s Garage Revisited. SFTRI 1999
Compulsive Gamblers. Crystal Gazing Luck Amazing. Sympathy For The Record Industry 2000
Compulsive Gamblers. Live And Deadly - Memphis/Chicago. Sympathy For The Record Industry 2003
Jack-O & The Tearjerkers. Don’t Throw Your Love Away. Sympathy For The Record Industry 2001
Cool Jerks. Cleaned A Lot Of Plates In Memphis. Sympathy For The Record Industry 2002
South Filthy. You Can Name it Yo Mammy If You Wanna. Sympathy For The Record Industry 2002
South Filthy. Crackin’ Up. Rockin’ Bones 2005
South Filthy. Undertaking Daddy. Beast Records 2009
Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. Jack-O Is The Flipside Kid. Sympathy For The Record Industry 2006
Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. The Disco Outlaw. Goner Records 2009
Jack Oblivian. Saturday Night Part 2. Big Legal Mess records 2009
Parting Gifts. Strychnine Dandelion. In The Red Recordings 2010
Jack Oblivian. Rat City. Big Legal Mess records 2011
Jack Oblivian & The Sheiks. Live. Red Lounge Records 2014
Jack Oblivian & The Sheiks. The Lone Ranger Of Love. Mony Records 2016
LES ANGES NOIRS
I
JIM MORRISON
ET LE DIABLE BOITEUX
MICHEL EMBARECK
( L'Archipel / Août 2016 )
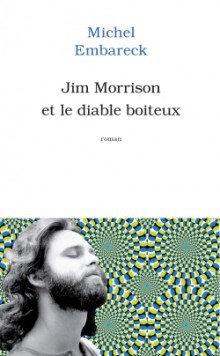
Tout se perd dans ce bas monde. Parfois les perles les plus belles gisent au fond de la mangeoire des pourceaux. C'est dans Les Echos - torchon économique à la solde du libéralisme - que j'ai appris la sortie de Jim Morrrison et Le Diable Boiteux. Et de Michel Embareck, par-dessus le marché ! Un gars que je connais depuis toujours. Je n'exagère pas, l'est né un an après moi, le jeunot. L'a ses lettres de noblesse, publie dans la Noire de Gallimard des polars plus sombres que l'encre des rotatives les plus désespérées, et l'a écrit en sa jeunesse dans un des meilleurs french canards rock, logiquement vous avez reconnu le mensuel Best. Cela vous classe un homme. Ce qui ne l'empêche pas, comme tout un chacun de se poser des questions. Attention amis rockers, le titre est trompeur, le bandeau de couverture - beau portrait du Roi Lézard sur fond de rosaces psychédéliques - aussi. Pour le diable boiteux, faut être un peu initié, référence au titre d'un reportage de Bonjour Les Amis sur... Gene Vincent.

L'est parfois des problèmes qui vous turlupinent durant des années. Pour Michel Embareck, une de ses obsessions réside en l'étrange amitié qui unit de 1968 à 1971 Gene Vincent et Jim Morrison. Quoi de plus normal que deux chanteurs de rock aiment à se rencontrer autour d'un verre ? Avec Jim et Gene, nous ajouterons plusieurs tournées. J'apporte mon témoignage personnel. L'annonce de cette fréquentation me sembla en ces époques couler de source. Expression ô combien malheureuse pour ces deux alcooliques pas du tout anonymes. Fus simplement déçu que Jim n'ait pas été présent sur la cire de I'm Back I'm Proud ( 1969 ) comme l'annonce qui avait fuité le laissait espérer. Cela eût permis de relancer la carrière de Gene. L'on parla de clauses de contrats chez Elektra incompatibles. N'en suis point sûr, Gene fut le prince noir des occasions perdues.

L'est un point de vue d'Embareck qui m'embarrasse. Assure que Jim et Gene étaient de la même génération. Aristote selon qui l'écart qui sépare deux générations est de quatorze ans et demi - le temps d'être en état érectif et menstruel de procréation - lui donne raison puisque Gene naquit en 1935 et Jim en 1943. N'empêche que chacun s'inscrit dans une époque différente. Gene est un pionnier du rock et Jim Morrison un épigone. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une scène très symbolique, le show d'Elvis à la TV sur NBC en 1968, que visionne Jim en compagnie de sa mère horrifiée - point par Presley, par son rejeton - une autre manière de tuer le père. Phantasmatiquement parlant le paternel n'est pas le géniteur. Le rôle du backdoorman - l'amant qui passe par la porte de service - pour Jim ce n'est pas Elvis, mais Gene Vincent. La vie est un miroir. Le reflet que vous entrevoyez n'est pas toujours ce que l'on croit voir. Le roman nous offre la même scène avec un triomino équivalent, Elvis sur l'écran, maman Craddock plus aimante, et le fiston Gene, beaucoup plus sympathique envers le personnage du Pelvis, car exempt de ressentiment, n'est pas jaloux de la carrière du King, l'a simplement été plus malin, l'a su tirer son épingle du jeu, avant que la partie ne devienne trop dangereuse.

Tout est question de trajectoire. Gene aborde la courbe descendante de sa course folle avec le diable - pas le cornu, cette partie noire que chacun porte en dedans de soi - et Jim sur sa lancée zénithale, est un des phares les plus illustres du mouvement hippie. Mais les apparences sont trompeuses. Tout échec comporte son point nodal de réussite symbolique et toute brillance un coeur d'ombre qui ne demande qu'à battre de plus en plus fort. Tout les sépare, Jim est le fils d'un amiral, en cheville avec la CIA pour les coups fourrés, rempli de principes, Gene est le rejeton d'un petit épicier bourré du matin au soir. Famille bourgeoise pour l'un et prolétarienne pour l'autre. Jim peut se permettre les caprices d'une rockstar et Gene cachetonne pour survivre. Mais à chacun ses failles.

Chez Gene, l'est grosse comme une maison. S'aperçoit dès le premier coup d'oeil. Sa blessure à la jambe, son atèle, ses os broyés. Insupportable douleur physique, alcool et morphine sont ses deux médicaments préférés. Mais il y a des fêlures plus insidieuses, le sentiment de s'être fait avoir par sa maison de disques, par ses managers, par les avocats, et encore plus ce relent de culpabilité qu'éprouvent ceux qui rejettent la faute de leur situation sur eux-même, leur inexpérience, leur naïveté, leur jeunesse...

Chez Jim, ne faut pas chercher bien loin la poutre qui vous crève les yeux. Un enfant instable, un mytho, s'invente des vies parallèles car la sienne ne lui appartient pas. L'est reconnu comme un des plus grands chanteurs de son époque, cela lui fait comme à Gene Vincent une belle jambe. Veut bien chanter si ça vous procure du plaisir et si ça rapporte la liberté qu'offre le pognon. Lui se voit plutôt en cinéaste ou en poëte. Embareck le rembarre sec, question ciné ne connaît pas grand chose, quant à ses écrits sont du genre illisible cafouilleux. Se fait même aider par un prof de fac pour les améliorer. Heureusement qu'Embareck n'a pas été critique littéraire, serait à l'heure actuelle l'homme le plus haï de l'hexagone !

L'on a dressé le portrait de nos deux héros. L'en existe un troisième, un chargé de liaison, joue le rôle de la boîte à lettres des récits d'espionnage, mais nous n'en causerons point, l'est fictif. Une composition d'écrivain, un truc chiadé à mort, qui pue le blues. Fantôche parce que " Entre la vérité et le mensonge existe une zone libre appelée roman". L'épigraphe du bouquin n'est pas une seconde citation d'Aristote, provient de Victor Boudreaux. Moins connu que le stagyrite, je vous l'accorde, mais qui exerce une profession fort honorable, celle d'un privé aux méthodes expéditives qui sévit dans les romans de Michel Embareck. Grattez l'écorce de l'arbre, dessous vous trouverez ce même bois qui part en fumée dès que l'on approche une allumette pour y voir plus clair. L'est vrai que l'on n'y zieute que du bleu. Du blues, car le rock en sort et y retourne. Du blues de blancs. De nègres blancs. De petits blancs. Ne faut pas exagérer non plus. Ne mélangeons pas les torchons noirs de misère avec les serviettes amidonnées aux traces séminalement suspectes. Pour Jim ce sera taches de poésie blues, et balafres de bluesy ballades pour Gene.

Pour l'histoire, ne comptez pas sur moi pour vous la raconter. Parce que vous la connaissez déjà... Alice Cooper, Toronto, John Lennon... Parce que ce livre doit impérativement faire partie de votre bibliothèque. Pour vous donner l'alcool à la bouche, je vous dirai que c'est une espèce de road-movie. En territoire d'Amérique, le pays mythique où l'on n'arrive jamais. L'est vrai que les stations - christiques et à essence - ne manquent pas. Bar à babord. Bar à Tribord. Particulièrement réussie, émouvante et sardonique, la partie qui traite des pérégrinations de Vincent de par chez nous, et morceau de bravoure, l'hommage rendu à ce dernier carré de fans français qui portèrent l'ultime carrière de Gene à bout de bras. Notons au passage combien le fantôme de Gene Vincent s'inscrit de plus en plus profondément dans les soubassements opératifs de l'imaginaire littéraire national.

Evidemment, les héros meurent. On le savait avant de commencer la lecture, mais ces scènes finales font toujours aussi mal. Embareck, de la race des polaroïdes, lève le voile pour mieux recouvrir le mystère des choses définitives. En trois mots : sex, drugs and rock'n'roll. Ce Michel Embareck, nous ne serions point offusqués si après un tel livre il signait le prochain : Michel Embarock.
II
LES ANNEES VINCE TAYLOR
DE JACQUES BARSAMIAN
( Jukebox N° 331 / Septembre 2016 )

Pas tout à fait un article, une interview de Jacques Barsamian par le regretté Bernard Boyat. Parle de Vince Taylor mais aussi de lui-même. Non qu'il ait la grosse tête, mais sa vie fut si proche de celle de Vince qu'il est impossible de séparer les deux moitiés de la poire empoisonnée. Espérons au passage qu'il soit déjà venu à Jacques Barsamian l'idée opportune d'écrire la saga de son existence consubstantiellement mêlée à l'histoire du rock français, depuis ses origines, avant même qu'il ne commence, car il était déjà présent en Angleterre avant que les étincelles de la musique du diable ne traversassent le Chanel.
Barsamian témoigne du passage surprise de Vince Taylor au Musicorama d'Europe 1 du 7 novembre 1961. Fut subjugué par la beauté de sa prestation. Mais ce n'est qu'en 1966 que par un concours de circonstances - travaillait alors à Disco Revue - il se retrouva à chercher des engagements pour Vince puis à endosser le rôle ingrat du manager. Pas une sinécure. Nous sommes loin des années flamboyantes de Vince. Les braises lysurgiques ont cramé le cerveau de Vince. Rien ne sera plus jamais pareil à la légende dorée des débuts. Barsamian arrêtera les frais en avril 1968. Raconte donc ces trois années de folie à essayer de remettre sur pied la carrière de Vince, notamment la fameuse tournée de L'épopée du Rock.

Barsamian parle sans acrimonies, nettement, mais avec pudeur. L'étoile noire avait perdu de sa splendeur. Sa course était erratique. Capable de tout. Et même de sursauts prodigieux. Le temps d'un concert, tout redevenait comme avant, les incertitudes étaient abolies, Vince était de nouveau le grand Vince Taylor. Mais le soufflet retombait aussi vite qu'il avait monté. Vince se mure en lui-même. Assis sans bouger dans sa chambre. Perdu et inaccessible. Parfois le rocker était aux abonnés accents, mais l'homme de chair restait là comme en attente d'une impossible résurrection.
Certains n'ont pas hésité de parler de déchéance. Plutôt un volcan endormi. Semble inoffensif. Mais Vince était de ceux qui avaient chaussé les sandales d'Empédocle. On le croyait paumé, l'était en train d'explorer les coulées de lave intérieures. Parfois il ressortait de son étrange cauchemar. Sa parole, comme à côté du réel, était incompréhensible car elle portait les scories du futur, mais qui aurait pu s'en rendre compte ? Son existence répondit à la seule question essentielle : qu' y-a-t-il au bout du rock'n'roll ? Répondit de la seule manière adéquate à ce no future interrogatif : érigea son existence en un silence nietzschéen. Une vie de rocker par-delà le rock'n'roll.
III
EDGAR ALLAN POE
LETTRES D'AMOUR A HELEN
( PRESENTEES ET TRADUITES
PAR CECIL GEORGES-BAZILE
et LAURENCE PICCININ )
( Editions Dilecta / Mai 2006 )

Le premier de tous les rockers américains. Par ordre chronologique. Par importance. Avec Edgar Allan Poe, le romantisme européen prend une autre tournure. Finies les plaintes élégiaques, désormais ce sera une implication existentielle, exunt les grandes révoltes sociales, le rêve replie ses ailes et s'enferme en lui-même, terminés les châteaux écossais peuplés de fantômes revanchards, tout se joue dans la citadelle intérieure assaillie par des monstres engendrés par d'atroces phénomènes auto-immunes... Edgar Poe plume le volatile des représentations extérieures jusqu'à l'os.
Ces lettres d'Edgar Poe ne sont pas inédites. Sont abondamment citées dans les biographies, mais ici resserrées en leur unicité, elles apparaissent en leur froissement êtral. Il faut l'avouer, le lecteur français a pris l'habitude de passer un peu vite sur les dernières tentatives amoureuses du poëte. Des scories désagréables, quelle femelle aurait pu rivaliser avec la virginale Virginie ? Aucune. La réponse est ferme et inébranlable. Généralement du bout des lèvres, l'on conçoit que le poëte ait pu penser à la nécessité d'une sécurité matérielle indispensable à l'émergence des dernières grandes oeuvres. Le coucou - oiseau de mauvais augure - ne pond-il pas ses oeufs dans les nids étrangers ?

Nous aurions dû être plus attentif. Mallarmé nous y avait engagé, n'avait-il pas entretenu une correspondance avec Sarah Helen Whitman, lors de sa traduction des poèmes du Sphinx ? Ne lui avait-il pas adressé son sonnet hommagial ? Non, Sarah Helen Witman ne fut pas une groupie exacerbée par sa future ménopause. Un bas-bleu comme les désignait si dédaigneusement Barbey d'Aurevilly. Son oeuvre fut un maillon essentiel du développement de la poésie américaine. Quand l'on voit le peu d'estime dans laquelle en Amérique est tenue depuis toujours l'oeuvre de Poe, relégué parmi les écrivains de troisième zone, l'admiration obstinée et combattive qu'elle porta au créateur du Corbeau fut peut-être ce qui le sauva de l'oubli littéraire.
Ce sont bien deux sincérités qui se rencontrent. Deux aérolithes venus de deux mondes différents. Sarah fut comme un havre de paix entrevue depuis le milieu tempétueux de l'ouragan, le corbeau cyclonéen aurait aimé s'y muer en paisible alcyon, mais ce fut à peine une halte. Le temps de faire sa déclaration dans un cimetière et de repartir vers de sinistres rivages. Sous les imprécations funestes d'une famille qui ne voyait que d'un mauvais oeil cette alliance de la colombe avec cet échassier décharné échappé par miracle du massacre du lac de Stymphale. Ramier voyageur par trop agité, messager de la fin, porteur des messages du Gouffre et de l'Obscur.

Pour Poe le terminus létal était proche. Tout le restant de sa vie - elle mourut à soixante-quinze ans - Sarah Helen Witman, resta fidèle à l'esprit de Poe. Jamais elle ne dérogea à son admiration native pour le poëte. Elle, qui ne fut qu'un rêve, sut rester à l'intérieur des portes de corne et d'ivoire virgiliennes de ce domaine d'Arnheim dont beaucoup auraient aimé à ce que le portail promothéen demeurât aussi introuvable et interdit que les portes du jardin perdu.
Ces lettres d'Edgar Allan Poe ne sont pas déchirantes. Déchirées.
Damie Chad.
FOIX ( 09 ) / 15 - 07 - 2016
L’ACHIL' CAFE

HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME
WIRE
De retour à l’Achil' Café qui continue imperturbablement ses programmations rock hebdomadaires. Un volontariat digne d’admiration dans ce village de La Barre qui jouxte la cité fluxéenne davantage connue pour les trois tours de son château que pour ses groupes de rock and roll. En tout cas devrait y avoir des centaines de lieux rock hexagonaux qui piqueraient une jaunisse de jalousie s’ils avaient la possibilité de comparer la surface de leurs locaux à celle de ce lieu privilégié. Chez l’Achil' Café tout est plus vaste, la terrasse, l’intérieur, et la scène à laquelle vous serez dans l’impossibilité d’appliquer l’épithète d’exigüe. Service sympathiquement discret, et six euros pour trois groupes l’on ne peut pas dire que l’on détrousse le rocker.

HOUSE OF STAIRS

Zénitude et plénitude. L’on s’agite autour d’elle, musiciens et techniciens de l’Achil'. Reste devant son micro, silencieuse, un sourire placide sur ses lèvres d’enfant sage. Terrienne, les jambes campées sur le sol, l’émane une étrange force de son imposante stature. Quand tout sera OK, nous dira en toute simplicité bonjour, comme si elle saluait une connaissance croisée dans la rue. Sont prêts, Pierrot derrière ses caisses, Sam à la basse sur sa droite, Nico sur sa gauche en sandwich entre sa collection de guitares et son acoustique exposée sur son piédestal. Elle, Elo, n’a que sa voix. Ne croyez pas que je l’ai oublié, l’occupe tout l’avant de l’aile droite de la scène. C’est que voyez-vous un claviériste dans un groupe, ça vous détermine le son autant qu’un kimono habille un judoka. Après ce n’est qu’une question de style. Et ici, ce sera les grandes orgues.
Au début vous ne comprenez pas où vous êtes tombé. N’y a que le dôme de sa voix qui surplombe la pâte sonore telle la coupole de Sainte-Sophie, l’antique Byzance. Majestuoso. Inutile de vous débattre, vous êtes englué dedans, et vous n’en ressortirez qu’à la toute fin du set. Faut comprendre comment ça marche. Méchamment intuité. Un tutti, pas frutti mais savamment orchestré, y en a toujours un des cinq qui prend le commandement, vous êtes piégé au moment où il se retire, les deux oreilles orientées sur le soliste ont besoin de trente secondes pour piger que ce n’est plus lui qui joue, qu’un autre a pris sa place, exactement sur la même tessiture. Bluffant. Il ne court pas le furet musical, il avance lentement mais passe tour à tour de guitare en basse ou d’orgue en voix sans que jamais vous ne parveniez à saisir les lignes de fuite. Faut de sacrés musicos pour réussir ce tour de passe-passe. A la basse Sam nous dégringole de ces tourmentes de swing rampant à vous renverser tandis que Nico nous pique de ces pizzacati à vous fricasser les tympans. Ou alors il se penche sans s’en saisir sur son acoustique, comme un chirurgien sur le ventre de son patient ouvert, lui secoue violemment les tripes pour lui apprendre à ne pas demander son reste. A grands coups de pelles, Pierrot entasse les contreforts, pose la chape sur laquelle les autres édifient.
La musique est en vous. S’impose à votre cortex et phagocyte votre hypothalamus. Une gradation incessante, neuf morceaux déployés comme autant de mouvements oratorioïques pour employer un adjectif aussi chatoyant que leur cheminement. Mais à chaque fois, plus fort, plus violent. Plus incisif. Les applaudissements qui suivent chaque titre seront eux aussi à chaque station plus chaleureux et frénétiques. Mais il est temps de revenir à elle, Elo. La clef de voûte. Quelle aisance ! Vous ne parlerez pas de chant, mais d’intervention phonique. Très courtes, ou s’inscrivant dans une assez longue durée. Lentes ou rythmées. Ballades ou courses schizoïdes. Qu’importe, vous êtes surpris par l’ampleur, la netteté et la plasticité de de cette voix. Le recueillement c’est après, lorsque par sa seule rétention vous entendez le silence. Vous réalisez alors votre manque. S’est retirée comme la mer. Debout près de son micro, tranquille, laissant ses acolytes battre le fer rouge de son absence, respectant son tour comme dans la salle d’attente du docteur, revenant à point nommé pour illuminer de sa présence la secrète architecture des compositions, The Light, Black Bones, After Show / Broken, The Silent Words…

Non ce n’est pas du métal mélodique, plutôt de la mélodie rock and rollisée. Avec intelligence, ce qui est rare. Ce qui est sûr que nous sommes tous entrés dans la maison des spirales à la Piranèse. Et que personne n’a eu peur. Méfiez-vous toutefois, le chant des sirènes signale souvent l’imminence d’un futur naufrage. A vos risques et périls. Mais qui hésiterait une seconde pour embarquer vers les délices de Cythère ?
INTERLUDE
Tiens encore une fille. Le programmateur serait-il un farouche partisan de la parité ? Entre le groupe qui remballe, les régisseurs, et le combo qui s’installe, l’on ne sait plus qui est qui. Le mystère sera dénoué en un quart d’heure. Nul besoin de se rendre à Stokholm pour connaître les secrets de 3 AM Syndrome.
3 AM SYNDROME

Parfait pour jouer au triomino. Le salaire de base du rock and roll, basse, batterie, guitare. Assez de monde pour faire un boucan de tous les diables. Avec une arme aussi absolue, la galaxie est à vos genoux. Donc une fille. Aurore, nocturne. De noir vêtue, cheveux roux mi-long et peau laiteuse, le bras gauche aussi coloré qu’une bande dessinée de Druillet, une basse de laque noire entre ses mains, un petit air de prêtresse vaudou, pas méchante, mais l’a du chien. De l’enfer. Pour le sourire, l’humour et l’entertainment, vous vous adresserez au guitariste, Joris. Le monsieur jovial du groupe. Demoiselle Aurore, gavial glacial concentré sur son instrument. Vous n’imaginerez jamais le bruit qu’elle peut émettre à elle toute seule. Grande tonitruance. Remarquez que si elle veut se faire entendre, elle n’a pas intérêt à s’endormir dans son étui. Car le plus dangereux, c’est Olivier le batteur. Un fou à lier. De l’énergie à revendre. Se sert de tout le kit. Donne envie que l’on lance une souscription pour qu’il ait au moins vingt-cinq toms à sa disposition. Plus il en aura, plus il en abusera. Y a des batteurs qui marquent le rythme. Doit être un autodidacte. N’a jamais appris que ça existait. Lui il manie les marteaux de Thor et les enclumes d’Héphaïstos. L’a tout un répertoire : l’orage, la tempête, le déferlement, la grêle tueuse, le tourniquet de Sardanapale - un truc qui vous rend tout pâle - la carapace qui se carapate, la trombe furieuse, et autres joyeuses duretés dont je vous épargnerai la liste infinie. Bref, c’est un batteur. Tout simplement. Mais un vrai. Face à ce déchaînement continu tout guitar héros qui se respecte n’est pas là pour jouer au yoyo avec les cordes à étendre le linge de sa maman. Joris vous assène des riffs au marteau-piqueur et des licks à la tronçonneuse. Faut que ça rugisse, et que ça surgisse de la cuisse de Jupiter tonnant. Je résume : deux garçons qui se se toisent du regard, plus vite que moi, plus fort que moi, tu ne pourras pas. Vous certifie qu‘ils peuvent sans difficulté.

Et notre damoiselle rousse, croyez-vous qu’elle a la frousse ? Que nenni bonnes gens. S’en prend au micro. Qui ne lui a rien fait. Tant pis, elle y glapit dessus comme une hyène en furie. Le bouscule et lui hurle de ces promesses de mort si épouvantables que vous avez envie de vous tirer au plus vite une balle dans la tête. Point de précipitation, elle a plus d’une corde à son arc vocal. Vous prend un minois de petite fille sage qui quémande un tour de manège à son papa préféré. Vous ne sauriez résister, mais la lueur bleuâtre d’un projo passe sur sa face et la voici transformée en Cruella sans cœur et sans pitié. La caravagienne tête de Méduse hérissée de serpents est encore plus avenante, vous éructe de son gosier de ces sons métalliques réfractaires à toute égoïne. Nous fait le coup de la reprise de Blondie. Bye bye la blondeur des rêves. Vous la troque à la tignasse noire, mèches dark et toupet gothique, imaginez une Evanescence qui aurait avalé le stock de speed des douze pharmacies du quartier. Mais agitée en-dedans, parce que d’extérieur s’applique sur sa basse sans le moindre zeste d’énervement. Tout dans la voix.
On joue du rock and roll. C’est ainsi qu’ils s’étaient présentés en début de set. Ont splendidement tenu leurs promesses de déjantés durant la moitié du concert. Z’ensuite, se sont laissés piégés par leur propre violence, sont passés au rock and funk, bien calibré certes, mais dans l’accumulation répétitive des saccades rythmiques ils ont oublié la folie meurtrière du rock and roll et commis l‘irréparable crime de la désagrégation quantique de l‘énergie. Dommage. Nous les reverrons tout de même avec plaisir.
INTERLUDE
Minuit moins dix. Zut Cendrillon m’attend. Ô Damie tu me récupères devant le ciné à minuit, ce serait si gentil ! Je fonce comme un madurle au volant de la teuf-teuf durant le changement de matos. N’ayez crainte, entre temps la princesse au petit pois ( dans le cerveau ) a changé de programmation et de ciné ! Bref quand nous revenons, Wire entame son deuxième morceau. Elle s’assoit en se bouchant les oreilles Ô Damie quel changement d’ambiance, comment peux-tu supporter une telle horreur !
WIRE

Elle a raison un rocky horror show. Autant dire que j’adore. Sont quatre, le batteur derrière et les guitares en première ligne. Tactique d’attaque ultra-simpliste mais ô combien efficace. Une horde de broncos en plein galop dans l’horizon sans fin des grandes plaines. Pleines d’électricité. Le chanteur, Eric envoie les lyrics, juste ce qu’il faut, mais ce n’est pas ce qui les intéresse vraiment. Eux ce sont les grandes chevauchées électriques à la poursuite du rock and roll perdu qui les motivent. Se marrent entre les morceaux. De vieux briscards qui se lancent des défis avant la charge héroïque. Un galop de drummin’- Patrick insatiable aussi effréné que les huit sabots fous de Sleipnir, un bassiste qui se prend pour un guitariste soliste, et quasiment deux leads, Eric et Phillipe, qui entrecroisent le torrent bondissant de leurs descentes éblouissantes. Quand ils sont lancés, le combo vous prend des allures de Poupées de New York qui ne chipotent pas des heures à admirer leur rouge à lèvres devant la glace de leur salle de bain. Let me go, Evil Mind, Like a Schizo, No Justice, les morceaux se suivent et se ressemblent comme des gouttes de nitroglycérine. Genre de gars qui ne regardent que les scènes d’action dans les westerns les plus sanglants. Pas de temps à perdre, le rock and roll n’attend pas. Lui courent derrière et parfois même le dépassent. Wire vire en tête.

Moins de monde que pour les deux groupes précédents. L’on a dû évacuer les âmes sensibles, les vieillards, les femmelettes et les enfants de moins de douze ans. Saines précautions, tout le monde ne supporte pas les doses de rock and roll à haut-voltage. Les Wire pourraient vous occasionner des lésions cérébrales irrémédiables. Oui, c’est juste du rock and roll, mais l’on aime ça. Esprits fragiles s’abstenir. Rock and rolliser tue.
Damie Chad.
FOIX ( 09 ) / 12 - 08 - 2016
L’ACHIL' CAFE

THE RED’S LYGHT
L’est des lumières rouges qui s’allument dans votre cerveau et qui malgré les années refusent de s’éteindre. Les avais vues en août 2011 ( voir KR’TNT ! 62 du 01 / 09 / 2O11 ). Cinq ans déjà, durant lesquels elles se sont obstinées à donner des concerts à des dates où je n’étais pas, à un ou deux jours près, en Ariège. Mais enfin ce soir, elles passent à l’Achil' Café, un rendez-vous à ne pas manquer, c’est qu’elles m’avaient séduites ces quatre jeunes filles, le groupe phare de ce mini festival de village, la plus inexpérimentée des quatre formations présentes, mais la plus définitivement rock and roll. Etaient habitées par la décisive innocence expérimentale de l’adolescence.

Ne m’échapperont pas. Tiennent la caisse. Se sont partagées les tâches, une qui annonce le prix, une qui rend la monnaie, une qui vous tamponne l’avant-bras et une qui vous passe un bracelet fluo autour du poignet. Jamais fans de rock and roll n’auront connu lors d’un concert un accueil aussi charmant. Précisent qu’elles seront sur scène d’ici une petite demi-heure.
ALERTE ROUGE
N’ont pas menti. Sont exactes au rendez-vous. Elles ont grandi. Ne sont plus des lycéennes mais gardent toujours cette fraîche beauté qui leur va si bien. Toutes gracieuses dans leur short noir et leur t-shirt rouge. Ont même teint leur main d’une substance censée se colorer en rouge sous la lumière des projecteurs. Trois sur scène, Cécile au fond derrière sa batterie, LN au longs cheveux blonds à la basse sur sa gauche, Lauriane guitar lead à sa droite abondante crinière brune qui ruisselle sur son dos à sa gauche. Audrey les rejoint dès le commencement des hostilités pour s’emparer du micro. Que sont-elles devenues depuis tout ce temps ? N’aurai besoin que de trois minutes pour être rassuré. Ont évolué dans le bon sens. Toujours rock and roll.
Céline, un visage décidé et une poigne de fer. N’allez pas lui marcher sur les pieds, elle sait taper, rapide et varié. Un drummin’ raisonné, sans perte de temps, utilise toute sa batterie, frappe avec ses baguettes et avec sa tête. De l’instinctif intellectualisé, sait ce qu’elle veut faire et ne se trompe jamais de chemin. Si elle était le petit chaperon rouge, le loup aurait du souci à se faire.
Laurianne est du même bois apollinien. Vous ne savez jamais comment elle va réagir, mais dès qu’elle touche ses cordes, vous ne pouvez qu’être d’accord avec elle. Fait attention à ne pas se répéter. Chaque cas mérite sa propre solution. Propose la meilleure. Droit au but. La facilité et l’à peu près ne l’intéressent guère. Précise et adroite, un jeu intelligent et économe. Dans l’histoire de Guillaume Tell elle serait la flèche qui pulvérise la pomme. Vous vise en plein cœur.
LN inscrit sa longue silhouette dans la légende des bassistes enfermés dans leur tour d’ivoire. Joue comme en-dedans d’elle-même. A peine quelques sourires. Mais qui trahissent son attention. Paraît loin de nous, mais très près de ses camarades. Ne les laisse pas en rade. D’ailleurs elles ne s’inquiètent point pour elle, sont sûres qu’elle assure. Dans le poème de Leconte de Lisle, elle est le rêve que l’animal sauvage jamais n’achève.
Audrey est le reflet inversé des trois autres. La grande communicante. Elle chante et elle parle. L’interface agissante. Naturelle et ouverte au monde. Elle est le bateleur et le fou du roi ou pour être exact la fofolle de ces trois reines penchées sur le rouet de leur instrument. Amuse la galerie, dans la belle au bois dormant, elle est l’instant merveilleux d’après le baiser de vie quand le palais s’éveille et bruit de mille cris de joie.
Ne la prenez pas pour la folle de service, dès qu’elle arrête de parler elle se révèle telle qu’en elle-même le chant la change. L’est plus qu’au point. C’est elle qui démontre l’extraordinaire cohésion du groupe. Elles ont bossé comme des madurles. Tout tombe pile à point pour un public qui manifeste sans attendre son plaisir en applaudissant à chaque performance. Sont des malines, n’ont pas construit leurs morceaux à la diable, les ont intuités, des pièces de haute précision, remplies de chausse-trappes rythmiques, qui vous ménagent feintes traîtrises et heureuses surprises, mises en valeur par la voix claire et haute d’Audrey. Un vocal ensoleillé, qui sait moduler et crier, l’en fait ce qu’elle veut et ce qui est le plus fascinant ce sont ses arrêts impromptus qui vous laissent sur votre faim tout en vous rassasiant pleinement.

Un set performatif, n’ont pas inventé le rock and roll mais elles le perpétuent avec aisance et élégance. Rappel obligatoire pour nos quatre jeunes filles. Dommage qu’il y ait un groupe derrière. Le public les regrettera. Je suis content de moi. Ne m’étais pas trompé, voici cinq ans. Ont encore un énorme potentiel. Très proches des girls bands américains.
Damie Chad.
P.S. : pour le groupe d’amateurs de variétoche qui a suivi, je serai gentil en omettant de citer leur nom.
26/08/2016
KR'TNT ! ¤ 291 : ALAN VEGA / BONNY "SIR MACK" RICE / JUKE JOINTS BAND / JAZZ COOKING AND HIS BLUES BUDDIES / KERYDA / VAUDOU
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 291
A ROCKLIT PRODUCTION
25 / 08 / 2016
|
ET C'EST REPARTI POUR UN AN ! |
|
ALAN VEGA BONNY "SIR MACK" RICE + SOUL JUKE JOINTS BAND JAZZ COOKING AND HIS BLUES BUDDIES KERYDA / VAUDOU |
Viva Las Vega
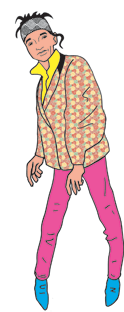
Quand on chante dans un groupe qui s’appelle Suicide, ça ne peut que mal se terminer. Et pourtant, Alan Vega a réussi a faire des vieux os, puisqu’il a réussi à tenir jusqu’à 78 ans, ce qui constitue un record pour un suicidaire. En 2012, il avait déjà survécu à une attaque. Un certain doctor Wong de New York lui avait sauvé la vie. Selon Liz, la compagne d’Alan, c’était complètement inespéré. Alan avait toutes les artères bouchées.
Les fans de Suicide et d’Alan Vega ont une veine de pendu, car dans Suicide - A New York Story, Kris Needs raconte l’histoire détaillée des deux compères, Martin Rev et Alan Vega. C’est en premier lieu l’histoire d’une amitié qui fait rêver, celle de deux gosses du downtown New York. C’est aussi une histoire qui plonge ses racines dans la jazz-scene new-yorkaise. Kris Needs lui consacre quasiment la moitié de son livre. On se croirait par moments dans La Rage De Vivre de Milton Mezz Mezzrow. Needs travaille bien sûr à partir d’interviews de Martin Rev qui en matière de jazz se montre intarissable. On comprend mieux d’où vient cette énergie qu’il développe quand il joue sur scène. Martin Rev vient du jazz et du doo-wop new-yorkais, de la même façon qu’Alan Vega vient de l’avant-garde artistique new-yorkaise et des Stooges. Emportés par ces deux tourbillons historiques, les albums de Suicide flottent à la surface comme des fétus de paille.
Quand Martin Rev parle, c’est en gros la même chose que Lemmy, il faut dresser l’oreille. Martin Rev dit tout ce qu’on a envie d’entendre. Il a écumé les clubs de jazz de New York à l’époque où cette ville était la capitale mondiale du jazz - et du reste - «Pendant dix ans, Marty allait être obsédé par trois géants du jazz, Thelonious Monk, John Coltrane et Miles Davis.» Marty se mit à travailler le piano comme un dingue. Il voulait jouer au même niveau que ses idoles d’alors. «Monk fut ma plus grosse influence. J’écoutais Monk ado. C’était un personnage incroyable, avec une allure à part, une personnalité à part et une musique fascinante. Monk était une sorte de père pour les autres musiciens. C’était un pur new-yorkais, très évolué. Tout le monde allait demander des trucs à Monk. Il était incontournable. Il était l’essence du cool. On l’appelait le prêtre du bebop. Monk était l’inventeur suprême, le visionnaire, au pur sens du terme. Aux yeux du monde, le jazz cool, c’était Monk et Miles. Miles disait qu’il avait tout appris de Monk et de Dizzy. Monk fut le grand compositeur de l’époque. Sa musique était à l’image de sa vie. Il était beaucoup plus à l’avant-garde que Bartok. Son approche du piano, c’était une approche du son et de la couleur. Dans ses meilleurs titres, comme ‘Monk’s Dream’, il ne joue que des nappes de son.»
Marty découvre Lester Young, Bud Powell, tous ces junkies et ces marginaux recrachés par l’intelligentsia du jazz. Il ne le sait pas encore à cette époque, mais Alan et lui connaîtront le même destin puisqu’ils seront aussi recrachés par l’intelligentsia du rock. Par le même genre de connerie réactionnaire.
Et Coltrane ! Et Miles ! «John Coltrane joua dans l’orchestre de Miles Davis. Pour Marty, Miles fut soit une inspiration, soit un héros ou tout simplement le personnage le plus charismatique du siècle dernier. ‘J’ai eu la chance de voir Miles jouer plusieurs fois. C’était un créatif et on voyait bien, à travers tout ce qu’il produisait, qu’il était prodigieusement intelligent.’» Et puis Eric Dolphy qui est selon Marty du niveau de Coltrane, de Mingus, d’Albert Ayler et de Miles. Marty se montre intarissable sur Albert Ayler. «Il était incroyable. J’étais fasciné. Il soufflait un gros coup dans son sax et on comprenait pourquoi il provoquait une telle controverse. Il incarnait l’avenir du jazz.»
Puis Marty prend des cours de piano avec Lennie Tristano, le pianiste aveugle et iconoclaste qui fut le joueur de bebop le plus controversé de son époque. Il avait accompagné Charlie Parker. Parmi les élèves de Lennie, on trouve aussi Mike Garson qui allait jouer du piano pour David Bowie. Les rivières de perles dans Aladdin Sane, c’est lui. Marty évoque pas mal de héros du jazz, puis il nous emmène dans l’underground du jazz, dans les lofts où tout le monde peut jouer. On a là des pages fascinantes, car il décrit cette scène bouillonnante de l’intérieur. Il fréquente même Tony Williams. Ils jouent ensemble à l’époque où Tony bat le beurre pour Miles, comme par hasard.
On le voit bien, les petits albums de Suicide ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. Au moins, ce livre a pour avantage de nous replonger le museau dans une culture qui fut extraordinairement vivante et, accessoirement, de nous inciter à réécouter des trucs assez magiques comme «Crepuscule With Nellie» ou encore «Bitches Brew». Monk & Miles.
Kris Needs farcit son gros mille-feuilles d’autres portraits de personnages capitaux, comme celui de Peter Crawley qui fut un temps le manager de Suicide et le responsable de la programmation au Max’s Kansas City. C’est lui qui permit à Suicide de démarrer. Et pas seulement Suicide, il sauva aussi les Cramps qui avaient raté leur première audition chez Hilly Kristal au CBGB.
Gamin de Brooklyn, Alan adorait la boxe. Il fréquentait les ritals du quartier et se passionnait aussi pour le base-ball. Dans le livre de Needs, il explique tout ça très bien, dans son langage. Il rêve de faire du sport quand il sera grand. Jusqu’au jour où une prof dit devant toute la classe qu’Alan écrit bien. C’est là qu’il va s’intéresser à la littérature, mais sans la ramener. Alan n’a jamais su frimer. Il se contente de dire à un moment, l’air de rien : «Camus reste mon auteur préféré.»
C’est sans doute le trait le plus frappant d’Alan Vega : l’absence totale de prétention. L’anti-m’as-tu-vu. L’archétype de l’artiste qui suit une vision : la sienne. Comme Gauguin et Duchamp avant lui, comme Apollinaire et Cézanne.
Puis, comme tous les ados de sa génération, il découvre Elvis. Il aura par la suite d’autres chocs émotionnels : «Les grosses influences de Suicide sont le Velvet, Iggy, Question Mark & The Mysterians et les Silver Apples.» Needs nous refait le portrait en long, en large et en travers des Silver Apples qui sont les vrais précurseurs de l’electro-rock : un mec aux oscillateurs et un batteur, le tout arrosé d’un joli parfum de scandale - une raison de plus de lire ce livre - Il faut savoir que les Silver Apples sont toujours en activité. On les voit à l’affiche des festivals du grand renouveau psychédélique européen.
«Alan avait déjà trente ans quand il rencontra Marty et qu’ils donnèrent naissance à Suicide. Alan était un petit mec de Brooklyn qui aimait le sport et qui se destinait à une vie d’ouvrier. Mais son sens artistique et sa conscience politique émergèrent en lui lorsqu’il vit jouer Iggy Pop en 1969.» Personne ne pouvait rester insensible à l’impact des Stooges en 1969 et encore moins un esprit prédisposé comme celui d’Alan : «Pour Alan, les Stooges étaient beaucoup plus qu’un grand groupe de rock, le côté kamikaze d’Iggy qui jouait avec l’hostilité du public était une performance artistique destinée à briser les barrières entre l’artiste et son public. Pour Alan, c’était clair. Il savait ce qu’il avait à faire. ‘J’ai démarré grâce à eux. Ils ont changé ma vie.’» Tout l’Alan provocateur et asticoteur de public vient de là, de l’Iggy des débuts. Alan va suivre l’enseignement d’Iggy à la lettre et faire participer le public au spectacle en l’agressant. Modèle que reproduira fidèlement James Chance.
Alan dans les Stooges et Marty dans le jazz ? Alors, comment ont-ils fait pour se rencontrer ? La réponse est dans le loft. Un soir de 1970, Marty ramène son groupe Reverend B pour jouer au Project Of Living Artists, un loft d’art total dont s’occupe Alan et dans lequel il vit. Alan y construit des sculptures électriques à partir de détritus qu’il ramasse dans la rue. C’est dans ce loft que les deux compères se rencontrent pour la première fois. Reverend B est une formation libre qui peut jouer du jazz pendant des heures et des heures. Alan se joint à eux avec un tambourin et ils mettent leur maigre public en transe. Cette nuit-là, quand tout s’arrête, Marty vient dire à Alan : «Toi et moi, on va faire de la musique ensemble !»
C’est le début d’une aventure extraordinaire, celle de deux mecs qui refuseront toute leur vie la moindre compromission. «Leurs premiers concerts sous le nom de Suicide eurent lieu en novembre 1970 au même endroit, au loft du Project Of Living Artists. On lisait sur les flyers écrits à la main : ‘PUNK MUSIC BY SUICIDE’». Sans le savoir, ils lançaient plusieurs mythes, le leur et celui du punk-rock new-yorkais. Question dégaines, nos deux héros avaient aussi dix bonnes longueurs d’avance : «Comme ils n’avaient pas un rond, ils portaient des vêtements trouvés dans les poubelles. Ils en firent une sorte de mode de la rue, mi-junkie, mi-mac. En fait, ils inventaient sans le savoir l’esthétique punk, cinq ans avant le CBGB et Richard Hell.» Marty opta pour un chapeau de cuir noir comme ceux que portaient les rockers et les mafieux new-yorkais. Voyez les photos de Shadow Morton et de Jerry Leiber.
Ils deviennent rapidement le groupe live le plus spectaculaire de l’underground new-yorkais puisqu’ils vident les salles. Alan fait son Iggy en se cognant le tête à coups de micro et en agressant les gens. Les descriptions de ses excès pullulent dans le livre de Needs et Alan profite de l’occasion pour corriger les inévitables dérives : il s’en prend notamment à cette cloche de Thurston Moore qui faisait un fanzine à l’époque et qui racontait n’importe quoi. Alan est malheureusement obligé d’expliquer qu’il n’a jamais tiré de fille par les cheveux : «Le seul à qui j’ai fait du mal, c’est moi ! Ce mec de Sonic Youth jure que j’ai tiré une fille par les cheveux. Ça n’est jamais arrivé. La musique qu’on faisait était d’une certaine façon psychédélique, mon pote, elle était si extrême que des gens ont commencé à voir des choses et à se mettre en transe. La limite entre la fiction et la réalité n’existait plus. Les gens se souviennent de choses qui n’ont jamais existé, j’en suis sûr. Je n’ai jamais fait de mal à quelqu’un ni tiré une gonzesse par les cheveux à travers la salle. Je suis le seul à qui j’ai fait du mal. J’empêchais ceux qui partaient de sortir. Je sautais sur les tables, je renversais leurs verres, mais je n’ai jamais blessé personne. Des gens ont peut-être été mouillés, c’est vrai. J’avais un cran d’arrêt et une chaîne, je me frappais à coups de chaîne et me tailladais au cran. J’ai le corps couvert de cicatrices.»
S’il lui arrivait de saigner, c’est uniquement parce qu’il se tailladait la joue ou le bras, car ça collait bien avec la pétaudière que générait Marty sur ses machines. C’est Marty Thau qui nous raconte ça : «Quand Alan Vega commença à se taillader le bras avec une lame de rasoir, certaines personnes essayèrent de quitter la salle, mais elles comprirent rapidement qu’elles étaient enfermées. La Kitchen était mal éclairée. Elles se sentaient prises au piège. Vêtu de cuir noir avec une chaîne de moto enroulée autour de la poitrine, Alan allait au devant d’elles pour les terroriser. Il chantait des paroles violentes, chargées d’images de meurtres, dégoulinantes d’angoisse et ça se combinait avec un drone assourdissant, répétitif, une purée électronique martelée, un spectacle auquel les critiques perplexes ne comprenaient absolument rien et qu’ils jugeaient avec suspicion. Mais en seuls maîtres à bord, Alan et Marty savaient exactement ce qu’ils faisaient.»
Thau est un autre personnage-clé de cette histoire. Avant de devenir le manager des Dolls puis de Suicide, il travaillait chez Cameo-Parkway et s’occupait de groupes de Detroit comme Question Mark & The Mysterians et Terry Knight & The Pack. Pas mal, non ? Puis il monte Buddah Records et fait des albums avec 1910 Fruitgum Company, Ohio Express, Curtis Mayfield, les Isley Brothers et les Edwin Hawkins Singers. Il démissionne et cherche autre chose, et c’est là qu’il flashe sur Suicide. Il découvre Martin Rev, «troublant mélange de psychose et de sentimentalité enrobé d’un fatras de drones electro minimalistes» et «les hurlements chargés d’écho d’Alan Vega, ses murmures incohérents et ses unh-hunhs psychobilly sucrés à la Elvis». Il ajoute : «Suicide était à la fois un rituel spirituel et un carnage de rock dissonant qui avait une incroyable puissance d’évocation théâtrale. Alan Vega était à la fois Elvis par son côté provocateur et Iggy par sa vision futuriste de la rue. Martin Rev amenait un chaos de distorsion, de feedback et de jazz recyclé, de rythmes latins et de dance electro. Suicide était un mélange de ferveur punk originelle, de rythmes disco hypnotiques, de futurisme electro high-tech et un carnage sonique avant-gardiste fait pour fondre sur les esprits les plus audacieux.» La messe est dite. Amen.
C’est à Thau qu’on doit les fameuses descriptions des premiers concerts de Suicide : «C’était avant les boîtes à rythme. Il n’y avait qu’un orgue. Leur set était entièrement improvisé, ils faisaient exactement ce qui leur venait à l’idée. Alan avait des chaînes, il se taillait la peau et portait un blouson et des bottes en cuir. Marty Rev jouait une seule note pendant 40 minutes.»
Ce livre amène un éclairage passionnant sur cette scène qui va du Velvet aux Dolls, en passant par tous ceux qui s’illustraient au CBGB, un bar paumé du Bowery qui était un bar de Hell’s Angels. Walter Lure nous rappelle que les chiens d’Hilly chiaient partout dans le club et Needs nous brosse un savoureux portrait de Wayne County qui accuse Bowie d’avoir tout pompé dans son spectacle Pork. On croise aussi Jeff Starship qui allait devenir Joey Ramone et Debbie Harry qui voulait récupérer Marty pour jouer de l’orgue dans son groupe. Heureusement, Marty était un mec fidèle en amitié. Ho, tu rigoles ou quoi ? Pas question de lâcher Alan !
Après leur premier album, Alan et Marty partent en tournée en Europe avec Costello et les Clash, c’est-à-dire les rois de la frime. C’est l’occasion pour l’auteur de rappeler à quel point les gens haïssaient Suicide. Marty Thau : «On sentait une certaine confusion dans ce public belge venu voir Costello et à qui on demandait d’encaisser le choc de Suicide. Ignorant les cris de ces fans européens qui n’avaient encore jamais vu un groupe de rock sans guitares, Alan Vega se fit surprendre par un mec qui sauta sur scène pour lui arracher le micro des mains, sous les acclamations du public. La moitié du public se mit à chanter ce que j’imaginais être des chansons traditionnelles belges et l’autre moitié applaudissait et ovationnait. C’était la même chose qu’avec les Dolls : soit vous adoriez Suicide, soit vous les haïssiez. Il n’y avait pas de demi-mesure.» Les Belges venaient pour Costello et ça dégénéra en émeute. Miriam Linna, qui était l’attachée de presse du label de Suicide Red Star, raconte ça encore mieux : «Je ne suis pas fan de Costello. Cette musique ne m’intéresse pas, je n’y connais rien. Je savais que Suicide allait être dix mille fois meilleur que Costello. C’était excitant de voir ça. Ils ont explosé comme une grenade dans une surboum. Au fur et à mesure que les lumières se rallumaient, on voyait la foule en colère. J’étais à côté de Marty Thau. Il transpirait abondamment et ses verres teintés fumaient littéralement. Il en avait la bouche ouverte. Quand le bordel à commencé, on se serait cru pendant la Troisième Guerre Mondiale et Marty Rev a monté le son de sa boîte à rythme. Alan s’est mis à railler la foule. Ils avaient l’air de deux mecs des rues de New York qui affrontaient une foule énorme. Leur musique sonnait comme une invasion de forces étrangères. La salle s’est transformée en scène de guerre. On nous a évacués par l’arrière et des voitures nous ont mis à l’abri avant qu’on ait découvert que ces enfoirés d’Américains s’étaient volatilisés.» Ce n’est qu’un tout petit aperçu des aventures extraordinaires d’Alan et Marty, gamins des rues du Lower East Side de New York. L’apothéose, ce fut le fameux concert du 4 juillet à l’Apollo de Glasgow, en première partie des Clash. «4.000 skinheads et punks écossais n’en revenaient pas de voir s’installer un groupe qui n’avait ni guitare ni batterie. Marty envoya un drone. Alan portait un blouson en lamé argenté dont il avait arraché une manche. Il hurla et prit une pose. Un mec commença à claquer des mains et Alan se joignit à lui. Le public crut qu’il s’agissait d’une provocation. La scène fut aussitôt bombardée avec tous les engins possibles et inimaginables. Les Écossais arrachèrent les rangées de sièges du sol mais elles étaient trop lourdes pour être balancées sur scène. Alan regardait la foule avec étonnement. Une boîte de bière atterrit à ses pieds. Il la ramassa et fit semblant d’en boire une gorgée. La colère monta d’un coup. Les mecs du service d’ordre qui était souls commencèrent à taper dans les gens et à en virer. À un moment, une hache siffla et alla se planter sur scène, à quelques mètres d’Alan.» Plus loin dans l’ouvrage, Alan revient sur l’anecdote de la hache et la confirme : «Quand on a joué à Glasgow, j’ai vu arriver cette putain de hache. C’était comme dans les westerns, quand tu vois arriver les flèches. Elle ressemblait à un tomahawk ! Pendant des années, personne n’a voulu me croire. Les mecs de Jesus & The Mary Chain étaient au concert et ils ont vu la hache filer vers moi. C’était dingue, mec !»
Mais Alan n’était pas né de la dernière pluie. Il avait pendant des années affronté des publics hostiles à New York et savait transformer la confrontation en art : «Parfois le public était trop hostile mais je savais comment il fallait réagir. Tu te taillades un peu le visage et comme tu transpires comme un porc, ça ressemble à une hémorragie. Alors je cassais une bouteille de bière et je me tailladais le visage avec un bout de verre. Ça se mettait à saigner et les gens se calmaient. Ils devaient se dire que j’étais complètement dingue et qu’il n’y avait plus rien à faire pour moi. ‘S’il veut crever, il peut crever ! ‘ Il fallait savoir gérer le chaos, mec, parce que parfois, ça pouvait devenir très dangereux.» Mick Jones raconte plus loin qu’à Crawley, un skin est monté sur scène et a frappé Alan, mais ils ont continué. Alan se souvient d’un autre épisode craignos impliquant des skinheads nazis : «On a joué une nuit dans un port de sous-marins sur la côte Est de l’Angleterre. La loge se trouvait derrière la scène. À cette époque il y avait le National Front et tous ces nazis. J’avais laissé Marty continuer à jouer et j’étais revenu dans la loge. Soudain, cinq de ces enculés sont arrivés avec des brassards nazis. Ils faisaient deux mètres de haut. Ils me haïssaient. J’ai cru que j’allais y passer, mais des gens sont arrivés et ces bâtards se sont barrés.»
Et puis voilà qu’ils passent à l’autre extrême et deviennent victimes de leur succès. Alan est terrorisé : «On a joué dans cette grosse discothèque à Édimbourg. Une énorme salle, pas bien éclairée. On avait déjà fait trois morceaux et les gens avaient l’air de bouger un peu. Comme j’étais habitué à voir les choses tourner au vinaigre, j’ai dit à Marty : ‘Regarde, ça va bientôt péter parce qu’ils commencent à remuer !’ Je suis revenu au micro et soudain, c’est devenu une grosse boîte disco et tout le monde dansait ! Ah la vache ! J’étais baisé ! Voilà que je faisais danser les gens ! Je suis retourné voir Marty et je lui ai dit : ‘Ils dansent sur notre musique, poto !’ Je te le jure, je croyais que j’étais cuit. Je me demandais ce que j’allais devenir ! J’étais scié. Partout, ils se mettaient à danser ! Après les concerts, des jeunes mecs venaient nous voir, des mecs qui allaient devenir Depeche Mode et Soft Cell. Ils étaient tous dans la loge.» Eh oui, Suicide allait être récupéré par toute cette scène bien propre sur elle. Pour Alan, ce fut une tragédie. Ils entraient dans une sorte de mainstream, celui de la reconnaissance éperdue et du développement commercial. La mort d’une éthique. L’arrivée de la No Wave et des fucking synthés. Bien malgré eux, Alan et Marty se retrouvèrent mêlés à ça. Ils allaient même tomber dans les pattes de Rick Ocasek et de Michael Zilkha du label ZE qui voulait absolument que Giorgio Moroder produise leur nouvel album ! Oui ce mec de ZE rêvait de succès commercial pour Alan et Marty qui n’en voulaient pas. Résultat : avec ce deuxième album, ce fut la fin des haricots. Ocasek avait réussi l’exploit d’aseptiser les figures de proue de la scène punk new-yorkaise.
Alan entame ensuite sa carrière solo. Il vient de rencontrer le guitariste Mark Kuch. Et pouf, ça repart, mais en mode boppin’. Back to the rockabilly roots, baby. Puis grâce à son quatrième album solo - Just A Million Dreams, le plus mauvais de tous, une autre histoire de producteur foireux - Alan rencontre la compagne de sa vie, Liz Lamere. À partir de là, c’est elle qui va s’occuper de la carrière d’Alan et même de celle de Suicide. Quand Alan revient jouer en Angleterre pour la promo de son album Power To Zero Hour, il renoue avec une vieille tradition : l’affrontement avec un public hostile : «Alan et Liz eurent à supporter les insultes d’une partie du public et ils furent bombardés de verres de bière, de pièces de monnaie et un mec leur balança un gros morceau de miroir qui venait des toilettes. S’appuyant sur sa longue expérience des agressions, Alan répondit avec le mépris le plus total, et il chargea les premiers rangs, provoquant des mouvements de retrait. Mais les agents de sécurité arrêtèrent le show. Le lendemain soir, la salle était pleine de journalistes qui espéraient assister à un carnage, mais les organisateurs supplièrent Alan de ne pas jouer. Liz en profita pour demander de l’argent en plus. Le lendemain, on vit dans le journal français Libération une photo d’Alan assis sur un WC, le pantalon sur les chevilles, en train de compter des billets de banque. Et on pouvait lire : ‘Mieux payé pour ne pas jouer, ça ne fait pas chier Vega’.»
Puis c’est l’épisode du 11 septembre. Alan : «Les ruines des immeubles sont les choses les plus horribles que j’aie pu voir dans ma vie. C’était comme une sculpture qui n’aurait pas pu être faite par des êtres humains. Après le 9/11, tout mon univers a basculé. Parce que c’est là que j’habitais. J’étais en plein cœur de tout ce bordel. Je ne pouvais plus croire à ce que je chantais avant. Ma vie était complètement différente. C’est comme ça que je fonctionne. Je vis en fonction de ce qui m’arrive. C’est la raison pour laquelle il m’est impossible de chanter les vieilles chansons. Les paroles anciennes me paraissent stupides maintenant. J’ai dû les refaire. Maintenant je suis enragé. Je l’étais déjà avant le 9/11, à cause de ce président de merde qui foutait tout en l’air. Je savais que ça allait se terminer comme ça.»
Alan et Marty enregistrent American Supreme, l’un des premiers albums à illustrer l’après 9/11, cet album fabuleux où se niche l’apocalyptique groove funky «Beggin’ For Miracles» qui dépeint une ville de New York rendue à l’anarchie, sans ordre ni loi.
Le dernier concert de Suicide eut lieu à New York, peu après celui de Paris à la Gaîté Lyrique. Liz : «Alan et Marty n’avaient aucune idée de ce que l’autre allait faire. Ce fut un concert exceptionnel. Alan et Marty ne s’étaient pas revus depuis le concert de Marseille. Marty avait sa loge au deuxième étage, mais Alan ne pouvait pas monter les marches. Marty arriva juste pour le début du concert et ils sont arrivés sur scène par deux entrées différentes. Ils ne s’étaient donc pas concertés. Il n’y avait pas de set-list, ils ont donc improvisé. C’était extraordinaire, la salle était pleine à craquer et les gens n’en revenaient pas. Personne n’a quitté la salle pendant le concert. C’était incroyable. Il y avait tellement d’amour dans la salle.» Et Alan rajoute : «On boucle la boucle. Je sais que ce fut un grand set, mais je n’en ai aucun souvenir. Voilà, c’est comme ça mais c’est pas grave, parce que Suicide est un gros truc. On peut faire ce qu’on veut. J’adore Marty. On ne fait jamais de balance ou de répètes ! Non mais tu rigoles ou quoi ? Tu vois, cette fois personne ne s’est barré. On aurait pu jouer encore une heure de plus. Je ne peux plus danser maintenant, mais on était bien dedans et je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je ne me souviens pas d’avoir quitté la scène. J’en avais un coup ? Ouais, j’avais bu du blanc. Je ne bois plus que du blanc. J’étais complètement crevé. Je ne me souviens de rien. J’aime ça. Je ne veux rien savoir. Apparemment, c’était génial.»
Signé : Cazengler le Vegaga
Alan Vega. Disparu le 16 juillet 2016
Kris Needs. Suicide - A New York Story. Omnibus Press 2015.
Rice with the devil

Les Staple Singers et Tav Falco ont un sacré point commun : ce sont de grands admirateurs et de grands consommateurs de hits signés Bonny ‘Sir Mack’ Rice. «Respect Yourself» et «Tina The GoGo Queen» figurent parmi les plus gros classiques de tous les temps. Mais son hit le plus connu est sans doute «Mustang Sally». Le cut s’appelait «Mama Sally» et Aretha qui jouait la démo au piano proposa à Mack de transformer le nom en «Mustang Sally». Wilson Pickett en fit ensuite le hit que l’on sait. Devenu pourvoyeur de hits pour Stax, Sir Mack Rice vendit donc du Respect à Pops Staples, de la Cadillac Assembly Line à Big Albert et du Funky Penguin à Rufus Thomas.
Mack débute sa carrière comme baryton dans un quintette vocal de Detroit, les fameux Falcons, rendus célèbres par un smash hit de 1959, «You’re So Fine». C’est Joe Stubbs - le frère de Levi Stubbs, l’un des quatre Four Tops - qui chante cette merveille de soul mélodique et entêtante. Les Falcons furent aussi le premier super-groupe de l’histoire de la soul, car Eddie Floyd et Wilson Pickett en firent partie, avec Mack Rice et Joe Stubbs. On peut entendre Eddie le sirupeux chanter lead sur «You’re In Love» et Mack chanter lead sur «Sent Up», d’une voix de rock’n’roller qui était alors d’une étonnante modernité. Sur la compile Flick Records des Falcons, on trouve aussi des cuts terribles comme ce «Baby That’s It», un mambo saxé et battu au débraillé de Detroit, admirable car bardé d’énergie, ou encore «Anytime Anyplace Anywhere» un balladif de charme chanté au chat très perché. Il est certain que ces cinq jeunes blacks avaient le diable au corps. Il faut entendre «I Wonder», un jumpy énergétique très rock’n’roll dans l’esprit. Ou encore «I’ll Never Find Another Girl Like You» incroyablement moderne et qui préfigure le Detroit Sound.
Sur une compile intitulée The Original Sound Of Detroit, parue en 1967, on trouve des cuts de Bettye LaVette, des Falcons et des Corvells. Sir Mack Rice fait un carton avec «My Baby», un r’n’b popotin noyé de chœurs et de cuivres. Bettye a déjà une envergure de Soul Sister. Mais le roi, c’est bien Sir Mack Rice qui revient à la charge avec «Baby I’m Coming Home». Il sait déjà trousser un hit et le rendre sympathique en le chargeant de clap-hands et
de chœurs torrides. Le «Has It Happened To You Yet» des Falcons est aussi une perle de juke d’un très haut niveau, dentelée à la vocalise et chantée comme du Marvin, mais en plus élégiaque. Pure magie vocale.
Sir Mack Rice a aussi enregistré quelques albums, mais si on veut les trouver, il faut se livrer au petit jeu de l’aiguille dans la botte de foin, car ses albums ont quasiment disparu des écrans radars.
Le plus accessible est l’album qu’il enregistra en 1992 avec les Dynatones, Right Now. Il y reprend justement le hit des Falcons, «You’re So Fine» car depuis l’époque de l’enregistrement de 1959, il voulait le reprendre avec un vrai son. Alors si on ne veut pas mourir idiot, il faut écouter ce remake absolument écœurant de classe. Le hit de cet album, c’est «America Right Now». Mack Rice parvient toujours à récréer la magie. Ça sonne tout de suite comme un hit intemporel, avec un groove insistant joué sous le boisseau. Mack Rice impose un style reconnaissable entre tous. Il fait une version du fabuleux «Cadillac Assembly Line» jadis composé pour le gros Albert et monté sur un riffing à la ramasse. Il reprend aussi le vieux «Cheeper To Keep Her» qu’il composa pour Johnnie Taylor. Il prend ça au groove de jazz. Il tape aussi dans son vieux Mustang. Incomparable ! Le seul qui sache vraiment attaquer ce vieux hit, c’est lui, Mack - Mustang Sally wow babe - Quelle diction et quel feeling dans le déroulé ! Quand on l’entend chanter ça, on repense bien sûr à la scène d’Hail Hail Rock’n’Roll où Chuck Berry explique à Keith Richards comment se joue l’intro de «Carol». Seul Chuck pouvait la jouer à la Chuck.
This What I Do paru en 2000 est un album absolument génial. Sur la pochette, Mack rit comme le diable au beau milieu des flammes de l’enfer. Et pouf, il attaque avec «Money Talks», le rumble de Detroit staxé de frais. Il chante d’une voix qui transperce l’âme. Mack Rice règne sur l’empire du groove popotin et son na na na na se promène sur la Grande Muraille qui protège ses frontières - Gonna buy me a wife/ Gonna buy me a dog/ Gonna buy me a home - C’est vrai qu’avec de l’argent, on peut tout faire. On trouvera encore du gros son dans «Pussy Footin’», joli cut de pop soul joué à la wha-wha. Mack le chauffe, il sait s’y prendre. Quand on écoute ça, on se dit qu’à l’époque il devait essayer de négocier un retour dans l’actu, comme le fit Andre Williams. Encore un extraordinaire groove avec «Where Was You At». Pure merveille. Il chante ça avec une invraisemblable classe d’accent et termine en beauté avec un sax et des chœurs de dingue. On retrouve la patte du maître dans «24-7 Man». Il déroule son groove infectueux avec une belle insistance. Il a une façon bien à lui de rendre le chant magique. On croit parfois entendre psalmodier un sorcier. Il revient au vieux heavy blues de black qui se sent seul avec «Another Lonely Weekend in Memphis», allumé à l’harmo. On ne se méfie pas et pouf il nous tombe dessus. Ce sorcier peut emmener le blues au paradis, voilà sa force et son pouvoir. Il est absolument incommensurable. Il gueule dans la viande du blues, il se situe bien au-delà du commun des mortels. Pur génie. Personnage diabolique. On reste dans l’enchantement avec «Other Side Of Town», il négocie des virages serrés dans la viande du groove - Bye baby bye bye - et il finit cet album hallucinant avec une reprise de «Respect Yourself», ce vieux cadeau qu’il fit jadis à la famille royale de Memphis. À ce niveau de perfection, on ne peut parler que d’universalisme.
La pochette de Get That Money paru en 2006 évoque automatiquement celle du Black Godfather d’Andre Williams enregistré avec la crème de la scène garage de Detroit en 2000. Mack pose en manteau de fourrure devant des grosses bagnoles. Attention, c’est encore un album d’île déserte. Le vieux gator fait un retour fracassant dans un «Yesterday Hero» monté sur un énorme drive de basse ronflante. Puis il vire funk avec «Get That Money». Mack réclame son blé - Get that money dough - Wow, quel fantastique brouet de funk ! On entend aussi des machines sur cet album, mais l’ami Mack s’impose par sa seule classe de vieux crabe. Trop de machines dans «Honey Bad», et par miracle le funk s’impose - Gimme my bread - C’est le meilleur funk du coin, avec une voix qui vrille. Il enchaîne quatre vieux hits, Cadillac, Respect, Mini Skirt Minnie et Mustang. Tout est bien sonné des cloches, on peut lui faire confiance. Avec ces quatre titres, on patauge dans le mythe. Il rajoute un peu de wha-wha Shaft dans Mustang et des chœurs de filles lubriques achèveront les plus coriaces d’entre-nous. Il reste le maître du jeu avec l’affolant «Everything Looks Good And Good» et les filles font yeah yeah yeah. Il nous fait plus loin le coup de la grippe exotique avec «Hong Kong Flu». Il chante ça à la voyelle joyeuse et délirante - She got the Hong Kong flu - Il chante en dérapage contrôlé. Le voilà capable de miracles en Palestine. Mack ? Mais c’est le messie du funk ! Il finit son disque avec d’autres énormités cabalistiques et un clin d’œil au père Rufus avec «That Thang». Et pour finir, il nous ressert cette merveille qu’est «Right Now America». Mack y dépeint l’horizon, mais avec une mélodie inscrite dans le groove. Ici tout n’est que chatoiement et grande présence. Il en fait le hit du siècle.
On retrouve bon nombre de ces merveilles sur son dernier album, Justice, paru en 2008. À commencer par l’effarant «Right Now America» et «Viagra Man» qu’il groove avec des machines, ce qui ne l’empêche pas de swinguer sur un beat extraordinaire. Il est tellement à l’aise avec les machines qu’on l’entend même siffler. Il faut aussi l’entendre chanter le morceau titre d’une voix de timbre fêlé. Avec cet album, il s’efforce d’entrer dans la modernité du rap et des machines, comme le fit aussi RL Burnside. C’est forcément intéressant car il s’arrange toujours pour croasser à la surface du groove, qu’il soit analogique ou synthétique. Comme chez Chuck Berry, c’est la voix qui fait tout. La musicalité vient du chant et non des instruments. Voilà la grand force des interprètes de haut rang. Il n’ont besoin de personne en Harley Davidson.
Grâce au Professor Von Bee, émérite érudit ébroïcien, j’ai pu écouter une compile des singles de Sir Mack Rice. Il doit bien être le seul sur cette terre à pouvoir la fournir. Mettre le nez dans ce genre de concentré de tomate, ça équivaut à franchir le Rubicon. On sait qu’il n’y a pas de retour en arrière possible. Ah tu voulais palper la cuisse de Jupiter ? Vas-y mon gars, palpe donc ! Le danger, c’est qu’après avoir écouté un pareil ramassis de concentré de tomate, il devient difficile d’aller écouter autre chose. La fête commence avec «Tina The GoGo Queen» que Mack chante en lousdé. Fantastique car doucéreux. Avec «You Can’t Lose It», il renoue avec l’ambivalence de proximité qui fait le charme de Mustang. Mack retrouve toujours ses marques. «Love Sickness» date de 1967, Mack est en plein Stax et avec «I Gotta Have My Baby’s Love», Mack fait son Pickett. Pur jus de juke ! Dans «Coal Man» il fait des promesses - I’ll be your coal man - Et il rajoute - I like your fire - Mack allume. Il a une science du doigté extraordinaire. Avec «Love’s A Mother Brother», il montre qu’il sait lui aussi chauffer un r’n’b à blanc. Et voilà encore un hit perdu dans l’espace temps, «What Good Is A Song». Mack est prodigieusement doué, mais il se perd dans le cosmos de l’underground. C’est pourtant un hit de 68. On y assiste au combat d’un géant avec sa mélodie. Groove de rêve encore avec «Santa Claus Wants Some Lovin’», du Stax sound des années 80. Puis il revient à la funky motion avec l’extraordinaire «Bump Meat». Il est allé chercher ça au paradis des funksters. Back to the firmament avec «Muhammed Ali», hommage d’un géant à un autre géant. Voilà encore l’un des hits universels de Mack. C’est joué aux trompettes de la renommée. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie - Ali ! Ali ! - Et la fête continue avec «Hope», la B-side de ce single mirifique, encore du groove étoilé chanté au profit d’une bassline éminente que notre héros chevauche comme un cow-boy de rodéo. Il nous ressort son meilleur funk pour «I Can Never Be Satisfied». Il a un sens du funk inégalable, une façon de placer son chant qui n’appartient qu’à lui. On est en 1976 et ça danse. Une pure merveille. Au risque de radoter, tout est bon chez Mack Rice. Cette compile trop dense se termine avec un «Women Part 1» suivi d’un «Women Part 2». Voilà du funky strut un peu violent, bardé de son - In the USA/ We got somewhere good God ! - On se retrouve une fois de plus dans le meilleur groove de funk d’Amérique.
En farfouillant dans les rayons de la librairie anglaise de la rue de Rivoli, je suis tombé l’autre jour sur un grand format intitulé Soul Memphis Original Sound. Ce livre propose une galerie de portraits photographiques signés Thom Gilbert. Si l’évocation de cet ouvrage arrive à la suite de l’hommage à Mack Rice, c’est parce qu’on y trouve son portrait étalé en double page. Il porte une casquette blanche de Gatsby tournée vers l’arrière, des lunettes à montures en or, une chaîne en or et un costume funky saumon et blanc. Il fixe l’objectif, mais son regard paraît tellement sauvage ! Il fait en plus une moue extraordinaire. Mais attention, ce livre recèle bien d’autres trésors. C’est une vraie caverne d’Ali-Baba.
Dans la petite intro - un texte du président américain lu le 9 avril 2013 à la Maison Blanche, en hommage au Memphis Sound - on lit les noms de Don Nix, d’Al Green, puis des labels mythiques de Bluff City, Hi, Duke, Sun et Stax. Page suivante, Dan Aykroyd salue la mémoire de Donald Duck Dunn et ses amis Eddie Floyd, Sam Moore et Steve Cropper, toujours en vie. Nous n’en sommes qu’à la page 9 et on comprend tout de suite qu’avec ce livre, on risque l’indigestion.
Et pouf ! On tourne la page et sur qui on tombe ? Booker T et Aretha. Des vieilles photos en noir et blanc. On passe ensuite aux choses sérieuses avec un fabuleux portrait contemporain de Sam Moore. Il sourit de toutes ses dents blanches. Ça c’est du black ! Le trompettiste Wayne Jackson (tout juste disparu) évoque plus loin les souvenirs de ses rencontres avec Elvis, Aretha, Wilson Pickett, Isaac Hayes et la box of dynamite, Sam & Dave. BB King vivait encore au moment où Thom Gilbert photographiait les stars de Memphis. BB sourit béatement. Mais c’est son assistant Norman Mathews qui vole la vedette lorsqu’on tourne la page. Celui-ci ramène en effet sa fraise, avec les yeux grands ouverts et un sourire espiègle, un nœud pap de traviole et des médailles épinglées au revers du tuxedo. Attention au beau portrait de Charlie Musselwhite, qui du haut de ses soixante-dix balais rigole comme un Bibi Fricotin du blues, harmo en main et skull ring au doigt bien osseux. Si vous voulez voir la Cadillac Eldorado en or d’Isaac Hayes, vous devrez acheter ce livre. Rien que pour cette image, il vaut largement l’investissement. Toute la calandre avant est en or massif et le reste de la carrosserie peint en bleu. Hallucinant ! Et puis voilà l’extraordinairement belle Denise LaSalle. Elle n’est plus toute jeune, puisqu’elle va sur ses 80 balais, mais quelle allure et quel sourire ! Et quel parfum de légende ! On se sent bien en compagnie de tels artistes. Dans son sourire transparaît toute sa beauté intérieure. S’ensuit un portrait stupéfiant d’Al Bell, le résurrecteur de Stax. L’homme se montre incroyablement bien conservé, pas de cheveux blancs, sapé comme un milord des finances, le regard légèrement décentré, avec une espèce de fossette sur la joue droite. On voit bien que flotte dans son regard la farandole des souvenirs de l’âge d’or. Par contre, Bonnie Bramlett n’est pas à son avantage. Alors que cette femme est extraordinairement belle, Thom Gilbert en propose une image de mémère coiffée d’un balai à poil long. C’est d’autant plus choquant qu’en vis-à-vis, on a la dégaine de Bobby Whitlock (le seul qui soit resté fidèle à Delaney & Bonnie quand tout l’orchestre est parti jouer avec Joe Cocker - la fameuse tournée Mad Dogs & Englishmen - laissant le couple alors en pleine ascension le bec dans l’eau). Bobby vieillit bien, il affiche une mine resplendissante de rocker sur le retour et porte une veste en daim cloutée. On n’ose porter ce genre de fringues qu’aux États-Unis. On voit aussi pas mal de fringues dans ce livre, et l’inévitable combinaison blanche d’Elvis. Même conseil que pour la Cadillac en or d’Isaac Hayes : si vous voulez voir l’extraordinaire bague en diamants de Jerry Lee, il faut acheter ce livre. Elle apparaît en gros plan et si on l’examine en détail, on ne compte pas moins de 328 diamants sertis dans la monture en or massif. On ne saura jamais comment le bijoutier a pu entasser autant de diamants sur une couronne, mais on s’en fout. Il faut avoir vu la personnal stationary and diamond ring de Jerry Lee au moins une fois dans sa vie. C’est absolument indispensable.
On tombe un peu plus loin sur l’extraordinaire portrait de Mable John, la sœur du pauvre Little Willie John mort dans des circonstances mystérieuses alors qu’il croupissait dans une taule de la côte Nord-Ouest américaine. Cette femme est extrêmement âgée - elle va sur ses 80 balais - mais comme Denise LaSalle, elle rayonne de beauté intérieure. Petit conseil en passant : écoutez Stay Out Of The Kitchen paru sur Ace en 1992. Ce disque a la particularité devenue très rare de ne contenir aucun déchet. Et puis tout le monde le sait : Mable John fait partie des légendes vivantes de la Soul Music. Avant de chanter, elle fut la première secrétaire de Berry Gordy, elle fit quelques disques sur Motown, puis elle descendit à Memphis pour enregistrer chez Stax car le son lui plaisait davantage. Même démarche qu’Arthur Conley. Attention au portrait de Steve Cropper : il ressemble désormais à un ogre rigolard, alors qu’au temps de sa jeunesse, il arborait les atours d’un séducteur hollywoodien. Très beau portrait du vétéran Don Nix, revenu de toutes les batailles avec ses Alabama State Troupers. Il porte désormais un casquette et une barbe bien taillée. Dans son regard qui semble perdu flottent aussi les souvenirs de l’âge d’or, car on peut dire de Don qu’il fut partout et dans tous les coups fourrés. Magnifique portrait d’Overton Wright, le fils d’O.V. Wright, une image qui aurait tendance à ré-actualiser le slogan Black Is Beautiful. Ann Peebles fait aussi partie de cette fascinante galerie de portraits. Elle vieillit plutôt bien et à l’air d’une gamine avec un visage de grand-mère. Stupéfiant. Il faut voir à quel point ces portraits vivent de leur propre vie. Carla Thomas devenue grand-mère elle aussi occupe la place qui lui revient : une double page, en tant que Queen Of Memphis Soul. Elle porte un joli chapeau de paille et ses yeux, comme souvent chez les noirs âgés, s’embuent de chaleur humaine. Quelle femme et quelle allure ! Mesdames les mémères blanches, prenez modèle. Sur une double aussi, voilà qu’apparaît le fameux Muscle Shoals Sound Studio, l’un des endroits les plus mythiques de l’histoire de la musique moderne américaine. Regardez bien les deux fenêtres, les pierres de la façade, la porte d’entrée, la pelouse, Aretha, Wilson Pickett, Millie Jackson, et des tas d’autres légendes sont allées là-dedans enregistrer des hits planétaires. Ce studio se trouve en Alabama et non à Memphis, alors que fout-il dans ce livre ? Al Bell y envoyait justement tous les artistes Stax. Il trouvait le son de Muscle Shoals meilleur que celui du studio Stax. Tiens, justement, voilà Spooner Oldham, toujours aussi maigre, avec un nez proéminent comme ce n’est pas permis, une tête de vétéran taillée à la serpe, on dirait presque un portrait d’oiseau de tribune dessiné par Daumier. L’immense David Hood figure lui aussi en bonne place, le regard planqué derrière des lunettes noires. David Hood est avec Duck Dunn et James Jamerson l’un des plus grands bassmen de l’histoire du rock et de la Soul. Rick Hall vit toujours, lui aussi. Il vient d’ailleurs de publier ses mémoires. Rick Hall, c’est toute la légende de Fame, c’est Candi Staton, Millie Jackson, Clarence Carter et des tas d’autres légendes de la Soul. Il porte désormais la même moustache que Jackie Lomax, une moustache de mousquetaire. Il est toujours aussi bien coiffé et au fond de ses petits yeux danse la farandole des souvenirs enchantés, même si un jour, à la suite d’une shoote avec le mari d’Aretha, il s’est fâché avec Jerry Wexler qui menaça de l’anéantir. S’ensuit bien sûr le portrait de Bobby Bland, coiffé de sa casquette d’officier de marine, et toujours cette classe indécente qu’ont les vieux blacks qui ont su rouler leur bosse à travers les modes orchestrées par les petits blancs dégénérés. Bobby sourit car il sait qu’il est le meilleur groover de l’univers. Comme Carla, il a sa double page. Portrait en noir en blanc de Roland Janes qui a cassé sa pipe récemment. Voilà encore une raison évidente de rapatrier ce livre fantastique : le portait d’Eddie Floyd ! Très beau vieillard aux cheveux blancs, il pose le menton penché vers l’avant et dans son regard darde toute l’innocence du peuple noir. Il y a du Denzel Washnington dans sa physionomie. L’homme est beau et en impose. On ne se lasse pas de regarder ce portrait. Ni d’écouter ses albums d’ailleurs. Encore une preuve de l’existence de Dieu ? Oui, car l’homme noir finit enfin par régner sur la terre comme au ciel, selon le vieux rêve de Malcolm X.
Tiens, encore une femme démente, au sens de la présence, Rita Coolidge, pas de cheveux blancs, une nature indienne intacte, elle porte des lunettes à verres orangés, et on sent la star, mais la vraie star, celle qui ne la ramène pas, la star naturelle chez qui tout est comme en un ange aussi subtil qu’harmonieux. Toujours fidèle au poste, voici le géant Syl Johnson, habillé en cow-boy et planqué derrière des lunettes noires. À côté de lui, en vis-à-vis, l’incroyable Jimmy Johnson nous fixe de son regard clair. Comme Smokey, il a des rétines colorées. Et il porte sur les joues des nuées de petites taches brunes qui lui donnent un côté enfantin. Plus loin, voilà le grand Sam the Sham assis torse nu avec son accordéon, le regard dur fixé sur l’horizon, comme au temps des incessantes tournées avec les Pharaons. Encore un personnage culte ! Magnifiquement conservé lui aussi, voici Jody Stephens, l’ancien batteur de Big Star. Irma Thomas vous attend page 207, la bouche ouverte et les yeux charbonnés. Elle ne semble pas avoir d’âge. Par contre, Chips Moman vieillissait bien. Il avait toujours le cheveu brun et affichait un petit look à la Nicholson. Il avait de belles dents toutes neuves et un cou de dindon. Mais il vient lui aussi de casser sa pipe, enterrant du même coup une sacrée tranche de l’histoire de la Soul et du rock. Et sur une double, on retrouve face à face deux légendes : Dan et Don, Dan Penn et Don Covay. Don qui a lui aussi cassé sa pipe portait un stetson noir. Il flotte autour de ces deux héros un capiteux parfum de légende. Ce beau livre fume.
Signé : Cazengler, Mack Rincette
Sir Mack Rice. Disparu le 27 juin 2016
The Falcons. You’re So Fine. Flick Records
Sir Mack Rice & the Dynatones. Right Now. Blue Suit Records 1992
Sir Mack Rice. This What I Do. Infi Music 2000
Sir Mack Rice. Get That Money. 2006
Sir Mack Rice. Justice. 2008
Thom Gilbert. Soul Memphis Original Sound. Officina Libraria 2014
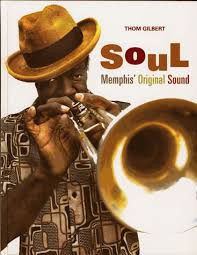
JUKE JOINTS BAND
+ friends
29 / 07 / 2016 - LERAN ( 09 )
Dix-huit heures. La carte postale rurale. Le village tout en longueur écrasé de chaleur, perdu au bout de la plaine. Sa place centrale, une allée de platanes à vous donner envie de réciter du Valéry.
"Tu penches, grand Platane, et te proposes nu
Blanc comme un jeune Scythe"
Pas grand monde dans les rues. Route barrée, nous approchons du but, le prospectus n’a pas menti, l’on aperçoit les premières baraques à frites. Etrange, uniquement des éventaires de bouffe. Ici mijote doucement une paella dans une poêle géante, là des escargots grillent de leur belle mort, plus loin l’on s’active autour de futurs hamburgers. A part cette débauche de préparatifs culinaires, personne si ce n’est trois individus fourrés devant le comptoir d’un bar improvisé. Facile de reconnaître dans ce groupe étique Chris et Ben du Juke Joints Band. Traînent un peu pour aller faire le son, l’estrade au bout de la rue est inondée d’un soleil saharien.
Dix neuf heures. Nous ajouterons une petite douzaine d’individus qui déambulent tout en donnant l’apparence d’être là par hasard. Le Juke s’en va peaufiner sa sono. Nous partons en exploration. Encore cent mètres de maisons, un pont que nous franchissons allègrement tel Bonaparte à Arcole - remarquons pour la vérité historique qu’aucun autrichien ne s’oppose à notre passage - et plomp ! nous restons azimutés par le château qui nous surplombe de toute sa hauteur. Grandiose ! Type renaissance huppée. Au-dessus de nos moyens. Nous opérons une retraite prolétarienne.

Dix neuf heures trente. Nous avons manifestement raté un épisode. De la guerre de Cent Ans. Et un autre des Evangiles. La multiplication des tables et des bancs. S’en aligne, surgies du néant, une profilée de trois cent mètres de long, plus une autre dans une rue adjacente, des gosses qui courent partout et des parents sagement assis qui sortent de leurs paniers, couteaux, fourchettes et assiettes. Six cents affamés. Mais les vocables gutturaux aussi tranchants que des faux qui heurtent nos oreilles, tudieu ! ce n’est point le miel du doux langage national mais les disparates sonnailles de l’ennemi héréditaire, ces damnés bâtards d’anglais. Un peuple qui mérite toute notre considération pour avoir inventé les Rolling Stones, Eric Burdon et les Yardbirds. Pas fous les Englishes, ont racheté les maisons vacantes des villages alentours qui se vidaient au rythme soutenu de l’exode rural, et se mêlent avec joie à toutes les festivités locales des patelins.
Vingt et une heures trente. Les panses sont remplies, l’heure du blues est venue.
THE BLUE BAND

Ben n’a pas trifouillé deux fois sa guitare que l’évidence s’impose. La beauté et la netteté du son. Tout à l’heure n’ont pas tourné les boutons en vain, profitent un max de cet angle droit de murs qui réfléchissent et se renvoient les ondes sonores, une quadriphonie artisanale ariégeoise du meilleur effet. Clarté de la guitare et raucité de la voix. Toute la soirée nous allons bénéficier de cette idéale et paradoxale tension. Le feu dévorant de Chris et le limpide torrent dévastateur de Ben qui se mêlent et s’entremêlent sans que jamais l’un n’assèche ou ne noie l’autre. Deux frères en lutte contre le blues accaparateur, qui se soutiennent, se filent et se repassent le feeling sans faillir. Le blues est un serpent qui ne s’apprivoise pas, faut le laisser dérouler ses anneaux en sa toute bestiale majesté. C’est une bête affamée et fascinante qui sort des marais et qui s’en vient vous mordre l’âme, l’en emporte chaque fois un morceau, mais elle repousse uniquement par désir de sentir encore et encore une fois cette indicible blessure qui vous instille une petite mort fascinatoire dans les cellules les plus lointaines de votre chair.
Opération délicate de l’appel ophidique. C’est Chris qui s’en charge. Possède la voix brûlée nécessaire. Communique avec les puissances chamaniques. Un véritable cracheur de blues. Peu de gestes grandiloquents, mais le corps est transcendé par la flexion souveraine du rythme. La scène est un rituel. L’invocation tellurique exige une improvisation scrupuleuse, quelques mots d’introduction, une courte invocation d’un des grands fondateurs du blues - que ce soit un précurseur enfoui depuis longtemps dans la glaise profonde de l’oubli ou un survivant prestigieux - et puis le chant qui jaillit en une infinie reptation terrienne. A côté l’on aimerait l’électricité. Mais non Ben, ne donne pas dans ces facilités. Tamponne son acoustique. Le blues fut ainsi en ses débuts. Une guitare et une voix, sèches toutes les deux. C’est en frottant les pierres les plus simples l’une avec l’autre que l’on arrache ces étincelles qui mettent le feu à toute la plaine.
Les adultes restent assis mais les enfants se pressent et esquissent des pas de danse. Leur naïveté existentielle est sûrement beaucoup plus apte à saisir le message sans mot d’ordre de cette musique originelle. Leurs parents sont enrobés d’une écorce de convenances sociales et pseudo-existentielles dont-ils ont de la peine à se défaire. Mais au troisième morceaux les conversations ralentissent et les applaudissements fuseront à chaque solo de Ben, à chaque sauvage sérénade de Chris.
J’ai dit solo, mais le terme me paraît inadéquat. Je lui substituerai celui d’envolée, un peu comme ce vent sauvage dans les roseaux de Yeats. Ben se carapate. Pas du tout en douce. Suit sa guitare diabolique, plus vite, plus fort, plus en avant, l’est ailleurs, dans un quelque part aventureux où il emporte l’auditoire en un allant prodigieux. Ni notes, ni accords, mais une tempête qui se déchaîne, un vent de rêve qui arrache les arbres et envole les hommes comme des fétus de paille. Comment peut-on orchestrer de telles symphonies avec six malheureuses cordes soumises à un si violent traitement ?
Une espèce de folie rentrée agite ces deux hommes. Shake your MoneyMaker, Chris égosille les raideurs tuméfiantes du sexe, et Ben démultiplie l’ampleur de l’orgie du plaisir. L’organe vocal qui râcle le pertuis fatidique et le jus ambré de la guitare qui éclabousse le tout. De l’Elmore James comme jamais. Le Dust My Broom de Robert Johnson subira le même traitement. Le blues est une musique impudique qui vous en met plein la bouche. Nourriture diabolique porteuse des germes de toutes les fièvres. Dans le lointain, l’orage tonne et quelques lourdes gouttes de pluie s’écrasent sur le sol. Mais nos deux sorciers connaissent toutes les formules, de Keb' Mo' à Willie Dixon, d’Otis Redding à John Mayall, et les éléments s’apaisent, la colère des dieux laisse place à l’exultation jubilatoire et incendiaire du blues.
Deux sets, un court, un long. Le premier qui commence, et le deuxième qui finit par un morceau du Creedence Revival. Une manière éloquente de boucler les méandres du Mississippi intérieur qui arrose notre sang. Un concert d’éblouissance parfaite. D’ébluesissance apothéositale. Merci le Juke.
28 / 07 / 2016 - LAC DE MONTBEL ( 09 )
L’ECUME DES JOURS
JAZZ COOKING AND HIS BLUES BUDDIES
JUKE JOINTS BAND
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Un autre visage de l’Ariège. L’Ariège hippie. Ces hordes de chevelus qui dans les années soixante-dix se sont ruées sur le département déserté de ses autochtones... N’ont pas fait qu’y passer. Se sont acclimatés. Ont formé des colonies d’implantation, à diffusion lente mais obsédante. Au fil des années ont gagné leur croix de guerre : on ne dit plus les hippies mais les néo-ruraux. Preuve qu’ils représentent un secteur d’économie vivrière ( chèvres, abeilles, fromages, miel, artisanats divers, menus travaux ) non négligeable. Ont aussi pactisé avec toute une frange de la jeunesse locale heureuse d’adopter un mode vie beaucoup plus libre qui leur a permis de rester au pays et d’échapper à la loi d’airain de l’exode rural…
L’Ecume des Jours est située sur la rive est du lac artificiel de Montbel. Si vous êtes un peu chochotte, vous vous arrêterez à la belle structure de restauration spécial-touristes-tire-fric avec parcs d’attractions gonflables pour les enfants qui n’embêtent pas leurs parents. Si vous préférez les réserves indiennes au Madison Square Garden, continuez votre route. L’Ecume des Jours vous attend. Pirouette caca chouette c’est la cahute du bonheur. Un toit branlant, des vieux canapés autour, une soupente minuscule qui sert de cambuse, WC bouchés mais champs à perte de vue pour les commodités, que demander de plus ? Rien. La bouffe est bonne et peu onéreuse mais l’important c’est la faune qui s’amasse autour. Des marginaux de toutes sortes. Du bobo anglais déclassé au militant bio survolté, du vieux baba revenu de tout, sauf de ses rêves, à l’amateur du picrate local, une espèce de pandémonium borderline des plus joyeux. Un truc sympa : la scène est presque aussi grande que l’espace réservé aux convives.
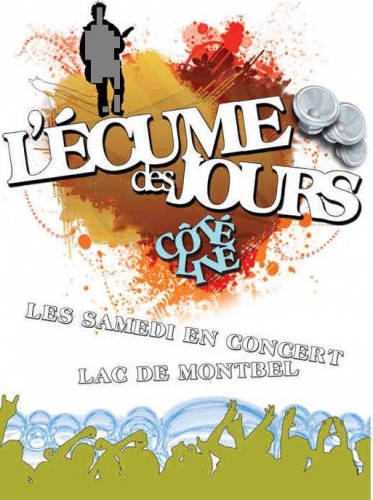
JAZZ COOKING AND HIS BLUES BUDDIES
Du jazz ! Horreur ! Nos trois jeunes garçons partent avec un handicap défavorable. Mais le jazz n’est plus ce qu’il était. En tout cas, ces toulousains savent jouer. Et y prennent du plaisir. Commencent avec un Wash My Back, un de ces insupportables mid-tempo qui s’étire à n’en plus finir sur une valse de blues cocufié. Basse électrique, batterie, clavier, il vous semblerait qu’il va vous manquer quelque chose. Mais non, se débrouillent très bien pour nous servir leur tambouille. Belle voix un peu voilée du bassiste. Très noire, très américaine. Une Lucky Strike qui sent davantage la grève que la chance. L’on aurait aimé qu’elle soit mise un peu plus en avant, mais ce sont avant tout des instrumentistes. Se sont partagés les rôles. Le batteur percute et la basse harmonise. Sont perpétuellement en défi amical. L’un funkise et l’autre jazzise. L’un tape sur les grilles comme un taulard dans sa cellule et l’autre tourne les clefs sans jamais ouvrir. La souris veut sortir du trou et le chat le bouche avec sa patte. Elle court vers une sortie de secours but the cat is already here. Un jeu incessant dans le labyrinthe des tempos. Le clavier est en dérive permanente. Au début du set il sonne comme un Playel de concert et à la fin il tord les accords comme un ogre électrique affamé. L’on voyage. Sont des malins. Vous effraient par quelques mollesses de cet insupportable jazz cool des années cinquante et sans crier gare vous le transmuent en swing déglingué de gros matou fou qui court après sa queue, à coups de louches de blues, de funk, de rock, dans le potage. Le brouet se transforme en gumbo frétillant de meilleur augure. Une ronde infernale entre compos originales et standards maltraités. Nous font visiter le pays alligatorien : le chaudron de la New Orleans, des résonnances africaines de Congo Square au déhanchement rock and rollisé de Fats Domino. Le public apprécie. Les imite, applaudit de plus en plus fort, de plus en plus rapidement. S’arrêtent au bout d’une heure. Ont vaincu et nous ont convaincus. Terminent sur un Since You’ve Been Gone incandescent. Comme quoi l’on peut trouver son bonheur lorsqu’une fille vous quitte. Mais eux ils auraient pu rester un tout petit peu plus.
JUKE JOINTS BLUES
Les mêmes qu’hier ? Oui mais aujourd’hui ce n’est pas pareil. Arrivent en force. Ont doublé les effectifs. De deux sont passé à quatre. Damien est à la basse, Grassendo à la batterie. A l’arrache, sans répétition. Le premier morceau servira de check sound. Ben est à la peine. Christophe des Number Nine ( voir KR’TNT ! 153 du 29 / 08 / 2013 ) ) vient de lui passer une Ibanez de 1973 avec un petit ampli Marshall à la structure sonique teigneuse. Mais non, ça ne passe pas. La troque illico avec son acoustique habituelle qui démarre au quart de tour. Sur les trois premiers titres, je me demande ce que Grassendo fait là. Un vicieux. Tamponne le rythme doucettement, sourit de toutes ses dents. N’apporte rien de fondamental. Fallait se méfier. Son foulard de pirate sur sa tête aurait dû m’avertir. Le genre de matelot qui descend des haubans tout guilleret pour poignarder le capitaine et déchaîner la mutinerie de l’équipage. L’accélère la cadence, l’air de rien, et bientôt le Juke Joints Band file les quarante nœuds par vent arrière, et chevauche la tempête. Le blues vous connaissez ? Très bien, et son bâtard de fiston, le rock and roll, ça ne vous dit rien !
Les dîneurs se dépêchent d’avaler les dernières bouchées, collent les tables sur les murs et une horde de filles entre en danse. Entrent en transe. C’est qu’ils y vont fort. Damien s’est mis au diapason de Grassendo, secoue le cocotier sans frette de sa basse comme s’il devait en tomber des louis d’or. Vous fait de ses descentes d’escaliers des enfers abracadabrantes. Damien le démon. A l’autre bout de la scène Ben n’a même pas pris le temps de se percher sur son tabouret. N’en laisse pas tomber le fromage pour autant. L’est le phénix du riff des hôtes de ce combo maudit. Vous ne l’ignorez pas un groupe sans chanteur c’est comme un condensateur sans électrogène. Chris mène le vocal comme Murat la charge décisive d’Eylau. Ecrase tout sur son passage. Les filles ont l’air d’aimer, viennent le caresser sous sa tunique. Sont des gorgones en furie, vident les verres du sang de la vigne comme d’autres leurs chargeurs de mitraillette. Arrosent partout, corps et habits, tables et plancher. Et les moins jeunes ne sont pas les moins déchaînées. Impossible de s’arrêter, le groupe turbine comme une centrale EDF à plein régime. A chaque titre Grassendo pousse le curseur, et les autres réagissent à la nano-seconde. Le morceau n’est pas terminé qu’ils se tournent vers lui, avec un regard suppliant d’enfant qui quémande une douzième part de gâteau, on ne pourrait pas aller un peu plus vite, s’il te plaît ! Et c’est reparti pour par exemple une version de Lonely Avenue que Chris parcourt à la vitesse d’un cent mètres haie barbelée. Le blues qui vous écorche la peau, vous troue l’âme, vous arrache des lambeaux de chair, vous démantibule le squelette. Un super premier set, d’une longueur démesurée, qui se clôt sur la promesse d’un final proximal. Sont trop chauds et les filles brûlantes. Le temps de se rincer les amygdales et les revoilà. Pas une minute à perdre. Maintiennent le cap et la vitesse. C’est la bacchanale ( ne pas confondre avec les anales du bac ) qui mène le bal. Le Juke filoche jusqu’au bout de la pelloche. Torride, s’ils continuent ainsi, cette bande de requins bleus and drôles massés derrière Chris et son micro-climat vont nous assécher le lac. En tout cas, à l’Ecume des jours, les Juke ont été le soleil noir de la nuit bleue.
11 / 08 / 2016 - MIREPOIX. ( 09 )
HALLE AU MARCHE
Vous avez à Mirepoix tout ce qu’il faut pour rendre un homme heureux. Des bars, des filles, des chiens et des chats. Je vous livre le quartet gagnant dans un ordre préférentiel que vous n’êtes pas obligés de partager, j’avoue avoir beaucoup hésité ranger les félidés après les canidés. La ville la plus animée d’Ariège, avec son contingent obligatoire d’anglais, ses animations hebdomadaires, et ses kyrielles d’artisans qui vous vendent les trucs les plus indispensables à la survie de notre espèce sur cette nef de fous pathologiquement stupides et furieux qu‘est notre planète, par exemple une feuille de papier avec votre prénom calligraphié à la japonaise ou une lampe à huile qui marche à l’huile de colza.
Tous les jeudis soirs des mois d’été c’est la traditionnelle moules / frites ( plat préféré de Bashung ) à chaque fois agrémentée d’une formation musicale afin d’accompagner le mastiquage des mandibules affamées. L’on ne change pas une équipe qui gagne, pour cette deuxième soirée d’août les organisateurs ont choisi, à l’instar de l’année précédente, le Juke Joints Band. Z’ont quand même compris qu’au lieu de les faire jouer, comme l’an passé, le cul tourné vers les convives vaudrait qu‘ils tournent pile leur face vers les empifreurs de mytilidés.
HORS D’ŒUVRE

Chris au micro, le fiston Damien à la basse sur sa gauche, Ben sur sa guitare ( en fait c’est plutôt la guitare qui est sur Ben ) à sa gauche, vous connaissez déjà, je ne m’attarde pas. Eux non plus. Parfois le blues c’est de la nourriture jetée aux cochons qui ne pensent qu’à se remplir la panse. Reprendront la jam un peu plus tard le temps de laisser la foule impavide se sustenter. Une heure d’entracte. Lecteurs ne vous éloignez pas trop, gardez une place pour le dessert.
NOUVEAUX INGREDIENTS

Sont partis à trois et reviennent à quatre. Et par un prompt renfort les voici cinq. En effet le nouveau venu n’a pas fini de tirer de son sac un… accordéon que survient l’ami surprise Thierry Kraft, sourire aux dents, chemise à fleurs, écharpe léopard et ceinture plastifiée aux couleurs du même royal animal. Sort sa collection d’harmonicas de son sac et branche d’autorité son micro sur l’ampli. Plus on est de fous, plus on rit, le Juke aime ses réunions improvisées, style auberge espagnole où chacun apporte son instrument et vogue la galère pour de nouvelles aventures. La veille, nous apprendra Chris, après le set, c’est un trompettiste qui s’est joint à eux avec sa corne de brume. Mais vous aimeriez en savoir plus sur l’accordéoniste - notre service de renseignements étant parfaitement au point nous pouvons vous livrer sa fiche de signalement. Miguel Gramontain exerce la noble profession de facteur. Non, mes demoiselles, même s’il est jeune et beau, il ne porte pas vos lettres d’amour, il fabrique des accordéons dans un hameau perdu de la commune de Saint-Martin-de-Caralp. Tout est en place, go ! Juke ! Go ! For a new jointure !
BLUES JOINTURE

Un de plus à table et un repas peut changer d’envergure. Deux de plus et le dîner se transforme en festin de roi, ou en banquet des mendiants. Comme diraient les Stones. Justement c’est la reprise de It’s All Over Now, Un pieux mensonge car la fête ne fait que commencer. N’ont plus le blues mais cette émulation communicatrice qui vous pousse à vous surpasser. Pendant le pont, Chris quitte le micro pour imiter Jagger, ressemble à un volatile dans sa parade nuptiale, Thierry se lance dans un solo d’harmonica qui vous écraserait un éléphant comme une mouche, Ben et Damien galopent comme des zèbres en rut à la poursuite de leurs femelles dans la plaine du Mozambique. Mais comment se comporte Miguel ? Est en train d’apprendre le métier. Essaie de timides coups de cornes de gazelle qui s’insèrent bien dans le paysage, mais ce n’est pas encore cela. Dès le morceau suivant Chris se hâte d’augmenter le volume de sa ligne. Pas question qu’il joue les inutilités, l’est ici pour s’en donner à cœur joie. L’est encore un peu maladroit, ne sait pas exactement quand il doit intervenir et quand il doit rentrer dans le rang commun. N’est pas un adepte du blues et l’a été jeté dans la grande bleue - ma foi fort tempétueuse - sans gilet de sauvetage. Meilleur moyen pour apprendre à nager. Damien se charge de lui donner les tops départs et de lui indiquer l’imminence de la ligne d’arrivée, du regard ou en tapant fortement du pied. Thierry se charge du premier solo et puis lui fait signe de s’adjuger le second. N’a pas froid aux yeux le moussaillon, monte vite au grade de lieutenant de vaisseau de première ligne, et nous l’on a chaud aux oreilles. Nous sommes loin des flonflons ringards du musette, l’a compris d’instinct que le secret réside en le tumulte brocantuesque des sonorités émises. Trouve la justesse du ton nécessaire, ajuste son intervention, la cisèle telle la pièce manquante du puzzle en formation, l’a trouvé sa place et ne la lâchera plus, comme le chien qui apporte et défend son os dans la meute.
Le combo sauvage a pris la piste du blues et n’est pas prêt de s’arrêter pour regarder passer le mystery train. Devant eux, c’est la grande pagaille, une petite fille blonde comme les blés se lance dans de gracieuses révérences et la voici rejointe par une flopée d’adultes qui dansent rockent, jerkent, se déhanchent, se démènent à qui mieux-mieux portés par la muraille de son qui déferle sur eux. Lève-toi et danse a dit Chris, et ils se sont levés et ils ont dansé. Ont ressuscité à la vie. Joyeux méli-mélo, Thierry plante des dards d’harmo dans les cassures fractales de l’accordéon, n’est pas essoufflé pour pousser son soufflet Miguel, nous offre un fond de son inaccoutumé mais qui se marie merveilleusement à l’ensemble. Les étreintes les plus inattendues sont souvent les plus frénétiques. Ben en profite pour montrer ce qu’il sait faire avec une guitare - solo et rythmique - de quoi mettre le feu au plancher des vaches folles. L’a dû user ses doigts au moins jusqu’à la deuxième phalange. Que ne sacrifierait-on la cause sacrée du vaudou-blues ! Ne laisse même pas le temps à Chris de présenter les morceaux. L’est obligé d’embrayer sans ménagement et de nous étriller le cortex à la paille de fer avec sa voix de corbeau messagère de la misère du monde. Le diable a dû rôtir ses cordes vocales sur sa fournaise la plus brûlante, et quand il ne chante pas, il mime le blues. Vous prend des poses de statuaire grecque. Avec sa barbichette de sage asiatique et ses mexicaines pointues au talon biseauté il vous revisite Praxitèle, encore plus classe que Sony Boy Williamson II avec son melon sur les scènes anglaises. N’oublie pas non plus qu’il est de bordée de canon, et s’en enfourne quelques lampées, car le blues carbure au white lightning. C’est pourtant Damien qui sera pris de délirium tremens. Jusqu’à maintenant, s’était bien tenu, en fils de bonne famille, soucieux de fournir à tout un chacun les lignes de basse nécessaires à l’exercice périlleux de leur expression artistique. Sans préavis, sans raison apparente, il passe à la dimension supérieure. Il jouait de la guitare basse, vient de la changer pour un quadrimoteur qui emballe ses hélices pour monter vers le soleil. Submerge tout. Un ronflement de rotors vrillés à mort qui balaie tout sur son passage. Du coup tout le monde s’emballe, Ben accélère sans prévenir qu‘il ne sait plus où se trouve le frein, Kraft lance des poignards de hululement d‘une longueur démesurée, Miguel déplie sa boîte à music comme une carte Michelin et vous le ratatine à la manière d’un escargot qui rentre sa coquille, saviez-vous qu’un accordéon pouvait couiner ainsi ! et Chris Papin, tel Bernard Palissy qui inventa la technique de l’émaillage, brûle dans son gosier les meubles de la maison branlante du blues pour alimenter le foyer du grand œuvre. Finissent en apothéose comme un navire qui s’écrase sur les rochers.
N’ont pas encore terminé, sont pris d’assaut par une foule d’admirateurs qui s’acharnent à leur arracher le secret des dieux.
MONTSEGUR
HÔTEL COSTES - 17 / O8 / 2016
KERYDA
Amis rockers accrochez-vous, nous quittons le pays des guitares hurlantes pour une après-midi des plus dépaysantes. Cinquante minutes de musique douce et deux heures trente de conférence de haute tenue éruditoire. Nous sommes au cœur de l’Ariège Mythique, dans le village de Montségur, la dernière citadelle cathare, l‘ultime étincelle de notre vieux Sud hexagonal. C’est Damien Papin du Juke Joints Band qui nous a refilé le tuyau, pas percé aux deux bouts pour deux sous. Nous voulions savoir où nous pourrions le voir jouer avec son propre groupe, Marcillac, Orange, un peu loin objectons-nous, lorsqu’il s’est souvenu au dernier moment de ce passage à l’Hôtel Costes. Un truc un peu spécial, nous a-t-il prévenus, de quoi nous mettre l’eau à la bouche.
Voici pourquoi à quatre heures et demie tapantes nous sommes confortablement assis à l’intérieur de la terrasse ombragée de l’Hôtel Costes. Les arbres filtrent l’écrasante chaleur, une trentaine de personnes sont réunies dans cette espèce de patio, comme retranchées du monde, l’assemblée se tait, même les enfants crayonnent sans bruit leur livre de coloriage, ambiance feutrée, forte impression d’une porte entrouverte sur le mystère invisible des présences secrètes.
KERYDA

Jeunes et beaux. Damien cale son imposante contrebasse allemande d’un bois sombre, quasi austère, longue et étroite comme un point d’interrogation qui s’interroge au bout d’une ligne sur l’énigme de sa présence au bout d’un chemin de signifiances incompréhensibles. Sara, toute blonde, toute gracile, est à ses côtés. En adoration devant sa harpe, ses doigts frêles effleurent les cordes comme l’épeire du matin qui danse sur sa toile illuminée de gouttelettes de rosée translucide. Damien est à l’archet, contrechant mélancolique aux arpèges harpiens qui s’égrènent en pluie de pétales de roses sur la surface immobile d’un étang perdu au fond des bois au creux d’une clairière heideggérienne.
Echos celtiques, évocations du jardin clos des amours troubadouriennes d’une légende bretonne, la musique ondule, paresseuse couleuvre qui se coule entre les touffes d’herbes vers l’arbre paradisiaque, calme, luxe et beauté baudelairienne nous envahissent. Keryda ouvre les sentiers du songe et des images héraldiques des représentations mythiques. Parfois le rythme s’accélère pour une polka diaphane aussi légère que les battement d’ailes d’un papillon. Nous emportent ailleurs, aussi bien en Bulgarie qu’en Israël, caresses d’âmes de tristesses de vieux peuples.
De la musique avant toute chose. Verlainienne comme une plainte d’automne, joyeuse comme une mazurka apollinarienne. A peine si Damien entonne deux couplets, presque à mi-voix, un appel à saisir l’exubérance de vivre. Sans peur, ni reproche. Une musique philosophique auréolée des secrets sourires de Sara et du mystère du nombre d’or entretenu au cœur de des coroles des fleurs et des roses trémières. Deux licornes d’or dans un pré qui tissent le silence d’interstices musicaux, la biche gracile qui s’interrompt de boire à la claire fontaine pour mieux éloigner la menace diffuse de l’existence de l’univers dont elle n’est qu’un fragment de grâce si vite enfuie, retenue en cet instant d’écoute comme par miracle. Keryda embaume nos impatiences, nous emporte dans une nacelle de nacre vers l’innocence du rêve.
Hélas tout s’achève. Même les concerts de Keryda. Nous ont mis le monde entre parenthèses. Retour à sa cruauté. Nul ne saurait le leur reprocher. Au contraire, l’on se presse autour d’eux pour témoigner et remercier de cette vision idéelle trop tôt enfuie, mais dont ils semblent détenir la clef .
RICHARD PIGELET-TACQ
Ne joue pas de musique. Mais la voix humaine est le plus merveilleux des instruments. Surtout lorsqu’elle se soucie apporter la grande sagesse. Ce savoir obscur teinté d’érudition historique et d’ésotérisme religieux. N’êtes pas obligé d’adhérer. Et encore moins d’y croire. Pour ma part je préfère le prince des carrefours hécatiens cher à Robert Jonhson et les anciens Dieux de l’antique Imperium qui forgent les armes du Retour sur l’Île des Bienheureux. Deux heures et demie durant, sans une seule interruption, Richard Pigelet-Tacq envoûte son auditoire, nous conte l’odyssée du pog ségurien depuis quatre cent mille ans et la geste cathare. Je ne vous résume pas car le sujet est trop loin des préoccupations premières de KR’TNT ! . Mais il faut souligner la clarté ensorcelante de l’élocution, la précision historiale du dire, et la netteté pas du tout obsédante de ses positions intimes et préférentielles. Un pur moment intellectuel de Connaissance. Quant à agir pour l’amour de Dieu, très peu pour moi. Merci. Je préfère la hargne du rock and roll.
Damie Chad.
( P.S. : les photos des artistes ne correspondent pas aux concerts )
LES MYSTERES DU VAUDOU
LAËNNEC HURBON
( DECOUVERTES GALLIMARD / 2008 )
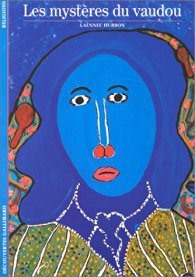
L'on n'en sait jamais assez sur le vaudou. Une manière différente d'entrer dans la psyché des créateurs du blues. L'oeil attiré tout de suite par le magnifique bleu de la couverture. En effet le livre est superbement illustré de pleines pages de reproductions de tableaux d'artistes contemporains affiliés à la saga afro-américaine du vaudou. Texte de qualité, très fouillé, mais décevant. Pas la faute de l'auteur. Stoppe le voyage des premiers esclaves avant de toucher au littoral du continent américain. S'arrête comme Christophe Colomb au coeur des îles caraïbes. A Haïti exactement. Moi qui me voyais débarquer en plein coeur de la Nouvelle-Orléans, c'est raté. N'en cause pas. Même pas un mot. Un peu chauvin Laënnec Hurbon, professeur à l'université de Port-au-Prince. A sa défense nous devons reconnaître que le vaudou est une invention haïtienne. Nous employons ce terme d'invention dans le sens qui caractérise les trouveurs de trésor qui localisent une épave chargée d'or au fond de l'océan.
Le début de l'ouvrage est le plus intéressant, les esclaves razziés, mais le plus souvent achetés à des rois africains, que l'on transporte de l'autre côté de la mer dans les bateaux négriers. Ethnies différentes originaires de régions du Golfe du Bénin occupées aujourd'hui par le Togo, le Bénin, le Dahomey, le Ghana et le Nigéria. A peine parvenus à destination les maîtres blancs s'ingénient à briser les liens qui pourraient les rattacher aux souvenirs de l'Afrique natale, mélangent les diverses provenances, se hâtent de les christianiser afin de leur faire perdre toute référence culturelle originelle.
Très vite se forment dans les parties isolées de l'île des communautés d'esclaves en fuite qui ne cesseront de rester en contact avec les populations noires soumises à la tyrannie des blancs. Les marrons - ainsi appelle-t-on les insoumis - syncrétisent le fonds commun de leurs anciennes pratiques religieuses en ce qui deviendra plus tard le vaudou. Faudra presque deux siècles pour qu'en 1791 l'insoumission larvée débouche sur une émeute sanglante qui se terminera après moulte péripéties par la première Déclaration d'Indépendance de l'île en 1804... Ce ne sont-là que les débuts d'une histoire tourmentée qui mêle la volonté d'insoumission des créoles haïtiens aux jeux de rivalités dominatrices des trois grandes puissances coloniales : France, Espagne, Angleterre...

Laënnec Hurbon délaisse cet aspect historique pour exposer en profondeur la généalogie constitutive du vaudou et la pratique cultuelle de cette religion. Aujourd'hui le vaudou se pare des oripeaux du catholicisme. Longtemps les noirs ont fait semblant d'adopter la religion de leurs maîtres pour mieux observer en toute tranquillité leurs rites de provenances tribales sans inquiétude.
L'existe une puissance invisible - une sorte de Dieu unique - inaccessible aux hommes. Cette force première est révélée par une multitude de loas, des espèces de démons dont il convient de s'attirer les attributs en leur ouvrant les portes de votre psyché. Phénomène de possession qui s'obtient au cours de cérémonies bruyantes et colorées - tambours, danses, sacrifices d'animaux ( boeufs, chèvres, coqs ) qui vous permettent d'entrer en transe afin d'accueillir en vous le loa que vous désirez. Ces divinités sont capricieuses, voire facétieuses, peuvent monter en vous sans que vous le désiriez... Les rites sont complexes et exigent une minutieuse attention. Le vaudou est un mix de tribales cérémonies païennes et de remémoration permanente des fastes liturgiques du catholicisme...
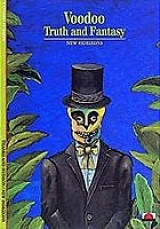
Au cours du vingtième siècle les chrétiens - catholiques et sectes protestantes importées des USA - ont tenté de dévaudouïser les masses populaires. Sans grand succès. Plus tard, tout au contraire le dictateur Duvalier s'est au contraire réclamé du vaudou pour appuyer sa popularité... Le vaudou a survécu à tous ces heurts, l'est devenue une religion reconnue. Les pouvoirs politiques ont compris qu'il ne s'agissait pas de cracher sur cette mouvance qui regroupe plus de cinquante millions de fidèles dans le monde. La reconnaissance dite culturelle est une manière de castration douce qui permet d'arracher les épines protectrices des roses carnivores les plus sauvages.
Rien de plus stérile et ennuyeux qu'une religion. Toutefois nous n'oublierons pas la charge poétique des noms des loas - Legba, Gédé, Dambala, Baron Samedi, Ezili, Simbi... - forment une espèce de catalogue surréaliste de la Manufacture Française d'Armes et de Cycles de Saint-Etienne, un contre-calendrier déglingué et burlesque des saints apostoliques. Le vaudou que nous aimons est celui des films d'horreurs et pornographiques, déferlements de zombies cannibales et accouplements de puissances maléfiques avec chairs humaines outrageusement extasiées. Peut-être existe-t-il un vaudou des cryptes maléfiques, en attendant les seules cérémonies auxquelles nous participons sont celles du Woodoo Child ou du Woodoo Lounge. C'est que nous sommes les bleus adeptes du red rooster.
Damie Chad
18:08 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/07/2016
KR'TNT ! ¤ 290 : REAL KIDS / NASHVILLE PUSSY / BLUES STORY / SOUND PAINTING / TROIS NEGRES / MALCOLM X / EDDY MITCHELL
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 290
A ROCKLIT PRODUCTION
14 / 07 / 2016
|
REAL KIDS / NASHVILLE PUSSY / BLUES STORY / SOUNDPAINTING / TROIS NEGRES / MALCOLM X EDDY MITCHELL |
|
AVIS A LA POPULATION KR'TNT ! ferme ses portes. Comme tous les étés. Une véritable catastrophe nationale, mais c'est ainsi. Nous avons aussi une vie secrète sur laquelle nous ne nous étendrons point. Pour le seul plaisir de vous laisser phantasmer. Une lueur d'espoir toutefois pour vous au bout du tunnel de cette longue et terrible nuit dans la noirceur de laquelle nous vous abandonnons sans pitié. Nous serons de retour, fin août dernier jeudi. KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME ! |
LE PORTOBELLO / CAEN ( 14 ) / 30 - 06 - 2016
LE PETIT BAIN / PARIS XIII° / 01 - 07 - 2016
THE REAL KIDS
LE REAL KICK DES REAL KIDS

Ce dernier soir de juin, une petite vague de chaleur semblait ramollir notre bonne ville de Caen. Un petit club situé à proximité du bassin de plaisance accueillait les Real Kids, ce groupe de Boston qui tira son épingle du jeu dans les années soixante-dix grâce à un micro-hit pop-punk intitulé «All Kindsa Girls». Comme la porte vitrée du club bénéficiait d’une ouverture automatique, elle s’ouvrait toute seule si on l’approchait. Il ne manquait qu’une seule chose : un bruitage à la Tati. Croyant qu’il régnait à l’intérieur une chaleur d’étuve, on hésita longuement à entrer. Il fallut bien entrer. Par miracle, il y faisait bon. Et on y servait de la Carlsberg à la pression, ce qui rendit l’endroit encore plus sympathique.
On le sait, la pop est un genre particulièrement ingrat. Des milliers de groupes, dont font partie les Real Kids, s’y sont frottés avec plus ou moins de réussite. Par définition, tous les genres sont difficiles, le garage, le rockab, le rock’n’roll, le blues, le stoner, mais la pop l’est certainement bien davantage, car elle repose sur un pouvoir auquel une infime minorité de gens peut prétendre : le pouvoir mélodique. Tout le monde n’est pas Ellie Greenwich. Ni Dwight Twilley. Ni George Harrison.
De toute évidence, les Real Kids n’ont jamais eu cette prétention. Au pire, ils se contentaient d’adresser un clin d’œil à Buddy Holly, notre cher binoclard texan. Mais le succès (d’estime) de leur pop est resté une énigme digne de celle de Toutankamon. Ils n’avaient pas de son. Quand on réécoute leur premier album aujourd’hui, c’est frappant. Le pauvre Marty Thau qui les produisit à l’époque était notoirement incompétent. Son enthousiasme ne pouvait en aucun cas pallier à une carence productiviste. Marty Thau n’avait pas l’envergure ni l’expérience d’un Shadow Morton ou d’un Jim Dickinson, pour ne citer que les plus connus.

Après le concert, la porte d’entrée automatique du club resta grande ouverte sur la rue. La fraîcheur du soir se fondait dans celle du bar. John Felice traversa le bar à pas extrêmement lents pour aller lui aussi prendre l’air. Cet homme qu’on donnait pour cuit aux patates ne semblait en effet pas très frais. Il affichait un air hagard avec la bouche ouverte, le cheveu long d’un blond délavé, pas peigné, les dents superbement pourries et le regard usé, mais un vrai regard, avec un dessin d’yeux très rond et très doux. L’occasion était trop belle, il se trouvait à moins d’un mètre de distance.
— Hey John !
— Hey....
— You were trouly fantastic !
— Hank ya....
— But it ize criminal the way they prodiouced your ricords !
— Ah...
— You sound far more better on stage zan on ze ricords !
— Ah...
— What is ze title of the last song you played ?
— Reggae Reggae...
— Ah...

Ils firent deux morceaux en rappel, et le deuxième explosa littéralement. «Reggae Reggae» était tout simplement méconnaissable. Ils jouèrent une sorte de brouet psyché-psycho ahurissant et mouliné à coups de gros accords magsitraux. La pop des Real Kids se mit à sonner les cloches du tocsin, ils atteignirent un sorte de démesure et embarquèrent leur public pour Cythère, mais sur un fleuve en flammes. C’était d’autant plus frappant qu’on ne s’y attendait pas du tout. John Felice et Billy Cole mirent en route une mécanique infernale qui valait bien toutes les autres mécaniques infernales, mais avec un fort parfum psyché, quelque chose d’à la fois hypnotique, dévastateur et envoûtant. Ces vieux de la vieille qu’on tenait pour de misérables has-been se mirent à dévorer les âmes et à allumer les lampions sous les crânes. John Felice prit les deux premiers solos et Billy le dernier, dans une sorte d’apothéose. Ce fut une véritable révélation. Un concert sur lequel on ne misait pas cher se transformait en un événement spectaculaire.

Ils étaient en effet montés sur scène sans grand enthousiasme. John Felice se déplaçait très lentement. Il portait un vieux blouson de jean, une chemise ouverte sur un T-shirt improbable. On sentait bien le vétéran de toutes le guerres. D’une certaine façon, il impressionnait. Il brancha sommairement sa Telecaster et annonça une vieille chanson, «Better Be Good».
Ils se mirent à jouer des morceaux qui n’avaient absolument plus rien à voir avec ceux des albums. Ils sortaient sur les deux guitares un son plein et bien gras. Billy Cole jouait sur une Les Paul. Il portait des baskets comme au bon vieux temps et semblait ravi de se retrouver enfin sur scène. John Felice compensait son statisme par une sorte de fulgurance de jeu. On le voyait prendre des solos d’une vive intensité, il triturait des petits phrasés furibards qui basculaient dans le viscéral. On découvrait là un guitariste remarquable. Il jouait des solos sur des accords de bas de manche et taillait sa route avec une maîtrise sidérante. En sortant du solo, il retombait toujours en place pour attaquer son couplet chant. On le croyait ralenti, mais sur scène, John Felice tournait à plein régime. Il était même très spectaculaire. On finissait par prendre sa nonchalance pour de la concentration. Et du coup, leur set devint fascinant, même si on ne connaissait pas bien les morceaux, qui encore une fois, n’avaient plus rien à voir avec ceux enregistrés en studio. Les Real Kids sur scène en 2016 n’ont absolument plus rien à voir avec les Real Kids sur Red Star ou New Rose. C’est le jour et la nuit.

Comme la conjonction des planètes était favorable, on put les revoir jouer le lendemain soir à Paris, sur la fameuse péniche qui accueille désormais les bons groupes de passage en France : Flaming Groovies, Vibrators, Pretty Things, Ash and co. L’idée était de vérifier que le concert caennais ne relevait pas d’une vue de l’esprit. On voulait surtout revivre ce final éblouissant qu’est la version de «Reggae Reggae» en rappel.

Nos amis les Real Kids cassaient la croûte à la cantine du Petit Bain et ce fut un plaisir que de revoir John Felice toujours un peu far-out et Billy Cole toujours aussi délicieusement juvénile. Par contre, il n’y eut pas foule dans la salle. Nous assistâmes exactement au même genre d’arrivée sur scène : pas la moindre trace de frime, pas de roadies, ces mecs arrivèrent avec leur guitares, se branchèrent et commencèrent à chanter, sans transition. Et ça se mit à tourner à plein régime, avec ce son miraculeux, avec cette voix bien posée, et ces départs en solo magnifiques d’efficacité et de virulence. Ce fut un plaisir que de revoir jouer ce guitariste exceptionnel qu’est John Felice.

La version live d’«All Kindsa Girls» ne doit plus rien à celle du premier album, qui sonne comme de la pop frénétique, pour ne pas dire écervelée. La version studio semblait en plus plombée par le bassiste qui jouait sa note en continu. Rien de pire. Il fallait attendre la reprise de «Rave On» pour trouver un peu de viande. John Felice chantait ça avec de la hargne et on avait enfin un truc qui se tenait, avec ses belles montées en wow wow wow - A pretty doggone impressive version, disait Miriam Linna de cette version - On entendait John Felice prendre un excellent solo dans «Better Be Good», et c’était d’autant plus remarquable qu’il embrayait à la ramasse dans l’aiguillage du train fou.

Sur l’album Red Star, on trouvait aussi un cut assez hargneux, «She’s Alright». Ils sortaient les dents et voulaient certainement passer pour des gens dangereux. Mais c’est «Reggae Reggae» qui décrochait le pompon. À l’époque, c’était déjà leur cut le plus percutant. On y entendait même de la friture de distorse.
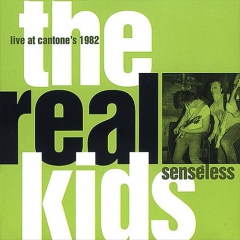
Norton a toujours soutenu les Real Kids. Billy Miller et Miriam Linna n’ont pas lésiné sur les albums live, mais le son n’était hélas pas au rendez-vous. Car si on veut du foutraque, là, on est servi ! Bel exemple avec l’album live «Senseless». Dès l’ouverture du bal, cette petite pop énervée saute dans tous les coins et rue dans les brancards. Ils sautent comme des poux. Avec «Now You Know», ils ramènent de la bonne teigne. Ça gratte, car bien monté sur le collet, et en même temps brouillon et bostonique. «Problems» n’est pas celui des Pistols, mais cette petite pop de jeans serrés qui moulent bien cette burnerie contingente typique d’une époque contrite. La grande différence avec les Ramones, c’est probablement la voix de Joey Ramone qui imposait une identité forte. Il n’existe rien de la sorte chez les Real Kids. Ils sortent un son exorbité. Leur pop se précipite en continu, le son de ce live est beaucoup trop rêche. Il n’y a aucun charme. John chante «Common At Noon» au congrès des arpèges de la pêche aux congres et «She’s Got Everything» vire miraculeusement garage. Mais pour le reste, ça trépigne beaucoup trop. On croirait entendre aboyer des jeunes chiots. Le son de ce live ruine tous leurs efforts. Il faut être fan pour écouter ça jusqu’au bout.

On attend donc un vrai album live, digne de ce qu’on entend en concert. Au bar de l’after-show, des rumeurs circulaient. C’est dingue ce que les rumeurs aiment à se propager. Elles n’ont même besoin de personne en Harley Davidson.
Signé : Cazengler, real de madrid
Real Kids. Le Portobello. Caen (14). 30 juin 2016
Real Kids. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 1er juillet 2016
Real Kids. Real Kids. Red Star Records 1977
Real Kids. Senseless. Live At Cantone’s 1982. Norton Records 2001
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 10 - 03 - 2016
NASHVILLE PUSSY
WHAT'S NEW NASHVILLE PUSSY CAT ?

On aurait tendance à vouloir faire entrer Nashville Pussy dans l’enclos des bourrins, mais franchement, ils ne méritent pas ça. Avant de monter Nashville Pussy, Blaine Cartwright jouait dans Nine Pound Hammer, un quatuor garage punk du Kentucky qui faisait partie de l’écurie Crypt. Normalement, quand on sort trois albums sur Crypt, ça lave de tout soupçon.
Tim Warren était malin comme un renard, car en signant tous ces groupes sur son label, il les anoblissait, d’une certaine manière : depuis les Raunch Hands jusqu’aux les Devil Dogs, en passant par les New Bomb Turks, les Gories, les Chrome Cranks et les Mighty Caesars. Eh oui, on écoutait surtout ces groupes parce qu’ils étaient sur Crypt, ce n’est pas plus compliqué que ça. Et c’est justement la raison pour laquelle on a mis un jour le nez dans les trois albums de Nine Pound Hammer.
Le garage punk pose quand même un sérieux problème : ça tourne assez vite en rond. Il faut aux tenants du genre de sacrés aboutissants, car sinon, on risque de s’emmerder comme un rat mort, pour citer le Professeur Choron. Le garage punk est un genre difficile, éminemment brutal et généralement réservé aux bourrins, ces groupes américains qui prennent un malin plaisir à flirter avec le hardcore. Inutile de citer des noms, tout le monde connaît ces groupes insupportables. Les Nine Pound Hammer sortaient un son tel qu’ils parvenaient à se démarquer. On les vénérait surtout pour certaines reprises des Stones, de Johnny Cash et des Groovies.

Le premier album de Nine Pound Hammer qui s’appelle «The Mud The Blood And The Beers» parut en 1988. Nos quatre Hammer posaient pour la pochette dans une belle lumière orange. En écoutant ce disque, on comprenait pourquoi Tim Waren avait flashé sur ces cul-terreux du Kentucky. Eh oui, avec «Crawdaddy», les Hammer nous balançaient une fantastique pièce de garage délinquante chantée à la mauvaiseté du loubard qui prépare un mauvais coup. On sentait confusément que ces quatre lascars ne risquaient pas d’être rattrapés par la délicatesse. Et avec «Little Help», ils proposaient un petit échantillon de punk rural d’Amérique profonde et quand on parle d’Amérique profonde, ce n’est jamais bon signe. On entend nos quatre Hammer fracasser leurs couplets avec un mépris total des conventions de Genève. Ils refont les Huns du Kentucky avec «Doomsday Poptarts» et se prennent pour les New Bomb Turks, ce qui n’est pas non plus très flatteur. Par contre, on trouve de l’autre côté un «Runaway Train» enthousiasmant, car c’est du garage punk solide. Ils font admirablement bien le train lancé à toute vapeur. On voit qu’ils fonctionnent à l’énergie brute. Ils recrachent plus loin du fiel de punk avec «Bye Bye Glen Frey». Oh on peut dire que ça coule et que ça dégueule. On sent qu’ils déversent un trop-plein et avec «Looking For Somebody», ils sonnent littéralement comme des punks anglais de 77. Ils font bien les oh-oh-oh. Il reste encore une belle pièce à se mettre sous la dent : «Hate To Think», garage-punk toujours, mais cette fois plus incendiaire et même carrément endiablé, saturé de guitares et riffé à la mort du petit cheval blanc d’Henri IV. C’est d’ailleurs un riff des Damned.
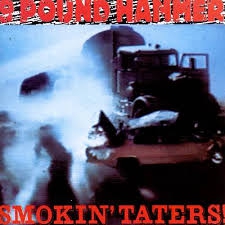
Le deuxième album «Smokin’ Taters» restera dans les annales pour la reprise trash de «Folsom Prison Blues». Nos amis Hammer la jouent plutôt crampsy. C’est bardé de dégoulinures et de petites poussées de fièvre. On les sent particulièrement dévoyés, sur ce coup-là. Mais les autres cuts ont du mal à se faire un nom. «Cadillac Man» restera toute sa vie un garage-punk ulcéré, joué trop vite et trop fort, «Feelin’ Kinda Froggy» restera de la pure Americana barbare, aux antipodes de celle d’un Gram Parsons, et de l’autre côté, «Headbangin’ Stock Boy» restera tout juste digne de figurer sur un album des New Bomb Turks. Ça veut dire ce que ça veut dire.
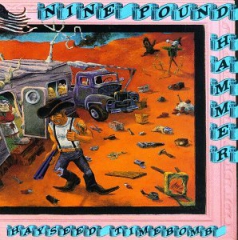
«Hayseed Timebomb» est probablement le meilleur des trois albums Crypt, ne serait-ce que par la classe de sa pochette illustrée qui nous montre le white trash américain dans toute sa splendeur. Le voilà en marcel et en stetson, avec le canon scié sur le bras, devant son trailer rempli de gosses dégénérés. Et c’est lui, Hayseed Timebomb, qui fait l’ouverture du bal avec cette magnifique dégelée de garage punk viandu. Les Hammer racontent son histoire, celle du white trash qui descend en ville - He’s trumbling into town to try to sell his boots/ He spent all his money on a one eyed prostitute - On trouve plus loin le garage punk de la Grande Bouffe : «Run Fat Boy Run» - jack, salmon, gumbo, steak fries, ho hos, catfisf - tout y passe à un rythme échevelé. Nouvelle dégelée définitive de garage avec «Devil’s Playground». Voilà le hit des Hammer, monté sur un riff insistant et joué en distorse maximaliste. De l’autre côté on a «Shotgun In A Chevy» pour se gargariser, pur garage punk d’évidence. On les sent déterminés à vaincre. Wow, quelle bande de brutes épiasses ! Comme on le voit avec «Adios Farewell Goodbye», les Hammer excellent dans les reprises musclées de vieilles country songs, comme on l’a vu avec Folsom. Ils ont deux atouts majeurs : la vélocité et le gras du son. Ils finissent avec «Slam Bag», un vieux coup de garage tradi, avec un son toujours aussi gras et bon.

La bande annonce de «Kentucky Breakdown» paru en 2004 pourrait être : «Oh putain les gars il faut écouter ce disque !», avec un fort accent des barrières, évidemment. Les morceaux de cet album sont tellement énormes qu’ils frisent le génie. Prenez «Rub Yer Daddy’s Lucky Belly», par exemple. Vous êtes là, assis dans votre fauteuil et soudain vous avez ce son qui saute littéralement à la gueule, c’est une anomalie de l’énormité. Blaine et ses acolytes dépassent toutes les bornes possibles et inimaginables. On croit voir surgir les forces des ténèbres du Kentucky, c’est d’une puissance extrême et comme auto-régénérée. Ils cognent dans la panse du beat à coups redoublés. C’est le meilleur gras des moines, je meilleur jus de Jupiter, le meilleur bam de boum. «Dead Dog Highway» sonne comme du garage vorace tenu en laisse. Puissant car battu en pleine carlingue de dingue de frappadingue. On reste dans l’esprit de corps de garde cher au père Blaine le blême. Il revient vous secouer le cocotier avec «Drunk Tired & Mean». Il réussit même à nous balancer une intro à la Heartbreakers, mais sur un tempo un peu plus soutenu. C’est extravagant de son. On a ensuite un «Double Super Buzz» battu à la diable. Mais quand on dit à la diable, c’est à la diable, d’accord ? Et la fête continue avec «Ain’t Hurtin’ Nobody», une belle palanquée d’Absalon Absalon, ça tombe de partout. Ce Blaine est un guitariste monstrueux, il faudrait cesser de le prendre pour un bourrin, ce mec a de la majesté, même s’il adore se gratter les couilles devant les caméras et qu’il perd ses cheveux. Toujours aussi brûlant, «Zebra Lounge». Ces mecs sont des géants de la désaille. Quelle leçon de mise en place ! Encore plus dément : «800 Miles» - Hey Oh hey !- On dirait des matelots et bien sûr c’est bombardé de son, insolent de santé vitale, appelons ça un pounding de génie. Et Blaine nous fracasse d’entrée «If You Want To Get To Heaven», en plein dans les dents du rock, Nine Pound bat la chamade et on a même l’explosion finale avec «Chicken Hi Chicken Lo», ils partent en délire total de miam miam miam miam et perdent la raison. À la fin du cut, on entend Blaine qui tombe des nues. Oh Christ !

Pire encore, voilà «Mulebite Deluxe» paru en 2005. Il s’agit en fait d’une démo de morceaux qu’on retrouvera sur «Smokin’ Taters» et «Hayseed Timebomb». Ils enchaînent les trois reprises définitives qui font la réputation de Blaine et de son Hammer : «Folsom Prison Blues» qu’ils jouent comme une reprise des Cramps - pur génie de la compréhension maximale - «Dead Flowers», avec le son que les Stones ont toujours rêvé d’avoir et «Teenage Head», cover dévastatrice des Groovies époque Roy Loney, l’ultime version. Après celle-là, ce n’est plus possible, car c’est bardé de distorse et hurlé à la vie à la mort, c’est d’une rare insanité, avec un solo en coulis de morve dans la plaie ouverte du trash-punk. Ils reprennent aussi le fameux «Radar Love» de Golden Earing qui leur va comme un gant. Ils y entrent comme dans du beurre, c’est plombé au marteau-pilon, c’est-à-dire au pire drumbeat de l’univers. Leurs cuts valent aussi le détour comme ce «Cadillac Inn» gonflé de la puissance des enfers. Ô imparabilité des choses, quand tu nous tiens... On retrouve la belle santé power-riffique du Hammer. Ils sont bel et bien les tenants et les aboutissants du genre, ils se donnent des cartes pour jouer le poker gagnant. Ils sont aussi puissants que les mauvais dieux viking jadis adorés dans les fjords oubliés des hommes. «Wrong Side Of The Road» sonne comme un hit avec son battage d’accords somptueux et c’est chanté à la charcute divine.

Ouf, par miracle, «Sex Drugs & Bill Monroe» est un album un peu moins dense que les deux précédents. Mais il faut quand même se taper quatre belles énormités, à commencer par «I’m Yer Huckleberry» - Some Kentucky vintage - Peu de groupes peuvent sortir un son pareil. On a là un cut digne des Supersuckers et de Motörhead. On les voit passer par toutes sortes d’états successifs (garage-punk à la Dropkick Murphys, balladif énergétique du Kentucky, rock high energy monolithique à la Hellacopters, trash-balloche, tatapoum extravagant, dérives incendiaires de la cosmic Americana, white trash de caravane, sautillade de garage-punk) puis on tombe en fin de disque sur un enchaînement de trois excellents morceaux. «The Wheels Flew Off Again» file tout droit et Blaine fusille son cut à coups de notes de solo rageur, suivi de «You Ain’t Worth Killing» et de «Cooking The Corn» qui est une merveille absolue grattée à la misérable et montée sur un vieux pied de grosse caisse.
Si vous êtes sage, le petit mec qui tient le mershandising au concert de Nashville Pussy vous fera un prix sur les albums live des deux groupes de Blaine, Hammer et Pussy. On s’en doute, le «Live In Berlin» du 11 septembre 2010 est une bombe atomique. Tout est joué à la puissance maximale, ils sont même capables de faire du Motörhead à la puissance dix sur «Runaway Train». C’est poundé à la folie. On a pétaudière sur pétaudière et au passage on reconnaît les hits comme «Hayseed Timebomb» joué en cavalcade insensée. Peu de groupes vont aussi vite avec une telle puissance. Les Hammer enfoncent le nail. «I’m Your Huckleberry» sonne comme de l’Americana apocalyptique. C’est battu à la Thor. Ils sortent l’un des meilleurs blasts qui se puisse concevoir et «Wrong Side Of The Road» sonne comme un hit dès l’intro. C’est franchement dévastateur. Tout est explosé, cavalé, ravalé, Blaine le blême devient fou avec «800 Miles». Ce n’est pas un blast de pied tendre, vous pouvez me croire. Comment font-ils pour tenir un tel beat ? Here we go et voilà qu’arrive une bombe nommée «Dead Flowers». Décidément, les reprises des Stones leur vont aussi bien qu’aux Lords of Altamont. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin avec des exactions comme «Run Fatboy Run» et «Long Gone Daddy» où Blaine le blême pousse un hurlement et alors l’enfer redescend sur la terre.

Le petit mec du mershandising vend aussi un «Wanted» de country classics où traînent quelques belles énormités, comme «One Long Saturday Night», une méchante pétarade. Encore du gros tapé de son. Ils sortent une version country de «I’m Your Huckleberry» montée sur un beat cavaleur qui tourne au tatapoum de la folie. Il faut aussi écouter au moins une fois dans sa vie ce truc qui s’appelle «Drivin’ Nails In My Coffin». Voilà du country punk capable d’incendier un saloon. On goûte là au charme capiteux de la country festive à la Hank III.

Oh, il vend aussi un «Live In Rennes 1998» de Nashville Pussy. Même chose qu’avec Hammer, ça blaste dans tous les coins, et si on l’écoute, c’est surtout pour se régaler des interventions de Ruyter. «Wrong Side Of A Gun» sonne comme l’archétype de la fournaise maximale de heavyness. Rien d’aussi explosif que la version de «Going Down». Ruyter va vite, c’est une bonne et dans «I’m The Man», Blaine le blême pique des pointes stoogiennes dignes de «Raw Power». Terrifiante version de «Go Motherfucker Go», battue à la ramasse du non-retour. Peu de groupes savent ainsi foncer dans le lard du son et quand Ruyter part en solo, les colonnes du temple se mettent à trembler. Tout le monde le sait : Nashville Pussy est avant tout un groupe de scène.

Avec le succès de Nashville Pussy, Blaine Carwright fait désormais partie des poids lourds du rock américain. Il suffit de voir sa compagne Ruyter Suys s’amener sur scène et secouer le cocotier du rock. Avec Donita Sparks de L7, c’est la meilleure rockeuse qu’on puisse voir sur scène actuellement. Elle incarne toute une imagerie du rock, celle du guitariste à crinière qui se fond dans la fournaise d’un stomp avec un solo liquide. Elle ramène tout ce côté visuel qu’on vénérait jadis, les départs en solo d’un Paul Kossof en veste rayée, la crinière en mouvement de Dickie Peterson, la folle gestuelle d’un Jimmy Page, les franges de la veste de Leo Lyons en plein matraquage de basse à Woodstock, la crinière en mouvement de Barry Melton qui s’excitait sur sa Gibson SG, oui elle est tout ça à la fois et même encore plus, car elle n’arrête pas de bouger, de grimacer, de prendre des poses et petite cerise sur le gâteau, elle joue comme une déesse.

Ruyter est une belle femme, et forcément, elle vole le show. Dit autrement, Nashville Pussy n’aurait pas vraiment d’intérêt sans elle. Nashville Pussy passe à Rouen chaque fois qu’ils tournent en Europe et chaque fois, c’est une fête. Oh, il est bien certain qu’ils ne jouent pas des compos sophistiquées. Leur truc reste ce que les anglais appellent du sleaze rock, un rock très sexué et très électriquement gras qui remonte justement à Blue Cheer, à l’Atomic Rooster de John Du Cann et aux Hollywood Brats (et surtout pas aux groupes de la scène californienne des années 80 qui étaient de piètres imitateurs des Dolls). On se régale toujours de voir jouer un groupe bien en place. Pour ça, les Américains déçoivent rarement. Ils s’arrangent toujours pour mettre en avant le côté machine de guerre. Tu veux du rock, gamin ? Tu vas en avoir ! Pendant un peu plus d’une heure, ils ratiboisent tout, et jamais on ne s’ennuie, au contraire, Ruyter Suys s’arrange pour captiver de bout en bout.

On entend même de drôles de commentaires dans les premiers rangs agglutinés au pied de la scène, des trucs du genre ‘J’uis mettrais bien ma bite dans l’cul !’. Il est vrai qu’avec sa réputation ‘cowpunk’ et lingerie, le groupe draine une certaine faune. Mais l’excellence du groupe sur scène balaye tous les mauvais a-prioris. On préfère mille fois voir jouer une belle gonzesse comme Ruyter plutôt qu’un groupe de mecs qui se prennent au sérieux.

Côté albums, on est bien servi. Six albums en 15 ans, c’est un bon rythme.

Avec «Let Them Eat Pussy» paru en 1997, Blaine et son gang dépassent les bornes de la vulgarité. Franchement ils exagèrent. Ruyters et Corey Parks se font bouffer la chatte sur la pochette, ce qui bien sûr a dû attirer pas mal de regards obliques. L’intérieur de la pochette est décoré de photos de scène édifiantes. Corey portait sur le ventre un immense tatouage ailé - comme Asia Argento - légendé Eat Me, et elle crachait du feu sur scène. Cet album n’a rien de révolutionnaire, mais il y a tout de même deux ou trois cuts qui sonnent bien les cloches, à commencer par l’effarant «Snake Eyes» qui cavale à travers les plaines et que Ruyter allume d’un coup de solo stoogien. Ils enchaînent avec un «You’re Going’ Down» digne de Motörhead et noyé de guitares. L’autre énormité cabalistique est le cut de fermeture, «Fried Chicken And Coffee» monté sur le heavy beat de rêve et de rage. Ils sont dans l’excellence du son et quasiment dans les Cramps. Ils visent l’apothéose - Stay out of my yard - Blaine chante à l’horreur profonde de la dégueulade sur le meilleur beat du monde et Ruyter rôde dans la fournaise avec des notes suspendues. Franchement, le spectacle vaut le détour. Ils tapent aussi une reprise du fameux «First I Look At The Purse», mais ça ne marche pas. Ils font pas mal de trash-punk d’énervement maximum sur ce disque, et Ruyter montre de belles dispositions à l’interventionnisme. Elle trouve toujours le moyen de venir se fondre dans la fournaise, ce qui fait d’elle une guitariste exceptionnelle. Au fil des morceaux, Blaine semble vouloir repousser les limites de l’explosivité, et il utilise tout ce dont il dispose, la colère, la bave, la rage, la vitesse, la folie, la brutalité. Ça barde.

En l’an 2000, «High As Hell» s’annonce comme un disque brûlant. Au dos de la pochette, Corey Parks et Ruyter se pavanent sur un lit rouge en forme de cœur. On trouve une fantastique reprise de Rose Tatoo sur ce disque, le fameux «Rock’n’Roll Outlaw». Blaine le chante à la démesure du trash et en sort une version énorme et inspirée. Avec le morceau titre de l’album, on se croirait dans un épisode de Blueberry - Goodbye baby Go to hell - Mais le cut qui emporte la bouche, c’est le «Strutting Cock» d’ouverture, qui sonne comme le rock des vainqueurs, avec ses accords stoniens et la furie du Kentucky. Rien d’aussi dévastateur ! Le cut entre comme le char d’un empereur dans la ville conquise de nos émois pétrifiés. Qui peut s’opposer à ça ? Et Ruyter part en solo pour faire gicler la pulpe. Blaine chante «She’s Got The Drugs» au dégueulé et «Wrong Side Of The Gun» part sur un heavy sludge. Quand ils vont trop vite, ils perdent en efficacité, comme on le constate à l’écoute de «Piece Of Ass», une reprise de Rick Sims, un petit énervé du garage-punk américain qui jouait dans les Digits. On préfère les Nashville dans des choses comme «You Ain’t Right», car c’est battu tout droit par Jeremy, sans retour possible. Ces gens-là ne se retournent pas. Leur obsession est de foncer à travers la plaine en feu. Jeremy bat sec et dru, sans sourciller, alors le groupe fonce sans se poser de questions. Pas de fioritures. Blaine le blême porte sa croix, il est en short, pauvre Christ trash en route pour l’enfer, yeah !
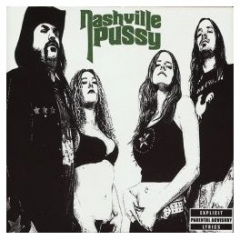
Belle pochette intérieure que celle de «Say Something Nasty», paru en 2002. Nos quatre amis n’ont pas l’air de rigoler. Et Ruyter tape à l’œil, avec son déhanché de rock star. Elle peut se le permettre, au moins chez elle, ce n’est pas de la frime. On l’a vue sur scène, c’est une vraie rock star. Avec le morceau titre, la machine infernale se met en route. Dans ce climat de belle violence, Ruyter glisse un beau solo liquide. C’est un très beau rock à guitares, celui qu’on écoute depuis cinquante ans. Les Nashville sont devenus l’épitome de nasty rock américain, une vraie bénédiction. C’est le son dont on rêve la nuit, surtout que Ruyter est bien devant dans le mix. L’autre merveille de cet album, c’est la reprise de «Rock ‘n’ Roll Hoochie Coo» du grand Johnny Winter. Reprise exceptionnelle, ils sont dessus, Blaine fait son Johnny avec une classe écœurante et il restitue toute la sauvagerie de cet albinos devant lequel se prosternaient les foules. Sur la plupart des morceaux, comme sur «Gonna Hitchhike...», c’est Ruyter qui fait le show avec ses solos dévastateurs. Elle dégringole des rivières de notes, mais de façon puissante et sans appel. Avec «You Give Drugs A Bad Name», ils partent au quart de tour sur des accords saccadés de blues. Ils se montrent merveilleusement efficaces. Avec «Keep On Fucking», ils passent au heavy boogie et Ruyter plonge dans la mélasse pour soloter comme une folle. Même chose avec «Keep Them Things Away From Me», ils reviennent avec un son qui donne le vertige, au meilleur gras et au chant hurleur, avec bien sûr un énorme solo de Ruyter à la clé. Et Blaine le blême screame comme un malheureux tombé dans les pattes de la Sainte Inquisition. Le hit de l’album est probablement «Let’s Get The Hell Outta Here». Ruyter fonce dans les fondements du cut dès l’intro. Elle a tout compris, la fouine. Elle taille son chemin dans les dynamiques du sous-bassement, juste en dessous du chant. Elle sonne comme un franc tireur et file comme le vent. C’est là que s’illustre le génie des Nashville Pussy, dans le gras de la couenne.

C’est Daniel Rey qui produit «Get Some» en 2005. On se souvient de lui comme d’un bel amateur de gras (Dee Dee Ramone, les Misfits, D-Generation, Gluecifer et Joey Ramone, entre autres). Ouverture explosive avec «Pussy Time». Il faut bien dire qu’avec eux, on finit par être habitués à ce genre de procédé. La reprise de l’album, c’est «Nutbush City Limits» d’Ike & Tina Turner. Ils en font une version violente et hurlée. D’ailleurs, tout est violent et hurlé sur cet album, comme cet «Atlanta’s Still Burning». Franchement on se croirait dans Autant En Emporte le Vent, au plus rouge des combats - Atlanta had burned down to the ground/ Oh yeah ! - C’est du garage à la Blaine, sans fioritures. On se régale aussi de ce «Come On Come On» noyé de guitares dès l’intro, joué aux accords claqueurs de beignets, ça sonne comme les Stones, mais en mille fois plus virulent, bien sûr. Dans «Good Night For A Heart Attack», on assiste à une violente montée de température et Blaine bascule comme d’habitude dans les excès - I’m going to a drug fight/ I ain’t coming back - Dommage, ils ont beaucoup de cuts cousus de fil blanc et ils sonnent parfois comme AC/DC, ce qui est loin d’être un compliment. Heureusement que Ruyter la folle rôde dans les buissons. Ils jouent une autre reprise, le «Raisin’ Hell Again» de Scott H. Biram. Ils nous noient ça dans une grosse purée de slide, sur un drumbeat de dieu viking. Ruyter y fait un travail hallucinant.

On sent une sorte de perte de vitesse avec «From Hell To Texas», enregistré en 2009. Si cet album reste dans les annales, c’est uniquement pour le dernier cut, «Gimme A Hit Before I Go» qui est un petit chef-d’œuvre de Stonesy - Wanna drown in the sweet/ Strench of success ah ah - Et Blaine n’en finit plus de décrire son état d’esprit jusqu’au-boutiste - I’d rather do drugs with world famous sluts/ I want the whole world to kiss my butt - Blaine Cartright ne fera jamais dans la dentelle, inutile d’espérer un miracle. On trouve aussi une belle apologie des drogues, «I’m So High», mais il ne peut pas s’empêcher de retomber dans le trash du Kentucky - I’m gonna get wasted in the stratosphere/ And take a shit on the moon - Il n’y a que Blaine pour rêver de chier sur la lune. Autre chanson intéressante : «The Late Great USA» : il y fait l’apologie d’Amsterdam et de Madrid, juste pour faire la différence avec la façon dont on est traité en Amérique. Et puis on se régalera aussi d’«Ain’t Your Business», bien claqué du beignet de crevette, ça plâtre sec au plafond à l’ancienne et ça gicle dans l’œil du cyclope.

Sur «Up The Dosage» paru l’an dernier, on trouve de sacrés clins d’yeux aux Stones et notamment ce fabuleux «Before The Drugs Wear off», soutenu par un gros riffage et du bon vieux pounding hammerien - I got it all I got it all/ So let’s get it on/ Before the drugs wear off - En bonus, ils font une version attaquée à l’acou de cette petite merveille et Blaine chante comme un vieux pirate. On se régale du «Everybody’s Fault But Mine» d’ouverture qui est du pur jus de heavy blues à l’ancienne - Staggering up the montain - un son qui justement nous renvoie aux extraordinaires délires pachydermiques de Mountain. Voilà un cut de rêve, fabuleusement gras et heavy. Just perfect. Ils sortent à peu près la même purée avec «White And Loud». Petite chanson politique avec «The South’s Too Fat To Rise Again» : Blaine s’y moque des gros rednecks - Now we’re having heart attacks from tryin’ to wipe our ass - Ils font pas mal de garage punk, mais ça ne leur va pas bien. Le blues rock leur va bien mieux, comme on le constate à l’écoute du morceau titre de l’album - Gimme more/ gimme more - Blaine ne vit que pour les excès et Ruyter sonne comme Fast Eddie Clarke. Ils finissent avec «Pussy’s Not a Dirty Word», une énormité explosée à coups d’ouvertures interventionnistes combinées de Ruyter et de Blaine. Encore un couple infernal.
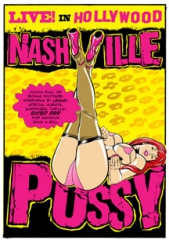
Et ce film ? Idéal pour les inconditionnels. Sur le DVD «Live In Hollywood», on a une bonne heure trente de concert, du gros Nashville avec toutes les pointes de fièvre, mais ce qui fait le charme de ce DVD, ce sont les bonus, eux aussi copieux. Ça commence par des séquences filmées dans des backstages divers lors d’une tournée en France. On les voit faire une balance pour Canal + et on sent tout de suite l’infernale puissance du groupe. Ils tapent en effet dans «Come On Come On». Ruyter porte des lunettes de vue et un sweater gris à capuche, elle prend les deux premiers solos comme sur le disque, et Blaine le troisième. On la voit taper du pied. Elle aime ça, aucun doute là-dessus. Puis on les voit jouer en direct devant les caméras de Canal, et ils sonnent pareil. Ruyter porte un pantalon en vinyle noir et un petit haut noir. Dans une autre séquence filmée en Australie, on les voit sur scène avec Pete Wells de Rose Tattoo. Plus loin, on voit Blaine jammer et travailler des morceaux. Mais la séquence la plus fantastique arrive : Ruyter en studio avec Daniel Rey. On la voit jouer en re-re sur «Nutbush City Limit» et en comprend mieux pourquoi elle est la star du groupe. Elle joue en gras et en continu sur le beat de stomp. Daniel allume une clope pendant que Ruyter joue. Elle est exceptionnelle, colorée, inventive, bluesy. Et la petite cerise sur le gâteau, c’est l’interview de groupe par Lemmy dans le backstage à Hollywood. Extraordinaire séquence de concentré de tomate de mythe. À la fin, Lemmy serre la pince aux quatre Nashville mais Ruyter lui roule une pelle.
Signé : Cazengler, Nashville Poussif
Nashville Pussy. Le 106. Rouen (76). 10 mars 2016
Nine Pound Hammer. The Mud The Blood And The Beers. Crypt Records 1988
Nine Pound Hammer. Smokin’ Taters. Crypt Records 1991
Nine Pound Hammer. Hayseed Timebomb. Crypt Records 1994
Nine Pound Hammer. Kentucky Breakdown. Middle Class Pig Records 2004
Nine Pound Hammer. Mulebite Deluxe. Acetate Records 2005
Nine Pound Hammer. Sex Drugs & Bill Monroe. Buzzville Records 2007
Nashville Pussy. Let Them Eat Pussy. Amphetamine Reptile Records 1997
Nashville Pussy. High As Hell. TVT Records 2000
Nashville Pussy. Say Something Nasty. Artemis Records 2002
Nashville Pussy. Get Some. Spitfire Records 2005
Nashville Pussy. From Hell To Texas. SPC USA 2009
Nashville Pussy. Up The Dosage. SPV USA 2015
Nine Pound Hammer. Wanted. Country Classics.
Nashville Pussy. Live In rennes 1998. Booting The Bootleggers Volume 1. Singing Pig Records 2010
Nine Pound Hammer. Live In Berlin. Booting The Bootleggers Volume 2. Singing Pig Records 2012
Nashville Pussy. Live In Hollywood. DVD Steamhammer 2008
De gauche à droite sur l’illusse : Blaine Cartwright, Karen Cuda, Jeremy Thompson & Ruyter Suys.
BLUES
LES INCONTOURNABLES
( Editions Filpacchi / 1994 )

Encore un mastodonte, format genre diplodocus qui vous oblige à relever le plafond de la maison. Mais quand on l'ouvre, l'on ne regrette pas. D'abord les photos pages de droite qui vous mangent les yeux. Pour la plupart sorties des archives de Jazz Magazine. Du blanc et noir de toute beauté. Ensuite le texte. Ou plutôt les textes car ils s'y sont mis à plusieurs : Philippe Bas-Raberin, Kurt More, Jacques Demêtre, Robert Sacré, Sébastien Danchin, Gérard Herzhaft, Frank Ténot, Véronique Mortaigne, Emmanuel Gimenez, Jean Buzelin, Jacques Périn, Alain Tomas, Francis Hofstein, Philippe Carles, Denis-Constant Martin, François Thomazeau, fines plumes et grands bretteurs qui au siècle dernier ( comme le temps passe ! ) ont été les pionniers des revues qui se sont battus pour introduire le blues, le jazz, et même le rock, en notre pays, en ses larges masses un tantinet réfractaires à ces musiques ensauvagées. Le lecteur assidu de KR'TNT ! se souviendra d'anciennes livraisons dans lesquelles nous avons chroniqué certains de leurs ouvrages. Pour les amateurs nous signalons que Les Incontournables sont une collection de prestige, ils retrouveront, entre un volume consacré au Jazz et un autre dédié à l'Opéra, un opus voué au Rock'n'roll. Qui ne m'est jamais tombé entre les mains, ce que je regrette.

N'y a pas que le rock and roll dans la vie. Ici ça jase de blues. Très bellement. Christian Casoni qui chaque mois dresse dans Rock & Folk le portrait que nous qualifierons de littéraire d'un bluesman a dû s'inspirer du principe. Page de gauche : une évocation sur deux colonnes ( du temple ) d'une des principales figures du blues. L'exercice demande de la précision biographique et du style. Je vous laisse deviner ce qui prime. Ne soyez point béotien dans votre réponse.
Reste la grande difficulté : celle du rangement. Les Incontournables ont contourné la difficulté : ont adopté l'ordre alphabétique. De Texas Alexander à Jimmy Yancey. Pas de jaloux, pas de préséance. Facile de s'y retrouver. Nous avons vu lors de la recension de l'ouvrage Le Blues de Mike Evans comment celui-ci n'évite pas les circonvolutions historiales pour présenter son panorama chronologique. Mais ici l'on a fait l'impasse sur le rhythm and blues et l'on ne s'aventure guère dans la modernité, pas plus loin que Robert Cray, et en général l'on se cantonne aux états du Sud et à Chicago.
Pour le choix des artiste : y sont tous. Sauf ceux qui manquent. Votre outsider n'y sera pas. Tant pis pour vous. Gros lot de consolation : les essentiels connus moins célèbres sont là. Régal des yeux et de l'esprit. Qu'exiger de plus ?
Si la paresse vous étreint d'une poigne léthargique, pages 25-26, rentrez en contemplation devant la magnifique et inquiétante vue des méandres du Mississippi, le vecteur naturel du blues qu'ils disent en légende, ils ont raison, ce sera votre initiation au sortilège hypnotique de la musique du Diable. Vous comprendrez mieux les reptations du muddy crawlin' snake blues. Cette légère incertitude, cette claudication rythmique de la menace du destin qui alourdit votre fragilité existentielle.
Un livre pour rêver.
Damie Chad
SOUNDPAINTING
Un ami est venu passer trois jours à la maison. J'aurais dû le tuer. Non, je ne suis pas méchant. Le méritait. C'est un jazzeux. Tout de suite vous comprenez. J'ai été faible, je l'avoue. Je ne voulais pas non plus perdre mon temps précieux de rocker à éponger son sang impur dans les sillons de mon plancher. Mais en y réfléchissant, je me dis que c'était une injonction kantienne des plus morales. Je regrette. Ne serait-ce que pour l'édification des jeunes générations. Surtout qu'il s'est ouvertement moqué de moi, plié de rire sur le canapé, crachotant une marre de ricanements putrides de hyène. J'étais en train de parler d'un peintre - j'ai oublié le nom - qui réalisait des tableaux durant les concerts des bluesmen auxquels il assistait. Voulant lui en mettre plein la vue avec mes restes d'anglais de sixième lointaine je m'étais risqué à employer l'expression soundpainting ce qui à ma grande surprise avait déclenché son exaspérante hilarité. En plus je me suis enquillé sa professorale explication des plus techniques.
LE SOUNDPAINTING
Rien à voir avec la peinture. Ne vous encombrez de références malvenues style Picasso, Monet, Degas, Malevitch. Le soundpainting c'est un langage de signes pour des gens qui entendent parfaitement. Même que si vous avez l'oreille absolue, c'est encore mieux. Ne foncez pas sur une méthode assimil, il y aurait près de trois mille signes. Une chinoiserie sans fin. D'ailleurs ça peut se pratiquer avec une baguette, mais la main suffit.

Vous avez eu la définition, vous explique le mode d'emploi. Réunissez quelques musiciens de jazz, une vingtaine par exemple, batteur, saxophonistes, trompettistes, tubas, pianiste... et même si aimez innover un joueur de castagnettes. Votre palette sonore est au garde à vous devant vous. Profitez-en pour les agoniser d'insultes, ce sont des jazzmen ne l'oubliez pas, afin de les galvaniser. Maintenant vous commencez votre tableau sonorisé. Chaque musicien, chaque sous-groupe de musicos, possède son signe d'appel. Vous écoute des doigts et de leurs deux yeux, vous leur demandez ce que vous voulez - par signes évidemment - toi le trompette une strette en fa mineur s'il te plaît et maintenant tous les cuivres, espèces de sagouins, modérato expansivo un nappé rutilant... Cela vous donne l'air idiot des transcripteurs des informations en langage de signes pour les malentendants à la télé, en contrepartie vous créez votre concerto à votre guise. Oeuvre collective, ( vous écrirez leur noms en minuscules illisibles sur la pochette ) les musiciens obéissent à vos injonctions digitales mais c'est leur inspiration qui décide de la phrase musicale qu'ils vont jouer, même si vous vous êtes mis d'accord au préalable sur un vieux standard connu de tous dont les harmonies de base limiteront de trop grands écarts.

C'est un certain Walter Thompson qui inventa cette méthode en 1974 à Woodstock ( c'est fou tout ce qui s'est passé dans ce patelin paumé quand on y pense ), depuis elle s'est enrichie par l'adjonction d'autres arts comme la danse. En France c'est François Cotinaud ( voir KR'TNT ! 285 du 05 / 06 / 16 ) qui est le fer de lance de ce mouvement.
Faudra qu'un jour je réunisse les vingt meilleurs rock critics nationaux et je mènerai la première chronique rock en soundpainting de l'univers. D'office le Cat Zengler est désigné pour le titre et la signature finale. Prendra le stylo rouge fluo, celui qui se voit le plus.
Damie Chad.
NOUS, LES NEGRES
JAMES BALDWIN / MALCOLM X
MARTIN LUTHER KING
Entretiens avec KENNETH B. CLARK
( La Découverte / Poche : 2008 )
Soixante-dix pages d'interviewes réalisées par Kenneth B. Clark pour la WGBH-TV chaîne éducative de Boston, entre mai et juin 1963, produites par Henry Morgenthan, comme il s'en explique en une trop courte notule en fin de volume, dans le cadre d'une émission intitulée : Le Noir et la promesse Américaine.
Ces contributions de trois des figures représentatives de la contestation noire furent réalisées entre deux moments importants, l'échec de l'entrevue d'une délégation comportant en son sein James Baldwin avec le Ministre de la Justice et la grande marche sur Washington DC du 28 août de la même année. Mais tout cela est précédé d'une préface d'Albert Memmi qui remet les pendules de la négritude à l'heure. L'a été rédigée en 2007, dix ans après aucun mot n'est à changer. L'esclavage, la ségrégation, la déplorable situation des couches populaires noires, c'est bien. Enfin manière de parler. Mais il ne faudrait pas que l'arbre des afro-américains cachât la forêt des afro-européens. Entendez par ce mot, les populations noires d' une Afrique dont les richesses sont confisquées par les multinationales, résultat de plusieurs siècles de colonisation. N'oublie pas non plus les vagues d'immigration en route vers l'Europe si peu accueillante. Loin de lui l'idée de s'apitoyer sur les pauvres petits gentils noirs tout blancs d'innocence. Dénonce et fustige sans pitié les gouvernements africains gangrénés par la corruption et leurs élites inféodées à la toute puissance du Capital. Ne s'agit pas de pleurnicher des larmes de crocodile pour soulager sa bonne conscience. Le problème n'est pas de constater l'ampleur des dégâts mais de s'opposer dans les faits à toutes ces oppressions.
Que faire ? Comment faire ? Exactement la problématique soulevée par ces trois interviewes. James Baldwin tient le rôle sympathique de l'intellectuel. Le gars compréhensif, aux idées avancées, prêt à discuter pour faire avancer le schmilblick. L'on peut certainement trouver un terrain d'entente. N'est-il pas un démocrate ? Oui, bien sûr. Mais Baldwin ne mâche pas ses mots. Il est trop tard. Les noirs attendent depuis trop longtemps, ils sont victimes de multiples violences, la liste des morts et des assassinats s'allonge sans cesse. Quand on lui demande de se positionner sur le radicalisme de Malcom X et la non-violence prônée par Luther King, il n'est pas plus enthousiaste envers l'un qu'avec l'autre. C'est la violence des blancs qui ont créé Malcolm X, et quant aux bondieuseries de Luther de moins en moins de noirs y croient... La mèche est allumée, il n'y a plus qu'à attendre l'explosion...
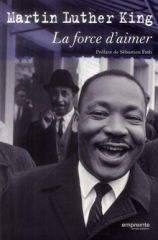
Malcolm X est la froideur orientée. Répond avec précision. Sa vérité toute nue. L'est partisan d'une séparation complète. Les blancs d'un côté. Les noirs de l'autre. Accuse les blancs progressistes et les juifs de phagocyter les associations noires dans le but conscient ou inconscient d'empêcher l'identité noire de s'épanouir pleinement. Se revendique de la rigueur morale de l'Islam. Tout le contraire de Luther King qui se réclame de la non-violence sous-tendue d'humanisme chrétien. Cite Gandhi comme exemple et compte sur l'opinion publique mondiale pour faire céder les blancs.
Kenneth B. Clark ne contredit pas ses invités. Leur pose des questions destinées à exprimer leur position avec un maximum de clarté, Leur permet de retracer leurs parcours, d'expliciter leurs actes, et de préciser leurs idées. L'Histoire se chargera de répondre à sa manière à leur point de vue respectif. Malcolm X sera assassiné en 1965, Martin Luther King sera abattu en 1968, en 1970 James Baldwin sentant le danger se préciser s'installera en France...
Damie Chad
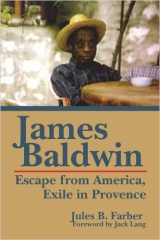
P. S. : je finis cette courte chronique lorsque j'entends à la radio que la maison de James Baldwin à Saint-Paul de Vence a été rachetée par un promoteur pour construire sur son terrain des appartements de luxe... Des militants estiment que ce lieu chargé d'histoire aurait plutôt vocation à devenir un centre de réflexions axées sur les luttes de libération actuelles... Nous leur donnons raison.
MALCOLM X & ALEX HALEY
L'AUTOBIOGRAPHIE
de
MALCOLM X
( GRASSET / 1993 )
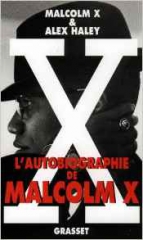
Vaut mieux s'adresser à Satan qu'à ses diablotins. Généralement quand on aborde le cas Malcolm X, soit votre votre interlocuteur expédie le problème d'une pichenette intellectuelle, parlons d'un sujet un peu plus sérieux s'il vous plaît, soit le visage se ferme et vous sentez que votre vis-à-vis a bien un avis positif sur le personnage mais qu'il ne veut pas vous le donner, craignant de froisser vos susceptibilités politiques.
L'est sûr que Malcolm X n'a jamais fait dans la dentelle. N'avait pas des opinions tranchées, mais des certitudes aussi tranchantes qu'une hache d'abordage. En plus, l'a eu la mauvaise idée de périr sous les balles de ses assassins à l'âge de trente-neuf ans alors qu'il abordait une mue intellectuelle des plus intéressantes comme l'explique Daniel Guérin dans une assez longue préface.
Cette autobiographie que Malcolm a dictée à Alex Haley est divisée comme la Gaule de Jules César en grande partie, trois tronçons d'un chemin de vie dont la signifiance finale échappera en partie à son auteur.
ENFANCE

La première moitié du volume est des plus classiques. Corrobore toutes les biographies qui nous retracent la jeunesse d'artistes et d'écrivains noirs américains nés dans la troisième décennie du vingtième siècle. Nous pouvons les résumer en deux mots, misère et racisme. Et violence. Le père de Malcolm Little est un pasteur adepte des thèses de Marcus Garvey qui prônait le retour des Noirs en Afrique, tient des réunions secrètes dans des appartements privés, le petit Malcolm y assiste parfois... Idées jusqu'au boutistes et séditieuses qui ne plaisent pas à tout le monde. Le Klu Klux Klan le menacera de très près avec toute la panoplie des torches et des cagoules. Lorsque l'on retrouvera le père de Malcolm la tête réduite en bouillie et le corps méchamment entaillé par le tramway qui lui est passé dessus, les soupçons se porteront plutôt sur la Légion Noire - organisation raciale et suprématiste blanche - que sur le KKK... Pas d'enquête, la compagnie d'assurance statuera sur un suicide.... Malcolm prétend que ce sont des noirs partisans de l'intégration lente de leur communauté parmi les blancs qui auraient révélé à la Légion Noire le comportement politiquement incorrect de son père.

Tout son enfance et toute son adolescence seront confrontées à la pitié des blancs. Les assistantes sociales qui viennent au secours de cette veuve éplorée mère de huit enfants et qui sous prétexte d'aider placent un à un les rjetons chez des familles qui au moins les nourriront à leur faim... La mère effondrée finira à l'asile...
La suite ne ressemble guère à du Zola, Malcolm est un élève doué, le seul noir de sa classe, les dépasse tous par sa taille et son intelligence, l'est un peu la mascotte de son école, le gentil petit nigger que tout le monde apprécie. Premier désenchantement, un professeur qui lui conseille de viser la profession de menuisier plutôt que celle d'avocat. Sera désormais le pitre doué qui ridiculise les profs ce qui lui vaudra la maison de redressement. Où tout se passera pour le mieux. Le bon garçon qui devient le chouchou de la directrice et de son mari. Pas du tout des tortionnaires. De la discipline, mais l'endroit a un peu l'esprit d'une pension de famille quasi-débonnaire. Malcolm a pour la première fois l'occasion de côtoyer des blancs. Ne sont pas méchants, mais leur opinion sur les noirs est sans appel : des espèces de sous-hommes qui ne sauraient se débrouiller tout seuls, ont besoin de l'attentive compassion des blancs pour marcher droits. De grands enfants.
JEUNESSE

A seize ans se retrouve à Boston chez sa demi-soeur Ella. C'est le moment de gagner sa vie : emploi dans une compagnie de chemin de fer, petits trafics en tous genres, une histoire de fesse qui tourne mal et le voici en 1943 à New York. Une place de cireur de chaussures au Lindy Hop NightClub. Boulot que vous trouvez peu ragoûtant ? Erreur sur toute la ligne. Duke Ellington, Count Basie, Lionnel Hampton, Cootie Williams, Jimmy Lunceford, Johnny Hodges, sont régulièrement au programme. Et puis tous les à-côtés, les pourboires, les billets pour les services rendus : cigarettes de marijuana, petits billets de rendez-vous coquins à remettre en mains sûres, adresse d'établissements spécialisés à glisser au creux de l'oreille... Durant ces années new yorkaises Malcolm s'initie à l'autre face cachée de la ségrégation, les blancs qui baisent les prostituées noires et les gentes dames blanches insatiables à la recherche d'étalons noirs... Révélation de l'hypocrisie sociale. Se fait beaucoup d'argent, boit, fume - tabac et marijuana - le luxe d'une copine blanche, et pour assurer les fins de mois quelques cambriolages avec une bandes de potes.

Ces cinq années de fêtes incessantes se termineront brutalement : tombe stupidement dans un guet-apens tendu par la police chez un bijoutier chez qui il a déposé une belle montre volée pour réparation... Verdict sans appel : dix ans de prison. Aura droit à une remise de peine de trois ans mais ce n'est pas le même homme qui en ressortira.
MILITANT MUSULMAN
Cure de désintoxication, par la force des choses. Se met à lire, à éplucher un dictionnaire et se réapprend à écrire, à maîtriser sa syntaxe. Lui qui a toujours été un beau parleur, goûte les vertus du silence propice à d'intenses réflexions. Ses frères lui ont rendu visite. Ont eu une jeunesse plus sage que la sienne, sont devenus des adeptes d'Elijah Muhammad, dont ils lui laissent quelques brochures. Malcolm intrigué lui écrit et Elijah Muhammad lui répond. Malcolm est subjugué, comment cet homme si important peut-il manifester son intérêt pour un petit délinquant comme lui ? La correspondance ne cessera plus.
L'ennui et la solitude peuvent suffire à expliquer l'improbable. Malcolm a été élevé dans un milieu religieux, le christianisme a été depuis les débuts de l'esclavage une des colonnes vertébrales sur laquelle s'est réalisée une partie de l'identité des communautés noires. Mais cet aspect ne viendra qu'en deuxième position : ce qui l'enchante dans les écrits d' Elijah Muhammad réside en l'implacable analyse effectuée par celui-ci sur les rapports entre noirs et les blancs. En quatre siècles, rien n'a vraiment changé, toutes les évolutions présentées comme des bonds qualitatifs historiques par les blancs ne sont que des leurres. De belles idées en trompe l'oeil sur le papier que la réalité de la situation dément instantanément. Ce sera le cheval de bataille de Malcolm lorsqu'il deviendra le bras droit de Muhammad. L'est un tribun au discours implacable. Les blancs sont des diables, il est inutile de leur courir après. Malcolm en veut particulièrement aux élites noires embourgeoisées qui ont perdu tous les attributs mentaux de leur race. C'est à ces traîtres qu'il réserve ses flèches les plus acerbes.

L'islamisme de Muhammad permet de se démarquer totalement de la communauté blanche. Il modélise par ses obligations et interdits moraux - no sex, pas d'alcool, pas de tabac, s'instruire, consommer noir, bien s'habiller - une régénération de la race noire. Dans les années soixante-dix le mouvement chrétien des re-born n'est pas très éloigné de tels comportements. S'agit d'opérer une révolution intérieure pour s'isoler de la chienlit morale environnante et pour opérer une coupure radicale avec son passé.
Malcolm Little a pris le nom de Malcolm X comme le préconisait son organisation pour ses adhérents. Cette revendication de l'anonymat du X est un rappel que les noirs portent des patronymes qui ne sont pas les leurs, qui leur ont été imposés par les maîtres blancs pour éviter tout rappel malencontreux de leurs provenances africaines.
Durant quatorze ans Malcolm se démène pour faire progresser le mouvement des Black Muslims, en est la figure de proue. De quatre mille adeptes le mouvement passera à quatre cent mille sympathisants, les violentes attaques dont l'organisation est victime dans les médias lui procurent une énorme publicité parmi les couches les plus défavorisées de la population. Malcolm dit tout haut ce qu'elles sont incapables de formuler avec clarté.

Les Black Muslims sont des séparatistes, rêvent d'un territoire sur le sol américain qui leur permettrait de couper tous liens avec les blancs détestés. Ne plus se mêler avec les Diables Blancs devient leur obsession. Se referment sur eux-mêmes comme un oeuf à la coquille incassable. L'adhésion fonctionne comme une coque de protection qui vous permet de vous couper du monde extérieur. Une île qui possède ses garde-côtes. Qui ne servent pas à grand-chose en vient à juger Malcolm. Des milices d'auto-défense nommées Fruit on Islam chargées de protéger les cadres de l'organisation et ses manifestations. Mais en attendant, c'est le mouvement non-violent de Martin Luther King qui mène des actions décisives et qui subit les exactions les plus brutales de la police. Etat de fait d'autant plus insupportable que de nombreux blancs de bonne volonté participent à ses marches de protestation.
Malcolm se trouve pris entre une redoutable contradiction, lui qui hait les blancs, qui déclare haut et fort que tout blanc qui entre dans une organisation noire la corrompt, pense que les Black Muslims devraient s'engager en des confrontations violentes avec les forces de répression. Des révélations sur les amours illicites d'Elijah Muhammad avec ses secrétaires l'incitent à remettre en question la personnalité sacrée du guide suprême... Finira par être exclu de l'organisation.
ULTIMES METAMORPHOSES
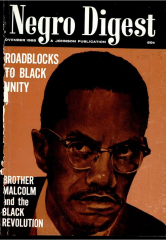
Malcolm est une figure charismatique. L'on attend de lui des directives précises. En son fort intérieur il hésite. Le mouvement qu'il essaie de créer ne mord pas sur les masses. Pour se mettre au clair avec lui-même il participe au pèlerinage de la Mecque. Prend la grande claque de sa vie : les fidèles sont de toutes les races : des blancs, des jaunes, des noirs, tous unis. Tous des êtres humains. Lorsqu'il rentrera il amendera ses principes de base reconnaissant que tous les blancs d'Amérique ne sont pas des ennemis. Sont aussi sincères que lui lorsqu'ils dénoncent le racisme. L'a profité de son voyage pour circuler en Afrique, l'est reçu par de nombreux chefs d'état comme Nasser. Se rend compte que la lutte des noirs américains n'est qu'un sous-ensemble d'un mouvement de revendications économico-politiques qui parcourt la planète. Le monde connaît alors l'acmé du mouvement tiers-mondiste anti-colonialiste.

Son cerveau est en ébullition, l'aspect religieux passe au second plat, se dirige vers un nationalisme noir qui ne serait plus un cocon protectif. Sent qu'il faut déployer celui-ci dans la réalité nationale américaine. Dans sa préface Daniel Guérin affirme que l'étape suivante aurait été celle d'une affirmation d'un combat de lutte de classes révolutionnaire. Nous ne le saurons jamais. Des cocktails molotov sont lancés dans l'appartement familial de Malcolm. pas de dégâts humains, dans un premier temps il accuse l'organisation des Black Muslim. Mais bientôt il pense que le danger vient d'ailleurs. A la prescience de sa fin prochaine. Sera abattu de quinze balles dans un meeting par deux tireurs noirs. L'on ne saura jamais qui étaient les commanditaires. Mais l'on connaît les méthodes de manipulation et d'élimination du FBI et de la CIA...
INTERROGATIONS

Que reste-t-il aujourd'hui de Malcolm X ? Le souvenir d'un homme engagé. Qui n'a jamais hésité à indiquer clairement qui étaient ses ennemis. L'était comme le Seigneur, recrachait les tièdes, préféraient les racistes à la Goldwater qui affichaient leurs idées et volitions raciales sans complexe. Rappelait qu'il n'avait jamais mis les pieds dans les Etats du Sud et qu'il était un américain des Etats du Nord dont il dénonçait avec une extrême virulence l'hypocrisie de leur anti-racisme théorique...
La fascination et l'adhésion dont il fit preuve envers l'islam nous interroge particulièrement quand l'on pense à cet islamisme radical qui embrase les pays du Moyen-Orient et qui ne laisse pas insensible toute une portion non-négligeable de la jeunesse des cités européennes. Il y a sûrement des enseignements à tirer sur cette évidence d'une colère sociale qui se structure selon un radicalisme religieux. Cette constatation étrange aussi que Malcolm fut abattu alors qu'il se rapprochait d'un mode de pensée plus purement politique.
Reste à savoir ce que le mouvement noir américain fera de la figure de Malcolm X dans les années prochaines.
Damie Chad.
IL FAUT RENTRER MAINTENANT
EDDY MITCHELL
avec DIDIER VARROD.
( Editions de La Martinière / 2012 )
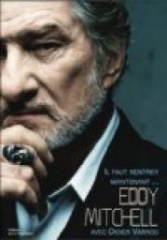
J'ai longtemps été fan d'Eddy Mitchell. Mes années collège surtout. Trente kilomètres en stop pour mon premier concert à Tarascon. En Ariège. En 1968. Deux mille personnes, facile de me reconnaître, dans la bande des quarante excités tellement agités que le public avait organisé un prudent no man's land autour de nous. J'en garde le souvenir d'Eddy sirotant un jus d'orange pendant le solo de J'avais deux amis. Deux ans plus tard j'ai remis le couvert. Ce devait être à Saint Cyprien au bord de la Mare Nostrum. Vous ne pouvez pas ne pas me voir, tout devant de la photo de fausse une de l'Indépendant qui couvre toute la page. Grandiose ! Des milliers de participants. A part qu'aux premiers rangs nous étions près de cinq cents. Une ambiance délirante. Je ne vous raconte pas l'orga débordée qui interrompt Eddy au bout d'une minutes et qui menace d'annuler le concert si nous ne nous calmons pas... Nous étions jeunes et fous. Quarante ans après, toujours aussi jeunes du ciboulot et encore plus fous de rock.
J'aimais bien ses titre rentre-dedans du genre Si tu n'étais pas mon frère je crois bien que je t'aurais tué ou alors ces diatribes à l'emporte pièce contre la religion chrétienne. Puis le père Eddy a doucettement évolué comme on dit pour ne pas employer le verbe régresser. Ai fait l'impasse sur ces insupportables face B blues du blanc déconnecté du blues, l'a adopté en filigrane de ses morceaux un ton désabusé un peu inquiétant. Etait-ce le vieillissement de la trentaine qui s'annonçait ou ce que les esprits pondérés appellent le début de la sagesse ? J'ai longtemps acheté ses disques plus par fidélité à moi-même qu'à Eddy. J'ai définitivement stoppé lorsqu'il a sorti son double CD de génériques de films, d'une tristesse glaçante.

Mais lorsque Mister B m'a proposé le bouquin, je n'ai pas dit non. Pas un véritable livre, une série d'interviewes réalisées par Didier Varrod entre 2010 et 2012. S'achève juste après les adieux... Un coriace le grand Schmall. Ne se livre guère. L'on n'apprend que ce que l'on connaissait déjà. Toutes ces anecdotes qu'il a déjà racontées mille fois à la radio. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Un trait typique de son caractère. Ce qui est fait est fait et il est inutile d'y revenir dessus. L'homme n'a pas d'état d'âme. Ne larmoie pas sur ses regrets. Déteste se vanter. Se préserve des médias, participe le moins possible aux hypocrites comédies de la promotion à tous vents. Est sûr de lui, a la fierté d'assumer sa carrière, l'on sent le gars insensible aux critiques et peu enclin à céder à la fumée des louanges extatiques. Reconnaît ses concessions, les pubs qui comblent les déficits, les tournées dans les pays de l'Est qui remplissent le porte-feuille... Parle un peu avec émotion de ses parents et très peu de sa femme et de ses enfants. Attitude de français moyen, protège sa famille, paie ses impôts sans se plaindre ( ce qui est plus rare ), essaie de bien faire son boulot, et tient un discours sans pitié pour nos élites politiques. Pas un extrémiste, ni un rebelle, quelqu'un qui louvoie avec le Système tout en essayant de garder les mains propres... Refuse de se plaindre, l'a eu un cancer qu'il a terrassé et une vie supérieure à la moyenne de ses concitoyens. L'en est conscient. A tracé une ligne de démarcation - avec points de passage inévitables - entre l'intime personnalité de Claude Moine et le personnage public d'Eddy Mitchell.

Ne regarde point en arrière, se tourne vers son présent. Evoque longuement cette seconde carrière d'acteur de cinéma qui prend le dessus sur celle de chanteur. Sur ce coup-là Eddy m'a beaucoup déçu, lui le passionné de pellicules américaines joue dans cet insupportable cinéma franchouillard qui m'a toujours débecté... Question musique, pas trop à se mettre sous la canine. Ses prédilections premières pour Bill Haley et Gene Vincent. Insiste sur son amitié avec Johnny Hallyday et Coluche, raconte les quatre opérations successives que Claude François infligea à son nez trop long. C'est en cet épisode, et pratiquement pour la seule fois, que l'on a droit à ses saillies ( nasales ) si particulières de son humour pince-sans-rire et coupe-court qui forment d'habitude le fond de ses interventions radiophoniques et télévisées.
Le plus passionnant du livre reste cette confidence de Quinn Ivy, fauché comme les blés, qui réunit ses derniers dollars et envoie sa femme travailler afin de payer les séances studio d'un chanteur noir rencontré dans un bar. Un célèbre inconnu qu'il va coacher car sa chanson : When a Man Loves a Woman lui semble prometteuse. La proposera à Atlantic pour la mettre sur le marché. Jusque là tout va très bien quand survient cette révélation extraordinaire, lui qui a pris tous les risques financier pour Percy Sledge ne l'a jamais laissé entrer chez lui. Un noir invité chez les blancs ? Ne poussez pas la mémé dans les orties !

Honnête et travailleur. Pas de sexe. Pas de drogue. Très peu de rock. L'a arrêté l'alcool et tente de ne plus fumer. Une vie phantasmatiquement peu rock and roll. No mytho-destroy. Les pieds fermement enfoncés dans le goudron des mentalités prolétaires peu sensibles aux sirènes des conduites à risque. N'est pas James Dean, ne vit pas trop vite. Et mourra vieux. Ne nous donne pas envie de rêver. Mais ferons-nous mieux ?
Damie Chad.
22:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : real kids, nashville pussy, malcolm x, eddy mitchell