02/11/2016
KR'TNT ! ¤ 301 : JOE CLAY / VINCE TAYLOR / MAXIME SCHMITT / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / WAMPAS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 301
A ROCKLIT PRODUCTION
03 / 11 / 2016
|
JOE CLAY / VINCE TAYLOR / MAXIME SCHMITT / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / WAMPAS |
Un Joe clé

«En 1982, j’assistais au set d’un groupe de revival dans le sous-sol d’un club de Toronto. Un Mister Hairdo avec une pompadour exagérée - il me dit plus tard qu’elle tenait avec le Royal Crown qu’utilisait Elvis et qu’on trouve encore chez Honest Ed - commença à gueuler pour réclamer un morceau de Joe Clay. Le copain de Mister Hairdo demanda : ‘Mais c’est qui Joe Clay ?’ Je n’en avais pas la moindre idée moi non plus. Je me sentais même complètement largué.»
Voilà comment Graig Morrison attaque son hommage à Joe Clay dans Go Cat Go !
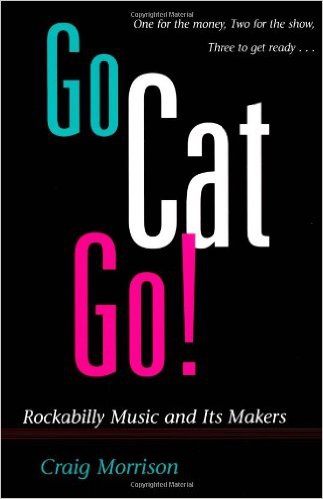
Joe Clay vient de casser sa pipe, ce qui paraît logique vu qu’il date de l’époque des débuts d’Elvis. D’ailleurs, un jour où DJ Fontana était malade, Joe le remplaça pour accompagner Elvis à la batterie. Hey Joe !
Morrison ajoute que Joe Clay frappa l’imagination des connaisseurs grâce à une poignée de purs classiques de rockabilly enregistrés en 1956, dont l’excellent «Ducktail» composé par Rudy Grayzell. Comme Lew Williams ou Gene Maltais, Joe n’enregistra hélas qu’une poignée de cuts, mais il est entré dans la légende grâce à la fulgurance de son style.
Précision capitale : Joe vient de la Nouvelle Orleans, comme Frankie Ford. Et de la même manière que Mac Rebennack, Ronnie Barron ou encore Shirley & Lee, Joe a démarré de bonne heure. À douze ans, il grimpait sur scène.
Morrison dénombre deux sessions dans la courte carrière de Joe : une première à Houston où il est accompagné par Hal Harris et Link Davis, et une autre à New York un mois plus tard, accompagné cette fois par Mickey Baker et deux batteurs.

On trouve ces deux sessions sur un album Bear paru en 1986, Ducktail. Si on aime le wild primitive rock’n’roll, on est servi. Et même plus que servi. Tout est bon là-dessus, beaucoup trop bon. Dès «Ducktail», on comprend que ça va chauffer, car Joe fait comme Carl, il te prévient, si tu touches à ma banane, ça va barder pour ton matricule - If you mess my ducktail/ I’ll get so mean to you ! - C’est du pur jus de rockab explosif, swingué à la sautillade de 56, le pire qui soit. Il est d’ailleurs resté inégalé. En B, on trouve l’effarant «Sixteen Chicks», composé par Link Davis, beau rock de rockab pulsé des reins et bousculé au challenge d’épaules, joué à la souplesse d’une sauvagerie de semelles de crêpe. Joe n’est pas aussi beau qu’Elvis ou Eddie Cochran, mais c’est un félin du son, un couguar du rock des bois, il nous sonne les cloches avec ses manières du trappeur du fleuve, oublié de Dieu et des hommes. Tiens, encore un titre issu de cette session fatidique : «Sleeping Out And Sneaking In», un mid-tempo rockab d’allure martiale chanté du gras de la glotte. C’est tout simplement admirable. On n’ose à peine imaginer le carton que Joe aurait fait si les calamiteux connards de Capitol l’avaient signé. «Doggone It» sort aussi de cette session infernale. C’est lumineux et bien sanglé. Joe chevauche son beat comme un cowboy d’opérette, avec une classe écœurante.
Les cuts enregistrés avec Mickey Baker sont du même niveau d’indomptabilité. On survit difficilement au passage de «Get On The Right Track» dans les oreilles. Car c’est d’une violence plutôt rare. Bobby Donalson et Joe Marshall, les deux batteurs, jouent ça au tatapoum de cavalcade infernale. Joe sait poser sa voix dans cet enfer, comme savait si bien le faire son collègue Frankie Ford. On l’entend même piquer une crise à la fin du cut - You know the right track baby ! - S’ensuit une fantastique reprise du «You Look That Good To Me» d’Ivory Joe Hunter. C’est du «Long Tall Sally», avec ses breaks chantés à la bonne arrache et ses redémarrages au slap. Tout est bourré d’énergie vitale, là-dedans. Il faut aussi l’entendre chanter «Dis You Mean Jelly Bean (What You Said Cabbage Head)». Oui, Joe chante d’une belle voix pointue et claire. Tous ses cuts sonnent comme des hits. On finira par trouver ça indécent qu’il soit tombé dans l’oubli. Il chante «Cracker Jack» à la Gene Vincent, mais en plus perçant. Avec sa voix, Joe peut percer des coffres. Et comme le bop coule dans ses veines, il ne se refuse rien. En B, on trouve une autre prise de «Get On The Right Track» et on comprend pourquoi Richard Weize l’a rajoutée : on y entend un faux départ - Hey Joe ! - Éclat de rire strident et ça repart au quart de tour. Joe bouffe son rockab tout cru, c’est un freluquet doté d’un appétit d’ogre, il mâche ses syllabes avec une violence hors normes - Morrison dit qu’il chante avec une hot potato dans la bouche - Ce fabuleux wild cat n’en finit plus de secouer les colonnes du temple qui finira bien par s’écrouler.

Comme ça n’a pas marché à l’époque, Joe est devenu chauffeur de bus, comme Arthur Alexander à Cleveland et Eddie Phillips à Londres. À l’époque du revival rockab des années quatre-vingt, le promoteur anglais Willie Jeffrey se mit à sa recherche et eut un mal fou à le dénicher. Trois ans de recherche ! Jeffrey finit par le localiser. Il le fit ensuite tourner en Europe et aux États-Unis. Joe s’amusa à casser la baraque à droite et à gauche. Morrison salue ce miracle de la nature - His drive, his confidence, his undiminished voice and his ability to drive a crowd wild - Joe shoutait le même rockabilly sauvage qu’en 56, avec toute son énergie, toute son assurance et toute sa classe. Alors bien sûr, les gens devenaient fous.
Signé : Cazengler, Joe claybar
Joe Clay. Disparu le 26 septembre 2016
Joe Clay. Ducktail. Bear Family 1986
Craig Morrison. Go Cat Go! University Of Illinois Press 1998
L'ÊTRE ET LE NEON
JEAN-PAUL SARTRE et VINCE TAYLOR
JEAN-MICHEL ESPERET
( L'Ecarlate / Octobre 2016 )

J'en connais qui feront la moue en voyant la plaquette. Quoi, un truc si riquiqui sur Vince Taylor ! C'est une honte ! Un scandale ! Appelez-moi le directeur ! Un conseil les rockers, pédale douce s'il vous plaît ! C'est vrai qu'avec ces cinquante-six pages l'engin ne paye pas de mine. Mais dedans, attention, c'est du solide, du concentré, du pemmican intellectuel, calmez-vous, détendez-vous, buvez un grand verre d'eau fraîche pour vous rafraîchir les idées ( non je n'ai pas dit une grosse chope de bière ), et maintenant soyez tout ouïe. Attention la montée sera dure. Malgré les allégation de Thomas Mann, la montagne ce n'est pas toujours magique.
Quelques sentiers d'approche. Qui serpentent mollement dans l'herbe sinueuse des hauts plateaux. Jean-Michel Esperet vous connaissez. L'a publié en 2013 Le dernier come-back de Vince Taylor ( voir KR'TNT ! 142 du 02 / 05 / 2013 ) un livre prophétique en le sens où très vite après ce coup d'éclat, les publications sur Vince n'ont plus cessé. Pas un zozo de la dernière espèce Jean-Michel Esperet, l'a connu l'époque d'or des early sixties du rock français de très près. Un témoin.
L'est temps d'installer le camp de base. S'agit d'un dialogue imaginaire entre deux personnes qui ont réellement existé. Jean-Paul Sartre, le philosophe et Vince Taylor le rocker. Une conversation de deux personnes qui s'entendent très bien. Toutefois le pronom réfléchi « s' » ne renvoient pas aux deux protagonistes mais à chacun des deux séparément. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'interférence. Pour les paroles, les deux interlocuteurs ne sont pas traités à égalité. Pour Sartre Jean-Michel Esperet a prélevé des citations son ouvrage le plus célèbre L'Être et le Néant, oui les pentes seront dures à gravir ! Pour Vince, il a recherché des propos dans divers documents et avoue en toute bonne fois qu'il en a inventé quelques uns. Qui ne sonnent pas toc, qui sont dans la droite ligne des expressions de notre rocker préféré. Jean-Michel Esperet sait de quoi et pour qui il parle.

Allez hop, nous partons bivouaquer au pied de l'aiguille ( pas du tout creuse ). Ne vous affolez pas, Jean-Michel Esperet manie l'humour. Etablit en tête de chapitres la différence sémantique ente l'anchois et l'en-soi, le pourceau et le pour-soi, l'âtre et l'être, le néant et le céans... Vous souriez, vous croyez être parti au pays du jeu de mot et de la contrepèterie, hélas, en philosophie, l'on ne croit pas, l'on pense. C'est qu'avec Jean-Paul Sartre, on ne se marre pas tous les jours. D'ailleurs l'a comme un petit compte à régler avec le Jean-Paul, notre Jean-Michel. L'est vrai que Jean-Paul Tartre - ainsi le surnommait Louis-Ferdinand Céline - a toujours gardé le cap du bon côté du vent qui souffle. Un grand donneur de leçon, une bonne conscience de gauche qui termina sa course en compagnon de route de la Cause du Peuple mais qui aux temps noirs de l'Occupation ne montra guère une virulente antipathie envers les nazis, un résistant de la dernière heure, le premier à condamner ceux qui n'avaient pas choisi le bon camp qu'il rallia une fois que les carottes furent cuites pour les Allemands. Un naphtalinard de l'heure pénultième, ce qui explique les colères de Céline contre cet épandeur patenté de moraline que dans sa fureur il accablait aussi du surnom de Jean-Paul Dartre...

Fini de rigoler. Nous voici au pied de la paroi. Verticale, encroûtée de glace. Suivez-moi. Accrochez-vous à la mousse. Facile, il n'y en a pas. Ai toujours eu l'intuition que ce que l'on reproche à Sartre, dès qu'il s'agit de L'Être et le Néant, est faux. L'est évident qu'il s'est fortement inspiré de Être et Temps d'Heidegger. Facile de reconnaître la terminologie heideggérienne à tous les coins de page. L'a repris le concept d'être-là au grand Martin, et a ficelé son truc à lui par dessus. Mais l'était trop intelligent pour s'amuser à un simple démarquage. N'a pas suivi le sentier tracé par le professeur de Fribourg. L'est remonté plus haut. L'a emprunté deux sentes beaucoup plus embroussaillées, celles taillées à la machette conceptuelle par Fichte et Schelling.

Deux grands penseurs mais très prises de tête. En France, on ne les lit guère. Trop compliqués pour notre génie national si cartésien. Bien intuité le Sartron, personne ne s'est donné la peine de vérifier. Maintenant décortiquons. L'être-là, c'est vous, c'est moi, tout un chacun. L'ici et maintenant de votre présence dans ce bas monde. En bref tout cela c'est le là, votre existence. Reste le le gros morceau, l'être, cette partie essentielle de votre existence. Heidegger a écrit plus de cent volumes pour explorer cette notion d'être. Pas fou le Sartrou. Trop fatiguant. Ce n'est pas avec des études de ce genre que vous attirez le regard du grand public. S'est dépêché de liquider cet être si profond. Impossible de le fusiller, donc il a fait le coup du camion qui porte un trou. Un coup de frein brutal et le trou tombe sur la route. Le camion effectue une marche arrière pour se rapprocher du trou afin de le recharger dans la benne. Recule un peu trop et plouf, il tombe dans le trou. N'a pas pris un 38 Tonnes pour se débarrasser de l'être. A simplement utilisé un vieux truc qu'il a fauché à Aristote. L'avait un problème le Stagirite, regardez autour de vous tout bouge, les camions, les chevaux, les arbres. L'arbre ne change pas de place, mais il change en lui-même et vieillit. Si tout est en mouvement se demandait Aristote, c'est qu'il y a un moteur ( vous comprenez pourquoi Heidegger s'est intéressé au temps qui passe et qui bouge ), mais si le moteur lui-même bouge, faut qu'il y air un autre moteur qui le mettra en branle mais qui bougera cet autre moteur ? C'est alors qu'Aristote a sorti son idée géniale – pas celle du siècle mais celle des deux derniers millénaires et demi. Le premier moteur ne doit pas bouger, sinon il n'est pas le premier puisqu'il y en a un autre qui le bouge. Donc le premier moteur est immobile. Logique imparable. Sartre a copié, l'a utilisé du papier calque philosophique. L'être est. Si l'être est, le véritable être qui est c'est celui qui est l'être. Et vous pouvez remonter la chaîne à l'infini. Donc pour trouver l'être qui est en tout premier – l'essence de l'être - faut faire comme le moteur immobile. L'être que l'on recherche ne doit pas être. L'essence de l'être est le néant ! D'où le titre de l'ouvrage L'être et le néant.
Le problème quand vous avez tué votre chat, c'est qu'il ne chasse plus les souris. Un chat, chat se remplace facilement à la SPA. L'être hélas n'encombre pas les fourrières animales. D'où le recours à Fichte le penseur du Moi excellence. Je ne suis plus puisque mon être n'est plus mais mon moi existe. Sartre est tout fier de son nouveau joujou. L'emporte partout avec lui. Lui donne parfois le surnom moins m'a-tout-vu de soi. Suffit pas d'avoir son petit moi chez soi. Faut en dresser les limites. Il y a le moi et tout ce qui n'est pas le moi. Le non-moi, le non-soi. Attention, passage dangereux, l'on frise l'abîme du solipsisme qui consiste à poser le non-moi comme une simple partie du moi. Bref le non-moi n'existe pas, l'univers qui m'entoure n'existe pas, il n'existe que moi ! Attitude un peu grosse tête. Extrêmement embêtante quand l'on recherche le succès auprès de ces dames. De ces messieurs aussi. Jean-Paul Sartre est bien embêté, garderait le Moi pour lui tout seul, mais la solitude lui pèse. L'est donc obligé de définir le non-moi comme l'autre. Et par extension les autres. Parce qu'un philosophe sans disciples admiratifs c'est comme un gruyère sans trou. ( Certains disent que le gruyère n'a pas de trou, normal : le fromage est tombé dans son propre trou.)
On y est. L'on a passé le plus gros. Levez le nez et admirez le paysage autour de vous. Tout ce qui précède, c'était de l'alpinisme théorique. Mais une fois au sommet l'on comprend la problématique espérienne. Passons aux cas pratiques. L'on est toujours l'autre de l'autre. Ainsi Taylor est l'autre pour Sartre et de même Jean-Paul est l'autre pour Vince. Vous pouvez faire l'expérience avec la prochaine personne que vous rencontrez.

Tout le monde n'a pas le même niveau de conscience philosophique. Certains se prennent la tête pour dégager la pertinence d'être là dans le monde mais la plupart se contentent de l'évidence de leur présence sans chercher midi à quatorze heures. Voici donc la problématique espérienne : confrontation : à sa droite Sartror poids-lourds de l'entendement métaphysique, à sa gauche Vincor poids plume à la cafetière un peu fêlée. L'un a lu Schelling, et l'autre pris un peu trop de LSD. Schelling c'est le philosophe de l'ungrund ( l'abîme ) et les addictions de Taylor sont connues. L'un laboure les champs du savoir et l'autre batifole dans les champs de jonquilles.
Dialogue impossible. Chacun étant incapable de comprendre les motivations de l'autre. Dans sa jeunesse Vince Taylor a été si peu capable d'assimiler le manuel qui expliquait l'atterrissage d'un avion qu'il s'est scratché en beauté, quant à Sartre il n'a jamais pigé que le grand livre que le public attendait de lui - et dont même l'idée n'a jamais effleuré ses neurones - aurait dû s'intituler Phénoménologie du Rock and roll. Les voici assis à une même table de café dans le livre de Jean-Michel Esperet, mais dans la vraie à dix mille lieues l'un de l'autre, même si tous deux, résidents de Paris, ont eu en les mêmes années l'honneur des manchettes des journaux.
L'on pourrait penser l'exercice un tantinet artificiel. Mais quand on y réfléchit un peu, chaque jour nous sommes confrontés à de semblables situations. Nous discutons avec des gens de toutes sortes, des proches, des intimes, des inconnus. Parfois nous avons l'impression que le courant passe. Et même davantage pour les affinités. Mais très souvent, nous restons à la surface des choses. Nous sourions, nous disons oui, parce que nous sommes polis. Mais au fond de notre moi, nous n'avons rien à faire de notre interlocuteur. Nous ne cherchons même pas à le comprendre. Chacun sa merde comme disent les beaufs.

Les amateurs de rock sont fascinés par Vince Taylor. Pour beaucoup de concitoyens les sixties françaises sont mythiques. Sont capables de réciter la disco des Chats Sauvages, et la liste des concerts de Johnny Hallyday par coeur. Des passionnés. C'est bien, nous dit Jean-Michel Espéret – lui l'est féru de Vince Taylor – mais il tire la sonnette de rappel. Les sixties, très bien, le rock and roll parfait, mais dans ces mêmes temps, il y avait aussi des tas d'autres phénomènes, Jean-Paul Sartre par exemple. Evidemment il ne figure pas dans la liste de vos dix rockers préférés, mais l'a fait partie du paysage. Pas un minuscule caillou que personne ne remarque. Une énorme montagne qui bouchait tout un coin de l'horizon. Ne se sont jamais rencontrés. Auraient pu. Auraient pu se parler. Ne se seraient peut-être pas compris. Mais là n'est pas le problème, en imaginant ce dialogue, c'est nous que le livre interpelle. Que se disent-ils ? Et que nous disent-ils ? Prendrons-nous le temps de réfléchir ? Ou agirons-nous comme pour ces connaissances que l'on croise dans la rue « Salut, ça va ? / Salut, ça va ! » et l'on passe notre chemin sans plus de salamalecs.
Une piste de lecture. Plantez deux poteaux balises. Côté gauche : l'absurde du non-sens. Côté droit : le hasard objectif des rencontres aléatoires. Lisez les phrases introductives de Sartre et les réponses de Vince Taylor. Vous vous apercevrez que Jean-Michel Esperet pousse souvent le ballon au fond des filets. Ce n'est pas du n'importe quoi, aborde les grandes thématiques : la solitude, les femmes, les autres, la liberté, la mort... Le genre de gravier que l'on trouve au fond de ses souliers ou au bout du chemin. Donc à la portée de tout le monde. La preuve, c'est que la confrontation entre le Maître du Savoir et l'Innocent aux Mains Vides ne tourne pas en défaveur de Vince. La sagesse du fou porte parfois beaucoup plus que la tour d'ivoire intellectuelle. Dans la fable Le Savant et le fou, bien fol celui qui se fierait à son instituteur pour apprendre à vivre. Sartre s'enferme dans ses châteaux de sable conceptuel et Vince habite la bicoque de son moi dévastée. Mais quel est le plus heureux ? Celui qui a peur du néant ou celui dont la cervelle clignote comme les néons de la gloire ? Vive Vince !
Damie Chad.
FACE B
MAXIME SCHMITT
( Le Castor Astral / 2OO2 )

Cercle rouge avec portrait d’Elvis Presley. Tout ce qu’il faut pour déclencher le réflexe pavlovien du rocker de base. Face B ? What is it ? Une divulgation éhontée des dessous cachés - connus de la planète entière - du King ? Ou une énième exploration de la monumentale disco du petit gars de Tupelo. Le catalogue raisonné des disques que vous ne pourrez jamais vous procurer. Trop rares. Trop chers. J’allais laisser tomber lorsque j’ai aperçu le nom de l’auteur. Maxime Schmitt. Je prends d’office. Sans même regarder à l’intérieur. Acte de confiance irraisonné ? Comme quand votre arrière-grand-père s’est précipité sur les emprunts russes, ruinant ainsi toute votre famille ? Que nenni, je connais bien Maxime Schmitt, l’a partagé durant toute une année ma chambre d’étudiant. Je me hâte de préserver la réputation de notre auteur. Pour la mienne j’aurais davantage de mal, mais ceci est une autre histoire. Donc rassurez-vous, n’était pas là en chair et en os. Simplement sur l’affiche. Immense, rouge et noire. Que j’avais récupérée lors de la venue du Poing à Toulouse. J’aurais du mal à préciser la date. Pour les lecteurs de KR’TNT ! je me permets de renvoyer à notre chronique 2O1 du 18 / 09 / 2014, sur la tellurique bande dessinée “Vince Taylor N‘existe Pas” d’un certain Maxime Schmitt…
Reste tout de même un grand mystère. De quelle face B, Maxime Schmitt veut-il exactement nous entretenir ? L’a produit tant de disques qu’au lieu de se perdre en oiseuses conjecctures vaut mieux plonger directos dans le bouquin. L’on comprend vite, surtout que dans son intro Antoine de Caunes soulève quelque peu le voile d’Isis. Un format carré, plus grand qu’un 45 tours mais plus petit qu’un vingt-cinq centimètres. Quelques lignes et une photographie par page, vite lu ? Ne concluez point trop hâtivement. Le texte avec ses mini-paragraphes de deux à cinq lignes est beaucoup plus long qu’il n’y paraît à première vue. Tant mieux, car c’est du petit lait. Avec adjonction d’un cocktail de vitamines explosives.
J’explique le titre. Très simple. Saint John Perse disait qu’en poésie il fallait être comme ces voiliers qui dans les ports n’offrent que leur poupe à la curiosité des passants. Traduit en langage Dumoutier ( voir plus loin ) cela donnerait ceci : regarde mon cul et va voir ailleurs si j’y suis. Pour les cerveaux lents insensibles aux arcanes de la poésie dumoutierrienne ( je précise que Jojo Dumoutier fut le batteur du Poing et de Gene Vincent ) je me permettrai quelques éclaircissements. Le fan de rock est soumis à la portion congrue. Un disque et une pochette. Peut l’écouter mille fois et étudier à la loupe l’avers et le revers des inscriptions, sa curiosité ne sera pas assouvie. Vous êtes confronté à un produit fini et vous n’en saurez jamais davantage, à part quelques glanes dans une interview pécho au hasard à la radio ou une indiscrétion journalistique dans un fond d’article.
Maxime Schmitt a compris le dilemme. Alors il tire le rideau et vous entretient de tout ce que vous ignorez. En langage pinkfloydien, cela s’appelle la face cachée de la lune. Oui, mais Maxime il est plutôt branché rock. Le vrai, comme l’on dit. Pour la petite histoire, l’a profité de son boulot de producteur chez Capitol pour commettre quelques rééditions de Gene Vincent ( coffrets et pictures-discs ) que la terre entière nous envie. N’est pas non plus un esprit borné. L’a mis la main à la pâte pour permettre à Kraftwerk d’accoucher de sa musique électronique. Eclectique et prêt à s’embarquer dans toutes les aventures.

Dépêchons-nous de l’imiter, en commençant par le commencement. Ne naît pas dans la rue, ni dans le dix-neuvième un arrondissement presque maudit comme le chante Schmall, se contente du quatorzième. Milieu populaire, père communiste. Ne cherchez pas l’erreur. Il n’y en a pas. Par contre il ne met jamais de date, à vous de situer. Ensuite il avance par touches impressionnistes qui confine à un scrupuleux pointillisme. Nous dépeint l’époque en citant quelques marques de produits alimentaires et économiques tout en faisant référence à quelques titres de musique scron-gneu-gneu. Ce n’est pas de sa faute le rock n’est pas encore né. En France. En attendant s’adonne à des plaisirs incompréhensibles comme le foot et le vélo. Continuera à les pratiquer. Nul n’est parfait. Nous lui pardonnerons aisément. L’a l’âge requis pour assister et très vite participer activement à l’implantation du rock and roll dans notre hexagone. Le livre devient passionnant. Je vous concède le droit moral d’abattre toute personne qui viendrait vous déranger dans votre lecture. C’est à ce moment que vous comprenez le pourquoi de cette écriture fragmentale et lapidaire. Ne point trop s’étendre. La nostalgie est un vilain défaut. Un rocker ne pleure jamais. Vaut mieux couper court. Et quelques fois planter un ou deux coups de cran d’arrêt ironiques dans le gras des légendes. Tout le monde possède ses baudruches bien-aimées, mais il ne faut pas hésiter à leur montrer qu’elles sont comme les civilisations de Paul Valéry, mortelles, et point du tout increvables, afin qu’elles ne prennent pas trop toute la place et ne vous empêchent de vivre par leur intumescence par trop dilatoire.

Ceci jusqu’à sa démission du Poing. Entre temps vous avez droit à toute l’histoire de ces magiques années soixante durant lesquelles les vagues successives du rock s’en viennent s’écraser sur les rivages mentaux de toute une jeunesse. Plus qu’une musique, une culture, une façon d’être qui vous modélise d’une manière indélébile. Un témoignage essentiel. Le statut d’adulte est un cap dangereux. L’on y croit encore, mais l’on est revenu de tout. Sacré courage pour continuer sur sa lancée. Ne pas abandonner. Persévérer. Serrer les dents ne permet point l’éloquence cicéronienne. Maxime Schmitt devient producteur. Sur le fil du rasoir. Va s’en sortir, fait feu de tout bois, cherche, découvre, écrit, compose, se fait un nom, une réputation. N’oublie pas de noter ses regrets, ses bévues. L’auto-dérision vous empêche de vous enfermer dans le mythe de l’Incompris. Surtout qu’il n’a pas à rougir, organise les séances d’enregistrement pour Le Chat Bleu de Mink Deville par exemple. Ne s’en prend pas plus au sérieux pour autant : remarquez qu’avec le compagnonnage de Jacques Dutronc ce serait difficile. Impossible avec un zèbre de cet acabit de faire un caca poum nerveux.
L’est partout, Bijou, Taxi-Girl, la renaissance rockab, l’URSS et Memphis Tennessee, j’en passe, j’en oublie des essentiels comme les Shadows, le livre s’arrête trop tôt pour qu’il nous conte l’odyssée des Plasticines, mais nous ne pouvons lui en vouloir. Maxime Schmitt aime trop le rock pour être pris en défaut sous sa cuirasse. Ne dites pas je viens de lire un super livre de souvenirs sur le rock. Ce que vous avez entre les mains est un objet littéraire. A part entière. Qui décoiffe la gomina des jours perdus.
Damie Chad.
COURGIVAUD / 31 -10 -2016
L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Brrr ! Nuit d'Halloween. Prudence de mise. Pas le soir à sortir de la maison. Foule de goules dans les coins sombres des rues devenues le royaume des fantômes. En plus, la teuf-teuf mobile est chez le mécano. L'a regardée d'un air excédé “ Monsieur Damie, je ne suis pas un sorcier, suis mécanicien pas ferrailleur, laissez-la pour la semaine, mais si j'étais vous j'en rachèterais une autre, avec vos habitudes de rocker à conduire à tombeau ouvert faut démonter le moteur, je ne sais pas si j'arriverai à tout remettre en place ! Revenez samedi en huit, je ne promets rien”. Dix-neuf heures trente, noir absolu au-dehors. Me vautre sur le canapé et m'apprête à passer une petite soirée tranquille au chaud à lire les Conférences de Stuttgart de Friedrich Wilheim Joseph Schelling lorsque mes oreilles perçoivent dans le lointain un son famillier... Qui se répète et s'accroît durant plusieurs minutes... Mon dieu ! Mon diable ! Serait-ce possible ? Et voici que maintenant ça corne devant le portail ! Elle est là, elle m'attend, toute noire comme un fourgon mortuaire, stupéfait je n'ose faire un pas, mais elle s'impatiente et se met à klaxonner, que dis-je à huhuler de désespoir comme la chouette d'Athéna, au soir de la bataille des Thermopyles. Je ne saurais résister à une telle plainte funèbre, s'ouvre la portière arrière et cédant à une force irraisonnée je m'engouffre dans la Teuf-Teuf. Je préfère ne pas vous décrire la forme gélatineuse qui tient le volant. Je ne sais point où elle m'emmène mais le trajet ne durera guère. S'arrête dans une ruelle étroite et montante, sur la gauche se profile la masse imposante d'une église, mais de la lumière filtre sur ma droite, au-haut d'un escalier se profilent quelques inquiétantes silhouettes. Je Le reconnais. Sur le perron, Monsieur le Comte, entouré d'une cour de soubrettes endeuillées, qui se pavane dans sa cape noire et son haut de forme cérémonial, me souhaite la bienvenue au bal des vampires. Me précise que l'orchestre de la veuve noire descendra des lambris du plafond pour nous charmer de ses couacs sulfureux. “ Bonne soirée, Monsieur Damie, n'oubliez pas de vous gaver de nos gâteaux à l'asticot et de vous abreuver largement à la pompe funèbre de Beer Town. Sang de houblon parfaitement coagulé, prix dérisoires mais garantis cent pour cent empoisonnés bio.”
Tout le village est là, sagement assis en face de la scène. Les murs sont tendus de toiles d'aragnes monstrueuses, des squelettes démantibulés sourient de toutes leurs dents, un chien fantôme vous reluque de ses yeux féroces, je m'étonne, pas une citrouille qui vous file la trouille, je n'oublierai pas de poser une réclamation.
PREMIERE PARTIE
LA FANFARE MAUDITE
Huit qui se tassent dans le coin droit de la scène. La véritable section de cuivres de la Mère Michel, celle qui a perdu son chat noir. Sont allés la chercher à la Nouvelle-Orléans, celle qui suit les enterrements. Qui refile un dernier réconfort aux jeunes morts juste avant la bascule dans la tombe. Un boucan d'enfer. Un trombone qui coulisse, deux trompettes qui se la pètent, trois saxophones qui mugissent au téléphone, une clarinette qui fait place nette, et une flûte qui vous étrille les les tympans. C'est lourd comme du Muscle Shoals et ça swingue comme un troupeau d'éléphants en goguette qui se rend au mariage de Babar et Céleste. Danse macabre et chalerston désopilant. Le sax baryton tonne et borborygme tel un vieux tubar en train de cracher par à-coups ses poumons. Z'ont le punch au rhum et ça cartonne tous azimuts. Filent good à la James Brown et moussent verdâtre le rising sun. Ça claque comme des becs d'alligators affamés qui n'ont rien à se mettre sous la dent depuis huit jours, et ça bruit de stridences africaines d'hippopotames qui pataugent dans les marigots. Ah ! ça fonce tout droit sérieux comme les moutardiers du pape et l'instant d'après ça rigole de traviole. Là ça groove dans la mangrove et ça youglourte dans le bayou. Blague à part vous font un tabac qui vous encrasse les bronches à jamais.
Applaudissements frénétiques. Pas de rappel. Pire que cela. Tous en ligne, un bec jaune en carton sur le nez, vous interprètent le crac-crac du poussin qui sort de l'oeuf. Montre en main, nous laissent vingt minutes pour nous régaler des larves gâterelles et glouglouter le sang des sidaïques.
DEUXIEME PARTIE
LES CHANTS DE LA MORT

Lumières noires. Sont une équipe de rugby sur la scène, empilés les uns sur les autres comme des petits pois sauteurs dans une boîte de conserve rouillée. La fanfare entonne une marche funèbre. De quoi vous donner envie de passer de vie à trépas. Roulement de tambour wagnérien, l'angoisse s'appesantit, un air de tragédie antique flotte dans les airs. Entendez-vous ces pas pesants qui proviennent de la porte d'entrée qui vient de s'ouvrir en un horrible grincement ? Sont six, un à chaque poignée. Portent un lourd cercueuil d'ébène qu'ils déposent cérémonieusement au bas de la scène. Silence de mort. L'on entendrait le battement d'une aile de corbeau perché sur un arbre à trois kilomètres. Les cuivres gémissent doucement. Horrible miracle ! Le couvercle du cercueil se soulève avec lenteur. Horreur, Mildred, la toute belle Mildred, toute blanche, toute pâle, repose entre les ais cruels. Nos coeurs pleurent. Mais voici qu'elle se redresse avec maladresse, des gestes de faon qui vient de naître et qui s'efforce, et tente poussé par l'instinct de vie de se camper sur ses grêles pattes malhabiles.
Elle monte sur scène et s'empare du micro dans lequel elle plante très forts deux grands cris de joie et redescend de l'estrade pendant que l'orchestre égrenne I put a spell on you du regretté Screamin' Jay Hawkins. L'est rejointe par cinq jeunes danseuses et toutes ensemble, pâlides sylphides évanescentes, s'adonnent à un féérique ballet baigné de sombre lumière lunaire. Sont toutes belles. Ah, c'est comme ça le soir dans les cimetières ? Vivement que je meure au plus vite ! Mildred a repris le micro et nous tonitrue des because your mind à enfoncer des clous dans un catafalque. Sont quinze sur scène. Admirez-les, la petite Eva en zombie qui gratte ses instruments percussifs, la grosse citrouille orange pour le bouillon de onze heures, ces emplumés sortis tout droit d'une cérémonie aztèque, et le plus respectable de tous, monsieur le curé engoncé dans sa soutane qui essaie de passer inaperçu empêtré dans son énorme soubassophone dont l'énorme pavillon blanc ressemble autant à une gueule de requin édentée qu'à une corolle épanouie de fleur vénéneuse. Cuivres qui reluquent, congas saccageurs, orgue d'ogre, guitare mordante, basse rampante, batterie fracassante, percus qui castagnent et au milieu de ce tohu-bohu Mildred aussi à l'aise qu'une rose sur un taillis d'épines acérées. Derrière ça vous dégomme un tohu-bohu de rhythm'n'blues touffu comme une jungle, ou alors ils vous écument des relents de carnaval de Rio, vous les passent au laminoir pour qu'ils perdent leur latino, reviennent au galop pour stomper sans stop du rock and roll, et vous balladent dans des slows infernaux qui tournent vite au délirium tremens.

Et plunk ! intermède ballet de l'opéra, avec Mildred et ses majorettes frénétiques, qui mène la revue et chante en même temps avec une facilité déconcertante. Sur scène c'est la java multicolore, font du corps à corps avec leurs instruments, et Bob look de pirate et guitare ovale à angles droits brisés ne se retient plus. Ne se contente plus de prendre des poses de guitar héros en vous assénant des riffs de malade mental, pousse la tyrolienne dans le micro et s'en vient bonimenter la foule tel le colonel Parker avant qu'il ne coache Elvis. Chaude ambiance. Mildred survole sa couvée de coucous fous. L'a un secret, plus elle chante, plus elle sort sa voix. Vous croyez qu'elle culmine au dernier étage, mais elle n'est pas encore sortie de l'entresol. Apothéose sur le final. L'orphéon par derrière, chaud comme les braises des fournaises hadésiennes du grand Lucifuge Rofocale, ne se retient plus. Une épaisseur musicale que vous ne couperez pas au sabre d'abordage, un tumulte cahotique aussi dense que l'orchestre symphonique de Berlin à fond dans la neuvième de Beethove ( celui qui avait l'oreille torve ), et notre Mildred qui vous entonne crescendo un Stand by me que Bene King n'aurait jamais osé imaginer. Pas une plainte, un cri revendicatif à vous interdire de faire le moindre pas de côté, à vous glacer la lymphe, et ensuite gagne en hauteur telle une chanteuse d'opéra. Où s'arrêtera-t-elle ? On ne saura pas, elle mène le capharnaüm à sa baguette de sorcière, sourire délicieux, danse espiègle, et vous plonge la baïonnette de sa voix toujours plus avant, au plus profond des aîtres de votre être. Mais il se fait tard, l'on approche de minuit l'heure fatidique, l'on se quittera sur un lâcher de ballons de baudruche halloweenique, avec le regret de savoir que l'on aurait encore pu atteindre des altitudes nouvelles. Mildred remercie sous les applaudissements.

Au bas des marches la teuf-teuf mobile et son allure de fourgon mortuaire m'attendent pour me ramener à la maison. La plus belle de mes plus affreuses soirées. Mais pourquoi mes canines sont-elles si douloureuses ? C'est à cause de l'araignée qui descend du plafond. La tarentule qui vous innocule le rock and rulle.
Damie Chad.
( Photos : FB : L'ARAIGNEE AU PLAFOND )
DICTIONNAIRE BORDELIQUE
DES WAMPAS
PHILIPPE WAMPAS
( Hors Collection Editions / 2007 )
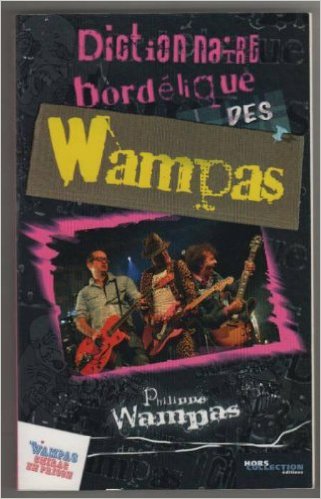
NASTY FROGGIES
Très obligeamment l’homme m’a conduit à l’étagère de son rayon musique. Pas la spécialité de sa boutique si j’en juge d’après la dizaine de bouquins qui ont l’air de s’ennuyer ferme, victimes de l’oubli poussiéreux des hommes. M’agenouille pour mieux voir, me relève très vite, horreur, enfer et damnation, que Saint Chuck Berry me protège de ces atrocités, des bios de Beethoven, du coup je m’éloigne vers le rayon poche. Ne jamais perdre un client, loi intangible du commerce. Sourire rigolard sur ses dents carnassières, regardez vous devriez pouvoir l’adapter en rock, et hilare il me tend un opuscule poétique du dix-neuvième siècle Chants Patriotiques à la mode Déroulède. La conversation s’engage, l’a un fils qui est dans un groupe punk, The Nasty Froggies. N’a pas l’air convaincu de la future réussite commerciale du fiston, mais l’est tout fier de m’annoncer qu’ils écrivent leurs propres morceaux. Trop sympathique. Je ne peux pas ressortir les mains vides, me faut au moins un achat d’approbation symbolique, un encouragement moral à ce géniteur de rocker. Je reviens du côté de Ludwig, et stoïquement je m’efforce de lire tous les dos de couverture : pari gagné, le dernier bouquin de la file se révèle être un dictionnaire de ces étranges animaux échappés d’une cage du cirque Pinder.
WAMPAS

Ne suis pas un fanatique. Ni du rock alternatif français. Ni des Wampas. Même s’ils viennent de faire la couve de Rock & Folk. C’est surtout l’indigence des paroles qui m’a toujours rebuté. L’humour au énième degré me fatigue vite. Les Wampas c’et un peu les Ramones à la française, admettent leur insuffisance musicale mais question textes ils ont l’air de revendiquer la remarquable supériorité culturelle de l’Europe aux anciens parapets sur ces gros bêtas d’amerloques à l’esprit aussi épais qu’un double Big Mac, genre regardez comme je suis intelligent d’écrire des lyrics si bêtes. Dada qui se prend pour un cheval de course.
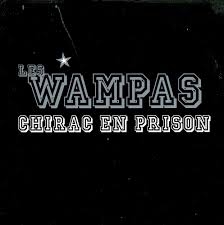
Remarquons toutefois que les Wampas ce n’est pas non plus le Jockey Club. Un joyeux foutoir. Le bouquin porte bien son titre. Rend bien compte du phénomène Wampas. Dans le désordre. Quelques entrées n’apportent pas grand-chose, mais il faut bien sacrifier à la nécessité alphabétique, ces sorties de secours qui débouchent sur un mur de briques sont dignes de cet esprit philosophique du non-sense qui irrigua toute une génération. Après la défaite de la révolte punk, le rêve grandiloquent d’un futur paradisiaque enterré à jamais, le rire de la dérision fut la seule arme de défense qui resta. Les Wampas eurent leur Bromley Contingent, la fameuse armée Wampas, un peu trop pompeusement nommée, de maigres troupes en réalité. Mais d’élite. Formée d’un ramassis de soldats d’infortume - ceux que Jean Giono nommait les enfants perdus - un mélange hétéroclite et explosifs d’anciens rockers, de punks, de bikers, de cats, de skins, un peuple violent, passionné, et excessif, un conglomérat de tribus, chacune enfermée dans la solitude de son auto-représentation mythique, mais toutes prêtes à enterrer ( pas très profond tout de même ) la hache de guerre pour suivre un concert du groupe. Philippe Wampas leur rend un hommage méritoire et appuyé, les Wampas ne crachent pas sur ceux qui les ont nommés rois. Ne jamais oublier d’où l’on vient.
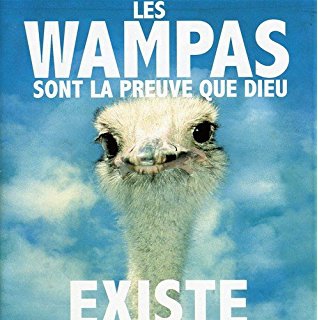
C’est un peu la marque de fabrique des Wampas. Assument tout. Ne se défaussent pas. La vie d’un groupe n’est pas un long fleuve tranquille. L’on fait un bout de chemin, mais l’on n’est pas marié pour la vie. Certains s’en vont de leur plein gré dès qu’ils sentent un peu trop le roussi, d’autres sont virés. Pas manu militari, mais sans prendre de gants non plus. Pour entrer chez les Wampas un musicos a le droit d’être mauvais, mais faut pas non plus exagérer. Faut progresser, mais attention surtout ne pas devenir un virtuose. Aussi bizarre que cela puisse paraître - mais ceux qui ont observé le fonctionnement grégaire des regroupements humains ne seront pas surpris - les Wampas possèdent un chef. Un grand manitou. Didier Wampas. N’affiche pas un complaisant démocratisme de façade. Sait ce qu’il vaut. Parolier prolifique et bête de scène. Provocateur et le ciboulot sur les épaules. Revendique ses contradictions, l’idole bosse à la RATP, idéal pour dégonfler les grosses têtes, métro n'est jamais trop. Notre anarchiste bordélo numéro un croit en dieu. Mais celui-ci reconnaît-il ce fils si turbulent ? Grave débat théologique. En attendant Didier Wampas n’en fait qu’à sa tête. Se méfie des maisons de disques - l’auto-production n’est pas la panacée non plus - déclare haut et fort à la télévision que les Wampas n’aiment pas la variété de merde française, cite des noms, estime qu’il est un être libre, mène la guerre conte The Washington Dead Cats tout en ayant soin de préciser qu’ils sortent de la même matrice, fait de Manu Chao sa tête de turc - trop de succès ne rendrait-il pas jaloux ? - admet que les excès - tout relatifs - de sa jeunesse ont laissé place à la vie de famille, ne pontifie pas, se présente comme un gars ouvert, mais on pressent l’individu qui possède un plan de carrière, sait ce qu’il veut et le veut très fort. Ce qui n’est pas un défaut en soi.
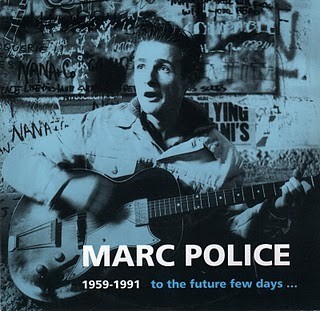
Une tragédie chez les Wampas. Le suicide de Marc Police. Ex-Jezebel Rock. Se tire deux balles dans la tête après avoir formé autour de lui un cercle des CD rock qu’il aimait. Marc était peut-être l’antithèse des Wampas. Prenait le rock and roll au sérieux. Pas à la rigolade. Au fond de lui, le côté festif devait le hérisser, la fausse naïveté des années soixante soigneusement entretenue par les Wampas devait le ravir autant que le démolir. Fun, Fun, Fun, tout ce que vous voulez, mais les blessures intérieures suppurent sans arrêt.

Remarquons que les Wampas accueillirent en leur sein deux guitaristes des Dogs, Philippe Almosino et Tony Truant. Dogs et Bijou - Vincent Palmer en prend d’ailleurs pour son grade - sont présents dans l’abécédaire tout comme Dick Rivers et Johnny Hallyday, davantage que leurs pairs générationnels. Mais Parabellum, Mano Negra, Los Carayos, OTH, Pigalle, Garçons Bouchers, les Wampas s’inscrivent dans une historiale généalogie du rock français. Avec ses grandeurs et ses misères d’éternel courtisan de la suprématie anglo-américaine.
Damie Chad.
07:49 | Lien permanent | Commentaires (0)
26/10/2016
KR'TNT ! ¤ 300 : CYRIL JORDAN / CRAMPOLOGIE / NATCHEZ / ELI D'ESTALE / SIDILARSEN / PUB ADK
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 300
A ROCKLIT PRODUCTION
27 / 10 / 2016
|
CYRIL JORDAN / CRAMPOLOGIE NATCHEZ / SIDILARSEN / ELI D'ESTALE PUB ADK |
Monsieur Jordan - Part 1
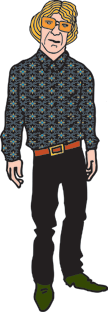
Qu’on se rassure, Monsieur Jordan ne sort pas d’une comédie de Molière. À l’encontre de son homonyme (Monsieur Jourdain), celui-ci aspire à des développements plus prosaïques.
Cyril Jordan présente pourtant un sacré point commun avec Molière : un don de conteur qui lui permet de trousser une chronique passionnante de son époque, comme le fit Molière au XVIIe siècle.
Avant de devenir le leader mythico-cartoonesque des Flamin’ Groovies, Cyril Jordan incarna le fan de rock à l’état le plus pur, de la même manière que Greg Shaw, qu’il eut le privilège de fréquenter. Cyril Jordan est aussi un homme extrêmement drôle : les Groovies étaient à l’affiche au Petit Bain, en avril dernier. On les vit arriver en file indienne à la cantine, où ils cherchaient une table pour casser la croûte. On leur fit donc un accueil digne de ce nom, avec un retentissant Hey Chris à Chris Wilson qui marchait en tête avec la gueule de travers, puis un Hey George à George Alexander qui le suivait avec la gueule de travers lui aussi. Le seul qui rigola comme un gamin fut Cyril Jordan. On était dans les conditions d’un gag et ça le fit marrer spontanément.
Depuis plusieurs années, Cyril Jordan tient une chronique passionnante dans Ugly Things, le gros fanzine de Mike Stax qui paraît deux fois l’an. La chronique s’intitule «San Francisco Beat», et Cyril raconte dans le détail, année après année, la vie d’un fan de rock dans les années soixante et soixante-dix. Il fournit un éclairage extraordinaire, non seulement sur la genèse des Groovies, mais aussi et surtout sur la scène californienne de l’époque. Mais ce qui rend ces chroniques capiteuses, c’est justement le style de notre héros, un style très direct et immanquablement drôle, comme ponctué de claquements des doigts et de Ha ! C’est tellement vivant qu’en le lisant, on croit l’entendre parler.

Le premier épisode de «San Francisco Beat» date de 2012. Cyril n’a alors que deux pages. Dans le chapô d’intro, il indique qu’il va raconter l’histoire de la scène de San Francisco et précise qu’il était là depuis le début - I was here from the beginning - Il est encore morpion quand il parvient à s’infiltrer dans le backstage des Beach Boys, en 1962. À l’époque, c’était très facile, nous dit-il. Il suffisait de surmonter sa timidité et personne ne vous barrait le passage. Il devient tout suite copain avec Dennis Wilson. Dans la loge, il remarque la présence d’un bonhomme plus âgé qui s’amuse à enlever son œil de verre pour faire peur aux filles. Cyril se demande qui est ce bonhomme atroce. Il va découvrir un peu plus tard qu’il s’agit de Murray Wilson, le père de Brian, Dennis et Carl. La même année, il voit les Ronettes sur scène. Qui dirige l’orchestre ? Phil Spector, bien sûr ! Ha ! Cyril est fasciné par les fringues de Phil : un costard en peau de serpent argenté avec un col en velours noir - Think of it ! Ha ! Nous autres en France, à la même époque, on regardait encore la Piste Aux Étoiles à la télévision.

Avec le deuxième épisode, Cyril raconte la découverte des Beatles en 1963. Il en profite pour sortir une anecdote poilante : ça se passe dans le bureau de Lou Adler qui est alors un producteur à succès. PF Sloan entre dans on bureau et voit le single d’un groupe qui s’appelle les Beatles au sommet d’une pile de 45 tours. Il demande à Lou Adler ce que vaut ce single et Lou lui répond que ça ne vaut pas un clou - Forget about it - Piqué par la curiosité, PF Sloan met le single sur le tourne-disque, l’écoute et déclare : mon p’tit Lou, tu ferais mieux d’avoir ce groupe à l’œil !
Comme des millions de kids américains, Cyril devient raide dingue des Beatles. Dead crazy, comme il dit. Il sort alors de sa réserve une autre anecdote : ça se déroule en 1963, sur la route. Bob Dylan est assis à l’arrière d’une bagnole avec Richard et Mimi Farina. Soudain, «I Want To Hold Your Hand» explose dans l’auto-radio. Dylan hurle : Stooooooop the car ! Il descend et se met à gueuler : Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Il venait de prendre en plein poire le génie des Beatles. Cyril suppose que le Dylan électrique vient de cet épisode. Il ajoute qu’un an plus tard, Dylan offrira aux Beatles leur premier joint et qu’à partir de là, les drogues vont entrer dans la danse, comme c’était déjà le cas dans le monde du jazz. Puis Cyril revient longuement sur les costumes Chesterfield que portent les Beatles, sur la pochette de l’album Introducing The Beatles. Les fringues le fascinent. Pour lui, la qualité des fringues est aussi importante que celles des chansons et des instruments. Il parle aussi des racines italiennes de la mode beat et notamment d’Anello and Davide, et de Felipe Verde, dont tout le monde connaît les boots. Il évoque aussi l’histoire des Modernistes français qui fréquentaient les jazzmen américains installés à Paris dans les années cinquante. C’est de là que viennent les Mods anglais. Avant d’avoir pu voir les Beatles sur scène, Cyril s’était déjà acheté un manteau Chesterfield et des boots Felipe Verde - Philippo Verde Cuban-heeled boots - En lisant ça, on réalise subitement que la pochette de Shake Some Action n’est pas sortie de la cuisse de Jupiter !
Cyril rend ensuite un premier hommage à Brian Jones, qui était fan de Muddy Waters et de Wolf, alors que Jagger et Keef étaient fans de Chuck Berry. Pas pareil. En plus, Brian jouait de l’harmo comme Slim Harpo et les Stones étaient SON groupe. En vrai Stone-maniac, Cyril rappelle que le premier album des Stones, England’s Newest Hitmakers, est l’un des plus grands albums de tous les temps. Phil Spector l’aurait produit, ajoute-t-il d’une voix chantante, comme si tout le monde le savait. Il profite de l’occasion pour sortir une nouvelle anecdote : nous sommes en 1980. Cyril rencontre Phil Spector qui vient tout juste d’enregistrer l’album des Ramones, au Gold Star de Los Angeles. Voilà qu’ils se retrouvent seuls, tous les deux, dans une salle, tard le soir. Phil n’a pas l’air d’aller bien. Cyril lui pose la main sur l’épaule et lui demande si ça va. Phil répond d’une voix d’outre-tombe :
— Sais-tu que j’ai produit Meet The Beatles et les trois premiers albums des Stones ?
Cyril lui répond aussi sec :
— Oui, je le savais, comme tous les gens branchés !
Là, Phil n’en revient pas ! Quoi, t’es au courant ? Selon Cyril, Phil aurait été très affecté de ne pas être crédité sur ces albums. Cyril précise à toutes fins utiles que Phil Spector est l’homme qui a le plus apporté au rock - Phil Spector did more for rock’n’roll than anyone in this business - Quand Cyril pense à Phil et à ce manque de reconnaissance, il en a la larme à l’œil.
Notre fiévreux chroniqueur profite d’un concert des Searchers à l’Ed Sullivan Show pour évoquer le nom de Jackie DeShannon qui a composé leur hit, «Needles And Pins». Il l’a déjà rencontrée. Et elle lui a fait la bise ! Wouah ! Il évoque aussi Jack Nitzsche qui travaillera plus tard avec les Groovies, lors de l’enregistrement de Supersnazz. Cyril a tout compris : il s’intéresse aux groupes anglais, aux fringues, il s’achète un ampli Vox Pathfinder avant même d’avoir une guitare électrique, et se passionne pour les grands songwriters, comme Jackie DeShannon, Phil Spector et Jack Nitzsche. Soudain, il découvre les Kinks. Cyril ne sait plus ou donner de la tête ! Il y a des disques et des groupes dans tous les coins ! Pendant tout l’été 64, il écoute jour et nuit les deux premiers albums des Beatles, les premiers albums des Stones, des Searchers, du Dave Clark Five et des Kinks. Quand les Beatles débarquent au Hilton de Los Angeles, Cyril se faufile dans le parking du sous-sol pour photographier le matériel qu’on sort du van. On voit ces photos dans le fanzine, bien sûr. Il raconte ensuite le concert des Beatles au Cow Palace, 100.000 personnes à l’intérieur et 100.000 autres à l’extérieur, qui n’ont pas de ticket. Pour Cyril, les Beatles restent le plus grand groupe de l’histoire du rock. Il n’a jamais revu un phénomène aussi hors normes que la Beatlemania en 64. Cette année-là, ses parents lui offrent une Gibson ES-235 pour son anniversaire. Chouette ! Il peut la brancher dans l’ampli Vox Pathfinder qu’il avait déjà acheté ! En novembre 1964, il devient dingue, mais vraiment dingue, en entendant «Baby Please Don’t Go» des Them à la radio. Il n’en finit plus de jouer et de rejouer «Baby Please Don’t Go» sur sa guitare neuve. Il s’est acheté le single et n’a même pas pensé à écouter l’autre face ! Les DJ de la radio font exactement la même connerie ! Jusqu’au jour où un DJ passe l’autre face dans son émission. C’est quoi l’autre face ? Mais c’est «Gloria» ! Un hit qui grimpe directement en tête des charts ! Quelle rigolade ! Ha !
Pour Cyril, 1965 est l’année de naissance du rock américain. Il attaque ce nouvel épisode avec les Beau Brummels dont Sly Stone produisait les hits. Cyril continue de gratter sa belle Gibson et chaque fois qu’il achète un disque, il apprend à en jouer les morceaux. Il rend un bel hommage à l’album So Many Roads de John Hammond, cet album légendaire sur lequel jouent Mike Bloomfield et Robbie Robertson. Il s’éprend aussi des Yardbirds qu’il trouve beaucoup trop en avance sur leur époque. Coup de chapeau aux Byrds - on my fave list forever - Cyril raconte que les seuls Byrds qu’il fréquentait étaient Mike Clarke et Clarence White. Il les voit sur scène au Civic et la technique de picking de McGuinn le fait loucher. Ah putain ! Cyril se demande comment il va pouvoir jouer ça ! Il ajoute que personne dans le monde du rock ne jouait alors comme Roger McGuinn. Cyril va donc étudier le picking de Scotty Moore sur «Mystery Train». Il se servira de cette technique pour enregistrer «Evil Hearted Ada» sur Teenage Head. Puis ce sont les Stones qui grimpent sur scène au Civic. Cyril n’a d’yeux que pour la Gretsch verte de Brian Jones. Il louche aussi sur l’Harmony Meteor de Keef. Alors, il donne un conseil à tous les amateurs : si vous voulez sonner comme les Stones, payez-vous une Harmony Meteor ! Puis arrive le nouveau single des Stones, «Satisfaction». Cyril trouve le son étrange. Il découvre qu’il provient d’une Fuzztone fabriquée par Gibson. Avant de commencer à les mettre en vente, Gibson en offrit une à John Lennon et une à Keef. Un peu plus loin dans cette chronique trop touffue, Cyril revient longuement sur les Kinks et nous explique qu’ils n’ont pas de manager. C’est Ray qui gère la boutique - No tour manager, no roadies, no nothing ! - Ray s’engueule avec le patron du Cow Palace qui ne veut pas le payer en cash. Bon d’accord, mon con joli ! Les Kinks montent sur scène, font un doigt d’honneur au public et se cassent aussitôt. Pas de cash ? Pas de concert ! Cyril prendra modèle sur Ray pour les Groovies - Single-handed ! Ha !

En 1966, Cyril prenait du LSD, comme tout le monde. «À cette époque, l’acide qu’on prenait se trouvait dans des sucres, 1.500 mics de pur LSD. Mec, t’avais intérêt à attacher ta ceinture quand tu avalais ça ! Le ciel commençait à tournoyer et les trottoirs fondaient sous tes pieds !» Cyril explique que le LSD lui permettait de se concentrer sur des points incroyablement précis. Il avait des résultats extraordinaires au lycée et il apprenait la guitare bien plus facilement qu’à jeun.
Il entre pour la première fois au Fillmore pour voir deux groupes : l’Airplane et le Paul Butterfield Blues Band. À l’entrée, un hippie barbu lui file un gros joint, alors Cyril dit qu’il entre au paradis. C’est encore Skip Spence qui bat le beurre dans l’Airplane et le groupe fait sauter la baraque. Cyril décrit les guitares : Paul Kantner gratte une Gibson douze cordes avec un micro DeAmond, Jorma Kaukonen gratte une Guild Thunderbird et Jack Casady une Fender Jazz Bass. Il ajoute que Casady a un ampli pour chacune des cordes de basse. Il jouait incroyablement fort - it was loud ! - Puis il voit ces mecs de Chicago, le Paul Butterfield Blues Band, qui foutent un peu la trouille. Mike Bloomfield joue encore dans le groupe en 1966 et Elvin Bishop hypnotise littéralement le jeune Cyril. Un peu plus tard, il voit jouer John Cipollina sur une SG équipée d’un Bigsby. John joue comme Roger McGuinn, avec un onglet de pouce en plastique blanc et deux onglets en métal aux doigts. Cyril raconte que l’air de rien, Cipollina fit sacrément évoluer la technique des joueurs de guitare.
Notre héros opte rapidement pour une Guild Thunderbird, comme Zally des Lovin’ Spoonful et Jorma de l’Airplane. Il donne même un nom à sa Guild : Berny. Et en février 1966, il entend «Shapes Of Things» des Yardbirds à la radio. «Ce disque est le commencement de ce qu’ils appellent le heavy metal. On n’en revenait pas quand on a entendu ça la première fois ! C’était à la fois cool et fantastique. Je comprenais qu’on allait se faire régulièrement exploser la tête en écoutant la radio.»
Petite anecdote : en 1977, Cyril joue à Londres. Les Groovies sont inscrits en tête d’affiche, au-dessus des Troggs. Cyril va trouver le promoteur et lui dit que la vraie tête d’affiche, c’est les Troggs, pas les Groovies. Mais ce porc de promoteur lui répond que le Troggs sont des has-been. Cyril est scandalisé ! «Ce fut une étrange manière de découvrir que les gens du monde réel n’ont aucun respect.»
Premier voyage à Londres en 1966. Il va faire ses courses à Carnaby Street. «J’avais 600 dollars. J’ai acheté un col roulé, le même que celui que porte Dave Davies sur la pochette d’un EP. Trois paires de pompes, dont une qui était la même que celle de Brian Jones sur l’une de ses photos.» Cyril raconte qu’en arrivant chez lui coiffé du chapeau hollandais de Keith Richards, sa mère lui dit : «Tu ressembles à l’un de ces Kinks !». On se marre bien chez les Jordan.
Puis il flashe sur la Gibson Les Paul, à cause d’une photo de Clapton au dos d’un album des Bluesbreakers. À l’époque, Mike Bloomfield jouait aussi sur une Les Paul. Cyril ajoute qu’il a enregistré Sneakers avec cette Les Paul.
«Alors que la fin de l’année approchait, je dansais et tournoyais dans ma chambre en écoutant ‘Over Under Sideways Down’ des Yardbirds.» Cyril eut l’immense privilège de voir les Yardbirds au Fillmore, la formation mythique avec Jimmy Page et Jeff Beck. «L’endroit était plein. Tous les guitaristes de San Francisco étaient là, avec la langue qui pendait.» Cyril est tordant : «J’étais au premier rang. Je regarde à gauche et je vois John Cipollina de Quicksilver. Je regarde à droite et je vois Jerry Garcia du Dead et David Frieberg de Quicksilver. Jorma et Paul étaient derrière moi.» Et il ajoute plus loin : «Ce fut probablement l’un des plus grands concerts de rock de tous les temps». Même chose avec Moby Grape au Fillmore. Tout le monde était là. «Le public est devenu dingue. Les gens hurlaient après chaque chanson. C’était un belle façon de finir l’année.»

Hop, on saute en 1967. Cyril rappelle dans son intro que le rock’n’roll fit la grandeur de l’Amérique. Il embraye aussitôt avec le souvenir des premiers concerts de Doors : «Franchement, mec, Bill Graham n’a jamais engagé un groupe aussi rapidement. Les Doors l’avaient complètement scié !». Il évoque les Who qui allaient devenir «le plus grand groupe de rock des années soixante-dix». Les Who grimpent sur scène. Cyril voit Pete Townshend casser des Gibson ES 335 l’une après l’autre. Ce gâchis l’épouvante. Il voudrait lui dire : «Hey mec, s’il te plaît, ne casse pas cette guitare, donne-la moi !»
C’est en 1967 qu’il rencontre Brian Jones dans l’aéroport de San Francisco, où les Stones sont en transit. «God bless you Brian Jones.» Cyril avoue qu’il pense à lui tous les jours. Puis il flashe sur les Easybeats : «‘Friday On My Mind’ est encore mon disque préféré de 1967.» Cyril raconte que les Cream passent au Fillmore cette année-là et qu’il devient leur pote en leur fournissant des tablettes d’acide. Il dit même à Ginger d’y aller mollo et curieusement, Ginger suit son conseil. Cyril flashe aussi cette année-là sur le premier album du Pink Ployd, «one of the great LSD records». Il sait de quoi il parle, ha !
En 1968, les groovies jouent au Whisky A Go Go, la boîte de Mario et d’Elmer Bernstein. Un soir, Jim Morrison se met à quatre pattes et hurle à la mort. Ça ne plait pas à Mario qui le fait virer à coups de pompes dans le cul. Cyril évoque aussi le souvenir de Dan Hicks des Charlatans qu’il admirait mais qui n’était pas très sympathique. Il rend aussi hommage à Al Wilson de Canned Heat : «Al Wilson était un génie. Il savait tout du blues.» Et il ajoute : «Al était un mec défoncé, bien barré, mais à la différence de Jim Morrison, il gardait le contrôle - Morrison l’avait perdu à cause de l’alcool et des drogues.»
L’un des passages les plus spectaculaires de ces chroniques est celui qu’il consacre à la mafia locale, qu’il appelle the Mob, comme Tommy James dans ses mémoires. Cyril raconte qu’un soir les Groovies jouent dans un club et le propriétaire refuse de les payer. Cyril a le numéro de Paul Catalina. Il l’appelle pour lui expliquer le problème. Paul envoie un big daddy qui arrive en Cadillac Fleetwood - You da Groovies ? - Yeah ! - Le big daddy dit à Cyril et aux Groovies de l’attendre dehors. Il entre dans le club. On entend des cris, des chaises voler, des vitres tomber et le big daddy ressort dix minutes plus tard avec l’argent des Groovies - Don’t fuck with da Groovies ! - 1968, c’est aussi l’année de «Jumping Jack Flash». Cyril saute en l’air : «Cette chanson te rend dingue !». Cette même année, les Groovies tournent avec les Stooges, Love Sculpture et Golden Hearing. En arrivant à Detroit, ils découvrent le groupe le plus extraordinaire du monde, selon Cyril, the fucking MC fucking Five - And man were they loud ! - Mais il précise toutefois que le groupe qui jouait le plus fort, à Detroit, c’était les Frost.
Tout ceci est écrit dans un style imagé qui est celui des bandes dessinées humoristiques. Cyril Jordan, c’est Bibi Fricotin au pays des guitares électriques.

Au début de l’année 1969, Cyril fait un petit rappel sur ses chères drogues psychédéliques : «Si on veut comprendre l’approche artistique de cette génération, il faut accepter le rôle prédominent qu’ont joué les drogues. Mais pas n’importe quelle drogues. Une certaine catégorie de drogues, celles qui permettent d’élargir le champ de conscience.» Ce fameux mind expanding fut, souvenez-vous, le leitmotiv de Timothy Leary. Il était persuadé que les drogues psychédéliques allaient changer le monde et rendre l’homme meilleur. Il n’avait pas tort. Si tous les habitants de la terre avaient pris de l’acide, nous n’aurions plus de guerre. Après l’échec de la piraterie au XVIIIe siècle (l’utopie du partage) et du Phalanstère de Charles Fourier (l’harmonie universelle), la théorie du mind expanding fut la dernière grande utopie de l’histoire de l’humanité. À présent, qu’avons-nous en guise d’utopie ? Les réseaux sociaux ? Ha !
Cyril revient aux Who pour saluer la parution de Tommy et du «best electric guitar sound of all time». Comme tous les gens surexcités, Cyril ne craint pas les excès langagiers. Pour lui, il n’y a pas de doute, Tommy est un fucking landmark, une putain de pierre blanche, Pete Townshend a mis du big beef dans ses overdubs, qui sont stunning to the extreme. Sans même s’en douter, Cyril Jordan est l’un des meilleurs rock-critiques d’Amérique. Pourquoi ? Parce qu’il s’agite comme un fan passionné par ses disques, et non comme une pauvre cloche de coupeur de cheveux en quatre qui joue les intellos sans en avoir les moyens. Il rappelle aussi au passage que les Groovies étaient un groupe de San Francisco, the only real Frisco band, et qu’ils ne collaient pas du tout avec la fameuse scène psychédélique de San Francisco - As real as pain mystery. Ha ! - On se marre encore plus quand il évoque la façon dont il composa avec Roy Loney les cuts de l’album Flamingo. Ils roulaient en bagnole et rigolaient tous les deux comme des bossus, car la ville était quadrillée par les flics et pouf, ils pondent «Comin’ After Me» - The way we wrote was something to see. It was a gas gas gas ! - Il explique que 80% des cuts de Flamingo furent écrits sur le trajet Los Angeles/San Francisco, Roy au volant et lui à la guitare. Cyril raconte aussi que «Wiskey Woman» (qu’on trouve sur l’album suivant, Teenage Head) concerne Nancy Throckmorton, une baby doll qui était la nièce de John Phillips. Cyril en était amoureux, mais John Mayall aussi. C’est le vieux Mayall qui finit par emporter la compétition puisqu’il l’épousa la baby doll. Cyril profite aussi de l’épisode Mayall pour expliquer qu’il allait voir Mick Taylor répéter (celui-ci faisait alors partie des Bluesbreakers). Et pouf, il profite de la transition pour revenir à ses chers Stones, et justement, c’est Mick Taylor qui remplace Brian Jones. «But Prince Jones était un homme de many talents : les Stones perdirent d’un seul coup le blues, le folk, et le côté classique.» Cyril rappelle qu’avec les derniers hits sur lesquels joue Brian Jones, «We Love You», «Jumping Jack Flash» et «Street Fighting Man», les Stones avançaient dans une nouvelle direction - I mean fuck it was amazing. These three are my Number 1 all-time favorites. No question about it ! Oui, ces trois hits restent ses favoris - Et il rend un peu plus loin hommage aux Englanders qui voulaient toujours être défoncés en permanence - Ah they wanted to get stoned, stay stoned et get stoned some more - «Keith Moon, mon pote Viv Prince, et mon vieux pote Ginger Baker - Pour en nommer trois». Ces Englanders étaient tous des diables, y compris Brian.
C’est aussi l’année de Woodstock. Cyril a détesté cet événement : «Est-ce qu’il y avait les grands groupes de rock américains à l’affiche de Woodstock ? Non ! Je veux parler du MC5, des Stooges et des Groovies.» Puis il rencontre Kim Fowley au Big Sur Folk Festival, et comme il fait bien marrer Kim, ils deviennent potes aussi sec. Ils vont passer des nuits entières à se marrer et à faire marrer les gens, avec Kim qui n’en finit plus de demander : Where could we get some teenage head ? Cyril raconte qu’une fois il a rigolé pendant huit heures d’affilée. Le lendemain, sa mâchoire était bloquée. «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi intelligent et d’aussi drôle que Kim.»
Et pouf. Un jour ils sont tous les deux dans la ‘57 Chevy de Roy et qu’entendent-ils à la radio ? «I Hear You Knocking» de Dave Edmunds - Ce disque a fait tomber John Lennon de sa chaise. Même chose pour Roy et moi - We were blown away - C’est là qu’il découvre l’existence de Rockfield - Je savais que c’était le nouveau studio Sun. Il y avait un son, une identité. Comme Gold Star avec Phil Spector. Comme Sun avec Sam Phillips. C’était à l’automne 1970. Il allait encore me falloir deux ans pour réussir à emmener le groupe à Monmouth, dans le Sud du Pays de Galles - Cyril ajoute qu’il avait tourné avec Dave Edmunds dans le midwest l’année précédente (Love Sculpture), mais il ne se doutait de rien. Ha !
Les intros d’épisodes de Cyril sont chaque fois des modèles du genre : «Dans le dernier numéro, on arrivait en 1970. C’est la fin des sixties, they are over, kaput and fini.» Il commence par rendre hommage à Paul Revere & the Raiders, they were tight beyond belief, oui, ils jouaient comme des dieux. Il rappelle aussi que les Beach Boys étaient la fondation sur laquelle le rock américain des sixties fut construit, et que les Beau Brummels ont inventé le folk-rock - as far as I’m concerned - Il évoque à un moment ses souvenirs d’enfance avec Roy qu’il a connu à l’âge de 8 ans. Sa mère lui achetait chaque mois les disques du Top Ten, et donc Roy avait une énorme collection de disques. Cyril allait manger chaque dimanche chez Roy et ils passaient ensuite la nuit à écouter des disques, notamment du rockabilly, dont Roy était particulièrement friand. Cyril : «J’ai commencé à apprendre à jouer les trucs de James Burton qu’on entend dans les disques de Ricky Nelson.»
Cette année-là est bien sûr celle de l’enregistrement de l’un des plus beaux classiques du rock, l’album Teenage Head, dont on retrouve la fameuse photo de pochette en couverture du numéro 40 d’Ugly Things. Toute la genèse de l’album est dans ce numéro infiniment précieux. Cyril rappelle que ce fut aussi pour lui l’occasion de rencontrer Jim Dickinson qui jouait alors dans les Jesters avec le fils de Sam Phillips. «Cadillac Man» fut le dernier single Sun, le numéro 400. Jim joua sur «High Flyin’ Baby», «City Lights» et «Have You Seen My Baby». Cyril dit que les autres titres enregistrés avec Dickinson se trouvent sur l’album Still Shakin’. Mais sur Teenage Head, il n’y a pas que la musique. Il y a aussi la guitare et les boots. Cyril tombe un jour sur une photo de Keith Richards. Il tient une guitare en verre et porte des boots en peau de serpent. Ha ! Il demande à Jimmy Page : où c’est qu’on trouve ces boots ? Jimmy lui répond qu’elles viennent de chez Granny Takes A Trip, un boutique hip de Londres. Justement, ils viennent d’ouvrir une succursale à New York ! Lorsque les Groovies repassent par New York, Cyril file directement chez Granny. Il claque 500 dollars dans une paire de boots en peau de serpent. Et dans la vitrine, il voit «the koolest boots ever» : «Elles étaient noires avec des talons de 20 centimètres, des étoiles en or et des quartiers de lune ! Wow ! J’ai flashé et j’en ai commandé une paire sur mesure pour 700 dollars ! Je les voulais en cuir bleu avec des étoiles et des quartiers de lune argentés. Comme j’avais été magicien quand j’étais gosse, ces boots étaient faites pour moi !» Et il ajoute un peu plus loin qu’il revoit ces boots dans ses rêves. Puis il se met à chercher la fameuse guitare en verre. Il file chez Don Weir’s Music City, à San Francisco. Coup de chance, Don en a une ! Wow ! Elle vaut 400 dollars, avec l’étui en dur. Don lui dit qu’il a besoin d’herbe, alors Cyril troque la guitare contre un kilo d’herbe. Il explique ensuite que cette guitare est fabriquée par Dan Armstrong d’Harmony guitar et qu’elle est équipée de micros Dan-Electro - Now I was ready to enter the rock star arena. Ha !
Cyril consacre de gros paragraphes à l’horreur de l’industrie du disque - No one in it seemed to have morals or honor - Aucune trace de moralité dans ce monde, tout le monde le sait. Il se demande d’ailleurs ce qu’il fout dans ce circuit. Tout ce qu’il voulait, c’était jouer du rock et en vivre. Rien de plus. Mais ça tournait au cauchemar. «Je venais de découvrir en plus un terrible secret : un groupe était pareil à un animal sauvage, complètement incontrôlable. Encore aujourd’hui, je me demande pourquoi je n’ai pas arrêté tout ça à l’époque. Je pense que je devais trop aimer la musique.» C’est aussi l’époque où la soupe envahit les radios et toute l’Amérique sombre dans un immense marécage de médiocrité. «Le problème, c’est qu’il y a un million de beaufs pour un mec branché.» Cyril s’aperçoit aussi que les albums des Groovies ne sont pas distribués. C’est là qu’il décide de s’exiler en Angleterre.

Au lu de tout cela, on prend un peu mieux la mesure du charisme de Cyril Jordan, lorsqu’on a la chance de le revoir sur scène. Franchement, est-ce qu’un homme aussi élégant peut sortir de la cuisse de Jupiter ?
Signé : Cazengler, jordan le baba
Flamin’ Groovies. Petit Bain. Paris XIIIe. 29 avril 2016
Ugly Things #33. Spring/Summer 2012
Ugly Things #34. Fall/Winter 2012
Ugly Things #35. 30th Anniversary Issue. Spring/Summer 2013
Ugly Things #36. Fall/Winter 2013
Ugly Things #37. Spring/Summer 2014
Ugly Things #38. Fall/Winter 2014
Ugly Things #39. Spring/Summer 2015
Ugly Things #40. Fall/Winter 2015
LE PETIT ABECEDAIRE DE LA
CRAMPOLOGIE
P. BRINEE / P CAZENGLER
( CAMION BLANC / Septembre 2016 )
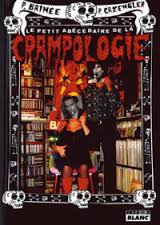
A comme Abécédaire
Un abécédaire ! Les vingt-six lettres rangées dans l'ordre ( alphabétique ! ) plus une centaine de pages d'annexes. Ne commencez pas à râler, vous ne vous en tirerez pas en affirmant que vous avez depuis longtemps passé l'âge des alphabets ludiques. Ayez souvenance du tout premier que Papa et Maman avaient acheté pour que leur petit bourricot chéri commençât à déchiffrer ses premières majuscules. Une cause perdue. Vous a fallu dix ans pour ânonner péniblement trois mots à la suite. Alors les bouquins de cinq cents pages, vous vous en méfiez autant que la sainte Bible. Oui mais là, c'est un peu différent. Total délire. Le genre de visions que le jeune Arthur a relatées dans son fameux sonnet sur les voyelles colorées, a very good trip. Mais pourquoi votre paupière s'allume-t-elle brusquement ?
B comme Blanc Camion
Le paradis des rockers. Doivent tourner autour du cinq centième bouquins. Les sortent par rafales plus ou moins mensuelles. Un unique sujet de prédilection : le rock and roll. Sous toutes ses formes. Le lecteur qui veut en savoir plus ira chercher sur leur site wwwcamion blanc. Serait étonnant que vous ne trouviez point chaussure à votre pied. Chez KR'TNT ! Nous en avons chroniqué quelques uns, surtout ceux dévolus aux pionniers. Je vous laisse découvrir.
C comme Crampologie
Crampologie. C'est la dernière des sciences exactes. Une recherche de pointe. Même à Berkeley ils ont du mal à s'y mettre. La Crampologie ne s'apprend pas. Elle s'existentialise. Il se murmure qu'elle n'est pratiquée que par des savants fous. Ce n'est pas de leur faute. Z'étaient des mecs très bien jusqu'à ce qu'ils se fassent happer par la monstruosité crampsique. Terrible maladie qui s'attrape par les oreilles. Inutile de fomenter un téléthon pour recueillir des subsides dans la louable intention de leur leur venir en aide. C'est inguérissable. Une sorte de ver qui remonte le conduit auditif et qui vous mange le cerveau.
D comme Douce Folie
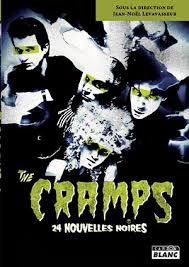
L'on a isolé la bestiole : le bacille de rock. Se communique par outils phoniques ( disques, CD, DVD, MP3... ) Rassurez-vous, pas tous. Uniquement ceux qui portent la mention CRAMPS en grosses lettres horrifiques. A première oreille le cramps est inoffensif. A été catalogué par les savants comme faisant partie de l'ordre des Groupusculi rockenrolli. Méfiez-vous, le Crampsus Groupusculus rockenrollus est particulièrement nocif.
E comme Etat fébrile
La morsure du Crampsus est terrible. Vous plonge dans un état d'excitation infini. Heureusement l'infection existe aussi sous sa forme bénigne, mais dans ce livre ont été réunis les cas désespérés. Nous allons en passer quelques uns en revue. Pas tous, ils sont trop nombreux, et puis nous nous intéresserons aux étranges effets de cette MCT ( Maladie Crampsiquement Transmissible ).
F comme Fan Cazengler
Nous l'avouons avec douleur. Notre Blogue possède son alité crampsien. Notons que peu à peu se substitue à cette expression médicale celle plus populaire d'agité crampsique. S'agit de notre Patrick Cazengler chéri. Eh ! Oui, chers lecteurs, nous avons toujours essayé de le cacher. Mais notre Cat zingler préféré, notre Cat Cinglé favori, bref le sieur Patrick Cazengler qui vous régale chaque semaine de sa science rock infinie est atteint du syndrome crampsien. A un degré ultime. L'est vrai qu'il n'a pas de chance, réside en une région de France où le microbe semble se complaire. Le climat pluvieux peut-être.
G comme Grand Cazengler
Pourrait se contenter d'être un malade lambda. Qui se soigne. Qui ne la ramène pas trop puisque la mort est au bout du chemin. Non il l'ouvre tout grand. Le crie sur le toit. C'est dans son cerveau qu'a germé cette idée vengeresse. Un peu comme ces malades du sida qui font l'amour en décapotable pour inoculer le virus à la terre entière. L'a convoqué tous les grands atteints, les introduit, en brosse un portrait flatteur, leur donne la parole, les interviewe, attire le projecteur sur eux, les présente sans vergogne comme des exemples mirifiques à notre pauvre jeunesse désemparée. Bref, l'est le maître d'oeuvre du projet. Celui par qui l'épidémie se propagera.
H comme House of Fun
Faut aussi être honnête. La crampsilite n'est pas une maladie désagréable. Elle possède ses côtés positifs. Vous ne crachez point vos poumons, des bubons ne poussent pas sous vous aisselles, vous ne courez pas aux gogues toutes les deux minutes faire du caca liquide, ce n'est ni la phtisie, ni la peste, ni le choléra. Le crampsilite est un être affable. L'est heureux de vivre. L'a un pêchon incroyable, il crie, il danse, l'est incapable de rester immobile, déborde de projets, hurle dans les escaliers, honore sa compagne douze fois par jour. Un extraordinaire boute en train. Dans votre vie de tous les jours, vous pouvez côtoyer des crampsilites gravement atteints sans le savoir. Comment croyez-vous que le Cat Zengler a rejoint l'auguste rédaction de KR'TNT ?
I comme ISABELLE

M'intéresserai maintenant à une autre crampologue. Pourquoi elle précisément ? Une raison bien simple, Isabelle fut le grand amour de ma vie. Je ne la connaissais pas. Jamais vue. Jamais entendu parler d'elle. Jusqu'à ce matin maudit, au café, je prenais un petit dèje, tranquillou avec un copain, nous parlions de tout et de rien, quand mâchouillant dans son croissant le pote s'est exclamé la bouche pleine : « Chas vu, dans Rock & Chlok ch'ils ont chembauché une chouvelle chournalite, une chaductriche qui chappelle Isabelle Chelley ». Ce fut la révélation. Elle existait. Elle était pour moi. Je n'attendais qu'Elle. Je suis parti en courant, en hurlant comme la chorale des Poppies Isabelle, Isabelle, je t'aime !
J comme Joutes d'amour
M'a fallu deux jours pour repérer son appartement. Savais où elle habitait : ne me restait plus qu'à passer à l'action. Le copain tenta de me dissuader. « Tu es taré, t'arrives chez elle, tu sonnes, elle ouvre la porte et elle se jette dans tes bras. Elle est sans doute maquée, un mari, des enfants, et tu crois qu'elle va changer de vie rien qu'en voyant ta bobine ? Tu te fais des illusions, désolé de te le rappeler mais tu n'as pas le physique de James Dean. » Ne t'inquiète pas, Elle est à moi. C'est le destin. Personne n'y peut rien. Ni moi. Ni Elle. C'est inéluctable.
K comme K.O. technique
Suis arrivé devant la porte. L'était blindée. J'ai souri. J'avais tout prévu. De ma musette style guérillero année soixante-dix j'ai retiré quatre pains de plastic que j'ai consciencieusement dispatchés aux quatre coins de la porte. J'ai planté les quatre détonateurs préalablement reliés à un fil électrique. Me manquait plus que la prise de courant. Evident ! Un plan machiavélique ! N'y avait qu'à dépiauter la sonnette, faire le branchement et enfoncer le bouton. J'ai voulu vérifier au dernier moment que je ne m'étais pas trompé d'étage. J'ai lu le nom : Isabelle Chelley ! Enfer et damnation, funeste malédiction, terrible déception ! Survivrai-je ? J'ai remisé ma camelote dans la sacoche et me suis enfui en courant !
L comme Life like poetry
Le copain s'est assis. « Tiens tu es seul ! - j'ai pressenti un soupçon d'ironie dans sa voix - alors Casanova, Isabelle n'a pas voulu de toi, elle t'a ri au nez et envoyé une paire de mandales qui t'a remis les idées en place en te traitant de cinglé. » Arrête tes sarcasmes vil helminthe ! Tu ne comprendras jamais rien à la poésie. Ma vie est brisée ! Quand tu m'as parlé d'Isabelle Chelley. Ça a tilté dans ma tête. Mon rêve secret de poète maudit a toujours été de m'unir à une descendante de mon idole absolue, le grand poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley. Isabelle, c'est Chelley; mais avec un C ! Tu aurais pu préciser. « Excuse-moi, je ne savais pas. Tiens, je t'offre un petit crème. »
M comme Maudit Poison

Esculape l'a prescrit dans son enseignement. Les mauvais toubibs soignent les symptômes et omettent de s'attaquer à la cause. Primera Causa dixit magnus et doctissimus Aristoteles. Le virus crampsien est double. Marche par deux. Mâle et femelle. La femelle est aussi malfaisante – certains disent même plus redoutable - que le VIH, possède une dénomination pratiquement similaire, IVY, mais pour en marquer la virulence on le fait précéder du terme Poison. Poison Ivy, un véritable panneau à tête de mort.
N comme Négative influence
L'est comme l'araignée. Le mâle s'approche d'elle. Tant pis trop. Trop tard. Il est ferré à vie. Pas question de le laisser échapper. Vous le ligote, vous l'empègue dans sa toile. L'a pas intérêt à s'éloigner de plus de deux mètres cinquante. Vingt quatre heures sur vingt quatre. Eight days the weeks. Monomaniaquerie. Certes elle a des arguments trébuchants. Une rousseur incendiaire, une jupe à ras la praline. Vous lui suce l'énergie jusqu'à ce qu'il en crève. Dans le virus qui nous occupe, huit ans qu'il est mort au champ d'honneur et d'horreur de l'attirance maléfique.
O comme ON / OFF
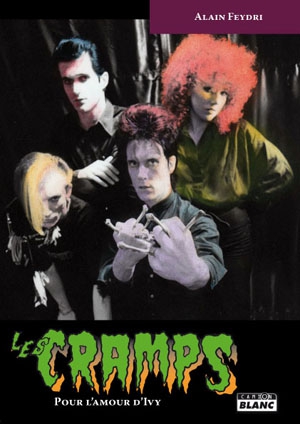
Le mâle est comme la femelle du lampyre ( communément appelé ver luisant ). C'est lui qui clignote pour attirer sa promise. Les chercheurs américains disent qu'il est la lumière intérieure du couple. Le désignent par son nom latin, tout de suite ça fait plus classe. Lux Interior. Entre nous soit dit, un sacré numéro.
P comme Parade nuptiale
L'est comme ces mecs incapables de tenir une conversation. Une fois qu'ils ont annoncé qu'il fait beau, et après un grand effort intellectuel, que demain peut-être il pleuvra, se referment comme une huître. Se radine une minette et les voilà qui vous récitent l'Odyssée, qui vous font le poirier, le cochon pendu et la grande roue. Ne savent pas comment se faire remarquer. Les blaireaux !
Q comme Qualité supérieure
Le Lux Interior use de stratagèmes bien plus subtils. C'est un être cultivé. Pas comme on l'entend généralement. Se pâme devant tout ce qu'il est de bon ton de ne pas aimer. La sous-culture prolétarienne des frustes ados boutonneux. Les films d'horreurs peuplés de zombies et d'extra-terrestres, les fanzines d'épouvante à l'encre pisseuse, les poitrines pulpeuses des comics, les émissions débilitantes de la télé et de la radio, le porno hardzen. Mais ce n'est pas tout.
R comme Rockabilly
L'est un fan invertébré de la musique des péquenots des Appalaches. Dès la formation du couple a lieu cette étrange migration à la recherche du soleil ( se dit Sun en anglais ). L'on a longtemps pensé que le binôme était attiré par la la chaleur afin de hâter les phénomènes de reproduction. Mais non, gagne simplement cette partie du Tennessee particulièrement bruyante autour de la ville de Memphis. Etrangement le couple viral restera stérile. Passera sa vie à émettre des sons que le commun des mortels jugent insupportables.
S comme Scènes obscènes

Pourraient être discrets, mais non. Dès qu'un projecteur s'allume dans un quelconque coin du globe, ils y foncent. Accompagnés par quelques comparses aussi frappadingues qu'eux. Aucune retenue. Si le Poison Ivy se contente d'asséner de basses modulations de fréquences meurtrières le Lux Intérior se déchaîne. Hurle et s'égosille. Se roule par terre, se déshabille, se trémousse sur le plancher nu comme un ver, saute sur les spectateurs, vocifère de toutes ses forces, et entre en transe.
T comme Trop excessif
Un comportement excessif. Les savants se demandent si le microbe crampsus n'est pas le gène de la folie. Jugez du scandale, le dérangement psychique ne proviendrait pas de lésions intérieures comme l'argue le célèbre doctor Freud, mais d'un germe extérieur qui s'introduirait dans votre cerveau et peu à peu vous inoculerait un fatal glissement de vos facultés de raisonnement et induirait l'adoption de comportements borderline...
U comme Unités psychiatriques
De sérieux indices semblent confirmer cette vision de la maladie. Une équipe du laboratoire de San Francisco n'a-t-elle pas pas détecté dès 1984 la présence du microbus Crampsus dans le Napa State Mental Hospital ? Mais il y a pire.
V comme Vérités inquiétantes
La lecture de cette ouvrage de Crampologie confirme la théorie de l'interdépendance des consciences telle que la définit dans ses études phénoménologiques le grand Edmond Husserl. La folie crampsique – conformément à ce que nous subodorions au début de notre étude est lourdement communicative.
W comme What is the question ?
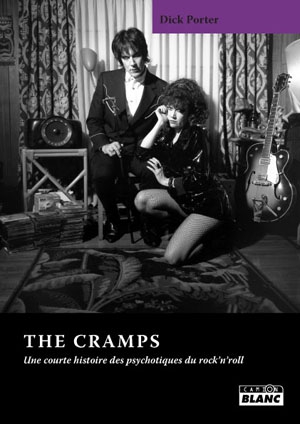
La vérité se regarde en face. Certes paraissent sympathiques nos intervenants. Mais quand on voit Ben qui passe sa vie à récolter les enregistrements de tous les concerts crampsiques, Slim Gil Deluxe à portraiturer sans relâche le Poison Ivy et le Lux Interior, Alain Feydri à écrire un livre indéfinitif sur le sujet, Linsay Hutton à dépenser une énergie folle à fomenter le fan-club, Michael Joswig à peaufiner un site, Kogar à éditer des disques d'enregistrements rares, Mike McEchron à répértorier tous les concerts, Howie Pyro à monter une immense exposition sur les objets crampsiques, Dirk Roeyen à écrire un bouquin tiré à 101 exemplaires, Sean à éditer le fanzine Trash Is Neat, et toute une flopée d'autres chamboulés par le microbe crampsique, l'on peut se demander où et quand cela s'arrêtera-t-il ?
X comme Xénobiotique
Nous l'avons démontré : le crampsus est de nature zénobiotique. Etranger à tout corps humain normalement constitué et toxique pour la propagation de l'espèce. Doit donc être classé dans la catégorie des nuisibles qu'il est loisible d'éradiquer sans avoir à demander permission. La chasse au Groupusculus Rockenrollus Crampsus devrait donc être fortement recommandée et encouragée par l'Etat.
Y comme Y a pas...
Ne nous faisons aucune illusion. Comme d'habitude l'Etat et les conglomérats pharmaceutiques ne feront rien. N'entameront aucun plan prophylaxique de combat pour juguler cette maladie orpheline qui ne touche à l'heure actuelle qu'un minuscule pourcentage de la population active. Y a pas urgence.
Z comme Zut !
Lecteurs ne soyez point découragés. Imitez-moi, écoutez mon conseil, et suivez-le. Il ne faut jamais désespérer. Lorsque la situation vous semble irrémédiablement bloquée, vous reste une issue de secours. Tout de suite vous vous sentirez mieux, c'est tout simple, mettez-vous un disque des Cramps, et rock on ! laissez la folie vous envahir ! N'existe pas de meilleur remède.
ANNEXE 1
Faut toujours avoir deux sorties à son terrier. Une deuxième solution est hautement recommandée pour pallier les coups de blues ( bien plus dangereux que les coups de grisou ). Suffit de se procurer L'Abécédaire de la Crampologie si magistralement mis en oeuvre par Cazengler le loser. Un genre de nouvelle littérature loufoque et roborative. Admiration et éclats de rires à tous les coins de page, le centre du feuillet étant occupé par une érudition sans faille. Plus les illustrations cultissimes. Dévorez-moi tout cela en quelques heures et désormais vous n'aurez plus qu'une idée en tête : jouer au Polidori. Un jeu de société. Qui peut aussi se pratiquer en solitaire. Rien à voir avec le Monopoly. Polidori est un des éternels seconds du romantisme européen. Etait le secrétaire de Byron. Participa à cette pluvieuse soirée durant laquelle le Lord proposa à ses invités – un certain Percy Bysshe Shelley et sa radieuse épouse - un concours d'écriture. Saine émulation ! La règle du jeu est d'une simplicité extrême : composez-vous aussi votre petit abécédaire crampsique, c'est jouissif.
ANNEXE 2
M'aperçois que je n'ai pas donné le résultat de la byronienne compétition. Sans contestation possible, issu de la plume de Mary Schelley, ce personnage qui depuis deux siècles hante les nuits fiévreuses de l'imaginaire occidental, Frankenstein ! Pierre de touche de l'univers crampsien par excellence !
Damie Chad.
TROYES / 22 – 10 – 2016
BAR LE 3 B
NATCHEZ

La teuf-teuf galope comme un poney sur le sentier de la guerre. L'a peur d'arriver en retard. L'a rendez-vous pour un pow-how géant avec la tribu des Natchez. Du moins ce qu'il en reste. Fut razziée de la carte du Mississippi par les troupes françaises. Ils exagéraient, ne voulaient pas déguerpir de leur village pour laisser l'emplacement aux colons. Bref furent promptement éliminés en tant que pré-définition custérienne selon laquelle un bon indien est un indien mort. Leur nom aurait sans doute disparu de l'imaginaire français si Chateaubriand ne l'avait préservé dans Les Natchez une espèce d'épopée sauvage – au sens rousseauiste de cet adjectif – rédigée en une prose somptueuse et emphatique dont aujourd'hui ne surnagent – hélas ! - que deux épisodes, Atala et René, textes phares à la source du romantisme français. Pour ceux qui n'ont aucune envie de se lancer dans le demi-millier de pages de ce roman de jeunesse, et qui désireraient rendre symboliquement hommage au peuple rouge de l'Amérique génocidé, l'est une solution davantage rock and roll, c'est d'assister à un concert de Natchez.

Le 3 B est rempli de rockers. La gent habituelle, mais aussi un lot important de fans du groupe qui ont fait le déplacement – le band a planté son camp de base dans les profondes forêts de l'Argone - tous amateurs de rock qui ne tardèrent pas à sympathiser sans réticence.
CONCERT

Les Natchez ne sont pas un groupe de rockabilly. Font partie de cette génération pour qui le rock commence avec les Rolling Stones. Y aurait pu avoir quelques frictions puristes. Mais les Natchez ont l'art et la manière de faire taire les contradictions. Ne sont pas nés de la dernière pluie, écument les bars et les scènes depuis trente ans. Savent s'y prendre. Z'ont un atout maître dans leurs manches ( de guitare ). Jouent du rock and roll. Puissant et électrique. Le genre d'arguments qui met tout le monde d'accord.

En première ligne. Deux escogriffes. Deux grands gaillards qui arborent des crinières ébouriffées de broncos. Un petit air de famille. Normal, sont frères de sang. Sur notre gauche Barbac'h, le bateleur, le Natchez tchatcheur, vous emballe en trois secondes, sourire narquois et humour qui fait mouche à chaque fois. Pas de grandes déclarations, deux ou trois réparties lapidaires, un zeste d'auto-dérision et c'est dans la poche. L'est à la rythmique, mais chaque fois que cela s'avèrera nécessaire il vous envoie de ces riffs tonitruants à vous clouer au poteau de torture. Se charge des vocaux. Commence par deux titres en français, et ma fois ça tient sacrément la route, un phrasé bien articulé qui colle parfaitement à la musique. De l'autre côté Manu, l'a l'allure du gars flegmatique qui prend son boulot à la cool, relax max, de temps en temps je caresse les cordes pour vous faire plaisir.

Dans les westerns, c'est le mec que vous prenez pour le dix-septième couteau. Vous lui accordez huit minutes de survie en début de pellicule. Erreur totale, c'est un tueur impitoyable, le héros du film. Sa spécialité ce n'est pas le colt mais le bottle neck. Un véritable sorcier. Ce simple tube de métal il parvient à le faire miauler comme pas un. On se croirait sur le toit brûlant de la chatterie de la SPA durant la saison des amours. Use de sa nonchalance particulière – le « je ne fais presque rien » et le « je donne plus que tout » - bouge à peine le doigt et ça feule à tout berzingue. Avec lui, on comprend pourquoi la guitare est un être femelle essentiellement clitoridien. Ne nous égarons pas.

André est à la basse. Des quatre, avec ses cheveux longs, son sourire mystérieux, et sa fine discrétion, l'a le look le plus indien. Attitude silencieuse mais question instrument c'est raté, vous distille un vrombissement rythmique des plus alléchant, épais comme une crème brûlée. L'air de rien il s'amuse comme un fou, parfois il s'immisce entre ses deux confrères et à eux trois ils ressemblent aux frères Younger

en train d'entretenir des deux gâchettes un meurtrier feu de barrage sur les détectives de l'agence Pinkerton, parfois il disparaît tout au fond de la pièce dans un recoin d'où il nous fait signe en agitant le bout de son manche. A la batteuse vous trouverez Benjamin. Moissonne sans désemparer. Pas un tiers de seconde de repos. C'est que le band bande dur. Vous avez de ces arrêts sismiques en bout de riffs qui déstabiliseraient les montagnes rocheuses. Très rockeuses. Des compos, du Stones, du Lynird Skinird, du Creedence ( à l'eau lourde ), pas besoin de vous peindre davantage le paysage. D'autant plus que cela, ce n'est que le premier set. De la rigolade par rapport au suivant. La même chose mais en dix fois meilleur. Faut voir Manu, travaille sur ses cordes. Ne se mélange pas les pinceaux. Pose ses doigts avec une précision d'horlogerie. Une élégance de comtesse qui n'omettrait de lever son auriculaire pour porter la tasse de thé à ses lèvres. Faut l'entendre aussi, ces notes grasses comme des bosses de bisons qui courent à fond de train sur l'étendue sans fin de la prairie. En prime bien sûr le duel rituel.

Barbac'h qui envoie une barbaque de riffs faisandés à dégoûter une horde de coyotes affamés et Manu qui réplique en vous offrant le charnier des abattoirs de Chicago. Ça pue le méchant rock and roll à plein tube. Dans la salle tout le monde s'enivre de ces fumets diaboliques. Et ils en rajoutent, à chaque fois plus rapides. Rigolent comme des bossus, se marrent, échangent des plaisanteries tout en larguant des plans de guitare plus complexes que les circuits électroniques d'une fusée intercontinentale. La tension monte à El Paso. L'on entend siffler le train vingt cinq mille fois et nous avons même droit à une hilarante évocation de l'homme des hautes plaines. Une prière pour Benjamin trempé de sueur derrière ses fûts. S'il continue à s'appliquer ainsi, l'est sûr qu'il ne passera pas l'hiver. En attendant, fait sacrément chaud. Font un tabac, mais version calumet de guerre. C'est la fin. Mais là encore Béatrice la patronne surgit - telle le septième de cavalerie dans La prisonnière du Désert - du sein de la foule et exige un dernier morceau. Se laissent violenter avec plaisir et l'on aura droit à un It's all over now repris en choeur par l'assistance et un Neil Young de derrière les fagots pour clôturer la cérémonie. Z'ont dû jouer près de trois heures, remarquez qu'en contrepartie les T-shirts, les double CD et les photos géantes se sont envolées comme un vol de vautours sur l'horizon infini. Une soirée de rêve, dégoulinante de rock and roll. Les Natchez ont été splendides. Une tribu dangereuse, à suivre à la trace.
( Photos : FB Christophe Banjac )
Damie Chad.
LE MEE-SUR-SEINE / 19 – 10 – 2016
LE CHAUDRON
ELI D'ESTALE- SIDILARSEN

Ce qu'il y a de bien avec Le Chaudron, c'est que vous y tombez dessus au moment même où vous êtes en train de penser que décidément vous vous êtes fourvoyé. Vous pouvez y passer trente fois devant sans que vous l'ayez remarqué. Les architectes ont parfaitement réussi leur plan d'intégration d'une structure communale dans l'habitat local. Ne l'ont peut-être pas fait exprès, mais ils devraient être cités à l'ordre de la nation. A ce niveau-là ce n'est plus de l'art mais du camouflage militaire. J'ai triché, me suis fié à l'instinct proverbial du rocker. Dix jeunes qui discutent sur un parking, affublés de T-shirts noirs sur lesquelles se profilent têtes morts, créatures effrayantes, lettrages gothiques et autres babioles aussi joyeuses, je tiens le bon filon. Ouverture des portes à dix-neuf heures trente, non ce sera huit heures. Plutôt que de faire le pied de grue dans la petite brise frisquette je me réfugie dans la MJC attenante. Lorsque j'en ressors c'est pour tomber sur les membres de Scores et Fallen Eight que nous reverrons très bientôt puisque Scores prépare sa Release Party ce prochain 19 novembre – dans ce même Chaudron – pour fêter la sortie de son deuxième EP. En attendant engouffrons-nous dans l'escalier qui nous emmène entre les noires parois de la panse chaudronique.
ELI D'ESTALE

Noir complet. On ne les voit pas. On les devine. D'obscures silhouettes. Musique pharamineuse, c'est lorsque la lumière éclate que la noirceur apparaît. Deux chanteurs. L'un est censé growler et l'autre chanter. Mais la différence n'est pas évidente. Nous ont par surprise. Restent coi et lorsque le chant éclate c'est le guitariste sur notre gauche qui se charge des premiers lyrics. Très bien d'ailleurs. L'a la hargne. Maltraite son instrument et éructe très méchamment dans le micro. Mais les yeux sont ailleurs. Sur Thomas le chanteur. Torse nu et bipolaire. Côté sombre et zone lumière. La moitié de la poitrine et le haut du visage maquillé de noir. L'attire les regards. Large ceinture de janissaire qui pend jusqu'à terre. L'est le mouton à moitié noir du groupe, celui qui apporte une touche artiste. Un groupe de métal avec un plus. Une aura de mystère supplémentaire. Chantent en français. Pas toujours compréhensibles car la musique recouvre parfois le vocal.
Musique climatique. Qui installe une ambiance. Saccadée. Des séquences qui se bousculent. Laissent la place au chant mais les épisodes purement musicaux sont nombreux. Peu de lignes mélodiques, l'espace est occupée par des saccades rythmiques. L'impression d'un train qui ralentit avec les wagons qui se heurtent violemment comme s'ils allaient s'encastrer les uns dans les autres. Toutefois le voyage continue comme de rien n'était. Les doigts s'arrêtent sur les cordes des guitares et aux drums Michael Schmidt enclenche une touche sur son ordi pour envoyer un trailer sonore sur lequel les instruments redémarrent et se fondent comme s'ils se perdaient dans le bruit du son. L'on sent que le groupe cherche à réaliser l'alliance des contraires l'énergie brute du métal et d'une certaine théâtralité poétique. Ce n'est pas un hasard si leur premier album se nomme Stellogénèse. Essayent d'accoucher de quelque chose de neuf, d'accoupler deux insectes géants d'espèces différentes. La virilité sonore est accomplie mais l'esthétique d'une sensibilité féminine n'a point atteint son stade de perfection. Les deux facettes du yin et du yang sont mises tour à tour en évidence, mais elles s'effacent dès que leur moment est passé. Guitaristes et chanteurs se retirent discrètement au fond de la scène prés du batteur comme s'ils voulaient se faire oublier. L'on préfèrerait qu'ils imposent une présence statique, une pose statuozidale, qui perpétuerait leur nécessité. Il manque toute une dimension imagiale à la mise en scène. Tout disparaît, se retrouve avalé par la nébulosité d'un retrait total qui donne le regret de sa discrétion. Ne jamais oublier que dans une éclipse ce n'est pas l'obscurité engendrée par le phénomène qui est atterrant, mais la disparition de l'astre qui se donne à voir pleinement en s'imposant en tant qu'absence. La télé d'Eli Estale a le son, mais l'image est encore quelque peu brouillée. Agréable à regarder, le public l'acclame, et toute une partie est manifestement venue pour eux seuls. Pas tout à fait ma tasse de thé-âtre. Manque une splendeur iconique.

SIDILARSEN

Autant le dire tout de suite je n'ai guère apprécié. Ce n'est pas qu'ils soient mauvais en leur genre, c'est le genre qui me déplaît. Sont définis comme du Dance floor metal. Perso, je pense que cela s'apparente un peu trop à la musique de boîte. Sais bien que la disco fut la face concomitante du punk à la fin des années soixante-dix, mais j'ai choisi mon camp et n'entends point en changer. Cinq sur scène, sombrement habillés sobrement. Ne sont pas de mauvais musicos et sont même sympathiques. Trimballent des idées généreuses et révoltées contre lesquelles je n'ai rien. Envoient méchamment du son, mais sont trop gentils. S'excusent de leur morceau very too go fast. Juste une métaphore. La griserie de la vitesse. N'allez pour cela écraser les gens sur votre route. Nous ne sommes pas des brutes. Nous respectons l'humanité de tout individu. Chantent en français pour être sûrs de bien se faire comprendre. Martèlent les paroles comme des slogans. Nous sommes des milliards, faudra bien que l'élite se rende compte que l'on existe. En son temps Trust disait la même chose mais ça vous cinglait le visage comme un coup de fouet à la lanière en fil de fer barbelé. Pour Sidilarsen il y a tant de générosité que cela en devient du consensus idéologique mou. Pas de panique pour les durs de la comprenette, ont installé deux maxi-écrans de chaque côté du fond de la scène. Projettent des images. Stylisées, simples et répétées. Avec les phrases importantes des morceaux écrits en gros lettrages blancs et noirs. Sont synchrones à la seconde près. Rien n'est laissé au hasard. Tout est minutieusement mis en place. La batterie qui enfonce les clous, toujours les mêmes breaks incessamment répétés, basse et guitares qui envoient les linéaires de binaire à fond. Electrochoc à mort mais beaucoup trop d'électro. Ce ne sont plus des trailers, mais le film entier plus les séquences enlevées au montage. Le public n'adore pas. Est en communion. M'étais fait la remarque de cette moyenne d'âge plus élevée que pour Eli d'Estale. Je comprends pourquoi. Un peu trop musique populaire dans le mauvais sens du terme. Une grande différence aussi avec les groupes pur métal, point de charivari garçonnier, ici ce sont les filles qui sont en état transique, refermées en elles-mêmes, insensibles au monde, prisonnières de cette hypnose balancée sans relâche par le groupe. Terriblement efficace. Vous servent une musique décérébrante pour vous faire réfléchir. Mais ils y croient. L'on sent la sincérité et l'authenticité. Ont un super chanteur, Didou, un plaisir chaque fois qu'il se rapproche du micro. Y a encore des attitudes rock en sa façon d'être, mais ce qui est sûr c'est que ce métal a perdu toute accointances avec ses racines blues. La musique évolue. Mais l'on n'est pas obligé d'apprécier tous les chapitres qu'elle parcourt.

Damie Chad
( Photos : FB des artistes )
P.S. 1 : Sidilarsen me fait un peu penser à Anakronic Electro Orkestra ( les amateurs doivent connaître ) vu cet été en Ariège au festival Les Z'arts en Douc et pour lesquels j'avais renoncé à écrire une chronique car trop éloigné de mes centres d'intérêt.
P.S. 2 : Par contre faudra que je vous fasse un topo sur les Vidéophages, une espèce d'ovni filmique théâtralisé d'une originalité folle... qui fut le summum de ce festival pas tout à fait comme les autres.

PUB ADK
Ai légèrement évoqué le problème voici quinze jours en rendant compte du concert des Dix-huit Marches. Les menaces de fermeture de sites dévolus aux concerts rock ( tous styles confondus ) dans le département se précisent. Vous ai souvent emmené aux soirées organisées par le pub ADK de Roissy-en-Brie. La dernière fois fin mai pour Junior Rodrigues and his Evil Things et The Distance, mais aussi la fine fleur du rockab national. De bons souvenirs, la mairie a prévenu qu'elle ne renouvellera pas ses subventions pour l'année 2017. Envisage froidement la fermeture du local courant décembre. Ce que l'on appelle un beau coup de pied au cul en guise de cadeau de Noël. Un désastre. Pour en mesurer l'ampleur sachez que plus de deux cents groupes ont été accueillis en 2015. Dont plus de cent cinquante régionaux. Vous connaissez la chanson : l'Etat qui se défait de ses prérogatives, les nouvelles équipes municipales fraîchement élues qui appliquent à la lettre les préceptes de la rentabilité libérale... Quand on pense que la jeunesse avait été déclarée priorité nationale pour ce quinquennat finissant, il y a de quoi se mettre en colère. L'est temps d'appliquer le célébrissime mot d'ordre du MC 5 : Kick Out The Jams, motherfuckers !
Damie Chad.
19/10/2016
KR'TNT ! ¤ 299 : BOB DYLAN / PLAYBOYS / POPA CHUBBY / JALLIES / TOM ROISIN / SENTINHELL / NICK COHN / TENNESSEE WILLIAMS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 299
A ROCKLIT PRODUCTION
20 / 10 / 2016
|
BOB DYLAN PLAYBOYS / POPA CHUBBY JALLIES / TOM ROISIN / SENTINHELL NICK COHN / TENNESSEE WILLIAMS |
UN PRIX NOBEL POUR BOB DYLAN ?
La nouvelle en a fait sursauter plus d'un, Bob Dylan se voit décerner le Prix Nobel de littérature 2016. Pour une fois au moins l'on cause dans les médias de ce satané prix de Littérature que l'on avait pris l'habitude d'escamoter au plus vite depuis une vingtaine d'années. L'est vrai que Bob Dylan est diantrement plus célèbre que Sveltana Alexievitch couronnée en 2015. Au moins Dylan, tout un chacun connaît, et peut émettre un avis non autorisé sur cette attribution.
Certains abordent le problème sous un angle d'attaque riquiqui : se délectent de l'angoissante question : Dylan le mérite-t-il ? Vu le nombre de nobélisés retournés à l'anonymat depuis un siècle, vaudrait mieux ne point se risquer à de prophétiques conjectures. Rappelons que ni Rainer Maria Rilke, ni Robert Musil, ni Marcel Proust, ni James Joyce, n'ont accédé à cet honneur. Ces absences remettent le prix à sa juste place de distinction somme toute hasardeuse. Ni un sacrement, ni un couronnement. Tout juste une récompense. Un colifichet mal fichu de la gloire. Que Stéphane Mallarmé se plaisait à accroire irréfragable.
Ma première réaction ? C'est sympa pour Dylan, mais en avait-il besoin ? Financièrement non. L'aurait mieux valu le refiler à un écrivain qui a du mal à boucler ses fins de mois. Au moins cela aurait été utile.
Ensuite l'envie de bomber mon torse ( velu et musclé ) de rocker. En honorant Dylan c'est toute la culture rock qui est hissée sur le grand pavois. Notons que dans bien des avis égrenés sur les antennes et la toile, les impétrants emploient à quatre-vingt dix neuf virgule neuf pour cent le doucereux vocable passe-partout de chansons pour évoquer l'oeuvre de Dylan. A croire que le mot rock and roll leur écorche encore la bouche....
Je terminerai par cette inquiétude. Recevoir le Prix Nobel de Littérature n'est pas obligatoirement bon signe. A l'échelle nationale le jeu consiste pour un écrivain à être élu dans un des fauteuils de l'Académie française. Cela sent un peu la naphtaline et le faisandé. Le rock'n'roll, vecteur dune certaine idée de contre-culture underground et de révolte existentielle serait-il devenu si inoffensif que l'on puisse déjà initier son embaumement ?
Damie Chad.
BETHUNE RETRO / 28 AOÛT 2016
PLAYBOYS
Playboys don’t cry
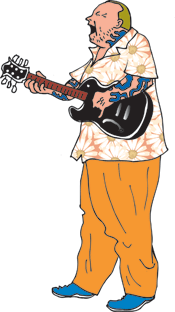
Rob Glazebrook est arrivé sur la grande scène de Béthune Rétro en plein dimanche après-midi ensoleillé. Quoi, les Playboys passent dans le camp des rockabs du dimanche qu’on charge de brasser large ? Non, heureusement, Rob ne mange pas de ce pain là. Il porte une chemise Tahiti comme tous les rockabs en été, et tient haut sur la poitrine sa vieille Les Paul noire. Il porte une barbe miteuse et affiche une bouille rigolarde à la Bukowski.

Des tatouages lui mangent le cou et en deux ou trois cuts, il remet les pendules à l’heure. Rob est là pour shaker le shook. C’est une grande gueule, un vétéran de toutes les guerres, un vieux briscard du circuit, il sait toiser un beffroi et régaler la compagnie. Rob est un géant du rockab anglais, il nettoie les ardoises et redore les blasons, il plie les genoux et swingue sa soupe avec une aisance confondante. Il ébahit sans le vouloir. Il ouvre sa grande gueule et le Rétro reprend tout son sens.

Il claque ses solos et se marre comme une baleine, il revient au micro raconter des conneries, il parle du fromage et du pinard, il crée les conditions du contact, il fait l’effort de truffer son délire de mots français, ce qui est assez rare pour un Anglais, et puis entre deux cuts qui passent comme des lettres à la poste, il nous tape une version magique de «Wild Cherry», ce cut bizarre et envoûtant monté au shuffle de charley et qui doit être si difficile à jouer, car bien déboîté de la clavicule de Salomon. C’est peut-être ce qui intéresse Rob, le déboîté, le déclassé, le chemin de traverse, l’exotica et les syllabes sauvages, celles qui sautent en marche du beat pour créer du vénal moite.

Ce mec a du jus en réserve, s’il calme le jeu avec une pièce un peu suave, c’est pour mieux revenir au rockabilly sauvage qui a sûrement nourri toute son enfance, car il ne se contente pas de le jouer, non, il le chevauche, comme un cow-boy de rodéo chevauche un étalon sauvage. On sent la poigne, le métier et la passion. Rob is burning hot ! Rob Glazebrook entre dans la caste des puristes activistes, ceux qui comme Bloodshot Bill ne lâcheront jamais la rampe et qui ont assez de talent pour que personne ne puisse douter un seul instant de leur détermination.

Il va parfois sur des choses plus rock’n’roll, comme sur ses albums, mais ça passe bien, car la voix est au rendez-vous. Son stand-up man et son batteur charpentant bien le son, Rob peut se livrer à quelques facéties et son copain saxophoniste amène la petite touche wild fifties qui lubrifie bien le passage des cuts d’exotica.

Oui, Rob fait partie des gardiens du temple. Sur scène, il rappelle qu’il fait ça depuis trente ans, et on le croit sur parole. All the way from non pas Memphis, mais UK Bop city, ce qui au fond revient au même. Rocking wild with Rob. Twisting the beff’ away.

Discographiquement parlant, on compte quatre époques dans l’histoire du dysnate Rob : le temps où il accompagnait Ronnie Dawson, puis les Playboys, ensuite les Houserockers et un projet plus bluesy, les Broadkasters.

Si vous voulez l’entendre gratter derrière Ronnie Dawson, alors il faut mettre le grappin sur une copie de Rockinitis, paru en 1989. Rob joue sur trois cuts (le morceau titre, «A Real Good Time» et «I’m Tore Up») et Boz Boorer des Polecats joue sur les autres. Le morceau titre est un rocky road blues à la Bo Diddley, haché menu avec une belle intention vaudou. On assiste à un retour en force du slap dans «Yum Yum Yum». Ce brillant slappeur s’appelle Matt Redford. Son de rêve, slap sourd et finement métallique, structure classique mais la qualité du chant et le pulsif ventral du slap font toute la différence. En B, on se régalera de «The Cats Were Jumpin’», un beau rockab joliment agencé, bien juteux, sévèrement swingué. Finalement, les Anglais s’en sortaient plutôt bien. «A Real Good Time» est du pur Jerry Lee, même assise de voix, même penché de glotte, même façon de dominer le monde, même prestance de chef de guerre dressé sur ses étriers. Pareil pour «I’m Tore Up», chanson de poivrot d’Ike Turner dans laquelle Ronnie raconte comment il dépense sa paye dans les bars avec les copains. On imagine le bonheur qu’a dû éprouver Rob à jouer ça.

L’ère des Playboys s’ouvre en 1989 avec l’album Invitation To Death. On y trouve deux belles choses, à commencer par «Anna Mae», pur jus de rockab saxé de frais. Voilà l’Admirabilis de Paracelse, le grand bop du Pic de la Mirandole. Si vous aimez bien le British bop bien intentionné, c’est là que ça se passe. On tombe plus loin sur l’excellent «What’s The Matter» qui sonne comme un hit rockab condamné à l’underground des collectionneurs. Just perfect. Voilà encore un cool cut joué au slap, mais comme les Playboys n’intéressent qu’une poignée de gens en France, c’est condamné aux oubliettes. Dommage, car Rob sait bigner le bop. Il adresse aussi un clin d’œil à Buddy avec «You Cheated Me» et sort pour l’occase le chant idiot idoine. Puis il joue «Dreamer» la main sur le cœur et propose plus loin un autre hit de juke qui s’appelle «The Cats Come Back» et qui sonne comme un message d’espoir.

Rob comes back cinq ans plus tard avec l’album 21. Quatre merveilles s’y nichent, notamment «Bloody Mary», aussi repris par Barrence Whitfield. Rob pousse des cris et part en drive de cruise. C’est l’une de ses spécialités. Il fonctionne comme Frankie Ford, il avale le bitume. Il sait créer l’événement avec du cousu de fil blanc et soudain, il casse le beat et se cale sur la charley, l’un des trucs les plus difficiles à réussir. Il fait aussi un joli carton avec «Wild Cherry» qu’il prend d’une voix bien alerte. Ce qui frappe le plus chez lui, c’est son énergie. Il sonne terriblement anglais, il pousse son falsetto infecté dans les orties. Rob est l’un des chanteurs de rockab les plus attachants. Plus loin, il emmène «Is It True» au pas de charge. Ce mec est marrant car complètement dévergondé. Il sait aussi piquer des crises et faire le survolté. Un solo de sax tombe là-dessus comme de l’huile sur le feu. Encore un hit avec «Come Back Judy», joué plus heavy. Les Playboys tiennent bien leur rang, ils jouent avec une classe impériale. Rob cuit ça au gratin de heavy boogie dauphinois. On trouve aussi sur cet album une belle reprise d’«Ooh Wee Pretty Baby» de Long John Hunter.

La même année paraît Strike It Lucky, encore un gros album-dinde farci de hits. Sur «Orieta», Rob hurle comme un démon. Ça joue au beat des vainqueurs. Dans «Skippy Is A Sissy», Rob passe un killer solo et son copain saxeur arrose au sax pour activer l’incendie. Tiens, encore une histoire de bonne femme avec «Cindy Lou». On assiste là à une belle voltige de rock’n’roll et Rob y place un solo enragé, digne de l’institut Pasteur. Encore un hit avec «The Train», un cut magnifique de waiting at the station for the girl come home. Rob a du feeling plein les bronches et plein les rotules. Il est magnifique de défiance et d’exaltation. Il bat tous les records de véracité. «Flying Fish» compte aussi parmi les cuts endiablés de l’album. D’ailleurs, tout est endiablé sur cet album. Tout est noyé de son, d’énergie et de sax. Avec Strike It Lucky, les Playboys reviennent au pur rock’n’roll des fifties.

Quand on écoute Feeling Good paru en 1996, on comprend que Rob Glazebrook fait partie du patrimoine britannique. Ce mec est ce que les anglais appellent un buried treasure, un trésor caché. La preuve ? Tiens, écoute «Feeling Good», le boogie d’ouverture du bal qu’il joue avec sa Gibson bien haut sur la poitrine. On assiste là à une fantastique débauche de bon beat de boogie. On sent bien battre le pouls du boogie. Il prend plus loin «Mean Ol’ Frisco» au riff teigneux. Voilà encore un cut terrifiant de grandeur d’âme et claqué aux accords violents. Rob a le diable au corps. Quand on l’écoute jouer, on le revoit twister du genou sur scène. Encore un cut diabolique d’énergie et de son avec «Slippin’ The Strings». Les Playboys foncent ventre à terre et Rob gratte toutes ses notes aux allers et retours. Il enchaîne avec un autre brûlot, «Little Lil’», un cut du set sur scène - You go to hang on the string - Rob enroule son chant sur la musicalité de Little Lil’/ Little Lil’ et il relance encore et encore, il enroule les little Lil’/ Little Lil’ you make my heart sing. Pur génie. Et le sax chauffe la marmite.
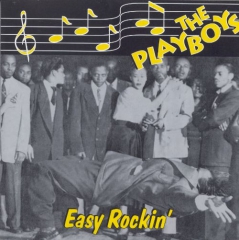
Easy Rocking restera sans doute le meilleur album des Playboys. Ce disque est un gros tas de dynamite. Allumons la mèche et paf, «Shake Your Hips» explose dès les premières mesures. Rob salue Slim à coup de boogah shooté d’hot harp. Rohan Lopez souffle dans son harmo comme le fils caché de Little Walter et de Saint-Guy. Rob et ses diables d’amis en font une fantastique version longue, bien ancrée dans un mix de rockab et de hot boogie swampy. On frise l’hypnose fatale. Bien sûr, Rob va revenir à son cher rock fifties, celui qu’il affectionne particulièrement, avec des cuts comme «Little Miss Pancake», ou encore un «Rockin’ N Scrapin’» très saute au paf et drivé par un jive d’exception, oh yesss, le pire bop de swing qui soit ici bas, Bob. Retour au boogah rockab avec «Baby Treat Me Right», joliment slapé à la bonne franquette d’early in the morning, bien endiablé et digne des third-rate ragtag bands de bucket of blood down in Louisville, Louisiana. Bienvenue dans l’enfer du boogie ravageur, baby, dans un infernal bayou d’hot harp. Encore plus déterminant, voici «24 Hour Girl», un vieux boogaloo chauffé au sax - She’s my girl ! Well she’s my girl - Rob fait du crawling Gene Vincent de cuir noir qui ne va pas bien - Oh oh man she’s my girl - Eh oui, c’est un disque hanté par des esprits, Gene, Slim, the Conjure Woman de Tony Joe et Rob le hâbleur. Dans «She Sure Can Rock me», Rob se prend pour une espèce d’Esquerita blanchi à la chaux de fond et quand Rohan le guerrier prend son solo de sax, eh bien figure-toi qu’il se croit dans les godasses de Lee Allen, l’animal on est mal. Few ! ferait l’Anglais, it rocks ! On passe au groove des auto-tamponneuses avec «Revenge», paradis de la bigne et des blondasses ! C’est saxé de frais et perdu dans les fifties. Quel shoot de nostalgia et d’amertume mercuriale ! Alors, attention, car l’«Easy Rockin’» qui donne son titre à l’album est beaucoup trop endiablé. Franchement, le batteur Ritchie Taylor est beaucoup trop doué. Il se croit dans les godasses de Gene Krupa, il se prend littéralement pour la charge de la brigade légère et fait un vrai numéro de cirque. Mais on assiste au retour de Rob le démon avec «Dizzy Miss Lizzy». Son petit jeu consiste à rallumer la mèche à chaque morceau. Sa version de Dizzy est une merveille d’énervement carabiné. Inutile de vouloir calmer un mec pareil. C’est Lucifer avec une guitare. Il claque son solo en accords. Comme il est dit dans le Nécronomicon, le génie jaillira des entrailles de la terre. En voilà la preuve avec «Don’t Start Cryin’ Now», et cette fois, Rob ne rigole plus. Dégage connasse ! Arrête de chialer ! T’es pas contente ? Il joue les cadors et lâche un pur jus de rock de rockab avec des oh yeah qui se fondent dans les coups d’harmo, et soudain, Rob part en solo flash. On l’aura compris, c’est un album dramatiquement bon. Rob est un roi du rock fifties, il en cultive l’essence. Il finit avec «Rock-A-bye Baby Blues», coup de chapeau écœurant de classe à Buddy Holly, explosé dans le contexte du cortex. À ce stade de la situation, les Playboys sont complètement irrécupérables.

Le dernier album en date des Playboys s’appelle Gotta Be Lose. Rob y présente une sélection de cuts qu’il adore, à commencer par l’effarant «Sugar Doll» de Johnny Jay. C’est slappé à l’os du bop et Rob charge bien son Sugar Doll. Il tape aussi «Henrietta» de Johnny Dee, un solide walking-rock chanté au vieux guttural. Rob s’énerve après Henrietta. Il y frise à la fois Jerry Lee et Little Richard. Il tape aussi «Mutha» de Jimmy Bing, un hit inconnu de plus avec un solo monté sur le pont de la rivière Kwai. Dans ses notes de pochette, Rob se souvient d’avoir accompagné Rusty York sur scène pour «Sugaree», et il dit le plus grand bien de «Gotta Be Loose». Mais bizarrement, l’album est nettement moins dense que les précédents. Ouf, ça permet de se reposer.
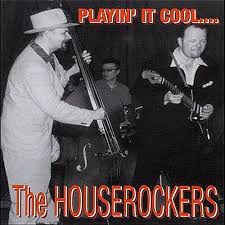
Les Houserockers sont probablement l’un des meilleurs groupes de la scène rockab actuelle. Playin’ It Cool vaut son pesant de slap, Slim ! Dès «You’re Gone», Rob sonne comme l’Elvis de 56, quand il shakait le shook de Mama dans «That’s Allright Mama». Il faut se pincer pour être sûr de ne pas rêver. Il enchaîne avec un autre coup de Trafalgar, l’excellent «Shorty The Barber», pure dégelée de rock’n’roll swinguée au bop de base et de rigueur, summum de la vénérable véracité versatile. Sure Rob can rock ! Il reprend aussi le fameux «Fire Of Love» de Jody Reynolds et il enroule «Buy Me A Car» dans son cornet à piston. Rob est un fin renard rockab, il pouette-pouette ses petits solos avec une belle assurance. Encore du pur rockin’ rockab de Rob avec «Don’t Be Gone Long». Ce mec reste dans la ligne du parti. Il prend «Fancy Dan» à la furia del sol et pique sa crise de fièvre rockab. Wow ! Quelle fabuleuse slabette de real cool cat in a pink Cadillac ! Quel crac ce Rob ! On trouve plus loin un virulent coup de rage intitulé «You Don’t Bug Me No More». Rob sait rider le rumble, il sait vraiment monter à l’offensive et claquer ses syllabes dans le micro - Don’t bug me no more yeah ! - Et puis on trouve encore un slob de slab extraordinaire, «Cats Got Back In Town», joué à l’écho fatal et au slap métallique de doigts chargés de bagues.
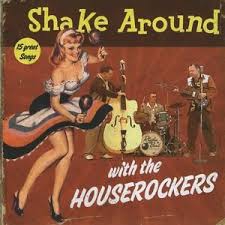
Shake Around With The Houserockers fait partie des albums classiques du rockab, pour au moins cinq raisons. Un, «Rock On The Moon», qui ouvre le bal, pur rockab dans les règles de l’Art Suprême selon Villiers. Rob connaît bien Charlie Feathers, car il chante le bop avec la même classe. Deux, «Bye Bye», boppé et strummé au pas lourd. Rob tire bien son bah-bah sur le beat, c’est rythmé de la nuque, avec un solo éclair et des cymbales qui scintillent. Diable, comme ces mecs sont bons ! On reparlera des passes d’armes de Rob, dans dix mille ans, comme dirait Léo. Trois, la fantastique reprise de «That’s All Right Mama». C’est là où les Anglais sont très forts, car un mec comme Rob est capable de taper dans l’intapable et d’en faire une version inspirée qui n’entre absolument pas en concurrence avec elle d’Elvis qui est si parfaite qu’elle en est devenue intouchable. Rob dispose de toute la vitalité d’un vitaliste prévaricateur. Quatre, «Please Give Me Something», et là, il faut bien parler de coup de génie. Car Rob tape dans l’essence même du rockab. Il en fait une version définitive, aussi dévastatrice que dévastée, très différente de celle de Tav Falco. Cinq, «One Kiss», où Rob joue du solo clair sur fond de slap intense. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie, si on ne veut pas mourir idiot. Encore une merveille avec «It’s Good To Know». Les Houserockers sont dans leur trip de tripe et Rob joue avec le brio d’un croyant macqué de la Mecque du rockab. Il est invincible, voilà ce que ça veut dire.

L’an passé, les Houserockers enregistraient Blue Swingin’ Mama, un bien bel album chauffeur de paillasse. On y trouve du rockab pur jus avec «Slippin’ In». Rob sait brosser le rockab dans le sens du poil. Cet admirable shouter ne se refuse aucune crise de guttural. Avec le morceau titre, il propose une belle fournaise rock’n’roll. Il nous embarque dans son territoire qui est le rock’n’roll fifties, et même si c’est cinquante ans après la bataille, Rob se bat encore. Ses exploits sonnent comme des coups d’épée dans l’eau, car à part les gens de son âge, qui va aller écouter ça ? Il n’a aucune chance de passer dans les radios à la mode. Tant mieux pour lui. Il reste dans le rock fifties avec «If I Had Me A Woman», encore du rock vintage à l’ancienne. Rob ? Mais c’est un seigneur de l’occase et de la tôle rouillée. Quel merveilleux ferrailleur ! Il chante dans la clameur du parc de carcasses abandonnées. Encore du pur jus de rock’n’roll avec «She’s Mine» que Rob prend du bas - So long oh all the time/ She’s mine - Il est sûr de lui, pulsé par un fabuleux strumming des sous-bois non pas de l’Arkansas, mais du Kent. Et il jette là-dedans un solo en forme de bombe artisanale. Le hit du disque s’appelle «Trapped Love», joué à la démence de la partance. Rob reste dans le rock’n’roll high energy bien buté du bulbe, mais avec un vieux fond de pulsion rockab. Le son est si épais qu’on se pâme. Rob riffe comme un démon et grave sa légende dans le marbre des falaises d’Orion, là-bas, vers le Septentrion.
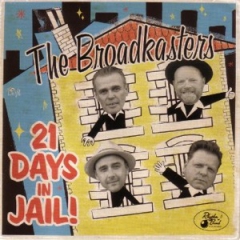
En 2014, il montait un projet parallèle, les Broadkasters et enregistrait un album de blues rockab, 21 Days In Jail, très axé sur Little Walter et Big Dix. Rob partait lui aussi en quête du Graal, c’est-à-dire le son qui croise le blues et le rockab. Eh bien, il n’est pas rentré bredouille, car il propose dans cet album deux cuts géniaux, «Mellow Down Easy» et «Come Back Baby». Avec Mellow, il tape dans le languide des bas-fonds de Chicago, mais sur fond de slap rageur. Il nous verse dans l’oreille du pur jus de jute de juke. Voilà un cut de rêve, bien slappé derrière les oreilles. Little Walter serait fier d’entendre son cut joué ainsi. Encore du pur génie interprétatif avec «Come Back Baby», toujours signé Little Walter. Rob joue le fameux riff fantôme. Il a tout compris. Il transforme ça vite fait en pure sorcellerie et invoque l’esprit de Little Walter. Il tape dans un autre cut de l’ami Jacobs, «Ah’w Baby», mais c’est joué plus heavy et arrosé d’harmo, donc plus prévisible. Il tape aussi dans Big Dix avec «Crazy Mixed Up World» qui vire aussi en tour de magie, clip clap, Rob des bois sort d’un Sherwood of blast, c’est swingué à l’épaule et twisté du genou. Impossible de rester assis. Rob sait aussi faire du boogie sale et violent. La preuve ? «A Fool No More» - I said babe/ You’ve just got to go - Il lui dit de se tirer et joue ça au riff rampant. Un dernier coup de Little Walter avec «Just Keep A Lovin’». C’est éclaté à coups d’harmo, cousu de fil blanc, mais ça passe bien. Rob bouffe Walter tout cru, c’est un goinfre, il fallait voir ses yeux briller lorsqu’il évoquait vin et le fromage sur scène à Béthune. Il adore Little Walter au point que ça devient louche. Il finit cet album réconfortant avec un excellent blues de slap intitulé «Baby Done Left Me». On rêve d’une temps où le slap régnera sur la terre comme au ciel.
Signé : Cazengler, playbaye (aux corneilles)

Playboys. Béthune Rétro. 28 août 2016
Ronnie Dawson. Rockinitis. No Hit Records 1989
Playboys. Invitation To Death. Fury Records 1989
Playboys. 21. Joker Records 1994
Playboys. Strike It Lucky. Joker Records 1994
Playboys. Feeling Good. Joker Records 1996
Playboys. Easy Rocking. Vinyl Japan 1997
Houserockers. Playin’ It Cool. Pink ‘N’ Black Records 2005
Houserockers. Shake Around With The Houserockers. Rhythm Bomb Records 2013
Playboys. Gotta Be Lose. Rhythm Bomb Records 2013
Broadkasters. 21 Days In Jail. Rhythm Bomb Records 2014
Houserockers. Blue Swingin’ Mama. Rhythm Bomb Records 2015
BRUGUIERES / 14 – 10 – 2016
POPA CHUBBY
Nous voilà, mes amis et moi, au Bascala, à Bruguières petite bourgade à 20 km au nord de Toulouse pour découvrir Popa Chubby. On m’en avait parlé mais je ne connaissais pas (hé oui !).
En arrivant, nous découvrons dans le hall, Popa Chubby, « himself », assis derrière une table assurant lui même la promo de son dernier disque et se prêtant volontiers à quelques selfies. Allez j’ose ? Oui ! J’ai jamais fait de selfie avec une star car je trouve ça stupide mais de voir Popa, gros poupon, tout seul dans ce grand hall, tout triste devant des cd et des tee shirts, j’avais envie de….je ne sais pas, de lui dire : « on est là pour toi ».

Et puis le concert débute avec le pianiste Dave Keyes pendant 20 minutes. C’est bien, du blues, classique, correct mais voilà….

Et puis déboule Popa !!! C’est une tornade, que dis-je un tsunami !!!! On ne voit rien venir à part sa masse imposante. Une vague gigantesque nous emporte pendant près d’une heure trente ! Une onde que les surfeurs ne peuvent même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. D’un souffle, tu nous as dispersés sur les flots, Popa ! Nous sommes happés, nous n’avons rien vu venir. Le rythme est époustouflant ! La vague nous soulève, nous emporte avec elle, entraînant tout le monde sur son passage !!! Nous sommes là, haletants ! Nos corps ne touchent plus terre, d’ailleurs nous n’avons plus d’enveloppe corporelle ! Nous ne sommes plus que les arpèges de Popa ! Nous essayons de reprendre notre souffle mais impossible de revenir en arrière ! On ne peut lui échapper et c’est tant mieux ! Est-ce du rock, du blues ? Peu importe nos corps flottent dans la houle ! Nous ne sommes plus que du son à l’état pur ! Des sens, du sens ! Le son nous pénètre, nous sommes devenus ta musique ! Les corps s’arqueboutent, ondulent…Nous faisons corps avec la musique mais en même temps notre enveloppe charnelle ne nous appartient plus ! Le marionnettiste Popa !!! Nous sommes tes cordes, tu joues avec nos corps ! Il paraît que ton nom de scène serait tiré d'une expression d'argot, « pop a chubby », qui signifierait « avoir une érection » !
Tout devient crescendo, s’accélère, nous sommes en apnée !!!!!!!!!!!

Et puis, ce regard !!!! As-tu déjà croisé le regard de Popa ? Il te regarde, appose deux doigts boudinés sur la guitare… en une fraction de seconde le temps s’est figé… et puis tout devient indescriptible ! Ta poésie nous harponne Popa, en équilibre sur la vague, au bord de l’écume. L’écume devient de la dentelle, tu tisses la voile et tu nous enveloppes, délicatement, avec elle, Popa ! Puis dans un slow (celui qui tue), tu nous déposes ensuite sur la grève, tels un autel. Tu nous laisses, là, haletants, ballotés, rompus, laminés, bouleversés, échoués, frissonnants, écorchés à vif !!! Notre âme effilée par les embruns !
(beaucoup, à ce moment là, dont moi, se sont assis par terre tellement nous étions épuisés physiquement )
Quel voyage Popa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Au cœur de la musique, ton amour, au pays des sens…Tu nous as offert tant d’émotions ce soir-là, tu nous as offert ton âme ! Tant de volupté avec ta guitare de baroudeur ( Fender « 66 sunburst Stratocaster », je pense) barbouillée de scotchs, d’autocollants où l’on peut lire « Support Hell Angels » Mais on dirait la guitare d’un gosse de 16 ans ! Et j’adore ça.

Puis tu repars Popa vers une seconde partie du voyage, toujours magnifique, mais tu ne réussiras pas à nous amener totalement avec toi cette fois-ci. On dirait plutôt une performance : « écoutez tout ce que je sais jouer ». Mais le répertoire est infini pour Popa… Et s’enchainent du rock, toujours, mais aussi du jazz, du blues, de la country, du funk, de la soul (et même du reggae il parait, mais je n’ai pas entendu. Trop lessivée par la 1ère partie sans doute !).

Petit break où tu joues de la batterie, Popa. Bof, petit solo avec ton air désabusé (pour moi ça « rythme » à rien). Dave Keyes exécute quelques « trémolos » à l’orgue façon Rhoda Scott. Suis pas trop fan ! Un petit reproche quand même, depuis le début du concert tu ne laisses pas beaucoup de place à tes musiciens. Tout tourne autour de toi. Il est vrai que ton excellence prend beaucoup de place.

Tu reprends ta guitare ! Hé marathon man ! Mais tu ne veux plus t’arrêter ! Tu veux jouer jusqu’au bout de la nuit et nous accompagner jusqu’à ce qu’il ne reste plus personne dans la salle ! Cela me rappelle un film : « On achève bien les chevaux ! ». Et tu te distrais de cela. Tu t’en enivres peut-être... Eh mec, tu gagnes ! Beaucoup de personnes partent… presque trois heures de concert Popa !!! Où veux-tu en venir ? Mais si on est attentif, on se rend bien compte que tu ne te lasses pas de donner tout ton amour, d’offrir une musique puissante comme ta carcasse mais tout en délicatesse. Tu auras raison de mes amis qui doivent rentrer et je pars avec eux. Je vais manquer le bouquet final mais tu m’as offert l’un des plus beaux parfums de ma vie, un ineffable bonheur !

Patou Rock
TROYES / 15 – 10 – 2016
Le 3B
JALLIES / TOM ROISIN
Je file en teuf-teuf sans meuf avec le grand Phil, tout droit sur route à deux voies vers Troie. Mission importante. Ouverture de la saison des concerts du 3 B en fanfare ( non, elles n'ont pas embauché une section de cuivres ) avec les jolies et joyeuses Jallies, nos joyaux, nos jouvencelles préférées. Pas grand monde devant le rade... à part nos demoiselles. Mais le miracle s'accomplit, à peine s'installent-elles pour leur premier set que le bar se remplit par enchantement. Zut ne manque que Duduche dans la ruche ! Par contre tout un tas de têtes nouvelles dans la clientèle habituelle. L'effet Jallies qui rejaillit.
CONCERT


Les laisse se débrouiller avec leur intro. We are the Jallies. Que se passe-t-il ? Exactement comme avant, mais totalement différent. Enfilent un Be Bop a Lula qu'elles boppent à mort, immédiatement suivi de Boots sinatriennes qui sont faites pour galoper à fond de train. L'est temps de faire le point. Avant même que les hostilités ne commencent. Ont tenu leurs promesses du mois de septembre. Nous avaient assuré avant de monter sur scène que l'automne serait studieux. Allaient se mettre au boulot. Le résultat est indéniable. Décapant. Juteux, jouissif, jaillisif. Elles ont bossé non pas comme le dromadaire monobosse mais comme le chameau à deux panses dorsales que, dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche nous indiquait comme la première des trois métamorphoses qui conduisent au Surhomme. En l'occurrence ce soir aux Surfilles. Y a un velours dans les choeurs qu'elles ne nous avaient jamais offert jusqu'à maintenant. Sacredieu, elles ont peaufiné ! Du miel de châtaigner. Une aisance déconcertante. L'impression qu'elles se coupent la parole à tout bout de chant, et les voix s'enlacent et s'encastrent à merveille comme le lierre qui se coule sur les branches du chêne. Et la vitesse ! Vous entendez, mais pas le temps de voir. Sont pourtant adorables, polo à rayures bleues de marin, robe rouge, tunique blanche à pois roses, des adolescentes dans la cour de l'école, pas les plus sages, celles qu'il faut garder à l'oeil pour éviter leurs espiègleries. Qui font le mur dans un murmure. Courent telles des gazelles qui gazouillent. Les deux gars sont à la bourre. Thomas en cassera deux cordes coup sur coup. S'en fout, au fond l'a son copain Bertrand qui se charge de ressusciter les cadavres. Et Kross se lance dans des soli démentiel qu'il balance comme la rose à tout vent du dictionnaire Larousse. A peine est-il revenu dans le swing que Tom hâte sa guitare, vous la joue en vrille, qui s'insinue partout à tel point que les filles lui font les gros yeux. Ce soir, qu'il soit bien entendu que ce sont-elles les stars. Ne sont pas venues les mains vides mais la bouche pleine. Déballent leur cadeau.


Attention ce n'est pas de la balle. Des surprises. Une petite adapt ( c'est astap ) par exemple. Un truc qui fait peur. Au début. Commencent comme des tourterelles, roucoulent La vie en rose. Evidemment ça vit aussi longtemps qu'une rose flétrie par le vent d'hiver. Les deux gars derrière doivent être jaloux, vous cisaillent la mélodie, vous la découpent en morceaux et les recollent dans le désordre. Et les fillettes qui s'énervent et qui vous les transforment en charpie, le rose passe à l'écarlate, dégage un parfum manouche qui touche, et s'apothérose en fouillis d'épines carnivores. Ovations. Plus tard ce sera à la vie à la mort, morceau ( en anglais ) composé à la suite des évènements du Bataclan, aucune sensiblerie, aucune pleurnicherie, ni pleurs, ni haines, une explosion énergétique, la célébration incendiaire du triomphe de la vie. Ensuite, elles nous conteront l'histoire du chaton mignon qui ne fait que ce qu'il veut, doit se torsader sans arrêt le pauvre animal pour retomber sur ses pattes s'il ne veut pas être piégé dans le labyrinthe rythmique. Pour nos félines pas de souci, leurs voix ondulent, hululent, et pullulent. Un festival contrapuntique. Encore une nouveauté, une mélodie sonore, guitare early sixtie et les garçons qui mêlent leurs timbres au choeur des filles. Un dédale vocal répétitif recouvert par les clameurs du public. Y a longtemps que les couples dansent et se remuent à qui mieux-mieux, aussi quand elles annoncent le dernier morceau de la soirée, Béatrice la patronne vient mettre de l'ordre dans la cambuse. Pas question. Arrêt immédiat. Tout le monde descend. Pause pipi dix minutes, et c'est reparti mes kikis pour un troisième set. En sont toutes contentes. Nous aussi. Elles ont été extraordinaires, pétillantes, pétulantes. Avec leur défaut de filles bien sûr. Le pauvre Jérem extrait de force du public et contraint par deux fois de venir taper sur la caisse claire sous prétexte de leur fatigue, et Bertrand sommé de tenir la rythmique sur Goin' up the country et Johnny B. Goode. Ce que Marx a oublié de théoriser l'exploitation ( éhontée ) de l'homme par les jolies filles. Mais on leur pardonne, z'ont peut-être donné, de l'avis de la colonie qui les suit, leur meilleur show. En plus, elles minaudent, les derniers morceaux pas tout à fait calés, joués pour la première fois en public... Bref des broutilles de filles. Qui vous émoustillent de leurs fausses faiblesses. Sourires, rires, chamailleries, railleries, elles ont décliné tout l'artifice du charme ensorceleur de la gent féminine pour le plus grand plaisir de l'assistance. Attention, enregistrent leur deuxième album en février. Ne vais pas vous quitter sans vous donner leurs prénoms, par ordre alphabétique. Notez bien, je ne répèterai pas : Céline, Leslie, Vanessa. N'insistez pas, aujourd'hui vous n'en apprendrez point davantage sur le secret des déesses.
TOM ROISIN

Un garçon tout seul. Chemise blanche, cravate noire et guitare en main. L'a du cran. L'a demandé à passer dans le premier interset des Jallies. Après la grâce virevoltante des demoiselles, la solitude dépouillée, une attitude qui n'est pas sans rappeler Johnny Cash. Pas tout à fait son idole. Lui, c'est Hank Williams. Coup sur coup nous interprètera Lonesome Boy, I saw the Light et devant la demande du public il enchaînera par Jambalaya. Tom Roisin ne donne pas dans la facilité. A peine dix-huit ans, une voix qui n'a pas encore atteint sa plénitude, mais l'émotion – rien à voir avec le trac – cette adhésion à l'attitude country, ce timbre qui parfois nasille à merveille et cette gravité inhérente au style, l'a tout compris d'instinct.

Ne s'en tirera pas comme ça. Faudra qu'il revienne dans le deuxième interset. Kross le suit à la contrebasse. Du coup son jeu de guitare s'affirme, l'on comprend mieux pourquoi il se réclame de Duane Eddy. Un petit Honky Tonky et après avoir tergiversé quelques secondes – l'on ne sait pourquoi, il se murmure qu'il est resté sur scène une et demie dans un bar de Romilly-sur-Seine – il rechante Lonesome boy. Cinq morceaux et l'on se presse autour de lui. L'a séduit. Sait rester humble, avoue qu'il est autodidacte, que c'est la troisième fois qu'il monte sur scène et qu'il aimerait former un groupe avec un contrebassiste et un violoniste. Juste un brin d'herbe qui pointe dans la prairie, mais déjà empli de l'esprit qui souffle sur les Appalaches. A suivre.
Damie Chad.
SENTINHELL
THE ADVENT OF SHADOWS
THE ADVENT OF SHADOWS / THE ARCHMAGUS / TIME / DARK LEGACY / SEA OF SANDS / THE STORMRIDER / DEMON'S RUN / SENTINHELL .
Bass : Olivier Bernal / Guitars : Angelo Di Luciano / Vocals : Nicolas Garuana / Keyboards : Anna Garic / Drums : Adrien Djouadou.
2013.

The Advent of Shadows : une porte qui grince et l'orage qui gronde. L'horreur peut commencer. La lourdeur de la rythmique épaissit le trait. Ce qui s'avance n'est pas rassurant. La voix grave de Nicolas Garuana détache les syllabes comme des balles. Emphase et avertissement. Insistance et provocation. La musique se déploie comme un générique de film. Accélération finale. Il ne suffit pas d'attendre, le mieux est de se porter au-devant du danger. The Archmagus : Vous l'aurez voulu. L'intensité de l'obscur déboule sur vous. Vous voici investi de tous les secrets qu'il vaudrait mieux ignorer. Il en est ainsi de toutes les initiations, vous infusent sur le même tempo et un poison mortel et une force accrue. Comptez sur votre volonté de puissance pour vous tirer du piège. La guitare d'Angelo Di Luciano émet des larmes de sang. L'orgue d'Anna Garic tisse des toiles d'araignées monstrueuses. Time : Le temps est un monstre : arrive toujours trop tôt ou trop tard, qu'importe l'heure il est urgent de fuir au devant des ombres funéraires. Vous ne courrez jamais assez vite malgré le drummin d'Adrien qui martèle la cadence et joue au métronome de la mort. Peut-être tournez-vous en rond sur le cadran du désespoir. Dark Legacy : l'orgue d'Anna se déploie comme des tentures sépulchrale d'église maudite un jour d'enterrement. L'angoisse est dans la gorge de Nicolas. Course éperdue, n'a hérité que d'une perle encore plus noire que son âme carbonisée. La noirceur de l'abîme galope à ses côtés et l'enveloppe. Sea of Sands : bande-son de film oriental. Méfiez-vous des plages trop belles. La musique se tortille comme la danseuse du ventre dans Les Mille et Une Nuits. Inversion des rôles, le serpent des perfidies charme de ses yeux obliques le malheureux musicien. Les guitares deviennent folles. Inutile de crier comme si vous voudriez avaler le monde. C'est juste le contraire qui est en train de se dérouler. The Stormrider : entrée wagnérienne. Vous vous êtes enfui sur le tapis volant. Vous croyez chevaucher la tempête. Vous n'êtes qu'un fétu de paille emporté par l'orage du destin. Lorsque les éclairs vous traversent la sensation de puissance ouranienne alterne avec celle de votre humaine impuissance. Danse du sabre. Demon's Run : plus noir que noir. Gradation dans l'inéluctable. Vous n'échapperez pas à la meute des démons qui courent autour de vous. Peut-être même êtes-vous l'un d'eux. Est-ce vraiment si important ? Reprenez votre souffle. Vous n'êtes pas encore au bout du chemin. Plus vous avancez dans les guitares qui flambent plus vous vous éloignez de vous-même. Chemin d'ordalie. SentinHell : ce qui est devant vous n'est autre que la porte du début qui s'est entrouverte. Inutile de prendre à témoin le monde entier. Egosillez-vous avec tout le lyrisme dont vous vous croyez capable. Vous ne saurez jamais de quel côté de l'huis vous vous trouvez. En défendez-vous l'accès ou attendez-vous les ombres qui en sortiront ? Vous êtes la sentinelle de l'Enfer. Encore plus profonde la basse d'Olivier Bernal.
Ce n'est pas la formation que nous avons vue la semaine dernière en concert. Princesse Anna Garic n'est plus là, pleurez son altière beauté et la blondeur de ses cheveux évanouis. Nicolas Guruana a laissé sa place à Niels Bang. La musique de Sentinhell a changé. N'a rien perdu de sa puissance, mais s'est transformée, aujourd'hui moins hard et davantage rock'n'roll. L'orgue qui permet les mises en son mélodramatiques a disparu et la voix ample de Nicolas Garuana s'est tue. La première mouture de Sentinhell n'était pas désagréable même si perso mes préférences opteraient pour l'actuelle. Nous offrait un hard super maîtrisé. Pas du métal extrême mais une grosse production quasi-cinématographique. Super bien en place. Ne manque rien. Pas du carton pâte. Du carton rock. Drôlement bien fait. Toutes les instrumentations judicieusement calées. L'on ne pourrait lui reprocher que son manque d'originalité. Nous a fait penser aux deux premiers albums d'Uriah Heep, avec une plus grande amplitude sonore. Mais pour un premier disque il est demandé avant tout que l'on maîtrise pleinement le genre. Romantisme grandiloquent et surnaturalisme exacerbé. Et en ce sens le disque est parfait. Mais qu'un groupe puisse redéfinir ainsi ses positions esthétiques est avant tout la preuve bluffante de sa créativité. Ne nous reste plus qu'à attendre la venue du second album. Risque d'être brûlant. Cette fine équipe a toutes les chances de nous surprendre.
Damie Chad.
ANARCHIE AU ROYAUME-UNI
MON EQUIPEE SAUVAGE
DANS L'AUTRE ANGLETERRE
NICK COHN
( Editions de l'Olivier / Février 2000 )
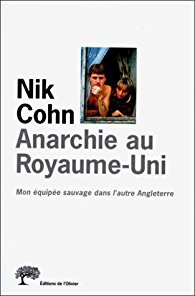
Désolé pour ceux qui aiment étiqueter les partis politiques, ce livre n'est pas le bottin des groupuscules anarchistes rangés par ordre alphabétique. Pas non plus un relevé des fiches de police des militants d'extrême-gauche repérés par les renseignements généraux de sa très gracieuse majesté ( yes, she's just a fascit pig ! ). L'est vrai que le terme anarchiste attire le client. Les éditeurs n'ont pas su résister. D'autant plus regrettable que le bouquin est remarquablement traduit en langue françoise par Elisabeth Peellaert. Le titre original, s'il n'est pas plus explicite, ne se permet aucune référence à la mouvance libertaire. Yes, We Have No.
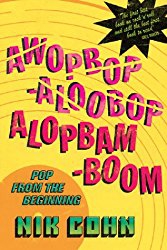
Pour Nick Cohn nous abrègerons les présentations. Il nous suffira de mentionner deux de ses ouvrages précédemment parus en France pour que le déclic s'opère dans le cerveau fatigué des lecteurs de KR'TNT ! L'est l'auteur de « Awopbopaloobop alopbamboom, l'Âge d'Or du Rock », et des légendes votives du rock and roll inscrites au bas des plus belles représentations iconographiques - jamais réalisées et réunies dans le volume de Rock Dreams - dues au pinceau de Guy Peellaert qui fut le compagnon d'Elisabeth la traductrice.
Je vous épargne une deuxième fausse route. Non ce n'est pas non plus un ouvrage super pointu sur des groupes inconnus de la perfide Albion dont vous n'auriez jamais entendu parler, mais puisque c'est Nick Cohn qui officie, confiance absolue, l'on se tait et l'on prend des notes. Niveau rock, c'est un peu vache maigre, en monopolisant une armée de détectives vous parviendrez à isoler une ou deux fois les noms Beatles et Rolling Stones, mais jetés là un peu au hasard, et encore peut-être est-ce mon imagination qui les rajoute quasi-pavlovniennement sur le paquet cadeau. A part cinq lignes dévolues à un ancien guitariste de Napalm Death ( ouf, on a parlé du groupe voici deux semaines ! ) qui s'adonnerait à la production de musique concrète, vous n'aurez pas grand chose à vous caler dans le creux de l'oreille droite.
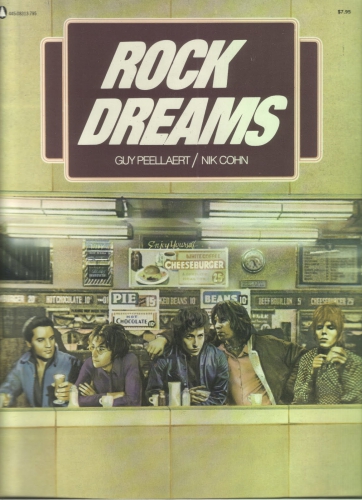
Le sous-titre ne vous avancera guère. Equipée sauvage, certes par deux fois l'on croise des bikers mais pour les chevauchées à fond la caisse sur les routes du Sussex, vous pouvez vous la sucer grave. Ce qui est sûr, nous sommes bien au Royaume-Uni, toutefois hâtez-vous de biffer les deux mentions inutiles : Royaume et Uni.
En fait nous sommes en République, et vraiment désunie, totalement séparée. Pas tout à fait un territoire. N'existe pas sur la carte. Aucune frontière ne la circonscrit. Ou vous en faites partie, ou vous n'en êtes pas. Pas besoin de remplir des formulaires pour recevoir sa carte d'identité. Je ne vous résume point un roman d'anticipation uchronique. Encore que dans quelques années - cinq, six, voire deux ou trois de moins avec un semblant de chance - et la France a toutes les malchances de suivre le mouvement. C'est que l'Angleterre a été pionnière. Par la faute de Maggie. Rien à voir avec la Marguerite du mois de May des mandolines de Rod Stewart sur Every Picture Tells a Story. Celle-là, l'est beaucoup plus méchante, une demoiselle de fer qui a broyé les classes populaires et moyennes d'Angleterre. Thatcher, la jument de Troie du libéralisme européen.
L'a fini par crever de sa sale mort. L'on n'en causera plus. Reste les conséquences de sa politique. Pas joyeuses. Un champ de ruines – et cette expression n'est pas une métaphore mais la description objective d'une sordide réalité - et des franges entières de la population abandonnée dans la misère la plus noire.
En soins hospitaliers pour trouver la chair saine, l'est nécessaire de casser la croûte afin de libérer le pus. Ne détournez pas les yeux. La pourriture n'est pas belle à voir et pue du cul. L'homme est un animal doué de déraison. Attaqué il se défend en attaquant ceux qui sont dans une situation identique à la sienne. Les skinheads ne font que passer dans ce bouquin mais Nick Cohn en montre l'autre face, celle que le roman de John King ( voir notre chronique de Skinheads in KR'TNT ! 296 du 29 / 09 / 16 ) occultait quelque peu, cette violence, ces coups de pieds et de poings, ces tabassages qui vous déglinguent le squelette et les organes, distribués sans compter à tout individu un peu trop brun de peau. Attention les policiers censés vous protéger usent des mêmes méthodes, même sauvagerie mais administrée avec moins de coups de pieds mais avec davantage de matraques. Dans la série varions les plaisirs tous en coeur, visent moins les parties génitales mais vous fendent l'occiput.
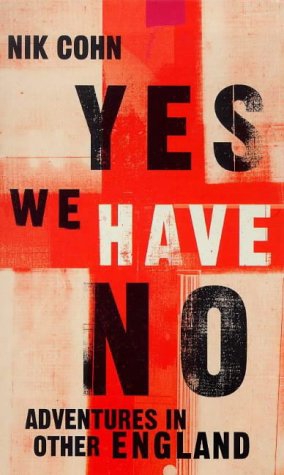
No regrets. Soit vous mourez, soit vous survivez. Les survivants forment cette République pétulante que Nick Cohen décide d'explorer. Voyage non pas au bout de l'horreur mais après le bout de l'horreur. Nous fait visiter des villes célèbres, les banlieues de Londres, Newcastle, Manchester, Bradford, et bien d'autres. Les a parfois traversées et connues dans sa jeunesse. Ne les reconnaît plus. Là où s'étendaient zones industrielles et quartier ouvriers ne restent plus que des ruines, des murs écroulés, des toits effondrés, des cheminées éteintes. Un paysage de désolation. Sur des hectares et des hectares. Y eut un temps où certains de ces bâtiments furent squattés mais ces années de loyers gratuits sont en train de disparaître. La police déloge les squatteurs sans pitié, les rejette à la rue sans état d'âme.
Les industries ont été délocalisées. La main d'oeuvre n'est plus bonne à rien. L'Etat et les élites ont abandonné le peuple. Bye bye la fierté prolétaire. Les syndicats ont eu les reins brisés. Ceux qui se sont faits tout petits en espérant qu'on leur saurait gré de ne pas avoir cédé à la colère, à la confrontation physique avec la milice policière, ont subi les conséquences de la défaite des braves qui avaient osé résisté, et à qui il a manqué la force d'appoint représentée par les lâches qui n'eurent pas l'intelligence tactique de les rejoindre. Maintenant il est trop tard. C'est même de l'histoire ancienne.
No future. Aucun avenir pour les gamins de prolos sans travail. S'ennuient, errent désoeuvrés dans les rues. Les gangs, les trafics de toutes sortes se mêlent et s'entrechoquent. Rien n'est certain. Rien ne dure. Une nouvelle idéologie du plaisir est née sur ces brutaux paradigmes. L'éthique collégiale n'existe plus. Les groupes qui se forment ne sont plus d'essence protectrice mais prédatrice. Vivre vite et jouir tout de suite. Le sexe et l'argent. La prison si tu tombes, ce n'est pas un malheur. Si tu prends des risques, ne t'étonne pas d'en payer les conséquences.
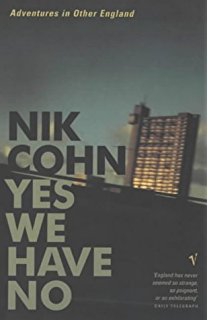
Une fois que tu as compris, une fois que tu as intégré les règles du jeu, se produit chez beaucoup une métamorphose intellectuelle. Les temps sont durs, mais ils te permettent d'exercer le monopole de ta liberté individuelle. Ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus libre. Nick Cohen ne pleure pas sur les malheurs des pauvres, nous peint une série de rencontres avec des hommes et des femmes extraordinaires. Ne détiennent aucun savoir ésotérique mais ils vivent un bonheur au-delà du déraisonnable. Le Système ne veut plus d'eux, ils s'ingénient à vivre sans. Créent leurs réseaux de survie individuelle et collective. Parfois sont un peu frappés de la cafetière, mais leur délire est des plus rationnels. Ne luttent même plus. Utilisent tous les interstices et le jour où ceux-ci sont obstrués ils ne se désolent pas, partent ailleurs. Des adeptes de la flexibilité d'un nouveau genre. Celle qui vous permet d'éviter le travail et l'exploitation.
La grande union qui s'étend des vieux hippies rescapés des premières célébrations du solstice d'été de Stonehenge durement réprimées par la police dans les années 80 aux communautés de pakistanais proto-islamistes en passant par les bikers, une étrange galaxie disparate est en train de se regrouper. Des extrêmes qui s'attirent et se repoussent mais qui ont compris qu'une certaine entraide festive n'est pas inopérante... Et dieu dans tout ça ? Plus présents que jamais. Des sectes comme s'il en pleuvait. Des suprématistes blancs affiliés aux cultes nordiques, des groupements de sorcières, des partisans du sado-masochisme, des églises protestantes dévoyées, il y en a pour tous les goûts. Toujours les mêmes schémas d'adhésion. J'ai fait toutes les conneries possible et imaginables durant toute ma jeunesse, maintenant j'ai pris de l'âge, j'ai réfléchi, j'ai d'autres résolutions... Un schéma mental que vous retrouvez chez presque toutes les personnes interrogées par notre auteur. L'est un moment où devant la réponse de plus en plus violente du Système lors de leurs primes révoltes, elles éprouvent la nécessité d'un réajustement de leurs conduites. Ne se rangent pas des voitures mais tentent d'entrevoir des modalités d'attitude plus positives non pas sous forme d'accommodements avec la réalité sociale mais selon une articulation plus efficace de leur propre vécu avec une espèce de situationnisme individuel en accord avec leurs désirs les plus profonds.
Ce livre commence à dater. L'est un témoin de la déflagration que subit la société anglaise dans le dernier quart du vingtième siècle. J'ai bien peur que ces quinze dernières années la situation ne se soit guère améliorée... Le pire c'est qu'il sonne comme un avertissement...
Damie Chad.
SOUDAIN, L'ETE DERNIER
JOSEPH L. MANKIEWIZC
( Film / 1959 )

Faut de sacrés arguments pour m'emmener au cinéma. Je ne suis que modérément sensible aux images mouvantes. Pas d'erreur si je me mêle à la cinquantaine d'adeptes du ciné-club provinois, ce soir s'agit de Tennessee Williams, l'un de mes écrivains préférés. Une adaptation d'une des pièces les plus fortes de notre dramaturge. N'est pas venu seul, l'a emmené pour parfaire le scénario son meilleur ami. Gore Vidal, que l'on oublie trop souvent de citer parmi les meilleurs plumitifs américains. L'a commis quelques sacrilèges. Tennessee a tiré un peu fort sur le zizi de la prude Amérique, mais Vidal a laissé échapper deux ouvrages scandaleux dont on ne cause jamais, et pour cause ! Une bio de Julien l'apostat et une espèce de road movie burlesque au travers de L'Empire Romain avec Saint Paul dans le rôle principal, qui reste à mes yeux la plus violente attaque contre le christianisme jamais écrite. Nous français qui sommes si fiers d'être citoyens du pays aux mille fromages, que sommes-nous face au pays aux cent mille Eglises ! Vous comprenez pourquoi le Nobel ne lui a jamais été décerné. Entre parenthèses, lui non plus n'en avait pas besoin.

Le film n'a pas la force de la pièce. Si vous devez choisir entre les deux, n'optez que pour la pellicule que si vous désirez une happy end, avec un beau bisou d'amour tout tendrou. Comporte de belles scènes, les deux plongées dans les culs de basse-fosses de l'asile des lunatiques. Mais le meilleur, c'est surtout le début. Du théâtre pur. La caméra en plans fixes et Katharine Hepburn qui nous fait son numéro de milliardaire givrée, désespérée d'avoir perdu son fils chéri. Face à elle Elizabeth Taylor ne fait pas le poids. Tant et si bien que lorsque arrive son tour, les mots qui sortent de sa bouche ne se suffisent plus à eux-mêmes, l'on pose sa tête en surimpression sur les scènes qu'elle raconte. L'on prend aussi un peu ( beaucoup ) le spectateur pour un imbécile : ne vous inquiétez pas, si par hasard vous ne comprenez pas, l'on a mis le dessin ( qui bouge ) à côté pour que vous puissiez suivre sans difficulté...
Par contre, pour ce qui est le noeud gordien de la pièce – celui qui ne verra aucun Alexandre le trancher d'un coup d'épée – Gore Vidal et Tennessee Williams ont mis la pédale douce. Vous donnent les rudiments mais à vous de trouver la solution. Cela pourrait s'intituler sexe et poésie. La poésie conçue comme une maternité sans mère porteuse. Dans la mythologie grecque Héra déteste que son mari ait pu cacher en son corps de mâle sa fille Athéna avant de la mettre au monde d'une manière fracassante, tout seul, la faisant sortir tout droit de sa tête d'un unique coup de hache héphaïstonien, sans l'assistance d'un seul élément féminin ! D'autre part, c'est bien connu, ces êtres fragiles et romantiques que sont les poètes se révèlent être des pédés. Des pédérastes pour faire semblant de rester poli.
Ce scandale ne peut plus durer. Les Orphées de service finissent mal. D'habitude un quarteron de femelles enragées d'être sexuellement dédaignées passent à l'attaque. Se précipitent sur le malheureux et vous le découpent rondement en petits morceaux. C'est-là que Tennessee Williams pousse les mégères ensauvagées dans les orties. Nous n'avons plus besoin de vous, vous pouvez disposer, allez hop au placard !

Une histoire d'hommes vous répète-t-on. Ce sont eux qui se chargent de la besogne macabre. Totale émasculation par manipules virils. Tout rentre dans l'ordre. Tout un chacun peut reprendre son rôle. Faudra faire sans celui du poète. L'est le grand absent. Pas grave, nous reste ses poèmes. Dans le livre. Et dans le cinéma z'avez encore le film à déguster. Pas mauvais du tout. Avec Tennessee vous ne serez jamais déçus. Une âme rock and roll.
Damie Chad.





