28/04/2021
KR'TNT ! 508 : BADFINGER / COBRA VERDE / LOVE AS LAUGHTER / RITA ROSE / LEE O' NELL BLUES GANG / ACROSS THE DIVIDE / MICHEL EMBARECK / ERIC BURDON / ROCKAMBOLESQUES XXXI
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 508
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR'TNT KR'TNT
29 / 04 / 2021
|
BADFINGER / COBRA VERDE LOVE AS LAUGHTER / RITA ROSE LEE O' NELL BLUES GANG / ACROSS THE DIVIDE MICHEL EMBARECK / ERIC BURDON ROCKAMBOLESQUE XXXI |
TEXTE + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Badfinger in the nose
Tout le monde s’accorde à dire que l’histoire de Badfinger est une histoire tragique. En effet, deux pendus, ça vous plombe une histoire. C’est un peu comme si on passait brutalement du jardin magique (la musique) aux poubelles (les faits divers). La vie souriait pourtant à Badfinger. Elle lui souriait de ses trente-deux dents. Son avenir semblait assuré. Ces quatre surdoués savaient composer et les Beatles les chouchoutaient, au point de les signer sur Apple en 1970. Ils en imposaient sur les photos : ouvrez le gatefold de No Dice et vous les verrez rayonner tous les quatre dans la lumière orangée d’un crépuscule gallois. Le grand, derrière, c’est Pete Ham, ou si vous préférez Pete Jambon, dressé comme un phare dans la nuit et principal compositeur du groupe. Le petit rastaquouère, devant, c’est Tom Evans. Une vraie petite gueule de berger calabrais. Il joue de la basse et compose lui aussi pas mal de trucs. À gauche, le mec qui ne ressemble pas à grand chose, c’est Mike Gibbins, le batteur. Et de l’autre côté, la petite gueule de rock star évaporée appartient à Joey Molland, le guitariste et second phare dans la nuit de Badfinger. Alors qui sont les deux pendus ? Pete Jambon et le berger calabrais. On les a retrouvé tous deux pendus, le premier dans son garage, l’autre à un arbre parce qu’il n’avait pas de garage. Que s’est-il passé ? L’histoire classique du groupe à succès qui se fait arnaquer en bonne et due forme par un intermédiaire véreux. Homme d’affaires new-yorkais Stan Polley prend les Anglais sous contrat et ça donne le résultat suivant : une tournée américaine en 1971 rapporte environ 25 000 $ aux quatre musiciens et 75 000 $ à Stan. Ça, c’est du business ! Les plus malins diront : Ah, si les musiciens sont assez cons pour accepter ça, tant pis pour eux ! Mais dans la réalité, les choses ne sont jamais aussi simples qu’on le croit. Déjà, pour commencer, les musiciens ne voyaient pas la paperasse. Ils faisaient confiance. On fait toujours confiance à un spécialiste. On fait même confiance à un comptable.
Le résultat ne se fait pas attendre : les quatre Badfinger n’ont pas un rond alors qu’ils voient leurs singles parader en tête des charts. Pete Jambon se demande comment il va pouvoir rembourser l’emprunt qu’il a contracté pour s’acheter sa baraque. Il finit par se convaincre qu’il n’y parviendra pas. Il flippe tellement qu’il se pend. Dans sa lettre d’adieu, Pete Jambon traite Polley de bâtard. Le berger calabrais finira lui aussi par craquer, huit ans plus tard, suite à une engueulade téléphonique avec Joey.
Dans un récent numéro de Record Collector, Bill Kopp rend hommage à ce groupe décimé par le destin. Kopp rappelle que le nom du groupe provient du working title d’un célèbre cut des Beatles : «With A Little Help From My Friends» s’appelait au début «Badfinger Boogie». C’est McCartney qui leur compose leur premier hit («Come And Get It»), mais très vite Pete Jambon montre qu’il sait lui aussi pondre des œufs. Les quatre Badfinger sont tellement potes avec les Beatles qu’ils sont invités à jouer sur les albums solo de Ringo, de John Lennon (Imagine) et de George Harrison (All Things Must Pass).
Les interviews de Joey Molland menés par Michael Cimino et rassemblés dans Badfinger And Beyond apportent un bel éclairage sur l’histoire de ce groupe qui faillit bien devenir énorme. Indépendamment du fait que George Harrison les avait à la bonne au point de les signer sur Apple, il est important de savoir que Pete Jambon et le berger calabrais étaient gallois, alors que Joey Molland venait de Liverpool et qu’à l’époque où il rejoignit Badfinger, il pouvait déjà se targuer d’un joli parcours. Eh oui, Joey avait connu la mythique Cavern - The Cavern was probably the best Rock club there ever was - Il évoque Rory Storm, Gerry & the Pacemakers et bien sûr les Beatles - The sound was punchy and hard - Il évoque aussi The Big Three, avec le batteur Johnny Hutchinson au chant, Johnny Gustafson à la basse et Brian Griffith à la guitare. Joey était tellement fasciné par Grif qu’il se rendit chez lui, tapa à la porte et lui demanda de lui apprendre à jouer de la guitare, mais Grif lui dit non. Pourquoi ? «Parce que je ne sais pas jouer de la guitare !». On raconte pourtant que Grif a formé George Harrison. Joey raconte aussi son enfance à Liverpool. Chez lui, il y avait un piano, comme dit-il dans toutes les maisons à l’époque. Il rend hommage à son père qui lui enseigna la patience et qui l’autorisa à commettre des erreurs pour apprendre. Il rappelle aussi que le Liverpool de son enfance était une ville très dure, il fallait apprendre à courir vite. Les gangs régnaient dans les quartiers et on se battait à coups de marteau. Et puis on découvre au fil des pages que Joey est un mec charmant. Richard DiLello dit de lui qu’il était toujours de bonne humeur - a Liverpudlian rocker who never seemed to have a bad day - On voit à sa bouille qu’il est à part. Joey fit aussi partie d’un groupe mythique, Gary Walker & The Rain. C’est Gary Leeds, alias Gary Walker, qui lui enseigne le cool - Gary was a very cool guy and he wanted the people around him to be cool. To look cool and to be cool - Le groupe s’installe à Chelsea et Joey n’en revient pas de vivre avec une giant rock star. C’est là dans les clubs du Swinging London qu’il commence à fréquenter la crème de la crème du gratin dauphinois. En 1967, il a vingt ans. Tout le monde portait des futals en mohair et des pulls à col roulé. Le moindre détail avait son importance. Il rappelle que les Londoniens voulaient tous aller en Allemagne, car c’est là qu’on trouvait les meilleures écharpes et les plus beaux cols roulés.
L’histoire de Badfinger remonte au temps où les Beatles cherchaient de nouveaux talents pour leur label Apple. George Harrison avait déjà ramené chez Apple Jackie Lomax, lui aussi de Liverpool, Doris Troy et le clavier de Little Richard, Billy Preston. C’est Mal Evans qui déniche the Iveys, le groupe qui accompagne David Garrick. C’est dans ce groupe que se trouvent les trois autres Badfinger. Avec Joey en complément, le groupe trouve un son. Chez Apple, Joey voit bien sûr Allen Klein et ne l’aime pas beaucoup. Il garde par contre des bons souvenirs de l’enregistrement d’All Things Must Pass, auquel George Harrison leur demande de participer. Parmi les stars qui traînaient au studio 3 d’Abbey Road, il y avait Ringo, Klaus Voorman, Bobby Whitlock, Carl Radle, Leon Russell et bien sûr Phil Spector.
Alors, la réputation de Badfinger est-elle surfaite ? Pour répondre à la question, le mieux est d’écouter les albums. Ce n’est pas une expérience désagréable. Au temps de leur parution, ces albums ne laissaient pas indifférent, même si pour les gueules à fuel le son paraissait un peu trop poppy. Par contre, les obsédés sexuels pouvaient se branler sur la pochette de No Dice. Une fois dépliée, on y voyait une splendide créature au regard torve s’exhiber dans un costume de courtisane orientale. Elle dégageait cet érotisme littéraire à la Pierre Louÿs qui au temps jadis réveillait aisément les bas instincts. S’il l’avait aperçu en vitrine, Baudelaire aurait de toute évidence acheté l’album rien que pour la pochette. Sans doute l’aurait-il ensuite écouté. Sans doute aurait-il succombé au charme de «Love Me Do», cette solide machination inspirée de «The Ballad Of John And Yoko». Sans doute aurait-il salivé à l’écoute de «No Matter What», cette pièce scintillante et pleine de vie, en qui tout est, comme en un ange, aussi subtil qu’harmonieux. Sans doute se serait-il réjoui d’apprendre que Pete Jambon jouait sur la Gibson SG utilisée pour «Paperback Writer», une guitare que lui avait offert George Harrison, et Joey Molland sur sa Firebird de débutant, tous les deux branchés sur des Vox AC30. Sans doute se serait-il agacé de ce «Without You» connu comme l’albatros, cette mélopée torride et bêtement romantique qui, bien que popularisée par Nilsson, ne pouvait plaire qu’aux Belges et à Mariah Carey. Sans doute aurait-il levé un sourcil à l’écoute du jeu byzantin de Joey Molland dans «Better Days», sans doute se serait-il rapproché pour mieux entendre couler cette rivière de diamants dans la texture même du son. Ah, mais ne nous méprenons pas, Baudelaire n’est pas Des Esseintes, il n’ira pas jusqu’à l’évanouissement. Intrigué par tant d’allure, il aura sans doute poursuivi l’examen et découvert que Joey Molland hantait à nouveau un autre château d’Écosse, «Watford John». Comment pouvait-on résister à ce succédané d’élévation spirituelle, à cette touche démiurgicale d’éclat lunaire ? Baudelaire en convenait, c’était impossible. Agité d’une fièvre de curiosité, il aura sans doute poussé jusqu’à «Believe Me», étrangeté chantée d’une petite voix funeste, mais gonflée comme une voile de démesure ancillaire. On ne saura jamais ce que Baudelaire aurait pensé de tout ceci, mais il plaît aux esprits fantasques de l’imaginer.
Dans le cours de ses interviews avec l’ami Cimino, Joey Molland rappelle que No Dice fut enregistré sur du temps libre de studio à Abbey Road, à raison de trois heures par jour, au moment où le groupe qui louait le studio allait déjeuner. Une chanson par jour pendant dix ou douze jours.
La pochette de Magic Christian Music paru sur Apple Records en 1970 nous renvoie tous non pas au vestiaire, mais chez Giorgio De Chirico, ce peintre des architectures somnolentes annexé par les Surréalistes dans les années vingt. Mais nos amis de Badfinger n’ont rien de particulièrement surréaliste. Ils optent pour une petite pop inoffensive et relativement bien intentionnée, au plan des harmonies vocales. Le cut qui sort du lot s’appelle «Dear Angie», un groove de Beatlemania dûment violonné, doux et brillant, admirablement travaillé au corps. Et puis au fil des cuts, une certaine forme de solidité s’impose, digne du meilleur cru albionnesque. On s’effare même du très beau niveau composital de «Beautiful And Blue». C’est une pop qui se tient, une matière chamarrée, nappée de violons et anoblie par l’ampleur des harmonies vocales. Ils frisent la Slademania avec les mah-mah de «Rock Of All Ages». Encore de jolies choses en B, notamment «I’m In Love», un bel exercice de style tapé au drive de basse bondissant. Voilà un cut à la fois convaincu et convaincant, qui flirte avec les progressions de jazz. On est à Liverpool, ne l’oublions pas. Pete Jambon nous chante «Walk Out In The Rain» au fil ténu de sa sensiblerie et «Knocking Down Our Home» flirte avec l’esprit de «Martha My Dear», un esprit généreux et légèrement rétro. C’est à peu près tout ce qu’on peut en dire.
On les voit tous les quatre poser pour la pochette de Straight Up paru un an plus tard. Ce sont les coiffures rococo de l’époque. Le seul des quatre qui sache rester intemporel est Joey Molland, à gauche. Pete Jambon affiche l’air perplexe d’une tête de broc et Tom Evans celle d’une tête de coiffeur pour dames. Todd Rundgren produit quelques cuts et George Harrison d’autres. Deux des cut produits par Todd Rundgren vont éclater au grand jour : «Flying» et «Sometimes» qui est en B. On le sait, Rundgren est un fan des Beatles et comme les quatre Fingers jouent comme des dieux, ça prend une tournure captivante. Les deux cuts sonnent littéralement comme des hits des Beatles. C’est aussi simple que ça. George Harrison passe un solo sur «Day After Day». On note aussi la présence de Leon Russell - Little piano fill. That’s how great those people are, nous dit Joey Molland dans l’une de ses interviews. Tiens, encore un hit digne des Beatles : «Suitcase», doté d’une fantastique émotivité - Pusher pusher/ All alone - Avec «Baby Blue», ils proposent un hit de power-pop et Joey Molland se tape une fois encore la part du lion en déliant un solo magistral. Mais il précise qu’il n’aime pas Todd Rundgren. Pourquoi ? Parce qu’en studio, Rundgren les insulte et leur dit qu’ils ne savent pas jouer - He was openly rude - Il n’a accepté de produire cet album que pour ramasser du blé. Ça se passe mieux avec George Harrison. C’est lui qui joue le Strat stuff sur «I Die Babe» - You make me loving like crazy/ You make my daisy grow high - On entend Nicky Hopkins sur «Name Of The Game». C’est assez puissant car la musicalité est celle d’All Things Must Pass.
Comme ce fut le cas pour la plupart des groupes qui commençaient à marcher à cette époque, le business leur mettait la pression : «Make a hit record !». Ça devint une obsession pour le berger calabrais et Pete Jambon. Ça les rendait fous - Tommy drove himself crazy trying to make a hit record, absolutely crazy - Pete Jambon n’a jamais réussi à écrire un hit, ça le rendait fou, lui aussi. Plus on lui mettait la pression, plus il devenait fou. Il finira par détruire sa guitare préférée.
La carotte qu’on voit sur la pochette d’Ass est une idée du berger calabrais. C’est la fameuse carotte de Magritte (Ceci N’est Pas Une Carotte) qu’on utilisait jadis pour symboliser la motivation, lorsqu’on menait une opération de communication interne dans une grande entreprise. Ass pourrait aussi vouloir dire : tu l’as dans le cul. Il y avait du ressentiment dans les rangs de Badfinger. Ceci dit, Ass reste un très bel album de pop anglaise. Cette pop d’Apple qui jadis nous faisait tant baver. Dès «Apple Of My Eyes», on se retrouve au cœur du Apple Sound System : admirable facture mélodique et Chris Thomas produit, alors, ça fait encore plus la différence. Le hit du disk ouvre le bal de la B et s’appelle «Constitution». Ils sonnent là-dessus comme les Beatles du White Album. Joey Molland signe cette imparable resucée beatlemaniaque. «Icicles» sonne comme un hit de George Harrison, avec un fabuleux son de guitare océanique. Quel cachet ! On trouve aussi sur Ass deux cuts produits par Todd Rundgren et tirés des sessions de l’album précédent, à commencer par «The Winner», qui se veut plus rocky, avec une belle approche du son carré. Alors là, on peut dire qu’ils savent monter un œuf de pop en neige du Kilimandjaro ! Joey Molland explique que sa chanson concerne John Lennon qui passait à son temps à se plaindre de tout. Et quand on écoute «Blind Owl», on se dit qu’on n’en attendait pas moins de Badfinger. Pete Jambon nous entortille ça au riff de guitare virtuose et on voit ces quatre mecs s’auto-émerveiller par tant de brio. Ils éclatent tellement au grand jour que ce spectacle fait plaisir à voir. L’autre cut produit par Rundgren s’appelle «I Can Love You», un immense balladif à prétention romantico-universaliste. Ils savent s’en donner les moyens, c’est vraiment le moins qu’on puisse en dire. Ils savent mailler les moyeux et mouiller les maillets. Au fond, la présence de Rundgren dans les parages n’étonnera personne quand on sait à quel point il vénère lui aussi les Beatles. Il suffit d’écouter les trois albums de Nazz. Et puis nos vaillants héros tragiques bouclent l’Ass avec un «Timeless» extrêmement joué à la guitare. Joey Molland joue au gras tout au long de ce balladif typiquement britannique, il sort ce bon gras spécifique de la panacée, il fait vraiment le show et son solo compte parmi les merveilles du rock anglais. On le voit revenir par vagues, inlassablement, pareil à l’océan hugolien - Ces enfers et ces paradis de l’immensité éternellement émue.
Jolie pochette que celle de ce Badfinger paru en 1974 sur Warner Bros. Eh oui, l’empire Apple s’est écroulé et le vieux label américain, flairant la bonne affaire, les accueille à son bord. Nos héros tragiques ne prennent pas de risques, puisque Chris Thomas veille au grain. «Love Is Easy» sonne comme un hit. On y va les yeux fermés. Ils ramènent tout le bon son dont ils sont capables, d’autant que ça bat bien au devant du mix. Et bien sûr, Joey Molland fait à nouveau des merveilles. En B, on se régalera du r’n’b Mod pop action de «Matted Spam», et plus loin de «Lonely You», une belle pop anglaise soutenue par des harmonies vocales de premier choix et un jeu de guitare bien tempéré. Mais le hit de l’album pourrait bien être «Give It Up», un jaillissement de belle pop immaculée dûment monté en apothéose. Une vraie réussite, tant au plan atmosphérique qu’affectif, parsemée de très beaux éclats de guitare. Nos quatre héros tragiques portent le poids du monde sur leurs épaules et se montrent capables de sacrés coups de Jarnac.
Il semble que le soufflé retombe un peu avec Wish You Were Here paru la même année. Deux cuts sauvent l’album, à commencer par l’excellent «Just A Chance», nouveau coup de pop de grande ampleur, cuivré et chanté à pleine voix. On sent la patte des vieux briscards de la pop. Mais on sent aussi chez eux une tendance à s’endormir sur leurs lauriers, car cette pop devient souvent très pépère. «Know One Knows» se laisse consommer tranquillement. On appelle ça de la petite pop sans histoires. Le «Love Time» qui se planque de l’autre côté sonnerait presque comme un hit, car ce balladif se prévaut d’une élégance suprême. On croirait presque entendre «Across The Universe». Mais il faut attendre «Meanwhile Back At The Ranch» pour enfin trouver chaussure à son pied. Voilà encore de la belle pop à la Lennon, on sent frémir le son d’une belle détermination. Ce cut visité par l’esprit du White Album, indéniablement. Avec les Buffalo Killers et Ty Segall, ils sont sans doute les seuls capables de jouer à ce petit jeu-là.
Joey quitte le groupe en 1974, complètement ruiné. Il perd sa maison à Londres et se retrouve dans un minuscule appart à Golden Green, Lyons avenue. Pete Jambon est mort et Joey se rend à ses funérailles au pays de Galles. Sa famille dit-il était détruite. Ils le croyaient à l’abri du besoin, comme n’importe quelle rock star et ne savaient pas qu’il en bavait et que la dépression due à sa pauvreté allait le pousser à finir pendu comme un paysan ardéchois.
Les voilà sur Elektra pour l’album Airwaves qui sort en 1979. Sur la pochette, on ne voit plus que Joey Molland et Tom Evans, les survivants. Tom Evans compose et chante énormément, mais il ne crée pas forcément la sensation. Joey pense que «Love Is Gonna Come At Last» est une great song et avoue que le riff est difficile à jouer. Mais si on veut de la viande, il faut aller la chercher en B, et ce dès «The Winner» et son festin d’harmonies vocales. Ça joue dans les règles de l’art fingerien et ce n’est pas Joey qui se tape la partie de lead, mais Joe Tansin. D’ailleurs Joey dit de Joe qu’il sait vraiment bien jouer. On retrouve Tansin au lead dans «The Dreamer». Joey dit que ça sonne comme une Ringo song, doesn’t it ? Les voix se fondent dans l’excellence des arrangements orchestraux. Quel fieffé mélodiste que ce Tansin. «Come Down Hard» sonne comme un hit d’entrée de jeu. Joe Tansin rôde dans les parages et perpétue bien l’esprit in the nose de Badfinger.
Tom Evans est encore vivant quand Badfinger enregistre Say No More en 1981. En bons vétérans de toutes les guerres, lui et Joey Molland s’adonnent aux joies du rock’n’roll dès «I Get You». C’est un très anglais et presque trop parfait. Leur «Come On» sonne comme du boogie rock à dents blanches. Le pire, c’est que cet album tient bien la route, même si Pete Jambon n’est plus là. «Hold On» s’orne d’un fil mélodique à l’or fin et «Because I Love You» renoue avec l’ampleur du souffle pop d’antan. C’est exactement ce qu’on attend de Badfinger : une pop cousue de fil d’or. On s’extasie aussi devant la belle tenue de «Rock’nRoll Contact», même si ça chante au guttural. Les retours au calme y fonctionnent comme des havres de paix et Joey Molland gratifie son cut d’un éblouissant final guitaristique. L’un dans l’autre, c’est un beau brin d’A. Il faut bien comprendre que ces mecs ne font pas n’importe quoi. Le «Passin’ Time» qui ouvre le bal de la B sonne incroyablement juste. C’est encore une pop très entreprenante, avec des parties chant gonflées d’énergie - I couldn’t believe it/ Oh no - Et ça accroche terriblement. Idem pour «Too Hung Up On You», chanté à l’Anglaise, c’est-à-dire à l’inspirette carabinée, dans le pur esprit pop, avec tout le répondant du palpité de glotte. Tout est incroyablement solide et bardé de son. Badfinger fait vraiment partie des élus de Palestine. Ils terminent cet album tonique avec «No More», une pop qui comble bien les vides, qui captive et qui nourrit bien son homme. Belle ambiance progressiste et même assez envoûtante. Joey Molland et le berger calabrais ultra-jouent leur va-tout en permanence.
La fin du groupe est moins glorieuse. Joey et le berger calabrais attendent une avance promise par le management. Comme l’argent ne vient pas, Joey refuse de commencer à travailler sur le prochain album. Il quitte le studio et annonce qu’il ne reviendra que si le blé est là. Puis il apprend que le berger calabrais et Tony Kaye continuent tous les deux en tant que Badfinger, annonçant à qui veut bien l’entendre que Joey a quitté le groupe. What ? Joey tente de joindre ses amis, mais personne ne prend ses appels. En désespoir de cause, Joey finit par former un autre Badfinger aux États-Unis. On a donc deux Badfinger en circulation qui finissent par enterrer la légende. C’est une fin d’histoire assez pitoyable.
La nuit où le berger calabrais va se pendre, il appelle Joey pour lui raconter ses déboires financiers. Il avait signé un contrat avec un certain John Cass et comme il n’avait pas honoré ce contrat, Cass lui collait un procès au cul pour plusieurs millions de dollars. Il se savait donc fait comme un rat. Au téléphone, il semblait nous dit Joey très détendu, mais il annonçait tout de même qu’il allait se foutre en l’air. Bien sûr, Joey n’en croyait pas un mot.
Signé : Cazengler, badfinger dans le cul
Badfinger. No Dice. Apple Records 1970
Badfinger. Magic Christian Music. Apple Records 1970
Badfinger. Straight Up. Apple Records 1971
Badfinger. Ass. Apple Records 1973
Badfinger. Badfinger. Warner Bros. Records 1974
Badfinger. Wish You Were Here. Warner Bros. Records 1974
Badfinger. Airwaves. Elektra 1979
Badfinger. Say No More. Radio Records 1981
Michael A. Cimino. Badfinger And Beyond. CreateSpace Independant Publishing 2011
Bill Kopp. Maybe Tomorrow. Record Collector #487 - Christmas 2018
La morsure du Cobra
Cobra Verbe et son chanteur John Petkovic sont probablement l’un des secrets les mieux gardés d’Amérique. Quand on parle de la scène de Cleveland, on mentionne généralement les Dead Boys et Pere Ubu, mais on oublie hélas Cobra Verde. Ce n’est pas la même époque, bien sûr, mais au niveau prestige, Cobra Verde vaut mille fois les Dead Boys. Six albums sont là pour le prouver. À commencer par l’excellent Viva La Muerte paru en 1994. C’est là que se niche «Montenegro» - Montenegro/ In your mountains of my worthlessness - Fabuleux balladif infectueux, hit en forme de puissant sortilège. Petko mène bien sa barque vers l’autre rive du Styx de l’underground. On trouve plus loin «Debt» qui sonne un peu pareil, avec un bel aperçu sur les abysses - She’s a suicide/ And I’m a cyanide/ Look at us die/ She cries I’m blind - Effarant ! Toutes les puissances des ténèbres se pressent dans le corridor - So in debt/ The days I’ve blown away - John Petkovic est l’un des grands auteurs américains. Même trempe que Mark Lanegan ou Greg Dulli. «Despair» sonne comme une vraie stoogerie clevelandaise. Tout est là, même les clap-hands. Son Awite est stoogy en diable et c’est claqué aux accords de Detroit. Petko jette de l’huile sur le feu, il chante son all the way to the bank à l’arrache impétueuse. Attention aussi au «Was It Good» d’ouverture de bal, car ça joue au funk clevelandais, avec de grosses dynamiques et une basse métallique, invendable mais si présentable. Cet album spectaculairement artistique se termine avec une sacrée doublette : «I Thought You Knew (What Pleasure Was)» et «Cease To Exist». Le premier reste très Velvet d’aspect. Petko vise l’explosion du bouquet final - Don’t make me wait - C’est exemplaire. Il va au bout du wait - I don’t wanna wait in the valley of kings - Puis il taille son Cease dans une matière d’apothéose, c’est très écrit, pulsé à l’ultraïque - I am the richess/ You are the pain/ I’ll never see you ever again - Voilà ce que les historiens appelleront dans 150 ans un classic album.
C’est dans la presse rock américaine de type Spin que paraissaient les rares articles sur Cobra Verde, des textes plutôt bien foutus qui bien sûr mettaient l’eau à la bouche. Le journaliste qui les suivait en faisait une sorte de légende underground et Viva La Muerte répondit bien aux attentes. Cobra Verde devint comme les Saints l’un des groupes à suivre de près.
On retrouve les big atmospherix petkoviens sur Egomania (Love Songs) paru trois ans plus tard. Dès «Everything To You», on retrouve le charme toxique de «Montenegro». Beaucoup d’allure et gros impact - What else could I do but leave everything to you ? - Il lui laisse tout. Pekto a cette générosité, celle du big atmospherix, du larger than life, c’est tellement bardé de son, my son, il va même jusqu’à exploser les annales de sa rafale. S’ensuit un «A Story I Can Sell» battu à la vie à la mort et tout aussi dévastateur - I lost my pride/ I lost myself - On note l’indéniable power du Cobra Sound. Il s’adresse à des chicks from Babylon. Il chante tous ses cuts à la pire intensité de l’incandescence. Avec «Leather», Petko s’énerve - Born in different dreams/ Every stranger is an enemy - Il taille son rock dans la falaise, porté par un gros drive de basse - Same bed/ Different dreams - Ce mec est atrocement doué. Tiens, encore deux passages obligés : «Blood On The Moon» et «For My Woman». Avec Blood, il tape dans le heavy balladif captivant, atmospherix en diable, sacrément bien senti, bien foutu, bien ficelé, bien gaulé, tout tient par la présence de cette voix ultraïque. Même chose avec Woman, Petko fait son cro-magnon - I need to be your man - Quelle clameur ! - Yeah I’m gonna understand - Solide, punkoïde as the fuck of hell, solo de rêve, rond et flashy - You know I love you woman/ More than the world - C’est la réponse du Cobra au défi du love affair de deep end.
Backseat, champagne et poules pour la pochette du Nightlife paru en 1999. Une fois de plus, on se retrouve avec un très gros album dans les pattes. On le sent dès cette puissante démiurgerie clevelandaise qu’est «One Step Away From Myself». Ils nous bardent ça de son, nous cisaillent tout au riffing et il faut voir comme ça descend sur le manche de basse. En gros, ça dégueule de son. Il semble que Cobra Verde crée la sensation sans même le vouloir. Ils sortent un «Conflict» travaillé au corps défendant, bâti par des charpentiers de marine. Et puis soudain, on tombe sur le furieux et glorieux «Crashing In A Plane» - Baby I’m a detour - Petko ressort son meilleur guttural montenegrain - Baby I’m the dustbin - Il envoie ça à l’outrance princière, avec toute la bravado dont il est capable et le sax s’en vient rallumer les brasiers du Shotgun de Junior Walker. Véritable coup de génie que ce «Don’t Let Me Love You», véritable hit d’insistance parabolique - My baby’s desperation/ Is driving me insane - Il faut le voir touiller sa fournaise, c’est absolument faramineux de menace sous-jacente, effarant d’inventivité du glauque. Il n’en finit plus d’allumer les plus bas instincts du rock, il chante à la voix d’orfraie, porté par un sax de free en perdition mentale. Il reste encore une énormité sur cet album : «Don’t Burden Me With Dreams» qui sonne comme une délivrance catatonique, Petko charge en tête du Cobra, il chante à la vie à la mort avec toutes les foisons du monde. Il tape aussi «Casino» aux gros climats d’extrême violence, il s’en va laper du sang dans le creux des mains. Bel exploit aussi que cet «Heaven In The Gutter» tapé à la basse métallique. Ces mecs n’offrent que des solutions extravagantes, il faut le savoir. Joli coup aussi que ce «Back To Venus», ça joue au heavy groove de guitar slinger. Encore un cut que les Stones auraient sans doute rêvé de jouer.
Après cette fantastique triplette, trois membres originaux disparaissent : Don Depew, Dave Swanson et Goug Gillard. Frank Vazzano (guitar), Mark Klein (drums) et Ed Sotelo (bass) les remplacent pour enregistrer cet album effarant qu’est Easy Listening. Trop de son, sans doute. Trop écrit. Trop chanté. Comme le furent les grands albums des Pixies et des Saints. Un cut comme «Whores» frappe par la violence du volontariat. Petko explose la comète - I don’t care cause I got away - Ça explose des deux côtés, par le chant et par le son. Même chose pour «Terrosist» amené aux riffs de non-retour, Petko chante à la glotte en fer, c’est sa force. Back to the big atmospherix avec «The Speed Of Dreams». On a l’impression de voir cette merveille s’écrouler dans la mer comme une falaise de marbre. Ça tombe dans la bascule de l’énormité rien qu’au son du chant - I can’t remember how it is/ You disappeared - Avec «Riot Industry», il fait du rentre-dedans clevelandais. Ça se situe vraiment un cran au dessus du reste. Petko fait régner la terreur de son génie sur le rock américain. Il emmène très vite «Til Sunrise» dans l’enfer clevelandais et jette des lyrics de «Hosanna To Your Pretty Face» au ciel. On trouve un peu de Bowie en Petko, justement dans cette façon de jeter au ciel. Même genre de puissance. Cobra Verde est une vraie usine à tubes. Ils jouent «My Name Is Nobody» au surjeu et traînent leur «Mortified Frankenstein» dans un anglicisme à la Led Zep. Fantastique energy of surgery, fantastique shake up de yeah yeah yeah. Avec «Throw It Away», Petko retrouve son titre de champion du monde du Big Atmospherix - Raise a glass to the dead and gone - Et back to the big Cobra Sound avec «Here Comes Nothing», bardé de relents de Montenegro et forcément ça vire à l’énormité, wow, cette façon qu’il a de swinger et de crawler sous le boisseau du Cleveland Sound of steel, il embarque tout au chant comme dans «Debt».
Nouveau point commun entre Petko et Bowie : l’album de reprises réussi. Oui, car Copycat Killers est aussi brillant, aussi viscéralement bon que Pinups. Petko tape un peu dans les silver sixties, comme Bowie, avec l’«I Want You» des Troggs, qu’il transfigure au stomp de Cleveland, c’est l’une des plus belles versions jamais enregistrées, alone on my own. Quel fantastique écraseur de mégots que ce Petko, il fait son Reg du midwest, c’est punk jusqu’à l’os et il faut voir le départ en solo clevelandais, la torchère devient folle et éclaire la nuit comme un phare breton. Son prophétique, apocalypse démesurée, le solo place le Cobra au panthéon des crève-cœurs. Ils tapent aussi dans le «Play With Fire» des Stones. On s’étonnera toujours de la fascination des Américains pour la Stonesy de série B. Jolie reprise du «Yesterday’s Numbers» des Groovies. Petko veille à chanter à la Roy Loney. Eh oui. Ça donne une petite merveille d’absolutisme absolu. On les voit aussi taper dans un cut de New Order qui s’appelle «Temptation», qu’ils transforment en bête de somme. Petko tord le bras à la new wave pour lui faire pleurer des larmes de sang. Même traitement infligé à Donna Summer et à son hit diskö «I Feel Love». Petko et ses amis transforment ça en shoot de furie clevelandaise. Ah il faut voir le travail ! Quelle admirable incursion dans la pétaudière du dance-floor ! Autre coup de Jarnac : le fameux «Urban Guelilla» d’Hawkwind, ce hit qui rendit Lemmy tellement furieux car il fut censuré sur la BBC. Le Cobra nous claque ça à la volée, ils redonnent vie au vieux coucou d’Hawk, ils le gavent de toute la niaque du monde et développent une puissance de marteau-pilon. C’est embouti à la vapeur. Ils vont loin, bien au-delà du Cap de Bonne Expectation. Encore un hommage de taille avec the «Dice Man», hommage au géant de ‘Chester, Mark E. Smith, via le Diddley Beat, push push, les Clevelandais retroussent les manches, ce n’est pas si simple, et puis voilà le clin d’œil à Mott avec «Rock And Roll Queen», ils sautent au paf, avec de quoi ridiculiser cette vieille moute de Mott. On le sait, Cleveland est une ville infiniment rock. Comme à Detroit, le son, rien que le son. Belle cerise sur le gâteau : un «Teenage Kicks» amené à la baravado, c’est tout de suite over the rainbow, Petko le chante à l’urgence de la démence, c’est déjà un hit monstrueusement beau, alors tu imagines ça dans les pattes de ces mecs-là ! Ils ramènent les clap-hands, ils jouent comme d’habitude à la vie à la mort, c’est d’une profonde véracité fanatique. On sort de là à quatre pattes.
Paru en 2008, Haven’t Slept All Year est encore un album à tomber par terre. L’urgence du beat qu’on trouve dans «World Can’t Have Her» est sans équivalent. On voit ce diable de Petko entrer dans la danse et ça cisaille dans les parages. C’est bien lui, le beat clevelandais, assez ultime, ultra-chargé, d’une terrifiante puissance, c’est même battu au stomp des forges avec des breaks exacerbés et ce diable de Petko hurle dans la fournaise alors que coule l’acier liquide des riffs à la Zep. S’ensuit un «Wildweed» embarqué au meilleur rock de bonne constance. Allez-y les gars, c’est gagné d’avance. Pour ceux qui auraient raté un épisode, les Cobra Verde sont l’un des fleurons du rock américain. Ils font tout beaucoup mieux que les grands groupes, avec une énergie convaincante. C’est ultra-électrique, joué à fond de train, avec un roaring Petko au sommet de son art - I won’t let you go now - Un vrai modèle d’exemplarité concurrentielle. Petko renoue avec la magie des grands balladifs dès «Home In The Highrise». Véritable consécration eucharistique, c’est même un éclair dans le ciel de la pop, une Beautiful Song maximaliste, une merveille assez rare. Petko sait éveiller l’instinct d’un album à des fins mélodiques, cousues de fil blanc, certes, mais quel souffle ! On pourrait dire la même chose du «Haunted Hyena» qui referme la marche, d’autant qu’un killer solo flash lui en transperce le cœur. Ces mecs grouillent de coups de génie comme d’autres grouillent de puces. On trouve aussi un bel exercice de style intitulé «Wasted Again», tapé au groove de jump, assez risqué et pire encore : inutile. Même si les trompettes de Miles viennent saluer la confrérie. Autre cut intriguant : «Something About The Bedroom». Il s’agit là d’une puissante pop sous le boisseau, ou si tu préfères, un puissant boisseau sous la pop. Oui, le Cobra peut aussi sonner pop, presque anglais, même s’ils frappent la pop derrière les oreilles de la pop, et elle n’est pas contente. Elle devra s’arranger avec le batteur. Figure-toi qu’ils se montrent aussi capables d’Americana de haut vol avec «Free Ride» - Bye bye West coast - Quelle équipe ! Et quel album !
L’ère post-Cobra Verde porte le doux nom de Sweet Apple. Petko s’y acoquine avec J Mascis. Les journalistes appellent ça une rencontre au sommet. Leur premier album, Love & Desperation, paraît en 2009. La pochette est un délicieux pastiche de celle du quatrième album de Roxy Music, Country Life : deux belles poules s’y pavanent en petite tenue. Comme le Roxy, on ne l’achète que pour la pochette. Mais on est bien récompensé, car voilà le vieux stomp d’«Hold Me I’m Dying». Petko adore les grandes mesures. Encore de la viande en B, avec «Blindfold». Petko joue la carte du plomb, c’est-à-dire celle du heavy doom suspensif, hanté par les envolées cosmiques du vieux J, la sorcière du Massachusetts. «Somebody’s Else Problem» sonne comme un hit et J y fait carrément des chœurs de Dolls. On assiste là à une véritable débauche cobra-verdesque, une pavane de carrure extravagante. Tiens, tu as encore du heavy rock de Cobra avec «Crawling Over Bodies». Petko le coco revient à l’attaque avec des effets dévastateurs. Ce cut semble sortir tout droit de l’un des grands albums de Cobra Verde. Et ça continue avec «Never Came», fantastique et sur-puissant. Ah ces mecs-là savent ficeler un cut de rock ! C’est le filon du Cleveland rock, les mêmes racines que celles de Rocket From The Tombs. Ils bouclent ce disque ahurissant avec «Goodnight», solide et bien élancé. Avec un J en contrefort, ça donne de la power-pop moderne et riante.
Cinq ans plus tard paraît The Golden Age Of Glitter. On y trouve des invités de marque : Mark Lanegan et Robert Pollard, la fine fleur de l’underground américain. Avec Petko, on entre au royaume de la power-pop par la grande porte, et ce dès «Wish You Could Stay (A Little Longer)». Derrière, J ne chôme pas. Avec des mecs comme J et Petko, on a toujours l’impression de passer aux choses sérieuses. J bat le beurre sur «Reunion» et nos amis flirtent avec le Cheap Trick sound. «Boys In Her Fanclub» sonne comme l’absolu d’Absalon. Laissez tomber Paul Collins et écoutez ça, car on parle ici de haute voltige, d’une power-pop explosive et fraîche comme l’eau d’un torrent d’Écosse. Petko renoue avec son cher stomp de glam dans «Another Dent Skyline». Tous les vieux fans de Cobra Verde sont ravis de retrouver Petko le coco. Et en B ça dégénère avec «I Surrender». Ça s’envole littéralement. Quelle tenue et quelle ampleur ! Il faut voir avec quelle classe Petko manage ses syllabes dans le feu de l’action. J repasse à la guitare pour «Troubled Sleep» et il ramène sa violence proverbiale. En Amérique, il doit bien être le seul à savoir jouer comme ça, sans vergogne, avec un son épais, saturé, infesté de départs de solos apocalyptiques. Il rivalise de démesure avec Bob Mould. Lanegan vient chanter «You Made A Fool Out Of Me», un vieux heavy blues de circonstance. Et ils terminent cet album exceptionnel avec un nouvel hymne planétaire, «Under The Liquor Sing». Ils se situent immédiatement à la croisée des Raspberries et de Brian Wilson. Petko n’en finit plus d’exploser la coque de la power-pop pour en faire jaillir le lait jusqu’au ciel. C’est un homme libre qui chante à l’envie pure. Il réinvente le paradis et la clameur des anges.
Troisième set de Sweet Apple avec Sing The Night In Sorrow. La pochette montre le très gros plan d’une bouche nubile qui fume sa clope, sans doute en écho au délicieux Green Mind de Dinosaur. J Mascis joue essentiellement de la batterie sur l’album et laisse Tim Parmin s’exprimer sur «World I’m Gonna Leave You». John Petkovic cultive toujours ses idées suicidaires et ne souhaite qu’une chose : quitter ce monde cruel. On tombe très vite sur un hit avec «You Don’t Belong To Me». Quelle fantastique élévation power-poppy ! C’est la force du grand Petko que de savoir donner le l’élan. J Mascis revient à sa chère lead guitar sur «She Wants To Run». Voilà encore un hit inter-galactique, chanté à la puissance Byrdsy, mais en power mode heavy. En vérité, on pense plus au Teenage Fanclub, car cette pop roule joliment ses muscles sous la peau. Et J l’honore d’un solo exemplaire. En B, il reste en lead pour l’effarant «Candles In The Sun». On a là une sorte de heavy blues à la Screaming Trees. Admirable, beau et wild. J rôde dans le fond du cut comme un aigle en maraude, il joue loin là-bas dans l’écho du canyon, il plane sur le rock comme l’Empereur sur le pays des aigles, c’est-à-dire l’Albanie. Le tour de force se poursuit avec «Thank You». C’est littéralement bardé du meilleur son d’Amérique, voilà de l’heureuse pop de heavy rock et Pekto la mène au combat, il chante à l’énergie pure, avec toute la grâce et toute la bravado du pur rock’n’roll animal clevelandais. C’est bourré à craquer de stomp et J graisse sa disto à outrance. C’est le genre d’album qui marque la mémoire au fer rouge.
Quant à l’ère pré-Cobra Verde, elle porte le non moins doux nom de Death Of Samantha. Doug Gillard fait partie de cette aventure qui démarre en 1985 avec Strungout On Jargon. Sans doute leur meilleur album, mais à l’époque, on ne le sait pas. Cet album fourmille de hits, à commencer par le «Coca Cola & Liquorice» d’ouverture de bal. Petko chante ça comme un Beefheart de Cleveland, à l’incantatoire, avec un aplomb qui en dit long sur ses intentions. Quelle fabuleuse lutte intestine ! Quel brouet déterminant ! C’est joué au bactériel agressif, à la hargne du Midwest, celle des gens qui liquorisent en lice et qui poussent si loin le bouchon qu’on ne le voit même plus. Avec sa merveilleuse aisance ambulatoire, «Simple As That» renvoie directement au Velvet, car ils jouent ça la dépouille de Lou Reed. Petko scie plus d’un tronc et descend les vallées de son immense Jargon. Ça se corse encore en B avec «Grapeland (I’m Getting Sick)», violemment gratté à l’énergie du MC5. Petko et ses amis renouent avec l’énergie du Grande Ballroom, ils sortent la meilleure des attaques, ils vont vite et bien et Doug Gillard part en virée psyché en pleine cavalcade, alors forcément, ça sidère. Dans «Sexual Dreaming» Petko déclare : «I got to stop/ Sexual Dreaming». Le grand Doug Gillard nous infecte ça à coups de virées intestines. Petko étale ses whaooouh à la surface du groove, un peu dans le style de ce que fait John Lennon dans «Cold Turkey». Ils bouclent cet album captivant avec «Couldn’t Forget ‘Bout That (One Item)», un very big atmospherix. Dans ses moments de rage, Petko sonne comme Jim Morrison, il s’envole dans le taffetas des riffs du bout de la nuit. On a là un thème mélodique imparable doublé d’une atmosphère grandiose qui rappelle Adorable, ne serait-ce que par le côté brillant du dépôt de voix sur l’aile du désir. Là où Petko fait la différence, c’est quand il emmène sa chanson loin dans la démesure. Il la ravive et l’anime indéfiniment, And I got up to there.
Paraît l’année suivante un sacré beau brin de mini-album, Laughing In The Face Of A Dead Man. Pourquoi ce groupe n’a pas explosé comme un pétard dans la bouche d’un crapaud, on ne le saura jamais. On a là un rock extrêmement agité, bardé de son, avec de jolis échos de stonesy, joué au panache clevelandais, très désordonné, littéralement emmené à la force du poignet : bref, tout ce qu’on peut aimer dans le rock. Dans «Blood & Shaving Cream», on a tout le dépenaillé de braguette ouverte qu’on peut espérer. On retrouve en B l’énorme présence vocale de Petko dès «The Set Up (Of Madame Sosostris)». Ces mecs n’en finissent plus d’éclairer l’underground. Ils ont du répondant à revendre. Même chose avec «Yellow Fever», Petko n’en finit plus de ramener sa petite niaque clevelandaise - I’m so/ Sick sick sick.
Ils reviennent avec un nom d’album à coucher dehors : Where The Women Wear The Glory And The Men Wear The Pants. Ça saute à la gueule dès «Harlequin Tragedy». Petko en impose dès le git go. Il ramène sa fraise épique et bien enlevée et sort du cut vainqueur, avec un éblouissant final d’exaction mercuriale. Imbattable. Avec «Good Friday», ils sonnent presque comme les Damned - C’mon round ! - L’autre énormité de cet album se niche au bout de la B : «Blood Creek» : en voilà encore un chargé de son comme une mule, dira le voisin à sa fenêtre - We are/ Going to/ Blood Creek/ baby ! - C’est du rock décidé et sans compromission, une belle viande lardée d’intrusions, les deux guitares surjouent à la mortadelle du cheval blanc d’Henri IV, pas de tergiverse sur le Pont des Arts, ça swingue et ça avance. Petko chauffe son rock avec toute l’énergie clevelandaise - Blood Creek/ Put your hands/ Into the wa/ Ter ! - Dire que tout est bon sur cet album serait un euphémisme. On ne se lasse pas de la présence d’un tel son ni du panache d’un tel Petko. «Lucky Day (Lost My Pride)» sonne si américain. C’est extrêmement travaillé au corps. Avec «Monkey Face», ils trempent dans le Detroit Sound malevolent - You’re so evil - Comme Jagger qui ne supportait pas the man on the radio, Pekto ne supporte pas qu’on vienne lui raconter n’importe quoi on the TV et justement, il part en sucette jaggerienne d’I’m a monkey, et on assiste médusé à une fabuleuse sortie de route - Evil monkey/ Monkey evil ! - Et ça repart de plus belle en B avec «Savior City». Qui aurait pu se douter que l’album était aussi bon ? Petko pose encore une fois sa voix sur un admirable slab de rock, il cale bien son wording sur le beat d’acier bleu du midwest - No one seems to really care/ Baby/ What you’re talking about - Et ça continue avec «Start Through It Now» - We’re gonna have some fun tonite - Il faut dire que Doug Gillard joue comme un dieu. Il reste en effervescence permanente.
Pour leur ultime album, Petko et ses amis vont s’amuser à sonner comme les Dolls. Come All Ye Faithless va tout seul sur l’île déserte. En effet, trois cuts sonnent too much too soon, à commencer par «Geisha Girl» - Geisha Girl get in my Chevrolet/ We’ll make love the American way - Spectaculaire beau et sexy, comme les hits des Dolls. Tout y est, l’énergie du déroulé, les coups de cuivres et le bouquet final digne de Johansen. Même chose avec «Looking For A Face», fantastique déballage de rock samanthy - And we both know/ We’re looking for a face - Ce n’est pas le Looking for a kiss des Dolls, mais tout juste, car flamboyant et comme emporté. Ils remettent ça en B avec un «Machine Language» magnifiquement riffé. Doug et Petko se livrent à une sorte de carnage guitaristique de la pire espèce et on a toujours ce chant héroïque monté au dessus de la mêlée. Petko repart ensuite dans l’un de ces immenses balladifs crépusculaires dont il a le secret, «Oh Laughter». Ça s’étend à l’infini. Il est d’ailleurs l’un des grands specialistes de ce genre d’évasion. Avec «New Soldier/New Sailor», il raconte une nouvelle histoire d’amour, mais il ne traite jamais ça deux fois de la même façon, il trouve chaque fois un nouvel angle - You know and I say/ That we’re both big nothings - Et voilà qu’avec «Come To Me», il sonne exactement comme le Jim Morrison de «When The Music’s Over». Il chante à la supplique de la vint-cinquième heure. Ce mec reste tendu de bout en bout. Quel chantre de la désespérance relationnelle ! Il clame tout à la clameur de la chandeleur.
Signé : Cazengler, cobra cassé
Cobra Verde. Viva La Muerte. Scat Records 1994
Cobra Verde. Egomania (Love Songs). Scat Records 1997
Cobra Verde. Nightlife. Motel Records 1999
Cobra Verde. Easy Listening. Muscle Tone Records 2003
Cobra Verde. Copycat Killers. Scat Records 2005
Cobra Verde. Haven’t Slept All Year. Scat Records 2008
Sweet Apple. Love & Desperation. Tee Pee Records 2009
Sweet Apple. The Golden Age Of Glitter. Tee Pee Records 2014
Sweet Apple. Sing The Night In Sorrow. Tee Pee Records 2017
Death Of Samantha. Strungout On Jargon. Homestead Records 1985
Death Of Samantha. Laughing In The Face Of A Dead Man. Homestead Records 1986
Death Of Samantha. Where The Women Wear The Glory And The Men Wear The Pants. Homestead Records 1988
Death Of Samantha. Come All Ye Faithless. Homestead Records 1989
Laughter ne rigole plus
Perdu dans l’océan des groupes garagindés américains, il y avait ce groupe au nom rêveur, Love As Laughter. Remember ? Spin qui fut dans les années 90 le canard référentiel en la matière disait le plus grand bien de ce groupe et donc on suivait les recommandations de Spin.
Love As Laughter se distinguait des autres groupes garagindés par un côté expérimentateur qui n’était pas sans rappeler l’early Sonic Youth. Bon, ça pouvait engendrer quelques malentendus, mais au fond, ce n’était pas si grave. Comme beaucoup d’autres pêcheurs, Sam Jayne et ses amis cherchaient le chemin de la rédemption. Il se peut d’ailleurs que Sam Jayne l’ait trouvé, car en cassant sa pipe en bois, il est monté tout droit au paradis.
Il ne nous reste pas que nos yeux pour pleureur. Sam Jayne laisse aussi cinq albums extrêmement intéressants qui au temps de leur parution furent toujours salués dans une certaine presse. Avec son air de ne vouloir toucher à rien et sa chemise à carreaux, Sam Jayne était capable de coups de génie. On en trouvait deux sur ce premier album si difficile à trouver à l’époque, The Greks Bring Gifts. À commencer par l’incroyable «Singing Sores Make Perfect Swords», cette heavy oh so heavy Beautiful Song tartinée au riff de plomb, cette rengaine d’une beauté béatifiante plongée dans le meilleur vinaigre d’Amérique, ces mecs développaient un climax mélodique digne des grandes heures du Duc de Mercury Rev. C’est un Sores qu’il faut saluer. L’autre merveille de cet album s’appelle «Half Assed». Sam Jayne chante à l’anglaise, maybe I’m half to be, mais il le fait de manière seigneuriale, comme s’il avait grandi en Franche-Comté en 1210. Et voilà qu’il part à dada avec «Eeyore Crush It». En sortant son dada flush, il frise l’excellence inversée, il va loin dans le cat cat cat, il a du dada plein la disette, c’est fabuleux de non-sens. Du coup, il devient éminemment sympathique. Et ce n’est pas fini, il dispose de ressources insoupçonnables, comme le montre encore «If I Ever Need Someone Like You». Il va là où le vent le porte. Il nous fait le coup du balladif d’arpèges magiques, tu veux du by one ? Il est là. Sers-toi. Les LAL, comme les appellent les journalistes, cultivent aussi la démesure, comme le montre l’«It’s Only Lena» d’ouverture de bal. C’est sur-saturé de son et Sam Jayne chante en plein cœur de tout ce bordel. Par contre, ils ont pas mal de cuts invertébrés qui n’avaient aucune chance d’atteindre le rivage. Le rock indé introverti était insupportable. Les marchands classaient Love As Laughter dans le bac du garagindé, alors qu’ils n’avaient rien à voir avec ça. Ils s’apparentaient plus à une sorte de mouvance dada paumée, enfin disons qu’ils affichaient clairement leur mépris des conventions. Comment pouvait-on écouter des trucs comme «Uninvited Trumpets» ou «Next Time You Fall Apart» à l’époque ? Ces cuts invertébrés n’avaient aucune chance. Mais on s’extasiait encore de «High Noon». Sam Jayne devenait une sorte de fabuleux essayiste, il testait des idées de son à mains nues avec de l’harmo et du gratté d’acou, alors on lui accordait du temps.
Deux ans plus tard, les LAL réapparaissaient avec #1 USA, un album dramatiquement privé d’information. Le packaging du CD est réduit à sa plus simple expression. Merci K. Ça veut dire en clair : débrouille-toi avec les chansons. Il faut attendre «Fever» pour retrouver la heavy disto de Sores. Et en plus Sam Jayne chante ça à la dégueulante maximaliste. Il est capable d’excès terribles, il faut entendre ses hoquets de dégueulade et cette guitare qui s’étrangle dans le prurit. Sur cet album, il rend deux hommages superbes : le premier aux Stones avec «Pudget Sound Station», un rumble de Stonesy drivé d’une main de fer, le deuxième au Velvet avec «I Am A Bee», gratté au no way out, et là il explose littéralement le fantôme du Velvet, il drive ça de main de maître. Il fait aussi un heartbreaking Blues avec «Slow Blues Fever». Sam Jayne sait allumer la gueule d’un heavy blues, pas de problème. Il propose aussi un «California Dreaming» ravagé par les vinaigres. C’est violent et sans espoir. Ces mecs jouent dans une sorte de dimension supérieure. Le «Old Gold» d’ouverture de bal est assez révélateur. Ils drivent ça comme on drivait les choses à l’époque, au riffing féroce. D’ailleurs, ils grattent pas mal de cuts sans peur et sans reproche. Ils étaient les chevaliers Bayard des années 90.
Ils débarquent sur Sub Pop en 1999 pour Destination 2000. C’est leur album le plus connu et sans doute celui qui s’est le mieux vendu. Dès le «Stay Out Of Jail», on sent les chevaux vapeur, comme dirait Lavoisier. Mais il faut attendre «On The Run» pour retrouver l’ampleur compositale de Sam Jayne. Il nous sort là les power-chords de la romantica et retrouve sa couronne de roi des Beautiful Songs. Puis il passe à son autre marotte, qui est celle des énormités, avec le morceau titre, joué à la ferveur du chaos, un cut bardé de tout le barda du régiment, il gave ses cuts de son et développe des puissances incontrôlables, et boom, voilà que ça explose dans un final dément avec du piano et des cascades du Niagara dans les sous-couches. C’est stupéfiant ! Sam et son gang repartent à l’assaut du ciel avec «Stakes Avenue», ils deviennent passionnants, ils créent leur monde à coups de douches froides et montrent d’excellentes dispositions au power. En prime, Sam Jayne screame son ass out. Nouveau shoot de Stonesy avec «Statuette». Ils ont du répondant à revendre et ils savent lester un cut de plomb. Quel power ! Nouveau prodige avec «Freedom Cop». Sam Jayne arrose son délire de délire, il n’en finit de montrer des dispositions à tout, il fait même du distodada. Quelle singulière aventure que cet album ! Voilà un nouvel épisode avec «Demon Contacts», un mélopif de type Sister Morphine. C’est exactement la même ambiance - Are you sick of fucking your life - Même délire que When are you coming round, Sam the charm jette tout son pathos dans la balance et pour ça, cet enfoiré a la main lourde. Quel stupéfiant power de la mainmise ! Il explose tout. Les tenants fondent dans la graisse des aboutissants. Merci de ne pas prendre Sam Jayne pour un branleur. Il termine son album avec le big surge de «Body Double», au no way out. C’est le côté Sam de Sam, il peut lui exploser la gueule si l’envie lui en prend. En attendant, c’est bardé de gaga à gogo. Il faut aussi le voir amener son «Margaritas» au run down de mec qui va tomber à la renverse. Belle potée aux choux. Ça sonnerait presque comme un hit tellement c’est parfait.
On reste dans les gros disks énergétiques de Sub Pop avec Sea To Shining Sea paru en 2001. On y va de bon cœur car comme Nash Kato dans Urge Overkill ou encore Greg Dulli dans Afghan Whigs, ce mec Jayne a un truc. Son «Coast To Coast» d’ouverture de bal est dévastateur. On comprend qu’ils aient pu se bâtir une grosse réputation. En plus, ça sent bon les drogues. Sam Jayne chante son «Temptation Island» à la petite précipitation. Il cherche le train wreck et chante comme une folle échappée de l’asile. Il entre dans le territoire des énormités avec «Sam Jayne = Dead», un cut terriblement précurseur. Il sonne exactement comme Neil Young dans le Gold Rush - Shoot me in the hand man - Il demande à l’autre de lui faire un shoot dans la pogne alors bienvenue dans le délire de LAL, dans ce fabuleux shake de druggy motion. Monstrueuse dérive ! Il revient à l’experiment avec «Put It Together» et 8 minutes de blast all over, il colle tous les morceaux au plafond d’un rock acrobatique. C’est le rock de Jayne, Sam, mais en même temps il faut suivre. Et puis avec «Miss Direction», il bascule dans le Dylanex. Il est le boss du disk. Et voilà revenu le temps des cerises avec «Druggachusetts». Wow, ça sent bon la titube. Il mise sur sa connaissance des gouffres et ça passe par des excès, il sature ça de solos clairs et nous entraîne dans sa misère psychologique. C’est explosif et beau à la fois, mais d’une beauté plombée comme peut l’être celle de Syd Barrett. Il fait une fois de plus exploser son cut en lui enfonçant un pétard dans le cul. Et ça continue avec «French Heroin», explosif d’entrée de jeu, allumé aux accords de white heat, incroyable renversement des réacteurs abdominaux, le cut explose dans l’œuf du serpent, c’est violent, vraiment digne du Velvet. Sam Jayne a du génie, qu’on se le dise. Il faut le voir allumer sans fin son «French Heroin», il vise la fin des limites qu’on appelle aussi l’infinitude et chante à la clameur fatale de la vingt-cinquième heure. Ses morceaux longs ne tiennent que par l’intensité de la fournaise, comme ceux de Lou Reed au temps du Velvet. Il faut le voir se jeter dans le combat. Beautiful loser.
Le dernier album de LAL date de 2005 et s’appelle Laughter’s Fifth. On y dénombre pas moins de trois coups de génie, pas mal pour un groupe underground, non ? Avec «Every Midnight Song», il repasse un contrat avec la heavyness. Son truc à trac, c’est le big atmospherix. Alors voilà une belle tempête de sonic trash demented. Sam Jayne redevient le temps d’un cut le prince des ténèbres et du débordement. Il se montre encore extrêmement passionnant avec «I’m A Ghost». Il a des idées de son et entre vite dans le vif du sujet. Il drive son power surge dans une madness de ponts audacieux comme pas deux et ça explose de bonheur, aw comme ce mec est doué. Il joue sur les alternances avec du fruit dans le son. Avec «Pulsar Radio», ils se prennent pour les Spacemen 3, puisque c’est amené à l’orgue des drogues. L’ambiance évoque une fois encore le Velvet, Sam Jayne hurle dans le chaos spongieux et là tu vois défiler toute l’histoire du rock, mêlée à son désespoir et à ses tempêtes. Sam Jayne bat bien des records de puissance. Il peut aussi faire son Neil Young comme le montre «An Amber» et tremper son biscuit dans le Crazy Horse, comme le montre «Survivors», mais quand il le faut, il sait ramener des paquets de mer. Il ramène même du Tonnerre de Brest dans «Fool Worship Fool Worship». il claque sa pop-rock sur une guitare rouillée et cultive l’effervescence.
Signé : Cazengler, torve as laughter
Sam Jayne. Disparu le 15 décembre 2020
Love As Laughter. The Greks Bring Gifts. K 1996
Love As Laughter. #1 USA. K 1998
Love As Laughter. Destination 2000. Sub Pop 1999
Love As Laughter. Sea To Shining Sea. Sub Pop 2001
Love As Laughter. Laughter’s Fifth. Sub Pop 2005
*
Les temps ne sont pas roses pour les groupes. Une année épineuse pour tout le monde. Les avoir privés de concerts c'est comme leur avoir ôté leur raison d'être. En attendant la reprise chacun s'est organisé selon ses moyens. Certains ont sorti un disque, d'autres se sont rabattus sur les radios, on a tourné des clips, on a jammé entre copains, on a joué live devant un public absent calfeutré chez lui derrière l'écran de son ordinateur... bien sûr il y a eu des concerts sauvages de-ci de-là, mais il vaut mieux ne pas ébruiter... Big Brother is hearing you.
Rita Rose est un groupe de reprises, AC / DC, Stones, Pixies, Steppenwolf, des gens que l'on imagine jeter leur dévolu plus facilement sur Guns N' Roses que Les Roses Blanches de Berthe Sylva. A défaut de scènes se sont réunis exactly au DGD Music Studio, et là l'idée leur est venue qu'au lieu de transplanter les boutures déjà existantes ils pourraient créer comme dans le roman d'Alexandre Dumas leur propre tulipe noire. N'ont pas l'âme commerciale, ils ne vendent rien et on ne les achète pas, donc ils l'ont laissé en accès libre et chacun peut la cueillir à sa guise.
TOMORROW MAYBE
RITA ROSE
( Clip / YT )
Chant : Dénis / Guitare : Eric Coudrais / Guitare : Manu Doucy / Basse : Jean-Claude Aubry / Batterie : Michel Dutot.
Quand on a lu dans le paragraphe précédent leur goût pour les reprises hot, l'on est sûr qu'ils vont extirper triomphalement de leur hotte une espèce de hot-rod brûlant dégoulinant de bruit et de fureur, pas du tout, z'ont opté pour la douceur et la nostalgie, une ballade électrique, qui vous emmène doucement en balade, vous prend par la main et vous entraîne sur un sentier tapissé de pétales de roses. Malheureux vous marchez les yeux fermés sur la sente des vipères. Ce Dénis, quel enchanteur, une voix qui coule comme de l'eau pure. N'y buvez pas elle est empoisonnée. Ensorcelante, cascade comme du kaolin sur le verre de vos artères, vous mène par le bout des oreilles, vous emplit le cœur de mélancolie, vous phagocyte la mémoire de souvenirs beaux comme hier, les guitares glissent et la batterie vous attire plus qu'elle ne vous pousse, demain le monde sera plus beau et la nuit s'évapore et l'aube se lève, Rita vous passe exactement le film que vous vous tournez dans votre tête, méfiez-vous des magiciens, ils pétrissent à votre guise la gangue de vos émotions, vous emportent sur les tapis volants des rêves vertigineux d'innocence, et vous suivez la route que l'on vous trace, plus vous avancez plus vous retournez vers le néant du passé et vous vous croyez en partance pour un futur radieux, mais c'est la fin, un susurrement de langue d'aspic et le doute s'installe en vous pour toujours. Seriez-vous cette abeille enivrée dans le calice refermée d'une rose carnivore. Peut-être.
Maintenant que vous avez rouvert les yeux, vous vous apercevez qu'ils sont plus cruels que vous ne l'imaginiez, le clip est empli d'images muettes et remuantes des concerts d'avant...
Damie Chad.
LEE O' NELL BLUES GANG
Bien avant le temps de la prohibition les vieux bluesmen ne voyageaient pas de ville en ville les mains dans les poches, bien sûr se dépatouillaient pour porter leur guitare, mais la plupart n'oubliaient jamais de se munir de leur assurance tous risques, rien de mieux qu'un calibre en état de marche pour faire son chemin dans la vie. Les temps étaient durs, il était nécessaire de savoir se défendre contre les aigrefins de toutes espèces avec des arguments convaincants. L'association des mots blues et gang s'avère historialement correcte, reste encore à savoir qui se cache derrière cette redoutable association.
Sont français. Cette précision ne relève d'aucun chauvinisme, simplement le fait que l'on peut être amené à les rencontrer au hasard de nos pérégrinations. Respirons, ne sont que deux. Pas beaucoup, mais pensons au gang Barrow plus connus sous le nom de Bonnie and Clyde, justement, sont bâtis sur le même modèle, un couple, aussi venimeux qu'une paire de crotales qui auraient élu domicile dans une de vos bottes ( voir la Mine de l'allemand perdue de Blue Berry ), donc un gars Lionel Wernert et une gerce Gipsy Bacuet. Pas des tendrons de la dernière couvée, citer la liste des mauvais coups auxquels au sein de diverses formations ils se sont livrés, soit séparément, soit ensemble, serait trop long. Ils ont fini par se faire repérer, l'agence Bluekerton de la revue Soul Bag les tient à l'œil. En ces temps covidiques ils ont réussi un gros coup, ils ont sorti en décembre 2020 un album Shades of Love, en cette occasion a éclaté au grand jour les ramifications secrètes de leur influence occulte, notamment leur amitié avec Fred Chapelier, une sommité du blues ( blanc rouge ).
WALKING BY MYSELF ( YT )
Vocal : Gipsy Bacuet, Leadfoot Rivet, Fred Chapelier, Neal Walden Black / Guitars : Lionel Werner, Fred Chapelier / Slide : Neal Walden Black / / Drums : Jonathan Thillot / Bass : Philippe Dandrimont / Keys : François Barisaux
Walking by myself because Jimmy Rogers a longtemps été dans l'orchestre de Muddy Waters, vous le chante d'ailleurs assez gentiment sur une rythmique qui musarde doucettement, notre gang le commence comme finissaient les morceaux de musique dans l'antiquité, tous les instruments ensemble en une espèce d'apocalypse sonore, puristes du blues ne criez pas au scandale, le balancement de gondole vénitienne particulier à la zique bleue, il arrive très vite, prenez cette expression au pied de la lettre, sur une espèce d'aircraft électrisé qui fonce droit devant sans se poser de question sur la métaphysique du blues, la Gipsy elle n'aime pas que les gars se reposent, vous envoie le vocal à la batte de baseball et chacun essaie ( et réussit ) de rester sur le même diapason, deux solo de corrida et des lyrics à la rasetta entre les cornes du taureau impulsif. C'est du rapide et ça se déguste, donc il faut réécouter septante sep fois. Avis personnel : ne vous laissez pas happer par les photos réalisées lors de l'enregistrement, elles mangent votre attention et vous empêchent de vous plonger dans la musique, qui vous attend gueule ouverte style les dents de la mer.
ALONE ( YT )
( Official Music Video )
Vocal : Gipsy Bacuet / Guitars : Lionel Werner, Fred Chapelier / Drums : Jonathan Thillot / Bass : Philippe Dandrimont / Keys : François Barisaux
Tout ce que vous n'avez pas eu le temps de goûter à sa juste valeur dans le morceau précédent, Alone vous le permet, les images bistres suivent les musiciens de près, les doigts sur les guitares et le bonheur dans la prise. Ne chôment pas pour autant, mais Gipsy a dosé un entrefilet de jazz dans sa manière distinguée de dispatcher les syllabes, elle n'essaie pas d'arriver la première, elle pousse vers le haut, du coup les guitares prennent de l'altitude et deviennent aériennes. Ici la rythmique ne joue pas à la terre brûlée, rapide et relax en même temps, Lionel et Fred se tirent la bourre de la fraternité, montrent ce qu' ils savent faire, mais sans esbroufe, pas à la m'as-tu-vu-je-te-tue, ils distillent leur style félin flexible sur les fusibles, un régal.
DIFFERENT SHADES OF LOVE ( YT )
( Live / La Scène / Sens / Octobre 2020 )
( Organisé par l'association Red & Blue 606 )
Vocal : Gipsy Bacuet / Guitars : Lionel Werner / Drums : Jonathan Thillot / Bass : Philippe Dandrimont / Keys : François Barisaux
Blues, soul, rock, tout ce que vous voulez, les gars ont une chanteuse avec eux, alors ils la servent, la gâtent, sont à ses petits soins, pas un qui essaie de tirer la couverture à soi, mais sans cesse un petit yoyo à lui refiler sous chaque intonation, l'air de rien, sans démonstration, juste de temps en temps un petit sourire satisfait car tout baigne, z'auraient d'ailleurs tort d'essayer de se pousser devant, car Gipsy elle survole, l'épeire qui danse dans le soleil de l'aurore sur la toile perlée de rosée, une équilibriste, une funambule, n'a pas le vocal bancal, elle hausse à peine le ton et le monde change de couleur, n'en fait jamais trop, une simplicité renversante, vous donne l'impression qu'elle lit à mi-voix la liste des commissions, mais avec une aisance, un tact et une classe infinis. Le tout sans la froideur de la perfection, sans ostentation, infiniment naturelle.
Damie Chad.
BURRIED MEMORIES
ACROSS THE DIVIDE
( Clip / YT / 04 – 04 -2021 )
Dans notre livraison 497 du 11 / 02 / 2021 nous présentions Disaray le dernier CD de Across The Divide, nous en avions profité pour évoquer certaines vidéos reprenant certains titres de l'album. Au début du mois est parue une nouvelle vidéo de Regan MacGowan illustrant le deuxième titre de cet opus, que nous avons beaucoup apprécié, un artefact soigné tant au niveau esthétique que musical.
Le clip est à l'image de Across The Divide, un objet fini qui se suffit à lui-même qui de surcroit est facile à appréhender puisqu'il est loin d'atteindre les cinq minutes. De belles prises de vue, un bon son, d'une lecture agréable et facile. Apparemment une situation idyllique, le groupe en pleine nature interprétant une de ses dernières œuvres. La face claire des phénomènes. Cette dernière phrase induit qu'elle coexiste avec une face plus sombre.
Nous n'en dirons pas plus ne voulant pas davantage effleurer le contenu de cette chose. La chose diffère de l'objet, si l'objet relève du mental, la chose participe du mystère de sa propre présence. L'esprit ne l'a pas scannée. Elle fait encore partie de l'informe, du mystérieux, du menaçant, ce n'est pas qu'elle serait non humaine, c'est qu'elle est a-humaine. D'une nature autre. A vous de regarder ce clip. Pas uniquement du début à la fin. De d'avant le début à après la fin. Sachez voir. Ensuite vous êtes libre de l'interprétation. Quand on raconte une histoire, l'on n'est pas obligé de tout dire, à vous d'interpréter les indices. De monter votre propre scénario. A partir de vos malaises et de vos angoisses, et de la réalité dans laquelle vous évoluez.
Ce clip est une merveilleuse réussite, une clef qui s'adapte à de nombreuses serrures. Choisissez la porte qui vous correspond. Celle d'ivoire ou celle d'ébène.
Damie Chad.
TROIS CARTOUCHES POUR
LA SAINT-INNOCENT
MICHEL EMBARECK
( L'Archipel / Mars 2021 )
Fût-il aristocrate Michel Embareck pourrait se vanter d'avoir des ancêtres qui auraient participé à la première croisade, ceci pour vous dire que notre homme possède ses quartiers de noblesse rock, n'était-il pas une des plumes des plus talentueuses qui en des temps anciens s'illustrèrent dans la revue Best. Si le nom de ce magazine ne vous dit rien c'est que vous êtes jeunes, ce qui n'est pas, je vous rassure, une tare rédhibitoire... Depuis Michel Embareck a publié une bonne trentaine d'ouvrages, nous avons déjà chroniqué en ce blog-rock Jim Morrison et le diable boîteux ( livraison 322 du 29 / 03 / 17 ) et Bob Dylan et le rôdeur de minuit ( livraison 361 du 15 / 02 18 ), le voici qui revient parmi nous avec un roman, qualifié selon sa couverture, de noir. Evitez les raccourcis dangereux, noir ne signifie pas policier.
Certes vous avez un cadavre en ouverture, dès le premier chapitre, mais ce n'est pas le bon, celui-là s'apparente à un cadeau Bonux, circulez il n'y a rien à voir, très vite nous tenons l'assassin, une femme ( elles sont dangereuses ), inutile d'endosser votre chapeau à la Sherlock et de vous munir d'une loupe pour les indices. L'Embareck ne vous laisse pas dans l'embarras, nous refile son nom et nous signale qu'elle a depuis longtemps été jugée et qu'elle a purgé sa peine. Ce n'est pas non plus une serial killer qui aurait avoué un meurtre pour mieux faire silence sur les soixante autres bonshommes qu'elle aurait précédemment occis sans que nul ne la soupçonne. Bref le livre commence alors que l'histoire est terminée, je n'ose pas écrire morte et enterrée.
La victime est aussi au fond du trou. Un gars sympa, un blouson noir – chez Kr'tnt cela équivaut à un certificat de bonne conduite - un bosseur, certes il tapait peut-être sur sa femme – c'est elle qui le dit – mais qui en ce bas-monde n'a pas ses petits défauts... Elle devait bien aimer ça puisqu'elle s'était mariée avec lui.
Donc Michel Embareck rouvre l'enquête. Pourquoi pas. Toutefois quelques détails nous interpellent quant à cette démarche. Premièrement, il ne fait pas cela au grand jour, se déguise en journaliste, pour brouiller les pistes, pour qu'on ne le reconnaisse pas, lui l'amateur émérite de rock'n'roll, il s'adjuge le nom d'un musicien classique : Wagner. Deuxièmement : il nous tend un piège, file au lecteur un détail foireux à se mettre sous la dent. Dans quel ordre ont été tirées les trois bastos qui ont envoyé l'innocent trucidé ad patres ? Non il n' y a pas de troisièmement. Notre perspicacité nous permet dès maintenant de vous filer la véritable identité du meurtrier. Ne poussez pas des oh de stupéfaction ou d'indignation en l'apprenant. Nous fournirons les preuves et les terribles révélations qui marchent avec, dès la fin de ce paragraphe. Tiens, il est fini.
Le criminel c'est... Michel Embareck ! Mais enfin Damie tu dérailles, n'est-ce pas Jeanne Moreau – pas l'actrice, l'autre – qui s'est dénoncée elle-même à la gendarmerie, z'oui âme naïve, mais c'est Michel Embareck qui a créé le personnage de Jeanne et l'assassinat de son mari. Il en est donc pleinement responsable. L'auteur du crime, c'est lui. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est qu'un début. Assez médiocre quand on connaît la suite. Ne jetons pas la pierre sur Michel Embareck, ce n'est pas de sa faute, l'a sans doute été atteint du terrible syndrome du tigre altéré de sang. Mangeur d'hommes. Et de femmes. ( Soyons respectueux de la parité ).
Un peu la problématique de la carabine. Si elle ne tire qu'un coup et si vous attrapez un coup de sang, vous ne tuez qu'une seule personne. A répétition, c'est le carnage. L'aurait dû intituler son book, ''Midnight rambler sur piste sanglante'', au long de son enquête l'Embareck wagnérien, il ne s'économise pas, vous offre la tétralogie in extenso, Crépuscule des Dieux compris avec embrasement final terminator. Méfiez-vous si vous ouvrez le bouquin, attention aux balles perdues, parce que l'Embareck en colère ne respecte personne, l'est prêt à abattre son lecteur ( et même sa lectrice ) sans sommation si sa figure ne lui revient pas. Non, n'ayez pas peur, il ne dum-dumise pas au fusil à cinq balles mais à symboles. Plus il avance dans son enquête plus notre confiance en nos institutions s'estompe. N'épargne aucune de nos vaches sacrées. Remonte le troupeau jusqu'au vacher en chef. Un crime peut en cacher un autre.
Attention dear kr'tntreaders, ne vous précipitez pas sur une courageuse lettre anonyme pour dénoncer aux autorités la malfaisance anarchisante de cet ignoble individu qui répond au nom de Michel Embareck, c'est que pour le moment nous n'avons traité que le roman. L'intrigue romanesque si vous préférez. Le plus dur reste à venir. On vous a avertis, c'est noir. Très noir. Non, pas tout à fait le noir anarchie. Plutôt le noir opaque. L'est comme cela l'Embareck vous raconte une petite histoire de rien du tout. Une bonne femme qui se débarrasse de son mari. Ça ne va pas chercher loin. Vingt ans maximum. ( Vingt ans pour avoir tué un blouson noir, perso je lui en aurais filé quarante et l'on n'en parlait plus. ) Le malheur c'est qu'à partir de ce fait divers, Michel Embareck vous fait visiter les sept cercles de l'Enfer de Dante.
Depuis la Divine Comédie les choses ont bien changé, l'Enfer n'est plus en Enfer, s'est déplacé, l'est partout, ses tentacules ont envahi le Purgatoire et le Paradis. Ce ne sont plus les morts qui occupent l'Enfer mais les vivants comme vous et moi qui y résidons. Vous pensez que j'exagère, que je dépeins l'existence terrestre sous une couleur un peu trop sombre. Vous avez totalement raison. C'est plus que sombre, c'est noir. ( Cf la couverture ).
Michel Embareck se gausse tel un gosse, il laisse traîner le fil de l'intrigue et vous vous amusez à le tirer. C'est idiot parce que c'était le cordon du bâton de dynamite qui vous explose à la figure. Ah ! vous croyiez être dans un livre policier, erreur sur toutes les lignes, Embareck vous a embarqué dans un essai politique. Philosophiquement parlant traduisons par : Marx a remis la dialectique de Hegel sur ses pieds. Les crimes ne sont que le miroir de notre société. Si vous inversez la phrase cela donne : notre société est criminelle.
Imaginons que vous soyez de bonne composition. D'accord Damie, Michel Embareck n'a pas tout à fait tort, plus on monte dans la pyramide, moins c'est beau. Vous vous rendez à la raison, oui dear lector avec Embareck l'on part de la mésentente d'un couple pour se retrouver tout en haut, nous l'avons déjà dit, mais en reconnaissant cela vous n'aurez fait que la petite moitié du chemin. En fait vous vous débrouillez pour ressortir de cette histoire ( noire ) blanc ou blanche comme neige, ce n'est pas moi, c'est les autres. Ben non ! vous démontre Embareck que vous aussi ( pas tous, beaucoup d'élus mais peu qui refusent de céder à l'appel trompeur ) vous marchez dans les entourloupes, pardon vous y courez, vous y galopez ventre à terre, car vous êtes totalement manipulés par les instances politiques, médiatiques et marchandiques, elles ont bien compris que vous ne croyez plus en leur combine, alors elles vous préparent et vous proposent la contre-combine, voire l'anti-combine, pour soi-disant esquiver la première, mais qui dans les faits se révèlent encore plus piégeuses. Ce n'est pas de votre faute, c'est que vous êtes bêtes.
Pas moi ! Pas moi ! tout ça c'est de la théorie de l'emberlificotage, vous écriez-vous, alors Michel Embareck qui est très gentil, vous plonge le nez dans votre caca, au moins vous n'êtes pas dépaysé, vous parle du quotidien dans lequel vous tracez votre route, et c'est-là qu'il décanille sec, vous ouvre les yeux, vous révèle ce que Balzac nommait l'envers de l'histoire contemporaine, vous n'êtes que des marionnettes qui récitez le texte que l'on attend de vous. Vous sciez en toute stupide bonne foi la branche sur laquelle vous êtes assis, vous vous attaquez à ceux qui vous ressemblent mais qui gardent une vision claire de la situation que vous n'êtes plus capable d'appréhender...
Ce n'est pas un livre optimiste. Michel Embareck ne se gêne pas pour crever les baudruches des idées nouvelles qui embrasent les fausses colères des révoltes auto-immunes. Talentueux et jouissif, surtout quand il porte direct la main au saint du sein.
Aux lecteurs innocents, la cervelle pleine ! Distribution gratuite de coups de pied au cul pour les autres. Ce dernier mot s'entend aussi au féminin.
Damie Chad.
SURVIVOR
ERIC BURDON
( 1977 )
Lead vocals : Eric Burdon / Keyboards : Zoot Money – John Bundrick – Jürgen Fritz / Guitar : Alexis Korner – Frank Diez – Colin Pincott – Geoff Whitehorn – Ken Paris + vocals / Bass : Dave Dover – Steffi Stefan / Drums : Alvin Taylor / Backing vocals : Maggie Bell – P. P. Arnold – Vicky Brown
Une belle pochette due à Jim Newport. Un disque à la croisée des chemins pour Burdon. Ne sait plus trop où il en est. L'aventure War est terminée depuis longtemps mais en 1976 est sorti un album de vieilles bandes, il remonte la pente avec la création d'Eric Burdon Band, les Animals datent de la préhistoire pourtant quelques mois après la sortie de ce Survivor sortira le disque de la re-formation originale et cette aventure parallèle durera pratiquement jusqu'au milieu des eigthies, et il faudra attendre 1980 pour un nouveau disque d'Eric Burdon, preuve que le Survivant n'a pas trop bien survécu son titre fait froid dans le dos : Darkness, darkness... Survivor est enregistré en Angleterre, dans la flopée des musiciens l'on remarque un ami de la première heure Alexis Korner pionnier du blues anglais, mais aussi Alvin Taylor qui participa à Sun Secrets et surtout Zoot Money qui depuis la fin des Animals croise sans cesse la route de Burdon et qui co-signe avec lui huit titres sur dix de l'album Si l'on regarde Survivor avec le recul nécessaire, l'on se rend compte que cet album qui n'a jamais été réédité est bien meilleur que les deux derniers disques des Animals reformés, Ark et Greatest Hits Live, qui de fait apparaissent comme de pâles copies, de tristes tentatives avortées. La comparaison est d'autant plus significative que Zoot Money a participé à l'aventure de ces deux disques animaliers.
Rocky : l'on peut partir d'un principe d'équivalence simple c'est que si Eric Burdon n'est pas au mieux de sa forme, c'est que le rock'n'roll a perdu son innocence, certains lecteurs tiqueront, en 77 le punk lui file un sacré coup de pied au fesse au vieux rocky des familles, c'est une époque explosive et séminale, certes mais quand on y réfléchit le Burdon est devenu un has been, la jeune génération n'a pas besoin de lui, ne l'attend pas, alors il va leur montrer comment on manie la dynamite, vous empoigne le vocal et ne vous le lâche pas d'un millimètre et derrière ça déménage un max, on dirait que tous les crédités sont présents sur cette séance et ça tourbillonne dans tous les sens, un bon vieux rock'n'roll comme l'en n'en fait plus et Burdon vous le chevauche comme s'il drivait les chevaux de Poseidon dans la tempête et se sert de sa voix comme du trident neptunien pour ébranler les consciences. Sur ce coup vous fout K.O. Au premier round. Woman of the rings : changement d'atmosphère, vous avez eu le rock, voici le blues. Mais un blues comme vous n'en avez jamais entendu. Comme le Led Zeppe n'a jamais eu l'idée, des guitares qui jouent comme des chats écorchés et un clavier qui roucoule comme la colombe poignardée d'Apollinaire, pas besoin de plus, là-dessus Burdon pose ses phrases sans emphase à tel point que les nanas se chargent de craquer l'allumette et l'orchestre s'engage dans le maelström, et c'est à cet instant précis que vous réalisez, maintenant qu'il se tait, l'art de Burdon, le mec qui fait semblant de chanter à moins qu'il ne fasse semblant de parler, funambule sur la ligne de crête. The kid : un sale gamin qui brouille la piste et qui ne se laisse pas écouter. Tomb of the unknown singer : malheureux vous entendez les premiers arpèges et vous pensez être parti pour une ballade de toute coolitude d'un chanteur qui se meurt d'amour, et puis le Burdon l'on dirait qu'il a emprunté la voix écorchée de Dylan, good trip en perspective, d'ailleurs le titre se retrouve sur la compil Good Times, certes mais alors éloignez-vous tout au fond du jardin et écoutez le ramage des petits oiseaux … pour vous donner une idée de comparaison c'est le même scénario que Le chanteur abandonné de Johnny Hallyday mais avec Burdon le loup est entré dans la bergerie, l'a bouffé le Berger, l'a égorgé tous les agneaux et puis s'en est allé pousser sa plainte lugubre à la lune hécatienne, un iceberg de solitude vous tombe dessus, vous ressentez l'incomplétude humaine, ce titre est une invitation baudelairienne au suicide, une pente fatale qui vous happera sans pitié si par hasard vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme, un faire-part de la mort qui vous spécifie l'heure de votre rendez-vous au cimetière. Glaçant. Toutes mes condoléances. Famous flames : réchauffons-nous, rythmique guillerette à conter le guilledou à Magie Bell et ses copines, Alvin Taylor bat le beurre mais ce n'est pas du bio, heureusement qu'il y en a qui se défoncent à la guitare, le Burdon rigole tout seul, mais vous avez du mal à participer à la fête, je vous le dis mais le répétez pas, les flammes ne sont pas aussi fameuses que promises, un peu longuet et la gueule du dragon cracheur de feu n'est pas au rendez-vous à l'autre bout de la queue. Hollywood woman : Burdon nous fait son cinéma country : au début ce n'est pas mal, à la suite aussi, c'est dans les refrains qu'il sourit un peu trop fort pour plaire au grand public, les musicos se la donnent, des petites trouvailles de partout, on en oublie le Burdon qui chante un peu trop dans le registre de l'attendu. C'est vrai que l'on ne peut pas être tout le temps Johnny Cash. Surtout si l'on part du principe que c'est une cause perdue. Hook of Holland : un morceau qui accroche qui arrive à point nommé après les deux relâchements précédents, dans la droite ligne du morceau introductif, un feu de bois qui pétille dans la cheminée et qui met le feu à la maison, Burdon est parfait en pyromane, les filles crient pour qu'il vienne les délivrer, mais non, il faut du combustible pour alimenter le feu de joie. Une guitare incendiaire et des chœurs de pompiers heureux du beau brasier qui s'offre à eux. Chaud. Très chaud. I was born to live the blues : le Burdon l'est comme les aristocrates, se souvient qu'il a le sang bleu, voix nue et une guitare dont les cordes sont en boyaux de chat, le vieux classique de Brownie McGhee qui se permettait de le chanter de sa face joviale et épanouie, le vieux renard qui en a trop vu pour ne pas sourire à la vie, le Burdon lui il emmêle ses tripes dans ses cordes vocales de tigre, la dureté de la vie vous cisaille sans pitié, chante comme une lame de guillotine qui tombe sur les condamnés à mort que nous sommes. Highway dealer : rien qu'au titre l'on sent que l'on aime déjà et quand on écoute l'on est subjugué, non ce n'est pas pied au plancher en sens inverse sur l'autoroute ( si un peu quand même ) une ambiance proche de The man sur Stop, avec des guitares qui pètent les mégaphones à la Roadrunner du grand et du beau Bo Diddley, tout le début pue le soufre et l'enfer, le Burdon barrit comme une éléphante dont un car de touristes vient de buter son petit, bref un carnage. Quant au band derrière et devant il déploie plus d'inventivité et de nuances que le Deutches Symphonie-Orchester Berlin quand il était mené par Wilhelm Furtwangler. P. O. Box 500 : poste restante. Pas à perpétuité mais récidiviste. Rien de plus terrible que d'être mis en boîte par un ami ! Burdon en faux-jeton gagnant ! K. O. Boxe. Cinq sens éteints.
Damie Chad.
XXXI
ROCKAMBOLESQUES
LES DOSSIERS SECRETS DU SSR
( Services secrets du rock 'n' rOll )
L'AFFAIRE DU CORONADO-VIRUS
Cette nouvelle est dédiée à Vince Rogers.
Lecteurs, ne posez pas de questions,
Voici quelques précisions
Suite à notre trentième livraison, nous avons reçu des centaines de lettres de la part des adhérents de la Société Protectrice des Animaux ulcérés nous reprochant l'absence de Molossa et de Molossito dans les évènements dramatiques relatés. Certains nous accusent même d'avoir falsifié notre document. Jamais, affirment-ils nous n'aurions pu sortir vivants de cette aventure sans leur aide précieuse. C'est la vérité vraie, mais les reproches qui nous sont adressés sont particulièrement injustes, ils méconnaissent surtout le génie stratégique du Chef. Il est évident que sans nos canidés nous aurions perdu la partie, mais il ne faut jamais oublier que dans toute attaque il convient d'assurer la protection de la base de repli. Cette besogne souvent ingrate mais nécessaire échut à nos quadrupèdes aguerris. Connaissez-vous quelque chose de plus féroce qu'un chien de garde ? Sinon deux chiens de garde.
126
Nous nous retrouvâmes tous dans la cuisine où nous avaient précédé Vince et Ludovic. Ce dernier avait repris des couleurs, des timbales fumantes de café extra-fort nous attendaient, nous en avions besoin pour nous remettre de nos émotions. Les filles auraient bien croqué un petit gâteau sec, mais le Chef s'y opposa :
-
Nous n'en avons pas le temps, nous repartons dans une minute, le temps que l'agent Chad récupère les chiens, et hop tout le monde dans le SUV !
Molossa était sagement assise devant la porte, je remarquai immédiatement l'absence de Molossito, le museau de Molossa se posa comme par inadvertance sur mon jarret gauche, je la fis rentrer avec moi.
-
Chef, sûrement un problème, l'on doit nous épier, et Molossito n'est pas là !
-
Léger changement de programme dit le Chef, Vince, Ludovic, les filles, vous sortez en papotant comme si de rien n'était, vous ne risquez rien, s'ils ne sont pas intervenus c'est qu'ils attendent les ordres, Vince au volant, moteur allumé vous attendez que l'on revienne, l'Agent Chad et moi-même nous allons récupérer Molossito, Charlotte tu prends Molossa dans tes bras quand tu es devant le Suv tu fais semblant de la poser sur le siège arrière mais tu la relâches discrètement, les autres et les portières grande-ouvertes te faciliteront la manœuvre, que notre comité de surveillance ne s'aperçoive de rien, exécution immédiate !
En passant derrière le tronc de l'ormeau, le Chef et moi nous nous engouffrâmes dans une zone d'ombre, Molossa nous rejoignit très vite et nous guida rapidement vers un bosquet, une longue voiture noire stationnait tout feu éteint. Nous nous accroupîmes sans bruit, le Chef alluma un Coronado en faisant attention qu'aucune flamme ne trahisse notre présence.
-
A toi de jouer Molossa !
Elle ne se le fit pas dire deux fois. Trois secondes plus tard elle était sur le capot, grognant, aboyant de toutes ses forces, l'on s'agita dans la voiture, mais des piaillements aigus nous cisaillèrent les oreilles, l'otage Molossito donnait de la voix, la réaction ne se fit pas attendre, une vitre s'abaissa et Molossito fut rapidement éjecté sans ménagement.
-
Cassez-vous les cabots, vous allez nous faire repérer, proféra une voix sourde,
Nous étions tout près je récupérai Molossito au vol, d'un geste vif le Chef balança son Coronado par l'entrebâillement de la vitre, la grosse limousine explosa illico !
Trente secondes plus tard nous plongions dans le SUV que Vince arracha de son immobilité de main de maître. Le Chef nous conseillait d'avoir toujours un Coronado série El dynamitero dans sa poche, ça peut toujours servir, ajoutait-il.
127
Vince connaissait la région, il roulait à tombeau ouvert n'hésitant pas à éteindre régulièrement les phares, et changeant systématiquement de direction à chaque croisement. Malgré toutes ces précautions nous ne tardâmes pas à être repérés par un hélicoptère, qui bientôt nous prit carrément en chasse.
-
Décidément l'homme à deux mains n'aime vraiment pas le rock'n'roll soupirai-je !
-
Il n'a pas que deux mains bougonna Vince, il a aussi les moyens !
-
Hum-hum, le Chef toussota, si nous étions d'un optimisme béat nous pourrions dire que ce déploiement de moyens permet de l'identifier à coup sûr, mais comme nous sommes des pessimistes actifs, nous en déduirons que s'il se montre ainsi à visage découvert c'est qu'il est sûr que nous ne profiterons pas longtemps du renseignement qu'il nous a révélé.
-
Ce qui veut dire ? s'enquit Ludovic que l'on sentait dépassé par la cascades d'évènements qui avaient si abruptement bouleversé sa vie...
-
Vous pensez que bientôt nous allons donner du museau en plein dans un barrage proposa Brunette
-
Non, cela ne correspond pas au personnage, le Chef allumait un nouveau Coronado je suppose qu'il emploiera les grands moyens, il reste à deviner lesquels avant qu'il ne se présente
-
Vous avez-vu, ils ont changé d'hélicoptère, celui-ci il porte un long-tube sous lui !
-
Ce n'est pas un long-tube charmante Charline, mais un missile air-sol, à tête chercheuse, Vince arrête-toi tout de suite, sans vouloir t'offenser l'agent Chad s'est déjà trouvé dans de telles circonstances, ce n'est pas qu'il soit meilleur conducteur que toi, mais il connaît les procédures à suivre en de tels cas, que nous pourrions qualifier de dramatiques.
128
Je me mis à zigzaguer sur la chaussée, piètre échappatoire, essayant de me rabattre juste devant les rares voitures que je doublais les obligeant à me coller au cul, ralentissant si elles ralentissaient, accélérant si elles accéléraient de telle manière que nous ne formions qu'un seul véhicule et qu'avec un peu de chance le missile s'abattrait sur l'autre conducteur, mais le gars préférait piler net et s'arrêter sur place, je repartais donc à la recherche d'une tête brûlée qui trouverait ce jeu stupide intéressant. Hélas la nationale n'était visitée que par des pleutres. Ces velléités avaient dû inquiéter, car un deuxième hélicoptère vint se ranger à côté du premier, que je sois sur la voie de droite ou de gauche, j'étais toujours dans le viseur de l'un ou de l'autre.
-
Agent Chad nous avons affaire à des coriaces, sans doute auriez-vous intérêt à adopter une autre stratégie !
Comme toujours le Chef avait raison. Ce fut le déclic qui me permit de prendre les bonnes décisions. Pour être risqué, c'était risqué, mais si je réussissais quel magnifique chapitre à ajouter aux Mémoires d'un Génie Supérieur de l'Humanité. Maintenant que nous connaissions l'identité de l'homme à deux mains il aurait été stupide d'échouer si près du but.
-
Chef je vais utiliser une tactique vieille comme le monde, mais qui au cours de l'Histoire a fait ses preuves.
-
Agent Chad, je n'en attendais pas moins de vous !
-
C'est simple Chef, quand l'ennemi est plus fort que vous il convient de l'attaquer sur son point le plus faible !
-
Agent Chad, cela me paraît d'une grande sagesse, je vous laisse faire, pendant que vous vous emploierez à nous défaire de nos ennemis, si cela ne vous dérange pas, je me permettrai, en toute sérénité de fumer un Coronado. Que le rock'n'roll soit avec nous !
A suivre...
31/08/2016
KR'TNT ! ¤ 292 : OBLIVIANS / GENE VINCENT - JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE / HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE / RED'S LYGTH
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 292
A ROCKLIT PRODUCTION
01 / 09 / 2016
|
OBLIVIANS / GENE VINCENT / JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE RED'S LYGHT |
BINIC FOLK BLUES FESTIVAL
( 22 ) - 30 juillet 2006

OBLIVIANS
Obliviande
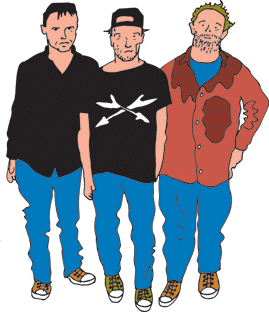
Les trois frères Oblivian sont un peu les frères Dalton du garage américain. À l’époque de leur grandeur, personne n’osait les affronter à OK Coral. Leur principal atout était la polyvalence : Greg, Jack et Eric Oblivian savaient jouer à la fois de la batterie et de la guitare, composer et screamer, ce qui leur permettait d’alterner le lead et de varier les styles.
Comme les Stooges, Jimi Hendrix, le Velvet et les Gories, ils ont aussi commencé par enregistrer trois albums qui sont devenus des albums cultes chez les garagistes : Soul Food, Popular Favorites et Play 9 Songs With Mr Quintron, tout ça sur Crypt. Avec ces trois albums et ceux des Gories aussi parus sur Crypt, la messe est dite. Amen.
Et quelle messe !

À l’époque, ces disques nous brûlaient les doigts. Trop de culte tue le culte. Le festin de Soul Food s’ouvre sur une horreur ultraïque baptisée «Viet Nam War Blues», a fuckin’ smokin’ beast, comme disait à l’époque Tim Warren, un truc aussi puissant et carnassier qu’un crocodile, bâtard, violent, vénéneux, on ne lui trouve aucune qualité. On plonge ensuite dans la pire insanité avec «Big Black Hole», chanté avec du trash plein la bouche, c’est à peine croyable, il faut l’entendre pour croire qu’un truc pareil puisse exister. Berk ! C’est screamé jusqu’à l’os du scream. Dans un concours de scream, Greg Oblivian aurait certainement battu Frank Black. Ils tapent aussi dans l’hypno du North Mississippi Hill Country blues pour «Never Change». Ils ne reculent devant aucun excès. De l’autre côté, on tombe sur ce fantastique classique garage qu’est «Blew My Cool», embarqué au riff sempiternellement effervescent. Voilà le garage désossé et ramené à l’essence du riff. Encore un petit shoot d’adrénaline avec «Bum A Ride», joué au dératé et sacrément agressif, ils tapent dans la hurlette de Memphis avec de jolies interjections orgasmiques. À l’époque, les critiques américains n’avaient qu’un seul mot en guise de commentaire : Gasp !
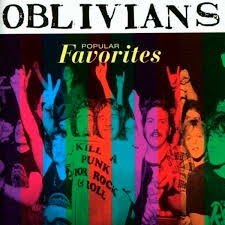
On croit qu’ils vont se calmer avec Popular Favorites. Pas du tout. Ils trash-punkent dès l’allumage avec «Christina». À dégager ! Ils développent une sorte de démesure de l’excès, dans le son, dans le beat, dans le trash. Ils balaient tout. On attend qu’ils explosent. Ils dégagent la pire pulsion primitive qui se puisse concevoir ici bas. Ils shootent une fatale injection de sténo dans la stéréo. Atroce ! Ce disque sonne comme un assaut. Avec «Trouble», on réalise subitement qu’ils se trouvent dans un trip de destruction totale. Ils réinventent même le garage sans le faire exprès. Les choses empirent encore avec «The Leather», un cut rampant, horrible, qui passe sous la moquette, c’est le vrai primitif, celui qui donne le frisson, et comme dans les cauchemars, on ne parvient pas à s’enfuir. Alors t’en veux encore ? Tiens ! «Hey Mama Look At Sis» ! Ce Greg est un psychopathe ! Dans la chanson, il lui dit de regarder ce qu’elle fait. Ça devient insupportable. Il ne la lâche pas. Tiens, et ça, «Strong Come On» ! Du Jack qui se prend pour les Beatles à Hambourg. Mais ils préfèrent nettement la brutalité, avec «She’s A Hole», c’est du sans pitié, du claqué du beignet de riff. Et dans «Bad Man», ils explosent littéralement le désossé, c’est de la soudarderie qui dépasse toutes les bornes. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec des abominations comme «He’s Your Man», saturé de fuzz, ou encore «Pinstripe Willie», trash-punk de la dernière heure. Tout semble définitif sur cet album du non retour.
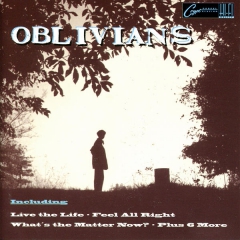
Mais non, car le pire est à venir. Play 9 Songs With Mr Quintron est un disque parfait. Les 9 cuts sont d’épouvantables classiques du garage moderne. On sent même le vent du génie dans «Feel All Right», une vraie merveille de pulsatif définitif. C’est mouliné au riff insidieux, relancé aux raids de Memphis, à coups de I wanna know, et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue il faut voir comme. Avec «I May Be Gone», ça hurle dans les coursives. Voilà un cut possédé par le diable. Si on s’intéresse à la démence pure, c’est cet album qu’il faut écouter. Nouvelle exaction avec «I Don’t Wanna Live Alone», battu et rebattu au riff de fuzz. Voilà la magie des Oblivians. Ils nous sortent le meilleur stomp de Memphis et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue, comme s’il arrosait le stomp de crème anglaise un peu tiède. Ils tapent carrément dans l’exponentiel avec «Final Stretch» et Greg fait son numéro de hurlette des Hauts de Hurlevent. Tout est incroyablement dense et bon sur cet album. Et voilà «What’s The Matter Now», échantillon de Memphis punk explosé au coin du bois. Quelle énergie ! De vrais rebelles. Des invaincus ! Ces mecs sont tout simplement invincibles. Ils sont terrifiants de classe. Ils dépassent encore les bornes avec «Ride That Train». Et là on se dit que c’est trop. Trop de classe, trop d’énergie, trop de son, on voudrait leur dire d’arrêter, mais ils n’écoutent pas, ils explosent tous les standards de manière quasiment automatique. Ils pulsent jusqu’à l’aube et ils enchaînent avec un beat mortel de la mortadelle, «If Mother Know», le garage de la dernière chance, ils plombent le stomp du groove droit dans la grave, énorme et fatidique, pire que la rivière sans retour. Et Mr Quitron nous nappe ça impitoyablement. Ouf, on arrive au dernier cut, «Mary Lou», encore une abomination chantée d’autorité, ils crucifient le cercueil du garage qui va renaître sur la berge du Mississippi, ils sortent pour ça un beat buté et de la hurlette de dératé, et Mary Lou s’en va caramboler le firmament.

Il y a encore deux ou trois choses des Oblivians que tout esprit déviant doit écouter. Par exemple ce Best Of The Worst (93-97), capable de hanter un château d’Écosse. On y trouve un «Indian In Me» joué sur le sentier de la guerre, avec sa dose de référence au National Indian Reservation. C’est aussi sauvage que du Link Wray. On trouve aussi l’effarant «Bald Headed Woman», pur jus de trash-garage joué à la vrille de fuzz dégueulasse. Ils poussent le trash comme grand-mère, d’un coup d’épaule dans les orties. Même chose avec ce fantastique «Don’t Haunt Me» joué à l’admirabilité des choses, ils pataugent dans l’épaisseur d’un garage noyé de distorse, hanté par des cris d’horreur et des solos égarés. On retrouve des exactions comme «Hey Ma Look At Sis» et une version de «Locomotion» joué à la clameur virulente. «The Losing Hand» est l’archétype du trash d’Obliviande, fracassé à l’extrême. On se croirait chez le boucher, dans la pièce du fond. On trouve aussi une cover du «Alone Again Or» de Love et un «Kick Your Ass» enfoncé à coups de talon dans le néant du trou du cul du monde, et d’autre horreurs qu’il vaut mieux éviter d’écouter si on est d’une nature délicate, comme «Mad Lover», «Blew My Cool» ou «Everybody But Me». C’est l’affreux Long Gone John qui sortait ces disques sur son label Sympathy. Ah la canaille !

Il fit aussi paraître deux maxis, les fameuses Sympathy Sessions, avec des filles nues sur les pochettes. Ce n’est que du coup de génie à répétition, de l’overdose de garage fuzz trash joué à deux guitares invertébrées («Never Enough» et «Feel Real Good»), la beauté s’élève du chaos de distorse, il faut avoir vu ce spectacle au moins une fois dans sa vie. Ils font aussi du speed garage explosif et défonceur de rondelle des annales avec «Shut My Mouth». Le solo qui traverse le cut vaut pour une dégueulade de Memphis take.
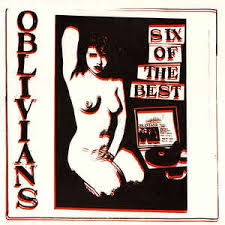
L’autre maxi s’appelle Six Of The Best, et dès «Clones», on tombe de la chaise, car c’est gratté au sec de la dépouille de Memphis. Ils savaient jouer de la guitare tuberculeuse. Ils rendaient aussi hommage aux racines du garage avec un «No Time» vitupéré et esquissaient l’avenir du garage moderne : gras et sale, saturé de crasse de son. «Memphis Creep» ? Laissez tomber, les gras. C’est au-delà du génie. Voilà un modèle de retenue et de tact trash absolument unique au monde. Sans commune mesure avec la mesure. C’est le garage du paradis des fosses à vidange. Ça continue avec l’infernal «Something For Nothing» et «Big Black Hole», pure tranche d’Obliviande fumante, jouée aux accords de gras double avec des wooohh dignes de Little Richard et un killer solo définitivement privé d’avenir.

Les Oblivians se reformèrent en 1993 et enregistrèrent Desperation, un album indispensable pour trois raisons. Un, l’«I’ll be Gone» d’ouverture de bal, du garage pilonné et harcelé par des arsouilleries mélodiques dont est si friand l’ami Greg. «Call The Police» flirte aussi avec le génie, d’autant plus que Mr Quintron et Miss Pussycat sont invités à participer au festin. C’est d’ailleurs Mr Quintron qui chante. On atteint une nouvelle fois les sommets du Memphis garage, c’est soutenu au meilleur beat et bien nappé d’orgue. Mr Quintron chante comme un diable. En B, on trouve la troisième raison : «Little War Child». Voilà la patte de Jack, cette incroyable aptitude à composer des cuts qui sonnent comme des hymnes dès la première mesure. C’est une réalité à laquelle il va falloir s’habituer, les gars : Jack-O est l’un des grands songwriters des temps modernes. On tombe plus loin sur «Back Street Hangout», encore du Jack, du vrai bardé de classe, une danse de décibels décidément dodus au dedans du doute et c’est comme visité par un solo aérien.
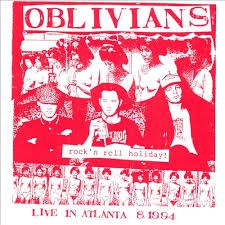
Il existe deux albums live des Oblivians, un Rock’n’Roll Holiday enregistré à Atlanta en 1994 et Barristers Ninetyfive paru en 2009. On s’en doute, c’est dans les deux cas du concentré d’insanité. Ils attaquent leur set d’Atlanta avec «Motorcycle Leather Boy» - Awite ! Let’s rock ! - Greg est complètement fou. C’est bizarre qu’on ne l’ait pas interné, à l’époque. Leur «Viet Nam War Blues» semble monté sur le riff de Death Party. «Love Killed My Brain» est l’un des hits planétaires des Oblivians. Greg le chante au gore de trash et «No Reason To Live» vaut pour un modèle d’insanité qui devrait servir de modèle dans toutes les facultés de médecine. Encore plus explosif, cette version de «Shut My Mouth» joué avec l’énergie du diable, il n’existe pas d’autre explication. Et on retrouve ces coucous inexorables que sont «Blew My Cool», «Shake Your Ass» et un «Nigger Rich» joué dans la pire des démesures, car gratté jusqu’à l’os du raw to the bone. Et ça se termine bien sûr dans la fournaise définitive avec «Never Change». Les Oblivians, ça ne pardonne pas.

Avec Barrister, on retrouve grosso-modo les mêmes excès. Greg hurle son «Losing Hand» à la vieille ramasse d’obliviande carabinée, c’est tellement mal foutu qu’on s’en étrangle de bonheur. Ah si on aime la délinquance juvénile et le foutraque, c’est eux qu’il faut écouter. Leur version de «We’re The Doll Rods» dégueule littéralement de distorse. Et ils battent comme plâtre ce pauvre «Mystery Girl». Ils atteignent là une sorte d’apothéose sauvage, ils clapotent dans leur bouillasse binaire de boudin de sang royal archétypal. Inutile de commenter la version de «Viet Nam War Blues», ni celle de «Pill Popper» qui ouvre la B. Ils sont sans pitié pour les canards boiteux. Jack passe au micro et à la guitare pour «Strong Come On» et il tâte de l’apanage de garage sacré avec «Let Him Try», offrande suprême aux dieux du garage des temps anciens. C’est en effet une reprise des mighty Makers. Il enchaîne cette merveille avec une autre merveille, «Black September», un cut de power-pop signé Jack-O, emmenée à train d’enfer après un faux départ. C’est dans la veine du grand Jack, cet immense songsmith. Il finit avec l’effarant «Clones», dans l’obliviande hachée poussée dans le tourbillon par un phrasé frelon.

Retour à Binic pour une belle tranche d’Obliviande saignante. Nos trois héros entrent dans l’ère de la reconnaissance puisque les voilà hissés en tête d’affiche. Cadre idéal pour ces figures de proue de l’underground américain, car ils jouent devant un public conquis d’avance, ce qui est généralement le cas dans les concerts gratuits. Les gens adorent tout ce qui est gratuit, même si la musique n’est pas d’un abord facile. Pour un néophyte ou un téléramiste, le trash-punk des Oblivians doit paraître un peu âpre. Mais c’est justement ce que cherchent les amateurs, la grosse âpreté, celle qui fait hocher la tête en rythme.

Quelle joie que de revoir arriver Greg Cartwright sur scène, avec sa dégaine de prof de math, et Eric Oblivian, avec sa dégaine de magasinier chez Renault. Derrière eux, l’éternellement jeune Jack bat le beurre pendant la première moitié du set. Ils enfilent leurs hits comme des perles et on sent bien qu’avec l’âge, ils finissent par se calmer. Ça fait tout de même trente ans qu’ils jouent ces classiques insurrectionnels, ne l’oublions pas. Eric et Greg claquent bien leurs accords au beignet de crabe, mais ils semblent vaccinés contre la rage. Ils n’ont plus cette démesure qu’on trouve encore chez les Gories. Quand on suit Greg Cartwright à la trace et donc son parcours discographique avec Reigning Sound, on sait qu’il aspire à des choses plus paisibles, ce qui n’est absolument pas le cas de Mick Collins, si on reste dans le parallèle avec les Gories, ni de Jack Yarber, comme on le voit lorsqu’il arrive au micro et qu’il commence à taper dans ses vieux coucous défenestrateurs comme «Blew My Cool».

Jack est le plus incorrigible des trois. Et on a vraiment l’impression de voir jouer une superstar. Il dégage ce type de rayonnement. C’est Jack qui relance cette prodigieuse locomotive, d’autant que derrière, son copain Greg tape comme un sourd sur les fûts. Chaque fois qu’on les voit jouer, on se dit qu’ils sont le groupe idéal, car en alternant les rôles, ils se débarrassent du problème que peut poser le leadership. Pas la moindre de frime non plus, chez ces gens-là. Ils ont tout bon.
Avant de former les Oblivians avec Eric Oblivian, Greg et Jack jouaient déjà dans les Compulsive Gamblers qu’il reformèrent après le split des Oblivians, en 1996. Un bon conseil, mettez le grappin sur les trois albums des Compulsive, car si vous appréciez le compulsif, vous serez compulsé comme il se doit.
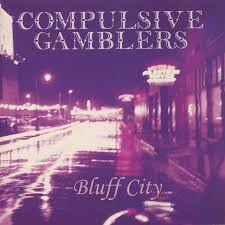
Bluff City et Crystal Gazing Luck Amazing sont leurs deux albums enregistrés en studio et dès Bluff, on sent le trio accompli, à l’immense majorité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Bluff City est le surnom de Memphis, de la même façon que Brum City est le surnom de Birmingham. On trouve une grosse pièce de stonesy sur Bluff, «I Call You Mine». En gros, ça sonne comme «The Last Time» gratté par les Who. Greg brame ça dans la Brum de Bluff. Quelle persévérance dans la latence ! On retrouve en B le fameux «Don’t Haunt Me» joué au heavy groove des familles. On retrouve l’énergie de l’Obliviande dans «X Ray Eyes», pour cette fois une petite pointe d’excellence de la consistance. C’est en plus superbement soloté et avenant en diable. On les sent sans peur et sans reproche, libres comme l’air, bercés par les alizés et avides de bon temps. Il faut aussi écouter «Mystery Girl», rudement bien secoué du bocal et réveillé en sursaut par des clameurs soniques, des petits retours de manivelle et une belle dose de ramasse à la clé de sol.

Crystal Gazing est encore plus énervé. On le voit bien, dès le premier cut, «The Way I Feel About You», riffé à l’Obliviande et chanté à la tendance mélodique. Tout y est : l’impatience, les échappées, les départs de feux et l’ébullition. Deux autres merveilles illuminent l’A : «Negative Jerk», garage punk emmené à train d’enfer, et «Stop And Think Over», magnifique hit de power pop incroyablement lumineuse, une vraie perle rare, bien portée par son élégante bassline. C’est à la fois inspiré, brillant, élancé et sans faille. On est à Memphis, ne l’oublions pas. La B vaut aussi le détour avec des choses comme «I’m That Guy», monté sur les accords de «Gloria». Personne n’ira leur faire des reproches. Ils ont le droit de pomper Gloria. Ils tapent aussi dans un vieux hit de Nolan Strong composé par Miss Deborah Brown, la patronne de Fortune Records, «(I Want To Be Your) Your Happiness». Ils jouent à l’Obliviande caractérisée, ils en sortent une version incroyablement musclée. Cut idéal pour des esprits aussi libres que ceux de Jack et de Greg, et puis on se régale de ce petit départ en solo. Ils sont parfaits. Encore un hit de Jack avec «Rock’n’Roll Nurse», lancinant et vaillant à la fois, slow & hypnotic comme dirait Long Gone Jone.
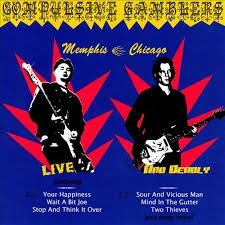
Live And Deadly - Memphis/Chicago vaut le détour, car ça saute à la gorge dès «Your Happiness», reprise du cut de Deborah Brown. Jack et Greg en font un hit ensorcelant. Ils shootent toute leur énergie dans le cul ridé de cette vieille pépite de soul. Rien que pour cette reprise, l’album vaut d’être rapatrié. Attention, ce n’est pas fini. Ils nous font du Question Mark & the Mysterians avec «I’m That Guy». C’est nappé d’orgue, avec de la tension garage - In my room/ All alone - et la montée de fièvre qui va avec - Baby I’m that guy on about - et ils oh-yeatent comme des brutes. Avec «Stop And Think Over It», Greg revient à sa chère power pop. Il laisse échapper des floppées de notes multicolores. Voilà une pop de rêve digne des Nerves. On reste dans l’énormité avec un «Two Wrongs Don’t Make A Right» terriblement alerte, bardé de nappes d’orgue et de gros accords dylanesques. Si ce n’est pas du génie, alors qu’est-ce que c’est ? On voit encore l’immensité du talent cartwrightien s’étendre à perte de vue avec «I Don’t Want To Laugh At You». On sent que Greg a bouffé du Dylan et de la soul. Ça lui ressort par tous les pores de la peau. Il en deviendrait presque visionnaire.
Et si on mettait le nez dans les albums solo de Jack ? Il faut bien dire que Jack-O ne chôme pas depuis 1997. Son palmarès est franchement éblouissant. Dans l’underground, il reste une star et ceux qui le connaissent pour l’avoir vu jouer soit avec les Oblivians à la Maroquinerie, soit avec les Knaughty Knights au Point Éphémère ou avec les Cool Jerks à l’Espace B, oui tous ceux là savent qu’il l’avoir à l’œîl. Partons du principe suivant : sur chaque album solo de Jack-O se niche un hit planétaire.
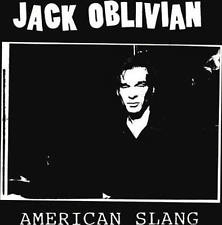
Il a commencé sa «carrière» solo par deux maxis, American Slang et So Low. L’«American Slang» qui donne son titre au premier maxi sonne comme un hymne. Jack-O chante perché, comme s’il reprenait un hit des Dictators. C’est même gonflé par des guitares à la Johnny Thunders. Quel jus ! Scott Bomar joue une belle partie de basse sur «Hustler» et on retrouve le foutraque typique du Memphis Sound. En B, ils tapent un «Got The Funky Blues» au beat tribal à la Captain Beefheart et Jack s’amuse bien avec «Out Of Tune», un groove bien gras et bien râblé.

Sur So Low, on trouve un «Shake It Off» gratté à la sauvage par Greg. Ils sortent là un vrai son primitif, un incroyable désossé de la désaille. Toute la science ancestrale est exacte au rendez-vous. Ils tapent ensuite une belle reprise des Dolls, «Trash» et Jack finit l’A avec un fantastique «Let Me Be Your Chauffeur». En B, on retrouve un léger parfum de Magic Band dans «You Made Me Crazy», très dada dans l’esprit et saxé à la basse du néant.

À partir de là, Jack-O va embarquer avec lui une fière équipe, The Tennessee Tearjerkers et enregistrer de solides albums, comme ce Don’t Throw Your Love Away paru en 2001. Il y rend un fantastique hommage à Dylan avec un cut intitulé «Still Got It Bad», un balladif de poids nappé d’orgue Hammond. Il ne faut surtout pas prendre Jack-O pour un amateur ou un bricoleur du dimanche. Ce mec navigue dans la cour des grands, en compagnie de gens comme Frank Black ou Robert Pollard. L’«Ain’t Got No Money» qui ouvre le bal de l’A est tout simplement claqué au riff royal de Memphis et brouté aux nappes d’orgue. C’est nettement au dessus de la moyenne. «Dope Sniffin’ Dog» relève de l’énormité garagiste, car c’est alarmé du cortex avec des yeah de baryton à la Iggy. Voilà le garage dont Jack-O a le secret, un garage à fort parfum stoogien dans la façon de ramper sur les braises en poussant des yeah miséricordieux. Il revient à sa passion dylanesque en B avec un «Flash Cube» extraordinaire d’élégance. Encore un cut puissant et inspiré. Il tâte plus loin du solide romp de rock avec «Fire» et le farcit de dégelées de guitare fratricides. Ces gens-là savent brûler Rome.

Il continue de faire du Dylanex sur Jack-O Is The Flipside Kid. Le cut se trouve en B et s’appelle «Black Boot». Jack-O sonne tout bêtement comme le grand Bob de l’âge d’or. Mark Sultan l’accompagne à la batterie. On a aussi un coup de génie avec le cut qui donne son titre à l’album : «Flip Side Kid». Il s’agit là d’un rock à vocation de stonesy, mais orienté vers Memphis. On assiste là à l’explosion d’une véritable clameur d’envergure brutale. Jack-O tire ça à la force du poignet et place un solo d’antho à Toto. On retrouve aussi sur cet album des gens comme Jimbo Mathus et Harlan T. Bobo. Les autres hits sont en B, notamment ce «I Live For Today», battu par Mark Sultan. Jack-O y pétrit sa pop flamboyante et rend une nouvelle fois hommage à Bob Dylan. Il reprend aussi le fameux «The Man Who Loved Cough Dancing» de Mr. Jeffrey Evans et en fait une version instro superbe. Jack-O retrouve plus loin son cher débraillé foutraque avec «Night Owl», espèce d’apothéose de good time music et boucle avec une stoogerie de haut rang, «I Want You» joué au reptilien, nappé d’orgue et chanté dans la torpeur d’une profonde inquiétude paranoïaque.

Encore un énorme album avec The Disco Outlaw. Il l’attaque avec «Ditch Road», un fantastique cut de pop rock du Tennessee. Jack-O est un auteur classique qui sait monter des coups fumants. Son cut est imparable, éclairé par le jeu du guitariste John Paul Keith et soutenu par la belle bassline d’Harlan T. Bobo. Tous les morceaux de cet album sont fouillés, chargés de son, bien construits, On goûte la succulence de l’effarance avec «Against The Wall» qui sonne comme un classique avec des vieux relents de «Drop Out Boogie». «Make Your Mind Up» sonne comme un hit pop planétaire. Voilà de quoi notre héros se montre capable. C’est digne des meilleurs jukes et troussé à la hussarde. Il prend ensuite «Sweet Thang» à l’hypno de Memphis, et ça trépide, avec une grâce infernale. Quelle énergie et quelle puissance dévastatrice ! En B, John Paul Keith embarque «Scratchy» dans la clameur d’un solo incendiaire. Ils nous explosent ce vieux classique des sixties. Et ça va se terminer avec «Stop Stalling» bien soutenu à l’orgue et «Walk Of Shame», un nouvel hymne pop. Ce mec n’enregistre que des disques condamnés à l’île déserte.

Encore un maxi avec Saturday Night Part 2 et au moins quatre raisons de le rapatrier. Un, «Mad Love Pt 2», pur jus de garage de Memphis, rythmé au foutoir de grosse caisse et John Paul Keith joue un solo à l’insidieuse. Deux, «Milkshake Baby» qui ouvre la B avec un riffing sauvage et dévoyé, ambiance Cubist Blues, c’est-à-dire groove urbain avec des faux airs d’Alan Vega. S’ensuit la troisième raison, «Make Your Mind Pt 2», joué à la dépouille, à la fois classieux et classique. Et quatre, «Against The Wall Pt 2», toujours dans l’insidieuse, avec ce vieux relent beefhartien et joué au gras double.

Les Tearjerkers entrent dans la légende en 1999 avec l’album Bad Mood Rising. Explosion d’énergie dès «White Lie Black Eye». Ça dégouline de jus. Scott Bomar joue de la basse. Retour à la power-pop de sang royal avec «Stupid Cupid». Ça sent bon le Big Star Sound et la complexité pharaonique de la belle pop américaine. En B, il faut absolument écouter «Head Of The Class Clowns», qui sonne bien dès la première mesure. Voilà le génie garage de Jack Yarber. Il enchaîne ça avec un autre cut brillant, «Earthquake Date», du garage punk dératé monté au riff sur-puissant.
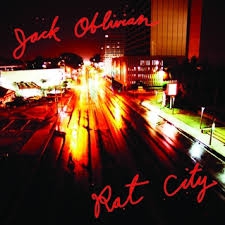
On frôle un peu l’overdose avec tous ces disques, et pourtant on y revient. Tiens ! Voilà Rat City paru en 2011 sur Fat Possum. Ce n’est pas compliqué, on y trouve deux hits, à commencer par celui qui donne son titre à l’album, qui est lancé comme une locomotive et Jack-O se montre une fois de plus imparable et lumineux. Quand on voyait ce mec traîner à l’espace B le jour du concert des Cool Jerks, on n’était pas loin de penser qu’il avait au pire une allure de rock star et au mieux le charisme d’un messie. John Paul Keith joue lead dans «Mass Confusion», monté sur un beau beat funky. Ça pulse comme au temps de l’âge d’or du swamp funk. L’autre hit du disque c’est bien sûr «Kidnapper», doté d’un fort parfum de country rock et finement nappé d’orgue. On y retrouve tout l’allant du rock du Tennessee.
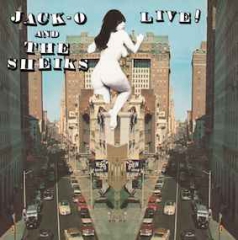
Jack-O se produit maintenant avec une nouvelle formation, Jack Oblivian & The Sheiks, et un premier album intitulé Live. Quatre bombes sur cet album, à commencer par le retour du vieil «American Slang» tiré de son premier mini-album solo. Fabuleux classique de power-pop. Imparable et juteux. Jack Yarber reste avec le temps désarmant de fraîcheur et d’aisance. Avec une telle entrée en matière, la partie est gagnée d’avance. Il ressort aussi l’infernal «Black Boots» digne des grands hits de Bob Dylan. Il éclate ça au ramalama d’accords magiques. Il ressort aussi ses vieux hits, «Night Owl» et «Flash Cube». En B, on retrouve l’excellent «Little War Child», belle tranche de power-pop universaliste. Avec Jack-O, ça joue avec le feu, ça lève le vent, ça file droit au cœur et ça mène au but. Il finit en beauté avec son vieux «Strong Come On» de l’époque des Oblivians.

Jack Oblivian & The Sheiks viennent d’enregistrer un nouvel album, The Lone Ranger Of Love. Eh oui, encore un album surprenant et si dense ! Trois merveilles caractérisées s’y nichent, à commencer par l’infernal «Hey Killer», une pop à la Jack-O pleine d’allant. Il faut l’entendre emmener ça fièrement à l’assaut des hit-parades ! Même chose avec «Downtown», pur Jack-O jive, écœurant de classe garage. On se noie dans une sauce d’obédience obliviande. D’autres gros cuts avec «Blind Love», dégringolade d’exception qui brille dans la nuit comme une idée géniale, et «Boy In A Bubble» qui marque un retour au garage. En B, attention au morceau titre, car il sonne un peu comme «Teenage Head» et un petit serpent de solo gras l’enfile en douce. On se régalera aussi des deux parties de «La Charra» grattée au gratin de menace dauphinoise, c’est joué au harcèlement apache, à petites touches infectueuses. Par contre, avec «Run Like The Wind», Jack tape un groove salubre émaillé de piano à la Aladdin Sane, dans une ambiance digne de Soon Over Babaluma. C’est à la fois exceptionnel et surprenant.

Jack monta les Cool Jerks avec David Boyer des Neckbones et ils enregistrèrent l’excellent Cleaned A Lot Of Plates In Memphis en 2002. On sent chez David Boyer une forte influence des Dolls et des Stones. «Not The Only Girl In Town» sent bon le vieux boogie des Dolls. C’est très inspiré. Ce mec semble totalement fasciné. On pourrait dire la même chose de «Who You Running To», car ça sonne comme un hit des Stones de la grande poque. On sent que David Boyer peaufine ses préférences. Avec «Why Can I», Jack et David passent directement au coup de génie. Ce démon de Jack Yarber ravage tout. Et il vrille la charpente du cut à coup de solo insidieux. Jack est vraiment le roi de la bravado. Encore de l’énormité à gogo avec «Got Damned Again» et un «Certified Fool» embarqué au riff diabolo. Voilà comme sonne le rock échevelé de Memphis, puissant et définitif. Tout l’album est bon. Trop bon. Jack pulvérise «Let’s Go And Rock» et nous fait même friser l’overdose avec «Friend Of A Loner» qui sonne tout simplement comme un hymne.

N’oublions pas l’épisode South Filthy, conglomérat de notables puisqu’on y trouve Monsieur Jeffrey Evans, Walter Daniels et bien sûr Jack Yarber. Trois album, même quatre, si on ajoute l’excellent Melissa’s Garage Revisisted paru en 1999. Leur boogie sent le fauve, on le voit tout de suite avec «It Don’t Take Too Much». Ils semblent possédés par le diable, mais un diable particulier, celui du Tennessee. Le «Rocking In The Graveyard» qui suit semble lui aussi ravagé par des guerres intestines, et c’est monté sur un beat rebondi et noyé dans le gras double. Nos amis les franc-tireurs s’amusent à créer du garage ténébreux, chargé de maladies et très insécurisé. Ils font une surprenante reprise de Marty Robbins, avec «Don’t Worry», bien congestionnée par un solo de déglingue affreusement malsaine. Ces rebs sont très indisciplinés. Dans «The Darker The Berry», la voix de Jeffrey Evans est couverte par une fuzz acariâtre. Ils tapent plus loin dans Lowell Fulson avec un «Bending Like A Willow Tree» assez furieux. Sacré disque. Aucune concession.

Le premier album de South Filthy s’appelle You Can Name It Yo Mammy If You Wanna. Sur la pochette, on voit une pute noire. Image très impressionnante. Les cuts sont à l’image de la pochette, marginalisés d’office. Justement ils attaquent avec un «Bad Girl» foutraque que Walter Daniels vient hanter à coups d’harmo. Quelle santé ! Monsieur Jeffrey Evans renoue avec le génie dès «Hot Dog», joué à la stand-up. C’est du pur rockab de Memphis. Puis il tape dans Wolf avec «Somebody In My Home». Là on ne rigole plus. Jeffrey Evans fait tout le boulot et il wahaoooute à la lune. Il chante du nez et recrée le temps d’un cut l’illusion de la légende de Wolf. Et comme si de rien n’était, il passe à la country magique, celle de Memphis qui ne doit rien à celle de Nashville. Il faut écouter ce «Sandra Lynn’s Blues» pour bien comprendre la différence. Jim Dickinson en parlait d’ailleurs très bien - I’m gonna marry her some day/ Some day - Encore une énormité avec «LA Country Jail» du boogie rock à tomber de sa chaise. C’est crédité Jeffery Lee Pierce et John Schooley y joue de la slide. Notre collectif intrépide reste dans l’excellence du boogie avec «First Train Away From You», une compo signée Jack. Si on aime les tours de magie, alors il faut écouter «Spyder Blues» de Monsieur Jeffrey Evans, un authentique blues de cabane - It’s called spyder blues/ Cripplin’ around my window before the sun - Rien de plus inspiré.
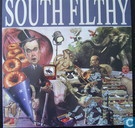
Jack retrouve ses amis Monsieur Jeffrey Evans, Jimbo Mathus, Walter Daniels et tous les autres sur Crackin’ Up, un album bardé de reprises superbes, dont un Wolf qui s’appelle «You Can’t Put Me Out» - I’m so down/ You can’t put me out whoooo-ouuuhhhh - pure énormité. On trouve aussi un fabuleux «Ran Out Of Run» qui sonne comme un classique dylanesque. Monsieur Jeffrey Evans y raconte ses mémoires. Encore du dylanesque avec «Original Mixed-Up Kid» qui est en réalité une reprise de Ian Hunter - Pour la petite histoire rappelons que Guy Stevens voulait monter un groupe qui sonnât à la fois comme Dylan et les Stones, et ce fut Mott The Hoople - Et donc Hunter se mit à pomper Dylan pour composer. Le hit de cet album se niche aussi en B. Il s’agit de «Ol Brush Arbor», un balladif folkah de Monsieur Jeffrey Evans qui tourne à l’enchantement. Et Eugene Chadbourne vient jouer du banjo sur «Flaming Star» - When I see the flaming star/ I know the time has come - Jack prend le micro pour «C’mon Let’s Monkey» et il mène la danse, comme il sait si bien le faire.
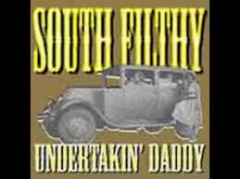
Tiens, encore un sacré disque ! Undertaking Daddy est sorti sur Beast en 2009, oui, sur ce petit label rennais qui fait maintenant tout le boulot. Si vous aimez le boogie foutraque à la sauce de Memphis, alors il faut écouter «The House On Old Lonesome Road», emmené par Monsieur Jeffrey Evans au pas de charge. Voilà du vieux boogie de bois sec tartiné à coups d’harmo. C’est d’ailleurs le seul morceau de l’album sur lequel joue Jack. Ils font ensuite une reprise du cut de Bo que préfère Keef, «Bring It To Jerome». Monsieur Jeffrey Evans en fait du Wolf ! Ils finissant l’A avec deux autres boogies de haute volée de bois vert dont un «Dimples» sacrément secoué du cocotier. Monsieur Jeffrey Evans attaque la B avec un coup de rockab de Memphis, «Watching The 710 Roll By», une espèce de modèle du genre, histoire de rappeler que tout a commencé dans cette bonne ville du Tennessee.

Pendant ce temps, Greg Cartwright n’est pas resté inactif. Il jouait dans des groupes comme des Detroit Cobras et en produisait d’autres comme Mr Airplane Man. Avant de monter de Reigning Sound, Greg s’est amusé à enregistrer un album complètement foireux, «Head Shop». On avait commandé ce disque directement chez Long Gone John, en Californie. Ah la tête qu’on a tiré quand on a écouté ça !

Et puis avec Coco des Ettes, il a monté en 2010 les Parting Gifts et enregistré un album qui nous console de toutes nos peines, Strychnine Dandelion. C’est encore un album de l’île déserte, car les hits y pullulent. Ils chantent à deux «Bound To Let Me Down» et ça donne un cut qui pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc des Beatles, avec sa belle ambiance rondouillette. Une merveille. C’est la pop de rêve que Greg n’avait peut-être pas réussi à sortir avec les Detroit Cobras. Notons au passage qu’on retrouve les deux Black Keys sur cet album. «Starring» sonne comme un hit. C’est un hommage magistral à baby’s in black - And yesterday ain’t coming back/ It’s time to start to think about that - Il enchaîne avec un «Don’t Stop» très punky et infesté de killer solos. Greg les étale dans la poussière, les deux bras en croix. Une vraie furie ! On trouve trois hits monstrueux enchaînés en B : «Don’t Hurt Me Now», chanté au grégorien de haut rang et joué très sixties à l’encorbellement licencieux qui telle la liane enserre la colonne du temple d’Amon. Justement voilà «Hanna», encore du grand art grégorien. Sa pop a quelque chose de profondément infectueux, il faut bien le reconnaître. Elle finit toujours par nous avoir - That’s how it’s gonna stay ! - Et le festival se poursuit avec «I Don’t Wanna Be Like This», une fantastique échappée belle de pop visionnaire. Goûtez donc la puissance du refrain, c’est joué à grands coups de reins, ça jute dans l’énormité et voilà encore un hit intemporel ! Il faut aussi écouter le cut qui donne son titre à l’album, car il dérouterait n’importe quel cargo. Et le «This House Ain’t A Home» qui referme la marche est lui aussi de qualité supérieure.
Signé : Cazengler, obli terré
Oblivians. Binic Folk Blues Festival (22). 30 juillet 2016
Oblivians. Soul Food. Crypt Records 1995
Oblivians. Popular Favorites. Crypt Records 1996
Oblivians. Rock’n’Roll Holiday. Negro Records 1996
Oblivians. Play 9 Songs With Mr Quintron. Crypt Records 1997
Oblivians. Barristers Ninetyfive. In The Red Recordings 2009
Oblivians. Desperation. In The Red Recordings 2013

Oblivians. Never Enough. Sympathy For The Record Industry 1994
Oblivians. Six Of The Best. Sympathy For The Record Industry 1995
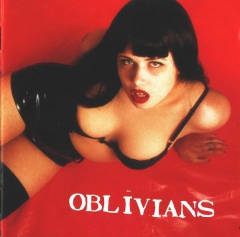
Oblivians. Sympathy Sessions. Sympathy For The Record Industry 1996
Oblivians. Best Of The Worst (93-97). Sympathy For The Record Industry 2000
Jack Oblivian. American Slang. Sympathy For The Record Industry 1997
Jack Oblivian. So Low. Sympathy For The Record Industry 1998
Greg Oblivian & The Tip Tops. Head Shop. Sympathy For The Record Industry 1998
Compulsive Gamblers. Bluff City. Sympathy For The Record Industry 1999
Tearjerkers. Bad Mood Rising. Sympathy For The Record Industry 1999
Walter Daniels, Oblivians & Monsieur Jeffrey Evans. Melissas’s Garage Revisited. SFTRI 1999
Compulsive Gamblers. Crystal Gazing Luck Amazing. Sympathy For The Record Industry 2000
Compulsive Gamblers. Live And Deadly - Memphis/Chicago. Sympathy For The Record Industry 2003
Jack-O & The Tearjerkers. Don’t Throw Your Love Away. Sympathy For The Record Industry 2001
Cool Jerks. Cleaned A Lot Of Plates In Memphis. Sympathy For The Record Industry 2002
South Filthy. You Can Name it Yo Mammy If You Wanna. Sympathy For The Record Industry 2002
South Filthy. Crackin’ Up. Rockin’ Bones 2005
South Filthy. Undertaking Daddy. Beast Records 2009
Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. Jack-O Is The Flipside Kid. Sympathy For The Record Industry 2006
Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. The Disco Outlaw. Goner Records 2009
Jack Oblivian. Saturday Night Part 2. Big Legal Mess records 2009
Parting Gifts. Strychnine Dandelion. In The Red Recordings 2010
Jack Oblivian. Rat City. Big Legal Mess records 2011
Jack Oblivian & The Sheiks. Live. Red Lounge Records 2014
Jack Oblivian & The Sheiks. The Lone Ranger Of Love. Mony Records 2016
LES ANGES NOIRS
I
JIM MORRISON
ET LE DIABLE BOITEUX
MICHEL EMBARECK
( L'Archipel / Août 2016 )
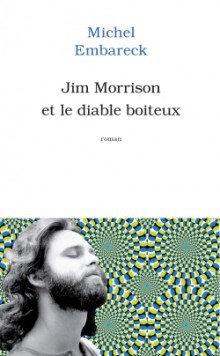
Tout se perd dans ce bas monde. Parfois les perles les plus belles gisent au fond de la mangeoire des pourceaux. C'est dans Les Echos - torchon économique à la solde du libéralisme - que j'ai appris la sortie de Jim Morrrison et Le Diable Boiteux. Et de Michel Embareck, par-dessus le marché ! Un gars que je connais depuis toujours. Je n'exagère pas, l'est né un an après moi, le jeunot. L'a ses lettres de noblesse, publie dans la Noire de Gallimard des polars plus sombres que l'encre des rotatives les plus désespérées, et l'a écrit en sa jeunesse dans un des meilleurs french canards rock, logiquement vous avez reconnu le mensuel Best. Cela vous classe un homme. Ce qui ne l'empêche pas, comme tout un chacun de se poser des questions. Attention amis rockers, le titre est trompeur, le bandeau de couverture - beau portrait du Roi Lézard sur fond de rosaces psychédéliques - aussi. Pour le diable boiteux, faut être un peu initié, référence au titre d'un reportage de Bonjour Les Amis sur... Gene Vincent.

L'est parfois des problèmes qui vous turlupinent durant des années. Pour Michel Embareck, une de ses obsessions réside en l'étrange amitié qui unit de 1968 à 1971 Gene Vincent et Jim Morrison. Quoi de plus normal que deux chanteurs de rock aiment à se rencontrer autour d'un verre ? Avec Jim et Gene, nous ajouterons plusieurs tournées. J'apporte mon témoignage personnel. L'annonce de cette fréquentation me sembla en ces époques couler de source. Expression ô combien malheureuse pour ces deux alcooliques pas du tout anonymes. Fus simplement déçu que Jim n'ait pas été présent sur la cire de I'm Back I'm Proud ( 1969 ) comme l'annonce qui avait fuité le laissait espérer. Cela eût permis de relancer la carrière de Gene. L'on parla de clauses de contrats chez Elektra incompatibles. N'en suis point sûr, Gene fut le prince noir des occasions perdues.

L'est un point de vue d'Embareck qui m'embarrasse. Assure que Jim et Gene étaient de la même génération. Aristote selon qui l'écart qui sépare deux générations est de quatorze ans et demi - le temps d'être en état érectif et menstruel de procréation - lui donne raison puisque Gene naquit en 1935 et Jim en 1943. N'empêche que chacun s'inscrit dans une époque différente. Gene est un pionnier du rock et Jim Morrison un épigone. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une scène très symbolique, le show d'Elvis à la TV sur NBC en 1968, que visionne Jim en compagnie de sa mère horrifiée - point par Presley, par son rejeton - une autre manière de tuer le père. Phantasmatiquement parlant le paternel n'est pas le géniteur. Le rôle du backdoorman - l'amant qui passe par la porte de service - pour Jim ce n'est pas Elvis, mais Gene Vincent. La vie est un miroir. Le reflet que vous entrevoyez n'est pas toujours ce que l'on croit voir. Le roman nous offre la même scène avec un triomino équivalent, Elvis sur l'écran, maman Craddock plus aimante, et le fiston Gene, beaucoup plus sympathique envers le personnage du Pelvis, car exempt de ressentiment, n'est pas jaloux de la carrière du King, l'a simplement été plus malin, l'a su tirer son épingle du jeu, avant que la partie ne devienne trop dangereuse.

Tout est question de trajectoire. Gene aborde la courbe descendante de sa course folle avec le diable - pas le cornu, cette partie noire que chacun porte en dedans de soi - et Jim sur sa lancée zénithale, est un des phares les plus illustres du mouvement hippie. Mais les apparences sont trompeuses. Tout échec comporte son point nodal de réussite symbolique et toute brillance un coeur d'ombre qui ne demande qu'à battre de plus en plus fort. Tout les sépare, Jim est le fils d'un amiral, en cheville avec la CIA pour les coups fourrés, rempli de principes, Gene est le rejeton d'un petit épicier bourré du matin au soir. Famille bourgeoise pour l'un et prolétarienne pour l'autre. Jim peut se permettre les caprices d'une rockstar et Gene cachetonne pour survivre. Mais à chacun ses failles.

Chez Gene, l'est grosse comme une maison. S'aperçoit dès le premier coup d'oeil. Sa blessure à la jambe, son atèle, ses os broyés. Insupportable douleur physique, alcool et morphine sont ses deux médicaments préférés. Mais il y a des fêlures plus insidieuses, le sentiment de s'être fait avoir par sa maison de disques, par ses managers, par les avocats, et encore plus ce relent de culpabilité qu'éprouvent ceux qui rejettent la faute de leur situation sur eux-même, leur inexpérience, leur naïveté, leur jeunesse...

Chez Jim, ne faut pas chercher bien loin la poutre qui vous crève les yeux. Un enfant instable, un mytho, s'invente des vies parallèles car la sienne ne lui appartient pas. L'est reconnu comme un des plus grands chanteurs de son époque, cela lui fait comme à Gene Vincent une belle jambe. Veut bien chanter si ça vous procure du plaisir et si ça rapporte la liberté qu'offre le pognon. Lui se voit plutôt en cinéaste ou en poëte. Embareck le rembarre sec, question ciné ne connaît pas grand chose, quant à ses écrits sont du genre illisible cafouilleux. Se fait même aider par un prof de fac pour les améliorer. Heureusement qu'Embareck n'a pas été critique littéraire, serait à l'heure actuelle l'homme le plus haï de l'hexagone !

L'on a dressé le portrait de nos deux héros. L'en existe un troisième, un chargé de liaison, joue le rôle de la boîte à lettres des récits d'espionnage, mais nous n'en causerons point, l'est fictif. Une composition d'écrivain, un truc chiadé à mort, qui pue le blues. Fantôche parce que " Entre la vérité et le mensonge existe une zone libre appelée roman". L'épigraphe du bouquin n'est pas une seconde citation d'Aristote, provient de Victor Boudreaux. Moins connu que le stagyrite, je vous l'accorde, mais qui exerce une profession fort honorable, celle d'un privé aux méthodes expéditives qui sévit dans les romans de Michel Embareck. Grattez l'écorce de l'arbre, dessous vous trouverez ce même bois qui part en fumée dès que l'on approche une allumette pour y voir plus clair. L'est vrai que l'on n'y zieute que du bleu. Du blues, car le rock en sort et y retourne. Du blues de blancs. De nègres blancs. De petits blancs. Ne faut pas exagérer non plus. Ne mélangeons pas les torchons noirs de misère avec les serviettes amidonnées aux traces séminalement suspectes. Pour Jim ce sera taches de poésie blues, et balafres de bluesy ballades pour Gene.

Pour l'histoire, ne comptez pas sur moi pour vous la raconter. Parce que vous la connaissez déjà... Alice Cooper, Toronto, John Lennon... Parce que ce livre doit impérativement faire partie de votre bibliothèque. Pour vous donner l'alcool à la bouche, je vous dirai que c'est une espèce de road-movie. En territoire d'Amérique, le pays mythique où l'on n'arrive jamais. L'est vrai que les stations - christiques et à essence - ne manquent pas. Bar à babord. Bar à Tribord. Particulièrement réussie, émouvante et sardonique, la partie qui traite des pérégrinations de Vincent de par chez nous, et morceau de bravoure, l'hommage rendu à ce dernier carré de fans français qui portèrent l'ultime carrière de Gene à bout de bras. Notons au passage combien le fantôme de Gene Vincent s'inscrit de plus en plus profondément dans les soubassements opératifs de l'imaginaire littéraire national.

Evidemment, les héros meurent. On le savait avant de commencer la lecture, mais ces scènes finales font toujours aussi mal. Embareck, de la race des polaroïdes, lève le voile pour mieux recouvrir le mystère des choses définitives. En trois mots : sex, drugs and rock'n'roll. Ce Michel Embareck, nous ne serions point offusqués si après un tel livre il signait le prochain : Michel Embarock.
II
LES ANNEES VINCE TAYLOR
DE JACQUES BARSAMIAN
( Jukebox N° 331 / Septembre 2016 )

Pas tout à fait un article, une interview de Jacques Barsamian par le regretté Bernard Boyat. Parle de Vince Taylor mais aussi de lui-même. Non qu'il ait la grosse tête, mais sa vie fut si proche de celle de Vince qu'il est impossible de séparer les deux moitiés de la poire empoisonnée. Espérons au passage qu'il soit déjà venu à Jacques Barsamian l'idée opportune d'écrire la saga de son existence consubstantiellement mêlée à l'histoire du rock français, depuis ses origines, avant même qu'il ne commence, car il était déjà présent en Angleterre avant que les étincelles de la musique du diable ne traversassent le Chanel.
Barsamian témoigne du passage surprise de Vince Taylor au Musicorama d'Europe 1 du 7 novembre 1961. Fut subjugué par la beauté de sa prestation. Mais ce n'est qu'en 1966 que par un concours de circonstances - travaillait alors à Disco Revue - il se retrouva à chercher des engagements pour Vince puis à endosser le rôle ingrat du manager. Pas une sinécure. Nous sommes loin des années flamboyantes de Vince. Les braises lysurgiques ont cramé le cerveau de Vince. Rien ne sera plus jamais pareil à la légende dorée des débuts. Barsamian arrêtera les frais en avril 1968. Raconte donc ces trois années de folie à essayer de remettre sur pied la carrière de Vince, notamment la fameuse tournée de L'épopée du Rock.

Barsamian parle sans acrimonies, nettement, mais avec pudeur. L'étoile noire avait perdu de sa splendeur. Sa course était erratique. Capable de tout. Et même de sursauts prodigieux. Le temps d'un concert, tout redevenait comme avant, les incertitudes étaient abolies, Vince était de nouveau le grand Vince Taylor. Mais le soufflet retombait aussi vite qu'il avait monté. Vince se mure en lui-même. Assis sans bouger dans sa chambre. Perdu et inaccessible. Parfois le rocker était aux abonnés accents, mais l'homme de chair restait là comme en attente d'une impossible résurrection.
Certains n'ont pas hésité de parler de déchéance. Plutôt un volcan endormi. Semble inoffensif. Mais Vince était de ceux qui avaient chaussé les sandales d'Empédocle. On le croyait paumé, l'était en train d'explorer les coulées de lave intérieures. Parfois il ressortait de son étrange cauchemar. Sa parole, comme à côté du réel, était incompréhensible car elle portait les scories du futur, mais qui aurait pu s'en rendre compte ? Son existence répondit à la seule question essentielle : qu' y-a-t-il au bout du rock'n'roll ? Répondit de la seule manière adéquate à ce no future interrogatif : érigea son existence en un silence nietzschéen. Une vie de rocker par-delà le rock'n'roll.
III
EDGAR ALLAN POE
LETTRES D'AMOUR A HELEN
( PRESENTEES ET TRADUITES
PAR CECIL GEORGES-BAZILE
et LAURENCE PICCININ )
( Editions Dilecta / Mai 2006 )

Le premier de tous les rockers américains. Par ordre chronologique. Par importance. Avec Edgar Allan Poe, le romantisme européen prend une autre tournure. Finies les plaintes élégiaques, désormais ce sera une implication existentielle, exunt les grandes révoltes sociales, le rêve replie ses ailes et s'enferme en lui-même, terminés les châteaux écossais peuplés de fantômes revanchards, tout se joue dans la citadelle intérieure assaillie par des monstres engendrés par d'atroces phénomènes auto-immunes... Edgar Poe plume le volatile des représentations extérieures jusqu'à l'os.
Ces lettres d'Edgar Poe ne sont pas inédites. Sont abondamment citées dans les biographies, mais ici resserrées en leur unicité, elles apparaissent en leur froissement êtral. Il faut l'avouer, le lecteur français a pris l'habitude de passer un peu vite sur les dernières tentatives amoureuses du poëte. Des scories désagréables, quelle femelle aurait pu rivaliser avec la virginale Virginie ? Aucune. La réponse est ferme et inébranlable. Généralement du bout des lèvres, l'on conçoit que le poëte ait pu penser à la nécessité d'une sécurité matérielle indispensable à l'émergence des dernières grandes oeuvres. Le coucou - oiseau de mauvais augure - ne pond-il pas ses oeufs dans les nids étrangers ?

Nous aurions dû être plus attentif. Mallarmé nous y avait engagé, n'avait-il pas entretenu une correspondance avec Sarah Helen Whitman, lors de sa traduction des poèmes du Sphinx ? Ne lui avait-il pas adressé son sonnet hommagial ? Non, Sarah Helen Witman ne fut pas une groupie exacerbée par sa future ménopause. Un bas-bleu comme les désignait si dédaigneusement Barbey d'Aurevilly. Son oeuvre fut un maillon essentiel du développement de la poésie américaine. Quand l'on voit le peu d'estime dans laquelle en Amérique est tenue depuis toujours l'oeuvre de Poe, relégué parmi les écrivains de troisième zone, l'admiration obstinée et combattive qu'elle porta au créateur du Corbeau fut peut-être ce qui le sauva de l'oubli littéraire.
Ce sont bien deux sincérités qui se rencontrent. Deux aérolithes venus de deux mondes différents. Sarah fut comme un havre de paix entrevue depuis le milieu tempétueux de l'ouragan, le corbeau cyclonéen aurait aimé s'y muer en paisible alcyon, mais ce fut à peine une halte. Le temps de faire sa déclaration dans un cimetière et de repartir vers de sinistres rivages. Sous les imprécations funestes d'une famille qui ne voyait que d'un mauvais oeil cette alliance de la colombe avec cet échassier décharné échappé par miracle du massacre du lac de Stymphale. Ramier voyageur par trop agité, messager de la fin, porteur des messages du Gouffre et de l'Obscur.

Pour Poe le terminus létal était proche. Tout le restant de sa vie - elle mourut à soixante-quinze ans - Sarah Helen Witman, resta fidèle à l'esprit de Poe. Jamais elle ne dérogea à son admiration native pour le poëte. Elle, qui ne fut qu'un rêve, sut rester à l'intérieur des portes de corne et d'ivoire virgiliennes de ce domaine d'Arnheim dont beaucoup auraient aimé à ce que le portail promothéen demeurât aussi introuvable et interdit que les portes du jardin perdu.
Ces lettres d'Edgar Allan Poe ne sont pas déchirantes. Déchirées.
Damie Chad.
FOIX ( 09 ) / 15 - 07 - 2016
L’ACHIL' CAFE

HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME
WIRE
De retour à l’Achil' Café qui continue imperturbablement ses programmations rock hebdomadaires. Un volontariat digne d’admiration dans ce village de La Barre qui jouxte la cité fluxéenne davantage connue pour les trois tours de son château que pour ses groupes de rock and roll. En tout cas devrait y avoir des centaines de lieux rock hexagonaux qui piqueraient une jaunisse de jalousie s’ils avaient la possibilité de comparer la surface de leurs locaux à celle de ce lieu privilégié. Chez l’Achil' Café tout est plus vaste, la terrasse, l’intérieur, et la scène à laquelle vous serez dans l’impossibilité d’appliquer l’épithète d’exigüe. Service sympathiquement discret, et six euros pour trois groupes l’on ne peut pas dire que l’on détrousse le rocker.

HOUSE OF STAIRS

Zénitude et plénitude. L’on s’agite autour d’elle, musiciens et techniciens de l’Achil'. Reste devant son micro, silencieuse, un sourire placide sur ses lèvres d’enfant sage. Terrienne, les jambes campées sur le sol, l’émane une étrange force de son imposante stature. Quand tout sera OK, nous dira en toute simplicité bonjour, comme si elle saluait une connaissance croisée dans la rue. Sont prêts, Pierrot derrière ses caisses, Sam à la basse sur sa droite, Nico sur sa gauche en sandwich entre sa collection de guitares et son acoustique exposée sur son piédestal. Elle, Elo, n’a que sa voix. Ne croyez pas que je l’ai oublié, l’occupe tout l’avant de l’aile droite de la scène. C’est que voyez-vous un claviériste dans un groupe, ça vous détermine le son autant qu’un kimono habille un judoka. Après ce n’est qu’une question de style. Et ici, ce sera les grandes orgues.
Au début vous ne comprenez pas où vous êtes tombé. N’y a que le dôme de sa voix qui surplombe la pâte sonore telle la coupole de Sainte-Sophie, l’antique Byzance. Majestuoso. Inutile de vous débattre, vous êtes englué dedans, et vous n’en ressortirez qu’à la toute fin du set. Faut comprendre comment ça marche. Méchamment intuité. Un tutti, pas frutti mais savamment orchestré, y en a toujours un des cinq qui prend le commandement, vous êtes piégé au moment où il se retire, les deux oreilles orientées sur le soliste ont besoin de trente secondes pour piger que ce n’est plus lui qui joue, qu’un autre a pris sa place, exactement sur la même tessiture. Bluffant. Il ne court pas le furet musical, il avance lentement mais passe tour à tour de guitare en basse ou d’orgue en voix sans que jamais vous ne parveniez à saisir les lignes de fuite. Faut de sacrés musicos pour réussir ce tour de passe-passe. A la basse Sam nous dégringole de ces tourmentes de swing rampant à vous renverser tandis que Nico nous pique de ces pizzacati à vous fricasser les tympans. Ou alors il se penche sans s’en saisir sur son acoustique, comme un chirurgien sur le ventre de son patient ouvert, lui secoue violemment les tripes pour lui apprendre à ne pas demander son reste. A grands coups de pelles, Pierrot entasse les contreforts, pose la chape sur laquelle les autres édifient.
La musique est en vous. S’impose à votre cortex et phagocyte votre hypothalamus. Une gradation incessante, neuf morceaux déployés comme autant de mouvements oratorioïques pour employer un adjectif aussi chatoyant que leur cheminement. Mais à chaque fois, plus fort, plus violent. Plus incisif. Les applaudissements qui suivent chaque titre seront eux aussi à chaque station plus chaleureux et frénétiques. Mais il est temps de revenir à elle, Elo. La clef de voûte. Quelle aisance ! Vous ne parlerez pas de chant, mais d’intervention phonique. Très courtes, ou s’inscrivant dans une assez longue durée. Lentes ou rythmées. Ballades ou courses schizoïdes. Qu’importe, vous êtes surpris par l’ampleur, la netteté et la plasticité de de cette voix. Le recueillement c’est après, lorsque par sa seule rétention vous entendez le silence. Vous réalisez alors votre manque. S’est retirée comme la mer. Debout près de son micro, tranquille, laissant ses acolytes battre le fer rouge de son absence, respectant son tour comme dans la salle d’attente du docteur, revenant à point nommé pour illuminer de sa présence la secrète architecture des compositions, The Light, Black Bones, After Show / Broken, The Silent Words…

Non ce n’est pas du métal mélodique, plutôt de la mélodie rock and rollisée. Avec intelligence, ce qui est rare. Ce qui est sûr que nous sommes tous entrés dans la maison des spirales à la Piranèse. Et que personne n’a eu peur. Méfiez-vous toutefois, le chant des sirènes signale souvent l’imminence d’un futur naufrage. A vos risques et périls. Mais qui hésiterait une seconde pour embarquer vers les délices de Cythère ?
INTERLUDE
Tiens encore une fille. Le programmateur serait-il un farouche partisan de la parité ? Entre le groupe qui remballe, les régisseurs, et le combo qui s’installe, l’on ne sait plus qui est qui. Le mystère sera dénoué en un quart d’heure. Nul besoin de se rendre à Stokholm pour connaître les secrets de 3 AM Syndrome.
3 AM SYNDROME

Parfait pour jouer au triomino. Le salaire de base du rock and roll, basse, batterie, guitare. Assez de monde pour faire un boucan de tous les diables. Avec une arme aussi absolue, la galaxie est à vos genoux. Donc une fille. Aurore, nocturne. De noir vêtue, cheveux roux mi-long et peau laiteuse, le bras gauche aussi coloré qu’une bande dessinée de Druillet, une basse de laque noire entre ses mains, un petit air de prêtresse vaudou, pas méchante, mais l’a du chien. De l’enfer. Pour le sourire, l’humour et l’entertainment, vous vous adresserez au guitariste, Joris. Le monsieur jovial du groupe. Demoiselle Aurore, gavial glacial concentré sur son instrument. Vous n’imaginerez jamais le bruit qu’elle peut émettre à elle toute seule. Grande tonitruance. Remarquez que si elle veut se faire entendre, elle n’a pas intérêt à s’endormir dans son étui. Car le plus dangereux, c’est Olivier le batteur. Un fou à lier. De l’énergie à revendre. Se sert de tout le kit. Donne envie que l’on lance une souscription pour qu’il ait au moins vingt-cinq toms à sa disposition. Plus il en aura, plus il en abusera. Y a des batteurs qui marquent le rythme. Doit être un autodidacte. N’a jamais appris que ça existait. Lui il manie les marteaux de Thor et les enclumes d’Héphaïstos. L’a tout un répertoire : l’orage, la tempête, le déferlement, la grêle tueuse, le tourniquet de Sardanapale - un truc qui vous rend tout pâle - la carapace qui se carapate, la trombe furieuse, et autres joyeuses duretés dont je vous épargnerai la liste infinie. Bref, c’est un batteur. Tout simplement. Mais un vrai. Face à ce déchaînement continu tout guitar héros qui se respecte n’est pas là pour jouer au yoyo avec les cordes à étendre le linge de sa maman. Joris vous assène des riffs au marteau-piqueur et des licks à la tronçonneuse. Faut que ça rugisse, et que ça surgisse de la cuisse de Jupiter tonnant. Je résume : deux garçons qui se se toisent du regard, plus vite que moi, plus fort que moi, tu ne pourras pas. Vous certifie qu‘ils peuvent sans difficulté.

Et notre damoiselle rousse, croyez-vous qu’elle a la frousse ? Que nenni bonnes gens. S’en prend au micro. Qui ne lui a rien fait. Tant pis, elle y glapit dessus comme une hyène en furie. Le bouscule et lui hurle de ces promesses de mort si épouvantables que vous avez envie de vous tirer au plus vite une balle dans la tête. Point de précipitation, elle a plus d’une corde à son arc vocal. Vous prend un minois de petite fille sage qui quémande un tour de manège à son papa préféré. Vous ne sauriez résister, mais la lueur bleuâtre d’un projo passe sur sa face et la voici transformée en Cruella sans cœur et sans pitié. La caravagienne tête de Méduse hérissée de serpents est encore plus avenante, vous éructe de son gosier de ces sons métalliques réfractaires à toute égoïne. Nous fait le coup de la reprise de Blondie. Bye bye la blondeur des rêves. Vous la troque à la tignasse noire, mèches dark et toupet gothique, imaginez une Evanescence qui aurait avalé le stock de speed des douze pharmacies du quartier. Mais agitée en-dedans, parce que d’extérieur s’applique sur sa basse sans le moindre zeste d’énervement. Tout dans la voix.
On joue du rock and roll. C’est ainsi qu’ils s’étaient présentés en début de set. Ont splendidement tenu leurs promesses de déjantés durant la moitié du concert. Z’ensuite, se sont laissés piégés par leur propre violence, sont passés au rock and funk, bien calibré certes, mais dans l’accumulation répétitive des saccades rythmiques ils ont oublié la folie meurtrière du rock and roll et commis l‘irréparable crime de la désagrégation quantique de l‘énergie. Dommage. Nous les reverrons tout de même avec plaisir.
INTERLUDE
Minuit moins dix. Zut Cendrillon m’attend. Ô Damie tu me récupères devant le ciné à minuit, ce serait si gentil ! Je fonce comme un madurle au volant de la teuf-teuf durant le changement de matos. N’ayez crainte, entre temps la princesse au petit pois ( dans le cerveau ) a changé de programmation et de ciné ! Bref quand nous revenons, Wire entame son deuxième morceau. Elle s’assoit en se bouchant les oreilles Ô Damie quel changement d’ambiance, comment peux-tu supporter une telle horreur !
WIRE

Elle a raison un rocky horror show. Autant dire que j’adore. Sont quatre, le batteur derrière et les guitares en première ligne. Tactique d’attaque ultra-simpliste mais ô combien efficace. Une horde de broncos en plein galop dans l’horizon sans fin des grandes plaines. Pleines d’électricité. Le chanteur, Eric envoie les lyrics, juste ce qu’il faut, mais ce n’est pas ce qui les intéresse vraiment. Eux ce sont les grandes chevauchées électriques à la poursuite du rock and roll perdu qui les motivent. Se marrent entre les morceaux. De vieux briscards qui se lancent des défis avant la charge héroïque. Un galop de drummin’- Patrick insatiable aussi effréné que les huit sabots fous de Sleipnir, un bassiste qui se prend pour un guitariste soliste, et quasiment deux leads, Eric et Phillipe, qui entrecroisent le torrent bondissant de leurs descentes éblouissantes. Quand ils sont lancés, le combo vous prend des allures de Poupées de New York qui ne chipotent pas des heures à admirer leur rouge à lèvres devant la glace de leur salle de bain. Let me go, Evil Mind, Like a Schizo, No Justice, les morceaux se suivent et se ressemblent comme des gouttes de nitroglycérine. Genre de gars qui ne regardent que les scènes d’action dans les westerns les plus sanglants. Pas de temps à perdre, le rock and roll n’attend pas. Lui courent derrière et parfois même le dépassent. Wire vire en tête.

Moins de monde que pour les deux groupes précédents. L’on a dû évacuer les âmes sensibles, les vieillards, les femmelettes et les enfants de moins de douze ans. Saines précautions, tout le monde ne supporte pas les doses de rock and roll à haut-voltage. Les Wire pourraient vous occasionner des lésions cérébrales irrémédiables. Oui, c’est juste du rock and roll, mais l’on aime ça. Esprits fragiles s’abstenir. Rock and rolliser tue.
Damie Chad.
FOIX ( 09 ) / 12 - 08 - 2016
L’ACHIL' CAFE

THE RED’S LYGHT
L’est des lumières rouges qui s’allument dans votre cerveau et qui malgré les années refusent de s’éteindre. Les avais vues en août 2011 ( voir KR’TNT ! 62 du 01 / 09 / 2O11 ). Cinq ans déjà, durant lesquels elles se sont obstinées à donner des concerts à des dates où je n’étais pas, à un ou deux jours près, en Ariège. Mais enfin ce soir, elles passent à l’Achil' Café, un rendez-vous à ne pas manquer, c’est qu’elles m’avaient séduites ces quatre jeunes filles, le groupe phare de ce mini festival de village, la plus inexpérimentée des quatre formations présentes, mais la plus définitivement rock and roll. Etaient habitées par la décisive innocence expérimentale de l’adolescence.

Ne m’échapperont pas. Tiennent la caisse. Se sont partagées les tâches, une qui annonce le prix, une qui rend la monnaie, une qui vous tamponne l’avant-bras et une qui vous passe un bracelet fluo autour du poignet. Jamais fans de rock and roll n’auront connu lors d’un concert un accueil aussi charmant. Précisent qu’elles seront sur scène d’ici une petite demi-heure.
ALERTE ROUGE
N’ont pas menti. Sont exactes au rendez-vous. Elles ont grandi. Ne sont plus des lycéennes mais gardent toujours cette fraîche beauté qui leur va si bien. Toutes gracieuses dans leur short noir et leur t-shirt rouge. Ont même teint leur main d’une substance censée se colorer en rouge sous la lumière des projecteurs. Trois sur scène, Cécile au fond derrière sa batterie, LN au longs cheveux blonds à la basse sur sa gauche, Lauriane guitar lead à sa droite abondante crinière brune qui ruisselle sur son dos à sa gauche. Audrey les rejoint dès le commencement des hostilités pour s’emparer du micro. Que sont-elles devenues depuis tout ce temps ? N’aurai besoin que de trois minutes pour être rassuré. Ont évolué dans le bon sens. Toujours rock and roll.
Céline, un visage décidé et une poigne de fer. N’allez pas lui marcher sur les pieds, elle sait taper, rapide et varié. Un drummin’ raisonné, sans perte de temps, utilise toute sa batterie, frappe avec ses baguettes et avec sa tête. De l’instinctif intellectualisé, sait ce qu’elle veut faire et ne se trompe jamais de chemin. Si elle était le petit chaperon rouge, le loup aurait du souci à se faire.
Laurianne est du même bois apollinien. Vous ne savez jamais comment elle va réagir, mais dès qu’elle touche ses cordes, vous ne pouvez qu’être d’accord avec elle. Fait attention à ne pas se répéter. Chaque cas mérite sa propre solution. Propose la meilleure. Droit au but. La facilité et l’à peu près ne l’intéressent guère. Précise et adroite, un jeu intelligent et économe. Dans l’histoire de Guillaume Tell elle serait la flèche qui pulvérise la pomme. Vous vise en plein cœur.
LN inscrit sa longue silhouette dans la légende des bassistes enfermés dans leur tour d’ivoire. Joue comme en-dedans d’elle-même. A peine quelques sourires. Mais qui trahissent son attention. Paraît loin de nous, mais très près de ses camarades. Ne les laisse pas en rade. D’ailleurs elles ne s’inquiètent point pour elle, sont sûres qu’elle assure. Dans le poème de Leconte de Lisle, elle est le rêve que l’animal sauvage jamais n’achève.
Audrey est le reflet inversé des trois autres. La grande communicante. Elle chante et elle parle. L’interface agissante. Naturelle et ouverte au monde. Elle est le bateleur et le fou du roi ou pour être exact la fofolle de ces trois reines penchées sur le rouet de leur instrument. Amuse la galerie, dans la belle au bois dormant, elle est l’instant merveilleux d’après le baiser de vie quand le palais s’éveille et bruit de mille cris de joie.
Ne la prenez pas pour la folle de service, dès qu’elle arrête de parler elle se révèle telle qu’en elle-même le chant la change. L’est plus qu’au point. C’est elle qui démontre l’extraordinaire cohésion du groupe. Elles ont bossé comme des madurles. Tout tombe pile à point pour un public qui manifeste sans attendre son plaisir en applaudissant à chaque performance. Sont des malines, n’ont pas construit leurs morceaux à la diable, les ont intuités, des pièces de haute précision, remplies de chausse-trappes rythmiques, qui vous ménagent feintes traîtrises et heureuses surprises, mises en valeur par la voix claire et haute d’Audrey. Un vocal ensoleillé, qui sait moduler et crier, l’en fait ce qu’elle veut et ce qui est le plus fascinant ce sont ses arrêts impromptus qui vous laissent sur votre faim tout en vous rassasiant pleinement.

Un set performatif, n’ont pas inventé le rock and roll mais elles le perpétuent avec aisance et élégance. Rappel obligatoire pour nos quatre jeunes filles. Dommage qu’il y ait un groupe derrière. Le public les regrettera. Je suis content de moi. Ne m’étais pas trompé, voici cinq ans. Ont encore un énorme potentiel. Très proches des girls bands américains.
Damie Chad.
P.S. : pour le groupe d’amateurs de variétoche qui a suivi, je serai gentil en omettant de citer leur nom.


