11/10/2016
KR'TNT ! ¤ 298 : KING KHAN & HIS SHRINES / FALLEN EIGHT / SENTINHELL / FURIES / NAKHT / T.A.N.K. / THE ARRS / ROCK CRITIC / JODOROWSKY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 298
A ROCKLIT PRODUCTION
13 / 10 / 2016
|
KING KHAN & HIS SHRINES FALLEN EIGHT / SENTINHELL / FURIES NAKHT / T.A.N.K. / THE ARRS ROCK CRITIC / ALEJANDRO JODOROWSKY |
3 octobre 2016
LE HAVRE (76 ) / LE TETRIS
KING KHAN & HIS SHRINES
Le Khan dira-t-on

King Khan et BBQ ont tellement de talent qu’on les suit à la trace. Ils multiplient les projets parallèles et donc les disques abondent, souvent passionnants. Comme dans les cas de Robert Pollard et de Wild Billy Childish, on peut parler ici d’une authentique démarche artistique. King Khan et BBQ ont une vision si riche du rock qu’elle leur permet d’avancer dans des directions souvent aventureuses. N’oublions jamais que l’homme qui n’avance pas recule.

Avec les Shrines basés en Allemagne, King Khan a déjà enregistré quatre albums. Sur scène, leur set impressionne. Les Shrines sont nombreux. Une section de cuivres complète la section rythmique habituelle. Autrefois, une danseuse venait animer la scène et King Khan chantait et dansait avec le cousin d’Henry, le célèbre crâne de Screamin’ Jay Hawkins. King Khan & the Shrines sont toujours d’actualité, et même plus brûlants que jamais, comme ont pu le constater les veinards venus les vois jouer au Havre, par un beau soir d’automne.

Toujours autant de monde sur la petite scène du Tétris, clavier, deux cuivres, guitare, basse et un vieux black magique aux percus assis dans un coin. Tous ces gens sans exception sont des musiciens exceptionnels. Celui qu’on observe peut-être le plus, après King Khan, est ce sacré funkster de bassman allemand qui drive toujours ses lignes avec l’aisance d’un Bootsy booty. King Khan attaque son set en costume gris. Il plante le décor de la soul avec l’aisance d’un Booty bootsy, tout en grattant sur sa guitare noire de garagiste. En fait, avec les Shrines, il rallume le mythe de la revue, au sens où l’entendaient les grands artistes noirs des années cinquante et soixante.

Leur set était avant tout un spectacle, ils voulaient que les conditions de la scène soient celles du studio, aussi fallait-il du monde pour recréer les arrangements et offrir à leur public un VRAI spectacle. King Khan & the Shrines recréent cette tradition, avec le même impact, car ces gens ont du répondant. Rien n’est plus risqué que de jouer de la soul sur scène quand on n’est pas noir. Figurez-vous qu’ils s’en sortent avec les honneurs et qu’ils font danser les dames. Fabuleuses équipe, fabuleux shouter que ce King Khan tombé du ciel. Il va changer trois fois de tenue dans la soirée, pour observer un rite lui aussi lié à la légende des revues. Il revient dans un déshabillé moulant de soie noire, bien échancré sur la poitrine, pour qu’on puisse apercevoir ses mauvais tatouages et sa bedaine.

Quelle classe épouvantable ! Ce mec sonne comme une superstar et il joue la carte du trash à fond. C’est inespéré. King Khan incarne son art, un anglais dirait de lui qu’il est larger than life - une formule imagée intraduisible - King Khan, c’est le Pantagruel avec un micro, Little Richard rajeuni de quarante ans, Néron au Balajo, c’est Jean Lorrain en lunettes noires, l’enfant caché de William Burroughs et de Divine. Justement, notre héros vient de faire paraître un album de William Burroughs, Let Me Hang You. Burroughs lit ses poèmes et des musiciens jouent derrière. King Khan jour sur sept des titres.

Attention, il faut idolâtrer Burroughs pour écouter l’album, car l’ambiance reste très expérimentale et même bruitiste, disons à la Schoenberg, et Burroughs reste le génial story-teller que l’on sait, avec des mots à la traîne et son fort accent new-yorkais. King Khan nous replonge dans cette avant-garde musico-littéraire qui semble avoir complètement disparu depuis le temps où Erik Satie et Picasso œuvraient ensemble pour Parade, le temps où Francis Poulenc mettait des poèmes d’Apollinaire en musique et, plus récemment va-t-on dire, le temps où Leo Ferré orchestrait les vers magiques d’Aragon. D’ailleurs, lit-on encore Aragon de nos jours ?

Mais nous nous éloignons du sujet, il est temps de revenir à cette petite salle du Havre surchauffée par une fière équipe. Dans la salle, tout le monde est en état d’admiration avancée. King Khan revient sur scène en culotte de satin noir et en cape, comme au Cosmic, tout l’orchestre est survolté, notamment le petit brun aux claviers, la soul suinte de partout, King Khan jerke la paillasse du beat sans répit, il continue de screamer et, en parfait gentleman-soul shaker, il sourit aux dames qui dansent. Franchement c’est l’un des groupes qu’il faut voir jouer sur scène, car ils sont beaucoup trop bons.

Un groupe comme ça pour douze euros ? Non mais c’est une plaisanterie ? Ils devraient déjà jouer à l’Olympia et prendre un cachet de 150.000 euros, histoire d’aller ensuite remplir la baignoire d’une suite au George V de cochonnailles fumantes et de s’y vautrer en l’honneur de Divine, et de Rabelais, son père spirituel. Ouvrez la pochette de Let Me Hang You et vous tomberez sur un tas de tripes. King Khan tire ça du délire trash de William Burroughs. Kahnnibalism, baby !

Le premier album de King Khan & the Shrines date de 2001 et s’appelle Three Hairs And You’re Mine. Petite précision d’importance : le Révérend Beat Man le fit paraître sur son label Voodoo Rhythm. Pour un premier tir, c’était un véritable coup de maître. D’autant qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens, car l’album est enregistré au Toe Rag Studio de Liam Watson, à Londres. Dès le morceau titre d’ouverture, on sent un magnifique drive de basse artériel en hyper-tension. Ils enchaînent avec un coup de boogaloo vindaloo exceptionnel, «Kukamonga Boogaloo». Ils nous swinguent ça au mambo du lounge et ça saxe sec dans la fournaise. On entend des accords inconnus dans le torride «Feel Like Me». Oui, attention ! Cet album réserve des surprises de taille. S’ensuit un «Don’t Walk Away Mad» monté au meilleur groove cavaleur du mondo bizarro. Seulement quatre titres et l’auditeur se doit d’admettre qu’il a dans les pattes un album incroyablement inspiré, bien sanglé, sévèrement jerké du jive. Les Shrines passent au pur rock’n’roll avec «King Of The Jungle». King Khan ne s’accorde pas le moindre répit. Il n’en finit plus de monter à l’assaut de la gloire. Il sait qu’il vaincra, car il dispose des fameuses forces intrinsèques. Ce mec est puissant et terriblement doué. Il rend hommage à James Brown dans «Tell Me». Hommage dévastateur, car à la croisée du garage et des Famous Flames et il enchaîne avec «Crackin’ Up», un cut de charme invraisemblable.

Trois ans plus tard paraît l’imbattable Mr Supernatural. On y trouve deux véritables coups de génie, «Stone Soup» et «Burnin’ Inside». Avec le premier, il tape dans la soul garage nappée d’orgue. De nos jours, plus personne n’ose sortir un son pareil. Si on aime la soul ravagée par les Huns, c’est ce disque qu’il faut écouter. On retrouve cet énorme shuffle envahisseur dans Burnin’. King Khan ne respecte qu’une seule loi, celle du blast. Ce qu’il fait subir à la soul va au-delà de ce que tolèrent les conventions de Genève. Il traîne sa soul par les cheveux jusqu’à une sorte d’abattoir nucléaire. Attention, ce n’est pas fini. On trouve aussi sur ce disque un «I Don’t Have To Tell You» joué cartes sur table. Ils misent sur le groove, mais ne peuvent pas réfréner leurs sales manies de garagistes. King Khan chante «On The Street Where I Live» au timbre fêlé d’Harlem, accompagné par les trompettes latino du héros Gato. C’est tout simplement admirable de son et de vision. Il faut aussi écouter le morceau titre, fouillé aux percus et aux cuivres. King Khan mène sa meute comme James Brown, avec des cris de guerre. Derrière lui, ça joue comme à Rio. La basse monte devant dans le mix et le son semble se dédoubler à l’infini, en d’innombrables encorbellements funkoïdes. Ça pullule, ça bouillonne, c’est plein de vie, ramassé, animé, excité. Et puis il y a aussi cette merveille intitulée «Pickin’ Up The Trash» qui sonne encore une fois comme un hommage à James Brown car voilà une pure merveille énergétique avec des Pickin’ up baby parfaits. King Kahn est capable de visiter tous les styles avec une égale réussite, le garage, la soul, le punk-rock. Vous en connaissez d’autres ? Il monte plus loin «Train N°8» à la fournaise maximale. Il y hurle comme un damné avec des sock it sock it dignes de Mitch Ryder, au temps béni des Detroit Wheels.

Paru en 2007, What Is ? est une véritable bombe. Dès le premier cut, «(How Can I Keep You) Outta Harms Way», King Khan plonge ses crocs dans le garage. Il se dresse comme un shouter invincible. Il peut aussi allumer la soul comme Wilson Pickett. La preuve ? «Land Of The Freak» qu’il chante à la meilleure shouterie des Indes, et derrière lui, ça nappe d’orgue et de cuivres à gogo. Il passe au psyché sixties avec «I See Lights». King Kahn est un touche-à-tout de génie. En B, avec «Cosmic Serenade», le groupe se tape une belle dérive instro saxée free d’ambiance gluante de jazz-band à la dérive. Puis King Khan se fend d’un bel hommage à Dutronc avec «Le Fils De Jacques Dutronc» joué au garage classique et descendu à la fuzz, chanté en Français et géré au tourbillon d’orgue. Il revient à la soul de winner avec «Let Me Holler» et enchaîne avec un «In Your Grave» chauffé à blanc, ultra joué, noyé d’orgue et visité par une basse volante, celle du grand Jeans Redeman qu’on observe toujours attentivement lorsqu’il est sur scène, car il joue avec une sorte de vélocité Tamla. King Khan termine avec un magnifique clin d’œil à Dylan, «The Ballad Of Lady Godiva». Oui, il peut même aller chercher le dylanesque et créer la magie.

Idle No More est un album très différent, beaucoup moins soul et nettement moins agité. King Khan semble mettre le paquet sur les compos plus ambitieuses et il réussit l’exploit de nous maintenir en éveil jusqu’à la fin du disque. «Bite My Tongue» sonne comme la meilleure good time music de l’univers, en tous les cas, les Shrines groovent admirablement bien. Avec «Thorn In Her Pride», on comprend que le parti-pris est résolument poppy, très orchestré, à l’anglaise des seventies. King Khan vise l’excellence de cette pop anglaise jadis incarnée par Love Affair ou les early Bee Gees. Joli cut que ce «Luckiest Man» monté sur un shuffle d’orgue de pop funk. King Khan s’y amuse comme un petit fou. On se croirait dans une confiserie où tout est précieux et succulent, raffiné et bienvenu.

On trouve aussi un Best Of, The Supreme Genius Of, qui comme tous les Best Of, simplifie les choses au plan monétaire international. On y retrouve en effet la plupart des cuts qui nous ont mis en émoi, comme «Torture» et sa blue eyed soul chauffée à blanc où encore «Took My Lady To Dinner» où King Khan fait son James Brown dans un système plus électrique et des cuivres plus staxy. On retrouve aussi le fameux «Outta Harms Way» noyé d’orgue et chargé de sens, puis «Land Of The Freak» endiablé et digne du Midnight Mover, car pulsé à la vie à la mort. En B, on retrouve l’excellent «Sweet Tooth» visité par la basse du Jamerson allemand, Jeans Redeman.
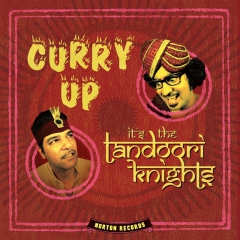
King Khan et Mark Sultan adorent travailler avec l’excellent Bloodshot Bill. Mark et Bill font les Ding Dongs (deux albums chez Norton). King Khan et Bill font les Tandori Knights, dont le premier album est aussi paru chez Norton, sous une magnifique pochette rigolote. Si on l’ouvre, alors on les voit tous les deux étalés sur un tapis persan, avec des mocassins blancs aux pieds : ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, la pochette intérieure de «Fun House» ! Les Stooges ! En plus, l’album est complètement déroutant et nos deux amis flirtent en permanence avec le génie. Il vous suffira juste d’écouter «Roam The Land». Bill prend la main, mais sous la lune du Gange. Ils livrent là un curieux mélange d’exotica et de beat rockab unique au monde. Bill passe ses couplets dans les fumées du temple de Shiva. Avant King Khan, personne n’avait eu l’idée d’un tel mélange, pas même Cornershop. D’autres coups de génie guettent l’amateur en B, à commencer par «Lovers Moon», attaqué au doux strumming de l’Arkansas, rechanté sous la lune du Gange et adouci à l’instrument d’exotica maximaliste. C’est joué avec une finesse extrême, une justesse de son qui n’en finira plus d’intriguer le commun des mortels. Même chose avec «Brown Trash» joué dans le meilleur esprit rockab, avec ce fourvoyeur de King Khan dans les parages. On se régale aussi de cuts comme «Bucketful», un joli rockab de bazar du Passage Brady. C’est joué au beat tribal et au gimmick lunatique, chanté du nez et fantastiquement entraînant. On appelle ça de l’exotica rockab. Bill est l’un des meilleurs continuateurs du mythe rockab. Il en prolonge l’ardeur à coups d’idées brillantes. Il faut suivre ce mec à la trace. Plus loin, «Tandori Party» éclate - Owee baby ! - et King Khan fait des wap-doo bah derrière. C’est à la fois extravagant et gagné d’avance, tellement l’idée nous sidère. Sur ce disque, les idées pullulent. Il suffit d’écouter cette merveille qu’est «Bandstand» : Bill prend ses couplets en mode classique et ça vire exotica dans le refrain. Stupéfiant ! Bill prend aussi «Dress On» au rockab doux et il réussit à tempérer les ardeurs orientales du grand Khan. Ils finissent l’album en beauté avec «Beauty & The Feast», emmené au chant rockab sur un fabuleux mid-tempo visité par les dieux des Indes. Bill chante avec de la mélodie plein la voix, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les chanteurs rockab.

Dans un genre totalement différent, King Khan fait les Black Jaspers avec Jasper Hood des Moorat Fingers, dans une mouvance radicalement punk. Ils se partagent les morceaux et ceux de King Khan sont plus rock’n’roll, comme par exemple «No Brain No Pain» monté sur un gros tempo et visité par ces solos éclairs dont il a le secret. Même chose pour «(I Wanna Be Your) Razorblade», un pur délire bien arrosé de guitares. Il joue tout au classique incendiaire et on retrouve le guitar hero du KK& BBQ Show. «Leather Boy» sonne comme un rock à la Dolls, ça déglingue au riff de dégelée. On sent bien le génie sous-jacent de King Khan. Ils nous font là une sorte de post-pop punky chanté à la meilleure gouaille des barrières. Les cuts sont systématiquement intéressants, même si le son reste aigrelet et même si Jasper chante d’une voix désespérément criarde. Dans «I Want My Face On The Radio», il chante avec la voix d’un glam-punkster blessé par balles. King Khan chante «Long N’ Wavy» au lofi de casque à pointe. En B, on tombe sur d’autres merveilles du type «Born In 77» avec des couplets lancés au c’mon de waouhhh. «I Can’t Stand The Summer» évoque bien sûr les Rezillos et le cum-punk jouissif.
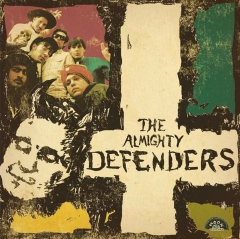
Nos deux compères King Khan et Mark Sultan ont aussi fricoté avec les Black Lips. Ils ont formé avec eux les Almighty Defenders et enregistré un album. Malheureusement, c’est une sorte de gros coup d’épée dans l’eau, car évidemment, on en attendait des miracles. On sauve deux cuts sur cet album en forme de rendez-vous manqué : «All My Loving», un gospel de juke à la BBQ. Ça swingue dans les brancards et ils recyclent la vieille énergie du gospel choir. Puis «One Of Light», chanté à la clameur doo-wop sur le bon vieux beat dévoyé de BBQ, l’extraordinaire partenaire. Il est accompagné à la mandoline speedo. En B, il tente encore une fois de sauver l’album avec «She Came Before Me», mais la déception l’emporte. Fatalitas !
Signé : Cazengler, King Khon
King Khan & His Shrines. Le Tétris. Le Havre (76). 3 octobre 2016
King Khan & The Shrines. Three Hairs And You’re Mine. Voodoo Rhythm 2001
King Khan & The Shrines. Mr Supernatural. Hazelwood Records 2004
King Khan & The Shrines. What Is ? Hazelwood Records 2007
King Khan & The Shrines. Idle No More. Merge Records 2013
King Khan & The Shrines. The Supreme Genius Of. Vice Records 2008
Almighty Defenders. Almighty Defenders. Vice Records 2009 (With Black Lips)
Black Jaspers. Black Jaspers. In The Red Recordings 2009 (With Jasper Hoods, Moorat Fingers)
Tandoori Knights. Curly Up. Norton Records 2010 (With Bloodshot Bill)
William Burroughs. Let Me Hang You. EJRC 2016
MOISSY-CRAMAYEL / 07 / 10 / 2016
LES DIX-HUIT MARCHES
FALLEN EIGHT / SENTINHELL / FURIES
( Photos : Alexandre Maeder )
Retour aux Dix-huit Marches. Un exploit, l'année dernière ( KR'TNT ! 250 du 02/ 10 / 2016 ) l'on craignait la disparition du lieu. Sont encore vivants, mais une discrète affichette fait le rappel d'une douzaine de citadelles rock qui ont fermé ces derniers temps. L'escalier pas du tout branlant a fêté au mois de mars ses vingt ans d'existence. Rappelons que les Dix-huit Marches possèdent aussi deux studios de répétition pour les groupes. L'existe un maigre réseau de lieux similaires sur la Seine & Marne, peu nombreux, mais qui apportent une aide logistique des plus indispensables aux jeunes groupes.
FALLEN EIGHT

Je ne sais si vous êtes comme moi, mais au dessert je n'aime guère recevoir la plus petite portion du gâteau. C'est pourtant ce qui nous est arrivé. Un set bien trop court pour Fallen Eight, une mise en bouche. Quand la maîtresse de maison range la bouteille de whisky sitôt le premier verre servi, vous êtes frustré.

N'auront pas le temps d'installer leur climax si particulier. Dommage, car ça promettait. Ça Prométhée. Une entrée en matière plus nerveuse, plus incisive, JP aux baguettes qui accomplit prouesse sur prouesse. Déblaie la route. Des blocs cyclopéens qu'il repousse et ordonne comme du revers de la main. Torse nu, concentré sur son jeu, il donne une prestation éblouissante. Précision, vitesse et violence habilement conjuguées. Clem est au chant, se débarrassera vite de sa légendaire chemise à carreaux rouges et noirs comme s'il voulait coller davantage à lui-même. Etonnant comme il peut exprimer une finesse toute féminine et passer à une expression de force virile.

Il possède cette sensibilité d'artiste capable de s'immiscer au plus près du mystère des subtilités. C'est en cela que réside la spécificité du groupe. Cet équilibre, tour à tour précipité dans d'aériens transports d'envolées arachnéennes ou enkysté dans les arasements terrestres les plus primitifs, reste sa marque de fabrique. Une balance oscillant perpétuellement entre le ballet des éléments primordiaux, de la légèreté de l'être à la pesanteur anthropologique. Fallen Eight forge les métaux les plus précieux. Une basse qui appuie partout où ca fait le plus mal et deux guitares qui découpent au chalumeau. Au final trois guitaristes qui n'auront pas eu l'espace qui leur aurait permis d'exprimer leur singularité. De l'atelier de Fallen Eight sortent des chefs-d'oeuvre d'or, de platine et de vermeil. Vous livrent aussi des pièces aux arêtes les plus dures. C'est vrai que l'on ne prend pas le temps d'apprécier à sa juste valeur. L'on a déjà l'esprit préparé à accueillir la prochaine merveille. L'on ignore tout du prochain prototype qui sortira de leur aciérie. L'oiseau a pris son envol. Mais l'a trop vite disparu des écrans. Sept misérables morceaux, un Reborn qui vous redonne goût à la vie, un Priest qui confine au hachoir métallique et un Final Shoot à vous donner envie de mordre un tigre. Mais non. Retransmission coupée. Timing oblige. Regrets partagés par toute la salle. Recueillent des remerciements de la part du public. Mais ce lot de consolation ne nous satisfait pas, faudra les revoir très vite, in extenso.

SENTINHELL

Méchamment rock. Déjà pendant la mise en place y avait eu quelques échappées de guitares qui laissaient présager un orage chargé d'électricité. Plus violent qu'on ne s'y attendait. Cinq sur scène. Aurélien est à la batterie. Lance le feu. Un spectacle à lui tout seul, torse nu sous des dreads en bataille, corps pâle et longiligne, tape dur et vite. Pluie de baguettes diluviennes. Faut le voir. Extériorise ses pulsions. Son visage égaré semble le reflet de son monde intérieur. L'a l'air d'un zombie évadé de sa tombe, encore ravagé par des tics d'outre-tombe, tantôt marionnette folle dont un esprit malin tirerait les ficelles, tantôt fantôme aux mille bras occupés à martyriser ses fûts.

Quand vous avez un carburateur infatigable comme cela derrière vous, vous ne pouvez pas vous contenter de jouer au scrable par devant. Nous avons de la chance, Angelo Di Luciano n'est pas du genre à regarder regarder mûrir les grenades. Pas question de se laisser subjuguer par le sol invictus d'Aurélien. Une guitare et c'est parti. L'a tout compris du rock'n'roll, je passe par-dessus et j'envoie la marmelade riffique sans jamais m'arrêter une demi-seconde. Angelo, un véritable demono ! Barbichette blanche et élégance princière. Jamais en défaut d'imagination, le genre de gars qui vous remonte les autoroutes en sens inverse sans même une égratignure. Le sourire en coin et la guitare en feu.

Ce n'est pas tout. Ils ont un chanteur. Un vrai. N'a pas ouvert la bouche que déjà vous savez que l'on vient de lâcher un fauve. Imaginez Rahan, le héros des âmes farouches, mais en brun, une crinière de jais tout en boucles ondoyant sur ses épaules, cartouchière à la ceinture, blouson noir collé à la peau cuivrée qui permet d'entrevoir un torse félin. Une voix qui part facilement vers les aigus, et cette aisance, cette facilité avec laquelle il occupe l'espace, pourtant réduit de la scène. Se déplace avec tant de charisme que cette dernière paraît s'allonger à chacun de ses pas de danse. Une facilité déconcertante, en joue, s'en amuse, facétieux, met les mains sur les yeux d'Angelo, s'incruste sur le manche d'Olivier, leur fait toutes les misères du monde. Avec son sourire irrésistible de panthère. Olivier, deuxième guitariste. Je n'ai pas dit second rôle. Avec les trois autres ostrogoths qui s'agitent à ses côtés l'a intérêt à garder la tête froide. Difficile de savoir comment il se débrouille, les trois mousquetaires dressent un mur du son impénétrable et lui il se permet de combler les vides. Interventions d'une précision si absolues, si naturelles qu'elles paraissent une évidence. Discrètes comme son visage qui disparaît sous les ailes refermées de ses cheveux. Enfin, Jean-Louis, le mythe du bassiste incarné. Ne me dérangez pas, je suis ailleurs. Je fourbis des armes plus noires que les eaux du Léthé sur l'île des Bienheureux. Maintenant faut faire attention, ce ne sont pas des musiciens qui jouent, mais un groupe qui produit un son, très rock'n'roll et très heavy metal. Déclinaison trashy. Pour notre plus grand plaisir ils confondent vitesse et précipitation. La musique tombe sur vous comme l'aigle fond sur sa proie. Burn Them All, Satan's Little Helper, Sandslaves enchaînés, en entrée juste pour montrer de quoi ils sont capables, nous referont le coup avecc Cries Of the Damned et Jack Boot Stomp. Niels annonce un titre du premier album ( n'y était pas encore ) Sombre Héritage, en français précise-t-il, pourrait nous le refiler en japonais que ça passerait comme une ogive dans un char d'assaut. L'invite l'ancien batteur du groupe à pousser le scream avec lui et après c'est au tour de Lynda des Furies de le rejoindre sur scène, s'en tirent très bien, la demoiselle sait aussi aller chercher la note dans les aigus, panthère noire et léoparde blonde feulent à qui pire-pire pour le plus grand plaisir de l'assistance. Time, Countered, Battle Hymn pour finir en apothéose shred. Un set époustouflant. Viennent d'Avignon. C'est eux qui ont cassé le pont. Et la baraque. A frites molles de nos cerveaux. Subjugués.

FURIES

A l'origine un groupe essentiellement féminin d'après ce que j'ai compris. L'en reste deux, blondes comme les blés, belles comme le houblon, Zaza à la batterie et Lynda vocal et basse. Se sont adjointes deux guitaristes, Billy Laser à notre gauche, Sam Flash sur notre droite. Deux adeptes du manche shrediques. Du genre le rock and roll c'est un solo continu de guitare, de la première à la dernière note.

De toutes les manières s'ils veulent exister face à Lynda, sculpturale, vêtue de sa chevelure blonde et de cuir noir, basse rouge hémoglobine effilée comme une flèche qui zèbre son corps, et voix de Walkyrie, ont intérêt à se manier. Le programme de Furies est d'une simplicité extrême à l'image de leur premier morceau, Furies Attack, rentre-dedans et ne jamais sortir de la première ligne avant d'avoir écrasé l'adversaire. Une stratégie sommaire qui pourrait s'avérer un peu lassante. Mais il y a la voix de Lynda, une espèce de cristal épais comme une vitre blindée mais au tranchant de couperet de guillotine qui monte haut et vous emmène jusqu'au septième ciel. A ses côtés Sam et Bill se tirent la boule, appliquent le programme de base sans faillir, en avant toute, vite et encore plus vite. Zaza repasse un peu trop souvent les mêmes plans de batterie mais produit un beat efficace et entraînant.

Les titres se suivent, SSSS !!! qui glisse comme un serpent dans l'herbe sèche, un Fire in the Sky qui met le feu, le temps d'inviter Niels pousser la tyrocklienne et voici le dernier titre emblématique La guerrière. This the end, Beautifull girls ? Une voix s'élève du fond de la salle « Pas de rappel ? » - c'est la règle dans ces concerts de structure municipale – moment de flottement sur scène mais la suggestion est immédiatement reprise par l'assistance enchantée de cette proposition . Finalement c'est reparti pour Sortilège que le public reprend en choeur. Un beau clin d'oeil à cette première vague des groupes de hard rock français, de la génération Vulcain, Satan Jokers. Un set qui n'a pas bouleversé l'avenir du rock and roll mais qui a su séduire et induire le désir de les revoir.
Damie Chad.
SAVIGNY-LE-TEMPLE – 08 / 10 / 2016
L'EMPREINTE
NAKHT / T.A.N.K. / THE ARRS
Passent toutes sortes d'artiste d'artistes dans cette salle. Mais certaines soirées sont réservées au métal. Mettre ses pas dans l'Empreinte des dinosaures, ces véloces prédateurs en même temps lourds et pesants, n'est pas désagréable. Un peu moins de monde que pour le concert précédent, mais la salle est loin d'être un désert.
NAKHT

Groupe d'ouverture et local. Avec une telle étiquette vous êtes mal partis. Ce ne sera une révélation pour personne : Nakht se moque de ces préventions comme de sa première pyramide. Ne savent qu'une chose, leur musique parle pour eux. Nakht c'est d'abord un choc. Dès la première seconde le son s'abat sur vous, vous plaque contre les murs, vous écrase sur le plancher. Pas de sauve qui peut général. Trop tard, vous êtes pris au piège. Violent et brutal. Soit vous vous enfuyez en hurlant de peur soit vous hululez de joie en dansant la carmagnole. Ne leur a fallu que quarante secondes pour déchaîner l'hystérie collective. Insufflent une énergie qui rejaillira sur toute la soirée et dont bénéficieront les deux groupes suivants. L'on attrape les requins en versant des citernes d'hémoglobine dans l'océan, alors Nakht applique la recette en adaptant à leur démesure le vieux triptyque churchillien, de l'épilepsie sanguine à foison, des tonnes de sueurs, des larmes d'extase, et le public se rue sur lui-même comme deux tribus d'anthropophages affamés recluses sur une île déserte. L'est déjà grand Danny, mais il se fiche sur un caisson un peu comme Napoléon sur sa colline pour diriger le carnage. Pousse des rugissements d'une raucité époustouflante, l'oesophage doit s'enrouler sur ses cordes vocales pour lui permettre d'émettre ces grondements qui tombent sur vous comme les marteaux d'Héphaïstos. Clément secoue sa basse et son espèce de crinière déplumée qui tient autant fois du plumet de cuirassier en pleine charge que de la crête en folie d'un iroquois s'apprêtant à trucider trois tuniques rouges d'un seul coud de tomahawk. Alexis et Christofer sont aux guitares, lâchent de courtes bordées de canon qui vous démâtent le cervelet, puis vous avez un millième de seconde de silence pour reprendre votre esprit et la bordée suivante détruit le gouvernail de la raison pure qui en temps normal guide vos pas en ce monde que Nakht est en train de détruire.

N'est pas dans ma ligne de mire, je ne vois que ces baguettes qui voltigent au-dessus de sa tête. Damien est le grand fracasteur, selon sa philosophie de batteur, un riff de guitare ne doit pas durer plus de quatre secondes, au-delà de ce temps il est perdu pour l'Humanité. Donc il vous le clanche en plein vol et le précipite à terre pour qu'il explose de sa belle mort. Inutile de perdre son temps à le pleurer, le suivant a déjà subi le même sort. Une bonne nouvelle, sont en train d'enregistrer leur second EP dont ils nous donnent quelques aperçus. Introduction de sections mélodiques – enfin tout est relatif - dans le tintamarrock. Apparemment devrait arriver bientôt. L'on attend avec impatience. Bref les Nakht ont été prodigieux.

( Photos : Antoine Kit Rivier )
T.A.N.K.

Après un tel déluge, j'aurais eu peur de prendre la relève. Pourtant je sais de quoi ils sont capables puisque j'avais assisté à leur prestation au festival de Romilly-sur-Seine ( voir KR'TNT ! 197 du 10 / 07 / 2014 ). Les gars de T.A.N.K fignolent l'installation de leur matos avec une tranquillité des plus sereines. Oui mais il nous faut apprendre à penser autrement. Think of A New Kind comme l'indique l'acronyme. Un acrocknyme qui vous incite au grand chambardement.

T.A.N.K. C'est la limousine de luxe. Frottée, huilée, bichonnée. Un bijou de précision. Une berline de milliardaire. Calme, confort et volupté. Ne faites pas confiance au dépliant. De loin sur scène, sans le son, la réalité peut sembler correspondre à la description. Mais dès que vous mettez le volume, vous réalisez que c'est un hot-rod tout terrain chargée de nitroglycérine spécialement adaptée pour gravir et descendre les sommets de l'Himalaya. Vous prennent la suite de Nakth sans problème, un peu moins brutaux mais plus trashy, des pointes de vitesse effarante, et des reprises ébouriffantes. Disturbia en entrée pour bien signifier qu'ils ne sont pas venus pour fumer le calumet de la paix. Les pneus ne crissent pas mais résistent à tous les imprévus. Facilité déconcertante pour s'arroger le public dans la poche. N'y restent pas sagement assis, car de tout le set, ce sera le gymkhana du siècle dans la fosse aux lions. Le public s'empoigne, se frotte, s'escarpoufle, se dégommole, se tampochoque comme un entremêlement de géants dans un poème d'Henri Michaux.

Raf rafle, tacle, érafle, arque, baffe, sarcle et craque le vocal. Cris de lyrics et bris de crimes, crises de scies et rites de mythes. Le métal ne chante pas se donne à entendre comme de la poésie brute. Le mot réduit au souffle de son élocution éjaculatoire. Debout, légèrement penché, micro à la main, Raf attise les braises de ses borborygmes de tyrannosaure démentiel. Super talent, sait moduler la foudre et cracher des incendies. Derrière lui, Nils, Charly à la guitare et Olivier à la basse sont impeccablement alignés. Alternent les séquences, chacun préoccupé de son propre jeu, ou après un break fulgurant secouent leur tête en cadence comme les pensionnaires d'une maison de fou atteints d'un tic collectif. Et chacun replonge en lui-même, les yeux fixés sur son instrument. Marionnettes du diable, habitées par saccades, fétiches spasmodiquement agités dans une cérémonie vaudou. Ces états collectifs de transes quasi-hypnotiques disparaissent et vous laissent l'étrange impression d'une vision onirique échappée de votre cerveau. Apprenez-vous à penser autrement, à faire en sorte que l'image prime sur le raisonnement, l'effet sur la cause. T.A.N.K a compris et intériorisé la mise en scène du métal, s'agit d'atteindre sous l'effet du déluge sonore à un stade de perception qui n'est plus exactement le vôtre. Beautiful Agony et le cri des corbeaux pour chant funèbre.

Clément n'est guère clément avec ses fûts. Brûle ses vaisseaux à chaque break. La forge métallique est incessante et joue sur l'oubli du tempo. Chaque passe annihile la précédente. Le beat passe trop vite pour qu'il puisse entrer dans les synapses de la remémoration. Musique d'empilements successifs qui vous dénude à chaque fois. C'est cette fuite en arrière – pratiquement à contre-temps dans un ordre métaphysique - qui a pour résultante ce besoin inextinguible du fan et des groupes d'avoir sans cesse besoin de plus d'amplitude sonique, de plus d'urgence de vitesse, de plus de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler de présence. Le serpent de l'absolu qui se roule sur lui-même en une propulsion quasi mystique ne parvient plus à mordre sa propre queue.
T.A.N. K. Un grand groupe.
THE ARRS

Serai plus mitigé envers The Arrs. Certes s'en sont très bien tirés. La folie du public est même montée crescendo. Possèdent surtout Teko, un bon batteur. Plus très jeune, mais un feu d'enfer. Selon mon immodeste personne l'est l'élément essentiel du groupe, j'irai jusqu'à dire celui qui lui permet d'exister. Un roulement interminable, grosse caisse à contribution sans arrêt et puis, cette pulsion incessante qui dégage l'énergie nécessaire à la propulsion. La section de cordes n'est pas déméritante, mais les morceaux sont un peu trop bâtis sur les mêmes patterns. Le band présente un côté sympathique joyeusement bordélique, les musiciens changent sans arrêt de place, adoptent les poses archétypales et les cambrures des guitars heros, quant à Nico le screamer il invite le public à ne pas hésiter à monter sur l'estrade et à faire le saut de l'ange sur les bras tendus des compagnons qui grouillent dans la fosse, qui le saisissent et le portent en triomphe au travers de la salle. Beaucoup ne se le feront pas répéter deux fois. Durant tout le set ce sera vols planés à répétitions.
Nico chante accroupi sur l'extrême-bord bord de la scène – des mains se tendent pour l'attirer à elles et d'autres pour le retenir - offre souvent son micro au public et surprise, il est indubitable que dans la salle beaucoup connaissent les paroles par coeur. Lyrics, intonations, les gestes qui vont avec, sans une erreur à l'identique. Aurait-il eu une extinction de voix que je subodore qu'il aurait pu être remplacé. Paroles en français ce qui explique peut-être la ferveur des fans. La musique est métal mais l'esprit semble avoir subi des influences rock alternatif festif et quelques accointances avec les attitudes rap. Mes réticences sont une chose, l'adhésion sans frein de l'assistance les bat en brèche. Quand ils sortiront de scène, l'insistance des ovations les feront revenir pour un long rappel durant lequel ils réduisent en poussière la fameuse baraque.

Damie Chad.
*
Petit détour par Lady Long Solo. Suis rentré dans la librairie tout fier de mon gouvernement. Qui n'hésite pas à mettre un car de CRS lourdement armés à dix mètres de cette tendancieuse boutique qui diffuse bouquins et affiches pas très politiquement corrects. Non seulement le stock est constitué d'éditions anarchisantes, mais en plus ils se battent pour la légalisation de la fumette. ! Ah ! les vertus de la démocratie en actes, la police qui veille à la protection de ceux qui ne pensent pas comme il faut ! J'en pleurerais presque. Hélas c'était une mauvaise interprétation, notre cher premier ministre ( celui qui va vallser aux prochaines élections ) loge dans cette artère. A quelque chose malheur est bon, me suis-je dit en incurable optimiste, cet après-midi en se rendant au boulot, notre principal sinistre n'aura pas manqué de remarquer ces gamins de cinq ans qui dorment dans la rue au coin du boulevard, les aura fait reloger fissa, en même temps que ces affamés qui fouillent dans les poubelles pour en extirper les déchets alimentaires et toutes ces femmes à la dérive qui mendient... Suis repassé plus tard dans la soirée, ben les fillettes de cinq et six ans dormaient toujours dans le froid... Quant au tri sélectif dans les containers, plus besoin de le faire... Paris se tiers-mondise dans l'indifférence éhontée de nos élites politiques.Lady Long Sanglot.
ROCK CRITIC. N°1
Sept-Oct 2016 / Gratuit.
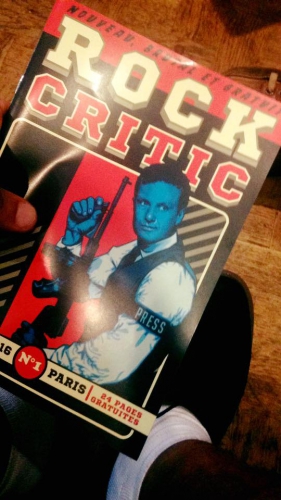
Suis ressorti de Lady Long Solo avec un petit trésor. Un zine, Rock Critic, avec Eliot Ness en couverture, serait-ce des incorruptibles ? Petit format, papier glacé, typo couleur, le truc hyper chiadé. Esthétique garantie. Gratuit en prime. Distribué en province, et disponible dans une dizaine de points de vente sur Paris. Tout cela est indiqué sur leur FB Rock Critic. Les articles ne sont pas signés mais l'on retrouve le nom de Géant Vert à l'intérieur. Non, ne sont pas sponsorisés par les boîtes de maïs en conserve, s'agit de ce rock critique grand amateur de concerts, connu pour ces préférences punkozoïdales. Le lecteur averti trouvera peut-être étrange que l'on retrouve un papier sur le festival d'Ostrava en République Tchèque et dans Rock & Folk et dans Rock Kritic. Je vous laisse vous perdre dans les plus sombres hypothèses complotistes...
Pour les kronics de disques, ne se foulent pas trop, Ramones, Sex Pistols, Clapton, faudra repasser pour l'originalité, s'en défendent à l'avance en arguant de l'indigence des jeunes créateurs... Ne soyons pas méchants, chez KR'TNT ! nous aussi nous évoquons souvent les vieilles gloires . Mais z'ont aussi des articles de fond. Une interview de Band of Skull présenté comme l'un des groupes actuels les plus importants. Même topo pour Luke Elliot. A ces entretiens nous préférons nettement l'article mal titré mais intelligent qui essaie d'expliquer pourquoi les punks sont restés fidèles à Bowie partisan d'une esthétique très éloignée du destructivisme punk. Le papier mériterait deux ou trois pages de plus mais le fascicule n'en possède que vingt-quatre.
Evidemment l'important c'est le ton. Acerbe et critique. Peu d'illusion sur l'état du rock actuel. N'osent même pas entrevoir le futur... Mettent la barre un peu haut. Seront-ils capable d'influer sur le futur du rock ? Car sinon, à quoi pourrait servir une revue rock ? A suivre.
Damie Chad.
POESIA SIN FIN
ALEJANDRO JODOROWSKY
( Sortie : 05 / 10 / 2016 )
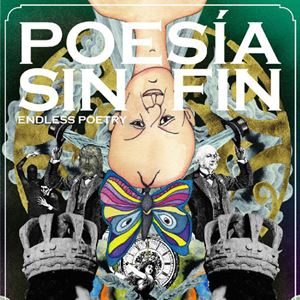
Vous voulez voir du rock 'n' roll ? S'il vous plaît, pas de ricanements intempestifs, je sais que vous possédez chez vous tout ce qu'il vous faut, des centaines, des milliers de galettes au frockment dument rangées sur vos étagères ou gisant en un indescriptible désordre sur le plancher de votre chambre. Soyez un peu attentifs, je n'ai pas dit écouter, mais voir du rock'n'roll. Ne vous précipitez pas non plus sur votre collection de dvd de concerts historiques, le rock'n'roll est partout, même là où on ne l'entend pas. La preuve, même pas une demi-mesure de la musique du diable dans le dernier film d'Alexandro Jodorowsky, l'immortel réalisateur de La Montagne Sacrée ( voir KR'TNT ! 268 du 11 / 02 / 2016 ).
Frise les quatre-vingt dix balais notre Jodo et ces dernières années il dresse un peu le bilan de sa vie. Pas du tout une rétrospective de sa carrière – l'est encore trop vivant pour se draper dans des auto-embaumements thurifériques – en 2013 c'était la revisitation de son enfance avec La Danza de la Realidad, et cette année il nous offre la suite chronologiquement naturelle, la jeunesse, le portrait de l'artiste en salamandre jetée dans les hautes flambées des années décisives d'une vie.

Pour les adeptes du réalisme socialiste ou des séries télévisées, il vaudrait mieux passer son chemin, Jodorowsky est un cinéaste, il ne reproduit pas le réel à l'identique. Il crée des images. Pas d'Epinal. Oniriques. Une espèce d'iconisation libre, une figuration démente qui puise dans le merveilleux symbolique et imaginatif. Recherche l'archétype individuel pour se mettre en scène. Images mouvantes qui vous engloutissent dans les sables les plus prégnants de la mémoire. La folle du logis a tissé des toiles dans lesquelles vous vous engluez à tout jamais.
Difficile de raconter un film de Jodorowsky même si la trame est des plus solides. L'on peut dégager des points nodaux de bifurcations qui vous ramènent au-delà du délire d'un capharnaüm baroque imaginal dans les intimités obsédantes des strates du vécu. Un peu l'équivalent cinématographique de l'imagier onirique que Guillaume Apollinaire tenta toute sa vie en poésie. Avec Dufy qui sort du bois d'Orphée et le testament du poète sous le bras. Avant que le coq tôt ne chante.
Beau fil d'Ariane pour remonter la piste du labyrinthe de Poesia sin Fin. Poésie sans fin comme la bobine d'un cinéaste qui tournerait sur elle-même en refusant de s'arrêter. Une vision hâtive du film le simplifierait à outrance en le résumant comme la bataille de la vie contre la poésie. Ce serait-là une lecture mortuaire bonne pour les plaques commémoratives des cimetières. Vaut mieux opérer un anéantissement nietzschéen des valeurs qui permettrait de le métamorphoser en combat de la poésie contre la vie. Car le film se résume à cela, l'intrusion de la turgescence poétique dans la réalité du monde, non pas une fleur chétive recroquevillée dans la fente protectrice d'un trottoir en attente de réfection mais une capricieuse et irréductible ombellifère carnivore décidée à dévorer la planète toute entière. Si le décor existentiel dans lequel vous vous mouvez dans la tristesse des jours perdus vous annihile, il vous suffit de le changer. Facile, laissez vos fantasmagories intérieures s'emparer du devant de la scène.
Le monstre de la poésie est au bout du fil. De l'autre côté, c'est encore pire : la femme. L'intercesseur femelle qui tient la laisse. Le poète va de l'un à l'autre. L'a choisi son camp. Le taureau sauvage. Un fauve en liberté ne se domestique pas. La poésie doit quitter les pages du livre. Elle est le meilleur chemin, le plus tentant, celui qui file droit. Le plus efficace puisque le plus court. En théorie, car en pratique il faut tenir compte de la courbure de la planète où l'homme fait résidence. Questions courbes l'éternel féminin en possède des plus excitantes. Aussi merveilleuses que meurtrières. Le poète qui croit faire de l'équilibre sur un fil tendu se retrouve vite toutou attaché aux fantaisies expiatoires de sa maîtresse. Orphée finit déchiré par les ménades, l'amour suprême ne serait-il qu'une forme des plus subtiles du masochisme ?

Poesia sin fin est aussi le partage des eaux de la poésie. Ou le fleuve majestueux mais sans danger de Pablo Neruda, ou le torrent impétueux impropre à toute navigation de Nicanor Para. C'est celui-ci qu'AleJandro Jodorowsky se décide à emprunter. Use et abuse du stupéfiant image cher à André Breton. Poesia sin fin est à regarder comme le passage de l'image poétique à l'image cinématographique. Ces visions qui se lèvent en vous lors de la lecture d'un poème, Jodorowsky les arrache à vos mentalisations intérieures et les met en scène devant vous. Le film aurait pu s'intituler l'exaltation aquiléenne du poète. Le torero poétique porté en triomphe par les rues de la cité tenant bien haut les couilles juteuses de l'animal sauvage dont il vient de se rendre maître. A moins qu'il ne s'agisse des siennes propres qu'il aurait, dans le tumulte du combat, arrachées par inadvertance. Jodo le vieux ne vient-il pas lui susurrer à l'oreille que si le rut échevelé et sans borne est un appel auquel le poète se doit de ne pas résister, il faut aussi se réconcilier avec les vieux démons du père castrateur au nom de l'amour fou. L'unification des contraires n'est pas un acte de tout repos. Plongez-vous dans le torrent dévastateur de Jodorowsky. Peu de chance que vous en sortiez indemnes. Attention à vos abatis. Menstruels ou bandant. Ne croyez pas vous en tirer en douce. Jodo possède toujours dans sa manche la carte du tarot qui vous manque. Se débrouille toujours pour vous refiler la plus fascinante. Celle qui est aussi la plus inquiétante. Le cinéma est une arme meurtrière. Tout dépend de celui qui la détient.
Damie Chad.
04/10/2016
KR'TNT ! ¤ 297 : BIG BEAT / BIG SANDY & HIS FLY-RITE BOYS / JO L'IGUANE ET SES REPTILES / CRASH TES COUILLESBRUCE SPRINSTEEN / SKINHEADS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 297
A ROCKLIT PRODUCTION
06 / 10 / 2016
|
BIG BEAT / BIG SANDY & HIS FLY-RITE BOYS JO L'IGUANE ET SES REPTILES CRASH TES COUILLES BRUCE SPRINGSTEEN / SKINHEADS |
|
BONNE NOUVELLE Renaissance de la revue BIG BEAT à l'ordre du jour. La numérotation reprend là où elle s'était arrêtée en 1982. ( Oui, nous avons été abonné ) Donc voici le numéro 22 consultable en cliquant sur l'adresse ci-dessous. Ce fascicule sonne un peu comme un appel aux armes. Les passionnés de pure rock'n'roll et du blogpost ROLL CALL supprimé par Google ( voir KR'TNT ! 287 du 23 / 06 / 2016 ) y retrouveront un lot de chroniques déjà parues sur ce site. http://www.calameo.com/read/00009080439a5fae454e0 Il ne nous reste plus qu'à attendre le numéro 23 ! |
BETHUNE RETRO / 27 – 08 – 2016
BIG SANDY & HIS FLY-RITE BOYS
Big Sounding Big Sandy
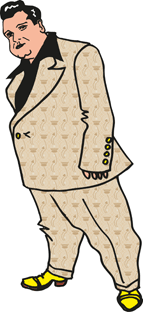
Après Wanda Jackson, Sleepy LaBeef, Barrence Whitfield et Lee Rocker, Big Sandy et ses Fly-Rite Boys se retrouvent en tête d’affiche de Béthune rétro 2016. Une consécration ? Big Sandy n’a plus besoin de ça. Apparemment, il tourne bien aux États-Unis, c’est un professionnel de l’Americana, il brasse un public large et, comme Elvis avant lui, il plait beaucoup aux ménagères.

C’est toujours très impressionnant de voir de grands artistes américains sur scène. Big Sandy dispose de deux atouts majeurs : une présence indéniable et une voix de rêve. Il déroulait ce soir-là le velours de sa voix dans la tiédeur de la nuit picarde. Même si ses chansons laissent parfois le bobo baba, il finit toujours par enjôler ses cajolés. Impossible de résister au charme de ces roucoulades de haut niveau, Big Sandy amène avec lui les grands horizons, la grand-canyonisation des choses, il hollywoodise le bop et tartine son swing de crème au beurre.

Son western-swing n’est pas celui des campements de mineurs du Nord, non, Big Sandy va plus vers le soleil et la douceur de vivre, vers les virées en roue libre et les routes qui se noient dans l’horizon enflammé. Il fait vibrer ses trois gouttes de sang mexicain et ses cheveux noirs plaqués brillent du meilleur éclat sous les projecteurs picards. Comme tous les gros, et notamment ceux qui sont des artistes, Big Sandy déborde de pâte humaine et de générosité. Il déborde même de talent et d’énergie. Il mène son show à la patte molle, mais il ne court aucun risque, car ses amis jouent comme des cracks, à commencer par Ashley Kingman, Telecaster-man redoutable de fluidité et incisif en diable, une sorte de virtuose sorti d’on ne sait où et qui se tape tous les raids éclairs.

Ces mecs-là savent jouer, pas de doute. On sent les professionnels aguerris, les vétérans du circuit. Le set de Big Sandy passe comme une lettre à la poste. Il compense l’absence de sauvagerie par un gros shoot de swing et le swing vaut tout l’or du monde, lorsqu’il est bien joué. Si on vient chercher sa dose, on repart content. On repart même doublement content, car on sent bien que Big Sandy assure d’une certaine façon la relève des pionniers qui auront tous bientôt disparu.

On ne se relève pas la nuit pour écouter le country-boogie de Big Sandy, c’est évident, mais en même temps, on apprécie de pouvoir écouter ses albums et de le voir jouer sur scène, car à sa façon, il porte le flambeau. Ce soir-là, face au vieux beffroi, le gros semblait ravi de jouer. Il n’en finissait plus de louer la grâce de Bitoune et de remercier les people.

Et pourtant, les gens de la technique faillirent bien saboter le set en envoyant trop de fumigènes. Le grand rigolard qui jouait de la stand-up n’y voyait plus rien et Sandy cherchait lui aussi son chemin à travers les volutes de fumée. Quand vint le moment des adieux, Big Sandy fit une effort de communication insolite en lançant : «I’m Big Sandy !» et pour ceux qui n’avaient pas compris, il ajouta : «Yé souis glos Sandy !»

Son premier album Jumping From 6 To 6 paraît en 1994. Big Sandy est donc encore un débutant. But what an album ! Dès le morceau titre qui ouvre le bal, on assiste à une fantastique partie de jump de swing et comble d’exotica, c’est traversé par un troublant solo hawaïen. À les entendre, on croirait voir arriver le 6e de cavalerie au triple galop. Avec des yah d’éclaireurs bop ! Quelle énergie ! Le fête continue avec «Different Girl», jazzé au débotté du bop. Big Sandy chante d’une voix gaie, il fait du hip shake de real cool cat. Il faut voir comme ça swingue ! Dans «True Blue», il sort sa meilleure diction de rockin’ cat pour balancer : I was born on the banks of the mighty Mississippi ! Avec sa voix, il épouse les virages du bop à la perfe. Il tape plus loin dans le swing-along pour «When I Found You». Big Sandy chante tout à la bouche pleine, avec une réelle gourmandise. Il est tout simplement admirable. Dans «Who Tell Me Who», on note la fabuleuse présence du who expiré. Il sait colorer la musicalité du chant. C’est un chanteur parfait, plein d’initiatives. Les gros sont toujours les meilleurs. Il passe au jumpy bon enfant avec «Hi-Billy Music». Ce mec est un diablotin plein d’allant. C’est jumpé à la stand-up, bien sûr. Il s’amuse aussi à chanter des bluettes agitées du popotin, comme ce «Honey Stick Around A While». Retour de l’extravagante débauche de rythme avec «Honky Tonk Queen». Le gros embarque son monde à la régalade d’un drive de stand-up. On a encore des coups de guitare hawaïenne derrière. Ces mecs sont vraiment pleins de vie. L’album se termine avec des raids éclairs dans le country-boogie et le swing surexcité de «Juiced». What a bum !

Ils se déguisent en cow-boys sur la pochette de Swingin’ West qui sort l’année suivante. Dave Alvin des Blasters produit l’album. On s’en doute, c’est une fois de plus bardé de swing, avec des merveilles comme «You Don’t Matter Anymore», pas loin du jazz manouche, tellement c’est enjoué et passionné. On y sent même une tension sourde et douce à la fois. Ils retapent dans le swing élancé avec «Blackberry Wine». C’est taillé comme l’aile arrière d’une Thunderbird, magnifique de finesse et d’éclat - Hey mister Call ! - Encore une belle pétaudière. Ils enchaînent ça avec «Murphy’s Law», un instro de classe nuptiale, d’allure royale, complètement envoûtant. C’est même un hit. Retour à l’absolu du bop avec «You Said You Don’t», pur rockab de juke, bien boppé au chant. Big Sandy chaloupe son cut comme un cat cool. C’est même du bop délicat, un vrai travail l’artiste. Il faut voir comme il étire bien ses syllabes, le bougre. Il termine son bel album avec «The New Ball», une merveilleuse sautillade de boppin’ cat - It’s a ball ! - Eh oui, Big Sandy s’y connaît en ball ! Un petit conseil, comme ça, en passant : écoutez ses albums.

Feelin’ Kinda Lucky est encore un disque frais comme un gardon. Sur la pochette, un couple danse le rock à l’ancienne. Et pouf ! Ça part avec «The Loser’s Blues» que le gros chante avec délectation - I lost my appetite - Une vraie voix de miel. Il sonne comme un maître chanteur. Voilà encore un album qui s’annonce délicat et pur. Quelle classe il a dans le délié ! Pur coup de swing avec le morceau titre qui suit. Voilà le swing cristallin, du vrai jive de juke - Lucky you baby ! - Et la fête continue avec «Let’s Make It Tonite». Le gros chante vraiment dans tous les coins. Quelle leçon de swing ! Ils tapent aussi dans le jazz manouche avec «If You Know Now» et «Strange Love» et dans le jazz swing avec «Have And Hold». Un album idéal pour l’amateur de swing pur.

Le gros s’écarte et laisse jouer ses copains surdoués dans l’album Big Sandy Presents The Fly-Rite Boys paru en 1998. Si on aime la musique bien jouée, il faut l’écouter. Si ce n’est pas le cas, alors il faut passer à autre chose. Les Fly-Rite jouent de gros instros diabolo. Ce sont de vrais swingers. Ils vont chercher le croisement du jazz manouche et du groove de rêve. Dans «Wizard’s Dust», l’infernal Ashley Kingman passe un solo jazz digne de Wes Montgomery. Ces mecs-là sont capables de toutes les entourloupes. Mais c’est mieux quand Big Sandy chante. Cet album sert juste à montrer qu’ils sont vraiment capables de tout jouer. Aucun doute là-dessus.

Encore du swing à la pelle sur Night Tide paru en l’an 2000. Ashley Kingman passe un solo de confédéré au tototo de la régalade dans le morceau titre qui ouvre le bal. Une fois de plus, les Fly-Rite frisent la dextérité sautillarde du jazz manouche. «When Sleep Won’t Come» sonne comme du swing à la dentelle de Calais, c’est tissé fin à la note diaphane et battu à discrétion. Sacré Sandy, il sait y faire. Et quand ils tapent dans le rockab, ça redevient magique. Exemple avec «Hey Lowdown» - Hey lowdown you better slow down - Fabuleux leitmotiv et le gros active sa pompe à jive alors il redevient le cool leader cat du combo jive. On se régalera aussi d’«I Think Of You». Le gros a envie de limer la belette, alors il pense à elle - At half past twooooo - Et il boucle ce très bon disk avec «Let Her Know», chevauché ventre à terre par un gros déchaîné, yahhh ! il y va, il fonce comme un messager de la Wells Fargo sous les flèches apaches, yahhh ! Quelle vision de la plaine sous le vent au tagada de l’étalon jive ! Voilà de la pure Americana jouée sur des accords de concasse.

En 2003 ils passent avec armes et bagages sur le label de Tony Joe White, de Chuck Prophet et du bon Révérend Horton Heat, Yep Roc Records. Ainsi sort l’album It’s Time. Quelle bombe ! Dès le premier cut, «Chalk It Up To The Blues», on tombe sur une fabuleuse attaque, un riff à la Eddie Cochran et un chant classieux à la Elvis, avec le gras de la voix, celui d’un seigneur du rock américain. Quel fantastique gros lard ! Ça swingue comme au paradis, lorsque les anges dansent le bop. Encore mieux, voilà «Bayou Blue», monté sur un tempo de beat inexorable, emmené à la bonne franquette. Le gros sait pulser un hit et derrière lui, Ashley Kingman joue des riffs tahitiens, puis il pique une crise à la Duane Eddy. On entend même l’accordéon. Effarant ! Big Sandy revient à la country avec «Her Hair Is A Mess», mais comme il fait ce qu’il veut de sa voix, ça tourne à la sorcellerie. Il caresse l’Americana dans le sens du poil. Ce gros lard pourrait charmer un cobra rien qu’en chantant. Il enchaîne avec le morceau titre, slappé de base et de rigueur. Voilà une magnifique sauterie de gros au pinacle de sa gloire. Il chante à la régalade de la délectation et derrière, ça slappe au paradis des rockab. Encore de la country au miel avec «Wishing Him Away». Il est plus sucré qu’Elvis, mais il fait autant de ravages chez les ménagères. Avec «Catalina», il tape dans l’exotica d’exception. On dirait presque un cut des Pixies. C’est plein de soubresauts de bourrelets de cellulite, comme on en voit sur les hanches des danseuses, dans les restaurants de Marrakech. Puis il éclate «(You Mean) Too Much To Me» à la country éclair et ça vire au groove de surdoué. Quelle énergie ! Son «The Money Tree» flirte avec le jazz manouche. On sent bien qu’ils se régalent à jouer ça. L’infernal Ashley Kingman allume «Heaven Is The Other Way». Il joue des plans intermédiaires qui damnent l’oreille pour l’éternité. Et le gros finit cet album fascinant avec «The Night Is For Dreaming», un swing de rêve, une nouvelle preuve de son génie.

Attention, Turntable Matinee figure aussi parmi les grands albums de swing moderne. Le gros développe une pure énergie rockab dès l’ouverture du bal avec «Power Of The 45». On a un joli slap à l’avant du mix - Start to move ! That’s the power of the 45s - Le gros rend hommage à des héros comme Lew Lewis, Link Wray, Johnny Powers et Little Esther ! Fantastique ! Voilà un homme de goût. Cut après cut, on renoue avec la vivacité de ce grand groupe de swing. On retrouve le «Hauted Heels» chanté sur la grande scène du Rétro. Ça sonne comme un embarquement pour Cythère et le gros use et abuse de sa belle voix - They took my baby away ! - Il enchaîne avec un autre cut joué sur la grande scène, «Spanish Dagger», d’apparence très pépère, mais bien atmosphérique. Pure exotica. Back to the country strut avec «Mad», joliment slappé derrière les oreilles. Le gros sait conduire sa diligence. Voilà un chanteur bien vivant et très diversifié. Et derrière, ça ne chôme pas ! Quelle ambiance ! Trop de son, trop de texte, trop de qualité - And I got mad/ Sometimes I’m mad - Comme chez Johnny Cash, on se régale de la diction. Le gros chante «Lonesome Dollar» à l’admirabilité des choses et il passe au r’n’b avec «Slippin’ Away» monté sur le riff de «Keep On Runnin’». Oui, le gros fait du Spencer Davis Group sans le faire exprès. En prime, il sonne comme un black de l’âge d’or de Kansas City. Il finit avec un slight return de «Power Of The 45». Dommage que tout l’album ne soit pas de ce niveau.

Son dernier album en date s’appelle What A Dream It’s Been. Il s’y niche une énormité intitulée «Three Years Blind». Voilà du pur bop chanté à la cantonade, plein de vie et gratté à coups d’acou - I was three years blind - Extraordinaire débauche d’énergie. Sur ce joli coup de bop de base qu’est «Glad When I’m Gone», Ashley Kingman passe un solo de picking diabolo. On entend rarement des mecs gratter des cordes avec une telle frénésie. Rien que pour cette partie de picking incendiaire, il faut écouter l’album. On y trouve aussi un joli duo avec une nommée Grey Delise : «What A Dream It’s Been». Derrière, ça joue carrément à la Django. Ces mecs-là sont beaucoup trop puissants. On comprend que l’Amérique profonde puisse les plébisciter.
Signé : Cazengler, Big Saindoux

Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Béthune Rétro. 27 août 2016
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Jumping From 6 To 6. Hightone Records 1994
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Swingin’ West. Hightone Records 1995
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Feelin’ Kinda Lucky. Hightone Records 1997
Big Sandy Presents The Fly-Rite Boys. Hightone Records 1998
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Night Tide. Hightone Records 2000
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. It’s Time. Yep Roc Records 2003
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. Turntable Matinee. Yep Roc Records 2006
Big Sandy & His Fly-Rite Boys. What A Dream It’s Been. Cow Island Music 2013
TOULOUSE / 01 – 10 - 16
L'AUTAN
JOE L'IGUANE ET SES REPTILES
CRASH TES COUILLES
L’Autan en emporte le vent…
C’est dommage, c’est fini. C’était bien, mais c’est fini. Toulouse perd, encore une fois, un lieu culte pour les rockers, après la fermeture du Mandala et celle de la Dynamo, même si ces lieux n’étaient ni le temple, ni le Graal, ni le muséum d’histoire naturelle. Il y a sans doute d’autres zones à dénicher, allez savoir où…

Ce soir, la dernière, organisée par Marco et Pablo, en hommage à la voisine acariâtre et pas rockeuse pour deux cents, laquelle fut la grande inspiratrice du déménagement pour cause de décibels prétendument nuisants et illégaux, est dédiée justement au hard et à la fiesta : La garde meurt et ne se rend qu’au fût de blonde, qu’on aura vu couler à flot. Il y a même un photographe (gros calibre, milliards de pixels et zooms prodigieux) dont un quidam renverse le seau posé par mégarde, ou par excès de confiance, à même le sol. Bonheur du platane dont les racines poussaient se frayant un chemin sur la place Arnaud Bernard, à l’angle du boulevard d’Arcole et de l’avenue Honoré Serres…
Depuis près de trente ans, le zinc de ce bar Punk’n Roll du quartier Arnaud Bernard voit défiler les amateurs de musique et les piliers de comptoir. Mais c’est en 2003 avec la reprise en main de Paulo et Marco que l’établissement devient résolument rock. Paulo affrète même des bus pour transporter les fans de Motörhead jusqu’à leurs concerts au Zénith.
La notoriété du bar passe aussi par sa décoration. Sacs à main couverts de toiles d’araignées aux murs, flexibles de douche enlacés au-dessus du comptoir, robots métalliques et squelettes en plastique : l’Autan a des airs de brocante et de train fantôme.
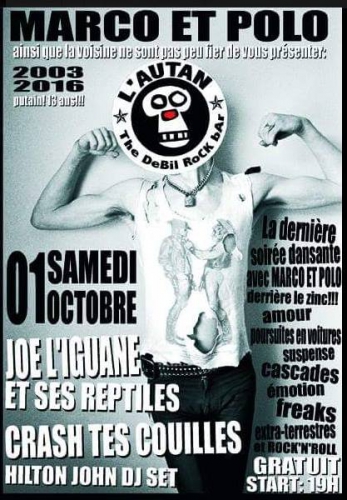
Avant de partir, samedi soir, Paulo et Marco ont fêté leur départ avec dernier un baroud d’honneur : un double concert de Joe l’iguane et Crash tes couilles. « On a prévenu la voisine, et on lui a dit qu’on ne l’embêterait plus », explique Paulo. « Elle a souri ».

Bien carré, tape dure, énergie à revendre, tout aurait été parfait si cette triste et funeste circonstance n’avait drainé autant de populo : impossible même de battre le rythme, impensable même de tenter de claquer des doigts, inutile d’essayer de les porter aux lèvres pour siffler notre admiration. On se marchait littéralement dessus ! Quelles jolies paires de fesses frottaient quels pantalons pour tenter un passage au plus près de la scène, quelles paires de seins forçaient les torses supposés velus autant que tatoués pour la même ambition ? On savait bien que le corps se maintient à 37,2°C (ou 99 Fahrenheit si vous préférez) mini, mais là, on se serait cru dans une étable bourrée de testostérone qui n’aurait nul besoin de chauffage d’appoint…
Cette chaleur aura finalement eu raison de notre enthousiasme, et aura un peu gâché la fête…
Heureusement, on entendait bien quand même, de la fraicheur relative de l’extérieur où il y avait autant de monde… Un enterrement de 1ère classe, la voisine aura probablement effacé rapidement son sourire. Mais quelques mots sur les musicos :

"Joe L'Iguane & ses Reptiles", groupe punk rock toulousain célèbre dans les années 90 qui s'est reformé récemment. A mon avis, moins punk qu’au millénaire dernier, mais tout aussi hard. Samy, voix de ténor sanglant, Flo à la basse, Troll à la batterie et en slibard (c’est sa marque de fabrique), Laurent et José aux grattes défoncées. Z’étaient déjà passé par là (6 juin 14), puis à l’Internazionale (autre bar toulousain, c’est marrant comme la bière et le rock font bon ménage), et enfin au Bikini (octobre 14, lors du festival « La France dort »). Bref, du bon, du hard, pas forcément du très original, mais ça s’écoute bien.
« Crash tes couilles », c’est autre chose, c’est la 4ème dimension, à un point tel qu’on ne pourrait (presque) plus parler de musique. C’est trash à souhait, c’est complètement déjanté, et en même temps ça passe des slogans aimablement accueillis par l’underground toulousain.

Dans son livre « Histoire secrète du Rock français » Jean-François Manœuvre en parle ainsi : «Quand j’ai vu ces mecs en string ce fut la révélation. Les Crash tes Couilles on croit que c’est de la musique mais ce n’est pas de la musique, les Crash tes Couilles c’est surtout la meilleure chose qui soit arrivé au Rock n’Roll… ». Pour ma part, je ne partage pas : la meilleure chose qui soit arrivée au R’nR, c’est… l’invention du R’nR ! Et là, on en est quand même un peu loin. OK, OK, chacun sa moutarde.
Allez, ciao, je vais me coucher, comme d’habitude avec les oreilles en vrac, je n’entends même plus les ronflements de la ptite louloute, bonne nuit.
BELUGA ROCK
BORN TO RUN
BRUCE SPRINGSTEEN
( Traduction : Nicolas Richard )
( Albin Michel / Septembre 2016 )
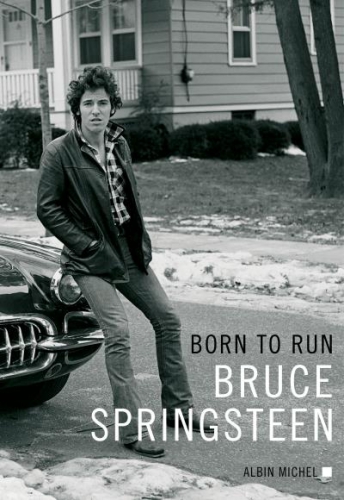
Plus de six cents pages. Pleines à ras bord. Le boss ne fait pas les choses à moitié. Une véritable autobiographie. Pas une broutille torchée sur un magnéto. Rédigée avec soin. Ne vous inquiétez pas, il raconte sa carrière de rocker en long et en large. Pour les petites anecdotes croustillantes, la récolte sera maigrichonne. Un torchon à la Closer aura du mal à prélever une dizaine de bonnes pages. L'est sans doute un peu pudique le Bruce, l'on sent le gars qui n'aime pas étaler ses frasques et ses intimités au grand jour, mais son projet est tout autre. N'écrit pas pour se raconter mais pour faire le point, l'a des tonnes de renseignements à nous offrir, mais de fait il préfère se livrer à une véritable introspection. Essaie de répondre à quelques questions essentielles, qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? – le vieux questionnement de la célèbre toile de Gauguin.
Pour l'origine, ne s'en cache pas. Né en 1949. Milieu prolo. Famille d'origine italo-irlandaise. Y a toujours eu à manger à la maison. Guère plus. Mais la pauvreté n'est pas le problème. L'a eu faim d'autre chose de bien plus important. La reconnaissance du père. Un véritable boss lui aussi. A sa manière. Un handicapé du sentiment et de la communication. Ne parle pas, reste assis à la table de la cuisine à allumer clope sur clope. Boit. La statue du commandeur pourvue d'une terrible force d'attraction négative. Une présence pesante. Un trou dans la psyché du petit Bruce. Recouvert dans ses neurones par une formidable appétence de vivre. Qui ira s'agrandissant sournoisement avec l'âge. Un abîme dans lequel il tombera lorsqu'il sera devenu adulte.

Pas de père. Pas de mère non plus. Elle adore ses trois enfants. C'est elle qui lui paiera sa première guitare et qui n'hésitera pas à prendre un crédit pour un engin plus évolué. Elle aime son fils, l'encourage, lui conseille de vivre ses passions, vive, enjouée, mais qui abandonnera ses deux grands Bruce et Virginie, aux âges cruciaux de dix-sept et dix-neuf ans, afin de suivre son mari qui a décidé de partir pour entamer une deuxième existence en Californie...
La voie pour l'usine était toute tracée. Entre temps y avait eu n grain de sable. Un véritable tempête de rocs. Vous connaissez le nom du coupable. Elvis Presley. Qui fait son apparition sur l'écran de télévision en l'année de grâce 1956. Pour Springsteen dans sa caboche de gamin de sept ans, c'est l'étincelle rassurante, il existe un autre monde possible. L'aura une piqûre de rappel en 1964, par le même canal, I want to hold your Hand, avec les Beatles. Confirmation, lui aussi sera un musicien de rock and roll.
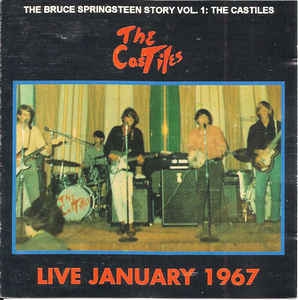
Les débuts ne seront pas faciles. L'apprentissage se fera par étape. Le cousin qui au bout de quelques mois lui révèlera qu'il est nécessaire d'accorder une guitare avant de jouer... Bruce tâtonne. Doucement mais pas très sûrement... Plus tard après les premières répètes informelles avec les copains, le bal du lycée, les premières formations aléatoires l'accède enfin à sa première guitare potable. Pas très maniable, mais il est indubitable qu'elle possède un son fabuleux, une grave plénitude à nulle autre pareille. Faudra l'admiration d'un gamin qui vient le féliciter de sa géniale idée d'avoir osé monter des cordes de guitare sur une basse pour qu'il comprenne enfin le pourquoi de l'onctuosité de sa sonorité ! Presque aussi bien que Bashung qui brancha et explosa sa première gratte directement sa gratte sur la prise de courant... Apprentis rockers, ne désespérez pas ! Tous les espoirs sont permis aux obstinés. Ce qui ne vous électrocute pas, vous rend plus fort !
Progressera tout de même, d'expériences cuisantes en tentatives plus ou moins réussies. Ne se découragera pas, s'entêtera, accumule de la pratique, s'aperçoit bientôt que par rapport aux copains et aux gratteux du coin, il n'est pas le plus foireux. Serait même dans le peloton de tête. Son premier vrai groupe commence à se faire remarquer. Les Castiles moulinent bien, avec Steel Mill ce sera encore mieux, commence à réunir les premiers éléments de l'esprit de ce qui sera un jour le E Street Band. Sont même devenus les rois de la petite ville d'Asbury Park et de tout le New Jersey, les gloires locales, avec même un amateur Tinker qui investit sur le groupe. Bossent dur, donnent des shows qui soulèvent l'enthousiasme du public, commence à se former un noyau de fans. Sont parvenus à un stade critique, se pensent assez bons pour aller jouer dans la cour des grands mais il leur manque les réseaux qui leur faciliteraient l'entrée en contact avec un label et l'argent qui leur permettrait de tourner hors du comté natal.

Tentent le gros coup. Si la bonne fortune ne vient pas à toi, il te suffit de courir vers elle. Faut quitter le New Jersey, une taupinière à blaireaux, le futur du rock se fait de l'autre côté du pays, sur la côte ouest. Matériel entassé dans un camion, une voiture suiveuse et avant pour le California Dreamin ! A les en croire on n'attend qu'eux. Ces damnés surfers vont apprendre ce que c'est que le rock couillu. Sont gonflés à bloc, et au début les dieux leur semblent favorables. Mettent le feu, ont un bel article dans un grand journal et décrochent une place pour passer au Fillmore à San Francisco. Montée en flèche ? Cible ratée. Enregistrent une démo qui n'emballe personne, mais le coup de Trafalgar survient au moment où ils ne s'y attendent pas. Participent à une sélection, sont sûrs d'être les lauréats, mais c'est un autre groupe qui est pris. Quelle injustice ! Non pas du tout ! Rien de plus utile qu'une bonne gifle pour remettre les idées en place. Les autres groupes étaient meilleurs. Point barre. Suffit pas de sortir le grand jeu des guitares malmenées, faut jouer mieux.
Retour à la case départ. Le moment de se remettre en question. Pour Springsteen ce moment de doute est primordial. Pas question d'abandonner. Prend pleinement conscience de sa position de leader. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Faut revoir sa copie. Fini le rock échevelé, à l'arrache, l'adolescence est terminée, un peu de finesse, désormais l'on tapera davantage dans le rhythm'n'blues, avec section de cuivres, s'il vous plaît. Le groupe est remanié, change de nom, voici The Bruce Springsteen Band. Et cette fois Monsieur le Responsable Springsteen s'aperçoit d'une simple règle mathématique, plus vous devez payer de musiciens plus cela vous coûtera cher ! Exunt les saxophones, et bientôt Bruce décide de faire cavalier seul.
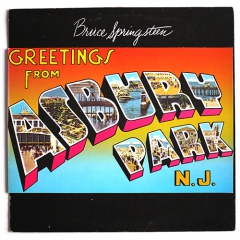
Quitte ou double. Ce sera double. L'a rencontré Mike Appel qui le prend en main. Lui trouve une audition chez Atlantic qui ne mord pas, et puis avec John Hammond de Columbia, le mythe en personne celui qui a signé Billie Hollyday et Bob Dylan... et qui finit sa carrière en signant Bruce Springsteen. Nouveau départ pour Springsteen, ne fonce pas dans le brouillard, l'a ses idées et ses modèles. Pour la voix lorgne sur Roy Orbison pour le son des guitares guigne sur Duane Eddy, et pour les textes l'a Bob Dylan dans la mire. Le premier album Greetings s from Asbury Park, N. J. sortira en janvier 73. L'en vendra, 25 000 exemplaires. En novembre de la même année paraît un deuxième album The Wild, the innocent, and the E Street Shuffle, qui ne perce pas davantage.

Bruce saisit le taureau par les cornes. Si les disques ne parviennent pas à faire la différence, il établira le forcing grâce aux concerts. Ira chercher les fans un par un. Tournent un maximum. C'est en ces mois sur le fil du rasoir que Springsteen se révèle à lui-même. La pression est énorme mais décuple ses facultés créatrices, le groupe acquiert une cohésion qui touche à la perfection, l'est un vecteur qui le pousse en avant, qui lui donne la confiance en lui-même qui lui manquait. C'est le début de la décennie fabuleuse, Springsteen pond des chefs- d'oeuvre à la chaîne. Born to Run ( 1975 ), Darkness on the edge of the Town ( 1978 ) , The River ( 1980 ), Nebraska ( 1982 ), Born in the USA ( 1984 )... Années fastes, le groupe tourne à plein régime, l'argent entre à flots, mais les premières fêlures apparaissent. Une grosse fatigue à l'origine vraisemblablement, mais cette explication n'en est pas une. Pas plus que celle du fisc qui lui tombe dessus après les deux couvertures de Newsweek et du Times la même semaine et qui lui réclame les impôts qu'il n'avait jamais payés. Jusqu'en 1982 la majorité de ses gains serviront à régler l'ardoise. Bruce a recherché la célébrité, l'a désirée, l'a recherchée, l'énonce clairement, s'il a marné si dur c'est qu'il voulait atteindre le haut de l'échelle et pas un échelon inférieur, et maintenant il doit faire avec. Les contradictions seront de deux ordres, personnelles et idéologiques.

Qui règle ses dettes s'enrichit. Le fils de prolo se retrouve avec des revenus de millionnaires. L'est le patron. Pas un anarchiste. Ses camarades du E Street Band, il les paye selon les besoins qu'ils déclarent avoir. Un principe simple : celui qui doit une pension alimentaire reçoit davantage que celui qui n'a point ce genre de poids mort à sa charge. Démarche sympathique qui ne court pas après un égalitarisme de façade. Certains exagèreront. Bruce s'en plaint. Avec humour. Nous voulons bien le croire, toutefois il oublie de mentionner l'épaisseur de la tranche du gâteau qu'il se réserve. Mais ce n'est point ce genre de problématique – que appellerons la recherche de l'injuste milieu - qui le gêne.

Le problème qui le taraude n'est pas d'ordre individuel. Lui suffit de ne pas rougir de lui-même, de pouvoir se regarder chaque matin dans sa glace. Patron mais pas exploiteur. Ses amis, ses musicos, c'est de la sphère intime, n'a pas l'impression d'être un esclavagiste. C'est par rapport au reste du monde qu'il se sent mal. Pour circonscrire sa mauvaise conscience nous la limiterons à sa réalité existentielle américaine. Ne se contente pas d'être un artiste qui apporte du plaisir à son public. N'est pas là pour faire passer du bon temps à la foule qui assiste à ses concerts ou qui achète ses disques. Ni pour leur procurer quelques heures de plaisir et l'oubli facile d'un quotidien grisâtre... Revendique ses origines prolétariennes, n'est qu'un simple fils d'ouvrier, fait partie des humbles, et lui qui a magnifiquement réussi se sent redevable de la masse informe des sans-grades, des anonymes, des petites gens, des misérables. Aucune culpabilité, mais l'envie de les défendre, en leur donnant la parole au travers de ses textes et chansons.

Une démarche à la Dylan. Mais Bobby a rapidement effectué une marche arrière en s'apercevant qu'il était devenu le porte-drapeau de toute une contestation à laquelle il n'était pas insensible mais qui ne le taraudait pas plus que la moyenne. Entre le partage des idées et l'engagement militant il existe une sacrée marge. Le sieur Zimmerman a eu la désagréable sensation qu'on lui forçait la main... Pour Springsteen la donne sera différente. Entame un parcours qui se peut résumer musicalement, de Hank Williams à Woody Guthrie. De l'homme perdu en ses tourments intérieurs, tournoyant dans le tohu-bohu d'un mal-être existentiel, à l'individu attentif à ses semblables, soucieux de leur montrer un chemin de lutte et de combat.
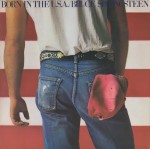
Le dépouillement de Nebraska et la batterie claironnante de Born in the USA traduisent chacun à leur manière ce souci de Springsteen. Certes son rock and roll avait jusqu'à lors toujours mis en scène des personnages ou des attitudes appartenant à la riche faune des déclassés de la grande America. L'Amérique des loosers. Mais la guitare et la voix dans leur nudité dénoncent tout ce qui pouvait y avoir de convenu et de stéréotypé dans tous les textes précédents de Bruce. L'on est en quelque sorte plus près de la germination sémencielle du blues. Les paroles charrient une authenticité à laquelle le boss n'était jusque-là jamais parvenu.
A l'inverse le Born in the USA sonne comme une déclaration de guerre... à la guerre. Toutes les guerres. Les répliques du Vietnam, de l'histoire faussement ancienne, une catastrophe morale pour les Etats-Unis, contre laquelle les artistes de la rock-music de l'époque s'étaient élevés, mais surtout le piège qui s'était refermé sur les soldats traumatisés et inadaptés de retour dans la mère patrie. Springsteen prend position.

Semble avoir résolu ses distorsions. Il n'en est rien. Tout ce qui précède n'était que l'écume de la mer. En 1988, Bruce congédie l'E Street Band. Continuera à enregistrer des disques, mais le combat est ailleurs. Se colleter avec son pire ennemi est devenu une nécessité. L'a toujours su, le rocker n'est qu'un leurre. Un épouvantail utile qui attire les oiseaux pour les mieux chasser dès qu'ils deviennent trop pesants. Le rock lui a permis de tenir à distance la grande trouille de sa vie. La trajectoire agitée du baladin est le meilleur moyen de ne pas replonger dans l'enfer familial. Joue de la guitare et chante pour ne pas avoir le temps de s'arrêter et de ne pas être confronté au plus insupportable des défis. Ne pas se comporter comme son père. Être à la hauteur de ce que son géniteur n'a pas su faire. Savoir s'occuper de ses enfants et de sa famille. Analyse son comportement avec les filles. Les admiratrices, les groupies, les rencontres d'un soir, a su en profiter. Pas un collectionneur, parle de ces accointances fugitives avec respect et sans une once de mépris, mais ne s'y attarde pas. Plus importante ces liaisons qui ont duré deux années et qu'il a sciemment sabordées avant qu'elles ne deviennent trop sérieuses. Pas un chaud partisan du développement affectif durable. Un mariage de quatre ans, séparons-nous bons amis, tu es une fille formidable. Le chanteur engagé a peur de s'engager. Faudra l'intelligence amoureuse de sa choriste pour qu'il accède enfin à la stabilité affective qu'il recherchait. Pat lui donnera trois enfants, aujourd'hui bien grands.

Le denier tiers du livre est consacré à cette vie familiale, ce simple bonheur de vivre partagé. Mais le rocker n'est pas mort, l'a rappelé le E Street Band et les tournées recommencent. Reste encore le problème du père qui fera deux fois huit cents kilomètres en voiture juste pour lui dire qu'il ne s'était point trop occupé de lui gamin. Une reconnaissance paternelle qui a dénoué bien des noeuds d'attente et de désespoir. La vie est facétieuse, ce père qu'il l'a si longtemps haï d'un amour insatisfait, lui a transmis plus qu'il ne croit. Son hérédité. Sa folie. Sa schizophrénie. Sa paranoïa. Ne l'a pas vécu comme son père. Cela s'est traduit par d'immenses crises de désespoir nihiliste. Un monstre tapi au fond de lui qui attend l'ouverture des portes. Des bouffées d'angoisse incapacitante. A su les éloigner, les tenir en respect, ne pas le montrer, faire semblant, les juguler, seul, puis avec le secours de docteurs et d'entretiens psycho-psychanalytiques, et de gros médocs en dernier recours. Séances de musculation et interminables virées en moto pour se tirer des griffes de la dépression. Merci papa ! Sans ironie. Ne lui en veut pas. Constate le fait en toute simplicité.
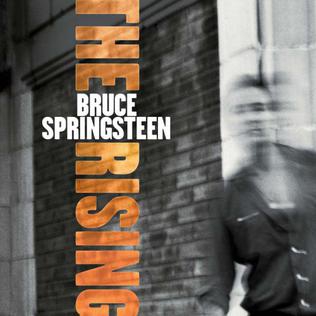
Preuve d'humilité tout le long du chemin. Ne tire pas la couverture à lui. Ne se prend pas pour un grand chanteur. Son timbre manque de cette profondeur mystérieuse que les plus grands ont acquis à la naissance. L'a tenté d'en tirer le maximum. A rusé, a surtout exploité ses qualités les plus fiables. Pragmatisme bien américain. Do it yourself, but do the best. Parle beaucoup des musiciens qu'il a côtoyés, trace de très beaux portraits de Nils Lofgren, de Steven Van Zandt et de tous les autres qui ont émargé dans ses groupes. Clarence Clemons reste le plus attachant. Possède cette folie nonchalante si particulière, cette touche de génie fulgurante qui le classe dans la hors-classe. Ce n'est pas qu'il était le meilleur saxophoniste du monde, c'est qu'il habitait le monde si pleinement qu'il n'était pas ces clones de fantômes tremblotants que sont les autres hommes. L'était présent. C'est tout. Dans la démesure de sa présence. Le plus malheureux de tous. Le plus heureux de tous. Ce cette gousse de vanille noire qui tant fait défaut au rock and roll blanc.
Une biographie différente. Des ressemblances par ci par là, les longues années de progression ressemblent à celles que Steven Tyler narre dans sa bio, ce qui n'est pas étonnant deux gamins qui se hissent aux premières places à la force du poignet, les premiers pas chez Columbia ne sont pas s'en rappeler ceux de Dylan racontés par François Bon. Mais la seule qui puisse rivaliser avec celle-ci reste Life de Keith Richards. Très différentes, pour ne pas dire exogènes. Celle de Keith pue la vieille Europe. Personnalité faisandée jusqu'au trognon. Celle de Springsteen fleure bon la rusticité américaine. Richards referme le buffet et c'est à vous d'entrevoir par les fentes du battant ce qui se cache à l'intérieur. Springsteen ouvre les portes en grand. Montre tout, ne voile rien, pas question de laisser la housse sur le canapé de doctor Freud. Keith l'européen respire le blues et Springsteen l'américain transpire le country rock.
Bruce raconte sa carrière, officie chronologiquement. Mais l'aurait été chauffeur d'autobus qui à la retraite se serait décidé à rédiger ses mémoires que le livre n'aurait pas été profondément différent. Certes vous auriez tout su sur les vicissitudes de la ligne 24 ou sur les moeurs douteuses de ses passagers. Les amuse-gueules de l'apéritif. Le gros du déjeuner aurait consisté en ces tempêtes sous les crânes chères à Victor Hugo. Un galimatias sans fin de pensées tordues qui tourneraient en rond en s'entrecroisant sans répit dans sa boîte à ruminations à l'instar d'un essaim de poissons rouges dans un bocal à cornichons. Maintenant soyons francs, les affres de la vie de Bruce Springsteen nous auraient-elles autant intéressés s'il n'avait pas été un chanteur de rock and roll ? Et pourtant la relation de ces atermoiements psychologiques représentent la partie la plus profondément springstéenne de son autobiographie !
Damie Chad.
SKINHEADS
JOHN KING
( Traduction : Alain Delfossé )
( Au Diable Vauvert / 2012 )
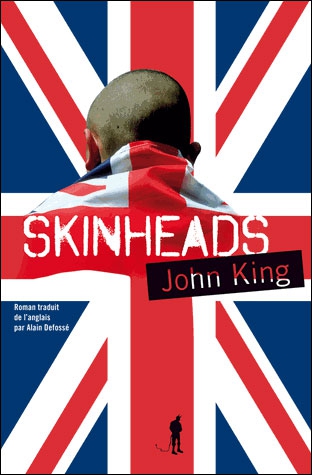
John King, n'avais jamais lu une ligne de lui. De sa faute, l'a été célèbre à la fin du siècle précédent pour son bouquin Football Factory qui conte les aventures d'un groupe de hooligans fans de Chelsea. Or moi je déteste le sport, cet opium du peuple... Et puis chez le soldeur, j'avise de loin sur la gondole aux livres le pavillon de l'Union Jack qui ne flotte pas au vent mais qui s'étale sur une couverture, serait-ce un opuscule sur les Who ? Ne faut jamais prendre ses désirs pour la réalité, le titre est sans équivoque, un truc sur les Skinheads, un roman en plus, j'hésite mais à un euro l'exemplaire je ne risque pas la banqueroute.

Les Skinheads ont mauvaise réputation. L'existe l'antidote, les fameux redskins qui font la chasse aux fachos-skins, mais John King n'en parle point, n'agite pas le chiffon rouge du communisme. N'en a pas besoin. Aborde la problématique d'une autre manière. Ne s'intéresse pas aux épiphénomènes, nous plonge directement en plein coeur du mouvement skin. Et pour être très précis dans la tête de ses héros. Car la fantasmagorie du monde, c'est votre cervelle qui tient les crayons de couleur et qui distribue les teintes qui vous conviennent le mieux. Le monde en tant qu'objet de ma représentation. Pour la volonté, King donne comme l'impression qu'elle est surtout l'expression d'une fondamentale poussée collective exercée par une force étrangère. La désigne par un nom simple : le Système.
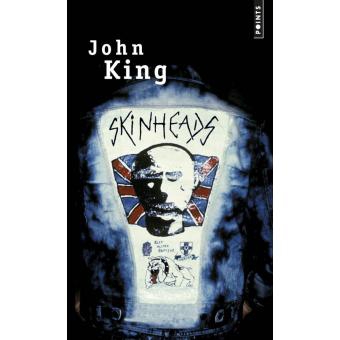
Le Système possède son carburant de base. Les prolétaires. Bossent dur, sont peu payés, et cerise empoisonnée sur ce maigre gâteau sans crème, sont mal vus... De quoi engendrer quelques sentiments de frustration et quelques manifestations de colère... Chair à patrons et chair à canon. Question artillerie, ce sont les futurs pères qui engendreront la première génération skin, eux qui ont donné leur vie, leur sang. Lors de la deuxième guerre mondiale. Les prolos anglais seront de toutes les batailles. Et revenus du combat se sont attelés à la reconstruction. N'aiment guère parler de leurs exploits guerriers à leurs rejetons qui les regardent trimer et fermer leur gueule avec étonnement. Se contentent de ramener de quoi payer le loyer et nourrir la progéniture. Assurent l'essentiel. Ce sont eux qui fournissent la base de l'idéologie conservatrice qui irriguera le futur mouvement : sans le cocon protecteur de la famille, t'es foutu, tu l'as dans le cul. Oui mais quand tu grandis et que tu sors dans la rue justement pour t'affranchir un peu de tes parents, tu as intérêt à forger tes propres coques de protection. Ce seront les copains, la bande, les bandes. Quand on y réfléchit, il manque un peu de sel dans cette vie. L'on a beau se doter de paravents faut encore qu'ils tiennent le coup devant les tempêtes les plus violentes. La meilleure manière de les fortifier c'est encore de les mettre à l'épreuve en les choquant contre ceux des voisins. Les bandes et les individus se livrent à des vendetta interclanique. C'est en se battant entre soi que l'on devient plus fort. Les skins professent la mystique de l'affirmation de soi par la violence. Terry le principal héros du livre en est un peu revenu. Se foutre sur la gueule c'est très bien, mais il existe des manières plus performatives. Suffit de gagner en autonomie. L'a monté son entreprise. De taxis. Si vous n'êtes pas skin, vous ne serez jamais embauché. Pas un truc brinqueballant de copains bidouillé à l'arrache. Il y a des règles à respecter. Véhicule propre, respect du client, politesse et professionnalisme. C'est le vieil adage de la meute revisité. Ensemble on est plus forts. Plus les corollaires. L'on ne tape pas sans raison, l'on impose ses buts d'abord par la négociation, l'on a des billes. Pouvez critiquer. Ne serait-ce pas un embourgeoisement sournois ? Terry n'envisage pas la question sous cet angle. Pense simplement être beaucoup plus efficace ainsi. Moins de brutalité, davantage de sagesse. A le suivre, le prolo skin anglais n'est pas sans rapport avec le militant communiste français de base. Mais il ne milite pas et ne compte que sur lui-même et les copains pour se défendre. Possède une éthique. Professe le culte de la dignité, pas de cheveux crasseux, boule à zéro, vêtements propres ( pour les marques comme elles ne sponsorisent pas KR'TNT ! nous ne ferons aucune publicité ), très importantes, les chaussures de sécurité pour envoyer un bon coup de pied dans la gueule ou les couilles de celui qui vous emmerde. Les skins sont pour l'action directe et la riposte immédiate. N'accordent aucune confiance aux hommes politiques à la solde des multinationales capitalistes.

Y a Ray, qui travaille avec son oncle. Quelques années de moins. N'aime pas tout à fait la même musique que le tonton. Terry c'est le reggae, le ska, le rhythm and blues, des goûts très prêts des mods. Ray écoute les groupes Skins, plus violents aux paroles crues et aux rythmiques rentre-dedans, très près des punks. L'est la génération qui a pris la crise dans la gueule, les temps sont plus durs. A l'époque de Terry, c'était bosse et tu t'en tireras. Mais pour Ray l'ascenseur social est en panne. Sa colère est grande, la contient, mais l'on sent qu'elle est prête à exploser. S'accumule contre le Système mais aussi contre ceux qui sont les plus proches de lui. Les Pakistanais, qui vivent des aides sociales, qui revendent de la drogue aux gamins. La tentation raciste n'est pas loin, l'on s'en défend plus ou moins, mais on l'on n'aime pas les Paquis. Les thématiques d'extrême-droite imbibent la mouvance Skin...

Enfin la troisième génération. Représentée par Lol le fils de Terry, le plus jeune de ses trois gamins, le dernier encore à la maison, dont il se soucie, l'a peur qu'il fasse de grosses bêtises. Les jeunes morflent le plus. N'en peuvent plus. De plus en plus portés sur la violence. Ecoute de la Oi, du skin radical.
Trois générations qui se retrouvent tous ensemble, l'union sacrée pour soutenir Chelsea et en profiter pour régler leurs comptes aux fans de Tottenham, l'ennemi Skin héréditaire... La police montée s'ajoute à la mêlée pour les séparer taper sans distinction sur tout crâne qui passe à portée de matraque. Le fairplay tant vanté des bobbies british perd un peu de son lustre. Ressemble comme deux gouttes aux CRS français qui assuraient la sécurité – it's just a joke - des manifestations de ce printemps à coups de grenades tirées à hauteur d'homme. Quelle maladresse !

Mais revenons-en à nos moutons sauvages – sans laine sur l'occiput – faut maintenant départager les prises de position. Honneur au patriarche. L'est vrai qu'il est dans une sale situation, ne s'est lamais remis de la mort de sa femme décédée voici dix ans, et est en prise avec une espèce de crabe qui le ronge de l'intérieur. L'a un problème à régler. Un deux fois rien, un richard qui a racheté le terrain d'un copain qui ne sait plus où mettre ses deux vieux chevaux. Normalement tout pourrait s'arranger à l'amiable, mais le gros con ne veut rien entendre. Résultat de la négociation. Zéro. Terry se charge de surmonter la difficulté à lui tout seul. Enfin pas tout à fait, avec un fusil à canon scié. Comme quoi quand on prend les gens par les sentiments tout de suite vous êtes compris. Du coup Terry se sent en pleine forme, ce retour aux expéditifs rudiments de la morale skin lui refile une pêche paradisiaque, le cancer s'évapore en quelques minutes, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes skin.

Super bien écrit. Du suspense, car pour tout obstacle qui se présente l'on assiste d'abord à la cogitation intellectuelle qui permettra son évincement. Pratique et théorie. Pro skin. Notons que John King se définit historialement comme un punk. Toutefois cette happy end est un peu à l'eau de rose. Une manière aussi d'escamoter la réflexion. Pourtant à un moment où Ray est sous pression, il trouve une échappatoire dans la lecture. 1984, La Ferme des Animaux, etc... prélève dans les bouquins des arguments qui renforcent ses propres analyses sur le Système, n'avait point les outils et les mots pour s'exprimer clairement mais dès lors il comprend que ce qui est en marche c'est l'installation d'une société de surveillance de plus en plus totalitaire et d'autant plus efficace qu'elle agit insidieusement pour votre bien... Face à ce monstre froid, l'individu est démuni, ne reste comme moyen de défense que l'attitude Skin, ce raidissement sur ses propres valeurs et cette éthique de self-défense ( pour ne pas dire de self-attaque ) qui consiste à ne laisser aucune autorité étatique vous empêcher de régler par vous-mêmes vos propres problèmes. Ne serions-nous pas très éloignés de l'autonomie individuelle anarchiste. Vous avez même en option le recours à l'autre versant de la théorisation anarchisante, le concept d'association ( Skin, bien sûr ) si vous avez besoin d'aide.

Les skins nous semblent farouchement stirnériens. Mais cette apparence relève du faux-semblant. A l'autre bout du Système les libertariens pro-capitalistes se réclament eux aussi de Stirner. Se prévalent de l'Unique et sa Propriété, tout en oubliant d'accoler à ce terme aristotéliciennement qualificatif, l'adjectif privée, ce qui change toute la donne. Le problème, c'est que le skin de base se situe à l'opposé de la toute puissance de ce spectre libertarien. Ne possède rien, pas de propriété personnelle. Des fils de prolo qui à part leur force de travail – de plus en plus dédaignée – leurs gamins, leurs beaux habits neufs et leur fierté, ne peuvent s'honorer d'une quelconque accumulation de capital. Rien, non rien. Juste assez de quoi se payer une bière de temps en temps. Certes ils se sont emparés de la morale des maîtres mais ils l'appliquent à une situation qui ne correspond guère à leur réalité sociale. Il en est de même pour tous les mouvements de rébellion juvénile tels les rockers, qui dans le livre sont présentés comme les ennemis, pratiquement héréditaires, des Skins. Ne portent pas les mêmes vêtements, roulent en moto, n'écoutent pas la même musique, mais au fond ne sont pas très différents comme Terry le pense.

L'habit ne fait ni le moine, ni le révolutionnaire. Les skins redoutent le Système. Le jugent à raison comme un milieu hostile. Développent des stratégies de défense et de survie. Tels des insectes qui se forgent une carapace pour que les prédateurs s'y brisent les dents dessus. Une espérance qui ne marche pas toujours. Reste un ventre mou source de tous les dangers.
Les différentes composantes du mouvement rock ne sont guère mieux loties. Les rockers et les hippies, pour ne prendre en exemple que ces deux-là, n'ont pas été beaucoup plus malins. Qu'importe la solution adoptée, de la mystique du baston à l'adoration d'Hare Krishna pour ratisser large et ne pas hésiter devant la caricature, les positions sont multiples, chacun trouvera pitance à son goût, vous bâtissez votre niche écologique de survie qui vous offre toutes les garanties qui s'adaptent au plus près de vos préférences, mais les années passent, vous avez sauvé votre peau, mais la situation générale n'a pas évolué...
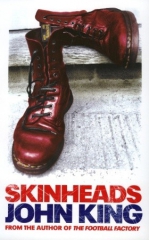
Toutefois les Skins ne sont pas aimés, leur silhouette martiale, leur accoutrement uniformisé, leur donnent l'aspect de groupes militaires d'extrême-droite. Certaines photos sont troublantes, survit le souvenir de ratonnades raciales qui font froid dans le dos. John King n'élude pas le problème. Les condamne. Tout mouvement de masse possède ses béliers galeux, assurent-ils. Ne condamnez pas toute une collectivité au nom d'individus extrémistes. Le répète à plusieurs reprises. Ne nie pas les tentatives de manipulation politique dont le mouvement Skin peut être victime. Préfère le présenter comme une réaction d'auto-défense des milieux ouvriers. Certains le traiteront de démagogue. Nous n'irons pas jusque-là, nous dirons simplement que les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences en totale contradiction avec les buts recherchés. C'est vrai pour les Skins, pour tout le monde aussi. C'est en cela, en cette généralisation que ce livre peut vous faire peur. Ne soyez point dupes. Ni des Skins, ni de vous-même. Surtout de vous-même.
Damie Chad.
28/09/2016
KR'TNT ! ¤ 296 : REZILLOS / BLACK BOX WARNING / WILD MIGHTY FREAKS / FRCTRD / BARABBAS / ATLANTIS CHRONICLES / THE DISTANCE / JAMES BALDWIN / NEGUS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 296
A ROCKLIT PRODUCTION
29 / 09 / 2016
|
REZILLOS / BLACK BOX WARNING WILD MIGHTY FREAKS / FRCTRD BARABBAS / ATLANTIS CHRONICLES THE DISTANCE / JAMES BALDWIN / NEGUS |
LE PETIT BAIN / PARIS XIII° / 16 – 09 – 2016
REZILLOS
Le résolu des Rezillos
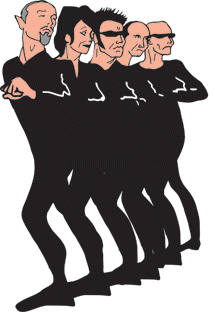
S’il est bien un groupe qui peut prétendre à la couronne de roi des groupes énergétiques, c’est bien les Rezillos. Ces Écossais sont arrivés dans le rond du projecteur en pleine vague punk et quarante ans après, ils sont toujours là, en parfait état. En tous les cas, Eugene Edwards et Fay Fife sont toujours aux commandes de cette belle silver rocking-machine.
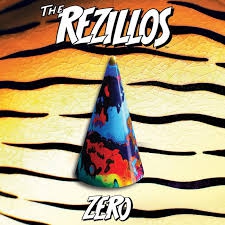
On savait que leur concert parisien allait être un événement, car ils venaient d’enregistrer un superbe album, Zero. On y trouve un véritable coup de génie intitulé «Life’s A Bitch» - Got out for a ride/ Get hit by a truck - comme chez les Cramps dans «Let’s Get Fucked Up». Fay chante ça à l’aune du meilleur stomp écossais, elle est sans illusion - Life’s a bitch/ Then you die/ I don’t know why/ I don’t know why - On a là du grand art. C’est aussi Fay qui tape «She’s The Bad One» en B à la dramaturgie. Quelle belle compo de pop ambitieuse ! C’est même complètement inespéré de la part d’un groupe aussi nettement catalogué. On les connaît pour leur ardeur combative et leur jumping blast, mais pas pour ce genre de petite merveille encorbellée. Eugene et Fay se partagent le morceau titre, ils adressent des reproches à l’anti-héros - You are really something/ Even though you’re nothing - Curieusement, ils ont pas mal de cuts qui sonnent comme ceux des deux premiers albums de Blondie, à commencer par «Song About Tomorrow». C’est même quasiment la même voix et la même lumière. Même chose avec «N°1 Boy». On se croirait dans Plastic Letters. Les trois derniers cuts de la B sont tout simplement spectaculaires. Ils reviennent à leur son de 1978 dans «Nearly Human», avec une belle dégelée d’accords sautillés et un texte à vocation comique. Encore du Rezillo Sound avec «Spike Heel Assassin». Ils renouent avec la veine trépidante et enjouée, merveilleusement vivace et racée. Ils bouclent avec un «Out Of This World» de pulsion maximale. Cet album se hisse vraiment parmi les chefs-d’œuvre du XXIe siècle, n’ayons pas peur des mots. Ce cut vaut pour une pièce de pop pantelante qui baigne dans la joie et la bonne humeur. Ils regrimpent une fois de plus au sommet de leur grand art, à cheval sur une bassline incroyablement traversière - You’re out of this world/ So different from the other girls.

Quel concert ! Dans un Petit Bain bien plein, Fay, Eugene et leurs copains firent feu de tous bois. Bon d’accord, Eugene a pris du volume et Fay n’est plus la jeune fille svelte des pochettes d’antan, mais elle dégage à elle toute seule plus d’énergie que n’importe quel groupe garage contemporain. Il faut la voir allumer les cuts sur scène.

Le terme modération ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle profite de toutes les occasions pour pulser des cuts ultra-énergétiques qui n’ont pas besoin d’elle car ils s’auto-pulsent tout seuls, mais c’est plus fort qu’elle, il faut qu’elle en rajoute. Fay Fife, c’est l’anti-frimeuse, et quand elle prend des cuts de soul au chant, elle rallume le vieux flambeau du Tamla sound. Pas mal pour une Écossaise, n’est-ce pas ?

En fait, ce qui impressionne le plus, c’est la mise en place du groupe qui continue de jouer les vieux hits spectaculaires, avec exactement la même énergie. Le guitariste Jim Brady saute dans tous les coins. Il n’est plus tout jeune lui non plus, mais il sait encore sauter en l’air sans craindre le ridicule. Et puis l’arme secrète des Rezillos, c’est aussi une section rythmique implacable, deux crânes rasés qui font tourner les cuts à cent à l’heure. On put enfin voir jouer la ligne de basse de «Flying Saucer Attack». Chris Agnew tricotait ça des quatre doigts de la main gauche, évidemment. Il s’agit certainement de l’une des basslines les plus véloces de l’histoire du rock. Ce mec est avec John Entwistle le bassman le plus spectaculaire qu’il m’ait été donné de voir jouer sur scène.

Ils font une reprise de «River Deep Mountain High» assez démente et en rappel, il reviennent balancer un «Glad All Over» du Dave Clark Five qui met fin à toutes les velléités de commentaires. La grande force des Rezillos, c’est qu’ils ne supportent par l’approximation, et par conséquent, ils se placent au dessus de tout soupçon, comme dirait Elio Petri.

Rien de surprenant au fond, car leurs antécédents sont irréprochables. Leur premier album, Can’t Stand The Rezillos a pour particularité de ne contenir aucun déchet. Dès «Flying Saucer Attack», le grand Mysterious nous embarque vite fait bien fait à la vitesse de la lumière sur sa bassline aérodynamique. Fay Fife et Eugene chantent à la régalade et l’admirable Jo Callis place de jolis solos concis. Leurs deux mamelles sont une énergie considérable et une précision cabalistique. Dans «Somebody’s Gonna Get Their Head Kicked In Tonight», Eugene se comporte comme un shouter de grand cru. On se régale des chœurs de rêve de Fay dans «2000 AD» et «Can’t Stand My Baby» se révèle alarmant de jus qualitatif. L’un des points forts des Rezillos, c’est le choix des covers. Sur ce premier album, ils rendent un hommage tonitruant au Dave Clark Five avec «Glad All Over». Ils sont dessus, avec le sautillant de leur énergie considérable. On a même l’impression qu’ils font des étincelles. Eugene chante «I Like It» à l’aristo des highlands, au milord des bas-fonds d’Aberbeen. On reste dans l’infernal brouet pop-punk avec «Cold Wars» que Fay embarque au paradis. Ils terminent avec une violente rasade de boogaloo, «Bad Guy Reaction», grattée sec par l’immense Jo Callis. Quelle équipe de surdoués ! Voilà l’une des raisons pour lesquelles il était si difficile de prendre les groupes français au sérieux, à l’époque. Qui jouait comme ça en France ? Absolument personne.

L’année suivante sortait leur deuxième album, le fameux Mission Accomplished qui est un album live. On y trouve trois énormes reprises, à commencer par «Land Of Thousand Dances», embarquée au drive et explosée en plein vol. Ils enchaînent avec une version incroyablement garage d’«I Need You» et plus loin, ils rendent un hommage spectaculaire aux Sweet avec «Ballroom Blitz». Rien qu’avec ces trois titres, on frise l’overdose. Mais attention, ce disque recèle d’autres fringantes énormités, comme ce «Destination Venus» de clôture, monté au pounding de grosse caisse. Ils nous invitent à partir en voyage dans l’espace, alors on y va. Pas de problème. On s’assoit à côté de Fay. Elle est craquante. Ils jouent vraiment ce cut au pounding supra-normal. On assiste même au retour du groupe après un faux départ. Quelle santé ! Et dans «Mystery Action», Jo Callis fait un carton éhonté. C’est un vrai Scot, il joue en kilt. Dans «Thunderbirds Are Go», Simon Templar joue une bassline traversière et comme Fay et Eugene chantent ensemble, on se croirait dans les B52s. Encore de l’énergie à revendre dans «Cold Wars», juteux et joué à la grande échevelée. Saura-t-on dire un jour à quel point les Rezillos étaient bons ?
En 1980, Eugene Edwards et Fay Fife décident de continuer et le groupe se transforme en Revillos. Leur traversée du désert s’illustre par six albums dans lesquels on retrouve bien sûr le dynamisme qui fit le charme de la première mouture.
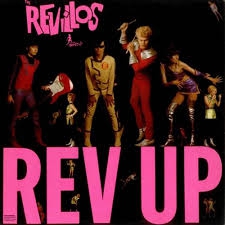
Sur la pochette de «Rev Up», on les voit costumés en créatures Sci-Fi. Ont-ils inspiré Zolar X ? Leur batteur est un sosie de Billy Idol. On trouve deux hits en B, «On The Beach» (ambiance à la Shadow Morton, avec du vent, le ressac et une basse énorme embarque la voix de Fay - complètement envoûtant, un vrai coup de génie) et bien sûr l’immense «Motorbike Beat» - Me and Mister CC - complet avec les coups de gaz, vroarrrr, le mec qui sent le cuir et l’avalage de bitume, et cette lourdeur si caractéristique avec laquelle les motos anglaises s’élancent. C’est un hommage à la culture biker britannique qui ne doit rien à l’américaine. Les bruits des moteurs, les façons de conduire, le design des engins, tout est complètement différent. On trouve d’autres jolis cuts sur cet album comme par exemple «Juke Box Song» chanté à deux voix effrénées, comme au temps béni des Rezillos, ou encore «Voodoo» quasiment rockab quant au beat. Cut brillant, monté au voodoo stomp et bien articulé sur les breaks du wannabe de Billy Idol. «Bobby Come Back To Me» sonne comme un hommage aux Shangri-Las et on se régale de «Scuba Boy Bob», rythmé ventre à terre, fruité de frais et poppy à gogo.

Sur Attack paru en 1982, Eugene et son gang de futuristes continuent d’explorer les coulisses du sci-fi rock avec «Snatzomobile». Ils y déploient une énergie qu’il faut bien qualifier d’explosive. Fay rôde dans les parages. Voilà encore un cut dynamique et moderniste, avec du son à la palanquée. On les sent tendus et déterminés, prêts à s’amuser coûte que coûte. Fay chante comme une gamine en plastique. Dans «Graveyard Groove», Eugene annonce la couleur - Gotta ejaculate in the graveyard - Et puis, il y a ce hit fondamental, «Love Bug», Fay s’y montre une fois de plus brillante. Elle fait sonner ce cut comme un hit des Supremes et l’explose avec des chœurs schyzoïdeaux. Wow, ça bat Tamla ! Quelle puissance ! Ils font un joli coup de Diddley beat avec «Man Attack» et Fay retape «Midnight» au beat du Brill. Elle s’y prend comme une star et ça vire à l’effarance de la prestance. «Do The Mutilation» sonne comme de la pop franche du collier et «Caveman Raveman» repose sur une tension maximale, car joué aux tambours africains. Magnifique de primitivisme ! Ça relève même de l’hypo dans la douleur. Encore de la magnifique pop de Fay avec «Your Baby’s Gone». Elle sait la traîner, sa pop. Il faut bien parler ici de pop craze.

Si on apprécie particulièrement les duos d’enfer, alors il faut écouter Live And On Fire In Japan paru en 1995. Eugene et Fay sonnent un peu comme les B52s du premier album. Fay fait les rev up. Ils sont excitants et bardés de dynamiques internes. Fay craque et Eugene fait wouahh ! Autre pure merveille, «The Friend», embarqué à la pulsion maximale, c’est chevillé au corps du mandrin, Eugene le démon fait des siennes et Fay vole à son secours avec de la pop plein la bouche pour le refroidir. C’est franchement monstrueux. Tout est bien sur ce disque. On a le meilleur boogaloo d’Écosse avec «Bongo Brain». Fay fait fissa sur «Rock-a-Doom». Eugene agit en conteur d’exception sur le fameux «She’s Fallen In Love With A Monster Man» qui les a rendus célèbres. Fay se révèle en tant que chanteuse d’exception sur des classiques pop comme «Where’s The Boy For Me», ou encore «Bitten By A Lovebug». Elle drive ça seule, en vraie petite reine d’Angleterre, pas avare de ses avantages, capable de monter toute seule au créneau. On la retrouve dans «Baby Come Back To Me», cup pop ancré dans l’univers Shadow Morton/Shangri-Las. Elle s’y prélasse les bras en croix. Les Revillos jouent sur la brèche permanente, comme on le voit avec «My Baby Does Good Sculptures» qui date de la première époque. Ils jouent ça sous le couvert du beat avec une classe effarante. Et Eugene reprend au guttural son vieux chant de guerre, «Somebody’s Gonna Get Their Head Kicked Up Tonight». Ils font littéralement gicler l’énergie. Splish splash !
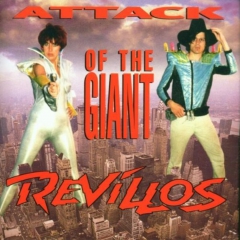
Encore du gros fretin sur Attack Of The Giant Revillos qui date de 1995. «Man Attack» sonne comme un hit de Bo. On a là le Diddley beat du futur. On peut être certain que Bo aurait adoré ça. On trouve aussi sur ce disque la version studio de «Bongo Brain», un deadly hit de prime abord. Eugene sonne comme les Equals, c’est le même tempo - What’s your name ?/ Bongo Brain ! - On tombe plus loin sur un véritable hit de soul, «Mad From Birth To Death», chanté à deux voix et poundé comme à l’aube des temps. Quelle belle énormité ! C’est normal puisque monté sur le riff de basse de «Keep On Running». Ils profitent de «Graveyard Groove» pour redéconner avec le gonna ejaculate in the graveyard groove - On entend aussi Eugene aboyer sur le beat jungle de «Caveman Raveman». C’est aussi sur cet album que se trouve la version studio de «Bitten By A Lovebug» que Fay emmène dans les étoiles. Elle semble vraiment régner sur la pop anglaise. Et avec «Midnight», elle revient à sa chère ambiance Shangri-Las. Chimérique !

Les albums live des Revillos permettent de mesurer leur niveau d’hyperactivité. Totally Alive fait partie des grands disques live de l’histoire du rock, ne serait-ce que pour l’effarante version de «Motorbike Beat» jouée ventre à terre. On trouve aussi sur cet album une version explosive de «Glad All Over» du Dave Clark Five. C’est joué à l’avalée, soutenu par des chœurs de rêve. Autre pure merveille, «Can’t Stand My Baby», où on voit Fay tenir le taureau par les cornes. C’est joué, beaucoup trop joué. Ils reprennent aussi leur vieux «Flying Saucer Attack», hit fatal bardé de remontées d’instrus et de panache d’accords d’Écosse. Démentoïde ! Ça va même un peu trop vite. Ce sera leur seul défaut : le trop. Cet album explose dès le premier cut, «Mystery Action». On prête aussitôt allégeance, pas moyen de faire autrement. D’autant qu’ils balancent des chœurs de Dolls dans leur pétaudière. Et un solo de dingo balaie la pauvre Fay. Ils vont encore trop vite avec «Getting Me Down» qui sonne comme une croisière en enfer. C’est quasiment du Dr Feelgood allumé au speed. Ils allument aussi «Manhunt» au riff vainqueur et un drive de basse embarque tout le monde pour Cythère. Ils s’auto-explosent de classe. Fay emmène «Crush» au trot. Elle fait sa Blondie et se fourvoie, mais on lui pardonne. Attention, un album live des Revillos n’est pas de tout repos.

Le dernier album des Revillos s’appelle Jungle Of Eyes et s’il laisse un souvenir, ce sera surtout pour «Love Bandit», que Fay chante en parfaite Soul Sister, avec une ténacité qui en dit long sur la pertinence de son grabbing. C’est tout simplement exceptionnel de véracité. Fay nous fait de la soul à l’Écossaise, une soul nerveuse et bien cambrée sur ses chœurs virulents. Fay fait aussi un festival dans «Guilty In The First Degree». Elle l’attaque d’une voix chaude et roule des r de romanichelle des Highlands. Ils reprennent de vieux hits comme Lovebug ou Man Attack, mais il vaut mieux écouter les versions live. Ils jouent «Call Me The Cat» au tribal de boogaloo. Eugene semble hélas céder aux sirènes de la mode. On entend même du synthé dans «The Vampire Strikes». Ils sauvent l’honneur avec «Trigger Happy Jack», cut de comic boogaloo digne des Rezillos - Gun powder essence/ A degenerate mental case - Bel étalage de paroles de balistic blasted maniac ouh-ah !/ A delinquant with a scar ouh-ah !/ Case hardened hoodlum comatose killer man/ Got a total disregard for human life - Eugene charge bien la barque.
Signé : Cazengler, le grazillo
Rezillos. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 16 septembre 2016
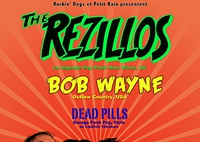
Rezillos. Can’t Stand The Rezillos. Sire 1978
Rezillos. Mission Accomplished... But The Beat Goes On. Sire 1979
Revillos. Rev Up. Dindisc 1980
Revillos. Attack. Superville Records 1982
Revillos. Live And On Fire In Japan. Vinyl Japan 1995
Revillos. Attack Of The Giant Revillos. Receiver Records Limited 1995
Revillos. Totally Alive. Sympathy For The Record Industry 1998
Revillos. Jungle Of Eyes. Captain Oi 2003
Rezillos. Zero. Metropolis 2015
De gauche à droite sur l’illusse : Jim Brady, Fay Fife, Eugene Edwards, Chris Agnew, Angel Paterson.
LA CITROUILLE / CESSON / 24 – 09 – 16
WILD PIG FEST # 3
BLACK BOX WARNING
WILD MIGHTY FREAKS / FRCTRD
BARABBAS / ATLANTIS CHRONICLES

J'avais prévu Guido and the Hellcats à Troyes. Trois ans depuis ma première rencontre avec Guido. L'avait seize ans alors et les Megatons l'avaient laissé joué tout seul durant leur inter-set. Ne s'était pas dégonflé avec sa drap jacket et sa guitare et l'avait envoyé une bonne dizaine de classiques. L'est passé de l'eau dans la Manche depuis cette soirée... L'a grandi et l'a formé son propre groupe. Devait passer au 3 B, mais l'Histoire en a décidé autrement. Passeport périmé, les britishs doivent montrer patte blanche pour mettre le pied sur le continent. Pour Guido rendez-vous est pris pour le quinze avril 2017. Pour itou m'a fallu improviser le plan B. Pas besoin d'aller très loin, à moins d'une heure de teuf-teuf le troisième rendez-vous de l'association Wild Pig Music. Petits cochons de lait tout mignons, tout bons, gare à vos grandes oreilles sensibles ! La wild Pig Music est réservée aux sangliers aux défenses de fer !
La Citrouille est une petite salle à peu près ronde d'où l'appellation contrôlée supposons. N'a pas poussé toute seule dans son champ, l'est entourée de deux menus potirons qui servent pour l'un de bureau, pour l'autre de salle, que l'on imagine polyvalente, qui ce soir fera office de bar à bière. Cinq groupes, cinq euros. Le genre de dumping social qui me botte. Ouverture des portes à dix neuf heures, mais les musiciens sont en train de déguster leur part de pizza. A ce tarif, on ne pas leur offrir les agapes d'un Beggars Banquet à la Stone ! D'ailleurs à peine vingt minutes plus tard début des hostilités. La scène est vaste, occupe facilement un quart de la surface totale qui peut avaler jusqu'à deux cents personnes. Quorum qui ne sera atteint qu'au trois-quarts. Tant pis pour les absents qui ont toujours tort.
BLACK BOX WARNING

Sont trois. Batterie en retrait à gauche. Bassiste imposant au centre. Guitare à droite. Pas nombreux pour le bruit qu'ils vont produire. L'on aurait dû se méfier de l'avertissement sur la boîte. Deuxième apparition publique, à peine vingt minutes. Mais aux âmes trempées dans le sludge la valeur ne dépend pas du nombre de quarts d'heure alloués. Déferlement de boue noire en ouverture de la soirée. Tout repose sur le batteur. Les deux autres ne font que suivre. Le bassiste tranquille, genre de gars que rien ne surprend. Fournit l'onde de fond. Une avalanche de glace noire peut lui passer dessus, l'on se demande s'il l'a remarquée. Rien ne l'émeut. L'émet son ondulation comme la balise de sécurité de l'avion englouti au fond de l'océan signale le lieu de la catastrophe. Ne compte pas les morts, fait son job avec une placidité mortelle. Pour le guitar égoïne amplifiée, c'est un peu plus complexe, doit être dans l'exact prolongement du tohu-bohu qui déferle sur lui. Son rôle est simple, accentuer la glissade, la rendre davantage vrombissante et tranchante afin qu'elle déferle sur le public avec la délicatesse d'une épée qui vous coupe délicatement en deux.
Retournons au fautif. L'a des lunettes et des baguettes. Si vous ne l'avez pas remarqué c'est que êtes à l'article de la mort. Pas de soucis, ceux qui n'entendent que lui en sont au même stade. Ultime. L'a aboli l'interrogation métaphysique du batteur. Et maintenant je tape sur la caisse claire ou sur le tambour ? Frappe sur les deux en même temps, parfois il peaufine un léger décalage, ce que l'on appelle le décervelage en deux temps. Pour la grosse caisse, tirs ininterrompus et en continu. Le pire c'est quand ça s'arrête. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'était qu'une ruse. Reprend le bombardement à outrance, un morceau de rock c'est comme le fameux Livre de Mallarmé, qui ne commençait ni ne se terminait, et qui tout au plus faisait semblant. En plus vous adorez. Votre corps dodeline à ce rythme assourdissant, fermez les yeux, un troupeau de pachydermes avance à pas pesants. La terre tremble, vous auriez dû vous reculer. La première des gigantesques bestioles vous a saisi dans sa trompe et expédié en l'air. Vous avez la colonne vertébrale cassée en deux. Vous souriez d'aise, vous êtes à l'abri d'un nouveau danger puisque vous avez atterri tout en haut, hors de portée, dans le feuillage du palmier-dattier ( pour sûr dans votre fauteuil roulant vous vous souviendrez de la date ), vous croyez être sauvé, mais un deuxième animal arrache de son appendice nasal le tronc de trente-cinq mètres tout au haut duquel vous aviez trouvé refuge et le lance négligemment dans le marigot boueux infesté de caïmans affamés avec la facilité de Tante Agathe jetant un mince spaghetti qui ne lui avait rien fait dans la marmite d'eau bouillante.

Le public échaudé ne craint pas l'eau froide. The Black Box Warning emporte, l'adhésion, c'est à son tour de plier sous la bronca des applaudissements et des hurlements frénétiques. C'est comme cela que l'on aime les premières parties. Vous servent largement et ne laissent rien pour les autres. Un rock minimal, frustre et efficace à deux cents pour cent. Ce médicament n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Heureusement, sans quoi vous seriez immuno-dépendant tout le restant de votre vie.
WILD MIGHTY FREAKS

Z'ont dû réfléchir salement à la programmation, après un caterpillar de cette cylindrée, faut occuper les esprits avec un autre genre de confiture. Changement de style pour tromper l'ennemi. Ce sera Wild Mighty Freaks. N'y a qu'à les voir avec leurs capuchons sur la tête pour comprendre que l'on a changé de cité. Du métal certes, sans quoi ils n'auraient pas été de la fête, mais bouturé au hip-hop. Une nouvelle hybridation qui se révèle prometteuse.
Sont quatre mais ont tous regagné les coulisses. Ne reste que Yaboy, trifouille son ordi avant de s'asseoir sur le devant de la scène. Pose cool. Le gars flegmatique qui ne sait pas trop quoi faire en sa vie sinon téter au goulot sa bouteille de Jack Daniel's. Se donne une apparence de nonchalance désabusée mais l'on devine qu'il doit savoir bouger son corps longiligne et que derrière cette impression désabusée l'esprit est en éveil et habitué aux ripostes verbales acides. L'est rejoint par ses trois acolytes qui ne se pressent guère. Portent tous un masque, rehaussé d'un maquillage outrancier. Beurre noir, blanc cadavérique, rouge sang. Ni Kiss, ni Alice Cooper, plutôt bad boys revenus d'une explication tuméfiante et qui entendent garder l'anonymat. Tonton est aux drums. Flex à la guitare et Crazy Joe au micro. Alternent les séquences, chant et musique. Hip-hop pour déclamer. Métal pour souligner et appuyer. Genre l'on vous l'enfonce dans le crâne, afin que ça y reste incrusté à jamais. Peut-être fut-il dénommé Flex à cause de ses soli flexibles. Quand c'est à son tour de monopoliser l'attention, il ne lâche pas facilement sa proie, poursuit les notes sur les tonalités aigües. Exactement comme à la morgue quand le toubib vous scie la boîte crânienne pour vérifier si vous avez un cerveau. Qu'il ne trouve pas d'ailleurs, mais ceci est une autre histoire.

( Photo : Laura Lazurite )
Bref Flex sait se servir d'une guitare et chacune de ses interventions sera saluée comme il se doit. Mais les Freaks ne se contentent pas de jouer ou de chanter. Z'ont tressé une autre corde, solide et résistante. La danse. Crazy Joe et Yaboy détestent les temps morts. Ce fou de Joe coule à flow, Yaboy aussi, mais se contente du minimum. Joe vous récite un paragraphe de vingt lignes et Yaboy se contente de répéter un mot. Esquisse un vague geste de la main, comme s'il se retenait à l'air pour ne pas tomber. Un seul vocable mais asséné au moment précis où son absence serait une faute. Vous partage en deux, faut-il s'émerveiller du professionnalisme des acteurs ou céder au côté burlesque du phénomène ? Voyez par vous même. Cela n'est rien comparé aux subtiles chorégraphies qui suivent. Quand Tonton tamponne sa caisse pour accélérer le rythme, nos deux étoiles se mettent à briller de mille feux. Crazy Joe s'embarque dans une espèce de danse du scalp échevelée et aussitôt sec Flex, avant de repartir titiller sa programmatique MAO,vous en offre la pantomime. Exactement les mêmes gestes, sans un écart de nano-seconde, le même et le semblable, le miroir qui renvoie son propre reflet. Parfaitement au point. Au petit doigt près. Impromptu mais pas improvisé. Parfaitement au poing. Frères jumeaux de la rue. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un show élaboré qui n'est pas sans rappeler les spectacles itinérants des noires troupes de black faces des Etats Unis dans les débuts du précédent siècle. Festif et violent, une couche de hip-hop, une épaisseur de rock'n'roll et un nappage de métal. Le millefeuille se déguste brûlant. Public enthousiasmé. Font un carton.
FRCTRD

C'est comme en hébreu, ils ont enlevé les voyelles. Prononcez Fractured. Ont juste gardé le bruit. Un drôle de son, entre pavés de facture sociale et friture de fracture musicale. Genre Djent. Du core à core. Avec soi-même. FRCTRD produit une musique qui se suffit à elle-même. Un scorpion qui ne trouve personne à piquer finit par retourner son dard contre lui-même. Un art d'auto-mutilation. A peine avez-vous produit un riff que tout de suite vous songez à le couper en morceaux. Faut le tordre, le cisailler, le concasser, le réduire, le distribuer en une nouvelle combinaison, aucune note ne sortira entière de l'aventure. Cinq sur scènes, Vincent est au chant, foulard de pirate rouge sang vermeil d'abordage sur la tête et les deux gros anneaux dorés aux oreilles qui vont avec. Ne chante pas, il screame, il howle, il glisse du son sur les brisures opérées par les quatre autres forbans. L'on ne peut parler d'individualités, la musique est trop complexe pour laisser à tout un chacun le droit de tirer la couverture sur son quant à soi. Doivent avoir l'oeil et l'oreille aux aguets, attentifs à tout son émis par le reste de l'équipage. Ne rien laisser passer sans le renvoyer aussitôt sur le bord de la route. Toute note doit être encastrée, enkystée, défenestrée, FRCTRD ne recherche pas le chant du cygne mais le coassement des corbeaux plutoniens. Un seul titre suffit à définir leur entreprise. Négative. Pas d'harmonie, mais le déroulement exact de son manque.

Symptomatique la basse de Maxime, davantage de cordes comme pour fractionner encore plus l'amplitude sonore. Deux guitares, Filip et Clément, chacune oeuvrant ensemble dans la césure de l'autre. Musique de choc et de bris, des allures barbaresques, mais qui s'apparente à de la mathématique pure. Semblent traiter une équation monumentale. Un problème à résoudre. Le drame du métal qui se fait hara-kiri pour mieux étinceler de sa splendeur métallique. Musique savante qui s'enroule sur elle-même pour mieux cristalliser la teneur de sa déliquescence. Une auto-évaporation perpétuellement concrétisée par son effort à rejoindre l'essence de son émission. FRCTRD rejoint certains vertiges de la New Thing. Ne sont pas issus de ce courant, mais des chemins partis de provenances opposées finissent un jour par se croiser.

Font un tabac, preuve que les fans de métal ont des oreilles pointues et capables d'auditionner de multiples possibles. Pour ma part j'eusse aimé qu'ils aient pu bénéficier d'un peu plus de volume sonore. Musique gravitationnelle, comme ces étoiles qui s'effondrent sous leur propre masse. Applaudissements sans fin.
( Photos 2 & 3 : Laura Lazurite )
BARABBAS

Changement de décor. Finies les intellectualités pures. Place au cirque. L'est temps de faire coucou au diable. Barabbas est de retour. Sont en train de fignoler la balance et j'éprouve une légère déception. Me manque un truc. Vu de si près le groupe souffre de déficit de charisme. L'est bêtement humain. Que se passe-t-il ? Où est passée cette sensation de démesure grandiloquente qui m'avait séduit à l'Empreinte de Savigny ( voir KR'TNT ! 243 du 09 / 07 / 15 ) ? Commencent à jouer, tant pis je ferai avec. C'est alors que je m'aperçois de mon erreur car brusquement tout s'illumine. La lumière survient. Y avait une pièce en moins au puzzle, et la voici. Le cinquième élément éthérique, indispensable à ceux qui veulent connaître l'envers des choses et de la vérité, s'extrait des ténèbres impénétrables des back stages. Impressionnante silhouette, le chaînon manquant, qui s'empare du micro et qui distribue aussitôt la bonne parole. Sa Sainteté Rodolphe, colosse aux pieds agiles qui martyrise son micro, parmi nous, en son ministère, comme par miracle la zique devient plus sourde, plus lourde, elle nous écrase, nous doomine.

Le rock est un opéra de carton-pâte, une suite de clichés repeints à la peinture fluo, du faux, du toc, du toc-toc, mais rigoureusement authentique. Toute la génialité réside en cette infime différence entre la réalité et son énonciation. Suffit de donner l'apparence d'être convaincu pour vaincre. Barabbas c'est la caricature qui périme le communément admis. Un chanteur qui mugit comme un taureau que l'on conduit au sacrifice et quatre musiciens qui nous servent les grandes orgues des hécatombes au fond des catacombes. Nous embarquent en une vaste fresque pour une espèce de rituel hérétique et maudit. Nous avons droit à la grande révélation que le public subjugué récite à son tour comme un mantra ensorcelant. Judas était une femme. Ce qui tout de suite présente sous un jour nouveau le fameux baiser de Judas et explique peut-être la coupable faiblesse du rejeton de Dieu envers la nature de ce si spécial adepte... Bousculade au portillon des idées reçues. Mais ne nous égarons point en des voies beaucoup trop réflexives. Laissons-nous entraîner par les envoûtements musicaux apporté par le groupe.

De véritables magiciens, vous mènent par le bout du nez en des contrées que vous n'aborderiez seuls par vous-même. Saint Rodolphe descend dans le public et s'en vient murmurer son blasphème à l'oreille des filles, qui ont l'air d'apprécier, pour les garçons et toutes les autres il reviendra, le graal de houblon malté à la main, et le geste auguste pour baptiser les impétrants. Au cas où vous auriez échappé à cette sainte onction, de retour sur scène, vous assisterez au miracle dde l'aspersion du crachat changé en pluie de bière que les premiers rangs reçoivent sans déplaisir. Le rock est en perpétuelle accointance avec le sacré, Barabbas possède le secret des remembrances originelles, nous fait le coup du bonneteau diabolique. N'y a rien dans les trois godets que vous soulevez, mais durant tout le temps du jeu, vous y avez cru et métamorphosé le vide des désillusions en un sentiment de jouissance suprême. Ovations du public. Barabbas empoche la mise. Tout est consommé.

( Photos : Fabrice Dci )
ATLANTIS CHRONICLES
« Là s'étendait Atlantis ! Des Hauteurs qui Place Mage, nous avaient emportés vers les lumières victoriales, nous tenions une sapience ouranienne, légère, héliaque et royale, issue de cette transparence antérieures qui contenait tout ; et c'est ainsi qu'un ressouvenir bouleversant nous submergea, nous portant comme une vague bienfaitrice sur le sable sec et doux de la mémoire enfin retrouvée. Mais ce jour-là l'ombre était claire. Nous regardions le ciel à travers les feuillages, nous écoutions les floraisons du silence, ses couronnes perpétuelles et le zénith, doublement ailé, tombait lentement sur la mer et les oliveraies d'Atlantis. »
Excusez-moi de vous arracher à votre contemplation. Mais il se fait tard, c'est le dernier groupe. Désolant de constater que la majeure partie de l'assistance a profité de l'inter-set pour s'en aller. Permission de minuit ou dernier autobus ? Atlantis Chronicles remerciera à plusieurs reprises le dernier carré. Pour ceux qui voudraient continuer la lecture, le texte est de Luc-Olivier d'Algange. Ne l'ai pas recopié par hasard, mais pour surseoir à l'étonnement qui m'a saisi au début de la prestation du groupe.

( Photo : Laura Lazurite )
Cinq sur scène. Bibent le chanteur au centre tout devant. La musique s'élève et Bibent est au micro. Me faudra quelques minutes pour intuiter. La voix me semble lointaine, j'attends qu'à la console l'on pousse la targette adéquate. Mais non rien. Je comprends enfin. Ce n'est pas chanteur + un groupe, mais un groupe qui joue à l'unisson, les cinq contributions phoniques étant traitées au même niveau. Point par un parti pris d'égalitarisme théorique forcené. Mais pour ajouter au mystère du dire. La voix n'est qu'un instrument parmi les autres, totalement fondue en la matière sonore. S'installe ainsi une aura de mystère légendaire. Le son est fort, véhicule les légendes perdues, ne les décrypte pas. N'explicite pas. A chacun de se laisser emporter sur les ailes du rêve. La musique en dit plus que les mots. Révèle des sortilèges. Vous entraîne sur des sentes merveilleuses et héroïques. Bibent ne crie pas, il module sa raucité, tout l'accompagnement musical semble porter et s'appuyer sur sa voix qui ne plie pas. Le crépuscule tombe sur la terre, s'étend sur son immensité mais le manteau herbu ne s'effondre point sous ce fardeau de pénombre accablant. Atlantis Chronicles rouvre les anciens grimoires d'où surgissent d'antiques secrets. Une symphonie romantique aussi belle qu'un tableau de Caspard David Friedrich. Crescendo, sans arrêt, tout au long du set la musique s'alourdit et se complexifie mais la voix suit la même courbe ascendante tout en restant au même diapason. Un tour de force qui doit demander une satanée technique vocale, debout sur les retours Bibent est la figure de proue qui taille la route pour le navire qui file avec lenteur vers les portes oniriques et océanes. Un dernier morceau comme une ultime escale... Atlantis Chronicles a refermé le livre et la nef de cristal disparaît dans les confins du songe entrevu. Un rêve de beauté qui s'achève...
The Wild Pig fEST numéro 3 a tenu ses promesses. Une programmation gérée de main de maître.
Damie Chad.
THE DISTANCE
RADIO BAD RECEIVER
THANK YOU FOR NOTHING / MESMERISE / HOW LONG BEFORE THE BLEEDING STOPS / RADIO BAD RECEIVER / NASTY LIGHT / THE UNCONSCIOUS SMILE / TROUBLE END / MORE THAN SERIOUS / PERFECT THINGS / INSOMNIA / ALONE / DON'T TRY THIS AT HOME
Mike : guitare & chant / Sylvain : guitares / Duff : basse / Dagulard : batterie.
Sortie : avril 2016 / NAB 1604

Y avait eu le EP auparavant, chroniqué in KR'TNT ! 276 du 07 / 04 / 2016. Nous avait enthousiasmé. Voici l'album qui reprend quatre des cinq titres de l'EP. Même pochette cartonnée extérieure, noire au profil squelettique de biche qui n'est plus au bois ni aux abois. Une préfiguration de nos futures irradiations, soulignées par la minuscule virgule crânienne, une espèce de contre-marque blanche renversée – tels les premiers alphabets mésopotamiens - sur le fond noir létal. Signe de deuil, signe de seuil. Double photo couleur en intérieur. Le groupe en un décor gothique, autour de la chaise curule pour bébé. Pas tout à fait la même que celle que l'on vous offre dans les restaurants, à comprendre comme une gravure alchimique de la vie issue de la mort. Rabattez le volet, The Distance en lettres rouges sur la noirceur du support.
Thank you for nothing : musique implacable avec broderie de vocal lyrique, une introduction au malheur de vivre. La batterie qui accentue les angles et les guitares qui polissent les ongles. La batterie bat le rappel. Mike entonne les présentations. Ce n'est rien mais les guitares obsédantes le rappellent c'est du rock and roll. Appuyons joyeusement sur l'accélérateur. L'on ignore au juste où l'on va mais l'on sait très bien vers quoi l'on se dirige. Nous prenons tous les risques. Mesmerise : souvenir de la maison des morts. Pas de répit. Des éclats de guitares qui vous trouent la peau, l'on déroule le parchemin des épisodes précédents pour mieux foncer en avant. Tout cri primal n'est qu'un hurlement final. Cet apologue est définitivement réversible. How long before the bleeding stops : un titre qui fleure bon les anciens blues, inutile de pleurnicher, The Distance est un groupe de rock. Vous enlève le morceau comme l'on prend une barricade. Dommage pour les insurgés, mais l'on ne gagne pas toujours. Charge de cavalerie qui emporte tout. Lorsque l'on pressent que la situation tourne mal, presser la vitesse pour dépasser la catastrophe finale est signe d'optimisme. Au bout de la nuit, l'est toujours un autre commencement, au moins une autre nuit. Radio bad receiver : Accélérations rock et rythme bluesy appuyés se succèdent en courtes séquences, un choeur de voix de secours qui arrivent en soutien, le tempo qui s'accélère, arrêt brutal. L'on ne reçoit pas obligatoirement ce que l'on attendait. Nasty light : la lumière n'éclaire que l'obscurité qui du coup paraît encore plus sombre. N'écoutez pas la voix de Mike, qui se fait douce pour mieux pour vous entraîner dans d'étranges corridors, l'ombre ne se couche jamais sur le royaume de l'incomplétude humaine. Quand le noir arbore une teinte grisâtre ce n'en est que plus déprimant. The unconscious smile : ne riez pas, les temps ne le permettent pas. Les guitares enfoncent des chevilles dans vos zygomatiques. Quand vous croyez que c'est fini, l'enfer recommence, gardez le sourire c'est tout ce que vous pouvez tenter pour faire croire que vous avez sauvé l'intégrité du château de votre âme. Trouble end : les histoires se terminent mal. Normal. Entendez la guitare au loin qui sonne comme la cloche fêlée de l'espérance, le groupe déboule avec la force d'un bulldozer. Arase tout. More than serious : lorsque tout est effacé, il ne reste plus qu'à recommencer. La voix de Mike essaie de nous convaincre mais derrière la musique nous entraîne plus loin. Un peu comme si l'image dépassait la bande-son. Perfect things : Vu la vitesse de défilement l'on est obligé de se dire que le bonheur ne durera pas éternellement. Il est inutile de décourager les bonnes volontés mais il est dangereux de marcher sur la surface de la glace déformante de votre existence. Imsomnia : le cauchemar recommence. Gardez les yeux ouverts. Les images s'impriment avec une trop grande violence dans les synapses de votre cerveau pour que vous puissiez faire semblant de les garder fermer. Les guitares vous arrachent les paupières. Dagulard frappe spasmodiquement sur sa batterie. C'est elle qui le contrôle. Hurlement de terreur. Vous avez entendu la voix de l'Innommable. Alone : un peu de répit, faut bien reprendre ses esprits lorsque l'on se retrouve face à soi-même. Paysage de cendres. Les feux sont éteints. Une guitare sonne comme des larmes qui coulent sur la joue du destin. L'on est toujours seul dans le labyrinthe du monde. Don't try this at home : Faut toujours une morale à une histoire. Inutile de rouvrir les portes intérieures. Le drame se répètera. La musique devient aussi lourde que des plaques de chagrin. Les leçons de chose sont rarement objective. La brume des amertumes recouvre tout. Les guitares tombent en flaques sur le catafalque.
The Distance nous a servi un magnifique oratorio. Un oriatoriock. L'oeuvre s'écoute du début à la fin. Piocher un morceau serait une hérésie. L'ensemble possède son architecture. La voix de Mike conte une étrange pérégrination. Nous fait visiter le domaine. Suivez le guide. N'oubliez pas de descendre dans les fondations pour admirer la machine dragulardienne qui fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'édifice. Ensuite intéressez-vous à l'étrange alliage des guitares de Sylvain + Mike et de la basse de Duff qui tissent des murs de béton. Des cloisons mobiles qui tour à tour se dressent devant vous avec l'implacabilité des monolithes égyptiens, ou s'effacent subitement pour mieux réapparaître plus loin. Rien d'aléatoire dans cet étrange décor mouvant. Une intelligence préside ce jeu d'effacement et de surgissement. Vous pensez être libre de vos déambulations mais The Distance vous mène par le bout du nez. Le rock and roll est son domaine et le groupe en connaît tous les recoins et toutes les chausse-trappes. Profite de son savoir pour en bâtir comme un décalque annonciateur de quelque chose de nouveau, au sens baudelairien du terme. Cent pour cent rock and roll, et pourtant la construction n'est pas sans évoquer l'entremêlement d'un quatuor de Bartok. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une influence, je parierais plutôt pour une intuition formelle de l'appréhension des masses sonores. Un disque qui s'écoute et se réécoute sans fin si vous vous obstinez à en trouver la clef.
Ce n'est pas un bon disque de rock and roll. C'est une avancée.
Damie Chad.
LA PROCHAINE FOIS, LE FEU
JAMES BALWIN
( Traduction : Michel Sciama
Préface : Albert Memmi )
( Folio 2855 / Mai 1996 )

Il ne faut jamais jurer de rien. Surtout pas de l'avenir. La prochaine fois, le feu publié en 1963 était à lire comme un livre d'avertissement. Pas de menace, car si Baldwin prophétisait le pire, il indiquait une autre voie de sortie, qu'il tenait pour possiblement illusoire... Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de la communauté noire américaine. Baldwin exprime en quelque sorte ce moment particulier où la nécessité de la violence révolutionnaire devient le point d'enjeu crucial de la réflexion des élites noires américaines. L'était temps de tirer le bilan des actions entreprises jusqu'à lors. L'écriture de ces deux courts textes réunis sous ce titre comminatoire correspond au moment exact où le mouvement noir se fractionne, l'angélisme de Martin Luther King commence à être sérieusement remis encore. Trois années plus tard, émergera de toute cette réflexion théorique le Black Panther Party qui prônera l'installation d'un rapport de forces beaucoup plus offensif. Un pistolet accroché à votre ceinture indique votre détermination. Même si vous ne vous en servez point.
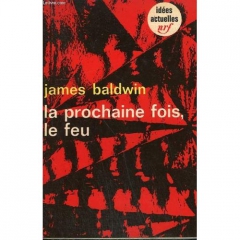
Baldwin part d'un constat simple, d'une évidence. La situation doit changer rapidement, radicalement. La jeunesse noire qui monte n'est plus prête à suivre l'exemple de leurs pères. Ceux-ci ont usé leurs forces en un combat de longue haleine. Une interminable patience, une guerre d'usure. Se sont battus centimètre par centimètre, des milliers d'anonymes qui ont peu à peu redonné dignité et confiance à leurs pairs. Mais le temps des discussions, des pétitions, et du respect servile est terminé.
La tare du racisme n'est pas celle d'une oppression impitoyable. Il est facile de lutter contre l'ennemi de l'extérieur qui vous agresse. Mais lorsque les enceintes de la citadelle sont forcées et que l'occupant a pris le commandement la situation devient inextricable. La soumission, la collaboration et la pactisation s'emparent de votre esprit. Malgré vous, vous intégrez la fatalité de votre infériorité. Le noir n'a plus confiance en lui. Il est dépossédé de sa force vitale car il admet que le blanc lui est ontologiquement supérieur. Le processus de domination est achevé lorsque le dominé donne raison à son maître. S'en prend à lui-même, rejette sur lui-même la faute de sa déplorable situation d'être humain inférieur. Processus d'auto-culpabilisation destructeur.
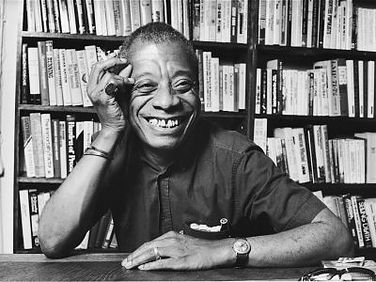
Ce n'est pas un hasard si la religion chrétienne a si fortement imprégné l'âme noire. A été perçue comme un élément salvateur et par certains de ses aspects elle possède cette qualité. Vous redonne confiance en vous, vous donne la mission exemplaire de salvation de vos frères. Mais de fait elle vous enferme en vous-même. La lutte contre les démons qui vous assaillent sans cesse occupe votre temps. La religion vous confine dans la voie du salut individuel et vous empêche de participer à un combat collectif. Pour les diables qui titillent votre chair, Baldwin s'appuie sur son expérience personnelle. Entre quatorze et dix-sept ans l'a prêché tous les dimanches. Mais la pureté est une armure qui vous sépare de votre propre humanité charnelle davantage qu'elle ne vous rapproche des autres. L'amour chrétien n'a pas de sexe. La reconversion du jeune Baldwin en l'acceptation de ses instincts les moins spirituels débouche sur un corollaire idéologique de condamnation des moyens de lutte prônés par Martin Luther King. La non-violence n'est que l'autre face de la charité christologique. C'est alors qu'il est contacté par le Black Muslim d'Elijah Muhammad dont un des leaders les plus connus en Europe demeure Malocolm X même si celui-ci s'en est détaché durant les derniers mois de son existence juste avant son assassinat ( voir KR'TNT ! 290 du 14 : 07 2016 ). Baldwin n'a rien contre ces hôtes. Avoue même un préjugé favorable envers le groupe. L'est impressionné par les foules qui écoutent les discours des orateurs du mouvement. Et encore plus par l'attitude des policiers qui surveillent ces attroupements. Trop de monde, trop d'attention et de ferveur pour que les porcs puissent les interdire et les disperser sans provoquer des troubles qu'ils ne pourraient contrôler. Les flics ont la trouille. Pourtant le public est calme et pacifique. Mais il est dangereux de troubler l'eau qui dort. Une méchante bestiole pourrait en sortir. Inutile de faire des vagues.
C'est qu' Elijah Muhammad ne recherche pas la confrontation mais la séparation. Totale. Demande que soit octroyé aux noirs l'équivalent de sept ou huit états. Avec les déplacements de population nécessaires. Fait remarquer que cette thèse n'est point farfelue, elle est en parfaite corrélation avec les mouvements racistes suprématistes blancs d'extrême-droite. Chacun chez soi, le Christ pour les blancs et Allah pour les noirs. Baldwin refuse cette façon de voir. Que le racisme soit blanc ou noir, il reste un poison mortel. Pour lui l'avenir réside en le rapprochement des deux communautés. Nécessité et bonne volonté. Certes le plus gros du travail relève des blancs. Tire la sonnette d'alarme juste avant le déraillement. Sans quoi notre auteur ne répond plus de rien...
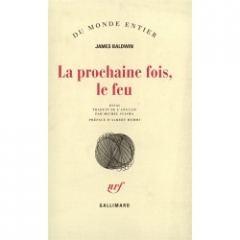
Un demi-siècle est passé. Les premières années ont semblé donné raison à Baldwin. La montée en puissance du Black Panther Party a fait vaciller l'establishment. Pas très longtemps. Le FBI et la Justice se sont empressés de décapiter le mouvement. Le BBP s'est dégonflé piteusement comme le soufflet aux trois fromages de Tante Agathe. Mais le Système a élargi les portes de secours destinées à la jeunesse. La pharmacopée des produits illicites a été développée ce qui s'est traduit par l'émergence d'une économie parallèle qui par effet de domino a entraîné la prolifération de gangs ultra-violents. Du pain bénit pour la police. Plus ils s'élimineront entre eux, moins ils auront de boulot. En plus cette montée de la violence permet les arrestations musclées dans le profil du bon indien mort... L'a aussi instauré une séparation dans la communauté, les couches les plus élevées se séparent des moins favorisées. La bourgeoisie noire faisant de plus en plus cause commune avec l'idéologie libérale du capitalisme américain. Barack Obama est l'exemple parfait de cette intégration réussie...
Deuxième exit. Le vieux rêve américain repeint en noir. La réussite sociale. Pas pour tout le monde. N'exagérons rien, si les pauvres s'enrichissent vous organisez l'extinction des plus riches. Une mince frange, mise en exergue sur les média, la musique adoucit les moeurs et dissout la colère. Le R&B est la vitrine qui sert de miroir aux alouettes. Même le rap des cités vient faire le beau et ramasser la tune.
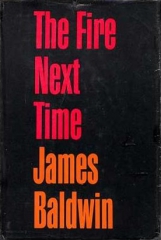
En réalité les statistiques indiquent que le revenu moyen des pauvres ne comble pas l'abîme qui le sépare du minimum du seuil le plus bas de l'aisance financière... Les aides sociales sont plus que maigrichonnes. Les promesses des années soixante sont passées à l'as qui pique dur. Un lot de consolation tout de même. Il est devenu très politiquement incorrect de traiter un afro-américain ( ne pas lire un affreux-américain ) de nègre. Surtout si vous spécifiez qu'il est sale. C'est ce que l'on appelle la politique des petits pas. Qui ne permettent pas d'avancer beaucoup. Les noirs sont devenus en leur grande majorité des pauvres, des assistés, des chômeurs professionnels, des drogués. N'y voyez aucune malice, sont traités à égalité parfaite avec les mexicains, les porto-ricains, les blancs des couches inférieures et même les indiens qui ont toujours une plume de trop qui dépasse de leurs réserves.
La Prochaine Fois, le Feu sonne comme un remake de En attendant Godot. Wait and see. Mais rien ne vient. James Baldwin a lancé une grenade de désencerclement. Mais ce fut un coup plus rien. Dans l'immédiat, il y eut bien les émeutes de Wats en 1965 et l'été de la haine en 1967, près de cent trente révoltes dans les banlieues chaudes de Detroit, Newak, et autres grandes agglomérations du pays. Des dizaines de mort, mais l'ordre a fini par régner. Aujourd'hui la sinistre prophétie ne fait plus peur à personne. Nous sommes déjà à après-demain. Qui tirera les leçons de cet échec ?
Damie Chad.
NEGUS
N° 1 / Juillet 2016
Une revue noire pour les noirs par des noirs. C'est écrit en grosses lettres rouges sur la couverture : Les Noirs Prennent La Parole. Je me méfie des identités que l'on brandit comme une fin en soi. Ne suis pas plus fier que honteux d'être blanc ou français. Premièrement parce que je n'y suis pour rien. Pas de ma faute. Deuxièmement parce que je n'y peux rien. Ne fais confiance qu'aux individus. Sans oublier que souvent ce sont les circonstances qui révèlent les qualités et / ou les tares de tout un chacun davantage que le quidam ne suscite les aléas... Pour parler mathématiquement si l'on considère que quinze pour cent des blancs sont indignes du nom d'homme, je pense que vous retrouverez le même pourcentage chez les noirs, les jaunes, les rouges, les bleus et les verts. Idem pour les nationalités. Quant à l'admiration que je porte à tel ou tel individu ce n'est jamais en fonction de sa couleur ou de sa nationalité mais pour pour ses réalisations tant au niveau politique, artistique, professionnel, etc...
Négus part d'un constat simple : jusqu'à sa propre parution, il n'existait pas en France de journal dirigé, et rédigé en leurs plus grandes parties, par des noirs. Je veux bien le croire, mais la réparation de ce manque éditorial ne m'apparaît guère comme une assurance de qualité. Faut juger sur preuves. Sans oublier que si les majorités silencieuses ne se bougent guère pour améliorer leurs situations ce sont bien les minorités actives qui font avancer l'Histoire.
Sur ce, Negus est une revue qui se lit avec plaisir. Et intéressante. Bien mise en page, aérée, bien écrite. Une face A conjuguée sur le modèle afro-américain I'm black and I'm proud qui consiste à montrer les personnalités noires qui ont réussi en leurs domaines que ce soient des sommités universellement reconnues comme Mohammed Ali avec en contre-miroir les dires de Joe Frazier qui écornent quelque peu le mythe, ou des petits gars bien de chez nous comme Güllit Baku né dans le quartier du Mirail de Toulouse qui bosse dans une des plus prestigieuses agence de pub. Une de celles qui reçoit les commandes des grandes marques qui peuplent le triste imaginaire consumérial de beaucoup de nos contemporains. Une belle réussite, mais perso j'éprouve un malaise quand je pense à tous ces enfants des milieux populaires qui à force d'audace, de talent, et de travail parviennent à s'intégrer dans les élitistes de commandement ( qu'il soit privé ou public ) de la culture libérale. Chevaux de Troie ou traîtres à leur classe ? Préfère de loin l'action revendicative d'Afeni Shakur infatigable combattante et résistante des USA. Fut aussi la mère du rapper 2Pac assassiné à l'âge de vingt cinq ans. Puisque l'on est dans la sphère du hip-hop autant mentionner l'interview de Booba qui défend, avec raison, sa stratégie autonomique de production de ses propres oeuvres. L'article consacré à Obama n'est pas vraiment méchant, l'on y sent surtout de la déception. La cause noire n'a guère évolué durant ses deux mandats de président des Etats-Unis. Beaucoup pensent qu'elle a régressé.
Face B, moins visible. Un fil noir qui parcourt les différents articles. Un peu en filigrane. D'un côté Negus affirme que l'exemple du combat des noirs américains ne saurait être reproduit en Europe, car trop spécifique. Etrangement pour une revue qui espère devenir un des porte-drapeaux de la communauté noire française, mais très logiquement si l'on a quelque peu réfléchi à la problématique politique, les espoirs se tournent vers l'Afrique. Non pas les chefs d'état africains actuels véreux et à la solde des multinationales blanches, mais vers le vieux rêve de l'unification de l'Afrique, ce pan-africanisme dont un Patrice Lumumba reste un des héros. Assassiné comme il se doit. Une belle idée qui pour l'instant reste remisée sur l'étagère poussiéreuse des utopies irréalisables. En tout cas ce n'est pas gagné d'avance. Suffit de jeter un coup d'oeil sur les pays arabes pour juger du naufrage du pan-arabisme pour être certains que les élites des pays occidentaux préfèrent le morcellement chaotique de leurs anciennes colonies à des unités supra-nationales maîtresses de leur destin...
Un bel avenir réflexif s'offre à Negus. Peut aussi choisir de surfer sur le clinquant des réussites sociales personnelles qui sont comme les derniers baobabs qui cachent la destruction des forêts équatoriales mises en coupe réglée par nos multinationales chéries. Difficile pour l'instant de prédire le chemin futur qu'empruntera la revue. Ses rédacteurs ont l'air de posséder des idées plus acérées qu'il n'y paraîtrait si l'on se donne la peine de lire entre les lignes. La seule méthode de lecture digne de ce nom.
Le numéro deux serait en préparation, tarde quelque peu, l'est attendu par beaucoup. Une initiative à soutenir.
Damie Chad.
13:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rezillos, black box warning, wild mighty kreaaks, frctrd, barabbas, atlantis chronicles, jim baldwin, la prochaine fois, le feu, negus


