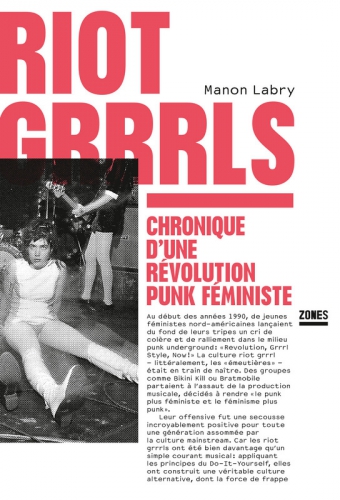13/04/2016
KR'TNT ! ¤ 277 : DARRELL BATH + VIBRATORS / GODFATHERS / JALLIES / RIOT GRRRLS / PATTI SMITH / NUIT DEBOUT
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 277
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
14 / 04 / 2016
DARRELL BATH + VIBRATORS / GODFATHERS /
JALLIES / RIOT GRRRLS / PATTI SMITH
NUIT DEBOUT
LE VINTAGE / ROUEN ( 76 ) - 02 / 04 / 2016
DARRELL BATH
LE PETIT BAIN / PARIS 13 ° – 14 / 01 / 2016
VIBRATORS
LITTLE BIG BATH ( 2 )
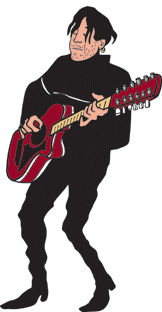
— Alors comment va Darrell Bath ?
— Oh il va bien ! Même très bien ! J’ai même l’impression qu’il ne s’est jamais aussi bien porté. Voyez-vous, monsieur Faustroll, plus ils sont petits et mieux ils résistent à l’usure du temps.
— Il jouait paraît-il dans un célèbre bar de la capitale normande ?
— Ah ce petit concert vous aurait tourné la tête, cher ami ! Cadre exotique, accueil cordial, ambiance intimiste, un épisode de rêve pour la pincée de happy few prévenus à temps.
— Je sens poindre une certaine ironie sous vos propos...

— Vous devez savoir vous aussi qu’il convient de ne point s’attarder sur les contingences si l’on veut humer l’essence du moment, si l’on veut goûter aux sucres de l’éphémère, si l’on veut pincer la fesse d’un songe ! J’évoque bien sûr l’héroïque candeur de ce gavroche des faubourgs de Londres et les vaillantes rengaines qu’il entonne avec tant d’allure ! Depuis le temps ou Ronnie Lane traversait des villages aux rênes de son misérable attelage, on n’avait plus vu pareil prodige de fraîcheur mélodique et d’élégance cockney ! Ce petit Darrell ira loin, je suis prêt à miser gros !
— Si l’on ouvre les paris !
— Cela va de soi !
— On voit remonter à la surface, tel le Hollandais Volant, votre vieux penchant vermoulu pour l’indergrounde !
— Vous ne croyez pas si bien dire, aimable Faustroll ! Je rêve d’un monde plus clément qui rendrait enfin justice à l’indergrounde ! Ne vous faites pas plus bête que vous n’êtes, cher ami, vous savez comme moi que c’est là dans les ténèbres à peine voilées que se niche l’avenir de l’humanité ! C’est dans l’indergrounde que s’agitent les élus de la bohème londonienne, les Darrell Bath, les Boys, les Crybabys, les Godfathers, les Gallon Drunk, les Dogbones, les Bevis Frond, les Graham Day, les Jim Jones, les Derellas, les Hipbone Slim, les Miraculous Mule, les Vibrators, tous ces gens incarnent le rock en devenir, au contraire des autres plus célèbres qui ne sonnent plus que comme des statues de sel, punis d’avoir succombé aux charmes de l’ultra-commercialisation lobotomiseuse.
— Certes, mon vieux, mais vous savez fort bien que l’indergrounde, aussi gratifiant qu’il puisse paraître, ne nourrit pas son homme !
— Et alors, préférez-vous ces gravures de mode qui nous miaulent leur clairette insipide ou de blêmes créatures qui s’échinent encore à composer ce qu’on appelait autrefois des chansons ?
— Mon cher, ne craignez-vous pas de vous enliser dans un manichéisme de faible amplitude ? Vous me faites penser à l’Empereur qui lors de sa campagne de Russie, n’en finissait plus de réfléchir en dépit du bon sens et d’accumuler les erreurs stratégiques !
— Bien sûr, tenir de genre de raisonnement, c’est une façon de brûler les ponts, je vous l’accorde. Je mesure l’intérêt d’un spectacle à l’émotion qu’il procure, tout simplement. Quand on a vu des centaines de concerts de rock, on finit par devenir atrocement exigeant. On distingue très vite le bon grain de l’ivraie. On fuit les m’as-tu-vu et les pourvoyeurs d’ennui pour aller se réfugier au bar. Par contre, on dresse l’oreille dès le premier coup de trompette de l’Apocaplypse. Quand Darrell Bath attaque son premier morceau, on s’alarme, comme par réflexe.
— Il jouait seul ?

— Non il jouait en trio, dans un minuscule caboulot, avec un niveau sonore réduit, mais dès les premiers accords, il recréait comme par magie le son des très grands groupes anglais...
— Les statues de sel ?
— Non, les Faces et les Stones n’entrent pas dans cette catégorie, même s’ils ont ramassé des fortunes. Ils constituent avec les autres grands groupes des sixties les racines du rock anglais et ils se trouvent par conséquent déifiés, donc intouchables. Vous ne touchez ni aux Who ni aux Kinks. Ni aux Beatles ni aux Troggs.
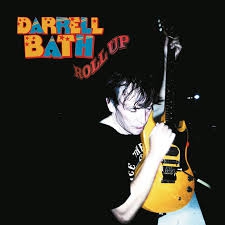
Quand Darrell Bath claque un accord de Keith Richards, il rend un hommage. Il vient d’enregistrer un nouvel album intitulé «Roll Up». Eh bien, avec le premier morceau de cet album, «Dancin’ With The Devil’s Goombah», Darrell Bath rend un fantastique hommage aux Stones de l’âge d’or. Sachez Faustroll que tous les guitaristes anglais fantasmaient à une époque sur Keith Richards, mais seuls des surdoués comme Darrell Bath parviennent à ce niveau d’émulation. Attendez, ce n’est pas tout ! Notre homme sait créer la surprise avec des balades qu’il faut situer au niveau de «Debris» ou «Glad And Sorry», vous savez, les fameux hits de Ronnie Lane. Eh bien figurez-vous qu’en plein cœur du set il attaque «Greeny Greeny Eyes», une balade enchanteresse qui n’est même pas enregistrée et qui ne mérite qu’un seul sort : finir en tête des hit-parades, car elle éclate d’une pureté mélodique incomparable. D’ailleurs, sur l’album dont je viens de vous chanter les louanges, vous en trouverez une autre, elle aussi destinée à conquérir des sommets imaginaires : «Clingin’ On». Voilà encore une œuvre d’art digne des grandes heures de Nikki Sudden. Ah oui, il faut entendre Darrell Bath miauler «And clingin’ on is all I can do !» Vous frissonnerez, je vous le garantis ! Et puis l’air de rien, il annonça «Rat Palace» qui se trouve à la fin de cet album fatidique. Je ne vois pas d’autre moyen que de recourir à la notion de coup de génie pour qualifier cette nouvelle échappée belle - In the rat palace there’s food and love/ In the rat palace yeah - Et les chœurs font «In the rat palace yeah». Darrell Bath passe alors un solo magique et là, ça s’envole. Il envoie tout simplement son hit exploser au firmament à coups d’accords chatoyants. Si je ne suis pas tombé de ma chaise quand il a joué ça, c’est que par chance j’étais debout !

— Vous aviez un hit de Third World War qui s’appelait «Rat Crawl», n’est-ce pas ?
— Même dimension légendaire, mais «Rat Palace» va bien au-delà. J’ajouterai même que la version enregistrée paraît bien pâle face à la version live. Ce petit Darrell Bath joue, chante et compose comme un démon.
— Vous m’avez aussi parlé d’un concert de ce petit monsieur avec les Vibrators...

— Oui, l’épisode fut intéressant. Vous savez, voir les Vibrators sur scène sans Knox, c’est un peu comme de parcourir un album de Tintin sans capitaine Haddock. Mais on ne se pose pas la question du sens, on file au Petit Bain. Darrell Bath remplace Knox à la guitare et le bassiste punk Pete Honkamaki chante la grande majorité des morceaux. Bien sûr, on y va surtout pour voir jouer Thor, plus connu sous le nom d’Eddie. Cet Eddie-là présente deux grosses particularités : un, c’est le batteur originel des Vibrators. Il a tenu bon pendant quarante ans, au fil des modes et des changements de personnel. Vous me direz qu’il existe deux albums des Vibrators où un batteur le remplace, mais Thor est revenu. Et deux, John Eddie Edwards est l’un des très grands batteurs anglais. Est-ce lui qu’on va voir lorsque les Vibrators sont à l’affiche ? La réponse est dans la question, mon cher Faustroll. Évidemment pour Darrell Bath et son collègue finlandais, rien n’’est plus facile que de jouer avec un tel batteur. Thor n’est qu’un monstre d’opiniâtreté, de régularité, il est la locomotive dont rêvent tous les groupes. Montez un groupe et si vous ne disposez pas d’un bon batteur, ce n’est même pas la peine de commencer à répéter. Vous pouvez taper dans les reprises les plus prestigieuses, les choses tournent vite en eau de boudin si le batteur flotte ou s’il arrive en retard dans les breaks. Jouer avec un batteur comme Eddie, ça doit être extrêmement voluptueux. Il agit comme un chef d’orchestre. C’est lui qui fait voguer la galère. Darrell Bath profite à outrance de ce confort que lui procure Eddie pour piquer des crises. Le public se pâme avec les hits connus comme «Babe Babe» et Darrell Bath se paye le luxe de chanter une redoutable version du «Slow Death» des Groovies. Malgré l’absence de Knox, il règne dans le trio une bien belle essence nostalgique.

— C’est tout de même un groupe qui a quarante ans d’âge...
— Comme les UK Subs ou les Wildhearts, sachez que les Vibrators sont une institution en Angleterre. Certainement pas en France. Leur réputation s’appuie tout simplement sur un sans-faute discographique. Comme chez Aretha, Bobby Womack ou Bobby Bland. Il n’est pas surprenant qu’un petit prodige comme Darrell Bath s’associe avec la fine fleur des vétérans du rock anglais.
Signé : Cazengler, Bathifoleur
Darrell Bath. Le Vintage. Rouen (76). 2 avril 2016
Vibrators. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 14 janvier 2016
Darrell Bath. Roll Up. Cargo Records 2015
L’ESCALE. Le HAVRE (76). 03 / 04 / 2016
GODFATHERS.
ÇA COGNE AVEC LES FRERES COYNE ( 2 )
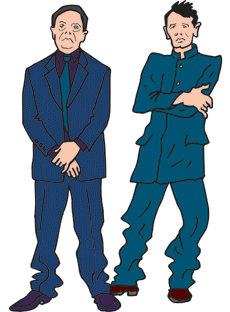
— Alors comment vont les Godfathers ?
— Oh ils vont bien ! Même très bien ! J’ai même l’impression qu’ils n’ont jamais été aussi percutants. Voyez-vous, monsieur Bonhomet, leur show, c’est vraiment le show de la mortadelle du petit cheval !
— Par Dieu que voulez-vous dire ?
— C’est pourtant clair ! Ces gens-là prennent le Havre sans même assiéger la ville, de quoi faire frémir la moustache gommée d’un Clausewitz ! Des Huns, je vous le dis bien net !
— Voyez-vous ça ! N’auriez-vous pas une fâcheuse tendance à grossir le trait ?

— Ha ha ha ! Chez vous la bonhomie reprend toujours le dessus, monsieur Bonhomet ! Seriez-vous donc si mal informé ? Chacun sait, dans les salons comme dans les bas-fonds que les Godfathers règnent sans partage sur le milieu. Avec ce genre de brutes épaisses, tout est couru d’avance ! Inutile de miser ! Le raffinement et la délicatesse ne figurent pas au premier rang de leurs préoccupations, soyez-en sûr ! Ils ne raisonnent qu’en termes d’enclume et de coups rebondis ! D’aplatissement des masses et d’anéantissement des oreilles. On pourrait presque les croire Vikings, tant ils cognent ! Les frères Coyne ne reconnaissent qu’une seule loi : la cogne. Alors ils cognent. Et quand je dis cogner, ça signifie - paf ! il claque sa paume d’un violent coup de poing - cogner, hein ! S’ils prennent une scène, c’est à la hussarde, pour emboutir, pour défenestrer, démonter, déboîter, pour oblitérer, déraciner, éradiquer, défoncer, ils n’ont pas la moindre miséricorde pour leur public ! D’ailleurs, il faut complimenter ces Havrais qui acceptent ces coups de boutoir comme un don du ciel. Les frères Coyne cognent avec l’acharnement méthodique du psychopathe et chaque riff vous enfonce d’un bon centimètre dans le sol.

— Vous devez donc avoir des bosses, sous votre Gibus !
— Sans doute, mon bon ami, mais j’ai surtout une oreille qui siffle sans discontinuer depuis six jours. Ah les brutes, ils ne respectent rien, pas même les oreilles de chrétiens ! Mais si on apprécie tout ce qui sent le fauve, les fromages qui coulent, les filles qui ne se lavent pas, les vins noirs comme le sang d’un moine, le jus de chique, le smog des tripots et le gros son qui met en péril tous les équilibres physiologiques, alors on se réjouit de la compagnie des Godfathers.
— À vous entendre, on les croirait sortis d’un coupe-gorge de l’East End !

— Non ! J’image simplement la tonalité d’un rock rude, violent, aveuglément brutal et interprété par des gens impitoyables. Le paradoxe, voyez-vous, c’est qu’ils se sapent comme des milords, oh des milord-l’Arsouille de la trempe de Lacenaire. Ils paraissent sur scène tirés à quatre épingles dans leurs complets bien coupés, le cheveu peigné et le menton rasé de frais. Chris Coyne laboure toujours sa basse avec une frénésie pathologique et Peter Coyne pointe vers la salle un museau peu avenant qu’on n’aimerait pas croiser la nuit au coin du bois. Ces Coyne qui valent bien les Kray ont recruté deux guitaristes et un horrible batteur au crâne rasé, un nommé Tim James qui arbore une authentique hure de galérien. Ah vous auriez vu ce petit bellâtre de Mauro Venegas sauter partout avec sa scintillante Les Paul en or ! Un Walter Lure sans cravate, vous pouvez me croire ! De l’autre côté, un hérisson du nom de Steve Crittal martyrisait sa Strato avec des expressions chargées de stupeur. Maintenant qu’ils sont cinq, ils peuvent sonner les trompettes de l’Apocalypse ! Ils cognent dès les hors d’œuvre à coups de «Cause I Said So», pur paquet de rock anglais, fumant et capiteux, extrait de leur premier album «Birth School Work Death». Ils ne jurent que par Saint-Blast, voyez-vous, et n’escomptez pas de répit car ils besognent leur set sans trêve, comme on charge la chaudière d’une locomotive à vapeur, à la pelletée volante ! Stupéfiant ! Ils ressortent aussi leur vieux «Johnny Cash Blues», Chris Coyne le joue en mode valse à deux temps sur sa basse dépolie par les outrages. Quand il n’aboie pas sur la foule, Peter Coyne promène un regard noir sur les pauvres gens et réclame des ovations. Avez-vous vu Robert de Niro interpréter Al Capone ?

— Oui...
— Eh bien, monsieur Bonhomet, qu’avez-vous remarqué ?
— Où voulez-vous en venir ?
— Capone sourit ! Pas Peter Coyne ! Peter Coyne ne sourit jamais. Il cogne. Quand il se montre généreux, on se méfie : il nous annonce un inédit, «Defibrillator», mais c’est pour mieux nous ra-ta-ti-ner ! Avec «Love Is Dead», autre extrait du premier album, ils accentuent une pression qu’on estime pourtant insoutenable, mais avec leurs nouveaux lieutenants, les frères Coyne transforment ces vieux morceaux en golems soniques. On les reconnaît à peine ! On reste là plantés comme des étendards en terre conquise, fascinés par cette démesure apoplectique. Ils bourrent «She Gives Me Love» d’une étoupe de chœurs et allument la mèche ! Alors forcément, les colonnes du temple n’en finissent plus de trembler. Voyez-vous, monsieur Bonhomet, les Godfathers disposent aujourd’hui d’une réserve de hits au moins égale en qualité et en quantité à celle des autres grands barons du rock anglais. Rendez-vous compte, «This Is War» date de 1991 et Peter Coyne en fait la cerise de son gâteau ! La clé de voûte du paradigme ! La touche finale d’un bombardement ! L’ultime soubresaut d’un tremblement de terre ! Le dernier râle d’un dragon agonisant ! Et en rappel, ils laminent les dernières poches de résistance avec l’effarant «Birth School Work Death» qui dit si bien l’insignifiance de la vie et dont les riffs percent les tympans comme des alarmes de défense aérienne.

— Prévenez-moi, la prochaine fois qu’ils sont à l’affiche !
— On devrait logiquement les revoir puisqu’ils enregistrent un nouvel album...
— Ces vieux groupes ne fatiguent jamais... Ne voyez rien d’insultant dans mon propos, mais ils me font penser à ces braves bêtes de labeur que brossa jadis Rosa Bonheur ! De l’increvabilité des choses, mon cher ! L’antithèse de cette fameuse inutilité de vivre dont vous vous gargarisiez tout à l’heure ! Vos amis les Godfathers se produiront encore longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes aient disparu...
Signé : Cazengler, le silly Coyne valet
Godfathers. L’Escale. Le Havre (76). 3 avril 2016
BARBIZON – 02 / 04 / 2016
BLACKSTONE
JALLIES
Les peintres de Barbizon
Ont des barbes de bison !
Au volant de la teuf-teuf, tout guilleret je chantonne l'antique refrain des rapins du bon vieux temps de l'impressionisme, vous comprendrez vite le motif de ma joie lorsque vous saurez que ce soir je vais revoir, non pas ma Normandie natale, mais les délicieuses Jallies. Quatre mois sans entendre mes gelinottes aux si jolies notes, de quoi devenir fou. D'ailleurs me faut faire dix kilomètres pour m'apercevoir que je remonte la 207 – la mythique Nationale 7 de Trénet - en sens contraire. La route du soleil qu'il chantonnait, tu parles Charles ! demi-tour acrobatique sur la chaussé mouillée et glissante, n'ai jamais posé mes augustes panards au Blackstone mais je subodore que l'établissement ne doit pas être situé dans le centre faisandé de Barbizon, cette ville pelotonnée sur son passé comme une huître refermée sur l'absence de sa perle enfuie... Une masse sombre au travers des essuie-glaces, des voitures en épi sur le large trottoir boueux, et un groupe de fumeurs agglutinés sous l'auvent de l'entrée.
Pub. Si vous imaginez le mini-troquet style mouchoir de poche, vous faites erreur. Pas exactement un manoir, mais du volume, un bar central, deux vastes salles, une plus petite et l'espace concert, plus étroit, la scène en coin, mais ouvert sur le comptoir par les voûtes de larges arcades. Murs noirs, blanche tête de Jim Morrison en effigie. Ici il est indubitable que l'on aime le rock. L'est sûr que j'y reviendrai, passent des groupes chaque semaine.
THE JALLIES

Enfin ! Les voici tous les cinq alignés, sur la scène longue et étroite comme les deux branches d'un combat ouvert, telles des pièces de jeu d'échec, trois reines et deux cavaliers. Prêts pour le dur combat du rock and swing. La partie sera jouée en trois manches. Faisons durer le plaisir, intéressons-nous d'abord aux hommes. Des vrais, des durs, mais pas des tatoués.

Kross cataphracte, la cavalerie lourde, casquette, lunettes, barbe, contrebasse noire et bretelles de mafioso. Parfois il semble dormir, les yeux mi-clos, la tête appuyée sur le manche de sa big mama. Méfiez-vous, il fait semblant. Une vigilance de python qui attend sa proie. Et le voici, courbé en deux, les jambes qui volent et en posture de karaté, dangereux, tyran tirant sur ses cordes comme la tempête sur les haubans d'un navire qui se joue des lames tranchantes de la mer.

Tom, l'homme à la guitare rouge, cavalerie légère, toujours en pointe, qui porte les attaques les plus meurtrières. Avec son borsalino sur la tête, l'arbore l'air moqueur de Clint Eastwood, du temps de sa jeunesse, le sourire charmeur juste avant qu'il ne tire et qu'il dégomme à lui tout seul la moitié de la population du saloon. Une fine gâchette. Sait très bien qu'un colt finit un jour ou l'autre par s'enrayer, alors lorsqu'il casse une corde, il dégaine tout de suite sa seconde guitare, noire comme la mort.
Nous arrivons à la douceur du rodéo. Nos gentes demoiselles, un sourire et vous vous sentez pousser des ailes. Parce que c'est nous, parce que ce sont elles. Pas de préséance, comme elles papillonnent sans arrêt de place en place, j'opte pour l'ordre alphabétique.

Céline, fine ceinture rouge qui coupe et rehausse sa robe noire, un mince galon amarante et tout de suite c'est le chic choc. Virevoltante sur la caisse claire, bras blanc de Nausicaa tels serpents du poème de Saint-Pol Roux le Magnifique, et chevelure auburn flottante autour de l'épanouissement de son sourire. Parfois comme l'oiseau sur la plus haute branche elle gazouille du gazou, l'oeil aux aguets, joyeuse comme une fillette qui vient de vous coller un mortel poison d'avril dans le dos.

Leslie, la plus rousse, celle qui cueille le jour avant qu'il ne s'éteigne dans son rire. Une robe d'écolière, à motifs rouges rangés à la queue leu leu, en ordre méticuleux, mais la haute bande rouge qui se dresse telle une flammes écarlate indique qu'elle n'est ni la plus sage, ni la plus douce, mais la plus insoucieuse. Leslie qui nous délie de toutes les sèves sévères de Maurice Scève claironne le rock des trains du désespoir qui ne reviennent jamais.

Vanessa, corolle de sang dans ses cheveux blonds. Dont l'or fin ressort d'autant plus sur le fond noir de l'obscure paroi. Sourires et émotions. Visage expressif, lumineux comme le soleil se reflétant sur l'étang de nos insouciances, et l'instant d'après l'acidité des volontés conquérantes. Froissement de soie et bruissement de bruine sur l'en allée des libellules perpendiculaires. Ici, là, ailleurs.

Trois reines souveraines et deux cavaliers expérimentés qui nous promèneront par trois fois sur la diagonale du fou. We are the Jallies, modulent-elles et les deux mariniers souquent ferment dans la chaloupe du rythme. Descendre et remonter les échelles comme des pierrots lunaires. La réalité s'éparpille et se multiplie comme des éclats surréalistiques d'un kaléidoscope en crise d'identité. Les images se bousculent et tourneboulent dans nos têtes. La basse contre nature sonique de Kross bourdonne dans nos oreilles et bonimente nos indigences. Les solos de Tom s'infiltre dans les moelles secrètes de nos abattis les plus intimes. Céline chantonne sur les plaies du désastre intérieur, elle nous bazooke au kazou et tranche les casoars de nos certitudes. Leslie nous délie de nos délits et des promesses que nous n'avons jamais faites. Vanessa taquine en sa tunique se moque de nos délires.
Je devrais arrêter les Jallies. C'est un alcool trop fort que je ne supporte plus. Au fait, c'est quand leur prochain concert ?
Bref ce fut une très belle soirée, trois sets en montée continue, coupés de courts entractes, inondés d'un public jeune et chaleureux. Attention ne dépassez pas la dose prescrites, produit addictif.
Damie Chad.
( Photos noir et blanc : Aurélien Tranchet : FB Aurélien fait de la photographie
Photos couleurs : FB : Mel Journeau )
Me suis trompé. Ce n'était pas de ma faute. Mais d'Olivier, le libraire, qui était parti dans la réserve chercher un book qu'il avait mis de côté, pour moi. L'avait sa main sur la couverture, je n'ai vu que les quatre grosses lettres majuscules, GRRR en rouge sang. Ce ne pouvait être qu'un livre sur les Stones, sans doute sur GRRR ! Leur compilation de 2012, avec le gorille à la langue pendante dégoulinante de stupre sur la pochette. Ah ! Les Rolling avec leur univers impitoyable, foutrement rock and roll, violence, machisme, cynisme, un rêve d'Atlamont, un monde pour les garçons, les durs, les méchants, les voyous, les rockers, un livre pour moi.
Deuxième erreur. Toujours à cause d'Olivier et ses doigts qui barraient la couve, je ne sais pas si ça va te plaire, apparemment c'est un truc sur les filles. Ah ! Les filles ! Leur douceur, leur calme, leur sérénité, leurs câlins, leurs tendresses, leurs bisous tout mimi, leurs yeux luisants de désir, les îles secrètes de leurs corps, leur empressement si doux auprès des garçons, un livre pour moi.
C'est alors qu'il m'a tendu le bouquin. Ah oui ! Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, attention, ça mord ces bestioles, indomptables et dangereuses, mais je prends, très intéressant, un livre pour moi.
RIOT GRRRLS
CHRONIQUE d'UNE REVOLUTION
PUNK FEMINISTE
MANON LABRY
( ZONES / 2016 )
Comme quoi l'on n'est jamais à Labry d'une surprise ! Attention, voici Manon. Féministe dans l'âme ( le corps aussi, nous supposons ), l'a déjà soutenu à l'Université de Toulouse-Le-Mirail une thèse sur un sujet similaire au titre quelque peu à rallonge : Le cas de la sous-culture punk féministe américaine : vers une redéfinition de la relation dialectique "mainstream - underground" ? Ouf, je vérifie si je n'ai rien oublié. Du sérieux, j'hésite avant de me lancer dans la lecture : va falloir marcher sur les oeufs et les ovocytes. Et bien non, c'est super bien écrit, un peu à la manière des kros de Kr'tnt ! Une écriture qui colle à son sujet, humour, dérision et punkitude. Pousse même l'honnêteté intellectuelle jusqu'à dire qu'elle ne sait pas quand elle ne sait pas. Pour ceux qui n'auraient pas compris, elle explicite : parle de ce qu'elle n'a pas vécu, ne dicte pas la vérité, se contente d'approximations. Mais de celles qui font sens, et qui éclairent. Le genre de démarche qui nous agrée.
Riot Grrrls, ne vous mélangez pas les pinceaux avec les Pussy Riot, nous ne sommes pas au pays de Poutine, mais de l'autre côté du Détroit de Behring, aux Etats-Unis, la terre promise du rock and roll. Hélas pas aux temps de Chuck Berry, mais beaucoup plus tard entre 1985 et 1995. Et même entre 1990 et 1995, si l'on s'en tient à une datation carbrockne plus précise. Nous touchons-là à un des aspects de par chez nous les plus méconnus du rock américain : le futur du primo punk amerloque : ni les Ramones, ni Patti Smith, mais son évolution hardcore et straightedge. Le lecteur soucieux de se rafraîchir les idées se reportera à nos chroniques des livres de Fabien Hein ( Do It Yourself in Kr'tnt ! 240 du 18 / 06 / 15 ) et d'Eleanor Henderson ( Alphabet City in Kr'tnt ! 202 du 25 / 09 / 14 ). Un mouvement qui s'inscrit aux alentours de ces mouvances, mais adjacent. Spécialisé, serions nous prêt à écrire, mais vu les circonstances nous dirons non-mixte.
Une révolte de filles, qui s'emparent du micro du rock et qui comptent bien le garder. Ce ne sont ni des super-chanteuses, ni des super-musiciennes. Mais elles tiennent à s'exprimer et le punk est un terreau idéal. N'est-il pas le chantre de cette idéologie du Do It Yourself si encourageante ? Faites du bruit et hurlez. C'est là l'essentiel. Vous ne serez jamais Jimmy Page, alors soyez vous mêmes. Eclatez-vous avec vos qualités et vos défauts. Que ceux qui ne seraient pas contents aillent se faire fucker chez les Hellènes. Oh ! Les filles vous ne serez jamais une rock and roll star, mais vous perdrez aussi votre mauvais rôle : celui de groupie. Le repos des boys, c'est terminé. Insoumission toute. Quelque part, lecteurs attentifs, vous avez raison : l'on n'est pas très loin des premiers mouvements de libération de femmes des années soixante, exactly my dears, mais avec la grosse caisse du rock and roll la révolte en sera amplifiée, à la puissance mille.
Des filles, il y en déjà eu dans le rock, de Janis Martins à Kim Wilde, mais trop souvent elles furent considérées comme des citoyennes de seconde zone, n'existaient pas en tant qu'elles, Janis était définie comme the Female Elvis et la fille de Marty Wilde était une trop jolie poupée blonde pour que l'on ait pu prendre le temps de l'écouter chanter. La révolte punk emmena les Slits, sans doute trop près des groupes de mecs comme les Clash et les Pistols pour que leurs provocations soient vraiment entendues. Les Runaways échappèrent à leur créateur, semblaient être la bonne idée du moment de Kim Fowley leur producteur, heureusement Joan Jett possédait une fougue et une volonté de puissance qui feront d'elle la reine d'un glam vindicatif. Comme par hasard, nous la retrouverons au côté des deux groupes dont les personnalités et le destin forment l'ossature du récit de Manon Labry, les légendaires Bikini Kill et Bratmobile.

Tobi Vail, Kathleen Hanna et Kathi Wilcox, ne sont pas des musiciennes. Des révoltées certainement mais avant tout des filles qui portent un regard acéré sur leurs conditions de filles. Pas des oies blanches, Kathleen exerce la noble profession de strip teaseuse. En règle générale ce sont les gars qui occupent le devant de la scène - dans les concerts sont même dessus – quant aux filles, vaudrait mieux ne pas parler du quotidien de leurs existences. Un point positif dans le malheur de nos trois pionnières : elles en ont conscience, beaucoup plus que toutes les autres. Seront les catalysatrices du mouvement. La musique viendra plus tard, essaient plutôt de trouver une caisse de résonance à leurs analyses : se regroupent autour de la confection d'un fanzine, ce sera Jigsaw, le puzzle des idées que l'on essaie d'énoncer clairement pour mieux les mettre à jour. Ne veulent pas devenir des anges, alors elles font les bêtes, se traitent de Square, des brutes de décoffrage, revendiquent de n'être pas plus futées que les autres... Ce n'est pas qu'elles intériorisent leurs féminines faiblesses, c'est que la démonstration sera plus évidente si elles partent de rien. Suffit de vouloir et de faire. Ne savent pas jouer mais elles montent un groupe Bikini Kill, apprendront sur le tas, pour faire passer leurs façons de voir, elles ont d'abord mis au point le mode d'emploi, sur papier, fanziné, manuscripté, tapuscripté, premier nommé Bikini Kill. Nous sommes au coeur de l'underground. L'on se débrouille avec les moyens du bord, on se détourne des médias, premièrement parce qu'ils n'ont rien à faire de vous. Deuxio, parce que la radicalité s'installe dans les esprits. Les dominos chutent les uns à la suite des autres, l'on commence par revendiquer sa spécificité féministe et l'on finit par désigner le coupable : le capitalisme qui avec sa division du travail, compartimente les êtres humains dans des catégories inamovibles, ce qui nécessite une visée révolutionnaire. L'on sera antisexiste, antiraciste, anticapitaliste...

C'est une mouvance indistincte, tout le monde se retrouve en juillet 91 à l'International Pop Underground Festival. Des dizaines de groupes, des dizaines de fanzines. Mais une défection, le groupe Nirvana qui vient de signer avec une major, l'on dit que Kurt Cobain ne surmontera pas sa trahison... L'on ne s'est pas réuni uniquement pour écouter de la musique, la prise de conscience politique, l'idée qu'un autre monde est possible, fait son chemin, l'on se rend compte que les pensées alternatives que l'on brandissait un peu comme des provocations sans lendemain pour épater l'establishment, acquièrent une solidité, une caution sinon morale du moins sociale et culturelle. Les plus surpris en seront les agents du FBI !
Ce sont des jeunes, mais principalement des jeunes blancs. Et même de jeunes blancs issus de classes moyennes plutôt friquées. Le mouvement s'est cristallisé dans l'Etat de Washington peuplé de fonctionnaires des administrations étatiques... Les noirs s'adonnent à des activités plus sportives : l'émeute raciale. The Riot. Un mot qui va inspirer la colère des filles, Riot Grrrls, le mouvement de révolte féministe a désormais sa banderole.

Musicalement le mouvement déclinera assez vite. Les groupes de filles deviennent une mode, les adolescentes en profitent pour jeter leur foutre, la philosophie première est carrément dénaturée avec l'apparition des girls bands formatés à la Spice Girls. Les revendications ne font pas que des adeptes, des groupes fachisant de mâles en danger s'attaquent physiquement aux meneuses et n'hésitent pas à recourir à la plus extrême violence... Mia Zapata la chanteuse des Gits, de Seatle, violée et assassinée en sera la victime plus que symbolique. Mais il est trop tard. Un peu partout des groupes de femmes se réunissent, discutent, et remettent en question la domination masculine et commencent à tracer la frontière des genres en dehors de l'habituelle différence physiologique... Quand on y pense, l'on se dit que les problématiques et les revendications qui agitent aujourd'hui le féminisme européen n'ont qu'une vingtaine d'années de retard sur l'implosion de nos émeutières ricaines...

Dans les nineties, l'influence des Riot Grrrl n'essaimera pas énormément en Europe, un peu en Angleterre grâce à la tournée des Bikini Kill et des Huggy Bear, où elles se feront remarquer par leur courageuse intransigeance : pour lutter contre les pogos dévastateurs des garçons elles exigent que les filles soient devant la scène.
Reste quelques disques, pas énormément, dont Manon Labry dit le plus grand bien. Nous aussi. Le refus de coopérer avec les majors a eu pour conséquence des discographies peu opulentes. Les Riot Grrrls n'étaient pas dans une logique de production à outrance. Les fans ne sont pas là pour cracher au bassinet. Et les artistes pour embrasser le statut de rock and roll stars. Les Riot Grrrls auront réussi à éviter les compromissions marchandes du grunge. Z'ont su préserver leur intégrité.
C'était une autre époque. L'internet n'était pas encore là. Les premiers enregistrements circulent sur des minicassettes. Le fanzine et le flyer étaient les documents privilégiés de communication. Ce livre de Manon Labry arrive à point pour exhumer de l'oubli tout un pan de l'histoire du rock. En plus elle a écrit avec sa tête. L'a repris tous les éléments qu'elle avait à sa disposition. L'a tout repensé. Et puis s'est souvenue qu'elle aussi elle existait et n'a pas hésité à intervenir dans cette histoire avec ses gros sabots de prédateurs, pardon avec ses ballerine de rose sirène. D'usine. N'a pas fait du Do It Yourself, mais du Do It With Yourself. Ce n'est pas divin, mais presque. Just Diwy !
Damie Chad.
M TRAIN
PATTI SMITH
( Traduction Nicolas Richard )
( Gallimard / 2016 )
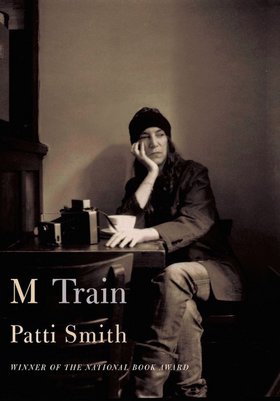
J'en connais qui sont en train de hurler de joie. Z'ont lu le titre du bouquin et le nom de l'auteur, chic ! La suite de l'autobiographie de Patti Smith que l'on attend depuis trois éternités, l'après Just Kids, la première partie de sa vie, sa jeunesse, sa rencontre avec Robert Mapplethorpe, et maintenant la gâterie suprême, ses années de compagnonnage avec Fred Sonic Smith, le guitariste du groupe MC 5, j'imagine très bien les lecteurs de KR'TNT en train de trépaner leurs gosses à coups de batte se baseball pour obtenir le calme olympien nécessaire à une si saine lecture.

Hélas, trente mille fois hélas, Freddie est mort depuis belle lurette, bien sûr que sa silhouette énigmatique se profile à l'intérieur des pages, mais comme il est exactement comme on l'imagine, le mec pas causeur, enfermé dans son monde, retranché à l'intérieur de lui-même, solide comme un rock... Sourit rarement. Amateur de bière. Vous n'apprendrez rien sur lui, cela tient en trois lignes, aime la pêche, supporte les Tigers de Detroit et est passionné d'aviation. L'a passé son brevet de pilotage – un truc qui aurait plu à Vince Taylor – mais n'a jamais volé tout seul, pour la simple et mauvaise raison qu'il n'a jamais eu assez d'argent pour louer un oiseau métallique. Et question musique ? Pas un vocable. L'aurait pu être livreur de pizza, elle n'en aurait pas dit un mot de plus.
Un dernier espoir, semblable à la flamme vacillante du soldat inconnu que l'on éteint après la cérémonie des décorations aux anciens combattants, brille dans vos yeux cendreux. Oui mais Patti elle va tout de même de temps en temps chevaucher les grands chevaux blancs du rock and punk new-yorkais, nous livrera quelques confidences sur les gravitations tumultueuses autour du CBGB's, quelques révélations inouïes et ultimes ! Rien pas un mot. Si vous ne me croyez pas, procurez vous le volume, qui je vous le répète n'est pas sonore.

Mais de quoi qu'elle cause alors ? De rien. La réponse est lapidaire. Mais d'une justesse absolue. Pour être plus précis, je me permets de donner un conseil à tous les buveurs patentés de Jack et à tous les adorateurs de Sky, n'ouvrez jamais ce livre vous ne le comprendriez pas. Cet avertissement n'est pas une insulte à votre quotient intellectuel, l'est une précaution : sur les deux cent soixante pages du bouquin ( petits caractères pleine page ) le premier tiers est consacré à la dégustation du café. Patti Smith se nourrit exclusivement de café, n'importe lequel, le meilleur du monde dégoté dans une infâme gargote de Mexico au fin fond d'un quartier craignos comme la mort, ou une vulgaire tasse de nescafé soluble, la dame n'est pas difficile. Dans le deuxième tiers puisqu'elle n'est pas en train de boire du café, très logiquement vous la suivez dans ses pérégrinations incertaines à la recherche d'un bar où l'on puisse boire... un café. Tiens super, elle est partie à Tokyo, chic l'on va pouvoir s'abreuver de lampées de saké à ramper par terre. Erreur, en terre nipponne, notre friponne ne visite que les hôtel à touristes américains dans l'espoir insensé de trouver la précieuse manne. Un peu fort de café, vous ne trouvez pas ?
Etrange comportement. Vous tiquez : est-elle toquée ou est-elle au taquet ? La réalité est plus triste. Vous livre mon analyse. N'en parle point. N'évoque jamais une telle possibilité. Patti souffre d'une méchante dépression. En présente tous les aspects, sous une déclinaison un peu spéciale que je qualifierais, si vous me pardonnez mon pseudo jargonage médical, d'artisto-autistique. Se referme sur elle-même, comme la boîte sur la sardine. Sans huile. La solitude est la dernière coque de protection à laquelle vous pouvez accéder. Une vie de vieille fille. Elle n'émiette pas du pain sur son balcon pour nourrir moineaux et pigeons et vivre par procuration comme dans la chanson de Goldman, mais elle donne leur pitance à ses chats chaque matin. Et après ? Elle ne fait pas sa toilette, de toutes les manières elle se couche souvent tout habillée, puis elle va au café. Sa place, sa table, sa chaise, quand elle en sort au bout de quelques heures, c'est pour se rendre – ô quel hasard Balthasar !– dans un autre café. Tournée des grands-ducs au jus de chaussette.
Fête son anniversaire. C'est là que le boomerang vous atteint en plein coeur. L'a soixante-six printemps la damoiselle, le genre de nouvelle qui ne nous rajeunit pas. Too Old for rock and roll, mais assez vieille pour mourir. L'est sûr qu'elle est plus près de la tombe que du berceau. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est elle. S'en rapproche même fatalement. Totalement fascinée par l'inéluctable. Le meilleur moyen d'apprivoiser votre trouille des serpents c'est de vous endormir chaque soir avec un boa constrictor dans votre lit. Exactement ce que fait Patti. Certes elle dort avec ses chats, mais elle passe son temps à amadouer la mort. L'a son truc, le voyage. Un peu partout, aux States, en France, au Japon, au Mexique. Son buzz ce n'est pas de visiter les Chutes du Niagara ou le Palais de Versailles. L'est un peu comme les vampires, se complaît dans les cimetières. Non elle n'est pas nécrophile, elle recherche la recette de l'immortalité.

J'entends les ronchons au groin de cochon : ça ne lui suffit pas d'être une icône du rock an roll à cette vieille bique ? L'a un album classé parmi les cinquante premiers de l'histoire du rock dans le baromètre de la revue Rolling Stone, que veut-elle de plus ? Ben le rock, si vous avez lu ce qui précède, ce n'est plus son souci majeur. L'a d'autres ambitions, ne se recueille pas sur la tombe d'Elvis Presley ou de Gene Vincent ( là, elle devrait), uniquement sur des sépultures d'écrivains : Arthur Rimbaud, Sylvia Plath, Jean Genet, ou Akutagawa... nettoie les pierres tombales, enlève les mauvaises herbes, jette les fleurs séchées à la poubelle et enterre quelques objets propitiatoires au plus près de la dépouille. Médite, intense moments de communion, parfois elle sent une présence...
Patti Smith cherche l'assentiment de ses pairs. Ils sont ce qu'elle aimerait être, un grand écrivain. Un de ces êtres fabuleux qui règnent au panthéon de la littérature universelle. Pourquoi croyez-vous qu'elle ingurgite pendant des heures des milliers de tasses de café dans les bars ? Pourquoi passe-t-elle ses soirées seule avec ses chats dans son lit ou à sa table de travail ? Pour écrire. Des milliers de feuilles, dans des carnets, sur des serviettes de restaurant, sur des feuilles volantes, qu'elle retrouve illisibles dans ses poches, qu'elle égare ou qu'elle perd avec une régularité qui mettrait la puce à l'oreille bouchée du plus mauvais des psychanalystes.
L'est une monomaniaque de l'écriture. Transmue le plomb du quotidien de son existence dans l'or de la poésie. Encore que souvent la transmutation est des plus incertaines. Alors elle se protège, se fourbit des armes contre le néant programmé de sa mort. Epouse des conduites que le vulgus pecum condamnera pour leur non-rationalité. L'aura raison, Patti Smith procède d'une démarche magique. Communique avec le monde au travers de mille petits rituels que beaucoup jugeront comme des conduites déviantes. Les sains d'esprit ne parlent pas aux choses. Ils ne reçoivent pas de signe en réponse à leurs actes.
Elle qui décrétait dans son premier disque que Jésus n'était pas mort pour elle, nous apparaît comme un esprit profondément religieux. Une constance de l'âme américaine pétrie de moraline puritaniste, et sa propension à sentir les présences spirituelles autour d'elle nous semble trop entaché d'un indécrottable fond de christianisme insupportable. Toutefois mélangé avec d'insidieuses croyances spirites : non pas tant une communication directe avec les morts, mais une traque de l'éternel présent de ce qui est, au travers de leur aura iconique.
Car dans le troisième tiers de son livre, Patti Smith se détourne de ses sempiternelles tasses de café, elle prend des photos. Des photographies de ce sur quoi elle est en train d'écrire. Certes de temps en temps elle flashe ses feuillets, mais c'est là pratique anecdotique, elle mitraille plutôt les objets chargés d'un affect sentimental, héréditaire, symbolique... Le livre est parsemé de ses polaroids, l'on imagine que les éditeurs ont dû en limiter le nombre. Ce ne sont pas des photos d'art, juste des témoignages froidement objectifs, une chaise, une robe, une paire de béquilles, une devanture de café, une station – au sens évangélique du mot – une fixation du fleuve du temps qui court à notre perte. Des gestes d'une vanité absolue contre tout ce qui nous ronge et nous détruit.
Une manière de survivre. Sandy est l'ouragan qui ravagea New York. L'a emporté dans les eaux de l'Atlantique les gros pontons de bois de la plage sur laquelle Patti aimait à se promener. Et surtout la baraque de planches du café qu'elle fréquentait... Mais elle Patti a survécu. Elle et le cabanon qu'elle avait acheté afin de le retaper et y vivre dedans. Un tas de palanques pourries désertées par les vers à bois.
Faut-il y lire une certitude d'espoir ? L'épreuve de survie de l'écrivain Patti Smith embarquée sur le radeau de la Méduse littéraire ! Qui mourra, verra.
Hobo littéraire.
Damie Chad.
NUIT DEBOUT

Les rockers ne dorment jamais. C'est bien connu. Alors autant passer la nuit debout et y faire un tour. Place de la République, celle de Paris. Ce samedi 9 avril, juste après la manif. Ne vous inquiétez pas, l'Etat policier s'occupe de notre sécurité. De grands garçons sympathiques veillent sur notre santé. Pas méchants, un coeur d'enfant, s'habillent encore comme Goldorack avec la panoplie que leur papa avait reçue à Noël, et tiennent à s'inonder du parfum de leur maman, le célèbre N° 17 de Chanel, Hyène Puante, tellement fort qu'il fait pleurer des yeux. Des gamins, faute de sabre laser comme les chevaliers de la Guerre des Etoiles, ou de kalachnikovs comme des islamistes au Bataclan, ils vous tirent dessus avec de misérables pistolets qui projettent d'inoffensives balles de plastique. A peine s'ils parviennent de temps en temps à crever un oeil ou briser une jambe. De véritables pères de familles, lorsque certains ont voulu aller prendre l'apéro chez Valls, leur ministre préféré, ils se sont interposés, pas par méchanceté, simplement par prévenance, pour leur éviter les effets nocifs de l'alcool.

Bref, il y a comme un petit parfum de pré-mai 68 qui fleure bon, au fin fond de l'atmosphère de ce printemps pluvieux. Un peu fleur bleue bonjour les bisounours, un peu fleur rouge tiens revoilà la lutte des classes qui pointe son nez, un peu fleur noir-anarchie. L'on ne sait trop quand cela va s'arrêter et peut-être ne sont-ce que les premiers signes avant-coureurs d'un phénomène beaucoup plus important. Avec les français l'on ne sait jamais, râlent tout le temps mais ne passent que bien rarement à l'action.
Je me pose tout de même une question, mais là-dedans où est le rock'n'roll ?
Damie Chad.
16:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/04/2016
KR'TNT ! ¤ 276 : TINDERSTICKS / APARTMENTS / OL' BRY / DISTANCE / JUNIOR RODRIGUEZ / TONY VISCONTI
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 276
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
07 / 04 / 2016

TINDERSTICKS / THE APARTMENTS / OL' BRY
THE DISTANCE / JUNIOR RODRIGUEZ
TONY VISCONTI
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 02 – 03 – 2016
TINDERSTICKS
TINDERSTICKS EN STOCK
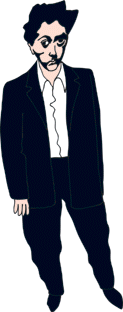
Il semble qu’avec le temps, Stuart A. Staples ait perdu son ramage de Dandy. Voilà qu’aujourd’hui il monte sur scène en jean, avec une chemise passée par dessus, comme pour masquer un début d’embonpoint. De larges rouflaquettes et une moustache en crocs lui donnent un petit air manouche. Sans doute reste-t-on attaché à de vieilles images. On préfère certainement le Staples des origines, l’un peu blême, le Staples surpris dans la lumière frileuse du petit matin, les yeux cernés et le regard un peu dubitatif, échoué dans le salon d’un hôtel décadent. Il avait encore cette coupe d’épais cheveux noirs qui rappelait celle de Charles Baudelaire et ce teint dont la pâleur tranchait si nettement sur l’ombre. Sur scène, les Tindersticks restent un groupe émouvant. Tout repose sur la voix de Stuart Staples et cette diction mouillée et tiède qui transforme la langue anglaise en une sorte de glaise mélodieuse. L’esprit de ce groupe unique survit, bien que légèrement diminué. Quand un groupe démarre avec un chef-d’œuvre aussi manifeste que «The First Tindersticks Album» paru en 1993, il crée forcément des attentes. Difficile de rester 25 ans à un tel niveau d’excellence. Seuls Dylan, Brian Wilson et David Crosby en sont capables.
Sur scène, l’ambiance est au recueillement. Et le fait d’avoir réinstallé les chaises au 106 renforce encore cette impression qu’on assiste à un récital et non au concert d’un groupe pop. C’est un peu comme si on forçait le public à se recueillir, mais c’est une vaste farce car il est évident que la plupart des gens ne comprennent pas ce que marmonne Stuart Staples au long de ses mélopées, surtout quand il attaque «How He Entered», un poème fleuve avec le texte à la main. C’est de la chanson à texte destinée aux Anglais et aux Anglophiles confirmés. Vous alliez voir Barbara, Pierre Louki, Diane Dufresne ou Dick Annegarn en récital, mais jamais un groupe pop chantant en Anglais, car ça n’a aucun sens. Pourtant la salle était pleine à ras-bord. En prime, un inconditionnel du groupe applaudissait à tout rompre à chaque fin de morceau et me crevait le tympan droit à gueuler comme un veau. Le moment fort du set fut cette reprise hallucinante de «Boobar Come Back To Me» qui se trouve «The Hungry Saw». Stuart Staples semblait jouer cette merveille comme pour faire une concession au monde du rock mainstream auquel il n’appartient pas. En tous les cas, il fait tout ce qu’il faut pour ne pas l’intégrer, ce qui l’honore.
Ça doit être très difficile pour un artiste aussi brillant que lui de préserver sa différence. On pense bien sûr à Brian Wilson qui cherchait une autre voie alors que les Beach Boys s’installaient au sommet de la gloire. Brian Wilson se moquait du succès. Ça ne pouvait pas l’intéresser. Il défendait une vision et n’ambitionnait qu’une seule chose : la préservation de son intégrité artistique. Stuart Staples semble livrer le même combat en rejetant la facilité. La petite pop ne sautait l’intéresser.
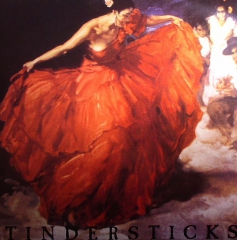
Paru en 1993, «The First Tindersticks Album» et sa dame en rouge créèrent l’événement. Cet album est certainement l’une des meilleures choses qui soient jamais sorties d’Angleterre. Dès «Tyed», Stuart Staples et ses amis nous embarquaient dans un fantastique delirium de couloirs déserts et de somptueuse désolation - The sheep that was cut/ Cut for blood - cut extraordinairement tendu et décadent, et même définitivement morbide car on y suspend un mouton dépecé. Le dandy repart en dérive avec «Whiskey And Water», où l’on ressent une troublante proximité et on savoure sa façon d’accrocher l’accroche - ‘Turn my whiskey into water - Puis il prend «Blood» à la plaintive tremblante et semble se laisser emporter par le flux d’un son toujours richement orchestré. S’ensuit une absolue merveille, «City Sickness». Stuart Staples trépigne de city sickness - I’m crawling don’t know where to or from/ And the city sickness growing inside me - Il prend ça d’un ton unique et développe vraiment quelque chose de fascinant. C’est un hit, un morceau qu’on recroisera toujours avec même plaisir. Et tout le disque se maintient à ce niveau d’excellence. Voilà «Patchwork», magnifique de tension intimiste, allumé à petits coups de trompette comme chez Peter Milton Walsh et ça violonne à tout va dans le final. On peut parler ici d’indicible beauté. Encore une énormité avec «Marbles» et cette attaque mélodique en contrescarpe. Chez les Tindersticks, tout s’écoute, rien de se perd. Encore une belle virée tinderstiquienne avec «Milky Teeth», embarquée au train unique d’un son poissonneux d’instruments, et on retrouve cette petite tension de la trépignance insistante qui va si bien les caractériser - You know I’m a kisser/ I wanted you for that mouth - Puis il attaque «Jism» au chant de nez bouché - I need to taste her pain/ For accomplishment - Il ne recule devant aucune extravagance lyrique. Il fait de la pop en attente d’on ne sait quoi. Retour aux grosses ambiances extraordinaires avec «Tie-dye». Personne ne sait d’où sort ce son. L’ambiance pèse, chargée de grondements orageux et de dynamiques organiques et on entend Stuart Staples aspirer de l’air. Plus loin «Drunk Tank» renoue avec la colère rentrée. C’est exceptionnel de classe, voilà l’histoire d’un mec à la rue qui revient voir sa poule - Just walked these miles to be passing by/ Just to say that I’m okay/ For you to see the state fo me - Fort peu de disques de pop anglaise sauront vous fasciner à ce point-là.
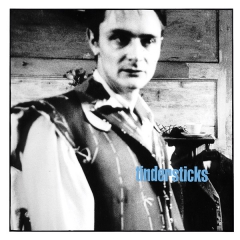
Pour la pochette de leur second album titré «Tindersticks», les Tindersticks posent chez un tailleur. On retrouve sur cet album des pièces maîtresses de leur premier album, à commencer par «City Sickness» - In the city there is no place for love - et «Drunk Talk», avec sa persistance de l’observance, tendu et beau comme le ciel que décrit Brel dans «Le Plat Pays». Dans «A Night In», il parle de ses chaussures de clochard - I had shoes full of holes - suivi d’un tragique «Talk To Me», chanté à la langue coincée des ze - I know it’s scary darling/ it comes back from ze dead - Il envoie «No More Affairs» cingler sur une mer de violons et les gens applaudissent. C’est vrai qu’on est en concert. Le télescopage des ambiances : voilà la grande spécialité des Tindesrticks. Ils savent jouer de l’anticipation. Dans «Vertrauen II», ils télescopent James Bond avec des tambours africains, mais c’est complètement free et truffé d’ouvertures sur Stockhausen et sur les fantaisies de Scriabine. Il est bien évident que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Mais ce deuxième album n’est pas au niveau du premier qui était peut-être beaucoup trop dense, beaucoup trop riche.

Même problème avec «Curtains». Pochette faible (un détail de rideau) et disque assez terne, excepté deux choses. À commencer par «Fast One», un cut d’essence velvetienne joué à l’outrance du son. Voilà une belle démonstration de force - And I squandered her love/ It’s the biggest kick I ever got - Puis «Ballad Of Tindersticks» où il raconte la tournée américaine et le retour à Londres, ils sont fatigués, ils arrivent à Soho pour boire un dernier verre et Stuart Staples finit son poème fleuve en ressortant du club - bumping shoulders we stumble out into Soho - pour enjamber les gens qui dorment dans la rue - slipping over the sleeping bags - et appeler un taxi - shouting for taxis. Sur cet album on entend aussi des violoncelles qui créent encore plus de tension. On retrouve aussi les ambiances d’aube pâle («Rented Room»), de belles intensités viscérales dont on se gave jusqu’à plus soif («Don’t Look Down»), un beau balladif violonné et explosé à coups de trompettes («Let’s Pretend»), du désespoir à l’état le plus pur («Desperate Man» chanté à la tremblotte de glotte flappie - Remember what Am I/ Without her) et de l’énergie fantastique («Bathtime», avec un gros beat tendu - The trains they run all night).

On voit un joli corps de femme sur la pochette de «Simple Pleasure». Pas de hits au sens où l’entendent les Tindersticks sur cet album, mais on apprécie leur confort intellectuel. Stuart Staples démarre avec une prière solennelle, «Can We Start Again», bien emmenée au groove de basse. Stuart Staples presse ses syllabes-oranges dans les corridors déserts de sa folie - What can I say/ To make you stay - On retrouve le très beau son de basse sur «Pretty Words». Stuart Staples travaille ça à la voix d’haleine radieuse. Il chante de l’intérieur du menton, il prend les choses à la manière chaude. S’ensuit une balle cavalcade d’élégance démesurée avec «From The Inside», un instru perlé des notes de lumière de la nuit londonienne. On tombe plus loin sur un «Before You Close Your Eyes» largement négocié à la basse et il faut attendre «I Know That Loving» pour renouer avec la belle soul longitudinale. On croirait même entendre un Stephen Stills ruiné de fatigue. Ça sonne comme un hit intemporel, dans la veine du «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield.

C’est un âne qui vous attend sur la pochette de «Can Our Love». Il se niche sur cet album une pure merveille de groove, «Sweet Release», joué à coups d’acou et d’orgue. Stuart Staples serpente sa diction - It’s too long till I see you again - C’est tendancieux car violonné à la mode Tamla et ils en font carrément un groove hypnotique - Gimme that sweet release - Stuart Staples revient en mendiant, il veut ce corps pour le caresser, c’est franchement digne des grandes heures du Duc de Berry, c’est-à-dire Marvin Gaye. L’autre point fort de cet album, c’est ce chef d’œuvre de désespérance qui fait l’ouverture du bal, «Dying Slowly». Pur jus de Tindesticks - I’ve seen it all and it’s all done/ I’ve been with everyone and no one - Constat terrible de l’inutilité des choses et surtout de l’inutilité de vivre - I’m just tired baby/ I just need to lay down - C’est exactement ce qu’on dit quand on en a vraiment assez. On appelle ça une fin en soi admirable. Cet album semble cependant plus groovy que les autres, car «People Keep Comin’ Around» se laisse bercer par des violons. C’est un joli de groove britannique - You know I’ll always wait - Le groove de basse et les violons, c’est la clé du succès, ne l’oublions pas. Avec «Don’t Ever Get Tired», Stuart Staples délivre ses enseignements - Learn to recognize when the joy lies - Voilà de la belle pop de perle de rosée chantée à l’inspiration définitive et au meilleur feeling du mondo bizarro. Retour au groove insistant avec «Chilitetime». Wow, quelle fantastique redondance d’insistance - You say you got love/ Got a love to set you free/ I can feel it darling/ It runs all over me - belle échappée du grand Stuart Staples qui jamais ne laisse indifférent.

Excellent album que ce «Waiting For The Moon». C’est là que se niche l’extraordinaire «Say Goodbye To The City» , tendu à se rompre, gonflé aux violons et aux trompettes d’intensité maximaliste et ça tourne à la fantastique explosion de vie. On voit rarement dans la vie de tous les joues de telles exactions. Ils nous font une récidive merveilleusement tendue. «Until The Morning Comes» relève de la perfection mélodique à l’Anglaise. On sent un peu de Cohen au fond du sac. La chanson goutte d’un jus macabre car il raconte qu’il lui serre le kiki. On trouve d’autres énormités sur l’album, comme par exemple «4.48 Psychosis» qui sonne comme un brillant hommage au Velvet. Eh oui, les Tindersticks sont capables de sacrés coups d’éclat et en voilà un. Ils s’enfoncent dans le Psychosis de Can et des autres. Stuart Staples y va d’une voix un peu neutre pendant que ses copains se déchaînent - How do I stop - Et puis ils font un brillant retour au groove avec «Trying To Find A Home» qui une fois de plus sonne un peu comme le «For What It’s Worth» du Buffalo Springfield. On a même les violons de «Walk On The Wild Side» ! Quelle télescopage ! Stuart Staples joue les funksters à la voix blanche, il chante à l’adresse du Worth et on entend les tu-tu-tu de Walk. Belle pièce aussi que ce «Just A Day» joué à la bonne franquette d’harmo et à la décadence d’un banjo traînard.

Fantastique ambiance, l’incongruité stupéfie - But I’m not a dog !
Coup de génie sur «The Hungry Saw» avec «Boobar Come Back To Me». Sans doute le plus beau hit des Tindersticks, une chanson complètement envoûtante qu’on réécoute plusieurs fois d’affilée - I picked an old guitar/ I tried to learn that song - Pareil pour «The Turns We Took», extraordinairement violonné et visité par la grâce - It’s time to stop pretending - Pure féerie. Dans l’épais set somptueux «Mother Dear», on entend un killer solo, des pas dans les ténèbres, une nappe d’orgue souterraine et il y règne une tension extrême - It’s not so serious not so serious after all - oh mais ce solo concassé, il faut l’avoir entendu une fois dans sa vie ! Et le poids de «Yesterdays Tomorrows», oh le poids de la voix - Ah all these days where did they go - Il se plaint de la fuite du temps et de tous ces jours qui nous rapprochent de la mort. Encore un bel instro avec «e Type». Eh oui, il s’agit bien de la Jaguar, et donc de London by night. On entend un orgue mécanique de fête foraine dans «The Organist Entertains» et le Vienne d’Arthur Schnitzler revient au devant des nappes de visions. Belle ouverture sur les rondeurs du passé, les seules qui puissent faire rêver.

Pochette mystérieuse pour «Falling Down A Mountain». La toile représente un volcan en éruption ? On ne sait pas. En tous les cas, le morceau titre qui ouvre le bal est un puissant groove trompetté à la nocturnale. On retrouve toute la menace qui fait l’art des Tindesticks. On note même un petite parfum de Babaluma. «Harmony Around My Table» sonne comme un hit énorme. L’accent tranché de Stuart Staples tranche le son en tranches. Il mouille bien ses syllabes tremblées. Bryan Ferry n’a pas cette profondeur de timbre. Avec Stuart Staples, on est en présence d’un singulier mélange de diction aristocratique et d’excellence moderniste. Une sorte de joie émane de la vieille matière et ça claque des mains. S’ensuit un «Peanuts» mélodiquement pur - I know you love peanuts/ So I love peanuts too - Il va chercher ça dans les profondeurs humides de son baryton. On se régalera de «She Rode Me Down», orchestré à la guitare espagnole et aux violons pressés. On assiste à un merveilleux numéro de cirque instrumental. Il règne dans «Black Smoke» une fantastique énergie rock. Stuart Staples fait son Jean Genie avec des chœurs chauffés à blanc et un solo s’en va courir comme le furet. Stuart Staples pique sa petite crise de r’n’b. Oh rien de bien grave ! Puis il chante «No Place So Alone» comme un vainqueur. Il y a presque trop de reverb.

Un petit montage de ciels orne la pochette de «The Something Rain». On suit les Tindersticks à la trace, car on les sait capables de petits miracles. Ils font partie de ces groupes intéressants qui ne cherchent pas le succès commercial, mais qui sont constamment menacés de récupération. Il semble que leur austérité naturelle soit une forme de protection, comme peut l’être celle de Nick Cave, bien que celle de l’Australien soit infiniment plus morbide. Vous trouverez quatre merveilles absolues sur ce nouvel album. À commencer par un chef-d’œuvre hypnotique, «A Night So Still», complètement perdu, crépusculaire, horizontal et donc à perte de vue. Extraordinairement stimulant pour l’esprit, surtout si on consomme des bonbons à la menthe en l’écoutant. Ça nous renvoie à l’époque où on écoutait Tago Mago ou The Bogus Man en se shootant à l’éther. Autre merveille hypnotique : «Frozen». C’est tellement bien foutu qu’on se sent immédiatement concerné. On note l’intro véloce et la vitalité du beat, on sent le jazz sous la cendre. Véritable coup de génie avec «The Fire Of Autumn», chanté en retenue avec des vacillements. Ils vont chercher le suranné de la modernité, c’est extraordinaire, on retrouve la fabuleuse foison de la tension urbaine, ils sont sans doute les seuls à savoir produire un son d’une telle pression. C’est même xylophoné. Ça nous embarque pour Cythère, au hasard de petits accords grattés à la ramasse. C’est intense et ça monte, ça se tend à se rompre. Ils tirent dessus à outrance et ça tient. «Slippin’ Shoes» renoue avec le son original des Tindesticks. Stuart Staples chante à la glotte chaude, le menton rentré dans le col - dance dance dance - on retrouve les couloirs du palais abandonné - hey, ça claque à l’effarant cliquetis de la classe ibérique, ils sont mille fois plus décadents que ne le fut jamais Bryan Ferry - And this feeling breaks/ But my desire to give/ So much that I had to lose - Puis on écoutera «Come Inside» pour entendre Stuart Staples chanter à la plaignante, penché en avant avec des boutons de manchettes imaginaires - Come inside/ I’ve been expecting you - Il espérait donc la revoir ?

On trouve un beau gâteau au chocolat peint sur la pochette d’«Across Six Leap Years». Alors, la réputation de groupe solide tient-elle toujours avec ce nouvel album ? Plus que jamais. Les Tindersticks ont tout simplement ré-engistré des titres anciens à Abbey Road dont le fameux «Say Goodbye To The City» qu’on trouve sur «Waiting For The Moon». Simplement, ils font exploser le morceau - Get in the car babe - Arrive un solo explosé de trompette à la Spike Lee (Mo Better Blues), nous voilà précipités dans un abîme d’anticipation - Stop to call me Dizzy - Une voix de femme se mêle à l’explosion et ça tourne à la fournaise, l’une des plus violentes qu’on ait vues ici bas depuis un set de Gallon Drunk en 2007. Ils reprennent aussi «Dying Slowly» mais sur un groove Tamla, il voudrait exprimer des choses -I would shout it out - et après avoir fait du café et enfilé a pair of pants, il revient à son couplet mortifère - I’m just tired baby/ I just need to lay down - «A Night In» vient aussi du premier album, avec les shoes full of holes et ça devient dans cet album une extraordinaire épopée épique. Il revient à la rue, comme le héros d’un film noir de Mike Leigh (Naked) - So go turn these flat undergroung/ There’s no further down - C’est joué au tourbillon, admirable de désespoir. «I Know That Loving» est aussi un morceau ancien transfiguré. Ça devient ici un groove magique, on dirait presque Question Mark, une sorte de jerk incroyablement inspiré - Do you wanna try and carry on - Stuart Staples fait grimper son cut à la folie du r’n’b des Buffalo avec du white niggah plein la bouche.

Attention avec l’album «Ypres». Il s’agit là d’un disque complètement hors des modes, mais pas hors du temps. On a demandé aux Tindesticks de faire la bande son d’Yprès (Belgique), une exposition permanente qui commémore le souvenir de l’un des champs de bataille les plus sanglants de la Première Guerre Mondiale. Dès qu’on entre dans «Whispering Guns Parts 1 2 3», c’est foutu. L’ambiance funèbre nous happe littéralement. Le seul qui ait été aussi loin, c’est le grand Jacques Lanzman avec «Shoah». Il était allé au bout du cinéma. On ne pouvait plus aller au-delà de «Shoah». À leur façon, les Tindersticks vont au bout de la musique. On entend chanter les violoncelles et une cloche sonne au loin. Aw God, l’enfer est descendu sur la terre. Ce truc sonne comme une sorte de cauchemar inéluctable. La notion de vie de disparaît complètement, au profit de la notion des technologies de la destruction. Pendant que des ingénieurs au service de la patrie perfectionnaient le fonctionnement des armes mécaniques, des ouvriers, des pauvres et des paysans arrachés à leur moyen-âge se faisaient tailler en pièces à la sortie des tranchées, juste après avoir englouti le pâté de lièvre envoyé par les familles. Ils écrivaient au crayon gras sur leur mauvais papier : «Ah ma mie, tu n’as pas idée de ce qu’on endure ici ! Il n’y a plus d’espoir, plus de soleil, le croque-mitaine rôde tout partout...» C’est exactement ce qu’illustrent musicalement les Tindersticks : la fin de la lumière et les carcasses des arbres morts. Avec «Ananas et Poivre», ils jouent une sorte de mélodie malade, disons blanche et tuberculeuse. Dans «La Guerre Souterraine», on entend le grondement d’une menace surnaturelle. C’est là qu’on réalise que la vie ne tient qu’à un fil. Ça gronde tant et si bien que le son chevrote. Le morceau suivant s’appelle «Gueules cassées». Comment illustrer musicalement cet effroyable spectacle ? Le filet de bave au bas du visage effacé ? La corne de brume reprend sa respiration. C’est au-delà du supportable, bien pire que «Johnny Got His Gun» de Dalton Trumbo. La guerre avait rongé l’esprit de l’homme jusqu’à l’os. Si on a le courage, on peut essayer d’écouter aussi «Sunset Glow», qui pourrait être sous-titré «Le Crépuscule des Cadavres». On est loin de Copacabana. En ce temps-là, il valait mieux ne pas être en âge d’être incorporé car on allait à la mort comme les cochons vont à la mort, aujourd’hui encore, dans les abattoirs. Bien sûr qu’ils sentent la mort, de la même façon que le bidasse breton ou clermontois de 1915 qui sentait la mort en arrivant au front. Il croisait tous ces cortèges de corps couverts de charpie ensanglantée qui revenaient des première lignes. T’es foutu mon gars, tire-toi une balle dans la tête, ça vaudra mieux. Et surtout ne te rate pas, parce que sinon tu seras bon pour le peloton et au village, ces sadiques de notables déshonoreront ta famille à jamais.
Il y a tout ça et tout le reste dans ce disque épouvantable.

Le dernier album des Tindersticks vient de sortir. Dans la pochette de «The Waiting Room», Stuart Staples a glissé un petit livret de photos de l’homme à tête d’âne, celui qu’on voit sur la pochette. C’est du pur Pasolini ! L’autre soir au 106, les Tindersticks jouaient principalement les morceaux de cet album. Et d’ailleurs, le dandy n’était plus Stuart Staples, mais Earl Harvin, le batteur noir originaire du Texas. C’est lui qui joue le groove de «Help Yourself», un groove de rêve amplement cuivré - Will you just hep yersééé - La perle du disque, c’est bien sûr «We Are Dreamers». C’est battu aux galères par Earl Harvin - This is not us/ This is not us - Voilà du pur son d’angoisse anticipative et tout se réveille au fur et à mesure. On sent la présence de ce batteur fantastique dans tous les morceaux. Cet album fonctionne comme la nouvelle étape d’un parcours initiatique, celui d’un groupe de pop anglaise qui peut se vanter de n’avoir jamais enregistré un mauvais disque. «The Fear Of Emptiness» tient en haleine avec son sens de l’infini et «How He Entered» renoue avec le big atmosphérix - This is how he came in - Quelle fabuleuse ambiance déviante ! Cette mélopée envoûtante renvoie à certaines choses du Velvet, notamment «The Murder Mystery».

Oh on peut aussi aller fouiner dans les albums solo de Stuart Stapes, mais ce sera sans surprise, car on retrouve évidement le son ambiancier des Tindersticks. Quelques chansons reprises sur «Across Six Leap Years» sortent de «Lucky Dog Recordings», notamment «Marseilles Sunshine» que Stuart Staples chante au baryton - here comes moments - et surgit un solo discret, étrangement beau et hésitant. On trouve aussi sur cet album «Say Something Now», un rock puissant, une vraie débine de son attaqué aux trompettes. Quel show ! «Friday Night» repris dans «Across Six Leap Years» vient aussi de cet album, cut hypnotique en diable et monté sur un riff binaire, avec une douce entrée d’un shuffle de jazz. Il termine avec «I’ve Come A Long Way», funèbre, bien sûr, mais incroyablement attachant. Sa voix tranche. Tout est tellement fascinant, chez Stuart Staples qu’on lui donnerait le bon dieu sans confession. Amen.
Signé : Cazengler, Pinderstick
Tindersticks. Le 106. Rouen (76). 2 mars 2016
Tindersticks. The First Tindersticks Album. This Way Up 1993
Tindersticks. Tindersticks. This Way Up 1995
Tindersticks. Curtains. This Way Up 1997
Tindersticks. Simple Pleasure. Island Records 1999
Tindersticks. Can Our Love. Beggars Banquet 2001
Tindersticks. Waiting For The Moon. Beggars Banquet 2003
Tindersticks. The Hungry Saw. Beggars Banquet 2008
Tindersticks. Falling Down A Mountain. 4AD 2010
Tindersticks. The Something Rain. Lucky Dog Recordings 2012
Tindersticks. Across Six Leap Years. Lucky Dog Recordings 2013
Tindersticks. Ypres. Lucky Dog Recordings 2014
Tindersticks. The Waiting Room. Lucky Dog Recordings 2016
Stuart A Staples. Lucky Dog Recordings 03-04. Beggars Banquet 2005
LE KALIF / ROUEN ( 76 ) / 21 – 09 – 2015
THE APARTMENTS

APARTMENTS A LOUER
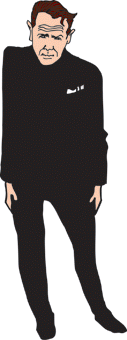
Il est des gens sur lesquels le temps ne semble pas avoir de prise. L’exemple le plus connu est celui des vampires, condamnés à l’éternelle jeunesse, un sort qu’on ne leur envie pas. Un autre exemple est celui des Vanilla Fudge qui ont toujours la même tête qu’en 1968. Vampires new-yorkais ? Allez savoir. Il conviendrait d’ajouter à cette courte liste le nom de Peter Milton Walsh, le chanteur des Apartments, groupe australien des années 80 devenu quelque peu légendaire pour sa pop de rang princier.

Approchez-vous de Peter Milton Walsh et vous verrez à quel point ce mec est bien conservé. Il n’est pas très grand. En France, on qualifie ces hommes de taille moyenne de petits gabarits. Il ne porte que du noir, et pas question de voir ses yeux puisqu’il les abrite derrière des lunettes noires. Il se coiffe comme un play-boy, ramassant son subtil fouillis mêchu vers l’arrière du crâne. Il offre en pâture au public l’agréable physionomie d’un jeune premier à peine défraîchi, comme pouvaient l’être Jean-Pierre Mocky ou Marcello Mastroianni à l’approche de la soixantaine. Ce mec a un charme fou et on imagine aisément qu’aucune femme ne saurait lui résister. Mais attention, il veille à taire ce charme, car à aucun moment il n’en joue. Cet homme ne sourit pas. Il semble vouloir s’effacer au profit de ses chansons. Il s’enveloppe d’un voile de mystère.

À certains moments, ce mystère se transforme en grâce. Parlons plutôt d’élégance. Peter Milton Walsh réincarne tout simplement ce vieux dandysme qu’on croyait disparu. Il est probablement le dernier héritier d’une tradition qui remonte dans le temps jusqu’à George Brummel et Jules Barbey d’Aurevilly, Rémy de Gourmont et le baron de Charlus (Robert de Montesquiou), des Esseintes et Dorian Gray, Monsieur de Phocas et Pierre François Lacenaire, puis les deux Francis - Picabia et Scott Fitzgerald - et jusqu’à Brian Jones, Syd Barrett, Kevin Ayers, Tav Falco ou, bien évidemment, Stuart A. Staples.

Pas la moindre petite trace de frime chez Peter Milton Walsh. Rappelons que l’art du dandy consiste justement à ne pas paraître. La seule élégance tolérée est elle de l’esprit. Et c’est bien ce qui frappe lorsqu’on écoute l’album qui l’a fait connaître en France, l’excellent «Drift», distribué par New Rose (comme par hasard).

Il s’agit là d’un grand album de pop mélodique hors du temps. Ça explose dès «Nothing Stops It», un hit planétaire, bien hargneux et emmené aux guitares. Peter Milton Walsh savait déjà allumer les candélabres ! Même chose avec «Over» et «Knowing You Were Loved», deux chansons singulièrement accrocheuses, une sorte de pop qui arrive l’air de rien et qui se révèle absolument fantastique. On a là une pop qui monte au cerveau et qui soûle, comme celle de Syd Barrett sur ses deux albums solo. Bien sûr, le son n’est pas le même, mais l’envoûtement se produit de la même façon. L’ami Atkinson embarque «All Those Stupid Friends» à la seule force de la mélodie. Voilà un son qui se boit avec délectation. Autre hit : ««Could I Hide Here (A Little While)», monté sur une fantastique partie d’accords racés. Voilà de la pop à la Prefab, évidemment, dotée des mêmes envolées extraordinaires, cette espèce de pop surnaturelle qui doit plus à l’enchantement mélodique qu’aux savantes orchestrations - d’où la différence entre les Bee Gees mélodiques et les Zombies orchestraux - On retrouve chez Peter Milton Walsh la classe de Paddy McAlloon. On goûtera encore un peu de groove prefabien avec «What’s Left Of You Now», excellente dérive septentrionale de quart sud-est qui sent bon l’esprit de grand large et qui s’inspire par les trous de nez. On a parfois l’impression d’entendre Paddy le héros et les anges du paradis. Si on entre aussi facilement dans l’univers des Apartments, c’est justement parce qu’ils sonnent comme Prefab et qu’ils disposent du même genre de génie pop. L’ami Atkinson y va de bon cœur, il s’inscrit dans la veine du filon, il sort sur sa guitare une pop miraculeuse. Il s’élève dans chaque cut de manière radicale. Tout est bien sur ce disque, incroyablement bien. Il faut le dire haut et fort, car de nos jours, les disques de ce niveau ne courent plus les rues.

Le premier album du groupe parut en 1985. «The Evening Visits... And Stays For Years». Il est nettement plus transparent que «Drift». Peter Milton Walsh cultivait déjà les ambiances intimistes et il fricotait avec les gens des Go-Betweens et toute une scène dont la presse intellote française allait faire ses choux gras. Walsh utilisait aussi le violoncelle, mais pas à la manière de Roy Wood. Il faut attendre «Great Fools» pour trouver un peu de viande, car c’est joué à la trompette instinctive. Ce mec aime l’exotica classique, ça crève les yeux. Il va au Paddy comme d’autres vont au Burt. Il sait sonner comme un petit chef de pop australo-pithèque - I’m a great fool ! - Il adore s’exprimer en public. Il tape «Speechless With Tuesday» au heavy blues. Il vise clairement le Tom Waits. Il devait écouter ce genre de truc à l’époque. On retrouve la grande pop de Walsh avec «Cannot Tell The Days Apart», une pop très entraînante, presque joyeuse, transgressive au sens propre comme au sens figuré. Il tartine et pose ses jalons pour la grande pop à venir. Puis il crée la surprise avec «Lazarus Lazarus», car voilà du gros garage à la Gloria. C’est incroyable de véracité cacochyme. On se croirait chez Kim Fowley ! Même chose avec «The Black Read Shines», cut sacrément musculeux qu’il chante comme un beau diable.
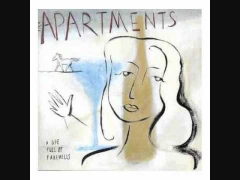
L’album «A Life Full Of Farewells» s’ouvre sur «Things You’ll Keep» qui sonne comme un hit dès l’intro et qu’il reprend sur scène. Peter Milton Walsh y rappelle le Bowie d’Hunky Dory - Everybody was skinny then/ Nobody said you wouldn’t win - C’est un merveilleux balladif. Dans les chansons de Peter Milton Walsh, il y a toujours quelque chose de profondément mélancolique, mais aussi de chaleureux et d’intime, même si parfois il ne se passe pas grand chose, au plan mélodique. On a le même problème avec Joni Mitchell qui dans chaque chanson crée un monde, mais rarement le frisson. Il faut attendre «End Of Some Fear» pour retrouver une fantastique embardée de pop claquante - There’s a change all around there - Oui, on sent le vent. Ce mec est capable d’éveiller les consciences et de fabriquer de fantastiques pièces d’excavation - The end of some fear ! - On se prélasse les oreilles dans la merveilleuse gadouille de «Thankyou For Making Me Beg» et on admire le poids émotionnel de «Paint The Days White». On sait qu’il ne va pas bien, alors il en rajoute des tonnes et il martèle, mais c’est un artiste. Tout est plombé à l’extrême comme dans les disques les plus pénibles de Nick Cave. Et soudain, une merveille surgit des brumes ! «All The Time In The World» est un vieux groove de croon shooté aux trompettes. Il chante d’une fantastique voix d’allant dans l’embrasure d’une porte de ciel - All the time in the world/ How are you gonna kill it ? - Il raconte l’histoire d’un mec qui part à la retraite.
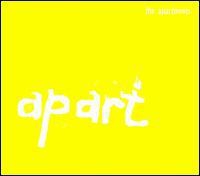
«Apart» sort en 1997 avec sa pochette jaune. Pas n’importe quel jaune puisque c’est le jaune primaire. Peter Milton Walsh attaque avec «No Hurry», une mélodie hantée par les accents faubouriens de Melody Nelson et sa lente montée de sève, basses devant toutes. Oh cette voix prégnante de pregnency ! Il laisse la basse rebondir au premier plan. Une sorte de dandysme prévaut à la prévalence, comme chez les Tindersticks et des grosses ambiances traînent comme les haillons d’une rode de soie. «Breakdown In Vera Cruz» est le groove de rêve absolu, grandiose et orchestré à la trompette en or. Peter Milton Walsh est une sorte de visionnaire, il travaille ses horizons mélodiques à la manière de Phil Spector, la basse roule comme la houle - The day goes no longer/ The night comes so late - Il règne un parfum d’Under The Volcano et de Malcolm-Lawrynisation des choses - Leave tomorrow/ I mean no hurry - Mais il n’a pas d’argent. Dans «To Live For», il évoque le fameux something to live for dont on est tous en quête. Avec «Welcome To The Walsh World», il livre une sorte de groove délétère égaré dans des labyrinthes, sans aucun espoir de retour - Each time we breathe we tear along with pain - Quel désespoir ! Il décrit l’horreur absolue de la vulgarité de la condition humaine - Fuck shit breasts - On sent une fantastique détermination dans «Friday Rich/Saturday Poor», bien monté sur la ligne de basse et dans «World Of Liars», les banjos font la loi - It’s a world of liars - Il chante au meilleur laid-back d’Australie. Puis avec «Cheerleader», il fait son dub de bassmatic. Il est marrant, car il est dessus. Il boucle avec «Everything Is Given To Be Taken Away», qui sonne comme une évidence, car lancé à la traînarderie d’une note de piano esseulée. C’est du jazz de stand-up et Peter Milton Walsh chante à la sourdine décatie. Il finit ça au groove de jazz de pin-pin pin pink. Admirable !

«Seven Songs» fut enregistré à paris en 2012 à la Maison de la Radio. Sur les sept chansons, quatre sont exceptionnelles, à commencer par la resucée de «Things You’ll Keep», certainement l’un de ses plus beaux hits. C’est admirablement orchestré. Peter Milton Walsh fait ses grands aow élégiaques. Il adore se répandre à la surface des choses. C’est un mentor d’orgue mystique de la mélancolie. Il gratte «World Of Liars» à coups d’acou selon un beau fil mélodique - And didn’t we care/ In a world of liars - Non, évidemment, we didn’t care. Il enchaîne ça avec le fabuleux «On Every Corner» - I look for you on every corner - Sa version est moins flamboyante que sur «Drift», car il manque les vagues de cuivres. «Every Day Will Be New» sonne comme un vieux hit fatigué, suivi par la trompette de La Strada, jusqu’à la sortie du village. C’est d’une tristesse insondable. Et même cosmique.
Lors de ce concert étonnant au Kalif, Peter Milton Walsh a opté pour jouer l’intégralité des titres de son nouvel album, «No Song No Spell No Madrigal». Voilà encore un disque infernalement bon. Tout y reste admirablement mélodique et donc captivant, à commencer par le morceau titre qui ouvre les festivités. Par sa façon de chanter, il renvoie une fois de plus aux Tindersticks et à Paddy McAlloon, et il traite ses textes à coups d’éclairs - The flowers of regret are suddenly in bloom - Chacune de ses chansons finit par accrocher, c’est inéluctable, comme chez Nick Drake. On retrouve son insondable mélancolie dans «Black Ribbons». Une trompette rôde dans le background et donne à l’ensemble une douce coloration jazzy. «Twenty One» fut l’un des moments forts du set live, sans doute à cause de ce final éblouissant joué à la trompette et qui renvoie sans détours aux Tindersticks, eux aussi coutumiers de ce genre d’exploit. Il attaque la face B avec la chanson des mauvais souvenirs, «The House We Once Lived In» - The cardboard boxes by the side of the road/ Are ready to load ? - C’est d’une infinie mélancolie. Toute souffrance humaine est unique, ne l’oublions pas. Et voilà de la pop parfaite avec «September Skies», un vrai hit doté de dynamiques étonnantes - September skies/ It will be alright/ Dry your eyes - Il en fait une chanson d’espoir à grands coups de blew away hey hey hey jetés au ciel gris. On retrouve dans «Please Don’t Say Remember» les grands fils mélodiques de Paddy MacAlloon. Ce hit pourrait très bien sortir de «Jordan The Comeback», car les accents colorés de Peter Milton Walsh sont du Paddy pur et dur.
Signé : Cazengler, the Aparté
The Apartments. Le Kalif. Rouen (76). 21 septembre 2015
The Apartments. The Evening Visits... And Stays For Years. Rough Trade 1985
The Apartments. Drift. New Rose 1992
The Apartments. A Life Full Of Farewells. Hot 1995
The Apartments. Apart. Hot 1997
The Apartments. Seven Songs. Talitres 2013
The Apartments. No Song, No Spell, No Madrigal. Microcultures 2015
28-03 - 2016
VILLENAUXE-LA-GRANDE ( 77 )
OL' BRY
LA MORT
Quand vous arrivez à Provins, vous avez l'impression d'être au bout du monde. C'est une réalité objective. Prenez votre voiture et lancez-vous sur la première départementale qui s'offre à vous, vous n'en croirez pas vos yeux. Du rien, du rien, du rien. De l'herbe verte à perte de vue, un truc à devenir mongol. Pas âme qui vive. Pas une vache, pas un cheval, pas une girafe. Au fond deux grands panaches de fumée blanche. C'est la centrale nucléaire. Vous vous dites que vous arrivez après l'explosion, et que vous êtes le survivant. Mais non, au fond rayonne l'Aube.
N'a pas des doigts de rose comme chez Homère, mais la main verte car le paysage ne change guère, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Votre vue se voile, le désespoir noir inonde votre coeur, vos êtes prêt à vous faire sauter le caisson comme sur la pochette de Teenage Depression, lorsque devant vos yeux hagards, au loin surgit la silhouette fantomatique d'un clocher d'église, poule rousse cernée de sa couvée de maisons ocres.

Villenauxe-la-Grande, ses rues étroites où la teuf-teuf a failli rester coincée, ses façades rébarbatives, son cimetière et sa prison. Ce sera tout pour le dépliant touristique. Non, je ne serai pas embauché par le syndicat d'initiative du patelin, mais il faut reconnaître qu'à Villenauxe quand ils cassent les oeufs de Pâques, ils font une sacrée omelette.
RESURRECTION
Une véritable fête foraine ! Stand de tirs, manèges pour les enfants, attractions pour les grands, confiseries, sandwichs, exposition de vieilles voitures, marabouts avec producteurs locaux, pêche aux canards, barbe à papa, dégustation d'alcool, distribution de jeux-vidéo, tout cela serpente sur plus d'un demi kilomètre et j'avoue que je n'ai pas tout regardé, ayant ostensiblement tourné le dos à la place de l'Eglise d'où proviennent des groupes et des groupes de badauds. A Villenauxe, on ne badine pas avec la fête, doivent pas être très chrétiens dans le coin puisqu'ils profitent du week end de la mort du Christ pour se goinfrer de frites et de charcutailles durant trois jours sans interruption. Pudiquement je me tairais sur les groupes de danse, avec ces jupes de filles qui tourbillonnent bien plus haut que culottes et strings, apparemment on sait s'amuser par ici, au micro l'on prévient la population, qu'en fin de soirée, le comité des festivités offre le champagne...

Mais je suis en mission. Je détourne les yeux et les oreilles de toutes ces diaboliques tentations. Je cherche l'improbable, l'impensable, l'inenvisageable, l'incroyable, les Ol' Bry ! Hé ! Oui, car afin que la population locale puisse goûter et s'abreuver à la coupe de tous les péchés capiteux des fleurs du mal, l'orga n'a pas reculé devant l'ultime sacrilège, un groupe de rockabilly ! Mon flair de hound dog ( race des Perkinois ) patenté me mène direct au marabout du concert. J'ai été devancé par Billy qui me refile des affiches pour le concert qu'il organise, le 21 Mai, à Troyes, à la La Chapelle Argence, avec Miss Victoria Crown, The Southerners and The Spuny Boys. Les Bry sont en train de s'installer, cinq minutes d'attente qu'ils aillent se faire beau et passer la cravate des dimanches, et les voici enfin !
OL' BRY
Sont là. Non pas les Ol', les gens. On était au plus une vingtaine et en cinq secondes les bancs se remplissent de grand-mères. Pas des avachies qui ont besoin d'une canne pour faire trois pas, du quatrième âge en pleine forme qui d'un bout à l'autre du concert marqueront le le rythme de la tête et du pied, les yeux pétillant de malice, dans les allées et sur le côté se pressent les gendres avec femmes et enfants, plus de deux cents personnes qui ne lâchent pas les musiciens du regard, qui applaudissent à tout rompre à la fin de chaque morceau et qui malgré l'heure tardive exigeront un rappel, le seul village de France où apparemment l'on préfère le rockabilly au champagne.

Le genre d'ambiance qui motive un groupe. Le son n'est pas parfait, souffle latéralement une petite brise froide dont on se serait passé mais qui n'arrivera pas à refroidir cette atmosphère de chaleureuse complicité qui s'est installée. En quelques mots, Eddie le bonimenteur a conquis les âmes, son oeil de velours, sa guitare sur le plexus comme une carapace pour se défendre d'une trop grande sensibilité, ça vous chavire le cœur de ces dames en un tour de main. Surtout qu'au début Diego abuse des plans guitares hispano-jazz, la fougue du torero et le battement spasmodique en demi-teinte d'Harlem la noire, un mélange sensuel qui vous émeut le sang et vous fracture les sens. Rajoutez Thierry dont on ne se méfie pas. Tout droit, à côté de sa contrebasse, l'a l'air de suivre le mouvement sans trop s'en faire et au moment où vous ne vous y attendiez plus il institue de ces montées d'adrénaline qui vous réveillent le serpent de la kundalini qui sommeillait dans vos entrailles. Sacrés coups de canifs dans les hormones ! Et c'est alors que Rémy vous recouvre le tout d'un nappé de saxophone, une caresse, un velouté qui ne vous laisse pas le sexe aphone. L'a du souffle se permet le luxe de jouer à plus d'un mètre du micro.

Mais ce n'est pas tout. Reste Thomas. Un jeune, grand comme un I qui donne l'impression de ne pas vouloir grandir. L'a dû écumer tous les catalogues pour trouver un kit de batterie au-dessous de sa taille. Une caisse claire à pleine plus grande qu'une assiette à soupe, une grosse caisse miniature qui mériterait l'appellation petit-quart-de caisse, deux cymbales ( l'on se demande pourquoi il ne se sert que d'une seule ) deux balais et deux baguettes. Et c'est tout. L'a fait le conservatoire, mais l'a dû rater pas mal de cours, ceux où l'on apprend à taper, à frapper, à effectuer des roulements, à tamponner comme une brute. Se contente d'abaisser, sans se presser, de deux centimètres sa baguette, j'ai bien dit sa, car l'autre il la laisse immobile sur la peau, parfois elle glisse doucement de quelques millimètres avec la lenteur d'un escargot paraplégique. A peine croyable, mais avec cette indolence de koala en train de déguster une pousse de bambou, il vous fait un raffut de tous les diables. Z'avez l'impression qu'il a enfermé les sabots du derby d'Hepsom dans ses deux misérables cylindres. Un charivari infernal, des sonorités qui se cognent les unes sur les autres comme des boules de billard, des bouffées délirantes de rythmes qui se poursuivent, des hoquètements de portière que l'on referme brutalement une dizaine de fois de suite, juste pour le plaisir de réveiller les voisins. C'est simple de tous les batteurs que j'ai entendus c'est celui dont la frappe se rapproche le plus des spécifiques errements de Dickie Harrel.
Eddie ne recule devant aucune difficulté. Explique à l'assistance médusée ce que c'est que doo wop, cinq secondes six centièmes, montre rock o' clock en main. Méthode japonaise d'art martial, il vaut mieux frapper qu'expliquer longuement ce qu'est l'essence du coup. Le quartette de devant en profite pour batifoler à pleines voix. Chacun appose son timbre et derrière Thomas cachette l'enveloppe d'un battement péremptoire.
Enclenchons la vitesse supérieure, un petit stroll juste pour le plaisir de voir au plus haut des jambes des danseuses et sur la demande de Billy, l'on accélère le tempo. Une dizaine de rockabilly enlevés à la baïonnette, un petit Cochran, un petit Gene Vincent, pour les rockers et en même temps mettre le public à genoux. Une chanson pour Carl et c'est la fin. Avec le rappel.
M'attendais au pire, avec cet auditoire France profonde et agreste. Tout le contraire. Des esprits ouverts que les Ol' Bry ont emballés en deux coups de cuillère à pot, avec leur répertoire habituel, leurs propres compos sans concession. L'on n'a jamais été aussi proche de ce que devait être un ball hillbilly dans les recoins perdus des Appalaches dans les années cinquante.
Superbe fin d'après-midi. Ne faudra pas oublier de recrucifier le Seigneur l'année prochaine, si l'on doit nous offrir un concert d'une même qualité.
Damie Chad.
MESMERISE / THE DISTANCE
THE CALLING / TROUBLE END / THANK YOU FOR NOTHING / MESMERISE / EMPHASISE.
Mike : guitares, chant / Sylvain : guitares / Duff : basse / Dagulard : batterie
NAB 1509. 2015.
Ironie du sort nous chroniquons ce CD alors que ce premier avril vient de sortir leur nouvel opus, Radio Bad Receiver, mais nous partons du principe que mieux vaut rock and roll stard que jamais.

The Calling : l'appel s'insinue dans vos oreilles venu de loin avant d'éclater dans les sombres cryptes des soubassements de votre boîte crânienne. Du plus profond des mystères aliénés, téléguidé par quelque force obscure inconnue, mais explose de près. Haute tension, un titre sans rémission. Les guitares hachent votre cervelet et votre bulbe rachidien n'est plus beau à voir. Contre-plongées de basse, vous ne ressortirez jamais du gouffre qui s'accumule sur vous. Trouble End : La fin arrive sans prévenir, une voix d'écorcheur, une guitare qui pleure des larmes de sang et les gourdins du combo qui vous paraplégisent. La fin est proche, mais le trouble est grand. Quelques coups de hache pour découper suivant les pointillés au cyanure. Thank You For Nothing : Ne dites pas merci, ce soir l'horreur est gratuite. Tout le plaisir est pour le groupe qui vous assassine. Ecoutez-moi la grâce de ces reprises en suspension, presque du menuet, avec tout de suite après la bastonnade. Ne l'oubliez jamais, la mort est une option de base. On vous le répètera jusqu'à la fin. L'on n'est pas pressé d'abréger la souffrance de vivre. Mesmerise : une espèce de polyphonie corse pour commencer. Mais au bout de cinq secondes, l'on réalise que l'île de beauté n'est pas prévue au programme. Galère de souvenirs sur mer d'irradiations chroniques. Si vous apercevez le soleil c'est que vous vous êtes trompé ou alors qu'il est noir comme le plus sombre de vos cauchemars. L'enfer n'a-t-il donc pas de fin ? Le pire c'est que l'on s'y complaît. Emphasise : Accélération épileptique, terreur dans les rues de Pompéi, trop tard en trente secondes les cendres du trépas ont tout recouvert. Silence de mort.
Squelette de biche gracieuse sur la couve noire et bébé Alister en photographie intérieure. C'est l'homme qui donne le sein. La musique de The Distance est pour les fils des âges farouches. Les nôtres que nous traversons dans la noirceur de l'absence de futur vers lequel nous nous dirigeons. Terre de désolation, grunge de granges abandonnées et stoner étonné de tant d'énergie accumulée.
Un chef d'oeuvre.
Damie Chad.
TRYPTYK ALBUM
( Vol 2 : WELCOME HOME )
JUNIOR RODRIGUEZ

TURN ON THE LIGHT / SILVERLAKE DRIVE / CACTUS SEED / BITE ME NOW / DALI WAS A LIAR / HEAVEN LIPS
Turn on the Light : l'abeille engluée dans le pot de miel, c'est vous. De la guitare comme s'il en pleuvait des cordes. Une tourmente de batterie qui aboie et la voix du maître qui s'en vient vous roucouler à l'oreille. Tout va bien, vous êtes mort. La grande modification, la vaste momification radicale peut commencer. Vous êtes sur les antennes échoïfiées du scarabée de l'immortalité, soleil liquide aveuglant. Buvez du blé blanc et mangez du blé rouge comme la petite reine Karomama de Milozs. Silverlake Drive : Les rayons d'or du soleil se reflètent sur l'argent du lac. Tempête sur les eaux. L'étrave de la guitare fend la mer des argonautes. Se joue de tous les monstres. Passe entre les tentacules du kraken. Joie profonde. Cactus Seed : Junior sème les graines de cactus comme des mines anti-personnels. A chacun de faire selon ses déchirures. Vous n'y échapperez pas, parfois cela porte aussi le nom de délivrance. Orgie finale de guitare. Bite me Now : l'amour est une morsure redoutable, mais au sortir de la nuit verrez-vous le soleil ? Rien n'est moins sûr et vous appelez les amis à votre rescousse. Opéra de guitares grondant comme des messages d'outre-tombe. Tout vous revient, l'expérience de la vie, mais oserez vous regarder la face cachée du soleil ? Dali was a Liar : blues cosmisque toutes les images sont trompeuses, mais elles trahissent votre mal-être. La guitare est partout. Comme la nuit qui vous enveloppe de son suaire de rédemption. Eclatement stellaire. Musique, univers en expansion. Heaven Lips : Sitôt la guitare qui sonne comme un sitar. Mais l'électricité reprend ses droits. La voix de Junior se traîne comme un serpent sur les pierres des pyramides. Une fois l'Apophis de nos terreurs harponné, quelle terre, quelles lèvres reste-t-il à pénétrer ? Les portes sont ouvertes et les anges au sabre de feu laissent la guitare de Junior Rodriguez remonter la piste perdue depuis des siècles.
Spirales noire qui tourne infiniment sur le fond blanc du CD, tracée d'une main maladroite comme celle d'un enfant. Spirale de feu orange sur la pochette, lunettes noires et troisième oeil ouvert tel le chakra de l'entrée des dieux, Junior Rodriguez vous accueille à bras tendus tel le larron du rock and roll - cloué sur l'originelle crossroad de Robert Johnson - qui ne croit qu'en sa guitare magique. Disque païen. Fête dionysiaque. Fulgurance apollinienne.
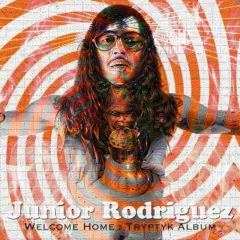
Si j'étais Jimmy Page, au lieu de nettoyer les vieilles bandes du Dirigeable, je produirais le futur album de Junior Rodriguez. Juste pour savoir la suite de l'histoire interrompue un peu trop tôt.
Damie Chad.
TONY VISCONTI
BOWIE, BOLAN
ET
LE GAMIN DE BROOKLLYN
( Editions Tournon / 2008 )
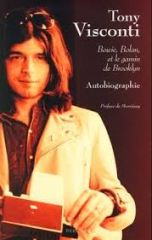
Quatre cent pages, deux cahiers photos ( noir / blanc et couleurs ), préface de Morrissey, traduction de Jerôme Soligny, tout neuf, le tout pour deux euros cinquante, pas la peine de s'en passer. Le début est passionnant, la deuxième partie un peu ennuyante. Pas Tony Visconti en lui-même. Le gars un peu discret, qui ne s'étend guère sur ses états d'âme, qui ne nous fait pas le coup de tempête sous un crâne, qui ne cherche pas à briller comme le soleil d'Austerlitz, à nous tenir au courant de ses turpitudes, même qu'il n'a qu'un gros défaut. N'aime que son boulot. En toute innocence, vous savez ces collègues de travail que vous invitez chez vous pour une soirée récréative et qui passent leur temps à déblatérer sur leur chef de service. L'est un peu comme cela le Tony Visconti, si vous rêvez de devenir producteur, ne lisez pas le bouquin, vous en ressortirez le rêve brisé à jamais. Et pourtant le début de l'histoire est fabuleux. Un petit américain que rien ne prédestinait à un telle gloire. Un véritable storyboard américain. Le gars qui bosse dur, qui ne se décourage jamais, et à qui s'offre une chance si inespérée qu'elle ne peut être que le signe d'élection du destin.
Un papa, une maman, un foyer stable, et un petit garçon qui on ne sait pourquoi est attiré par la musique. Peut-être l'origine italienne – tous des conducteurs de gondoles à s'égosiller sur Sole Mio – mais aussi un grand-père dont les frasques musicales de jeunesse ne sont pas sans rappeler Gus, le grand-papa de Keith Richards, toujours est-il qu'à sept ans l'est un pro de l'ukulélé, a appris tout seul à l'aide de la méthode colorée qui marchait avec, l'a déniché son répertoire en écoutant la radio comme Elvis et tous les autres l'ont fait avant lui. Ce qui est parfait puisqu'il est pré-ado ( l'est né en 1944 ) lors de la déferlante du rock and roll, Buddy Holly, Buddy Knox, Chuck Berry sont ses dieux. Qui seront vite détrônés par l'intransigeance de son prof de musique qui lui met le nez dans le solfège et lui fait jouer Jean Sébastien Bach à la guitare...
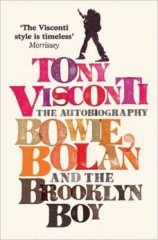
N'est pas idiot non plus, comprend que le rock and roll c'est la vie vivante et exaltante, mais que qu'il existe d'autres musiques qui exigent davantage de rigueur. Réalisera l'union des contraires. Assiste aux shows d'Alan Freed, y entend en live Fats Domino, Little Richard, Bo Diddley, Mickey Baker et quelques autres du même acabit. Au lycée l'est incorporé d'office dans l'orchestre de l'établissement, à la contrebasse, qu'il maîtrise facilement et du coup il s'aperçoit qu'il arrive à se débrouiller plus ou moins bien sur tout autre instrument. Le mec doué, mais les profs ne le lâchent pas, lire une partoche c'est bien, savoir en écrire une c'est mieux... Depuis l'âge de douze ans il gagne son argent de poche en participant à des combos des plus improbables, écoute du jazz, s'intéresse à Mingus, devient semi-pro, commence à tourner avec des orchestres plus sérieux, se passionne pour la photographie, arrive à décrocher de l'héroïne, à éviter l'armée, à trouver sa première véritable petite amie, à se marier avec, écoute les Beatles, se laisse pousser les cheveux, consomme du LSD, trouve du boulot en tant que songwriter chez TRO ( The Richmond Organization ), travaille dans les studios... L'aimerait bien devenir producteur, mais des petits gars comme lui, doit y en avoir dix mille rien que sur la côte est des USA... c'est alors que les dieux du hasard prennent les choses en main.

Se trouve nez à nez avec un type étrangement accoutré qui a tout l'air d'un étranger, en train de se servir un verre d'eau au distributeur automatique de TRO, bingo, c'est, incroyable mais vrai, c'est Denny Cordell, producteur des Moody Blues et de Georgie Fame ! Le swinging London in person ! En quelques mots Tony met Cordell au courant des moeurs des studios américains, s'il n'arrive pas avec une partition toute prête les musiciens vont faire durer la séance sur deux jours et au prix des heures de studio... et illico presto il lui torche un arrangement de cordes plutôt bien foutu. Cordell ne sait comment le remercier. Si, il lui demande de venir à Londres pour être son assistant...
AMERICAN BOY IN LONDON
Grosse déception. Télévision en noir et blanc, bouffe immangeable, loyers hors de prix, salaire au lance-pierre, Londres est encore une ville triste en 1967 comparée à l'insolente avance de la civilisation de l'Oncle Sam... La douche froide. Vaudrait mieux dire la baignoire froide. Parce que la douche les anglais ils ne connaissent pas, avoir une baignoire est un luxe, Visconti s'en apercevra au nombre d'amis qui viennent lui emprunter sa salle de bain, dont un certain Marc Bolan...
Visconti se lance à corps perdu dans le travail. Denny Cordell est plus qu'occupé, l'est en train de lancer un groupe qui ne restera pas longtemps inconnu, Procol Harum, alors le boulot pour le petit nouveau, ce sera le grand bain tout de suite, tu as vu pendant trois jours comment l'on place les overdubs sur une bande, alors justement, les Procol ont besoin de peaufiner un morceau, les voici, bonne chance. Délègue à mort le Cordell. Visconti s'improvise, psychologue, conseilleur, musicien, sorcier des pistes étroites, s'en sort plutôt bien et souvent au mieux. Cordell est content, David Platz – le patron celui qui tient les cordons de la bourse - un peu moins. Ce ne sont pas les compétences techniques de Visconti qu'il remet en cause, mais son huitième sens d'entrepreneur a détecté l'artiste qui songe davantage à la beauté qu'au rendement financier, nécessité de tenir l'énergumène à l'oeil.
TYRANOSAURUS

Cette bestiole Splatz il n'en veut pas. C'est mignon, c'est joli, mais cette musique de folkleux surévolué est trop précieuse pour accrocher le public. Du succès d'estime à la pelle. Pour les hippies regroupés autour de la revue IT, pas de problème, que John Lennon fasse savoir qu'il apprécie, c'est parfait, mais ce n'est pas avec le 45 tours qu'il n'achètera pas que Platz gagnera de l'argent... Visconti n'est pas d'accord. Bolan est un ami, se rejoignent souvent dans son appart et l'on passe des soirées à jammer sans fin... Tyranosaurus Rex, un potentiel certain. Voudrait bien leur faire faire un album. Platz refuse. Qu'à cela ne tienne. Il les enregistre en cachette. Platz ne met jamais les pieds dans les studios. Par contre les yeux dans les comptes à éplucher les bordereaux. A quoi correspond au juste cette séance ? Visconti avoue son méfait. Platz gronde mais ne licencie pas. Vous devinez la suite de l'histoire : l'album de Tyranosaurus ne se vend pas. Encouragé par son insuccès Visconti refait le coup de l'enregistrement pirate. Cette fois-ci, Platz se fâche tout rouge. Visconti échappe de peu à un remerciement en bonne et due forme. C'est Bolan qui change de maison de disques.
REX

Tony Visconti aura produit les quatre albums de Tyranosaurus Rex, de beaux bijoux mais ce qu'il voudrait c'est un hit, un gros, un énorme qui lui permette de voler de ses propres ailes. Mais ce n'est pas avec une musique aussi fine qu'il touchera le public des kids qui achètent des scuds qui remuent. Bolan en est arrivé aux mêmes conclusions, Mickey Finn son nouveau complice ne saurait que l'encourager vers une plus grande électrification. Le premier groupe de Bolan n'était-il pas d'ailleurs du genre guitares à fond la caisse ?

Depuis trois ans qu'il officie dans les studios Visconti a compris qu'il ne s'agit pas que de jouer à fond les manettes. Opère une transgression : mettre la subtilité au service de la force. Ce que George Martin a fait pour les Beatles cette déstructuration du son du vieux rock and roll des familles dans Sergent Pepper, lui il va le réaliser en sens inverse, restructuration des sonorités du vieux rock and roll. Oui à la décadence, non à la déliquescence. Le son sera glissant, l'invente le riff peau de banane, vous mettez l'oreille et vous êtes emporté dans un flip-flap avant monstrueux, vous pensez que dans cinq secondes vous retrouverez votre équilibre, erreur sur toute la ligne, sous l'épluchure perfidement disposée dans votre tympan il n'y a pas le macadam du beat rythmique qui avance en ligne droite mais une seconde enveloppe de musa acuminata banksii et c'est reparti pour un looping avant vertigineux, le Visconti vous empile les riffs les uns sur les autres, se marchent sur les pattes en se mordant férocement la queue, parfois pour que vous ne sachiez plus dans quel sens il faut écouter, il vous le repasse à l'envers – ce qui s'appelle tourner en bourrock – et comme on ne se refait pas, vous y colle comme en sourdine son truc préféré, un petit arrangement de cordes style quatuor classique passé à la moulinette. Ride a White Swann, les vols transparents du glacier qui n'ont pas fui du cygne de Mallarmé, c'est terminé. Fonte des glaces, réchauffement climatique, envol vers les pays chaud, brûlant, hot rocks.
T-Rex et Visconti vont nous pondre une série de merveilles : Hot Love, Get it Qn, Telegram Sam, Metal Guru, Jeepsteer, les hits caracolent en haut des charts, pour Marc Bolan c'est la gloire.
MARC BOLAN
Bolan est le roi. Le roi du glam. Les prédécesseurs, les suiveurs, aucun ne lui arrive à la cheville. Atomise la concurrence. La musique plusieurs crans au-dessus des autres. La sape encore plus. Un exhibitionniste né, l'androgyne platonicien reconstitué à lui tout seul. Tout lui sied, porte beau, porte belle, l'invente la robe hybride et relance la mode du chapeau haut-de-forme. Mais sous la coiffure, le melon grossit, mûrit, pourrit.

Bolan devient prisonnier de son personnage de rock star. S'éloigne de ses amis, de ses musiciens. Vertige de l'argent. Gagne des millions de livres qu'il dépense stupidement mais n'augmente pas d'un schilling ses musiciens, ne crédite pas les intervenants sur les pochettes – froissement d'égo et suppression de royalties – Visconti qui a quitté Platz pour suivre l'aventure T-Rex est obligé de signer un accord qui divise par deux ses attendus... Mais il y a pire, Bolan n'écoute pas, oublie de regarder que le monde évolue, que le public est attiré par des musiques un peu plus sophistiquées. La mode change, le travail de sape des critiques n'y est pas pour rien. Le raidissement de Bolan est compréhensible, le succès suscite la jalousie et qu'écrire sur un hit de Bolan ? : des guitares effrénées un riff répété à satiété, efficacité qui vous met la profession de musicologrocks en danger. Les portes se referment sans bruit autour de Bolan... C'est la brouille entre Marc et Tony. Une amitié qui s'effiloche. Pas d'esclandre, une séparation, deux chemins qui divergent. Bolan deviendra son propre producteur. Ses réalisations n''attireront plus les foules.
De 1970 à 1973 T-Rex est un bulldozer. En 1974 les carottes sont cuites. 1975 et 1976 Bolan n'occupe plus le devant de la scène médiatique. N'aura pas le temps de penser à sa prochaine métamorphose. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'avait pas tout dit. En 1977, la mort le cueille dans un accident de voiture. T-Rexit.
DAVID BOWIE

L'a commis une grosse erreur Mister Visconti, malgré toute l'attirance amicale qui le pousse vers David Bowie, en 1970 il refuse d'enregistrer Space Oddity sous prétexte que le morceau surfe sur la mode du premier pas de l'homme sur la lune. Regrettera plus tard d'avoir dédaigné le titre qui permettra la mise en orbite planétaire de David. Ce qui n'empêchera pas Bowie de lui demander d'enregistrer The Man Who Sold the World. Ce n'est qu'après le long intermède T-Rex que Bowie exprimera le désir de retravailler avec lui. Visconti a raté Ziggy Stardust mais il arrive à temps pour clore avec Diamond Dogs la partie la moins expérimentale de l'oeuvre bowienne. Sera derrière la console pour la trilogie berlinoise, Low, Heroes et Lodger.

La méthode de travail diffère de tout au tout de celle employée avec T-Rex. Avec le dinosaure, Visconti n'était pas très éloigné du Wall of Sound de Phil Spector, construisait un mur de gros parpaings, un béton spécial, mais rien de bien révolutionnaire, ne multipliait pas les micros mais les surimpressions sur les bandes. Avec Bowie, ce sera l'aventure. Bowie arrive avec deux ou trois riffs, même pas un titre, même pas une direction définie. L'on enregistre une première mouture de base que Visconti s'empresse de modifier quelque peu, en variant la hauteur d'une note par exemple, Bowie reprend le bébé et lui fait subir une subtile variation avant de repasser le marmot à son ami, qui s'empresse de rajouter, ou d'enlever, ou les deux à la fois, un ou plusieurs éléments, et c'est reparti pour un tour. Et ainsi pratiquement à l'infini. Bowie prend les ultimes décisions mais Visconti compose et harmonise à l'égal de Bowie. Cela prend des mois. Le travail studio devient titanesque. Visconti est à la pointe du progrès technique, le rock and roll devient une science sonore de décomposition et recomposition du son. Les deux hommes sont comme Baudelaire, ils cherchent du nouveau, inventent de nouvelles esthétiques. Bowie écrit les paroles en bout de course, et pose généralement sans difficulté avec une aisance surprenante sa voix sur la pâte sonore concoctée avec soin. Visconti lui octroie sans détour le rôle du démiurge créateur.

De Diamond Dogs à Scary Monters, de 1974 à 1980, Visconti produira huit albums de Bowie. Bowie est adorable, financièrement généreux, créditant sur ses pochettes les moindre interventions des participants à la réalisation du disque. Visconti le décrit comme son ami.
TONY VISCONTI
Qui le laissera treize ans sans nouvelle. Tony en souffre mais n'en pipe mot. Pratique les arts de combat, le bouddhisme, la médecine douce et l'ésotérisme... Le travail ne lui manque pas : accepte un peu tout ce qui se propose, besoin de rentabiliser son studio et nécessité de se tenir à la page, de ne pas se faire distancer par la nouvelle génération. Le palmarès final est impressionnant : Thin Lizzi, John Hiatt, Rick Wakeman, Boomtown Rats, Stranglers, Altered Images, Adam Ant, Moody Blues, Alarm, Hazel O' Connor, Prefab Sprout... l'on sent le tâcheron, l'homme qui vit sur sa réputation, l'artisan intègre... nous voici sur la partie la plus indigeste de l'ouvrage, Visconti parle moins de musique et cite beaucoup plus son matériel. Un parfait exemple du concept heiddegérien de l'arraisonnement de l'homme par la technique... Heureusement que Bowie revient. Le volume s'achève en 2007, mais notre homme sera encore là au final pour l'opus final, Blackstar l'étoile noire testamentaire du Thin White Duke.

Après 2000, Tony lève un peu la pédale – collabore tout de même avec Morrissey – fait un peu le point, évoque rapidement ses addictions à l'alcool, à divers produits, et peut-être à la plus terrible de toutes la musique qui l'a empêché de s'occuper comme il aurait dû de ses compagnes successives – notamment Mary Hopkin et May Pang ancienne fiancée de John Lennon – et de ses quatre enfants qu'il n'a jamais délaissés. L'est revenu aux USA après vingt deux ans passés en Angleterre et à courir des semaines entières dans tous les studios d'enregistrement de la planète rock.
Mais l'est un aspect très jouissif de cette autobiographie, notre homme ne se plaint jamais, assume tout ce qu'il a réalisé, et surtout est terriblement conscient de la chance qu'il a eue de côtoyer ses idoles. Réconfortant de sentir que ce magicien du multipiste, cet acteur important du rock anglais a gardé jusqu'au bout, non pas son innocence d'enfant, mais son âme de fan.
Damie Chad.
16:23 | Lien permanent | Commentaires (0)
30/03/2016
KR'TNT ! ¤ 275 : STEVIE WRIGHT / DISTANCE / ACCIDENT / JUNIOR RODRIGUEZ / JANINE / SAN FRANCISCO
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 275
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
31 / 03 / 2016
STEVIE WRIGHT + EASYBEATS
THE DISTANCE / THE ACCIDENT
JUNIOR RODRIGUEZ & THE EVIL THINGS
JANINE + WC 3 / SAN FRANCISCO
IT' S ALL WRIGHT !

Little Stevie Wright a cassé sa pipe avec une admirable discrétion. Pas de numéro spécial dans les kiosques, pas d’émissions à la télé, la classe totale ! Il est certain que les Easybeats appartenaient depuis longtemps au passé, et qui allait encore s’intéresser au chanteur d’un groupe préhistorique ?
Eh oui, il y a de cela 50 ans, les Easybeats arrivaient d’Australie pour rejoindre peloton de tête des prétendants au trône. Ils disposaient d’un potentiel qui leur permettait de rivaliser directement avec les Beatles.
On commettait tous la même erreur à l’époque en pensant que les Easybeats étaient australiens. En réalité, Stevie Wright était né à Leeds, Harry Vanda aux Pays-bas et George Young en Écosse. Leurs familles avaient émigré en Australie lorsqu’ils étaient jeunes et le groupe s’était formé down under.
Les Easybeats durent leur popularité au tandem Vanda & Young qu’on surnomma l’usine à tubes, mais avant que cette usine ne ponde des tubes planétaires comme «Friday On My Mind», «Pretty Girl» ou encore «Who’ll Be The One», George Young composait tous les hits du groupe avec Stevie Wright.

Fantastique album que ce «Easy» paru en 1965 ! Dès «I’m A Madman», on est frappé par la hargne de Stevie. Il chante comme Van Morrison et pose sa voix sur un tempo de valse à trois temps. C’est sacrément bien descendu à la cave avec du solo très étiolé. Plus loin, «I’m Gonna Tell Everybody» sonne plus poppy, très Hollies dans l’esprit, mais l’époque veut ça. Stevie revient au garage pur et dur avec l’excellent «Hey Girl» et se montre exceptionnel. On reste dans une certaine forme de sauvagerie avec «She’s So Fine» bien dégringolé à coups de basslines transversales. En B, on tombe aussitôt sur un «You Got It Off Me» solide, de belle allure, chanté à l’unisson, avec une certaine prestance de la constance. Il maîtrisaient déjà l’art du hit. On trouve plus loin «You’ll Come Back Again» monté sur un beat survolté et joué avec une sorte de sauvagerie bon enfant. Ils bouclent avec une dernière giclée de pur garage, «You Can’t Do That» : Stevie y chante le meilleur garage du monde.

Tout aussi frais et rose, voici «It’s 2 Easy» paru un an plus tard. Et là on tombe sur l’un des plus gros hits de l’époque, «Women (You Make Me Feel Alright)», la pop idéale zébrée par un beau solo d’Harry. C’est à ce moment-là que l’énergie des Easybeats entre dans la légende. Et tous les cuts qui suivent nous embarquent pour Cythère. Avec «Come And See Her», on a une belle pièce de pop évolutive et même extrêmement ambitieuse. On s’effare de l’incroyable vitalité des Easybeats. Encore de la jolie pop d’attaque frontale avec «I’ll Find Somebody To Take Your Place». On a sur cet album un mélange de genres tellement original qu’on pense bien sûr à l’Album Blanc des Beatles qui allait sortir un peu plus tard. Les Easybeats allaient absolument partout, dans toutes sortes de directions. S’ensuivait un «Some Way Somewhere» une extraordinaire pièce de pop têtue bien montée aux guitares et chantée par Harry. Retour à l’ambition faramineuse avec «Easy As Can Be». On continue de s’alarmer de ce foisonnement d’idées, au fil de morceaux qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. De l’autre côté, il tapent dans les Who pour «I Can See», chant perçant et beat nerveux, très moddish. Ils auraient pu ajouter for miles. Ils prennent plus loin «Something Wrong» au petit beat de circonstance. On pense là aux Pretties de SF Sorrow. Les Easybeats sont un groupe tout aussi magique, avec un chanteur doté d’un timbre distinct et dont le niveau composital renvoie directement à celui de Phil May. On croit rêver en entendant l’harmo et les chœurs. Ils nous font même le coup du Mersey beat avec «What About Our Love». On se croirait sur la rive du Mersey en 1963 ! Et voilà une petite compo de Vanda & Young : «Then I’ll Tell You Goodbye». Ça décolle dans la seconde, on sent le déclic du progrès harmonique, et le cut s’oriente directement sur l’avenir, avec une petite mélodie sous-jacente. Stevie referme la marche avec un «Wedding Ring» dévastateur, incroyablement agressif, écœurant d’énergie et de classe.

Le troisième album de cette trilogie légendaire s’appelle «Volume 3». On retrouve leur fantastique énergie avec «Sorry» joué à la cocotte sourde et de toute évidence pompé par Jethro Tull pour «Locomotive Breath». C’est exactement le même riff. Ils reviennent à l’énergie du Mersey beat avec «You Said That». Encore un cut délicieux qui fond dans la bouche, une power pop de rêve pointue et intemporelle. Tout est parfait dans ce cut, le riff récurrent, les chœurs et la bassline traversière. Ils re-sonnent comme les Pretties avec «Goin’ Out Of My Mind», Stevie chante avec l’esprit du fauve de cave qui guette sa proie, le rat, et on assiste à des montées de fièvre extraordinaires. On ne sent que ça, d’énormes possibilités. Le délire continue avec «Not In Love With You», un pulsatif de beat tendu et goinfré de chœurs superbes. De l’autre côté, ça s’essouffle un peu. Ils se tapent une Scottish lament avec «The Last Day Of May». Roy Wood aurait ajouté des cornemuses, c’est sûr. Et ils reviennent une dernière fois sur la rive du Mersey pour «What Do You Want Babe».
Grâce à ces trois albums, les Easybeats connurent la gloire en Australie. Ce fut la fameuse Easymania, un véritable fléau biblique. Les hordes de fans s’abattaient sur les hôtels et les salles de spectacle comme des nuées de sauterelles et rasaient tout. Obligés de vivre clandestinement pour protéger leurs biens et leurs proches, les Easybeats décidèrent de quitter l’Australie en 1967 pour aller s’installer en Angleterre. Et c’est là où, malgré les hits pré-cités, le groupe entama son déclin. À Londres, ils n’étaient plus qu’un groupe parmi tant d’autres. Et comme ceux qui jouaient du r&b et du garage, ils durent évoluer rapidement vers un son plus ambitieux. Vanda et Young se mirent à écouter des albums de soul et à composer des choses nettement plus ambitieuses, ce qui mit les trois autres très mal à l’aise : Dick Diamonde en bavait sur sa basse. Little Stevie était un excellent showman, mais les vocalises n’étaient pas son fort et Snowy s’épuisait à anticiper les relances de batterie. Petite cerise sur le gâteau, George Young et Harry Vanda demandèrent à Shel Talmy de les produire.

C’est sur «Good Friday» paru en 1967 qu’on retrouve «Friday On My Mind», l’hymne des mods working-class des hot nights du Swingin’ London. Sucré, rapide et juteux à souhait, c’était le hit idéal - I’ll lose my head tonite - En ce temps là, il est vrai qu’on sortait uniquement pour se défoncer. Stevie ne pense plus qu’à ça, il attend le vendredi to have fun in the city. Bowie avait bien compris la magie de ce cut. Avec cet album, les Easybeats prennent un tournant décisif : toutes les compos sont signées Vanda & Young. Sauf «River Deep Mountain High» dont ils lâchent une version redoutable, menée au trot par Stevie le râblé. Ils jettent tout leur génie de rockers dans la balance. Le seul qui parviendra à dépasser ça sera Chris Bailey avec les Saints. Et les voilà qui enchaînent les hits pop bardés de na-na-na-na et de aïe-aïe-aïe-aïe, «Saturday Night», hit ambitieux comme pas deux, suivi d’un paradis pop intitulé «You Me We Love», où ils font monter la sauce avec des chœurs ouvragés dignes des coupoles en or massif de Byzance. Encore un pur hit d’élan vital avec «Pretty Girl» et de l’autre côté on replonge aussi sec dans l’excellence «Happy Is The Man», une pop entrepreneuriale d’effervescence évidente, orienté vers la lumière comme le fameux tournesol du champ d’Auvers. Encore un hit absolu avec «Make You Feel Alright (Women)» annoncé par un riff d’intro et le mnnnn de Stevie. Mené à la baguette et descendu au refrain poppy des saperlipopettes, le tout doté d’un joli tatapoum de Snowy et d’un solo aigrelet d’Harry - Mnnn woman come along with me ! - Alors attention, car on passe à la magie pure avec «Who’ll Be The One». Tout éclate dans des boisseaux d’harmonies vocales et de chutes de refrains lancés au chat perché. On assiste là à de spectaculaires ascensions vers la lumière. Niveau harmonies vocales, ils sont aussi puissants que les Beatles, ça ne fait pas de doute. On revient à la belle pop acidulée avec «Remember Sam», joué à la guitare claire et dopé par un fil mélodique qui dans tous les cas ne laisse pas indifférent. Ils bouclent avec le fantastique «See Line Woman» joué aux percus du Gainsbarre de «Couleur Café». Les Easybeats y créent une fabuleuse ambiance négroïde de sorcellerie tribale. On y danse avec les esprits de la forêt profonde.

Les Easybeats enregistrèrent encore deux albums, avant la fin des haricots, «Vigil» et «Friends». Tout est signé Vanda & Young sur «Vigil». On ne trouve sur cet album que deux énormités, tout juste de quoi satisfaire les appétits. À commencer par «Good Times», avec sa fantastique dynamique de la cloche, un hit fondamental dans lequel on entend Stevie screamer au coin du bois et Nicky Hopkins faire couler des rivières de diamants. Mais les morceaux qui suivent semblent le plus souvent laborieux, très anglais dans l’approche. On se croirait chez les Hollies ou les Beatles, période cuivres fantaisistes, c’est-à-dire Sergent Pepper’s. Il est évident que ça ne pouvait pas plaire à Stevie. De l’autre côté, ils tapent une belle version groovy du «Hit The Road Jack» de Percy Mayfield, et Nicky Hopkins y refait des siennes. Stevie sauve l’album avec un «I Can’t Stand It» énorme, aussi énorme que les grands hits du Spencer Davis Group.

«Friends» est leur dernier album avant le split, en 1969. Il semble qu’avec ce disque ils soient arrivés au sommet de leur art, car le morceau titre qui ouvre le bal montre une ambition démesurée, par la qualité de chœurs qu’on dirait conçus pour des cérémonies religieuses, des chœurs tellement perchés qu’on s’en étonne, un côté épique qui fait bien sûr penser à l’opéra, mais pop. On retrouve l’éclat surnaturel des Easybeats dans «Watching The World (Go By)», un éclat dont on ne se lassera jamais. On se régale ensuite du «Can’t Find Love» craquant de gratte de guitare comme un gratin dauphinois et le chant entre tardivement dans ce pur jus de Vanda & Young. On sent qu’ils testent un nouveau rayon d’action avec tous ces morceaux et notamment «Holding On», un morceau qui s’emballe au prodigieux du propre et à l’élan du figuré. On se régale une fois de plus car c’est gorgé de dynamiques internes et pulsé par une bassline démente. Et là, surprise, voilà qu’ils envoient un «I Love Marie» digne des plus grands hits produits par Phil Spector. Quel spectaculaire rebondissement ! Stevie chante avec la hargne d’un Tom Jones. On retrouve une bassline fabuleuse dans «The Train Song», un cut qui sonne comme du Three Dog Night avec ses petits grattés de gratte funky et sa grosse bassline bien fournie. Ils finissent cette carrière météorique avec un véritable coup de Jarnac : «Woman You’re On My Mind». Stevie donne tout ce qu’il a, c’est un sacré bigorneau. Il va partout où il peut aller. Quelle atmosphère envoûtante ! On aura adoré les Easybeats pour ça. Ils auront su créer des espaces où il faisait bon s’installer pour danser jusqu’à l’aube.

Les fans des Easybeats sont tous aller fourrer leur museau dans une compile d’inédits intitulée «The Shame Just Drained» qui en plus flattait l’œil avec sa belle photo de pochette en fish-eye, dans la tradition des grandes pochettes anglaises des sixties («Have Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow» et la pochette anglaise d’«Are You Experienced ?»). On tombe très vite sur l’incroyable «Baby I’m A Comin’», garage pop que Stevie embarque à fière et même très fière allure. On trouve sur cet album des cuts produits par Shel Talmy et qui étaient restés sur le carreau. Incroyable mais vrai ! On retrouve plus loin dans «Peter» tout le foisonnement musicologique qui faisait la grandeur des Easybeats, cette fantastique propension à l’élévation harmonique. Encore de la puissance indiscutable avec «Me & My Machine» que George emmène au bal, un cut effarant d’aisance et vraiment lumineux. De l’autre côté se niche le morceau qui donne son titre à la compile et c’est encore une fois mélodiquement très ambitieux. Nos amis les Easybeats n’en finissent plus d’aller chercher le très haut de gamme des combinaisons harmoniques et forcément, on se prosterne. Stevie chauffe un peu plus loin cette grosse machine qu’est «Johnny No One». On sent chez lui une belle appétence pour la viande de shuffle. Puis l’aventure des Easybeats s’arrêta. Il ne nous restait plus que nos yeux pour pleurer.

Alors que Vanda & Young filaient vers le succès en tant que compositeurs de renom, Stevie chercha a monter des groupes pour redémarrer. Ses albums solo sont extrêmement difficiles à dénicher, mais ils valent largement le détour. On savait qu’il était l’un des grands chanteurs des Sixties, et l’écoute de ses disques solo ne fait que confirmer tout le bien qu’on pensait de lui. Il suffit par exemple de poser «Hard Road» (même titre que sa bio) sur la platine et on comprend immédiatement ce qui se passe. Stevie prend son boogie rock avec la niaque d’un Rod The Mod, et ça frôle parfois le Highway to Hell. Quelle énergie ! On est en plein dans le haut de gamme de ce qu’on appelle le boogie-rock anglais des seventies. C’est solide et gorgé d’énergie brute, pris à la tripe de chant. Il enfile les petits cuts comme des perles. Il adore le boogie et les trucs teigneux à la Steve Marriott. Il boucle sa face avec un «Didn’t I Take You Higher» admirablement mené au chant et on se régale d’un gros passage de percus, comme sur l’album d’Art (post-VIP’s et pré-Spooky Tooth). On sent que Stevie cherche encore le hit intemporel. La merveille des merveilles se trouve de l’autre côté : «Elvie». Voilà un cut en deux parties, véritable chef-d’œuvre composé par Vanda & Young. Stevie part un peu à la hurlette comme dans AC/DC, et on a même du gros solo gras, mais le cut évolue et semble filer comme un train à travers des pays imaginaires. On a là une belle suite progressive qui tourne à l’équipée passionnante, avec une succession de climats intensifs. Belle évolution captative ! On a une zone en balladif enchanté et la surprise se niche dans le lard de la deuxième partie d’Elvie. Stevie vire soul et même pounding de soul, sur un beat vainqueur. Édifiant ! C’est un hit fantastique ! On s’effare de tant de classe de la part de Vanda & Young. On a là l’une des meilleures combinaisons de l’histoire du rock, un équivalent de Bacharach/Warwick, de Greenwich/Spector, de Hayes/Sam & Dave, du très haut de gamme capable de faire des miracles. Et ça repart à la conquête du monde dans des gerbes d’excellence. On trouve une autre merveille sur cet album, «Didn’t I Take You Higher», un joli rock de tension permanente, bien serré dans ses sangles et on le voit monter doucement en puissance, une véritable merveille de grosse compo évolutive.
La règle d’or : quand on dispose d’un beau chanteur comme Stevie Wright, on se doit de lui composer de belles chansons.

Il existe un autre album solo de Stevie qui vaut le détour : «Black Eyed Bruiser». Le morceau titre reste très AC/DC dans l’esprit, car Stevie chante perché et derrière ça riffe sans vergogne. Il répète qu’il ne veut pas être le black-eyed bruiser. On le comprend. Autre gros cut, «The Loser», chanté au glam des faubourgs. Stevie s’y montre le rampant de service, digne des Heavy Metal Kids et de Gary Holton. Encore un joli cut avec «My Kind Of Music», joué au shuffle d’orgue et sous-tendu par un joli riff de basse joué en sourdine - I like to play all kinds of music - Il ajoute qu’il aime bien le devil’s corner. C’est dingue comme les gens savaient faire de bons albums en ce temps-là.
Mais Stevie va rencontrer l’héro et entamer une belle carrière de loser. Il va même faire les frais d’un traitement médical à base de sommeil intensif et un peu louche qui va lui démolir la cervelle. Stevie va en ressortir vivant, mais dans un état comparable à ceux de Syd Barrett, de Brian Wilson et de Roky Erickson, les trois autres éclopés de la légende du rock. Stevie passa de l’état de très beau mec à celui d’épave aux dents jaunes.
Signé : Cazengler, le Stevie Wrong de service
Stevie Wright. Disparu le 27 décembre 2015
Easybeats. Easy. Parlophone 1965
Easybeats. It’s 2 Easy. Parlophone 1966
Easybeats. Volume 3. Parlophone 1966
Easybeats. Good Friday. United Artist Records 1967
Easybeats. Vigil. United Artist Records 1968
Easybeats. Friends. Polydor 1969
Easybeats. The Shame Just Drained. Albert Productions 1977
Stevie Wright. Hard Road. Albert Productions 1974
Stevie Wright. Black-Eyed Bruiser. Albert Productions 1975
26 / 03 / 2016 – ROISSY-EN-BRIE
PUB ADK
THE DISTANCE / THE ACCIDENT
JUNIOR RODRIGUEZ
AND THE EVIL THINGS
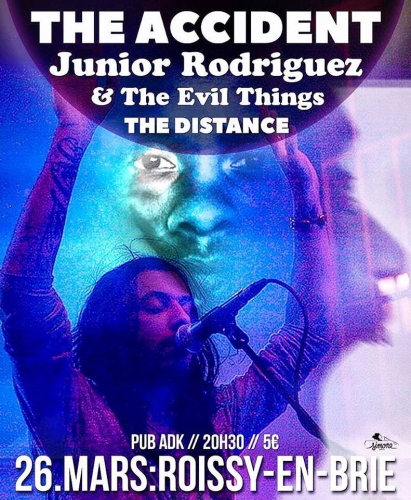
Faut suivre son instinct de rocker. Remarquez parfois le choix n'est pas cornélien. Ne se pose même pas. Junior Rodriguez à soixante-dix kilomètres avec annonce de pluie diluvienne pour le retour, ou alors, à dix neuf heures tapantes des invités avec petits gâteaux fourrés à la crème et rosbeef au four qui embaume la maison. L'est moins cinq, le temps de sauter dans la teuf-teuf et de s'arracher.
Bizarre, le parking est vide, les dernières fois que je suis venu l'était plein comme un oeuf... de Pâques. Doit y avoir du monde qui n'a pas pu s'évader. Les traditions familiales c'est comme le lichen, ça s'incruste partout. Perdu dans mes hautes pensées philosophiques, me trompe de porte et atterris... en Afrique. Des gosses qui s'amusent sagement, une centaine d'adultes qui discutent paisiblement autour de tables encore encombrées d'assiettes. Non ce ne sont pas des réfugiés arrivés par le dernier radeau qui prend l'eau ( vous savez ces gens qui souillent les plages du littoral grec avec les cadavres de leurs gamins ), mais une structure d'accueil, un havre de secours ( payant ) pour des familles qui ont du mal à trouver un logement. Comme par hasard tous des noirs ( comme dirait Donald Trump, doivent être génétiquement programmés pour le blues ). L'est désolant de voir comment la France anciennement Mère des Arts et Terre d'Asile se transforme aujourd'hui en territoire d'instabilité sociale et de précarité honteuse. Suis reçu avec sourire, gentillesse et dignité. L'on pousse même l'amabilité jusqu'à me raccompagner de l'autre côté du bâtiment, dans la cour de la Ferme d'Ayau qui abrite le Pub ADK.
Fermé ! Mon coeur arrête de battre. N'ayez crainte, l'en faut beaucoup plus pour tuer un rocker. Une dizaine de jeunes gens qui battent la semelle devant la porte me détrompent. Ouverture dans quelques minutes, l'on en profite pour évoquer Led Zeppelin, Elvin me parle du groupe The Accident, des amis à lui, qui assurent lourd. Genre de promesse qui me met en appétit. Me vend des craques, The Accident n'assure pas lourd, ils assurent très lourd. Mais procédons avec ordre et méthode.
THE DISTANCE
Surprise, surprise. Ce n'est pas la face A de Parachute Woman des Stones, c'est The Distance – pas stone mais plutôt stoner - le groupe qui était annoncé en tant que surprise guest sur le flyer Facebook du concert. Une bonne et même une des meilleures. Dagulard est relégué tout au fond derrière sa batterie. Sans cesse présent, cartonne ample sur ses drums et ne peut s'empêcher de reprendre les lyrics en sourdine... appuyée très fort, dans son micro. Peau de miel dorée et voix de bourdon. L'a intérêt à marquer sa place car devant les deux guitares fricotisent à bout de bras. Deux grands gaillards, Sylvain cheveux blonds viking et guitare drakkar qui fend les flots, Mike, anneau de pirate à l'oreille, guitare brise-glace et maître du micro. Duff est à la basse, s'en va souvent jouer, dos au public, face à Dagulard, manière de faire déborder la mayonnaise.
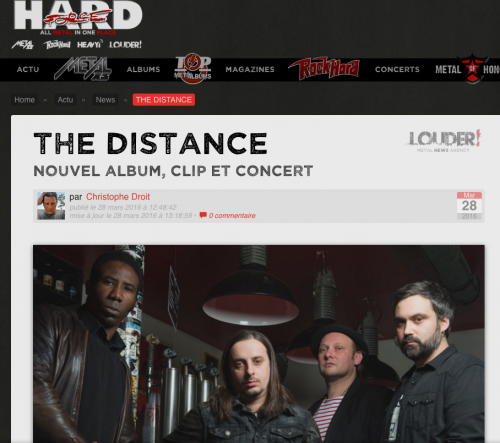
Jouent serrés, faut le temps que l'oreille s'habitue pour savoir qui fait quoi, le groupe est merveilleusement en place, totalement imbriqué, total instrumental, met en place un mur sonore qui s'avance sans cesse vers vous, implacable. Imsomnia ( sûr que l'on ne va pas s'endormir ! ) la fièvre des cauchemars vous étreint, Radio Bat, How Long Before, pas le temps de réaliser que c'est méchamment bon qu'avec Mesmerise et Unconscious Smile, l'on change d'étage, le son prend une autre dimension, plus appuyé, plus dense, jamais stérilement agressif, mais dans une urgence d'autant plus affolante que froidement contrôlée. Belles parties vocales de Mike, timbre écrasé comme du verre pilé quand il fait monter la pression et puis, plus haut c'est l'éclaircie après la folie, le rayon de soleil sur les champs de désastre.
Séparation des sexes dans le public, les garçons immobiles, scotchés, sérieux et attentifs et les filles, grand sourire extatique, qui dansent, l'une d'elles bras levé virant sur elle-même, gracieuse comme un cygne dans l'onde pure d'un poème de Stéphane Mallarmé. Doivent être insensibles à la poésie, car voici qu'ils en rajoutent une couche. Don't Try This – non, on n'essaiera pas, le réussissent trop bien – The Calling, aussi wild que le roman de London, mais brûlant, une flamme dévastatrice qui vous assèche les neurones. Définitivement. Trouble End, presque la fin, et c'est vrai que c'est la lutte finale, la musique qui flotte comme un étendard et Mike qui nous pulvérise avec ses lyrics à vous défenestrer de joie.

C'est la fin. Vous ne comprenez pas. Vous avez envie de rembobiner la cassette et de faire défiler de nouveau. Soudés comme pas un, compacts et tranchants. Ce n'est pas un concert, c'est une démonstration. Rien à reprocher. Faut entendre les clameurs d'approbation. Et puis quand ils commencent à ranger le matériel, les félicitations et les remerciements qui pleuvent. Des invités surprise comme cela à la maison, je ne pars pas.
THE ACCIDENT

Ne connaissais rien d'eux sauf les trois premières lignes du texte qui les annonçait sur FB : le groupe aurait été formé à la suite d'un accident de vélo – ce qui n'est guère courant, moi-même enfant étant passé sous une voiture avec ma bicyclette n'ai jamais éprouvé un tel désir – et Accident serait l'acronyme de Apte À Contre Carrer Idées Débiles Et Nazes Tonton. En plus ce serait du hip-hop. Je ne suis pas réticent ( mais à quatre-vingt dix neuf, oui ). Elvin m'a promis monts et merveilles, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Une première consolation, sur la scène s'agite le grand noir qui tout à l'heure s'est proposé pour annoncer la soirée et présenter The Distance. Aisance, décontraction et énergie en quelques mots.

Sont en place. Démarrent fort : deux constatations dans les quinze premières secondes : c'est du hip hop nitroglycériné, pouvez coller l'étiquette hard rock and roll sur le flacon, vous ne serez pas embêté par la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Chantent en français. Soyons sérieux, ils ont des choses à dire. Les minettes tringlées sur le siège arrière des décapotables, c'est résolument rock, mais quand on y réfléchit, notre société a aussi besoin d'autres lubrifiants. The Accident ne chante pas pour passer le temps. D'où les racines rap.

Patrick Biyick est au micro et à la guitare qu'il quitte souvent pour, tel un scalde, scander ses textes et laisser le sens du slam slalomer dans les bruits de colère des tambours. Ne quittera pas son K-Way rouge flamboyant, capuche sur la tête de toute la soirée. Nous crache pas au visage, partage nos frustrations. Nos vies en cage, nos quotidiens aseptisés, nos désirs normés, ce fachisme libéral douceâtre qui devient de plus coercitif ces dernières années, dédiera sous les applaudissements un morceau aux jeunes du Lycée Bergson qui sont allés caillasser un commisariat, n'a pas dit que la veille ils se sont faits brutaliser par la police, car les temps ne sont plus à l'apitoiement, mais à la riposte.
Musique violente et de rage. Et de jouissance. Les titres parlent d'eux même : Maintenant, Horrifice, Cri de Guerre, Pussy is good, Jusqu'ici tout va bien... les décline façon hardcore, façon rap slam avec derrière le combo qui booste comme des galériens sous les fouets de la chiourme. Un batteur fou au fond, un organiste présenté comme le guitariste de Linkin Park, un bassiste traité d'Egytien et un guitariste avec casquette et capuche sur la tête, un ensemble à première vue hétéroclite mais qui rocke à mort ou qui funke à fond. Se foutent des genres et des classifications. Sont musiciens pour renverser les barrières musicales. Mentales et physiques aussi. Sans céder à la facilité. Pas d'esquive, l'énergie en premier, des mots pour faire éclater les consciences et des notes pour que les corps se pâment.
Applaudissements nourris. Font l'unanimité. Elvin avait mille fois raison. Sont superbe. Une véritable découverte.
JUNIOR RODRIGUEZ
& THE EVIL THINGS

Les Choses Mauvaises. Laissez-moi rire. Ne vous laissez pas avoir. C'est le Mal en entier qui s'est installé sur la scène. Vous savez ce côté obscur de la force, cette chatoyance sans fin, ce miroitement infini qui vous fascine et vous attire irrésistiblement à lui. Junior Rodriguez and The Evil Things squattent la beauté du monde. Donnez-lui une guitare et votre vie s'agrandit. Nous en apportera la preuve lorsqu'au deuxième morceau, une corde cassera. S'emparera de celle que lui tend Accident, et continuera comme si de rien n'était. C'est bien le guitariste qui fait la guitare et pas le contraire. Question d'influx. La musique est avant tout une chose instinctivement mentale.
Les deux groupes précédents ont préparé la piste d'envol. C'est l'heure de se surpasser et de nous emmener en voyage. Beaucoup sont venus pour cela et l'on sent les frémissements du public. Même pas d'impatience. Embarquement immédiat. Dommage qu'il ne soit pas sans retour. Rêves et ouragances, musique d'oubli et sensitive, synesthésie de toutes les perceptions, des grésils de lumières flashantes vous enveloppent dans des linceuls de pourpre tyrienne et des splendeurs ultraviolettes. Il y a un guitariste fou qui s'avance sur le bord de la scène et qui lance des orages d'acier, Junior est derrière, en retrait au centre du plateau, magicien de la six-cordes, la voix qui se perd dans les haubans de la tempête et navigue sur les eaux tels les alcyons d'André Chénier qui pleurent le blues de la mort et l'éclat incandescent des fragrances idéelles.

A la fin du concert, chichiteront sans mélodramatiser sur le son qui à tel moment n'était pas, sur la guitare qui n'était pas, sur tout ce qui n'était pas... au top, nous n'y avons vu que du feu, brûlant volcanique, éruptif. Des perfectionnistes d'une humilité quasi-incompréhensible. Termineront sur Heaven Lips, tous ceux qui se demandent depuis trois décennies ce que la Lady qui ne croyait pas que tout ce qui brille soit en or allait faire en haut de son fameux Stairway to Heaven, la réponse est enfin donnée. Si vous redoutez les ambiances paradisiaques? Bite Me Now and Cactus Seed vous ménagent des descentes vertigineuses dans les escaliers des fournaises infernales. Junior et ses sbires vous offrent les anneaux de la volupté et la morsure du serpent. Plus les visions oniriques qui vont avec – méfiez vous Dali was a Liar, et les Chants d'innocence d'un William Blake sont aussi ceux des expériences les plus extrêmes. Turn on the Light et Sweet Demon pour synthétiser l'alliance des contraires.
Ne sont que quatre – batteur et bassiste qui fourbissent et fournissent l'appareillage audacieux de structures rythmiques, brisures et contre-brisures, élévations soudaines et dégringolade de dénivellements les plus abrupts. Et les guitares, l'on ne peut même pas parler de guitaristes car ils ne sont que des focales irradiantes d'ondes tour à tour maléfiques et apaisantes.

La voix de Junior qui ne rappelle en rien celle d'un Robert Plant, plus suavement épicée, emporte ailleurs, qu'elle morde ou caresse, elle infléchit la musique vers un noyau gravitationnel, originel, caravelle en partance vers les particules électriques de lointains tropiques mystérieux et emplis de périls. Les lèvres du paradis entrouvertes se referment. La technique fait signe qu'il se fait tard. Immense ovation.
RETOUR
Difficile de se quitter. Trois prestations de toute magnificence. Duff exprime la pensée commune – celle du public, de l'organisation, et du public – un triple concert tellement beautiful où chaque groupe s'est porté à son meilleur qu'il est dommage qu'ils ne puissent tout de go partir en tournée...
Me reste deux bricoles à rajouter : la route transformée en patinoire jusqu'à la maison ce qui est peu intéressant, et cette exclamation qui fuse « C'est un honneur ! » lorsque Junior remercie pour la guitare que le guitariste d'Accident vient de lui passer, ce fut aussi un honneur pour nous d'assister à un tel concert.
Damie Chad.
P.S. 1 : récupéré deux CD ( Distance et Evil Things ) que je chronique la semaine prochaine.
P.S. 2 : les photos des deux derniers groupes sont prises sur le FB de Fustin Do de la Nébuleuse d'Hima que nous retrouverons bientôt en spectacle.
JANINE
OLIVIER HODASAVA
( INCULTE / Janvier 2016 )

Etrange livre. Glauque à souhait. Sur la couverture ils ont ajouté la mention roman. L'on ne sait jamais. Peut-être ont-ils espéré que ça passerait mieux en tant qu'œuvre d'imagination. Mais le livre s'inscrirait davantage dans la section des documentaires. Et même si l'on veut être plus précis dans la série des enquêtes. Encore que le lecteur ne découvre rien de plus que ce qu'il savait déjà, ou que ce que la quatrième de couve lui aura révélé. Il est des murs qu'il est difficile de franchir. Celui du futur et celui de la mort, pour ne citer que deux culs-de-sac de la pensée. Vous vous en doutez, mes deux exemples ne sont pas pris au hasard. Nous avons pourtant droit à un témoin de première main. Un fan absolu. Nous pouvons lui faire confiance.

Au départ il s'agit de l'histoire d'un groupe de rock français. L'un des plus célèbres de cette génération que l'on surnomma les Jeunes Gens Modernes. Expression malheureuse. Rien ne se démode davantage que la modernité. A Trois dans les WC, un groupe, pour vous les situer, un peu dans la mouvance de Taxi Girl ( que j'abomine, mais là n'est pas la question ), mais provincial, du grand nord, pas la toundra boréale mais Saint-Quentin. Z'auraient pu rester des inconnus, mais leur appellation non contrôlée a dû soulever bien des phantasmes puisque très vite ils furent signé par CBS. Good deal, une major. L'a tout de même fallu qu'ils changeassent leur nom en WC 3 – moins graveleux pour les programmateurs frileux de nos radios nationales... Le succès ne fut pas au-rendez-vous, et CBS s'apprêtait à ne pas renouveler leur contrat après deux disques lorsque le groupe arrêta de lui-même les festivités. S'étaient formés à cinq, très vite ne furent plus que quatre, puis se retrouvèrent à trois, lorsque Janine, au sortir d'un concert décida de mettre fin à son existence en avalant volontairement une surdose de médicaments, le jeu à deux n'en valait plus la chandelle... Pour la musique, je vous laisse juge, vous trouverez sur You Tube une cinquantaine de titres à écouter, pour ceux qui voudraient creuser plus profond, ces dernières années ont vu quelques rééditions...

Olivier Hodasava fut un fan de la première heure. L'assista au dernier concert. Celui à la suite duquel Janine décida de franchir la frontière interdite... De quoi vous glacer le sang et l'âme. Ce n'est que trente ans plus tard, suite à la mort de son père, qu'il se sent capable de revenir sur l'énigmatique tragédie de la disparition volontaire de Janine. Remonte la pente. Explore toutes les cavités. Interroge les survivants. Essaie de circonscrire au plus près les circonstances du drame, amasse les documents... et finit par ne pas trouver grand chose...
Françoise n'est pas une beauté. Un peu boulotte. Elevée dans une famille de cathos coincée du cul, enfant sérieuse qui trouve son évasion dans la musique. Piano, orgue, premier prix du conservatoire, une voie royale se dessine, l'on imagine le rêve des parents. Patatras, l'enfant modèle se laisse séduire par la musique du diable. Si ce n'est pas l'amour du rock and roll qui la guide, nous diagnostiquerons le désir d'un joli pied de nez à Papa et Maman et leur vie trop étriquée pour une adolescente... Mal dans sa peau et silencieuse. C'est ainsi qu'aux premières semaines on la ressent dans le groupe. Mais les garçons ne font pas les difficiles, elle s'y entend trop en musique pour lui tenir rigueur de son air un peu rébarbatif... Surtout que les mois passant, elle finit non pas par s'amadouer mais par trouver sa place. Regards commisératifs de grande fille sur ces gamins insupportables mais attachants. Leur apprend le respect, la distance, petit sourire et légère dose d'ironie, elle ne s'en laisse point compter. Mine de rien, elle préserve son intimité et son mystère. Le papillon s'extrait de sa chrysalide. Janine est belle et attirante.
Le groupe est soudé, partage espoirs et galères. Sans doute y trouve-t-elle cette chaleur affective qui lui a été refusée pendant l'enfance. Finira même par sortir avec Jean-François. L'idylle durera quelques mois, mais les relations s'espaceront peu à peu. Pas de fâcherie. Une incompatibilité existentielle. Trop de silence de sa part qui excède l'empressement du garçon dérouté...
Le groupe possède sa base de repli : Saint-Quentin. Mais il arrive un jour où nécessité fait loi. C'est à Paris que se forge les grands destins. A la capitale, WC 3 ne se retrouve que pour les séances de répétition et de studio. Chacun assure sa survie économique dans son coin comme il peut. Janine ne peut pas grand chose. L'est remarquée dans le milieu pour ses compétences musicales, mais elle ne parviendra jamais à participer à un projet qui ferait décoller sa carrière professionnelle. Le groupe enregistre son ultime disque et décide de le défendre en tournée, vous connaissez la fin.
Le mystère reste entier. Mal-être qui remonte à l'enfance ? Dépendance à l'héroïne ? Déception, errance amoureuses ? Déviances ( nous sommes en 1984 ) homosexuelles ? Troubles bipolaires héréditaires ? Janine ne s'est jamais livrée, peut-être aussi l'auteur préfère-t-il taire, par respect envers la discrétion existentielle dont elle fit preuve, des éléments qui expliqueraient la trajectoire de la musicienne.
Ironie de la vie, Janine repose dans la sépulture familiale. Elle n'est plus qu'un nom, un surnom, un souvenir dont la présence en ce monde se dilue doucement... Le livre ne nous apprend rien. Il est le reflet exact de notre angoisse devant l'effacement progressif dont tout ce que nous aimons et nous-mêmes deviendront l'objet. La trame de nos jours n'appartient qu'à nous. L'histoire de WC 3, parfaitement racontée, ne saurait rendre compte de la vie d'un de ses membres. Pas très joyeux. Ni très optimiste. Olivier Hodasava a écrit un très beau livre, que les futurs lecteurs s'attendent davantage aux grandes orgues funèbres des sermons de Bossuet sur la mort, plutôt qu'à une monographie sur l'histoire du rock and roll. Même si c'est Janine qui tient les claviers. Marche funèbre.
Damie Chad.
SAN FRANCISCO
1965 – 1970. LES ANNEES PSYCHEDELIQUES
BARNEY HOSKYNS
( Castor Astral / 2006 )
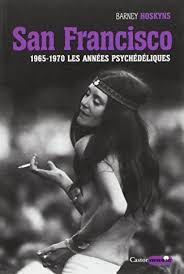
Le titre original Beaneath The Diamond Sky / Haight-Ashbury est beaucoup plus classe et plus précis. Pas question d'en faire une omelette aux regrets, c'est un cadeau – j'aurais choisi quelque chose de plus virulent dans la collection, mais je ne regrette pas ma lecture. A peine cent cinquante pages si vous enlevez la bibliographie et l'index, mais un topo d'une clarté et d'une limpidité absolues.
Barney Hoskyns est surtout connu de par chez nous pour son énorme livre sur Led Zeppelin paru chez Rivage Rouge en mai 2014, sous le titre de Gloire et Décadence du plus Grand Groupe du Monde, qui se présente comme un montage chronologique de plus de cinq cents pages de propos oraux tenus par les acteurs – qu'ils soient du premier ou du dernier cercle de l'aventure du Dirigeable. Fut aussi rédacteur à Mojo et au New Musical Express. Sa bibliographie est aussi longue que le pédigrée de la famille royale d'Angleterre. L'a apposé sa signature dans tous les grands titres de la presse anglo-saxonne mais depuis l'an de grâce 2000, il dirige le site en ligne Rock's Backpages qui archive plus de vingt-huit mille documents écrits sur la musique que l'on aime. A ma connaissance, ils n'ont pas encore archivé KR'TNT ! une erreur impardonnable, une tâche honteuse et indélébile dont leur réputation ne se relèvera pas.
SAN FRANCISCO
Si vous allez à San Francisco
Vous y verrez des gens que j'aime bien
Tous les hippies de San Francisco
Vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien
Une petite intro pour vous faire bondir de vos chaises. Non nous ne sommes pas en France, en 1967, avec Johnny Hallyday, mais à San Francisco, aux States en 1964. Pas très loin des pionniers quand on y pense, mais sur l'autre versant. Le rock and roll à la Elvis, c'est celui des pouilleux et des ignares. L'existe une autre musique, parallèle, serait-on tenté de dire, qui ne se mélange pas avec les torchons graisseux. Le folk. Ce n'est pas très différent du country, mais ça s'inscrit dans une autre tradition, celle du prolétariat en lutte. L'est écouté par les étudiants, des intellos qui commencent à lire Sur La Route de Kerouac paru en 1957, une jeunesse quelque peu contestataire qui se sent étouffée par le futur que leur réserve leurs parents...
Fallut une conjonction de plusieurs éléments pour que l'explosion eut lieu. Une ville : ce sera San Francisco : le soleil, les loyers modérés - notamment dans les quartiers de New Rose puis de Haight-Ashbury qui ont attiré au début des années soixante la première vague contestataire, la génération Beat, littérature, jazz, marginalité... Début soixante, toute une jeunesse issue de la petite-bourgeoisie se regroupe menant une indolente et innocente vie de bohème et de fumette... C'est alors que survient l'élément catalyseur qui va chambouler les esprits, au propre comme au figuré.
THE MERRY SPRANKERS
La bestiole délirante descend du bus. Celui des Merry Sprankers. Les joyeux drilles. Cornaqués par Ken Kesey. Un écrivain, l'auteur d' Vol au-dessus d'un Nid de Coucous, un aficionado de cette nouvelle substance communément appelé LSD. Pas une vulgaire drogue. Un additif spirituel qui vous débouche à la dynamite les portes de la perception de votre cerveau. L'expérience psychédélique par excellence. Une nouvelle philosophie de la vie. Accessible à tous. Suffit d'ouvrir la bouche et de recevoir l'hostie salvatrice.

Dans son bus ultra-colorié Ken Kesey parcourt les USA. Organise de mémorables soirées : avec musique et dégustation gratuite. Les Merry Sprankers hallucinent leur folk originel, de blues et puis de rock. Tout est bon pour faire monter la mayonnaise. C'est à San Francisco qu'ils recevront le meilleur accueil : toute une frange de jeunes oisifs qui ne demandent qu'à être convertis à la nouvelle religion lysergique. Autour de Ken Kesey gravitent bien des personnalités locales destinées à devenir célèbres : Jerry Garcia, John Cipollina, George Hunter, Paul Kanter... vous avez reconnu dans l'ordre d'apparition les premiers éléments appelés à fonder Gratefuu Dead, Quick Silver Messenger Service, Charlatans et Jefferson Air Plane...
1965
Toutes ces formations sont encore instables, les changements de personnel – fâcheries, divergences – seront fréquents, mais l'on peut parler d'une communauté musicale au sens large. L'important ce n'est ni la musique, ni le succès. Le plaisir d'être ensemble est primordial : ne donnent pas des concerts mais participent à des rencontres acidulées. Pas de coupures entre les musiciens et l'assistance. Une espèce d'expérience sensitive généralisée. Des moments de vie plus intense, les corps et les esprits s'ouvrent et s'interpénètrent. L'utopie réalisée. Mieux qu'en rêve. Eros et psychos !
1966

Un joyeux bordel organisé. Mais la nature a horreur du vide. Toute société humaine éprouve le besoin de perdurer. Et cette noble tâche de la survie collective débouche sur un problème d'institutionnalisation. Nos doux hippies ne cherchent pas à élaborer un code civil, ils ont seulement besoin de pérenniser l'organisation de leurs fêtes... Deux logiques vont s'affronter : celle de la rationalité froide portée par Bill Graham et ses fameux concerts au Filmore Auditorium, et celle générée par la seule lancée du mouvement lui-même qui sous l'égide de l'association Family Dog et de Chet Helms le petit copain de Janis Joplin réunissait à l'Avalon Ball les jusqu'au-boutistes des expérimentations lysergiques.

Une lutte sourde opposa les deux salles. Ce fut Bill Graham qui l'emporta. Sa victoire est de l'ordre du symbole : peu porté sur la consommations des produits, l'était frais comme un gardon dès le petit matin. Quand Chet Helms enfin remis de ses frasques de la veille se réveillait en début d'après midi, Graham avait déjà passé les coups de téléphone nécessaires à l'organisation de ses futurs concerts. Graham ne travaillait pas pour l'amour de l'art ou de la cause, mais pour gagner de l'argent. Ses ennemis reconnaissaient toutefois qu'il offrait au public des plateaux de qualité.
A l'opposé du pragmatisme grahamiste, les Diggers ( voir in KR'TNT ! 116 du 01 / 11 / 2012 notre recension de Ringolevio l'autobiographie d'Emmett Grogan ) organisaient des concerts gratuits et distribuaient de la bouffe gratuitement et essayaient de mettre sur pied des magasins libres...
1967

L'été de l'amour fut celui de la résolution de toutes les contradictions. Si les Charlatans ratèrent leur coup, Gratefull, Jefferson et Messenger Service, avaient pris de l'importance. Le mouvement prenait de l'ampleur et se mesurait au reste du monde. Y eut une première cassure idéologique suscitée par les mouvements des étudiants de Berkeley. Hippies et rads ( entendez radicaux politisés ) ne vibraient pas sur les mêmes longueurs d'ondes. Les seconds manifestaient pour abattre la société fachisante, et les premiers se contentaient de vivre dans leurs espaces de liberté conquise... Les milliers de jeunes adolescents fugueurs qui alertés par les médias se ruèrent vers l'Eldorado de San Francisco, ne furent pas les seuls à s'intéresser à cette nouvelle poule aux oeufs d'or. Le danger vint de la soeur ennemie. La ville de Los Angeles, bardée d'hommes d'affaire et de représentants du show-bizz. Le piège fut parfaitement tendu. Très agréable. L'organisation d'un festival hippie avec les Who, Jimmy Hendrix et Otis Redding. Bien entendu la scène de Monterey était ouverte pour les têtes d'affiche de Frisco. Difficile de résister aux sirènes lorsque l'on s'appelle Jefferson Airplane ou Janis Joplin and the Holding Compagny, Country Joe and the Fish, Steve Miller Band, Moby Grape, Quick Messenger Service... La pomme s'était précipitée vers les vers. Dans les majors l'on sortait déjà les carnets de chèques...
1968
Les groupes maison de Frisco tournaient désormais dans tous les States. Les anciens camarades se sont transformés en rock and roll stars. Mais la réalité rattrapait maintenant nos utopistes sans lendemain. Engluée au Vietnam, l'armée avait besoin de chair fraîche, plus question de gober son acide pépère dans son coin, fallait se mobiliser et organiser les filières d'expatriation au Canada pour les réfractaires à cette conscription de plus en plus entreprenante... Nos hippies eurent de surcroît à subir les critiques de la communauté noire qui leur reprochait leur absence dans la lutte pour les droits civiques... Le rêve se lézardait de partout...
1969
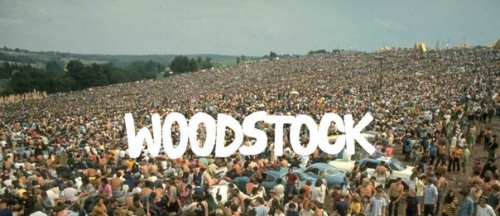
Le pire était à venir. Coup double. Face claire et face sombre. Pluie et sang. Woodstock fut le chant du cygne. Cinq cent mille jeunes vautrés dans la boue, hébétés par toute sortes de produits, un beau film, une catastrophe moutonnière. La mode hippie. La pré-industrialisation galopante. La victoire du renoncement. Mais ce n'était que la brise qui annonce la tempête. Partaient d'un bon sentiment. Les Rolling offraient un concert gratuit. Le Gratefull Dead leur indiqut un service d'ordre dont ils n'ont jamais eu à se plaindre, les Hell Angels d'Oakland. Pas plus gentils que ces bikers ! Barney Hoskyns ne jette la stone à personne, nous explique que les différents clans des Angels étaient en guerre quant au contrôle des ventes de stupéfiants sur la Californie, réglèrent-ils leur différent en s'en prenant aux innocents spectateurs ? La boue et la pluie à Woodstock, la mort et le sang à Atlamont... Le rêve agonise.
1970
The end. Les fugueurs qui ne sont pas retournés chez leurs parents s'adonnent aux drogues et à la prostitution. L'acide n'est plus ce qu'il était. Le monde change. L'on a trouvé mieux. L'héroïne. L'acide vous déglinguait les neurones, l'héro vous chavire le sang. Dureté des temps. Il pousse de plus en plus de tombes dans les cimetières. Le rock est devenue une industrie. La musique ne libère plus. Elle vous endort. Elle vous assomme. Votre existence s'azombie, vous êtes l'addict de votre propre consommation. Rock ou héroïne, quelle différence ?
Un livre qui fait réfléchir. Qui remue le couteau dans l'espoir d'une vie vouée au rock and roll.
Des dizaines de noms, de nombreuses pistes de recherche. Une époque foisonnante, plus audacieuse que la nôtre. A lire pour tous ceux qui n'étaient pas nés et qui ont du mal à se représenter une si folle effulgence.
Damie Chad.