15/11/2017
KR'TNT ! 348 : STOOGES / BARNY AND THE RHYTHM ALL STARS / ROCKABILLY GENERATION / VINCE TAYLOR / FRANCOIS REICHENBACH / JOHNNY HALLYDAY / MOUSTIQUE
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 348
A ROCKLIT PRODUCTION
16 / 11 / 2017
|
STOOGES / BARNY & THE RHYTHM ALL STARS ROCKABILLY GENERATION / VINCE TAYLOR FRANCOIS REICHENBACH / JOHNNY HALLYDAY MOUSTIQUE |
TEXTE + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Stoog by me - Part Two
Allons bon, encore un livre sur les Stooges ! On le sort de l’étagère. Il pèse une tonne, avec de la bonne vieille stoogerie à toutes les pages. On le feuillette et on le repose. On ne regarde même pas le prix. Vu le look du book, il coûte forcément une fortune. C’est vrai, Memphis Soul coûtait aussi une petite fortune, et on ne l’avait pas regretté. Oh et puis fuck it ! Allons fouiner ailleurs. Tiens, par exemple au rayon presse. Ah tous ces magazines de rock qui te tendent les bras en criant : «Prends-moi ! Prends-moi !». Quelle débauche d’images ! On se croirait devant les vitrines du quartier chaud à Amsterdam. On prend vite le large et comme le destin fait bien son boulot, on repasse devant la fameuse étagère, et hop, on met machinalement le grappin sur le book des Stooges, histoire de lester la cale du brigantin.
Le book s’appelle Total Chaos. Joli titre. Couverture parfaite. Quand on l’examine, deux choses frappent immédiatement. Un, la photo d’Iggy est à l’envers, le voilà accroché au plafond comme une chauve-souris. Deux, il dégage quelque chose d’à la fois cadavérique et christique. La peau sur les os, la bouche ouverte, un torse qui sort de l’ombre comme s’il ressortait vivant d’une tombe, un collier de chien remplace la couronne d’épines, ceci est mon sang, kiss my blood, par le sacrifice de mon corps, je rachète cash tous vos péchés, ceci est ma dope, I’ve been dirt, mais comme on est à Detroit et non en Palestine, Iggy s’empresse d’ajouter I don’t care, c’est-à-dire qu’il s’accorde un passe-droit, l’accès direct à l’amoralité, l’état de l’homme sans qualité, bien avant Robert Musil et tout le bordel des religions, bien avant que ne plane sur les cervelles en surchauffe l’ombre de Mircea Eliade, et on se prend à rêver d’une église moderne, avec ce livre posé debout sur l’autel et l’immense foule du dimanche matin qui psalmodierait «No fun, my babe no fun», à la suite de quoi le prêtre lancerait d’une voix forte et douce : «No fun to be alone», alors la foule répondrait «Walking all by myself», et le prêtre lèverait les bras au ciel puis il relancerait la ferveur des fidèles en clamant une nouvelle fois «No fun to be alone», et bien sûr, la foule ferait trembler les colonnes de la nef en tonnant «In love with nobody else !».
Dans sa préface, Jeff Gold nous explique qu’il a rassemblé 100 docs des Stooges et qu’il est allé voir Iggy chez lui à Miami. Car à la différence des autres livres consacrés aux Stooges, c’est Iggy qui mène le bal de celui-ci, et comme il fait partie des hommes les plus intelligents de cette terre, on entre un peu dans ce livre comme Fernandel dans la Caverne d’Ali-Baba. C’est bardé de citations de choc. Iggy s’exprime comme un messie : «Je ne voulais pas faire un break total avec la musique d’alors, je ne voulais pas me faire passer pour un musicien, je voulais seulement faire quelque chose de complètement nouveau. Comment ? The answer is it was done with drugs, attitude, youth, and a record collection.» On a là une définition parfaite du rock qu’on aime bien.
On passe les épisodes Iguanas et Prime Movers qu’Iggy drum drum boy commente dans le détail - il se montre effarant de précision - et on finit par tomber sur la genèse des Stooges. Iggy raconte que Scott Asheton le harcelait pour qu’il lui apprenne à jouer de la batterie - He was just a beautiful kid who looked athletic and would stare at me and say ‘Would you teach me to play some drums ?’ - Iggy va répéter chez les frères Asheton. Il doit commencer par les réveiller, car ils ne se lèvent pas de bonne heure, puis il leur fait fumer un joint, car les frères Asheton ne répètent pas s’ils ne sont pas stoned. Alors voilà les early Stooges : Ron (bass), Scott (drums) et Iggy (keyboard). Ça donne Iggy + Ron the weird guy + Scott de stoned punk - That’s very accurate - Et puis Iggy comprend que Ron doit jouer de la guitare, et non de la basse. Et tout part de là, pendant une répète informelle - Ron jouait un riff hendrixien, bam bam, baa, de, doot-doot, daa, de, doot-doot, doo, exactly how it went - et Iggy se met à danser comme un Chiricahua, à faire le con. Le plus tordant de cette histoire, c’est la remarque de John Cale qui produit leur premier album. Il lance à Iggy : «They don’t play good unless you jump around», alors Iggy saute partout dans le studio pendant que les trois autres Stooges enregistrent les cuts de leur premier album. Iggy fait les voix dans un deuxième temps. Ça s’appelle la naissance d’un mythe. Dans une histoire comme celle des Stooges, le moindre détail revêt une importance considérable.
Les Stooges ? Au tout début, Ron n’y croit pas trop. Quant à Scott, il ne dit rien. Ni oui, ni non - He was always ready to drum if you could get him out of bed - Par contre, Iggy n’en finit plus d’y croire - We can do this ! - Il devient la loco des Stooges. Et paf ça part ! On tombe soudain sur une photo des Stooges dressés dans un champ de maïs. Double page. Direct en pleine poire. Iggy commente l’image en disant que les Stooges ressemblent à Nirvana, sauf que c’est en 1968, it’s the whole ethic, and not just the clothes but the whole attitude you know ? And the music - the music, the Asheton brothers - those two wonderful people lived their whole lives in a trance - Iggy fait l’apologie de la transe, bande-son de l’amoralité.
Il brosse un stupéfiant portrait de Dave Alexander, ce petit mec qui souffre de problèmes de peau, qui boit parce qu’il n’arrive pas à baiser une seule gonzesse à cause de sa mauvaise peau, un petit mec qui adore Love, alors que Ron ne jure que par Jimi Hendrix et les Pretty Things - You could really hear that in the bass playing on Raw Power - Iggy ajoute que John Stax did wonderful walking bass lines. Iggy leur fait aussi écouter le Velvet, évidemment. Ils adorent aussi Stones, bien sûr. Plus tard, Scott ira plus sur Funkadelic, des blacks qui sont aussi à Detroit, ils les connaissent bien. De son côté, Iggy raffole de Jim Morrison et des Doors, et du MC5. Mais surtout de James Brown : il entend un jour «Papa’s Got A Brand New Bag» à la radio - Holy shit what the fuck is this ? - c’est ce qu’il veut faire dans Fun House - A little bit urban blues but a lot of James Brown in there - Et quand Iggy voit Jim Morrison faire n’importe quoi sur scène and still look great doing it, il comprend que ce type de bordel est à sa portée.
Toutes les légendes se construisent à partir de menues broutilles, que ce soit en Palestine ou a Detroit, et les concours de circonstances historico-sociologiques font le reste du boulot. Tu marches dans le désert et tu wanna be your dog, tu marches sur l’eau et tu call mom on the telephone, tu reviens d’entre les morts et tu don’t care, tu portes le poids du monde et tu gonna have a real cool time, tout est dans tout, rien n’est dans rien, ainsi va cette vie dont nous ne savons finalement pas grand chose et qui va s’achever avant même que nous ayons compris quoi que ce soit. À peine le temps de danser le jerk des Stooges, et on replonge dans le néant dont on vient.
Pourvu qu’on ait le temps de finir la lecture de ce livre palpitant ! On a beau connaître l’histoire par cœur, on s’y replonge, car Iggy parle et son timbre résonne. On l’a souvent dit ici et là, c’est le meilleur pote qu’on ait jamais eu, le seul en qui on peut avoir une totale confiance. Pas besoin de l’avoir rencontré. Sa seule présence suffit. Pourvu qu’il tienne encore un peu. On se souvient du départ de Gainsbarre. Celui d’Iggy serait encore plus douloureux.
Voilà que les Stooges entrent dans le godlike corporate world du show-business : Danny Fields les repère et les recommande à Jac Holzman d’Elektra qui se déplace en personne pour venir écouter trois chansons. Tope-là ! Il signe le groupe pour 5.000 $, et profite de son séjour à Detroit pour signer en plus le MC5 (15.000 $). Fabuleuse anecdote d’achats en gros. Sacré Jac, il fait une bonne affaire, à ce prix-là. Iggy trouve Jac intelligent, alors ça se passe bien. Les Stooges ont du blé, ils trouvent une bicoque sur Packard Road et la baptisent The Stooges Manor, ou Fun House, c’est comme on veut. Et paf, Ron comes up with two riffs that you could start staking a career on. I knew that at the time when I heard «Dog» and «Fun» - Oui, c’est Ron qui s’y colle, car Iggy est trop camé. Ron sort les deux riffs clés des Stooges, ceux de Wanna Be Your Dog et No Fun. Tout va ensuite très vite. Les voilà à New York en studio pour enregistrer leur premier album. Iggy profite de l’occasion pour rappeler qu’il règne une ambiance stoogy dans le studio : John Cale porte une cape de Dracula et Nico tricote - And the two of them it was really like the Munsters - Ça ne te rappelle rien ? Oui, c’est la même histoire que celle de l’enregistrement du premier album des Cramps à Memphis, dont se souvient Tav Falco - The Cramps approached studio recording as if it were a wild live show. Their antics in the studio were astonishing (Les Cramps jouaient en studio comme ils jouaient sur scène, avec la même sauvagerie. Les séances d’enregistrement furent spectaculaires) - Iggy précise un point fondamental : on fait un meilleur album avec un producteur qui est une personnalité plutôt qu’avec un technicien. Parmi les applications de ce théorème, on trouve Andy Warhol (Velvet), Nick Lowe (Damned), David Bowie (Lust For Life et The Idiot) et bien sûr Jim Dickinson.
Alors forcément, quand on traîne du côté de la Palestine, on finit par tomber sur les pharaons. Quand il ne répète pas, Iggy va fouiner dans les livres d’art de la bibliothèque du coin. Le look des pharaons le fascine - The paraohs with no shirts and I thought ‘It just looks so classic !’ - Et pouf, le voilà torse nu sur scène. Il faut savoir se donner les moyens de sa stoogerie. Mais Iggy connaît aussi le Living Theatre, Nam June Park et John Cage, il est loin d’être l’abruti que l’on croit. Il sent germer les idées en lui, il sait qu’il va bientôt marcher sur les mains des fidèles. Ses apôtres Saint-Ron, Saint-Dave et Saint-Scott se gavent de came. Les Stooges écument les États-Unis d’Amérique et dix ans après Elvis, ils rallument tous les brasiers et réinventent le rock.
L’histoire s’emballe. Ils enregistrent Fun House à Los Angeles avec Don Galucci, et donc ils tournent, tournent, tournent, ils deviennent énormes - We were shit hot - Iggy prend de tout, coke, speed, LSD, héro - I would use that heroin to calm me down - et il devient accro - I became a complete drug maniac on and off from late 1970 through the end of ‘74 - et quand Saint-Dave commence à merdouiller sur scène, Iggy le vire comme un malpropre. C’est là que l’alchimie des Stooges se casse la gueule dans les escaliers - When you change a thing in a group like that, it destabilizes everything - Joe Strummer disait exactement la même chose après avoir viré Topper Headon. Les Stooges entament leur déclin, alors qu’ils sont partout dans la presse. Iggy tente de colmater les fuites dans la cale, il engage le dark Williamson, ce sale mec qu’on voit dans une spectaculaire photo des Stooges, assis par terre en slibard noir et en bottes. Il est encore plus stoogy qu’Iggy. Il a même une hépatite A - I’m sick man, don’t bother me - Iggy ne l’aime pas, mais Williamson lui montre des riffs, comme celui de «Penetration» - It had this moody violent vibe - Qu’en pense Iggy ? Ça lui va - We have syncopation a la Fun House, but more sophisticated - Iggy tente de sauver les Stooges car il sait qu’il a le meilleur groupe de rock d’Amérique. Alors direction l’Angleterre. Iggy et ce Williamson, un vautour qui déteste tout et tout le monde, Bowie, les Anglais, tout - Is James malovelent ? I think so - Iggy le sait malveillant. Pas d’auditions à Londres comme on l’a raconté partout, à l’époque, Williamson propose d’appeler Saint-Scott. Iggy rétorque : Saint-Scott ne vient pas sans Saint-Ron. Bon alors okay. Oh la belle ambiance ! - Ron hated me and hated James, but not openly. Scott hated James and hated Ron sometimes in like a brotherly way - Et voilà que le street walking cheetah with a heart full of napalm écume Hyde Park, Iggy porte ces silver-leather pants et ce blouson Cheetah acheté au Kensington Market et il marche, marche, marche pour travailler ses idées - So that was the idea and the I’d always liked the song ‘Heart Full Of Soul’ by the Yardbirds - Et il n’en finit plus d’aimer la vie, le lust de la vie - I actually enjoy food, sex, intoxication, travel and freedom - Et tous ses ennuis, ajoute-t-il, viennent justement de ce mighty lust for life - Which is what I sing about - Il fait de cette fantastique amoralité un fonds de commerce, mais attention, c’est un fonds de commerce stoogien, unique au monde. La cohérence de son goût pour l’amoralité peut faire peur, mais il finit par l’imposer, aussi vrai que le diable règne sur cette terre et que les Stooges sonnent comme la plus grande preuve de l’existence d’un dieu des drogues, on appelle ça le Raw Power, et la presse saute dans le train en marche et s’empresse de titrer «Punk messiah of the teenage wasteland», pas mal, n’est-ce pas ? Mais les Stooges vont mourir - too much drugs, the end of it all - avant de renaître glorieusement. Alors, partout dans le monde, les foules vont aller se prosterner aux pieds des Stooges revenus d’entre les morts.
Signé : Cazengler, Stoobidoo bidoo bidoo ahh
Jeff Gold. Total Chaos. The Story Of The Stooges/As Told By Iggy Pop. Third Man Books 2016
Encore une chose : quand on pose la question à Iggy : «Que doit-on retenir de l’histoire des Stooges ?», il répond ceci qui est le mot de la fin : «Well, I think it’s the eyes of a kid looking at the world» (C’est le regard d’un gamin sur le monde). «That’s what I would say. The feel of the group emanates from looking at everything from a childish perspective» (L’essence du groupe émane d’une vision enfantine du monde). «That’s what I would say. There are good things and bad things to come from that.»
11 / 11 / 2017 – TROYES
LE 3 B
BARNY & THE RHYTHM ALL STARS
Paris-Troyes d'une seule traite. J'arrive juste à temps pour la balance de Barny & The Rhythm All Stars. Sont tatillons les gars, ne laissent rien au hasard. Démarrent au quart de tour, splendide sans se forcer, mais chinoisent, coupent les pousses de bambou en quatre comme Lao-Tseu sur le sentier infinitésimal du Tao, apparemment une mesure en rupture de ban dont l'absence ne se profile guère dans mon oreille. Ce qui est marrant c'est qu'ils semblent y prendre un plaisir fou. Ce qui est précis est précieux affirmait Paul Valéry, certes mais pour les rockers c'est encore mieux quand s'y mêle une pointe de sauvagerie... En tout cas, un excellent hors d'œuvre avant le concert, eux ils auront en prime la raclette que dame Béatrice leur a mitonnée...
CONCERT
Pour des sauvages, commencent doucement, Barny collé au fond devant le rideau noir – une nouveauté – immobile, et le band qui entre sans se presser dans le riff de Claude Placet, monte systématiquement d'un demi-cran toutes les cinq secondes, avec cette régularité inquiétante de l'océan imperturbable qui grignote peu à peu les îlots sableux du Pacifique, mais eux ils vont plus vite, sont patients mais point trop, et dès avant la submersion finale, Barny surgit devant le micro, jeune et sauvage. L'est beau Barny, avec ses yeux noirs pleins de fougue et de gravité, la bandoulière de sa guitare à son nom incrusté de perles, et sa voix de foudre qui se pose en gerbe de feu tel l'alcyon sur les eaux tempétueuses. N'a pas fini son deuxième morceau que déjà une corde désemparée vole au vent. Rien de grave. N'en continue pas moins de frapper son instrument avec cette hargne méthodique et enivrante des outlaws qui mettent le feu à la prairie juste pour précipiter les cavalcades des tribus indiennes. Nous refera le même coup au troisième set, mais ne prendra même pas la peine de changer d'instrument, pas de souci à se faire avec les trois autres pistoleros à ses côtés.
Fred est à la contrebasse. Tout contre. L'est droit comme un I, cheveux peignés en arrière, l'a le look de ces serveurs de casino stylés dans les films d'espionnages, de ceux qui vous ramassent sur les tapis verts d'un coup élégant de raclette des milliers de dollars avec cette indifférence dégoûtée des philosophes revenus de toutes les turpitudes humaines, et qui se révèlent dès la première scène d'action la plus fine gâchette de la pellicule. Le croupier est amateur de belle croupe. Connaît la valeur des jetons ronds et des féminines rondeurs. Tient sa big mama fermement, dans sa jupe de bois cirée comme un cercueil, debout, plantée comme un arbre raide comme la justice, balancier immobile, axis mundi de la régularité temporelle. Visage imperturbable et main infiniment baladeuse sur le corsage du cordage. A peine la penche-t-il légèrement que sa volute vous surplombe comme tête menaçante de drakkar effilé qui remonte les fleuves à la recherche d'un village à piller et à incendier. Le rockab est une musique de prédateurs. La contrebasse est tour à tour moutonnement régulier des vagues, ou mouette rieuse qui rase les flots déchainées ivre de vent et de tempêté, la blanche Leucothéa qui s'en vient porter secours à Ulysse sur son radeau disloqué par les coups de boutoirs des lames neptuniennes. Ingratitude humaine, le contrebassiste semble suivre le mouvement, rameur obstiné rivé à son banc de nage, mais lorsque le guépard rockabillien se met en chasse, faut un doigté clitoridien pour épouser les félinités des successives cambrures de son échine, frôlements de velours quasi inaudibles dans les moments d'approches, lentes traînées insidieuses pour les reptations nécessaires aux positions d'affûts, staccati démultipliés pour les fulgurances de l'assaut ; slaps brutaux pour les morsures sanglantes des résolutions finales. Fred, l'impeccable imperturbable, suscite traduit et dessine de ses doigts agiles les scènes technicoloresques de nos imaginations les plus vives. Souligne les contours et avive la couleur amarante des flammes du rockab.
Stephane est à la batterie. J'avoue avoir été distrait lorsque Barny nous l'a présenté pour expliquer sa présence – une ravissante bout de chou de trois ans s'étant glissée tout devant la scène à mes mes côtés, Barny s'est d'ailleurs précipité, tombé à genoux pour lui permettre de gratouiller sa guitare – tranquille, pas inquiet, prend soin de vérifier sur sa set-list le prochain titre que Claude ou Barny lui annoncent, et il démarre aussitôt comme s'il accomplissait une formalité. C'est qu'avec les numéros de haute-voltige effectués par les deux trapézistes l'a intérêt à renvoyer le trapèze au dixième de seconde prêt. N'a pas droit à l'erreur. Alors il n'en fait pas. L'a une technique que je qualifierai de couvre-feu, s'agit de modérer brutalement les envolées à coups de cymbales comme si vous tentiez de regrouper les braises éparpillées dans la cheminée à mains nues. Pour mieux laisser s'échapper les flammes, plus hautes, plus vives, plus brûlantes, dès que le morceau en cours nécessite une de ces soudaines bouffées d'énergie dont en les violentes survenues réside l'essence du rockab. D'autant plus remarquable que parfois il improvise, résout les problèmes à la vitesse des ordinateurs qui vous posent les satellites en orbite avec cette tranquille assurance avec laquelle vous remplissez votre verre de liqueur ambrée.
Claude est à la lead. Ou plutôt la lead est enchaînée à Claude comme l'esclave soumise à son maître. L'en fait ce qu'il en veut. Une facilité déconcertante. Ne le citez pas en exemple à un guitariste débutant. L'aurait l'impression qu'en un peu moins de trois heures il maîtrisera facilement cet instrument rudimentaire. Vous passe les riffs les plus sauvages avec le tour de main inimitable de Tante Agathe qui repasse votre chemise. Sourire débonnaire et doigts incendiaires. L'air innocent du promeneur distrait qui sort de la pinède en flammes tout étonné des trois cents pompiers appelés en renfort pour éteindre l'incendie qu'il s'est fait un plaisir d'allumer, just for fun. Vous déclenche une catastrophe sonore chaque fois qu'il touche de son onglet une corde. Une espèce de tumulte sonique qui vous emporte au septième ciel, z'avez l'impression de voir Dieu en personne et des anges qui caressent le luth de sainte-Cécile pour en extraire des riffs de fou, mais non, ce n'est que Claude qui médite sereinement l'endroit exactement adéquat où il faut frapper la corde pour qu'elle se détende et libère une note dont l'intensité égalera la morsure du mamba noir ulcéré d'avoir été dérangé dans sa sieste.
On a passé l'équipage en revue. Reste le capitaine. Le plus jeune, le plus audacieux. D'abord la voix. Ou plutôt l'art de la poser. Où il faut. Quand il faut. Comme il faut. Avec en plus cette impression de n'agir que dans l'urgence, de s'en débarrasser à toute vitesse, d'avoir commencé trop tard et fini trop tôt, ou de la jeter avec cette désinvolture de grand seigneur comme des pièces de monnaie pour que le personnel s'amuse, du grand art, quoiqu'il fasse la constatation s'impose, c'était là et ainsi qu'il fallait faire. Barny a l'instinct du rockab, l'est habité par, possédé, l'est des moments où il ne s' appartient plus, des montées foudroyantes de speed-stress, n'est plus lui-même mais n'est pas un autre non plus, l'est simplement la musique qu'il est en train d'exsuder de son corps comme de son intimité la plus profonde, n'en voulons pour preuve que cette interprétation démentielle de Run Away dédié à son père Carl, faut dire que derrière les matelots ont hissé la voilure et que le combo file comme l'ouragan, surtout Stéphane avec ses reprises de batteries, ses trois coups de feu qui relancent la bordée de mitraille, un long morceau qui vous conte la libération de l'esprit qui s'envole à la rencontre de l'âme du monde, le cheval noir de l'attelage platonicien a pris le contrôle sur le blanc et vous conduit en une course folle dans l'excessivité exaltante du soleil, un des plus beaux moments que j'ai vécus, un instant d'infinitude folle, une intensité de toute beauté, jamais égalée, l'on ne sort pas indemne d'une telle interprétation, Barny se retire derrière le rideau noir, tel le roi lézard de Jim Morrison dans sa tente à la fin de la cérémonie, laissant l'orchestre improviser un instrumental.
Revient pour le troisième set. Comme si de rien n'était. Et l'on peut admirer sa prestance. Certes l'espace du 3 B ne permet pas de grands mouvements mais il nous régalera de ces poses stupéfiantes, instantanés de guitare bloquée en des immobilités hiératiques, morceaux à l'arrache et à l'emporte pièce qui vous dégoupillent la grenade du cerveau. Il se fait tard, la soirée se termine sur deux morceaux époustouflants de hargne rockab.
Un des plus beaux concerts du 3 B ( et d'ailleurs) chargé d'une émotion à couper au cran d'arrêt.
Merci à Barny, au Rhythm All Stars, et à dame Béatrice.
Damie Chad.
YOUNG ' N' WILD
Wild Records ( USA ) / 2016
Barny Rodrigues Da Silva :vocals, acoustic guitar, / Claude Placet : electric guitar / Fred Bonifacio : upright bass / Pedro Pena : drums.
Belle pochette cartonnée avec à l'intérieur des mots simples et percutants qui marquent le passage de témoin de Carl à Barny, du père au fils, l'héritage pleinement relevé et assumé, car le wild rockabilly ne saurait mourir. Tant qu'il subsistera des amateurs pour perpétuer la légende et entretenir la flamme dévorante. Jusqu'à ce qu'elle nous ait tous consummés et qu'il ne reste personne pour s'intéresser à ces cendres froides d'un monde évanoui. Qui fut et qui aura été nôtre.
Run away : l'adieu et l'hommage à Carl, parti trop tôt selon nous, mais selon la destinée qu'il s'est choisie en homme libre. Cordes acoustiques et la voix qui monte et s'interroge, l'élan d'une flamme que le vent couche mais n'éteint pas, se redresse et reprend de plus belle sur cette brève charge de tambour ulcérée, montagnes russes de la douleur et de l'acceptation, les chevaux les plus libres et les plus fous courent d'infinis galops dans les pâturages hauturiers. Magnifique. Une Partenza digne de Viélé-Griffin. Not ready : une deuxième composition de Barny, tous les ingrédients du rockab réunis et réussis, une guitare insistante, une basse grondante et une batterie impitoyable, une voix qui s'impose d'office, naturellement. Bluffant, déconcertant de facilité. I got the bull by the horns : faut toujours chercher la cocarde d'honneur entre les cornes du taureau. Si possible, un vieux vicieux qui a fait ses preuves, c'est ainsi que la jeunesse n'attend pas le nombre des années, Barny et ses stars vous massacrent ce redoutable bison de Johnny Horton de fort belle manière, une danse de scalp indienne comme l'on n'en fait que trop rarement dans nos contrées. I got the river : remettent tout de suite le couvert, un peu plus fort, un peu plus sauvage, la guitare de Claude s'électrifie comme une ligne à haute tension. Barny tient ferme sur la vache folle du rodéo et son vocal qui vous arrache des touffes d'herbes aussi grosses que des balles de foins. Help me to find out : ne s'agit pas de foncer comme une brute, faut encore oser au coeur des tempêtes le détachement moqueur et la voix qui s'amuse, sans oublier que derrière les intruments sont comme le lait sur le feu qui n'attendent qu'un moment d'inattention pour déborder et envahir le monde. Crazy beat : des partisans de la montée continue, vous voulez du sauvage, en voici, en voilà, à profusion, c'est à qui ira le plus vite, la voix ou la musique, passent la ligne d'arrivée à fond en oubliant de s'arrêter. Vous renversent la tribune d'honneur et s'adjugent la coupe d'or promise par les Dieux. Mary Sue : Vous croyiez avoir touché le paroxysme, eh ben non, vous font valser le jupon de la petite Mary par dessus les moulins de Don Quichotte. Vous lui essorent le sexe d'une bien belle manière. Je n'en dirai pas plus mais n'en pense pas moins. Vu les cris, ce doit être particulièrement voluptueux. I don't want to be like you : la voix traîne un peu sur la rythmique endiablée, la guitare en profite pour vous passer un riff dans les replis accordéonesques d'un reptile qui étire ses méandres venimeux. Au point où vous en êtes un peu plus de folie ne peut que vous rendre plus sage. Il faut soigner le mal par le mal. Brutale thérapie. Mais vous file la forme. Mad man : la deuxième et dernière reprise du disque, de Jimmy Wages, le pionnier improbable, l'a connu Elvis à Tupelo, l'a enregistré chez Sun avec Jerry Lee au clavier et Charlie Rich à la guitare. N'a rien vu sortir. Un peu trop sauvage, un peu en dehors des canons – lui qui pourtant tirait à boulets rouges. Plus qu'un symbole, un parti pris. L'enregistrent avec la folie nécessaire. Commencent comme en sourdine et finissent collés au plafond. Crazy about you : tant qu'à être fous, soyons-le jusqu'au bout. Barny traîne exprès sur les syllabes, broute à Charlie Feathers, la vie et l'amour ne sont qu'un jeu de jupe et de dupe. Ce n'est pas pour cela que l'on ne va plus s'amuser. Oh mama : du riff et de la voix. Pas besoin d'ajouter de la persillade sur la lave du volcan qui brûle votre maison. La basse de Fred halète comme un chien qui a couru après tous les chats du quartier, et la batterie de Pedro vous hache le filet de boeuf en purée mousseline. Young and wild : une promesse, un engagement. Tous les deux tenus. Démarrage tout en douceur, mais très vite Barny allume l'incendie, ce sont toujours les pyromanes qui s'égosillent le mieux pour appeler les pompiers. Le plaisir du vice. D'être jeune et sauvage. Dans sa tête. C'est là l'essentiel.
Je me répète : un disque essentiel.
I GOT THE RIVER / OH MAMMA
( RIP CARL )
Je le cite pour mémoire. Les deux morceaux sont sur le CD. Ce quarante cinq tours sorti quelques mois après la disparition de Carl avait fait le buzz dans le milieu rockab. C'était trop beau, trop inespéré pour être vrai.
Damie Chad.
ROCKABILLY GENERATION N°3
Novembre – Décembre 2017
L'art de la revue est difficile et de longue haleine, tient en même temps du marathon et du cent mètres haies. Faut tenir la distance et paraître à allure métronomique. Sergio Kazh et son équipe ont décidément adopté le bon tempo, celui de la parution régulière et de l'intérêt accru à chaque numéro. Avant d'être une mine d'informations Rockabilly Generation est un bel objet, se feuillette par plaisir, typographie aérée, superbes photos, papier glacé. Plaisir de voir, désir de toucher sont au fondement de l'esthétique et de l'érotique de l'art de la revue. Pin up rockabilly !
Ce numéro trois nous permet de voyager en Europe, compte-rendu du festival Get Rhythm Go Wild d'Ebelsbach en Allemagne et visite chez Rick & Ruby de The Tinstars, en Hollande. Toute la différence entre un reportage et l'accueil chaleureux dans une maison d'amis. L'on se sent bien, comme chez soi, dans ces pages, une conversation à bâtons rompus mais menée fort intelligemment qui se révèle pleine d'enseignements, Rick donne l'impression d'un guerrier rockabilly qui a atteint la maîtrise absolue de la zénitude. Grand article sur Hot Slap de Rouen qui retrace son histoire, quelques propos alléchants des Memphis Flyers, une rapide évocation d'Israël Proulx originaire du Canada, et une interview des Noisy Boys réalisée quelques minutes avant leur dernier concert... Rubriques habituelles, disques Be Bop Creek à l'honneur, concerts, courriers des lecteurs...
Nous avons gardé pour la fin, l'hommage à Sonny Burgess placé en tête du fascicule. Honneur aux pionniers – la forêt d'arbres cannibales qui se cachent derrière le séquoia majestueux d'Elvis - sans qui rien ne serait arrivé mais dont l'histoire épouse les contours d'une génération sacrifiée...
Attention, lecteurs faites vite, les numéros 1 et 2, sont épuisés et vu la qualité et la densité de ce 3, il risque de disparaître rapidement.
Damie Chad.
Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 7 hameau Saint-Eloi / 35 290 Saint-Méen-Le Grand ), 36 pages, 3, 50 Euros + 3, 40 de frais de port pour 1 ou 2 numéros, abonnement 4 numéros : 25 Euros, chèque à Lecoultre Maryse 1A Avenue du Canal 91 700 Ste Geneviève-des-bois ou paiement Paypal maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de toutes les revues... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro.
VINCE TAYLOR
SONORAMA N° 37 / FEVRIER 1962
Moins connu que le scopitone, la revue Sonorama. Revue papier et sonore. Chaque article s'étalait sur deux pages, mais la merveille résidait entre, le disque souple glissé entre les deux. Suffisait de poser la revue sur le tourne-disque pour écouter. Sonorama proposait plusieurs sujets d'actualité, mais quand on regarde les sommaires il est facile de se rendre compte que les chanteurs et dans une moindre mesure les artistes de cinéma étaient privilégiés. Entre octobre 1958 et juillet 1962, parurent 42 numéros. Les documents consacrés à Johnny Hallyday ont été réédités par Jukebox Magazine. Pour les curieux, les numéros se trouvent facilement sur les sites à des prix tournant entre 4 et 20 euros... A l'époque la revue était relativement chère ce qui explique son interruption. Le promoteur en était Louis Merlin fondateur d'Europe 1. L'est sûr que le succès de Salut Les Copains ( numéro 1 en juillet 1962 ) a dû lui couper le sifflet. Sonorama a toutefois bénéficié de signatures célèbres comme Jean Cocteau, Pierre Mac Orlan, Louise de Vilmorin...
Et de Vince Taylor, ce qui est nettement plus classe. Twenty Fligth Rock d'entrée, rien de tel pour vous mettre de bonne humeur, mais voici qu'une voix féminine se livre à une analyse psychologique de notre rocker (quasi)national N° 1. L'est comparé à Doctor Jekyll et Mister Hyde, à en croire notre demoiselle ( Jacqueline Joubert ) Vince le jour serait un garçon timide et bien élevé, mais hélas quand survient la nuit et qu'il est assailli par les démons du rock... l'ange de la destruction en personne, et hop on lui donne la parole avec surtout cette bonne idée de faire la traduction une fois qu'il a fini de parler et non pendant. Un peu gêné le Vince, tente de raccommoder la vaisselle brisée – c'est trop tard, l'on n'a pas le texte des deux pages de présentation mais l'on subodore que c'est juste après la mise à sac du Palais des Sports du 18 novembre 1961 – rejette la faute sur la centaine de voyous qu'il ne faut pas confondre avec l'ensemble des cinq mille participants, même si le rock comporte un arrière-fond de violence... passons... la speakerine laisse Bobby Clarke dérouler son solo, les guitares s'en donner à coeur joie et Vince déroule en intégralité un très bon Sweet Little Sixteen.
Tout amateur de Vince écoutera avec plaisir. N'en sort point trop étrillé le Vince, maintenant je ne sais pas comment la majorité des lecteurs de Sonorama devaient recevoir le paquet cadeau quand on pense que le N° 1 proposait Le Soulier de Satin de Paul Claudel... Une étude statistico-sociologique s'impose !
Damie Chad.
A LA MEMOIRE DU ROCK
( V. Taylor, J. Hallyday, E. Mitchell )
FRANCOIS REICHENBACH
1962
Cinéaste, François Reichenbach est un témoin important de la naissance du rock en France. L'a beaucoup filmé et archivé ( voir KR'TNT ! 312 du 19 / 01 / 2017 ) mais à part le long métrage sur Johnny Hallyday et ce court documentaire qui ne dépasse pas la douzaine de minutes peu d'images ont été montrées au public.
Réalisé en 1962 ce film mélange entre autres des rushes du premier ( 24 février 1961 ), du deuxième ( 18 juin 1961 ) festival international de rock'n'roll au Palais des Sports de Paris. Notons que Vince Taylor était la tête d'affiche du troisième festival du 18 novembre 1961. La salle chavire avant qu'il ait pu rentrer en scène... La carrière de Vince ne s'en relèvera pas...
Fallait du courage pour oser montrer d'un oeil sympathique la furia rock'n'roll en pleine action, François Reichenbach ne se démonte pas et use de subterfuges socio-culturels qui le rangent parmi les manipulateurs d'opinion les plus remarquables. Réalise un agressif et insidieux mélange cinématographique : complaisance d'images-choc enveloppées dans une bande-son des plus séductrices.
Bruit de foule déchaînée et lecture en lettres blanches sur fond noir d'un extrait d'un article du 21 novembre 1961 de France-Soir. Assez prémonitoire quand on pense au joli mois de mai 1968, les échauffourées du 18 novembre 1961 ne sont que signes avant-coureurs d'une tempête plus dangereuse qui se profile à l'horizon. Brutal changement d'ambiance, une de magazine offrant un beau portrait de Johnny Hallyday alors que s'égrènent les premières notes du Quintette N° 1 de Luigi Boccherini. Le genre de musique que l'on retrouverait facilement en fond de lecture de La Chartreuse de Parme de Stendhal. Vous allez vous en fader encore quelques instants de ce satané Luigi durant les gros plans sur les visages d'une jeunesse qui se dirige vers les entrées du Palais des Sports. Sont beaux, sont jeunes, nos Rastignac du Rock, n'empêche qu'aujourd'hui ils dépassent les soixante-dix balais et que la réalité a dû raboter sérieusement ce désir de vivre qui les habitait... Du bruit et du noir. Des cris infinis dans lesquels surnage la musique des Chaussettes Noires. Vous ne les entreverrez qu'à peine, la caméra préfère ne pas quitter de son œil de verre ces jeunes fous qui dansent, remuent, crient, exultent... une vague de folie communicante, les Chaussettes têtes coupées pour mieux insister sur la désarticulation des corps et montrer que l'hystérie de la cohue généralisée n'appartient à personne et subitement dans la cohue surgit le visage extatique de Vince Taylor, apparition dionysiaque, félin cerclé de cuir noir, essentiel, absolu, l'essence même du rock, une vision, une interpolation des plus artificielles puisque Vince n'a pas chanté – je dirais des plans de son spectacle à l'Olympia de décembre / Janvier 61 / 62 – puis par la grâce du montage retomber sur Hallyday qui fut la vedette incontestée et incontestable de la soirée du 24 février. Les images s'éclaircissent comme pour filmer un tour de chant des plus classiques, mais non, pour mieux désigner la descente des flics qui provoquent mouvement de reflux et sur la musique de Boccherini se dessine un étrange ballet de pandores qui marque la mesure de leurs matraques qu'ils abattent sur la tête de cette jeunesse en délire. La caméra se braque comme un fusil sur ces jeunes innocents et nous désigne les coupables qui continuent à danser, à tressauter, à s'agiter infiniment, visages épanouis, corps comme libérés de la pesanteur sociétale, comme si leurs soubresauts épousaient le rythme des violoncelles de Boccherini... manière de dire qu'au-delà des siècles musique de chambre ''classique'' et rock'n'roll sauvage ne sont que la même expression de la rage de vivre.
Si je devais donner un titre, ce serait : Tombeau pour Vince Taylor.
Car les images de François Reichenbach ne sont pas loin de la perfection formelle des sonnets mallarméens.
Damie Chad.
Disponible sur Youtube. Tapez les quatre lignes de notre titre. La (re)lecture de Vince Taylor, le perdant magnifique de Thierry Liesenfeld s'avère indispensable pour les esprits curieux et les amoureux du rock.
Ces deux articles ont été suscités par les posts de Vince Rogers sur son FB. Mine de combustible hautement radio-actif à ciel ouvert.
JOHNNY
LA DERNIERE DES LEGENDES
CLAUDE FLEOUTER
( Robert Laffont / Septembre 1992 )
Rien que deux livres parus sur Johnny, ces 26 et 27 octobre dernier... J'ai remonté de mon garage – la pièce la plus rock de tout appartement respectable - celui-ci, sorti en septembre. 1992. Un quart de siècle s'est écoulé depuis sa parution. La dernière des légendes a décidément la vie dure. Aussi dure que du bois dont on fait les cercueils. Claude Fléouter n'est pas né de la dernière pluie non plus. L'a réalisé une trentaine de films et écrit une trentaine de bouquins. L'est aussi le fondateur des Victoires de la Musique et des Victoires de la Musique Classique. Je vous laisse seuls juges, n'ai jamais vu puisque que je ne possède pas chez moi cette boite à esclaves que d'aucuns s'entêtent à appeler télévision. L'on sent l'inconditionnel, qui a connu Johnny dans sa jeunesse. Sait de quoi il parle. L'a cette qualité rare, de ne pas se mettre en avant. Raconte Johnny, pas les aventures de Fléouter avec Johnny. A peine si l'on peut deviner sa silhouette dans les coins.
Pas d'anecdotes graveleuses. Ne se voile pas non plus les yeux devant les seins qui dépassent et les chattes qui miaulent de plaisir. Ne raconte pas. Dresse un portrait. Qui tient aussi bien de La Bruyère pour les scènes de genre, que de Pascal pour la contemplation des gouffres intérieurs. Pas d'effort de style, mais bien écrit. Un Johnny en noir et blanc. Beaucoup de gris, beaucoup de noir. Peu de blanc. Ce n'est pourtant pas la couleur qui manque. La saga hallydéenne en épouse les teintes les plus vives. De quoi faire le bonheur d'un coloriste. Cléouter ne s'en prive pas non plus, mais toute la quincaillerie rutilante il la laisse en arrière-plan. L'on ne compte plus les journalistes en mal de ressentiment qui ne se sont pas privés d'attacher de multicolores casseroles dans le dos de notre rocker national. L'on reconnaît les écrivaillons du ressentiment à leurs stylos qui bavent.
Cléouter décrit le rocker mais s'attache à l'homme. Commence par la douleur. Automne 1966. Johnny ne sera pas sur la scène de la Fête de l'Humanité. L'a craqué, tentative de suicide. Sur la brèche depuis trop de temps. Le succès n'est pas venu trop vite. Il est venu très vite. Bien sûr il y a eu les années de galère, mais cela c'est la ration quotidienne de l'artiste qui s'en vient chambouler le jeu de quille établi. N'ont pas duré trop longtemps et lorsque l'on a seize ans et dix-sept ans cela relève encore du jeu. Idem pour le public qui se colle à lui dès la première émission télé. Et qui ne le lâchera plus. Il est l'allumette qui met le feu à la bonbonne de poudre noire. La jeunesse se découvre en le regardant. Il est n'est pas qu'un simple miroir. Il est un modèle. Il est l'artificier. Tout lui sourit. La gloire, l'argent, les filles et le rock'n'roll. De 1960 à 1965, il est l'idole d'une génération. A peine est-il parti à l'armée, à peine s'est-il marié que tout se désagrège. La vague adolescente qui l'a porté reflue, et la nouvelle guigne déjà ailleurs. Se retrouve seul dans un monde nouveau. Son nom fait encore illusion, il est un symbole, ce n'est pas un hasard si les communistes lui offrent le plus grand podium de France. Mais Johnny n'est pas dupe. L'a vu de près la solitude égotiste de Dylan et celle extasiée d'Hendrix, il le sait, il le comprend, il sera seul jusqu'au bout.
Quand l'aigle est blessé il ne revient pas chez les siens parce qu'il na pas de chez lui. Ou il crève ou il se métamorphose en phénix. Et Johnny revient. L'a retenu la nuit du désespoir dans sa poche avec un mouchoir dessus pour qu'elle ne ressorte comme le mauvais génie de la lampe. Côté soleil Johnny est imbattable. Fatigue tout le monde, inlassable, increvable, se couche pour ne plus se relever et se réveille le lendemain en pleine forme. Toujours des idées nouvelles, des lubies qu'il lui faut réaliser à la minute. Filles, voitures, musique, tout et tout de suite. Le prince flamboyant du rock'n'roll. Côté lunaire, c'est nettement moins drôle, un insomniaque – ce n'est pas qu'il est trop surexcité pour dormir, ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas se confronter à ces minutes d'abîme qui précèdent le sommeil, peur du rêve qui vire au cauchemar, peur inconsciente de la mort, de ne pas se réveiller, Johnny est un angoissé. Rayonnant dès qu'il met pied à terre. Mais l'angoisse l'habite, l'angoisse le ronge. Ne le quitte pas, même quand il allume le feu. Celui qui brûle la peau et qui consume le désir.
Certains mettront plus de temps que lui à comprendre que le rock est une course avec le devil. Même ceux qui se vantent de sympathiser avec lui. En 69 le concert d'Hyde Park en l'honneur de Brian Jones, si symboliquement pharamineux fût-il, n'était que cinq gars qui essayaient tant bien que mal de recoller les morceaux cassés de leur groupe. En 67, Johnny est au Palais des Sports, ne s'agit pas d'un énième tour de chant dont il sait fort bien s'acquitter, mais d'une mise en scène, d'un spectacle qui en donne plus. Faudra attendre la douche froide d'Altamont pour que les Stones comprennent qu'ils ont mangé le pain bleu du rock'n'roll, que désormais il va falloir voir plus grand, prouver au monde entier que c'est eux qui possèdent le plus gros zizi. Entre temps Johnny est revenu aux racines du rock, l'a son Johnny Circus, une folie entre le barnum originaire du Colonel Parker et la carriole des medecine show, mais revue façon cirque Pinder et Bouglionne. Une catastrophe financière mais il s'en relèvera plus grand, plus fort, le livre s'achève alors que la démesure hallydéenne se met en marche...
Je vous passe la tarte à la crème de l'enfant abandonné, Johnny n'est pas Cosette, l'a su se construire sur une situation de départ qui n'était pas jojo. C'est tout. Claude Fléouter ne cache rien, le bon comme le moins agréable, mais pas besoin de sécher vos larmes aux rideaux de la salle à manger. Nous dessine un Johnny timide, secret et sans doute le maître-mot : pudique. L'auteur a eu le trait sûr et perspicace. Un quart de siècle plus tard, Johnny ressemble à ce portrait initial. En vingt-cinq ans frasques et vicissitudes se sont accumulées. Les temps ont changé. Le monde a périclité. Johnny est toujours égal à lui-même. Nous avons pris un sacré coup d'usure. Ce livre antédiluvien de Claude Fléouter nous permet de vérifier qu'à l'intérieur Johnny n'a pas vieilli.
Essayer de faire pareil. Alors on en reparlera.
Damie Chad.
MICHEL GREGOIRE DIT
MOUSTIQUE
UNE LEGENDE DU ROCK'N'ROLL
( Reportage inédit du 17 novembre 1989 / YouTube )
Ma chronique de l'album de Tony Marlow la semaine dernière m'a donné mauvaise conscience. L'on approche la trois-cent cinquantième livraison et Moustique n'a jamais été nommé qu'incidemment. Reste pourtant un pionnier du rock'n'roll français. On passe un peu vite sur lui, on l'écarte comme un moustique indésirable qui s'en vient butiner dans le pré-carré de votre peau. N'empêche qu'il est monté sur scène avec les plus grands, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent et surtout Little Richard qui l'a revendiqué comme ami. Ce mini-reportage est à voir. Moustique dès le début y revendique fièrement ses origines prolétariennes, un gosse de Paris, fils de la misère, à jamais traumatisé par l'apparition du rock'n'roll à l'orée des années soixante. Son premier 45 tours enregistré chez Barclay, la firme qui avait à son catalogue Les Chaussettes Noires et Vince Taylor lui apporta la gloire, celle qui survit à tout. N'en emprunta pas pour autant la voie royale d'Eddy Mitchell, comme Vince malgré des raisons différentes, il connut les itinéraires de la déglingue, rejeté par la vague yé-yé sur le sable les plages du dédain et de la non-rentabilité économique. Un avenir aussi sombre que le fond noir de sa première pochette. N'était pas le genre de gars que l'on pouvait calibrer, comme l'énonçait son premier hit Je suis comme ça, la reprise de My Way d'Eddie Cochran, quinze ans avant Sid Vicious, l'avait la sale habitude de n'en faire qu'à sa tête. N'a pas fait long feu chez les requins du showbizz. Alors l'a tout fait, la prison, un stand d'objets africains aux Puces, l'a tenu deux restaurants, bref l'a survécu dans les eaux troubles de la vie. Irrémédiablement rocker jusqu'au bout des ongles. L'est toujours présent, personnage doté d'un optimisme inamovible et pathétique, la foi du rock'n'roll chevillée au corps, toujours prêt à monter sur scène pour répandre la mauvaise parole du early rock'n'roll, cette musique qui vous salit les mains dès que vous les trempez dans son moteur et vous brûle l'âme. Irrémédiablement. Dès la première écoute. Moustique est un survivant. Moustique est un rocker.
Damie Chad.
31/08/2016
KR'TNT ! ¤ 292 : OBLIVIANS / GENE VINCENT - JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE / HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE / RED'S LYGTH
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 292
A ROCKLIT PRODUCTION
01 / 09 / 2016
|
OBLIVIANS / GENE VINCENT / JIM MORRISON / VINCE TAYLOR / EDGAR ALLAN POE HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME / WIRE RED'S LYGHT |
BINIC FOLK BLUES FESTIVAL
( 22 ) - 30 juillet 2006

OBLIVIANS
Obliviande
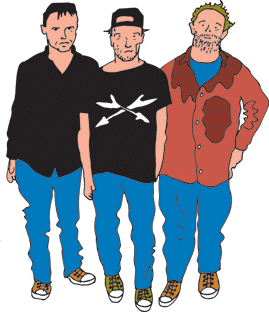
Les trois frères Oblivian sont un peu les frères Dalton du garage américain. À l’époque de leur grandeur, personne n’osait les affronter à OK Coral. Leur principal atout était la polyvalence : Greg, Jack et Eric Oblivian savaient jouer à la fois de la batterie et de la guitare, composer et screamer, ce qui leur permettait d’alterner le lead et de varier les styles.
Comme les Stooges, Jimi Hendrix, le Velvet et les Gories, ils ont aussi commencé par enregistrer trois albums qui sont devenus des albums cultes chez les garagistes : Soul Food, Popular Favorites et Play 9 Songs With Mr Quintron, tout ça sur Crypt. Avec ces trois albums et ceux des Gories aussi parus sur Crypt, la messe est dite. Amen.
Et quelle messe !

À l’époque, ces disques nous brûlaient les doigts. Trop de culte tue le culte. Le festin de Soul Food s’ouvre sur une horreur ultraïque baptisée «Viet Nam War Blues», a fuckin’ smokin’ beast, comme disait à l’époque Tim Warren, un truc aussi puissant et carnassier qu’un crocodile, bâtard, violent, vénéneux, on ne lui trouve aucune qualité. On plonge ensuite dans la pire insanité avec «Big Black Hole», chanté avec du trash plein la bouche, c’est à peine croyable, il faut l’entendre pour croire qu’un truc pareil puisse exister. Berk ! C’est screamé jusqu’à l’os du scream. Dans un concours de scream, Greg Oblivian aurait certainement battu Frank Black. Ils tapent aussi dans l’hypno du North Mississippi Hill Country blues pour «Never Change». Ils ne reculent devant aucun excès. De l’autre côté, on tombe sur ce fantastique classique garage qu’est «Blew My Cool», embarqué au riff sempiternellement effervescent. Voilà le garage désossé et ramené à l’essence du riff. Encore un petit shoot d’adrénaline avec «Bum A Ride», joué au dératé et sacrément agressif, ils tapent dans la hurlette de Memphis avec de jolies interjections orgasmiques. À l’époque, les critiques américains n’avaient qu’un seul mot en guise de commentaire : Gasp !
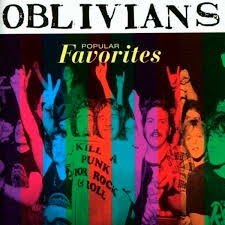
On croit qu’ils vont se calmer avec Popular Favorites. Pas du tout. Ils trash-punkent dès l’allumage avec «Christina». À dégager ! Ils développent une sorte de démesure de l’excès, dans le son, dans le beat, dans le trash. Ils balaient tout. On attend qu’ils explosent. Ils dégagent la pire pulsion primitive qui se puisse concevoir ici bas. Ils shootent une fatale injection de sténo dans la stéréo. Atroce ! Ce disque sonne comme un assaut. Avec «Trouble», on réalise subitement qu’ils se trouvent dans un trip de destruction totale. Ils réinventent même le garage sans le faire exprès. Les choses empirent encore avec «The Leather», un cut rampant, horrible, qui passe sous la moquette, c’est le vrai primitif, celui qui donne le frisson, et comme dans les cauchemars, on ne parvient pas à s’enfuir. Alors t’en veux encore ? Tiens ! «Hey Mama Look At Sis» ! Ce Greg est un psychopathe ! Dans la chanson, il lui dit de regarder ce qu’elle fait. Ça devient insupportable. Il ne la lâche pas. Tiens, et ça, «Strong Come On» ! Du Jack qui se prend pour les Beatles à Hambourg. Mais ils préfèrent nettement la brutalité, avec «She’s A Hole», c’est du sans pitié, du claqué du beignet de riff. Et dans «Bad Man», ils explosent littéralement le désossé, c’est de la soudarderie qui dépasse toutes les bornes. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec des abominations comme «He’s Your Man», saturé de fuzz, ou encore «Pinstripe Willie», trash-punk de la dernière heure. Tout semble définitif sur cet album du non retour.
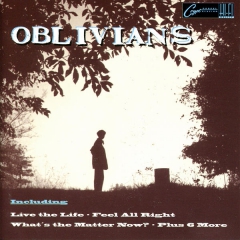
Mais non, car le pire est à venir. Play 9 Songs With Mr Quintron est un disque parfait. Les 9 cuts sont d’épouvantables classiques du garage moderne. On sent même le vent du génie dans «Feel All Right», une vraie merveille de pulsatif définitif. C’est mouliné au riff insidieux, relancé aux raids de Memphis, à coups de I wanna know, et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue il faut voir comme. Avec «I May Be Gone», ça hurle dans les coursives. Voilà un cut possédé par le diable. Si on s’intéresse à la démence pure, c’est cet album qu’il faut écouter. Nouvelle exaction avec «I Don’t Wanna Live Alone», battu et rebattu au riff de fuzz. Voilà la magie des Oblivians. Ils nous sortent le meilleur stomp de Memphis et Mr Quintron nous nappe ça d’orgue, comme s’il arrosait le stomp de crème anglaise un peu tiède. Ils tapent carrément dans l’exponentiel avec «Final Stretch» et Greg fait son numéro de hurlette des Hauts de Hurlevent. Tout est incroyablement dense et bon sur cet album. Et voilà «What’s The Matter Now», échantillon de Memphis punk explosé au coin du bois. Quelle énergie ! De vrais rebelles. Des invaincus ! Ces mecs sont tout simplement invincibles. Ils sont terrifiants de classe. Ils dépassent encore les bornes avec «Ride That Train». Et là on se dit que c’est trop. Trop de classe, trop d’énergie, trop de son, on voudrait leur dire d’arrêter, mais ils n’écoutent pas, ils explosent tous les standards de manière quasiment automatique. Ils pulsent jusqu’à l’aube et ils enchaînent avec un beat mortel de la mortadelle, «If Mother Know», le garage de la dernière chance, ils plombent le stomp du groove droit dans la grave, énorme et fatidique, pire que la rivière sans retour. Et Mr Quitron nous nappe ça impitoyablement. Ouf, on arrive au dernier cut, «Mary Lou», encore une abomination chantée d’autorité, ils crucifient le cercueil du garage qui va renaître sur la berge du Mississippi, ils sortent pour ça un beat buté et de la hurlette de dératé, et Mary Lou s’en va caramboler le firmament.

Il y a encore deux ou trois choses des Oblivians que tout esprit déviant doit écouter. Par exemple ce Best Of The Worst (93-97), capable de hanter un château d’Écosse. On y trouve un «Indian In Me» joué sur le sentier de la guerre, avec sa dose de référence au National Indian Reservation. C’est aussi sauvage que du Link Wray. On trouve aussi l’effarant «Bald Headed Woman», pur jus de trash-garage joué à la vrille de fuzz dégueulasse. Ils poussent le trash comme grand-mère, d’un coup d’épaule dans les orties. Même chose avec ce fantastique «Don’t Haunt Me» joué à l’admirabilité des choses, ils pataugent dans l’épaisseur d’un garage noyé de distorse, hanté par des cris d’horreur et des solos égarés. On retrouve des exactions comme «Hey Ma Look At Sis» et une version de «Locomotion» joué à la clameur virulente. «The Losing Hand» est l’archétype du trash d’Obliviande, fracassé à l’extrême. On se croirait chez le boucher, dans la pièce du fond. On trouve aussi une cover du «Alone Again Or» de Love et un «Kick Your Ass» enfoncé à coups de talon dans le néant du trou du cul du monde, et d’autre horreurs qu’il vaut mieux éviter d’écouter si on est d’une nature délicate, comme «Mad Lover», «Blew My Cool» ou «Everybody But Me». C’est l’affreux Long Gone John qui sortait ces disques sur son label Sympathy. Ah la canaille !

Il fit aussi paraître deux maxis, les fameuses Sympathy Sessions, avec des filles nues sur les pochettes. Ce n’est que du coup de génie à répétition, de l’overdose de garage fuzz trash joué à deux guitares invertébrées («Never Enough» et «Feel Real Good»), la beauté s’élève du chaos de distorse, il faut avoir vu ce spectacle au moins une fois dans sa vie. Ils font aussi du speed garage explosif et défonceur de rondelle des annales avec «Shut My Mouth». Le solo qui traverse le cut vaut pour une dégueulade de Memphis take.
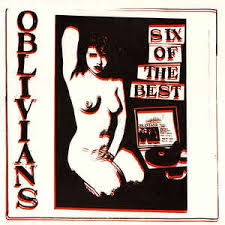
L’autre maxi s’appelle Six Of The Best, et dès «Clones», on tombe de la chaise, car c’est gratté au sec de la dépouille de Memphis. Ils savaient jouer de la guitare tuberculeuse. Ils rendaient aussi hommage aux racines du garage avec un «No Time» vitupéré et esquissaient l’avenir du garage moderne : gras et sale, saturé de crasse de son. «Memphis Creep» ? Laissez tomber, les gras. C’est au-delà du génie. Voilà un modèle de retenue et de tact trash absolument unique au monde. Sans commune mesure avec la mesure. C’est le garage du paradis des fosses à vidange. Ça continue avec l’infernal «Something For Nothing» et «Big Black Hole», pure tranche d’Obliviande fumante, jouée aux accords de gras double avec des wooohh dignes de Little Richard et un killer solo définitivement privé d’avenir.

Les Oblivians se reformèrent en 1993 et enregistrèrent Desperation, un album indispensable pour trois raisons. Un, l’«I’ll be Gone» d’ouverture de bal, du garage pilonné et harcelé par des arsouilleries mélodiques dont est si friand l’ami Greg. «Call The Police» flirte aussi avec le génie, d’autant plus que Mr Quintron et Miss Pussycat sont invités à participer au festin. C’est d’ailleurs Mr Quintron qui chante. On atteint une nouvelle fois les sommets du Memphis garage, c’est soutenu au meilleur beat et bien nappé d’orgue. Mr Quintron chante comme un diable. En B, on trouve la troisième raison : «Little War Child». Voilà la patte de Jack, cette incroyable aptitude à composer des cuts qui sonnent comme des hymnes dès la première mesure. C’est une réalité à laquelle il va falloir s’habituer, les gars : Jack-O est l’un des grands songwriters des temps modernes. On tombe plus loin sur «Back Street Hangout», encore du Jack, du vrai bardé de classe, une danse de décibels décidément dodus au dedans du doute et c’est comme visité par un solo aérien.
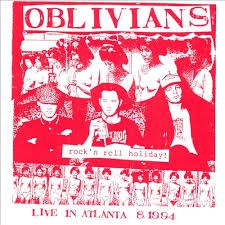
Il existe deux albums live des Oblivians, un Rock’n’Roll Holiday enregistré à Atlanta en 1994 et Barristers Ninetyfive paru en 2009. On s’en doute, c’est dans les deux cas du concentré d’insanité. Ils attaquent leur set d’Atlanta avec «Motorcycle Leather Boy» - Awite ! Let’s rock ! - Greg est complètement fou. C’est bizarre qu’on ne l’ait pas interné, à l’époque. Leur «Viet Nam War Blues» semble monté sur le riff de Death Party. «Love Killed My Brain» est l’un des hits planétaires des Oblivians. Greg le chante au gore de trash et «No Reason To Live» vaut pour un modèle d’insanité qui devrait servir de modèle dans toutes les facultés de médecine. Encore plus explosif, cette version de «Shut My Mouth» joué avec l’énergie du diable, il n’existe pas d’autre explication. Et on retrouve ces coucous inexorables que sont «Blew My Cool», «Shake Your Ass» et un «Nigger Rich» joué dans la pire des démesures, car gratté jusqu’à l’os du raw to the bone. Et ça se termine bien sûr dans la fournaise définitive avec «Never Change». Les Oblivians, ça ne pardonne pas.

Avec Barrister, on retrouve grosso-modo les mêmes excès. Greg hurle son «Losing Hand» à la vieille ramasse d’obliviande carabinée, c’est tellement mal foutu qu’on s’en étrangle de bonheur. Ah si on aime la délinquance juvénile et le foutraque, c’est eux qu’il faut écouter. Leur version de «We’re The Doll Rods» dégueule littéralement de distorse. Et ils battent comme plâtre ce pauvre «Mystery Girl». Ils atteignent là une sorte d’apothéose sauvage, ils clapotent dans leur bouillasse binaire de boudin de sang royal archétypal. Inutile de commenter la version de «Viet Nam War Blues», ni celle de «Pill Popper» qui ouvre la B. Ils sont sans pitié pour les canards boiteux. Jack passe au micro et à la guitare pour «Strong Come On» et il tâte de l’apanage de garage sacré avec «Let Him Try», offrande suprême aux dieux du garage des temps anciens. C’est en effet une reprise des mighty Makers. Il enchaîne cette merveille avec une autre merveille, «Black September», un cut de power-pop signé Jack-O, emmenée à train d’enfer après un faux départ. C’est dans la veine du grand Jack, cet immense songsmith. Il finit avec l’effarant «Clones», dans l’obliviande hachée poussée dans le tourbillon par un phrasé frelon.

Retour à Binic pour une belle tranche d’Obliviande saignante. Nos trois héros entrent dans l’ère de la reconnaissance puisque les voilà hissés en tête d’affiche. Cadre idéal pour ces figures de proue de l’underground américain, car ils jouent devant un public conquis d’avance, ce qui est généralement le cas dans les concerts gratuits. Les gens adorent tout ce qui est gratuit, même si la musique n’est pas d’un abord facile. Pour un néophyte ou un téléramiste, le trash-punk des Oblivians doit paraître un peu âpre. Mais c’est justement ce que cherchent les amateurs, la grosse âpreté, celle qui fait hocher la tête en rythme.

Quelle joie que de revoir arriver Greg Cartwright sur scène, avec sa dégaine de prof de math, et Eric Oblivian, avec sa dégaine de magasinier chez Renault. Derrière eux, l’éternellement jeune Jack bat le beurre pendant la première moitié du set. Ils enfilent leurs hits comme des perles et on sent bien qu’avec l’âge, ils finissent par se calmer. Ça fait tout de même trente ans qu’ils jouent ces classiques insurrectionnels, ne l’oublions pas. Eric et Greg claquent bien leurs accords au beignet de crabe, mais ils semblent vaccinés contre la rage. Ils n’ont plus cette démesure qu’on trouve encore chez les Gories. Quand on suit Greg Cartwright à la trace et donc son parcours discographique avec Reigning Sound, on sait qu’il aspire à des choses plus paisibles, ce qui n’est absolument pas le cas de Mick Collins, si on reste dans le parallèle avec les Gories, ni de Jack Yarber, comme on le voit lorsqu’il arrive au micro et qu’il commence à taper dans ses vieux coucous défenestrateurs comme «Blew My Cool».

Jack est le plus incorrigible des trois. Et on a vraiment l’impression de voir jouer une superstar. Il dégage ce type de rayonnement. C’est Jack qui relance cette prodigieuse locomotive, d’autant que derrière, son copain Greg tape comme un sourd sur les fûts. Chaque fois qu’on les voit jouer, on se dit qu’ils sont le groupe idéal, car en alternant les rôles, ils se débarrassent du problème que peut poser le leadership. Pas la moindre de frime non plus, chez ces gens-là. Ils ont tout bon.
Avant de former les Oblivians avec Eric Oblivian, Greg et Jack jouaient déjà dans les Compulsive Gamblers qu’il reformèrent après le split des Oblivians, en 1996. Un bon conseil, mettez le grappin sur les trois albums des Compulsive, car si vous appréciez le compulsif, vous serez compulsé comme il se doit.
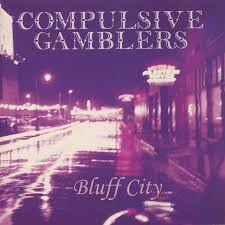
Bluff City et Crystal Gazing Luck Amazing sont leurs deux albums enregistrés en studio et dès Bluff, on sent le trio accompli, à l’immense majorité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Bluff City est le surnom de Memphis, de la même façon que Brum City est le surnom de Birmingham. On trouve une grosse pièce de stonesy sur Bluff, «I Call You Mine». En gros, ça sonne comme «The Last Time» gratté par les Who. Greg brame ça dans la Brum de Bluff. Quelle persévérance dans la latence ! On retrouve en B le fameux «Don’t Haunt Me» joué au heavy groove des familles. On retrouve l’énergie de l’Obliviande dans «X Ray Eyes», pour cette fois une petite pointe d’excellence de la consistance. C’est en plus superbement soloté et avenant en diable. On les sent sans peur et sans reproche, libres comme l’air, bercés par les alizés et avides de bon temps. Il faut aussi écouter «Mystery Girl», rudement bien secoué du bocal et réveillé en sursaut par des clameurs soniques, des petits retours de manivelle et une belle dose de ramasse à la clé de sol.

Crystal Gazing est encore plus énervé. On le voit bien, dès le premier cut, «The Way I Feel About You», riffé à l’Obliviande et chanté à la tendance mélodique. Tout y est : l’impatience, les échappées, les départs de feux et l’ébullition. Deux autres merveilles illuminent l’A : «Negative Jerk», garage punk emmené à train d’enfer, et «Stop And Think Over», magnifique hit de power pop incroyablement lumineuse, une vraie perle rare, bien portée par son élégante bassline. C’est à la fois inspiré, brillant, élancé et sans faille. On est à Memphis, ne l’oublions pas. La B vaut aussi le détour avec des choses comme «I’m That Guy», monté sur les accords de «Gloria». Personne n’ira leur faire des reproches. Ils ont le droit de pomper Gloria. Ils tapent aussi dans un vieux hit de Nolan Strong composé par Miss Deborah Brown, la patronne de Fortune Records, «(I Want To Be Your) Your Happiness». Ils jouent à l’Obliviande caractérisée, ils en sortent une version incroyablement musclée. Cut idéal pour des esprits aussi libres que ceux de Jack et de Greg, et puis on se régale de ce petit départ en solo. Ils sont parfaits. Encore un hit de Jack avec «Rock’n’Roll Nurse», lancinant et vaillant à la fois, slow & hypnotic comme dirait Long Gone Jone.
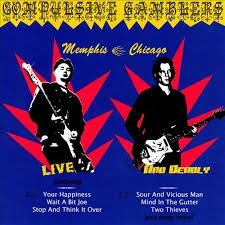
Live And Deadly - Memphis/Chicago vaut le détour, car ça saute à la gorge dès «Your Happiness», reprise du cut de Deborah Brown. Jack et Greg en font un hit ensorcelant. Ils shootent toute leur énergie dans le cul ridé de cette vieille pépite de soul. Rien que pour cette reprise, l’album vaut d’être rapatrié. Attention, ce n’est pas fini. Ils nous font du Question Mark & the Mysterians avec «I’m That Guy». C’est nappé d’orgue, avec de la tension garage - In my room/ All alone - et la montée de fièvre qui va avec - Baby I’m that guy on about - et ils oh-yeatent comme des brutes. Avec «Stop And Think Over It», Greg revient à sa chère power pop. Il laisse échapper des floppées de notes multicolores. Voilà une pop de rêve digne des Nerves. On reste dans l’énormité avec un «Two Wrongs Don’t Make A Right» terriblement alerte, bardé de nappes d’orgue et de gros accords dylanesques. Si ce n’est pas du génie, alors qu’est-ce que c’est ? On voit encore l’immensité du talent cartwrightien s’étendre à perte de vue avec «I Don’t Want To Laugh At You». On sent que Greg a bouffé du Dylan et de la soul. Ça lui ressort par tous les pores de la peau. Il en deviendrait presque visionnaire.
Et si on mettait le nez dans les albums solo de Jack ? Il faut bien dire que Jack-O ne chôme pas depuis 1997. Son palmarès est franchement éblouissant. Dans l’underground, il reste une star et ceux qui le connaissent pour l’avoir vu jouer soit avec les Oblivians à la Maroquinerie, soit avec les Knaughty Knights au Point Éphémère ou avec les Cool Jerks à l’Espace B, oui tous ceux là savent qu’il l’avoir à l’œîl. Partons du principe suivant : sur chaque album solo de Jack-O se niche un hit planétaire.
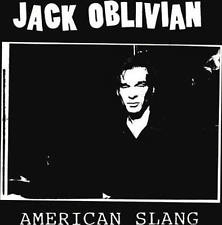
Il a commencé sa «carrière» solo par deux maxis, American Slang et So Low. L’«American Slang» qui donne son titre au premier maxi sonne comme un hymne. Jack-O chante perché, comme s’il reprenait un hit des Dictators. C’est même gonflé par des guitares à la Johnny Thunders. Quel jus ! Scott Bomar joue une belle partie de basse sur «Hustler» et on retrouve le foutraque typique du Memphis Sound. En B, ils tapent un «Got The Funky Blues» au beat tribal à la Captain Beefheart et Jack s’amuse bien avec «Out Of Tune», un groove bien gras et bien râblé.

Sur So Low, on trouve un «Shake It Off» gratté à la sauvage par Greg. Ils sortent là un vrai son primitif, un incroyable désossé de la désaille. Toute la science ancestrale est exacte au rendez-vous. Ils tapent ensuite une belle reprise des Dolls, «Trash» et Jack finit l’A avec un fantastique «Let Me Be Your Chauffeur». En B, on retrouve un léger parfum de Magic Band dans «You Made Me Crazy», très dada dans l’esprit et saxé à la basse du néant.

À partir de là, Jack-O va embarquer avec lui une fière équipe, The Tennessee Tearjerkers et enregistrer de solides albums, comme ce Don’t Throw Your Love Away paru en 2001. Il y rend un fantastique hommage à Dylan avec un cut intitulé «Still Got It Bad», un balladif de poids nappé d’orgue Hammond. Il ne faut surtout pas prendre Jack-O pour un amateur ou un bricoleur du dimanche. Ce mec navigue dans la cour des grands, en compagnie de gens comme Frank Black ou Robert Pollard. L’«Ain’t Got No Money» qui ouvre le bal de l’A est tout simplement claqué au riff royal de Memphis et brouté aux nappes d’orgue. C’est nettement au dessus de la moyenne. «Dope Sniffin’ Dog» relève de l’énormité garagiste, car c’est alarmé du cortex avec des yeah de baryton à la Iggy. Voilà le garage dont Jack-O a le secret, un garage à fort parfum stoogien dans la façon de ramper sur les braises en poussant des yeah miséricordieux. Il revient à sa passion dylanesque en B avec un «Flash Cube» extraordinaire d’élégance. Encore un cut puissant et inspiré. Il tâte plus loin du solide romp de rock avec «Fire» et le farcit de dégelées de guitare fratricides. Ces gens-là savent brûler Rome.

Il continue de faire du Dylanex sur Jack-O Is The Flipside Kid. Le cut se trouve en B et s’appelle «Black Boot». Jack-O sonne tout bêtement comme le grand Bob de l’âge d’or. Mark Sultan l’accompagne à la batterie. On a aussi un coup de génie avec le cut qui donne son titre à l’album : «Flip Side Kid». Il s’agit là d’un rock à vocation de stonesy, mais orienté vers Memphis. On assiste là à l’explosion d’une véritable clameur d’envergure brutale. Jack-O tire ça à la force du poignet et place un solo d’antho à Toto. On retrouve aussi sur cet album des gens comme Jimbo Mathus et Harlan T. Bobo. Les autres hits sont en B, notamment ce «I Live For Today», battu par Mark Sultan. Jack-O y pétrit sa pop flamboyante et rend une nouvelle fois hommage à Bob Dylan. Il reprend aussi le fameux «The Man Who Loved Cough Dancing» de Mr. Jeffrey Evans et en fait une version instro superbe. Jack-O retrouve plus loin son cher débraillé foutraque avec «Night Owl», espèce d’apothéose de good time music et boucle avec une stoogerie de haut rang, «I Want You» joué au reptilien, nappé d’orgue et chanté dans la torpeur d’une profonde inquiétude paranoïaque.

Encore un énorme album avec The Disco Outlaw. Il l’attaque avec «Ditch Road», un fantastique cut de pop rock du Tennessee. Jack-O est un auteur classique qui sait monter des coups fumants. Son cut est imparable, éclairé par le jeu du guitariste John Paul Keith et soutenu par la belle bassline d’Harlan T. Bobo. Tous les morceaux de cet album sont fouillés, chargés de son, bien construits, On goûte la succulence de l’effarance avec «Against The Wall» qui sonne comme un classique avec des vieux relents de «Drop Out Boogie». «Make Your Mind Up» sonne comme un hit pop planétaire. Voilà de quoi notre héros se montre capable. C’est digne des meilleurs jukes et troussé à la hussarde. Il prend ensuite «Sweet Thang» à l’hypno de Memphis, et ça trépide, avec une grâce infernale. Quelle énergie et quelle puissance dévastatrice ! En B, John Paul Keith embarque «Scratchy» dans la clameur d’un solo incendiaire. Ils nous explosent ce vieux classique des sixties. Et ça va se terminer avec «Stop Stalling» bien soutenu à l’orgue et «Walk Of Shame», un nouvel hymne pop. Ce mec n’enregistre que des disques condamnés à l’île déserte.

Encore un maxi avec Saturday Night Part 2 et au moins quatre raisons de le rapatrier. Un, «Mad Love Pt 2», pur jus de garage de Memphis, rythmé au foutoir de grosse caisse et John Paul Keith joue un solo à l’insidieuse. Deux, «Milkshake Baby» qui ouvre la B avec un riffing sauvage et dévoyé, ambiance Cubist Blues, c’est-à-dire groove urbain avec des faux airs d’Alan Vega. S’ensuit la troisième raison, «Make Your Mind Pt 2», joué à la dépouille, à la fois classieux et classique. Et quatre, «Against The Wall Pt 2», toujours dans l’insidieuse, avec ce vieux relent beefhartien et joué au gras double.

Les Tearjerkers entrent dans la légende en 1999 avec l’album Bad Mood Rising. Explosion d’énergie dès «White Lie Black Eye». Ça dégouline de jus. Scott Bomar joue de la basse. Retour à la power-pop de sang royal avec «Stupid Cupid». Ça sent bon le Big Star Sound et la complexité pharaonique de la belle pop américaine. En B, il faut absolument écouter «Head Of The Class Clowns», qui sonne bien dès la première mesure. Voilà le génie garage de Jack Yarber. Il enchaîne ça avec un autre cut brillant, «Earthquake Date», du garage punk dératé monté au riff sur-puissant.
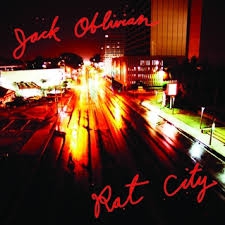
On frôle un peu l’overdose avec tous ces disques, et pourtant on y revient. Tiens ! Voilà Rat City paru en 2011 sur Fat Possum. Ce n’est pas compliqué, on y trouve deux hits, à commencer par celui qui donne son titre à l’album, qui est lancé comme une locomotive et Jack-O se montre une fois de plus imparable et lumineux. Quand on voyait ce mec traîner à l’espace B le jour du concert des Cool Jerks, on n’était pas loin de penser qu’il avait au pire une allure de rock star et au mieux le charisme d’un messie. John Paul Keith joue lead dans «Mass Confusion», monté sur un beau beat funky. Ça pulse comme au temps de l’âge d’or du swamp funk. L’autre hit du disque c’est bien sûr «Kidnapper», doté d’un fort parfum de country rock et finement nappé d’orgue. On y retrouve tout l’allant du rock du Tennessee.
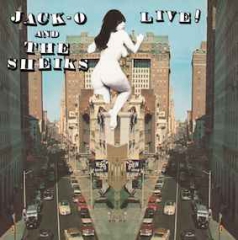
Jack-O se produit maintenant avec une nouvelle formation, Jack Oblivian & The Sheiks, et un premier album intitulé Live. Quatre bombes sur cet album, à commencer par le retour du vieil «American Slang» tiré de son premier mini-album solo. Fabuleux classique de power-pop. Imparable et juteux. Jack Yarber reste avec le temps désarmant de fraîcheur et d’aisance. Avec une telle entrée en matière, la partie est gagnée d’avance. Il ressort aussi l’infernal «Black Boots» digne des grands hits de Bob Dylan. Il éclate ça au ramalama d’accords magiques. Il ressort aussi ses vieux hits, «Night Owl» et «Flash Cube». En B, on retrouve l’excellent «Little War Child», belle tranche de power-pop universaliste. Avec Jack-O, ça joue avec le feu, ça lève le vent, ça file droit au cœur et ça mène au but. Il finit en beauté avec son vieux «Strong Come On» de l’époque des Oblivians.

Jack Oblivian & The Sheiks viennent d’enregistrer un nouvel album, The Lone Ranger Of Love. Eh oui, encore un album surprenant et si dense ! Trois merveilles caractérisées s’y nichent, à commencer par l’infernal «Hey Killer», une pop à la Jack-O pleine d’allant. Il faut l’entendre emmener ça fièrement à l’assaut des hit-parades ! Même chose avec «Downtown», pur Jack-O jive, écœurant de classe garage. On se noie dans une sauce d’obédience obliviande. D’autres gros cuts avec «Blind Love», dégringolade d’exception qui brille dans la nuit comme une idée géniale, et «Boy In A Bubble» qui marque un retour au garage. En B, attention au morceau titre, car il sonne un peu comme «Teenage Head» et un petit serpent de solo gras l’enfile en douce. On se régalera aussi des deux parties de «La Charra» grattée au gratin de menace dauphinoise, c’est joué au harcèlement apache, à petites touches infectueuses. Par contre, avec «Run Like The Wind», Jack tape un groove salubre émaillé de piano à la Aladdin Sane, dans une ambiance digne de Soon Over Babaluma. C’est à la fois exceptionnel et surprenant.

Jack monta les Cool Jerks avec David Boyer des Neckbones et ils enregistrèrent l’excellent Cleaned A Lot Of Plates In Memphis en 2002. On sent chez David Boyer une forte influence des Dolls et des Stones. «Not The Only Girl In Town» sent bon le vieux boogie des Dolls. C’est très inspiré. Ce mec semble totalement fasciné. On pourrait dire la même chose de «Who You Running To», car ça sonne comme un hit des Stones de la grande poque. On sent que David Boyer peaufine ses préférences. Avec «Why Can I», Jack et David passent directement au coup de génie. Ce démon de Jack Yarber ravage tout. Et il vrille la charpente du cut à coup de solo insidieux. Jack est vraiment le roi de la bravado. Encore de l’énormité à gogo avec «Got Damned Again» et un «Certified Fool» embarqué au riff diabolo. Voilà comme sonne le rock échevelé de Memphis, puissant et définitif. Tout l’album est bon. Trop bon. Jack pulvérise «Let’s Go And Rock» et nous fait même friser l’overdose avec «Friend Of A Loner» qui sonne tout simplement comme un hymne.

N’oublions pas l’épisode South Filthy, conglomérat de notables puisqu’on y trouve Monsieur Jeffrey Evans, Walter Daniels et bien sûr Jack Yarber. Trois album, même quatre, si on ajoute l’excellent Melissa’s Garage Revisisted paru en 1999. Leur boogie sent le fauve, on le voit tout de suite avec «It Don’t Take Too Much». Ils semblent possédés par le diable, mais un diable particulier, celui du Tennessee. Le «Rocking In The Graveyard» qui suit semble lui aussi ravagé par des guerres intestines, et c’est monté sur un beat rebondi et noyé dans le gras double. Nos amis les franc-tireurs s’amusent à créer du garage ténébreux, chargé de maladies et très insécurisé. Ils font une surprenante reprise de Marty Robbins, avec «Don’t Worry», bien congestionnée par un solo de déglingue affreusement malsaine. Ces rebs sont très indisciplinés. Dans «The Darker The Berry», la voix de Jeffrey Evans est couverte par une fuzz acariâtre. Ils tapent plus loin dans Lowell Fulson avec un «Bending Like A Willow Tree» assez furieux. Sacré disque. Aucune concession.

Le premier album de South Filthy s’appelle You Can Name It Yo Mammy If You Wanna. Sur la pochette, on voit une pute noire. Image très impressionnante. Les cuts sont à l’image de la pochette, marginalisés d’office. Justement ils attaquent avec un «Bad Girl» foutraque que Walter Daniels vient hanter à coups d’harmo. Quelle santé ! Monsieur Jeffrey Evans renoue avec le génie dès «Hot Dog», joué à la stand-up. C’est du pur rockab de Memphis. Puis il tape dans Wolf avec «Somebody In My Home». Là on ne rigole plus. Jeffrey Evans fait tout le boulot et il wahaoooute à la lune. Il chante du nez et recrée le temps d’un cut l’illusion de la légende de Wolf. Et comme si de rien n’était, il passe à la country magique, celle de Memphis qui ne doit rien à celle de Nashville. Il faut écouter ce «Sandra Lynn’s Blues» pour bien comprendre la différence. Jim Dickinson en parlait d’ailleurs très bien - I’m gonna marry her some day/ Some day - Encore une énormité avec «LA Country Jail» du boogie rock à tomber de sa chaise. C’est crédité Jeffery Lee Pierce et John Schooley y joue de la slide. Notre collectif intrépide reste dans l’excellence du boogie avec «First Train Away From You», une compo signée Jack. Si on aime les tours de magie, alors il faut écouter «Spyder Blues» de Monsieur Jeffrey Evans, un authentique blues de cabane - It’s called spyder blues/ Cripplin’ around my window before the sun - Rien de plus inspiré.
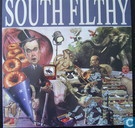
Jack retrouve ses amis Monsieur Jeffrey Evans, Jimbo Mathus, Walter Daniels et tous les autres sur Crackin’ Up, un album bardé de reprises superbes, dont un Wolf qui s’appelle «You Can’t Put Me Out» - I’m so down/ You can’t put me out whoooo-ouuuhhhh - pure énormité. On trouve aussi un fabuleux «Ran Out Of Run» qui sonne comme un classique dylanesque. Monsieur Jeffrey Evans y raconte ses mémoires. Encore du dylanesque avec «Original Mixed-Up Kid» qui est en réalité une reprise de Ian Hunter - Pour la petite histoire rappelons que Guy Stevens voulait monter un groupe qui sonnât à la fois comme Dylan et les Stones, et ce fut Mott The Hoople - Et donc Hunter se mit à pomper Dylan pour composer. Le hit de cet album se niche aussi en B. Il s’agit de «Ol Brush Arbor», un balladif folkah de Monsieur Jeffrey Evans qui tourne à l’enchantement. Et Eugene Chadbourne vient jouer du banjo sur «Flaming Star» - When I see the flaming star/ I know the time has come - Jack prend le micro pour «C’mon Let’s Monkey» et il mène la danse, comme il sait si bien le faire.
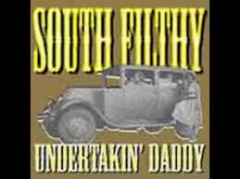
Tiens, encore un sacré disque ! Undertaking Daddy est sorti sur Beast en 2009, oui, sur ce petit label rennais qui fait maintenant tout le boulot. Si vous aimez le boogie foutraque à la sauce de Memphis, alors il faut écouter «The House On Old Lonesome Road», emmené par Monsieur Jeffrey Evans au pas de charge. Voilà du vieux boogie de bois sec tartiné à coups d’harmo. C’est d’ailleurs le seul morceau de l’album sur lequel joue Jack. Ils font ensuite une reprise du cut de Bo que préfère Keef, «Bring It To Jerome». Monsieur Jeffrey Evans en fait du Wolf ! Ils finissant l’A avec deux autres boogies de haute volée de bois vert dont un «Dimples» sacrément secoué du cocotier. Monsieur Jeffrey Evans attaque la B avec un coup de rockab de Memphis, «Watching The 710 Roll By», une espèce de modèle du genre, histoire de rappeler que tout a commencé dans cette bonne ville du Tennessee.

Pendant ce temps, Greg Cartwright n’est pas resté inactif. Il jouait dans des groupes comme des Detroit Cobras et en produisait d’autres comme Mr Airplane Man. Avant de monter de Reigning Sound, Greg s’est amusé à enregistrer un album complètement foireux, «Head Shop». On avait commandé ce disque directement chez Long Gone John, en Californie. Ah la tête qu’on a tiré quand on a écouté ça !

Et puis avec Coco des Ettes, il a monté en 2010 les Parting Gifts et enregistré un album qui nous console de toutes nos peines, Strychnine Dandelion. C’est encore un album de l’île déserte, car les hits y pullulent. Ils chantent à deux «Bound To Let Me Down» et ça donne un cut qui pourrait très bien figurer sur l’Album Blanc des Beatles, avec sa belle ambiance rondouillette. Une merveille. C’est la pop de rêve que Greg n’avait peut-être pas réussi à sortir avec les Detroit Cobras. Notons au passage qu’on retrouve les deux Black Keys sur cet album. «Starring» sonne comme un hit. C’est un hommage magistral à baby’s in black - And yesterday ain’t coming back/ It’s time to start to think about that - Il enchaîne avec un «Don’t Stop» très punky et infesté de killer solos. Greg les étale dans la poussière, les deux bras en croix. Une vraie furie ! On trouve trois hits monstrueux enchaînés en B : «Don’t Hurt Me Now», chanté au grégorien de haut rang et joué très sixties à l’encorbellement licencieux qui telle la liane enserre la colonne du temple d’Amon. Justement voilà «Hanna», encore du grand art grégorien. Sa pop a quelque chose de profondément infectueux, il faut bien le reconnaître. Elle finit toujours par nous avoir - That’s how it’s gonna stay ! - Et le festival se poursuit avec «I Don’t Wanna Be Like This», une fantastique échappée belle de pop visionnaire. Goûtez donc la puissance du refrain, c’est joué à grands coups de reins, ça jute dans l’énormité et voilà encore un hit intemporel ! Il faut aussi écouter le cut qui donne son titre à l’album, car il dérouterait n’importe quel cargo. Et le «This House Ain’t A Home» qui referme la marche est lui aussi de qualité supérieure.
Signé : Cazengler, obli terré
Oblivians. Binic Folk Blues Festival (22). 30 juillet 2016
Oblivians. Soul Food. Crypt Records 1995
Oblivians. Popular Favorites. Crypt Records 1996
Oblivians. Rock’n’Roll Holiday. Negro Records 1996
Oblivians. Play 9 Songs With Mr Quintron. Crypt Records 1997
Oblivians. Barristers Ninetyfive. In The Red Recordings 2009
Oblivians. Desperation. In The Red Recordings 2013

Oblivians. Never Enough. Sympathy For The Record Industry 1994
Oblivians. Six Of The Best. Sympathy For The Record Industry 1995
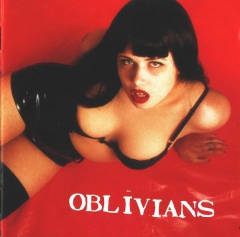
Oblivians. Sympathy Sessions. Sympathy For The Record Industry 1996
Oblivians. Best Of The Worst (93-97). Sympathy For The Record Industry 2000
Jack Oblivian. American Slang. Sympathy For The Record Industry 1997
Jack Oblivian. So Low. Sympathy For The Record Industry 1998
Greg Oblivian & The Tip Tops. Head Shop. Sympathy For The Record Industry 1998
Compulsive Gamblers. Bluff City. Sympathy For The Record Industry 1999
Tearjerkers. Bad Mood Rising. Sympathy For The Record Industry 1999
Walter Daniels, Oblivians & Monsieur Jeffrey Evans. Melissas’s Garage Revisited. SFTRI 1999
Compulsive Gamblers. Crystal Gazing Luck Amazing. Sympathy For The Record Industry 2000
Compulsive Gamblers. Live And Deadly - Memphis/Chicago. Sympathy For The Record Industry 2003
Jack-O & The Tearjerkers. Don’t Throw Your Love Away. Sympathy For The Record Industry 2001
Cool Jerks. Cleaned A Lot Of Plates In Memphis. Sympathy For The Record Industry 2002
South Filthy. You Can Name it Yo Mammy If You Wanna. Sympathy For The Record Industry 2002
South Filthy. Crackin’ Up. Rockin’ Bones 2005
South Filthy. Undertaking Daddy. Beast Records 2009
Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. Jack-O Is The Flipside Kid. Sympathy For The Record Industry 2006
Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. The Disco Outlaw. Goner Records 2009
Jack Oblivian. Saturday Night Part 2. Big Legal Mess records 2009
Parting Gifts. Strychnine Dandelion. In The Red Recordings 2010
Jack Oblivian. Rat City. Big Legal Mess records 2011
Jack Oblivian & The Sheiks. Live. Red Lounge Records 2014
Jack Oblivian & The Sheiks. The Lone Ranger Of Love. Mony Records 2016
LES ANGES NOIRS
I
JIM MORRISON
ET LE DIABLE BOITEUX
MICHEL EMBARECK
( L'Archipel / Août 2016 )
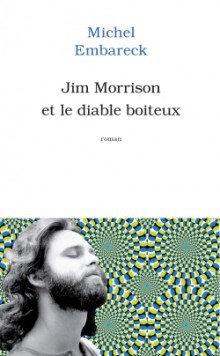
Tout se perd dans ce bas monde. Parfois les perles les plus belles gisent au fond de la mangeoire des pourceaux. C'est dans Les Echos - torchon économique à la solde du libéralisme - que j'ai appris la sortie de Jim Morrrison et Le Diable Boiteux. Et de Michel Embareck, par-dessus le marché ! Un gars que je connais depuis toujours. Je n'exagère pas, l'est né un an après moi, le jeunot. L'a ses lettres de noblesse, publie dans la Noire de Gallimard des polars plus sombres que l'encre des rotatives les plus désespérées, et l'a écrit en sa jeunesse dans un des meilleurs french canards rock, logiquement vous avez reconnu le mensuel Best. Cela vous classe un homme. Ce qui ne l'empêche pas, comme tout un chacun de se poser des questions. Attention amis rockers, le titre est trompeur, le bandeau de couverture - beau portrait du Roi Lézard sur fond de rosaces psychédéliques - aussi. Pour le diable boiteux, faut être un peu initié, référence au titre d'un reportage de Bonjour Les Amis sur... Gene Vincent.

L'est parfois des problèmes qui vous turlupinent durant des années. Pour Michel Embareck, une de ses obsessions réside en l'étrange amitié qui unit de 1968 à 1971 Gene Vincent et Jim Morrison. Quoi de plus normal que deux chanteurs de rock aiment à se rencontrer autour d'un verre ? Avec Jim et Gene, nous ajouterons plusieurs tournées. J'apporte mon témoignage personnel. L'annonce de cette fréquentation me sembla en ces époques couler de source. Expression ô combien malheureuse pour ces deux alcooliques pas du tout anonymes. Fus simplement déçu que Jim n'ait pas été présent sur la cire de I'm Back I'm Proud ( 1969 ) comme l'annonce qui avait fuité le laissait espérer. Cela eût permis de relancer la carrière de Gene. L'on parla de clauses de contrats chez Elektra incompatibles. N'en suis point sûr, Gene fut le prince noir des occasions perdues.

L'est un point de vue d'Embareck qui m'embarrasse. Assure que Jim et Gene étaient de la même génération. Aristote selon qui l'écart qui sépare deux générations est de quatorze ans et demi - le temps d'être en état érectif et menstruel de procréation - lui donne raison puisque Gene naquit en 1935 et Jim en 1943. N'empêche que chacun s'inscrit dans une époque différente. Gene est un pionnier du rock et Jim Morrison un épigone. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une scène très symbolique, le show d'Elvis à la TV sur NBC en 1968, que visionne Jim en compagnie de sa mère horrifiée - point par Presley, par son rejeton - une autre manière de tuer le père. Phantasmatiquement parlant le paternel n'est pas le géniteur. Le rôle du backdoorman - l'amant qui passe par la porte de service - pour Jim ce n'est pas Elvis, mais Gene Vincent. La vie est un miroir. Le reflet que vous entrevoyez n'est pas toujours ce que l'on croit voir. Le roman nous offre la même scène avec un triomino équivalent, Elvis sur l'écran, maman Craddock plus aimante, et le fiston Gene, beaucoup plus sympathique envers le personnage du Pelvis, car exempt de ressentiment, n'est pas jaloux de la carrière du King, l'a simplement été plus malin, l'a su tirer son épingle du jeu, avant que la partie ne devienne trop dangereuse.

Tout est question de trajectoire. Gene aborde la courbe descendante de sa course folle avec le diable - pas le cornu, cette partie noire que chacun porte en dedans de soi - et Jim sur sa lancée zénithale, est un des phares les plus illustres du mouvement hippie. Mais les apparences sont trompeuses. Tout échec comporte son point nodal de réussite symbolique et toute brillance un coeur d'ombre qui ne demande qu'à battre de plus en plus fort. Tout les sépare, Jim est le fils d'un amiral, en cheville avec la CIA pour les coups fourrés, rempli de principes, Gene est le rejeton d'un petit épicier bourré du matin au soir. Famille bourgeoise pour l'un et prolétarienne pour l'autre. Jim peut se permettre les caprices d'une rockstar et Gene cachetonne pour survivre. Mais à chacun ses failles.

Chez Gene, l'est grosse comme une maison. S'aperçoit dès le premier coup d'oeil. Sa blessure à la jambe, son atèle, ses os broyés. Insupportable douleur physique, alcool et morphine sont ses deux médicaments préférés. Mais il y a des fêlures plus insidieuses, le sentiment de s'être fait avoir par sa maison de disques, par ses managers, par les avocats, et encore plus ce relent de culpabilité qu'éprouvent ceux qui rejettent la faute de leur situation sur eux-même, leur inexpérience, leur naïveté, leur jeunesse...

Chez Jim, ne faut pas chercher bien loin la poutre qui vous crève les yeux. Un enfant instable, un mytho, s'invente des vies parallèles car la sienne ne lui appartient pas. L'est reconnu comme un des plus grands chanteurs de son époque, cela lui fait comme à Gene Vincent une belle jambe. Veut bien chanter si ça vous procure du plaisir et si ça rapporte la liberté qu'offre le pognon. Lui se voit plutôt en cinéaste ou en poëte. Embareck le rembarre sec, question ciné ne connaît pas grand chose, quant à ses écrits sont du genre illisible cafouilleux. Se fait même aider par un prof de fac pour les améliorer. Heureusement qu'Embareck n'a pas été critique littéraire, serait à l'heure actuelle l'homme le plus haï de l'hexagone !

L'on a dressé le portrait de nos deux héros. L'en existe un troisième, un chargé de liaison, joue le rôle de la boîte à lettres des récits d'espionnage, mais nous n'en causerons point, l'est fictif. Une composition d'écrivain, un truc chiadé à mort, qui pue le blues. Fantôche parce que " Entre la vérité et le mensonge existe une zone libre appelée roman". L'épigraphe du bouquin n'est pas une seconde citation d'Aristote, provient de Victor Boudreaux. Moins connu que le stagyrite, je vous l'accorde, mais qui exerce une profession fort honorable, celle d'un privé aux méthodes expéditives qui sévit dans les romans de Michel Embareck. Grattez l'écorce de l'arbre, dessous vous trouverez ce même bois qui part en fumée dès que l'on approche une allumette pour y voir plus clair. L'est vrai que l'on n'y zieute que du bleu. Du blues, car le rock en sort et y retourne. Du blues de blancs. De nègres blancs. De petits blancs. Ne faut pas exagérer non plus. Ne mélangeons pas les torchons noirs de misère avec les serviettes amidonnées aux traces séminalement suspectes. Pour Jim ce sera taches de poésie blues, et balafres de bluesy ballades pour Gene.

Pour l'histoire, ne comptez pas sur moi pour vous la raconter. Parce que vous la connaissez déjà... Alice Cooper, Toronto, John Lennon... Parce que ce livre doit impérativement faire partie de votre bibliothèque. Pour vous donner l'alcool à la bouche, je vous dirai que c'est une espèce de road-movie. En territoire d'Amérique, le pays mythique où l'on n'arrive jamais. L'est vrai que les stations - christiques et à essence - ne manquent pas. Bar à babord. Bar à Tribord. Particulièrement réussie, émouvante et sardonique, la partie qui traite des pérégrinations de Vincent de par chez nous, et morceau de bravoure, l'hommage rendu à ce dernier carré de fans français qui portèrent l'ultime carrière de Gene à bout de bras. Notons au passage combien le fantôme de Gene Vincent s'inscrit de plus en plus profondément dans les soubassements opératifs de l'imaginaire littéraire national.

Evidemment, les héros meurent. On le savait avant de commencer la lecture, mais ces scènes finales font toujours aussi mal. Embareck, de la race des polaroïdes, lève le voile pour mieux recouvrir le mystère des choses définitives. En trois mots : sex, drugs and rock'n'roll. Ce Michel Embareck, nous ne serions point offusqués si après un tel livre il signait le prochain : Michel Embarock.
II
LES ANNEES VINCE TAYLOR
DE JACQUES BARSAMIAN
( Jukebox N° 331 / Septembre 2016 )

Pas tout à fait un article, une interview de Jacques Barsamian par le regretté Bernard Boyat. Parle de Vince Taylor mais aussi de lui-même. Non qu'il ait la grosse tête, mais sa vie fut si proche de celle de Vince qu'il est impossible de séparer les deux moitiés de la poire empoisonnée. Espérons au passage qu'il soit déjà venu à Jacques Barsamian l'idée opportune d'écrire la saga de son existence consubstantiellement mêlée à l'histoire du rock français, depuis ses origines, avant même qu'il ne commence, car il était déjà présent en Angleterre avant que les étincelles de la musique du diable ne traversassent le Chanel.
Barsamian témoigne du passage surprise de Vince Taylor au Musicorama d'Europe 1 du 7 novembre 1961. Fut subjugué par la beauté de sa prestation. Mais ce n'est qu'en 1966 que par un concours de circonstances - travaillait alors à Disco Revue - il se retrouva à chercher des engagements pour Vince puis à endosser le rôle ingrat du manager. Pas une sinécure. Nous sommes loin des années flamboyantes de Vince. Les braises lysurgiques ont cramé le cerveau de Vince. Rien ne sera plus jamais pareil à la légende dorée des débuts. Barsamian arrêtera les frais en avril 1968. Raconte donc ces trois années de folie à essayer de remettre sur pied la carrière de Vince, notamment la fameuse tournée de L'épopée du Rock.

Barsamian parle sans acrimonies, nettement, mais avec pudeur. L'étoile noire avait perdu de sa splendeur. Sa course était erratique. Capable de tout. Et même de sursauts prodigieux. Le temps d'un concert, tout redevenait comme avant, les incertitudes étaient abolies, Vince était de nouveau le grand Vince Taylor. Mais le soufflet retombait aussi vite qu'il avait monté. Vince se mure en lui-même. Assis sans bouger dans sa chambre. Perdu et inaccessible. Parfois le rocker était aux abonnés accents, mais l'homme de chair restait là comme en attente d'une impossible résurrection.
Certains n'ont pas hésité de parler de déchéance. Plutôt un volcan endormi. Semble inoffensif. Mais Vince était de ceux qui avaient chaussé les sandales d'Empédocle. On le croyait paumé, l'était en train d'explorer les coulées de lave intérieures. Parfois il ressortait de son étrange cauchemar. Sa parole, comme à côté du réel, était incompréhensible car elle portait les scories du futur, mais qui aurait pu s'en rendre compte ? Son existence répondit à la seule question essentielle : qu' y-a-t-il au bout du rock'n'roll ? Répondit de la seule manière adéquate à ce no future interrogatif : érigea son existence en un silence nietzschéen. Une vie de rocker par-delà le rock'n'roll.
III
EDGAR ALLAN POE
LETTRES D'AMOUR A HELEN
( PRESENTEES ET TRADUITES
PAR CECIL GEORGES-BAZILE
et LAURENCE PICCININ )
( Editions Dilecta / Mai 2006 )

Le premier de tous les rockers américains. Par ordre chronologique. Par importance. Avec Edgar Allan Poe, le romantisme européen prend une autre tournure. Finies les plaintes élégiaques, désormais ce sera une implication existentielle, exunt les grandes révoltes sociales, le rêve replie ses ailes et s'enferme en lui-même, terminés les châteaux écossais peuplés de fantômes revanchards, tout se joue dans la citadelle intérieure assaillie par des monstres engendrés par d'atroces phénomènes auto-immunes... Edgar Poe plume le volatile des représentations extérieures jusqu'à l'os.
Ces lettres d'Edgar Poe ne sont pas inédites. Sont abondamment citées dans les biographies, mais ici resserrées en leur unicité, elles apparaissent en leur froissement êtral. Il faut l'avouer, le lecteur français a pris l'habitude de passer un peu vite sur les dernières tentatives amoureuses du poëte. Des scories désagréables, quelle femelle aurait pu rivaliser avec la virginale Virginie ? Aucune. La réponse est ferme et inébranlable. Généralement du bout des lèvres, l'on conçoit que le poëte ait pu penser à la nécessité d'une sécurité matérielle indispensable à l'émergence des dernières grandes oeuvres. Le coucou - oiseau de mauvais augure - ne pond-il pas ses oeufs dans les nids étrangers ?

Nous aurions dû être plus attentif. Mallarmé nous y avait engagé, n'avait-il pas entretenu une correspondance avec Sarah Helen Whitman, lors de sa traduction des poèmes du Sphinx ? Ne lui avait-il pas adressé son sonnet hommagial ? Non, Sarah Helen Witman ne fut pas une groupie exacerbée par sa future ménopause. Un bas-bleu comme les désignait si dédaigneusement Barbey d'Aurevilly. Son oeuvre fut un maillon essentiel du développement de la poésie américaine. Quand l'on voit le peu d'estime dans laquelle en Amérique est tenue depuis toujours l'oeuvre de Poe, relégué parmi les écrivains de troisième zone, l'admiration obstinée et combattive qu'elle porta au créateur du Corbeau fut peut-être ce qui le sauva de l'oubli littéraire.
Ce sont bien deux sincérités qui se rencontrent. Deux aérolithes venus de deux mondes différents. Sarah fut comme un havre de paix entrevue depuis le milieu tempétueux de l'ouragan, le corbeau cyclonéen aurait aimé s'y muer en paisible alcyon, mais ce fut à peine une halte. Le temps de faire sa déclaration dans un cimetière et de repartir vers de sinistres rivages. Sous les imprécations funestes d'une famille qui ne voyait que d'un mauvais oeil cette alliance de la colombe avec cet échassier décharné échappé par miracle du massacre du lac de Stymphale. Ramier voyageur par trop agité, messager de la fin, porteur des messages du Gouffre et de l'Obscur.

Pour Poe le terminus létal était proche. Tout le restant de sa vie - elle mourut à soixante-quinze ans - Sarah Helen Witman, resta fidèle à l'esprit de Poe. Jamais elle ne dérogea à son admiration native pour le poëte. Elle, qui ne fut qu'un rêve, sut rester à l'intérieur des portes de corne et d'ivoire virgiliennes de ce domaine d'Arnheim dont beaucoup auraient aimé à ce que le portail promothéen demeurât aussi introuvable et interdit que les portes du jardin perdu.
Ces lettres d'Edgar Allan Poe ne sont pas déchirantes. Déchirées.
Damie Chad.
FOIX ( 09 ) / 15 - 07 - 2016
L’ACHIL' CAFE

HOUSE OF STAIRS / 3 AM SYNDROME
WIRE
De retour à l’Achil' Café qui continue imperturbablement ses programmations rock hebdomadaires. Un volontariat digne d’admiration dans ce village de La Barre qui jouxte la cité fluxéenne davantage connue pour les trois tours de son château que pour ses groupes de rock and roll. En tout cas devrait y avoir des centaines de lieux rock hexagonaux qui piqueraient une jaunisse de jalousie s’ils avaient la possibilité de comparer la surface de leurs locaux à celle de ce lieu privilégié. Chez l’Achil' Café tout est plus vaste, la terrasse, l’intérieur, et la scène à laquelle vous serez dans l’impossibilité d’appliquer l’épithète d’exigüe. Service sympathiquement discret, et six euros pour trois groupes l’on ne peut pas dire que l’on détrousse le rocker.

HOUSE OF STAIRS

Zénitude et plénitude. L’on s’agite autour d’elle, musiciens et techniciens de l’Achil'. Reste devant son micro, silencieuse, un sourire placide sur ses lèvres d’enfant sage. Terrienne, les jambes campées sur le sol, l’émane une étrange force de son imposante stature. Quand tout sera OK, nous dira en toute simplicité bonjour, comme si elle saluait une connaissance croisée dans la rue. Sont prêts, Pierrot derrière ses caisses, Sam à la basse sur sa droite, Nico sur sa gauche en sandwich entre sa collection de guitares et son acoustique exposée sur son piédestal. Elle, Elo, n’a que sa voix. Ne croyez pas que je l’ai oublié, l’occupe tout l’avant de l’aile droite de la scène. C’est que voyez-vous un claviériste dans un groupe, ça vous détermine le son autant qu’un kimono habille un judoka. Après ce n’est qu’une question de style. Et ici, ce sera les grandes orgues.
Au début vous ne comprenez pas où vous êtes tombé. N’y a que le dôme de sa voix qui surplombe la pâte sonore telle la coupole de Sainte-Sophie, l’antique Byzance. Majestuoso. Inutile de vous débattre, vous êtes englué dedans, et vous n’en ressortirez qu’à la toute fin du set. Faut comprendre comment ça marche. Méchamment intuité. Un tutti, pas frutti mais savamment orchestré, y en a toujours un des cinq qui prend le commandement, vous êtes piégé au moment où il se retire, les deux oreilles orientées sur le soliste ont besoin de trente secondes pour piger que ce n’est plus lui qui joue, qu’un autre a pris sa place, exactement sur la même tessiture. Bluffant. Il ne court pas le furet musical, il avance lentement mais passe tour à tour de guitare en basse ou d’orgue en voix sans que jamais vous ne parveniez à saisir les lignes de fuite. Faut de sacrés musicos pour réussir ce tour de passe-passe. A la basse Sam nous dégringole de ces tourmentes de swing rampant à vous renverser tandis que Nico nous pique de ces pizzacati à vous fricasser les tympans. Ou alors il se penche sans s’en saisir sur son acoustique, comme un chirurgien sur le ventre de son patient ouvert, lui secoue violemment les tripes pour lui apprendre à ne pas demander son reste. A grands coups de pelles, Pierrot entasse les contreforts, pose la chape sur laquelle les autres édifient.
La musique est en vous. S’impose à votre cortex et phagocyte votre hypothalamus. Une gradation incessante, neuf morceaux déployés comme autant de mouvements oratorioïques pour employer un adjectif aussi chatoyant que leur cheminement. Mais à chaque fois, plus fort, plus violent. Plus incisif. Les applaudissements qui suivent chaque titre seront eux aussi à chaque station plus chaleureux et frénétiques. Mais il est temps de revenir à elle, Elo. La clef de voûte. Quelle aisance ! Vous ne parlerez pas de chant, mais d’intervention phonique. Très courtes, ou s’inscrivant dans une assez longue durée. Lentes ou rythmées. Ballades ou courses schizoïdes. Qu’importe, vous êtes surpris par l’ampleur, la netteté et la plasticité de de cette voix. Le recueillement c’est après, lorsque par sa seule rétention vous entendez le silence. Vous réalisez alors votre manque. S’est retirée comme la mer. Debout près de son micro, tranquille, laissant ses acolytes battre le fer rouge de son absence, respectant son tour comme dans la salle d’attente du docteur, revenant à point nommé pour illuminer de sa présence la secrète architecture des compositions, The Light, Black Bones, After Show / Broken, The Silent Words…

Non ce n’est pas du métal mélodique, plutôt de la mélodie rock and rollisée. Avec intelligence, ce qui est rare. Ce qui est sûr que nous sommes tous entrés dans la maison des spirales à la Piranèse. Et que personne n’a eu peur. Méfiez-vous toutefois, le chant des sirènes signale souvent l’imminence d’un futur naufrage. A vos risques et périls. Mais qui hésiterait une seconde pour embarquer vers les délices de Cythère ?
INTERLUDE
Tiens encore une fille. Le programmateur serait-il un farouche partisan de la parité ? Entre le groupe qui remballe, les régisseurs, et le combo qui s’installe, l’on ne sait plus qui est qui. Le mystère sera dénoué en un quart d’heure. Nul besoin de se rendre à Stokholm pour connaître les secrets de 3 AM Syndrome.
3 AM SYNDROME

Parfait pour jouer au triomino. Le salaire de base du rock and roll, basse, batterie, guitare. Assez de monde pour faire un boucan de tous les diables. Avec une arme aussi absolue, la galaxie est à vos genoux. Donc une fille. Aurore, nocturne. De noir vêtue, cheveux roux mi-long et peau laiteuse, le bras gauche aussi coloré qu’une bande dessinée de Druillet, une basse de laque noire entre ses mains, un petit air de prêtresse vaudou, pas méchante, mais l’a du chien. De l’enfer. Pour le sourire, l’humour et l’entertainment, vous vous adresserez au guitariste, Joris. Le monsieur jovial du groupe. Demoiselle Aurore, gavial glacial concentré sur son instrument. Vous n’imaginerez jamais le bruit qu’elle peut émettre à elle toute seule. Grande tonitruance. Remarquez que si elle veut se faire entendre, elle n’a pas intérêt à s’endormir dans son étui. Car le plus dangereux, c’est Olivier le batteur. Un fou à lier. De l’énergie à revendre. Se sert de tout le kit. Donne envie que l’on lance une souscription pour qu’il ait au moins vingt-cinq toms à sa disposition. Plus il en aura, plus il en abusera. Y a des batteurs qui marquent le rythme. Doit être un autodidacte. N’a jamais appris que ça existait. Lui il manie les marteaux de Thor et les enclumes d’Héphaïstos. L’a tout un répertoire : l’orage, la tempête, le déferlement, la grêle tueuse, le tourniquet de Sardanapale - un truc qui vous rend tout pâle - la carapace qui se carapate, la trombe furieuse, et autres joyeuses duretés dont je vous épargnerai la liste infinie. Bref, c’est un batteur. Tout simplement. Mais un vrai. Face à ce déchaînement continu tout guitar héros qui se respecte n’est pas là pour jouer au yoyo avec les cordes à étendre le linge de sa maman. Joris vous assène des riffs au marteau-piqueur et des licks à la tronçonneuse. Faut que ça rugisse, et que ça surgisse de la cuisse de Jupiter tonnant. Je résume : deux garçons qui se se toisent du regard, plus vite que moi, plus fort que moi, tu ne pourras pas. Vous certifie qu‘ils peuvent sans difficulté.

Et notre damoiselle rousse, croyez-vous qu’elle a la frousse ? Que nenni bonnes gens. S’en prend au micro. Qui ne lui a rien fait. Tant pis, elle y glapit dessus comme une hyène en furie. Le bouscule et lui hurle de ces promesses de mort si épouvantables que vous avez envie de vous tirer au plus vite une balle dans la tête. Point de précipitation, elle a plus d’une corde à son arc vocal. Vous prend un minois de petite fille sage qui quémande un tour de manège à son papa préféré. Vous ne sauriez résister, mais la lueur bleuâtre d’un projo passe sur sa face et la voici transformée en Cruella sans cœur et sans pitié. La caravagienne tête de Méduse hérissée de serpents est encore plus avenante, vous éructe de son gosier de ces sons métalliques réfractaires à toute égoïne. Nous fait le coup de la reprise de Blondie. Bye bye la blondeur des rêves. Vous la troque à la tignasse noire, mèches dark et toupet gothique, imaginez une Evanescence qui aurait avalé le stock de speed des douze pharmacies du quartier. Mais agitée en-dedans, parce que d’extérieur s’applique sur sa basse sans le moindre zeste d’énervement. Tout dans la voix.
On joue du rock and roll. C’est ainsi qu’ils s’étaient présentés en début de set. Ont splendidement tenu leurs promesses de déjantés durant la moitié du concert. Z’ensuite, se sont laissés piégés par leur propre violence, sont passés au rock and funk, bien calibré certes, mais dans l’accumulation répétitive des saccades rythmiques ils ont oublié la folie meurtrière du rock and roll et commis l‘irréparable crime de la désagrégation quantique de l‘énergie. Dommage. Nous les reverrons tout de même avec plaisir.
INTERLUDE
Minuit moins dix. Zut Cendrillon m’attend. Ô Damie tu me récupères devant le ciné à minuit, ce serait si gentil ! Je fonce comme un madurle au volant de la teuf-teuf durant le changement de matos. N’ayez crainte, entre temps la princesse au petit pois ( dans le cerveau ) a changé de programmation et de ciné ! Bref quand nous revenons, Wire entame son deuxième morceau. Elle s’assoit en se bouchant les oreilles Ô Damie quel changement d’ambiance, comment peux-tu supporter une telle horreur !
WIRE

Elle a raison un rocky horror show. Autant dire que j’adore. Sont quatre, le batteur derrière et les guitares en première ligne. Tactique d’attaque ultra-simpliste mais ô combien efficace. Une horde de broncos en plein galop dans l’horizon sans fin des grandes plaines. Pleines d’électricité. Le chanteur, Eric envoie les lyrics, juste ce qu’il faut, mais ce n’est pas ce qui les intéresse vraiment. Eux ce sont les grandes chevauchées électriques à la poursuite du rock and roll perdu qui les motivent. Se marrent entre les morceaux. De vieux briscards qui se lancent des défis avant la charge héroïque. Un galop de drummin’- Patrick insatiable aussi effréné que les huit sabots fous de Sleipnir, un bassiste qui se prend pour un guitariste soliste, et quasiment deux leads, Eric et Phillipe, qui entrecroisent le torrent bondissant de leurs descentes éblouissantes. Quand ils sont lancés, le combo vous prend des allures de Poupées de New York qui ne chipotent pas des heures à admirer leur rouge à lèvres devant la glace de leur salle de bain. Let me go, Evil Mind, Like a Schizo, No Justice, les morceaux se suivent et se ressemblent comme des gouttes de nitroglycérine. Genre de gars qui ne regardent que les scènes d’action dans les westerns les plus sanglants. Pas de temps à perdre, le rock and roll n’attend pas. Lui courent derrière et parfois même le dépassent. Wire vire en tête.

Moins de monde que pour les deux groupes précédents. L’on a dû évacuer les âmes sensibles, les vieillards, les femmelettes et les enfants de moins de douze ans. Saines précautions, tout le monde ne supporte pas les doses de rock and roll à haut-voltage. Les Wire pourraient vous occasionner des lésions cérébrales irrémédiables. Oui, c’est juste du rock and roll, mais l’on aime ça. Esprits fragiles s’abstenir. Rock and rolliser tue.
Damie Chad.
FOIX ( 09 ) / 12 - 08 - 2016
L’ACHIL' CAFE

THE RED’S LYGHT
L’est des lumières rouges qui s’allument dans votre cerveau et qui malgré les années refusent de s’éteindre. Les avais vues en août 2011 ( voir KR’TNT ! 62 du 01 / 09 / 2O11 ). Cinq ans déjà, durant lesquels elles se sont obstinées à donner des concerts à des dates où je n’étais pas, à un ou deux jours près, en Ariège. Mais enfin ce soir, elles passent à l’Achil' Café, un rendez-vous à ne pas manquer, c’est qu’elles m’avaient séduites ces quatre jeunes filles, le groupe phare de ce mini festival de village, la plus inexpérimentée des quatre formations présentes, mais la plus définitivement rock and roll. Etaient habitées par la décisive innocence expérimentale de l’adolescence.

Ne m’échapperont pas. Tiennent la caisse. Se sont partagées les tâches, une qui annonce le prix, une qui rend la monnaie, une qui vous tamponne l’avant-bras et une qui vous passe un bracelet fluo autour du poignet. Jamais fans de rock and roll n’auront connu lors d’un concert un accueil aussi charmant. Précisent qu’elles seront sur scène d’ici une petite demi-heure.
ALERTE ROUGE
N’ont pas menti. Sont exactes au rendez-vous. Elles ont grandi. Ne sont plus des lycéennes mais gardent toujours cette fraîche beauté qui leur va si bien. Toutes gracieuses dans leur short noir et leur t-shirt rouge. Ont même teint leur main d’une substance censée se colorer en rouge sous la lumière des projecteurs. Trois sur scène, Cécile au fond derrière sa batterie, LN au longs cheveux blonds à la basse sur sa gauche, Lauriane guitar lead à sa droite abondante crinière brune qui ruisselle sur son dos à sa gauche. Audrey les rejoint dès le commencement des hostilités pour s’emparer du micro. Que sont-elles devenues depuis tout ce temps ? N’aurai besoin que de trois minutes pour être rassuré. Ont évolué dans le bon sens. Toujours rock and roll.
Céline, un visage décidé et une poigne de fer. N’allez pas lui marcher sur les pieds, elle sait taper, rapide et varié. Un drummin’ raisonné, sans perte de temps, utilise toute sa batterie, frappe avec ses baguettes et avec sa tête. De l’instinctif intellectualisé, sait ce qu’elle veut faire et ne se trompe jamais de chemin. Si elle était le petit chaperon rouge, le loup aurait du souci à se faire.
Laurianne est du même bois apollinien. Vous ne savez jamais comment elle va réagir, mais dès qu’elle touche ses cordes, vous ne pouvez qu’être d’accord avec elle. Fait attention à ne pas se répéter. Chaque cas mérite sa propre solution. Propose la meilleure. Droit au but. La facilité et l’à peu près ne l’intéressent guère. Précise et adroite, un jeu intelligent et économe. Dans l’histoire de Guillaume Tell elle serait la flèche qui pulvérise la pomme. Vous vise en plein cœur.
LN inscrit sa longue silhouette dans la légende des bassistes enfermés dans leur tour d’ivoire. Joue comme en-dedans d’elle-même. A peine quelques sourires. Mais qui trahissent son attention. Paraît loin de nous, mais très près de ses camarades. Ne les laisse pas en rade. D’ailleurs elles ne s’inquiètent point pour elle, sont sûres qu’elle assure. Dans le poème de Leconte de Lisle, elle est le rêve que l’animal sauvage jamais n’achève.
Audrey est le reflet inversé des trois autres. La grande communicante. Elle chante et elle parle. L’interface agissante. Naturelle et ouverte au monde. Elle est le bateleur et le fou du roi ou pour être exact la fofolle de ces trois reines penchées sur le rouet de leur instrument. Amuse la galerie, dans la belle au bois dormant, elle est l’instant merveilleux d’après le baiser de vie quand le palais s’éveille et bruit de mille cris de joie.
Ne la prenez pas pour la folle de service, dès qu’elle arrête de parler elle se révèle telle qu’en elle-même le chant la change. L’est plus qu’au point. C’est elle qui démontre l’extraordinaire cohésion du groupe. Elles ont bossé comme des madurles. Tout tombe pile à point pour un public qui manifeste sans attendre son plaisir en applaudissant à chaque performance. Sont des malines, n’ont pas construit leurs morceaux à la diable, les ont intuités, des pièces de haute précision, remplies de chausse-trappes rythmiques, qui vous ménagent feintes traîtrises et heureuses surprises, mises en valeur par la voix claire et haute d’Audrey. Un vocal ensoleillé, qui sait moduler et crier, l’en fait ce qu’elle veut et ce qui est le plus fascinant ce sont ses arrêts impromptus qui vous laissent sur votre faim tout en vous rassasiant pleinement.

Un set performatif, n’ont pas inventé le rock and roll mais elles le perpétuent avec aisance et élégance. Rappel obligatoire pour nos quatre jeunes filles. Dommage qu’il y ait un groupe derrière. Le public les regrettera. Je suis content de moi. Ne m’étais pas trompé, voici cinq ans. Ont encore un énorme potentiel. Très proches des girls bands américains.
Damie Chad.
P.S. : pour le groupe d’amateurs de variétoche qui a suivi, je serai gentil en omettant de citer leur nom.
20/01/2016
KR'TNT ! ¤ 265 : DAVID BOWIE / RENE MILLER TRIO / VINCE TAYLOR / BILLIE HOLIDAY / CULTURE ROCK
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 265
A ROCK LIT PRODUCTION
21 / 01 / 2016
|
DAVID BOWIE / RENE MILLER TRIO VINCE TAYOR / BILLIE HOLIDAY CULTURE ROCK |
BOWISTITI
Janvier 2015, gare de Rouen. Il promenait sa gueule enfarinée au long des présentoirs de magazines. Les médias s’étaient emparés de Bowie. Cette beauté cadavérique s’affichait en couverture de tous ces pauvres magazines qui ne servaient plus à rien. Bowie était né illusion, et il repartait illusion, décorant par le design de sa grâce l’ultime stade de la futilité des choses.
Pendant tout le trajet, il fut incapable de reprendre la lecture de cette grosse bio d’Aretha qu’il avait emportée. Sa pensée courait après le vif-argent, c’est-à-dire le souvenir d’une sorte d’enchantement musical qui datait de plus de quarante ans. Il laissa son regard errer sur les campagnes blafardes qu’éclairait péniblement le jour naissant. Comme ce fut le cas pour bon nombre de gens de son âge, la trilogie «Hunky Dory»/«Pin Ups»/«Ziggy Stardust» avait laissé en lui une sorte d’empreinte magique.
Nous vivions alors l’âge d’or du glam britannique. En ce temps-là, les journalistes anglais firent de Bowie une sorte de demi-dieu. C’était bien le moins qu’ils pussent faire. Nous assistâmes effarés à la naissance puis au sacrifice de Ziggy Stardust. Nous n’en étions plus au stade du raffinement ni du dandysme dont nous nous gargarisions tous alors, mais au stade de la pure intelligence. Comme Dylan, Bowie nourrissait une vision. Comme Dylan, il réussit miraculeusement à se protéger de la pression médiatique pour continuer à exister artistiquement. Et comme Dylan, il allait réussir à bâtir une œuvre à l’échelle d’une vie. Et comme Dylan, il n’allait hélas jamais réussir à retrouver l’éclat de son âge d’or.

ABSOLUTE BIGORNEUR
Wham bah-bah-bah bam ! David Pinup traverse la Tamise, remonte Charing Cross Road, tourne dans Shaftesbury et reprend à gauche pour enfiler Wardour Street jusqu’au Marquee. Vrooaar ! La béquille de son scooter frotte au sol et sème dans son sillage de belles gerbes d’étincelles. This is the swingin’ London, baby. Teenage vitesse en deux roues, parka, mocassins et quête d’un Graal électrique. Here comes the nightssssssss, surtout bien tirer sur l’alangui du nightssss de Van Morrison, yuuuu-yuuuuu, bien laisser la mélodie se faufiler dans l’entre-jambe du taille basse en tartan, et voir enfin la fumée de sa clope dessiner une arabesque dans l’infinie décrépitude du crépuscule de l’Empire britannique. Yeah, la nuit tombe sur Londres et les vampires wham bam se fondent dans la nuit. Magnifique de blancheur cadavérique, David Pinup arpente la rue, suivi d’un air de sax - oh it makes me want to die.
Pourtant petit marquis, David Pinup vient se prosterner devant Syd Barrett dont l’Emily Play lui plait. Oh oui, il assiste à la barrettisation des choses. Il sait qu’un jour, il n’y aura pas d’autre jour - There is no other day - Ah si Syd le dit, alors... Mais Good Lord j’essaierai quand même, je tenterai le chant d’accent frêle d’un Lord à la dérive mais qui surtout ne laisse rien paraître... Oh je ferai tinter des médailles grandiloquentes sur un accord de guitare à l’agonie... Oh je porterai l’art psychédélique jusqu’au bout de la décadence vidée de tout son sang et je ferai renaître des cendres le phénix d’une beauté irréelle. Il tend les bras vers le ciel - Soon after dark Emily cries - Comme j’aime à me laisser couler au fond des ténèbres glacées de Soho ! Et il jette toute sa déchéance génétique dans la balance du destin.
— Ah tu veux fixer le temps, petit marquis ?
— Qui es-tu ?
— La Forme Des Choses...
— What ya mean ?
— Shape Of Things !
— Aw je vois, Shapes of things before my eyes ! Viens, viens, my lonely frame prodigieusement moderne dans les lumières de Londres ! Viens viens que je te réinvente, que je te sacralise, viens que je te hérisse d’épis pareils aux miens et que je redore tes ailes de fringuant Yardbird ! David Pinup lève l’oiseau magique à bout de bras et le jette en l’air pour qu’il s’élève et qu’il disparaisse, à l’image de toute chose.
— Ainsi finira-t-on tous, murmure le petit marquis, hantés et dévorés par la nostalgie.
Il décide enfin d’entrer dans le Temple. Quel jour somme-nous ? Oh vendredi ! Friday on my mind ! David Pinup chante d’une voix de nez pointu. Il colle comme l’alpaga des grands soirs à la peau de la mélodie - Monday morning feels so bad - La terre entière a chanté ça, car c’est le chant d’espoir des ouvriers, oh cette semaine qui n’en finit plus, monday, tuesday, wens’day et la fièvre maligne monte dans le chant, un héros apparaît, semblable à ces milliards de kids qui se déversent dans les rues chaque vendredi soir - Gonna have fun in the city - David Pinup s’électrocute sur la chaise du destin, wow, dans ses veines bat l’easybeat, il est en cette seconde précise l’un de ces heroes qu’il chantera quelques années plus tard, il joue avec la violence pop et les zones de béatitude mélodique, il sait que cette magie inventée par Harry Vanda et George Young peut couvrir d’or n’importe qui - Tonight I spend my bread - Et conduire aux portes de la renaissance - Tonight I lose my head - Rock’n’roll suicide !
— Où suis-je ? Il semble paniqué.
— Anywho, lui répond la mélodie décadente.
— Oui mais who ?
— Anyway, lui redit la voix de gorge lubrique.
— Wait !
— No way ! Anywhere !
Tout le monde sait que les Who n’ont pas le temps. Alors David Pinup les chante d’une voix de gorille échappé des jupes de Victoria. Il colle si parfaitement à la folie des Who qu’il va les voir jouer sur scène chaque vendredi - I can go anyway/ Way I choooose - On jerke dans le magasin de porcelaine secoué par un tremblement de terre. Au Marquee, le marquis saute dans des dégaines et s’arroge la modernité des temps. Whooo ! Whooo ! Il recherche le stade ultime de l’exaspération, de l’outrance atrocement mal contenue, il souffre comme l’orgasme qui menace d’exploser dans les mains d’une reine dévoyée. David Pinup s’enivre de l’effluve des Who et de tout ce rock qui n’en finit plus de jaillir en giclées laiteuses dans le satin mordoré des nuits londoniennes. Il sait au plus profond de lui - Deep inside my heart, comme dirait Dylan - qu’en dépit de son essence errante, l’Anyway Anywho Anywhere brillera comme un phare dans la nuit et s’imposera dans l’histoire des hommes comme un poids lourd de conséquences.
La brume quand point le matin retire aux vitres son haleine. David Pinup pourrait chanter Aragon, mais il lui préfère Rosalyn. Il lui demande même des comptes. Rosalyn, tell me where you been, arrghhh ! Il a vu Phil le faire, alors il le fait à son tour. David Pinup vénère Phil et Vince Taylor parce qu’ils sont les seuls à oser s’habiller en blanc sur scène. À ses yeux, ils apparaissent comme des demi dieux. D’ailleurs Ziggy va naître aux pieds de Vince Taylor. En dépit de toutes ses certitude aristocratiques, David Pinup ne peut pas s’empêcher de poser cette question désespérée : Do you really love me ? L’amour de Phil est plus fort que tout. David Pinup comprend instinctivement cette sauvagerie. Il est devant et il voit Phil et Viv ramper sur scène - I’m on my own/ Nowhere to roam - Le beat Don’t Bring Me Down se dresse pour l’éternité. Il fécondera d’autres imaginaires, dans d’autres civilisations, bien après que nous soyions tous redevenus poussière. Comme Phil, David Pinup recherchera les cris de véracité rentrée, il tordra le bras d’une syllabe ici et là pour qu’elle couine comme une mijaurée, et ils plongeront le chant du rock dans l’enfer de la volonté sacrée. On verra aussi le petit marquis secouer ses cuisses et agiter ses guêtres. Alors, le coup d’harmo lui coulera dans le dos comme une giclée de semence. Comme Phil, le petit marquis organisera - I wander round/ Feel off the ground - la meilleure orgie des sens de tous les temps. Ah il faut le voir poser son down...
Puis il pissera à la raie du temps en compagnie de Ray. David et Ray n’en finiront plus de se lamenter aristocratiquement - Won’t you tell me where have all the good times gone ? - On assistera là à une sorte d’expertise de la décadence du won’t tell me, et cette expertise s’étendra jusqu’à l’horizon. Et puis quelque part dans la culotte du temps viendra rôder une fuzz. Alors tout redeviendra ineffablement médusant et sexuel. Mais qu’on ne se méprenne pas, ces gens-là ne sortent jamais l’artillerie, non, ils sont beaucoup plus virils puisqu’ils suscitent à coups de reins, dans le secret d’un art superstitieux. David Pinup ahane si bien qu’il évoque le râble d’un blaireau maté. Il assène ses coups fantastiques d’on the ground et il donne de la fuzz à la fuzz comme d’autres donnent du temps au temps. Hanté par le génie de Ray Davies, David Pinup roule comme un carrosse à travers la nuit des temps.
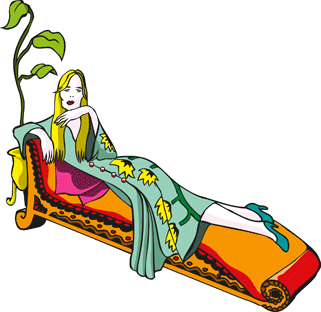
HUNKY PANKY
Les brumes d’automne léchaient les murs lépreux du manoir victorien de Hadden Hill, à Beckenham, une localité sise dans les faubourgs de Londres. Hunky Panky s’y tenait reclus, fuyant les assommantes vulgarités de la foule et la brûlante morsure des échecs.
Londres venait de réprouver The Hype, un groupe d’avant-garde qu’il comptait emmener au sommet des charts, épaulé par Mick Ronson et Tony Visconti. Ce cuisant échec l’avait profondément meurtri. L’aimable Hunky Panky renfermait comme l’huître la perle une nature à la fois quintessenciée et nubile.
Il gisait là, répandu sur une bergère vénitienne tendue de pourpre duveteuse, le regard embué de morosité. Il fuyait l’impitoyable nuisance des petites misères. Il caressait ses cheveux qui avaient la clarté de l’or pâle. Il sombrait dans des torpeurs hantées par de sourdes clameurs puis, pour éviter que son ennui ne devînt sans borne, se reprenait en songeant à de nouvelles chansons parées de scintillements mystérieux et pervers.
Il préparait ainsi «Hunky Dory», son prochain album. Pour attiser le brasier de sa mélomanie, il se laissait volontiers hanter par le spectre de Syd Barrett dont les couplets au fumet spécial, les mélodies aux charmes délirants, les contines aux accents dépravés achevaient d’irriter sa cervelle ébranlée.
Oh ce n’était pas tout. Il avait goûté à l’immense privilège de voir Vince Taylor sur scène. L’Anglais parut sur scène affublé d’une robe blanche. Pour les fidèles massés à ses pieds, il incarnait la résurrection. Hunky Panky vénérait Vince Taylor, un personnage suprêmement atypique qu’un solide abus de stupéfiants avait rendu emblématique. Au nombre des demi-dieux, Hunky Panky comptait aussi The Legendary Stardust Cowboy, une âme errante qu’on vit s’éloigner dans l’infini d’une lamentable désuétude.
Immergé dans l’eau stagnante de ses adorations, Hunky Panky sentait monter en lui le levain de touffeurs androgynes qu’exaspérait encore le camaïeu évanescent de sa tenue. Une robe d’homme moulait son corps d’éphèbe décavé. Celle-ci s’ornait d’un motif japonais représentant un boisseau de renoncules tendancieuses distribuées par une longue tige. Cinq boutons ciselés dans l’écaille de tortue fermaient cette robe sublime par le devant.
Hunky Panky prenait de longues poses accablées et mornes. Il levait une tasse diaphane et goûtait à petites gorgées un thé parfumé et bistre acheminé d’Orient par d’antiques caravanes. Autour de lui, les meubles sculptés dans des bois violets et fumés d’amarante imitaient les contractions du plaisir et les volutes des spasmes.
Hunky Panky grattait finement les douze cordes de sa guitare et parait son immense solitude de chansons d’un grand raffinement. Il désirait qu’elles fussent parfaitement aptes à tuer l’ennui, ce mal qui rongeait implacablement les jours. Il venait d’épuiser toutes ses ressources, notamment celles que prodigue la littérature. Il avait abusé, à s’en griser, des imprécations suroxygénées de Nietzsche, sucé jusqu’à la moelle les éditions complètes d’Aleister Crowley, une œuvre rongée par des syphilis et des lèpres, tout cela dans les âcres tourbillons des spirales haschichines. Il lui fallait revenir à des exhalaisons plus civilisées. Il n’entrevoyait qu’un seul moyen d’y parvenir : il lui fallait composer des chansons rares et précieuses qui brilleraient de l’éclat de topazes brûlées.
Angela Barnet, une Américaine au corps bien découplé et aux membres d’airain traversait la pièce. Elle évoluait, parée d’une robe de soie dont le frou-frou imitait le bruit d’un ruisseau. Il régnait à Hadden Hill un lourd parfum d’hédonisme.
En passant languissamment les accords de «Changes», Hunky Panky éprouvait la piquante satisfaction qu’éprouve le stratège à voir ses manoeuvres couronnées de succès. Il brassait avec les douze cordes de sa guitare un extravagant fouillis de notes lumineuses, et chantait d’une voix pincée, volatile et fruitée :
— Oh yeah, Mmmmm... Je ne sais toujours pas ce que j’attendais... Et le temps passait tellement vite...
Sa voix commettait de délicieux écarts :
— Un million d’impasses... Chaque fois que je croyais que c’était dans la poche, je sentais que ça n’allait pas...
Entre deux passades d’accords, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses, il laissait un gémissement glisser le long de pentes éhontées. Il débouchait alors sur une ample phrase musicale, ouvrant soudain une échappée de panorama absolument immense.
— Ch-ch-ch-ch-changes... Tourne-toi et affronte le stress... Ch-ch-changes... Je ne veux pas devenir meilleur...
Achevé, ce magnifique spécimen de self-encapsulo manifesto brillait comme une pierre rare, de celles qu’on voit luire au front des reines antiques peintes par Gustave Moreau. En se retirant comme la marée, «Changes» laissait Hunky Panky épuisé, ahanant sur un rivage imaginaire.
Il concevait «Hunky Dory» comme une généreuse brassée d’hommages. Il en destinait un à Warhola, ce peintre d’origine polonaise établi à New-York et dont le génie sérigraphique commençait à éclabousser les cimaises d’Amérique. Voulue maniérée à l’extrême, cette chanson modestement intitulée «Andy Warhol» s’ouvrait sur une longue note errante bientôt mariée à un voluptueux accord de flamenco. Les grandes pompes suivaient, pareilles à ces cortèges qu’on voit défiler les jours de funérailles nationales et le couplet déroulait son cours, aussi vibrant qu’une note argentine. Hunky Panky se voulait si sincère dans son hommage qu’il s’étranglait presque, au moment de psalmodier le refrain :
— Andy Warhol a l’air d’un cri... Je l’accroche sur mon mur... Andy Warhol, écran d’argent... Je ne distingue rien du tout...
Il achevait chaque morceau le corps renversé à l’arrière, secoué de spasmes, comme frappé par cette singulière maladie qui dévaste les races à bout de sang. Mais voyant ses chansons sauter allégrement par dessus les bornes de la musicalité, il reprenait des forces. Il se redressait lentement et passait d’un geste las à l’œuvre suivante.
«Oh You Pretty Things» se présentait comme un boogie et s’arrêtait bien vite au seuil d’un couplet dépenaillé qu’une mélodie d’une saveur fatale emportait aussitôt. Et le refrain s’écoulait alors de la gorge de Hunky Panky comme une fontaine d’eau bleue :
— Oh, you pretty things... Ne savez-vous pas que vous rendez fous vos pères et vos mères ?
Il écrivait des refrains à caractère sacerdotal qu’il ajustait comme des parements sur de féériques apothéoses. Il lui arrivait de perdre connaissance. Il revenait à lui un peu plus tard. Il ramassait sa guitare, échappée de ses mains pâles, pour s’attaquer à la chanson suivante.
Issue des profondeurs ondoyantes de sa gorge, «Life On Mars» surgissait comme une grande composition à dimension cosmique et tragique à la fois. Conçue comme un hommage à Frank Sinatra, «Life On Mars» déployait, ainsi que le corbeau d’Edgar Poe, d’immenses ailes noires marbrées de reflets bleus.
D’œuvre en œuvre, Hunky Panky étendait son empire, le corps parcouru de frissons répétés et majestueux. D’une lenteur anémique, comme privée de forces et déjà harassée, une rengaine nommée «Quicksand» s’élançait pour s’en aller plonger dans un océan de désespoir. La voix d’Hunky Panky revenait parfois à la lumière, révélant ses accents dorés et craquelés. Il poussait sa plainte avec une grâce infinie, se complaisait aux affres d’un faisandage sommaire et ralenti. Son art blet atteignait aux sommets de la déliquescence. Il lâchait en soupirant des paroles charnues et molles qui sentaient le fauve. Sa voix épousait toutes les nuances de la perversité, elle modulait des paroles opaques, sulfureuses et comme jaunies de bile. Sa voix hissait vers la cime de l’art de douloureuses imprécations aux lueurs vitreuses et morbides. Elles jaillissaient de ses lèvres en jets fiévreux et aigres. Son esprit saturé de littérature, d’art et de décadence l’emmenait si haut qu’il paraissait se détacher du genre humain. Chanson après chanson, il bâtissait une œuvre désespérée et érudite. Il établissait dans un recoin d’ombre le nid d’un enchantement singulier et incantatoire.
Hunky Panky sentait qu’il s’épuisait. Il peinait à reprendre souffle, mais il lui fallait encore rendre hommage à Bob Dylan. Rassemblant ses dernières forces, il s’élança hardiment. Il attaqua «Song For Bob Dylan» d’une voix de nez pincé, retrouvant le secret perdu des arcanes dylaniennes.
Ayant rendu un bel hommage au peintre Warhola, il se sentit dans l’obligation saluer le Velvet Underground, une formation new-yorkaise qui exerçait sur lui une réelle fascination. Se sentant faible, il s’inspira à la hâte de «White Light/White Heat» pour interpréter «Queen Bitch» à la volée. Hunky Panky balançait ses épaules et martelait ses paroles :
— Je suis au onzième étage... Et je regarde les voitures qui circulent.
Ses pieds chaussés d’une feutrine de Syrie battaient sèchement le tempo. Quelques bouffées de chaleur lui rougissaient les pommettes. Il battait ses accords d’une main ferme et un sang barbare irriguait des veines que les excès avaient rendues poreuses. Le refrain recelait ce petit goût de vacherie musquée. Des coquetteries vocales l’humectaient d’une pluie d’essences félines sentant la jupe :
— Elle porte des fripes en satin qui bruissent... Une redingote, et un chapeau haut de forme... Oh God, je pourrais faire beaucoup mieux !
D’un geste lent, il chassa le voile qui commençait à lui obscurcir les sens, car il restait à explorer les corridors de la folie avec «The Bewlay Brothers». Il se préparait à fouailler les tensions exagérées de son cerveau, lesquelles avaient singulièrement aggravé sa névrose originelle et épuisé le sang déjà frelaté de sa race. En interprétant «The Bewlay Brothers», Hunky Panky allait s’enivrer sans limite des magies du style et attiser le délicieux sortilège de la note rare.
— Dans les coulisses d’où jaillissaient des aboiements... Nos dents de cuivre brillaient... Nous nous dressions dans l’ombre, oh... Et nous disparûmes.
Il poussait le couplet à se jeter dans l’insondable repos d’un néant béant, puis il levait d’une voix ample le rideau sur un horizon lustré de lumière blafarde. Hunky Panky passait des brassées d’accords magnifiques et bizarres. Il atteignait des régions mélodiques inexplorées, jouant sur sa guitare des combinaisons de notes évaporées d’une nature démente et sublimée. «The Bewlay Brothers» brillait d’une flamme liquide et sale. Cette immense chanson paraissait dégager une lumière d’un beau vert argenté. Elle scintillait d’un authentique éclat lunaire.
Aux dernières notes de ce morceau mirifique et spectral, Hunky Panky ressentit une violente douleur à la poitrine. Il savait que la vie le quittait. Rassemblant ses ultimes forces, il tituba jusqu’à la haute fenêtre et l’ouvrit. Son corps se prostra subitement. Il s’affaissa, privé d’air, sur la barre d’appui de la fenêtre.
En mourant, Hunky Panky donna naissance à Ziggy Stardust.

SANTA MONI CAT
Friday on my mind at the Santa Monica Civic Auditorium ! «Ziggy’s first american tour !» lit-on dans la presse. La sono du Civic envoie «L’Ode À la Joie» de Beethoven rouler sur la foule. Stephen Della Bosca se pince le bras au sang quand il voit arriver Ziggy Stardust sur scène. Comme tous les kids californiens agglutinés au pied de la scène, Stephen encaisse un choc d’une rare violence : le choc du futur. À la suite de Ziggy, the Spiders From Mars débarquent sur scène dans leurs space suits. C’est comme de voir le corps d’une femme nue pour la première fois : la fulgurance dépasse les facultés d’assimilation.
L’expression British rock star paraît même désuète en de telles circonstance. Stephen est bouleversé, ces fuckers de journalistes anglais ont menti ! Fucking liars ! Ziggy Stardust brille d’un tout autre éclat. Il est bien au-delà de tout ce qu’on a pu raconter ! Il réinvente le rock, exactement de la même façon qu’Elvis l’avait inventé. En une seconde, Stephen comprend que Ziggy ramène sur scène des trucs nouveaux, la bisexualité, c’est-à-dire la provoc ultime dans ce monde d’hommes qu’est le rock, puis l’indicible menace du Clockwork, directement puisée dans la mythologie Kubricko-Burgessienne. Et surtout un parfum enivrant de futurisme. On ne parle même pas de la beauté, qui fulgure tant qu’elle paraît logique, comme offerte en prime.
Sous un haircut rouge carotte luit d’un pâle éclat son visage fardé de blanc. Il porte une guitare acou en bandoulière et s’approche du micro. Bam ! «Hang On To Yourself» sans transition, la plus élégante des intros pour un set qui va transformer quelques vies, dont celle d’un Stephen qui frémit comme un étalon sauvage, planté dans ses boots argentées - Com’on com’on/ You’ve really got a good thing going - Ziggy le trépigne au com’on com’on et Ronno des Batignolles riffe au petit trot la charge de la brigade légère - We’re theee Spiders from Marchhhh ! - C’est un coup à tomber à genoux, Ronno vrille la voûte du Civic et de l’autre côté Trevor Bass Boulder broute le beat avec la mine peu avenante d’un charognard cosmique. Pourtant sevrés de miracles par Walt Disney, les kids californiens n’en reviennent pas. Stephen se sent désaxé pour la première fois de sa vie. Il sent son orbite se dématérialiser. Une bouche le suce, une vie nouvelle lui glace le sang. Ce qu’il éprouve défie les normes du plaisir. Oui, car Ziggy s’adresse à l’intellect - You’re the blessed, we’re the Spiders From Mars - Dans les villages de Palestine, le Christ ne procédait pas autrement. Il s’adressait lui aussi à l’intellect. Stephen dévore Ziggy des yeux. Jamais encore il n’avait senti une telle animalité chez un mec. Ziggy contrôle le moindre de ses mouvements, le battement de paupière comme le pas - Ziggy played guitah, jamming good with Weird an’ Gilly - Le public ovationne Ziggy qui raconte l’histoire de Ziggy. Il joue de la guitare de la main gauche dans les Spiders - Became the special man - Et la magie se répand sur le Civic. Ronno claque son Sol et son Si mineur avec une telle indécence que ça devient le passage d’accords le plus célèbre du monde. Ronno joue au gras des marquis, avec la plaisante lourdeur d’un bras chargé de dentelles et de bijoux. Sous son casque de cheveux platine, il challenge la suprématie de Ziggy, d’autant qu’il s’est peint les lèvres en rouge.
Ah yeah fait Ziggy et dans la précipitation, il scande - I still don’t know what I was looking for - Il déroule ce magnifique délibéré d’essence princière qu’est «Changes» - Tchooo tchoooo tchoooo tchoooo Changes - qui laisse la Californie sans voix car jamais une telle épopée n’était encore alors arrivée jusque là. En empruntant cette chanson à Hunky Panky, Ziggy délie la dragée haute d’une civilisation usée jusqu’à la corde. Ronno monte au micro et approche sa bouche de celle de Ziggy pour chanter avec lui. Chacun dans le public semble se réajuster mentalement au fil des cuts. Personne n’était préparé à un tel spectacle. Ziggy pointe le doigt vers l’espace - Sailors fighting in the dance hall/ Oh man ! - et il enchaîne avec l’infinie délicatesse de «Life On Mars». Il se fond dans les encorbellements cristallins de motifs corinthiens et d’arabesques mauresques que dessine Ronno sur les cordes de sa Les Paul en or massif. Ziggy tend la main. Five ? Oh yeah - Pushing thru the market square - «Five Years», beaucoup trop anglais pour venir de la planète Mars. D’autant qu’il voit des boys, des toys, des electric irons and Teevees, alors c’est louche. Stephen s’en émerveille, lui qui est d’un naturel si inquiet. Ronno fait monter sa mayo jusqu’à la prolifération orgasmatique - So many people d’encorbellement majeur.
C’est le moment que choisit Ziggy pour emmener tout le monde dans le cosmos - Grand control to Major Tom - fantastiquement gratté à l’accord, et Ziggy recrée la pop dans une dérive interstellaire - Planet earth is blue and there’s nothing I can do - Tant de beauté à l’image d’une infinie détresse. Ziggy décrit en quelques phrases l’absolu de la solitude : être perdu dans l’espace, sans aucune chance de pouvoir regagner la terre. Il invente le romantisme futuriste. Les Californiens ne sont pas préparés à une telle épreuve. Ils ne savent rien de la souffrance. Ils ne vivent que dans une quête éperdue de plaisir - Can you hear me ? - Personne ne répond. Ni dans la salle ni dans l’espace. Comme Ziggy, Stephen sait que les carottes sont cuites. Sans l’arrivée providentielle de Ziggy, jamais il n’aurait pu réfléchir à une telle chose : la solitude qui précède la mort. Ziggy salue rapidement Andy Warhol et Jacques Brel avec «My Death», deux ombres qui passent largement au dessus d’une Californie notoirement inculte et les Spiders redescendent dans l’enfer du psych-out anglais pour touiller une monstrueuse version de «The Width Of A Circle», hit underground d’un certain David Bowie. Ronno joue au gras double de l’agressivité maximaliste. Ziggy se campe sur ses pattes de Spider, le temps que passe la tourmente. Il souffle sur le Civic un vent de folie de force V du type de ceux que levaient les Standells en leur temps.
Ziggy porte sa touche bisexuelle à incandescence avec «Queen Bitch». Les coup de hanches qu’il donne en disent long sur l’aisance avec laquelle il lève des michetons dans les bars - I’m the space invader ! - «Moonage Daydream» tombe comme une chape sur le Civic et pourtant, il s’agit là d’une nouvelle prière - Keep your electric eye on me babe - Ziggy far-oute le Civic. Stephen vibre de tout son corps. Mais son état empire encore lorsque Ziggy attaque «John I’m Only Dancing» car Ziggy atteint là les sommets du dévoiement, il va même jusqu’à s’étrangler dans son trémolo - Don’t get wrong - Il pousse jusqu’à la perversion extrême. Et après avoir présenté Mick Ronson on guitah, il attaque une version somptueuse de «Waiting For The Man», battant toutes sortes de records au passage, dont ceux de l’ambiguïté androgyne à la Fellini et de l’instigation sauvage, car il vaut bien à lui seul une horde de cannibales affamés.
Ah des gens réclament du rock ? Ziggy leur jette «The Jean Genie» en pâture et donne carte blanche à Ronno qui pétrit ses riffs avec une rare violence. Il joue comme un vrai lad de Hull, faut pas lui marcher les pieds ni lui dire un seul mot de traviole. Ziggy s’ébroue et crache du snow white et du New York a gogo - And everything tastes nice - Avec les Spiders survoltés, ça prend des allures extravagantes, Ronno riffe serré, on assiste à un looks like a man et ça rampe dans les reptiles, Ziggy swingue ses chimney stacks ouuuh ouuuuh, les Californiens n’en peuvent plus - Jean Genie let yourself go ! - Stephen frise l’overdose, s’il mourait à cet instant précis, ce serait fantastique. Ziggy chante à pleine bouche de pipe. Rien ne pourra plus l’arrêter - Loves to be loved, loves to be loved - Et la bulle pop explose en plein vol avec «Suffragette City». Ziggy fait aux Californiens le plus beau des cadeaux : la pop du Palace Pier bardée d’amphètes - hey man ! - Ziggy secoue sa crête orange et balance le plus célèbre des refrains - Oh don’t lean on me man/ Cause you can’t afford the ticket/ I’m back on Suffragette City - Les Spiders jouent comme des diables, Ronno glisse dans les coulures du soufflet et c’est le break que guette la terre entière - Ohhh, Wham Bham Thank You Maaam ! Stephen assiste médusé à l’apothéose du glam anglais.
En sortant du Civic, il sent l’air chaud envelopper son corps en nage. C’est à cet instant précis qu’il décide de changer de nom. Il s’appellera désormais Ygarr Ygarrist et viendra donner une deuxième chance aux terriens avec un groupe originaire de Plutonia, dans la Xavia Zeee Galaxy, les fameux Zolar X. Ils joueront régulièrement à l’English Disco de Rodney Bigenheimer et se montreront parfaitement dignes de «The Rise And Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars» en enregistrant de beaux album de glam pur.
Signé : Cazengler, drôle de zig(gy)
David Bowie. Disparu le 10 janvier 2016

David Bowie. Hunky Dory. RCA 1971

David Bowie. Pin Ups. RCA 1973

David Bowie. Live Santa Monica 72. Virgin Records 2008
TROYES – 16 / 01 / 16
MIDWAY SHOOTER BAR
RENE MILLER TRIO
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, alors on y va, en courant. En plein cœur de la bonne ville de Troyes. Vous avez perdu, ce n'est pas au 3 B, mais pas très loin, au Midway. Nous arrivons en avance. Pas question de perdre une note. Surtout une bleue. Les musicos finissent de manger confortablement installés sur un canapé. Au Midway les chaises sont rares mais les divans profonds et moelleux sont agrémentés de tables basses. Déco américaine typique sur les murs. René Miller, le fera remarquer durant son tour de chant, l'on se croirait chez soi, dans une grande pièce. Avec son borsalino et ses mains dans les poches, il ressemble à un gangster d'un film des année cinquante. En plus vous avez droit à une version originale puisqu'il parle sa langue natale. L'est en France depuis vingt ans, mais comme tout le monde connaît un peu d'anglais, il n'a pas eu à s'adapter...
L'on sent que l'envie de jouer le démange, pas le genre de gars à faire attendre le public. Une petite cigarette sur la terrasse et les voici tous les trois en place. Le bar s'est rempli doucement, moitié amateurs de blues et moitié fans de rockabilly...
CONCERT

Ben Body est à la contrebasse, le bras sur le manche et les doigts en attente sur les cordes. David Chalumeau a déballé ses harmonicas, toute la gamme posée dans l'ordre alphabétique près de lui. René s'est assis, le restera toute la soirée, telle l'image d'Epinal des bluesmen sur le perron de leur baraque en planches disjointes du Mississippi, l'a gardé son chapeau – étrangement il en paraît beaucoup plus jeune. Placidement il tire son étui à guitare, et l'en sort la plus merveilleuse des poêles à frire. Une guitare à résonateur bleutée comme un dos de requin. Nous prévient en son idiome qu'ils vont jouer essentiellement du blues, et après un regard ironique et appuyé sur le confederate flag, un peu de country aussi. No comment. Chacun appréciera l'humour de la situation à sa guise.

N'ont pas douze tonnes de Marshall derrière eux. Trois petits amplis de rien du tout. Celui de René Miller, vous l'employez chez vous pour ne pas réveiller les voisins. Brut de blues. Tout dans le souffle et les doigts. Pas de surenchère, ici, il faut jouer au plus près sans tricherie. Pas une question de son, mais de présence.

La guitare et la voix. Faut savoir les associer. Contrairement à ce que son nom laisserait supposer, le résonateur ne résonne pas. Il sonne, n'installe pas une profondeur sur laquelle le chant pourrait se vautrer comme sur un coussin rempli d'eau chaude. Le métal scalpe, il clinque et cliquette, c'est la voix qui dépose les harmoniques. Mais elle doit d'abord surmonter le clappement sec de l'acier, lui rabaisser le caquet comme l'on recourbe de la main vers le sol la tête du reptile qui voulait vous mordre. Faut être blues et shouter, ne pas passer en force, mais s'imposer une fois, deux fois, mille fois, autant de fois que nécessaire faut pousser son holler et retomber tout de suite dans la syncope du silence. Piquer du nez et reprendre de l'altitude.

Mais ce n'est pas tout. Reste le plus important, le doigt qui se glisse sous le manche au ras de la caisse et le cylindre du slide qui fait glisser les notes, les arrache et les gicle, en accentuent le feulement métallique tout en leur imprimant une onctueuse acidité. Le grain grinçant de sable qui enraye la machine tout en lui permettant de changer de dimension. La main gauche armée de ses deux médiators ne chôme pas mais c'est le bottleneck qui permet le basculement rythmique du blues, l'escalier qui descend alors que l'on monte, cette impression d'être aspiré par la vase du Delta alors que l'on se sent aggripé par le septième ciel. De la jouissance. Pas celui du mauvais dieu des églises.

David Chalumeau est à l'harmo. Monte en douce dans le wagon. Mais après plus question de le faire descendre, notre hobo. S'accroche à l'échelle et ne lâche plus la note. Pas de coupure, pas de zébrure, pas de déchirure. Joue à souffle continu. Ce n'est pas le train sifflera trois fois et se taira. N'est pas pour la stridence qui vous hache l'oreille en petits morceaux avec les oignons crus par-dessus. L'est pour la perceuse vicieuse qui vous troue le tympan et s'enfonce en avant sans jamais marquer de pause. Le serpent déroule ses anneaux, mais le bout de la queue n'apparaît que lorsque René Miller achève son morceau. Toujours par surprise. Brutalement. Une balle dans la tête et l'on passe au suivant. Et David Chalumeau se dépêche de choisir un nouvel harmonica.

Ben Body n'a pas ce souci. Toujours la même contrebasse. Suffit de suivre et d'impulser. N'a pas droit au déraillement. Les deux autres peuvent foncer devant, il est le gardien du phare. S'y réfèrent sans arrêt, l'est derrière, mais c'est lui qui guide même si Miller découvre le chemin et fonce en avant, Chalumeau est emporté dans sa cavalcade, mais Ben Body assure la logistique. A toutes les étapes l'on se retourne, mais il est là; imperturbable, le roc dans la tempête.

Deux sets, des incontournables du blues, un Crossroad démentiel, la guitare pour ainsi dire nue de René nous aide à comprendre l'attrait diabolique de ce morceau et pourquoi Robert Johnson est plus grand que son mythe. Du trapèze volant, sans filet. Une prédilection pour Mississippi John Hurt, son Frankie folk country bluesifié à mort, l'a la voix rèche qu'il faut pour cela. Un Higway 61 ( non revisité ) de Big Joe Williams, et un In my Time of Dying de Josh White, du blues comme il en ruisselle dans le grand fleuve. Un régal, live. Des compos comme Baby Roll, mais aussi des reprises plus modernes, ce Come Together des Beatles transformé en vieux blues déchiqueté à la Howlin Wolf – l'est vrai que Lennon s'était inspiré d'un peu trop près du You Can't Catch Me de Chuck Berry – puis ce qu'il annonce être l'hymne national « unofficial » du Canada, le Hallelujah de Leonard Cohen interprété un peu à la dernière manière de Johnny Cash, et surtout ce Sympathie for the Devil, d'autant plus fort et splendide que réalisé avec une formation pour ainsi dire à minima. Hyper bien chanté. Le morceau découpé jusqu'à l'os. Frisson sur la peau garanti. De quoi vous donner envie de lire les œuvres complètes d'Anton Lavey.

Et pour finir, en ultime rappel, une surprise, en français s'il vous plaît. Ne proposez pas de titre. Aznavour, un For Me Formidable, du temps il essayait de rivaliser avec les big bands d'Amérique. S'en tire joliment et avec le sourire. Applaudissements nourris. Le blues n'est pas toujours triste. Surtout pas celui du René Miller Trio, tonique et revigorant. Nous emportons un disque, comme un trésor, nous vous le chroniquerons bientôt.

Damie Chad.
( Photos : FB : Pascal SEHER )
ALIAS VINCE TAYLOR
LE SURVIVANT
( Editions DELVILLE / 1976 )
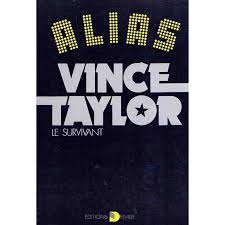
En 1976, l'on s'est précipité dessus comme les barbares sur l'Empire Romain. Enfin des nouvelles fraîches de Vince Taylor ! L'on n'y croyait plus. Pas trop en tout cas. Que Vince qui baragouinait un français approximatif ait pu rédiger son autobiographie laissait rêveur. D'autant plus que les trois premiers chapitres trahissaient la patte du romancier. Avec la collaboration de Jacques Guiod, c'était écrit en tout petit sur la page de titre. Le choix du rewriter n'était pas mauvais. Jacques Guiod a traduit plus d'une centaine de livres, principalement des ouvrages de science-fiction, les auteurs les plus prestigieux, je ne citerai à titre d'exemple que Robert Silverberg, d'autres babioles aussi, pour rester dans un domaine qui touche notre rêve américain nous mentionnerons la présentation des photographies des Indiens d'Edward Sheriff Curtis. Science-fiction, Vince Taylor, Ziggy Stardust David Bowie, les connexions s'opèrent d'elles-mêmes... Jacques Guiod était l'homme approprié pour ficeler coupures de presse et confidences de Vince en un tout cohérent.

Ne s'agit pas ici d'accuser Vince Taylor de mensonge. Toute vérité n'est qu'une reconstruction du réel. Au mieux on peut l'asséner de toute bonne fois. Mais ceux qui croient en leurs Dieux – idem pour les fans qui se prosternent devant leurs idoles - sont au minimum des naïfs. Au pire des idiots. Vince Taylor était trop intelligent pour ne pas douter de lui-même. Ne nous fait-il pas l'aveu au détour d'une phrase de nous révéler que ce qu'il vient de raconter n'a peut-être pas été vécu !
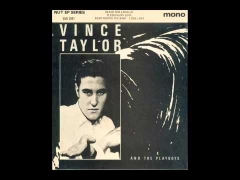
Inutile de délaisser le bouquin et de faire comme s'il n'était qu'un ensemble d'approximations fumeuses auxquelles l'on ne saurait accorder un crédit quelconque. D'abord parce que Vince donne pour tout le début de son existence des informations à l'époque inédites, que des enquêtes ultérieures corroboreront, mais surtout parce que se dessine en creux un portrait psychologique de Vince qui n'est pas sans intérêt.
Cette bio était censée préparer un des incessants comeback de Vince. Au premier plan de l'actualité. Dans sa tête sûrement. Pour son entourage l'on devait être plus dubitatif. L'on était passé au plan B, sauvons le rocker Vince Taylor, avant qu'il ne soit trop tard. Le plus étonnant c'est que de page en page, Vince Taylor s'y présente alternativement, sous son meilleur jour comme sous sa pire caricature.
L'a un côté vantard un peu énervant. Monsieur qui sait tout et qui a toujours raison. Peut prophétiser si les conseils qu'on lui prodigue et qu'il suit tourneront au fiasco ou seront des avancées décisives de sa carrière. Comme les premières années, la chance finit toujours par lui sourire, le lecteur lui pardonnera volontiers ses roublardises. L'on ne critique pas une équipe ( fût-elle constituée d'un seul membre ) qui gagne. N'insiste guère sur ses passages à vide en Angleterre, les mentionne, mais une fois qu'ils sont surmontés. C'est de bonne guère. In hoc signo Vinces. Si c'est écrit sur les paquets de cigarettes nous n'y pouvons rien. Peut-être était-ce un avertissement des Dieux, que la gloire s'envole facilement en fumée...
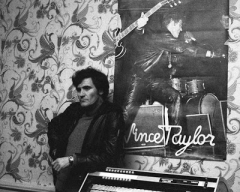
Rend fidèlement compte de son triomphe en notre douce France. Et peut-être même peut-on discerner en ses souvenirs heureux la prise de conscience que son incroyable succès repose sur une terrible méprise. Il apparaît à ses propres yeux comme le rocker par excellence, dans toute sa splendeur, des sets d'une sauvagerie inimaginable et d'une beauté absolue qui traumatisent littéralement la société française. Question rock, c'est une réussite parfaite. La France le gobe comme Proust sa madeleine. Mais ce n'est pas la coquillette sucrée de Marcel qui est l'héroïne du roman. Elle n'est qu'un adjuvant nécessaire mais contingent de ce qu'elle révèle. Idem pour les shows de Vince, n'intéressent – à part une poignée d'exaltés – the french population qu'en ce qu'ils dévoilent, mettent à nu, les désirs profonds et inavouables de la société, ceux d'une exigence d'une libération définitive des corps et des esprits.

Rompez les chaînes – Vince a pris l'habitude d'en brandir une sur scène - des esclaves, le retour du refoulé ne se fera pas attendre. Vince vous permet de vous débarrasser de votre culotte, mais à la fin de l'explosion libératrice c'est lui qui sera rejeté comme une vieille chaussette ( noire).
Vince ne dérogera pas à son chemin. Ses deux premières années de par chez nous tournent à l'émeute, c'est de la folie pure. Lorsque Barclay apurera les comptes de son investissement financier et qu'il retira ses billes, Vince n'en continue pas moins sa sente folle. Si le monde s'assagit, il comblera le déficit en prenant la folie à son compte. Tout se détraque dans sa tête. L'alcool et les produits n'y seront pas pour rien, mais nous les tiendrons pour des péripéties extérieures à la grande décision nervalienne de Vince Taylor, celle d'assumer du dedans, la folie de laquelle les spectres du dehors se détournent avec horreur.

Lui qui a connu le rock et les palaces se retrouvent seul. Les filles qui ne l'abandonneront jamais ne comptent pas. Se laissent pousser les cheveux. Vit dans la rue. Mais ce n'est pas le plus terrible. L'a perdu son statut de rocker. L'est devenu un hippie. Comparé à cette déchéance êtrale, les séjours en hôpitaux psychiatriques sont de la petite crème. Des broutilles. Les conte avec une certaine complaisance. Traverse l'enfer. Mais il en ressort vivant. A la fin du livre il dresse le bilan de sa vie. L'a été beaucoup trahi. Les seuls qui ne l'ont pas abandonné sont les rockers. Les Teddies en Angleterre, les rockers en France. Notamment la légendaire figure de Johnny de Montreuil. Le logent, le nourrissent, lui filent de l'argent, lui passent des copines, veillent sur lui. Préparent son retour... Des anges... noirs dont il dresse un portrait apocalyptique. Des réprouvés, des rejetés. Nés dans la misère et la violence. Des durs car les faibles ne survivent pas. Mais fidèles en amitié. Ne connaissent pas la pitié mais peuvent vous soutenir indéfectiblement. Avec eux, c'est à la vie, à la mort. Et jusqu'à après la mort. Cela s'appelle la vengeance...

Désolé pour les féministes. Comme dans les sociétés guerrières les filles passent après les gars. Sont là pour servir et se taire. Brunes ou blondes elles comptent pour du beurre. A Baratter. Une constance chez Vince. L'a honoré à la va-vite des tas de meufs. Macho, phalo et tout ce que vous voulez. L'était doué d'un irrésistible sex appeal. N'avait point besoin de se forcer. S'offraient. Consentantes. Soumises. N'allait pas non plus refuser ! Mais cette pression de femelles énamourées le dégoûtent. Gare à celles qui s'accrochent. N'hésite pas à les frapper si elles ont encore envie. Cette violence n'est pas réservée aux groupies anonymes un peu trop chaudes. Nombreuses seront ses compagnes qui auront droit à quelques mémorables corrections. En rejette la faute sur sa première épouse qui s'adonnait en cachette aux joies du striptease... Les contradictions du puritanisme anglo-saxon apparaissent au grand jour... Se dit assoiffé de pureté et s'étend longuement sur son aventure sentimentalo-érotique avec une nymphette de treize années. L'on n'est pas très loin des chaudes accointances de Jerry Lou avec sa petite cousine Myra et de la cour troubadourienne d'Elvis avec l'infante Priscilla... Très sexuellement incorrect. Qui de nos jours, en ces temps hypocrites d'ordre moral, aurait le courage de révéler sa vie intime avec autant de netteté !

Frelaté et fascinant. Authentique et outrancier. A la relecture, quarante après, ce bouquin est un magnifique artefact rock and rollien. Nous paraît même avoir gagné en force. En fait c'est notre époque qui s'est affaiblie. On a pris l'habitude de passer un peu vite sur ce livre. On a trouvé l'excuse, son manque de fiabilité et son imprécision chronologique. Mais à la lecture, si l'on prête l'oreille à la petite musique rock and roll qui s'en dégage, il n'est pas dépourvu d'un charme vénéneux. Prenez-y garde, le poison agit lentement. Mais sûrement.
Damie Chad
( Photo : Vince +jukebox / SITE ROLLCALL à visiter )
BILLIE HOLIDAY
MUNOZ & SAMPAYO
( Casterman / 2015 )
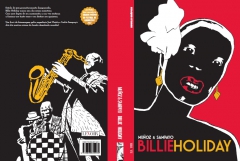
Centenaire de la naissance de Billie Holiday. Ca tombait bien, chez Casterman ils avaient dans les cartons l'album de Munoz et Sampayo sur Billie. Se sont dépêchés de le rééditer. A leur décharge, faut rappeler que les deux argentins sont pour ainsi dire des auteurs maison et que la boîte les édite sans désemparer depuis trente ans. Carlos Sampayo est un authentique amateur de jazz, l'a aussi participé à un Fats Waller avec le dessinateur Igort d'origine italienne - qui de son côté a commis un Sinatra - l'a même rédigé une Historia del Jazz. Vous l'avez compris Sampayo se charge des scénarii et José Munoz dessine. Dans sa jeunesse Munoz a travaillé avec un autre italien très célèbre, Hugo Pratt, le père de Corto Maltese... Italie, Argentine, jazz, Billie Holiday, Sinatra, quand j'aurai ajouté que Munoz et Sampayo ont réalisé un Carlos Gardel, prince du tango, nous pourrons certifié qu'il n'y a pas de hasard, uniquement des rencontres. Et comme notre monde vu depuis les étoiles est encore plus petit qu'on ne le pense, c'est la compagne de Jacques Tardi – duquel vous avez lu ses Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, héroïne anarchisante... - Dominique Grange – créatrice de Les Nouveaux Partisans – en quelque sorte l'hymne de la Gauche Prolétarienne – qui opéra la traduction des bulles. Pas étonnant que tous ces personnages se soient sentis en osmose avec la rage qui habitait Billie Holiday. Une même exigence artistique et un même sentiment de révolte politique les animent.
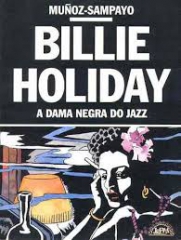
Suffit de regarder la couverture pour tout comprendre. Pourrait s'intituler la négresse rouge au camélia blanc. L'on vous résume la bio de Billie avant que vous ne commenciez, avec des photos d'époque. C'est que la suite est un peu embrouillée. C'est l'histoire de Billie mais dans le désordre. Trente ans qu'elle est morte. La radio en parle, les journaleux recherchent des documents et les témoins se souviennent. Ceux qui l'ont croisée sans même savoir qu'elle était Billie Holyday et ceux qui ne le savaient que trop. Les images arrivent dans le désordre, comme les coups de pied lorsque l'on vous passe à tabac, ou alors comme quand vous avez trop bu et que la tête vous tourne, ou alors comme quand le sang tape un peu trop dur dans vos veines sous l'effet de l'héroïne.
Billie vous offre le cocktail de sa vie. Difficile de l'avaler d'un trait. Trop d'amour, trop de sexe, trop de fric, trop de haine, trop d'injures, trop de mépris, trop de drogue, trop de trop. La vie est un cauchemar et la mort une épouvante. Entre les deux vous faites comme vous pouvez. Ne pensez pas à vous enfuir les issues sont fermées. Barrées. Obstruées. Bouchées. A la Reine. Cadenassées. La règle du jeu est simple. Les flics sont les bumpers et vous êtes la boule. De couleur noire. Cela à son importance car les arbitres ne seront jamais de votre côté. De toutes les manières, il n'y a pas d'arbitre. Billie connaît les règles du jeu. Elles sont simples. Tous contre vous. Vos ennemis. Et vos amis aussi. Du moins ceux qui devraient être vos amis. Les pigs sont partout. Même autour de votre lit de mort. Les honnêtes citoyens sont bien gardés. Les mauvais encore plus. Le répit ne peut venir que des anonymes. Mais ils n'ont aucun pouvoir, un sourire, une déférence. C'est tout. Je me demande si cela peut-être positif. Cela vous rembobine peut-être plus dans votre solitude. Dans votre désespoir.
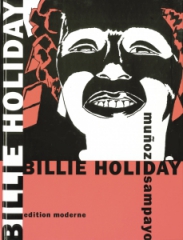
Mais à chacun sa citadelle. Celle de Billie s'appelle le Pres. Ne sera pas imprenable. La mort finira par planter son drapeau noir sur la plus haute de ses tours. Avant il y avait eu la dépression, la folie peut-être. On n'a jamais su. Une forme particulière de schizophrénie. Ou alors quelque chose de plus difficile à cerner. Un repli. Le silence. Le mutisme. L'a été un des plus grands du jazz. C'était le miel de l'Hymette qui coulait de son saxophone. Comme la parole de Platon. Mais un jour il a arrêté. De vivre. Mais avant, de jouer. Soufflait bien un peu pour gagner sa croûte. Mais n'y faisait plus attention. Sans cœur, sans joie. Parce qu'il faut le faire. La corvée de vaisselle. L'on s'en passerait aisément, mais là ce n'est pas possible. S'appelle Lester Young et c'est l'ami de Billie Holiday. Son amant. Mais peut-être pas de chair. Personne n'en sait rien. Son amant d'âme de dame, oui cela est sûr. A eux deux ils sont la citadelle. Deux miroirs qui se renvoient leur reflet. Et puis rien d'autre. Cela suffit. Ne se comprennent pas nécessairement. L'important ce n'est pas d'avoir la compréhension intime de l'autre. Ce sont les autres, tous les autres qui vous ont désignés comme seuls horizons possibles. Vous ont condamnés à aller l'un vers l'autre. Naturellement. Lorsque vous ne pouvez allez nulle part vous ne pouvez rencontrer quelqu'un uniquement dans cet espace de nulle part. Pas de quoi pavoiser. Mais une grande tendresse, qui vous happe l'un vers l'autre. Et qui vous zappe des autres.
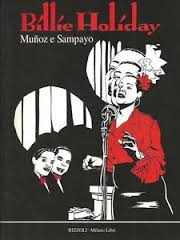
La mort du Pres fut un drame pour Billie. Ne le voyait plus beaucoup, ne jouaient plus ensemble, mais l'était toujours présent. En elle, près d'elle. Avec la mort de Lester, Lady Day s'est trouvée confrontée à la brutalité de l'existence. N'avait plus son bouclier de protection. Sans Young, la vie ne valait plus la peine. Billie absorbe la violence du monde dans son corps, et elle aussi devient violence. Lui faut émettre de la violence pour opposer une force au moins aussi forte à celle qui la submerge. Jeu de miroir mais la glace est cassée.
Ensuite plus rien ne peut l'atteindre. Ni les vivants ni les morts. Même quand elle est encore vivante, même quand elle est déjà morte. Encore morte. Il n'y aura pas de sorcellerie vaudou. Le fil est coupé. Personne ne le renouera. Allez vous recueillir sur sa tombe. Le cœur gonflé d'amour et de regret. Cela ne sert à rien. C'est tout juste bon à consoler votre chagrin à vous. Pas le sien. Egoïsme des hommes. Solitude d'une femme.

Sa conscience est plus vaste. Ce n'est pas sa propre existence qui lui fait mal. Ne s'en tire pas si mal que cela. Ce sont les blessures de tout un peuple qu'elle porte en elle. L'a bâti la cause stirnérienne de son moi sur rien. Elle l'a bâtie sur les autres. Tous couchés et si peu debout. Quelques uns et personne d'autre. De quoi subir tous les découragements du monde. Son âme était blessée mais la blessure était en dehors d'elle. Une situation qui n'est pas sans rappeler la double postulation du poète Joë Bousquet, blessé d'amour et de guerre. En la même époque. Mais le drame de Joë Bousquet fut personnel, individuel – même si la grande secousse cataclysmique de 14 – 18 en fut la première pourvoyeuse – celui de Billie Holiday est empêtré dans une trame collective qui se retire d'elle. L'alcool, le sexe et la drogue pour colmater les interstices.
Sampayo a découpé son récit en lanière. Un peu comme ces fouets qui s'abattaient sur les dos des esclaves. Munoz a adapté le dessin. L'a suivi le même processus créatif que son scénariste. Certes l'est difficile de décider si pour lui, le blanc de ses vignettes représente la béance d'ombre du vide et le noir la contrefort de la vie animée gorgée de sang chaud qui tente de faire barrage au néant, ou alors au contraire, si pour lui, le noir est le fond d'opacité du destin et les taches de blanc les battements d'ailes de la vie qui tenterait d'échapper à cette noirceur programmée.
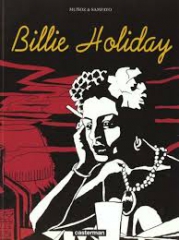
Dans les deux cas, ce n'est qu'un jeu d'ombre sans lumière. Un combat de noirs qui se battent dans un tunnel à coups de boulet de charbon. Tournez les pages du livre rapidement, les formes s'estompent, se détache juste une lutte mouvante entre le blanc et le noir. Entre les noirs et les blancs. Jamais un auteur de bande dessinée n'aura autant réussi à effectuer la coïncidence suprême, celle de la matérialisation graphique du dessin avec ce qu'il sensé raconter et exprimer. Une véritable calligraphie orientale, selon laquelle le geste du pinceau trace le signe qui détermine le sens de l'œuvre. Jamais le dessin n'aura été aussi près de cet art suprême qu'est la musique car le frémissement seul de la voix de la chanteuse suffit à indiquer les émotions qu'elle s'emploie à nous faire partager. Même si l'auditeur n'entend un traître mot de la langue dans laquelle elle chante, il entend parfaitement la signification exacte et universelle que le vibrato de la voix impose. Sculpture vocale, art total, qui se passe de tout commentaire superflu.
Pour ceux qui ne comprendraient pas, la couverture s'avère explicite. Un peuple symboliquement décapité en faisant taire cette voix dans laquelle perçaient d'étranges fruits. La lame rouge de sang. Et la tête soleil noir, cou coupé.
Damie Chad.
CULTURE ROCK
L'ENCYCLOPEDIE
DENIS ROULLEAU
( Flammarion / 2015 )
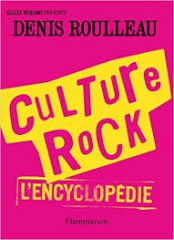
Je n'arrivais plus à y mettre la main dessus. Jamais en rayon dans les librairies que je visitais. Lorsque j'ai remarqué la couverture souple, au regard j'ai pressenti la parenté, oui mais en 2011 elle pépiait d'un jaune canari éclatant, et là s'étale un rose quasi-fuchsique, s'offrait aussi en format un moindre qui lui refilait l'apparence d'un missel du dimanche ( ô Satan que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ! ), exactement comme ces petits volumes qu'Hölderlin et toute la génération romantique trimballaient dans leurs poches durant leurs nobles pérégrinations. Réédition en cette fin d'année 2014, avec quelques centimètres de plus, augmentée et mise à jour, par son auteur Denis Roulleau.
Quand vous l'ouvrez, vous n'êtes pas dépaysé. Vous vous croyez dans votre blog-rock favori. Les mêmes couleurs criardes que celles qui badigeonnent les livraisons de KR'TNT ! Même que parfois vous devez écarquiller les mirettes comme des soucoupes volantes pour déchiffrer le texte. Spécialement un marron macrameux à dominante parmentière terreuse. L'esthétique punchy de mauvais goût du rockabilly dans toute sa splendeur. Sauf que ( de rat coupée ) les pionniers et les fifties ce n'est pas sa timbale de Jack.
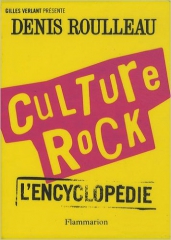
Si vous pensez trouver tous les gentils rockers sagement alignés à la queue leu leu alphabétique, vous vous trompez, certes vous avez droit à une encyclopédie-rock, mais c'est le versant culture qui sera privilégié. Culture et Rock, deux mots qui ne vont pas très bien ensemble, s'exclameront les grincheux de service. Mais ce sont là gens de chagrine et étroite intelligence. Auxquels nous n'accorderons qu'un regard de mépris compatissant. L'est bizarre de voir combien beaucoup de nos contemporains s'accordent à rétrécir les champs du possible. Encore que ( de renard hendrixien ) ici, encyclopédique ne signifie point universel. Le livre est avant tout destiné à un public français. Pas au sens nationaliste du terme, mais culturel. Entendez par ce vocable que Denis Roulleau explore et explicite les différents canaux et éléments qui ont permis à tous les petits frenchies que nous sommes d'entrer, un jour ou l'autre, par telle ou telle capillarité sympathique et osmosique, en relation avec cette musique d'importation sauvage qu'est le rock and roll.
C'est comme à la piscine municipale. Le meilleur moyen d'apprendre à nager c'est de tomber par mégarde des quinze mètres du plongeoir meurtrier directement dans le grand bain. Vous êtes pénardos chez vous, et schploff ! sans avertissement un titre vous étreint. Le boa constricteur du rock s'est jeté sur vous, désormais jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes perdu pour la communauté humaine, vous êtes devenu un rocker. Mais il y a des pétochards qui ont besoin d'une approche moins abrupte, demandent conseil au maître-nageur qui roulent de rassurantes mécaniques sur le bord des bassins. Vous êtes comme Dante ( une bonne pâte littéraire ) qui pour visiter les Enfers a eu besoin de Virgile pour la traversée des cercles peuplés de ces malheureux qui en leur terrestre existence se sont adonnés aux pêchés capiteux. Vous éprouvez la nécessité d'un intercesseur, d'un coach-rock pour vous guider en ce monde de sentes obscures, de pentes fatales.

Alors David déroule le Roulleau des opportunités à saisir de toute urgence. La presse tout d'abord puisque le premier article est dévolu à Actuel. Qui n'a pas eu entre ses mains ses pages colorées, ultraviolettes, et salades de fruits composées d'orange sanguine et de jaune citron mielleux, n'a rien vu. N'ont rien lu, non plus ceux qui se jetaient dessus. Mais c'était beau. Un magazine qui jetait l'encre dans les sujets tabous ( quoique le Special Cul du journal Tout ! à l'époque c'était vraiment culotté ), les gauchistes le lisaient en cachette, en public ils se méfiaient, le jugeaient un peu décadent. Pas vraiment léniniste. J'en profite pour évoquer Le Parapluie, un peu surfait à mon humble avis. Tant qu'il y était et vu le temps pluvieux, l'aurait pu ajouter L'Escargot Folk. En tout cas Rock'n'Folk, Best, Extra, JukeBox, Xroad et le premier d'entre eux le légendaire Disco-Revue qui essuya les plâtres. Mais un journal sans plumes c'est comme un oiseau sans ailes, les journalistes rock possèdent donc leur stèle Laurent Chalumeau, Alain Dister, Philippe ( grandes ) Manoeuvre, Yves Adrien, Eudeline, Philippe Garnier, et tous ceux qui s'appliquèrent à créer une écriture rock française, un art difficile, notre langue préférant de par son origine latine les grands drapés cicéroniens. Lisez, dans un tout autre ordre d'idée, une page d'hommes aussi peu marqués par le rock and roll que le général Charles de Gaulle et le Connétable Winston Churchill, pour comprendre hors de tout contexte l'avantage, dû à ses facultés plastiques, de l'idiome anglo-saxon. D'ailleurs le mieux serait peut-être que vous jetassiez un coup d'oeil chez les pères fondateurs d'outre-mer comme Greil Marcus, Nick Cohn, Nick Kent, Richard Meltzer, Lester Bang et l'ancêtre symbolique à tous Hunter S. Thompson, le grand inspirateur du journalisme rock gonzo. Le gonzo c'est le gonze insupportable qui se ramène là où l'on n'a qu'un besoin modéré de sa personne, et qui malheureusement ramène tout à sa petite personne. Bref le gars insupportable qui ne se prend pas pour la moitié d'un étron de chien ou de Dieu ( c'est un peu la même chose mais ce dernier sent un plus mauvais ), un égonze surdimentioné. Arrangez-lui une interview au paradis avec Elvis et vous aurez de la chance si par hasard il mentionne le nom du Memphis kid dans son article. Car Elvis est sûrement le rock, mais la star c'est celui qui pond l'article.
Attitude terriblement rock quand on y pense. Toutefois le rock ne se réduit pas à son écriture, alors Denis développe aussi le Roulleau des pellicules. Celles des photographes et des cinéastes. Et même celui des peintres rock qui peignent d'ailleurs de préférence au cran d'arrêt. N'oublie pas les salles de spectacle, les promoteurs, les tourneurs, les roadies, les ingénieurs du son, toute la faune spécialisée qui gravitent autour des musicos, sans faire l'impasse sur la quincaillerie qui marche avec, guitares, amplis, lunettes, Perfecto et tout le reste de la brockante...
Un malin le Denis Roulleau, les articles sont assez courts, dépassent généralement la Denis-page mais excèdent rarement la double pangée et avec les photos et les encadrés punaisés de ci de là, l'a toujours la possibilité de se retrancher derrière le manque de place si vous le trouvez le pépère un peu court. Sinon, c'est bien fait. Se débrouille pour refiler un max d'informations sans trop se prendre au sérieux. Juste ce qu'il faut pour rester crédible. Essaie de terminer sur une pirouette manière de mettre le lecteur dans sa poche.
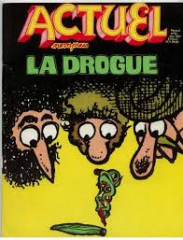
N'y a que deux artistes qui possèdent leur pré carré pour ne pas dire une concession à leur nom dans le bouquin, les Doors et Woody Guthrie. Tous les autres apparaissent uniquement quand ils ont participé à un événement mémorable dont ils ne sont pas obligatoirement la vedette. Manière de remettre chacun à sa place, le rock relégué dans les combles, sous les toits, et la culture ( rock ) dans les appartements de prestige. Une fois n'est coutume ! Veut sans doute nous prouver que les rockers ne sont pas des béotiens. Certes s'ils n'écoutaient pas cette musique de sauvage ils n'auraient point besoin de rechercher tant d'alibis, ma bonne dame.
Je ne saurais que trop le conseiller à ceux qui veulent toujours en savoir plus. Qui ne se contentent pas de la beauté d'un phénomène, qui aiment à en saisir la signification. Cette fausse encyclopédie qui ne repose sur aucun projet de savoir hégémonique et dictatorial leur donnera les clefs qui ne permettront d'accéder ni la connaissance infuse ni à la vérité révélée. Juste l'indication d'un passage que l'on se doit d'emprunter. A vous de vous débrouiller pour la suite.

En haut à gauche de la couverture l'est écrit « Gilles Verlant présente ». Le livre lui est d'ailleurs dédié. Gilles Verlant est mort prématurément en 2013. L'a été l'initiateur de la série radiophonique L'Odyssée du Rock, de très courtes émissions qui présentaient un titre rock agrémenté d'un commentaire purement anecdotique. Le rock vu avec les grosses lunettes sex, drugs and rock. Il se peut que certains d'entre vous soient tombés chez des soldeurs sur des caisses pleines d'un de ses derniers livres Les Miscellanées du rock ( chez Fetjaine ), le genre d'ouvrage tape-à-l'oeil ( et au porte-feuille ) auprès duquel un article de Match acquiert la densité d'un traité d'Emmanuel Kant. Ne vous laissez donc pas rebuter par cette mention verlantaise sur la couve de Culture Rock. Sont de conception antithétique. Les Miscellanées sont des eaux stagnantes. Des marécages qui vous engluent dans une représentation que je qualifierai de rock pipi caca. Alors que ce Culture Rock vous ouvre les mille chemins de la rock-culture.
Damie Chad.
15:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david bowie, rené miller trio, vince taylor, billie holiday, culture rock



