08/02/2017
KR'TNT ! ¤ 315 : JAMES LEG / PETE OVEREND WATTS / LES ENNUIS COMMENCENT / BROKEN FINGAZ / DÄTCHA MANDALA
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 315
A ROCKLIT PRODUCTION
09 / 02 / 2017
|
JAMES LEG / PETE OVEREND WATTS LES ENNHUIS COMMENCENT / BROKEN FINGAZ DÄTCHA MANDALA |
Le legs de Leg
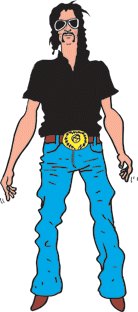

— T’as écouté le nouveau James Leg ?
— Ben non...
— Y s’appelle Blood On The Keys. T’as le même son que sur les albums précédents. Ça démarre avec un cut sacrément voodoo, «Ain’t You Hungry», battu à l’anticipation tribale et admirable de tension boogalo. Y fait aussi une curieuse reprise de Mungo Jerry, «Mighty Man», avec Reuben Glaser à la guitare, un mec qu’a joué dans Pearlene et Cut In The Hill Gang. Comme Y se veut possédé, Y dramatise le chant à outrance et Y va même parfois sonner comme Tom Waits, t’as qu’à voir !
— Y fait comme Y veut, c’est un grand garçon.
— Y balance même une valse à six temps violonnée par des gens du voyage. Finalement c’est sur le gospel d’orgue qu’Y fait la différence, t’as qu’à écouter «I’ll Take It». Y chante ça à l’éraillée, comme un ogre. Oh pis Y refait du gospel d’orgue bien poundé avec le morceau titre en B. Mais Y se jette trop dans la bataille, Y chante avec trop de ferveur et franchement, on ne lui en demande pas tant.
— Te fais pas chier à écouter ses albums, poto ! Vas donc le voir sur scène, tu verras un mec qui s’exacerbe tout seul derrière ses deux claviers, un frétilleur qui tient même pas en place, un mec qui vibrillonne et qui frémit de tous ses atomes d’eau de d’hydrogène nucléaire, tu le verras hennir comme un étalon fumant sorti d’un combat teutonique sur un lac gelé alors que le ciel est d’un gris tellement anthracite qu’il fout même les chocottes aux plus courageux soudards de la piétaille, ceux qui attendent massés à l’orée du bois voisin qu’on leur donne l’ordre d’aller achever les chevaliers désarçonnés, oui, tu verras des trucs dont t’as même pas idée, sur scène tu verras ce mec vivre, il vit de toutes ses forces, il est tendu, teigneux, assis pas assis, on ne sait plus, il est dans les positions intermédiaires de jambes fléchies, comme le séminariste qui n’ose plus s’agenouiller devant l’autel parce qu’il sent qu’il perd la foi, et il claque des dents, le gredin, il grelotte de plaisir et de terreur mêlées car il sent sur sa nuque le regard glaçant de cet enfoiré d’archidiacre qui rêve de l’envoyer au bûcher, oui, mec, avec un lascar comme le Leg tu voyages dans les circonvolutions du temps qui passe et qui n’en finit plus de ne pas repasser, il joue des milliards de notes hurlantes qui te replongent dans les catastrophes et les pillages, dans les écroulements de civilisations, les tourmentes et les pestes de l’an mil, dans les échos profonds des prêcheurs fous et dans une litanie de notes malingres, celles des orgues de barbarie qu’on jouait au pied du gibet de Montfaucon, ah oui, tu les verras, ces vieilles femmes en guenilles, elles viennent à pas de loup ramasser la mandragore au pied des potences, tu entendras cet incroyable capharnaüm de cris de corbeaux, ceux qui se massent sur la poutre haute de la potence et qui d’un claquement d’aile sinistre descendent à tour de rôle picorer les yeux des Villon et des Villard à peine refroidis, tu entendras couler dans ta cervelle la musique de ce monde si atrocement vieux et si terrible, ce vaste monde boursouflé et chargé de charniers et dis-toi bien qu’aucune matinée de printemps ne saura laver l’affront que les hommes font à Dieu, alors lui le Leg, Y chante et Y joue dans cette clameur insensée, il plaque ses deux mains comme de grosses araignées blanches sur ses deux claviers et il swingue comme un démon échappé d’une église en flammes, tu verras la colère s’incruster comme la crasse dans les plis de sa peau, tu verras son visage grimacer dans des grésillements de graisses qu’on brûle, tu verras ses cheveux couvrir son visage ruisselant et trempé de fièvres comme celui d’un crucifié, il libère la vie et il libère la mort, il plaque ses accords et la musique descend la rue Rebeval jusqu’au boulevard de Belleville comme cette marée de rats, crrrrric crrrrric, et tout ce raffut de tohu-bohu du diable assourdit un petit peuple déjà terrorisé, oui complètement terrorisé à la seule vue de cette marée de puanteur et d’horreur poilue, galeuse et carnassière, porteuse de tous les germes les plus immondes, c’est le cauchemar le plus noir de l’humanité, la rédemption impossible, l’affront qu’on ne peut laver, cette musique charrie l’ombre et la lumière, et sur sa croix, le Leg ne se débat pas, il plonge en son âme et conscience à la source de l’essence divine et produit une sorte de miracle, et comme les soufistes, il entre en transe, son corps ne tournoie pas, mais sa musique tournicote à la folie, les volutes s’encorbellent et se byzantisent, les vagues s’épousent pour le meilleur et pour le pire, les pluies fines succèdent aux déluges, mais dans une sorte de suite médiévale jaunâtre et verdâtre, les deux grosses araignées blanches dansent au bout de deux bras tatoués de numéros, ouais, comme à Dachau, et là sur le bras droit, tu verras un gros crâne tatoué à l’encre de Chine de barre d’immeuble de la Courneuve ou du Balnc Mesnil, c’est un Jolly Roger, camarade, il flotte au sommet du mât de cette barcasse de fortune que tu vois croiser là-bas, dans la brume, au large des côtes de Virginie, et dedans qui tu as, mais oui, Barbe Noire, avec ses fumerolles dans les cheveux et ses dix mousquets passés dans la ceinture, ben oui, tu l’as reconnu, James Leg c’est Barbe Noire à l’orgue, mais c’est aussi le Destouches des touches, tu l’as bien compris, il ne joue pas de la pop, mais il se répand en logorrhées de shuffle, il graham-bondise le brian-augerisme, il gospellise le Mose Allison à tort et à travers, juste pour aller pulser dans sa rue, il sacralise ce que tu appelles le gospel d’orgue pour mieux circoncire la concision, il réclame des clameurs, il prêche le Bach à la truite et il ouvre les vannes d’un monde antédiluvien, il nous refait le coup de la Grande Arche, pas celle de la Défense, pomme de terre, mais celle du mont Ararat, quand cette brute de Noé construisait son container géant en bois goudronné, et à ton avis, comment se fait-il que les deux crocodiles n’aient pas mangé les deux moutons, c’est pourtant simple à comprendre, réfléchis une minute, le Leg, Y jouait déjà du gospel d’orgue en ce temps là et il universalisait bien avant tous les autres, il n’y a absolument rien de prétentieux là-dedans, parce que si tu l’écoutes, tu te retrouves dans la rue grouillante de vie, tiens, une autre, celle du Faubourg Saint-Denis, par un beau matin de printemps, très tôt, et tu vois des légumes pourris et de déchets de viande que n’ont même pas fini les chiens joncher le trottoir et les caniveaux, et alors, ben alors t’es obligé de marcher dedans tellement t’en as, il n’est même pas huit heures et déjà grouillent de partout des ashkénazes et des nazes, des nonces et des gonzes, des bonzes et des bons hommes, des brutes et des bites, des blafards et des bluffeurs, des brêles et des belles, t’as de tout, c’est dingue, des babas et des bobeaufs, t’as déjà tout le peuple de paname dans les trois rues du quartier à pas d’heure et les mecs en tabliers te proposent des kilos d’oranges à pas cher, et ça sent la viande fraîche à l’étal du boucher halal, et t’as le flux qui gicle de plus belle sous la pression du shuffle d’orgue, tu sens palpiter la vie alors que passent des solofistes, des sinistrés, des simagrées, des saloupiaux et des salopardes, des salmigondis, des célébrités, des seigneurs des anneaux, des sales mecs et des sales cons, des singes savants, des seulâbres et des sous-préfets, des sectaires, des sans-culottes et des Jeanfoutre, des sabrés de la vie, des soulographes, des systématiques, des saint-simoniens, oui surtout des saint-simoniens, qu’est-ce que tu crois, et des similitudes, des amplitudes, des latitudes, t’as le monde entier qui grouille et qui vaque vaille que vaille autour de toi, tu as tout le délire shakespearien d’Horatio et cette maudite philosophie qui bouillonne dans sa purée, oui, cette purée fumante que déverse sur le monde Louis Ferdinand Leg, il te lègue son legs, tu peux tendre les mains et ouvrir la bouche, c’est pour toi, il te le donne, non, non, non, il ne veut rien en échange, prends ce qu’il te donne, prends, mais prends donc, ne te pose pas la question de ceci ou de cela et du patin-couffin de mes amygdales, prends, c’est à toi, il est comme ça, le Leg, il donne sans rien attendre en retour, c’est pas son genre, et pire encore, c’est assez rare, mais c’est comme ça, et tu l’offenseras si tu hésites une seule seconde, alors ne l’offense pas, amigo, car il pourrait s’encolérer et je ne conseille à personne de provoquer ça, n’attise pas sa rage, il ravage déjà assez de contrées comme ça, oh et puis une chose qu’il ne faut pas oublier, il peut même te transfigurer le psychédélisme, ça fait partie de son panel de sortilèges, tu le vois à certains moments écraser une pédale wha-wha comme s’il écrasait un mégot sur la moquette du grand hall, au Georges V, et paf il te fait Hendrix, mais pas un Hendrix à la petite semaine, diable non, et il te fait le Grand Jeu hendrixien à la Gilbert-Lecomte, celui qui se nourrit de tous les excès pour aller exploser le cosmos littéraire dans les tourbillons d’étoiles, pshhhhhhn pshhhhhh, tu vois, comme ça, et son sbire, son âme damnée le batteur se met à mitch-mitchelliser le beat avec une constance qui en dit long sur sa détermination, et te voilà groové comme pas deux, gros-Jean comme devant, et tu fais quoi, t’as déjà pensé à ce que tu allais faire dans ce genre de situation, non, évidemment, car tu es pris de court, alors c’est pas compliqué, compagnon de tranchée, tu te laisses aller et surtout, surtout, surtout, tu oublies de réfléchir, tu te figures que tu deviens un rat, crrrrrriii crrrrriiii, paumé au milieu de la multitude de rats qui descend la rue machin dont je te parlais tout à l’heure pour aller rejoindre les autres armées de rats lancées à la conquête de Paname et tu te sentiras joyeux, car justement tu oublies enfin de réfléchir, et Louis Ferdinand Leg, c’est à ça qu’il sert, à rien d’autre, il t’ampute de ton cerveau et donne carte blanche à ton corps, à ta peau, à tes pores de gros porc, alors tu te mets à vivre pour de vrai, tu n’appartiens plus à l’espèce maudite et honnie de Dieu, tu grooves dans l’apesanteur de l’anonymat retrouvé, tu n’as plus de carte d’identité, plus de poule, plus de compte en banque, t’as même plus de bite ni de bottes, t’en as plus besoin, ni de clés de bagnole, t’as plus un rond, t’as même plus besoin de rhum pour supporter quotidiennement ta médiocrité, ni besoin du dernier album de James Leg puisque tu n’as plus rien, rappelle-toi, Léo disait exactement la même chose, il y a quarante ans, il n’y plus rien, plus-plus rien, plus de liquide sénescence, plus de sextants d’alarme, tu es un rat, il n’y a plus rien, plus de catéchisme ombilical, plus d’ombilic des limbes, plus de renversement des réacteurs abdominaux, Léo et Leg c’est la même chose, oui, parfaitement, ces deux-là t’aident à échapper à tout ce qui te semble avoir de l’importance et qui n’en a pas, pas la moindre, ouvre un peu les yeux, camarade, examine cinq minutes ta gueule dans un miroir et demande-toi comment t’as fait pour en arriver à ressembler à rien, à moins que rien, et rappelle-toi ce que disait ce vieux pédé génial qu’était Gide, il te le disait bien avant le Congo et le fameux voyage en Ursse, que l’importance soit dans ton regard et non dans la chose regardée, alors regarde les deux araignées blanches écraser les touches de Destouches et tu t’échapperas de la cage du grand laboratoire urbain, tu fuiras cette modernité à la mormoille pour aller rejoindre le flot de la vie qui grouille au bas des rue de ta cité déliquescente, et pourquoi tu crois que Louis Ferdinand Leg Y fait du gospel d’orgue, ben oui, Y l’a entendu ça dans les églises noires chez lui, là-bas, en Amérique, et là tu réalises soudain qu’on monte encore d’un cran dans les phénomènes échappatoires, car le peuple nègre n’avait que ça et rien d’autre pour briser ses chaînes et échapper à la tyrannie sanglante des patrons blancs dégénérés, alors oui, tu peux parler de musique sacrée, ton Destouches des touches Y ne joue pas autre chose, Y fulgure le gospel d’orgue et comble d’orgueil, Y cherche même pas à se faire passer pour un nègre, c’est incroyable, au moins, Y l’a cette décence de la prestance, et le père Moreau, tu sais, le patron du PMU, Y parlait pas de décence de la prestance, mais de savoir-vivre savoyard.


Signé : Cazengler, légataire grabataire
James Leg. Le 106. Rouen (76). 27 janvier 2017
James Leg. Blood On The Keys. Alive Natural Sound Records 2016

Overend is over
Part one

Nous savions tous en 1966 que Brian Jones était l’âme des Stones. De la même façon, nous savions tous que Pete Overend Watts et Guy Stevens étaient l’âme à deux têtes de Mott The Hoople. Sans eux, pas de Mott, pas de rien du tout.
Guy Stevens rêvait d’un groupe original, avec un son anglo-américain. Il avait déjà sous la main un gang de deadly punks chevelus - Overend et ses potes Buffin, Mick Ralph et Verden Allen - et il passa une annonce pour recruter un chanteur. Ian Hunter arriva pour l’audition. Il portait des sandales et ne ressemblait à rien. On dit que ses lunettes noires lui sauvèrent la mise.
Le pote Pete vient de tirer sa révérence. Mais dans l’esprit des fans de Mott, il est toujours vivant. Oh, il suffit juste de remonter quelques années en arrière et d’aller traîner à Acton, dans l’Ouest de Londres, en 1974, l’année où Mott The Hoople, alors au faîte de sa gloire, vient de splitter. Argh !
Pour descendre chercher des clopes le matin, Pete Overend Watts doit se faufiler à travers les amplis entreposés dans le petit escalier de son immeuble. Eh oui, il y a de cela quelques jours, ces bloody fucking roadies avaient débarqué sans prévenir et largué tout le matériel de tournée sur le trottoir. Pete vécut ça comme une double catastrophe. Non seulement, Mott The Hoople venait de splitter, mais il n’avait pas assez de place pour ranger tout le matériel. Seules ses basses et sa garde-robe sont à l’abri. Tout le reste encombre l’escalier.
Sale temps pour les héros. D’autant que les raisons du split ne sont pas jojo. On avait fait comprendre au groupe que pour survivre, il devait s’installer aux États-Unis. Pete refusa catégoriquement d’aller s’installer dans ce pays qu’il déteste. À prendre ou à laisser ? Fuck that ! Par contre, Ian Hunter et Mick Ronson acceptèrent d’émigrer pour relancer leur carrière, laissant Pete, Buffin et Morgan Fisher sur le carreau. Largués comme de vieilles chaussettes.
Complètement fauchés, déchus de leurs statuts de rock-stars et privés de la moindre perspective, nos trois vieilles chaussettes continuent de se voir, mais l’enthousiasme brille par son absence. Alors, Pete décide de réagir. Il revêt sa vieille tenue de centurion du XXIème siècle : combinaison de cuir rouge cerise largement ouverte sur la poitrine et spectaculaires platform-boots blanches. Il secoue ensuite une bombe de peinture de carrosserie couleur or et s’asperge les cheveux. On frappe à la porte. Il ouvre. Buffin et Morgan Fisher n’en reviennent pas !
— Good Lord, Wattsy ! Qu’est-ce tu fabriques en costume de scène ?
— J’ai une bonne nouvelle, les amis, on redémarre le groupe ! Prêts à faire shaker the jewellery ?
— Quoi ? Mais t’es complètement dingue !
— Asseyez-vous, les gars, je vais vous expliquer.
Buffin bat le beurre dans Mott The Hoople. Son physique de gamin lumineux le rend particulièrement attachant. Ses longs cheveux fins et son sourire angélique font de lui une sorte de créature préraphaélite. Contrairement à Buffin, Morgan n’est pas l’un des membres fondateurs du groupe. Il a remplacé Verden Allen à l’orgue. Morgan se distingue à sa façon : il porte le cheveu court, une moustache blonde et d’élégants costumes trois pièces. Au sein de Mott The Hoople, il semblait au début un peu dépareillé. Par contre, Pete incarnait Mott, beaucoup plus que Ian Hunter ou Mick Ralph. D’abord par son allure de rock-star. Sa haute stature, ses mises extravagantes, ses cheveux longs systématiquement teints, son sourire radieux de star du cinéma et son poitrail velu constamment offert en spectacle focalisaient l’attention. Il fut le premier en Angleterre à oser porter des platform-boots surdimensionnées, bien avant Elton John, Sweet et Slade. En prime, Pete bouillonnait d’idées. Comme Bowie, il incarnait la modernité du rock anglais. Son rayon d’action s’étendait du design des guitares au concept du jeu d’échecs en 3D, en passant par un vaste choix de noms de groupes, des innovations scéniques complètement farfelues et des idées de morceaux à la fois classiques et flamboyantes. Pour mesurer le génie baroque de Pete, il suffit simplement de jeter un coup d’œil sur le ratelier où sont rangées toutes ses basses. La plus spectaculaire est sans doute celle en forme d’oiseau argenté, qu’il a baptisée the beast. Il s’agit d’une énorme basse faite de deux grosses planches de contreplaqué contrecollées, recouvertes d’une feuille de métal sur laquelle il a monté un manche monstrueux. Pendant longtemps, Lemmy voulut la racheter.
— Wattsy, t’aurais pas dû te repeindre les cheveux... Tu vas les abîmer... T’as l’air d’un vieux clown...
Pete sourit. Une grande bonté émane du personnage.
— Je vous propose d’avancer. Vous le savez, l’homme qui n’avance pas recule. Je ne vois pas d’autre solution que de remonter le groupe. Êtes-vous d’accord ?
— Oui, évidemment, mais il faut trouver un chanteur et un guitariste pour remplacer ces lâcheurs d’Hunter et de Ronson... Et puis, comment peut-on s’en sortir sans Guy ?
Buffin n’a pas tort. Pete le sait bien, lui aussi. Sans Guy Stevens, Mott The Hoople n’aurait jamais pu quitter la seconde division des groupes anglais. Collectionneur de disques et disc-jockey renommé, Guy Stevens joua à la fin des sixties un rôle prédominant dans l’émergence de la scène rock anglaise. Il commença par animer Sue records, un label qui soutenait des artistes de r’n’b complètement inconnus en Angleterre. Il s’associa ensuite avec Chris Blackwell, le fondateur d’Island Records, pour produire les groupes auxquels il croyait. Doué d’un flair infaillible, Guy dénichait les oiseaux rares. Il produisit le premier hit des V.I.P’s, «I Wanna Be Free», une reprise de Joe Tex, puis le premier album de Free, puis le premier album des V.I.P’s devenus les Spooky Tooth. Il mit aussi Keith Reid et Gary Brooker en relation et baptisa le groupe Procol Harum. Il se mit ensuite en quête d’un groupe qui pouvait sonner à la fois comme Dylan et les Stones. Ce groupe n’existait pas. Guy eut l’idée de le monter de toutes pièces, puis de le baptiser Mott The Hoople, en s’inspirant du roman de science-fiction de Willard Manus. Il produisit les trois premiers albums de Mott qui ne rencontrèrent qu’un succès d’estime. Ce n’est qu’à partir de Brain Capers que le public anglais commença à prendre Mott très au sérieux. Il faut dire que Guy créa les conditions pour que l’album sorte de l’ordinaire. Il sema tout simplement le chaos dans le studio, déguisé en Zorro et courant partout en tirant des coups de pistolet à eau. Guy voulait que ce disque jaillisse du chaos. Il rêvait d’un son extrêmement primaire. Le résultat dépassa toutes les attentes. Brain Capers compte aujourd’hui parmi les fleurons du rock anglais des seventies, certainement la période la plus prolifique de l’histoire du rock.
Pete reprend son rôle préféré, celui de Superman. Il recule de quelques mètres, fait un bond en l’air et retombe souplement devant ses deux camarades :
— Whizzzzzzzzz ! On va s’appeler Shane Cleaven & the Clean Shaven !
Morgan rigole :
— Fais gaffe, Wattsy, un jour, tu vas te péter les chevilles en sautant avec tes boots.
Buffin fait la moue.
— J’aime pas trop ton Shane machin. Tu nous sors toujours des noms qui sonnent comme des gags. Pourquoi ne garderait-on pas notre nom ? On l’abrège... Mott, ça sonne bien, non ?
— D’accord, Buffin. Mott, c’est mimi. Pour la guitare, j’ai pensé à Nils Lofgren. Et au chant, je verrais bien Stevie Wright, tu sais, le mec des Easybeats... Comme ça, on devient un super-groupe et on brûle les étapes. Wooooozzz ! On passe à la une du NME, on saute dans un jet et on remplit le Shea Stadium ! À nous les do-do, à nous les dollars !
Buffin refait la moue.
— Mais pourquoi tu vas toujours chercher des putains de guitaristes américains ? Ça ne peut pas marcher. On a une spécificité, Wattsy, tu sembles l’oublier. Avant, tu voulais faire venir des gars comme Joe Walsh, Tommy Bolin, Ronnie Montrose et même Leslie West, pour remplacer Mick ! Pourquoi pas Johnny Thunders, tant que tu y es ? Tous ces mecs prennent des drogues. Non, il nous faut un vrai guitariste anglais, un mec qui sort des banlieues de Londres, comme nous. On est des petits branleurs de quartier, Wattsy, ne l’oublie pas.
— T’as raison, Buffin. J’aimais bien Ronson, mais son caviar et son frigo rempli de bouteilles de champagne me donnaient la nausée. Demain, je mets une annonce dans le Melody Maker ! Here we go !
Pete, Buffin et Morgan font passer des auditions. Ils portent finalement leur choix sur Ray Major, le guitariste d’Hackensack, un groupe de deuxième division. Pete se frotte les mains. Ray a une bonne dégaine, des cheveux longs et une technique solide. Pendant un temps, Pete cumule les fonctions de bassman et de chanteur, mais il ne parvient pas à renouer avec l’aisance qu’il montrait lorsqu’il embarquait Mott The Hoople dans son fabuleux «Born Late ‘58». Il préfère s’effacer derrière une nouvelle recrue, le chanteur Nigel Benjamin.
La fine équipe part en tournée aux États-Unis. Ils jouent en première partie de groupes renommés qu’ils mettent dans l’embarras. Comment ose-t-on monter sur scène après Mott ? Déchaîné, Pete multiplie les extravagances. Il s’envole sur scène et plane au dessus du public en labourant le manche de son énorme basse. Des flammes jaillissent des talons de ses platform-boots. Il se repose sur les planches et jette sa basse en l’air. Elle voltige et il la rattrape au vol, juste au moment du break. Fascinés, les journalistes commencent à délirer. Certains affirment avoir vu Pete voler, cape au vent, entre les buildings. D’autres racontent que Pete ramène plusieurs filles à la fois dans sa chambre d’hôtel. Il commence même à recevoir des propositions d’Hollywood pour des remakes de Tarzan, d’Iron Man et de Captain America. Il les décline avec courtoisie, arguant qu’il doit prendre le temps d’y réfléchir. En réalité, Pete préfère rester fidèle à ses amis.
Malgré tout ce battage, ils rentrent bredouille à Londres. Pour une raison qui leur échappe, Mott n’intéresse pas le rock business.
Buffin et Morgan retournent voir Pete chez lui, à Acton. Le moral est au plus bas. Mais Pete ne désarme pas. Il monte sur le frigidaire et saute à travers la pièce. Whizzzzzzzzz !
Morgan comprend tout de suite :
— Tu viens d’avoir une nouvelle idée, Wattsy ?
— Cette cruelle panthère noire qu’on appelle l’évidence vient de me sauter à la gorge : nous allons prendre un nouveau départ. Première chose : débarrassons-nous de notre vieille peau. Mott, ça commence à sentir le moisi. Tournons-nous vers le futur. Frappons un grand coup en adoptant un nouveau nom pour le groupe ! Que pensez-vous d’Elegant Mess ?
— Non, trop sarcastique.
— C’est vrai. The Chauvinist Pigs ?
— Non, trop politique.
— Bon, alors... The Strummer Cakes ?
— Et pourquoi pas les Flying Bananas, tant que tu y es ?
— C’était pour rire, Buffin... J’ai une autre idée qui va vous plaire : The British Lions !
— Ah ouais, pas mal !
Ils contactent John Fiddler, le guitariste chanteur de Medecine Head, un groupe devenu culte grâce au soutien de John Peel et de son label Dandelion. Pete demande cependant à John Fiddler de revoir son look. En effet, le candidat porte encore des lunettes, une moustache et des cheveux beaucoup trop longs. Excité par la perspective de jouer avec les survivants de Mott The Hoople, John se fait couper les cheveux, rase sa moustache et enfile des platform boots. Ils montent rapidement un répertoire habilement saupoudré de reprises classieuses, comme par exemple «Wild In The Streets» de Garland Jeffreys et «International Heroes» de Kim Fowley. Le groupe entame une tournée anglaise et fonce, tel un paquebot fellinien, à travers un océan d’indifférence. Ils ont beau réhausser les talons de leurs platform-boots, jouer comme des lions et rajouter des reprises du genre «So You Wanna Be A Rock’n’Roll Star» des Byrds, rien n’y fait. Le public se tourne vers la scène punk, alors en plein essor. Les British Lions passent pour des vieux schnocks.
Retour à Acton. Morgan ne parvient pas à surmonter son amertume.
— Cette fois, c’est mort, Wattsy, par la peine de nous faire ton numéro de cirque.
Pete commençait à escalader l’un de ses gros juke-boxes pour sauter à travers le salon. Il redescend.
— Dommage pour vous, j’avais une nouvelle idée... Je suis sûr qu’elle vous aurait intéressé...
— C’est pas ça le problème, Wattsy. On est trop vieux. On passe pour des has-been. C’est horrible. Regarde les kids dans les rues. Ils portent des T-shirts marqués «I Hate Pink Flyod». On fait partie du lot, tu sais. Le pire, c’est qu’on n’a pas un rond et on finit l’année avec une ardoise aux impôts. J’ai décidé de quitter ce pays de merde.
— Tu comptes aller où, Morgan ?
— Probablement au Japon...
— Et toi, Buffin ?
— Oh, je reste dans les parages, t’inquiète pas. J’ai un contact pour entrer au service d’une maison de disques comme producteur...
— Quoi ? Toi dans la production ? Quel gâchis ! Tu es l’un des meilleurs batteurs de rock anglais !
— Oui, c’est possible, Wattsy, mais je tire trop la langue. Je commence à en avoir marre. Ça fait quinze ans qu’on vit avec 75 £ par semaine. Regarde, t’as revendu toutes tes guitares pour pouvoir payer tes factures. On t’aime bien Wattsy, mais c’est pas la peine de nous brancher sur ta nouvelle idée. On jette l’éponge. C’est trop dur.
— Vous savez pourtant qu’on est les meilleurs. Les Stones n’ont jamais eu le son qu’on avait sur scène.
— Qu’est-ce que tu comptes faire, Wattsy ?
— Embaucher Keith Richards comme guitariste et Bob Dylan comme chanteur ! Ils ont toujours rêvé de nous avoir comme section rythmique. Ça ne vous paraît pas évident ? On passe à la une du NME, on saute dans un jet, on remplit les stades américains et on achète plein de guitares, comme dans le temps. J’ai écrit une bonne dizaine de chansons. Rien que des tubes ! J’ai même remis au point ma bandoulière élastique. C’est un nouveau système. Avec ça, je peux jeter la basse vers le sol sans qu’elle ne me rebondisse dans les dents.
— Non, Wattsy, ce n’est pas le sens de ma question. Qu’est-ce que tu comptes faire dans le civil ?
— Bon, alors on arrête ?
— On te l’a expliqué, mais tu n’écoutes pas.
La vie reprend son cours. Pendant quelques temps, Pete tient un petit stand à Portobello. Il y écoule péniblement sa collection de platform boots. Puis il se retire à la campagne et se recycle dans la pêche à la carpe. Il finit par faire la une d’un journal local en brandissant une prise monstrueuse. La photo le montre souriant et coiffé d’un petit chapeau. La carpe fait plus d’un mètre. Jamais encore les gens du coin n’avaient vu une carpe aussi énorme.
Signé : Cazengler, Overenda en alu
Pete Overend Watts. Disparu le 22 janvier 2017

*
1
Mon ami le Commissaire est entré sans frapper dans ma chambre. A peine avais-je ouvert un oeil glauque qu'il m'a vigoureusement houspillé :
- Ah ! Ah ! Je croyais que les rockers ne dormaient jamais, debout grosse couleuvre ! J'ai dégoté huit jours de repos. On en profite !
- Euuuuu ! C'est quoi cette valise que tu as posée sur la table de nuit !
- Cadeau maison ! Pas de perfecto aujourd'hui ! Regarde ce que je t'ai apporté !
- Quelle horreur ! On dirait des costumes de CRS !
- Des authentiques ! Des vrais ! Je les ai fauchés ! Tu en enfiles un direct et moi l'autre !
- Tu crois que...
- Pas le temps de t'expliquer, mais aujourd'hui je réalise le rêve de ma vie ! Allez hop, on part !
Et voilà pourquoi quelques minutes plus tard la Teuf-Teuf fonçait vers les plages de la Grande Bleue à toute vitesse. Durant le trajet, alors que nous remontions une bretelle d'autoroute à contresens, l'intarissable Commissaire s'est livré à quelques confidences !
- Tu sais, si je suis rentré dans la police, ce n'est pas pour mon amour immodéré de l'ordre, au fond de moi je suis un démocrate, à la base depuis tout petit je voulais devenir CRS, pas ceux qui tapent sur les manifestants, non, ceux qui surveillent les plages en été, tu comprends le prestige de l'uniforme sur les baigneuses c'est imparable, mais quand j'ai passé les tests, ils m'ont dit que j'étais trop intelligent, et puis je ne savais pas nager, du coup ils m'ont bombardé Commissaire.
- Sûr qu'il n'y a rien de pire qu'une vocation contrariée ! Un rêve d'enfant brisé, quelle honte !
- Oh je ne me plains pas, j'écrase les piétons sur les passages cloutés en toute impunité, je revends la cargaison des dealers que je pince, je prélève les tableaux de maître sur le butins de cambrioleurs, je fais sauter les distributeurs de billets à l'explosif, la routine quoi !
- Je sais, mais tu ne pousses pas le bouchon un peu loin parfois ?
- Ne t'inquiète pas j'ai des dossiers sur la moitié des hommes politiques du pays, encore mieux qu'une assurance tout risque.
2
Une fois sur place j'ai un peu déchanté. Faisait pas chaud dans la guérite qu'un vent froid et violent secouait méchamment. Certainement le même aquilon qui avait décroché Keith Richards de son cocotier, de grosses vagues colériques s'écrasaient sur la plage déserte, et la température devait avoisiner le zéro, brrr !
- Voudrais pas te contrarier, mais ton idée me semble un peu foireuse, en février les naïades aux seins nus, même avec tes jumelles militaires super puissantes, ce n'est pas la saison idéale pour se rincer l'oeil !
- Le QI des rockers n'est plus ce qu'il était. Me prendrais-tu pour un cave à fromages ? Tu regardes du mauvais côté !
- Parce que tu crois que les filles du coin se promènent complètement à poil dans les dunes sableuses hérissées de bosquets d'ajoncs impénétrables et urticants avec un ressenti de température de moins quinze degrés !
- Commence par te taire, braque tes longue-vues et attends, je te promets des merveilles ! En attendant plus un mot, et arrête de bouger, tu finiras par nous faire repérer.
3
Au bout de trois heures, frigorifié jusqu'à la moelle, je commençais à trouver le temps long, et proposai au Commissaire d'opérer un mouvement de repli vers un bar accueillant. L'a à peine bougé les lèvres pour me répondre, mais ce qu'il m'a murmuré dans l'aigre bise valait le détour.
- Surtout pas, début février c'est la saison des accouplements et je pense que tu ne voudrais pas manquer cela !
- Tu sais la reproduction des mouettes rieuses, ça ne m'a jamais fait rire !
- Les rockers sont vraiment de plus en plus bêtes ! Tu crois que le gouvernement m'a offert huit jours de congés payés sur le dos du contribuable ? Mon vieux, nous sommes en mission commandée, l'on n'est pas ici pour admirer à la jumelle le fessier des touristes dénudées sur la plage. L'enjeu est beaucoup plus grave.
- J'y pige que couic !
- C'est l'anti-terrorisme qui m'a confié la mission.
- Des islamistes !
- Tu veux rire ! Un truc beaucoup plus sérieux. Les Amazones, un groupe féministe radical. Veulent prendre le pouvoir et asservir les hommes. S'entraînent au maniement des armes dans les endroits désertés. N'acceptent que les filles. Mais au début de février, elles s'emparent des hommes et les violent. Puis elles les tuent. C'est ainsi qu'elles se reproduisent. Or comme tu vois, nous sommes juste le premier février !
- Vachement sympathique ta petite virée, c'est quoi ce cirque, Martin, je me casse de Palavas !
- Rocker de mes deux ! Ecoute mon plan démoniaque. Tu connais ma devise : joindre l'agréable à l'utile. D'abord on se laisse faire, ensuite c'est nous qui les éliminons. Tiens prends ce joujou, il ne paye pas de mine mais il a une capacité de tir non rechargeable de 400 coups, des balles perforatrices à tête chercheuse.
- OK ! Comme ça, c'est jouable !
- Tais-toi ! Regarde sur la droite, les épineux bougent dans le sens opposé du vent !
- Diable ! C'est vrai !
4
Hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour sûr elles étaient nues mais l'on n'a pas eu le temps de proposer des selfies, elles se sont ruées sur notre poste d'observation en hurlant. Pas de joie. De haine. Ont commencé par nous tirer dessus au fusil de chasse. D'autres maniaient de longs coutelas qui laissaient présager un sombre avenir pour les attributs de nos virilités conquérantes. Des harpies ! Heureusement que les joujoux du Commissaire ont tenu leurs promesses. Mais plus on en abattait, plus il en sortait de sous les buissons. L'on a pu par miracle regagner la teuf-teuf et démarrer. Pauvres fous, malgré nos uniformes lacérés nous croyions nous être sortis d'affaire ! Mais il n'en était rien. Nous ont poursuivis en voitures jusqu'à Paris, nous tirant méthodiquement dessus avec leurs vieilles pétoires. On a fini par les égarer en prenant selon notre habitude le périph à l'envers...
- C'est bon on les a semées ! Le premier bar que tu aperçois, tu stoppes et on s'en jette un ! Tiens celui-là, Les Polissons, ça nous fera du bien de nous retrouver entre mecs !

C'est quand on s'est accoudé au comptoir que le Commissaire, pourtant incroyant notoire, a fait son signe de croix :
- Non d'un jus de carotte biologique ! Les ennuis commencent !
03 / 02 / 2017 / LES POLISSONS
LES ENNUIS COMMENCENT

J'étais dans le Sud, z'en ont profiter pour filer dans le grand nord. J'ai raté leur passage à La Féline, mais suis remonté dare-dare, sept cents kilomètres d'un trait pour finir par les pincer dans un bar – dans quel autre endroit auraient-ils pu être ? - à Paris. Quand je suis entré j'ai cru qu'ils étaient en train de voler les chaises, me suis précipité pour leur filer un coup de main, mais non, ils discutaient avec le patron, délimitaient l'espace nécessaire à leur futur méfait. Le temps de me délecter d'un burger de l'Aveyron et la salle a commencé à se remplir. Que voulez-vous, c'est ainsi, le vice, le crime et le rock'n'roll attirent le monde. En tête bien sûr leur indéfectible soutien, les Jezebel Rock, groupe mythique et originel de la grande vague du rockabilly français.
ASTRO
Les voici. Vous les présente. A gauche Guillermo del Mojo, casquette plate et lignes de basse swinguantes comme des ablettes dans le courant de la rivière, à droite Arno KLX, imperturbable, le plus redoutable des snipers, de temps en temps il effleure d'un seul doigt une corde de sa guitare et il vous envoie un exocet sous la ligne de flottaison de votre cerveau, ils ont tenté de cacher le plus beau et le plus jeune au fond, derrière ses caisses, mais avec son duveteux collier de barbe blonde Hugo le Kid monopolise l'attention de l'auditoire féminin – les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il passe le balai sur sa caisse claire avec une telle aisance, une telle élégance, une telle dextérité, qu'elles rêvent de le voir exercer son talent dans leurs deux pièces cuisine. Enfin Atomic Ben, guitare et vocal. Voilà, c'est tout. J'allais oublier ! Atomic Ben ne se contente pas de jouer de la gratte et de chanter. Il parle aussi. Un véritable camelot. Un extraordinaire bagout. Oscille entre la sentence péremptoire et la réflexion philosophique appliquée à la survie du rock'n'roll. N'ont pas fait de balance, alors ils commencent par un boogie-groove du meilleur effet, manière de se dégourdir les doigts et de chauffer la voix.
LOST ROCKABILLY
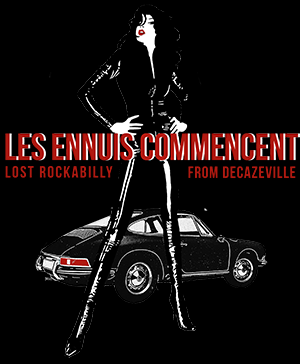
Rockabilly band. Mais le rockabilly des franges. Des marges. Des marais. De l'orée du bois. Tout ces lieux incertains d'échange et de partage. D'entrée et de sortie. De repli et de départ de raid. Les bouts de pistes et les prairies en feu. Dans la marmite du rock'n'roll mijote un étrange gumbo. Atomic vous fait l'article, détaille la recette et vous fait goûter. A pleines louches. Entre lampées post-fifties et lapées pro-seventies, le claquement sec du rockab et l'électricité flamboyante, la chatte du rockabilly n'y reconnaît pas tout à fait ses petits, mais que voulez-vous lorsque l'on s'accouple avec un tigre, l'on est obligé de reconnaître que parfois les amours illicites et les manipulations génétiques ont du bon. Du meilleur même.
MAMBO 1

Premier set. Semi-pseudo-acoustique nous prévient Ben. Il existe des voisins sourcilleux. Une déplorable engeance. Qui ne supportent pas le rock'n'roll, cette musique de voyous. Nous ne les avons pas tous tués. Les voisins bien sûr. En attendant le premier set jouera à l'usine à tubes. Des boots qui sont faites pour marcher et la basse électrique del Mojo qui slappe – comment fait-il ? – comme des coups de fouets sur le postérieur d'un adepte S/M, et Ben qui atomise sa voix pour que nous soyons pénétrés du sujet. L'on change de filles tout de suite après Nancy c'est Françoise et Le Temps de l'Amour, attention version wild surfin', Arno fait ronronner sa guitare comme une turbine électrique, mais Ben nous découpe dans les lyrics le mot blessure d'une voix si pathétique que c'est notre coeur qui saigne. Un truc typique des Ennuis, vous prennent une chansonnette, l'essorent dans leurs mandibules et vous en ressortent un ovni foutraque intensément rock. Poursuivent la démonstration. Elvis. The Pelvis. Marie's the name. His latest Flame pour être plus précis. Une rythmique sautillante et le bourbon ambré du Hillbilly Cat qui bourdonne et vous embouchonne l'âme d'une violence retenue. Du grand art. Essayez vous-même dans votre salle de bain et vous verrez les dégâts, les Ennuis s'en saisissent et vous l'étrillent méchant, le Kid qui précipite et saccade, Arno qui susurre la nostalgie, Guillermo qui déroule le tapis rouge de sang sous vos pieds et Ben qui vous vrille les entrailles du haut de ses amygdales, un incendie ravageur, ça vous brûle de haut en bas, et vous en avez en même temps des frissons dans le dos.
Ne se priveront pas de nous refaire l'histoire du rock, de Don Gibson à Elvis – oui, ils ont des préférences - tout le long de ce premier set. Mais nous offrent aussi une petite friture originale de leur estampille. Splish Splash le bruit de votre cerveau quand il est amoureux nous explique Ben, le coup de foudre et la déconvenue finale, le Yin et le Yang si vous le voulez à la japonaise, le tambour et le Trumpette si vous le désirez à l'américaine, le filon et le Fillon si vous le désirez à la franchouillarde, plein gaz, pied au plancher, la glotte de Ben ping-ponge entre le bonheur et douleur sur la table de l'ironie. J'arrête la liste du jukebox, vous auriez des remords. Certes tout est relatif, mais auraient-ils rajouté quarante titres que dans l'absolu cette première partie aurait été tout de même trop courte. Descendent de scène sous les applaudissements et les regrets.
MAMBO 2

Pas éternels puisqu'ils reviennent. Dommage pour le voisinage, mais ils appuient un peu sur le potentiomètre dès le premier morceau. Instrumental, Apaches. Mais là ils sont sortis de la réserve et laissé le vieux Cochise sous le wigwam, c'est Géronimo l'impitoyable qui mène le raid. Risque de ne plus rester de visages pâles pour témoigner de leur sauvagerie. KLX vous démantibule son bigsby comme jamais Hank Marvin l'a osé, vous scalpe les trémolos d'une main d'orfèvre, et sur sa guitare Ben vous secoue un tintamarre à réveiller les fantômes de la Ghost Dance. Les guerriers cavalent comme s'il y avait mille femmes blanches à s'emparer, et peut-être encore mieux un troupeau d'appaloosas aux sabots de feu. De la fureur rouge l'on passe à la brutalité noire. Come on de Chuck Berry, au rouleau compresseur, des riffs incendiaires qui ricochent de partout et une rythmique stonienne à brouter du béton. Un peu de blues. Classique rien à dire. D'ailleurs c'est quand le morceau est fini que Ben nous montre ce qu'il aurait pu faire dans les soli. Sa guitare ricane comme une colonie de chacals en train de dépiauter une momie égyptienne. Pas de temps à perdre, le train démarre. Mystérieusement. Trajet pas de tout repos. Les plaines du far-west à toute allure en hors d'oeuvre, ensuite c'est plutôt hot rails to hell, et Atomic bruite la locomotive. Inutile de tirer la sonnette d'alarme, les ennuis commencent. Si forts, que le patron s'en vient demander à ce que le train s'arrête en gare et que tous les voyageurs descendent.
Pas contrariant le Ben, OK my boy et il relance la vapeur. A sa manière. The Way of the West, une pétaudière australienne qui permet à nos kangourous sauvages de nous piétiner le cortex. C'est beau comme de la nitroglycérine. Deux ou trois petites babioles irradiantes comme cette reprise boléro-flamenco de Ricky Amigos, et l'on termine par ce que les groupes de rock'n'roll ne savent plus faire. La présentation du combo, aujourd'hui l'on se contente de jeter trois prénoms inaudibles et bonsoir les copains, l'est temps de vous brosser les dents avant de vous coucher. Les Ennuis eux ressortent l'antique rituel – cette étrange pratique qui tient autant de la déclinaison policière de la fameuse fiche S que du défilé de haute couture - chacun des champions sous ses plus beaux atours instrumentaux et la faconde de Ben qui proclame et enturbane le pédigrée de ses catcheurs. Sortez vos mouchoirs, c'est fini. Non, les voisins ne s'en tireront pas sains et saufs. On ne leur fera pas l'honneur de les caresser à la batte de baseball. Les Ennuis leur font le coup du parapluie bulgare. Leur ont réservé un dernier petit cadeau empoisonné. Une ritournelle vénéneuse, dont le cyanure mental s'insinue lentement en vous, porté par les ondes sonores et inoculatoires jusqu'à vos oreilles, La Belle Saison, des Dogs, chronique d'une mort prochaine annoncée... Que voulez-vous dès qu'il y a du rock'n'roll dans l'air, Les Ennuis Commencent...
OUF !
Quand cette kronic sera publiée ils auront déserté la capitale et rejoint leurs pénates, les mines à ciel couvert de Decazeville. Normalement ils ne passent sur Paris qu'au mois de février. Nous sommes tranquilles pour un an. On va enfin pouvoir vivre en paix !
A peine deux jours qu'ils sont partis, et déjà ils nous manquent...
Damie Chad.
Les ennuis continuent, décidément on ne peut jamais être pénardos en ce bas-monde. Nous ont glissé un petit souvenir dans la poche, un CD cinq titres, les pistes non retenues lors de l'enregistrement de leur dernier album Love - o - rama ( voir KR'TNT ! 270 du 25 / 02 /2016 ).
THE JOHNNY BURNOUT OUTTAKES
LES ENNUIS COMMENCENT
ASTRO ROCKABILLY MAMBO
ASTRO ROCKABILLY MAMBO / THE WAY OF THE BEST / ROUTE 66 / I'M SO DEPRESSED / MORE MORE MORE
METHANOL PRODUCTION

Astro Rockabilly Mambo : plus qu'un titre, un magnifique manifeste rock'n'roll, à la sauce Les Ennuis commencent. Z'écoutez les paroles, c'est toute l'histoire du rock qui est passé en revue, Jezebel Rock, Melody Massacre, Rycky Amigos, Ervin Travis, bref une certaine idée de la déglingue rockabilly, à la française, plus toute la mythographie internationale qui marche avec, le capharnaüm de la culture rock qui vous a détruit la tête, mais qui vous permet de survivre en ultime desperado des rêves écroulés. The Way of the Best : western rock, la guitare se charge des décors, vous peint les paysages en Colorado-rama, et ensuite c'est la cavalcade des pistoleros, vous traversez tout l'Ouest de long en large, premier arrêt à O.K Corral. Ça ne s'améliore guère par la suite, mais il vaut mieux vivre sauvagement que sagement. Route 66 : deuxième grande virée au travers des Etats-Unis, vous refont le parcours à la boogie woogie bastringue, autant dire que le pianiste est en danger de mort, d'ailleurs les guitares lui roulent dessus sans ménagement. Atomic Ben est au volant et les autres lui ont mis un foulard sur les yeux. Tout de suite la vie devient plus excitante. I'm so Depressed : un vieux truc d'Abner Jay. Un tordu, dites-moi qui vous aimez et je vous dirai qui vous êtes. J'ai toujours tenu Abner Jay ce cul-terreur descendant d'esclaves pour l'ancêtre country-folk-blues d'Hasil Adkins, ce genre de mecs qui tirent tout d'eux-mêmes, leur mode de survie et leur folie douce. Bref les Ennuis vous électrifient ce vieux chant de la grande dépression, une manière de se doter d'un anticyclone pour parer la menace sociale qui s'avance sur nous. More More More : dans la série I wanna be your Dogs, vous enlèvent la pastille à l'acoustique avec un accordéon qui déroule ses anneaux par derrière. Bonjour les cajuns, l'on attrape les alligators en leur saupoudrant la queue avec du sel. L'on en reste la bouche bée.
Cinq pépites indispensables à tous les chercheurs d'orck. En plus plein d'invités sur le disque – 3 Headed Dogs, Ben Bridgen, Aurore Asphalt, Kieran Thorpe, Plume, Laurent Biron, Fred Gissy Guy Messinesse - car plus on est de fous plus on rock. La preuve est faite – une fois de plus – c'est la société de ses semblables qui corrompt l'homme et c'est ainsi que les ennuis commencent.
Damie Chad.
04 / 02 / 2017 – TROYES
LE 3 B
BROKEN FINGAZ

Temps clément. Aucune excuse pour ne pas filer tout droit vers la bonne ville de Troyes. Aucun barrage d'icebergs prévu par les météorologues. La Teuf-Teuf picore les kilomètres avec la régularité d'une poule glousse qui gobe des grains.
Peu d'habitués dans le 3 B. Les fans de rockab ne seraient-ils point par hasard un tantinet sectaires ? Non pas du tout, mais ils n'aiment que le rockabilly. Moi aussi, mais entre le rockab et le rock'n'roll, d'après moi n'existe qu'un peu profond ruisseau calomnié comme le tournait en alexandrin Stéphane Mallarmé. N'empêche que le café se remplit de têtes nouvelles.
Broken Fingaz, la sonorité gaëlique du second terme m'avait induit en erreur. Je pensais avoir affaire à un groupe de rock celtique. Tiens me disais-je, une soirée menhir et dolmen, cela changera de chaussures de daim bleu sur calandre des cadillacs roses. L'étymologie est une science difficile et trompeuse, Fingaz n'est pas le nom glorieux du guerrier inconnu d'une obscure saga islandaise, mais le déformation argotique du mot anglais finger. Doigts Brisés, appellation très rock'n'roll ! Pourvu qu'ils tiennent leur promesse !
PLEIN GAZ
Deux guitares, une batterie et une basse tenue par DD Dufour, vous connaissez, c'est lui qui officiait à ce même instrument en ce même bar dans les Natchez ( voir KR'TNT 300 du 27 / 10 / 16 ), oui celui avec un look d'indien qui en remontrerait à un lakota pure souche. Ben Proy pousse sa batterie doucement et les guitares emboîtent le pas en cadence, et surprise, du fond de la salle s'avance Sylvain Lambert, le chanteur, un vrai, seul avec son micro. Pour le moment se contente de laisser monter la mayonnaise. Yeux à terre mais présence indubitable. N'a pas encore ouvert la bouche qu'il est là à égalité avec les autres qui préparent l'allumage des moteurs auxiliaires pour s'arracher à l'attraction terrestre. Z'ont enfilé les deux premiers titres Week End et Don't Be Sorry, tout en souplesse, l'air de rien, lorsque Sylvain nous annonce Put me in the Space, et là faut bien réaliser le tour de cochon qu'ils nous ont préparés. Nous ont englués, scotchés, collés, nous sommes prisonniers, le piège s'est refermé sur nous car on ne descend pas d'une soucoupe volante qui fonce dans les zones inter-galactiques. Remarquez personne n'a envie de s'évader. Ne vous méprenez pas, ne nous la font pas à l'atmosphère éthérée genre Pink Floyd avec des étoiles roses toute mignonnettes sur le papier peint !
Du rock à cent pour cent. Parfois ils se moquent de nous et nous assurent que le morceau suivant est un slow. Autant dire que les escargots se déplacent à la vitesse d'un TGV. On ne les croit pas. On a vite éventé leur ruse diabolique. D'abord ils installent une coupole sonique transparente dont ils ne vous laisseront pas vous évader, vous êtes trop occupés à savoir comment ils réalisent leur magie rouge. Ben a vite fait de vous entourlouper. Ne le lâchez pas des yeux, l'est en train de marquer un petite rythmique tranquilloute, et subitement tout s'envole, le morceau décolle, pourquoi rester simple quand c'est si facile de complexifier le jeu, donne l'impression de frapper ses cymbales par dessous comme pour amplifier la cadence et vous il vous emporte dans une structure mouvante comme s'il mettait le morceau en lévitation. Dom Lambert est à la lead. Imposant. Louvoie sur ses cordes tel un catamaran sur les vagues. Un artiste, n'essayez pas de l'imiter vous allez vous faire des noeuds dans les doigts et il faudra l'intervention d'un chirurgien pour remonter le kit de vos phalanges. A condition qu'avant vous ayez pris soin de les numéroter dans l'ordre. Et quand il joue en slide, inclinez-vous respectueusement.
Eddy Lambin est à la rythmique. Pistolero de choix. C'est lui qui envoie les riffs. Tonitruants et monstrueux, sur Gimme Shelter il lâche les scuds qui vous défoncent les os, ne tournez jamais le dos, c'est là qu'il vous tromblonne sans pitié. Fait parler la poudre et booster la foudre. Entre les deux guitares, Sylvain. Pourriez vous faire du souci pour lui. Ses deux acolytes produisent du gros son, place sa voix sans difficulté. D'abord le regarder bouger. Surtout dans son immobilité. Un chaman qui se concentre pour mieux capter l'énergie du monde, subitement il exulte, avec ses cheveux bouclés et son jeu de jambe rappelle un peu Ian Anderson de Jethro Tull, mais davantage cérémonieux, sait se recentrer sur lui-même, se recueillir pour accumuler le souffle et la force explosive dont il va avoir besoin. Derrière, DD participe d'une semblable sérénité, joue en profondeur, silencieusement a-t-on envie de s'écrier stupidement, plénitude du son qui aggrave les graves, semble rêveur mais est à l'affut et son sourire éclate lorsque la musique vacille dans les boursoufflements des breaks, et s'épanouit dans une coalescence de puissances. Devant un tel magma, et une cadence si enlevée, l'instinct vocal serait de s'égosiller à s'ensanglanter le larynx, Sylvain ne cède pas à cette facilité. Il chante, il module, il respire. Sait aussi hacher le phrasé, inciser les phonèmes et précipiter l'andante.
Deux sets remplis de surprises, ce Personal Jesus de Dépêche Mode totalement réapproprié et supérieur à l'original et cette reprise de Heroes de Bowie qui permet au combo de nous faire une démonstration de ce que l'on appelle une orchestration. Le deuxième encore plus rock que le premier et qui du coup en paraît si court qu'ils reviendront pour un troisième. Nous refont Gimme Shelter et un Fortunate Son à l'emporte-pièce. Les filles dansent, il y en a même une qui s'agenouille en joignant les mains pour quémander encore un dernier titre. Mais c'est à Jean-François qu'ils dédieront Antisocial. L'avait passé Trust sur la sono avant le concert et avait pallié l'absence de Duduche en improvisant un Sweet Home Alabama ( pas tout à fait d'anthologie mais courageux ) soutenu à la guitare par Eddy.
Quatre ans qu'ils jouent ensemble. Une cohésion et une cohérence étonnante. De l'humour et une grande simplicité. Broken Fingaz a tout cassé. Viennent de la région de Reims. Là où l'on sacre les rois.
Damie Chad.
BURN OUT
BROKEN FINGAZ
BORN IN THE CITY / I FEEL SO ISOLATED / PUT ME IN THE SPACE / HEROES
Dom Lambert : guitare / Sylvain Lambert : chanteur / Arno Jaloux : guitare / Ben : batterie / DD : basse / Arno Jaloux : guitare.

Born in the City : salmigondis de guitares en introduction juste pour vous avertir que vous venez de passer la frontière du pays du rock'n'roll. Venez pas vous plaindre si vous trouvez que ça balance un peu trop. Super bien en place. Sans bavure. Sans défaut. Lustré à l'huile de vidange. A écouter très fort. La batterie est merveilleuse et les cordes vous tirent du mauvais côté, celui que vous préférez. Sylvain vous avertit des dangers à éviter. L'est si persuasif – voix charmeuse de serpents venimeux - que vous vous précipitez dans la city pour louer un studio. D'enregistrement. I Feel so Isolated : un brin davantage binaire, juste pour vous montrer ce que l'on peut faire avec un kit de base. Sylvain l'a l'air d'ânonner les évangiles du diable et c'est parti pour la farandole rock and roll, le grand jeu, une démonstration, comment l'on passe le bâton de dynamite allumé au copain, qui s'en saisit et s'en amuse comme un dum dum boy, avant de le refourguer au voisin. Franchissent la ligne d'arrivée tous ensemble, en vainqueurs. Et la mèche brûle encore dans vos oreilles. Put me in the Space : un peu de grandiloquence ne messied pas aux épopées. Le guitares viennent brouter dans votre main, attention, elles ont des crocs de panthères affamées. La voix de Sylvain a beau leur caresser l'échine, elles restent des animaux sauvages. La section rythmique vous injecte des flaques de sang frais pour leur ouvrir l'appétit. Et vous aimez cela. Les hyènes stellaires. Heroes : moi je n'aurais jamais osé. Faut avoir les olives ou les ovules grosses comme des ballons de rugby pour se risquer à déplacer les pyramides. Z'y foncent franc jeu et le ridicule ne les tue pas. Z'ont l'aisance des dauphins qui se jouent des vagues assassines. Accélèrent même le final, faut bien montrer qu'ils ont encore de la réserve. Les héros sont ceux qui s'affrontent aux monstres et qui en ressortent vivants.
Nous ont promis un album pour bientôt. Prenez-le d'urgence en pré-commande, il risque de ne pas stagner longtemps dans les bacs à gruyère de votre crèmerie préférée. L'ambroisie des Dieux.
Damie Chad.
ANÂHATA
DÄTCHA MANDALA
MISERY / MOJOY

Nicolas Sauvey : vocal, basse, acoustic guitar, harmonica / Jérémie Saigne : guitare / Jean-Baptiste Mallet : drums / Production : Clive Martin
MRS Sound Septembre 2016.
Vu la semaine précédente au Petit Bain. Voir KR'TNT ! 314.
Visent haut. En plein coeur du quatrième chakra. Celui qui permet au reptile de la kundalini de grimper des tréfonds du pubis jusqu'à la voûte du ciel. Le serpent céleste. Avec un tel projet, les Dätcha Mandala ont intérêt à assurer. Ne vous étonnez pas de la longueur des morceaux qui flirtent avec les cinq minutes, ce quarante-cinq tours est un extrait du futur album destiné à paraître fin de ce mois des fièvres. L'orange de l'oeuf originel estampille le bleu foncé de la pochette. Attention, l'est fendillé, quel monstre merveilleux en éclora-t-il ?
Misery : vous mettent la misère. Vous content la vie d'un garçon qui vous ressemble trop pour ne pas être vous. La guitare pleure et la voix monte vers la plénitude de la souffrance. Et tout l'orchestre derrière qui commence à mugir comme un troupeaux de dix mille moutons noirs que l'on pousse vers l'abattoir. Escaliers pour le purgatoire. La voix de Nicolas Sauvey sur le fil du rasoir. Tient l'équilibre. Descente abrupte. Pas de rambarde où se rattraper. Vous lui emboitez le pas tout de même. Vous tenez à savoir comment tout cela se terminera. Mal. Mojoy : Après la ballade emphatique le mojo de la joie. Dérive honky tonky blues, l'harmonica qui draine le chemin, la voix qui saute les haies les nuits de pleine lune, et l'est sûr que ce soir on ne va pas s'ennuyer. La guitare gronde et la batterie gambade la chamade. Fête païenne, l'alcool de contrebande coule à flot, hymne à la joie. De vivre.
Davantage Dätcha que Mandala. Que voulez-vous la jeunesse a le temps devant elle, inutile de se précipiter vers la cauteleuse retenue de la sagesse. Les vapeurs d'encens ne valent pas l'âcre fumet du moonshine. Pas besoin de gratter l'écaille du serpent pour sentir le musc du Dirigeable. Mais si vous n'avez pas de maître pour vous tirer vers le haut, vous ne pourrez jamais le tuer. Le rock sourit aux audacieux.
Damie Chad.
14:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ' james leg, pete overend watts, les ennuis commencent, broken fingaz, dätcha mandala
01/02/2017
KR'TNT ! ¤ 314 : KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 314
A ROCKLIT PRODUCTION
02 / 02 / 2017
|
KIM SALMON / DÄTCHA MANDALA / POGO CAR CRASH CONTROL / JAMES LEG / ELVIS PRESLEY |
Kim est Salmon bon

Et même pire que Salmon bon. Kim Salmon a du génie. Quand on le voit sur scène, on comprend qu’il est né pour ça, pour jouer du rock sur scène, même s’il se retrouve après trente ans de pérégrinations sur la petite scène d’un bar de Ménilmontant.

Visiblement, c’est à la Féline que se termine la carrière des cult-stars de l’underground, mais l’ambiance y est si bonne qu’on s’en félicite. Ça se transforme même en concert de rêve. La bière y est fraîche, le public conquis d’avance et Kim Salmon joue à cinquante centimètres, alors que peut-on espérer de mieux ? Il joue en trio et Dimi Dero bat le beurre. Il porte une chemise à fleurs, un jean et des boots rouges. Comme Kim cumule les expériences, il dispose désormais d’un répertoire très riche. Trop riche, pourrait-on dire. Il peut taper dans les albums des Scientists, dans ceux des Beasts of Bourbon, dans ceux des Surrealists, dans ses albums solos et dans ses projets parallèles et monter une set-list de rêve, ce qu’il fait.

On entend des hits fatidiques comme «Swampland», inévitablement, mais aussi un «Cool Fire» tiré du fantastique troisième album des Beasts, «Black Milk», «Frantic Romantic» qui date des origines et puis bien sûr les deux énormités tirées de son dernier album solo, «My Script» : «Destination Heartbreak» et l’implacable «Already Turned Out Burned Out». Et puis histoire d’enfoncer le clou pour de bon, il termine avec une version définitive de «We Had Love», une sorte de classique garage capable de nous hanter jusqu’à la fin des temps.

Les Scientists firent partie de la petite scène culte underground des années 80, avec le Gun Club, les Spacemen 3, les Cramps et les Mary Chain. Rien qu’avec ces cinq groupes, on avait de quoi tenir pendant la décennie maudite.

Leur premier album sobrement intitulé The Scientists parut en 1981. On l’appelle aussi the pink album. Sous sa pochette rose et particulièrement insignifiante, l’album sonnait très power-pop et on surprenait Kim en flagrant délit d’imitation de Joe Strummer sur le premier cut, «Shadows Of The Night». Il fallait attendre la face B pour trouver un peu de viande, notamment dans «Teenage Dreamer» qui semblait traversé par le petit riff de «Death Party» mais en accéléré. C’était une coïncidence amusante, on retrouvait l’esprit de ce groove mortel, avec de longs passages ombrageux et des vents de broussailles. Dans «Walk The Plank», ils se prenaient pour les Jam, un mimétisme de mauvais aloi. Et ils s’enfonçaient toujours plus dans l’erreur avec «Larry», ce qu’on appelait alors du fake english sound. Ils sauvaient l’honneur avec le dernier cut, «It’ll Never Happen Again», poppy comme ce n’était pas permis, mais le groupe montrait une assurance exceptionnelle et nous sortait le meilleur des sons.

Sur la pochette du second (mini)album Blood Red River, les cheveux des Scientists avaient poussé. C’est avec cet album qu’ils trouvèrent leur véritable identité. Ils proposaient en effet un son basé sur le groove primitif, celui de l’anaconda géant qui rampe dans la moiteur de la forêt tropicale. L’un de leurs hits les plus viscéraux s’appelle «The Spin». Kim y plonge dans l’épaisseur du groove. Il y pique de sacrées crises et on y retrouve aussi le fameux riff de «Dirt». Comme la plupart des grands hits scientifiques, celui-ci est monté sur une bassline troglodyte. Visiblement, Kim est obsédé par Funhouse. Une autre stoogerie de haut rang se niche sur l’album : «Set It On Fire», chanté à l’insidieuse rampante, et même hurlé dans le néant du non-retour. C’est vrai que la composition de la photo de pochette rappelle celle du premier album des Stooges et Brett Rixton qui est au fond ressemble à Dave Alexander. C’est Tony Thewlis qui allume ce cut et les Scientists le jouent à l’admirabilité des choses. Le morceau titre sonne comme du boogaloo désespéré et sur «Rev Head», Kim sonne exactement comme Alan Vega. Par chance, cet album fut réédité en l’an 2000 par Citadel, le label australien qui eut l’intelligence de rajouter les cuts de singles qui ne figurent pas sur les albums, à commencer par le hit le plus connu des Scientists, «Swampland», une merveille de western-song gothique inspirée. On trouve aussi l’effarant «We Had Love», dévastateur et bousculé par de violentes montées de fièvre, le cut que Kim choisit aujourd’hui sur scène pour boucler son set en beauté. Et puis cette version fantastique du «Clear Spot» de Captain Beefheart. Kim n’a pas la voix, c’est sûr, il lui manque le fond de cuve, mais le son est au rendez-vous. Tony sait faire son Zoot Horn Rollo, pas de problème. On trouve aussi à la suite «Solid Gold Hell», certainement le plus brillant hit scientifique, un chef-d’œuvre de heavyness déviante et la basse de Boris fait le show car elle traverse le cut en crabe. Fascinant ! Autre merveille : «Demolition Derby», un vrai cut-bulldozer qui dégage tout, les avenues et les bronches. Une vraie mastication de riff et comme par hasard, on pense au «Death Party» du Gun Club.

En plus de Blood Red River 1982 - 1984 Citadel a aussi fait paraître The Human Jukebox 1984-1986, la réédition de l’album augmentée de cuts de singles. Ces deux disques valent l’investissement, car dans les livrets, Kim Salmon raconte toute l’histoire des Scientists à Perth, à Sidney, puis à Londres, où ils se firent connaître grâce au soutien de Lindsay Hutton. C’est assez passionnant, car Kim raconte une multitude d’anecdotes, comme celle-ci, qui se déroulait à Amsterdam, devant un club où devaient jouer les Scientists : des mecs les traitaient de kangourous, alors Kim raconte que ça s’est terminé en bagarre.

L’année d’après sort un autre mini-LP, This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. C’est une manie, mais en fait une bonne manie. Pour au moins deux raisons, l’énorme «Solid Gold Hell» qu’on en finit plus de réécouter à cause de cette bassline qui traverse le cut en crabe - Getting really used to live in solid gold hell - et «This Life Of Yours», atmosphérique et underground en diable, comme bardé de toiles d’araignées. On les sent partis une fois de plus à la dérive, la basse de Boris remonte dans le mix de manière seigneuriale et Kim se met à chanter comme Jeffrey Lee Pierce.
Selon Robyn Gibson de Sounds, les Scientists étaient parfaits : long greasy hair, low slung pants, ugly feedback, two chords songs over one note basslines, malovelant countenance.
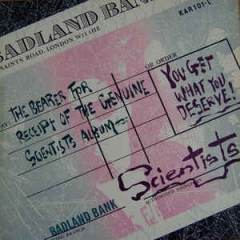
Deux énormités trônent sur You Get What You Deserve : «Hell Beach», une pure stoogerie - Kim chante comme Iggy, avec l’instance nasale des bas-fonds motorcityques - et «Demolition Derby monté sur le riff de «Death Party» ralenti et bien régurgité. C’est tout l’intérêt du cut : le goove de Death, ils ne s’embêtent pas, ils tapent là dans l’un des meilleurs grooves de l’univers et voilà, le tour est joué. En B on trouve «Atom Bomb Baby», accompagné par un gimmick frelon et chanté à la stoogerie des profondeurs de l’underground ténébreux. Kim attaque «Lead Foot» à la Jeffrey Lee, à l’insolence gun-clubbique. On note aussi la présence de l’excellent «It Came Out Of The Sky», garage harcelé par Tony Thewlis sous la pure dominance sulfrique du son de basse.
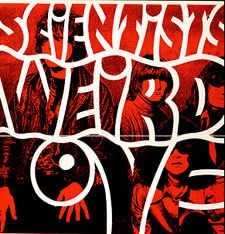
En 1986, ils ré-enregistrent tous leurs hits : c’est le fameux album Weird Love. Quel festin ! Ce sont des cuts dont on ne se lasse pas, allez hop, ils reprennent «Swampland» avec l’ in my heart bien timbré, le stoogy «Hell Beach» bien primitif et même ashetonien, «Demolition Derby - fuelled with a love song gone wrong, comme le dit si élégamment Kim - et «We had Love», le hit du cru. Non seulement le chant y est insistant, mais le riff l’y est encore davantage, alors ça devient rudement intéressant. En B, ils tapent dans «Of It’s The Last Thing I Do» et dans les commentaires, Kim cite le nom de Travis Bickle. C’est joué à l’épaisseur scientifique et visité par l’admirable groove de basse de Boris. Big atmospherix avec «Set It On Fire». On retrouve dans ce cut tout ce qui va faire la force des Chrome Cranks et de Gallon Drunk, le sens du groove souterrain et inspiré. Ils bouclent cet album magique avec une version faramineuse de «You Only Live Twice» qu’ils traînent à la mauvaise vitesse. Quelles brutes ! Le gluant qui suinte de l’ambiance leur va comme un gant.

Ils ne sont plus que trois pour Human Jukebox, Tony Thewlis, Kim à la basse et un batteur du nom de Nick Combe. Spontaneous sonic outburst and desconstruction : voilà comment Kim définit cet album déroutant. Le morceau titre qui ouvre le bal nous plonge tout de suite dans l’ambiance scientifique : dégelée de son et gros coups de jus. Ils avaient compris que tout reposait sur le son et qu’on pouvait aller très loin dans l’explosion des limites. Dans la fournaise on croit parfois distinguer des bouts de Velvet. C’est en effet la dynamique de «Sister Ray» mais avec des queues de phrases grillées au 220 et donc racornies. «Distorsion» sonne comme un cut privé d’espoir, trop épais, lymphatique, comme largué au large, dans une drôle de dérive. C’est hallucinant de liquidité, une sorte de fin du monde de distorse molle. Encore un exploit vicelard avec «Born Dead», claqué à l’accord violent et incroyablement incisif. Kim chante sale et Tony gratte acéré. Leur riff insistant révèle une dimension bornée, peut-être même un manque d’idées, tout au moins pour cet album. Ils finissent avec un mélopif hors du temps, «It Must Be Nice» - It must be nice to die at night - Lourd de sens et de présence et chanté à la mélodie. On a là le hit du disk. Kim résume bien l’art des Scientists : fuzz-guitar overload minimalism and primal beat.
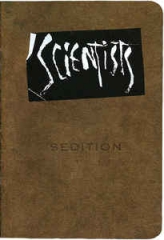
L’album idéal des Scientists est probablement Sedition, paru en 2007 et enregistré live au Shepherd Bush Empire. On y retrouve la formation originale, Kim, Boris et Tony, avec Leanne Cowie, qui avait flingué une tournée anglaise dans les années 80 parce qu’elle ne savait pas jouer de la batterie (elle apprenait). Dans le petit livret qui accompagne le disque, on peut lire des hommages de Jon Spencer, Warren Ellis et Henry Rollins. Les Scientists jouent tous leurs hits, à commencer par l’infernal «Swampland», bien doté à la mélodie. Kim sait monter un coup. Il sait hanter - In my heart, there’s a place called swampland - Il chante ça à l’épique de la désespérance, comme Jeffrey Lee Pierce. En écoutant «Burnout», on voit bien qu’il tient son chaos en laisse. Il ne lui laisse pas de mou. Il jette des pelletées dans le brasier. Tout est très incandescent chez les Scientists. Et voilà l’effarant «Solid Gold hell», attaqué à la fuzz, et la mélodie descend en diagonale à travers le mur riffique. Kim se lamente à la body of soul. Il s’adosse au meilleur wall of sound du monde et Boris envoie ses notes d’infrabasse perforer le chaos. Avec «Nitro», ils rendent hommage aux Stooges. Cette mélasse vaut bien «Funhouse». Kim crie. Kim couine. Kim cuit. Et avec «Set It On Fire», on retombe dans la fournaise scientifique. Kim compte parmi les héros les plus fulgurants de l’histoire du rock, soyez-en sûr. Il pousse des waouh d’antho à Toto et surnage à la surface d’une extraordinaire mélasse de son avec un fabuleux shouting de soute. Bel hommage à Alan Vega avec «Rev Head». Kim fait le talking show et navigue dans le groove urbain. Il peut screamer his head off. Et on repasse aux Stooges avec «When Fate Deals Its Mortal Blow», c’est battu et rebattu à la stoogerie et ça continue comme ça jusqu’à la fin, avec l’apothéose, «We Had Love», qu’ils font littéralement exploser sur les accords de Gloria. Comme dit Kim : six strings in one sound !

Si on aime les Scientists et qu’on dispose d’un budget confortable, alors ils faut rapatrier tout ce que sort le petit label basque Bang!, à commencer par Rubber Never Sleeps, un double album qui propose des bouts d’enregistrements live de la grande époque. En B, on tombe sur une version vivace de «Swampland», complètement saturée de basse par un Boris qui semble jouer la carte de la destruction massive. Dans «I’ve Had It», il fait gronder sa basse comme le dragon de Merlin, sous la surface de la terre. En C, on tombe sur une version explosive de «We Had Love», merveille d’excitation brutale, classique scientifique pur, bouillonnant et ravagé par ces charges héroïques. Ils font aussi une brillante reprise du «She Cracked» des Modern Lovers.

Une autre compile intitulée Pissed On Another Planet rassemble les premiers titres des Scientists. Dans les notes de pochette, Kim Salmon rappelle qu’au démarrage, il avait une idée claire du son qu’il voulait en tant que guitar head : Steve Jones ou Johnny Thunders. Pas étonnant que le cut qui donne son titre à la compile sonne comme un hit des Heartbreakers : même son et même magie au chant. Kim Salmon est l’un des meileurs caméléons de l’univers. Il sait reproduire le jouissif des Heartbreakers, cette fantastique foison de gros accords rockyrollah. On trouve aussi le premier single du groupe, Frantic Romantic», dont Greg Shaw avait acheté 500 exemplaires pour le diffuser via Bomp! Magazine. Cette power pop vitupérante n’a rien perdu de sa fraîcheur et en 2016, Kim peut encore jouer ce morceau sans problème. On sent bien qu’à l’époque, les Scientists trempaient dans la power pop à la Nerves. Il suffit d’écouter «Shake Together Tonite». C’est grouillant et vivifiant. Même chose avec «last Night». Ils vont dans des tas de directions, mais ils savent rester dans le musculeux harmonique. Un cut comme «It’s For real» éclate au grand jour, c’est plein de guitares et très impressionnant. Ces mecs sont à l'aise, ils sont déjà très complets. Avec «larry», Kim se prend pour un punk anglais. Il chante un peu cokney. On croirait entendre les Small Faces. Dans «Teenage Dreamer», il évoque les New York Dolls. Le riff évoque celui de «Death Party» du Gun Club et «Shadows of The Night» sonne comme un hit des Stiff Little Fingers. Quelle palette !

Kim va jouer quelques années dans les Beasts of Bourbon, un groupe qui a la sale réputation d’avoir accueilli en son sein tous ceux qui avait besoin de quick beer money. Kim était encore dans les Scientists quand il joua de la guitare sur The Axeman’s Jazz, le premier album des Beasts. Le morceau phare de l’album s’appelle «Evil Ruby», qui sonne comme un gros clin d’œil aux Stones. Car on y entend les accords de «Let It Bleed» et Tex Perkins chanterait presque comme Jagger. Ils font aussi une brillante reprise du «Graveyard Train» tiré du premier album de Creedence. La grande force des beasts fut de pouvoir sonner sur certains cuts comme Beefheart. Bel exemple avec «Save Me A Place», très beefheartien dans l’esprit. Kim et Spencer P Jones sortent les accords magiques du Magic Band et jouent au heavy groove. En prime, Tex Perkins screame superbement. Mais c’est tout. Pour le reste, on peut se rhabiller.

Leur second album Sour Mash est un peu plus solide. Ils démarrent avec une fabuleuse reprise du «Hard Work Driving Man» de Jack Nitzsche et Ry Cooder qu’enregistra Captain Beefheart pour le film Blue Collar de Paul Shrader. Tex Perkins chante cette merveille avec la voix d’un esclave noir à bout de nerfs. Les Beasts montrent là une belle propension à la heavyness maximaliste. On retrouve ce penchant beefheartien en B, dans «Driver Man», une belle dérive des continents de l’incontinence digne du bon capitaine. C’est du pur jus et en prime, ça saxe. Il faut aussi écouter «Pig», un chef-d’œuvre primitif joliment agressif. Tex Perkins peut grogner comme Wolf, il a le même sens du danger et de la menace. Voilà encore une pure énormité. Tex Perkins avait autant d’allure au plan vocal qu’au plan physique. Il faut le voir sur les photos du groupe avec ses têtes de loup et son regard noir. Fantastique présence ! Oh, ils font aussi une reprise de Merle Haggard, «Today I Started Loving You Again», country-rock sombrement aguichant.

Leur troisième album Black Milk entre dans la catégorie des grands albums de rock classique. Tous les cuts de cet album beaucoup plus calme sonnent comme des hits. Dès «Finger Lickin’», ils renouent avec un sens beefheartien des choses, dans le son comme dans le beat, dans l’intention comme dans le mystère. On va de balladif en balladif, mais tout est incroyablement inspiré, sur ce disque, indiciblement sombre («Hope You Find Your Way»), plombé et sans espoir («Word From A Woman»), et même hanté et puissant, comme c’est le cas avec «I’m So Happy I Could Cry», où ils tendent vers le calme qui accompagne les tout derniers instants de vie. Tex Perkins chante admirablement le groove de Beast qui s’appelle «You Let Me Down». On entend surtout la basse de Boris. Et en B, ils démarrent en force avec une version pétaudière du «Lets Get Funky» de Hound Dog Taylor. Tex Perkins rigole sur le beat furibard et il relance à coups de cris de guerre, yeah yeah ! On revient à l’excellence paisible avec «A Fate Much Worse Than Life», monté sur un beat de valse et finement souligné à l’accordéon. Kim compose «Blue Stranger» et Tex le chante au clair de la lune. C’est visité par un solo de jazz infernal. On reste dans l’excellence pure et dure avec le très cajun «Blanc Garçon» - I am bonnet blanc garçon - pur jus du bayou et on passe au mélopif crépusculaire avec «Execution Day», un cut insistant et buté, fabuleux car bien dosé et avenant. Ça sonnerait presque comme un grand hit d’Iggy. Par la qualité de ses morceaux , cet album se révèle absolument exceptionnel.

Le quatrième album des Beasts s’appelle The Low Road. Ils ouvrent le bal avec «Chase The Dragon», joli groove druggy, joué à l’aune du vieux gimmickage de la grassouille. Le morceau titre vaut pour une belle compo longiligne et chargée de son. On y retrouve l’implacabilité des choses qui semble vouloir caractériser le groupe. Et avec «Just Right,» ils passent à l’hendrixienne avec un fabuleux solo d’intro signé Spencer P. Jones. D’ailleurs, au dos de la pochette, on les voit tous les trois sur scène, Tex Perkins, Kim et Spencer, complètement démantibulés par leur chaos sonique, avec les cheveux en l’air. Il faut attendre «Straight Hard & Long» pour renouer avec la furia, celle du MC5. Ils la traitent au mode stop/break down, couplet chant sans vague, et puis ça lâche d’un coup, et quand ça lâche, ça lâche, avec Kim et Jones aux manettes de la moulinette. Ils semblent évoquer les élans d’une bite en émoi, mais dans l’exaction de la pure folie. Ces mecs sont capables d’aller gratter la gale des dieux. On tombe à la suite sur un fantastique garage-cut signé Kim, «Something To Lean On», épais et bien amené, qui monte comme la marée du diable, noire et rouge, infernale et bien touffue, quasiment scientifique - You’re my love and my dealer - Romantisme des ténèbres, avec un beat de fond de studio. On applaudit les Beasts.
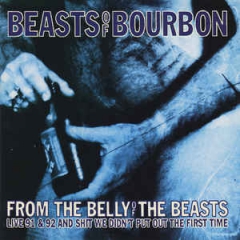
From The Belly Of The Beasts est un double album qui propose du live 91 et 92 et des cuts inédits. Tellement bon qu’il est condamné à finir sur l’île déserte. Ils redémarrent avec un «Chase The Dragon» lourd de conséquences, avec un son en forme de mur du son, c’mon, barrage de riffs, personne ne passe. Sacré clin d’œil aux Doors avec «Save Me A Place» monté sur un monstrueux groove de bassmatic et harcelé par des attaques de guitare sur les côtés. C’est même concassé par des breaks stoogiens, et ça part dans le son des Doors, avec ce groove qui rappelle l’I can hear the scream of the butterflies, fantastique improvisation des choses, ils poussent bien le bouchon. Ces mecs avaient tout compris, aussi bien au niveau des ambiances que du décorum. Ils passent à la stonesy avec «Drop Out», du pur Kim et ça sonne comme un hit. On retrouve l’excellent «Straight Hard & Long», attaqué au sans pitié. Kim et ses hommes lancent des assauts et halètent comme des chiens. Les riffs sont hallucinants de violence, Kim et les bêtes avaient du génie. Ils font une spectaculaire reprise du «Let’s Get Funky» de Hound Dog Taylor. Quelle pétaudière ! Kim outrepasse Hound Dog, il explose l’art du vieux rescapé des plantations. Le disque 1 se termine avec trois cuts sans Kim dont l’excellent «Good Times» chanté à l’arrache et joué high energy. Sur l’autre disque se nichent trois reprises de haut rang, le «Dead Flowers» des Stones que Tex attaque à la grosse voix et que le groupe joue très musclé à la ragged company, puis «Dirty Water», solidement charpentée, avec un Tex qui écrase sa voyelle du talon comme un lombric pour que ça gicle dans l’I’m gonna tell you a story, et «So Agitated», version atrocement heavy du vieux cut des Electric Eels, doté du plus liquide des solos et du plus tribal des beats d’extrême onction. Oh ils tapent aussi dans Hank Williams avec «Ramblin’ Man» et dans les Pretties, seigneurs des annales, avec une version somptueuse d’«ESP».
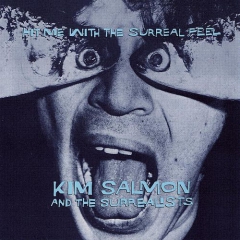
Avec ses copains les Surrealists, Kim commence à enregistrer en 1988 une série d’albums très ambitieux. Le premier s’intitule Hit Me With The Surreal Feel. En guise de clin d’œil à Captain Beefheart, Kim se fait photographier avec deux poissecailles devant les yeux. On retrouve sur ce disque tout le côté malsain insidieux qui faisait le charme maudit des Scientists. Bel exemple avec «Bad Birth», sa magnifique ambiance pesante et sa guitare en état d’alerte rouge. Franchement c’est admirable. On a là une énormité scientifique traitée à la pure tension de guitare et de basse, un climat digne des Chrome Cranks, c’est du pur jus de déflagration. Kim Salmon reste un artiste profondément dérangeant. Il est réellemet le maître de la menace cisaillante. C’est un puisant prévaricateur. Il faut attendre «Intense» en B pour renouer avec l’intensité. Voilà un cut monté au heavy riff scientifique et hanté par des sacrés coups de guitare frelon en folie. L’ami Kim gueule dans la mélasse, c’est un allumeur d’incendies patenté. Plus loin, on tombe sur «The Surreel Feal» joué à la bonne basse et chanté à la ramasse scientifique. Mais quel son de basse ! Kim fait aussi une belle reprise du «Devil In Disguise» d’Elvis et boucle avec un «Surreal Feal» toujours aussi bien joué par le bassman Brian Hooper. Quel bassman baby !

Excellent album que ce Just Because You Can’t See it Doesn’t Mean It Isn’t There paru un an plus tard. Kim nous embarque pour Cythère dès «Measure Of Love». Ce mec est un finisseur de cuts, il ne laisse rien dans son assiette. Il ramène toujours un énorme son de basse, qui est l’ingrédient fondamental. Il passe à la sunshine pop avec «Sundown Sundown». Avec Kim, il faut s’attendre à tout, surtout à ce genre de plan extraordinaire, il nous roule sa pop dans une distorse de génie et ça vire à la mad psychedelia. Encore un coup de génie avec «Sunday Drive», pure exaction scientifique, de la vraie rémoulade de Romulus avec une voix en chuchotis. Kim cisaille le réel, il étend son empire et devient le maître universel des ambiances scientifiques, il défie la morale, ça rampe et ça grouille sous le couvert. Il enchaîne avec un «Je t’aime» joué aux accords de Gainsbarre. On assiste là à l’incroyable hommage d’un homme éclairé à un autre homme éclairé. Une fille fait des bruits. Ça se frotte dans les culottes. Kim pousse le jus mélodique de Gainsbarre dans les extrêmes. Et puis à la suite, on retrouve les cuts de l’album Hit Me With The Surreal Feel, et ces merveille que sont «Bad Birth», «Belly Full Of Slys», «Intense» et «Surreal Feel» dont le violent groove de basse continue de hanter les régions reculées du cerveau.

On trouve deux belles pièces de choix sur Essence paru en 1991, à commencer par «The Cockroach», qui n’est pas le cafard de Charlie. C’est un autre genre de cafard, dissonant et un peu Dada sur le pourtour. «Self Absolution» se veut encore plus Dada dans le dedans. Cette merveilleuse pop ambitieuse semble déployer des ailes rognées de papillon mité. Et pourtant Tony Pola bat. Petit retour à l’Howard’s End de l’esprit scientifique avec «A Pox On You», une belle pop tendue à se rompre, car gothique et inspirée par les trous de nez. En B, Kim vire plus pop avec des trucs comme «Lightning Scary», farci de breaks de talking rap, ou encore «Essence Of You», plus éthéré et même quasiment à l’arrêt. Kim adore dérouter les cargos. Il retrouve quelques vieux réflexes d’agressivité scientifique dans «Looking At The Picture». On se régale par essence et on se lance dans la partance de sa prestance. Il termine ce bon album avec un «26 Good Words», plongé dans une ambiance extraordinaire, encore un cut monté sur une idée brillante, la fameuse idée ampoule des pictos qui éclaire les pas dans les ténèbres du septième cercle. Kim vire hypno avec une élégance non feinte.
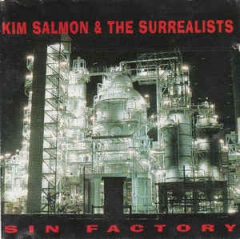
On trouve encore des preuves de l’existence du dieu Kim sur Sin Factory paru en 1993. Eh oui, il faut bien se faire à cette idée : Kim Salmon n’enregistre que des bons albums. Rien que des bons albums. Et pouf, il démarre avec un spectaculaire «I Fell», doté d’un joli son de basse et d’urgences de bas de manche. Kim connaît les ficelles du génie. Son cut est un modèle du genre, avec un pur son de blues-rock illuminé aux feux de plaine, il marmonne ses plaintes grasses et part en vrille de tourbillon sonique de plaie d’Egypte. Sainte-Marie Mère de Dieu protégez-nous de ce démon maléfique ! Mais non, elle ne peut pas nous protéger d’un cut comme «Gravity», car Kim envoie de violentes giclées scientifiques dans l’air chaud. On patauge en plein dans le mythe épais des Scientists, avec un son saturé de basse et des climats privés d’avenir. Kim hurle dans la clameur de la fin du monde et claque des départs gimmickaux dévastateurs. Encore un cut affreusement génial avec «Feel». Pas compliqué, Kim Salmon, c’est le Max la Menace du garage, c’est Jo le Cambouis, le redresseur de stomp et le décrasseur de carburateurs. L’infernal Kim Salmon surmonte toutes les difficultés, il sait anticiper l’apocalypse, la vraie, celle des quatre cavaliers. Il ne vit que pour les ciels chargés. Encore un heavy groove allumé aux gimmicks maléfiques avec «Come On baby». C’est sans doute ce qu’il sait faire de mieux. Il va même hurler au coin du bois. On reste dans le même esprit avec «Non Stop Action Groove», Kim Salmon pose ses yeah comme des jalons dans un délice de jouvence. Avec le non stop action groove, il sait de quoi il parle. Quel extrapolateur définitif ! Il joue ça à l’urgence de la note gluante !
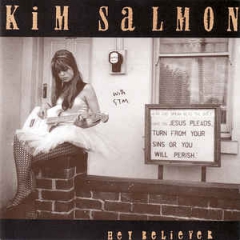
Un an plus tard paraît Hey Believer. Warren Ellis fait partie de l’aventure. Sautez tout de suite sur sa version de «Ramblin’ Man» qu’il attaque au son mal isolé. Son boogie rampe dans une flaque de sang. C’est admirable de dégueulerie. Il chante ça à la glotte tuméfiée, il dégueule tout ce qu’il peut. Voilà enfin un mec qui sait chanter le boogie comme il faut. Pur génie. Il faut aussi écouter «Hey Believer», il croone à l’imparabilité des choses, il en a les moyens et pas des petits moyens, non, les siens sont astronomiques. Il affiche une classe surnaturelle et on tombe sous le charme. Belle pièce aussi que le cut d’ouverture, «Reach Out», balayé par des guitares déflagratoires, comme au temps béni de Tony Thewlis. Kim nous ramène au bord de son cher précipice et livre une pièce d’une insondable profondeur. Avec «Obvious Obvious», il rend hommage à Dylan, il part en groove de croon et soigne une diction purement dylanesque. Il revient au very big atmospherix avec «You Know Me Better Than That». Il sait que c’est foutu d’avance, car trop underground, comme le sont les Chrome Cranks et Gallon Drunk, mais il y va quand même de bon cœur. Il sait faire preuve de bon sens et d’intégrité supra-normale. Il sait travailler ses cuts à coups d’ah c’mon ! C’est un fieffé leveur de levain - Ahh c’mon you know you’re better zan zat ! - Dans «Pass it On», il pique une violente crise de wha-wha. Il réveille le Krakatoa et en profite pour passer un killer solo qui porte bien son nom. Retour au rampant avec «Treachery», mais du rampant complètement insidieux. Il le traite sur le mode de la perte de raison. Il hurle dans la salive d’une glotte en sang et invente une nouvelle forme de génie : le génie des catacombes. Ça tourne à l’épreuve de force extravagante. Il travaille la pire des sous-gammes de raclements de gorge, il nous emmène dans une cave sans lumière, nous interdit l’avenir et même l’air, même si ça reste terriblement inspiré.

C’est assez bête à dire, mais le Kim Salmon & The Surrealists paru en 1995 est encore un album indispensable. Ne serait-ce que pour cette stoogerie intitulée «Redemption For Sale» - There’s a cost to be paid by you - On y savoure l’énormité des écarts de conduite. Oui, le cut est complètement dévasté par le son. Il est monté au groove rampant et c’est là l’un des meilleurs hommages aux Stooges qui se puisse imaginer ici-bas. Hommage complet avec ses crises de palu et son dégueulis groovy. Voilà le paradis du lapin blanc. Avec ce hot hit, Kim rallumait la chaudière des Stooges. Il faut l’entendre gueuler Do it d’une voix de cancéreux à l’agonie. Autre coup fumant, «I’m Gonna See You Compromized». Kim et ses deux amis prennent ça au boogie blues du Mississippi. Oui, ils savent le faire. Kim s’amuse même à réinventer le boogie. Il se l’octroie. Il se l’accapare. It’s awite ! Et tout à coup il vomit Yeahhh I’m your own ! - Voilà le boogie de nos rêves inavouables. Il faut aussi écouter «It’s Your Fault», le cut de fin, car c’est du scientifique à l’état pur. On y entend une grosse ligne de basse vénéneuse circuler dans la boue du groove. Kim avance en poussant des Yeah ! Yeah ! Le son se noie dans le jus de basse. Kim a toujours su faire sonner une basse, sur ses albums. On retrouve avec Fault toute la démesure de «Solid Gold Hell». Et puis, on trouve encore d’autres merveilles au fond de cette caverne d’Ali-Baba, comme «I Wish Upon You», joli stomp industriel frappé au marteau pilon des forges et joué à la guitare cromagnon. C’est Brian Henry Hooper qui joue de cette basse un peu métal. Autre pure énormité : «What’s Inside Your Box». Oui, car elle sonne tout simplement comme un balladif de pop interplanétaire. Ampleur garantie. Il faut parfois savoir se rendre à l’évidence. C’est joué aux guitares persuasives, celles dont les Stones ont toujours rêvé. Il se dégage en effet de ce chef-d’œuvre de forts accents de Stonesy. Kit sait conduire un hit vers les cimes de l’underground. D’ailleurs, dès que Kim Salmon joue quelque chose, ça accroche. La preuve ? «Draggin’ Out The Truth». Dès les premières notes, on a l’oreille qui frétille. Car voilà un son puissant, inspiré, scientifico-stoogy. Et ce mec chante comme une superstar, à la croisée d’Iggy et du croon. Il fait aussi une reprise de son «Frantic Romantic» et profite de l’occasion pour le muscler un peu. Avec «Plenty More Fish», il montre tout simplement qu’il ne craint pas d’affronter le destin. Sur ce disque, ils ne sont que trois et ils alignent hit sur hit. «Intense»... Tu parles d’un titre ! Évidemment, il en profite pour marteler. C’est de bonne guerre, avec un titre comme celui-là. C’est même assez brutal. Avec Kim, ça prend forcément des proportions extraordinaires. Il fait même sauter les compteurs et danse le jerk de l’apocalypse.

Ya Gotta Let Me Do My Thing paru en 1997 est un double album donc double dose de Kim. Et comme si ça ne suffisait pas, Jim Dickinson produit. Inutile d’ajouter que cet album figure parmi les classiques du rock moderne. Car dès «Won’t Tell» qui ouvre le bal, on comprend tout. Ce cut bien amené au petit stomp est chanté à deux voix sur une brillante idée de tension maximaliste. Une fois de plus, on est obligé de parler de génie. Impossible de faire autrement. En plus, il truffe sa syncope de cuivres. Puis il renoue avec le rampant scientifique dans «The Zipper». De toute évidence, Kim cherche la petite bête dans la noise. Il faut voir comme ça rampe dans la pénombre primitive - Down to the zippah - Joli groove de basse. Dans le morceau titre, on entend un solo de flûte. Kim aura tout tenté. Et avec «Alcohol», il reprend de l’altitude - Let’s try to get it back ! - Kim sait faire sonner sa basse ! Encore une belle énormité avec «The Lot», pur jus d’énerverie gorgé de riffing névralgique et éclaté aux gémonies. En prime, Kim nous fait le coup du départ en killer solo. Dans «Guilt Free», il évoque l’histoire d’un homme et de son combat avec sa conscience. Chez Kim tout est intéressant, même les combats. Il reste encore une belle énormité sur le disque 1, «But You Trust In Me», qui sonne comme un Dead Flowers alcoolisé. C’est exactement le même drive. On sent bien la patte de Jim Dickinson. Démarrage en force sur le mini-disk 2 avec «You’re Such A Freak», un joli balladif bien gratté à la basse et mélodiquement superbe. Kim sait créer les meilleures conditions de l’ambiance. C’est même tout ce qu’il sait faire dans la vie. Avec «I’m Evil», il renoue avec la ferveur dylanesque et produits des éclairs de chant insistants. Quel extraordinaire touche-à-tout ! Retour au gros scientifisme avec «Hey Mama Little Sister», cut sale, solide, musculeux, garagiste, superbe d’épaisseur, ce qui peut paraître logique quand on met deux pointures comme Kim et Jim dans un studio. Kim passe ensuite au psyché à la ramasse avec «Radiation» et il boucle avec «A Good Parasite Won’t Kill Its Host», cut expérimental monté sur un groove de machines et tartiné d’un dégueulis de wha-wha. Kim suicide son son, il visite les sous-sols du groove et il sort un son qui évoque le lance-flamme des nettoyeurs de tranchées. En gros, il visite les neuf cercles de l’enfer.

Nouvel épisode avec un groupe baptisé The Business et un album intitulé Record qui paraît en 1999. L’album vaut le détour pour deux raisons. À commencer par «Disconnected», sanctionné par un heavy riffing mal intentionné et animé par de petits accents sauvages. C’est le Kim qu’on préfère, le loup qui rôde dans la bergerie du groove, avec des yeux méchants et de la pure violence dans le chant. Il faut le dire et le redire : Kim Salmon sait créer l’événement. L’autre raison, c’est «Emperor’s New Clothes», un cut pop-rock embarqué sur un énorme riff de basse. On est convaincu d’avance. C’est joué à coups de basse rageurs et Kim chante à la meilleure mode de Melbourne - That’s how it goes - On dirait même qu’il extrapole le son. Un vrai miracle. D’autres cuts accrochent bien l’oreille comme «Anticipation», scientifique en diable, mauvais et sale, chanté derrière la porte, comme s’il préparait un mauvais coup. Quelle définition de la science ! Kim replonge le rock dans le chaudron du gore et il injecte dans sa fournaise tout un essaim d’abeilles. C’est assez stupéfiant. Avec «Give Me Some Notes Mike», il passe au funk, mais un funk extraordinairement décalé. Avec son équipe, ils se prennent pour Parliament ! Et puis encore une surprise de taille avec «New Kind of Angel», un groove bizarre orchestré aux trompettes mariachi. Ça donne un son intense, comme enflammé de l’intérieur, bien allumé à la basse. Il fallait y penser : basse, trompettes, cocktail exotique et parfait.
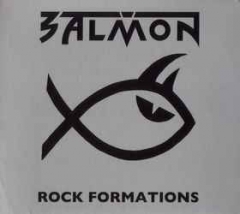
Retour de Kim Salmon sans les Surrealists en 2007 pour un album à la Glenn Branca intitulé Rock Formations. Ce double album propose des instrus joués par cinq guitaristes et deux batteurs. Un truc intitulé «ETI» sort du lot, car le thème éblouit par sa beauté. Kim et ses amis créent une ambiance fantastique orientée sur l’espace et ses mystères. On trouve d’autres choses intéressantes comme ce «Punk Fatwa» qui sonne comme un assaut sauvage à la foire à la saucisse. Kim tente l’aventure avec des intros furibards et ça marche. Place aux aventuriers ! «It Wears A Kilt» ensorcelle avec sa note tirée qui sonne comme le chant d’une sirène. On sent clairement le brillant d’une idée. Kim Salmon fonctionne exactement comme Robert Pollard : à l’idée pure. Il faut écouter son «Alien Chord Orchestra» : c’est joué au big atmospherix tendancieux, avec une volonté très nette de créer la peur. En B, il nous fait la grâce de jouer une reprise lumineuse du «Maggot Brain» de Funkadelic. Et le «Guitarmony Suite» qu’on trouve en D vaut tout l’or du monde.
Comme tous les albums de Kim à venir, Rock Formations est sorti sur Bang!, un petit label basque spécialisé dans les Scientists et le Gun Club.

Grand Unifying Theory est le dernier album en date de Kim avec les Surrealists. Encore un bon album. On y trouve une pure stoogerie, «Childhood Living», qui débouche sur une atmosphère à la Dolls avec des clap-hands et ça s’endiable, Kim claque le baigneur du meilleur rock de percus. Il est stoogien, à la vie à la mort. Autre coup de Jarnac avec «Predate», monté sur une pulsation démentoïde. Voilà l’un de ses traits de génie : sortir un cut stoogy au débotté, on a là le beat de «1969», c’est tout simplement monstrueux de mimétisme véridique. Encore un coup direct. Kim n’est autre que l’uppercut man du rock moderne, le brasero du rock faithfull, l’homme du pas de cadeau. Il faut aussi écouter ce «Turn Turn» d’ouverture monté au groove de basse, véritable énormité démonstratrice et parallèle. On frise le gras scientifique. Avec «EQ1», Kim nous replonge le museau dans la violence du néant. On croit entendre une charge de cavalerie. Voilà ce qu’il faut bien appeler un retour aux penchants scientifiques. Kim traite ça à la hurlette bestiale, il semble vouloir rameuter tous les démons du rock. Avec les deux parties de «Grand Unifying Theory», Captain Kim nous emmène en voyage tripal dans le néant. Ça dure 21 minutes, on file vers l’inconnu, mais ça reste très intéressant.
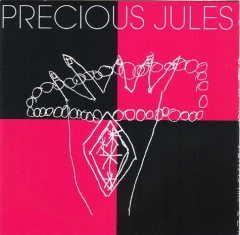
Et 2011, il monte Precious Jules avec Michael Stranges et enregistre l’album du même nom. Force est d’admettre que l’album vaut - une fois de plus - son pesant d’or. On y trouve un véritable hit glam, «Shine Some Darkness On Me» - C’mon shine some darkness down on me - et un classique swamp-rock, «The Urban Swamp», où on entend arriver les alligators. Kim sait de quoi il parle. Il croone son boogaloo, in the swamp, mais pas celui de Tony Joe, the urban swamp. Il crée les conditions d’une magnifique configuration de suspense. Il sait tourner un cult movie en trois minutes. On trouvera aussi trois véritables coups de génies sur cet album, à commencer par «The Precious Jules Theme» d’ouverture. Kim sort tout l’attirail du stomp et roule des r. On retrouve l’esprit inventif du vieux scientifique. Il attaque «A Necessary Evil» en lançant let’s get wasted ! Quel élan ! Il sait tailler sa route. Il se fâche même un peu et ça claque des mains. Precious Jules sonne comme un nouvel El Dorado, et on entend des chœurs de Dells sur la fin du cut. Coup de génie encore avec «Too Uptite» joué à la distorse maximale sur un beat funk. Kim va chercher des effets inédits. Il semble même perdre le contrôle et il part en dérive de syncope. Voilà une nouvelle façon de swinger le garage funk. Il chante aussi «You’re A Backlash» d’une voix de black des bas-fonds. Sacré Kim, il ne peut pas s’en empêcher. C’est visité par un solo gangrené. On appelle ça de la classe souterraine. On l’entend aussi gratter ses accords à l’aveuglette dans «Seein’ Spots». Écoutez les disques de Kim, il sera toujours au rendez-vous.
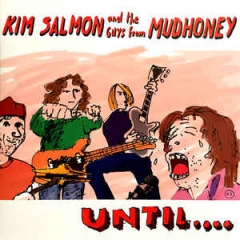
Il devait jouer dans Mudhoney, à l’époque où Steve Turner ne voulait plus tourner. Puis le projet a capoté quand Steve Turner a décidé de revenir dans le groupe. C’est cette histoire dessinée en bd qu’on découvre dans Until, l’abum de Kim Salmon & Mudhoney paru sur Bang! en 2011. Kim s’est bien amusé à dessiner cette histoire. Oh ce n’est pas un grand dessinateur, mais on peut dire qu’il a un certain style. Les morceaux enregistrés pour le projet tiennent bien la route, comme ce «I’ll Be Around» d’ouverture bien tenu à la sourdine avec un beau son de basse feutré. L’ami Kim y pulse bien son groove scientifique. On tombe plus loin sur «I Wanna Be Everything», un fantastique balladif. C’est là qu’on mesure l’énormité du mythe salmonien. Ce mec a des idées brillantes et ce cut sonne comme le grand hit planétaire inconnu. Kim chante avec de faux accents de Bowie dans la voix. En B, on tombe sur «The Goose», joliment embarqué au groove de basse par Matt Lukin, le vieux bassman de Mudhoney. Kim fait du Scientism avec les grungers de Seattle. Il leur enseigne l’art de groove de la menace.
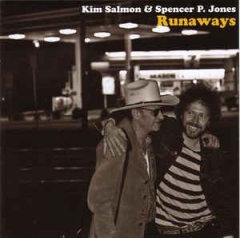
Kim Salmon & Spencer P. Jones enregistrent Runaways en 2013. Fantastique album ! Ils tapent une reprise ultra-inspirée du vieux hit de Wolf, «I Asked For Water». Ils ramènent du son au rendez-vous. Kim casse bien sa voix pour créer la pyschose. Ils enchaînent avec une reprise des Stooges, «I Need Somebody». L’incroyable de la chose, c’est que Kim chante comme Iggy. Il est dessus, avec du rab de guitares électriques. Comme c’est inspiré ! Comme c’est bien vu ! On gagne énormément à fréquenter un mec comme Kim. S’ensuit «It’s All The Same», un joli balladif digne de tous les honneurs, hanté par de faux airs d’«It’s All Over Now Baby Blue», c’est dire la classe du cut. Encore une reprise de rêve avec «Jack On Fire» du Gun Club, et une version laid-back incroyablement démente. Kim en fait un groove de blues dégoulinant de génie. Il chante ça sous le manteau. C’est atrocement bon. Sans doute la plus belle reprise du Gun Club. En B, avec «Loose Ends», Kim s’embarque dans un talking blues à la Lou Reed. Mais c’est dommage, car la B ne vaut pas l’A. Les cuts défilent et puis c’est tout.

Toujours sur Bang!, Kim vient de sortir son nouveau double album solo, My Script. Il y chante de gros hits glam comme «Destination Heartbreak», admirable d’allure altière, ou encore «Client JGT683», pop-rock magistrale hantée par un son de guitare à la Mick Ronson. C’est le son vainqueur, radieux, ondoyant qu’on adorait à la l’époque des Spiders. Kim chante ça avec un art consommé. Rien que pour ces deux cuts, l’album vaut l’achat, même s’il est cher - les albums Bang! comptent parmi les plus chers, mais les pochettes sont travaillées et les notes bien documentées. On trouve une autre merveille en début de C, «Already Turned Out Burned Out», gorgée de fuzz glam et hantée par une basse survoltée. Kim y part en solo et joue comme un dieu. La chose tourne vite à l’élévation mystico-sonique. Il faut aussi écouter le fabuleux «It’s Sodistopic». Kim y travaille le son avec une sorte de mauvais génie et fait monter la basse devant dans le mix. C’est lui qui joue tous les intrus. Ce disque est absolument passionnant de bout en bout, à condition bien sûr d’apprécier les aventuriers. Il ouvre la D avec un «Gorgeous And Messed Up» merveilleusement ambitieux et il fait le robot dans «Tell Me About Your Master».
Signé : Cazengler, le riki-Kim
Kim Salmon. La Féline. Paris XXe. 11 juin 2016
Scientists. Scientists. EMI Custom Records 1981
Scientists. Blood Red River. Au Go Go 1983
Scientists. This Heart Doesn’t Run On Blood, This Heart Doesn’t Run On Love. Au Go Go 1984
Scientists. Rubber Never Sleeps. Au Go Go 1985
Scientists. You Get What You Deserve. Karbon 1985
Scientists. Weird Love. Karbon 1986
Scientists. The Human Jukebox. Karbon 1987
Scientists. The Human Jukebox 1984-1986. Citadel 2002
Scientists. Pissed On Another Planet. Citadel 2004
Scientists. Sedition. ATP Recordings 2007
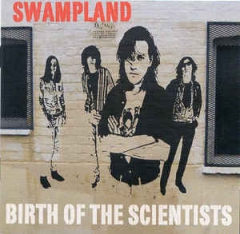
Scientists. Swampland. Bang! Records 2008

Scientists. This Is My Happy Hour (Birth Of The Scientists). Cherry Red 2010
Beasts Of Bourbon. The Axeman’s Jazz. Big Time 1984
Beasts Of Bourbon. Sour Mash. Red Eye Records 1988
Beasts Of Bourbon. Black Milk. Red Eye Records 1990
Beasts Of Bourbon. The Low Road. Red Eye Records 1991
Beasts Of Bourbon. From The Belly Of The Beasts. Red Eye Records 1993
Kim Salmon & The Surrealists. Hit Me With The Surreal Feel. Black Eye Records 1988
Kim Salmon & The Surrealists. Just Because You Can’t See it Doesn’t Mean It Isn’t There. Black Eye Records 1989
Kim Salmon & The Surrealists. Essence. Red Eye Records 1991
Kim Salmon & The Surrealists. Sin Factory. Red Eye Records 1993
Kim Salmon & STM. Hey Believer. Red Eye Records 1994
Kim Salmon & The Surrealists. Kim Salmon & The Surrealists. Red Eye Records 1995
Kim Salmon & The Surrealists. Ya Gotta Let Me Do My Thing. Half A Cow Records 1997
Kim Salmon & The Business. Record. Half A Cow Records 1999
Kim Salmon. Rock Formations. Bang! Records 2007
Kim Salmon & The Surrealists. Grand Unifying Theory. Low Transit Industries 2010
Precious Jules. Precious Jules. Battle Music 2011
Kim Salmon & Mudhoney. Until. Bang! Records 2011
Kim Salmon & Spencer P. Jones. Runaways. Bang! Records 2013
Kim Salmon. My Script. Bang! Records 2016
*
« Allo !
- Ah Damie ! Je croyais que tu m'avais oubliée !
- Mais non, mais non ! Tu es inoubliable !
- Oui, des mois que tu ne m'as donné de nouvelles !
- Totalement indépendant de ma volonté, baby. Tu sais la vie d'un rocker est très dure, concerts, disques, bouquins, revues, l'on n'en vient jamais à bout !
- Oui, mais tu pourrais tout de même penser un peu à moi, je...
- Justement, est-ce que ça te dirait un petit bain sur la Seine ?
- Ne sois pas timide Damie, si tu veux me voir en monokini, dis-le directement, je t'attends dès ce soir dans ma chambre.
- Non, non, je suis très sérieux un petit bain mercredi soir sur la Seine !
- Mais tu es complètement fou, avec ce froid de canard, arrête de plaisanter !
- Tout ce qu'il y a de plus sérieux, ma baby belle, mon fromage d'amour, je compte sur toi.
- Fuck ! »
J'ai ressenti comme un soupçon d'hystérie typiquement féminine dans ce dernier vocable. Qu'à cela ne tienne, je suis allé voir ma vieille et fidèle copine stationnée devant la maison.
« Hello teuf-teuf !
- Salut Damie, quel est le programme pour ce soir ?
- Les Pogo Car Crash Control
- Super, j'adore ce groupe ! Te rends-tu compte qu'ils ont mis le mot voiture dans leur appellation contrôlée. Eux au moins ils savent honorer la gent automobile ! Allez, zou on part tout de suite ! »
Et voici comment et pourquoi, deux heures plus tard je me pointais ce mercredi 25 / 01 /2017 au :
PETIT BAIN / PARIS
DÄTCHA MANDALA / JAMES LEG
POGO CAR CRASH CONTROL
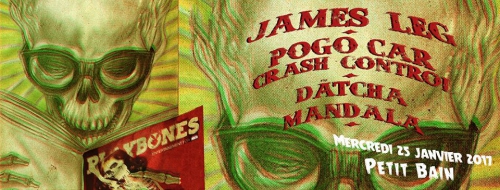
Franchement à dix-neuf heures trente il ne fait pas chaud sur les quais de Seine au pied de la très grande Bibliothèque François Mitterrand. Faut être un peu barge pour s'y promener, d'ailleurs en toute logique le Petit Bain est une barge amarrée – fluctuat nec mergitur - sur les bords de l'antique Lutèce chère à Julien, notre dernier imperator, reconvertie en restaurant et salle de concert.
L'espace n'est pas grand mais aménagé et pensé avec intelligence, l'on s'y sent bien, mais petit défaut inhérent à sa structure originelle, la scène est un peu étroite. Le public est là. Des connaisseurs.
DÄTCHA MANDALA

Les gros Marshalls qui encadrent la scène laissent présager que l'on ne va pas assister à un concert de flûtes à bec. Toutefois les tapis disposés sur le sol et toute une série d'objets indiens disséminés avec soin attirent les regards et m'assaillent de quelques craintes. Mandala ! Pourvu que l'on ne se retrouve pas avec des adeptes de Ravi Shankar ! Nos craintes seront vite balayées. JB Mallet s'installe derrière sa batterie, Jérémy Saigne s'empare de sa guitare, et Nicolas Sauvey est à la basse. Et au chant. Surtout au chant. Cheveux frisés, veste à franges, et la voix, aigüe en diable qui monte haut, et qui cascade en secousses telluriques. Le spectre Led Zeppelin s'impose à tous. Il est des fantômes qu'il vaut mieux laisser reposer en paix. N'atteindront jamais au cours de leur set la puissance apocalyptique du Dirigeable mais ils tireront leur épingle du jeu et démontreront que loin d'être une pâle imitation ils possèdent une personnalité intrinsèque et créatrice qui ne demande qu'à s'épanouir.
Si Nicolas attire les regards ses deux acolytes ne restent pas inactifs. Il s'agit bien d'un power trio et chacun a intérêt à assumer sa charge. Chacun son rôle, mais la musique qu'ils édifient exige une extrême attention. Jérémy reste concentré, les yeux fixés sur ses mains, la flamboyance d'un riff tient avant tout à sa précision, sa force lyrique procède de l'ensemble du groupe, l'appui drumique est essentiel en cela, JB, est aux aguets, lui incombe la tâche de porter ces coups de boutoirs qui doivent être aussi des contreforts inébranlables. Peu de roulements destinés à construire un mur du son de base, préfère nettement une frappe d'intervention qui soutient, achève et sculpte le riff, l'accompagnant de bout en bout tout en en marquant surtout la finitude, c'est lui qui clôt la séquence, d'un battement de suspension agonisique qui laisse l'espace de silence nécessaire à l'envol suivant de la guitare.
De sa poche Nicolas extrait un harmonica. Le blues est au fondement de cet heavy-psyké que propulse Dätcha Mandala. S'en tire bien. Même si à mon humble avis, il lui manque cette respiration lente qui reste la caractéristique du blues. Ce milliardième de seconde où tout s'arrête, ce silence oppressif qui donne davantage de violence à la propulsion qui suit. Ce troisième temps invisible qui irrigue le blues de fond en comble et constitue le fil essentiel de la trame existentielle. Si prégnant chez les bluesmen de la première génération, écoutez par exemple Son House si ce que je dis vous paraît obscur. N'empêche que Nicolas emporte la conviction. Pieds nus sur la terre sacrée et vrombissante du blues il électrise l'assistance. Se démène, frotte sa basse sur les amplis, larsène à souhait, nous tire dessus avec sa guitare mitraillette, danse, virevolte, hurle, feule et soupire, avec conviction.

L'assistance n'est pas au diapason de cette furie scénique que déclenche peu à peu Dätcha Mandala. Les applaudissements seront de plus en plus nourris mais une fois le set terminé, on a l'impression que le public vient tout juste de réaliser la beauté rock'n'roll de la prestation à laquelle il vient d'assister et qu'il flotte dans l'air le regret de ne pas avoir davantage participé à cette fête. Les derniers morceaux seront particulièrement enlevés, Jérémy quitte sa guitare et exécute un impeccable poirier, peut-être pour nous indiquer qu'il faut savoir parfois entreprendre le monde sous un angle d'attaque différent...
Dätcha Mandala nous vient de Bordeaux. Se revendiquent de la musique des seventies. D'avant les Sex Pistols pour être davantage précis, de ce moment où la prégnance des racines dans le rock n'avait pas encore été bousculé par cette volonté hardcorienne de jouer plus fort et plus vite. Où l'on prenait le temps de respirer. C'est vraisemblablement ce parti pris de jouer à rebours des codes actuels en vigueur qui a un peu désarçonné la foule. Mais nous ne nous inquiétons guère. Dätcha Mandala possède l'énergie et la fougue qui lui permettront de triompher. Ont déjà fait leurs premiers pas sur la chaussée des géants.
POGO CAR CRASH CONTROL

Pas évident de succéder à Dätcha Mandala. Pas de danger, les Pogo ont décidé de couler le Titanic, alors prenez votre bouée de sauvetage et tâchez de survivre jusqu'à la fin du set. Noir total. Les guitares agonisent sur le sol. Et subitement c'est l'enfer. Les Pogo ont pris le contrôle et il est sûr que ça va crasher.
Batterie Godzilla et guitares filles du Kraken, en six secondes les Pogo ont détruit le monde. Mais le pire est encore à venir. Ne se fait pas attendre. Extirpe son abominable face dans le chaos que vomit le vocal d'Olivier. La bouche d'ombre éructe l'ultime menace. L'infâme Cthulhu sort du gouffre. Les Pogo ont brisé les chaînes qui cadenassaient la citerne immémorielle. Et dans la salle les sectateurs du démon qui attendaient depuis si longtemps l'interdite délivrance s'adonnent aux entrechocs d une sarabande dinosaurienne. Les Pogo ont compris l'essentiel, si le rock'n'roll veut exister c'est en tant que démiurge de la fureur. Tout autre voie serait celle du mensonge parménidien.

Torse nu et sueur reptilienne qui exsude de sa peau Louis Péchinot accentue les battements titanesques de Sebeth l'invincible. Il est la force héphaïstossienne de cette grimace douloureuse que la jeunesse offre comme un crachat de haine à la laideur de l'existence sociétale. Lola Frichet par les pincements cruels et graciles dont elle triture sa basse rappelle cette enfant blonde qui dans le poème de Victor Hugo se penche sur l'abîme pour savoir si l'oeil de Dieu est enfin éteint. Olivier Pernot et Simon Pechinot sont aux guitares ce que les toreros sont au taureau. Sacrificateurs et scarificateurs. Ils jettent des incendies de sel purulent sur la pulvérulescence des plaies de l'adolescence. Et cette voix imprécative dénonce et porte le fer dans les noeuds les plus intimes qui nous rattachent par des liens hojojutsiques au réel du monde et de nos contradictions.
Les Pogo ont une dimension en plus. Sont conscients qu'il faudrait trancher le joug directionnel de l'existence, par deux fois Olivier proposera de précipiter la barge au fond du fleuve. Il suffirait d'un grand va et vient collectif des deux bords pour déplacer le centre de gravité et susciter la farandole finale. Mais la transe pogotive de l'assistance refusera de se transformer en missile implosif d'intérieur. Parfois la coupure du désir sépare l'acte du fruit. Les temps ne sont pas mûrs et face à l'Innommable les plus courageux reculent.

Le set des Pogo Car Crash Control est comme une ondée de soufre rafraîchissante. Des images s'imposent et se superposent à nos rétines intérieures. A chacun la sienne, pour moi, un drakkar viking dévasté après l'abordage. Sur le quai, après le concert un petit groupe échange ses impressions. Certains redescendent se procurer leur vinyl. Le groupe s'impose. A ceux qui s'inquiètent du futur du rock.
JAMES LEG

L'on installe un gros orgue Fender Rhodes au milieu de la scène et face à lui l'on monte vitesse grand V, un kit de batterie. Les artistes seront de profil. Original binôme. James Leg et Mat Gaz entrent sous les applaudissements, deux grands types dégingandés, tous deux porteurs d'une longue crinière, autant celle de Mat lui tombe en soyeuses cascades bouclées sur les épaules, autant celle de James, graisseuse à souhait descend autour de son cou tels de visqueux serpents vénéneux.
Et le groove commence. Bien gras, soutenu par une batterie omniprésente. Soul à mort, James possède une belle voix éraillée. Le public marque la cadence, en extase, surtout les filles, faut dire que James présente une belle dégaine, l'a du charme et du charisme. Perso je commence à m'ennuyer. C'est beau, c'est bon, c'est bien, mais ça ne me transcende pas. La qualité mais pas le souffle qui vous emporte au paradis ou en enfer. James martyrise un peu toujours les mêmes touches de ses deux claviers. Unité de de ton, de lieu et d'action, mais au final l'ensemble finit par être monotone.
Quarante minutes, courte pause et reprise, n'y a que l'avant-dernier morceau qui s'envole un tantinet. Sinon l'on reste dans un mid-tempo musicalement correct. En y réfléchissant, c'est la programmation qui est boiteuse, après les deux grandes secousses des deux premiers groupes l'on tombe dans la mer des Sargasses. Soyons juste, l'assistance en est sortie satisfaite. Mais en poussant la conversation je m'aperçois que certains ont déjà dans le passé assisté à plusieurs de ses prestations bien meilleures...
Damie Chad.
( Photos : Brian Ravaux ImmortalizR )
BYE BYE ELVIS
CAROLINE DE MULDER
( Actes Sud / 2014 )
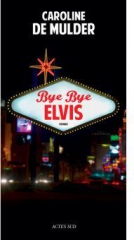
Froid de loup sur les trottoirs de Fontainebleau. Un panneau salvateur, Comptoir à Musique, s'offre à moi. Davantage de livres que de disques. Des CD mais pas de quoi faire le bonheur d'un rocker. Par contre les prix sont sympathiques entre deux et trois euros cinquante. J'en ressors avec ce roman. Pris par acquis de conscience pour Elvis, parce que les auteurs qui le brandissent en produit d'appel sur la gondole de leur couverture afin d'appâter le lecteur je préfère ne pas vous dire combien cela m'horripile. Un tour sur Wikipedia, Caroline De Mulder a écrit un livre sur le tango - scrongneugneu – mais aussi une thèse sur Leconte de Lisle, poëte majeur du dix-neuvième siècle stupidement dédaigné par nos futiles contemporains, j'en déduis que tout n'est pas totalement mauvais chez cette jeune femme. Donc je lis. D'une traite. Bien écrit, elle a du style, vous avez envie de savoir la suite. Parfois je suis hypocrite, comme vous je connais la fin. Enfin, juste la moitié.
Des livres de cet acabit nous en avons déjà chroniqué deux sur KR'TNT ! Complot à Memphis ( livraison 29 du 02 / 12 / 2010 ) de Dick Rivers. Très bon, qui raconte comment Elvis s'échappe du cirque parkérien pour pouvoir vivre une vie tranquilloute dans l'anonymat le plus complet, mais au tout début de sa carrière, et celui de Stéphane Michaka ( livraison 188 du 08 / 05 / 2014 ), Elvis sur Seine - la première mouture parut en 2011 et la deuxième en 2014 - qui envisage la même hypothèse de départ que Caroline De Mulder, la fausse mort d'Elvis qui pantoufle pépère dans la bonne ville de Paris. Z'oui, mais si vous devez n'en lire qu'un privilégiez celui-ci.
C'est comme dans les Histoires de Hommes illustres de Plutarque, deux vies en parallèle. Chacune suit son chemin, un chapitre sur Elvis, un chapitre sur John White. Et l'on recommence. En corollaire celle d'Yvonne veuve éplorée peu fortunée qui s'en vient trouver une place de gouvernante auprès de ce John White. Les fans d'Elvis ne seront pas perdus. La moitié du roman retrace la vie du King, il est facile pour les fans à simple lecture de retrouver dans quel livre notre auteur a pioché tel ou tel détail. Très honnêtement elle vous met sa bibliographie en fin de volume. De toutes les manières, la littérature est davantage un travail de réécriture que d'écriture. Les novateurs sont rares. Ce qui n'empêche pas d'appuyer sur certains aspects que l'on veut mettre en évidence. Pour Caroline De Mulder ce sont les origines prolétariennes d'Elvis. Fils de la misère, d'un père qui n'a qu'un goût fort modéré pour le travail – ce en quoi nous le comprenons - et d'une mère hyper-protectrice. Une espèce d'amour incestueux qui ne sera jamais conscientisé ni même charnellement esquissé. Le pauvre Elvis porte une autre croix, la culpabilité d'avoir survécu à son frère jumeau, d'avoir pris en quelque sorte la place de son aîné. L'aura du mal à se dépatouiller de cette existence qui ne lui appartient pas tout à fait. Surtout que la vie ne lui fait pas de cadeau, lui offre tout sur un plateau, la richesse, la gloire et surtout ce qui touche de plus près à sa condition charnelle d'être humain, les filles et les femmes. Comment refuser de tels dons du Ciel ! Elvis en consommera en grand nombre mais sa sexualité est dominée par l'obsession d'un désir de pureté qui n'est peut-être que l'échappatoire et l'expression d'une insoutenable contradiction, ne profite-t-il pas de faveurs indues ? Les filles s'offrent à lui, mais l'aiment-elles pour Lui ou pour son statut iconique à l'origine dévolu à son frère ? Et pourquoi Dieu a-t-il permis cette substitution ?

Pour John White, tout est beaucoup plus simple. L'a une personnalité, des traits de caractère, une corpulence, une richesse, une addiction médicamenteuse qui ne laissent aucun doute au lecteur. Ressemble à s'y méprendre à Elvis Presley. Ce ne peut être qu'Elvis. La seule qui ne s'en aperçoit pas, c'est évidemment cette godiche d'Yvonne. Restera plus de vingt ans auprès de lui. D'employée elle passe au rôle de mère protectrice ce qui pour Elvis équivaut à...
Un journaliste rock lui ouvre les yeux. Mister White n'est autre qu'Elvis, trop tard, John White a disparu et... lisez le bouquin pour savoir. Dick Rivers n'a-t-il pas sorti un disque qui se nomme L'Interrogation ? Nous touchons ainsi par l'entremise de Caroline De Mulder aux vertus de la littérature qui n'est pas de fournir les réponses aux questions que de prime abord vous ne vous seriez pas posées ainsi, mais de vous pousser à vous interroger sur les atermoiements du possible. Ô mon âme n'aspire pas à l'immortalité... début de cette citation de Pindare que Valéry plaçait en exergue du Cimetière Marin. La mort nous ferait-elle davantage question que le sexe à Elvis ?
Damie Chad.
25/01/2017
KR'TNT ! ¤ 313 : IGGY POP / WHEEL CAPS / GENE VINCENT / JOHN KING
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 313
A ROCKLIT PRODUCTION
26 / 01 / 2017
|
IGGY POP / WHEEL CAPS / GENE VINCENT / JOHN KING |
Pop art
Iggy Pop fait partie des rares rock stars capables de rendre une interview fascinante. Il partage ce privilège avec Keith Richards, Lemmy et John Lydon. Remontez aussi loin que vous le pourrez dans l’historique interviewal de ces quatre personnages et vous constaterez à quel point ils ont toujours su sonner juste. Iggy vient de donner à Gary Graff l’une de ces interviews dont il a le secret, et c’est tellement intense qu’on croit entendre filtrer le croon de sa voix. Dès que ce mec s’exprime, on sent le souffle de son intelligence. Comme ceux des trois autres cocos, ses interviews ne supportent pas le charcutage de la traduction. La parole d’un mec comme Iggy Pop est essentiellement une musique qu’il est impossible de corseter pour la restituer dans une autre langue. Par exemple, Iggy explique qu’il ne veut plus faire ce qu’on lui a demandé de faire lors de la dernière tournée : «Not something that’s going to put me in a room at the Apple store with a twenty-person camera crew and a fitted suit.» (Il ne veut plus jouer dans un Apple store en costard devant des caméras). C’est justement sa façon de dire les choses qui swingue. Il parle comme s’il improvisait les paroles d’une chanson. C’est exactement le même débit.

Et comme tous les gens de sa génération, Iggy se heurte désormais au problème de l’âge. Au printemps, il fêtera ses 70 ans. (Pour l’anecdote : dans le même numéro de Classic Rock, Chris Spedding annonce la reformation des Sharks. Il a 72 ans et il sait très bien que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps). Iggy estime qu’il lui faudra cinq ans pour finir son prochain album et il aura alors - what the hell what the hell - 75 ans. Il ajoute que d’ici là, il est fort possible que les albums aient disparu. C’est en tous les cas ce qui se profile à l’horizon.
Il est rentré épuisé de cette tournée Post Pop Depression - Yeah it was a toughter schedule than I’ve worked for many years. I thought I was gonna die - Iggy a cru qu’il allait y laisser sa peau. Désormais, il veut rester tranquille chez lui. Il envisage toutefois de travailler avec Don Was et un guitariste local du nom de Dr Lonnie Smith. Don lui dit «Let’s do a record with Lonnie Smith !», et Iggy lui répond : Okay if I don’t have to leave home ! So yeah, something like that.
Bien évidemment, la plus grosse partie de l’interview concerne cette fameuse tournée, et Iggy se montre généreux envers les gens qui l’accompagnaient. Il a sans doute fermé les yeux sur le côté atrocement frimeur de cette opération. Josh Homme et les autres se sont payés une sorte de crédibilité stoogy à bon compte, une faute de goût que n’auraient jamais pu commettre des gens comme David Bowie ou Alan Vega. Les photos de presse sont horriblement m’as-tu-vu et le film montre ces mecs en train de danser comme des coiffeurs sur «Lust For Life». What the hell what the hell, on est loin de Ron Asheton. On est loin de ce qui se passe à l’intérieur de la pochette de Fun House. Il n’est pas surprenant que ce dernier disque soit catastrophique. Pourtant Iggy se dit fier de cet album, même s’il a dû surmonter des différences - I’m East Coast and they’re West Coast - Il dit aussi que Josh est deux fois plus gros que lui, en corpulence, et qu’il a des tendances - He likes going arty but he’s a rock boy - (Dans la bouche d’Iggy, le mot arty peut avoir une consonance moqueuse, du genre il pète plus haut que son cul, mais au fond, c’est un rocker). Comme tous ces mecs sont principalement des surdoués, Iggy n’en finit plus de répéter qu’il a dû se mettre à leur niveau. Il raconte que le batteur Matt Helders (Artic Monkeys) chante mieux que lui et que Dean Fertita est un multi-instrumentiste mille fois meilleur que lui. Et là, on commence à se demander s’il n’est pas en train de se foutre de leur gueule. Ah il revient aussi sur l’idée des costards qui sortait du puissant cerveau de Josh Homme : comme on le voit dans le film du concert de l’Albert Hall, ils portent des jolis costards gris de businessmen. Iggy n’était pas chaud - Now I’m not the kind of guy who’s gonna fly coast to coast to meet a fashion designer. And I did - Voilà donc Iggy déguisé et il ajoute, avec un humour vengeur - So it was properly lit, proprely played, properly sung. I managed to do most of the show on key - Tout était parfait, bien éclairé, bien interprété et bien chanté, et je me suis arrangé pour essayer de chanter juste.
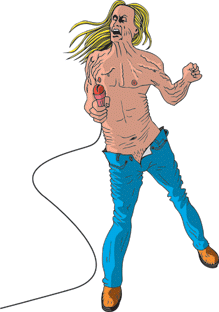
Bien sûr, si on lit entre les lignes, Iggy cède à son goût pour la dérision, ce qui peut sembler logique quand on sort d’un groupe comme les Stooges. Son cœur est ailleurs. Ron et Scott, c’est tout de même d’un autre niveau. Il évoque cette fin de parcours tragique - I wanted to finish up doing the job for the Stooges. And after Ron passed away, that involved resurrecting the second, Mark Two of the group with James - Ron casse sa pipe, alors il faut bien passer au Mark Two des Stooges avec James. Et paf, Scott tombe malade en pleine tournée. Iggy comprend ce que ça veut dire - There was no reason to go on once Scott passed away. So that was done - Une fois Scott mort, ça n’avait plus aucun sens de continuer. Heureusement, Iggy avait eu l’idée géniale de passer un coup de fil à son pote Jim Jarmush pour lui demander de faire un film sur les Stooges. C’était la dernière chose qu’il pouvait encore faire.
Après les Stooges, Iggy a su continuer de fasciner ses fans. On lui pardonnait plus facilement les mauvais albums qu’aux autres, peut-être parce qu’on se sentait incroyablement proche de lui. Cette relation relevait de l’affection. Exactement pareil qu’avec Gainsbarre. Si on buvait des grands verres de Ricard sans eau et qu’on fumait des Gitanes, c’était bien sûr en hommage à Gainsbarre. On cultivait alors un art de vivre et l’ivresse se voulait poétique. Sa disparition fut un tel choc émotionnel qu’on tremble à l’idée qu’Iggy disparaisse un jour. Impossible d’imaginer la vie sans Iggy Stooge.
Iggy Stooge ? L’homme qui a su réinventer le rock du XXe siècle.
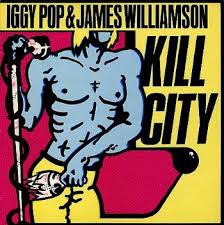
Après le naufrage des Stooges, Iggy traîne toujours avec Williamson. On ne l’aime pas, celui-là, mais il faut faire avec. Cette vipère de Williamson avait quand même réussi à virer les frères Asheton, c’est-à-dire l’âme des Stooges. On s’est retrouvés en 1977 avec un album Bomp qui sonnait comme une gueule de bois. Plus on l’écoutait et plus on se grattait la tête. Kill City essayait de nous réconcilier avec la légende des Stooges, mais on avait dans les pattes un album de pop. Oui, Pop faisait de la pop et ça interloquait le kéké. Des copains amputés du cerveau trouvaient ça bien. Dans «Beyond The Law», Iggy cherchait quand même à renouer avec la fusion de Fun House. Il faisait entrer un sax monté en haleine, mais le balladif dominait toute l’A et ça semblait parfaitement inconvenant. En B, il tapait dans le boogie rock des seventies avec «Consolation Prize». Il fallait attendre «Lucky Monkeys» pour trouver un peu de viande, et ce retour au punch, on le devait à Hunt & Tony Sales, l’une des meilleures sections rythmiques de tous les temps, et que Bowie allait d’ailleurs récupérer pour sa Tin Machine. Iggy semblait remonté en selle pour renouer avec la stoogy motion. Hey ! Il fallait voir comme ça prenait tournure !
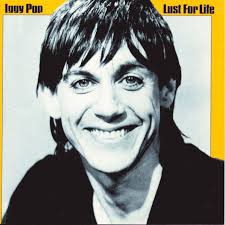
Débute alors la collaboration avec Bowie, et ça donne deux albums magiques : Lust For Life et The Idiot, parus en 1977 - Here comes Johnny Yen again/ With the liquor and drugs - C’est ainsi que démarre le fastueux Lust qui donne son titre à l’album. C’est tout simplement le vieil hymne des années noires de débauche et de désespoir - Well I’m just a modern guy - On en frissonne encore et on s’étonne même d’être toujours en vie. Ça et «Born To Lose» des Heartbreakers, c’était du poison à l’état le plus pur. Et bien sûr, on retrouvait Hunt et Tony Sales derrière. Iggy revenait aux Stooges avec son «Sixteen» - Sweet sixteen in leather boots - On connaissait toutes ces paroles par cœur, comme du temps de Let’s go down in my favorite place et de All across the USA, pas de problème. Toute la violence des Stooges coulait dans les veines de Sweet Sixteen. Et la fête continuait avec «Some Weird Sin». Quel héros ce fut, à l’époque. Son cooptage avec Bowie lui allait à merveille. Il finissait sa face avec «Tonight», du pur Bowie. Iggy faisait du mimétisme et on avait un fabuleux solo de Carlos Alomar. Et en B, on tombait sur ce coup de génie appelé «Success», l’extravagante démonstration de force d’un chanteur hors normes et hors du temps. Bowie chantait en backing. Quel délire ! - Here comes success over my hill/ Here comes my face/ It’s plain bizarre - Indépassable et décadent, drôle et puissant. Dans «Neighborhood Treat», Iggy chante aussi comme un dieu, c’est dingue ! Quelle extraordinaire ampleur ! Il finit avec le fabuleux stomp des frères Sales dans «Fall In Love With Me». C’est drivé au beat salace. Iggy chante à l’Iggy, la voix pleine d’animalité.
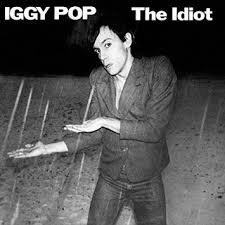
The Idiot ne vaut pas Lust, loin de là. Le son du Bowie post-glam y est beaucoup trop présent. Et ce dès le groove urbain de «Nightclubbing», vraiment crépusculaire, ou encore «Funtime», groove gothique typique de l’ambiance ultra-pourrie des années 80. On reste dans les ambiances chargées comme des mules avec «Baby». La patte de Bowie prédomine, mais on se régale du chant d’Iggy. Sa justesse de ton s’impose, même dans l’improbabilité de la menace et le glauquissime des ambiances louches. Pas plus Bowie que ce «China Girl». On sent l’imparable hit-maker, le fameux développeur d’espaces pop. C’est le hit parfait, et en plus, il est porté par ce chanteur hors du temps et hors des modes qu’est Iggy - My little China girl says/ Oh Jimmy just you/ Shut your mouth/ She says ssshhh - Et voilà qu’en B apparaissant les fameux «Dum Dum Boys», un groove traînard souligné à la wha-wha, avec encore une fois des lyrics de rêve - The first time I saw/ The dum dum boys/ I was fascinated/ They just stood in front/ At the old drug store.

On retrouve notre crooner préféré dans New Values qui sort deux ans plus tard. Le morceau titre est encore un hit d’Iggy, dotée d’une vraie tension. Il retape dans le concept de la modernité - I’m looking for new values but nothing comes my way - C’est d’une classe affolante, et c’est le hit de l’année 79. C’est joliment joué sous le manteau, avec un brin de clap-hands et une guitare qui se fait discrète. Avec «I’m Bored», Iggy revient à sa chère décadence. C’est un hymne à l’ennui - I’m sick/ I bore myself to sleep at night - Et il se prétend le chairman of the bored, malicieux clin d’œil. De l’autre côté se trouve l’édifiant «Five Foot One» monté sur le riff de New Values. C’est la même chose, mais avec du What the hell what the hell en plus - I wish life could be/ Sweddish magazine ! - On retrouve une troisième fois le riff de New Values dans «Billy Is A Runaway», mais ce n’est pas grave, car Slim Harpo et Elmore James faisaient la même chose, dès qu’ils tenaient un hit.
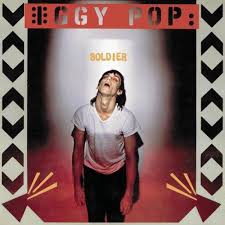
Pour Soldier, Iggy rassemble une drôle d’équipe. Glen Matlock joue et compose. Avec «Take Care Of Me», ils essayent de renouer avec la classe de «Success», mais ce n’est pas aussi réussi, loin de là. Alors ils sortent le gros son américain pour «Get Up And Get Out», avec un bel horizon urbain, une voix de veau au timbre argentin et du sax qui rôde dans les parages. Nouvelle tentative de «Success» avec «I’m A Conservative» et on retrouve tout l’humour d’Iggy. Il faut en effet se souvenir qu’Iggy est avant tout un mec infiniment drôle, il faut l’entendre marteler ses conneries - I like my beer I like my bread/ I love my girl I love my bread - Et en B, on tombe sur un coup de génie signé Iggy Pop : «Dog Food». Rien qu’avec ça, on est comblé, ce n’est même pas la peine d’écouter les autres titres de l’album - Dog food is good for you/ It makes you strong and clever too - C’est un pur chef d’œuvre de garage décadent.

Party est un pauvre album des années quatre-vingt. Ivan Kral joue sur cet album et dans le cut d’ouverture, «Please Be», on a un joli son de basse élastique. C’est très cuivré et la fin de couplet sonne comme celle de «Pretty Vacant». Il faut attendre «Houston Is Hot Tonight» pour trouver un peu de viande et retrouver l’allant d’Iggy, ce vieux jerkeur de beat. C’est encore pire de l’autre côté. On ne retient de cet album que la photo au dos de la pochette : Iggy plonge son regard candide dans le nôtre et on comprend soudain pourquoi toutes les filles à l’époque tombaient amoureuses de lui.
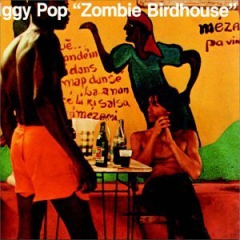
Pour la pochette de Zombie Birdhouse, il est assis dans une rue à Haïti. Comme il fait chaud, il est torse nu. Il boit un coca. Sur cet album, Clem Burke bat le beurre et Chris Stein joue de la basse. Avec «Run Like A Villain», Iggy s’en tire avec les honneurs. Tout est joué dans des ambiances de grooves bizarres, et à l’époque, ça nous semblait insupportable. «Life In Work» est un peu thibétain dans l’esprit. Iggy cherche une voie nouvelle, mais c’est douloureux. Il aimerait bien que ça ne soit qu’un jeu. De l’autre côté on tombe sur «Eat Or Be Eaten» - Eh miam miam - qui est sûrement le hit de l’album. On se réveille avec «Bulldozer». Iggy chante ça à l’interjectif en bon iguane qui se respecte, c’est-à-dire qui se laisse rôtir au soleil de Satan. Iggy sait exprimer la barbarie, pas de doute.

Malgré une très belle pochette, Blah-Blah-Blah est l’archétype de l’album raté. Iggy y fait du rock FM. Son «Real Wild Child» subit les ravages de l’époque. Cette production aseptisée est insupportable. On sent qu’Iggy est mal dans ses godasses. Il y a même un rock synthé atroce qui s’appelle «Fire Girl». En B, il essaye de retrouver l’éclat de «Lust For Life» avec le morceau titre, sur fond de bon beat tribal. Si on conserve l’album, c’est uniquement pour la pochette. Notre héros, comme dirait Houellebecque, y pose en playboy.

Après avoir fricoté avec Glen Matlock pour le résultat que l’on sait, Iggy fricote en 1988 avec un autre Pistol, Steve Jones, pour l’album Instinct. Rien que pour la pochette, ça reste l’un des albums préférés des fans d’Iggy. Il renoue avec son look stoogien et c’est l’époque d’un concert dément à l’Olympia, où il était accompagné par un trio de hardeux. Steve Jones cocote bien le «Cold Metal» d’intro. Il joue comme le métronome que l’on sait. Alors attention, les hits se nichent en B, à commencer par «Lowdown» qu’Iggy prend au baryton. Quel crooner fantastique ! Steve Jones joue ensuite le morceau titre à la grosse cocote, sur un vieux beat. Il sait qu’il se retrouve dans les meilleures conditions, puisqu’il accompagne un chanteur exceptionnel, comme au temps de Johnny Rotten. S’ensuit un fantastique «Tuff Baby» - I love you tuff baby - La veinarde ! C’est joué au gros riff de Jonesy. Il enrobe bien le chant avec son phrasé gras. Quel hit faramineux ! Il faut toujours faire confiance à Iggy. Retour de la vieille cocote de Jonesy dans «Squarehead» - But I ain’t gonna be no square head - Tu peux faire tout ce que tu veux baby, mais tu ne feras jamais de moi un beauf.

L’album Brick By Brick doit sa force à la pochette dessinée par Charles Burns. On ne peut pas dire que cet album soit bon, car il contient trop de déchets. C’est aussi l’époque où Iggy a de mauvaises fréquentations : les mecs de Guns n’Roses. Mais il sauve son disque grâce à trois pures énormités, à commencer par le fantastique «Butt Town». Iggy retrouve ses marques de rocker sur ce morceau ultra-joué. Eh oui, les malheureux Slash et McKagan se prennent pour les Stooges ! L’autre hit du disque c’est «Neon Forest», belle pièce d’awite et comme la plupart des compo d’Iggy, très autobiographique - It’s a miracle I haven’t fallen through any cracks - À la fois énorme et poppy - The life on display is trouble for sure/ The drugs that I took have made me insecure/ You can get a weird prize for being adored/ You can join the in crowd for being a whore/ Althrough you are lonely you wish for a fence - Fantastique intelligence ! Goddamned I wanted out ! - Le troisième gros cut de l’album s’appelle «Pussy Power», joué à l’épaisseur d’«Instinct», sauf que ce sont les clowns qui jouent, pas Steve Jones.

Par contre, American Caesar fait partie des meilleurs albums d’Iggy. Dès «Wild America», on plonge dans la bonne vieille fournaise d’Eric l’imprononçable, le guitariste qui accompagne Iggy à l’époque - One night out in LA/ I met a Mexicana - On se goinfre de ce genre de cut car Iggy y distille l’essence même du rock américain. Il finit ce classique en beauté. N’oublions pas qu’Iggy est l’un des grands finisseurs de cuts devant l’éternel. On retrouve ce diable d’Eric l’imprononçable dans «Plastic & Concrete». Il se balade dans tout le morceau avec un son bien gluant, puis avec «Fucking Alone», on retrouve l’immense Iggy crooner du désespoir. Il croone de plus belle sur «Highway Song». «Sickness» fait aussi partie des hits du disk, car c’est une véritable plongée dans le son et puis voilà le mirifique «Boogie Boy», chanté real wild, charbonné à la guitare, Iggy redevient le rocker définitif. Mais attention, car deux autres monstruosités suivent, à commencer par une version ultimate de «Louie Louie» - And now the news - Ça riffe et ça pianote et voilà que surgit soudain l’authentique horreur riffique - Oh oh baby - C’est la meilleure version de tous les temps - We’re gonna go now - La vraie racine du garage. Et puis voilà «Caesar», amené par des accords véreux - People of America - Iggy fait l’empereur avec une troublante véracité de ton - Throw them to the lions ! Throw them to the lions ha ha ha ha ! - Il fait jeter les Chrétiens aux lions. Tout dans ce classique néronien relève de l’intelligence supérieure.
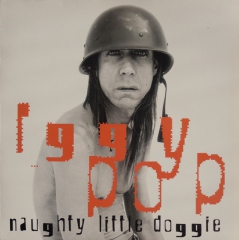
Décidément, les pochettes se suivent et ne se ressemblent pas. Celle d’American Caesar fascinait, mais celle de Naughty Little Doogie frise le ridicule. Dommage car au dos, on trouve un superbe portrait d’Iggy la clope au bec. Sur cet album, on retrouve l’équipe de chevelus qui fit merveille au fameux concert de l’Olympia - Kiss My Blood - et Eric Mesmerize qui fait des siennes dès «Pussy Walk» qu’Iggy prend au croon de la rue - The other day I was walking down 14th street/ It was a beautiful summer day - Encore du solide avec «Knucklehead», du pur Iggy de vieux renard à l’accent tranchant, psyché en diable, saturé de guitares. «Keep On Believing» est une compo foireuse, mais la fournaise est bien réelle. On assiste à une sorte de carnage sonique de groove de basse et de la wha-wha délinquante. On a le même problème avec «Heart Is Saved», une grosse machine insistante et sauvée par les grosses guitares.
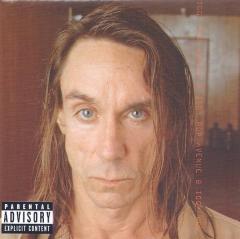
C’est Don Was qui produit Avenue B paru en 1999, avec sur la pochette un très beau portrait d’Iggy le héros. Avec le morceau titre, on retrouve le crooner considérable que l’on sait. Belle chanson aussi que ce «Miss Argentina», en tous les cas, c’est très écrit - She loves me Miss Argentina/ She loves to stay in bad/ And watch the movies play - Iggy renoue avec le génie en tapant une version ultra-violente de «Shakin’ All Over». Comme s’il ramenait la violence dans l’actualité, mais avec une puissance infernale. C’est reptilien, avec des couches d’effets. On sent bien la patte de Don Was. La surprise du disque s’appelle «Corruption». Iggy est capable d’exploser les charnières. On retrouve la folie des Stooges dans sa façon de hurler alors qu’il erre dans le tunnel qui mène à la salle des machines.
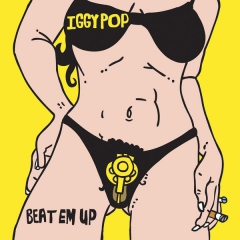
Beat Them Up arrive en 2001 avec une pochette illustrée et un peu ratée. On pourrait l’appeler l’album du son. Iggy l’attaque avec un pur blaster, «Mask». On pourrait qualifier ça de pétaudière de la patate maximale, ou même de mortelle randonnée. Encore plus stoogien que les Stooges. Tout est dans le rouge. C’est un véritable défi aux lois de la physique nucléaire. Iggy a choisi pour cet album le son pilonné d’indus barbare, comme s’il jouait avec Al Jourgensen. Ou encore le son de Killing Joke, mais en plus défenestrateur. Encore une grungerie explosive avec «Howl». Le guitariste s’appelle Whiters Kirst. Avec «Savior», on plonge dans un océan de son en fusion. Iggy adore nager dans l’acier liquide. Il a toujours eu des goûts exotiques. Ce cut est une merveilleuse élégie de la lave sonique. Iggy s’y laisse bercer. Coup de génie avec «Death Is Certain». Le solo liquide semble flotter au dessus des abîmes. C’est absolument grandiose. Iggy pousse des cris alors que la guitare couine et que rougeoient des brasiers étincelants. Pure folie ! Et tout ça va culminer avec «Ugliness» - Bruit de moteur - Ugly ! - Iggy hurle. Voilà le rock de Detroit. Il le prend comme au temps des Stooges. Iggy est le dernier grand rocker d’Amérique. Il perce toutes les lignes. Il chevauche toujours en tête. C’est un vrai chef de guerre. Il y a en lui quelque chose de purement impérial. Sa voix finit par lui échapper - They got the car the money house and all/ But ain’t got no motherfuckin’ balls - Terrifiant !

Paru en 2003, Skull Ring pourrait bien être l’un des meilleurs albums d’Iggy, car c’est une sorte de retour aux sources, c’est-à-dire aux Stooges. Le festival commence avec «Little Electric Chair». Iggy y pousse des cris de jouissance. Forcément, ce sont les frères Asheton qui l’accompagnent sur ce cut et ça claque des mains comme au bon vieux temps de «No Fun». On y retrouve cette façon unique de balancer un yeahhhh. Ron Asheton semble jouer son va-tout. On l’entend aussi partir en solo dans le morceau titre. On se croirait dans un film de Tarentino. C’est un cut frénétique, monté sur le riff ultime. Puis on retrouve les Stooges dans «Loser». Iggy dit qu’il ne peut plus continuer à vivre. Ron joue comme un démon, au gros son suspendu. Il prend un solo oblique qui entre dans le lard du cut comme dans du beurre. Par contre ce sont les Trolls qui accompagnent Iggy sur «Perverts In The Sun», une belle pièce de dementia à la Raw Power, puis sur «Whatever», une espèce de grosse pop épaisse chargée de bonnes doses de destruction massive. Iggy l’éclate aux cris d’orfraie. Il renoue avec le magistère définitif. Ce sont aussi les Trolls qui accompagnent Iggy sur «Blood On Your Cool», mais les ponts sont ratés.
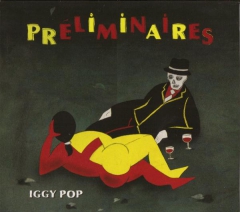
Avec Préliminaires, Iggy commence à taper dans le répertoire des grandes chansons françaises. Il sort son meilleur baryton pour «Les Feuilles Mortes», il swingue à la démesure et sort des trémolos de gras de glotte - Toâ tou m’aimey - Prévert/Kosma : imbattable. Il fait aussi du New Orleans («King Of The Dogs»), du heavy beat sacrément intense («Je Sais Que Tu Sais») et du groove urbain à la cocotte mortelle («Nice To Be Dead»). Il fait aussi du Houellebecq («A Machine For Loving») et du blues de cabane («He’s Dead She’s Alive») qu’il joue lui-même à la guitare, mais ça ne marche pas, même s’il fait son Wolf.
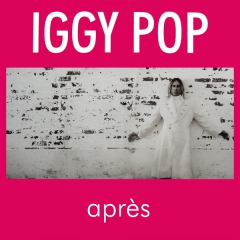
Pour l’album Après paru en 2012, Iggy revient aux chansons françaises, mais attention, il tape dans la crème de la crème. C’est le crooner qu’on entend ici. Il démarre avec le «Et Si Tu N’existais Pas» de Joe Dassin. Oui, il fait là ce qu’il sait faire de mieux : crooner. Pour chaque morceau, Iggy écrit un commentaire. Ici : «But it is still true that in life you meet special people who make it bereable to keep living.» (C’est vrai, dans la vie, il arrive qu’on rencontre des gens qui sachent donner des raisons de continuer à vivre). Bel écho à la chanson du grand Joe. Il tape ensuite dans «La Javanaise». On imagine le carnage. Iggy le prend au croon bien sourd - It is true that without love everything is fucked up but at the same time love is kind of a trick and maybe a problem - Il a une façon extrêmement élégante de nuancer les choses. Il sait que l’amour est indispensable mais que c’est aussi une source de problèmes insolubles. S’ensuit une version magique d’«Everybody’s Talkin’» et il se dit être une combinaison des deux personnages du film dont est tiré cette chanson de Fred Neil - The young stud and the old pimp - Propos incroyablement affectueux. Il profite aussi de l’occasion pour saluer Fred Neil qui vivait aussi à Miami, à deux pas de chez lui. De l’autre côté, il tape dans Brassens avec «Les Passantes», spectaculaire, et dans la magie avec «Syracuse» - The idea of finding love in the joys of the earth. So much more dependable than other people - Iggy est fasciné par la beauté de cette chanson. Il prend «Michelle» au solide groove de stand-up et boucle avec «Only The Lonely» pour rendre hommage à son chanteur préféré, Frank Sinatra. Il avoue avoir passé une grande partie de sa vie seul dans des cafés - This is a musical construction you just don’t hear right now. Ce genre de construction musicale n’existe plus, selon lui.
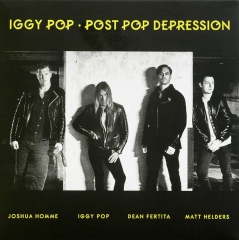
Alors justement voilà ce fameux dernier album, Post Pop Depression, amené par une campagne de presse pour le moins vulgaire. L’album est complètement raté, rempli de cuts de pop gothique qui rappellent les mauvais albums d’Iggy. Il croone, c’est vrai, mais sur des beats profondément antipathiques. «American Valhalla» sonne comme une nowhere song from nowhere land. On traite ici de la profonde inutilité des choses. De quoi disserter jusqu’à l’extinction des feux et des races. Avec «In The Lobby», le pauvre Iggy se perd dans un labyrinthe d’inutilité atroce. Le riff de «Sunday» vient tout droit de «Saturday Night Fever». En B, Iggy fait un joli portrait de vautour avec «Vulture». Ça vaut bien la Charogne de Charles Baudelaire et ça se termine en flamenco. Et puis tout à coup, voilà «Paraguay», le cut qui va sauver l’album du désastre. Iggy revient à sa chère dimension autobiographique et les choses reprennent du sens. Iggy dit qu’il va se tirer au Paraguay, parce qu’il ne peut plus supporter ce monde de dingues qu’est devenu le monde moderne - Just a bunch of people scared/ Everybody’s fucking scared/ Fear eats all the souls at one - Tout le monde a la trouille, la peur dévore toutes les âmes - I’m tired of it - Iggy en a marre de toutes ces conneries et il rêve d’un mode de vie plus simple, sans toutes ces connaissances - And I dream getting away/ To a new life where there’s not so much fucking knowledge - Il parle bien sûr de cette fucking technologie qui envahit les maisons et les vies privées - I don’t want of this information - Il ne veut plus de toutes ces informations qui ne servent à rien, qui aliènent les gens dans le monde entier. Fantastique ! On retrouve là grand Iggy de l’âge d’or.
Signé : Cazengler, Iguanodon empaillé
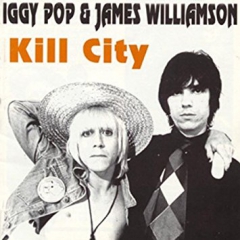
Iggy Pop & James Williamson. Kill City. Bomp! 1977
Iggy Pop. Lust For Life. RCA Victor 1977
Iggy Pop. The Idiot. RCA Victor 1977
Iggy Pop. New Values. Arista 1979
Iggy Pop. Soldier. Arista 1980
Iggy Pop. Party. Arista 1981
Iggy Pop. Zombie Birdhouse. Animal Records 1982
Iggy Pop. Blah-Blah-Blah. A&M Records 1986
Iggy Pop. Instinct. A&M Records 1988
Iggy Pop. Brick By Brick. Virgin America 1990
Iggy Pop. American Caesar. Virgin 1993
Iggy Pop. Naughty Little Doogie. Virgin 1996
Iggy Pop. Avenue B. Virgin 1999
Iggy Pop. Beat Them Up. Virgin 2001
Iggy Pop. Skull Ring. Virgin 2003
Iggy Pop. Préliminaires. Virgin 2009
Iggy Pop. Après. Le Rat Des Villes 2012
Iggy Pop. Post Pop Depression. Caroline 2013
Iggy Pop interview by Gary Graff. Classick Rock #231. January 2017
TROYES / 21 – 01 - 2017
LE 3 B
WHEEL CAPS
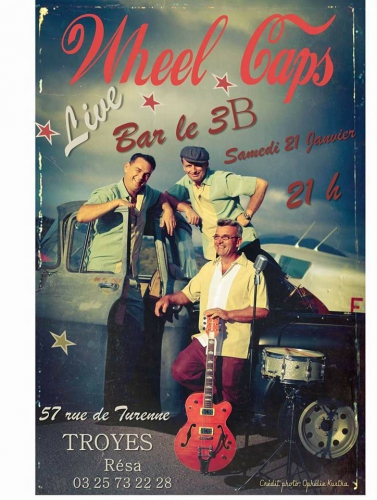
A demain qu'elle a dit Béatrice la patronne. A croire qu'à Troyes les gens se promènent en maillot de bain dans les rues ! Ici à Provins les ours polaires batifolent dans le jardin. J'hésite, mais la teuf-teuf-mobile a des étalons de course dans les pneus. Bien sûr qu'on y va, maugrée-t-elle, pour une fois qu'un combo de rockabilly se pare d'un nom intelligent qui veuille dire quelque chose ! Chapeaux de Roue, ça c'est aussi beau que de la titulature romaine. Que veux-tu les Wheel Caps sont la coqueluche des parkings, il est hors de question de rater un tel événement ! Cette satanée bagnole devine mes désirs les plus profonds, et nous voici au triple galop sur les routes blanches de givre mais au demeurant adhérentes. Et puis on ne mégote pas pour quatre-vingt kilomètres quand le groupe que l'on veut entendre vient du plus profond de la Corse. N'ont pas hésité à traverser la mer eux, rien que pour nous !
Fait bon et chaud dans le 3 B. Le troquet se remplit doucement et sûrement. Des habitués qui savent que les soirées ont la réputation d'être chaudes et quelques nouvelles têtes en attente de sensations fortes. Ne seront pas déçues.
WHEEL CAPS

Trois sur scène. Mais dès les trois premières secondes, l'on n'en entend que deux. Graves, très graves. Cette voix ! Cette guitare ! Les cordes du haut. Fermez les yeux, c'est du Johnny Cash, ouvrez-les c'est François Jandolo. Pas tout seul, trimballe dans sa voix tout le hillbilly des Apallaches. Le rockab, c'est un tiers de hillpilly, en arrière-fond, prêtez l'oreille, les cordes qui meuglent, la voix aussi grasse qu'un sillon de terre glaise, c'est souterrain et souverain, ça explose dans votre tête comme une odeur de foin coupé, un amoncellement d'épis de blé gorgés de soleil, une bouffée délirante d'énergie naturelle, pas pour rien qu'ils débutent par Get A Crazy. Le rockab c'est comme ça, ou c'est tout bon dès le tout début, ou il vaut mieux ne pas en parler. Pas de doute, Jandolo maîtrise. Sûr de lui, campé sur ses deux jambes, des yeux sans cesse aux aguets sous sa banane de renard argenté, l'on pressent que nous sommes en partance pour traquer le puma carnassier des rocky mountains. J'allais oublier ce son devant, pas vraiment une réverbe mais une résonance qui vous emprisonne en ses parois de vitre blindée.

Le hillbilly c'est bien. Mais à condition d'en sortir. Car le rockab, ce n'est pas qu'un tiers de guitare qui ronronne et puis s'affole, c'est aussi un tiers de crazy drive beat. En français nous traduirons par folie déjantée heureuse. Hey Mister Tucker ! Alain Perny se charge des sorties de route du bolide. Celles qui fauchent les spectateurs sur le bas-côté mais selon une courbe si parfaite que vous ne pouvez qu'applaudir. Vous ne pouvez pas le rater, debout derrière ses fût, pas le genre de gars qui se cache à l'affut, vous ne voyez que lui, l'a mis devant lui un micro aussi haut qu'un cou de dromadaire qui hausse la tête pour apercevoir la prochaine oasis, tape debout, dans la grande tradition des frappeurs de caisse claire, pour les feulements de traviole et les reptations accablantes, vous pouvez compter sur lui, un véritable be bop cat, sourire aux lèvres et baguettes stompantes. N'a pas de Perny de conduire mais marque les stops au centième de seconde près. Très importantes dans le rockab, ces brisures de rythmes, qui permettent les doubles reprises d'accentuation positive ou les bifurcations en épingles à cheveux.

Le dernier tiers, aussi nécessaire que la balle au fusil, la fièvre, toute de retenue explosive, la rébellion à fleur de peau, c'est Thierry Daime, un dominant qui surplombe sa contrebasse de bois ciré. Un vénérable engin aussi large qu'une armoire normande, normalement d'un tel monument ne devraient sortir que de lugubres grondements, mais Thierry vous la claque si fort qu'elle aboie, rageuse et swinguante, Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Pas des mièvreries pathétiques de roquet, non des glaviots de rage de mâtin décidé à vous emporter la fesse gauche, rien que pour le plaisir de vous voir boiter.
N'ont pas encore terminé leur deuxième morceau que les Wheels Caps ont gagné la partie. Vous servent le rockab de tradition, servi de main de maître selon une recette personnelle qui ouvre l'appétit. Mais dans la vie personne n'est à l'abri des surprises. Les Caps viennent de nous jeter un Rockin' & Flyin' galvanisant lorsque comme dans la grande tradition des westerns la porte du 3 B s'ouvre brutalement et déboule une horde hurlante d'individus qui fonce droit vers la scène. Serait-ce un remake de L'Impitoyable Revanche des Desperados ? Ah ! Les salauds ! Les enfoirés ! Les traîtres ! Jurons, interjections, embrassades, grandes claques dans le dos, bisous tout doux, sont une douzaine menés par PhiL et Arno des Ghost Highway qui sont venus faire coucou-la-surprise à leurs amis les Wheel Caps !

La soirée était bien partie mais l'arrivée inopinée des Ghost aura apporté un shoot d'adrénaline fort sympathique, un surplus de bulle dans le champagne du rockab. Si vous croyez que cette tapageuse entrée a interrompu le show, que nenni, les Wheels sont le seul groupe que j'ai vu fignoler leur morceau aussi à l'aise et au point que durant une séance d'enregistrement studio et tenir à tour de rôle une conversation des plus animées avec ces double-fêtes. Ce n'est pas qu'ils sont seulement doués, cette aisance d'exécution prouve avant tout leur compréhension intuitive et instinctive du rockab qui s'apparente à une bagarre au couteau. S'agit de suivre les règles, je ne suis pas là pour planter les copains, j'interviens à point nommé dans la musique, un ballet mortel, un peu d'avance, un soupçon de retard et c'est la catastrophe, l'équilibre du château de cartes est rompu, s'agit de se retirer sur la pointe des pieds pour laisser le passage ou au contraire d'intervenir abruptement pour s'engouffrer dans l'entrée du chemin dégagé. Une chorégraphie d'instruments qui se croisent sans jamais se télescoper. Un peu comme dans toutes les musiques objecterez-vous, oui mais il y a dans le rockabilly une sauvagerie innée et une rapidité d'exécution qui exigent une maîtrise sans faille.
Et tout le long de la soirée les Wheel Caps nous feront une démonstration éblouissante de leur virtuosité. Sans jamais se prendre au sérieux. Alain et François qui s'amusent à mimer les figures attendues, je tourne autour de ma basse et j'entrecroise mes jambes dans les tiennes pour faire croire que l'on pourrait tomber. Une autre règle, ne jamais tirer la couverture à soi, je ne m'étends pas dans les solo, ne suis pas là pour briller, mais pour éclairer, je montre ce que je sais faire en douze secondes et je me dépêche de laisser toute la place aux autres. Même pas le temps de recevoir des applaudissements que nous sommes déjà engagés en une autre structure qui nécessite toute l'attention. Alain se chargera du vocal sur Whenever You're Ready, sardonique et cassant, et Thierry exalté et effondré sur All Ican Do que la salle reprend en choeur. Le chant rockab relève de la comédie. Faut savoir être authentique tout en montrant que l'on joue un rôle. Pour Stray Cat Strut, tout le monde s'y met, guitare, contrebasse, batterie et l'assistance entière, nous miaulons à qui mieux-miaou aussi fort que dans la chatterie de la SPA. Le premier set se termine sur trois pépites, I got a Baby de Gene Vincent, gros boulot sur les choeurs, Rock Therapy la grande médication des rockers de Burnette aux Stray Cats, et une Pink Cadillac renversante de Sammy Masters.

L'excitation est à son comble lorsque commence le deuxième set. Pas des chacals, les Wheels, François nous a prévenu d'emblée, il y en aura un troisième. Difficile de choisir, se fondre dans la masse ondulante des agités qui s'adonnent à une danse de saint Guy envoûtante, ou suivre le jeu des Wheels. Pour moi, ce sera les Wheels, pas du tout guindés, plaisantent, échangent avec le public, rigolent, se moquent et dans le même temps nous délivrent un rockab impeccable, pas une faille, pas une hésitation, une interdépendance magnifique, François a beau changer de guitare, garde toujours cette netteté de profilage et de découpage qui trace les contours de chaque morceau avec une terrible précision. Idem pour sa voix qui ne faiblit pas, elle délimite et dessine les plans d'une scrupuleuse netteté. Un Ice Cold a vous donner des frissons de satisfaction dans le dos, un Completey Sweet cochranesque en diable, un Long Black Train à vous jeter sous les roues de contentement. Phil est appelé à la batterie. S'en tire avec aisance le sieur Phil, attitude indolente et rythme assuré.

Ambiance de plus en plus chaude. Ne me restent plus que des flashs. Musique électrique et public branché sur cent mille volts. Ça tourbillonne de tous les côtés. Le troisième set sera démentiel. Thierry couché sur sa contrebasse, François assis sur lui, Alain qui pilonne par derrière. Un Rip It Up à rallonge qui reprend feu juste au moment où l'on croit que c'est fini, un Tennessee Rock'n'roll le vieil hymne fédérateur rockab de Bobby Helms, un Twenty Flight Rock échevelé... Thierry sommé de nous faire couler des larmes de bonheur sur All I can do is Cry... François appelle Eric et lui refile le micro. L'orchestre n'attend plus que les ordres de Duduche qui se lance dans un Whole Lotta Shaking Goin' On de derrière les fagots et de belle facture, l'enchaîne comme un pro sur deux autres titres. Applaudissements nourris. This is the end. Oh non ! Déplorables gémissements dans la salle ! L'est tard, l'on a tiré les rideaux, il ne faudrait tout de même pas exagérer. Mais Béatrice la patronne a pitié de nous, un dernier morceau oui, mais si l'on promet d'être sages après. Nous oui, on a tenu nos promesses, les Wheels Caps non, Phil est appelé en renfort sur les fûts, et Arno est condamné à s'emparer du micro et des voix lui commandent le morceau : Matchbox ! Les Wheels démarent à fond et Arno nous sort le grand numéro, nous la joue chanteur de rock and roll, la pose et le glamour, descend les couplets avec délectation et un impayable accent américain, la star magnanime laisse ses musiciens s'adjuger des ponts aussi vertigineux que le viaduc de Millau, se fige dans des postures grandiloquentes, cabot et cabochard à souhait, brûle toutes les allumettes de la boîte. Bref c'est parti pour dix minutes de pure extravagance. Photos, embrassades finales. Un concert qui se termine sur les chapeaux de roue.

Les Wheel Caps nous ont séduits. De superbes musiciens. Une énergie inépuisable et une grande générosité. De pure rockabilly men. Avec encore un truc en plus. Des artistes chaleureux certes, mais avant tout des individus dignes du grand nom d'êtres humains.

Damie Chad.
( Photo : FB : Béatrice Berlot )
HEY MISTER TUCKER / WHEEL CAPS
GET A CRAZY FEELING / HEY MISTER TUCKER / LITTLE BIT MORE / WHENEVER YOU'RE READY / THE WHORRYIN' KIND / ICE COLD / CENTIPEDE / ALL I CAN DO IS CRY / JITTERBOP BABY / MY ONE DESIRE / ROCKIN' & FLYIN' / RIDING FOREVER / PINK CADILLAC / ZOMBIE SUNDAY
François Jandolo : lead vocal & guitar / Alain Perny : drums & Backing vocals / Thierry Dayme : double bass & backing vocals.
Enregistré par Jull Gretschy
Rock Paradise Records : RPRCD 41 / 2017
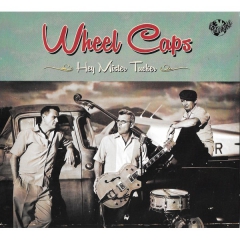
Get a Crazy Feeling : une grêlée de notes de départ qui hache les oreilles et la voix de Jandolo qui s'étend sur ce grésil avec l'indolence d'un serpent qui se chauffe au soleil, la batterie qui tamponne métronomiquement et la contrebasse qui vous offre ce léger décalé rythmique sec comme un vieux croûton de pain oublié au fond de la huche en lequel réside le secret de cette épaisseur sonique qui donne toute son ampleur à ce premier titre qui fleure bon la campagne. Hey Mister Tucker : un original, changement d'ambiance, les boys descendent en ville au volant d'une superbe Tucker 38, roulent à fond et partent en dérapages contrôlés, s'en donnent à coeur joie, l'accélérateur à fond, la voix qui chevauche la compression du moteur. Evitez de traverser la route lorsqu'ils déboulent. Little Bit More : c'est du Labeef pur boeuf, tout en finesse, le vocal qui tressaute, la guitare qui pique et repique, le bonheur de vivre et d'embrasser une fille. Vous reprendrez bien une bise et plus puisque affinités. Whenever You're Ready : Perny au vocal, les syllabes mutines qui traînent, les autres au wap doo wap, au wap doo caps, la guitare qui se paie deux petits sprints et la contrebasse de Thierry qui halète comme un athlète. The Worrying Kind : autant sur Little Bit More le chant évoquait le Temptation Baby de Vincent, ici c'est Cochran qui fournit le pattern et l'accompagnement électrique. Une réussite. Ice Cold : une démonstration de tout ce qu'il faut savoir faire si vous voulez jouer du rockabilly la voix pneumatique qui s'étire comme un chewing gum ou qui se rétracte comme un crotale et les parties fines d'entrecroisement des instruments qui se livrent à des carrousels de haute précision. Centipede : c'était trop beau sur le morceau précédent, alors ils recommencent, en oscillation entre mâchoire claquante et indolence traînante, les empilements de la batterie et le souffle de la contrebasse accentuent cette alliance des contraires, velours râpeux. All I Can Do Is Cry : le Thierry hit, vous fout de ces contreforts de contrebasse sur la rythmique à vous faire sauter le caisson, la batterie d'Alain qui monte les oeufs sur la neige du Kilimandjaro, la guitare de François qui rajoute du sucre acidulé et ce vocal à cheval entre le désespoir le plus noir et la plus fine ironie. Jitterbop Baby : du bop à en revendre, chant collectif, le lead vocal de François ne servant qu'à apporter cette respiration nécessaire au bon déroulement d'un rockab, et puis surtout ces passades d'instruments qui se répondent comme si leur vie en dépendait. My One Desire : dans la famille Burnette donnez-moi le frère Dorsey, procèdent par évaporations successives, chacun se paye la part du lion, l'on appuie et l'on lâche le morceau, le sec et le doux, le cru et le cuit, la guitare qui sonne et tout le reste qui persille en souplesse. De la belle ouvrage. Petit bijou. Rockin' & Flyin' : retour à Eddie, les racines country et l'envol rockab tout en délicatesse. La guitare qui perfore et le chant quasi collectif de cowboys autour du feu. Une petite merveille. Riding Forever : un original, cheval d'acier, roulent sans casque et à fond les gamelles, la voix qui goudronne, les intrus qui arrachent la gomme, ne respectent rien, poignée des gaz convulsive, la guitare s'envole comme l'ange de la mort. Pink Cadillac : ont fauché la tire de Sammy Masters en sont tout fiers, filochent sur le bitume et tricotent serré sur l'asphalte, si vite que François mange les mots et que la contrebasse hoquette sur les reprises mais Alain tient l'accélérateur au plancher, passent si vite que vous n'y voyez que du rose. Zombie Sunday : Diddley Beat, les zombies sont de retour et squattent votre tête douloureuse, tout s'emmêle, la guitare vous picore les méninges comme autrefois le vautour le foie de Prométhée, la rythmique bourdonne et frelonne dans vos synapses, ce qu'il y a de bien avec le rockabilly c'est que l'on adore ces suaves sauvageries.
Vous aimez le rockabilly ? ce disque est un must. Un trou béant dans votre collection. A écouter de toute urgence. Vous n'aimez pas, procurez-le vous, cela vous aidera à entrevoir le monstre en ses ébats et peut-être vous approcherez-vous de l'idée de la perfection. Merci les Wheel Caps. Chapeau, vous avez le droit de faire la roue !
Damie Chad.
THE LIFE AND TIMES
OF GENE VINCENT
56 -59
KENNETH vAN SHOOTEN
( Etit Production )

Tourné depuis une dizaine d'années, publié depuis le mois de février 2016, ce documentaire de cinquante-huit minutes fait depuis une dizaine de jours le mini-buzz chez les fans. Kenneth Van Schooten est surtout connu pour King of Punk dont il a repris les modalités pour cette présentation de Gene Vincent, un patchwork d'interviews de ceux qui furent parmi les principaux protagonistes de la saga tels les survivants bien souvent les membres issus de groupes légendaires, Ramones, Dead Boys, UK Subs...
Le film est destiné au public américain. L'épopée européenne de Gene est à peine évoquée, juste les images de Gene rentrant au pays après la mort d'Eddie Cochran... Un tel parti-pris est des plus compréhensibles. Pour le public américain, la France et l'Angleterre ne sont que des pays de seconde zone et l'Europe un vieux débris aussi respectable que votre grand-père que vous aimez bien, mais de là à passer tout votre dimanche avec lui... Ravalons notre fierté, pour les Amerloques, ce qui compte est born and made in the USA. L'est une autre raison que Johnny Meeks nous dévoile en quelques mots. Les Etats-Unis ont oublié Gene Vincent. De par chez nous il est une figure mythique mais dans les plaines du Nouveau Monde, il a disparu. Dites rock'n'roll et l'on vous cite les noms d'Elvis Presley, de Ricky Nelson, de Little Richard, et de bien d'autres, sauf de Gene Vincent. Et pourtant...
Longue séquence sur Be Bop A Lula. Normal, c'est le début, et aussi le seul déclic qui puisse faire surgir le nom de Gene dans les cervelles américaines. L'occasion de voir Joël Happel disc-jockey de WCMS la radio de Sheriff Tex Davies qui sera le manager de Gene pour un an mais qui empochera la moitié des droits du hit qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires. Une habitude solidement implantée dans les moeurs du showbizz outre-Atlantique. Ken Nelson bien sûr qui présida les séances d'enregistrement. Nous parle de la puissance des Blue Caps et de la pureté de leur son. On ne remerciera jamais assez Ken de n'avoir pas voulu interférer et ramener sa fraise dans le clafoutis, l'a apporté la maîtrise de la technique mais a laissé s'exprimer la créativité du groupe sans chercher à l'amender.
Très naturellement l'on en vient à l'évocation du style de Cliff Gallup. Mainte fois copié, jamais égalé, et hop une pierre en passant dans le jardin de Jeff Beck qui intervient à plusieurs reprises. Cliff qui invente l'ABC ( et tout le reste de l'alphabet ) de la guitare rock and roll et qui au bout d'un an s'en retourne à la maison jouer son petit country & western pépère. Nous sommes au coeur du problème. Chez Gene, la scène prend le pas sur le disque. Tournées épuisantes dans tout le pays, des milliers de kilomètres à parcourir, les musiciens sont vite lessivés. Rapidement ça tourne au défilé chez les Blue Caps, Bill Mack, Bobby Jones, Dude Kahn, remplacent peu à peu Willie Williams, Jack Neal et Dickie Harrell. Ce qui ne signifie pas une baisse de la qualité. Des recrues comme Paul Peek et Tommy Facenda sont même devenus des incontournables de l'anabase transgénique. Nul n'est irremplaçable, Johnny Meeks – merveilleux yeux bleus – hérite du fardeau le plus lourd, alors que Cliff Gallup procédait par plans successifs dument explorés, exposés et explosés de fond en comble, une espèce de dissection musicale qui permet de voir l'ossature, les organes et le cheminement de l'influx nerveux, Johnny Meeks ramasse le faisceau du son, le tresse et vous le sert tout de suite, pressé et électrique. La musique des Blue Caps s'en ressent, moins artiste, mais plus dure, davantage rentre-dedans. Jamais bourrine. Laisse la part au swing. Danse et pétille. La gesticulation des clapper-boys souligne les intonations de la voix de Gene. C'est ici que le montage du documentaire apporte un plus à des images cinématographiques et à des photos mille fois vues et revues par les fans. Donnent une idée de la folie dégagée par les prestations de Gene et de ses garçons qui étaient loin d'être des bleus. L'adjectif crazy revient à plusieurs reprises. Le bon temps, celui de la folie. Les yeux brillent à l'évocation des filles dans les hôtels. Ceux qui parlent sont des hommes âgés, beaucoup ont disparu au cours de la décennie suivante, mais l'on sent le regret de cette belle vie enfuie à jamais. Des trucs à vous tourner la tête. À se croire arrivés, ceux qui pensent à se reposer car les tournées sont harassantes et ceux qui trouvent d'autres propositions plus alléchantes. Oublient que l'on ne quitte pas une équipe qui gagne. Opèrent le mauvais choix. Tommy Facenda avoue qu'il n'a jamais été aussi heureux qu'à cette époque... Gene est au sommet de sa forme, pantalon rouge, chemise blanche finement brodée, veste léopard, veste zèbre, nous en propose de toutes les couleurs, participe à des films, tourne en Australie, tourne au Japon, l'est dans le maelström, sans plan de carrière lui reprocheraient les managers d'aujourd'hui. L'a un autre fou à ses côtés, Eddie Cochran... Dès novembre 1958 les Blue Caps ne sont plus là, Gene continue sur sa lancée, la fuite en avant, direction the old England. Peut-être pour cela que les USA l'ont oublié, inconsciemment lui reprochent-ils peut-être d'avoir déserté... Mais Gene va là où le tourbillon du rock'n'roll l'emporte...
Gene boit, mais n'est jamais soûl. Reste que la blessure à la jambe deviendra avec l'âge de plus en plus difficile à supporter. Des côtés tristes dans ce documentaire. Les séquences dans l'établissement de Country Earl dont l'orchestre The Circle E Ranch Boys fut le vivier de musiciens dans lequel Gene se servit sans vergogne. Scènes touchantes de reprises de vieux morceaux de Gene, stroll pathétique d'un quarteron d'aficionados déglingués. L'on ne devrait pas vieillir. A cette aune, Eddie a eu raison de partir si tôt...
Je ne sais si le documentaire a percuté le public américain. Je n'y crois guère. Le mieux serait peut-être qu'il donnât à un réalisateur le désir de réaliser un biopic sur Gene. Avec ces deux versants, tumultueux et crépusculaire, la vie de Gene se prêterait à une superbe évocation. Il est permis de rêver...
Les fans l'ont déjà vu. Ceux pour qui la figure de Gene n'évoque rien ou si peu, trouveront de quoi grignoter. Pas de sous-titrage.
Damie Chad.
GENE VINCENT
Rééditions Années 60 & 70
DANIEL DETHIOUX
JUKEBOX / 362 -Février 2017
Que du connu. L'article se donne à lire comme un complément au Numéro Jukebox Special Gene Vincent de 2011. Idéal pour les jeunes collectionneurs à la recherche de vieilles éditions françaises. Pour ceux de ma génération, il s'agit d'un souvenir au goût un peu saumâtre. Chouette, ces rééditions des années soixante-dix furent de magnifiques occasions de barrer sur la liste que l'on transportait toujours sur soi de nombreux titres qui nous faisaient défaut ! Mais cela venait trop tard. L'on eût préféré que Gene ait pu bénéficier quelque peu de l'argent dégagé par ce genre d'entreprise. Cela lui aurait sans aucun doute remonté le moral, l'aurait peut-être eu l'impression que la voie sans issue dans laquelle s'étaient engagés les derniers mois de son existence allait bientôt s'ouvrir et laisser entrevoir un nouvel envol. Le sort n'en a pas voulu. L'on peut évidemment chicaner sur les approximations des huit volumes de la série Gene Vincent Story parue chez EMI France, mais ce fut-là un apport musical et documentaire précieux. Même les anglais à l'époque en étaient jaloux. Evidemment il y eut aussi les deux Best of, le Memorial Album orange, la série les Pionniers du Rock, les MFP aux chouettes pochettes expressivement bariolées, le coffret quatre disques...mais tous les amateurs connaissent cela...

Damie Chad.
WHITE TRASH
JOHN KING
( Traduction : Clemence Sebag )
( Au Diable Vauvert / 2014 )
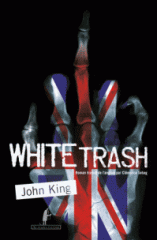
De loin, c'était la même couverture que Skinheads ( voir KR'TNT ! 297 du 06 / 10 / 2016 ), drapeau anglais sur la couverture, mais non, de John King oui, mais pas le même titre, White Trash, j'avais bien aimé le roman sur les Skinheads, mais cette saloperie blanche est beaucoup plus forte. Le même thème, mais traité à la puissance mille. Attention, l'auteur vous prend par la main, enfin vous envoie une blondinette qui joue à Eurydice pour vous emmener visiter les couloirs de l'Enfer. Amis rockers, je suis cool avec vous, vous permets de souffler avant la grande descente, dès les premières pages, la radio – pirate – diffuse Brand New Cadillac de Vince Taylor. Non nous ne sommes pas dans le swinging London des délicieuses sixties et ce n'est pas Radio-Caroline. Je suis gentil, flash back spécial dans les années cinquante, pas n'importe où, à l'Ace Cafe, Gene Vincent chante Race With The Devil, mais Charlie ne reviendra pas avant que le disque se soit arrêté, ni après non plus. Ainsi meurent les rockers... Mais l'intrigue se passe plus tard. Dans les nineties, le roman a été publié en 2002. On a mis du temps à le sortir par chez nous. Quel hasard ! Trop d'intelligence nuit à la santé publique.

John King nous égare quelque peu dans le premier chapitre. L'est en plein dans son sujet, mais parfois l'on vous met le nez dans le caca et vous ne réalisez pas dans quelle merdouille vous êtes. Donc Ruby, pas Baby mais blondinette. Vous la prenez en amitié tout de suite. Coupable de rien mais les flics à ses trousses. C'est elle qui court, les gros porcs la suivent en hélicoptère. N'a pas besoin de vous, parvient à les semer, se fond dans la foule. Plus forte qu'il n'y paraît. John King vous la présente comme une petite fille attardée, elle aime les gâteaux et les bonbons, capable de pleurer vingt ans après sur l'euthanasie de son gros chien, mais elle est plus courageuse que vous ne le croyez, et ne laissez pas échapper un seul détail. C'est monté comme un thriller. Sans en être un.
Ce coup-ci vous met le nez en plein dans la merde. Aucune scatologie. Ruby n'en mange pas, mais elle a les doigts dedans. Infirmière, mais partage aussi le boulot qu'en France on laisse aux filles de salle. Pas jojo. Z'avez intérêt à avoir l'estomac bien accroché. Le sang, le suint, le pus, la pisse, les matières fécales, les malades qui se vident. Faut leur tenir le braquemard pour qu'ils urinent, et extirper la crotte quand elle ne veut pas sortir. Peu ragoûtant. Le pire c'est que Ruby et ses copines ne se plaignent pas. Elles taffent dur, ne font pas semblant. Se soutiennent, s'entraident, se protègent, se marrent bien aussi. Assurent auprès des patients. Chacune selon sa personnalité, la chaudasse, la syndicaliste, la fataliste, et Ruby. Elle, c'est la championne de la positive attitude. Glaireuse formule qui ne recoupe pas ce que d'habitude on désigne par cette expression inventée pour que les humbles se satisfassent du peu qui leur est échu. Pas une imbécile Ruby, vous ne lui ferez pas prendre les vessies de la condition ouvrière pour les lanternes de l'acceptation béate. Peu égoïste, Ruby. Pense davantage aux autres qu'à sa modeste personne. Une véritable vision de classe. N'admet pas tout, n'excuse pas l'inexcusable mais refuse d'être dupe de la bonne conscience du travail personnel bien fait. La majorité des prolétaires agissent comme elle. Avec plus ou moins de réussite mais cela dépend surtout de vos possibilités. La vie est dure et le travail rare. Chômage et misère partout. Petits salaires. Deux ans qu'elle ne peut se payer de vacances, la copine revenue chez sa mère pour nourrir ses gosses, et celle qui fait des extras dans le salon de massages très spéciaux... Ni bien, ni mal. La survie économique. Point à la ligne. L'on n'en conserve pas moins sa dignité. L'important c'est de savoir ce que l'on fait, et d'assumer les raisons qui vous poussent à agir. Tout le monde n'y parvient pas. Alcool, drogue et violence. Beaucoup se laissent glisser dans l'ornière. La jeunesse paie un lourd tribut. Bagarres, viols, vols, Ruby n'excuse pas l'inexcusable mais admet le compréhensible, les coupables ne sont pas les seuls fautifs, le manque d'argent, les familles désunies, l'absence d'affection sont des cocktails explosifs. Dans cette Angleterre post-tatchérienne qui a réduit les syndicats à néant, toute défense collective appartient au passé. Régression sociale tous azimuts. Aucun espoir de changement ou d'amélioration. Vous ne pouvez compter que sur votre jugement, votre fierté. Ruby sourit, ses problèmes certes, mais aussi son réseau d'amis, s'est arrangée une existence qui lui permet de survivre dignement.

Vous l'ai présentée sous son meilleur jour. Mais ne vous bercez pas d'illusion. Retournez au titre. La saloperie blanche, c'est Ruby – normal qu'elle soit occupée à racler le cul des patients, elle est en dans son élément – c'est elle et ses copines, et ses voisins et les habitants de son quartier et ces skins à la tête rasée et ces chômeurs qui passent leur temps au bistrot, toute cette valetaille sous-cultivée, ces désoeuvrés qui s'empiffrent de sodas trop sucrés, de pain de mie pâteux, d'hamburgers graisseux, qui n'ouvrent jamais un livre, qui écoutent de la musique de nègres, qui se tortillent sur des danses dégénérées, qui sentent mauvais, mal sapés, mal coiffés, tatoués, bruyants, irascibles, bêtes et stupides.
Ne les condamnez pas. Oui ils sont ainsi. Peut-être pas tout à fait de leur faute. Pour la plupart mal-élevés, depuis leur petite enfance, vicieux et viciés dès le départ. Que voulez-vous que cela donne par la suite ! Et puis, chacun vit comme il l'entend. Abstenez-vous de juger et de condamner. Après tout chacun est libre. Et si ça leur plaît , de quel droit vous ne seriez pas d'accord ? Pour qui vous prenez-vous ? Cette liberté individuelle n'est-ce pas le fondement de la démocratie ? L'on ne s'est pas battu contre le facisme, l'on n'a pas combattu le communisme pour retomber dans leurs errements ! Le problème ne se pose pas ainsi. Chacun fait ce qui lui plaît, entendu, vive la liberté ! C'est au niveau économique que ça coince. Ces indigents, ces malappris, ces malotrus, ça coûte cher. Très cher. Trop cher. Ne vivent que sur les aides sociales, et quand ils sont au boulot ils rament un max.
J'arrête-là lecteur. Proposez vos solutions. Besoin d'une échelle pour franchir ce mur ? D'un tabouret pour résoudre la contradiction. Vous séchez lamentablement ! Vous êtes vraiment nuls. Vous aussi vous avez besoin que l'on vous mette le nez dans la bouse. Qu'entends-je ? Une bonne guerre ? Méfiez-vous les balles ne sont pas perdues tout le monde. Vous pourriez en être les premières victimes, l'extermination de masse est tout de même antidémocratique.

Bon, petites cervelles obstruées je vous souffle la solution. Pas difficile, tient en trois lettres : IVV ! Ne confondez pas avec l'IGV. IVV comme Interruption Volontaire de la Vie. Comment vous n'êtes pas volontaire ! Parfois je pense que j'ai affaire à des légions d'abrutis ! Mais personne n'est volontaire ! Vous possédez vraiment l'art de raisonner à l'envers. Le volontaire ce n'est pas celui qui ne veut plus vivre, c'est celui qui assure l'interruption. Une profession d'avenir. Pas de chômage à craindre. Le travail ne manquera pas. Et bien payé. Un corps d'élite, de fonctionnaires d'Etat formé à cette noble tâche.
Ah ! Déjà vous levez le doigt, vous êtes volontaire, mais nous n'avons pas besoin de sombres brutes, mais d'individus supérieurement intelligents, pourvu de tact, de doigté, de finesse. C'est qu'il ne s'agit pas de basses oeuvres. Rien à voir avec les pelotons d'exécution de la SS sur le front russe. Non, c'est un dialogue, une ouverture à l'autre, lui faire désirer sa disparition, comme nécessaire, sage, inéluctable.
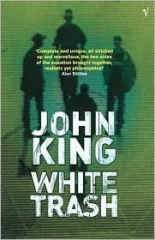
C'est un roman dites-vous. Non une métaphore. Présenté comme ceci, cela ressemble à 1984, mais non, vous n'y êtes pas, ouvrez les yeux, vous côtoyez cela tous les jours, mais vous ne savez pas voir. John King vous prend par la main. Tendrement, avec amour, avec la menotte de Ruby dans votre poigne solide, vous vous laisseriez mener jusqu'au bout du monde, nul besoin d'aller si loin, la réalité est tout prêt de vous. Apprenez à regarder autour de vous, le réel vous colle à la peau, souvenez-vous, c'est votre regard qui sculpte la vision, John King n'est pas un auteur de polar. Ne vous focalisez pas sur l'intrigue, oui c'est un roman mais c'est aussi et avant tout un ouvrage de réflexion, destiné à vous faire réfléchir sur le monde libéral dans lequel vous évoluez. Le plus beau, le plus incisif des livres politiques rédigés sur le sujet. Une analyse sans faille. La moindre fissure cache un gouffre. Méfiez-vous du moindre vernis. Attention, mon résumé est piégeux. Très piégeux. Facile à lire. Difficile à supporter. Humanité de la misère et misère de l'humanité.
Damie Chad.
( Photo : John King interviewé par des lycéennes. France )
13:44 | Lien permanent | Commentaires (0)



