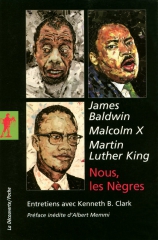11/07/2016
KR'TNT ! ¤ 290 : REAL KIDS / NASHVILLE PUSSY / BLUES STORY / SOUND PAINTING / TROIS NEGRES / MALCOLM X / EDDY MITCHELL
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 290
A ROCKLIT PRODUCTION
14 / 07 / 2016
|
REAL KIDS / NASHVILLE PUSSY / BLUES STORY / SOUNDPAINTING / TROIS NEGRES / MALCOLM X EDDY MITCHELL |
|
AVIS A LA POPULATION KR'TNT ! ferme ses portes. Comme tous les étés. Une véritable catastrophe nationale, mais c'est ainsi. Nous avons aussi une vie secrète sur laquelle nous ne nous étendrons point. Pour le seul plaisir de vous laisser phantasmer. Une lueur d'espoir toutefois pour vous au bout du tunnel de cette longue et terrible nuit dans la noirceur de laquelle nous vous abandonnons sans pitié. Nous serons de retour, fin août dernier jeudi. KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME ! |
LE PORTOBELLO / CAEN ( 14 ) / 30 - 06 - 2016
LE PETIT BAIN / PARIS XIII° / 01 - 07 - 2016
THE REAL KIDS
LE REAL KICK DES REAL KIDS

Ce dernier soir de juin, une petite vague de chaleur semblait ramollir notre bonne ville de Caen. Un petit club situé à proximité du bassin de plaisance accueillait les Real Kids, ce groupe de Boston qui tira son épingle du jeu dans les années soixante-dix grâce à un micro-hit pop-punk intitulé «All Kindsa Girls». Comme la porte vitrée du club bénéficiait d’une ouverture automatique, elle s’ouvrait toute seule si on l’approchait. Il ne manquait qu’une seule chose : un bruitage à la Tati. Croyant qu’il régnait à l’intérieur une chaleur d’étuve, on hésita longuement à entrer. Il fallut bien entrer. Par miracle, il y faisait bon. Et on y servait de la Carlsberg à la pression, ce qui rendit l’endroit encore plus sympathique.
On le sait, la pop est un genre particulièrement ingrat. Des milliers de groupes, dont font partie les Real Kids, s’y sont frottés avec plus ou moins de réussite. Par définition, tous les genres sont difficiles, le garage, le rockab, le rock’n’roll, le blues, le stoner, mais la pop l’est certainement bien davantage, car elle repose sur un pouvoir auquel une infime minorité de gens peut prétendre : le pouvoir mélodique. Tout le monde n’est pas Ellie Greenwich. Ni Dwight Twilley. Ni George Harrison.
De toute évidence, les Real Kids n’ont jamais eu cette prétention. Au pire, ils se contentaient d’adresser un clin d’œil à Buddy Holly, notre cher binoclard texan. Mais le succès (d’estime) de leur pop est resté une énigme digne de celle de Toutankamon. Ils n’avaient pas de son. Quand on réécoute leur premier album aujourd’hui, c’est frappant. Le pauvre Marty Thau qui les produisit à l’époque était notoirement incompétent. Son enthousiasme ne pouvait en aucun cas pallier à une carence productiviste. Marty Thau n’avait pas l’envergure ni l’expérience d’un Shadow Morton ou d’un Jim Dickinson, pour ne citer que les plus connus.

Après le concert, la porte d’entrée automatique du club resta grande ouverte sur la rue. La fraîcheur du soir se fondait dans celle du bar. John Felice traversa le bar à pas extrêmement lents pour aller lui aussi prendre l’air. Cet homme qu’on donnait pour cuit aux patates ne semblait en effet pas très frais. Il affichait un air hagard avec la bouche ouverte, le cheveu long d’un blond délavé, pas peigné, les dents superbement pourries et le regard usé, mais un vrai regard, avec un dessin d’yeux très rond et très doux. L’occasion était trop belle, il se trouvait à moins d’un mètre de distance.
— Hey John !
— Hey....
— You were trouly fantastic !
— Hank ya....
— But it ize criminal the way they prodiouced your ricords !
— Ah...
— You sound far more better on stage zan on ze ricords !
— Ah...
— What is ze title of the last song you played ?
— Reggae Reggae...
— Ah...

Ils firent deux morceaux en rappel, et le deuxième explosa littéralement. «Reggae Reggae» était tout simplement méconnaissable. Ils jouèrent une sorte de brouet psyché-psycho ahurissant et mouliné à coups de gros accords magsitraux. La pop des Real Kids se mit à sonner les cloches du tocsin, ils atteignirent un sorte de démesure et embarquèrent leur public pour Cythère, mais sur un fleuve en flammes. C’était d’autant plus frappant qu’on ne s’y attendait pas du tout. John Felice et Billy Cole mirent en route une mécanique infernale qui valait bien toutes les autres mécaniques infernales, mais avec un fort parfum psyché, quelque chose d’à la fois hypnotique, dévastateur et envoûtant. Ces vieux de la vieille qu’on tenait pour de misérables has-been se mirent à dévorer les âmes et à allumer les lampions sous les crânes. John Felice prit les deux premiers solos et Billy le dernier, dans une sorte d’apothéose. Ce fut une véritable révélation. Un concert sur lequel on ne misait pas cher se transformait en un événement spectaculaire.

Ils étaient en effet montés sur scène sans grand enthousiasme. John Felice se déplaçait très lentement. Il portait un vieux blouson de jean, une chemise ouverte sur un T-shirt improbable. On sentait bien le vétéran de toutes le guerres. D’une certaine façon, il impressionnait. Il brancha sommairement sa Telecaster et annonça une vieille chanson, «Better Be Good».
Ils se mirent à jouer des morceaux qui n’avaient absolument plus rien à voir avec ceux des albums. Ils sortaient sur les deux guitares un son plein et bien gras. Billy Cole jouait sur une Les Paul. Il portait des baskets comme au bon vieux temps et semblait ravi de se retrouver enfin sur scène. John Felice compensait son statisme par une sorte de fulgurance de jeu. On le voyait prendre des solos d’une vive intensité, il triturait des petits phrasés furibards qui basculaient dans le viscéral. On découvrait là un guitariste remarquable. Il jouait des solos sur des accords de bas de manche et taillait sa route avec une maîtrise sidérante. En sortant du solo, il retombait toujours en place pour attaquer son couplet chant. On le croyait ralenti, mais sur scène, John Felice tournait à plein régime. Il était même très spectaculaire. On finissait par prendre sa nonchalance pour de la concentration. Et du coup, leur set devint fascinant, même si on ne connaissait pas bien les morceaux, qui encore une fois, n’avaient plus rien à voir avec ceux enregistrés en studio. Les Real Kids sur scène en 2016 n’ont absolument plus rien à voir avec les Real Kids sur Red Star ou New Rose. C’est le jour et la nuit.

Comme la conjonction des planètes était favorable, on put les revoir jouer le lendemain soir à Paris, sur la fameuse péniche qui accueille désormais les bons groupes de passage en France : Flaming Groovies, Vibrators, Pretty Things, Ash and co. L’idée était de vérifier que le concert caennais ne relevait pas d’une vue de l’esprit. On voulait surtout revivre ce final éblouissant qu’est la version de «Reggae Reggae» en rappel.

Nos amis les Real Kids cassaient la croûte à la cantine du Petit Bain et ce fut un plaisir que de revoir John Felice toujours un peu far-out et Billy Cole toujours aussi délicieusement juvénile. Par contre, il n’y eut pas foule dans la salle. Nous assistâmes exactement au même genre d’arrivée sur scène : pas la moindre trace de frime, pas de roadies, ces mecs arrivèrent avec leur guitares, se branchèrent et commencèrent à chanter, sans transition. Et ça se mit à tourner à plein régime, avec ce son miraculeux, avec cette voix bien posée, et ces départs en solo magnifiques d’efficacité et de virulence. Ce fut un plaisir que de revoir jouer ce guitariste exceptionnel qu’est John Felice.

La version live d’«All Kindsa Girls» ne doit plus rien à celle du premier album, qui sonne comme de la pop frénétique, pour ne pas dire écervelée. La version studio semblait en plus plombée par le bassiste qui jouait sa note en continu. Rien de pire. Il fallait attendre la reprise de «Rave On» pour trouver un peu de viande. John Felice chantait ça avec de la hargne et on avait enfin un truc qui se tenait, avec ses belles montées en wow wow wow - A pretty doggone impressive version, disait Miriam Linna de cette version - On entendait John Felice prendre un excellent solo dans «Better Be Good», et c’était d’autant plus remarquable qu’il embrayait à la ramasse dans l’aiguillage du train fou.

Sur l’album Red Star, on trouvait aussi un cut assez hargneux, «She’s Alright». Ils sortaient les dents et voulaient certainement passer pour des gens dangereux. Mais c’est «Reggae Reggae» qui décrochait le pompon. À l’époque, c’était déjà leur cut le plus percutant. On y entendait même de la friture de distorse.
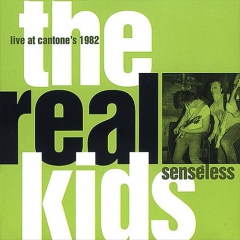
Norton a toujours soutenu les Real Kids. Billy Miller et Miriam Linna n’ont pas lésiné sur les albums live, mais le son n’était hélas pas au rendez-vous. Car si on veut du foutraque, là, on est servi ! Bel exemple avec l’album live «Senseless». Dès l’ouverture du bal, cette petite pop énervée saute dans tous les coins et rue dans les brancards. Ils sautent comme des poux. Avec «Now You Know», ils ramènent de la bonne teigne. Ça gratte, car bien monté sur le collet, et en même temps brouillon et bostonique. «Problems» n’est pas celui des Pistols, mais cette petite pop de jeans serrés qui moulent bien cette burnerie contingente typique d’une époque contrite. La grande différence avec les Ramones, c’est probablement la voix de Joey Ramone qui imposait une identité forte. Il n’existe rien de la sorte chez les Real Kids. Ils sortent un son exorbité. Leur pop se précipite en continu, le son de ce live est beaucoup trop rêche. Il n’y a aucun charme. John chante «Common At Noon» au congrès des arpèges de la pêche aux congres et «She’s Got Everything» vire miraculeusement garage. Mais pour le reste, ça trépigne beaucoup trop. On croirait entendre aboyer des jeunes chiots. Le son de ce live ruine tous leurs efforts. Il faut être fan pour écouter ça jusqu’au bout.

On attend donc un vrai album live, digne de ce qu’on entend en concert. Au bar de l’after-show, des rumeurs circulaient. C’est dingue ce que les rumeurs aiment à se propager. Elles n’ont même besoin de personne en Harley Davidson.
Signé : Cazengler, real de madrid
Real Kids. Le Portobello. Caen (14). 30 juin 2016
Real Kids. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 1er juillet 2016
Real Kids. Real Kids. Red Star Records 1977
Real Kids. Senseless. Live At Cantone’s 1982. Norton Records 2001
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 10 - 03 - 2016
NASHVILLE PUSSY
WHAT'S NEW NASHVILLE PUSSY CAT ?

On aurait tendance à vouloir faire entrer Nashville Pussy dans l’enclos des bourrins, mais franchement, ils ne méritent pas ça. Avant de monter Nashville Pussy, Blaine Cartwright jouait dans Nine Pound Hammer, un quatuor garage punk du Kentucky qui faisait partie de l’écurie Crypt. Normalement, quand on sort trois albums sur Crypt, ça lave de tout soupçon.
Tim Warren était malin comme un renard, car en signant tous ces groupes sur son label, il les anoblissait, d’une certaine manière : depuis les Raunch Hands jusqu’aux les Devil Dogs, en passant par les New Bomb Turks, les Gories, les Chrome Cranks et les Mighty Caesars. Eh oui, on écoutait surtout ces groupes parce qu’ils étaient sur Crypt, ce n’est pas plus compliqué que ça. Et c’est justement la raison pour laquelle on a mis un jour le nez dans les trois albums de Nine Pound Hammer.
Le garage punk pose quand même un sérieux problème : ça tourne assez vite en rond. Il faut aux tenants du genre de sacrés aboutissants, car sinon, on risque de s’emmerder comme un rat mort, pour citer le Professeur Choron. Le garage punk est un genre difficile, éminemment brutal et généralement réservé aux bourrins, ces groupes américains qui prennent un malin plaisir à flirter avec le hardcore. Inutile de citer des noms, tout le monde connaît ces groupes insupportables. Les Nine Pound Hammer sortaient un son tel qu’ils parvenaient à se démarquer. On les vénérait surtout pour certaines reprises des Stones, de Johnny Cash et des Groovies.

Le premier album de Nine Pound Hammer qui s’appelle «The Mud The Blood And The Beers» parut en 1988. Nos quatre Hammer posaient pour la pochette dans une belle lumière orange. En écoutant ce disque, on comprenait pourquoi Tim Waren avait flashé sur ces cul-terreux du Kentucky. Eh oui, avec «Crawdaddy», les Hammer nous balançaient une fantastique pièce de garage délinquante chantée à la mauvaiseté du loubard qui prépare un mauvais coup. On sentait confusément que ces quatre lascars ne risquaient pas d’être rattrapés par la délicatesse. Et avec «Little Help», ils proposaient un petit échantillon de punk rural d’Amérique profonde et quand on parle d’Amérique profonde, ce n’est jamais bon signe. On entend nos quatre Hammer fracasser leurs couplets avec un mépris total des conventions de Genève. Ils refont les Huns du Kentucky avec «Doomsday Poptarts» et se prennent pour les New Bomb Turks, ce qui n’est pas non plus très flatteur. Par contre, on trouve de l’autre côté un «Runaway Train» enthousiasmant, car c’est du garage punk solide. Ils font admirablement bien le train lancé à toute vapeur. On voit qu’ils fonctionnent à l’énergie brute. Ils recrachent plus loin du fiel de punk avec «Bye Bye Glen Frey». Oh on peut dire que ça coule et que ça dégueule. On sent qu’ils déversent un trop-plein et avec «Looking For Somebody», ils sonnent littéralement comme des punks anglais de 77. Ils font bien les oh-oh-oh. Il reste encore une belle pièce à se mettre sous la dent : «Hate To Think», garage-punk toujours, mais cette fois plus incendiaire et même carrément endiablé, saturé de guitares et riffé à la mort du petit cheval blanc d’Henri IV. C’est d’ailleurs un riff des Damned.
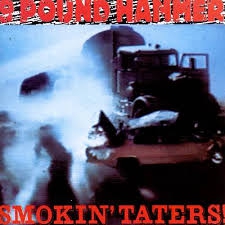
Le deuxième album «Smokin’ Taters» restera dans les annales pour la reprise trash de «Folsom Prison Blues». Nos amis Hammer la jouent plutôt crampsy. C’est bardé de dégoulinures et de petites poussées de fièvre. On les sent particulièrement dévoyés, sur ce coup-là. Mais les autres cuts ont du mal à se faire un nom. «Cadillac Man» restera toute sa vie un garage-punk ulcéré, joué trop vite et trop fort, «Feelin’ Kinda Froggy» restera de la pure Americana barbare, aux antipodes de celle d’un Gram Parsons, et de l’autre côté, «Headbangin’ Stock Boy» restera tout juste digne de figurer sur un album des New Bomb Turks. Ça veut dire ce que ça veut dire.
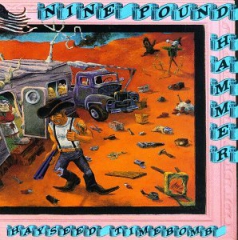
«Hayseed Timebomb» est probablement le meilleur des trois albums Crypt, ne serait-ce que par la classe de sa pochette illustrée qui nous montre le white trash américain dans toute sa splendeur. Le voilà en marcel et en stetson, avec le canon scié sur le bras, devant son trailer rempli de gosses dégénérés. Et c’est lui, Hayseed Timebomb, qui fait l’ouverture du bal avec cette magnifique dégelée de garage punk viandu. Les Hammer racontent son histoire, celle du white trash qui descend en ville - He’s trumbling into town to try to sell his boots/ He spent all his money on a one eyed prostitute - On trouve plus loin le garage punk de la Grande Bouffe : «Run Fat Boy Run» - jack, salmon, gumbo, steak fries, ho hos, catfisf - tout y passe à un rythme échevelé. Nouvelle dégelée définitive de garage avec «Devil’s Playground». Voilà le hit des Hammer, monté sur un riff insistant et joué en distorse maximaliste. De l’autre côté on a «Shotgun In A Chevy» pour se gargariser, pur garage punk d’évidence. On les sent déterminés à vaincre. Wow, quelle bande de brutes épiasses ! Comme on le voit avec «Adios Farewell Goodbye», les Hammer excellent dans les reprises musclées de vieilles country songs, comme on l’a vu avec Folsom. Ils ont deux atouts majeurs : la vélocité et le gras du son. Ils finissent avec «Slam Bag», un vieux coup de garage tradi, avec un son toujours aussi gras et bon.

La bande annonce de «Kentucky Breakdown» paru en 2004 pourrait être : «Oh putain les gars il faut écouter ce disque !», avec un fort accent des barrières, évidemment. Les morceaux de cet album sont tellement énormes qu’ils frisent le génie. Prenez «Rub Yer Daddy’s Lucky Belly», par exemple. Vous êtes là, assis dans votre fauteuil et soudain vous avez ce son qui saute littéralement à la gueule, c’est une anomalie de l’énormité. Blaine et ses acolytes dépassent toutes les bornes possibles et inimaginables. On croit voir surgir les forces des ténèbres du Kentucky, c’est d’une puissance extrême et comme auto-régénérée. Ils cognent dans la panse du beat à coups redoublés. C’est le meilleur gras des moines, je meilleur jus de Jupiter, le meilleur bam de boum. «Dead Dog Highway» sonne comme du garage vorace tenu en laisse. Puissant car battu en pleine carlingue de dingue de frappadingue. On reste dans l’esprit de corps de garde cher au père Blaine le blême. Il revient vous secouer le cocotier avec «Drunk Tired & Mean». Il réussit même à nous balancer une intro à la Heartbreakers, mais sur un tempo un peu plus soutenu. C’est extravagant de son. On a ensuite un «Double Super Buzz» battu à la diable. Mais quand on dit à la diable, c’est à la diable, d’accord ? Et la fête continue avec «Ain’t Hurtin’ Nobody», une belle palanquée d’Absalon Absalon, ça tombe de partout. Ce Blaine est un guitariste monstrueux, il faudrait cesser de le prendre pour un bourrin, ce mec a de la majesté, même s’il adore se gratter les couilles devant les caméras et qu’il perd ses cheveux. Toujours aussi brûlant, «Zebra Lounge». Ces mecs sont des géants de la désaille. Quelle leçon de mise en place ! Encore plus dément : «800 Miles» - Hey Oh hey !- On dirait des matelots et bien sûr c’est bombardé de son, insolent de santé vitale, appelons ça un pounding de génie. Et Blaine nous fracasse d’entrée «If You Want To Get To Heaven», en plein dans les dents du rock, Nine Pound bat la chamade et on a même l’explosion finale avec «Chicken Hi Chicken Lo», ils partent en délire total de miam miam miam miam et perdent la raison. À la fin du cut, on entend Blaine qui tombe des nues. Oh Christ !

Pire encore, voilà «Mulebite Deluxe» paru en 2005. Il s’agit en fait d’une démo de morceaux qu’on retrouvera sur «Smokin’ Taters» et «Hayseed Timebomb». Ils enchaînent les trois reprises définitives qui font la réputation de Blaine et de son Hammer : «Folsom Prison Blues» qu’ils jouent comme une reprise des Cramps - pur génie de la compréhension maximale - «Dead Flowers», avec le son que les Stones ont toujours rêvé d’avoir et «Teenage Head», cover dévastatrice des Groovies époque Roy Loney, l’ultime version. Après celle-là, ce n’est plus possible, car c’est bardé de distorse et hurlé à la vie à la mort, c’est d’une rare insanité, avec un solo en coulis de morve dans la plaie ouverte du trash-punk. Ils reprennent aussi le fameux «Radar Love» de Golden Earing qui leur va comme un gant. Ils y entrent comme dans du beurre, c’est plombé au marteau-pilon, c’est-à-dire au pire drumbeat de l’univers. Leurs cuts valent aussi le détour comme ce «Cadillac Inn» gonflé de la puissance des enfers. Ô imparabilité des choses, quand tu nous tiens... On retrouve la belle santé power-riffique du Hammer. Ils sont bel et bien les tenants et les aboutissants du genre, ils se donnent des cartes pour jouer le poker gagnant. Ils sont aussi puissants que les mauvais dieux viking jadis adorés dans les fjords oubliés des hommes. «Wrong Side Of The Road» sonne comme un hit avec son battage d’accords somptueux et c’est chanté à la charcute divine.

Ouf, par miracle, «Sex Drugs & Bill Monroe» est un album un peu moins dense que les deux précédents. Mais il faut quand même se taper quatre belles énormités, à commencer par «I’m Yer Huckleberry» - Some Kentucky vintage - Peu de groupes peuvent sortir un son pareil. On a là un cut digne des Supersuckers et de Motörhead. On les voit passer par toutes sortes d’états successifs (garage-punk à la Dropkick Murphys, balladif énergétique du Kentucky, rock high energy monolithique à la Hellacopters, trash-balloche, tatapoum extravagant, dérives incendiaires de la cosmic Americana, white trash de caravane, sautillade de garage-punk) puis on tombe en fin de disque sur un enchaînement de trois excellents morceaux. «The Wheels Flew Off Again» file tout droit et Blaine fusille son cut à coups de notes de solo rageur, suivi de «You Ain’t Worth Killing» et de «Cooking The Corn» qui est une merveille absolue grattée à la misérable et montée sur un vieux pied de grosse caisse.
Si vous êtes sage, le petit mec qui tient le mershandising au concert de Nashville Pussy vous fera un prix sur les albums live des deux groupes de Blaine, Hammer et Pussy. On s’en doute, le «Live In Berlin» du 11 septembre 2010 est une bombe atomique. Tout est joué à la puissance maximale, ils sont même capables de faire du Motörhead à la puissance dix sur «Runaway Train». C’est poundé à la folie. On a pétaudière sur pétaudière et au passage on reconnaît les hits comme «Hayseed Timebomb» joué en cavalcade insensée. Peu de groupes vont aussi vite avec une telle puissance. Les Hammer enfoncent le nail. «I’m Your Huckleberry» sonne comme de l’Americana apocalyptique. C’est battu à la Thor. Ils sortent l’un des meilleurs blasts qui se puisse concevoir et «Wrong Side Of The Road» sonne comme un hit dès l’intro. C’est franchement dévastateur. Tout est explosé, cavalé, ravalé, Blaine le blême devient fou avec «800 Miles». Ce n’est pas un blast de pied tendre, vous pouvez me croire. Comment font-ils pour tenir un tel beat ? Here we go et voilà qu’arrive une bombe nommée «Dead Flowers». Décidément, les reprises des Stones leur vont aussi bien qu’aux Lords of Altamont. Et ça continue comme ça jusqu’à la fin avec des exactions comme «Run Fatboy Run» et «Long Gone Daddy» où Blaine le blême pousse un hurlement et alors l’enfer redescend sur la terre.

Le petit mec du mershandising vend aussi un «Wanted» de country classics où traînent quelques belles énormités, comme «One Long Saturday Night», une méchante pétarade. Encore du gros tapé de son. Ils sortent une version country de «I’m Your Huckleberry» montée sur un beat cavaleur qui tourne au tatapoum de la folie. Il faut aussi écouter au moins une fois dans sa vie ce truc qui s’appelle «Drivin’ Nails In My Coffin». Voilà du country punk capable d’incendier un saloon. On goûte là au charme capiteux de la country festive à la Hank III.

Oh, il vend aussi un «Live In Rennes 1998» de Nashville Pussy. Même chose qu’avec Hammer, ça blaste dans tous les coins, et si on l’écoute, c’est surtout pour se régaler des interventions de Ruyter. «Wrong Side Of A Gun» sonne comme l’archétype de la fournaise maximale de heavyness. Rien d’aussi explosif que la version de «Going Down». Ruyter va vite, c’est une bonne et dans «I’m The Man», Blaine le blême pique des pointes stoogiennes dignes de «Raw Power». Terrifiante version de «Go Motherfucker Go», battue à la ramasse du non-retour. Peu de groupes savent ainsi foncer dans le lard du son et quand Ruyter part en solo, les colonnes du temple se mettent à trembler. Tout le monde le sait : Nashville Pussy est avant tout un groupe de scène.

Avec le succès de Nashville Pussy, Blaine Carwright fait désormais partie des poids lourds du rock américain. Il suffit de voir sa compagne Ruyter Suys s’amener sur scène et secouer le cocotier du rock. Avec Donita Sparks de L7, c’est la meilleure rockeuse qu’on puisse voir sur scène actuellement. Elle incarne toute une imagerie du rock, celle du guitariste à crinière qui se fond dans la fournaise d’un stomp avec un solo liquide. Elle ramène tout ce côté visuel qu’on vénérait jadis, les départs en solo d’un Paul Kossof en veste rayée, la crinière en mouvement de Dickie Peterson, la folle gestuelle d’un Jimmy Page, les franges de la veste de Leo Lyons en plein matraquage de basse à Woodstock, la crinière en mouvement de Barry Melton qui s’excitait sur sa Gibson SG, oui elle est tout ça à la fois et même encore plus, car elle n’arrête pas de bouger, de grimacer, de prendre des poses et petite cerise sur le gâteau, elle joue comme une déesse.

Ruyter est une belle femme, et forcément, elle vole le show. Dit autrement, Nashville Pussy n’aurait pas vraiment d’intérêt sans elle. Nashville Pussy passe à Rouen chaque fois qu’ils tournent en Europe et chaque fois, c’est une fête. Oh, il est bien certain qu’ils ne jouent pas des compos sophistiquées. Leur truc reste ce que les anglais appellent du sleaze rock, un rock très sexué et très électriquement gras qui remonte justement à Blue Cheer, à l’Atomic Rooster de John Du Cann et aux Hollywood Brats (et surtout pas aux groupes de la scène californienne des années 80 qui étaient de piètres imitateurs des Dolls). On se régale toujours de voir jouer un groupe bien en place. Pour ça, les Américains déçoivent rarement. Ils s’arrangent toujours pour mettre en avant le côté machine de guerre. Tu veux du rock, gamin ? Tu vas en avoir ! Pendant un peu plus d’une heure, ils ratiboisent tout, et jamais on ne s’ennuie, au contraire, Ruyter Suys s’arrange pour captiver de bout en bout.

On entend même de drôles de commentaires dans les premiers rangs agglutinés au pied de la scène, des trucs du genre ‘J’uis mettrais bien ma bite dans l’cul !’. Il est vrai qu’avec sa réputation ‘cowpunk’ et lingerie, le groupe draine une certaine faune. Mais l’excellence du groupe sur scène balaye tous les mauvais a-prioris. On préfère mille fois voir jouer une belle gonzesse comme Ruyter plutôt qu’un groupe de mecs qui se prennent au sérieux.

Côté albums, on est bien servi. Six albums en 15 ans, c’est un bon rythme.

Avec «Let Them Eat Pussy» paru en 1997, Blaine et son gang dépassent les bornes de la vulgarité. Franchement ils exagèrent. Ruyters et Corey Parks se font bouffer la chatte sur la pochette, ce qui bien sûr a dû attirer pas mal de regards obliques. L’intérieur de la pochette est décoré de photos de scène édifiantes. Corey portait sur le ventre un immense tatouage ailé - comme Asia Argento - légendé Eat Me, et elle crachait du feu sur scène. Cet album n’a rien de révolutionnaire, mais il y a tout de même deux ou trois cuts qui sonnent bien les cloches, à commencer par l’effarant «Snake Eyes» qui cavale à travers les plaines et que Ruyter allume d’un coup de solo stoogien. Ils enchaînent avec un «You’re Going’ Down» digne de Motörhead et noyé de guitares. L’autre énormité cabalistique est le cut de fermeture, «Fried Chicken And Coffee» monté sur le heavy beat de rêve et de rage. Ils sont dans l’excellence du son et quasiment dans les Cramps. Ils visent l’apothéose - Stay out of my yard - Blaine chante à l’horreur profonde de la dégueulade sur le meilleur beat du monde et Ruyter rôde dans la fournaise avec des notes suspendues. Franchement, le spectacle vaut le détour. Ils tapent aussi une reprise du fameux «First I Look At The Purse», mais ça ne marche pas. Ils font pas mal de trash-punk d’énervement maximum sur ce disque, et Ruyter montre de belles dispositions à l’interventionnisme. Elle trouve toujours le moyen de venir se fondre dans la fournaise, ce qui fait d’elle une guitariste exceptionnelle. Au fil des morceaux, Blaine semble vouloir repousser les limites de l’explosivité, et il utilise tout ce dont il dispose, la colère, la bave, la rage, la vitesse, la folie, la brutalité. Ça barde.

En l’an 2000, «High As Hell» s’annonce comme un disque brûlant. Au dos de la pochette, Corey Parks et Ruyter se pavanent sur un lit rouge en forme de cœur. On trouve une fantastique reprise de Rose Tatoo sur ce disque, le fameux «Rock’n’Roll Outlaw». Blaine le chante à la démesure du trash et en sort une version énorme et inspirée. Avec le morceau titre de l’album, on se croirait dans un épisode de Blueberry - Goodbye baby Go to hell - Mais le cut qui emporte la bouche, c’est le «Strutting Cock» d’ouverture, qui sonne comme le rock des vainqueurs, avec ses accords stoniens et la furie du Kentucky. Rien d’aussi dévastateur ! Le cut entre comme le char d’un empereur dans la ville conquise de nos émois pétrifiés. Qui peut s’opposer à ça ? Et Ruyter part en solo pour faire gicler la pulpe. Blaine chante «She’s Got The Drugs» au dégueulé et «Wrong Side Of The Gun» part sur un heavy sludge. Quand ils vont trop vite, ils perdent en efficacité, comme on le constate à l’écoute de «Piece Of Ass», une reprise de Rick Sims, un petit énervé du garage-punk américain qui jouait dans les Digits. On préfère les Nashville dans des choses comme «You Ain’t Right», car c’est battu tout droit par Jeremy, sans retour possible. Ces gens-là ne se retournent pas. Leur obsession est de foncer à travers la plaine en feu. Jeremy bat sec et dru, sans sourciller, alors le groupe fonce sans se poser de questions. Pas de fioritures. Blaine le blême porte sa croix, il est en short, pauvre Christ trash en route pour l’enfer, yeah !
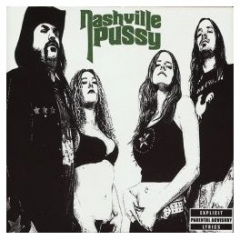
Belle pochette intérieure que celle de «Say Something Nasty», paru en 2002. Nos quatre amis n’ont pas l’air de rigoler. Et Ruyter tape à l’œil, avec son déhanché de rock star. Elle peut se le permettre, au moins chez elle, ce n’est pas de la frime. On l’a vue sur scène, c’est une vraie rock star. Avec le morceau titre, la machine infernale se met en route. Dans ce climat de belle violence, Ruyter glisse un beau solo liquide. C’est un très beau rock à guitares, celui qu’on écoute depuis cinquante ans. Les Nashville sont devenus l’épitome de nasty rock américain, une vraie bénédiction. C’est le son dont on rêve la nuit, surtout que Ruyter est bien devant dans le mix. L’autre merveille de cet album, c’est la reprise de «Rock ‘n’ Roll Hoochie Coo» du grand Johnny Winter. Reprise exceptionnelle, ils sont dessus, Blaine fait son Johnny avec une classe écœurante et il restitue toute la sauvagerie de cet albinos devant lequel se prosternaient les foules. Sur la plupart des morceaux, comme sur «Gonna Hitchhike...», c’est Ruyter qui fait le show avec ses solos dévastateurs. Elle dégringole des rivières de notes, mais de façon puissante et sans appel. Avec «You Give Drugs A Bad Name», ils partent au quart de tour sur des accords saccadés de blues. Ils se montrent merveilleusement efficaces. Avec «Keep On Fucking», ils passent au heavy boogie et Ruyter plonge dans la mélasse pour soloter comme une folle. Même chose avec «Keep Them Things Away From Me», ils reviennent avec un son qui donne le vertige, au meilleur gras et au chant hurleur, avec bien sûr un énorme solo de Ruyter à la clé. Et Blaine le blême screame comme un malheureux tombé dans les pattes de la Sainte Inquisition. Le hit de l’album est probablement «Let’s Get The Hell Outta Here». Ruyter fonce dans les fondements du cut dès l’intro. Elle a tout compris, la fouine. Elle taille son chemin dans les dynamiques du sous-bassement, juste en dessous du chant. Elle sonne comme un franc tireur et file comme le vent. C’est là que s’illustre le génie des Nashville Pussy, dans le gras de la couenne.

C’est Daniel Rey qui produit «Get Some» en 2005. On se souvient de lui comme d’un bel amateur de gras (Dee Dee Ramone, les Misfits, D-Generation, Gluecifer et Joey Ramone, entre autres). Ouverture explosive avec «Pussy Time». Il faut bien dire qu’avec eux, on finit par être habitués à ce genre de procédé. La reprise de l’album, c’est «Nutbush City Limits» d’Ike & Tina Turner. Ils en font une version violente et hurlée. D’ailleurs, tout est violent et hurlé sur cet album, comme cet «Atlanta’s Still Burning». Franchement on se croirait dans Autant En Emporte le Vent, au plus rouge des combats - Atlanta had burned down to the ground/ Oh yeah ! - C’est du garage à la Blaine, sans fioritures. On se régale aussi de ce «Come On Come On» noyé de guitares dès l’intro, joué aux accords claqueurs de beignets, ça sonne comme les Stones, mais en mille fois plus virulent, bien sûr. Dans «Good Night For A Heart Attack», on assiste à une violente montée de température et Blaine bascule comme d’habitude dans les excès - I’m going to a drug fight/ I ain’t coming back - Dommage, ils ont beaucoup de cuts cousus de fil blanc et ils sonnent parfois comme AC/DC, ce qui est loin d’être un compliment. Heureusement que Ruyter la folle rôde dans les buissons. Ils jouent une autre reprise, le «Raisin’ Hell Again» de Scott H. Biram. Ils nous noient ça dans une grosse purée de slide, sur un drumbeat de dieu viking. Ruyter y fait un travail hallucinant.

On sent une sorte de perte de vitesse avec «From Hell To Texas», enregistré en 2009. Si cet album reste dans les annales, c’est uniquement pour le dernier cut, «Gimme A Hit Before I Go» qui est un petit chef-d’œuvre de Stonesy - Wanna drown in the sweet/ Strench of success ah ah - Et Blaine n’en finit plus de décrire son état d’esprit jusqu’au-boutiste - I’d rather do drugs with world famous sluts/ I want the whole world to kiss my butt - Blaine Cartright ne fera jamais dans la dentelle, inutile d’espérer un miracle. On trouve aussi une belle apologie des drogues, «I’m So High», mais il ne peut pas s’empêcher de retomber dans le trash du Kentucky - I’m gonna get wasted in the stratosphere/ And take a shit on the moon - Il n’y a que Blaine pour rêver de chier sur la lune. Autre chanson intéressante : «The Late Great USA» : il y fait l’apologie d’Amsterdam et de Madrid, juste pour faire la différence avec la façon dont on est traité en Amérique. Et puis on se régalera aussi d’«Ain’t Your Business», bien claqué du beignet de crevette, ça plâtre sec au plafond à l’ancienne et ça gicle dans l’œil du cyclope.

Sur «Up The Dosage» paru l’an dernier, on trouve de sacrés clins d’yeux aux Stones et notamment ce fabuleux «Before The Drugs Wear off», soutenu par un gros riffage et du bon vieux pounding hammerien - I got it all I got it all/ So let’s get it on/ Before the drugs wear off - En bonus, ils font une version attaquée à l’acou de cette petite merveille et Blaine chante comme un vieux pirate. On se régale du «Everybody’s Fault But Mine» d’ouverture qui est du pur jus de heavy blues à l’ancienne - Staggering up the montain - un son qui justement nous renvoie aux extraordinaires délires pachydermiques de Mountain. Voilà un cut de rêve, fabuleusement gras et heavy. Just perfect. Ils sortent à peu près la même purée avec «White And Loud». Petite chanson politique avec «The South’s Too Fat To Rise Again» : Blaine s’y moque des gros rednecks - Now we’re having heart attacks from tryin’ to wipe our ass - Ils font pas mal de garage punk, mais ça ne leur va pas bien. Le blues rock leur va bien mieux, comme on le constate à l’écoute du morceau titre de l’album - Gimme more/ gimme more - Blaine ne vit que pour les excès et Ruyter sonne comme Fast Eddie Clarke. Ils finissent avec «Pussy’s Not a Dirty Word», une énormité explosée à coups d’ouvertures interventionnistes combinées de Ruyter et de Blaine. Encore un couple infernal.
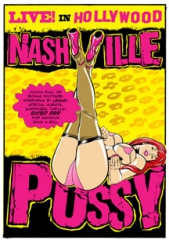
Et ce film ? Idéal pour les inconditionnels. Sur le DVD «Live In Hollywood», on a une bonne heure trente de concert, du gros Nashville avec toutes les pointes de fièvre, mais ce qui fait le charme de ce DVD, ce sont les bonus, eux aussi copieux. Ça commence par des séquences filmées dans des backstages divers lors d’une tournée en France. On les voit faire une balance pour Canal + et on sent tout de suite l’infernale puissance du groupe. Ils tapent en effet dans «Come On Come On». Ruyter porte des lunettes de vue et un sweater gris à capuche, elle prend les deux premiers solos comme sur le disque, et Blaine le troisième. On la voit taper du pied. Elle aime ça, aucun doute là-dessus. Puis on les voit jouer en direct devant les caméras de Canal, et ils sonnent pareil. Ruyter porte un pantalon en vinyle noir et un petit haut noir. Dans une autre séquence filmée en Australie, on les voit sur scène avec Pete Wells de Rose Tattoo. Plus loin, on voit Blaine jammer et travailler des morceaux. Mais la séquence la plus fantastique arrive : Ruyter en studio avec Daniel Rey. On la voit jouer en re-re sur «Nutbush City Limit» et en comprend mieux pourquoi elle est la star du groupe. Elle joue en gras et en continu sur le beat de stomp. Daniel allume une clope pendant que Ruyter joue. Elle est exceptionnelle, colorée, inventive, bluesy. Et la petite cerise sur le gâteau, c’est l’interview de groupe par Lemmy dans le backstage à Hollywood. Extraordinaire séquence de concentré de tomate de mythe. À la fin, Lemmy serre la pince aux quatre Nashville mais Ruyter lui roule une pelle.
Signé : Cazengler, Nashville Poussif
Nashville Pussy. Le 106. Rouen (76). 10 mars 2016
Nine Pound Hammer. The Mud The Blood And The Beers. Crypt Records 1988
Nine Pound Hammer. Smokin’ Taters. Crypt Records 1991
Nine Pound Hammer. Hayseed Timebomb. Crypt Records 1994
Nine Pound Hammer. Kentucky Breakdown. Middle Class Pig Records 2004
Nine Pound Hammer. Mulebite Deluxe. Acetate Records 2005
Nine Pound Hammer. Sex Drugs & Bill Monroe. Buzzville Records 2007
Nashville Pussy. Let Them Eat Pussy. Amphetamine Reptile Records 1997
Nashville Pussy. High As Hell. TVT Records 2000
Nashville Pussy. Say Something Nasty. Artemis Records 2002
Nashville Pussy. Get Some. Spitfire Records 2005
Nashville Pussy. From Hell To Texas. SPC USA 2009
Nashville Pussy. Up The Dosage. SPV USA 2015
Nine Pound Hammer. Wanted. Country Classics.
Nashville Pussy. Live In rennes 1998. Booting The Bootleggers Volume 1. Singing Pig Records 2010
Nine Pound Hammer. Live In Berlin. Booting The Bootleggers Volume 2. Singing Pig Records 2012
Nashville Pussy. Live In Hollywood. DVD Steamhammer 2008
De gauche à droite sur l’illusse : Blaine Cartwright, Karen Cuda, Jeremy Thompson & Ruyter Suys.
BLUES
LES INCONTOURNABLES
( Editions Filpacchi / 1994 )

Encore un mastodonte, format genre diplodocus qui vous oblige à relever le plafond de la maison. Mais quand on l'ouvre, l'on ne regrette pas. D'abord les photos pages de droite qui vous mangent les yeux. Pour la plupart sorties des archives de Jazz Magazine. Du blanc et noir de toute beauté. Ensuite le texte. Ou plutôt les textes car ils s'y sont mis à plusieurs : Philippe Bas-Raberin, Kurt More, Jacques Demêtre, Robert Sacré, Sébastien Danchin, Gérard Herzhaft, Frank Ténot, Véronique Mortaigne, Emmanuel Gimenez, Jean Buzelin, Jacques Périn, Alain Tomas, Francis Hofstein, Philippe Carles, Denis-Constant Martin, François Thomazeau, fines plumes et grands bretteurs qui au siècle dernier ( comme le temps passe ! ) ont été les pionniers des revues qui se sont battus pour introduire le blues, le jazz, et même le rock, en notre pays, en ses larges masses un tantinet réfractaires à ces musiques ensauvagées. Le lecteur assidu de KR'TNT ! se souviendra d'anciennes livraisons dans lesquelles nous avons chroniqué certains de leurs ouvrages. Pour les amateurs nous signalons que Les Incontournables sont une collection de prestige, ils retrouveront, entre un volume consacré au Jazz et un autre dédié à l'Opéra, un opus voué au Rock'n'roll. Qui ne m'est jamais tombé entre les mains, ce que je regrette.

N'y a pas que le rock and roll dans la vie. Ici ça jase de blues. Très bellement. Christian Casoni qui chaque mois dresse dans Rock & Folk le portrait que nous qualifierons de littéraire d'un bluesman a dû s'inspirer du principe. Page de gauche : une évocation sur deux colonnes ( du temple ) d'une des principales figures du blues. L'exercice demande de la précision biographique et du style. Je vous laisse deviner ce qui prime. Ne soyez point béotien dans votre réponse.
Reste la grande difficulté : celle du rangement. Les Incontournables ont contourné la difficulté : ont adopté l'ordre alphabétique. De Texas Alexander à Jimmy Yancey. Pas de jaloux, pas de préséance. Facile de s'y retrouver. Nous avons vu lors de la recension de l'ouvrage Le Blues de Mike Evans comment celui-ci n'évite pas les circonvolutions historiales pour présenter son panorama chronologique. Mais ici l'on a fait l'impasse sur le rhythm and blues et l'on ne s'aventure guère dans la modernité, pas plus loin que Robert Cray, et en général l'on se cantonne aux états du Sud et à Chicago.
Pour le choix des artiste : y sont tous. Sauf ceux qui manquent. Votre outsider n'y sera pas. Tant pis pour vous. Gros lot de consolation : les essentiels connus moins célèbres sont là. Régal des yeux et de l'esprit. Qu'exiger de plus ?
Si la paresse vous étreint d'une poigne léthargique, pages 25-26, rentrez en contemplation devant la magnifique et inquiétante vue des méandres du Mississippi, le vecteur naturel du blues qu'ils disent en légende, ils ont raison, ce sera votre initiation au sortilège hypnotique de la musique du Diable. Vous comprendrez mieux les reptations du muddy crawlin' snake blues. Cette légère incertitude, cette claudication rythmique de la menace du destin qui alourdit votre fragilité existentielle.
Un livre pour rêver.
Damie Chad
SOUNDPAINTING
Un ami est venu passer trois jours à la maison. J'aurais dû le tuer. Non, je ne suis pas méchant. Le méritait. C'est un jazzeux. Tout de suite vous comprenez. J'ai été faible, je l'avoue. Je ne voulais pas non plus perdre mon temps précieux de rocker à éponger son sang impur dans les sillons de mon plancher. Mais en y réfléchissant, je me dis que c'était une injonction kantienne des plus morales. Je regrette. Ne serait-ce que pour l'édification des jeunes générations. Surtout qu'il s'est ouvertement moqué de moi, plié de rire sur le canapé, crachotant une marre de ricanements putrides de hyène. J'étais en train de parler d'un peintre - j'ai oublié le nom - qui réalisait des tableaux durant les concerts des bluesmen auxquels il assistait. Voulant lui en mettre plein la vue avec mes restes d'anglais de sixième lointaine je m'étais risqué à employer l'expression soundpainting ce qui à ma grande surprise avait déclenché son exaspérante hilarité. En plus je me suis enquillé sa professorale explication des plus techniques.
LE SOUNDPAINTING
Rien à voir avec la peinture. Ne vous encombrez de références malvenues style Picasso, Monet, Degas, Malevitch. Le soundpainting c'est un langage de signes pour des gens qui entendent parfaitement. Même que si vous avez l'oreille absolue, c'est encore mieux. Ne foncez pas sur une méthode assimil, il y aurait près de trois mille signes. Une chinoiserie sans fin. D'ailleurs ça peut se pratiquer avec une baguette, mais la main suffit.

Vous avez eu la définition, vous explique le mode d'emploi. Réunissez quelques musiciens de jazz, une vingtaine par exemple, batteur, saxophonistes, trompettistes, tubas, pianiste... et même si aimez innover un joueur de castagnettes. Votre palette sonore est au garde à vous devant vous. Profitez-en pour les agoniser d'insultes, ce sont des jazzmen ne l'oubliez pas, afin de les galvaniser. Maintenant vous commencez votre tableau sonorisé. Chaque musicien, chaque sous-groupe de musicos, possède son signe d'appel. Vous écoute des doigts et de leurs deux yeux, vous leur demandez ce que vous voulez - par signes évidemment - toi le trompette une strette en fa mineur s'il te plaît et maintenant tous les cuivres, espèces de sagouins, modérato expansivo un nappé rutilant... Cela vous donne l'air idiot des transcripteurs des informations en langage de signes pour les malentendants à la télé, en contrepartie vous créez votre concerto à votre guise. Oeuvre collective, ( vous écrirez leur noms en minuscules illisibles sur la pochette ) les musiciens obéissent à vos injonctions digitales mais c'est leur inspiration qui décide de la phrase musicale qu'ils vont jouer, même si vous vous êtes mis d'accord au préalable sur un vieux standard connu de tous dont les harmonies de base limiteront de trop grands écarts.

C'est un certain Walter Thompson qui inventa cette méthode en 1974 à Woodstock ( c'est fou tout ce qui s'est passé dans ce patelin paumé quand on y pense ), depuis elle s'est enrichie par l'adjonction d'autres arts comme la danse. En France c'est François Cotinaud ( voir KR'TNT ! 285 du 05 / 06 / 16 ) qui est le fer de lance de ce mouvement.
Faudra qu'un jour je réunisse les vingt meilleurs rock critics nationaux et je mènerai la première chronique rock en soundpainting de l'univers. D'office le Cat Zengler est désigné pour le titre et la signature finale. Prendra le stylo rouge fluo, celui qui se voit le plus.
Damie Chad.
NOUS, LES NEGRES
JAMES BALDWIN / MALCOLM X
MARTIN LUTHER KING
Entretiens avec KENNETH B. CLARK
( La Découverte / Poche : 2008 )
Soixante-dix pages d'interviewes réalisées par Kenneth B. Clark pour la WGBH-TV chaîne éducative de Boston, entre mai et juin 1963, produites par Henry Morgenthan, comme il s'en explique en une trop courte notule en fin de volume, dans le cadre d'une émission intitulée : Le Noir et la promesse Américaine.
Ces contributions de trois des figures représentatives de la contestation noire furent réalisées entre deux moments importants, l'échec de l'entrevue d'une délégation comportant en son sein James Baldwin avec le Ministre de la Justice et la grande marche sur Washington DC du 28 août de la même année. Mais tout cela est précédé d'une préface d'Albert Memmi qui remet les pendules de la négritude à l'heure. L'a été rédigée en 2007, dix ans après aucun mot n'est à changer. L'esclavage, la ségrégation, la déplorable situation des couches populaires noires, c'est bien. Enfin manière de parler. Mais il ne faudrait pas que l'arbre des afro-américains cachât la forêt des afro-européens. Entendez par ce mot, les populations noires d' une Afrique dont les richesses sont confisquées par les multinationales, résultat de plusieurs siècles de colonisation. N'oublie pas non plus les vagues d'immigration en route vers l'Europe si peu accueillante. Loin de lui l'idée de s'apitoyer sur les pauvres petits gentils noirs tout blancs d'innocence. Dénonce et fustige sans pitié les gouvernements africains gangrénés par la corruption et leurs élites inféodées à la toute puissance du Capital. Ne s'agit pas de pleurnicher des larmes de crocodile pour soulager sa bonne conscience. Le problème n'est pas de constater l'ampleur des dégâts mais de s'opposer dans les faits à toutes ces oppressions.
Que faire ? Comment faire ? Exactement la problématique soulevée par ces trois interviewes. James Baldwin tient le rôle sympathique de l'intellectuel. Le gars compréhensif, aux idées avancées, prêt à discuter pour faire avancer le schmilblick. L'on peut certainement trouver un terrain d'entente. N'est-il pas un démocrate ? Oui, bien sûr. Mais Baldwin ne mâche pas ses mots. Il est trop tard. Les noirs attendent depuis trop longtemps, ils sont victimes de multiples violences, la liste des morts et des assassinats s'allonge sans cesse. Quand on lui demande de se positionner sur le radicalisme de Malcom X et la non-violence prônée par Luther King, il n'est pas plus enthousiaste envers l'un qu'avec l'autre. C'est la violence des blancs qui ont créé Malcolm X, et quant aux bondieuseries de Luther de moins en moins de noirs y croient... La mèche est allumée, il n'y a plus qu'à attendre l'explosion...
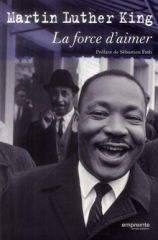
Malcolm X est la froideur orientée. Répond avec précision. Sa vérité toute nue. L'est partisan d'une séparation complète. Les blancs d'un côté. Les noirs de l'autre. Accuse les blancs progressistes et les juifs de phagocyter les associations noires dans le but conscient ou inconscient d'empêcher l'identité noire de s'épanouir pleinement. Se revendique de la rigueur morale de l'Islam. Tout le contraire de Luther King qui se réclame de la non-violence sous-tendue d'humanisme chrétien. Cite Gandhi comme exemple et compte sur l'opinion publique mondiale pour faire céder les blancs.
Kenneth B. Clark ne contredit pas ses invités. Leur pose des questions destinées à exprimer leur position avec un maximum de clarté, Leur permet de retracer leurs parcours, d'expliciter leurs actes, et de préciser leurs idées. L'Histoire se chargera de répondre à sa manière à leur point de vue respectif. Malcolm X sera assassiné en 1965, Martin Luther King sera abattu en 1968, en 1970 James Baldwin sentant le danger se préciser s'installera en France...
Damie Chad
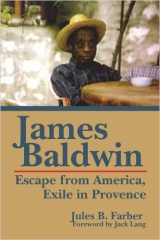
P. S. : je finis cette courte chronique lorsque j'entends à la radio que la maison de James Baldwin à Saint-Paul de Vence a été rachetée par un promoteur pour construire sur son terrain des appartements de luxe... Des militants estiment que ce lieu chargé d'histoire aurait plutôt vocation à devenir un centre de réflexions axées sur les luttes de libération actuelles... Nous leur donnons raison.
MALCOLM X & ALEX HALEY
L'AUTOBIOGRAPHIE
de
MALCOLM X
( GRASSET / 1993 )
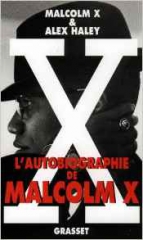
Vaut mieux s'adresser à Satan qu'à ses diablotins. Généralement quand on aborde le cas Malcolm X, soit votre votre interlocuteur expédie le problème d'une pichenette intellectuelle, parlons d'un sujet un peu plus sérieux s'il vous plaît, soit le visage se ferme et vous sentez que votre vis-à-vis a bien un avis positif sur le personnage mais qu'il ne veut pas vous le donner, craignant de froisser vos susceptibilités politiques.
L'est sûr que Malcolm X n'a jamais fait dans la dentelle. N'avait pas des opinions tranchées, mais des certitudes aussi tranchantes qu'une hache d'abordage. En plus, l'a eu la mauvaise idée de périr sous les balles de ses assassins à l'âge de trente-neuf ans alors qu'il abordait une mue intellectuelle des plus intéressantes comme l'explique Daniel Guérin dans une assez longue préface.
Cette autobiographie que Malcolm a dictée à Alex Haley est divisée comme la Gaule de Jules César en grande partie, trois tronçons d'un chemin de vie dont la signifiance finale échappera en partie à son auteur.
ENFANCE

La première moitié du volume est des plus classiques. Corrobore toutes les biographies qui nous retracent la jeunesse d'artistes et d'écrivains noirs américains nés dans la troisième décennie du vingtième siècle. Nous pouvons les résumer en deux mots, misère et racisme. Et violence. Le père de Malcolm Little est un pasteur adepte des thèses de Marcus Garvey qui prônait le retour des Noirs en Afrique, tient des réunions secrètes dans des appartements privés, le petit Malcolm y assiste parfois... Idées jusqu'au boutistes et séditieuses qui ne plaisent pas à tout le monde. Le Klu Klux Klan le menacera de très près avec toute la panoplie des torches et des cagoules. Lorsque l'on retrouvera le père de Malcolm la tête réduite en bouillie et le corps méchamment entaillé par le tramway qui lui est passé dessus, les soupçons se porteront plutôt sur la Légion Noire - organisation raciale et suprématiste blanche - que sur le KKK... Pas d'enquête, la compagnie d'assurance statuera sur un suicide.... Malcolm prétend que ce sont des noirs partisans de l'intégration lente de leur communauté parmi les blancs qui auraient révélé à la Légion Noire le comportement politiquement incorrect de son père.

Tout son enfance et toute son adolescence seront confrontées à la pitié des blancs. Les assistantes sociales qui viennent au secours de cette veuve éplorée mère de huit enfants et qui sous prétexte d'aider placent un à un les rjetons chez des familles qui au moins les nourriront à leur faim... La mère effondrée finira à l'asile...
La suite ne ressemble guère à du Zola, Malcolm est un élève doué, le seul noir de sa classe, les dépasse tous par sa taille et son intelligence, l'est un peu la mascotte de son école, le gentil petit nigger que tout le monde apprécie. Premier désenchantement, un professeur qui lui conseille de viser la profession de menuisier plutôt que celle d'avocat. Sera désormais le pitre doué qui ridiculise les profs ce qui lui vaudra la maison de redressement. Où tout se passera pour le mieux. Le bon garçon qui devient le chouchou de la directrice et de son mari. Pas du tout des tortionnaires. De la discipline, mais l'endroit a un peu l'esprit d'une pension de famille quasi-débonnaire. Malcolm a pour la première fois l'occasion de côtoyer des blancs. Ne sont pas méchants, mais leur opinion sur les noirs est sans appel : des espèces de sous-hommes qui ne sauraient se débrouiller tout seuls, ont besoin de l'attentive compassion des blancs pour marcher droits. De grands enfants.
JEUNESSE

A seize ans se retrouve à Boston chez sa demi-soeur Ella. C'est le moment de gagner sa vie : emploi dans une compagnie de chemin de fer, petits trafics en tous genres, une histoire de fesse qui tourne mal et le voici en 1943 à New York. Une place de cireur de chaussures au Lindy Hop NightClub. Boulot que vous trouvez peu ragoûtant ? Erreur sur toute la ligne. Duke Ellington, Count Basie, Lionnel Hampton, Cootie Williams, Jimmy Lunceford, Johnny Hodges, sont régulièrement au programme. Et puis tous les à-côtés, les pourboires, les billets pour les services rendus : cigarettes de marijuana, petits billets de rendez-vous coquins à remettre en mains sûres, adresse d'établissements spécialisés à glisser au creux de l'oreille... Durant ces années new yorkaises Malcolm s'initie à l'autre face cachée de la ségrégation, les blancs qui baisent les prostituées noires et les gentes dames blanches insatiables à la recherche d'étalons noirs... Révélation de l'hypocrisie sociale. Se fait beaucoup d'argent, boit, fume - tabac et marijuana - le luxe d'une copine blanche, et pour assurer les fins de mois quelques cambriolages avec une bandes de potes.

Ces cinq années de fêtes incessantes se termineront brutalement : tombe stupidement dans un guet-apens tendu par la police chez un bijoutier chez qui il a déposé une belle montre volée pour réparation... Verdict sans appel : dix ans de prison. Aura droit à une remise de peine de trois ans mais ce n'est pas le même homme qui en ressortira.
MILITANT MUSULMAN
Cure de désintoxication, par la force des choses. Se met à lire, à éplucher un dictionnaire et se réapprend à écrire, à maîtriser sa syntaxe. Lui qui a toujours été un beau parleur, goûte les vertus du silence propice à d'intenses réflexions. Ses frères lui ont rendu visite. Ont eu une jeunesse plus sage que la sienne, sont devenus des adeptes d'Elijah Muhammad, dont ils lui laissent quelques brochures. Malcolm intrigué lui écrit et Elijah Muhammad lui répond. Malcolm est subjugué, comment cet homme si important peut-il manifester son intérêt pour un petit délinquant comme lui ? La correspondance ne cessera plus.
L'ennui et la solitude peuvent suffire à expliquer l'improbable. Malcolm a été élevé dans un milieu religieux, le christianisme a été depuis les débuts de l'esclavage une des colonnes vertébrales sur laquelle s'est réalisée une partie de l'identité des communautés noires. Mais cet aspect ne viendra qu'en deuxième position : ce qui l'enchante dans les écrits d' Elijah Muhammad réside en l'implacable analyse effectuée par celui-ci sur les rapports entre noirs et les blancs. En quatre siècles, rien n'a vraiment changé, toutes les évolutions présentées comme des bonds qualitatifs historiques par les blancs ne sont que des leurres. De belles idées en trompe l'oeil sur le papier que la réalité de la situation dément instantanément. Ce sera le cheval de bataille de Malcolm lorsqu'il deviendra le bras droit de Muhammad. L'est un tribun au discours implacable. Les blancs sont des diables, il est inutile de leur courir après. Malcolm en veut particulièrement aux élites noires embourgeoisées qui ont perdu tous les attributs mentaux de leur race. C'est à ces traîtres qu'il réserve ses flèches les plus acerbes.

L'islamisme de Muhammad permet de se démarquer totalement de la communauté blanche. Il modélise par ses obligations et interdits moraux - no sex, pas d'alcool, pas de tabac, s'instruire, consommer noir, bien s'habiller - une régénération de la race noire. Dans les années soixante-dix le mouvement chrétien des re-born n'est pas très éloigné de tels comportements. S'agit d'opérer une révolution intérieure pour s'isoler de la chienlit morale environnante et pour opérer une coupure radicale avec son passé.
Malcolm Little a pris le nom de Malcolm X comme le préconisait son organisation pour ses adhérents. Cette revendication de l'anonymat du X est un rappel que les noirs portent des patronymes qui ne sont pas les leurs, qui leur ont été imposés par les maîtres blancs pour éviter tout rappel malencontreux de leurs provenances africaines.
Durant quatorze ans Malcolm se démène pour faire progresser le mouvement des Black Muslims, en est la figure de proue. De quatre mille adeptes le mouvement passera à quatre cent mille sympathisants, les violentes attaques dont l'organisation est victime dans les médias lui procurent une énorme publicité parmi les couches les plus défavorisées de la population. Malcolm dit tout haut ce qu'elles sont incapables de formuler avec clarté.

Les Black Muslims sont des séparatistes, rêvent d'un territoire sur le sol américain qui leur permettrait de couper tous liens avec les blancs détestés. Ne plus se mêler avec les Diables Blancs devient leur obsession. Se referment sur eux-mêmes comme un oeuf à la coquille incassable. L'adhésion fonctionne comme une coque de protection qui vous permet de vous couper du monde extérieur. Une île qui possède ses garde-côtes. Qui ne servent pas à grand-chose en vient à juger Malcolm. Des milices d'auto-défense nommées Fruit on Islam chargées de protéger les cadres de l'organisation et ses manifestations. Mais en attendant, c'est le mouvement non-violent de Martin Luther King qui mène des actions décisives et qui subit les exactions les plus brutales de la police. Etat de fait d'autant plus insupportable que de nombreux blancs de bonne volonté participent à ses marches de protestation.
Malcolm se trouve pris entre une redoutable contradiction, lui qui hait les blancs, qui déclare haut et fort que tout blanc qui entre dans une organisation noire la corrompt, pense que les Black Muslims devraient s'engager en des confrontations violentes avec les forces de répression. Des révélations sur les amours illicites d'Elijah Muhammad avec ses secrétaires l'incitent à remettre en question la personnalité sacrée du guide suprême... Finira par être exclu de l'organisation.
ULTIMES METAMORPHOSES
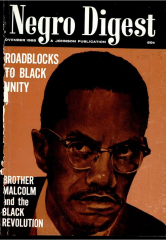
Malcolm est une figure charismatique. L'on attend de lui des directives précises. En son fort intérieur il hésite. Le mouvement qu'il essaie de créer ne mord pas sur les masses. Pour se mettre au clair avec lui-même il participe au pèlerinage de la Mecque. Prend la grande claque de sa vie : les fidèles sont de toutes les races : des blancs, des jaunes, des noirs, tous unis. Tous des êtres humains. Lorsqu'il rentrera il amendera ses principes de base reconnaissant que tous les blancs d'Amérique ne sont pas des ennemis. Sont aussi sincères que lui lorsqu'ils dénoncent le racisme. L'a profité de son voyage pour circuler en Afrique, l'est reçu par de nombreux chefs d'état comme Nasser. Se rend compte que la lutte des noirs américains n'est qu'un sous-ensemble d'un mouvement de revendications économico-politiques qui parcourt la planète. Le monde connaît alors l'acmé du mouvement tiers-mondiste anti-colonialiste.

Son cerveau est en ébullition, l'aspect religieux passe au second plat, se dirige vers un nationalisme noir qui ne serait plus un cocon protectif. Sent qu'il faut déployer celui-ci dans la réalité nationale américaine. Dans sa préface Daniel Guérin affirme que l'étape suivante aurait été celle d'une affirmation d'un combat de lutte de classes révolutionnaire. Nous ne le saurons jamais. Des cocktails molotov sont lancés dans l'appartement familial de Malcolm. pas de dégâts humains, dans un premier temps il accuse l'organisation des Black Muslim. Mais bientôt il pense que le danger vient d'ailleurs. A la prescience de sa fin prochaine. Sera abattu de quinze balles dans un meeting par deux tireurs noirs. L'on ne saura jamais qui étaient les commanditaires. Mais l'on connaît les méthodes de manipulation et d'élimination du FBI et de la CIA...
INTERROGATIONS

Que reste-t-il aujourd'hui de Malcolm X ? Le souvenir d'un homme engagé. Qui n'a jamais hésité à indiquer clairement qui étaient ses ennemis. L'était comme le Seigneur, recrachait les tièdes, préféraient les racistes à la Goldwater qui affichaient leurs idées et volitions raciales sans complexe. Rappelait qu'il n'avait jamais mis les pieds dans les Etats du Sud et qu'il était un américain des Etats du Nord dont il dénonçait avec une extrême virulence l'hypocrisie de leur anti-racisme théorique...
La fascination et l'adhésion dont il fit preuve envers l'islam nous interroge particulièrement quand l'on pense à cet islamisme radical qui embrase les pays du Moyen-Orient et qui ne laisse pas insensible toute une portion non-négligeable de la jeunesse des cités européennes. Il y a sûrement des enseignements à tirer sur cette évidence d'une colère sociale qui se structure selon un radicalisme religieux. Cette constatation étrange aussi que Malcolm fut abattu alors qu'il se rapprochait d'un mode de pensée plus purement politique.
Reste à savoir ce que le mouvement noir américain fera de la figure de Malcolm X dans les années prochaines.
Damie Chad.
IL FAUT RENTRER MAINTENANT
EDDY MITCHELL
avec DIDIER VARROD.
( Editions de La Martinière / 2012 )
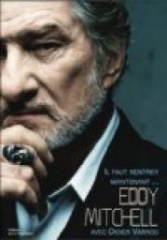
J'ai longtemps été fan d'Eddy Mitchell. Mes années collège surtout. Trente kilomètres en stop pour mon premier concert à Tarascon. En Ariège. En 1968. Deux mille personnes, facile de me reconnaître, dans la bande des quarante excités tellement agités que le public avait organisé un prudent no man's land autour de nous. J'en garde le souvenir d'Eddy sirotant un jus d'orange pendant le solo de J'avais deux amis. Deux ans plus tard j'ai remis le couvert. Ce devait être à Saint Cyprien au bord de la Mare Nostrum. Vous ne pouvez pas ne pas me voir, tout devant de la photo de fausse une de l'Indépendant qui couvre toute la page. Grandiose ! Des milliers de participants. A part qu'aux premiers rangs nous étions près de cinq cents. Une ambiance délirante. Je ne vous raconte pas l'orga débordée qui interrompt Eddy au bout d'une minutes et qui menace d'annuler le concert si nous ne nous calmons pas... Nous étions jeunes et fous. Quarante ans après, toujours aussi jeunes du ciboulot et encore plus fous de rock.
J'aimais bien ses titre rentre-dedans du genre Si tu n'étais pas mon frère je crois bien que je t'aurais tué ou alors ces diatribes à l'emporte pièce contre la religion chrétienne. Puis le père Eddy a doucettement évolué comme on dit pour ne pas employer le verbe régresser. Ai fait l'impasse sur ces insupportables face B blues du blanc déconnecté du blues, l'a adopté en filigrane de ses morceaux un ton désabusé un peu inquiétant. Etait-ce le vieillissement de la trentaine qui s'annonçait ou ce que les esprits pondérés appellent le début de la sagesse ? J'ai longtemps acheté ses disques plus par fidélité à moi-même qu'à Eddy. J'ai définitivement stoppé lorsqu'il a sorti son double CD de génériques de films, d'une tristesse glaçante.

Mais lorsque Mister B m'a proposé le bouquin, je n'ai pas dit non. Pas un véritable livre, une série d'interviewes réalisées par Didier Varrod entre 2010 et 2012. S'achève juste après les adieux... Un coriace le grand Schmall. Ne se livre guère. L'on n'apprend que ce que l'on connaissait déjà. Toutes ces anecdotes qu'il a déjà racontées mille fois à la radio. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Un trait typique de son caractère. Ce qui est fait est fait et il est inutile d'y revenir dessus. L'homme n'a pas d'état d'âme. Ne larmoie pas sur ses regrets. Déteste se vanter. Se préserve des médias, participe le moins possible aux hypocrites comédies de la promotion à tous vents. Est sûr de lui, a la fierté d'assumer sa carrière, l'on sent le gars insensible aux critiques et peu enclin à céder à la fumée des louanges extatiques. Reconnaît ses concessions, les pubs qui comblent les déficits, les tournées dans les pays de l'Est qui remplissent le porte-feuille... Parle un peu avec émotion de ses parents et très peu de sa femme et de ses enfants. Attitude de français moyen, protège sa famille, paie ses impôts sans se plaindre ( ce qui est plus rare ), essaie de bien faire son boulot, et tient un discours sans pitié pour nos élites politiques. Pas un extrémiste, ni un rebelle, quelqu'un qui louvoie avec le Système tout en essayant de garder les mains propres... Refuse de se plaindre, l'a eu un cancer qu'il a terrassé et une vie supérieure à la moyenne de ses concitoyens. L'en est conscient. A tracé une ligne de démarcation - avec points de passage inévitables - entre l'intime personnalité de Claude Moine et le personnage public d'Eddy Mitchell.

Ne regarde point en arrière, se tourne vers son présent. Evoque longuement cette seconde carrière d'acteur de cinéma qui prend le dessus sur celle de chanteur. Sur ce coup-là Eddy m'a beaucoup déçu, lui le passionné de pellicules américaines joue dans cet insupportable cinéma franchouillard qui m'a toujours débecté... Question musique, pas trop à se mettre sous la canine. Ses prédilections premières pour Bill Haley et Gene Vincent. Insiste sur son amitié avec Johnny Hallyday et Coluche, raconte les quatre opérations successives que Claude François infligea à son nez trop long. C'est en cet épisode, et pratiquement pour la seule fois, que l'on a droit à ses saillies ( nasales ) si particulières de son humour pince-sans-rire et coupe-court qui forment d'habitude le fond de ses interventions radiophoniques et télévisées.
Le plus passionnant du livre reste cette confidence de Quinn Ivy, fauché comme les blés, qui réunit ses derniers dollars et envoie sa femme travailler afin de payer les séances studio d'un chanteur noir rencontré dans un bar. Un célèbre inconnu qu'il va coacher car sa chanson : When a Man Loves a Woman lui semble prometteuse. La proposera à Atlantic pour la mettre sur le marché. Jusque là tout va très bien quand survient cette révélation extraordinaire, lui qui a pris tous les risques financier pour Percy Sledge ne l'a jamais laissé entrer chez lui. Un noir invité chez les blancs ? Ne poussez pas la mémé dans les orties !

Honnête et travailleur. Pas de sexe. Pas de drogue. Très peu de rock. L'a arrêté l'alcool et tente de ne plus fumer. Une vie phantasmatiquement peu rock and roll. No mytho-destroy. Les pieds fermement enfoncés dans le goudron des mentalités prolétaires peu sensibles aux sirènes des conduites à risque. N'est pas James Dean, ne vit pas trop vite. Et mourra vieux. Ne nous donne pas envie de rêver. Mais ferons-nous mieux ?
Damie Chad.
22:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : real kids, nashville pussy, malcolm x, eddy mitchell