23/11/2016
KR'TNT ! ¤ 304 : SHARON JONES / BILLY MILLER / OUR THEORY / DAGOBA / FALLEN EIGHT / POGO CAR CRASH CONTROL / SCORES / MANUEL MARTINEZ + MICHELE DUCHÊNE / METAL OBS'
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 304
A ROCKLIT PRODUCTION
24 / 11 / 2016
|
SHARON JONES / BILLY MILLER OUR THEORY / DAGOBA / FALLEN EIGHT / POGO CAR CRASH CONTROL / SCORES MANUEL MARTINEZ + MICHELE DUCHÊNE METAL OBS' |
Sharon la patronne
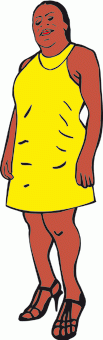
La pauvre Sharon avait réussi à vaincre son cancer. Mais en entendant la nouvelle à la radio, Hadès piqua une crise de colère. Quoi ? Cette conne ne veut pas venir chanter sa Soul dans ma caverne ? Il jeta le poste de radio dans la muraille et l'écrabouilla à coups de talons. Puis il ordonna au grand faucheur de lui ramener Sharon Jones illico presto.
Hadès la voulait pour lui tout seul. Maintenant, il vient de la récupérer. Sacré Hadès ! À son âge, il se comporte encore comme un enfant gâté. Il changera le cours du monde plutôt que le moindre de ses désirs. En attendant, Sharon fait la gueule. La voilà enfermée dans cette caverne, sans sa revue. La voilà obligée de chanter pour ce vieux schnock.
Nous aussi on fait la gueule. C'est une star de la Soul qui disparaît de la voûte étoilée. Pour l'avoir vue sur scène, j'irais même jusqu'à dire qu'elle faisait partie des plus brillantes.
Sharon Jones, c’est Zorrotte ! Elle sort tout droit de la nuit et à la pointe de l’épée, elle signe d’un S qui veut dire Sharon, Soul Queen des temps modernes. Mais attention, elle n’est pas seule. Les Dap-Kings - house-band de Daptone Records - l’accompagnent. Sharon et cette fière équipe ont entrepris de redorer le blason de la soul, la vraie, celle des sixties, et les cinq albums qu’ils ont mis en boîte sont là pour témoigner de leur éclatante réussite.
Comme Dionne Warwick, Sharon fut découverte alors qu’elle faisait des backing vocals. Pas pour Solomon Burke, mais pour Lee Fieds, un funkster contemporain - Oh, qui c’est celle-là ? Fuck ! Elle chante bien ! - Alors, on lui demande de passer devant, de chanter un truc et pouf, c’est parti.
Comme Sharon était devenue ces derniers temps une sorte de bête de foire chouchoutée par la presse institutionnelle, on s’en méfiait instinctivement. Pas question d’aller téléramer dans les salles parisiennes ni d’aller fureter dans les ruines fnacochères. Comme je faisais part de mes réticences à un bon ami, il m’a simplement répondu : Va la voir !
Coup de chance, elle passait dans le coin.

La grande salle du 106 était quasiment pleine. Les Dap-Kings commencèrent par s’installer. Grosse équipe, trois mecs aux cuivres dont un noir, un percu blanc, un batteur blanc, un bassman blanc, et deux guitaristes : Joseph Crispiano qui joue le chef de revue blanche et l’extraordinaire Binky Griptite qui sonne comme le guitariste des Famous Flames. Deux belles blackettes firent irruption. La pulpeuse Starr Duncan dansait comme Aretha dans son restaurant et Saundra Williams nous jerkait le bulbe avec ses magnifiques mouvements de hanches. À elles deux, elles auraient pu faire tout le show, tellement elles groovaient bien. Elles avaient derrière elles un fantastique orchestre digne de la Stax Revue et des Famous Flames. On commençait à retrouver nos marques et ça devenait particulièrement excitant. Elles firent deux ou trois morceaux de r’n’b assez haut de gamme. On se demandait si Sharon allait pouvoir surpasser ses deux choristes. Avec son faux air de Spike Lee, Binky Griptite annonça Sharon Jones et les deux grosses choristes rejoignirent leur place sur une petite estrade, derrière les cuivres.

On vit arriver une petite bonne femme aux cheveux courts, vêtue d’une simple robe bleue. L’anti-diva. Elle mit aussitôt une pression terrible. Ah t’as voulu voir Maubeuge ? T’as pas vu Maubeuge mais la Soul Sister Number One, baby, rien de moins, car ce petit bout de femme tirait son orchestre avec la puissance d’une locomotive à vapeur. Elle dansait, elle shoutait, elle fumait, elle screamait, elle râlait, elle pulsait, il sortait du petit corps rabougri de cette femme toute la vie du monde. Elle ressuscitait en vrac la soul magique de Stax et les diableries de James Brown, avec le même panache et la même énergie, et à certains moments, on allait même jusqu’à se demander si elle n’était pas encore meilleure que tous les autres. Elle jetait dans la balance tout le chien de sa chienne, elle tirait de son ventre une niaque terrible. Elle approchait du bord de la scène et on voyait brûler quelque chose de terrible au fond des ténèbres de son regard. Cette petite bonne femme était littéralement possédée par la grandeur de la soul, comme peut l’être Vigon, mais elle livrait sa version qui est à la fois explosive et primitive. Tout reposait intégralement sur elle. Elle shoutait comme Tina au temps de la Revue et comme Etta James au temps d’Argo, elle faisait Sam & Dave à elle toute seule, elle Pickettait à la vie à la mort et elle Otissait comme la Reine Pédauque. Elle naviguait exactement au même niveau que tous les géants qui ont fait l’histoire de la musique noire américaine. Cette petite bonne femme fonctionnait comme une machine infernale, elle ne s’arrêtait jamais, elle dansait le vaudou des temps reculés, elle vibrait d’imprécations et jetait tout son corps dans la bataille sans aucune retenue, elle enlevait ses sandales, on la voyait se désarticuler en rythme, elle dégoulinait de sueur et elle libérait tous les démons de la Soul. Stupéfiant ! Oui, elle était tellement spectaculaire qu’elle provoquait de l’émotion. Et pas de la petite émotion à trois sous. Non il s’agissait de quelque chose de particulièrement intense qui touchait des zones oubliées du cerveau. Il est important de bien le noter, car c’est assez rare. Je me souviens d’avoir vu un homme âgé en larmes au pied de la scène où chantait Martha Reeves.

Sharon était tellement dans la vie qu’elle faisait monter les gens sur scène pour qu’ils dansent avec elle, d’abord un jeune black avec lequel elle rendit hommage aux dieux africains de la fertilité puis un peu plus tard, une ribambelle de jeunes filles explosées du bonheur de danser avec une star comme Sharon Jones. Et là, on atteignit des sommets, comme lorsqu’Iggy fit monter les gens sur scène pour « No Fun », au temps de la reformation des Stooges avec les frères Asheton. Curieusement, les morceaux lents firent partie de ceux qui agitaient le plus les os du bassin. Ces musiciens groovaient si bien qu’on partait chaque fois au quart de tour. Puis il y eut cet infernal hommage à James Brown qui tint tout le monde en haleine, car Sharon Jones a du génie et tout le monde le sentait. S’installa alors dans l’immense salle une fantastique atmosphère de communion. Puis elle disparût comme elle était apparue, avec discrétion. Ce fut une stupéfiante leçon d’humilité.

Dans une interview, le journaliste demande à Sharon d’expliquer comment elle se prépare avant de monter sur scène. Elle répond : « You just go out and do your best ! ». Tu y vas et tu fais de ton mieux. Elle ajoute qu’elle ne fait pas tout ça pour de l’argent, mais pour l’amour de la musique - You’re not there for the money, you’re doing it for the love of the music - et dans ce cas très précis, on la croit sur parole. Ailleurs dans l’interview, elle confirme qu’elle vient de frôler la mort à cause d’un petit cancer. Mais à présent tout va bien. Sur scène, elle n’avait pas l’air d’une convalescente.
Comme toujours, ce sont les albums qui ramènent aux réalités. Alors avis à tous les amateurs de soul pure : écoutez les albums de Sharon Jones, car c’est du pur jus de juke.

Dap-Dippin’ With Sharon Jones & The Dap-Kings date de 2002. Après une intro monstrueuse, on entre dans le vif du sujet avec « Eat A Thing On My Mind » qui est un r’n’b merveilleusement primitif, dans l’esprit des grooves sauvages d’antan, ceux des Famous Flames et ce n’est pas rien que de le dire. Bosco Mann nous sort une descente de basse digne de Bootsy Collins. Sharon nous tient par la barbichette. Il faut voir comme elle amène son truc ! Arrive un solo de sax en tut-tut et ça bassmatique sec derrière. Deuxième choc soul avec « What Have You Done For Me », étrange pièce de beat transversal, montée sur une architecture moderniste qui s’étend au dessus du monde. Sharon y ramène toute la rage du r’n’b staxy, baby - Oh yeah yeah - le riffing des Famous Flames secoue sérieusement l’ensemble et on sent bien à ce moment précis qu’on écoute le plus gros disque de r’n’b des temps modernes. Encore une occasion rêvée de tomber de sa chaise avec « The Dap Dop », pièce sortie de l’église de la soul orthodoxe. Sharon fait sa James, elle fait sa Miss Dynamite, pas moins. Elle ramène dans notre pauvre époque en voie de rabougrissement la grandeur de la soul américaine, aidée par des coups de basse déments. C’est la soul de juke à l’état le plus pur. Encore une monstruosité funky avec « Got To Be The Way It Is ». C’est une bénédiction de plus pour l’amateur de gros beat. Ce funk mortel sort du larynx d’une sphinxe. On danse avec un manque d’air. Elle défait tout. Son funk se veut furieux, dévastateur et sans répit, comme celui de James à l’Apollo. Pur génie. Elle y revient sans cesse. Elle est imprégnée des deux génies à la fois, celui de James et celui de Stax. Elle est THE function at the junction - All the boogaloo yeah ! - Et ce disque n’en finit plus de vomir des énormités. « Ain’t It Hard » est digne de Sam & Dave, « Pick It Up Lay It In The Cut » revêt les apparats d’une fantastique évanescence de basse funk. Sharon est une femme puissante. Elle explose l’édifice du funk parce qu’elle chante à pleine voix. Si on apprécie James Brown, alors on se prosternera devant Sharon Jones.

Tout aussi agité, voilà son deuxième album, Naturally. Avec « Natural Born Love », Sharon va chercher l’énormité des sons d’antan. Elle renoue avec l’explosivité de la soul des catacombes. Elle fait ensuite un duo avec Lee Fields, « Stranded In Your Love ». On frappe à la porte. Elle demande : « Who is it ? », et une voix de baryton sensuel répond : « It’s me baby ! ». Le mec rentre à la maison. Il explique qu’on lui a volé sa voiture - Somebody stole my car/ Ah just came back - Groove dément à la clé. Ah la garce, il faut voir comme elle nous tord l’oreille. Elle chante avec la pire des inspirations - They stole my heart in Mobile/ Now I’m stranded in your love - Lee Fields fait le rappeur et Sharon s’y met elle aussi. Alors ils font de ce groove de bon aloi une pièce de génie, avec une diction diaboliquement dingue de dureté doomique. On a là un duo d’une invraisemblable modernité. Ils vont au maximum de ce que permet l’art du groove. Lee Fields chante avec toute la grandeur d’action blacky - Now I’m standing in your love - Peu de groovers atteignent un tel niveau. Encore un pur jus de pulsion adéquate dans « My Man Is A Mean Man », qui prend vite les atours d’une belle énormité soufflée à la trompette. Sharon y va et rien sur cette terre ne peut l’arrêter. Comme c’est à tomber, alors on tombe. On est encore une fois confronté au problème de la densité : ne comptez pas sur le répit, car sur ce disque tout est bon. Elle fait une reprise de Woody Guthrie, « This Land Is Your Land », qui devient un groove progressif à la mesure lente, monté sur un beat popotin très décalé et Sharon y va franco de port. S’ensuit un funk de folle, « Your Thing Is A Drag », monté sur une descente de basse dévastatrice. C’est claqué aux cloches de Padoue dans la gadoue du funk et ça devient le temps d’un funk le meilleur funk de l’histoire du funk. Elle est dessus, et c’est réellement stupéfiant. Ils couronnent le tout d’un final astronomique. On n’en finirait plus d’épiloguer sur la classe de Sharon Jones. C’est ça le problème.

100 Days 100 Nights ? Même topo. On prend les mêmes et on recommence. Il faut absolument entendre « Nobody’s Baby » au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour l’intro de basse et l’entrée de Sharon dans le lagon du groove - Ah Ah Ah - Elle le prend admirablement, à la mode de Stax, avec une voix bien fêlée. Elle fait son groove popotin à l’Aretha. S’ensuit un « Tell Me » chauffé aux chœurs et aux gammes de basse. Sharon nous ramène à la maison, c’est-à-dire chez Stax, et nous lui en serons tous éternellement reconnaissants. Elle connaît les arcanes de Stax. Elle groove dans l’or du beat. « Be Easy » est aussi infernal que le reste. Elle attaque encore au timbre fêlé et va chercher l’inaccessible étoile de la soul. Puis elle passe au r’n’b joyeux avec « When The Other Foot Drops Uncle » et nous embarque dans une sorte de Magical Mystery Tour. Elle ponctue à l’onction et elle fait sa Soul Queen d’antho à Toto. Elle est tout simplement juteuse, et même beaucoup plus sexy qu’Aretha. Elle va au Stax avec une classe faramineuse. Elle attaque « Something’s Changed » avec une ardeur sharonnique. Elle se pose bien sur sa voix. Elle groove en demi-teinte et affine toujours plus son art. On a là une pièce de r’n’b des temps modernes arrangée à la caribéenne. Du grand luxe. Elle frise le Doris Troy. Puis elle refait un slow d’Otis, « Humble Me » et on revient ensuite aux monstruosités avec un « Keep On Looking » monté sur un beat qui vaut tout l’or du monde. Elle termine cet album à fumerolles avec un « Answer Me » rampant. C’est staxé à la folie, fantastique de tenue et d’à-propos. Sharon nous mène par le bout du nez et on adore ça.

L’album I Learned The Hard Way recèle une pépite nommée « Money ». C’est une belle pièce insidieuse de groove urbain d’émeute des sens. Sharon le bouffe tout cru, en poussant des cris racés et définitifs. Elle redevient l’espace d’un cut une bête de juke pluridisciplinaire. On trouve pas mal de morceaux groovy sur cet album d’obédience paisible. Sharon ne prend plus de risques avec le beat, « I Learned The Hard Way » repose et « Better Things » sonne comme un groove de plage coconut bien sucré. Sharon adore ces petits airs légers qui sentent bon le bikini vert et la peau hâlée, les bijoux en plastique et les palmes bleues.

On sent encore une petite baisse de régime à l’écoute de Give The People What They Want paru l’an passé. Pourtant le premier cut met bien l’eau à la bouche. Les Dap-Kings embarquent « Retreat » au gros bataclan de soul et de chœurs d’écho vachard. Sharon chevauche sa croupe de soul avec le port altier d’usage et file droit sur l’horizon. Quelle merveilleuse cavalcade de glotte folle ! S’ensuit une autre petite merveille, « Stranger To My Happiness ». Derrière Sharon, ça ronfle dans les trompettes. Elle s’installe une fois de plus au cœur du mythe de la soul sixties, mais elle tape aussi dans l’approche tarabiscotée d’une soul évoluée et elle finit par éclater la coque du beat. « You’ll Be Lonely » sonne aussi comme une bonne vieille soul de fond de cave, une soul effarante de véracité casuistique. Back to the sixties, honey ! Sharon se sent incroyablement proche d’Otis, car « Now I See » sonne comme un hit d’Otis. Mais le reste de l’album est moins spectaculaire. Elle finit avec un vieux coucou étranglé de séduction postiche, « Slow Down Love » et elle se laisse un peu aller, mais qui osera le lui reprocher ?

Soul Time est une autre caverne d’Ali-Baba pour les fervents amateurs de soul music, un disque que vous allez classer à côté de tous les classiques Stax ou Vee-Jay. Cette compile est bourrée à craquer de hits fantasmagoriques. Sharon part en vrille dans le fonk - comme dirait Dr John - avec « Guenine Pt 1 » suivi de « Guenine Pt 2 », swingués jusqu’au coccyx du fondement paradoxal, tel que défini par Paracelse le bienheureux. Ces deux cuts sont de véritables nettoyeurs de conduits auditifs. De véritables aplatisseurs de neurones. Sharon est une bonne, on l’aura bien compris. On a parfois l’impression qu’elle enfonce des clous. Mais en rythme. Elle passe au groove de blues progressif avec l’incroyable « He Said I Can ». Elle prend son truc à l’arracherie soul-queenesque de haut vol. Sharon sait tirer sur une corde, pas la peine de lui expliquer comment on s’y prend. Ça la ferait marrer. Elle ne lâche jamais prise, comme on a pu le constater pendant ses quatre-vingt dix minutes de set sur scène. Cette femme a comme on dit chez les charpentiers de marine la vie chevillée au corps. Et paf, on tombe sur une fucking insanity, « I’m Not Gonna Cry », une sorte de soul tribale issue des forêts inexplorées des hauts plateaux africains. Elle ramène sa fraise avec un aplomb sidérant et derrière elle, les mighty Dap-Kings jouent le fonk à l’Africaine. Wow, baby, ça jerke tout seul dans les godasses. Tout vient des percus. C’est d’une finesse qui honore Gou, le dieu de la guerre et du fer travaillé, et dont la statue en métal ramenée du Dahomey fascinait tant Apollinaire. Gou ne ramène pas sa bobine par hasard, car forcément, quand on parle de Sharon Jones, on parle de mythologie. Elle tient bien sa boutique et ça gri-grite sec autour d’elle. Elle retient ses pleurs - Mmm I’m not gonna cry - Cette diablesse embrase les imaginaires et elle le fait avec une dose de véracité qui emporte la raison. Elle lance ensuite un petit appel à l’insurrection avec « What If We All Stopped Paying Taxes », mais c’est une insurrection à la Mister Dynamite. Voilà bien ce qu’il faut appeler le plus gros fonk politique de tous les temps. C’est une fabuleuse partie de jambes en l’air, de très haut de gamme, si haut qu’on le perd de vue. Les Dap-Kings chauffent le funk jusqu’au point de non-retour, c’est-à-dire la fission de l’atome - Stop corruption and injustice/ It’s up to you ! Awite ! - Sharon charge la barque et ça tangue. Pas le petit tangage du lac des Cygnes, mais plutôt celui du Cap Horn. Puis on sera à nouveau frappé de plein fouet par sa classe, à l’écoute de « Setting In ». Car madame joue la carte du slow torride et elle précipite les danseurs dans des conjonctures d’humidité abdominale. C’est fait pour. Pas la peine de rougir. Elle vole ensuite dans les plumes du r’n’b avec « Ain’t No Chimneys In The Projects », toujours plus fantastique - There ain’t no chimney - Alors elle explose tous nos pauvres concepts et l’artiste apparaît à nu dans toute la gloire de son humanité, comme c’est arrivé à plusieurs reprises sur scène. Il y a quelque chose de divin - en tous les cas de spirituellement supérieur - chez cette petite bonne femme. Lorsque dans ses mémoires, Dr John évoque les spiritual people de la Nouvelle Orleans - les reverend mothers - on pense aussitôt à Sharon Jones. Puis elle revient à l’enfer du r’n’b de choc avec « New Shoes » et elle atteint encore un sommet de la dinguerie. On a tout ce qu’on peut attendre de la vie avec ce cut : le son et la voix. On a aussi le génie de la soul et la pure énergie Stax mais enfoncée au marteau blasteur. Et elle envoie tout valdinguer dans la magie avec « Inspiration Information », un authentique groove de séduction formelle dont on ne peut se détacher. C’est dire si elle est bonne.
 Et puis tiens, vient de paraître un nouvel album, It’s Holiday Soul Party, un album étrange puisque sévèrement privé de hits. Elle salue les pauvres d’Amérique avec « Ain’t No Chimney In The Projects » tiré de l’album précédent. Les projects, ce sont les counci
Et puis tiens, vient de paraître un nouvel album, It’s Holiday Soul Party, un album étrange puisque sévèrement privé de hits. Elle salue les pauvres d’Amérique avec « Ain’t No Chimney In The Projects » tiré de l’album précédent. Les projects, ce sont les counci
l flats américains, autrement dit les HLM. Bosco tente de sauver l’album en prenant « Just Another Christmas Song » au meilleur groove de basse. On se régale vraiment de l’entendre rouler ses notes. Belle prestance. Sharon prend « Silent Night » au jazz blues de Billie. Elle veut montrer par là qu’elle sait jazzer la soul dans la nuit étoilée. Pour les fêtes, Sharon se calme. De l’autre côté se niche « World Of Love », un fantastique balladif de soul, chanté au mieux de ce que permet cet art.
Saura-t-on dire un jour le génie de cette petite bonne femme ?
Signé : Cazengler, Sharon comme une queue de pelle
Sharon Jones & the Dap-Kings. Dap-Dippin’ With. Daptone Records 2002
Sharon Jones & the Dap-Kings. Naturally. Daptone Records 2005
Sharon Jones & the Dap-Kings. 100 Days 100 Nights. Daptone Records 2007
Sharon Jones & the Dap-Kings. I Learned The Hard Way. Daptone Records 2010
Sharon Jones & the Dap-Kings. Give The People What They Want. Daptone Records 2013
Sharon Jones & the Dap-Kings. Soul Time. Daptone Records 2010
Sharon Jones & the Dap-Kings. It’s Holiday Soul Party. Daptone Records 2015
( Cet article précédemment publié dans KR'TNT ! 211 du 20 / 11 / 2014 )
*
Miller’s Crossing
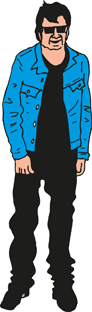
Billy Miller vient de partir en voyage dans le monde des morts. Un chapitre très important de l’histoire du rock se referme avec son départ. Comme Greg Shaw, il avait réussi à suivre la voie royale : celle du fan de rock qui fabrique un fanzine, qui monte un groupe et qui fonde un label. Et pas n’importe quel label, puisqu’il s’agit bien sûr de Norton qui reste avec Crypt et Bomp l’un des labels indépendants les plus prestigieux de l’histoire du rock.
Il est important de rappeler que des gens comme Greg Shaw, Tim Warren et Billy Miller ne visaient pas le profit, à l’inverse des autres acteurs de l’industrie du disque. Ils se livraient à un petit business exclusivement destiné à des fans. Comme les artistes qu’ils défendaient n’intéressaient pas les gros labels, ça leur facilita les choses : en fondant leurs labels respectifs, nos trois héros allaient pouvoir préserver leur singularité et celle des groupes. Dans une vieille interview, le bon Révérend Beat Man rappelle qu’il fonda Voodoo Rhythm tout simplement parce que personne ne voulait publier le premier album des Monsters.

Voilà ce qui rend un label comme Norton si précieux aux yeux des amateurs. Norton incarne cette intégrité qui brille par son absence dans l’industrie du disque. On le sait, l’histoire du rock n’est qu’un invraisemblable chaos d’arnaques et d’intrigues, le paradis des charognards et des sangsues. Les musiciens de rock ont toujours été des proies faciles. Vous en connaissez beaucoup des gens qui sont à la fois guitaristes de rock et docteurs en droit ? Ou fiscalistes ? Pas facile de combiner des domaines de compétences aussi opposés.
Billy Miller a permis aux artistes qu’il signait de vivre correctement et aux oubliés qu’il sollicitait de redémarrer une nouvelle carrière. Qui dit Norton dit Bobby Fuller, Esquerita, Benny Joy, Hasil Adkins et Kim Fowley. Billy nourrissait quelques belles obsessions.
Norton, c’est aussi l’histoire d’un couple : Billy et Miriam Linna, qui fut la seconde batteuse des Cramps, avant de devenir celle des Zantees puis des A-Bones.

Grâce à leur expérience du fanzine, Billy et Miriam prirent l’habitude de bien documenter leurs pochettes de disques qui du coup sont devenues de fabuleuses mines d’informations. Tout ce qu’on veut savoir sur Benny Joy se trouve au dos des cinq volumes d’archives parus sur Norton. Autres mines d’informations : les trois volumes de démos de Charlie Feathers, les deux Rock And Roll Demos des frères Burnette. Encore plus spectaculaire, le gatefold du Slow Death LP des Groovies où pour la première fois Cyril Jordan raconte ses souvenirs. Autre modèle du genre : les quatre volumes de Missing Links consacrés à Link Wray, l’Out Of This World et le Love Bandit de Gino Washington, l’Hully Gully Fever de Rudy Ray Moore, l’Everyday Is A Saturday où est racontée dans le détail toute l’histoire des Dictators, l’Ooh Wee Pretty Baby de Long John Hunter, et ça continue avec les volumes consacrés à Bobby Fuller, les trois volumes de Mad Mike Monsters, les quatre volumes de Lost Treasures From The Vault documentés PAR Kim Fowley en personne, les trois volumes mythiques de la Fort Worth Teen Scene, les NorthWest Killers Vol 1, 2 et 3, les six volumes consacrés à Sun Ra, sans compter les tartines de notes qu’on trouve au dos des innombrables pochettes d’Hasil Adkins, d’Andre Williams ou de Bloodshot Bill. On appelle ça un travail de bénédictin.

Le parti-pris des Zantees était bien sûr le rockab. Leurs deux albums sont non seulement sortis sur Bomp, le label de Greg Shaw, mais ils sont aussi bardés de bon bop et cat music fiévreuse. Out For Kicks est carrément dédié à Ray Smith. L’album s’ouvre sur un « I Thought It Over » solide que Billy shoute comme un cat du Bronx, pas un cat du Brill. C’est l’un des craziest combos in bopdom, nous dit Dog au dos. Oh yeah ! Ils sont bien plus agités que les Stray Cats. Miriam qui a conservé son job de batteuse nous bat ça sec. S’ensuit une fantastique reprise de Gene Vincent, « Cruisin’ ». Les frères Statile font des ravages sur leurs Gretsch. « Francene » ? Zanteequement parlant, c’est parfait. Les frères tactiles en font un épouvantable stormer. Et ils sonnent comme les Cramps dans « Blonde Bombshell ». Voilà le mélange idéal Cramps/rockab que peu de gens savaient manier en ce temps-là. Miriam s’y retrouve parfaitement et Billy Miller se révèle être un fantastique stroumfpheur de jive. En B, ils tapent dans « Please Give Me Something », le vieux classique de Bill Allen. Ils en sortent une version bien plus sourde et plus menaçante que celle de Tav Falco. Miriam le tatapoume en sourdine, derrière les frères Statile si tactiles. Pour « Bessie Mae », Billy va chercher des hiccups à la Charlie Feathers. Miriam fouette bien ses peaux et claque bien son bord de caisse. Puis ils nous boppent « Big Green Car » à outrance et Miriam pulse bien le beat. Franchement, elle bat tout ça à la perfe. En bonne batteuse de rockab, elle ne lâche rien. Pour « Watch My Baby », les frères Statile si tactiles jouent bien sûr le thème de « Train Kept A Rolling » en insistance sous-jacente.

C’est Andy Shernoff qui produit le second album des Zantees, Rhythm Bound. Miriam chante « I Need A Man ». Elle prend sa petite voix de canarde et pousse des cris de folle. On se régale de « Money To Burn », car l’admirable Andy sait comment doit sonner le rockab. Il met bien la percuterie en avant. Il sait que c’est l’esprit de l’Amérique profonde. Billy Hancock vient donner un coup de main sur « Crawded Hole », pur jus de petit rockab new-yorkais. Ah on peut dire que les Zantees adorent rocker. Et Miriam joue bien rebondi. Ils attaquent la B avec un « Ruby’s Place » excellent et passent ensuite un « Fat Gal Boogie » à la Billy Lee Riley. Miriam y pousse d’ailleurs des cris de folle. Ils font aussi une belle reprise d’« I’m Ready » d’Eddie Cochran qu’elle chante à la canarderie de Disneyland. Elle est vraiment poilante. S’ensuit « Gotta Gotta Gotta Be Mine », l’un des rockabs les plus menaçants de l’histoire.
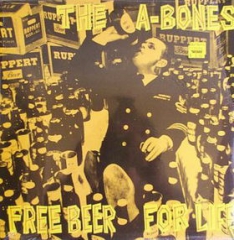
Les Zantees se transforment ensuite en A-Bones, avec quelques changements de personnel. Un premier mini-LP sort en 1988, Free Beer For Life. Bruce Bennett fait désormais partie du groupe. Miriam lance l’assaut d’« A-Bomp Bop ». Elle est complètement excitée et pas forcément très fiable à la mesure. Par contre, le « Mumbo Jumbo » qu’on trouve de l’autre côté est une vraie pépite de garage. Ils sont bien meilleurs lorsqu’ils passent au mambo garage d’exotica.
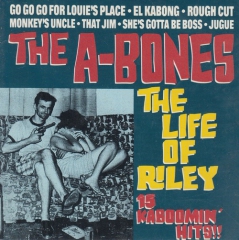
Le premier LP des A-Bones, The Life Of Riley, paraît en 1991. Markus The Carcass a rejoint le groupe, ainsi que le saxophoniste Lars Espensen. C’est un excellent album de rock’n’roll. Billy passe à autre chose, avec « That Jim », il tape dans le garage-rock new-yorkais. Miriam reprend le chant pour « Sham Rock » et fait sa canarde. Ils s’amusent à jouer frénétiquement. Miriam ne change pas sa ligne de conduite, elle joue tout au tatapoum et Bruce Bennett prend des solos bien rocky road. La B est nettement plus solide. Ils commencent par taper une reprise de Doug Sahm, « She’s Gotta Be Boss », et injectent du Tex-Mex dans le son du Bronx. Pure merveille. Ils mettent ce qu’on appelle vulgairement le paquet. « Jugue » est aussi une véritable arracherie. Billy a dû bien s’abîmer la glotte à gueuler comme ça, mais le résultat est intéressant, car ils tapent dans le haut du hot. Ils font une fiévreuse reprise du « Button Nose » de Benny Joy - She’s got a pretty pretty pretty button nose ! - Ils se payent ensuite un balladif du Bronx intitulé « I’ve Fallen » et sortent les chœurs les plus débiles de l’histoire du rock. Miriam revient chanter « Go Betty Go » et elle profite de l’occasion pour pousser de jolis cris d’orfraie. L’honneur de boucler ce bel album revient à Billy qui avec « Go Go Go For Louie’s Place » tape dans le grease du Bronx de bronze.
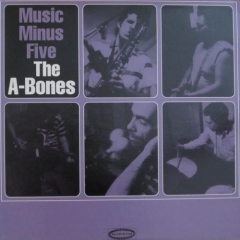
I Was A Teenage Mummy n’est pas le meilleur album des A-Bones, loin s’en faut. Billy y fait beaucoup de boogaloo, sans doute pour les besoins du film. Il drive aussi « Homicide » au plus serré dans les virages. En B, ils tapent dans le vieux « Little Egypt » de Leiber & Stoller dont les Downliners Sect firent leurs choux gras. Et Miriam devient dingue à chanter « Bandstand Rocket ». Comme on dit dans la pègre, elle s’affranchit !

Si on a un faible pour l’album Music Minus Five, c’est sans doute à cause de la reprise du mythique « Bird Doggin’ » qui s’y niche. Ils en font une reprise bien saxée et Miriam la tatapoume comme elle peut. Bruce Bennett gratte ses accords comme un beau diable, ah si seulement Gene Vincent pouvait voir ça ! Mais le solo n’est décidément pas le même. Il manque le génie de la menace instillé par Dave Burgess. Billy et ses potes le stoogent au sax à la fin. Excellente initiative. Dommage que toutes leurs reprises ne soient pas de ce niveau. Avec « You Oughta Know », on a une vraie pépite garage chantée avec la plus extrême des pugnacités. Billy y va franco, il s’arrache tout, le larynx et les cordes. Puis Miriam refait sa canarde dans « Little Bo Pete ». De l’autre côté, elle tape « Come On Come On » au jungle beat. Elle s’en sort admirablement. On est toujours un peu inquiet pour elle, car les A-Bones se montrent parfois ambitieux. Et on dresse l’oreille car Bruce Bennett commence à placer ici et là des killer solos d’antho à Toto. C’est Markus The Carcass qui se distingue dans « Flea Bitten Annie » avec ses infra-basses. Ils bouclent l’album avec une reprise des Groovies, « In The USA », et franchement, ce n’est pas ce que nous avons de mieux en rayon côté Groovies. C’est cousu, beaucoup trop cousu.
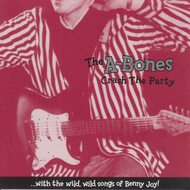
Billy et Miriam adorent Benny Joy, le rockab de Floride : ils ont réussi à remplir cinq albums de cuts et de démos retrouvés dans les archives. Mais ce n’est pas tout. Ils ont aussi enregistré un album de reprises intitulé « Crash The Party », et bien sûr, la pochette reprend en partie la fameuse photo de Benny en veste à rayures et jouant sur une Strato. Si on est fan de Benny Joy, on se régale. Sinon, on reste sur sa faim. « Wild Wild Lover » se résume à un beau burst d’énergie. Miriam prend « Ittie Bittie Everything » au chant sucré et Matt Verta-Ray qui l’enregistre veille au grain du slap. La B est plus solide. Miriam enregistre le morceau titre de l’album à Londres, chez Liam Watson, au Toe Rag studio. Rudy Grayzell intervient sur « Knock Three Times » en roulant des r. Avec « Bundle Of Love », on renoue avec le gros son profilé des Bones. La perle de l’album, c’est bien sûr la version crampsy d’« Hey High School Baby », sertie d’un solo d’antho arabisant. Ils font un fantastique « Call The Zoo » pulsé aux yeah yeah de chœurs et de retours de chœurs. On tombe plus loin sur une version dévastatrice de « Come Back » enregistrée à Seattle, sur le territoire des Sonics, avec Teengenerate dans les parages. C’est enregistré sur un deux pistes, avec un solo de sax et dans la folie pure, comme au temps des Sonics. Ils terminent avec le fameux « Button Nose » chanté au guttural par un Billy en transe.
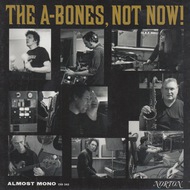
Ils s’inspirent de la pochette de Rolling Stones Now ! pour l’album Not Now ! paru en 2006. Matt Verta-Ray enregistre et Ira Kaplan a rejoint le groupe. Avec « Geraldine », ils sonnent bien sûr comme les Stones de Now ! On note l’énormité du son. « Restless » est joué au sax de corne de brume et embarqué au beat jugulaire de sur-tension. Admirable ! Ils tapent aussi un fantastique « Outcast ». Miriam prend « The Lover’s Curse » au chant et en fait une petite pièce de boogaloo à la sauvette. Avec « Jupiter Bulldog », on retrouve la grosse pulsation de clap-hands et de rythmique fiévreuse à la Stonesy. En B, Ira envoie le shuffle de « Cat Nip ». On tombe ensuite sur un garage-cut d’une rare violence, « Stolen Moments », battu à la diable et au tambourin. Bruce Bennett y prend un solo sauvage à la Dave Davies. Puis Miriam embarque « Bad Times » en cavale de cavalcade insensée. Elle chante du nez et pique des crises superbes. Elle est aussi mal intentionnée que Mary Weiss au temps béni des Shangri-Las. « Don’t Talk About Him » sonne comme un hit des Dictators. C’est une énorme pièce de pop new-yorkaise montée sur une belle mélodie chant.
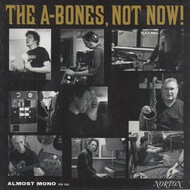
Ears Wide Shut qui vient de sortir fait écho au dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ira la bombe joue toujours dans les Bones et ils démarrent avec une énorme pièce de garage foutraque intitulée « Questions I Can’t Answer ». Ils sonnent comme les Sonics. Phew ! Quel son et Brune Bennett nous bat le nave des accords de Louie Louie. On a la même pétaudière avec « Henrietta ». Billy fait son Esquerita du XXIe siècle. Quelle fournaise ! Retour aux horreurs garage avec « Just A Little Bit Of You ». Bruce Bennett injecte des incursions démoniaques dans la purée puis il part en killer solo, alors que Miriam tapote joliment ses cymbales. C’est Ira la bombe qui chante le « Luci Brains » d’Arthur Lee. Ils terminent cette plantureuse face A avec « Lula Baby », joué à la folie du brasier du Bronx. Ils sonnent vraiment comme les Sonics. Ils attaquent la face cachée avec le beau « Tulane » de Chuck. Plus loin, ils ressortent le vieux beat crampsy pour « Four O’Clock Baby » et ils terminent avec une trépidante reprise des Easybeats, « Sorry », transformée en tourbillon d’ultra-exaction. Billy chante comme un ogre, il bouffe le cut tout cru, et Bruce Bennett joue comme Ross The Boss, à la folie.
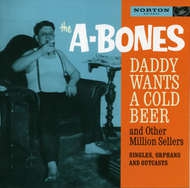
Daddy Wants A Cool Beer And Other Million Sellers paru en 2004 pourrait bien être le meilleur album des A-Bones. Ce double album propose des sessions et des outtakes datant de toutes les époques et on entre là-dedans comme dans un champ de mines. Dire que ce double album est une pétaudière, c’est un euphémisme. La réelle grandeur des A-Bones est de savoir monter des sessions avec des légendes vivantes. On trouve quatre titres fabuleux enregistrés avec Rudi Grayzell dont l’extraordinaire « Judy », puis du pur rockab avec « You’re Gone » - Here we go ! - et aussi « One Mile » dans lequel Rudi fait des brrrrr d’antho à Toto. Sans doute galvanisé par le souffle des A-Bones, Rudi se transforme en pur killer kat. On a exactement le même coup de Jarnac avec Johnny Powers. Les A-Bones l’accompagnent sur deux cuts explosifs « Mano Rock » et « New Spark » que Miriam bat comme une dingue, et c’est rien de le dire. On monte encore d’un cran avec la session Roy Loney et là on tombe sur la huitième merveille du monde, « Stop It Baby », l’un des hits garage les plus dévastateurs de l’histoire, pas compliqué. C’est chanté à deux voix et agrémenté d’un killer solo. Tout y est. On reste dans le génie pur avec « You Know What You Can Do » envoyé au groove ultraïque. Les A-Bones sonnent comme le backing-band idéal de Roy Loney. On a là encore un duettage terrifiant entre Miriam et Roy. Parmi les hommages tétaniques, il y a celui rendu à Bob Luman avec « All Night Long », extraordinaire de vitalité, celui rendu aux Seeds avec « It’s A Hard Life », doté de l’intro de basse de « Looking At You » du MC5, merci Markus, puis ils partent à fond de train dans la Seedy motion et ils nous tartinent ça à la fusion Stoogy de type « Fun House ». Ils font une version beaucoup trop explosive de « Teenage Head » et ils rendent un hommage d’experts aux Troggs avec « You Can’t Beat It » qui est en fait un outtake de leur premier album, The Life Of Riley. Hommage aussi très spectaculaire à Bo avec « We’re Gonna Be Married ». Miriam et Billy s’y renvoient la balle et c’est saturé de son. Pure démence de la partance ma chère Hortense. Billy fait des ravages et s’arrache la glotte au sang avec « Do The Squat » et « Squat With Me Baby ». Miriam bat le « Rock The Beat » au jungle beat des enfers. C’est à se damner. Voilà encore un cut qui vaut tout l’or du monde tellement il est explosé au beat et au sax. Ils rendent aussi un hommage fantastique à Brian Wilson avec un « Drive-In » infernal qu’ils avaient mis en boîte pour le fameux tribute à Brian Wilson, Smiles Vibes & Harmony. Ils rendent aussi hommage à Timoty Carey avec « The World’s Greatest Sinner » et ils profitent de l’occasion pour sortir une horreur rampante. Pas de pire enjôlerie sur cette terre - he’s a winner ! - Miriam se montre d’une incroyable kitscherie avec « Shanty Tramp ». Elle chante ça très pointu, poussée dans le dos par une belle déboulade. On revient au rockab avec un diabolique « Bamboo Rock’n’roll » monté au groove de beat ultimate. Billy invente un genre nouveau : le rockab bulldozer. Miriam enfonce « Spooks A Peppin Theme » à coups de marteau et voilà qu’ils tapent dans l’intapable avec le magnifique « Maintaining My Cool » des Sonics. Ils y vont avec tout le cœur dont ils sont capables. Miriam nous bat ça comme une folle et Bruce Bennett passe un solo d’antho à Toto. Ils font aussi une reprise complètement géniale du « Wah Hey » d’un groupe qui s’appelait les Turbines. Autre hommage de taille : « Guess I’m Falling In Love » du Velvet. En fait, les A-Bones nous font la discothèque idéale. Tellement idéale qu’ils font aussi une reprise de Paul Revere & The Raiders avec un « Louie Go Home » tapé au stomp du Pacific Northwest. Miriam prend « I’m Snowed » à la voix pincée. Elle est complètement folle. Elle flirte avec le génie, comme l’avait fait Hasil Adkins. « Bad Boy » est enregistré dans le studio de Seattle où ont enregistré les Sonics, donc pas la peine de vous faire un dessin. On se relèverait la nuit pour écouter « Take Up The Stack Daddy-O » et « Monkey Man » et ils tapent une fois encore dans le génie avec « A White T-shirt And A Pink Carnation ». Et voilà le travail.
Signé : Cazengler, Billy oui-oui
Zantees. Out For Kicks. Bomp! 1980
Zantees. Rhythm Bound. Midnight Records 1983
A-Bones. Free Beer For Life. Norton Records 1988
A-Bones. The Life Of Riley. Norton Records 1991
A-Bones. I Was A Teenage Mummy. Norton Records 1992
A-Bones. Music Minus Five. Norton Records 1993
A-Bones. Crash The Party. Norton Records 1996
A-Bones. Not Now ! Norton Records 2006
A-Bones. Ears Wide Shut. Norton Records 2015
A-Bones. Daddy Wants A Cool Beer And Other Million Sellers. Norton Records 2004
SAVIGNY-LE-TEMPLE
18 / 11 / 16 – L'EMPREINTE
OUR THEORY / DAGOBA

Juteuse soirée en perspective. La Teuf-Teuf retrouve sa place habituelle à cent mètres de l'Empreinte. Du monde devant l'entrée, la salle sera pleine mais pas bondée. L'on aurait pu s'attendre à davantage avec un groupe de la notoriété de Dagoba.
OUR THEORY
De la théorie à la pratique... Cinq sur scène. Batteur encapuchonné. Mettent le paquet dès la première seconde. Le chanteur désarticulé telle une marionnette et les trois guitaristes à l'unisson. Le lion royal qui rugit pour vous avertir qu'il est prêt à vous dévorer tout cru dans la minute qui suit. Puis va se recoucher tranquille. Content de vous avoir impressionné. Certes il se bat encore les flancs de sa queue et agite sa crinière en baillant comme un oriflamme de guerre. Au bout d'un moment vous n'avez plus peur. Vous préfèreriez que le fauve s'avance vers vous la bave dégoulinant de ses crocs, une lueur meurtrière au fond de ses prunelles. Mais non, c'est le contraire qui se passe. Sourit de toute sa gueule. S'il était un tigre mangeur d'hommes on l'entendrait ronronner. Promettent beaucoup, par à-coups. A peine vous ont-ils éructé un de ces riffs qui couperait un arbre en deux, le chanteur s'inquiète pour nous. Une véritable mère qui a lu un précis de psychologie de positive attitude. Nous caresse dans le sens du poil. Savigny un public exceptionnel, nous remercie de l'ambiance, c'est vrai qu'ils sont bien reçus et perçus avec sympathie, mais n'est point besoin de trop exagérer.

Z'ont droit à six malheureux titres. Juste le temps de se mettre en bouche. Pas même une minute pour se regarder dans le Mirror ou de rester un moment avec Stay Now. Suit Valentine, un petit téton d'acier chromé et l'autre tout mou. Delay qui fait attendre la montée de la mayonnaise entre deux parlottes. Un Unbreakable dont ils viennent à bout trop rapidement et un Girl final comme il se doit originalement dédié à toutes les filles. Six petits tours et puis se dépêchent de quitter la scène sous les acclamations.

La désagréable impression que l'on vous coupe le courant alors que vous preniez plaisir à enfiler les doigts dans la prise. Our Theory vous assomme d'un riff apocalyptique qui vous promet la mort et tout de suite après vous submerge de paroles réconfortantes. Faudrait qu'ils resserrent les mailles du tricot. Toutes à l'endroit en fil de fer barbelé et aucune à l'envers en satin duveteux.
DAGOBA

Suis venu pour eux. Je ne suis pas le seul si j'en juge par le nombre de sweat shirts à leur effigie le dos marqué du titre de leur avant-dernier album, Post Mortem Nihil Est, un programme à courte vue post létale mais qui en contre-partie induit une vie chaotique de diverses défonces. J'ai adoré le clip I, Reptile. Dès qu'un saurien laisse traîner sa longue queue quelque part je lui prête toujours une oreille compatissante. Vingt ans d'âge, viennent de Marseille mais leurs albums et leurs concerts leur ont permis d'atteindre une renommée nationale et un début de reconnaissance à l'international.

Suis obligé d'initier un raisonnement par l'absurde. Je serais arrivé au concert innocent comme l'enfant qui vient de naître je les aurais trouvés formidables, un groupe qui rentre dedans et qui ne s'en laisse pas compter. Efficacité redoutable. Un véritable show millimétré. Au fond Nicolas Bastos aux commandes d'une batterie impressionnante. Des toms atomiques, des cymbales cinglantes comme s'il en pleuvait, deux grosses caisses avec jantes chromées, une machine de guerre, une espèce d'insecte géant digne de Star Wars, une visualisation du microbe du Sida grossi à la puissance dix mille. Parfois elle étincelle d'éclairs foudroyants telle un vaisseau spatial qui croise ses feux sur une malheureuse cible condamnée à disparaître dans la nano-seconde qui suit. Quant à Bastos au baston, pas de problème, pilote avec une dextérité diabolique, un ado devant un jeu vidéo en train de déglinguer les soucoupes violentes de l'Empire du Bien à la suite. J. L. Decroiset à sa droite, le nouveau guitariste qui tient parfaitement son rôle, Werther Ytier à sa gauche prêt à vous vous infliger toutes les souffrances que l'homme ait bu inventer durant sa longue marche barbare vers le progrès. C'est tout, ne sont que trois pour dresser un groove mortel post-industriel, n'ont besoin de personne d'autre. Pierre Maille est au micro, devant et au centre. Très beau tatouage sur son épaule. Une forte personnalité de mâle alfa dominant. La clarté de sa voix dessine le bonhomme. Péremptoire, clair, l'on devine qu'il n'est pas un concessionnaire des demi-teintes. Une voix qui surmonte sans problème la tonitruance des trois soutiers du rythme.

Du beau spectacle, à fond les pistons et tout droit sur le béton. Jets verticaux de fumée, séances de lumières blanches clignotantes à toute vitesse. Un bon groupe qui fonce droit devant sans se soucier des bas-côtés. Eclipsed, Man You're not, Black Smokers, Winter, Born Twice, Epilogue, Sunset Course, Great Wonder, I reptile, Maniak, Things Within, White Guy, je vous les énumère comme ils les bazardent sans transiger, une seule pause obligée, Ducroiset qui casse une corde et Maille qui en profite pour partager une canette de bière avec les fans qui ouvrent grand et large une bouche dans lesquelles il verse des traits de houblon malté. Intermède vite oublié dès que le mastodonte dévastateur reprend son envol. Dans la salle règne la cohue, corps entrechoqués qui tournent à toute vitesse, mais attention pas de débordement le premier qui au comble de l'excitation monte sur la scène, sera sans ménagement rejeté dans la fosse par un Maille expéditif. Plus personne ne s'y risquera par la suite. Un fan averti en vaut deux. De toutes les manières, c'est déjà fini. Une heure pile montre en main. Pas une minute de plus. Mais non ils reviennent ! ah ! c'est pour débrancher les appareils ! Doivent être pressés de repartir. Pour les exultations jouissives de fin de party, rien à voir.

M'attendais non pas à mieux mais à plus. Excellente prestation scénique mais qui a laissé de tout côté toute l'imagerie portée par la discographie du groupe. Un savoir-faire indéniable, mais ils ont laissé la poésie à la maison. A penser qu'ils ne voulaient pas s'encombrer avec. Le corps mécanique mais pas le souffle vital. Vite fait, bien fait. Des diététiciens qui vous composent le menu à la calorie prêt. Bye bye les alléchants glucides graisseux et les succulents sucres rapides. Privation de dessert obligatoire. Ne vous octroient même pas un supplément d'âme qui pourtant ne pèse pas bien lourd mais qui fait toute la différence entre un bon groupe et un grand groupe.

RETOUR A LA MAISON
Ouverture des portes à vingt heures. Fin du concert : dix heures et demie ! Parlez-moi d'une soirée rock ! L'heure où Tante Agathe termine sa dernière prière en demandant à Dieu de lui pardonner cette audacieuse veillée devant le poste de télévision en compagnie de son vieux chat diabétique. Cette soirée à L'Empreinte risque de ne pas laisser beaucoup de traces. Pour les minutes de sable immémorial chères à Alfred Jarry faudra repasser. Trop court, pas assez bon.
Damie Chad.
LE MEE SUR SCENE
19 / 11 / 2016 / LE CHAUDRON
RELEASE PARTY
SCORES EP THE GATES TO LEAVE
FALLEN EIGHT
POGO CAR CRASH CONTROL
SCORES

Retour au Chaudron. La teuf-teuf doit pressentir que la mixture de srocksière qui nous sera servie doit être si bonne qu'elle passe devant le bâtiment à toute vitesse sans le voir. Demi-tour sur les chapeaux de roue et nous voici à pied d'oeuvre. L'est tôt mais le monde commence à arriver, les Scores discutent et grillent une dernière cigarette sur le devant de la porte, un peu de fraîcheur avant la vague de grande incandescence qui s'annonce ne saurait faire de mal.
FALLEN EIGHT

Entrent dans le noir et en une demi-seconde l'orage éclate. Musique forte et violente, l'on en oublie que le groupe n'est pas au complet. Et le voici qu'il entre, le cinquième élément éthérique, le fou hurlant, scalp danseur et agit-rock en transe. Clem brandit la torche meurtrière du micro qui incendie le public, screame comme si sa vie en dépendait, déclenche l'alerte rouge des jouissances éperdues. Derrière J-P affûte les fûts, assène d'assassines frappes sur les toms qui tonnent, fustige les cymbales, nouba des coups bas qui tombent de haut, précipite votre chute dans les tréfonds infernaux. L'a libéré les fauves, Joffrey et sa basse vibrionne sur la scène, ion étoilé enragé dégagé de son centre de gravité, Medy et Florian accomplissent des miracles sur leurs guitares, changent les notes en traits de feu, et Fallen Eight ouvre le bal des ardences de bien belle et meurtrière manière. En deux titres, Botta et Reborn, ils déchaînent une tempête qui ne se calmera pas de toute la soirée.

Departure et Last one de même acabit issu du cagibi des merveilles incendiaires. Le groupe est au maximum de sa puissance, haute dose de bulldozer qui déblaie la route de toutes les carcasses rouillée qui peuplent votre imaginaire. Le rock envisagé comme une thérapie de choc'n'roll destiné à dynamiter vos encrages dans les insuffisances du réel. Fallen Eight soude la salle, la transforme, la mute, la sculpte en un seul être organique, désormais à sa merci.

Everywhere, un truc spécial en l'honneur des Scores, ça commence gentillet avec J-P qui tapote sans bruit une promesse de tempête shakespearienne qui s'approche doucement porté par la voix de Clem, qui enfle, enfle, enfle, et finit par déborder et déferler en grandiose apothéose sur la plage des nerfs tendus vers la concrétisation salvatrice de cette menace souveraine. Catharsis aristotélicienne et décantation totémique.

Priest pour bousculer et Final Shot pour vous acculer dans vos derniers retranchements. Deux météorites de feu, la foule qui crie et rugit comme le fauve sous le fouet du dompteur pour mieux s'élancer dans la folie du cercle de feu. Un set magistral, percutant comme le gantelet de fer des cataphractaires des âges tumultueux perdus dans la nuit des temps, ressuscités en un magistral éclair par la fougue foudroyante de Fallen Eight.
( Photos : FB : Mlle Lazurite )
INTERMEDE
Un petit moment que je guette leur passage. Lorsqu'ils m'avaient invité à leur Release party, les gars de Scores m'avaient dit « Toi tu vas aimer, c'est très fort ». Sont en train d'installer leur matériel, moi question rock suis prêt à aimer le monde entier – du moins presque, la moitié, de la moitié, de la moitié, enfin quoi le un pour cent réglementaire fortement éjouissif – mais après le set dévastateur de Fallen Eight, la tâche me semble rude, insurmontable peut-être.
POGO CAR CRASH CONTROL

Dernière et rapide mise au point technique de Pogo Car Crash Control. Quatre sur scène. Jeunes et beaux. Enfin, surtout Lola la bassiste, frimousse de cheveux blonds et charme mimétique. Derrière ses drums, Louis est quasi invisible, les deux guitaristes, Simon et Olivier – l'est aussi au micro – dégagent une impression de force tranquille. Sont fin prêts, mais la foule traîne encore dans la salle du haut autour du bar. N'en peuvent plus, démarrent à l'apparition des premiers escadrons qui dévalent les escaliers. Dépêchez-vous bandes d'innocents, dans la vie des instants cruciaux de haut-vol qu'il vaut mieux ne pas rater.
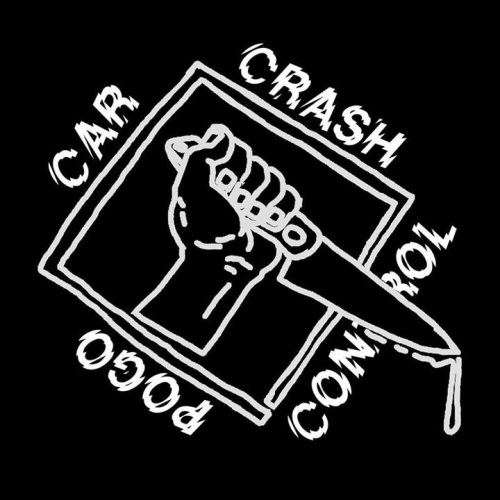
Vous prennent par surprise. Démarrent doucement. A toute vitesse en fait, mais si bien profilé que vous ne vous en apercevez pas, même que sur les deux premiers morceaux vous vous dites que le batteur est un peu monotone et au troisième titre vous recevez la commotion cérébrale. Première constatation, mais ils chantent en français ! C'est si bien envoyé que vous ne vous étiez point rendu compte ça sonne aussi rêche et plastique que de l'anglais, Olivier s'est débrouillé pour jacter un phrasé qui colle à la musique sans opérer aucune distanciation. Prenez les paroles de Meilleur Ami et de Royaume de la Douleur, vous n'en ânonnerez qu'un piteux verbiage, et lui vous en tord les vocables à vous les faire exploser comme une grêle de balles dum-dum. De la belle ouvrage. Deuxième constatation, vous êtes en aqua-planning-rollin' rock, dérapage contrôlé des plus carambolesques.

C'est parti pour ne plus jamais s'arrêter. Pas le temps de respirer entre deux morceaux. Surfin'guitars sans fin. Rock'n'roll en urgence absolue et montée continuelle. La rage s'installe, musiciens de plus en plus obnubilés par leur propres parcours intérieur. Lola qu joue les morceaux en même temps qu'elle les mime du geste et de la voix telle un pantin de Kleist libéré de toutes ses attaches terrestres et comme mu en dehors de toutes circonstances par la nécessité de son seul rêve d'adéquation à la tourmente rock'n'rollienne. A l'autre bout de la scène Simon le magicien explose. Ne se contient plus. Ne cherche plus le lick parfait l'a déjà trouvé mais se met en quête d'une disharmonie suprême, recherche le larsen comme Blue Berry la mine de l'Allemand perdu, suscite les serpents du larsen en propulsant sa guitare sur les amplis. Relégué dans la pénombre aurifère Louis accélère la cadence, on ne le voit pas mais repousse sans arrêt les limites au-delà du raisonnable. Olivier infatigable vitriole ses textes à l'ultra-violet des fureurs adolescentes, Paroles m'assomment, Hypothèse Mort, Tout Gâcher, Je suis Crétin, le scorpion maléfique des désirs de démesure retourne le dard des juvéniles impatiences contre lui-même.

Pogo Car Crash Control, nous emporte loin, quelque part entre le tic-tac déréglé du MC 5 et la modernité destructrice des Pixies. Accélération constante, malgré par deux fois l'annonce d'un morceau lent, un slow de six secondes qui se termine par une cavalcade d'apocalypse. Scène obscure traversée d'éclairs blancs de lumière de plus en plus rapprochés et aussi aveuglant que le noir le plus absolu. Une musique qui se situe au point focal de convergences tourbillonnantes, du punk, du hardcore, de l'électricité, ils n'ont mélangé que les esprits, pour se créer un golem bien à eux, un destroy kraken destiné à la désolation des fins dernières. Consensuel, Restons-en là, Je perds mon Temps – super, on y gagne un instant d'éternité – Conseil, Crash Test se suivent et se ressemblent comme une énumération de calamités funestement naturelles.
En toute fin, Crève, une exhortation définitive, une promesse de vie future, pour redescendre sous terre, une coupure fractale définitive. Sortent de scène sous une ovation assourdissante.
INTERMEZZO
Wah, la révélation de l'année ! Je cours illico acheter leur vinyl. Reviens pour la mise en place de Scores. Peuvent être contents, les deux groupes qu'ils ont invités leur ont chauffé la salle à mort. Un véritable défi rock and roll.
SCORES

Stratégie de la tension accumulée. Silence absolu. Noir complet. Tout le monde retient son souffle tandis que s'élève la musique mélodramatique de Funeral of Queen Mary, de Purcell – oui les rockers connaissent leur classique - remise à l'honneur au siècle dernier dans la bande-son d'Orange Mécanique. Un zeste de violence, ne messied point au rock'n'roll. Trois guitaristes qui essaient de se glisser en catimini sur la scène – totalement raté vu la bronca que soulève leur apparition – et plunchct ! Lumière, c'est parti ! C'est party and realeased.
Benjamin bondit sur scène comme un diable qui sort de sa boîte. S'empare du micro et la fête commence. Le groupe s'est métamorphosé. L'a grandi en deux ans, l'a gagné en force, en puissance, en souplesse et en maturité. S'éloignent de leurs modèles hardoriques initiaux pour s'installer dans leur propre musique et vont nous régaler d'un festival ébouriffant. Mais revenons à Ben dans son éternel et emblématique blouson noir, cramponné dans son micro, le fait moins tournoyer, le meut par saccades, courbé en deux, tapant le sol d'un pied exacerbé telle une panthère en cage, folle de rage, qui piétine sur place pour accumuler l'énergie d'un saut libérateur. Good Night ( premier titre du nouvel EP qui motive cette soirée ), Naughty Angel, Larger than Life, le groupe est derrière, impressionnant, un son musclé, à la monte hongroise, un pied sur le cheval rythmique du rock, cette interminable scansion binaire à la base de tout, et l'autre sur la monture de déglingue, la roue cassée du rock'n'roll, celle qui remet tout en question, qui détruit systématiquement la régularité de sa consoeur, le chien fou que nous voulons tous être dans le jeu de quilles du monde, l'essence du rock, une musique qui boîte, qui claudique, qui crockdique, comme Lord Byron ou le Maître majuscule des sombres palais infernaux d'en-dessous cher à Anton LaVey qui l'assimile à nos volitions libératrices les désirantes .
Leave me Now ( toujours du second extended play ) qui s'affirme déjà comme un titre locomotive qui pousse d'un cran la ferveur du public, la voix de Ben domine le grondement de l'orchestre, installe une ambiance qui capte et fascine la salle qui tangue salement comme le bateau ivre du sieur Arthur. Forget about It qui passe comme une lettre à la poste envoyée au bazooka. Take a New Turn, What about your dreams ( troisième bijou du scud ) nous font oublier tout ce qui a précédé. Scores nous a empochés, engloutis, englobés, dans l'estomac confiscatoire de leur musique. Nous reste encore à subir l'attaque des sucs digestifs, ces venins qui vous annihilent et vous rétament définitivement.

Ben annonce une reprise. Born to Be wild, le loup des steppes qui surgit et qui court sur vous pour infliger les cruelles morsures dont on ne guérit jamais. Nous en donnent une version dantesque – la meilleure que je n'aie jamais entendue sur scène à ce jour – la foule agonise le refrain à chaque reprise, mais la scène se vide. Ne reste plus personne dans le noir. Objection, votre honneur, nous pouvons désigner le coupable, c'est Elie Biratelle qui depuis le début du concert dans son coin d'ombre ne s'était pas fait remarquer, même si c'est lui qui nous fourguait cette pulsion essentielle qui permet de faire tourner le sang reptilien du rock and roll. Un murmure sur ses peaux tendues, qui enfle et s'organise sans fin, un monstrueux solo de batterie qui pointe son étrave comme un aileron de requin sur la crête des turbulences océanes. Möbho, un drum solo, sans une seconde d'ennui, une aventure qui déploie ses épisodes comme un anaconda resserre ses anneaux mortifères sur sa proie, sont revenus en silence et reprennent le riff de Steppenwolf, si puissamment ouvragé que c'est un véritable sacrilège de s'arrêter bien trop vite après trois éruptions riffiques volcaniques.
Surprise, voici Clem de Fallen Eight qui déboule sur scène pour chanter en duo Love in an Elevator. ( Nombreuses sont les manières de s'élever jusqu'au septième ciel de l'empyrée dionysiaque ). Beau mélange de l'aigu de Clem et de la voix plus grave de Ben. Hammer of Life et That's the girl pour finir sur deux pépites d'orichalque. N'iront pas plus loin que l'entrée des coulisses, rappel obligatoire dans lequel Clem revient encore. Photo finale, puisque les meilleures choses ont une fin. Même les concerts de Scores.

FIN DE SEQUENCE
Fabuleuse nuitée rock and roll. Trois groupes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Scores nous a offert une belle fête. Indéniablement rock'n'roll !
Damie Chad.
SCORES
THE GATE TO LEAVE
GOOD NIGHT / LEAVE ME NOW / WHAT ABOUT YOUR DREAMS / THAT'S THE GIRL
SPIRAL / SPR 002. 2016.
Benjamin Blot-André : chant / Simon Biratelle : guitare / Elie Biratelle : basse / Nicolas Marillot : batterie + choeurs / Léo Leroy : guitar + choeurs
Pochette cartonnée. Belle couve, qui n'est pas s'en rappeler le graphisme d'Aubrey Beardsley et les inquiétantes nouvelles d'Arthur Machen – l'un des inspirateurs de Lovecraft – mais prenez la peine d'entrer sans plus tarder, la porte est grand ouverte, le grand kaos originel de derrière les apparences s'offre à vous. Méfiez-vous de ce Mortsieur Loyal, trop avenant pour être honnête.

Good Night : pris à l'hameçon dès la première seconde, Ben impérial au vocal, guitares rentre-dedans et en même temps mélodiques. La nuit sera chaude, n'hésitez pas de la traverser jusqu'aux portes de l'aurore. Leave me Now : feu de cymbales, une voix de gorge encroûtée, une batterie omni-présente, guitares en feu, l'est des décisions sans appel. Prière d'obtempérer au plus vite. What about your dreams : ballade, ballharde, l'on commence tout doux et l'on monte les escaliers des beaux cauchemars par paliers, à toute blinde. Le pire est toujours meilleur que le mieux. That's the Girl : vaporeusement acoustique à ses débuts la damoiselle, et le boy Ben qui joue au chevalier servant. Derrière les guitares n'en finissent pas d'apporter démenti sur démenti. D'ailleurs à la fin on se hâte d'effeuiller cette chair de rose cru.
A écouter et à réécouter soigneusement, Scores vous réserve des surprises dans tous les coins. Des parties de guitares endiablées, des breaks de batterie drôlement bien foutus. N'ont pas cherché le bruit et la fureur à tout prix, jouent sur la subtilité des montages de séquences. Un bijou d'or fin.
Damie Chad.
POGO CAR CRASH CONTROL
ROYAUME DE LA DOULEUR / CONSEIL / CONSENSUEL / PAROLES M'ASSOMENT / TOUT GÂCHER / CREVE
Lola Frichet : basse / Louis Péchinot : batterie / Simon Péchinot : guitare / Olivier Pernot : guitare + chant

Cri d'horreur devant l'imprimante. Ce n'est pas l'impavide machine qui en est la cause, mais la pochette du vinyl EP de Pogo Car Crash Control que j'ai laissée négligemment traîner. Décidément la copine n'aime pas l'humour rouge. Remarquez que j'ai limité les dégâts, le verso est encore plus gore que le recto. Des images à vous couper les doigts de la main et à vous arracher les yeux de la tête. L'est sûr que le disque doit être chaudement recommandé par l'APS ( Association Protectrice des Serial-killers ) mais l'outrance n'est-elle pas une des dimensions de cette musique paradisiaque qui n'en finit pas de balancer et de rouler dans tous les caniveaux de la bonne conscience ?
Royaume de la douleur : Ça fait mal. Très mal. Une bande-son de cordes déjantées qui défile à toute vitesse et un gars qui agonise par-devant. En crise ascensionnelle vers le délirium ultra-trémens. Un bruital immondice à tuer les chats du quartier, d'ailleurs sur la fin les guitares griffent la transe rythmique. Monde délibérément cruel : la souffrance des uns aiguise le plaisir des autres. En l'occurrence le nôtre. Conseil : Faut savoir dire non, et envoyer valser le monde entier. L'on est jamais mieux que dans le vertige de ses propres fureurs. La musique vous balance par la fenêtre sans ménagement. Consensuel : Glapissement continu en accéléré. Dès qu'il s'arrête la cavalcade derrière presse le galop. Tout va de plus en plus mal : la preuve il n'y a que de la merde dans la radio. Remarquez, qui se permettrait de passer de telles calamités sur les ondes nationales ! Un dialogue peu platonicien. La montée du nihilisme adolescent. Paroles m'assomment : des guitares qui cliquettent comme des crécelles de lépreux atteints du tournis de la brebis. N'ajoutez pas un seul mot. Il sera de trop. Je préfère chevaucher la tempête des outrages festifs. Tout Gâcher : le karcher de l'auto-dérision. Musique et paroles impitoyables. Ne me parlez pas d'amour, je préfère la haine. L'autre nom du rock'n'roll. Crève : une batterie impitoyable qui vous hache le cerveau tout menu. Un seul mot d'ordre : crève générale. Fureur autodestructrice.

C'est quoi cet excrément fumant ? Le meilleur disque de rock français jamais enregistré jusqu'à ce jour. Notre Never Mind the Bollocks à nous, notre Fun House national. Un truc qui a des racines plus profondes qu'on ne croit, allez fureter dans L'Héautontimorouménos des Fleurs du Mal : « Je suis la plaie et le couteau » dixit Baudelaire. La sacrificiale postulation scarificatrice de l'adolescence. Brutal, incisif, sanguinolent. Une horreur sans nom. Qui nous ressemble trop pour ne pas être une suprême jouissance.
Damie Chad
P.S. 1 : Un seul gros défaut. Un six-titres ! Nous en faut le double, comme les douze coups qui annonceront le minuit létal de notre monde.
P.S. 2 : A déconseiller aux âmes timorées que la vie a flétries avant l'âge.
P.S. 3 : Tante Agathe a écrit au procureur de la République dans le but d'obtenir l'interdiction du clip officiel de Paroles M'assomment de Pogo Car Crash Control.
P.S. 4 : Il se murmure dans les hautes sphères gouvernementales que le procureur général de la Seine & Marne serait devenu fou. Il aurait perdu la tête après avoir visionné une vidéo de Pogo Car Crash Control.
P.S. 5 : l'APS soucieuse du bien-être de ses adhérents les avertit que la fameuse vidéo incriminée est visible sur You Tube et le FB du groupe.
VERSAILLES
GALERIE ANAGAMA
( 5 rue du Baillage )
20 / 11 / 16 – 03 / 12 /16
MANUEL MARTINEZ / MICHELE DUCHÊNE
Ne me dites pas que vous ne connaissez pas. KR'TNT ! Votre rock-blog préféré vous les a déjà présentés, pas en tant que peintre et sculpteur, mais comme membre de ce groupe mythique ariégeois : Les Maîtres du Monde. Une appellation incontrôlée qui sonne bien. Voir KR'TNT ! 253 du 05 / 11 / 2015. Pour les esprits curieux aux oreilles affamées de sonorités électriques nous sommes à la recherche de la dernière cassette existante. En vue d'une réédition qui risque de.... mais ne vendons pas la peau de l'ours ( blanc égaré sur sur la banquise ) avant de l'avoir retrouvée.

Mais cette après-midi c'est avec El Pinctor Majestuoso que nous avons rendez-vous. Ce n'est pas de sa faute. De mauvaises lectures tout gamin, l'a commencé par griffonner dans les marges de Blek le Roc, n'a jamais arrêté depuis. A aggravé son cas en ajoutant la couleur. Commence depuis quelque temps à intéresser les galeries en France et à l'étranger. Bref, en attendant une prochaine grosse expo à Prague, le voici à Versailles en compagnie de sa compagne Michèle Duchêne.

Michèle Duchêne, c'est une autre histoire. S'est remise depuis quelques années à jouer à la poupée. Géante, grandeur nature. En papier mâché. Rien à voir avec les globos d' Au Bonheur des Dames. Et pourtant ce serait un très beau titre générique. Très agréable d'être entouré de jeunes filles aux regards rêveurs, on les croirait sorties d'un roman d'André Dhôtel. Vous regardent sans voir, minces silhouettes, discrètes, mystérieuses, un peu en retrait du monde, dépositaires d'un silence attractif si j'en juge au nombre de visiteurs qui se collent à elles pour une improbable communion selfique.

Manuel Martinez, juste un problème d'équilibre. Le tableau se résout en lui-même. Trois couleurs, un peu de blanc, un peu de noir. N'en jetez plus. Le plus troublant c'est qu'en sus de leur résolution graphique ces équations picturales s'amusent à pousser les personnages qu'elles mettent en scène hors du tableau. Fut un temps où ils couraient sur les murs parmi les cadres brisés, mais maintenant se contentent de venir à notre rencontre. Nous ressemblent trop pour ne pas créer un malaise. Difficile de savoir si nous sommes le miroir, le reflet, ou le modèle.
Une grande unité entre ces deux oeuvres d'aspects et de techniques de grande dissemblance. La représentation du vivant n'est-elle pas uniquement une fragmentaion du vivant ? La représentation du monde ne serait-elle qu'une illusion aussi hallucinatoire que le monde lui-même ?
A visiter sans faute.
Damie Chad.
( Voir FB : Manuel Martinez peintre )
METAL OBS'
HORS-SERIE N° 1. AOÜT 2016

Ce qu'il y a de bien devant les concerts de métal, c'est que vous n'êtes pas plutôt arrivé que l'on se précipite sur vous, ce n'est pas pour vous demander un autographe mais pour glisser dans vos mains avides toute une collection de flyers d'annonce des prochains concerts ou de parution des nouveaux disques. A Savigny les marchands du temple ne manquent pas. J'adore ces feuillets aux couleurs tapageuses que vous engouffrez dans la poche arrière de votre jeans promesses de délectables lectures le lendemain matin à votre réveil. Mais cette fois dans le noir complet c'est un format A4 double page que l'on me tend avec précision élocutoire " Nouvelle revue, Métallos " entends-je proférer. Curieux non, me dis-je en mon fort intérieur, pouquoi ce S final si sifflant ? Quésacos ? C'est à la lumière de la maison que se révèle mon incompétence auditive, pas MétalloS, mais Métal Obs' !
Zine gratuit bien connu distribué à la FNAC, Leclerc et autres gros points de vente, ou magasins spécialisés. Ce quatre pages couleur est consacré au nouvel album Bad Vibrations, de A Day To Remember, photo de couve, pochette disque en quatrième, interwiew à l'intérieur + discogaphrie et critique du disc + les quatre dates de la tournée mondiale ( Italie / Autriche / France / Belgique ), un tour du monde étroitement européen, l'ensemble sent un peu trop la pub et le marketing. Ai voulu en savoir plus. Facile sur internet. Metal Obs.com relève de Hi-media rebaptisée ces derniers temps Adux. Une grosse société française cotée en bourse spécialisée dans les modes de paiement sur internet, avec comme branche annexe une activité marketing de stratégie de promotion médiatique... Parfois le ver n'est pas dans le fruit, c'est le fruit qui est dans le ver.
Nous sommes très loin de l'idéologie du Do It Yourself ! Le rock est aussi un produit de merchandising culturel. Calibrage systémique en vue. A méditer.
Damie Chad.
12:51 | Lien permanent | Commentaires (0)
16/11/2016
KR'TNT ! ¤ 303 : KILLING JOKE / SPUNYBOYS / HOT CHICKENS / JAKE CALYPSO + ARCHIE LEE HOOKER / GENE VINCENT / KEN LOACH
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 303
A ROCKLIT PRODUCTION
17 / 11 / 2016
|
KILLING JOKE / SPUNYBOYS / HOT CHIKENS JAKE CALYPSO + ARCHIE LEE HOOKER GENE VINCENT / KEN LOACH |
09 / 11 / 2016
ELYSEE-MONTMARTRE / PARIS XVII °
KILLING JOKE
Killing Joke ne plaisante pas
Comme tous ces groupes qui ont démarré en 1977/78, les Killing Joke sont maintenant devenus des vieux de la vieille. Mais quand ils montent sur scène, ils redeviennent ces rockers indestructibles qu’on apparente souvent aux vampires.

Jaz Coleman s’est toujours dit féru d’occultisme, d’évocations et de candélabres. Il s’est donc taillé une réputation de mage. Voici quelques années, il apparaissait sur la scène de l’Élysée Montmartre fardé comme un sorcier maori et le cou sanglé d’un col de prêtre. En réalité, Jaz Coleman est l’équivalent contemporain de Blaise Cendrars : son cosmopolitisme tourne à la légende. Il vit partout à la fois dans le monde, comme Blaise au temps du Transsibérien et de Valparaiso, des tranchées de Champagne et du port de Naples - comme Corto Maltese qu’on voyait à Venise, dans le Pacifique et à Vladivostock - Même genre de modernité et de style. On voit Jaz à Prague à la tête de l’orchestre philharmonique, au Caire où il étude la musique arabe, à Londres et en Nouvelle Zélande, réfugié au bout d’une presqu’île sauvage qui le protège de ce monde «moderne» qu’il vomit à longueur de temps. C’est là que se niche la vocation d’un groupe aussi essentiel que Killing Joke : disque après disque, ce groupe n’en finit plus de nous prévenir. Tout finira par s’écrouler. Jaz ne joue pas les Nostradamus à la petite semaine. Il observe les ravages du profit et rapporte les faits qu’il observe en parcourant le monde. Il s’alarme de l’accroissement fulgurant des inégalités et de la destruction mécanique de la biosphère. Les mauvaises langues vont le traiter d’écolo, bien entendu, mais Jaz s’en fout, il cède à sa vocation qui est de dénoncer. Comme Zola et Jules Vallès avant lui, il ne supporte pas l’injustice. Et pour dénoncer, rien de mieux que d’entrer sur le sentier de la guerre. Par le son, Killing Joke s’apparente souvent à une grosse machine de guerre moyenâgeuse lancée contre des forces redoutables, mais le problème, c’est qu’elle est toute seule. L’engagement est un mot qui a complètement disparu du vocabulaire. Celui qui par la seule force de son intelligence sut développer l’énergie d’un combat contre l’inégalité et la cupidité fut bien sûr Bob Dylan, mais il s’éteint tout doucement. Comme Léon Bloy avant lui, Dylan s’est retrouvé seul au front et les bras lui en sont tombés. Que nous reste-t-il aujourd’hui ? Killing Joke ? Sans doute. Jaz Coleman se voue entièrement au prêche contre l’absurdité des dérives du monde «moderne». Il semble résolu à se battre, aussi longtemps qu’il pourra enregistrer des disques et monter sur scène. Il est important de comprendre que Killing Joke n’est pas la même chose que Metallica ou Indochine. L’homme érudit qu’est Jaz Coleman nous parle du vrai monde, celui du vif argent et des forces de vie.
Étant un groupe à contenu, Killing Joke n’a qu’un impact anecdotique en France, pour une raison simple : la fameuse barrière du langage qui rendit aussi Dylan inintelligible en France. Du coup, Jaz Coleman passe pour un personnage de cirque dans la presse française. Dommage, car il se situe à l’opposé. Et on perd ainsi l’occasion de faire la connaissance d’un être de savoir. À travers les siècles qui nous précèdent (nous et notre bel âge d’ultra-superficialité), ce sont les êtres de savoir qui détenaient les vraies richesses. Ce sont eux dont les princes (éclairés bien sûr) se nourrissaient principalement.

Et puis nous avons les albums. Trente ans d’albums qui traversent les époques, à commencer par celle des années quatre-vingt. Les albums de Killing Joke brillaient toujours dans la nuit comme des feux, loin à l’horizon, signalant une présence humaine. Amie ? Hostile ? Il fallait s’en approcher pour savoir. Si par hasard on écoutait leur premier album paru en 1980, on y découvrait un magnifique groove de funk post-urbain nommé «Bloodspot», bien martelé au beat et vinaigré par un guitariste nommé Geordie Walker. Et puis en B se nichait l’excellent «Primitive», monté sur un riff dudit Geordie, grand inquisiteur du post-punk purulent. On l’y entendait jouer des paliers d’accords extra-ordinaires et poser les fondations d’un son unique en Angleterre.

L’année où François Miterrand fut élu, Jaz et ses amis sortaient leur deuxième album, What’s This For. C’est important François Miterrand, car c’est la dernière trace d’intelligence dans la vie politique de ce vieux pays chargé d’histoire. De la même façon que Killing Joke pourrait bien devenir la dernière trace d’intelligence dans l’histoire d’un rock anglais lui aussi chargé d’histoire, mais il est vrai qu’on n’attend pas du rock qu’il soit intelligent, car il ne se vendrait pas. C’est bête à dire, mais il en va des choses de l’esprit comme des choses de la vie. Plus on vieillit et moins on espère. Ce deuxième album démarre avec une espèce de messe martyre surgie de la nuit des temps, «The Fall Of Because», envenimée par les attouchements de l’infâme Geordie Walker. Puis le groupe se fâche avec un «Tension» joué aux tambours tribaux et gratté à la basse délétère. Quelle prestance dans la pertinence ! On sent chez eux comme chez David Lynch une sorte de fascination macabre pour la révolution industrielle. Voilà le cut idéal pour faire jerker Elephant Man. Et puis vous avez aussi «Butcher», un cut qui porte bien son nom, car il pue l’angoisse. Il se dresse comme un moignon et dégage cette odeur qu’on sentait dans les anciennes boucheries. On pense alors à tous ces animaux qu’on amenait là en les tirant par les oreilles. Killing Joke traduit bien l’horreur de ce monde et de la condition humaine, et toute cette profonde inclination à la barbarie. Voilà un cut pesant qui tétanise autant qu’un cauchemar orchestré par David Lynch. En B, Jaz renoue avec le beat goitreux dans «Madness». Le cut semble claudiquer au bas des marches humides d’une crypte. C’est terriblement oppressant, d’autant que les ciseaux de Geordie Walker cisaillent et que Jaz hurle dans le néant.

Pochette de satin bleu pour le troisième album qui s’appelle Revelations. Ils démarrent avec une messe païenne, «The Hum». C’est du gothique praguois infesté de rats. On y entend des pas de danse grotesques. Il ne faut pas prendre cet album à la légère, car il se veut lourd de sens. «The Pandys Are Coming» restera dans les anales, car voilà un killing stomp alarmant, baigné dans une merveilleuse ambiance post-moderniste d’infra-trouble urbain, orchestrée par Geordie Walker - Women of scarlet faces of flame/ Laughter and argue ever the same - On y entend des horribles bruits de machines moyenâgeuses. On B, on tombe sur un «Have A Nice Day» complètement déconstruit et donc affreusement inconvenant. Et puis on se pourléchera les babines de «Land Of Milk And Honey» où les Killing s’amusent comme des gamins avec le lait et le miel.

Le voyage initiatique se poursuit avec Fire Dances. C’est Geordie Walker qu’on voit brûler sur la pochette. Jaz développe sa vision anti-matérialiste dans «Frenzy» - Faster we go/ Leave it all behind/ Saw the cities come and go/ Then I saw beyond - Il le répétera plusieurs fois, pour voir au-delà, il faut se débarrasser du matériel. Enfantin. Le son de cet album prend d’abord au dépourvu, mais finit par fasciner. En B, ils font monter la sauce du beat dans «Song And Dance» - And the song became alive - Joli cut de batteur, en vérité - Stick hit the skin/ Hit the stich - Ils déploient là une énergie unique en Angleterre. Ils enchaînent avec «Dominator», un pur cut de funk gothique mené au drive de basse sec et même carrément vindicatif - Move in on them ! - Pure énergie primitive. C’est là que ce groupe atypique acquiert ses lettres de noblesse.

La pochette de Night Time présente les défauts des pochettes à la mode de cette époque. Très vénale. Mais l’album présente quelques aspects intéressants, comme le morceau titre. C’est Geordie Walker qui fait le son et donc l’identité sonique du groupe. Il intervient toujours de façon très stratégique. Et même très empirique, au sens de Néron. On s’en doute, le beat ne traîne pas en chemin. Geordie Walker propose un son hermétique dans «Darkness Before Down» et y aménage des vagues incertaines. Par contre, le groupe se décrédibilise avec «Love Like Blood» qui sonne comme un hit des garçons coiffeurs, c’est-à-dire Tears For Fear, même si l’âcre Georgie Walker s’efforce de ciseler un son florentin dans sa dimension qui est systématiquement parallèle. Le hit du disk se trouve en B : «Tabarzan». Un vrai stomp - Semen and blood is all I’ve got/ Investments of a future - Fantastique énergie des mages qui stompent dans la pénombre. «Eighties» est l’un des cuts les plus connus de Killing Joke. Geordie Walker y tisse sa toile et Jaz clame à la revoyure - Hummm eighties/ I’m living in the eighties/ I’m in love with the coming race !

Gros plan du visage de Jaz sur la pochette de Brighter Than A Thousand Suns. On retourne la pochette et on tombe sur le visage de Geordie Walker, d’une beauté fatale. Les hits sont en B, et notamment «Wintergardens», cut d’élan brisé par des ponts de Geordie - Visions of Pan transforming/ New heavens come/ Eternal on the grey skies - Quelle fabuleuses ambiances de ponts suspendus ! Et ça se termine avec «Rubicon» et un son qui n’en finit plus de se muscler - Let rage and hate of races/ Run from Adam down - Jaz chante comme un prophète - The magic of our sciences shines/ Brighter than a thousand suns - Nous voilà prévenus.

Outside The Gates paru en 1988, l’année de la réélection de François Miterrand, n’est hélas pas le meilleur album du groupe. Avec «Unto The Ends Of The Earth», ils tapent dans le prog à la Van Der Graff pour décrire les situations extrêmes - peace of mind is my priority, rappelle Jaz. En B, il évoque ses obsessions dans «Obsessions», il cite Tokyo, Londres, Paris, New York, les multinationales, Jésus et Mohammed - And I explode in my beautiful obsessions - Puis il se rend aux Andes, dans «Tiahuanaco», at the gate of the rising sun. Il termine avec le morceau titre qui est une initiation au culte des forces invisibles - I put on the mask/ I walk down the path/ I go through the arch/ Outside the Gate - très spectaculaire. Il doit être le seul à pouvoir proposer ça en Angleterre.
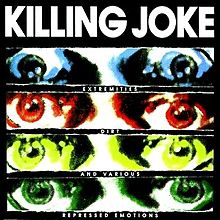
Extremities Dirt And Various Repressed Emotions pourrait bien être l’un des meilleurs albums du groupe. Il suffit d’écouter cette énormité tapageuse qui ouvre le bal, «Money Is Not Our God». Jaz revendique la seule richesse qui soit, celle de la Mère Nature - I own the beach and the blazing sunset/ I own the waves and the fresh air - Il rejette le matériel - Money money money/ Money’s not our god ! - Le prédicateur se dresse dans un ciel en flammes. Et ça repart de plus belle avec «Age Of Greed», du pur dénonciatif. Il s’en prend aux 10% de gens puis possèdent tout sur cette terre. Tout ça sur fond de prog dévastateur. On boit ses paroles - I just want to take a gun/ And put it to your head/ And pull the trigger - C’est hallucinant. Voilà leur premier véritable album de révolte. L’invasion du prog killerique se poursuit avec «Extremities», bien torturé au plan structural - The days go by/ We count the moments/ All the time/ All the life - Puis Jaz donne une vision extrêmement macabre du monde futur dans «Intravenous» - I saw the great work of man/ As he turned the forests/ Into deserts of sand - Il traite ça au catastrophisme épique et ça marche. Tout aussi épique, voilà «North Of The Border», où Geordie Walker répand ses nappes malveillantes. Jaz raconte la survie dans le monde sauvage et il gratte des briques avec ses ongles. Geordie continue son infernal travail de sape dans «Slipstream». Jaz n’en finit plus d’expliquer que le temps ne signifie rien. Et dans «Struggle», il prêche le dépouillement - Then you’ll find everything/ On heaven and earth - et il se met à hurler - The struggle is long/ The struggle is hard/ The struggle is beautiful - Apocalyptique.

Oh la la, voilà encore un grand album : Pandemonium. Dès le morceau titre qui ouvre le bal des vampires, on se retrouve au croisement de l’Orient, celui de Rachid Taha, et de la puissance des légions, celles de Scipion l’Africain, porteuses de mort et de destruction, ou bien au croisement des légions maudites de Lemmy Killmister et des hordes de chevaliers teutoniques. Voilà donc un cut puissant et dévastateur, aux effluves pour le moins surnaturelles. L’Orient semble remonter des terres desséchées, un Orient tellement ancien, qui remonterait aux origines de la civilisation et des premières utilisations de l’argile rouge. Et avec «Exorcism», on entend sonner les tambours de guerre. On ressent nettement l’excitation guerrière. Voilà ce que dégage cette horreur - Let it rumble/ Let it be/ Let it out - Jaz s’en étrangle. C’est tout simplement démoniaque de puissance. On sort du cadre. C’est le rock le plus direct, le plus brutal, le plus charnel qui soit. Avec «Communication», on revient à l’Orient antique, c’est comme chargé de tout le poids de l’histoire. Il se dégage encore une fois de cette musique des relents d’Orient extraordinaires. On se croirait dans le bazar de Bagdad, au tout début de notre ère. Sur cet album, tout est joué à la furia del sol. «Labyrinth» résonne aussi de puissance seigneuriale. C’est vraiment tout ce qu’on peut en dire. Ils vont loin au-delà de tous les au-delà possibles. Plus loin, Jaz chantera «Pleasures Of The Flesh» avec une voix de baron ivre de carnage, bardé de cuir clouté, dressé au milieu d’un amoncellement de cadavres décapités. Jaz n’est pas homme à épargner les canards boiteux. On sent l’humidité des contreforts du moyen-âge.

Deux autres coups de génie sur l’album suivant qui s’intitule Democracy. À commencer par «This Savage Freedom», doté du plus universaliste des refrains - This savage freedom I love - C’est un hymne libératoire, au sens révolutionnaire. Jaz marche sur l’Armée blanche à la tête de ses hordes de cavaliers anarchistes. Avec un tel cut, on a de la viande. C’est là, dans les entrailles fumantes de Killing Joke qui vit le rock. Jaz clame pour l’homme qui sait. Il chante sur le beat de la marche forcée et sa voix tinte d’un éclat universaliste. Oui, Jaz Coleman ne vit que pour la liberté absolue, il ne veut pas d’une vie d’esclave moderne - With the hours that we kill/ And the dreams that we hide - Oui, les heures qu’on tue dans les bureaux et les rêves qu’on cache. Un bon conseil, écoutez ce cut et ce que Jaz Coleman y raconte. Tout aussi beau, et même désespérément beau, voici le morceau titre de l’album, doté lui aussi d’un véritable refrain hymnique - Sorry democracy is changing - Jaz s’en prend comme à son habitude au big business, mais avec la puissance d’une armée de gueux. C’est un titan colérique qui ne supporte plus cette paupiette boursouflée qu’est devenue la démocratie. C’est puissant, démesuré et Geordie joue tout en arpèges lucifériens. Écoutez cette clameur ! Elles se font rares dans les disques de rock. Avec «Prozac People», il est encore en colère. Il ne veut pas faire partie du troupeau des moutons de Panurge. Et voilà que «Lanterns Of Hope» sonne encore comme un hit épouvantable. C’est à la fois épique et gravé dans les falaises de marbre. Ce rock échappe aux règles, et aux formats, ne serait-ce que par la grandeur d’âme d’un homme comme Jaz Coleman. Il n’en finit plus de mener son groupe à la victoire, celle qui espérons-le viendra à bout de la médiocrité. Sur ce cut, Jaz va chercher des échappées à la Paul Draper. Il chante «Absent Friends» avec une liberté de ton incomparable. Il termine cet album fascinant avec «Another Bloody Election». Jaz est en colère, il se jette à la gorge de la politique et va ensuite lui dévorer le foie.

On monte encore d’un cran avec l’album orange intitulé Killing Joke. Non seulement Jaz Coleman est un chanteur extraordinaire, mais il nous fait en plus la grâce de nous avertir : le ciel s’assombrit de jour en jour. Dès «The Death And The Ressurrection Show», on comprend que Killing Joke est le groupe le plus puissant de la terre - Listen to the drums ! - C’est le Dave de Nirvana qui bat le nave - Choose the crucifixion - C’est d’un mysticisme tribal hors du temps. Jaz hurle dans les abîmes - O beloved mother of liberty/ Come to me - Il est le maître des ténèbres. Aucun groupe ne leur arrive à la cheville. Selon Jaz, les âmes se recyclent dans la mort et ressuscitent. Quel fabuleux déploiement d’énergie ! - Burn away all my impurities/ Hold me in your arms - Jaz hurle à s’en découdre la métabole. On est au-delà du rock. Dans autre chose. Avec «Asteroid», on l’entend hurler dans la tourmente. Il est tout simplement héroïque. Voilà un fameux défenestrateur, un puissant démiurge, une bête de l’Apocalypse, un Athanor en fusion, un héros mythique des temps modernes, il est bien le seul à savoir gueuler comme ça. C’est cogné par Dave des douves. Et puis, on ne se lassera jamais de «Blood On Your Hands», l’avertissement définitif. C’est le hit de la révolte universelle - And the rain it rains so hard ouch ! - Et voilà que ça explose au refrain - Five corporations/ Earn more than forty six nations - Il les accuse. Jaz est le Zola des enfers. On a là le vrai son des invocations barbares du moyen âge, avec du contenu harangaire-va-t-en guerre digne des poètes qui finissaient pendus à Montfaucon. Awsome ! Avec «Loose Cannon», il continue de hurler dans les clameurs du carnage apostolique décidé par une meute de cardinaux passés à la solde du cornu. On est là dans une autre réalité, un truc de violence pure dont on ne mesure pas vraiment la portée. «You’ll Never Get To Me» sonne comme un hit. Geordie fait claquer des accords de glorieux vainqueur. Et puis ça s’en va exploser, au-delà de toute vision cartésienne. Jaz ne vise que la démesure, celle qui ne peut décidément pas correspondre à notre époque. Non, Jaz vise le temps de la vraie démesure, celle d’un temps où on se rasait au couteau, un temps où on dormait dans le flanc de la montagne, un temps où on dépeçait le gibier à la fumée âcre d’un feu de bois vert. Jaz chie sur internet et la modernité pourrissante. Mais quand tous les visionnaires comme lui auront disparu, que va-t-il rester ? Les pois chiches. Et l’atroce gargouillis du pourrissement social. Si vous souhaitez entendre la voix du diable, alors écoutez «Dark Forces» - You’ll need holy water/ And a little bit of kwoledge - Alors il lance son invocation - To you Holy Guardian Angel ! - Le diable parle - Just eat shit die/ Like everyone else !

On trouve deux belles preuves de l’existence du diable et des enfers sur Hosannas From The Basement Of Hell. À commencer par «Invocation», un horrible heavy groove orientaliste mené par Geordie, la bête des soubassements. C’est tout de même autre chose que «Kashmir» ! Au moins, chez Killing Joke, on trouve de la viande très ancienne. C’est même incroyablement orchestré. On peut parler ici de viande puante de prédicateur dangereux, car l’ambiance se veut pesante et terriblement infectueuse. Arrgh ! Il se dégage une vraie puanteur des ostensoirs, cette fumée noire qui renvoie bien sûr à ce chanoine Docre qui intriguait tant Huysmans. L’autre trace du diable se trouve dans «Gratitude». C’est encore une fois très oriental dans l’esprit, joué sous le boisseau comme dans la fameuse scène du baptême de Rosemary’s Baby. Il se dégage du cut un vrai parfum toxique de messe noire. Quelle mélasse hors du temps ! On entend hurler Jaz dans «This Tribal Antidote». Il lève les bras au ciel et hurle comme un shaman abandonné des hommes. Il hurle de plus belle dans le morceau titre. Mais s’il hurle, cette fois, c’est à la manière d’un chef de guerre hystérique qui lance sa troupe à l’assaut d’un ennemi en surnombre. Il sait qu’il va prendre des coups de hache et des coups de pique, mais il galvanise des hommes qui se savent eux aussi perdus. C’est battu à la folie brutale. Encore une abomination définitive ! Tout chez Killing Joke nous renvoie aux temps anciens, ceux d’avant toute forme de civilisation. Avec «Majestic», on assiste à la résurrection des dieux de l’Antiquité. Quelle cabale infernale ! Tout est dans le rouge de la Mer Rouge, dans l’or de Pharaon, dans la fleur de Babylone, dans l’écho des temples de Ra. Justement, on parlait des dieux, eh bien les voilà : «Walking With Gods». C’est battu tribal à la fellinienne. Quel affreux ballet défenestré ! Hypnose garantie ! C’est tout simplement monstrueux de puissance. Jaz hurle dans le fond des cavernes de l’enfer. Il chante d’une voix de mineur cancéreux. Tout est battu comme plâtre sur ce disque infernal, surtout «The Light Ringer». Ni canard boiteux ni bonté divine ici, la machine Killing Joke écrase tout sur son passage. On a parfois l’impression qu’ils nous enfoncent des clous dans le crâne. C’est encore pire du Ministry.
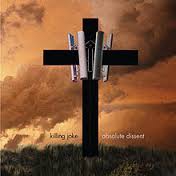
Paru en 2010, Absolute Dissent fait partie des très grands albums de rock moderne. Dès le morceau titre, on retrouve cette atmosphère de marche forcée. Geordie riffe à la cisaille et Jaz s’en va chercher des clameurs d’Occident moyenâgeux - I reject this poison planet - Si Jaz milite, c’est avec une singulière brutalité. Les Écolos n’auraient pas voulu d’un sauvage comme lui dans leur bureau politique, on s’en doute. Ce qui est amusant, c’est qu’on s’attend chaque fois à des lyrics traitant d’ésotérisme occulte, et paf, on tombe sur une violente diatribe écologique. Nouvelle énormité cabalistique avec «The Great Cull» - Thin the herd ! Mosento ! All the bees are dying ! - Si un groupe aussi puissant que Killing Joke ne parvient pas à se faire entendre, alors on comprend bien que c’est foutu. Jaz et les siens font la guerre. Ils sonnent comme une armée d’Orks. Ils renouent avec le génie dans «In Excelsis». C’est même joué dans l’épaisseur d’un riff à la Bob Mould. Terrifiant ! - The glory of freedom ! - Ils balancent ça comme s’il s’agissait d’un slogan déificateur, sur fond de wall of sound et de pure démence de la semence. Ça explose et ça coule de jus. Ils sont impériaux. Dans «This World Hell», Jaz hurle comme s’il était livré aux mains d’un tourmenteur de la Sainte Inquisition - This world hell/ Die long pig ! - Et puis avec «End Game», il nous prévient que ça va mal finir dans pas longtemps - World trade center turned powder - Plus loin, Geordie fait des siennes dans «Honour The Fire», encore un cut qu’on voit exploser au refrain, dans des bouquets d’harmonies soniques extraordinaires. Jaz chante du haut de son nez d’apothicaire et ce génie malin qu’est Geordie trafique des ambiances hallucinantes - Kali ! Kali ! Kali ! Spark of life/ Eternal spring ! - Ils savent aussi bricoler une belle pop musculeuse, comme on le constate à l’écoute d’«Here Comes The Singularity». C’est comme éclairé de l’intérieur. Mirifique ! Jaz est capable de jeter dans le bûcher des vanités la meilleure pop d’Angleterre.

Retour du grand prédicateur dans MMXII avec «Pole Shift» - A field energy reversal has begun/ Suddenly it hit ! - Il prédit que ça va mal finir et livre deux ou trois clés auxquelles on ne comprend rien, dès lors qu’on ne sait rien - Marvel at the mysteries of quantum immortality - Avec «Fema Camp», le groupe tape dans le heavy doom d’orientalisme industriel. Jaz rappelle que l’humanité est en voie d’extinction - Humanity fades - Aussi annonce-t-il qu’il va passer dans le rang des renégats - So I’m going up with the renegades - On retrouve la fantastique machine de guerre Killing-Joky dans «Rapture». Ces mecs sont très puissants, mais avec du contenu. Jaz gueule son Rapture au-dessus des abîmes. C’est très spectaculaire. Il hurle, debout dans ses étriers, et on l’entend jusqu’aux collines. Et paf, il s’en prend aux dirigeants de ce monde dans «Corporate Elect» - It’s an ADD generation/ Everyone accepts the re-introduction of slavery/ By a corporate elect - Il a raison de dénoncer le retour consenti à l’esclavage. D’autant qu’il est soutenu dans sa mission par le meilleur beat de stomp de monde libre. Dans «Glitch», il annonce la menace qui plane sur notre beau monde moderne : le black-out ! - The freezer’s broke/ The food is off/ The GPS has died - Oui, il a raison, quand le courant va sauter, plus de frigo, plus de bouffe, plus de smartphone, plus de facebook, plus de GPS, tout ça, terminé ! Jaz soutient que tout cela n’est qu’une vaste aberration - Eveyone knows it’s over - Oui c’est fini, terminus, tout le monde va descendre. «On All Hallow’s Eve» semble enregistré dans une certaine antiquité. Jaz semble revenir du monde des morts et il s’en vient rugir sur le mont Ararat. Il chante sa nostalgie de la vie simple, il évoque le bon vin, le fromage, un peu de pain, le parfum des cigares et des épices. Avant d’être le prédicateur que l’on sait, Jaz Coleman est surtout un poète.

On finit par s’épuiser à écouter les albums de Killing Joke. Trop de son et trop de surenchère dans la colère. Curieusement, le dernier album en date laisse un peu indifférent. Pylon paraît manquer de souffle, même s’ils attaquent au marteau-pilon dans «Autonomous Zone». Jaz y vante les mérites de la vie libre outside the grid, qui est à la fois la grille et le greed de la cupidité des multinationales - Living outside the grid is the goal/ Misery lies at the heart of control - Puis dans «New Cold War», Jaz se met à hurler comme le capitaine d’un voilier malmené au Cap Horn - Oil prices falling and the propaganda talks war - Jaz s’ancre dans l’actualité économique pour mieux nous prévenir. On s’en doute, «War On Freedom» est une remise en cause du nouvel ordre établi. Il les appelle Media monopolies et ajoute en rigolant - Bye bye sweet liberty - Dans «Delete», il re-dénonce l’élite - Eighty five people own half of the world/ It’s raining barium and no one’s concerned - Oui, ils ne sont que 85 à posséder la moitié de la terre. Bizarrement, Geordie Walker joue des accords métal. Oh à leur âge, ils ne feront plus de miracles. Cet album sonne un peu comme le chant du cygne. On se réveille heureusement avec «I Am The Virus», qui n’est pas le Walrus. Voilà un cut digne des grandes déboulades d’antan, et même complètement incendié par le pyromane Walker. Et Jaz tonne - Central banking mind fucking omnipotence ! - Et il se dresse en sauveur par l’esprit libertaire - I am the fury/ The spirit of outrage !

Les voilà de retour par un beau soir d’automne dans un Élysée Montmartre refait à neuf après l’incendie qui le détruisit voici quelques années. On renoue avec le confort de ce beau volume. Que de beaux concerts a-t-on vu dans cette salle ! Geordie Walker et Jaz Coleman ne vieillissent pas.

Youth fait des dreadlocks avec ce qui reste de ses cheveux et joue sur une Rickenbacker. Et le groupe met en route sa monstrueuse machine sonique, les roues en bois grincent dans la nuit. On note une belle densité de fans dans les premiers rangs.

Il faut vite se rendre à l’évidence : on n’assiste pas à un concert, on subit plutôt un bombardement. Les grooves de Killing Joke se répandent comme la peste sur l’Occident. Ils tapent très vite dans des vieux trucs comme «Love Like Blood» et mettent l’assommoir en service avec «Autonomous Zone», tiré du dernier album.

Il règne dans la salle une belle atmosphère de fête païenne. Ça sent bon le tribal. Ce genre de beat sourd fait ressortir ce qu’il y a de meilleur en nous, une sorte de conscience diffuse des origines. Une façon de se mesurer à l’idée qu’on se fait de l’univers, une façon de comprendre qu’on est bien peu de chose - autant dire rien - mais on fait partie d’un tout. Le moi-je se fond dans le collectif, l’ego retrouve son rang animal. Killing Joke ne donne pas vraiment un concert, Jaz Coleman officie et libère les âmes. L’organique fait la danse du scalp avec le tellurique, les qualificatifs perdent eux aussi leur épaisseur, le signifiant suce la moelle du prédicat et le métabolisme enfourne des feutrines délétères, il se dégage du conglomérat humain une forte odeur de semence, la raison s’incline devant l’oraison et la maison Usher glisse mollement dans la chère déraison, un souffle fétide balaye les ultimes poches de résistance et livre les âmes aux vertiges d’hallucinations mystico-mormoilliennes.

Pas d’échappatoire, Killing Joke martèle le beat des temps modernes. Ils jouent «War Dance» et «Pandomenium» en rappel, histoire de finir de marquer les esprits au fer rouge. On sortira en hâte de cet endroit torride et maléfique pour aller se jeter dans une voiture et regagner nos pauvres pénates. Un peu honteux, pour tout dire, comme si on voulait faire semblant de n’avoir rien compris.

Signé : Cazengler, bad joke
Killing Joke. Élysée Montmartre. Paris XVIIIe. 9 novembre 2016
Killing Joke. Killing Joke. EG Malicious Damage 1980
Killing Joke. What’s This For. EG Malicious Damage 1981
Killing Joke. Revelations. EG Malicious Damage 1982
Killing Joke. Fire Dances. EG Malicious Damage 1983
Killing Joke. Night Time. EG 1985
Killing Joke. Brighter Than A Thousand Suns. EG 1986
Killing Joke. Outside The Gate. EG 1988
Killing Joke. Extremities Dirt And Various Repressed Emotions. Agressive Rockproduktionen 1990
Killing Joke. Pandemonium. Butterfly Records 1994
Killing Joke. Democracy. Butterfly Records 1996
Killing Joke. Killing Joke. Zuma Recordings 2003
Killing Joke. Hosannas From The Basement Of Hell.
Killing Joke. Absolute Dissent. Svart Records 2010
Killing Joke. MMXII. Spinefarm Records 2012
Killing Joke. Pylon. Spinefarm Records 2015
11 / 09 / 2016
COULLY-PONT-AUX-DAMES
METALLIC MACHINES
SPUNYBOYS

Retour à Souilly-Pont-aux-Rames, non : Fouilly-Pont-aux-Lames, non : Jouilly-Pont-aux-Cames, ah, non ! j'y suis : Couilly-Pont-aux-Âmes ( en perdition ). Que voulez-vous, un reste de pudeur m'oblige à maquiller le nom de cette cité, toutefois l'honnêteté géographique me force à l'écrire en toutes lettres, Couilly-Pont-aux-Dames. L'a dû couler bien du sperme sous le fameux pont depuis qu'en ce beau jour du 26 Juin 1929, les joyeux lurons néanmoins élus du Conseil Municipal décidèrent de baptiser de cette gaillarde appellation leur bourgade bien-aimée.
Quoi qu'il en soit sous ce fameux pont serpente le Grand Morin qui ne trouva rien de mieux à faire, lors de ce dernier printemps par trop pluvieux, que de quitter son lit pour envahir le local des Metallic Machines. Annulation des festivités prévues, grand nettoyage – imaginez les murs recouverts de boue – mais les bikers sont des coriaces, z'ont tout récaté, et voici une nouvelle série de concerts qui se profile à l'horizon.

Du monde pour les Spunyboys même si la salle du bar ne désemplira pas de toute la soirée. Mister B and Me sommes contents de retrouver les Spuny, presque un an jour pour jour, c'était au 3 B à Troyes, le soir du Bataclan... Sont en pleine forme, le groupe tourne sans arrêt et ils viennent d'enregistrer une télé pour Canal + pour l'émission Antoine De Caunes. Relation de cause à effet ? toujours est-il qu'il y a beaucoup plus de filles que d'habitude.
SPUNYBOYS !
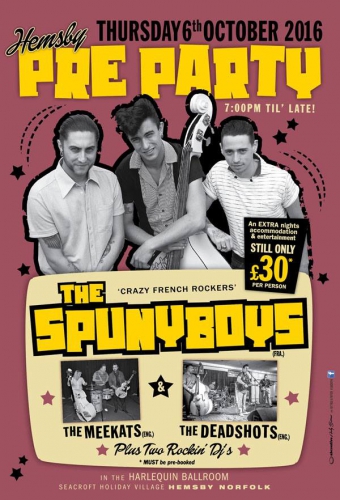
Un set. Trois garçons. Guillaume à la batterie. Eddie à la guitare. Rémi à la contrebasse et au chant. Une formule simpliste. Une musique de plouc. Livrée telle quelle. Sans emballage. Un travail d'artiste. Des orfèvres. Ecoutez les Spuny, tout est merveilleusement à sa place. Des principes de base d'une pugnacité rustique. Tous ensemble et pas question que ça cède ou que ça s'affaisse dans la graisse du bavardage. Témoignage de mon marchand de légumes, le matin même sur le marché "hier soir à Fontainebleau, j'ai vu un groupe de rockab, pas mon style de musique mais ils étaient plus que bons". Plus que bons ! Parmi les meilleurs d'aujourd'hui !
Difficile de trouver mieux. Dans leur style, modulerez-vous. Le problème c'est que le style des Spunyboys, ils sont les seuls à l'exercer. Beaucoup de reprises, mais ce n'est pas ce qui compte. N'importe qui peut reprendre un morceau, mais en respecter l'esprit tout en le façonnant à cent pour cent à sa propre manière, faut être doué. Et sacrément bosseur. Les Spuny approchent les mille concerts, sont devenus une terrible machine de guerre. Et de précision. Sont comme ces calligraphes japonais qui vous recomposent le monde en trois coups de pinceaux. Pinaillez si vous le désirez, mais vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a tout, l'essentiel et le superflu. Les Spuny vous ont décortiqué le rockabilly jusqu'à l'os. En connaissent toutes les articulations. Sont au-delà du squelette, en sont à l'épure. Juste ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, et rien de ce qu'il ne faut pas. Vous fournissent les trois modalités de l'existence en un seul dessin. Ne cherchez pas l'erreur, il n'y en a pas.

D'où la brièveté des morceaux. Vous en balancent trois ou quatre à la file, un petit speech de Rémi, et hop vous en débitent aussitôt trois ou quatre nouvelles tranches. Si vous pensez que cela risque d'être un peu austère, vous vous trompez. Le sourire de Rémi ferait fondre un iceberg. Sa célèbre banane accroche les coeurs. Quant à sa contrebasse il ne la ménage guère. La soulève, la promène un peu partout, la penche du côté par lequel elle va tomber, la jette en l'air, la rattrape aussi facilement qu'une pièce de cent sous.
En plus il se permet même d'en jouer. Et pas incidemment. L'apporte au groupe le son d'unisson, le grondement des fondations coulées dans le béton précontraint. Pas du monolithe mortuaire. Ça swingue par en-dessous. Pas d'esbroufe, le solo matuvu à rallonge qui capte toute l'attention n'est pas le genre de la maison. Prenez quinze secondes, pas une chaise-longue. L'on n'est pas sur le Titanic. Eddie ne dérogera pas à la règle. Trop occupé à jouer. Colle à la ligne rythmique de si près qu'il en est le pourvoyeur essentiel, à égalité avec ses deux frères d'armes. L'est comme ces boxeurs qui boxent rapproché, pas d'allonge, des coups brefs, incisifs et percussifs qui vous trouent la peau. D'une efficacité meurtrière. Guillaume en paraîtrait presque lyrique sur sa batterie. Une grosse caisse de fanfare sur laquelle s'étale en gros le logo des Spunybous – le dos de la contrebasse de Rémi arbore le même – la baguette friponne qui s'en vient titiller l'entaille fessière que tend de façon fort avenante la jeune femme dénudée sur l'immense poster rieur de fond de scène – ce n'est pas L'Origine du Monde de Courbet, juste la face B, toutefois nous ne sommes point ici pour nous livrer à une chronique picturale mais musicale, retournons nous vers ces cymbales qui s'emballent sous la férule de maître Guillaume. Le maestro du tocatoc du tocatrock qui bouscule son monde.

Nous déboulent plus de trente morceaux, de John Horton à Crazy Cavan en passant par Gene Vincent, avec une préférence nette pour les seconds couteaux du rockabilly, ceux qui vous tranchent la gorge si vite que vous êtes déjà morts quand vous vous en apercevez. Du cousu main, de la finition. Les Spuny sont en forme. Chassent les temps morts. A peine dix secondes s'est-il écoulé à la fin d'un titre qu'il y en a toujours un des trois qui se dépêche de plonger dans le suivant et les deux autres obligés de recoller à la locomotive sans attendre. Et c'est de nouveau l'extase jouissive, les Spuny dégomment les morceaux comme des pipes en terre de la fête foraine, des grandes ducasses du nord. Un bon rock est un rock mort semblent-ils nous dire. Aussitôt commencé que déjà fini, mais entre temps ils vous ont offert les grands canyons du Colorado, la bagarre dans le saloon, la traversée du Rio Grande et une course poursuite dans la Vallée de la Mort. Vous synthétisent le tout en deux minutes et vous refilent illico, illicrock un scénario tout aussi tumultueux. Des briques de carburant solide pour fusée interplanétaire.
Le public ne décroche pas de la scène. Beaucoup de personnes qui les voyaient pour la première fois sont sidérées par la netteté du show. Une jeune fille me demande pourquoi ils ne sont pas davantage connus. Est toute estomaquée de voir des jeunes de son âge, de sa génération, produire une musique si méticuleusement parfaite avec une telle force et avec un tel impact. Ce n'est pas qu'elle aime spécialement le rockabilly – à Couilly les distractions du vendredi soir doivent être rares - c'est qu'elle a été touchée par la netteté sidérante du set. Les Spunyboys s'étaient déjà attirés l'estime des connaisseurs et voilà qu'ils sont en train d'acquérir le respect d'un public plus large. L'avenir s'annonce sous de clairs auspices.

Damie Chad.
13 / 11 / 2016 – LAGNY-SUR-MARNE
LOCAL DES LONERS
HOT CHICKENS
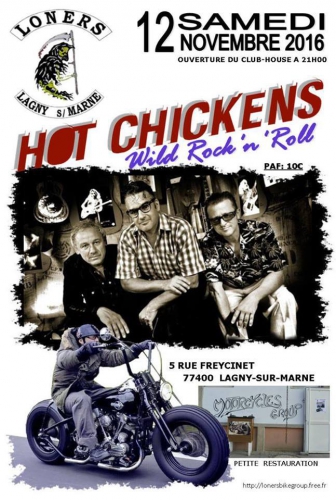
Retour chez les Loners. Suis un peu perdu dans la zone industrielle, mais pas la teuf-teuf toute neuve qui sort du garage. Un flair de pisteur. Retrouverait une trace d'ours polaire sur la banquise en pleine tempête de neige. D'ailleurs miracle, elle tourne au hasard – du moins crus-je – et voici le fanal orange qui signale le local des Loners. Deux tonneaux qui laissent échapper des panaches de flammes qui illuminent la nuit. Pas très écolo pour le réchauffement écologique mais voyez-vous les rockers ne sont pas des folkleux. En plus fait pas chaud, une espèce de crachin insidieux qui vous transperce le corps, et dès que la porte s'ouvre tout le monde s'engouffre à l'intérieur sans demander son reste. Une véritable migration, ça n'en finit pas d'arriver. Plein de têtes connues, notamment les aficionados du 3 B de Troyes aussi nombreux qu'une délégation soviétique en visite en pays ami durant la guerre froide. Le concert est prévu pour dix heures mais à neuf heures trente la foule s'entasse devant la scène et la tension monte... Hervé Loison est de retour des Amériques, l'est déjà passé par l'Espagne et le voici avec ses deux fidèles et valeureux chevaliers Thierry Sellier porte-tambour et Christophe Gillet porte-guitare à ses côtés.
SAVAGE SET
Personne sur l'estrade mais le concert commence. Une rumeur qui monte, enfle et éclate. Ne s'arrêtera pas une demi-seconde de toute la soirée. Arrivent un par un, Thierry en tunique léopard assorti à son étui de lunettes ( damoiselles prenez-en de la graine ), Christophe Gillet dans une chemise western à damner tous les chanteurs country de la rive ouest du Mississippi. Ne manque plus qu'Hervé Loison, le voici enfin magnifié dans une splendide veste rosckabilly à rendre jalouses les petites filles de la terre entière. Se saisit de sa basse et commence à chanter. Absolument faux. Bien sûr il chante juste, mais il n'est pas le seul, n'est qu'une voix parmi tant d'autres, celles de la chorale des rockers-bikers qui l'accompagneront sans faillir jusqu'à la dernière seconde des deux sets. C'est que Rave On de Buddy Holly et Race with the Devil, et le répertoire des classiques tout le monde connaît. Idem quand il reprend des morceau de Down in Memphis, son avant-dernier disque.
Durant le concert j'ai maudit Dieu et ma mère, je sais ce n'est pas bien, mais pourquoi m'ont-ils laissé venir sur cette terre sans me donner trois paires d'yeux mobiles indépendantes les unes des autres ? Ne savais plus où donner de la tête. Parce que d'habitude les Hot Chickens ça vous tombe tout rôti dans le gosier mais ce soir, chacun dans sa partie, ils ont réalisé une de ces flambées meurtrières dignes des fournaises de Lucifer.

Thierry tout d'abord, sis au milieu, tel un roi sur son trône. Nous sort le grand jeu. Celui qui épouse les ventouses rythmiques du old style. Cette respiration suffocante, cette reptation loufoque de l'apnée, toute en brisures mortifères et en reprises alléchantes. Sort le beau style des fioritures, lève la main droite tout en haut et fait circuler sa baguette entre ses doigts comme le furet du bois joli qui court à s'en dilater la rate, et bim il retombe à l'instant précis du battement exigé, ou alors l'a un coup plus vicieux, s'apprête à taper de la gauche sur la caisse claire, mais non il laisse retomber le bras vers le plancher, et tout de suite après il vous adresse un sourire narquois, style je vous ai bien eu, je ne joue pas les inutilités. En art martial, cela s'appelle le koukitupa qui vous désarçonne juste la fraction de seconde nécessaire à l'atemi mortel qui suit. Thierry se contente de darder son regard malicieux sur l'assistance.


Christophe, tout le contraire. Ferme les yeux. Tel un sphinx extatique. Un gars décourageant. C'est à peine s'il bouge les doigts et il balance des pluies de notes diluviennes. Parfois il s'avance, pas plus de quinze secondes – n'est pas là pour raconter sa vie, mais pour prendre la vôtre. Vous décoche une volée de flèches qui viennent se planter juste dans votre moelle épinière. Vous êtes proche de la jouissance du pendu, mais il déjà en train de chevaucher ailleurs. Economie de moyen et rendement maximum. En plus l'a l'oeil du chat sur tout, l'air de rien, peut batifoler tant qu'il veut Hervé, l'est toujours sûr que son guitariste le suivra dans toutes ses cascades.


Durant les quatre premiers morceaux, le Loison se tient comme il faut. Vous lui donneriez votre fille à marier. Le mec sérieux, blotti contre sa double bass, ressemble à un flamant rose solitaire au milieu de l'étang. C'est après que ça commence à se gâter. Avec la chorale qui le suit de conserve, il navigue sur du velours.

La big mama commence à ressembler à un mât de bateau secoué par une tempête de force sept. Pas encore l'ouragan mais l'on pressent que ça ne saurait tarder. Branle bas de combat, le capitaine jette coup sur coup sa veste et plus tard sa cravate dans la foule et l'odyssée du radeau de la Méduse déferle sur l'assistance. Pour la contrebasse pas de problème, le moussaillon Eric qui passait son temps à rugir dans la salle se propose pour manoeuvrer l'engin dont Hervé se débarrasse de bon coeur. Parfois l'instrument est l'ennemi du musicien. Tout compte fait, un micro c'est nettement suffisant pour un chanteur. D'autant plus qu'il y ajoute un harmonica. Après la période rose, nous passons à la période bleue.


Qui a dit que le blues était une chose nécessairement triste ? Qu'on le fusille tout de suite. Avec Hervé c'est une matière survitaminée qui vous transmet une énergie folle. Descend à plusieurs reprises dans le public. Hurlements autour de lui. La fièvre monte à El paso. Excitation à son comble. C'est un tout petit gamin qui a récupéré la veste, s'en sert de robe de chambre, saisie d'une impulsion frénétique, il lui frappe les fesses de ses manches trop longues. La jeunesse ne respecte plus rien ! Tout sourire Loison se tourne vers lui et lui offre une démonstration de gloussements featheriens du meilleur effet, le micro à moitié avalé. Tout le monde reprend en choeur, l'on se croirait dans un poulailler quand entre le renard ( par l'odeur alléché ).
Sur scène Thierry et Christophe assurent le train à coups de battements et de rafales de notes. Hervé les rejoint en courant et termine un roulé boulé par un poirier droit comme un I, le dos contre la grosse caisse. N'en peut plus. De devoir terminer le set. Propose un petit dernier avant la fatidique coupure.
DEUXIEME SET

Pas question de laisser tomber une si belle ambiance. A peine un quart d'heure plus tard, les Hot Chickens remettent le poulet au milieu du terrain. La contrebasse gît lamentablement à terre, Hervé armé de sa basse électrique sort le grand jeu surréaliste. Nos égosillements échevelés sont aussi beaux que les choeurs des marins dans le Vaisseau Fantôme de Wagner, du coup il nous gâte, une séquence Gene Vincent en l'honneur de la réédition de son album ( déjà quinze ans ) Play Gene, un Baby Blue apocalyptique, un superbe Say Mama ( quoique, faut être honnête, sur les wow ! Wow ! Wow la chorale est un peu faiblarde ), un Right Now échevelé... sur ce retombée dans le blues à foison, le blues à Loison, le blues à toison d'or et à crinière de lion. Loison s'envole dans les airs porté à bout de bras par un escadron de volontaires en grande forme. C'est la fin. Non, une reprise proposée par Hervé, puis un rappel, puis Hervé qui pense qu'un petit... bref à la fin du troisième rappel Thierry masse les articulations de ses doigts et Christophe se saisit de la housse de sa guitare. Personne n'ose insister. Personne, si, l'est magnifique dans son t-shirt noir orné de têtes de morts flamboyante, porte l'insigne des Hells Angels ( Nomads ) sur son blouson, prend le micro des mains d'Hervé exprime son admiration et propose que la fête ne s'arrête pas si brutalement, bref il espère un dernier supplément d'âme. Devant l'assentiment général les Hot Chickens refont tourner une dernière fois la broche du rock'n'roll. Pas n'importe quoi, un morceau de roi, un Bonie Moronie de Larry Williams, thin as kinny as a stick of macaroni mais à la sauce Johnny Winter que Christophe vous vitriole de main de maître... Vous ai épargné la chemise jetée dans le public en délire, Loison pantelant dans la batterie sur laquelle il vient de s'affaler, la tête sous la cymbale sur laquelle Thierry n'en continue pas moins de faire sonner les cloches de Notre-Dame, les filles montées sur scène ( expression malheureuse ) s'improvisant musiciennes et la salle en pleine exultation...

Une soirée mémorable. Les Hot Chickens déchaînés. Un public réactif. Le rock and roll c'est comme la tarte aux cerises de Tante Agathe. Hyper simple à faire. Mais il n'y a qu'elle qui la réussit. Par une chance extraordinaire Hervé, Thierry et Christople sont des vrais cordons blues.
Damie Chad.
( Photos : FB : Rockin' Lolo + Béatrice Berlot pour the first pinky )
VANCE, MISSISSIPPI
JACKIE CALLYPSO / ARCHIE LEE HOOKER
AND THE BOOGIE COMBO
RUINE B / TERRY REILLES
Vance, Mississippi / Juke House Men / Louise Blues / Blues inside Me / Rose Hill Blues / Blues & Trouble / Hey Barber, Barber / Blues in my Bones / Rain, Rain, Rain / Ruine B Boogie / No Good Woman / John Wood Choppin' / My Shoes / + Did You Stop Loving Me Baby ? / I've Played Boogie in Your Garden Man / Get a Job Man / Whithout One Million / Take your Time Lord /
Guests : Sonny Mat D / Manu Slide / Little Legs
Chickens Records / 2016

Certes il y a le rock'n'roll, mais il y a aussi le blues. Pèsent autant l'un que l'autre dans les plateaux de la balance. En plus, il y a le reste de la famille, le country et le rhythm'n'blues, pour ne citer que deux membres de la cohorte. Peut-être en son fort intérieur Hervé Loison incline-t-il vers le blues. Nous le redit, souhaite se faire enterrer dans le Sud auprès de la tombe d'un bluesman vénéré. Mais il lui est difficile de choisir. Le projet Jake Calypso lui permet de couvrir toute la gamme et se prête à toutes les aventures. Avec Downtown Memphis l'était allé courtiser le rock'n'roll des débuts des studios Sun, avec ce Vance, Mississippi il se tourne vers les noires racines de notre musique. Mais toute épopée musicale est avant tout prétexte à rencontre humaine. Ce disque est le résultat d'une collaboration amicale, Archie Lee Hooker est un lointain cousin du grand John Lee Hooker, un des géants du blues.
Une démarche de partage encore accentuée par le fait de mettre à la disposition du public en libre accès sur Internet ses propres enregistrements. Geste de grande générosité et de confiance. Les plus démunis auront accès à ces oeuvres et les fans ne se priveront pas pour autant de se procurer les disques à la fin des concerts. Le rock et le blues sont un combat. Chacun y participe selon ses moyens et son enthousiasme.
Vance, Mississippi : la grande tradition, deux qui toastent et le troisième grand absent dans le trou, c'est son rythme que l'on entend, cette cadence infernale, le pied qui frappe le sol et la solitude de l'homme seul. Arche Lee qui grogne et Jake Calypso plus que jamais avec l'accent américain. En plein coeur du Mississippi. Cela se fête. Juke House Men : Les hommes sont au bar, boivent de l'alcool de contrebande. Le seul havre de paix après une dure journée de labeur. Avant aussi. Louise Blues : la voix creuse de Calypso, les guitares qui couinent et la vie qui coule comme un robinet d'eau tiède. Gardez-vous de mélanger le chaud avec le froid, le noir avec le blanc, n'en sortira que du sang. Blues inside Me : Le blues à l'intérieur d'Archie ne demande qu'à sortir à gros flocons en emportant le granulé de la voix. Comme la langue râpeuse d'une chatte qui lèche ses petits, et ses blessures. Rose Hill Blues : La guitare devant qui résonne comme un jour d'enterrement. Toutes les collines ne sont pas roses mais le sang des rivières est noir comme un oiseau de malheur. Que de peine pour sortir la tête hors du trou. Dieu éclaire peut-être la route mais la lumière est éteinte. La voix de Jake bourdonne, même le bonheur a un goût amer. Blues & Trouble : trouble et bagarre, tétez le sein que vous voulez c'est du mauvais sang qui coule. Le blues n'est pas un long fleuve tranquille. Archie connaît cela par coeur. Musique qui va de l'avant et la voix qui théâtralise. Vous reprendrez bien un cigar-box. Hey Barber, Barber : Calypso yodelle et la musique ressemble à une vieille lessiveuse que l'on frappe sans retenue. L'harmonica étire la donne. Les rockers, un simple rasoir leur donne de ces idées. Fallait pas se faire prendre. Et encore moins pendre. Blues in my Bones : le blues du matin de la vie, quand on se réveille, vous colle à la peau et aux os. Rythme lent pour appuyer là où ça fait mal. Pas la peine de tenter de fuir, vous aurez beau cavaler, sera sempiternellement là. N'êtes même pas sûr qu'il vous quittera le jour de votre mort. C'est de votre faute, c'est vous qui avez demandé à naître. Rain, Rain, Rain : On ne reconnaît pas sa voix au début mais c'est Calypso qui fait le grand saut dans le blues. La batterie sert de locomotive et le phrasé s'étire tout le long du convoi. Une histoire d'amour et de désir, d'habitude ça se termine mal. Pleurs d'harmonica, comme des larmes retenues qui s'échappent. Ruine B Boogie : Le boogie de la mort. Pas besoin de chanteur, ça swingue comme une grande bringue à l'étage du Rising Sun à la New Orleans. No Good Woman : La femme n'est qu'un espoir. Souvent déçu. Que dire de plus ? La musique claudique. John Wood Choppin' : L'on arrive toujours trop tard. On croit que l'on fera une belle flambée, mais les planches serviront pour le cercueil. Le bruit du bois frappé et la voix de Calypso, écho des corvées au pénitencier de Perchman. My Shoes : toute la confiance en le monde que vous pouvez avoir repose en les chaussures d'Archie. Un chant d'espérance. Jusqu'au prochain tournant où nous pataugerons dans la boue du blues.
+ Quatre pistes du 45 tours.
Did You Stop Loving Me Baby ? : La voix comminatoire d'Archie, ne menace personne en particulier mais plutôt tout le monde. Le désir c'est comme la vie, ça vous tombe dessus comme un vol de corbeaux sur une charogne. S'envolent une fois satisfaits. Derrière le band fait un boucan d'enfer, peut-être pour que l'on n'entende pas. I've Played Boogie in Your Garden Man : très News Orleans, le plouc qui est descendu de ses campagnes à la ville et qui n'en finit plus de faire le fiérot. La vie est parfois cruelle pour les uns et pas pour les autres. Get a Job Man : L' a trouvé un boulot. L'est tout content. S'il savait, il mettrait la pédale douce. L'optimisme du pauvre. Whithout One Million : l'est temps de mettre les bouts du blues, le solo de guitare vous arrache les tripes.
+ un titre enregistré à la maison
Take your Time Lord : pour fêter la naissance du petit dernier, et la voix du bébé qui prend la place de l'harmonica. Surtout prends le temps de vivre. Toute la famille Loison s'y met. Tout est mal qui finit bien. Le blues n'est que l'autre couleur de l'azur.
Jake Calypso et Archie Lee Hooker ont décidé de booster le blues. Batterie omniprésente, et les guitares qui se font une rave-party par-dessus. Racontent de tristes histoires. Avec une dose d'humour noir. Le blues tel qu'il n'existe plus, le blues tel qu'il existera toujours. Des femmes, de l'alcool, du travail et du chagrin. Toute la vie, avec la mort qui rit jaune dans les coins les plus obscurs. Entre roots'n'blues et roll'n'blues. Une réussite.
Damie Chad.
DOCUMENTS GENE VINCENT

SLC / GALERIE DES PIONNIERS
GENE VINCENT "be bop a lula"
fr.calameo.com/read/000090804552d79f58f85
Ce n'est pas le document du siècle. Apparemment un extrait des archives de Salut Les Copains. Une page de texte remplie d'inexactitudes mais les légendes se construisent aussi sur des approximations... Pour ceux qui ne connaîtraient, pas allez voir sur Gene Vincent, dieu du rock'n'roll de Jean-William Thoury ou le There's One in Every Town de Mik Farren, traduit par notre Cazengler préféré, tous deux publiés au Camion Blanc. Par contre, la seconde page est nantie d'une superbe illustration, pas une photo, mais un portrait à la manière de ceux que l'on trouve accrochés sur les murs des westerns. A voir sans faute.
SWEET GENE VINCENT
DOUGLAS McPHERSON CELEBRATES
THE AMERICAN BLACK LEATHER REBEL
THAT BRITAIN TOKK IN HIS HEART
fr.calameo.com/read/00009080499c1ef4838
Quatre pages, des documents photographiques ultra-connus, rédigé en anglais. Pas l'ouvrage de fond que vous attendiez. Non, mais McPherson a du style. Ecrit bien et empoie les formules qui font mouche. Dresse un beau portrait de Gene, sans concession et sans enjoliveurs. Une vision très british, avec Stray Cats et Ian Dury à la clef. La dévotion des fans français pour le dieu du rock'n'roll, il s'en fiche comme de sa première audition des valses de Vienne. Mais on lui pardonne, pour le plaisir de lecture qu'il nous procure : « I'm looking for a woman with a one track mind' » as Gene pants, in the manner of a deshydrated man crawling accross the desert in searh of an oasis... vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans, la moiteur du sexe, le no-control drugs, et le rock'n'roll le plus inquiétant jamais enregistré. A punaiser dans votre chambre, au-dessus de votre lit.
GENE VINCENT
BIG BEAT N° 23
Novembre 2016
fr.calameo.com/read/00009080455690474332b1
Les rockers sont des gens insupportables. Ils tiennent leurs promesses. Vous signalai en tête de la livraison de KR'TNT ! 297 la parution après trente années d'interruption de la revue Big Beat désormais visible sur le site calameo. C'est d'ailleurs en recherchant le contenu du numéro de novembre que j'ai trouvé les deux publications présentées ci-dessus.
Certes beaucoup de documents déjà vus ou lus un peu partout, notamment sur Roll Call, mais un topo irremplaçable sur la tournée de Gene Vincent, en France, en 1967. L'on y retrouve, tous ceux qui ont tenu la pérennité de Gene en notre pays à bout de bras. Des idéalistes, des bras cassés, des fous furieux, nommez-les comme vous le voulez. Nous préférons leur rendre hommage et les remercier pour ce qu'ils ont osé entreprendre. Des amateurs, au sens noble du terme. Avec la touche foireuse qui va avec, ce Do It Yourself que nous préférons à l'efficacité des adeptes du professionnalisme, qui n'étaient plus là. En furent pour leurs frais et leurs illusions. Mais la gloire n'a pas de prix.
Gene n'était pas facile. Un fauve blessé, qui ne baissait jamais la garde, toujours en alerte, sur le qui vive dès qu'il sentait à tort ou à raison la situation lui échapper. Un merveilleux compagnon aussi, mais rarement, lorsqu'il estimait être en sécurité. Un solitaire, qui exerçait une profession de contacts humains. Un outlaw de l'intérieur.
Bref c'est à lire. Emouvant et désopilant. Cette notion de grotesque chère à Edgar Poe. Qui s'insinue dans la tragi-comédie de nos existence. Un bel hommage à Gene, tel qu'en lui-même les fans gardent le souvenir et la présence.
Damie Chad.
I, DANIEL BLAKE
KEN LOACH
( film / 2016 )

Un film monstrueux. Pour amateurs de sensations fortes. Pas d'araignées géantes, pas de zombies sortis de leurs tombes, pas de scènes de bataille homérique, pas de situations exceptionnelles, pas d'action. No happy end, ni sentimentalisme bêlant déplacé. Toutefois vous ne trouverez rien de plus violent, de plus glacé, de plus impitoyable dans vos salles de cinéma. Ni de plus humain.
Le film que Ken Loach aurait aimé ne pas avoir à faire. L'avait raccroché. Plus de trente films au compteur, à près de quatre-vingt balais comptait prendre une retraite méritée. Mais l'on est venu le rechercher. Qui ? Personne. Surtout pas les instances cinématographiques de son pays, l'Angleterre. Qui ne l'aime guère. Qui ? Tout le monde. Les gens que vous rencontrez dans la rue. Qui nous ressemblent. N'a jamais caché ses sympathies trotskistes Ken Loach. Révolutionnaire et militant. N'a jamais cherché à distraire le peuple, mais à l'instruire, en lui mettant sous les yeux la réalité dans laquelle il tente de survivre.
Pour les décors, pas de frais, quelques rues et deux appartements miteux. C'est peu mais amplement suffisant. Pour le sujet, les tribulations d'un prolo anglais dans les méandres de l'administration anglaise. Normal, le film se passe en Angleterre. A part qu'en le visionnant vous vous dites qu'il pourrait très bien se dérouler dans beaucoup de pays de notre planète, et cerise empoisonnée sur le gâteau sans sucre auquel il manque la farine et les oeufs, en France.
Une histoire de rien du tout. Une vie minuscule. Mais d'une folle modernité. Tout se passe par ordinateur. Un prolo anglais, veuf et solitaire qui sort d'une crise cardiaque mais que l'équivalent de notre A.N.P.E bien-aimée déclare apte au travail. Pour le lui faire comprendre l'on commence par lui supprimer ses maigres subsides... Je vous laisse deviner la suite entre Ubu et Kafka. Ni rires, ni pleurs, la vie toute simple. La mouche qui s'englue contre le carreau de la fenêtre qui ne la laissera pas passer. Ça n'arrive pas qu'aux vieux. Les services sociaux ont expédié à Newcastle, une mère seule avec deux gamins. La misère s'attaque aussi à la psyché des enfants. Les adultes se débrouillent comme ils peuvent, paient de leur personne ou s'adonnent à des petites combines qui essaient de court-circuiter l'ordre marchand et libéral.
Qui sait se défendre. Possède ses services sociaux d'une cruauté inhumaine. Tout est fait pour vous posséder de votre fierté. Humiliation bureaucratique. Si vous tentez de lever le doigt le système possède ses vigiles et ses chiens de garde. En dernier recours la police s'occupe de vous. Toutes les issues sont bloquées et vous n'en forcerez aucune.
Vous ne pouvez compter que sur vos propres forces. Maigres et déclinantes. L'entraide avec les voisins, la sympathie que de rares individus vous manifestent réchauffent votre coeur mais ne sont pas très efficaces. Un réconfort moral ne vous donne pas à manger. La dignité ne nourrit pas son homme. Ne resterait qu'une solution, la colère. Mais celle d'un homme seul est vite jugulée. Ken Loach ne nous laisse aucun espoir. N'esquisse aucune solution. La solution révolutionnaire n'est même pas évoquée. Il est trop tard. Parquez les indiens dans une réserve et laissez-les se déliter de l'intérieur. Dormez sur vos deux oreilles, ils n'en ressortiront plus. Les pauvres sont confinés dans le no man's land des inutilités sociales. L'on aimerait les laisser tranquilles, mais ils coûtent cher. Sont comme des animaux nuisibles, ces souris qui dans la cave s'en viennent grignoter un paquet de biscottes. Une atteinte insupportable à votre droit de propriété. En l'absence de camps de concentration ou de troisième guerre mondiale, ont intérêt à ne pas faire trop de bruit. N'est-ce pas déjà beaucoup que de les laisser vivre ? Ne serait-ce pas plus humain de les éliminer avant qu'ils ne souffrent trop ?
Allez voir ce film, un complément indispensable à Skinheads de John King ( voir KR'TNT ! 297 du 06 / 10 / 16 ) et à Anarchie au Royaume-Uni de Nick Cohn ( cf : KR'TNT ! 299 du 20 / 10 16 ). Une ultime remarque, chronologiquement parlant, selon une frise historique des cinquante dernières années, I, Daniel Blake se classe tout à la fin. Se déroule de nos jours. Actualité pure. Ces trois ouvrages relatent une descente prodigieuse, une chute vertigineuse des conditions de vie des classes prolétaires. Ce constat sans appel de la situation présente est un véritable ouvrage d'anticipation qui vous ouvre les yeux sur le déroulement de vos conditions de vie dans les dix prochaines années. Il sera alors inutile de venir vous plaindre en disant que vous ne saviez pas. Lâcheté et passivité sont de mauvaises conseillères.
Damie Chad.
11:42 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/11/2016
KR'TNT ! ¤ 302 : FU MANCHU / HOWLIN' JAWS / TONY TRUANT ET LES GRYS -GRYS / DU ROCK'N'ROLL
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 302
A ROCKLIT PRODUCTION
10 / 11 / 2016
|
FU MANCHU / HOWLIN' JAWS TONY TRUANT ET LES GRYS-GRYS DU ROCK'N'ROLL |
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 04 - 10 - 2016
FU MANCHU
Fu Manchu n'est pas manchot

Fu Manchu ? Voilà un groupe coupé en deux. On a l’avant et l’après Eddie Glass.
Eddie Glass appartient à cette caste des Guitar Gods, ces gens capables donner une vraie identité à un groupe. Non seulement Eddie Glass a inventé Fu Manchu (puis Nebula), mais il se pourrait bien qu’il ait aussi inventé le stoner, qui, lorsqu’il est inspiré, s’inscrit dans une lignée qui remonte à Leigh Stephens, et donc Blue Cheer, et à John Du Caan, celle d’un heavy heavy heavy blues rock. Le Graal des seventies. Le graas des seventies, devrait-on plutôt dire.

Les deux premiers albums de Fu Manchu sont des classiques imparables. Dès, No One Rides For Free paru en 1994, Eddie Glass brisait la glass. Il fondait même toute la banquise avec ce cut génial qu’est «Time To Fly» - I’m gone bye bye I’m gone - pas de meilleure introduction au monde magique du stoner de dieu. S’ensuit un «Ojo Rojo» gavé de son comme une oie ou un âne, on ne sait plus, en tous les cas Eddie lâche son paquet de mélasse et ça splashe. C’est l’un des plus gros dépoteurs d’Amérique. Il continue de faire son festival de la vasouille du gras double dans «Show And Shine». It’s rainin’ cats and dogs, oh oui, ça pleut à verse. Encore une belle bouse d’heavyness avec «Mega Bumpers». Quand Eddie rôde dans les parages, on ne rigole plus. En B, on renoue avec le heavy doom de stoner glassique grâce à «Superbird». Eddie nettoie tout ça à la wha-wha. Ce mec est tellement bon que tous les cuts finissent par sonner comme des classiques. Le «Snakebellies» qui referme la marche sonne comme une fondue stoner à la Belle Hélène. C’est du son tellement gras qu’il finit par couler. Eddie attaque par tous les côtés à la fois. Quel carnage ! Il faut l’entendre tortiller ses tortillettes, ramoner ses gammes, dépoter ses bronzes, il fait tout ça en même temps, en plein cœur des fumées et des odeurs du grand œuvre libératoire.
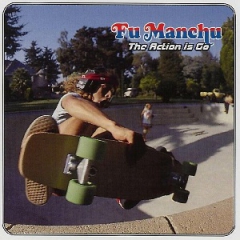
Le festival se poursuit dans l’excellent Daredevil, avec sa pochette ornée d’un buggy en plein saut de dune, comme celui de Steve McQueen dans L’Affaire Thomas Crown. Tous les ingrédients du stoner accourent au rendez-vous de «Trapeze Freak» : le gras double, le chant angelino, la lourdeur pathologique et la fumée spirituelle. Eddie amène «Tilt» au gimmick vicelard - Feeling so fine - et le groupe cède au vertige du garage. Eddie s’amuse ensuite à concasser «Gathering Speed». C’est gagné d’avance. Ils fondent le chaos avec un étrange sang froid. Tout le heavy rock des seventies est là. Quel album ! Il faut aussi les entendre swinguer la tourbe dans «Coyote Duster» et faire vomir le pauvre «Travel Agent». Si on veut voir un cut dégueuler du son, c’est là. Et si on apprécie le beat ralenti du bulbe, on se régalera de «Sleestak». Mais la vraie heavyness se trouve de l’autre côté, avec deux cuts faramineux, «Egor» et «Wurkin’», surjoués dans le riffing, ramollis dans le caoutchouc, coulants comme un gros Brie oublié sur une terrasse, à Marrakech. Eddie le diable se faufile comme un serpent dans toutes cette matière de son liquide. Il attaque enfin «Push Button Magic» au riff de Neanderthal. C’est d’une puissance qui dépasse le rock. Eddie n’en finit plus de surjouer le surjeu.

Fin de l’âge d’or Fu Manchu avec In Search Of. Quasiment tout est bon là-dedans. C’est Eddie qui régale. Avec «Missing Link», on nage dans la crème au beurre du bonheur, dans une mousse de gras qui colle parfaitement à l’idée qu’on se fait du heavy rock. On assiste à une belle déroute de l’armée du rock dans une Bérézina de bouillasse sonique. Voilà ce que développe l’infernal Eddie. Il fait de cet album un épouvantable classique. Avec «Asphalt Risin’», il s’attaque directement à la saturation du son. Il n’en finit plus de grimper sur la brèche, il lâche sa purée cosmique à jets continus. Quel troupier ! Le carnage se poursuit avec «Cyclone Launch», broyé d’entrée. Eddie l’écrabouille. Il atteint la cime du stoner californien. Les autres aèrent avec des passages joués à la cloche du père fouettard. Eddie rôde comme un loup affamé, long, fin et baveux, il joue dans son ombre et plombe l’histoire du rock avant de partir en solo de wha-wha. C’est tout simplement exceptionnel. Back to the heavyness of it all avec «The Falcon Has Landed». Avec Eddie, ce groupe devient imparable. Scott Hill chante sur la marche lente du beat et au cœur de l’infernabilité des choses, notre héros Eddie part en solo de rêve. On le retrouve sur «Seahag» en éclaireur franc-tireur overdosé. C’est comme s’il épaulait un vieux fusil à bison et que le son sortait liquide au bout du canon. Ils bouclent cet album à fumerolles avec un «Supershooter» bardé d’accords wha-whateux. Eddie joue comme un forcené. Il part en solo sans prévenir et s’en va consterner la postérité qui n’avait rien demandé à personne.
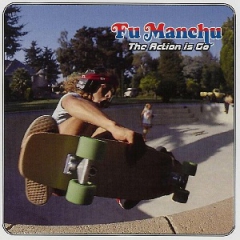
On entre dans l’après-Eddie Glass avec The Action Is Go. Le petit Bob Balch le remplace. On trouve quand même deux belles énormités sur cet album : «Hogwash» et «Grendel Snowman». Là on ne rigole plus, car Hogwash se montre digne des grands hits de Monster Magnet, avec son brouet baveux et les solos gras de Bob la bête qui filent à l’échappatoire. S’ensuit un Grendel monté sur un pur heavy groove de stoner et visité par un solo baveux, le merveilleux son de blues-rock dont l’amateur stonerisé jusqu’à l’os du genou est si friand. Ce sont là deux classiques indomptables. D’autres cuts sont devenus des classiques de Fu Manchu, mais ils banalisent un peu plus le stoner qui est un genre difficile. Exemple avec «Evil Eye» qui sonne comme la grosse Bertha et qui ne laissera pas de trace dans l’histoire. Côté mise en place, c’est parfait, mais il manque l’étincelle fatale. Bob Balch prend un solo complètement à la ramasse dans le cut suivant, «Unrethane». Il a l’art et la manière, et tout le son du groupe repose sur lui, désormais. Il sait se montrer entreprenant, surtout lorsqu’il écrase sa cry-baby d’un coup de talon rageur. Dans le morceau titre, c’est Brad Davis le bassman qui emporte le challenge, même si Bob graisse bien les choses. Ils ont tout bon, le son, l’esprit. Quelle équipe de Stormers du Stoner ! Leur principal atout reste le son. Encore un classique avec «Guardrail», joli brouet de boogie down et ils tapent «Anodizer» au gras double ralenti, avec des petites dynamiques internes. Tout l’art du stoner y passe, même les effets d’hypnose à la petite semaine. Ils savent flatter les oreilles blue-cheerisées, comme on le constate à l’écoute de «Strolling Astronomer» et dans «Saturn III», Bob Balch se couronne roi du solo liquide, vous savez, celui qui s’écoule comme une rivière de miel à travers la vallée des plaisirs.

L’amateur de stoner trouvera sa dose sur (Godzilla’s) Eating Dust, surtout avec «Godzilla», ses histoires de subway train et ses solos tortillards. Belle louche de purée. Belle descente aux enfers du son. Le pauvre Scott Hill tente de freiner - There’s no stop now ! - Trop tard. Voilà un beau spécimen de heavyness - Go Go Godzilla ! - Autre belle tranche de stoner : «Eatin’ Dust», qui fait l’ouverture du bal. Bob se venge sur Eddie, il joue plus fort que lui. Il sort un son qui cogne dans le pulsatif. Oui, il pousse le son dans ses retranchements, ce qui n’est jamais bon pour sa santé. Il joue si dru que ça devient immoral. Et ça continue avec «Shift Kicker», tout est poussé à douze sur les potards des nanards. Ils n’ont qu’une seule loi : saturer le son jusqu’à lui faire rendre gorge. Ils le saturent jusqu’à la nausée. Ça grouille de gelées vertes de son et Bob file ventre à terre dans la mélasse. Ils attaquent «Mongoose» à la cloche et au sableur, comme chez Slade et chez Ike - Look inside this glory ride - Ils jouent la carte de l’hyper-catégorique avec the mongoose guys et ça se met à exploser pour de bon. Ils savent faire monter une sauce et Bob revient inlassablement gratter son riff. Il joue carrément des clameurs de riffs incendiaires. On voit des couches se superposer. Puis ils explosent le pauvre «Pigeon Toe» contre le mur du son. Ils sont complètement tarés de jouer aussi fort. Mais bon, ils aiment bien ça. Au moins pendant qu’ils s’amusent, ils ne font pas de bêtises.

C’est donc cette équipe qu’on voit débarquer au 106 par un beau soir d’automne. Comme tous les californiens d’un certain âge, Scott Hill affiche un look de mec bien conservé. Il chante jambes écartées, en dessous du micro, comme Lemmy.

Il tient bien son rôle de leader et gratte une belle guitare transparente, avec la niaque d’un gamin de quinze ans. Forcément, pour un mec qui a passé la cinquantaine, ça impressionne. Scott Hill se comporte comme tous les mecs qui traversent les décennies à la tête d’un groupe : en vaillant guerrier, sûr de sa force et de son art.

Même si Eddie Glass s’est barré, Scott Hill continue d’y croire dur comme fer. Il s’appuie sur un son et douze albums dont les quatre premiers sont devenus légendaires. Fu Manchu attire un public spécifique : les fans de stoner. Ni metal ni punk, c’est encore autre chose. Mais la fibre du fan est la même, au fond. On voit des mecs au premier rang chanter toutes les paroles en chœur avec Scott Hill, comme lors du set des UK Subs, quand un mec chantait tout avec Charlie Harper.

Le petit Bob Balch s’est laissé pousser les cheveux et avec sa barbe, il traîne un bon look de freak californien. Il sort un beau son gras sur sa Les Paul et c’est toujours un régal que de voir cocoter les grands guitaristes américains. On sent que Scott Hill fatigue, il prend un peu de temps entre chaque cut pour se reconstituer. Il faut savoir que le job de chanteur guitariste dans un groupe n’est pas de tout repos.

Avec une discographie comme la leur, c’est un jeu d’enfant que de monter une set-lit. Ils ont largement de quoi faire sauter une sainte-barbe. C’est un peu comme Motörhead, les Vibrators ou Chuck Berry, ils n’ont que des classiques à proposer, mais pour ce concert, ils jouent tout l’album King Of The Road, avec un pic de tension au moment de «Blue Tile Fever». What an album, dirait un lapin blanc britannique.

On note au passage que les Fu Manchu ont un faible pour les voitures. C’est pour ça qu’on les retrouve sur les pochettes des albums. Pour King of The Road, ils ont choisi une file de Fords Transit. Et on trouve quatre énormités bien dodues dans ce disque. «Over The Edge», joué au heavy riffing, aux placards de distorse et chanté à la Sabbath. Ces mecs là ne veulent pas se casser la tête : du gros riff de barré sur le Marshall stack en stock et hop, c’est parti. C’est sans surprise et ça roule sous la peau du son. Bob passe un solo dans le cambouis - The more we see the more we know - Et ça vire au solo de surface à la Ron Asheton. Ils battent le morceau titre en brèche et se ressourcent dans la fosse à vidange. Ils chantent ça à deux niveaux et flirtent avec le garage. Résultat plutôt dévastateur. Bob attaque «Hotdoggin’» au heavy et on croit entendre la voix d’Ozzy dans l’écho. Quel bel hommage. Puis ils montent «Freedom Of Choice» au beat des enfers de Dante, mais pas le Dante à la con des poèmes, on est ici dans le stoner du cornu, et Scott Hill chante comme un Anglais, c’est saturé de son et soloté à la bonne bourre. Avec le fumeux «Boogie Van», ils créent une fois de plus l’illusion. Ils grouillent d’idées et raffolent d’aventures. On se régale aussi de «Blue Tile Fever» monté sur un heavy beat pointé à la cloche. Ils connaissent toutes les ficelles. C’est un peu comme s’ils n’avaient plus rien à apprendre. Et nous non plus.

Comme on l’a vu, ce groupe est excellent sur scène. Ce que confirme l’album Go For It Live. Ça blaste dès «Laser Blast», stomp de stoner stoned, complètement allumé aux gimmicks hendrixiens. C’est Bob qui fait tout le boulot. Il double le chant avec sa guitare. Il joue même le pyromane. C’est un teigneux qui ne recule devant aucun excès. Et pouf, ils enchaînent avec le gros «Asphalt Risin’». Bob navigue à la surface du temps. Tout l’intérêt de Fu Manchu se trouve désormais dans le harcèlement sonique de Bob. Ils s’amuse à pulvériser tous les cadres, tous les formats. Il ouvre le bal de «Mongoose» et le noie de son. Et ça continue comme ça sur deux disques, car c’est un double ! La version de «Boogie Van» vire à l’apoplectique. Bob passe un heavy riffing de rêve sur «Ojo Rojo», miracle stoner d’efficacité définitive, cocoté en diable. Et la version de «King Of The Road» sonne comme un hit de Steppenwolf, avec sa belle épaisseur riffique. Puissant et visité, bien excité par le cocotage. Sur le disk 2, on trouve une superbe version de «Hang On» martelée comme un chemin de croix, puis un «Wurkin’» joué au groove de stoner - an old song - Bob le tartine de saindoux. Ils se montrent une fois de plus totémiques. Et on retrouve la belle pulsasivité oblongue de «California Crossing». Ça file très vite sous le vent. Ces gens-là ne font pas semblant. Ça pue le soleil de Californie, les gens bien nourris et les peaux hâlées. Ils vont vite. Puis Bob nous graisse la patte d’«Over The Edge» et il refait le show avec ses solos. Véritable assommoir que ce «Regal Begel» bardé de son, incendié de la plaine, wha-whaté jusqu’à la moelle des os. Et ça culmine avec «Godzilla» qu’on voit marcher sur la ville. On entend des clameurs extraordinaires, c’est le hit de Fu Manchu. On retrouve aussi le fameux «Weird Beard» d’allure fatale. Les falaises de marbre s’écroulent dans le lagon argenté.

On trouvera encore du bon matraqué du cortex dans California Crossing paru en 2001, avec un beau pick-up rouge sur la pochette. On y retrouve ce cher «Mongoose» joué à la cloche de bois. Pour l’amateur de stoner, c’est du gâteau. Bob nous barde le morceau titre d’une belle palanquée d’accords fourrés au chocolat, puis il visite le cut avec un solo aérien et s’octroie une petite crise universaliste au passage, histoire de lâcher quelques clameurs. Joli cut que ce «Wiz Kid» claqué aux petits accords efflanqués. Scott Hill refait son Ozzy. On reste dans le haut de gamme, c’est même assez affolant de nothing yet. Tout aussi énorme, voici «Ampin’», hanté par le fantôme de la heavyness. On a l’impression qu’ils avancent mètre à mètre, comme dans un combat de rue à Stalingrad. Mais Bob passe un solo gras qui nettoie tout. De toute manière, le gras règne sans partage sur tous ces morceaux. Le mot maigre ne fait pas partie de leur vocabulaire. Ces gens-là ont une certaine forme de savoir-vivre. Ils terminent l’album avec un «The Wasteoid» trop heavy pour être honnête. Aucun espoir de maigrir un jour. Le cut s’enfonce dans le saindoux.

Désolé, mais Start The Machine est encore un disque énorme. Pour six raisons précises. Un, «Written In Stone» qui starte la machine et qui se grave aussitôt dans le marbre. Comme à son habitude, Bob gratte comme un dératé et part en virée wha-wha. Ils ont de l’énergie à revendre, c’est sûr ! Deux, «I Can’t Hear You», ce qui semble logique, vu le bruit qu’ils font, mais Bob joue un solo au chalumeau perceur de coffre. Trois, «Understand», monté sur un stomp de stoner. On croirait du glam. Quatre, «Make Them Believe», heavyness de la meilleure augure. On peut même parler de génie, dans ce cas. Ils se couronnent pour l’occasion rois du stoner à la cathédrale de Reims. Et Bob arrose tout ça d’un beau solo liquide. Cinq, «Open Your Eyes», qui n’est pas celui des Nazz. Ces mecs-là ne voudront jamais enterrer la hache de guerre. Tout ce qui les intéresse, c’est de s’énerver. Leur cut va vite, c’est de l’ultra-blast. Six, «I Wanna Be», stompé aux drums, une belle façon de tirer sa révérence.

On sent une petite baisse de régime dans We Must Obey paru en 2007. Oh bien sûr, on retrouve le flic floc de l’épaisseur, les solos déflagratoires, mais tout ça finit par ronronner. Le hit du disk s’appelle «Land Of The Giants», riffé comme il se doit d’entrée de jeu, malin et malsain. Presque garage en eaux sales, car tempéré au heavy shuffle. Bob joue en suspension de notes congestionnées et ça vire en terminal de non-retour. Quelle monstruosité ! On a aussi une petite heavyness de derrière les fagots du désert avec «Let Me Out». Bob y passe un fascinant solo qui court comme le furet dans le canyon éclairé par la lune. On sent parfois que le son se muscle encore, comme c’est le cas à l’écoute de «Hung Out To Dry». Comme s’ils visaient une sorte de démesure de la heavyness. Bob nous roule tout ça dans sa farine bien grasse. Quand il attaque un solo, il fait toujours penser à l’aigle royal qui fond sur sa proie. «Shake It Loose» sonne comme du Motörhead, mais en plus sur-pressé, dans le high energy blasting de blow-outisme patenté. Les Américains savent cultiver la démesure.

Signs Of Infinite Power est un album chargé à ras-bord de stoner apocalyptique et de beat obsessionnel. Pas de hit ici, mais du Sabbath cosmique épais à souhait et ralenti dans les virages («Steel Beast Defeated»), du Fu Manchu détaché de la terre et perdu dans le nulle part de groupes qui ne servent plus à rien («Against The Crowd»), du glam stomp qui fait illusion un court instant («Webfoot Witch Hat»), du riff broyeur chauffé au bec benzène («Eyes X10»), du no brain at all, du stoner sans horizon («One Step Too Far»). Bob tire son épingle du jeu dans le morceau titre. Sans lui, on crèverait d’ennui.

Dernier album en date, voici Gigantoid, avec sa belle pochette surréaliste. Nos amis attaquent avec un «Dimension Shifter» tendu et sauvage comme l’étalon du même nom. Encore une fois, toutes les ficelles du stoner accourent au rendez-vous. Même le break est plus lourd que le plomb. Dans «Invaders On My back», Bob prend un killer solo. Pas facile de remplacer un gars comme Eddie Glass, pas vrai Bob ? Quand on écoute «Radio Source Sagittarius», on se dit que les voies du stoner sont souvent impénétrables. Elles suivent en effet les méandres d’un fleuve qui se perd dans le continent. On dresse l’oreille en B à cause d’«Evolution Machine». Nos amis chargent comme la brigade légère sous le feu des artilleurs russes. Sans peur et dans reproche, et comme d’usage, Bob fait des miracles avec sa confiture de fraise. Puis il remonte bien les bretelles de «Triplanetary». Brad en profite pour faire un beau numéro de basse. Il passe même devant dans le mix. On voit qu’il adore gratter ses cordes. Et ça se termine avec «The Last Question», un cut monté sur une lourde progression riffique, légèrement retardée par des semelles de plomb. Mais c’est leur truc. Ils raffolent des semelles de plomb. Avez-vous déjà essayé de marcher avec des semelles de plomb ? C’est pas facile. Eux, ils adorent ça. Ils adorent traîner dans ces lumières crépusculaires, dans ce paysage de planètes tombées du ciel comme des dés d’une table de jeu. Ils contemplent ce joyeux capharnaüm et savent au plus profond d’eux-mêmes qu’un coup de dés jamais n’abolira le hasard.
Signé : Cazengler, Fou manchot
Fu Manchu. Le 106. Rouen (76). 4 octobre 2016
Fu Manchu. No One Rides For Free. Bong Load Records 1994
Fu Manchu. Daredevil. Bong Load Records 1995
Fu Manchu. In Search Of. Mammoth Records 1996
Fu Manchu. The Action Is Go. Mammoth Records 1997
Fu Manchu. (Godzilla’s) Eating Dust. Man’s Ruin records 1999
Fu Manchu. King Of The Road. Mammoth Records 1999
Fu Manchu. California Crossing. Mammoth Records 2001
Fu Manchu. Go For It Live. Steamhammer 2003
Fu Manchu. Start The Machine. DRT Entertainment 2004
Fu Manchu. We Must Obey. Century Media 2007
Fu Manchu. Signs Of Infinite Power. Century Media 2009
Fu Manchu. Gigantoid. At The Dojo Records 2014
De gauche à droite sur l’illusse : Brad Davis, Scott Hill, Bob Balch et Scott Reeder.
GAZON MAUDIT
Je vérifiais le résultat de ma dernière invention. Ma modestie dût-elle en souffrir je devais convenir que la réussite s'avérait totale. Devant moi s'étendait une étendue de terre battue. Enfin ! Après des années d'efforts opiniâtres et de recherches incessantes j'avais réussi. Pas une herbe, pas un brin, même pas un cône de taupe ! Demain, ne me resterait plus qu'à déposer le brevet du produit. Une graine nouvelle, enrichie au napalm et à l'agent Orange. Vous épandez à pleines mains sur la surface incriminée et vous êtes tranquille – garantie pour deux millénaires – grâce à mon Gazon Attila, plus rien ne repoussera. Le moindre papillon qui s'en viendrait à voleter au-dessus de la zone tombe mort au deuxième battement d'ailes. J'avoue que le simple dégoût de passer toutes les semaines la tondeuse dans le jardin était la prosaïque raison qui m'avait motivé. Mais à la réflexion, je m'apercevais que j'avais mis au point l'arme écologique absolue. Désormais les paysans détenaient la possibilité de bloquer le développement des néfastes semences Monsanto. De facto inopérantes.
Donc disais-je je contemplais avec la satisfaction du devoir accompli les deux mille mètres carrés de pelouse avégétalisée lorsque un bruit inopportun me tira de ma méditation. Sacrebleu ! un hélicoptère frappé d'une cocarde tricolore abordait les premières manoeuvres d'atterrissage. Même pas le temps de rentrer à la maison pour m'emparer de mon bazooka ( oui, je dors toujours avec un bazooka sous l'oreiller, l'on n'est jamais trop prudent ) que j'étais entouré d'un groupe de commandos.
« Messieurs, vous faites erreur, ceci n'est pas l'aéroport militaire, mais une parcelle privée entretenue avec le célèbre Gazon Attila.
- Vous êtes bien, le sieur Damie Chad, ancien agent du SSR, Services Secrets du Rock and roll !
- Oui je...
- Parfait on vous embarque. Direction l'Elysée, ne rouspétez pas, le Président vous demande, c'est urgent »
Bref trois quarts d'heure plus tard le Puma me déposait dans la cour d'honneur du Palais Présidentiel.
Je montai en courant les degrés du perron Elyséen et me précipitai vers les grandes portes. En passant je crachai sur le gendarme en faction – que voulez-vous tout le monde déteste la police – un chambellan me héla : « Arrêtez vos facéties. Dépêchez-vous, le Président est dans son bureau, deuxième porte à droite, au fond du couloir. »
C'était la grande réunion de crise, des ministres apeurés qui compulsaient frénétiquement leurs dossiers, des généraux chamarrés comme des arbres de Noël aux visages tendus, des larbins qui déroulaient une carte du monde sur le mur, et des soubrettes toute mignonnettes qui couraient dans tous les coins, visiblement à la recherche de quelque chose. Personne ne mouftait. Le Président n'était pas content, ne s'adressait en personne en particulier mais chacun se sentait visé par son ire vindicative :
« Bordel de dieu de putain de merde, où l'ai-je encore mise, trouvez-la tout de suite, je vais vous les dégommer ces japs de merde, me faire ça à moi, c'est une insulte à la France, c'est...
- Monsieur le Président, je l'ai retrouvée, elle était sous le porte-parapluie ! »
L'était toute fière la jouvencelle, mais sans un regard le Président lui arracha la valise des mains et la déposa devant lui. Il s'éclaircit la gorge et prit un air grave :
« Messieurs, vous assistez à l'écriture de l'Histoire, dans dix secondes j'appuie sur le bouton et je raye le Japon de la carte. Je ne veux aucun survivant, cette sale race de rastaquouères jaunâtres n'aura même plus le plaisir de se rappeler d'Hiroshima. Je compte jusqu'à dix et hop je les envoie au paradis. Un, deux, trois...
- Hum, hum ( c'était le toussotement nerveux du plus décoré des généraux ) certes le geste a du panache, mais ne règle en rien l'affaire, Monsieur le Président !
- Comment cela, expliquez-vous, maison close cacapouïque ! c'est à croire que je suis entouré d'incapables !
- Si vous envoyez les bombinettes, ils seront eux aussi victimes de notre action. Vous imaginez les rires des ruskofs et des amerloques ? Vont se moquer de nous pendant dix ans !
- Lupanar de fientes d'autruches, je n'y avais pas pensé, et vous avez raison. Que faire, que me proposez-vous alors ? »
Il y eut un silence de mort. Une minute qui dura un siècle. Je ne comprenais rien, et me faisais tout petit dans mon coin.
« Tant pis. Ne pas agir serait pire. Sûr que les Popovs et les Ricains se moqueront, mais les Chinetoques ne seront pas fâchés que je raye leur ennemi héréditaire de la terre. Stratégiquement, c'est jouable. Bon je continue, quatre, cinq, six – l'était content de sa leçon de géopolitique le prés, prit le temps de poser son sourire béat sur l'assistance – mais qui êtes-vous là dans votre coin ? Ne seriez-vous-pas un espion, qu'on me le fusille tout de suite, sept, huit, neuf...
- Hum, hum ! Monsieur le Président, c'est le spécialiste du Rock'n'roll que vous aviez demandé. Monsieur Damie Chad, expert es rock'n'roll, me semble être l'homme de la situation. Sans doute pourrions-nous lui accorder deux minutes pour qu'il nous donne son avis. C'est un ancien du SSR, peut-être serait-il à même de débrouiller l'affaire sans que nous parvenions à la toute extrémité de votre décompte, Monsieur le Président ?
- Pour vous servir, Monsieur le Président, mais quel est le problème ? Pourrait-on me mettre au courant ?
- Hum, hum, afin de rééquilibrer en notre faveur la balance commerciale entre nos deux pays, nous avons entrepris une action de séduction envers le Japon. Nous leur avons envoyé nos orchestres philharmoniques les plus renommés, nous leur avons prêté des collection entières du Musée du Louvre, sans résultat. A croire que les japonais sont insensibles au rayonnement culturel de la France !
- C'était une erreur -explosa le Président - ces vermines de Japs sont des sauvages. Qu'attendions-nous de bouffeurs de poissons crus ? C'est alors que nous est venue une idée mirifique. A ces sauvages, l'on a bazardé de la musique de sauvages. Et hop, nous leur avons expédié les Howlin' Jaws. Jamais entendu parler mais la fille de la concierge nous avait assuré qu'il n'y avait pas plus « friteux » sur la région parisienne. Le résultat ne s'est pas fait attendre au bout de trois concerts, ces satanés japs nous ont commandé deux porte-avions et trois escadrilles de Rafales.
- Monsieur le Président, je ne saisis pas le problème. Apparemment vos espérances les plus folles ne sont-elles pas comblées ?
- Plus que vous ne croyez, hier ils ont encore passé commande de deux Frégates et de trois sous-marins. Mais ce matin, nous ont prévenu qu'ils ne nous rendraient jamais les musiciens. Sont trop bons qu'ils disent ! Doivent produire une musique de marteaux piqueurs et croyez-moi, si cela ne tenait qu'à moi, je les leur laisserai sans problème. Mais vous entrevoyez la honte internationale : trois jeunes français retenus en otage par le Japon. Déshonneur gaulois ! Je vous laisse trois heures pour débrouiller la situation. Après quoi je compte jusqu'à dix et fin du japitre ! Deux bons coups d'une même pierre, on se débarrassera des Japs et de trois jeunes sauvageons qui ne savent plus quoi faire pour casser les oreilles de leurs concitoyens ! »
Trois heures plus tard.
« Mission Ippon Nippon accomplie, Monsieur le Président, les Howlin'Jaws rentreront en France à l'heure prévue. La négociation a été rude. Mais depuis la tournée de Gene Vincent au pays du Soleil Levant en 1959, le SSR a toujours gardé des relations amicales avec les services secrets japonais. Je vous passe les détails. Les discussions furent âpres. La France s'en tire bien, les Japs respecteront leurs commandes, ont même demandé en plus dix mille tonne de graines de Gazon Attila qu'ils veulent répandre sur la région dévastée de Fukushima, juste pour arrêter au sol les radiations nucléaires. Par contre, léger bémol, en contre-partie avant de monter dans l'avion les Howlin'Jaws devront donner un concert supplémentaire. Comme ils sont contents de revoir leur famille, ils vous invitent samedi soir à leur concert à l'Olympic Café, à Paris. Seraient très honorés de votre présence, Monsieur le Président.
- Parce que vous croyez que j'ai envie de me faire crever les tympans ! Pas question !
- Monsieur le Président, si je puis me permettre, leur déception sera immense...
- On leur dira que j'ai une réunion importante, un sommet secret des chefs d'état de l'hémisphère sud. Et puis tiens, une deuxième bonne idée, c'est vous-même en personne qui irez leur présenter mes regrets personnels. Je compte sur vous pour emballer le morceau. Et avant de partir, passez au ministère de l'Agriculture, sont intéressés par le Gazon Attila.
- Mes respects, Monsieur le Président
- Tâchez de survivre samedi soir. Nous avons intercepté une dépêche de la CIA, selon leurs agents, les Howlin Jaws sont une calamité rock and roll ! »
Voilà pourquoi ce samedi, j'arrêtai la teuf-teuf, rue Léon, devant l'Olympic Café.
OLYMPIC CAFE / PARIS ( 18°) / 04 – 11 – 16
HOWLIN'JAWS
TONY TRUANT & LES GRYS GRYS
Vaste café l'Olympic, tout en longueur, le sol carrelé avec ces mini carreaux à la mode à la fin des années soixante. Ce n'est que la partir émergée de l'iceberg, au sous-sol se trouve la salle des concerts, front de scène assez large, bar au bas des escaliers dans le fond, loges pour les artistes et fumoir attenant sur la gauche. Personne, j'en profite pour assister à la balance des Howlin'. Le son est plus que bon, fort, très fort, mais pas du tout assourdissant, un miracle d'équilibre. Ce sera ainsi tout le long du concert. Peu de monde mais comme très souvent à Paris, lorsque les lumières s'éteignent la salle se remplit dans votre dos sans que vous en rendiez compte.
HOWLIN'JAWS

Les Howlin' sont sur scène. Paraissent plus grands qu'avant. Une illusion psychologique. N'ont pas aspergé de trente centimètres en trois mois. Ont mûri, ont pris confiance en eux. Faut dire que les évènements s'enchaînent. Une tournée au Japon, une résidence au China Club, une tournée en Belgique et en Allemagne en décembre, l'on sent que c'est bien parti. Le groupe a pris conscience de sa valeur, ne jouent pas du rock'n'roll, comprennent qu'ils jouent leur rock'n'roll. Nuance infime lorsque ce sont les mots qui tentent de la décrire mais qui fait toute la différence lorsqu'un groupe la met en pratique.
Trois sur scène. Djivan derrière son micro girafe, Baptiste à la batterie, Lucas à la guitare. C'est ainsi que ça se passe. Les Howlin' ont résolu l'épineuse triangularisation du trio rock. Ne s'agit plus de plancher sur la sacro-sainte règle des trois unités. Le rock est un transfert d'énergie. Z'ont compris la manoeuvre. D'où ils viennent et où ils vont. Sans oublier le point de passage. C'est cette articulation-là que l'on retrouve systématiquement dans tous les morceaux des Jaws. Les Howlin' c'est la radicalité du rockabilly représentée par Djivan et l'effulgence british opérée par Lucas. Cela vous saute à la gueule dès le premier morceau. Cuttin Out, les tripes à l'air tout de suite. Ne pas perdre de temps dans le swing, directement dans le stomp, Djivan aligne les notes, crescendo, à la suite, c'est la continuité qui crée la ligne mélodique dont on se fout comme une guigne ; à l'autre bout Lucas fait exactement le contraire, les notes il les propulse, une à une, ou plutôt deux à deux, mais jamais à la suite, les lâche par à-coups, le temps d'une ouverture, d'un renversement, d'une brisure. Traduit cela magnifiquement dans son corps. Se fend en deux, une espèce de dérèglement subit d'un centre de gravité que l'on pourrait qualifier de cubiste. Un écartèlement qui fuse du dedans, pour éclater au-dehors. Se cambre, les nerfs tendus, la guitare projetée en avant et les bras en allant qui bougent comme la gueule d'un squale affamé. Musique violente. La mélodie inaudible s'inscrit dans le silence des ruptures. Baptiste hérite peut-être de la tâche la plus lourde. Ses deux acolytes s'expriment sans paraître se soucier de leur concordance. Sont sûrs d'eux pour la simple raison qu'ils savent que c'est Baptiste qui recolle les morceaux de la porcelaine. C'est lui qui leur permet de rester libres. Quoi qu'ils fassent, quelle que soient leurs volitions, lui il amalgame. Fomente l'alliage. Interpénètre les deux métaux que les cordiers martèlent sur leur instrument et c'est lui le batteur qui produit le son de base qui englobe le tout. Le quatrième élément, c'est le chant. Djivan ne chante plus, il joue de sa voix comme d'un quatrième violon. La pose comme une section de trompettes que l'on mixe sur une bande.
The Urge, Oh Well ! King of the surf, Stranger, les Howlin' ont traversé la Manche. Un son de plus en plus anglais. Ceux des premiers temps, quand Animals et Yardbirds avaient entrepris de faire sonner leurs instruments comme jamais auparavant. Un truc tout simple, vous voulez une guitare alors jouez comme s'il n'y avait que vous dans le combo. Ne vous souciez pas des copains, feront de même avec leurs propres bécanes. Un parti-pris qui vous densifie la musique à l'extrême, en contrepartie vous êtes bien obligé de faire méchamment gaffe à ce que démantibulent vos flamboyants si vous voulez en placer une de temps en temps. Une stratégie qui vous prouve que le mieux est l'ami du bien. Un objectif : produire un son. Car le son c'est le groupe. C'est ainsi que Beck, Page, et Mickie Most ont modulé et modelé le rock. Les Jaws effectuent une telle montée en puissance, parce que partis de l'extrémisme rockabilly ils redécouvrent l'esthétique bluesique des anglais.

Un morceau en français, fallait bien un zeste de couleur locale pour les Japonais, alors ils leur ont offert un vieux truc du patrimoine : le Oui je m'en vais de Jaky Delmone. Petit chanteur du début des années soixante. Sympathique. Réservé aux nostalgiques un peu pointus abonnés à Jukebox Magazine. A l'époque en France, les bons guitaristes se comptaient sur les cordes d'une basse. Jackie Delmone, ce n'était pas le démon. Maintenant filez un canasson à un bon cavalier et vous verrez le différence. Les Jaws vous le transforment en surf de la mort sur les plus hautes lames de Californie.
N'y a pas que moi qui apprécie les Jaws, le public s'est rapproché et ça tangue plutôt bien. You got to Lose, That's All Right, Tough Love, Snake your Hips clôturent le concert. Les Jaws changent un peu de braquet, un peu moins brutal et davantage de séquences instrumentales, juste pour montrer ce qu'ils savent faire. Un régal. Terminent sur une ovation.
TONY TRUANT & LES GRYS GRYS

On ne présente plus Tony Truant, une légende du rock français, successivement guitariste des Dogs et des Wampas. Un visage qui accuse l'âge mais une sveltesse de gamin. Une chevelure qui lui tombe sur les épaules, bouclée et crénelée comme la tour de Nesle. Sait ce qu'il veut : des guitares à fond de train et rien d'autre. Doucement et sûrement n'est point sa devise. Professe une dernière fantaisie. Chante en français. Exclusivement en french language. Faut un peu de temps pour s'y accoutumer. L'on a davantage l'habitude de yaourter en un anglais qui se bouffe les mots que de découper la vaste amplitude palatale des sonorités latines de l'articulation des syllabes françaises. Tous Egaux devant l'Asticot, Vérole et Dose de Cheval, permettent d'ajuster les tympans. L'est malin Tony Truant lance le morceau sur un train d'enfer et puis pas fou il laisse l'orchestre se débrouiller pour assurer la route. Lui, dès qu'il se plante devant le micro il passe en rythmique et allez les petits jeunes, c'est le moment de foncer tête baissée. N'a pas tort parce qu'il n'a pas choisi les derniers des bras cassés pour l'accompagner. Les Grys Grys seront les rois du show.

Un truc qui m'a sauté aux yeux dès les trente premières secondes. Le bassiste ne sait pas jouer de la basse. Vingt minutes plus tard Tony confirmera, deuxième soir qu'il joue de la basse. Inutile de crier au scandale. Ce n'est pas un bassiste. C'est beaucoup mieux. Un guitariste. Un soliste. Donc ce soir nous aurons trois guitares, une avec le son légèrement plus grave, mais sans plus. Nous avons droit à un véloce aux doigts particulièrement agiles.
Ensuite il y a un harmoniciste. Sur les deux premiers morceaux il s'est comporté comme un harmoniciste. On ne lui en aurait pas demandé davantage. L'a bien ressorti son harmo trois ou quatre fois, pour tirer un riff durant une quinzaine de secondes, mais après bye-bye s'en détournera sans regret. Son truc à lui, c'est les maracas. Une, deux, trois ou cinq, qu'importe pourvu qu'il puisse les agiter frénétiquement, on le devine heureux. Enfin presque. L'a tout un tas de percus dont il use sans discrétion, plus une washboard, plus un tambourin. Quand il a épuisé sa collection il squatte une des cymbales de son batteur. Vous ne comprenez pas, trois guitares lancées à fond, un bat-man imperturbable qui cogne comme un forcené, Tony qui apostrophe le micro, comment peut-il espérer que des grésillements de pépins de calebasse puissent atteindre l'oreille des spectateurs ? Je vous affirme qu'on les entend. Très bien. C'est qu'il dépense une énergie incroyable. Incapable de rester en place. Saute partout. Bondit si haut, pour un peu il s'écraserait la tête contre le ourdi et la vision d'un gars, le crâne éclaté , les cheveux ensanglantés, restant collé au plafond nous apparaît comme une possibilité des plus logiques. Inéluctable.

Vous n'y échapperez pas. Le troisième guitariste. Pardon : Le Guitariste. Porte un badge qui annonce la couleur : Flamin'Groovies. Tout un programme. La traversée du Jordan en aircraft. Pas une once de frime. Tout en concentration. Maintenant prêtez l'oreille. Si ça turbine à deux mille quatre cent tours à l'heure, c'est grâce à lui. L'a l'air de ne pas s'agiter. Les autres posent la première pierre et lui il finit la baraque de B à Z. Peuvent courir devant, lui il termine ce qu'ils ont débuté et laissé en plan pour aller plus loin. Et comme la stratégie de Tony est très simple. Rock and roll à fond les manettes, le morceau le plus lent est toujours le précédent, au fur et à mesure que le concert se déroule, son jeu prend de plus en plus d'ampleur. Les autres lui laissent à chaque fois davantage de boulot, et lui comble les trous avec une extraordinaire virtuosité. Après la version hyper speedée de Trop de Classe pour le Voisinage... Le Too Much Class... des Dogs, c'est carrément la chienlit riffique, c'est lui qui dresse la Tour Eiffel, à coups de trompes terminator. S'avance de guingois et darde le manche de sa guitare sur le public qui exulte. Un grand.
Faut dire que ça transbahute de tous les côtés. L'ambiance ressemble à un concert métal, ça houle de bâbord et de tribord, les corps s'entremêlent et se frottent avec violence, ça sent la bière renversée et la sueur de filles, l'on patauge dans le whisky et l'on essaie de surnager dans ce tohu-bohu festif. Règne une chaleur d'enfer. L'harmoniciste se vide un grand verre d'eau sur la tête, et un spectateur se précipite à ses pieds, pour allongé de tout son long, laper à même le parquet le liquide désaltérant. Tony remercie l'assistance, ne sait pas quoi dire, et comme il ne sait que jouer du rock and roll il relance la cadence. Vieux Canards, Dypsomanie, Zaza... les titres se suivent et se ressemblent dans leur folie furieuse. Lucas des Howlin' ne quitte pas des yeux le guitariste et hurle de joie, lorsque celui-ci lui ressort un de ses propres plans, deux notes qui font le grand écart aussi meurtrières que la botte de Nevers.
Maman n'aime pas ma Musique de Dick Rivers, et c'est la fin sur Merci... Mais ils ne parviendront pas à quitter la scène. Trop de désirs palpables émanent de la foule qui s'écrase sur le bord de l'estrade. Reprennent le taureau furieux par les cornes pour un ultime morceau.
BILAN
Chaude soirée ! Les Grys Grys sont à mettre dans le collimateur. Viennent d'Alès faudra les voir en tant que groupe à part entière. Avec un peu de chance cet été dans le Sud. M'ont plus impressionné que Tony Truant lui-même. Qui n'est pourtant pas né de la dernière pluie. Quant aux Howlin' Jaws, ce sont eux les authentiques rois de la soirée. Tony ressert une vieille recette, un potage qui ne manque pas de saveur, mais les Howlin' sont en recherche, ils essaient de faire progresser le rock, sont en train de faire péter les vieux cadres, et cela ça n'a pas de prix.
Damie Chad.
( PS : Les photos ne correspondent pas çà la soirée )
DU ROCK'N'ROLL
I : ETAT DES LIEUX
Three Stars est le titre d'un morceau d'Eddie Cochran qu'il enregistra au lendemain de l'accident d'avion qui coûta la vie à Buddy Holly, Big Bopper et Ritchie Valens, en 1959 voici près de soixante ans. Le rock n'en est pas mort pour autant, certains diront qu'il a même atteint un âge respectable. C'est ce qui pouvait lui arriver de pire.

Difficile à admettre mais le rock n'est plus ce qu'il a été. S'est pourtant bien battu. L'a été durement touché, envoyé à terre, enterré même, mais il s'est relevé et est reparti à l'attaque comme si de rien n'était. 1956, 1964, 1977, dates symbole qui ne veulent rien dire mais qui signifient toutefois quelque chose. La génération des pionniers, l'anabase invasive anglaise, la révolte punk. Je vous en offre deux lectures. L'establishment amerloque qui parvient à juguler la trombe de cette jeunesse dévoyée qui n'eut rien de pire à faire qu'à adopter les us et coutumes des nègres... La vague britannique submergeant tout, souveraine, hégémonique, colonisant le monde entier finissant par distiller un ennui profond. Super groupes, musiciens cultes, trop parfaits, trop brillants, trop lisses, tournent en rond, lassent le public qui aspire à des nourritures davantage roboratives. L'éclosion punk. Un feu de paille, et de colère, mais qui remet les pendules à l'heure tout en arrêtant définitivement l'horloge.
Fifties, sixties, seventies, le compte à rebours est commencé. Pouvez aussi comparer ces différentes étapes à celles de la Révolution Française, le Tiers-état qui secoue le cocotier, le triomphe de la République, la Conjuration des Egaux, et puis patatras, l'on passe à une autre séquence historiale. C'est à ce moment que ça se gâte pour le rock'n'roll. Depuis les eigthies l'on patauge dans le Directoire dilatoire et l'on n'est jamais parvenu aux fastes victoriaux de l'Empire...
Oui je sais, le grunge, le hard, le garage, la musique industrielle, le noise, la teckno, le métal... Beaucoup de rock a coulé sous les ponts depuis... N'empêche que le rock'n'roll donne l'impression de se mordre la queue. L'engendre des sous-genres, des voies sans issue, qui vous éloignent plus qu'elles ne vous rapprochent du sujet. Comble d'ironie, le bâtard du blues se bâtardise. S'acoquine avec les musiques du monde, les uns exaltent ces mélanges séminaux les autres déplorent ce parasitisme variétoche. Le rock se termine comme le jazz. En eau de boudin. A épuisé toutes ses possibilités, est incapable de se renouveler, s'en va se servir dans les grandes surfaces démagogiques, lui qui ne fréquentait que les boutiques hyper spécialisées. Le carnivore électrique change de régime, broute à tous les râteliers.
II : SURVIVANCE
Mais tout cela n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Le rock'n'roll survit. Cryptes, vieille garde et nouvelles franges. Devient une musique de ruche. Qui vrombit de mille insectes. Génération rockabilly, elle meurt mais ne se rend pas, pas encore en vue du cimetière mais se rapproche de la retraite. Vieux briscards du blues électrique. Font le pont entre la précédente et la suivante. Hordes métalliques, qui se renouvellent sans cesse à partir du terreau lycéen.
Le rock est partout, concerts dans les caves, les lieux spécialisés, les cafés, les bars, les festivals, les clubs de bikers, les petites structures municipales... Minoritaire mais actif. Porté à bout de bras par des associations, des blogues, des labels, des groupes. Une fourmilière chaotique qui reçoit bien des coups de pied mais qui reconstruit sans cesse des galeries où déposer ses larves. Ce n'est pas la grande invasion des termites qui s'apprêtent à ronger définitivement les poutres maîtresses de nos sociétés coercitives, mais un abcès de fixation purulent insensibles aux antiseptiques dont on le parfume régulièrement.
III : CONTRADICTIONS
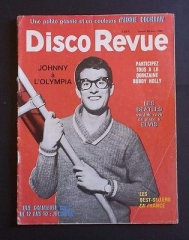
Subsiste toutefois un malaise. Les gouffres lovecraftiens qui renferment les Grands Anciens ne deviennent vraiment palpitants que lorsqu'ils laissent échapper quelques vapeurs méphitiques qui s'en viennent mettre le monde en grand danger. Certes la défaite est assurée mais dans les livres et les films les scénarios doivent naviguer entre deux écueils : la mort du héros, et tout aussi mortel, le triomphe définitif de ce même héros. Dans les deux cas, la poule aux œufs d'or est trucidée.
C'est identique pour les fans de rock. Fierté de faire partie de la légion des damnés, de s'adonner à un culte réservé à une élite, ultra-minoritaire mais ô combien exaltante. L'esprit des catacombes transfigure votre existence. Bien beau de former la minorité active, de fomenter la conjuration de Catalina, mais au bout du compte surgit la désagréable impression de s'être bâti une niche égotiste de survie écologique sans trop d'avenir. Nous avons creusé le trou, mais ce n'est pas nous qui avons vissé le couvercle dessus. L'on aimerait des lendemains qui chantent, l'on se contente des petits matins blêmes de la survivance.
L'on se raconte les vieilles légendes, Elvis foudroyant l'Amérique après une seule apparition télévisée, l'arrogance des Rolling Stones fédérant le mal-être de toute une génération, les Sex Pistols qui se jouent des médias, Led Zeppelin qui impose sa loi au showbizz... Grandiose ! Si Victor Hugo revenait il rajouterait quelques épisodes à la Légende des Siècles... Z'oui ! Zûrement ! Mais ne regardons pas trop derrière les belles images. Le rock a longtemps fonctionné comme les fusées à deux étages. Croyez ce que je dis, mais ne cherchez pas à savoir comment je le fais. Assis sur des gros tas de billets de banque. Derrière moi, il y a des majors, des entreprises qui font la course au profit, des actionnaires aux griffes acérées. Le rock n'aime pas le système mais le Système s'est dépêché d'adopter ces orphelins auto-proclamés. De la bonne zique par devant, et du gros fric sur les côtés. Jeunes gens en colère, chantez les frustrations mais entassons les millions. Suffit de présenter l'addition aux fans qui se feront un honneur de payer cash vos royales galettes.
Tout poison possède son antidote. En rock, cela s'appelle le Do It Yourself. Ecrivez vos paroles, enregistrez chez vous, ou chez des amis, vendez vos disques à la fin des concerts, faites votre pub sur internet, avec les moyens modernes induits par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, et un peu d'imagination, tout devient possible. Pour pas cher.
Pour pas loin aussi. Certes le monde a évolué. Fut un temps où vous étiez enfermé dans une cage. Vous avez maintenant la possibilité de créer votre zoo à ciel ouvert. Voire de résider dans une vaste réserve naturelle. C'est vous qui gérez les entrées et la réception des charters de touristes. Ne vous en prenez qu'à vous-même si vous ne vous y retrouvez pas. Appliquez vos idées philosophiques. Permettez-vous les petits prix, le chapeau de la contribution participative ou volontaire et même la gratuité absolue. Vous êtes libres. Dans l'espace délimité que nous avons eu la magnanimité de vous laisser. Si vous voulez pâturer hors des clôtures, vous changez de braquet. Ne venez pas vous plaindre si bientôt vous plafonnez. Dans vos revenus. Ou vous roulez en Deux-chevaux ou en Porsche. Ce ne sont pas les mêmes carrosseries. Ni les mêmes performances. La loi du marché. Nous n'y pouvons rien. Circulez, il n'y a plus rien à voir.
III : LAMARTINIENNES MEDITATIONS

Le fan de rock est ainsi. Tel Ulysse entre Charybde et Scylla. A première vue des monstres pas si méchants que cela. Si vous choisissez le tourbillon, il vous refile une pêche extraordinaire vous avez l'impression de diriger votre destin, de mener votre barque à votre convenance. Pas d'intermédiaire entre le groupe et le fan. Principal danger : les eaux stagnantes de la dérive centripétique, vous vous engloutissez doucement au fond de l'abîme. Vous ramez à contre- courant mais vous accéderez un moment ou l'autre à l'épuisement... Ou alors vous abordez la crique accueillante du rivage. Vous plantez vos graines. Récoltes abondantes. Vous engraissez. Votre profil s'épaissit. Les chiens de la mer vous engraissent à chaque morsure. Vous brisez les miroirs pour pouvoir vous y regarder sans trop de risques. Mutation de votre métabolisme.
Fut un temps idyllique où l'hypertrophie du succès des groupes réjouissait les fans. La machine à fric vous pompait votre argent mais vous refilait des jetons de présence. Pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Mieux que ça. En abstraction fiduciaire. Améliorait votre propre représentation hologrammique. L'idole se nourrissait du fan, et le fan de l'idole. L'artiste empochait the money et l'admirateur l'érigeait en totem propitiatoire dans son jardin intérieur. Pensait gagner au change. La valeur n'est-elle pas supérieure au vil métal ?
Une espèce d'alchimie d'un genre nouveau. La musique-rock se transformait en Rock-Culture Un partage à parts égales puisque communautaire. Elaboration d'une nouvelle attitude philosophique devant l'existence. Un regroupement de tribus bigarrées aux mœurs et coutumes divergentes mais en dernier ressort fédérées par ce vent énergétique propulsé par le rock and roll. Entre les Hells Angels et les Hippies la distance n'était pas plus grande que les modes de vie des différents peuplements des natives auxquels les colons furent confrontés sur le sol américain. Eux aussi perdirent les guerres indiennes. Comme nous. Sont parqués dans les réserves mais en contre-partie peuplent nos imaginaires.
La rock-culture est devenue un phantasme culturel. Le fan se répète à l'infini les scènes légendaires du film, qu'il ait ou non - cela dépend de son âge - participé à son tournage. Entre l'attitude et l'authenticité, souvent vous ne trouverez que l'épaisseur d'un billet de banque. Mais ceci est un autre problème. L'Homme se distingue des autres espèces animales par le fait qu'il produit des artefacts iconiques - non pas tellement des objets de terre, de bronze ou de titane - mais des représentations mentales qui s'immiscent entre lui et son rapport à la réalité de la nature.
Par corollaire nous pouvons affirmer que nos conduites sont soumises à l'emprise de notre milieu organisationnel social. Le rock and roll n'est qu'une réaction musicale et attituduelle – ce qui signifie contre-réaction instinctive et donc philosophique ( car la conceptualisation philosophique n'est que l'appréhension intellectuelle d'un mouvement de rejet ou d'attirance non encore raisonné devant une situation donnée ) - à un milieu évolutif jugé par trop contraignant.
Nombreux sont ceux qui s'étonnent du fanatisme des rockers. Avoir fait du rock and roll l'un ( souvent ce mot prend ici le sens d'unique ) des azimuts essentiels de sa vie étonne. Much ado about nothing, comme dit Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien. La traduction française évoque mieux le volume sonore incriminé ! En concluent que le rocker est un être sectaire. N'ont pas tout à fait tort. Ni tout à fait raison. L'est aussi, pour suivre une terminologie qu'adorent les sociologues et nos décideurs politiques, un indicateur. Le jour où cette balise n'émettra plus de signal, vous pourrez commencer à vous inquiéter.
Ce ne sera pas simplement qu'une génération aura été enfouie dans les froids caveaux ou réduits en cendre dans les brûlants incinérateurs des cimetières. Ce sera la deuxième extinction des monstres dinosauriques. Les manifestations sociétales de ces individus traduisaient l'imminence de l'émergence d'une société libérale d'esclaves satisfaits de leur servile condition. Et même s'ils n'y trouvent aucune satisfaction – I can't get no - ce sera trop tard. Cauchemar générationnel ? Le rock n'est-il qu'une forme parmi tant d'autres de rébellion métaphysique et infrapolitique ? Danger Zone.
Damie Chad.
16:20 Publié dans ROCK'N'ROLL | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : fu manchu, howlin'jaws + olympic café, tony truant et les grys - grys


