26/04/2017
KR'TNT ! ¤ 326 :PETE OVEREND WATTS / GUIDO & THE HELLCATS / JIMI HENDIX / JAMES BALDWIN + RAOUL PECK / JOHNNY HALLYDAY / POLYPHONIX
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 326
A ROCKLIT PRODUCTION
27 / 04 / 2017
|
PETE OVEREND WATTS ( II ) / GUIDO & THE HELLCATS JIMI HENDRIX / JAMES BALDWIN + RAOUL PECK JOHNNY HALLYDAY / POLYPHONIXMÊME |
MÊME TEXTE AVEC IMAGES SUR :
http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Overend is over
Part two
Si vous ouvrez le gatefold du premier album de Mott The Hoople modestement titré Mott The Hoople, vous y verrez Pete Overend Watts photographié de profil et coiffé d’un chapeau. À sa gauche, Buffin semble sortir d’un village de nains du Seigneur des Anneaux. Quant aux autres, ils ne ressemblent pas à grand chose. L’album démarre avec une brillante reprise du «You Really Got Me» des Kinks. Mick Ralph y joue la carte du gras double. Ils en font un instro punk. On sent d’énormes prédispositions. Ils frisent même le Hammersmith Gorillas et le gros solo d’orgue de Verden Allen passe comme une lettre à la poste. Et voilà, terminé. Pour le reste, ils se conforment au plan prévu : sonner comme Dylan. Alors l’Hunter-national y va de bon cœur. Il ne faut pas lui demander ça deux fois. Il en enchaîne trois à la suite : d’abord une reprise de Doug Sahm, «At The Crossroads» qui lui aussi s’évertuait à sonner comme Dylan, puis «Laugh At Me», un balladif tue-l’amour qui brise l’élan du disque, et zy-va Mouloud, les nappes d’orgue Hammond sonnent exactement comme celles d’Al Kooper dans Highwy 61 Revisited, et ensuite «Backsliding Fearlessly», où l’Hunter-continental fait tout bien, exactement comme Dylan. Là, ils exagèrent un peu. Qui avait besoin d’un nouveau Blonde On Blonde à Londres en 1969, soit quatre ans après la bataille ? Personne, sauf Guy Stevens. L’Hunter-rimaire glissera encore une petite giclée dylanesque en B avec «Half Moon Boy». Mott se voulait le plus américain des groupes de Londres et ce n’était peut-être pas une bonne idée que de vouloir singer Dyaln à tout prix, en tous les cas, pas avec quatre cuts sur un premier album.
Alors avec Mad Shadows, ils tentent de corriger le tir en allant plus sur les Stones, et notamment avec l’énorme «Walking With A Mountain», pur jus de Stonesy. On a là le vrai Mott, bourré d’énergie - It’s a gas/ Talkin’ that fast - Et Overend traverse le flux à grands coups d’empoignades de manche. L’autre gros cut de l’album se trouve en B : «Threads Of Iron», une sorte de jam bien enlevée. Ils semblent jouer leur va-tout, Verden pianote, Overend descend et remonte à contre-courant, Buffin multiplie les facéties rythmiques. On a là la fantastique équipe dont rêvait Guy Stevens, il souffle sur ce cut un véritable vent de folie. Le «Thunderbuck Ram» qui ouvre le bal de l’A vaut aussi le détour, car après des ponts malheureux, Mott vire épique et collégramme, oh ils adorent ça, ils tirent soudain l’overdrive, on entend Overend voyager dans le tumulte, et ça tourne à la pure frénésie. Mott sonne alors comme un fleuve qui emporte tout. Fantastique !
Le soufflé retombe brutalement avec Wildlife. Dommage, car la pochette est superbe, les cinq Mott photographiés dans un bois ont des allures de Pretty Things. Mais l’album est un peu mou du genou. Ils démarrent avec un «Whisley Woman» qui n’est pas celui des Groovies, dommage. Ils s’arrangent toutefois pour exploser ce cut insignifiant. Et puis ils vont enchaîner une série de balladifs ineptes, histoire de bien ruiner l’A. L’Hunter-minable n’en finit plus de ramener ses compos, toutes plus insignifiantes les unes que les autres. Overend devait s’emmerder comme un rat mort. Et pouf, l’Hunter-continental refait son Dylan en B avec «Original Mixed-Up Kid». Pour lui c’est facile, il n’a qu’à pomper dans les albums de Dylan. Et le désastre se poursuit avec «Home Is Where I Want To Be», une country-pop de petite bite. Pas la moindre trace d’inspiration à l’horizon. Ce disque tourne à la catastrophe. On se croirait sur un album d’Aerosmith. Ils terminent heureusement avec une petit coup de pétaudière : une reprise de «Keep A Knockin’» bien knockée du bulbe. Il est évident que ces mecs sont taillés pour la route.
Si on suit la chronologie, on tombe ensuite sur le fameux Brain Capers. Le hit de l’album s’appelle «Death May Be Your Santa Claus», introduit par un beat à sec, très vite rejoint par l’épais riff de Ralph, et pouf, ils partent en mode Mott, piano, basse, heavy beat et ça tourne à l’aventure, au boogie down production à l’Anglaise avec des chœurs en veux-tu en voilà. L’Hunter de Milan revient faire son Dylan avec «The Journey» et franchement, on s’en serait bien passé. Bilan de l’A : un seul bon cut sur quatre. Les renforts arrivent en B avec «Sweet Angeline», dylanesque, certes, mais musculeux et plein de son, superbement mal enregistré. Il faut remercier Guy pour ça. Ralph claque «The Moon Upstairs» au riff et ça redevient du pur jus de Capers, ils mettent le cap sur la Stonesy. Dommage que Mott n’ait pas joué davantage avec le feu. Ils terminent dans une sorte de chaos avec «The Wheel Of The Quivering Meat Conception». Belle photo du groupe au dos de la pochette : on les voit assis devant un mur de briques peint en blanc.
On peut s’épargner l’écoute de l’album All The Young Dudes et consacrer un peu plus de temps à Mott, ne serait-ce que pour examiner la pochette, si on a la chance d’avoir le pressage américain : ils ne sont plus que quatre, Verden Allen ayant jeté l’éponge. Buffin attire l’œil, car il est très beau, mais la star du groupe reste bel et bien Pete Overend Watts, vêtu d’une espèce de tunique en soie ouverte sur la poitrine et d’un pantalon de cuir orange. Avec cet album, Mott passe résolument en mode glam, avec deux excellents cuts, «All The Way From Memphis» et «Whizz Kid». On croirait entendre Ziggy Stardust ! - You look like a star/ But you’re still on the dole - Et Andy McKay prend un solo de sax. On retrouve dans «Whizz Kid» ces climats délétères de familistère. Avec «Violence», Ralph riffe sec et on passe enfin aux choses sérieuses - Nothing to do/ Street corner blues/ Nowhere to walk - Ils reviennent en B à la Stonesy avec l’excellent «Driving Sister». Ils retrouvent enfin leur prédilection pour le Keef System et soudain, tout s’éclaire enfin avec «I’m A Cadillac», un hit fabuleux signé Ralph - I’m a Cadillac/ I’m just holding back - Overend joue de la basse fuzz - You’re a Thunderbird/ Cruising round my heart.
On tombe enfin sur le meilleur album de Mott The Hoople, The Hoople et sa pochette emblématique : une jolie femme s’y pâme, et dans ses cheveux bouclés scintillent les mille et un visages de Mott. Mick Ralph a quitté le groupe pour fonder Bad Co et Luther Grosvenor le remplace. Le voici rebaptisé Ariel Bender et au change, Mott y gagne terriblement. Eh oui, un Grosvenor à bord, ça change tout ! Mott a enfin un vrai son, et un cut d’ouverture de bal comme «The Golden Age Of Rock’n’Roll» éclate au grand jour. On voit tout de suite la différence, surtout quand Ariel Bender passe un solo flash, avec seulement trois notes tirées et dégoulinantes de gras. Dès qu’ils tapent dans le boogie rock à l’Anglaise, ils redeviennent singulièrement convaincants. On trouve sur cet album un coup de génie signé Pete Overend Wats, le fameux «Born Late ‘58». Après un faux départ, Ariel riffe et Overend place un superbe glissé de basse. Oh le voilà qui se met à chanter comme le punk qu’on attend depuis le début - She’s a speeder, a leader/ You’re really gotta meet her - D’autres énormités guettent l’imprudent voyageur, comme par exemple «Marionette», cut volontairement dramatique et quand la marionnette parle, on croirait entendre Johnny Rotten. Le problème, c’est qu’on en 1974, et Johnny Rotten n’existe pas encore. Avec «Alice», ils reviennent au Dylanex, mais avec du poids à l’Anglaise. On les sent enfin détachés des amarres, plus libres de leurs mouvements. Il finissent l’A avec l’énorme «Crash Street Kids» - See my scars/ See my blood - c’est stompé il faut voir comme, Buffin bat comme un beau diable et dans ce monster cut, Overend roule pour vous. Ouf, le groupe trouve enfin son vrai son, car Overend est poussé devant dans le mix. En B, il règne aussi une grosse ambiance dans «Pearl’n’Roy». Franchement, l’arrivée d’Ariel beefe bien le son. Ils sortent là une superbe pièce de good time music décadente à l’Anglaise. On est au chœur du haut de gamme des seventies. Ariel joue très lyrique sur le dernier cut de l’album, l’imparable «Roll Away The Stone», une belle pièce de glam pur. Ils terminent sur cette note éclatante de grandeur. Mott sauve ainsi sa place au panthéon du rock anglais. Cet album est à Mott ce que Let It Bleed est aux Stones : un classique insurpassable.
Alors que le groupe avait enfin trouvé sa vitesse de croisière, l’Hunter-minable jette l’éponge et se barre aux États-Unis pour aller faire carrière avec Mick Ronson. Overend remonte le groupe avec Buffin, Ray Major, Nigel Benjamin et Morgan Fisher. Mott The Hoople devient Mott et un premier album intitulé Drive On sort en 1975. On voit au dos de la pochette une fantastique photo du groupe. Buffin est habillé comme Oscar Wilde, d’un petit veston noir sur-piqué d’un liseré blanc et passé sur un gilet à dix boutons. Autre fait marquant de cet album : Overend compose tous les cuts. Vous y trouverez deux hits glams absolument parfaits : «I’ll Tell You Something» et «Love Now». Nigel Benjamin chante exactement comme Ziggy Stardust. Ils se situent au cœur de cette mythologie - You’re such a shame - C’est le glam le plus pur qui se puisse concevoir ici bas. Même chose avec «Love Now» qui ouvre le bal de la B : Overend chante, repris au refrain par Nigel Benjamin. Le pote Pete reproduit le coup de génie de «Born Late ‘58» et sa fabuleuse machine ronronne. Avec «She Does It», ils reviennent à un format plus rock’n’roll. Overend ne se casse pas trop la tête pour composer, il va vite en besogne, il faut relancer le groupe, les fans attendent. On trouve aussi en B un heavy groove fantastico intitulé «The Great White Wail», joliment atmosphérique, une bonne aubaine, même si ça frise un peu le prog à la Cokney Rebel. S’ensuit un balladif extraordinaire, «Here We Are». Il faut bien dire que les balladifs d’Overend Watts valent mieux que ceux de l’Hunter-médiaire. Tiens, encore deux merveilles pour finir ce bel album : «It Takes One To Know One», pur jus de glam anglais, et «I Can Show How It Is», encore un fantastique balladif de fin de non-recevoir, une merveille d’habilitation de la paragenèse.
Shouting And Pointing, le deuxième album de Mott, accroche un peu moins, dommage. On y trouve toutefois deux petites merveilles, à commencer par «Career (No Such Thing As Rock’n’Roll)». Du pur Ziggy Stardust, encore une fois. C’est dingue comme ce mec Nigel peut sonner comme Ziggy. On a là du glam de rêve, ce qui se fait de mieux aussitôt après Ziggy. L’autre merveille est cette extraordinaire reprise du «Good Times» des Easybeats. C’est Overend qui chante ça - Gonne hava a good time tonite - C’est claqué aux breaks des enfers et Ray Major part en solo laser, il perce les murailles, ouille, quel fin limier ! On trouve sur l’album d’autres cuts solides comme «Collision Course», joliment délibéré et activement recherché de l’intérieur. Et puis aussi ce gros boogie-glam cousu de fil blanc qu’est «Too Short Arm (I Don’t Care)», véritable coup de poker glam à la table du casino, mais c’est un coup de bluff. On se régalera surtout de «Breadside Outcasts», une belle pièce de glam tardif dotée d’un bel élan populaire. Ces diables de Mott résisteront jusqu’au bout. Ils enjolivent leur glam au mieux des possibilités et on admire leur héroïsme.
On trouve aussi dans le commerce un mini-album de Mott avec Steve Hyams intitulé World Cruise. Dès «Dear Louise», on sent que Steve amène du sang neuf à un Mott exhausted, comme on dit en Angleterre. On retombe là dans l’ornière du vieux boogie privé d’espoir. Ce mini-album fut le dernier sursaut de Mott avant les British Lions. Il faut bien dire que Steve n’est pas non plus le sauveur de Bethléem. Avec «Hot Footin’», ils boogottent dans les brancards, pas de surprise, silly boy bye bye baby. S’ensuit la reprise du «Wild In The Streets» de Garland Jeffreys. Voilà un cut décent joué au heavy beat, merci Garland. Mott retrouve des couleurs et renoue avec sa réputation de Boogie Lords at war. Et ça se termine avec le morceau titre claqué aux beaux accords catégoriels. On guettait le réveil de Mott et le voilà, sous forme de gros boogie anglais absolument parfait, joué dans le gras de l’expansion. Ils renouent avec une certaine idée de l’admirabilité des choses et recréent leur vieille magie conquérante. Pur Mott sound. Terrific !
Dernier round avec The British Lions. Overend tente une dernière fois le coup du grand retour, mais pas de chance, ils tombent en pleine vague punk, et en Angleterre, ils n’intéressent plus personne. John Fiddler de Medecine Head est au chant et ce premier album propose deux reprises de choix : «Wild In The Streets» et «International Heroes». Le cut de Garland Jeffreys est poundé comme il faut, ça sonne très Mott - Your teenage jive is going to workout a mess - et le classique de Kim Fowley emporte tous les suffrages, grâce à son refrain magique - International heroes/ You got the teenage blues - Kim Fowley et Ray Davies même combat, pourrait-on dire ! Les Lions font un joli coup de Diddley beat avec «Break This Fool». Au moins, ils ne s’embarrassent pas avec les arcanes du régurgitage, ils pompent à sec et c’est bien. Il ouvrent le bal de la B avec «My Life’s In Your Hands», un gros balladif épique chargé de son jusqu’à la gueule. Retour sur les terres de Mott avec «Booster», gros boogie-rock chanté au renvoi de lyrics. Pas la moindre ambiguïté là-dedans, on a même du step on the gas.
Le deuxième et dernier album des Bristish Lions s’intitule Trouble With Women. Tout un programme. Et dès le morceau titre qui ouvre le bal, on sent que ça va coincer, car John Fiddler chante mal. Dès qu’il sort de Medecine Head, c’est foutu. Overend fait une vaine tentative de retour au glam avec «Any Port In A Storm», mais la voix de Fiddler ne fait pas l’affaire, monsieur le commissaire. Et avec les cuts suivants, on voit que nos amis les Lions flirtent avec le Cockney Rebel Sound System, ce qui n’est pas forcément une bonne initiative. Avec «High Noon,» ils tombent dans le lacustre. Ray Major tente de faire des miracles sur sa guitare, mais la compo ne convainc guère le conseil de guerre. Ils attaquent la B avec «Lay Down Your Love», une ravissante merveille de petite pop invertébrée. Ray Major a beau sortir sa virulence et croiser le fer avec Morgan Fisher, rien n’y fait. Le Lion ne bande pas. Pourtant, c’est tellement bien joué sous le boisseau qu’on y revient. Il se passe quelque chose d’étrange dans certains morceaux. Même sensation d’étrangeté à l’écoute de «Waves Of Love», soutenu aux chœurs sibyllins. Les Lions ont quelque chose d’indéfinissablement tendancieux, comme s’ils refusaient de se prendre au sérieux. D’ailleurs, les chœurs sont marrants. Ils reviennent enfin au glam à la Ziggy avec «Electric Chair». On sent le dernier spasme du glam anglais, d’autant que Ray Major retrouve le son de Mick Ronson. Ils finissent avec un «Won’t You Give Him One (More Chance)». Écoutons-les bien, car c’est la dernière fois qu’ils jouent. Avec cet ultime raout, les Lions tentent de retrouver le filon Mott du chant glam, avec des coulis de piano qui sonnent comme la mandoline d’«I Wish I Was Your Mother». Dommage que ça s’arrête là, car ces mecs avaient quelque chose de terriblement précieux dans leur façon de glammer le rock anglais. Ray Major fait une dernière fois son Ronson et les British Lions disparaissent à tout jamais, engloutis par l’océan. Quelle tragédie !
On trouve dans le commerce un DVD Angle Air qui propose un concert des British Lions filmé en Allemagne, en 1978. On s’aperçoit que sur scène, les Lions sont encore plus puissants que sur disque. Ray Major sort un gros son de gras double et il porte un pantalon de cuir noir. Overend porte un pantalon rouge et une sorte de petit marteau attaché à la taille. Mais le problème, c’est la voix de John Fiddler. C’est flagrant avec «Come On», un cut qui demande quand même un minimum de raunch.
Si on reste fan de Mott, il faut voir The Ballad Of Mott The Hoople, un film tourné par Chris Hall & Mike Kerry. On le trouve sur DVD. Il s’agit là du meilleur des hommages qu’on puisse rendre au gang d’Overend et de Buffin. Tous les acteurs de cette saga apparaissent un par un, tous sauf Overend qui, à l’époque du tournage, devait être déjà malade. Il brille par son absence. On voit Buffin sur le déclin, Verden Allen plutôt bien conservé, Mick Ralph bouffi, Ian Hunter évidemment, et puis tous les autres principaux acteurs, Stan Tippins qui fut le premier chanteur du groupe, relégué au rang de road manager après l’arrivée de l’Hunter-continental, on voit aussi la veuve de Guy Stevens, puis Luther Grosvenor qui a toujours des allures de rockstar, avec son béret, ses bagues et ses bracelets. C’est Buffin qui sort les choses les plus intéressantes, comme par exemple lorsqu’il parle des premiers albums de Mott : «Lots of recordings were dreadful, lots of songs were dreadful, but there were a few bloody good bits» (les morceaux et les enregistrements n’étaient pas bon, mais il y avait quand même dans le tas quelques petites merveilles). Le problème de Mott est qu’ils remplissaient les salles mais leurs quatre albums sur Island ne se vendaient pas. Bowie les sauve quand il apprend qu’ils vont se séparer, mais ça n’empêchera pas Verden Allen et Mick Ralph de quitter le navire. Luther Grosvenor entre dans la danse, mais il n’aime pas trop les chansons de Mott. Comme il le dit lui-même : «I come from a different sort of guitar category !». Eh oui, Spooky Tooth naviguait à un autre niveau. C’est là que Mick Ronson arrive, mais ça ne se passe pas très bien avec Overend et Buffin : Ronson ne leur parle pas. Ça se termine dans les choux. C’est Buffin qui conclut : «Mott came from nowhere except from Guy Steven’s mind. And it’s quite something !»
Et puis si on veut finir de faire le tour du propriétaire, on peut aussi jeter un œil sur Mott The Hoople Under Review. Cette fois, ce sont les critiques anglais qui dépiautent les albums pour nous en vanter les charmes délétères. Au vu de tout cela, on peut comprendre qu’Overend soit resté inconsolable.
Signé : Cazengler, échec et Mott
Pete Overend Watts. Disparu le 22 janvier 2017
Mott The Hoople. Mott The Hoople. Island Records 1969
Mott The Hoople. Mad Shadows. Island Records 1970
Mott The Hoople. Wildlife. Island Records 1971
Mott The Hoople. Brain Capers. Island Records 1971
Mott The Hoople. All The Young Dudes. CBS 1972
Mott The Hoople. Mott. CBS 1973
Mott The Hoople. The Hoople. CBS 1974
Mott. Drive On. CBS 1975
Mott. Shouting And Pointing. CBS 1976
Mott The Hoople Featuring Steve Hyams. World Cruise. Eastworld Recordings 2001
British Lions. British Lions. Vertigo 1978
British Lions. Trouble With Women. Cherry Red Records 1980
Mott The Hoople Under Review. DVD 2007
Chris Hall & Mike Kerry. The Ballad of Mott The Hoople. DVD 2011
The Bristish Lions. One More Chance To Run. Live Germany 1978. DVD Angel Air 2007
TROYES / 22 – 04 – 2017
le 3 B
GUIDO & THE HELLCATS
C'était au St Vincent, à St Maximin, près de Chantilly que nous avions, Mister B and me, rencontré pour la première fois Guido Kenneth Margesson. L'avait joué dans l'inter-set des Megatons ( voir KR'TNT ! 120 du 08 / 11 / 2012 ), lui et sa guitare, voici près de cinq ans, l'avait seize ans à l'époque, et en entrant dans le 3 B, je me disais qu'il devait avoir bien changé depuis. Doit être physionomiste car il me reconnaît dès que je m'approche de lui pour le saluer. L'est devenu un beau jeune homme, sourire aux lèvres et yeux étincelants. A se côtés Jerry des Megatons est là, nous discutons de Johnny Fay qui dans son Cleveland lointain ne rêve que d'une chose, revenir jouer en France et en Europe. Prêt à soixante quinze ans de faire l'aller-retour avion en deux jours pour seulement un unique concert ! A soixante-quinze balais, notre pionnier ne doute de rien !
Troisième rencontre, d'un autre type, Duduche tout heureux revenu des USA la veille, frais comme un gardon et n'ayant pas dormi depuis deux jours. Ce n'est pas l'assistance des grands soirs mais l'ambiance est bonne et chaleureuse.
PREMIER SET
Les Hellcats sont sur piste. Guido devant, arbore un magnifique chapeau de cowboy blanc, veste noire à franges David Crockett, tie ombrée sur chemise blanche et Gretsch 1620, l'oronge vénéneuse des amanites césariennes symbole du rockabilly en bandoulière. Légèrement derrière en décalé Miguel Martinez, jean sombre, et collier de barbe, chemise western aux épaulettes ornées de bucranes enguirlandées de plumes d'aigles indiennes, officie à la basse tandis qu'au fond Cameron Howett de noir vêtu s'assoit à la batterie. Démarrent sur Summertime Blues, nous offriront une belle sélection de Cochran toute la soirée, le son de la guitare sera un peu trop grêle sur les premiers titres suite à une défaillance de la pédale mais cela s'arrangera par la suite. Les morceaux sont enlevés à un rythme soutenu, tempo rapide, cela apparaîtra à merveille sur C'mon Everybody, mais de fait le jeu est beaucoup subtil que l'on l'on pourrait le supposer à première oreille. Miguel et Guido jouent à deux, deux complices – se retournent souvent l'un sur l'autre – ne cherchent pas l'osmose, plutôt une envie de dialogue borderline, la basse, s'en allant en un ruisseau tumultueux, suit son chemin, comme si elle ne prenait nullement garde de son compère, mais comme par hasard elle est toujours au rendez-vous pour laisser l'espace au tranchant de la guitare qui s'en vient ricocher sur le dos de lame du courant, tandis qu'à la batterie Cameron maintient un rythme impeccable qui ne souffrirait d'aucune approximation de la part des guitares qui semblent pétarader des quatre sabots comme des broncos en toute liberté alors qu'elles sont soumises aux figures imposées d'une stricte architecture structurante. Fluidité et énergie.
Beaucoup de reprises, notamment Johnny Cash, mais les originaux sont encore plus percutants. Ces pièces réalisent parfaitement ce que leur manière d'interpréter les classiques sous-entend. C'est du rythme que proviennent les éléments mélodiques, rehaussés des yodels que ne peut retenir Kenneth. Un rockabilly à deux facettes, historiale et moderniste, des relents country et des touches néo et presque psycho. Un Run Chicken Run à vous mordre les doigts, basse qui glousse comme une poule rousse et les staccato de la Gretsch incisifs comme des coups de bec, aiguisés comme les ergots du coq. Du grand art. Surtout que derrière Cameron vous bazarde de ces coups de pompes à détruire le poulailler. Jerry sera mis à contribution pour un titre, souffle doux, par dessous, en accompagnement.
DEUXIEME SET
A tout berzingue. Guido donne de la voix, rauque à avaler le micro, de plus en plus forte, de plus en plus violente à chaque morceau, mais sachant s'incurver à volonté, maltraite sa guitare, Miguel Martinez profite de ce qu'il soit si intensément occupé pour lui aussi se lâcher, vous profile de ces maelströms de lignes de basse à vous laminer les sens, pas de swing mais des ondulations infinies qui semblent s'échapper pour filer on ne sait où, de toutes les manières l'on est déjà emmené par la suivante qui vous emporte sur un espèce de toboggan géant. Un style peu canonique mais ô combien efficace et novateur. Comme une vibration souterraine empruntée au metal qui vous verserait de la moelle brûlante dans le squelette du rockabilly afin de le rendre davantage punchy. Les Hellcats sont bien les trois têtes du tigre sauvage qui monte la garde à l'entrée de la chatière infernale. Sont à fond, si bien que l'irrémédiable se produit, Guido casse une corde, et le set s'arrête le temps de réparer les dégâts.
L'on repartira sur Johnny B. Goode, afin de réopérer le contact avec ces instants de grâce interrompus bien trop abruptement alors que l'on sentait le public de plus en plus pris par l'ambiance. Les Hellcats ont su susciter intérêt et sympathie. L'on ne saurait se séparer si vite.
JAM DE FIN
Troisième partie. Le paradis des rockers, reprennent les classiques, just for fun, Jerry s'attelle à son saxo et suit la musique comme le chien qui s'attaque aux mollets des moutons pour les pousser vers la bergerie, vous mordillent de temps en temps de ces solos à ne plus avoir envie de quitter les pâturages de toute la nuit pendant que les Hellcats mettent le feu à toute la plaine. N'en peuvent plus, mais le public est une hydre insatiable, Duduche nous livre son Whole Lotta Shakin Goin' On habituel auquel il adjoindra – voyage à Tupelo oblige - un Hound Dog, des plus affamés. Se joindra ensuite à Jean-François pour une longue improvisation sur Lundi Matin, zéro catho, un poil au bas du dos scato, les Hellcats interprètent encore deux morceaux et à la demande expresse de nombreux participants ils donnent à bout de force un dernier Dixie qui pour certains résonne en cette veille d'élection présidentielle comme une profession de foi... ( Perso, je décline la rébellion rock selon une autre couleur. ). Les chats de l'enfer, directly from Brighton, ont bien mérité leur repos. Encore une excellente soirée au 3 B.
Damie Chad
( Photos : FB Christophe Banjac )
JIMI HENDRIX
LE GUITARISTE FLAMBOYANT
STEPHANE LETOURNEUR
( Oskar Editions / 2010 )
Pas faire le rachou pour un euro, belle couve, quatre-vingts pages, tout neuf, et puis Hendrix, tout de même ! L'enfant de Seattle ne mérite pas de moisir dans un bac à soldes ! Nous a trop apporté pour subir cette symbolique ignominie. J'ai feuilleté les dernières pages, Oskar ( rien que le nom ! ) une maison d'éditions spécialisée pour les livres à visée culturelle pour un public enfants, ados et jeunes adultes. Cette dernière catégorie est apparue voici à peine quelques années. Comme si les chérubins en âge avancé de plus de dix-huit ans avaient besoin qu'on leur mâche les globos. Quelle société d'infantilisation !
Stéphane Letourneur, inconnu au bataillon, l'a déjà fourni un Jim Morisson, un Bob Dylan et un The Clash dans la même collection. Pas lus, je n'en dirai rien. Par contre ce Jimi n'est pas mal foutu. Ecrit simplement, avec des simili-poèmes agrémentés de quelques lyrics ( sans traduction ) en tête de chaque chapitre, l'on a un peu peur au début, le petit garçon malheureux trimballé de droite et de gauche, va-t-on dévier vers une psychanalyse de bazar, mais non le texte a de la tenue. Défile vite, mais rapporte l'essentiel. Passe l'entourage, les sympathiques et les intéressés, systématiquement en revue, la bio avance au galop, parenté, copines, maîtresses, artistes, rencontres, chacun à sa place, mais à chaque fois la silhouette rapidement évoquée en plein dans le viseur. Les faits bruts rapportés sans la vaseline de la moraline. Toute l'Amérique est là, Elvis, le mouvement hippie, la fumette et le LSD, la guerre du Vietnam, et la carrière de Jimi, l'Angleterre, Monterey, Woodstock, les disques, les concerts, un véritable parcours de combattant, le crève-la-faim et la rock'n'roll star. Splendeur et déchéance. Une addiction aux produits qui n'est pas sans rappeler celle d'Elvis...
L'a aussi son explication quant à la brièveté de cette carrière. Ce n'est pas la pression, le vedettariat qui a tué Hendrix, mais son cul entre deux chaises. La blanche et la noire. Deux couleurs de trop pour un musicien qui voyait le monde en teintes bleues. Azur de rêve et pétrole cauchemardesque. Adulé en tant que musicien rock par la jeunesse blanche et boudé à cause de cela par le public noir, qui ne le connaît guère, davantage focalisé sur la lutte politique de plus en plus radicale prônée par les Black Panthers. Un bluesman sans peuple. Plus la sensation de ne pas maîtriser sa propre trajectoire musicale, d'être devenu dans le mauvais sens de l'expression, une bête de scène, celle que l'on va voir en premier lorsque l'on visite le zoo du rock'n'roll...
Jusqu'à cette nuit où il prend une dose de somnifères vingt fois supérieure à la normale alors qu'il n'a pas arrêté de boire de toute la soirée. Stéphane Letourneur ne prononce pas le mot de suicide – il ne faut point traumatiser les jeunes esprits – mais le sous-entend très fort... Courageux, vu le public visé. Idéal pour un néophyte. Le rock'n'roll n'est pas un dîner de gala.
Damie Chad.
JE NE SUIS PAS VOTRE NEGRE
RAOUL PECK
( Diffusé sur Arte le 25 / 04 / 2017
en salle à partir du 10 Mai 2017 )
Pas vraiment un film, plutôt un documentaire. Réalisé par Raoul Peck à partir d'un projet cinématographique non abouti de James Baldwin dont nous présentions, encore, Retour dans l'Oeil du Cyclone – recueil d'interventions politiques - voici à peine deux semaines dans notre 324° livraison du 21 / 04 / 2017. Expatrié en France depuis 1948, Baldwin sera un indéfectible combattant de la cause noire. En 1971 il retourne aux USA en 1979 non pour s'y réinstaller mais pour tourner un film sur l'histoire de la ségrégation des noirs mettant notamment l'accent sur trois leaders qu'il a personnellement côtoyés Medgar Evers, assassiné en 1963, Malcolm X, assassiné en 1965, Martin Luther, King assassiné en 1968... Le projet ne sera pas concrétisé.
Raoul Peck - cinéaste haïtien né en 1953 - qui a eu accès aux notes inédites de Baldwin le restitue en quelque sorte. Le film est constitué de documents – photographiques et filmiques – d'époque et contemporaines, et notamment d'interventions télévisées de James Baldwin qui en forment l'ossature.
Des images qui donnent froid dans le dos, strange fruits pendus aux arbres, foules de blancs déchaînés, arborant sans complexe signes et slogans nazis qui s'opposent à l'introduction des élèves noirs dans les écoles jusque là réservées aux blancs, émeutes noires durement réprimées par la police, exactions criminelles de cette dernière... Face à cette violence d'Etat les noirs s'organisent et les plus déterminés n'hésitent plus à proclamer la nécessité de l'auto-défense armée.
Les propos de Baldwin sont plus ambigus. Sans prôner la nécessité de la violence il prophétise que celle-ci ne pourra inéluctablement que se développer si rien ne change dans un avenir proche. Notons que quarante ans plus tard, si rien n'a fondamentalement bougé la colère noire malgré quelques explosions de grande ampleur a toujours été maîtrisée par l'establishment...
Baldwin se présente comme un lanceur d'alerte, l'annonciateur du cataclysme, use d'une arme oblique. Il renvoie l'ennemi face à lui-même. Il n'existe pas de problème noir aux USA. Ils sont simplement des américains qui ont permis l'édification de la civilisation américaine – les murs et les idéaux - chargés des travaux les plus pénibles et les moins rétribués. Incidemment, il remarque que nombre de blancs n'ont pas été logés – à part l'esclavage – à meilleure enseigne. Par contre il y a un problème blanc. Les blancs vivent dans le mensonge et l'ignorance. Leur suprématie repose sur deux génocides, le rouge et le noir. Le reconnaître leur est difficile, ce serait mettre à bas l'hypocrisie de toute leur structuration moralino-psychique. Le retour du bâton du sentiment d'auto-culpabilisation chrétienne. Baldwin ne méjuge pas de la difficulté de la tâche qui attend ses concitoyens à pâle visage. Mais il s'en lave les mains. Cela les regarde. A eux de se dépatouiller avec. Après quatre cents ans d'oppression sur le dos, les noirs ont leurs propres blessures à cautériser.
Les noirs sont dans la nasse, entre rêve américain de bien-être social dont ils ont intégré valeurs et espoirs et réalités cauchemardesques d'exploitation ségrégative, entre identité noire à laquelle ils sont sempiternellement renvoyés et problématique de classe qui présuppose une alliance envers les couches de population blanche les plus démunies qui n'ont pour toute richesse que leur soi-disant supériorité raciale... Bonjour la quadrature du cercle.
Raoul Peck pose le problème, ne joue pas à l'illusionniste qui possède bien au chaud dans sa besace le tour de passe-passe qui permettra de le résoudre. Beau montage rehaussée d'un arrière-fond musical particulièrement bluesy et commentaire mis en valeur par la voix grave et sombre du leader de NTM. Ce remake de cette never ending story est à voir.
Damie Chad.
JOHNNY INTERDIT
GILLES LHOTE
( Cherche MIDI / Octobre 2016 )
Un livre qui porte mal son titre. Rien de moins interdit que le Johnny qui nous est présenté par Gilles Lhote, ce serait plutôt la fabrication d'une idole, mais ce titre renvoie trop aux années soixante, nous sommes au vingt-et-unième siècle, ce serait donc plutôt le lancement du Nouveau Johnny.
Gilles Lhote n'est pas un inconnu pour les johnnyphiles, c'est lui qui est derrière l'autobiographie Destroy en trois volumes ( Déraciné 1996, Rebelle 1997, Survivant 1998 ), mais aussi, entre autres, Ma vie Rock'n'roll , Johnny de A à Z, Johnny, le Rock dans le Sang : Journal de la Démesure, 2012, tous réédités sous diverses formes à diverse reprises, mais revenons à ce Johnny Interdit. S'il est vrai que le simple nom de Johnny fait vendre, Gilles Lhote peut se vanter d'avoir témoigné une fidélité à toute épreuve depuis plus de trente ans à la star. Notons que Gilles Lhote qui travailla à Paris-Match, VSD, Télé 7 Jours, a beaucoup écrit, Rolling Stones, Sardou, Coluche, Claude François, Dutronc, mais aussi sur les objets représentatifs ou les univers parallèles de la mythologie rock comme les bottes, les jeans, les blousons de cuir, les Harley-Davidson, le rodéo... cela se sent dans cet ouvrage dans lequel le lecteur se rend facilement compte qu'il recycle quelque peu de nombreux éléments empruntés à ses divers intérêts.
Le livre n'est qu'indirectement centré sur Johnny, s'intéresse au couple formé par Johnny et sa femme Laeticia, du moins dans les premiers chapitres car insensiblement c'est la personnalité du rocker qui s'adjuge la première place. L'ouvrage traite de la période 2010 – 2016, mais Lhote vous file un peu le tournis. Fait des allers-retours dans le passé. Incessants, un coup vous êtes en 2013, puis en 2010, puis en 2016... ne s'interdit aucune limite, d'un paragraphe à l'autre l'on saute comme un kangorock, des années 80 à l'enfance du rocker, d'un show de 1996 aux mues successives de la carrière passée du chanteur... Toute anecdote est prétexte à digressions, faut bien remplir les pages. L'auteur en profite pour multiplier les références aux vedettes internationales qui ont croisé de près Johnny, de Jimmy Hendrix à Jimmy Page... Le dernier quart du bouquin s'ouvre par un abécédaire hallydayen qui regroupe filmographie et nomenclature des familiers pour la plupart déjà abondamment évoqués dans le reste du volume, est suivi par un Johnny Dixit qui contrairement à ce que nous promet son intitulé donne la parole à tous ceux qui ont croisé la route du rocker de Jean-Paul Belmondo à Elsa Triolet, et se termine par la sempiternelle discographie, l'officielle, sans surprise et uniquement les albums de surcroît...
C'était fin 2009, sur la route, m'étais arrêté au hasard dans un troquet, difficile de ne pas voir les photos de l'artiste qui envahissaient le bar. Manifestement le patron était un fan, de longue date expliqua-t-il – mais on l'avait déjà deviné – l'on sentait le baroudeur, un ancien parachutiste – la mine était grave, l'air inquiet, sur son lit d'hôpital Johnny venait d'être plongé dans le coma artificiel et dans les salles de rédaction l'on s'activait à réunir les éléments de sa prochaine nécrologie... Le récit de Gilles Lhote nous raconte les péripéties de cet épisode critique et nous permet d'assister à la lente et longue remontée de Johnny vers la lumière et le succès. Sous un angle différent que celui auquel on aurait pu s'attendre. Certes, la remonte à la surface nous est contée, la convalescence difficile, la dépression qui l'accompagna, la perte de sa voix, le repli familial, la peur et les angoisses, et enfin lors de son anniversaire Johnny capable de se servir d'un micro, il y a là de quoi faire pleurer dans les chaumières. Mort et résurrection, le combat d'un homme, contre son destin.
Ben non ! Les spots sont braqués sur Laeticia. Prend les choses en main. Tendresse, amour, sollicitude de l'épouse éplorée passent au second plan. Une intimité qui ne nous est montrée que de loin. Ne nous trompons pas de sujet. Nous ne sommes plus au moyen-âge, mais dans l'Ere de la Communication. Tout est question d'image. Les toubibs se chargeront des médicaments et des recommandations. C'est leur job, sont payés pour cela. Une maladie, si grave soit-elle, mérite un tout autre traitement. Il n'existe pas de remède miracle. La véritable lutte se passe à un autre niveau. Supérieur. Laeticia inaugure une nouvelle stratégie, vous pourriez la juger comme une fuite en avant, un déni de la réalité, mais c'est alors que vous vous trahissez, vous réagissez comme un gagne-petit ! Faut savoir prendre des risques et parier sur l'avenir. Si le moteur de la fusée est cassée, au lieu de vous désoler ou de vous acharner à remonter les rouages, préparez plutôt la rampe de lancement, et établissez le plan imminent de la mise à feu et sur orbite. De la rock'n'roll attitude passons à la Be positive attitude ! Finies les coups de coeur à l'arrache, les impros géniales, les hasardeuses virées déjantées, voici venu le temps des recettes longuement mijotées, des plans de carrière minutieusement fignolés.
Les mauvaises langues prétendront que Laeticia en profite pour prendre le pas sur son mari. Définitivement. Lui démontre preuve de réussite à l'appui que sans elle, il n'est pas grand-chose. Se la jouent sociologues, la femme moderne qui s'empare des rouages de la société – l'a existé dans les années quatre-vingts une version alternative de cette montée conquérante du féminisme, une vision davantage réactionnaire, la femelle américaine qui subjugue le mâle, qui corrompt sa virilité, et insuffle dans l'inconscient social de l'american way les valeurs conservatrices d'accumulation et de repli sur soi – et installe peu à peu sa prédominance araknique sur la société.
Un petit moment que Laeticia préparait son coup d'état. En douce, mais à la vue de tous. Pose en déshabillé léger dans Pure et nue dans Lui. Ne vous laissez pas subjuguer par la prégnance de ces délicieuses images. Laissez tomber vos jugements moraux. Affichez une femme dénudée et les imbéciles ne voient que la nudité. Ou leurs propres préjugés. Ce qui compte, c'est l'entrée dans le gotha international des femmes sublimes, le lectorat potentiel – ne soyez pas patauds d'esprit, s'agit de faire le buzz, non pas auprès des petits lecteurs qui vont débourser dix euros pour se rincer l'oeil à l'eau trouble de leurs phantasmatiques curiosités inavouables – mais faire signe à tout ce que ce ramdam savamment calculé vous ouvre comme possibilités d'accès à des sphères inatteignables au commun des mortels. Cet affichage permet de pénétrer dans le premier cercle de la jet-set artistique. Ne suffit pas d'avoir l'argent et les moyens. Ce genre de babioles est à la portée du premier riche venu. Il importe de devenir une personnalité indispensable de l'élite aux alouettes miroitantes. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous offrir votre caution morale, vous participez au campagne de l'Unicef, vous lancez votre fondation, vous venez au secours des malades et des pauvres. Ne s'agit pas d'engloutir votre fortune personnelle, non mais d'inciter le bas-peuple ému par votre coeur bon comme du pain blanc à verser une obole compatissante...
Johnny s'est rétabli. Entreprend de nouvelles tournées, enregistre de nouveaux disques, tout est reparti. L'on est content pour lui, Gilles Lhote plus que nous. Grisé – dans les cinquante nuances, les plus claires - jusqu'aux ongles des pieds, rien n'est trop beau pour le couple national, c'est un déluge qui nous submerge. Du fric, de la monnaie de l'argent. Les plus beaux habits, les fêtes les plus somptueuses, les avions privés, les résidences de rêve, les amis huppés, ne nous épargne rien, les marques, les coûteuses matières, les boutiques les plus prestigieuses, me demande comment le fan de base qui se prive pour acheter le moindre produit estampillé Johnny doit réagir. Peut-être vit-il cette insolente débauche sans réticence. Prend-il plaisir à contribuer à cette gabegie monstrueuse ? L'existence quotidienne lui procure-t-elle si peu de joie que cette vie par procuration lui est-elle indispensable pour se préserver de toute cruelle lucidité quant au vide abyssal de son propre vécu ? A-t-il l'impression que des paillettes de gloire auréolent ses jours ? Le phénomène d'identification est est-il si prégnant qu'il vit réellement comme en une sorte de dédoublement spectralement lumineux les remarquable épisodes de la saga de son idole ? Sans doute est-ce plus agréable que d'avaler un nombre incalculable d'anti-dépresseurs pour éloigner de sa propre inanité la tentation du suicide...
Gilles Lhote n'est même pas effleuré par cette problématique. Au royaume doré du roi Johnny tout est beau et magnifique. N'a plus grand chose à dire, nous détaille le nom des créateurs des costumes de scène, puise dans ses réserves et celles des copains. L'avant-dernier chapitre est une reprise de Johnny, Vingt Ans d'Amitié ( KR'TNT ! 278 du 21 / 04 / 2016 ) de Michel Mallory. Ne s'en cache pas, en profite pour nous relater l'enregistrement de Toute La Musique que j'Aime, mais c'est le dernier chapitre Dans le Regard « Brand New Cadillac » Vince Taylor qui s'avère être le plus passionnant.
Une simple photographie. De 1971. Due à Tonny Frank, journaliste attitré. Palais des Sports, Mois de septembre. Johnny de dos. N'est pas le sujet de la photo. Zoom sur le public. Foule indescriptible. Dans la cohue, l'on aperçoit Jacques Brel, et Charles Gérard ( comédien ). Et des anonymes. Parmi eux... Vince Taylor, en costume de ville. Et Gilles Lhote en profite pour résumer en trois pages des plus compréhensives la vie de l'ange noir. En rajoute quelque peu sur l'amitié qui lia les deux principaux protagonistes du rock'n'roll français... La photo est en très grand format dans le bureau de Johnny. Ces trois ultimes feuillets rachètent tout le bouquin.
Damie Chad.
POLYPHONIX
DEUXIEME ANTHOLOGIE SONORE
Fawzi Al-Aledy / Tahar Ben Jelloun / Julien Blaine / Peter Blegvad-John Greaves / Eberhard Blum-Hugo Ball / William S. Burroughs / Olivier Cardot / Jacqueline Cahen- Yocho'o Seffer / Henry Chopin / Corrado Costa / Jules Deelder / Caroline Deseille / François Dufrêne / Esther Ferrer / The Four Horsemen / Allen Ginsberg / John Giorno / Giovanna / Edouard Glissant / Felix Guattari / Brion Gysin / Les Hamadcha d'Essaoura / Bernard Heidsieck / Joël Hubaut-Rhizotomes / Tom Jonhson / Dyali Karam / Arnaud Labelle-Rojoux / Jean-Jacques Lebel – Texture / Ghérasim Luca / André Pieyre de Mandiargues / Michèle Métail / Katalin Molnar / Bruno Montels / Angeline Neveu / Peter Orlovsky / Serge Pey / Christian Prigent / Quatuor Manicle / Nathalie Quintane / Louis Roquin / Jérome Rothenberg / Christophe Tarkos / Tran Quang Haï / Sylvia Ziranek.
Amis rockers prenez un valium et ne vous énervez pas. Je suis gentil, je vous épargne la lecture du livre qui va avec. Pour les plus courageux, sachez que la connaissance du français, de l'anglais, de l'allemand, du latin, de l'espagnol, de l'italien sont nécessaires. Si par hasard la maîtrise d'un de ces étranges idiomes vous échappait, pas de panique, il n'est pas sûr que vous compreniez l'intérêt des textes écrits en la langue que vous jargonnez depuis votre plus tendre enfance. Permettez-moi toutefois, avant d'en venir au CD annoncé, de me pencher sur le bouquin – oui, il y a des images en couleurs – sobrement intitulé :
POLYPHONIX
( Centre Pompidou / Editions Léo Scheer )
A l'origine Polyphonix est un festival international de poésie contemporaine, directe, sonore, parlée, performante, fondé en 1979, ce livre édité en 2002 se présente comme le bilan des quarante éditions précédentes et se donne à lire comme un manifeste. Mais quel rapport avec le rock'n'roll ? Les noms de William S. Burroughs, de Gregory Corso, de Bryon Gysin et d'Allen Ginsberg ne sont pas inconnus des amateurs de la Beat Generation, John Giorno qui fut un familier d'Andy Warhol inspira beaucoup de personnalités rock et de groupes tels Debbie Harris, New Order, Sonic Youth et Nick Cave, les amateurs de jazz ne seront pas insensibles à Bern Nix qui officia à la guitare à côté d'Ornette Coleman, et Steve Lassy américain exilé à Paris qui influença une grande partie des musiciens de jazz de notre pays...
Polyphonix se trouve aux carrefours de nombreuses confluences, poésie, musique, peinture, dessin, dadaïsme, poésie lettriste, surréalisme, et de toux ceux qui au vingtième siècle tentèrent la jonction du poème et des différents modes d'enregistrement rendues possibles par l'évolution des techniques. Nous atteignons à d'étranges confins, expérimentations d'avant-garde, lectures, performances, bruitisme se mêlent et s'entremêlent. Plus de quinze cents artistes sont passés par Polyphonix, des plus traditionnels, aux plus révolutionnaires, la poésie et les textes quittent le livre et tentent d'occuper de nouveaux espaces plus ou moins éphémères, avec plus ou moins de bonheur. Le pire y côtoie le meilleur.
C'est un lieu ouvert, qui autorise toutes les facilités, je classerai Julien Blaine ( qui officia dans la revue Jungle qui eut quelque crédit dans les milieux rock'n'roll ) parmi celles-là, certains comme Deleuze qui bénéficient d'une aura de sérieux philosophique viennent y chercher une caution de modernité chaotique, et d'autres comme Serge Pey et ses bâtons de guerre sculptés offrent des performances de toute beauté qui empruntent davantage à la cruauté théâtrale d'Antonin Artaud qu'à de tristes pantalonnades.
Polyphonix se veut dissident. Mais peut-on encore parler de dissidence nomade lorsque l'institution culturelle du Centre Pompidou vous ouvre ses portes ?
Mais passons au disque. Très décevant. Peu de folie. Peu de cris tempétueux. Quelques suffocations bien venues, des essoufflements un peu malheureux, des chuchotements prévisibles pas du tout inquiétants, et puis pas grand-chose. Arnaud Labelle-Rojoux a beau s'écrier que « c'est très rock'n'roll », nous n'y trouvons pas notre compte. Tout cela manque de rythme. Nous sommes en France et l'ensemble sent trop l'intellectuel en goguette qui s'en vient s'encanailler à l'American Center, un petit côté bobos adeptes du fameux second degré qui permet de s'esbaudir joyeusement de n'importe quelle improvisation saugrenue. Eriger le non-sense en un-non art nous semble une démarche qui se réduit à l'énonciation tautologique du réel. Ce qu'il y a de terrible c'est que l'ensemble de ces gens sont aussi sérieux qu'une maîtresse de maison qui organisait une réunion Tupperware chez elle dans les années cinquante. Le plus décevant, c'est que tout cela sonne désuet. Dépassé. Faux.
Damie Chad.
P.S. : toutefois le livre nous offre un véritable trésor : la reproduction autographique d'un poème érotique de Pierre Louÿs aussi turgescent qu'un étron tout frais au milieu d'un parterre de fleurs fanées. Indispensable.
09/12/2015
KR'TNT ! ¤ 259 : ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS / JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258
A ROCK LIT PRODUCTION
09 / 12 / 2015
|
ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA |

LE PETIT BAIN - PARIS XIII - 01 / 12 / 2015
ASH
LE PANACHE D'ASH
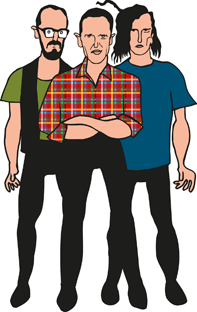
Même dans le cas d’Ash, on peut désormais parler de carrière ! Et même de vingt ans de carrière, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, pourtant, comme dirait le grand Charles, je n’ai-aime que toâ ! Et pourtant, quand Tim Wheeler et ses ceux petits compagnons de bordée déboulent sur scène, on a l’impression qu’ils n’ont pas vieilli. Ils dégagent une sorte de teenage flavour qui nous rappelle que le rock n’est autre que la forme moderne du mythe de la jeunesse éternelle qu’on dit à tort être l’apanage des vampires.

Mais non, il suffit d’aller voir Ash sur scène et de savourer leur ribambelle de hits pop. Ça gicle au plafond de la salle comme des bouquets de feu d’artifice. Ça explose de santé et d’allure. Ces trois Irlandais jouent comme s’ils avaient encore seize ans. Ils jouent, au sens fort du terme. Et le temps a fait d’eux l’un des fleurons du rock anglais. Tim Wheeler est tellement heureux de monter sur scène qu’il sourit à tout bout de champ. Mark Hamilton fait son cirque habituel, jambes écartées, basse en bas et grosse présence, alors que Rick McMurray bat le beurre comme un dieu. Tim Wheeler ne se coiffe plus comme avant. Il plaque ses cheveux vers l’arrière, mais il gratte toujours fièrement sa Flying V, comme au temps où il stoogeait la vieille Angleterre.

Ash peut désormais jouer dans la cour des grands, c’’est-à-dire monter sur scène et aligner une vraie collection de hits, et encore, ils sont gentils, car ils passent pas mal de chansons moins déterminantes. S’ils le voulaient, ils pourraient blower n’importe quel roof. Ils savent créer des moments de pure magie. C’est facile avec un hit comme «Shining Light». Et ils explosent leur fin de set avec «Girl From Mars» que tout le public reprend en chœur. C’est la fête au petit Bain, un bateau qui est en train de devenir, par la qualité de sa programmation, l’endroit de référence, comme le fut un temps la Maroquinerie.

Avec «Trailer/Kung Fu» paru en 1995, les trois gamins d’Irlande allaient devenir les coqueluches de la presse rock anglaise. On était alors encore en pleine Britpop et le son d’Ash arrivait comme un chien dans un jeu de quilles. Dès «Season», on sentait le souffle. Ils prenaient l’Anglais par surprise avec un son de garçons, bien cisaillé à la cisaillade et bardé de bardage. Ils sortaient ensuite l’un de leurs premiers hits, «Jack Names The Planets», balancé aux accords de poids. On sentait en eux une réelle appétence pour le power. Mais il y avait un gros problème avec «Intense Thing» : ce cut était beaucoup trop puissant pour un petit groupe irlandais. Leur truc sentait le charbon actif - She looked so lonely/ Standing on her own - Ils battaient leur final à coups de tempêtes mirifiques et Tim Wheeler hurlait dans les bourrasques.

Avec «Uncle Pat», Ash continuait de s’imposer. Au beau milieu de cette tourmente de distorse outrancière, Tim Wheeler partait en tortille de solo. Comme on le verra par la suite, son vice, c’est le départ en solo. Avec «Petrol», ils typaient un chant qu’on allait appeler le chant pantelant et toutes les puissances du rock étaient au rendez-vous. TimWheeler avait bien compris le mécanisme des explosions mis au point par les Pixies. Plus loin, ils tapaient dans l’insidieux avec «Different Today» et poussaient à l’extrême les logiques de beat et de grondement de basse. Au bout de ce disque se trouvaient les trois titres de «Kung Fu» et notamment «Luther Ingo’s Star Cruiser». Encore un cut beaucoup trop puissant avec lequel ils inventaient un genre qu’on pourrait qualifier de nitro-power pop, celle qui fait vibrer les tympans des pauvres ères qu’on voit traîner non loin des gibets où pourrissent les dépouilles des arsouilleurs.

«1977» est un album dément, l’un des fleurons du rock anglais, tous mots bien pesés. Ce deuxième album est une sorte d’album insurpassable. Ils attaquent avec «Lose Control», une magnifique dégelée de défenestration. Tim lâche ses légions sur les plaines. Quelle fantastique dynamique de guitares ! Et il passe à la heavyness mélodique avec «Goldfinger», l’Absalon Absalon absolu. La tête lui tourne mais il reprend le gouvernail de sa mélodie et ça devient imparablement bon et juteux. Il faut se souvenir de «Goldfinger» comme d’une pierre blanche, celle d’une éminence fondamentale. Le petit Tim sait écrire des hits fondateurs. Et ils tapent dans la stoogerie avec «I’d Give You Anything». Avec ce pilonnage d’accords de fonte brute, ces Irlandais se montrent encore plus stoogiens que les Stooges. Et ils descendent dans les soubassements d’une mélodie désespérée. Le petit Tim passe un solo de whawha et le cut prend feu en fin de partie. C’est plombé, on a là le meilleur sans espoir qui soit. On retrouve «Kung Fu», avec son drive de basse ultra-saturé et l’excellence de la persistance. Le petit Tim explose ça aux oh-oh-oh de power pop. Puis avec «Oh yeah», il replonge dans les profondeurs de sa heavyness. Le petit Tim n’est autre qu’une sorte de Brian Wilson du stoner irlandais. Il crée des ciels glacés et des dérives au septentrion, avec une force de poignet clouté. Il crée un univers unique dans le rock anglais. Ils revient à sa chère power pop avec «Let It Flow», encore une merveille bardée de paliers et d’autorité. On note le port altier du riff et les alarmantes couinades de coins de couplets. «Innocent Smile» se veut puissant comme le tonnerre et indomptable comme l’éclair. Complètement dévastateur ! Wow, quel album ! Chaque cut sonne comme une bombe. Il tombe un son plein comme le déluge d’Ararat explosé au détour de pont. Ce fatidique power trio expatrie le son au fond du blast. On tombe dans l’exceptionnel avec «Angel Interceptor», bardé de coups d’overdrive de son intentionnel et monté sur un énorme fil mélodique - Oooh it’s good to know/ Tomorrow you are coming home/ I feel heaven in you/ Don’t you know - Quelle fantastique énergie ! Il n’y a que Weezer qui puisse s’élever à un tel niveau jubilatoire. Ils tapent dans les puissances des ténèbres irlandaises pour «Darkside Lightside». Leur truc sort du ventre et ça reste dans l’imbattable. C’est même du pur Lovecraft à biscotos qui s’offre un final spectaculaire et terrifiant d’allure.
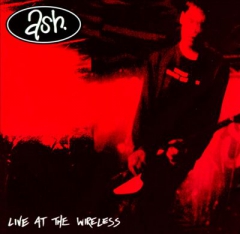
On va retrouver toutes les composantes du génie de «1977» sur un premier album live, le fameux «Live At The Wireless» paru l’année suivante. On retrouve la merveilleuse mélasse d’excellence blasteuse de «Darkside Lightime» que Rick McMurray bat comme plâtre au coin du bois. Ils passent ensuite la belle pop de «Girl From Mars» au foutage foutraque et retombent dans le heavy doom de «Oh yeah». Le petit Tim sait tisser sa toile de fil d’argent dans l’iris d’un soir tombant. Plus loin, ils vont lâcher «I’d Give You Anything», un vrai déluge de magnats du pétrole stoogy. On n’avait encore jamais entendu ça en Angleterre. Le petit Tim cloue la chouette à la porte de l’église maudite. Ils tapent plus loin dans «Goldfinger», l’un des hits d’Irlande les plus puissants qui soient. Quel pachydermisme ! Ils finissant avec une version de «Petrol» explosée à l’harmonie vocale. Ah oui, ils jouent comme des démons pendant que Tim chante comme un ange du paradis. Puis avec «A Clear Invitation To The Dance», Tim devient fou et pousse des hurlements.
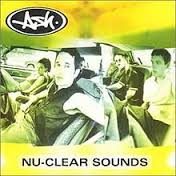
Ils sortent encore un album énorme avec «Nu-Clear Sounds». Dès «Projects», on sent la saturation du son. Ils sortent une mélasse de puissance digne de Monster Magnet. Et voilà une nouvelle bombe avec «Jesus Says», monté sur une fantastique pulsation de chœurs à la Dolls. Voilà une prunerie terrifiante de pataterie, un monstrueux bombardement d’ions soniques bien ronds - Ouh ouhh Ouhhhh - Ces mecs savent briser les murailles. Tout aussi terrific, voilà «Wildsurf», power pop d’ultra puissance, when the Stooges meet Brian Wilson. Encore un coup de génie wheelerien. Il va chercher des contrechants d’excellence explosive et il revient au fil mélodique avec une classe indécente. Quelle merveille ! C’est une sorte d’exaction de sunshine pop ultra débroussailleuse et jouée aux accords des enfers. On n’avait encore jamais entendu une chose pareille. Ils explosent ensuite «Death Trip» au chant de «Maggie’s Farm». Le petit Tim place une diction nitro-active dans l’enfer sonique d’Ash et de cendres. Il œuvre au pur génie iconoclaste et il en a les moyens, le petit bougre ! Et l’infâme Mark Hamilton broie tout ça à coups de basse. Attention à «Numbskull» ! Tim titille ça au gimmick innocent et il revient screamer en armure noire. Il prévient. Et tout s’écroule dans une fracas dévastateur. Il passe du chant à la destruction en règle, de la finesse à la déflagration. Il roule tout dans sa mélasse de farine de distorse et va aux extrêmes définitifs. Il reste encore un énormité sur cet album : «Fortune Teller». Une stoogerie de plus. Tim s’amuse à battre tous les records de garage incendiaire. C’est stoogy dans l’essence du chant. La ville brûle quand joue le groupe et Rick McMurray double la pétaudière en fin de cut.

«Free All Angels» paru en 2001 est le dernier album de l’âge d’or d’Ash. Première énormité : «Shining Light». On a là une pièce de power pop élégante et hautaine, digne des grandes heures de Pimrose Hill. Le petit Tim allie toujours la puissance à l’élégance. Il embarque son monde à l’ingénue libertine des Panzer Divisions. Il enchaîne ça avec «Burn Baby Burn», une puissante dégelée de gelée, encore un cut admirable de puissance de développement, une mainmise sur la marquise. Ces gens-là font ce qu’ils veulent. Il peuvent matraquer jusqu’à plus soif. «Candy» sonne comme un rêve de saturation maximaliste, souligné aux machines infernales de Dante. C’est une véritable mélasse ouatée de psychédélisme irlandais et le festival impitoyable se poursuit avec «Cherry Bomb», pris à l’extrême son d’exaction de power pop ultimate de mate de mythe. Le petit Tim explose tout ça à volonté, comme si Brian Wislon chevauchait les Walkiries. C’est porté au maxi du max de pack. Qui va oser se présenter après ça ? D’autant que Tim dégueule du wha-whatage et il reprend she’s a cherry bomb dans l’enfer d’une fournaise absolue. Il n’existe rien de plus déterminant sur cette terre. Plus loin, il renoue avec le génie en tapant dans «Pacific Palisades». Rick McMurray drumme ça comme une bête. Retour aux Stooges avec «Shark» et ils finissent cet album fumace avec «World Domination», une belle dégelée de gimme gimme more. Le petit Tim adore les dégelées. Il multiplie les occasions et Charlotte fait les chœurs.

Avec «Meltdown», Ash retombe comme un soufflet. Fini la rigolade. Tim nous cocote pourtant «Meltdown» à la pure méchanceté. Il fait bien le coup des couplets à vide sur fond de cocote, mais ça n’explose pas. Par contre, «Orpheus» explose. Tim sort de ses gonds et revient à son chant tordu d’ode d’Irlande. Mais on sent que la niaque d’«Angel Interceptor» a disparu. Avec «Clones», il va faire un tour dans le champs de maïs et on le perd de vue. Est-ce la présence de Charlotte qui plombe le groupe ? Ils semblent avoir abandonné la veine stoogy. Il faut attendre «Vampire Love» pour retrouver la bouillie surpuissante de power pop vampirique à laquelle ils nous avaient habitués. Le petit Tim revient à sa manie de l’explosion, mais sans la fibre d’antan qui se chargeait de mélodies. Il prend un solo furibard et sauve l’album.

«Twilight Of Innocents» est ce qu’on appelle un album foiré. Ils attaquent avec un «Started A Fire» qui sonne comme «I Got You Babe» de Sonny & Cher. Tim balaye ça d’un solo visionnaire. Puis ils nous stompent «You Can’t Have It All» et tapent un refrain lumineux, évidemment. Tim tente de renouer avec la démesure dont il s’était fait le héraut. Mais leur power pop va tomber dans la banalité. Rien ne ressemble plus à la power pop que la power pop. On s’y ennuie à mourir. Aucune étincelle ne veut montrer le bout du nez. Tim et ses amis enchaînent une série de cuts désespérément ordinaires. Tim passe un killer solo dans «Ritual», bien liquide et ravagé de tremblés longs, mais ça ne suffit pas. C’est Mark Hamilton qui mène «Princess Six» par le bout du nez. Il drive tout à la bonne basse - I’m out of my mind/ Cos I need your love - Et ça se termine à la folie garage de yeah yeah yeah oh oh - On voudrait bien qu’Ash fasse encore de gros albums, mais ça doit être difficile de maintenir un tel niveau. C’est évidemment la raison pour laquelle ils ont arrêté d’enregistrer des albums.

«Kablammo» vient de paraître. L’album du retour aux albums ne convainc pas. Avec «Let’s Ride», Tim cherche désespérément à retrouver sa vieille veine, celle des tubes puissants qui éclataient dans l’azur de la pop anglaise. «Let’s Ride» a l’étoffe d’un hit, on sent le retour des grandes eaux d’antan, mais ça reste un amuse-gueule. Il faut attendre «Go Fight Win» pour retrouver un peu de viande. C’est le stomp du retour en grâce d’Ash, l’apanage du power-trio. Ils renouent enfin avec l’art ancien de la belle démonstration de force battue à la diable. La face B bâille aux corneilles et se réveille avec «Shutdown», une power pop pressée qui ne traîne pas en chemin. Hâtons-nous, dit-elle, car le soir tombe !
On retrouve l’essence d’Ash dans les compiles de singles. C’est là que ça grouille. Autant se payer ces compiles, car on y fait le tour du propriétaire.

«Intergalactic Sonic 7’s» devrait monter à bord de la chaloupe en partance pour l’île déserte, car ce double album fonctionne comme un véritable champ de mines. On saute quasiment à chaque cut. Ash groupe imparable ? Allez savoir... Ça démarre avec «Burn Baby Burn», pas de surprise, c’est une dégelée avec un solo à la dentellière des enfers. S’ensuit un «Envy» allumé à coup d’one two three four et on plonge dans l’écume des jours. Tim joue la carte de la niaque maximaliste et il ne rigole pas. Avec «Shining Light», il fait monter la bébête de manière extravagante. C’est explosé de son dans un télescopage de beauté virtuelle à l’horizon. Encore une pétaudière avec «A Life Less Ordinary». Rick McMurray bat comme Vulcain, avec une rage démoniaque. C’est l’occasion idéale pour Tim, alors il emmène ses mélodies exploser au dessus de nos têtes. Pas compliqué : tout est démesuré chez Ash. On retrouve l’effarant «Goldfinger», ils tapent ça du haut des falaises de marbre. Il y a du Phil Spector chez Ash. Quelle clameur et quelle ardeur ! Ils enchaînent avec «Jesus Says» et «Oh Yeah» que Tim amène à la régulière et qui virent à l’énormité. Ici tout n’est que puissance et beauté surnaturelle. On tombe sur un «Candy» pompé dans «Make It Easy On Yourself» et saturé à l’extrême. Oh et puis voilà le retour d’«Angel Interceptor» qui pue le hit planétaire dès la première mesure. Tim amène «Wildsurf» au chant classique et c’est aussitôt explosé en pleine mesure. Ces gens-là ne respectent rien et surtout pas les oreilles. Ils vont à la rencontre de Brian Wilson avec du son plein les poches. On retrouve tous les autres hits à la suite, «Petrol» et «Numbskull», bien sûr. Le disk 2 est aussi éprouvant pour les nerfs. «No Place To Hide» blaste dès l’intro. C’est cisaillé à la base et tous les adjectifs n’y pourront rien. On s’effare de l’insolence de ponts sur-puissants. Quel groupe peut se payer ce luxe, aujourd’hui ? Tim attaque «Where Is Our Love Going» au riff indécis et violent. Puis il passe en mode cavaleur et va chercher des tracasseries d’accords intrinsèques. Ah il tire bien son épingle du jeu, l’animal. Il nous plonge dans le grand maelström de fin du monde démentoïde et c’est battu à la vie à la mort. Encore un cut écrasant de beauté : «Stormy Waters». C’est la power pop la plus heavy de l’histoire du rock, un vrai blasting d’énergie ! Et ils retombent dans la stoogerie de bas étage avec «Melon Farmer». Tim y va comme un Irlandais. C’est chanté à deux voix et ça se perd dans l’outrage fournaisien. Tout est tellement démesuré là-dedans. «Gabriel» est aussi hallucinant d’ampleur. Tim explose la surface du rock. Ils sont terrifiants de démesure et c’est battu comme plâtre. On assiste à l’embolie du beat. «Lose Control» est amené par la pire des menaces - I’m doin’ alright/ Don’t you lose your soul - Ils sont la pire démence qui soit - Out of your mind - le riff plane comme un aréopage de vampires. Et Rick McMurray tape comme un sourd sur «Sneakers». C’est à quatre pattes qu’on sort de cette compile.
Ils décidèrent à une époque de cesser d’enregistrer des albums et de ne faire paraître que des singles. C’est pourquoi on trouve deux volumes de singles parus en 2010, «A-Z Vol. 1» et «A-Z Vol. 2».

Curieusement, on retrouve sur la plupart des singles le son dévastareur, mais sans la démesure qui caractérisait les grands hits ashiens. Il faut attendre «Joy Kicks Darkness» pour vibrer un peu. On a des chœurs de folles dans l’intro et c’est du grand Ash explosé au refrain et des ponts déviants rabattus au beat fatal. Beau single aussi que «The Dead Disciples», joué à la cocote d’expert et monté au chant d’exception. Tim vise les ampleurs considérables - I’m feeling so alive - Il crée un authentique événement d’importance, tant la clameur porte au loin et il chante à l’extrême pourfenderie du chaos - When the show is breeding/ All the ghost are rolling/ When the wall are shaking/ Watch the stars exploding - Pur génie ! Encore une énormité avec «Pripyat» et de la power pop explosive - I listen to the defeaning silence/ In the beautiful lost citadel - On retrouve le grand Tim des envolées. C’est bardé d’images clairvoyantes et plâtré de plâtras de son. Attention à «Command» et à son intro de basse. On a le petit jeu couplet/refrain et les pires jutes d’explosivité. Les refrains coulent comme des fleuves de lave hilare au long des côtes. On tombe plus loin sur «Comin’ Around Again» joué à l’explosivité des descentes. Les couplets clamés sont jetés dans le chaos des refrains et ils nous sortent un final éblouissant. Voilà la puissance du team de Tim. Il balaye tout à la wha-wha et il part en pire vrille qui vaille. S’ensuit une autre dégelée avec «The Creeps». On voit rarement des cuts d’une telle intensité. On sort du commentable. C’est bombardé de Creeps Creeps Creeps.
Ash offre avec le Volume 1 un docu intéressant sur DVD. On suit le groupe en tournée en Angleterre et on voit à quel point Tim et ses deux amis sont décontractés. Sur scène, Tim joue sur une SG blanche. On les voit aussi déclarer la fin des albums. Ils décrètent ne plus vouloir faire que des singles. Et puis à un moment, Tim parle de ses albums favoris, «Abba’s Gold», «Singles Going Steady» des Buzzcocks et «Hot Roks» des Stones. Mais c’est vrai que le singles club est un exercice périlleux. Seuls s’y sont risqués avec eux le Wedding Present et les mighty Wildhearts.

On trouve au moins quatre hits énormes sur le «A-Z Vol.2». À commencer par le wall of sound de «Dare To Dream», gratté en compagnie des anges du paradis. On admire Tim pour ça, justement, pour son goût des apothéoses. Il adore s’installer dans l’enfer d’un mur du son. Il réinvente Spector et le Brill quand il veut. Il développe une puissance qui défie les lois de la nature. Autre hit : «Binary». Tim y retrouve sa belle veine glam. On peut bien parler ici de grandeur suprême du rock anglais - Pumping your heart/ Having your mind delicately blown apart - Énorme ! Toute aussi énorme, voici «Physical World», du vrai Ash sound gratté aux power-chords dévastateurs. Ces trois-là savent blaster un hit avec la même évidence que Slade. «Embers» est aussi du pur jus de power pop explosive. Tim est un entremetteur de power et de pop de premier ordre et en prime, il nous refait le coup de la vrille. Autre monstruosité : «Teenage Wildlife» qui aurait tendance à vouloir sonner comme le «Heroes» de Bowie. Franchement, c’est un hit, mais un hit d’allure planétaire. C’est chanté au meilleur glam d’Irlande et Tim l’orne d’un solo d’encorbellement majeur. C’est terrifiant de grandeur verte. Puisqu’il parle de grandeur verte, justement, voici «Running To The Ocean», encore de la power pop de très haut rang - Coming back to life/ Waking up inside - et il part en solo écarlate dans l’ocean is green, l’ocean is blue. Il faut aussi se gaver d’«Instinct», tendre et dense, avec encore un petit côté Bowie dans le chant. Tim sait naviguer au plus serré, c’est un popster de rang aristocratique.

Le fin du fin, si on aime Ash, c’est de les voir sur scène ou, à défaut, à la télé. Facile si on chope le fameux DVD Tokyo Blitz. On y voit la formation classique avec Charlotte, la perfe de la perfe. Ils sont bien écartés les uns des autres sur scène : Mark Hamilton le bassman fatal, Rick Tape-dur coiffé à l’iroquoise de Travis Bickle, Charlotte en chemisier blanc, Anglaise jusqu’au bout des ongles et au centre Tim la star avec sa Flying V, Tim de hargne et de jambes écartées, Tim d’essence du rock. Il envoie la mélodie de «Life Less Ordinalry» et c’est stupéfiant d’impact. S’ensuit un «Shining Light» qui est le hit absolu. Shining éclate Tokyo qui ovationne Tim la star, le teenage angel du mythe éternel. C’est à pleurer tellement c’est beau sur scène. Tim le sait, il ne joue que des hits, comme les Beatles avant lui. Les profondeurs de «Goldfinger» sont insondables de pur jus. Chaque titre pulvérise tous les hit-parades. «Cherry Bomb» n’a l’air de rien comme ça, mais au refrain, la mélodie nous saute à la gueule. Quand ils jouent «Kung Fu» et «Girl From Mars», ça pogote dans la fosse. «Wild Surf» fait danser Tokyo. Tim rappelle que «Jack Names The Planets» fut leur premier single et «Jesus Says» sonne comme un hit dès l’intro. Ils finissent avec l’effarant «Numbskull».
Et voilà que Tim la star se lance dans une carrière solo avec «Lost Domain». Son père vient de disparaître et il en parle dans «Hospital», une fantastique leçon d’humilité - So I found I was not so strong - Il s’y confesse et c’est poignant - Try to recall the good days gone for evermore/ Try to recall the innocence that I had before - Pour «Do You Ever Think Of Me», il va chercher les très gros effets. Tim est un être en quête d’absolu, ça crève les yeux. Il vise les parapets noyés de brume, au-delà des mondes connus. Il refait son Richard Hawley pour «End Of An Era» et se noie dans un océan d’orchestration. Il explose les limites du Brill et file vers les profondeurs inexplorables de l’univers. Mais il veille à rester indiciblement mélodique. «Medecine» est encore une belle pièce de pop directive et orchestrée à outrance. Tout sur ce disque est ultra-produit, ce qui paraît logique, vu l’étoffe du songwriter. Avec cette chanson fleuve, il va une nouvelle fois très loin. On trouve deux beaux instros sur cet album, dont un «Vapour» joué au sax et au xylo. Tim la star fait de la magie ni noire ni blanche mais lumineuse. Il termine cet album édifiant avec «Lost Domain» et confesse à nouveau ce que chacun ressent lorsque son père jette l’éponge - I think about my father/ And all that I have lost there/ Away away away.
Signé : Cazengler le pot-ash
Ash. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 1er décembre 2015
Ash. Trailer/Kung Fu. Squatt 1995
Ash. 1977. Infectuous Records 1996
Ash. Live At The Wireless. Death Star 1997
Ash. Nu-Clear Sounds. Homegrown 1998
Ash. Free All Angels. Infectuous Records 2001
Ash. Intergalactic Sonic 7’s. Infectuous Records 2002
Ash. Meltdown. Infectuous Records 2004
Ash. Twilight Of Innocents. Infectuous Records 2007
Ash. A-Z Vol. 1. Atomic Heart Records 2010
Ash. A-Z Vol. 2. Atomic Heart Records 2010
Ash. Kablammo. Atomic Heart Records 2015
Ash. Tokyo Blitz. DVD Infectuous Records 2001
04 / 12 / 2015
BUS PALLADIUM / PARIS
THE WAVE CHARGERS
HOWLIN' JAWS
Vendredi soir au coin du feu. Samedi soir à Troyes avec The Twillinger's, a rockabilly band que je n'ai jamais vu. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Pardon, sur du papier à rock'n'roll. Mais dans la vie, c'est souvent comme dans le poème d'Edgar Poe, le corbeau noir du désespoir et de la malédiction s'en vient frapper à votre porte. Les plans les mieux préparés s'effondrent, tel un château de cartes emportées par le vent de la terrible Nécessité. Serais-je donc privé de concert cette semaine ? Orage, ô désespoir, ignominique coup du sort qui tombe comme le tranchant de la guillotine sur mes prévisions saturdiennes. Non ! Il n'en sera pas ainsi, sort funeste, je te niquerai jusqu'à la moelle du trognon. Vu l'heure avancée, me reste dix-sept secondes pour fomenter le plan B. That's all right mama, anyway I can do !
La teuf-teuf mobile a compris. Ce soir les feux rouges, les limitations de vitesse, les passants sur les passages cloutés, ça n'existe pas. Des para(kilo)mètres négligeables. Elle a enfin décroché un rôle qui lui convient dans La Highway Impitoyable, celle dont le sang caillé d'innocents piétons forme un pourpre tapis ordalien de goudron rouge du meilleur effet. Résultat : j'arrive pile-poil, à l'heure. Et même avec un peu d'avance.
THE WAVE CHARGERS

Avec un nom comme ça, je ne me faisais pas trop d'illusion. Des attardés de la première mouture des Beach Boys ( ces amerloques qui avaient piqué leur riff à Chuck Berry ), mais comme le pire est toujours certain, les Wave Chargers m'ont séduit. Pas que moi d'ailleurs, vu la salle qui on-, qui ondudu-, qui ondulala, donc qui donc ondula durant tout le set. Quatre sur scène, dont trois avec des lunettes. Depuis Buddy Holly, nous avons appris qu'il faut se méfier de ces looks d'étudiants sages. Ne sont pas les derniers à lancer le chalut du chahut. Le seul qui n'en a pas – je parle des lunettes, demoiselles déjà gémissantes - c'est Francis, la même coupe de cheveux qu'Eddy Mitchel au début des Chaussettes, mais je ne pense pas que cette référence ait été recherchée, et une guitare d'un bleu pâle délavé, enfin pas une guitare, une Fender, et là ce n'est pas un hasard. En plus, va nous montrer qu'il sait s'en servir. Derrière, c'est Claude à la batterie. L'a le sourire facétieux du singe qui du haut de son palmier lance des noix de coco sur le naufragé épuisé que les vagues magnanimes ont roulé sur la plage salvatrice. Sacré coco, il vise juste, et tire des bordées incessantes. Un mauvais destin a voulu que Samy soit préposé à la basse. Ce n'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il a des attitudes innées de lead guitar, le gars qui fait tout le spectacle, debout, couché, à genoux, incapable de rester en place, prend la pose pour les photos souvenirs. Mais Anne ma soeur ne vois-tu rien venir ? Que nenni, ma soeur, je ne vois que le surf qui poudroie et le roll qui verdoie. C'est Anne en personne qui tient et son propre rôle et sa guitare – encore une Fender – qui lui donne la réplique.

Twang ! c'est parti, un petit Wave Chargers Theme, pour annoncer la couleur. Trailer musical, nous voici replongés en pleines années soixante avec ces guitares chantantes et vrombissantes qui affolaient la population. L'on n'avait jamais entendu ça, c'était fuselé et aérien comme un carénage d'avion, et ça vous emportait dans des galops de tribus apaches sur le sentier de la guerre. L'a fallu quatre ans pour s'y habituer, de par chez nous en notre douce France, ce fut un vent de folie, l'on ne comptait plus les groupes qui affutaient leurs guitares, c'étaient les jours heureux de Globule le phoque, les Guitares, les Champions, les Fingers, les Pingouins, les Mustangs, les Fennecks, les Aiglons, les Lionceaux, les Panthères, et toute la ménagerie avec, pour finir au plus proche de nous, en queue d'hirondelle, les Arondes de Montpellier... en arrière-fond bien sûr Dick Dale, Link Wray, Duane Eddie, Hank Marvin, et plus loin encore, plus secret et moins connu à son époque, le travail studio d'Eddie Cochran...

Y avait de tout dans le rock instrumental des années 60, des génies du manche... et des copieurs, et des faiseurs, et des suiveurs. C'est un rock qui s'est un peu dilué en sa propre parodie. De l'exaltation adolescente d'une jouissance sans entraves l'on est passé au médiocre farniente de l'oisiveté petit-bourgeoise, ambiance shaker lounge cocktails des îles avec coca et sans molotov. La vague blues Stones s'est abattue sur cette jeunesse décadente et l'a roulé au loin tel des fétus de chapeau de paille. Chance pour nous, les Wave Changers restent sur la crête de la lame. Ils ont le son et le mur, autant dire que ça décoiffe sec, roulements de Claude et cavalcades de Francis, va chercher les notes brontosaures qui résonnent graves et écrasent tout sur leur passage, et les notules toutes fines à la Woody Wood Peeker qui vous transpercent les tympans sans pitié. L'alterne les basses de basaltes avec la translucidité des cristaux transparents. Anne s'applique, un peu le rôle du second couteau qui ne passe pas dans les premiers plans de guitare, mais elle construit les contreforts nécessaires au soutènement des édifices qu'échafaude Francis. De l'autre côté, contrepoint parfait d'Anne immobile, Samy s'amuse, s'agite, ressemble au discobole de la statuaire grecque avec cet avantage indéniable, celui du mouvement perpétuel. Sale gamin à qui ses parents ont oublié de refiler sa dose de théralène pour qu'il se tienne enfin tranquille.

Nous font des trucs extraordinaires. Douze mesures de Nous les garçons et les filles et plang l'on part dans un tourbillon apocalyptique. Idem pour le Bambino, le must des années soixante, mais pour attardés mentaux, un truc à la sauce Dalida, mais qu'ils nous servent dans une assiette proto punk sixty, qui dégouline de moulinades déjantées. C'est que tout un set instrumental, faut le tenir. Le public est versatile, s'ennuie vite, faut le surprendre à tous les riffs. Faut savoir ménager les surprises, un What'd I say mouture Chat Sauvage chanté avec l'assistance, qui en deuxième partie est chargée de faire les Realets – entre parenthèses autant les Wave turbinent sec, autant nous ne sommes pas merveilleux sur l'affaire. Participation oui, mais les mystères du swing vocal ne sont pas acquis. Par contre question torsion, rien à redire ça twiste dur, à gauche, à droite, au milieu, tout le monde se contorsionne comme si le sort du monde en dépendait. Et pourquoi pas après tout ! Nietzsche n'a-t-il pas écrit beaucoup de bien sur la folie dionysiaque ?

Z'ont un répertoire qui flirte avec le western et les films sur écran panoramique. Un truc comme Attack of The Mexican Food ou La Revanche de Kuromaku, même sans savoir de quoi ça instrumente, vous dessinez les décors grandioses, les chevauchées prestigieuses et les scènes de combat à vous couper le souffle, l'instrumental sixty possède sa dose de carton twang et d'imaginaire kitch, cela peut être sa faiblesse, mais quand les Wave Chargers sont à la réalisation, vous y croyez dur comme du fer brûlant. Palissades Park c'est le grand huit des sensations,une tourmente de guitares qui vous arrachent le palpitant et vous précipitent dans le vide de l'extase.
J'éprouve un regret, j'aurais aimé les entendre sur Apache, oui m'ont offert en échange Shazam et Kasbah – ah ! l'orientalisme de bazar des années soixante, les sortilèges de l'Orient, les cordes qui vous tressent des tapis volants, et les volutes kiffées des narghilés – mais Apache, pour Claude, pour son entrée de batterie, j'aurais voulu le voir drummer, cela n'a l'air de rien, mais il en faut de la subtilité, et avec sa frappe, toute de roulements, pré-Keith Moon – somme toute peu articulée, si ce n'est dans ses accointances rythmiques avec les paragraphes d'arabesques de la Fender de Francis - je suis sûr qu'il s'en serait dépatouillé avec brio.

Rien ne ressemble plus à une giclée de guitares qu'une autre giclée de guitares. Les groupes de l'époque sont allés chercher des sonorités inaccoutumées un peu partout, fandango, flamenco, musiques arabes et d'ailleurs. Tout cela se retrouvera, plus tard magnifié par Led Zeppelin, n'oublions pas qu'à l'époque Jimmy Page était déjà en embuscade et que ces recherches ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, ni dans les mains d'un manchot. Les Wave Chargers sont des jeunes gens modernes que je devine abreuvés de pulp fiction, de manga, et de séries télé, des titres comme Ho Ku Kai et Kuma Beat, nous emportent dans dans un Japon. Exotic mais pas exotoc.
Sont convaincants, les Wave Chargers. Nous ramènent dans le passé du rock, mais ils en redéfinissent les contours. Ravivent les couleurs. Ne se contentent pas de simples décalcomanies. Inventent des teintes nouvelles. Plus flashy. Un set de plaisir. La salle les acclame à tout rompre. L'ont mérité.
HOWLIN' JAWS

Ah ! Les Howlin, rappelez-vous leur passage à La Mécanique Ondulatoire, même pas un mois, ( voir KR'TNT ! 255 du 12 / 11 / 2015 ) et le souvenir marqué au fer rouge d'une apparition apocalyptique. Les revoici donc sur la scène du Bus Palladium. Je ne suis pas tout à fait un idiot, n'ai pas choisi la soirée au hasard. Après le concert de Smooth and the Bully Boys de la semaine dernière, je n'aurais pas pu supporter du rock mélangé d'eau tiède. Me fallait du pur malt au venin de crotale. N'ayez crainte j'ai eu mon médicament. Mais cette fois, sans malt ni additif aquatique, rien que le poison du reptile. Ultra-cobraïque, flacon noir, avec tête de mort en rouge flamboyant. La pourpre agonistique des Dieux.
Avec leur casquette à hélice, n'ont pas l'air sérieux. Arborent un look de collégiens malicieux. Rayon farces et attrapes, l'inénarable trio, Djivan le grand échalas au coin à côté de sa contrebasse, le cancre Mathieu au fond près de la batterie radiateur, et Lucas le beau gosse de la bande qui scrute sa guitare cahier de mathématique d'un air blasé. Evidemment comme ce sont les trois mauvais garçons de la classe, il y a un max de filles qui s'écrasent sur le devant de la scène. Crient pour attirer leur attention. Peine perdue, sont déjà préoccupés par la préparation de leur prochain mauvais coup. Trop tard, vous ne les arrêterez pas, c'est parti.
Cuttin' Out. Tout de suite l'on sent la différence. Ce n'est pas qu'ils jouent mieux. C'est qu'ils s'expriment davantage. La grâce sauvage d'un tigre féroce vous ne saurez l'apercevoir dans une cage carrée de deux mètres sur deux. A la Mécanique Ondulatoire, la scène était minuscule. Z'étaient comme des lingots d'or tassés dans un coffre-fort. Il avaient le droit de respirer, mais pas davantage, ce qui nous avait surtout permis de nous régaler les yeux du jeu de Mathieu en quelque sorte privilégié par la vaste – toute relative - portion d'espace confisquée par ses tambours. Mais ici sur l'estrade du Bus, il y en a deux qui bénéficient d'une large bande de terrain. Pas de football, disons la surface d'un parterre de jardin. Pas le Pérou, mais une zone d'évolution libre. Ce qui change tout. C'est tout de même mieux d'avoir les coudées franches pour jouer de la guitare et emmener la grand-mère au bois et lui montrer comment l'on se chauffe.

Cuttin' Out donc. Facile d'imaginer la musique des Howlin', Djivan et Mathieu s'occupent de la bétonneuse, vous produisent un mortier précontrain, inaltérable et inattaquable. Un pavement aussi solide que les pierres que les Egyptiens ont assemblé pour former les pyramides. De la belle ouvrage. Que Mister Lucas s'emploie aussitôt à découper en morceaux. Vous la sculpte en moins que rien. Même pas au marteau-piqueur, non au burin. Touche trois fois les cordes et vous comprenez que vous êtes en face d'un grand. Dans le rock, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Pouvez acheter toutes les méthodes que vous voulez et vous payer des professeurs, cela ne sert à rien. C'est inné, le moment exact où vous posez la note. Ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop près, ni trop loin. Ce n'est même pas indiqué sur les partoches ( quand elles existent ). Et Lucas, il pique et repique à la nano-seconde près. Fait de la dentelle sur l'ouragan que lui concoctent les deux autres. Solitaire accompagné.

The Urge, By the Tim, Stranger, les morceaux se suivent et se ressemblent, défilent et exhibent leur différence. Magie du rock and roll, tempo de feu et vol du temps suspendu. Tout est dans le silence. Entre les deux notes assénées par Lucas. Une fraction de temps, et une attente interminable, nul ne sait où il veut en venir, mais nous débouchons à l'endroit précis du chemin qu'il a choisi. Ce ne sont pas des notes qui sortent de sa guitare. Mais des cris, incisifs dont l'écho se promène en nous, mais lui il est déjà ailleurs. Plus haut, et le médiator retombe comme un aigle dans le cœur de Nuage Rouge, ou comme la foudre sur nos âmes transformées en paratonnerre.

Ayez le meilleur guitariste que vous voulez mais cela vous sera aussi inutile qu'une cigarette sans allumette. Vous faut aussi le chanteur. Qu'est devenu Cliff Gallup sans Gene Vincent ? Et ce soir Djivan ne chante pas, il est le pétrel dans la tempête, il se joue des vents et des modulations. Ne passe pas en force. N'assène pas les lyrics à coups de barre à mine. Il les pose. Juste l'écume sur le haut de la vague, mais qui en souligne toutes ses inflexions et toute sa puissance dévastatrice. Les chanteurs de rock ne chantent guère. Sont des metteurs en scène, s'apparentent à des réalisateurs de cinéma. Créent un monde. Interprètent tour à tour une comédie désopilante et puis nous engluent dans un drame sanglant. Les paroles s'impriment sur votre rétine, elles ordonnent des images, parce que la voix du chanteur fait office de lanterne magique. Tout est dans l'attaque, la pointe d'ironie, la levée de voix sardonique, l'hésitation complice, l'incitation au crime, et l'invitation à d'obscures copulations. Un sacré manipulateur de marionnettes le vocaliste rock, sa voix est le fil et vous le pantin articulé subjugué hypnotisé et consentant. Une fois que vous avez compris cela, vous n'avez plus de souci à vous faire. Et Djivan a tout pigé.

L'a quand même une double fonction, l'est aussi le contrebassiste du groupe. Y prend un réel plaisir. La penche du côté par où elle ne tombera pas, s'y vautre dessus comme un ruffian énamouré, mais la remet d'aplomb au dernier moment juste avant de céder à la tentation de lui faire subir les derniers outrages. Elle en miaule de rage comme une chatte insatisfaite qui voit le mâle qui se fait la malle et part en cavale avant d'accomplir son devoir procréatif. Elle aimerait s'étendre sur un djivan du salon en vue d'une plus grande coopération, mais non, alors elle feule de désespoir et clame à tous les échos sa profonde déception.

Mais il y a remède à tout, même à une frustration meurtrière. C'est Baptiste qui se charge de faire briller l'espoir. Sur son estrade il annonce à coups de grosse caisse la vente de l'élixir spermatique de remplacement. Possède une appellation suggestive, rock and roll, et il rocke et il rolle à jets discontinus de toutes ses baguettes. La plainte de la Big Mama est englobée dans un magma germinatif, sous le rocky chapiteau tous les miracles sont permis.

Babylone Baby, Oh ! Well, le set atteint à une dimension pharamineuse. Lucas se surpasse. Avec la chair saignante que lui hachent ses deux acolytes, il vous prépare des boulettes de viande empoisonnée qu'il vous lance à la figure comme on jette des graines salvatrices aux passereaux affamés dans les parcs municipaux en hiver. L'on se rue sur cette persillade, en hurlant. Dans la salle c'est le délire. N'y a plus qu'une foule fusionnelle qui ondoie en mesure. Alors Lucas se plante sur le devant de la scène, cinq secondes pas plus, juste le temps de lâcher les cinq plus vicieuses notes de la soirée, celles qui mordent au bas du ventre, et puis il repart en arrière, perdu en lui-même, en une explication sans fin avec sa Squier guitar.
I'm Mad, You got to Loose, Tough Love – un programme de l'attitude quintessencielle rock – ce sont les trois derniers morceaux que les trois chiens enragés des Howlin'Jaws consentent à offrir à la meute hurlante qui assiège la scène. Fini, terminé, Lucas éteint son ampli. Pas de rappel c'est la règle. Mais quelle énergie ! Nous ont transformé en punching ball et n'ont pas arrêté de nous taper dessus. Non seulement on a aimé, mais l'on en aurait redemandé. C'est ça le rock and roll ! Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Nul n'est parfait. Vive les Howlin' Jaws !
( Les photos correspondent au concert de l'American Tours Festival 2015 )
LA MOUCHE

Rien de plus énervant qu'un essaim de mouches qui bourdonnent autour de votre tête. Sont nombreuses Les Mouches, une bonne douzaine. Avec trombone à coulisse, trompette et clarinette, et tout le bataclan. Un côté cirque pagailleux, un côté festif délirium, une ambiance post-hippie, rock alternatif français. Tout ce que je n'aime pas. Me suis enfui dès le deuxième morceau. Je sais c'est lâche, mais c'est ainsi. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être ont-ils donné un show de toute beauté. Ce qui est sûr, c'est que le public acquis d'avance a dû être comblé. Mais je n'ai pas senti. Me suis fié à mon flair. Et puis après les Howlin' je n'avais plus besoin d'autre chose. Tout ce qui suivrait ne pourrait que se situer à un moindre niveau.
Je n'aime guère ceux qui mettent de l'eau hilarante dans leur rock. Le dosage n'est jamais évident. Faut être, soit trop naïf, soit très fort. Le burlesque est un art difficile. Faut d'abord avoir traversé le noir de la nuit le plus désespéré pour en sentir par delà les éclats de rire les facettes les plus lugubres. Et la bande de joyeux godelureaux sur la scène m'ont paru manqué de cette grotesque expérience métaphysique. Trop sûrs d'eux. Leur manquait d'après moi une certaine fragilité existentielle. Tout ces a-priori sans remettre en cause leur dextérité musicale, même que le guitariste n'est pas du tout venant. Se défend mieux que bien. Ce qui me semble manquer à ce genre de groupe, c'est qu'au milieu de leur syncrétisme, ils ont oublié l'importance des racines rock and roll. Je le répète, je ne suis pas sectaire mais je n'aime que le rock.
Damie Chad.
THE HOWLIN' JAWS
TOUGH LOVE / BYE BYE BABY
DJIVAN ABKARIAN : Double basse – Lead vocal / BAPTISTE LEON : Drums – Back vocals / LUCAS HUMBERT : Guitar – Back Vocals
Recorded Live at BLR Studio / Mixage : Mister Jull – Thibaut Chopin /

Dernier 45 tours des Howlin'. Z'avaient le look anglais sur la pochette du premier, tenue plus décontractée pour celle-ci, sales gosses qui se foutent de votre gueule avec leur casquette à hélice de Spitfire sur la tête. A la limite il n'y aurait pas besoin d'écouter. Avec le précédent, sont parvenus à créer une esthétique, des objets de collection. Le vendent à cinq euros l'unité, vu l'épaisseur de carton et la lourdeur du vinyl, c'est donné.
TOUGH LOVE : c'est du brut, d'ailleurs Baptiste commence à taper sur sa batterie comme une brute et Djivan vous a une gosse voix à le faire passer pour un ogre. Après cela, vous vous laissez emporter par la bête. Sauvage. Martèle du sabot, mais Lucas vous y plante de ces banderilles de guitare si acérées dans le dos que vous avez envie de les dénoncer à la SPA. Fermez les yeux ( mais pas les oreilles ) et vous êtes transportés en 63 en Angleterre quand les Animals et les Them commençaient leur expérimentation sur le blues. Oui mais les Howlin', la vivisection ils la pratiquent sur le rock and roll, et faut avouer que ça saigne. Avec ce Tough Love ils ont toughé le gros lot. Ah cette basse qui broute, ce drummin' qui vous empogne et cette salière de guitare à la nitro...
BYE BYE BABY : encore plus colérique, la guitare qui pique, la voix qui résonne, la batterie qui caracole, une face B qui se profile aussi meilleure que la A, les backin'voices qui plagient la lead, un petit solo de Lucas comme on les aime, quinze secondes et circulez, n'y a plus rien à voir, sold out, Djivan qui s'égosille et s'étrangle de fureur, c'est rempli de petites séquences, comme ces tombeaux égyptiens truffés de chambres secrètes, cherchez et vous trouverez toujours quelque chose que vous n'aviez pas visité avant. Du grand art. L'est pas prête de vous débarrasser le plancher la baby, on ne le dira pas, mais c'est vous qui la retiendrez longtemps sur le pick up.
Rien de pire que le vice. Me suis repassé le volume 1, le Sleepwalkin' et le Bumblebee sur le phono. Si vous voulez mon avis philosophique sur la question, si les Howlin' Jaws avaient huit autres titres de l'acabit de ces quatre, et si l'idée leur venait de tous les réunir sur un trente-trois tours, l'on aurait là un album essentiel du rock français d'aujourd'hui. Wait and see !
Damie Chad.
JIMI HENDRIX
RENAUD EGO
( Le Castor Astral / 1996 )
Il y a des jours où je ne peux pas me regarder dans un miroir. Plus de deux cent cinquante livraisons de KR'TNT et pas la plus minuscule notule sur Jimi Hendrix. Un trou de cette grosseur dans le gruyère, c'est un peu exagéré. Je le comprends, je plaide coupable. Je n'ai aucune circonstance atténuante. Ce petit volume déniché dans la bibliothèque tombe à point nommé pour réparer cette omission criminelle. Peut-être que quand je mourrai, à cause de cette impardonnable faute, le bon dieu me refusera le paradis. Je l'aurai mérité. Mais peu me chaut, en vérité je m'en fous d'être avec les fous, tous les rockers sont des grands pêcheurs, sont tous damnés pour avoir joué la musique du diable, sont parqués au fond le plus noir de l'Enfer. N'y sont pas malheureux, une éternité de concerts et de jam-sessions, que voulez-vous de mieux pour des rockers ? D'autant plus qu'il y a des millions de jeunes filles fautives dont il faudra s'occuper activement afin qu'un peu de réconfort moral leur permette d'oublier leurs turpitudes terrestres. Que ces projets d'avenir et de pieuses intentions ne nous détournent de la vie de Jimi, en cette vallée de larmes.

Tout de même une chose me console : faut attendre la cent quinzième page du bouquin pour trouver un résumé de la vie de Jimi. Très bien fait d'ailleurs, dans l'ordre chronologique et agrémenté de brèves citations d'interviews qui éclairent parfaitement la trajectoire du zèbre. Discographie, bibliographie, filmographies à la suite. Rien de pesant, sélectif et rien que l'essentiel. Je vois poindre la question sur vos lèvres : mais que trouve-t-on donc avant ? Mais la biographie de Jimi Hendix, voyons c'est évident mes chers Watson.
Je sens le trouble qui s'installe dans votre cerveau. Soit vous n'avez rien compris, soit vous avez raté un élément important. Ne doutez point de vous, vous n'y êtes pour rien, tout est de la faute de Renaud Ego. Renaud Ego n'est pas un musicologue averti. Est loin d'être un imbécile. A produit des tas d'ouvrages sur des sujets aussi divers que l'architecture ou l'art rupestre africain, mais ce ne sont-là que des cordes adjacentes de son arc. Avant tout Renaud Ego est un poète. N'a donc pas rédigé un livre sur Jimi, tiré au cordeau. Nous offre plutôt ce que l'on pourrait nommer une transcription poétique du guitariste. Pas un recueil de poèmes sur Jimi, non mais le mystère Jimi - commun à tous les individus, car souvent nos actes répondent à des logiques qui nous appartiennent mais que nous ne révélons à personne – tel qu'il fut appréhendé par ceux qui le côtoyèrent. Pas tout le monde, en choisit cinq, Mae, Carol, Harry, Kate et Jim lui-même. Qui ont accompagné son existence, de la naissance à sa mort. D'où sa propre présence à la fin, car l'on est toujours seul lorsque l'on rend l'âme. Des témoins qui se sont plus ou moins épanchés lors et après la disparition de l'idole. Mais ces témoignages n'intéressent guère Renaud Ego. Sont juste des jalons, des balises enregistreuses qui essaient de comprendre le pourquoi du comportement erratique de Jimi.

Jimi ou la difficulté de vivre. Renaud Egonomise, ne nous fait point l'apologie du vaudou psychédélique, les disques sont là et ne demandent qu'à être écoutés. Non, nous conte l'histoire de Jimi le bluesman. Nous connaissons le musicien étincelant, le sorcier de la guitare, l'artiste accompli qui bouscule les traditions et redéfinit les bases de la guitare rock. Le côté glamour de Jimi, les journalistes à sa traîne, les filles à ses trousses, ses tenues vestimentaires colorées, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Le plus important est caché dans les eaux froides d'une vie éteinte. N'est pas né avec une cuillère d'argent dans les molaires. Noir et de sang indien. La dénomination d'Injun Fender serait celle qui lui conviendrait le mieux. L'est un peau-rouge, un Cheval Fou sur le sentier de la guerre, mais après l'extermination, s'est échappé des réserves. N'est qu'un fuyard qui tente de survivre. Né dans la misère, sociale et affective. L'a très vite compris que pour s'en tirer, il doit décamper au plus vite. A tout prix, par n'importe quel moyen, parachutiste - autant dire traître scout qui sert dans l'armée qui opprime son peuple - et puis plus tard avec sa guitare sur le dos, ce qui peut remplacer un bon cheval.

Joue déjà comme un dieu, mais c'est davantage une malédiction. Les Isley Brothers et Little Richard n'ont besoin que d'un accompagnateur, doué mais qui ne la ramène pas avec ses soli incongrus et tonitruants. Ne sait faire que du bruit pour se faire remarquer. Faudra attendre la rencontre avec Muddy Waters qui lui refile le secret du blues en trois minutes. Suffit pas d'ameuter le quartier. Le silence entre les notes est aussi important que les notes. Peut-être davantage même.
L'a tout compris, l'est prêt. Pour toutes les aventures. Ne ratera pas la chance Chandler. Chas des Animals qui cherchaient à devenir producteur... mais qui n'avait personne à produire. C'est l'Angleterre et en quelques mois la gloire. Ne le sait pas encore mais ce n'est qu'une étape. L'a franchira en toute splendeur. Mais c'est le deuxième pallier qu'il ne parviendra pas à surmonter.

Tout nouveau, tout beau. Eric Burdon, Eric Clapton, le Jimi Hendix Experience, Are you Experienced, une flèche qui monte dans l'azur du ciel et qui semble attirée par des hauteurs vertigineuses. Mais l'on n'échappe pas aux lois de la pesanteur terrestre, les filles, les dealers, les pique-assiettes, Jimi ne sait pas dire non. S'empêtre dans sa célébrité. L'a tout ce qu'il veut. Sauf ce qui lui manque le plus. Lui-même. Un peu de solitude pour se retrouver seul en lui-même. L'a de la ressource, suffit qu'il s'enferme dans un studio pour catapulter de nouveaux chef-d'oeuvres. Qui ne sont pour lui que des hors-d'oeuvres. Porte en lui de multiples possibilités. L'est un artiste, un vrai, un créateur. Et la machine s'enraye, la musique est en lui, mais refuse de sortir. Lui faudrait du temps, de la respiration, un manager à visées moins commerciales, un peu moins de dope, un peu moins de fatigue, et stupidement ce soir-là, un peu moins de narcotique...
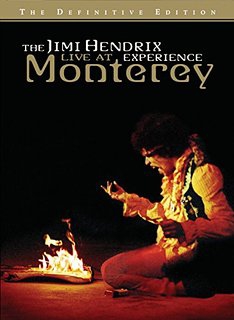
Robert Johnson est mort. On lui a volé sa vie. Toujours à courir devant sa chiennerie de vie qui le rattrape sans cesse. Au tournant, dans les lignes droites et sur le fil rouge de l'arrivée. Jimi Hendrix est mort. S'est fait voler sa vie. N'a pas su la garder pour lui. Difficile quand on ne l'a pas appris dès la naissance. Antonin Artaud dirait : suicidé de la société. Nous, l'on a inventé le mythe du club des 27. Mysticisme de pacotille. Une précaution oratoire en quelque sorte. Je parle pour nous. Nous n'aimons guère les miroirs qui nous ressemblent. Nous aussi, nous nous faisons, nous nous laissons, voler notre existence. Nous aussi sommes des anges exterminateurs, des goules insatiables, qui se repaissent du sang de leur entourage.
L'écriture poétique de Renaud Ego agit comme un scalpel, comme un révélateur. Un très beau livre que je vous engage à lire.
Damie Chad.
04 / 11 / 2015 – FRANCE INTER
TUBES AND CO
REBECCA MANZONI
Ma vie est une souffrance sans cesse renouvelée. Je ne plaisante pas. Je peux même vous donner l'heure. Tous les matins, à sept heures dix-huit minutes exactement. Moi pauvre victime innocente une cruelle torture m'est ainsi infligée à l'instant de mon petit déjeuner. Alors que je trempe généralement ma vingt-septième biscotte dans mon bol de café. Vous livre le nom de ma tortionnaire, Rebecca. Jusqu'à son apparition sur les ondes de France Inter, la seule radio captée sur les ondes du trou géologique provinois, tout va bien dans le monde. Une petite guerre par ci, un attentat par là, les impôts qui augmentent, une épidémie en préparation, des élites qui se remplissent les poches, des dizaines d'usines qui ferment, des sans-logis qui dorment dans la rue, pffft ! des broutilles. Le genre de facéties qui ne vous coupent point l'appétit. Et c'est-là que survient la Manzoni. Ne veut que votre bonheur. Sous prétexte que la musique adoucit les moeurs, elle nous présente selon ses humeurs, un chanteur, une chanson, un style. Ce n'est pas bien long. La plupart du temps, vous avez juste droit à l'intro du morceau, puis elle cause par-dessus. Ce n'est pas bien grave. En règle générale, aux heures de grande écoute les programmateurs de la radio nationale ont des goûts détestables. Ils s'en vantent. Se prévalent d'un label de qualité, une authentique certification NF à les en croire, vous pouvez écouter les esgourdes fermées, l'on vous assure que c'est du bon. Résultats vous avez droit à un, et de préférence une, asthmatique de service qui essaie de couvrir de son maigre filet de voix les éructations funèbres d'une piteuse orchestration électro.
Mais il ne faut jamais désespérer de l'humanité. J'ai évité la mort subite du nourrisson, je ne sais comment. Toute fière, Rebecca Manzoni nous annonce le titre de sa prochaine séquence : Be Bop A Lula !

BE BOP A LULA
De Gene Vincent se hâte-telle d'ajouter. En deux minutes et demie, elle s'en sort plutôt bien, le morceau composé sur son lit d'hôpital, l'accident de moto, parvient même à citer la guitare de Cliff Gallup et les balais de Dickie Harrell, son influence sur le rock européen, notamment anglais et français, et la fin amère dans la solitude et la misère... Crayonne une silhouette, peu, trop peu, à peine esquissée, mais assez toutefois, pour donner au néophyte l'envie de chercher, d'écouter et d'en savoir plus.
Assez rare pour être signalé.
Damie Chad.
00:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ash, the wave chargers, the howlin' jaws, jimi hendrix, be bop a lula


