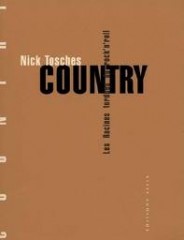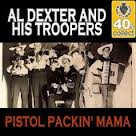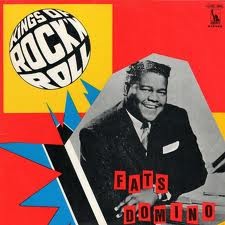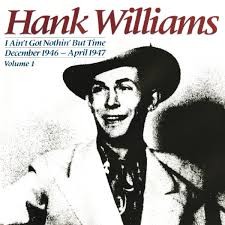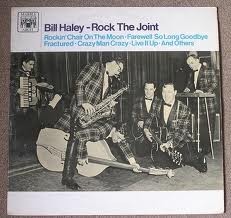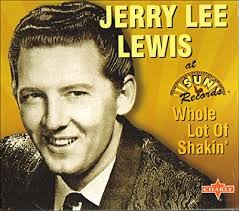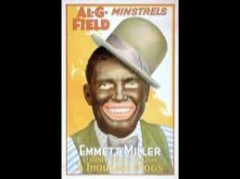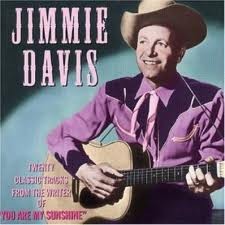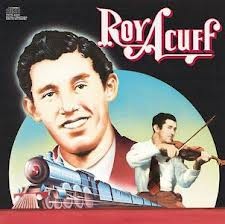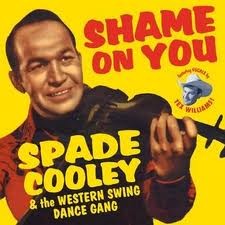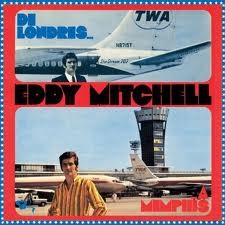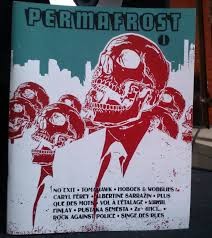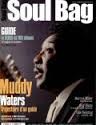20/06/2013
KR'TNT ! ¤ 149. MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM / KOFFIN' KATZ
KR'TNT ! ¤ 149
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
|
MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM / KOFFIN' KATS / ORVILLE NASH / NICK TOSHES / PERMAFROST / IN ALBERT LEA |
- LA MIROITERIE / PARIS / 18 - 06 - 2013
- MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM /
- KOFFIN' KATS
-

- Rue de Ménilmontant, c'est tout en haut et avec la chaleur écrasante l'on préfèrerait que ce soit vers le bas. La Miroiterie, en ai entendu beaucoup parlé par Frédéric Atlan alias Sonic Surgeon ( voir notre livraison N° 25 du 25 / 11 / 10 ) qui y a eu pendant des années son atelier de peintre. C'est un des tout premiers squats arty-punky, s'y déroulent très souvent des concerts – les parisiens ont de la chance de pouvoir fréquenter de tels lieux de vie et de création. La Mairie ne l'entend pas de la même oreille qui se débarrasserait volontiers de cette pustule par trop folâtre. Un projet d'expropriation survole depuis quelques mois les locaux, un peu comme ces vols de vautours de mauvais augure dans les westerns. Gageons qu'un jour ou l'autre les charognards finiront par l'emporter.

- L'est sûr que ce n'est pas tout neuf, suffira de mettre le bulldozer en marche pour que tout s'effondre, mais ce n'est pas l'état des locaux qui pose problème, ce sont les pratiques de vie peu conformistes qui gênent. C'est fou comme le libéralisme n'est pas vraiment libéral avec ceux qui s'essaient à des modes d'existence parallèles et qui tentent de se libérer du carcan de l'exploitation salariées au rabais.
- Passez la grille, longez la voie d'accès, les bâtiments sont tout en longueur. Ressemble un peu à l'architecture des typiques longères de notre Brie post-natale. Suis pas venu pour faire le guide mais pour voir les Midnight Rovers. Juste avant de partir m'aperçois en quêtant quelques renseignements sur le net qu'ils passent en première partie devant Koffin' Kats, et comme sur une table l'on vend le 45 tours des King Phantom, j'en déduis que pour notre plus grande satisfaction nous aurons droit à trois groupes, plus on est de fous, plus on rit.

- Deux ou trois stands de disques et de badges. Modèles boutons de chemises, ce serait bien de relancer comme dans les années 70, la mode des cinq centimètres de diamètre qui permettaient d'arborer beaucoup plus fortement choix esthétiques et goûts musicaux intempestifs à la face du monde.
- MIDNIGHT ROVERS
- L'est temps de renter surtout qu'ils sont en train d'achever le deuxième morceau. La salle n'est pas grande, mais la scène n'est pas exiguë. Un parallélépipède assez haut de plafond, les murs couverts d'inscriptions, derrière les musiciens un visage turgescent nous contemple. Au fond, une galerie surélevée abrite la sono. Autant le dire tout de suite, l'acoustique n'est pas merveilleuse, le son s'écrase sur les parois, et ne rebondit pas. Sur le plateau, les retours doivent être une énorme marmelade de sons compressés et congelés. Pour les trois groupes, ce sont surtout les parties vocales qui souffriront d'un tel phénomène. Pour les instrus c'est moins grave, il passent en force.
-

- Premier régal, avant même de jeter un regard c'est le marteau de Torz qui vous fracasse les oreilles. Une frappe comme je les aime, puissante, lourde mais trop en prise d'énergie pour devenir lassante. Au centre, au fond, comme tout batteur qui se respecte, on ne l'entrevoit que par intermittence, par contre je peux vous jurer qu'il envoie en continue. Pourrez jamais dire mieux vaut Torz que jamais, car il omni-présent sur tous les coups.
-
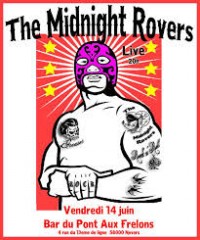
- De loin avec Manu et sa contrebasse et la gretsch orange de Cidou ca ressemble à un groupe de rockab des plus trads, mais au bout de douze secondes ( pour les esprits lents ) vous les classez vite dans les adeptes du psychobilly, eux-mêmes se définissent comme un groupe de suburb rock. Oui mais sachez ouïr la différence, de temps en temps au détour d'une séquence rentre dedans vous percevez la ligne claire d'un riff, c'est Cidou qui nous la joue quinze secondes à la Hank Marvin mais tout de suite après ce sont toutes les tribus indiennes qui jettent leurs cris de guerre à Little Big Horn, et pas du tout si doux que cela, il nous pulse des flèches d'acier qui nous transpercent sur place.
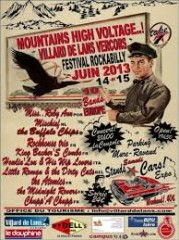
- Nico est au micro. Ou plutôt aux micros, car à certain moment il double sa voix sur un deuxième appareil. Me demande dans ma tête si c'est un plan piqué à Eric Burdon quand il imite par un tel stratagème la CB des voitures de police poursuivant un présumé tueur... Pour les paroles voir plus haut, mais la voix est belle et sonore, assez ample pour s'éviter de crier et de s'égosiller. Sort aussi son harmonica, assez frénétiquement bluesy, là-haut au mixage, z'auraient pu le mettre plus en avant.
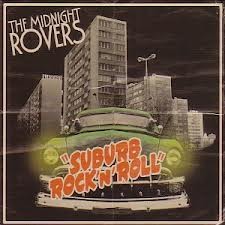
- J'aurais aimé vous parler plus longuement de Manu et de son slappin'game mais juste au moment où je vais me concentrer sur lui, le set se termine. Même qu'ils ont déjà passé en force leur deux derniers morceaux. Trop tard, trop court, juste au moment où les doigts commencent vraiment à se dévérouiller, la voix à se chauffer et l'énergie à circuler, faut qu'ils arrêtent, nous laissant sur notre faim comme des orphelins abandonnés.
-
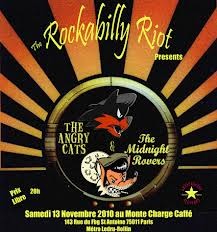
- Vous aurez un lot de consolation, la semaine prochaine, la chronique de leur vinyl. On essaiera de mieux cerner leurs implications projectales. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'était bien parti, et que s'ils repassent dans le quartier je serai au rendez-vous et pas pour une demi-part de gâteau.
-
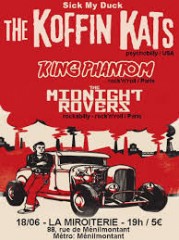
- KING PHANTOM
- Ne les connaissais pas, mais j'ai vite appris. Pas plutôt sorti, suis allé rafler leur record, la kronic comme pour les Midnight Rovers, la semaine prochaine. Sont pas nés de la dernière pluie, chacun traîne un pédigrée à rendre un chien jaloux. Johnny Rival a même longtemps joué aux States avec The Evils d'Atlanta.
-

- Des tatouages partout, batteur torse poil, casquette camouflage pour le chanteur, les trois guitares en première ligne, le tambour derrière qui fragmente à la Bo Diddley. Ne font pas dans la dentelle, construisent un mur, et comme ils auront tout le temps nécessaire vont nous édifier une muraille de Chine.

- Dès les premières notes c'est déjà très bien ce qui ne les empêche pas de s'améliorer à chaque morceau. En rajoutent à chaque fois, vous surprennent toujours, simple et efficace mais pas le genre à vous répéter deux fois les mêmes structures. Innovent, ne vous ennuient jamais. Jay et Johnny sont à la guitare, ne vous amusez pas à savoir qui est le lead. Ce n'est manifestement pas comme cela qu'ils posent le problème. Entremêlent leurs propositions, foncent à toute allure, distribuent l'énergie à tout venant. Ca crépite d'électricité. Le public commence à pogoter gentiment, mais sûrement.
-
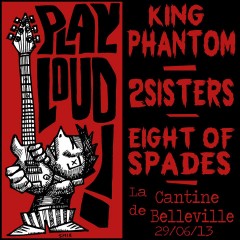
- Patclass ne joue pas de la basse électrique mais de la guitare si vous voyez ce que je veux dire. Le truc n'est pas pour lui de ponctuer une assise rythmique mais d'amener tout le speed nécessaire à ses coreligionnaires. Derrière ses futs Rumble Tom concourt au même challenge. Ne construit pas une assise mais une ligne de feu qui se déplace à la même vitesse que la trajectoire des guitares. Avec tout de même des breaks incessants qui éclatent comme des morceaux d'écorces trop sèches jetées dans une fournaise.

- Généreux, ont sans arrêt un titre en rabe à caser. Parfois l'on se dit cette fois ce sera le dernier, ne pourront pas filer plus loin, plus fort. Et blang vous en refilent trois de suite en constante gradation. Oublié de dire qu'ils sont les champions de la fausse fin. Vous n'imaginez même pas qu'après tel plan de crème fouettée l'on puisse apporter une suite au morceau en cours, vous pensez que c'est la fin coda, tout le monde s'arrête, mais non eux ils repartent à l'assaut et vous démontrent que le champ des possibles n'a pas encore été totalement labouré. Sortent épuisés, sous les applaudissements.
- Rien à redire. Tout à admirer.
- KOFFIN' KATS
- Si vous traduisez par petits chats mignons endormis dans leur couffin, c'est une erreur. Prenez plutôt trois tigres enfermés dans un cercueil et qui vous défoncent les planches à coups de griffes. Sont des Américains, vous n'aimez peut-être pas mais faut reconnaître qu'ils ne trichent pas sur la qualité de la marchandise. Les amerloques qu'ils vous envoient un obus Tomahawk sur votre quartier ou qu'ils délèguent un groupe de psychobilly, dans les deux cas, après le passage de l'ouragan faudra penser à numéroter vos abattis. Bande d'abêtis.
-

- Des mecs cools, sont restés deux heures assis pénardos à une table à vendre leurs T-shirts, parlent un sabir incompréhensible que mes profs d'anglais ne m'ont jamais appris, heureusement qu'il y avait trois américaines à l'accent aussi prononcé qu'eux pour discuter avec, mais quand ils sont montés sur scène, l'on a tout de suite vu que l'on avait affaire à des seigneurs. Rien qu'à la manière de diriger la balance, l'était certain qu'ils connaissaient la musique.
-

- Les States c'est grand, mais eux ils ne viennent pas du Sud Rural Profond, le rockabilly des bouseux, très peu pour eux. Traînent pas leur contrebasse dans le crottin de cheval. Eux ce sont les flaques d'huile visqueuses, les carburateurs kramés et le moteur en feu. Viennent de Detroit. Motor City. Z'ont attapé des gènes stoogiennes dans leur biberon. Et ça s'entend.
-

- Au début, l'on a l'impression d'une cocote minute qui explose. Même pas des morceaux. Des plans de feu d'enfer que l'on bazarde à la tête du public. A côté les titres des Ramones s'inscrivent dans une longueur symphonique. Le batteur s'en donne à coeur joie. Dommage que par la suite il se soit contenté d'un beat ultra violent mais trop métronomique.
-
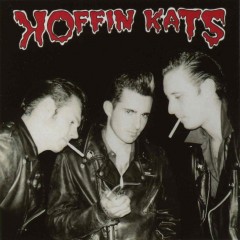
- Ensuite l'on ne peut pas dire que ça s'assagisse. Oh que non, ça gagne en dureté et en brutalité. Des morceaux plus longs mais d'une telle inventivité qu'ils passent comme un bâton de dynamite dans une poudrière. Le public se lance dans un pogo, sans sournoise volonté de faire mal à son voisin mais qui suivra une courbe exponentielle durant tout le set. Corps porté à bout de bras, embruns de bière, fièvres et emballements.
- Psychobilly si vous voulez, mais il y a de tout dans cette tornade, parfois ça brûle comme du Iggy, parfois ça bastonne comme du Rammstein, ça fond comme du blues, ça cavale comme du rock'n'roll, empruntent ce qu'il y a de plus intense dans chaque genre, et vous le rendent en dix fois plus méchant.
-

- Eric est comme cloué sur sa caisse claire, jamais un beat de retard, jamais une demi-seconde de trop. Implacable, imbattable. Vic brandit sa contrebasse et la fait tournoyer. Plus tard Tommy entreprendra de l'escalader tout en nous délivrant une marée de lave qui s'écoule de sa guitare comme d'un volcan. Pas le temps de s'arrêter. Tous deux échangent leurs instruments en plein vol comme des pilotes de chasse qui sauterait de cockpick en cockpick. Vic tire sur les cordes du bas de la double bass tandis qu'en haut du manche Tommy se sert de sa guitare comme d'un archer. Mais ne vous laissez pas séduire par les acrobaties.
- Toujours à fond la caisse, intraitables. Je commence à comprendre pourquoi j'ai toujours préféré le rock américain au son anglais. Ne tournent pas autour du rock pour arriver à l'heure. Sont d'une efficacité ouranienne. Sont partout à la fois. Ne laissent rien au hasard. Ces ripées de métal sur la guitare, difficile de trouver mieux, et chaque fois Johnny vous en redonne une mouture supérieure. Jouent longtemps, sans temps morts, sans respiration. Pas du genre à économiser les cartouches. Des tueurs qui vous découpent en rondelles au hachoir.
- En plus ils osent nous demander si l'on aime le rock'n'roll. Pas du tout, nous ce que l'on aime c'est les Koffin' Kats. Et le jour où je mourrai offrez-moi un cercueil de ce bois-là.
- Splendide.
- Damie Chad.
- La salle est emplie de buée et de fumées diverses. Près de moi une jolie maman attrape ses deux filles dans ses bras protecteurs et se dépêche d'entraîner les deux sweet little lycéennes sixteen vers la sortie. « Comment peut-on faire tant de bruit en un tel lieu ? » demande-t-elle les yeux baignés d'angoisse. Voudrais bien lui expliquer, mais elle est décidément trop vieille. Dans sa tête.
- ( pour les documents iconographiques voir le facebook des artistes. Seule photo du concert la première qui illustre Koffin Katz, elle est signée de Carnage Punk Rock, qui ont aussi un facebook )
- LE BATEAU IVRE
- ROUEN / 02 - 06 - 2012
LE PANACHE D'ORVILLE NASH
Nous avions naguère à Rouen un lieu saint, le Bateau Ivre. Saint aux yeux des noctambules, des amateurs de musique vivante et des ivrognes, faut-il le préciser ? Chaque fin de repas aviné s'achevait sur le même cri de ralliement : «Une mousse au bateau !» Pratique, car ça fermait à 4 heures du matin. Le patron s'appelait Michel. Grand, tête de boxeur, un physique à la Tom Jones, cet homme pouvait vous réciter d'un trait La Chanson du Mal-Aimé de Guillaume Apollinaire en vous fixant dans le blanc des yeux. J'y eus droit le soir où je lui avouais un faible pour le Flâneur des Deux Rives. Faut-il qu'il m'en souvienne.

Michel programmait des groupes pour tous les publics. Groupes de reggae pour les lycéens, métal pour les métaleux locaux, garage pour les garagistes locaux, goguette le mercredi soir pour les amateurs de chanson française, soirées blues et même du rockabilly. Eh oui, il existe encore une petite scène rockab à Rouen et un public de puristes.
C'est lors d'une de ces soirées rockab que j'échouai au bar du Bateau, flof, aussi flasque qu'un veau marin. Accoudé dans une mare de bière, parfaitement disposé à fanfaronner, j'entamai la conversation avec mon voisin, un pépère coiffé d'un chapeau de cow-boy. Il ne pouvait être qu'Orville Nash, programmé ce soir-là. Aucun rouennais n'aurait osé porter un tel chapeau de cow-boy. Je me crus obligé d'attaquer en anglais, forcément, mais j'éprouvais d'immenses difficultés à donner l'illusion de la fluidité. Je cherchais mes mots en vain, par contre, je voyais bien deux Orville. On a causé rockab pendant un temps qui m'a semblé infini. Jusqu'au moment où Michel lui demanda s'il voulait un autre verre de vin et ils échangèrent tous les deux quelques mots en français, une langue qu'Orville Nash parlait couramment. Il m'a salué en rigolant et il s'est dirigé vers la petite scène où l'attendaient les musiciens.

Orville Nash attaqua ce soir-là avec, je crois bien, «Tongue Tied Jill». Fini de rigoler, on avait sous les yeux une légende du rockab, un fabuleux survivant, capable de chanter à la demande. Quand on réclamait «One Hand Loose», il le prenait au débotté. Une vraie voix. On sentait que le bonhomme avait du métier. Il avait ce truc que les musiciens locaux n'auront jamais : cette aisance scénique, une sorte de classe innée, une façon de bouger les pieds, et les radiations. Sur scène, Orville Nash dégage quelque chose de très spécial : sous les apparences country se tapissent les vieux réflexes d'un bopper de premier choix.
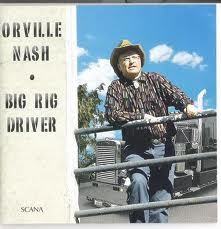
Peut-être avez-vous la chance de posséder l'album qu'il enregistra jadis pour Rolling Rock, «Nashin' Around». J'en ai déniché une copie d'occasion chez Born Bad peu de temps après le concert et là, je dois dire que je suis tombé de la chaise en l'écoutant. C'est l'un des classiques obscurs du genre, un rockab atmosphérique, hanté et pour ainsi dire moite (si on veut pousser la métaphore marécageuse), mâtiné de swamp-blues. D'ailleurs, le premier morceau s'intitule «Swamp Blues». On entre dans ce disque comme on entre dans un lieu chargé de mystère : le cœur battant et tous les sens en alerte. Il vaut mieux être sur ses gardes parce que le second morceau, «Hot Dog», vous cueille au menton. Bing ! Un rockab swingué jusqu'à la moelle des os. Du bopping haut de gamme qui semble rôder par derrière. Excellent, au delà de toute conjecture. Deux fantastiques musiciens accompagnent Orville Nash : Mitch Vogel à la guitare et Frank Gadotti, «Dog House Bass», comme l'indique la pochette. Avec «New Orleans Woman», Orville boppe le chant comme le faisait si bien Charlie Feathers.
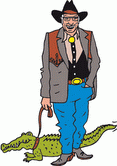
Sur ce disque, tout est savamment calibré, comme les seraient les éléments d'un art secret. On tombe ensuite sur la septième merveille du monde : «Austin City Limits». Riffage fantomatique. L'un des accompagnements les plus crépusculaires de l'histoire du rock. Orville Nash pose sa voix sur un tapis de magie swampy. C'est du pur voodoobilly. Appelons ça un coup de génie fatidique, si vous voulez bien.
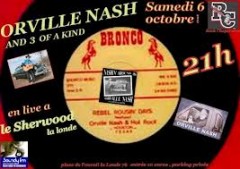
La face B réserve elle aussi son lot de bonnes surprises. Orville Nash met une pincée de sauvagerie dans le titre qui donne son titre à l'album. Puis il prend «Sweet Rockin' Mama» par en-dessous, avec des Hello baby d'anthologie. «I'm Out» sonne comme un classique intemporel. Orville Nash est vraiment le roi des atmosphères étranges. Il lance un «Hey Guitar !» et on entend une espèce de solo mou et duveteux, monté sur une ligne de basse ouatée. Tout cela dans le respect des traditions du laid-back tel qu'on le pratique dans les zones reculées du bayou. «Heart Breakin' Mama» est un rockab pur et dur, Orville le boppe à outrance. Tout y est, comme chez Charlie Feathers ou les frères Burnette. Quand on entend «Willing And Ready», on réalise enfin qu'Orville Nash est une vraie star. Dans «Bootlegger», il se permet toutes les audaces vocales, et il ferme ce bal des vampires avec un stupéfiant «Dr Jekyll & Mr Hyde», chef-d'œuvre boogaloo. Mais d'où sort ce type ?
Tout s'éclaire lorsqu'on lit les notes au dos de la pochette : il fréquentait Huey P. Meaux dans les années soixante. Et là, on ne rigole plus.

Huey P. Meaux est l'un des personnages légendaires de la scène texane. Il exerçait ses talents de découvreur, de producteur et d'escroc dans une région marécageuse située au Sud du Texas appelée le Triangle d'Or, une contrée hérissée de puits de pétrole et de raffineries. Meaux tenta de lancer les frères Winter sous le nom de The Great Believers, mais dans la région, les gens craignaient encore les Albinos et la manœuvre échoua. Il se tailla une réputation en produisant des groupes cajun qui chantaient en patois français, ce qu'on appelait le zydeco. On baptisa son style «swamp pop» (pop du bayou) et parmi les artistes qu'il produisait, on trouvait Big Mama Thornton, Clifton Chenier et Lightnin' Hopkins. Il lança la carrière de Doug Sahm. Huey recevait les candidats au succès dans son salon de coiffure de Winnie, un patelin situé entre Port Arthur et Beaumont, au Texas. Il sortait un 45 tours d'une petite caisse couverte de mèches de cheveux coupés et disait au candidat : «Écoute ça et reviens me voir dans six mois !». Quand les Beatles déferlèrent sur l'Amérique, Huey P. Meaux déguisa le Sir Douglas Quintet en groupe anglais et leur donna l'ordre de ne pas parler entre les chansons. Le public devait croire qu'ils étaient anglais. Et ça a fonctionné. Ils partageaient l'affiche avec les Stones, James Brown ou les Beach Boys et, pendant un petits laps de temps, le public est tombé dans le panneau.

Surnommé the Crazy Cajun, Huey P. Meaux aura pas mal d'ennuis avec la justice américaine. Il fera quelques stages au ballon et il sera très fier, en 1967, d'être blanchi par le président Jimmy Carter. Il connaîtra par la suite d'autres ennuis judiciaires. Augie Meyers (organiste du Sir Douglas Quintet) et Jerry Wexler (tête pensante du label Atlantic) feront partie de ses fidèles correspondants et jusqu'au bout, Huey P. Meaux restera un découvreur de talents. En 1998, atteint d'un cancer de la gorge, il affirmait avoir découvert le nouveau Freddy Fender.
En 1964, Orville Nash enregistra des démos pour Huey P. Meaux. Au dos de la pochette de «Nashin' Around», on nous dit que ces démos sont restées inédites mais qu'elles risquaient de réapparaître un jour.
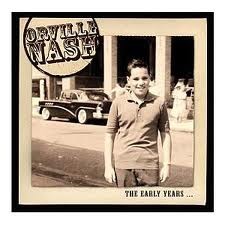
Apparemment, c'est chose faite, sur un CD intitulé «The Early Years». Deux des fameuses démos enregistrées au Goldstar studio de Huey P. Meaux à Houston s'y trouvent. Il démarre justement avec une reprise de Charlie Feathers, «Tongue Tied Jill». Orville boppe comme un fou et Johnny Jaxon envoie ses gimmicks avec l'ardeur d'un cueilleur de coton. «Awite JJ !» Dans «Let's Go Boppin' Tonight», on savourera la parfaite rondeur du slap. Orville sonne comme un petit Elvis, il respecte l'esprit du rockab Sun à la lettre. Rien qu'avec ces deux titres, on grimpe directement au paradis.

Mais là encore, d'autres surprises guettent le badaud. Avec «Hillbilly Boogie Stomp», on change d'époque et de son. Orville lâche sa bombe boogie bardée d'entrain, il y a là de quoi faire sauter toutes les bananes du Texas. Train d'enfer et coups de violon ici et là. L'animal n'en finit plus de nous surprendre. Il pompe l'intro de «Folsom Prison Blues» pour son «Wells Fargo Trail» et «Tombstone Gun» sonne comme un magistral clin d'œil à Johnny Cash. Pour Orville, pas de problème : il a le bon timbre. Nash fait du Cash. C'est carrément du cinémascope. On sent la dramaturgie de la frontière, le poids de la violence et de la solitude, sous l'immense voûte étoilée. «Boogie Woogie Cajun Girl» est, comme son nom l'indique, un boogie violent, serré, malsain et vénéneux, superbe et hargneux, Orville se montre digne des plus crasseux péquenots venus enregistrer chez Meteor. Quand il lance «Awite Bobby !», le Bobby en question décoche un chorus meurtrier. Comme Jerry Lee, Orville Nash sait déterrer la hache de guerre au bon moment. Avec un titre comme «Hollywood Glamour Girl», Orville montre qu'il sait faire le crooner et ça passe plutôt bien, grâce au gras de l'accent américain. «Bourbon Street Belle» est solide comme ce n'est pas permis. C'est du garage-punkillbilly des enfers. Orville chevauche son riff sauvage à travers la plaine immense. Il sait faire monter la température. On a là un truc admirable, digne des grands hits d'Eddie Cochran. Orville envoie ça avec une sourde assurance. Il plonge au plus profond de sa glotte pour évoquer les bas-fonds de la Nouvelle Orleans. Avec ses quelques accents à la Jerry Lee et ses coups de baryton, Orville Nash casse la baraque. Aouh ! Il embarque «Warning Shadows» avec le tacotac de Johnny Cash et fait autorité. «Montana Wildcat» est digne de tous les juke-boxes de Tupelo : «I'm the Montana wildcat, I don't wanna seduce. You'd better treat me good, but since I met you honey, I wanna compromise !» Absolument génial. Pur jus. Un bopping trié sur le volet. Irrémédiablement brillant. «Bayou Beast» est une pièce rampante digne des Cramps. Dommage que Lux n'ait pas chopé cette abominable merveille de swamp pop. Good Lord ! Le festival se poursuit avec «Everyday Has His Day», un boogie blues violent et des plus spectaculaires. Vous ferez comme moi, vous vous pincerez pour être sûr que ce n'est pas un rêve.
Ce disque d'une incroyable qualité ne vous lâchera pas. À chaque réécoute, il mord encore plus profond dans le gras du mollet.
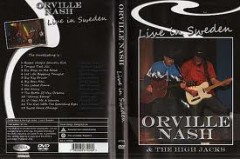
Les admirateurs d'Orville Nash sont gâtés, puisqu'il existe aussi un show filmé en Suède disponible sur DVD, «Live In Sweden». Ne vous fiez pas aux apparences. En voyant la photo ornant la pochette, on croit tomber sur un concert de country insipide. Orville tape dans son répertoire de reprises rockab, avec «Tongue Tied Jill», «Let's Go Bopping Tonight» d'Al Ferrier et «If I Had A Woman» de Mac Curtis, «from the King label», comme il le précise en guise d'introduction. Il tape aussi dans des merveilles du style «His Latest Flame» de Mort Shuman, rendu célèbre par Elvis et il s'en sort admirablement bien. L'animal sait crooner et on peut même dire qu'il excelle dans le genre. Orville Nash est un artiste complet. Avec ses syllabes mouillées et ses dérapages à la Jerry Lee, sa version d'«Ubangui Stomp» est probablement l'une des meilleures qui soient.
Héritier d'un passé prestigieux, cet homme sait se rendre accessible puisqu'il tourne partout en France. Si par chance il vient jouer par chez vous, allez l'applaudir. Vous goûterez au privilège de voir un très grand artiste, vous pourrez même discuter le bout de gras (en Français) avec lui après le set et vous lui ferez plaisir en lui achetant son CD et son DVD. Il vous les dédicacera et, un sourire malicieux au coin des lèvres, il dessinera un petit bonhomme dans le O d'Orville.
Signé : Le Marécageux Cazengler
Orville Nash. The Early Years. CD. www.orvillenash.com
Orville Nash & the High Jacks. Live In Sweden. DVD. www.orvillenash.com
Orville Nash with Mitch & Frank. Nashin' Around. LP Rolling Rock (Switzerland) 1990
C O U N T R Y
L E S R A C I N E S T O R D U E S
D U R O C K ' N ' R O L L
N I C K T O S C H E S
( A L L I A / 2 0 0 8 )
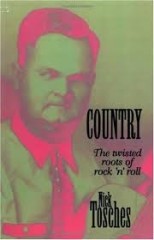
|
Avec ce premier livre de Nick Tosches, y a un truc qui cloche. Ce qui est sûr c'est que le bouquin est aussi tordu que les fameuses racines qu'il recherche. Part dans tous les sens. Rebondissement à chaque chapitre. Déjà un mal de coyote à fixer la ligne de départ. Commence par les premiers colons débarqués d'Angleterre. Mais il abandonne vite le tableau idyllique. 1607, paraît une bonne date, manifestement le millésime ne lui suffit pas. Si vous croyez en être quitte avec les vieux crin-crins d'Irlande, vous êtes loin de vous douter de ce qui va vous tomber sur le coin de la figure. On se calme, l'on se retrouve en eaux connues, tous les groupes rockab l'ont à leur répertoire, Black Jack David de Waren Smith. Un pionnier, un vrai, de chez Sun, la reverbe, Sam Phillips, etc... vous connaissez la musique. Dommage, c'est les paroles qui sont importantes. Sont un peu moins bâclée que Baby, I love You, Baby I want you. Black Jack David invite une jeune femme mariée à délaisser son mari et ses petitous pour le suivre. Jusqu'où ? Jusqu'au bout. Dans les bois, dans la tombe.
Snif ! Snif ! Waren Smith avoue qu'il a bâclé le titre sur un coin de table, au dernier moment. Comme beaucoup. Ce qui explique pourquoi de nombreux morceaux de rock'n'roll sont un peu mous du texte. Mais le Black Jack David se défend dans le lot. Normal nous dit Nick Tosches, l'a sorti de son cerveau le Waren mais l'était imbibé de tas de chansons populaires, anglaises et irlandaises et même américaines qui véhiculaient le même thème. Le problème c'est que les auteurs anonymes de ces ballades avaient eux-mêmes un peu trop démarqué les poètes romantiques de la grande culture british. Zoui, mais les Keats, Shelley, Byron, Lamb et toute la sainte famille étaient fortement influencés par les auteurs latins et grecs... Et que les aèdes Hellènes s'inspiraient de la figure originelle et mythologique d'Orphée... L'on ne peut pas accuser Nick Tosches de ne pas remonter assez loin dans son étude généalogique ! HONKY TONK C'est après que ça se met à tanguer salement. L'on s'encanaille dans les Honky Tonk, Tosches batifole un peu dans l'étymologie. Pour honky je ne m'aventurerai pas, mais pour tonk du haut de ma profonde méconnaissance de l'argot américain je proposerais une allitération du mot tank, réservoir, ce qui me semble en harmonie connotative avec ce que l'on peut attendre d'un bar. Quoi qu'il en soit c'est Al Dexter qui composa en 1937 Honky Tonk Blues avec un certain James B. Paris. Plus tard Al Dexter composera tout seul, Pistol Packin Mama que reprendra Gene Vincent. Ne brûlons pas les étapes. Tout est question d'ambiance - dans les honky tonk, dans les années 30 et 40, on ne jouait pas du rock'n'roll, mais l'on avait déjà les deux premiers termes de l'équation, les filles un peu trop chaudes et l'alcool un peu trop raide. Ne fallait pas en conter aux marloufs qui fréquentaient ce genre de boîte, depuis les années 20 les chansons étaient déjà pleines de my baby rocks me, et croyez-moi qu'elles tricotaient surtout en-dessous de la ceinture...
Tout le monde s'y mit, même le gospel connut ses réunions de Holy Rollers qui en proie à sainte transe chrétienne se roulaient par terre. L'histoire ne dit pas ce qu'ils faisaient exactement avec leurs soeurs après leurs cérémonies expiatoires, mais on peut supputer que les feux de l'amour divin devaient exacerber bien des frénésies... Surtout que ces fidèles n'hésitaient pas à saisir à pleines main des reptiles venimeux. Tonton Freud n'aurait pas hésité à parler de manipulations phalliques, les Holy Rollers eux déclaraient que leur foi les préservait de toute morsure intempestive. Même en leur accordant notre confiance nous ne pouvons nous empêcher de penser que dès que ça rolle un peu dans les coins, la queue du diable n'est pas très loin.
L'on n'a pas encore hissé les couleurs. Indéniablement ce fut la population noire davantage délurée que la blanche un peu puritainement coincée du postérieur qui mit du rock'n'roll dans sa musique. Ensuite c'est un peu la couse à l'échalote, Fats Domino dès 1949, devancé de peu par Hank Williams en 1947, des titres épars certes mais en avance sur l'imminence de la nouvelle ère qui allait s'ouvrir : celle du rock'n'roll.
Tosches n'est pas un fervent de Bill Haley, mais il fut la première star du rock'n'roll blanc, même s'il lui en coûte de l'avouer. En 1954, Rock Around the Clock passe inaperçu, l'aura droit à sa session de rattrapage lorsque son compositeur parviendra à le faire adopter pour le film Blackboard Jungle. C'est aussi en 1954 qu'Alan Freed baptise son émission de radio Rock and roll Party, l'année même où un certain Elvis Presley entre dans le studio Sun... Vous raconte pas la suite.
Tosches s'attarde sur Jerry Lee... une trentaine de pages pour une biographie non-autorisée sur le Killer, je ne résume même pas, puisque j'ai dans les cartons le compte-rendu sur Hellfire le livre que notre auteur lui a consacré. Vous refilerai cela prochainement sur le site. Disons que nous avons droit ici à la première mouture de ce brûlot sorti tout droit de l'enfer. L'on termine en beauté avec l'évocation de Gene Vincent et la mort de Buddy Holly et les enregistrements d'un certain Thumper Jones. Cela devrait vous rappeler la dernière livraison ( N° 149 ) que l'inaltérable Cazengler a nécrologisée en l'honneur de George Jones, l'autre grand nom du country avec Johnny Cash et Lefty Frizzell... Le rock and roll vient de vivre ses meilleures années. Les ligues de vertu auront sa peau. En 1959, ce sera déjà la fin. L'est temps de remonter à ses racines.
OBSESSION
Ce que c'est que de ne pas suivre l'ordre chronologique. Tosches s'attaque à une énigme qu'il résoudra dans un futur livre, Blackface, que nous avons chroniqué dans notre cent quarante-troisième livraison, sur la piste d' Emmett Miller le yodeleur fantôme qui influença Jimmie Rodgers... Nous ne sommes plus sur les racines tordues du rock'n'roll, l'aiguilleur Rodgers nous a mis sur la ligne qui conduit vers les sources de la country music. L'on repasse par des stations déjà visitées, Jerry Lee Lewis and Hank Williams. Pas pour rien que ces deux-là sont des monuments de la musique populaire américaine, soit ils ont crée, soit ils ont recréé, soit ils ont tout revisité. L'ESPRIT ET LA LETTRE
Dans la série plus-rock'n'roll-que-moi-tu-meurs ou la-country-a-tout-inventé, Nick Tosches redécouvre quelques chanteurs oubliés de par chez nous. Commence par Jimmie Davis, contemporain de Jimmie Rodgers qui ne se contentait pas de siffler les filles, regardaient de près dans leurs petites culottes et étaient un expert autorisé pour commenter les traces suspectes par de salaces lyrics à double-sens. Le sexe fut bien la première mamelle de la country. Sur ses vieux jours Jimmie Davis se refit une nouvelle virginité en se croisant de la ceinture de chasteté de la religion. N'est pas le seul à se revendiquer d'une nouvelle naissance. Reportez-vous aux errements christologiques de Johnny Cash. La dérive de Roy Acuff n'est pas à dédaigner non plus. Mystique à ses débuts, religieux, républicain, rétrograde, raciste, anticommuniste, et j'en passe. Le chantre de l'idéologie arriérée qui présida aux destinées du Grand Ole Opry. C'est avec Roy Acuff que la country music se teinta d'une coloration idéologique white trash people qui pour beaucoup lui colle encore à la peau, même si depuis et avant elle a su se couvrir de bien d'autres oripeaux.
Faudrait pas que l'arbre de la morale cachât la forêt des sexes dressés et des buissons ardents de l'entrejambe féminine, dieu merci il existe tout un fonds de morceaux pornographiques des mieux lotis. Dans les années cinquante l'on assistera au retour du refoulé culpabilisateur, je suis triste j'ai trompé ma femme. Remarquez dans la vie il n'y a pas que le sexe, il y a aussi la drogue. Je vous rassure, les vedettes country ne sont pas restées insensibles aux séduction de la benzédrine. Et autres dérivés.
Un dernier petit chapitre pour nous rassurer tout à fait. En 1961 Spade Cooley le roi du western swing force sa fille à le regarder tuer – lentement mais sûrement – sa femme qui le trompait... Nous sommes soulagés par ce merveilleux exemple. Tout comme le rock'n'roll, la country music charrie son lot de violence... BLACK AND WHITE Retour à la case départ. Ménestrel et Black Face. Durant tout le dix-neuvième siècle le violon est l'instrument roi. L'on retrouve dès 1737 la mention d'esclaves noirs jouant de l'instrument. L'on entend le roi de l'orchestre symphonique sur les premiers disques de blues, de Charlie Patton à Muddy Watters. De même les premiers groupes de jazz privilégient le violon avant le banjo et la trompette. Ce sont les prédicateurs noirs qui firent reculer l'emprise du violon. Le jeu de l'archet sur le corps hanché et les miaulements obtenus devaient leur rappeler le pêché de chair, c'est pour cela que l'on commença par utiliser dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle la guitare dite hawaïenne dont on frotte les cordes avec un peigne. C'est que les mauvaises habitudes ne se perdent pas facilement. A l'archet turgescent l'on substitua le goulot de bouteille ou le tube de métal plus discrets mais qui permettaient toutefois de reproduire les bienheureux gémissements de la femelle en rut.
Bottleneck pour les noirs, steel guitar pour les blancs, certains jouent assis en tenant la guitare couchée à plat sur leurs genoux. De cette pratique naîtra la pedal-steel guitar si caractéristique du son d'une certaine country grand public. Au début blues et country marchent ensemble, pas vraiment main dans la main, mais l'on s'inspire les uns et les autres et le hasard et la nécessité font qu'un chanteur blanc comme Al Dexter peut se faire accompagner par des noirs. Mais il ne faut pas exagérer, un jour de grande cuite Bob Wills embaucha un trompettiste noir qu'il congédia le lendemain matin sitôt les vapeurs de l'alcool dissipées. L'était plus facile pour un musicien blanc d'accompagner un chanteur noir. Rappelons-nous la surprise d'Eddy Mitchell lors de sa première session en 1967 au Muscle Shoals à Memphis, tous les musicos sont des blancs. L'avait pourtant engagé les session-men les plus réputés du Rhythm and Blues, à la Otis Redding.
Encore un chapitre sur l'industrie phonographique, du cylindre au 78 tours à la création en 1947 d'Atlantic par Herp Abramson et Ahmet Ertegun et d'Aristocrat que les frères Chess rebaptiseront de leur patronyme en 1950... Plus un retour sur Emmett Miller, ce chanteur blanc au phrasé si noir... BILAN Si vous ne connaissez rien au Country, ce livre vous fascinera. L'est tout de même un peu fouillis, regorge de mille anecdotes passionnantes mais est construit un peu en dépit du bon sens. Est constitué de morceaux de bravoure qui ne s'articulent pas vraiment ensemble. Nick Tosches s'y cherche plus qu'il ne trouve. Work in progress. A sûrement ouvert lors de sa première parution en 1977 une brèche dans la représentation iconologique que les amerloques se faisaient de la country music en tant qu'institution nationale. En ce sens-là, il a vieilli car nombreux furent ceux qui s'engouffrèrent par la suite dans l'ouverture. Mais pas toujours avec la même dévotion, et par trop souvent politiquement schématiques, du style le bon blues opposé à la mauvaise country. Vaudrait mieux s'en référer à la version de How I Love Them, Old Songs de Gene Vincent sur son dernier trente-trois tours... En trois minutes toute la poignante beauté de cette musique est exhumée et jetée à la face du monde assoupi en ses stupides certitudes. Damie Chad REVUES
PERMAFROST. N° 1 NO EXIT / TOMAHAWK / HOBOES & WOBBLIES / CARYL FEREY / ALBERTINE SARRAZIN / PLUS QUE DES MOTS / VOL A L'ETALAGE / VIRGIL FINLAY / PUSTAKA SEMESTA / Zr / 4HCI... / ROCK AGAINST POLICE / SINGE DES RUES.
Nom de Zeus, ils nous ont piraté deux articles, ah ! les infames capitalos, ah ! les dignes représentants de la bourgeoisie qui détroussent le travailleur inorganisé, Keep Rockin' Till The Next Time victime d'une OPA boursière, détroussé de plein fouet par un Hedge Fund de rédacteurs sans scrupules, mais que font les masses, pourquoi ne sont-elles pas dans la rue en train de brûler les coupables, mais où sont passés Bakounine et Ravachol ? Calmez-vous cher Damie Chad, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas le Grand Capital qui vous attaque, au contraire ce sont les gentils anarchistes, les sympathiques militants, les placides autonomes, qui diffusent gratuitement et sans contrepartie le contenu de vos colonnes ( du temple ) ( du rock'n'roll ). Diantre, vous me rassurez, peuvent prendre tout ce qu'ils veulent, même que que je vais faire l'effort de tout lire. Cent pages, un pavé parisien en quelque sorte. Couverture en sérigraphie, et pagination à l'offset. Ne mettent même pas de prix dessus. Un vrai fanzine, une philosophie du non-profit très peu libérale.
N'ont pas le discours policé du Grand Orient mais sont franchement orientés. Dans le bon sens. Celui de la révolte et de la colère. Des lascars qui n'aiment rien, ni les prisons, ni les cages dorées ni les délices de la propriété privée. Ecoutent de la musique peu harmonique, entre punk et rap, lisent des romans policiers très noirs et sans sucre, mirent des images pas du tout sages, se préoccupent des démarches collectives, ont le souci du social, et parlent à tout moment de réappropriation. Z'ont tout de même quelques beaux défauts. Qui jettent un froid. Pas pour rien qu'ils s'appellent Permafrost. Piaffent d'impatience. Ne théorisent pas. Sont pour l'expérimentation. N'aiment guère ceux qui se mettent sur leur chemin. Seraient du genre à se méfier de la police, à médire de la mentalité d'ilote des braves citoyens en route pour l'abattoir de l'école de Chicago, ne même pas mine de croire à la justice de classe. Des rebelles. Du front culturel. Car la pensée doit marcher main dans la main avec l'action. A lire. Esprit rock & roll. BLUES MAGAZINE. N° 69 Juillet-Août-Septembre 2013. Petit format, moins de cent pages, bien illustré, se débrouillent tout de même pour donner un aperçu de l'actualité blues nationale. Pas cent pour cent franchouillarde car ils ne ratent jamais le bluesman venu d'ailleurs qui pose ses boots sur notre sol. Ce que j'apprécie chez eux, c'est la qualité des interviews, rien à voir avec ces pensums répétitifs qui sont le lot commun de toutes les revues de hard rock aux questions et réponses tellement interchangeables que j'ai de plus en plus de mal à finir leur numéro. Un peu comme si l'expérience blues laissait subsister une plus grande part d'individualité chez des artistes qui ne sont pas métallisés à la chaîne.
Ceci dit, j'avoue avoir surtout tripé sur le troisième et dernier volet de la trilogie : Du blues dans le Rock'n'roll en Arkansas. Après Billy Riley et Sonny Burgess, un troisième pionnier est passé au détecteur. Ronnie Hawkins, nous vous en avons parlé dans notre livraison N° 145. Contents de nous, n'avions pas fait de boulette car la recension est assez fouillée, nous y relevons la figure initiatrice de l'oncle violoniste Delmar. Heureux homme – un peu trop porté sur la bouteille mais qui inspira à lui tout seul deux de nos pionniers, son fils Dale Hawkins, immortel créateur de Suzie Q, et Ronnie. Insiste un peu sur le travail de Ronnie chez Sun en tant que musicien de session, notamment pour Johnny Cash, Charlie Rich, Conway Twitty, jamais crédité car trop jeune. Et donne le numéro Roulette 4228 pour l'enregistrement de Bo Diddley en 1959, mais cette reprise ne peut être la création originale du morceau revendiquée par Ronnie Hawkins. Les amateurs de blues ne manqueront pas Taj Mahal qui eut son heure de gloire dans les années soixante-dix, il raconte son parcours de bluesman qui s'en fut fricoter avec ses racines africaines. SOUL BAG. N° 211 Juillet – Août – septeembre 2013. Muddy Waters en couverture. Superbe article de Gérard Herzhaft. Huit pages irremplaçables. La carrière et surtout la personnalité de Muddy Waters résumée avec une élégance inégalable. Chaque phrase amène son lot de connaissances. Au passage notre auteur réhabilite la figure de John Work qui accompagna ( Voir KR'TNT N° 119 ) Alan Lomax dans ses pérégrinations dans le Sud et qui fut l'irremplaçable interface entre le petit blanc curieux et la communauté noire. Est-il utile de préciser qu'en plus de ses talents de musicologue John Work était noir ? Le vilain Lomax dans un souci de gloriole toute personnelle aurait mis l'étouffoir sur le rapport de son collègue qui ne sera publié qu'en 2005, juste soixante ans de retard !
Quatrième ou cinquième chronique du coffret The Sun Blue Box que je vois passer ces jours-ci, mais celle de Christophe Mourot est la seule à apporter quelques connaissances. Ainsi, Sam Phillips n'aurait pas arrêté du jour au lendemain d'enregistrer des bluesmen sur son label, dès sa découverte de Presley. L'ai entendu dans une interview sur une radio déclarer que c'était-là son plus grand regret. Mourot explique entre autre que ce n'est pas une partie secondaire voire négligeable du travail entrepris par Phillips. L'a autant apporté par ses techniques d'enregistrement et son intelligence de la musique populaire au blues qu' au rock, même si ce sont les frères Chess qui hériteront de ses efforts. Le gros défaut de Sam Phillips – et cela nous le rend sympathique – aurait été son manque d'appétence pour les aspects financiers de son entreprise. Ne crachait pas sur l'argent mais était tellement obsédé par la dimension artistique qu'il aurait laissé passer bien des opportunités d'enrichissement. Notre homme d'affaires n'était point avisé. Ai abordé avec circonspection l'article suivant : Le Blues en 100 Albums. Tiens coco, on a un trou si on se faisait une petite récapitulation discographique. Peu d'investissement et ça bouffe des pages à remplir quatre numéros. Mais non, ont bossé avec sérieux, pas moins de quinze collaborateurs qui nous ont pondu une véritable histoire chronologique du blues que nous avons droit de Bessie Smith à Shemekia Copeland. Avec ces trois contributions nous sommes devant un numéro de référence, et nous n'avons feuilleté qu'un quart du gâteau. Je vous laisse découvrir le reste et les chroniques habituelles. Pour vous mettre une dernière fois l'eau à la bouche : deux pages, extraites d'un livre à paraître à la rentrée de septembre, sur Otis Redding à Paris. Salivez ! Damie Chad. |
F r o m t h e A U S T I N D A I L Y H E R A L D
Sister of Ritchie Valens to perform with DC Drifters
in Albert Lea Saturday
Published 5:29am Tuesday, June 4, 2013
The relatives of a rock ‘n’ roll pioneer will bring the music of the 1950s back to life in an area town.Bird
Connie Valens — the sister of Ritchie Valens — will perform with the Austin-based Denny Charnecki and the DC Drifters at Eddie Cochran Days in Albert Lea. The concert starts at 7:30 p.m. June 8 at the Marion Ross Performing Arts Center.
The music will be mostly music from the 1950s, including classics from Valens and Eddie Cochran performed in 50s attire.
“I’m just thinking it would be a great, great time for anybody,” Charnecki said.
Charnecki said he sees Valens’ participation as a stamp of approval on the band and its performances.
“It’s really cool,” he said.
This year will be the 27th Eddie Cochran Days held in honor of the Albert Lea-born musician, who died at 21 of a car accident in 1960. Ritchie Valens also died young at age 17 in a plane crash with Buddy Holly in Iowa at 17 in 1959.
According to Charnecki, the Cochran and Valens families knew each other, and relatives from each attended the others’ funeral.
Charnecki said Connie Valens doesn’t answer many requests for performances, but she performed with Charnecki and the DC Drifters at the Surf Ballroom in February at the show marking her brother’s and Holly’s deaths.
Charnecki said this will be a special show for the band.
“Every now and then, we get these special, special events,” he said.
Not only will the show offer a trip down memory lane to the hits of the 1950s, but Charnecki said she will also tell about being on set of the film “La Bamba.”
“She’s got stories that are incredible about the ‘La Bamba’ movie,” he said.
ADAPTATION PROPOSEE PAR THOMER
LA SOEUR DE RITCHIE VALENS VA JOUER AVEC LES DC DRIFTERS
SAMEDI A ALBERT LEA
Publié dans le ''Austin Daily Herald'' le 04 juin 2013
Des proches d'un des pionniers du rock'n'roll s'apprête à redonner vie à la musique des fifties dans une ville de la région [ndtm: le Minnesota].
Connie Valens (la soeur de Ritchie Valens) accompagnera le groupe d'Austin Denny Charnecki et les DC Drifters pendant les ''Journées d'Eddie Cochran'' qui se déroulent à Albert Lea. Le concert débutera à 19h30 le 08 juin au Marion Ross Performing Arts Center.
Sera jouée principalement de la musique des fifties, dont des grands classiques de Valens et d'Eddie Cochran chantés en tenues d'époque.
« Je pense que ce sera un grand moment pour tout le monde », précise Charnecki.
Charnecki ajoute que le fait que Connie Valens participe à l'évènement représente pour lui l'approbation de la famille Valens sur ce que fait son groupe.
« C'est vraiment cool ! »
Cette année auront lieu les 27ème ''Journées d'Eddie Cochran'' en l'honneur du musicien né à Albert Lea, décédé en 1960 à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture. Ritchie Valens également est mort jeune : d'un accident d'avion dans l'Iowa en 1959, en compagnie de Buddy Holly. Il avait 17 ans.
Selon Charnecki, les familles Valens et Cochran se connaissaient, et des membres de chaque famille ont assisté aux deux enterrements.
Connie Valens ne répond pas à énormément de demandes de spectacle, selon Charnecki, mais elle a chanté au Surf Ballroom en février dernier avec les DC Drifters, durant un show en mémoire de son frère et de Buddy Holly.
Le show à venir sera très spécial pour le groupe de Charnecki.
« De temps à autre, on fait ce genre d'évènement vraiment, vraiment spécial. »
Le concert offrira non seulement un voyage au cœur des hits des années cinquante, mais Connie parlera également de son expérience sur le plateau du film ''La Bamba''.
« Elle a des histoires incroyables à raconter sur le film ''La Bamba''. »
00:37 | Lien permanent | Commentaires (0)
13/06/2013
KR'TNT ! ¤ 148. GEORGE JONES / UNDERSTONES / KING BAKERS COMBO
KR'TNT ! ¤ 148
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
13 / 06 / 2013
|
GEORGE JONES / UNDERSTONES / KING BAKERS COMBO HEROS OUBLIE DU ROCK'N'ROLL / BOOKS |
G O R G E O U S G E O R G E
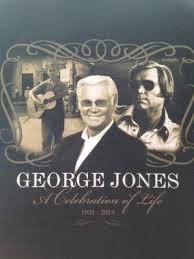
Peut-être vous souvenez-vous de ce road movie très particulier intitulé «Une Histoire Vraie» («The Straight Story», tiré pour le coup d'une histoire vraie), et tourné par David Lynch en 1999. Particulier, oui, car pendant deux bonnes heures, on voit un papy de soixante-dix ans nommé Alvin Straight rouler en tondeuse à gazon sur les routes américaines et franchir plusieurs frontières d'États. Grosso modo, c'est dans le même esprit que «Easy Rider», came, vitesse, cuir et violence en moins.
Alvin Straight entreprend ce périple, car il doit aller voir son frère tombé gravement malade avant qu'il ne disparaisse. Comme il n'a pas de teuf teuf, il remet sa tondeuse en état. Tirant derrière lui une remorque, Alvin Straight parcourt cinq cents bornes sur sa bécane, serrant au mieux le bord des routes et tout le monde le double, évidemment. Il n'avance vraiment pas vite. Aussi doit-il souvent s'arrêter la nuit pour bivouaquer. Et là on rentre dans la petite mythologie des bivouacs d'Alvin Straight. On entre là dans ces moments cinématographiques tellement marquants qu'on s'empresse chaque fois que l'occasion se présente de les reproduire. La moindre occasion est bonne pour bivouaquer sous les étoiles et trinquer à la santé d'Alvin Straight.

George Jones roulait lui aussi en tondeuse à gazon, mais il n'a pas dû croiser Alvin Straight car ils ne vivaient pas dans la même région. Quand madame Jones en avait assez de voir son mari pompette du matin au soir, elle planquait les clés des voitures pour l'empêcher d'aller picoler au rade local situé à plusieurs kilomètres. Comme tous les ivrognes, George grouillait d'idées tordues et il quand il vit que son épouse avait omis d'enlever la clé sur la tondeuse, une petite ampoule s'alluma au dessus de sa tête.
Voilà pour l'anecdote. Hélas, l'histoire retiendra surtout une chose de George Jones : sa consommation gargantuesque d'alcool. Mais fort heureusement, le grand George brille au firmament des amateurs de rockab pour des raisons plus intéressantes.

Il fait partie des rares chanteurs blancs que respectait Jerry Lee. Comme Jerry Lee appartient à la caste des seigneurs de l'histoire du rock américain, on en déduira que Georges Jones appartient lui aussi à cette caste, et il suffit de l'écouter chanter (même sur l'un de ses innombrables albums country) pour s'en convaincre définitivement.
Comme tous les petits mecs de sa génération, le jeune George est vite démangé par le rock et il commence sa carrière chez Starday, pas moins. Craig Morrison (l'auteur de «Go Cat Go !») pense que le jeune George commença à chanter du rockab lors d'une tournée avec Buddy Holly en 1956 (accompagné sur scène par Buddy et son gang, pas moins).

Doté d'un organe superbe, George Jones va rapidement devenir une star de la country, à Nashville. Mais comme d'autres country-singers nashvillais, il s'intéressait de près au rockab et ne voulant pas perturber son public country (et surtout ne pas se griller - À Nashville, on n'appréciait pas trop la musique des bouseux du Tennessee - Johnny Cash explique à quel point il a eu du mal à se faire accepter à Nashville, lui le péquenot de Memphis), il se fit appeler Thumper Jones pour enregistrer l'un des meilleurs singles rockab de tous les temps (Max Décharné et Craig Morrison sont catégoriques sur ce point) : «How Come It/Rock It». Mais hormis la voix qui déjà impressionne par sa qualité, le jeune Jones fout le paquet : il démarre «Rock It» sur de beaux chapeaux de roues, on le voit nettement hocher le menton et secouer les épaules. Et cette rage ! Un vrai punk avant l'heure. Il sait sonner la charge. On le sent beaucoup plus énervé qu'Elvis ou Carl Perkins. «How Come It» est encore plus racé. Voilà ce qu'on appelle la pure élégance rockab. Il sait hurler et plaquer de grands accords secoués de reverb.
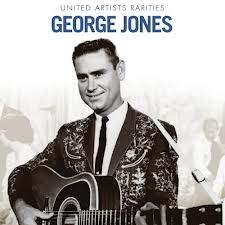
Pourtant, avec sa bobine, il n'avait quasiment aucune chance de plaire aux filles. C'est même le contraire. Berk. Il ressemble à un capitaine de gendarmerie coiffé à la brosse, le même que ceux qui hantent les reportages des télés régionales. Il a des oreilles énormes et l'air un peu placide. On est aux antipodes du glamour d'Elvis ou d'Eddie Cochran. Il semble que son allure cautionne la dimension anecdotique du personnage. Trombine, patronyme, il semble avoir tout faux. Un peu comme Jacques Brel à l'époque de ses débuts en France. Zavez pas vu la gueule de la brêle ? Comme les gens sont méchants...

Grâce à Crypt, j'ai eu la chance à une époque de mettre le grappin sur une espèce de compile intitulée «Rock It» et parue sur Encore. Désormais basée à Hambourg, l'équipe de Crypt propose depuis pas mal de temps un choix de disques triés sur le volet et classés par genres (D'ailleurs on retrouve toutes leurs nouveautés chez Born Bad). Quand on va dans le bac rockabilly, on tombe sur ce genre de merveille qu'est la compile rockab de George Jones
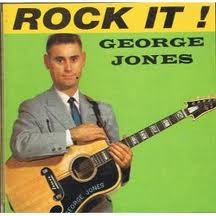
Et là, comme dirait Gide, des nourritures délicieuses attendaient que nous eussions faim. Et d'autres termes, des surprises de taille guettent les curieux.
Aussitôt après «Rock It» et «How Come It», «Maybe Little Baby» saute à la gorge. George Jones a la même classe que Charlie Feathers. Certains iront penser que c'est kif kif bourricot. Grossière méprise, Jiving George a un style bien défini. Il enrichit considérablement le son de ses morceaux. En plus du slap, il fait jouer un pianiste diabolique, alors que la messe est déjà dite, puisque tout repose sur sa voix et sur son jeu de guitare, comme chez Carl Perkins.
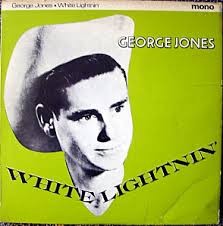
En entendant sa reprise du «White Lightning» de Big Bopper, on comprend pourquoi Gene Vincent et Eddie Cochran ont flashé sur ce morceau. La chanson est une ode aux bouilleurs de cru clandestins, comme toujours planqués dans les collines, cette fois en Caroline du Nord (les Drive-By Truckers rendent des hommages similaires aux bouilleurs clandestins de l'Alabama). «Mighty, mighty pleasin, pappy's corn squeezin'/Wshooh ! white lightnin' !» (c'est l'histoire de Papa qui fabrique son alcool de maïs, un puissant remontant). C'est construit comme «Whole Lotta Shakin'», mais ça fonctionne. Jumping George met le paquet. Il est LA VOIX. Il peut créer des climats. Ce genre de morceau n'a rien de novateur, mais c'est bien ficelé, admirable de mise en place, un peu sucré et tout en relief. Quand on examine la bandoulière de sa guitare, telle qu'elle apparaît sur la photo en noir et blanc à l'intérieur de la pochette, on voit à la suite de son nom gravé dans le cuir deux grands éclairs blancs. Aucun doute, là-dessus, Jolly George ne chantait pas ce morceau par hasard. «Who Shot Sam» sonne comme un hit de Chuck Berry. Jovial George ressort le coup du baryton après le break, comme dans «Summertime Blues». Il raconte l'histoire de Silly Milly qui bute Sammy d'un coup de forty-four, un samedi soir dans un honky-tonk de la Nouvelle Orléans. Normal, puisqu'ils avaient sifflé du white lightning. Qu'on se rassure, ce genre d'incident rock'n'rollesque n'est pas spécifique au Sud des États-Unis. On a eu les mêmes dans nos bonnes vieilles campagnes, au bal du samedi soir, quand le gros Jojo allumé au calva de derrière les fagots allait récupérer sa serpette planquée dans la sacoche de sa mobylette pour régler le compte du petit rabouin qui draguait la Giselle.
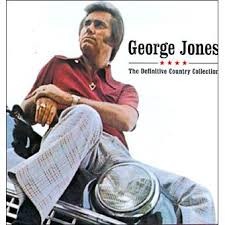
Avec sa reprise de «Heartbreak Hotel», Jubilant George s'attaque à un gros poisson. Il s'en sort avec brio. Il se révèle aussi vénéneux qu'Elvis et même peut-être plus insidieux. Glorious George devient un héros. Sur certains passages, il manque de profondeur, mais sa voix couvre une palette plus étendue que celle d'Elvis. Il envoie ensuite «Boogie Woogie Mexican Boy», une jolie pièce d'americana tex-mex, à faire pâlir d'envie Doug Sahm. Genius George s'y révèle un fantastique guitariste. Sur «Root Beer», il démarre avec des po-po-po-pom extravagants. Il bascule dans le kitsch. Il nous régale d'une belle chanson à boire digne des Coasters et il balance un solo d'une simplicité enfantine, presque maladroit, puis il reprend le fil de sa péroraison. Il hoquette comme s'il était soul. Generous George étend son registre vocal à l'infini. Il y a quelque chose de sidérant chez ce type. Il semble ne pas pouvoir contrôler son exubérance. Et lorsqu'on découvre un artiste, c'est vraiment le genre de constat qu'on adore pondre, car il faut bien avouer que ce genre de phénomène se produit rarement. George Jones est un rocker excitant, qui se renouvelle à chaque morceau et qui n'en finit plus d'épater, un peu comme savent le faire dans leurs registres respectifs les Rivingtons ou Bo Diddley, ou dans un genre totalement différent, Robert Pollard. Si on voulait tenter de qualifier cette forme d'exubérance innovante, on pourrait employer le terme de modernité.
Il tape à nouveau dans le répertoire de Big Bopper, avec «Running Dear», une pièce superbement swinguée, bien emmenée, jouissive et même rockab par endroits. Il souligne son chant d'un gimmick de guitare mélodique. Il sous-tend son affaire, il reste admirable de conscience professionnelle. «Little Boy Blue» sonne comme un énorme classique du slap. La guitare suit le chant avec un son élastique absolument fantastique. Même Liam Watson, le célèbre patron du Toe Rag Studio à Londres, ne pourrait pas reproduire un son pareil. George Jones se révèle de plus en plus surprenant, et même fantastique. Si on osait, on pourrait le surnommer le Mac Orlan du rockab.
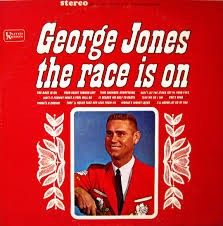
«Revenoover Man» sonne les cloches à la volée. Voilà un rockab parfait, monté sur des petites descentes structurelles à la Eddie Cochran. Gadjo George pose sa voix avec une aisance ahurissante. Il est le prototype de l'artiste complet. Il interprète chacune de ses chansons à la perfection. On a autant de plaisir à l'écouter qu'on en a à écouter Johnny Horton ou Charlie Rich. «Slave Lover» sonne comme un hit de Gene Vincent. Pour l'occasion, Juicy George sort sa voix rauque. Slave love, that's what I am ! Le message passe bien. Attention, «Gonna Come Get To You» s'envole sur des tapis de violons pour une séquence de pure americana, avec un joli brin de slap dans le fond du décor. L'espace d'un instant, George Jones devient le roi du Texas des westerns, une sorte de Tom Mix coiffé d'un balai brosse. Il pousse le bouchon très loin, plus loin que les autres Texans, notamment Buddy Holly, qui n'était pas avare de modernisme. George Jones est un rocker brillant, ça finit par crever les yeux. On sent chez lui la mâle assurance de Jerry Lee et un goût immodéré pour le kitsch hollywoodien du western, mais un goût qui serait authentifié par l'appartenance à la culture sudiste. Impossible de trouver un mauvais morceau sur ce disque. Les morceaux lents sont de purs régals d'interprétation, un peu comme le sont les morceaux que reprend Johnny Cash sur ses quatre derniers albums, sortis ces dernières années sur American Recordings, le label de Rick Rubin.
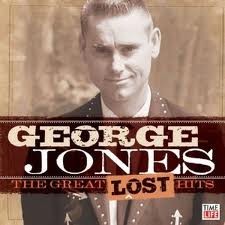
Malgré sa bouille d'ingénieur polytechnicien, George Jones inspire confiance. Pour «You Gotta Be My Baby», il fait à nouveau envoyer des violons grinçants dignes du «Heaven's Gates» de Michael Cimino et il ressort les petites ficelles d'Eddie Cochran. Avec «Eskimo Pie», on maintient le cap du rockab exotique.
«No Money In This Deal» sonne dès la première note comme un immense classique (un de plus !), arrosé de nappes de violon spectaculaires et soutenu par un riff de guitare que nous qualifierons d'historique, suivi d'un jeu de piano à la Duke Ellington. De quoi s'effarer pour de bon. Et comme si cela ne suffisait pas, il balance dans cette merveille absolue un solo de guitare hawaïen. Franchement, on n'en croit pas ses oreilles. «Done Gone» est du pur rockab, même un peu énervé. Il place au chœur de cette nouvelle dinguerie un solo de guitare dévastateur. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Inutile de compter sur une pause.

Pauvre George. Il vient de casser sa pipe. Alors, pour saluer la mémoire de ce bougre de Texan, écoutez l'un de ses disques et vous ne serez pas surpris de constater que ses interprétations font de lui l'un des artistes les plus fascinants de son époque.
Signé : Cazengler, endeuillé comme pas deux
T H E U N D E R S T O N E S
L A M A R O Q U I N E R I E / P A R I S X X
2 9 / 0 5 / 2 0 1 3
L E S U N D E R S T O N E S E N F O N T D E S T O N N E S
Pour les gens qui avaient entre 15 et 25 ans en 1978, quel était le hit le plus fédérateur, le plus digne d'incarner la flamboyance de la jeunesse éternelle, le hit rock auquel tous les kids des deux côtés de la Manche pouvaient s'identifier ? «No fun» ? «New Rose» ? «Kick Out The Jams Motherfuckers» ? «Blank Generation» ? «God Save The Queen» ? «Born To Lose» ? «Shake Some Action» ? «White Riot» ? Jolis morceaux, certes, mais celui qui emportait le cœur, la bouche et tous les suffrages, c'était bien entendu «Teenage Kicks» des Undertones.
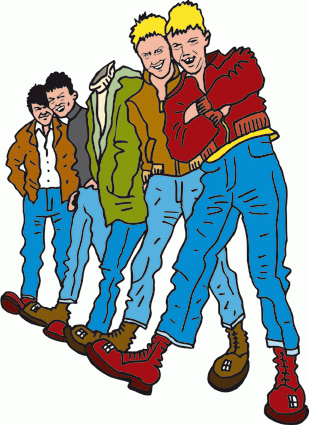
Nous possédions encore à cette époque des postes de radio qu'on pouvait trimballer partout. Quasiment identiques à ceux qui nous permettaient d'écouter treize ans plus tôt le hit-parade de SLC aussitôt rentré à la maison pour y choper «The Last Time», ce tube des Stones qui nous donnait le frisson mortel, ou encore «My Generation» des Who qui nous faisait croire qu'on était les rois du monde. Il fallait savoir bégayer pour chanter ce truc-là : People try to put us d-d-d-down...
Pourquoi treize ans (plus tôt) ? Parce que cette période de l'histoire du rock est tellement prolifique qu'il faut rester précis. Comme dirait Antoine Blondin, ça dégueulait de partout. C'est aussi l'époque où toute l'information rock (la seule qui pouvait nous intéresser, est-il utile de le préciser ?) transitait par le transistor.
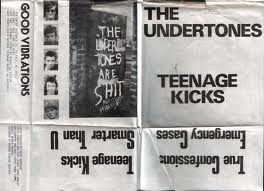
Et en 1978, on réglait encore délicatement les fréquences sur ces postes de radio. L'idéal était de capter Radio One pour y choper John Peel. Pas facile, il était sur les ondes moyennes. Ça craquotait, mais on dressait nos oreilles de lapins pour récupérer le son de sa voix le mieux possible et surtout essayer de comprendre ce qu'il baragouinait. John Peel était le grand découvreur devant l'Éternel. Tous ceux qui prétendent posséder une vraie culture rock avouent humblement qu'ils lui doivent tout. Gedge, le chanteur du Wedding Present, raconte quelque part qu'il n'aurait jamais pensé à monter un groupe s'il n'avait pas découvert l'émission radio de John Peel. Aucun autre homme de radio n'est jamais arrivé à la cheville de Peely et aucune émission de radio n'a eu un tel retentissement auprès des fans de rock. On a eu cette chance incroyable de pouvoir l'écouter chaque soir pendant des années. On parle ici d'une forme de dévotion. Quand le premier album des Ramones est sorti en 1976, Peely l'a diffusé dans son intégralité, d'un trait, ce que personne n'avait jamais osé faire avant lui. On idolâtrait littéralement John Peel. On le savait proche de Captain Beefheart et de Marc Bolan. On le savait curieux de reggae et de rock allemand. On le savait fan des Misunderstood et de Gene Vincent, de Mark E. Smith et de Medecine Head.
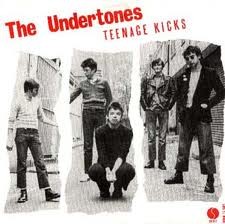
La presse anglaise proposait les paroles et John Peel offrait la musique. Grâce à lui, on mettait un son sur ce que racontaient les journalistes. Ils avaient drôlement intérêt à faire gaffe. Et puis John Peel savait trancher. Il avait un flair infaillible. Il était tout bonnement impossible de rater son émission. Je me souviens du soir, où avec sa morgue habituelle, il présenta d'une voix monotone les quatre titres d'un nouveau groupe de morpions. And now, the Undertones, from Derry...

Intro guitare, voix suraiguë : «C'est vraiment pas facile d'être ado. Chaque fois que je vois cette fille marcher dans la rue, je veux l'avoir. C'est dingue ce qu'elle me plait.» Puis ils attaquent le refrain : «Je voudrais te serrer, ouais, te serrer très fort contre moi. J'en ai la trique la nuit entière.»
Ils vont attaquer le deuxième couplet et déjà on brame à tue-tête. «I wanna hold you wanna hold you tight !» L'histoire de la jeunesse n'est qu'une interminable histoire d'amour charnel à l'état le plus pur. Le rock n'a d'autre fonction que de nous ramener à cette évidence.

Comme Iggy dans «No Fun», Feargal décroche son téléphone : «Je vais l'appeler au téléphone. Je vais lui demander de venir chez moi car je suis tout seul. Elle m'excite, c'est dingue ce qu'elle m'excite, c'est la plus belle fille que j'ai jamais eue !» Et là, le refrain nous retombe sur la gueule, comme un déluge divin. On se retrouve secoué de frissons, à bramer par la fenêtre : «I wanna hold you wanna hold you tight !» Jusqu'à la fin des temps, on voudrait continuer de bramer I wanna hold you wanna hold you tight et bander comme un âne en pensant à celle qui fut à une époque notre véritable amour de jeunesse.
«I wanna hold you wanna hold you tight !» C'est exactement ce qu'on bramait l'autre soir à la Maroquinerie. Les Undertones l'ont même joué deux fois. La petite foule hurlait comme un seule homme : «I wanna hold you wanna hold you tight !» «I wanna hold you wanna hold you tight !». On partage rarement des moments d'une telle intensité, dans une salle de concert. Quelque chose de très pur se mêlait au paganisme ambiant. C'était très différent de l'ambiance qui régnait aux concerts des Stooges, où le public reprenait en chœur tous les classiques jadis composés par Ron Asheton. Avec les Undertones, on se trouvait dans un monde magique, celui que ces petits mecs d'Irlande du Nord avaient créé de toutes pièces avec leurs petits doigts, leurs petites têtes et leurs petites guitares. Et quand on a la chance de les voir jouer sur scène, on ne peut faire qu'une seule chose, excepté bramer à la lune : les adorer. Ils sont tout simplement stupéfiants de simplicité, alors qu'ils ont largement de quoi rivaliser avec Chuck Berry, car ils sont eux aussi une véritable usine à tubes. Pendant deux heures, ils alignent les uns après les autres des hits planétaires tous plus acidulés les uns que les autres, et on croyait que ce privilège était réservé au grand Chuck, celui qu'affectueusement on surnomme le juke-box à deux pattes. Les Undertones font claquer au vent l'étendard de leur modernité, ils démarrent leur set avec «Jimmy Jimmy», un hit que tout le monde connaît puis ils enfilent les perles une par une, «Here Comes the Summer» (radieusement juvénile), «Jump Boys» (avec un accent qui fait penser à un bonbon exotique), puis plus tard «You Got My Number» (pulsé comme pas deux à coups de wanna-wanna-wanna), «Family Entertainment» (rutilant comme un jouet chromé) «My Perfect Cousin» (parfaite trépidance), «Much Too Late» (pépite garage effarante), «Listening In» (tressauté jusqu'à l'overdose), «When Saturday Comes» (qui rappelle étrangement «Paint It Black»), «Runaround» (trop sucré pour être honnête), «Get Over You» (un classicisme infaillible qui rappelle les Heartbreakers) et comme si cela ne suffisait pas, ils firent deux rappels, histoire de bien enfoncer leurs petits clous inoffensifs (on est aux antipodes des gros clous utilisés par les Romains pour crucifier leurs victimes). On a eu du rab avec des versions mirobolantes de «Male Model» (train qui fonce dans la nuit, sous des arches de chœurs fluorescentes), de «True Confessions» (sec et aride comme la biscotte post-punk), de «Hypnotized» (presque arrogant par le chant, tout juste un hymne, enfin quelque chose d'irrésistible, dans la plus pure veine undertonienne), de «Let's Talk About Girls» (leur reprise pétrie d'ingénuité). Pour le second rappel, nous fûmes une nouvelle fois conviés à bramer «I wanna hold you wanna hold you tight !» et ce n'est rien de dire que l'émotion finissait par bouleverser les plus coriaces d'entre nous.

Ces cinq mecs sont restés les morpions d'il y a 35 ans, en tous les cas est-ce ainsi qu'il faut les voir. De la même façon qu'on se voit toujours comme un ado dans la glace de la salle de bains. Et pour une fois, la réalité ne nous fait pas mentir : les deux frères O'Neill sont restés exactement les mêmes, Damian à droite de la scène et John de l'autre côté sur la gauche, encadrant le reste du groupe comme les deux piverts d'un conte magique, le nez pointu, des petites lunettes à verres fumés, des petites corpulences, des petits cheveux, une petite Gibson Les Paul jaune pour Damian, une petite Gibson SG rouge pour John, des petites fringues ordinaires, des petits jeans noirs au noir passé à force de lavages, des clarks bien propres aux pieds, un polo noir pour John et une chemise ouverte sur un t-shirt noir pour Damian, et ils ont dans les pattes le meilleur riffage d'Irlande, et très certainement l'un des plus joyeux du monde. Ils se complètent comme seuls des frères peuvent se compléter. Ils conservent le même entrain qu'à leurs débuts, ils sont là pour jouer les chansons qu'ils ont composé dans leur chambre et ils ne se doutent même pas que ce sont des tubes, tellement ils sont inoffensifs. Mais le public chante avec eux, alors, ils doivent bien se rendre à l'évidence. On comprend que pour eux, ce n'est pas simple. Chez eux, la pureté revêt l'apparence de la timidité.
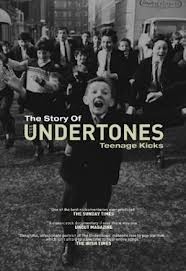
Derrière se démène Billy Doherty, rouge comme un tomate, avec l'épi de cheveux raides tombé sur le front, qui fait penser au petit gros qu'on oblige à courir sur le terrain de football et qui dit tout le temps qu'il n'en peut plus et qui souffle comme un bœuf, mais Billy continue de battre comme un chef, à sa façon, jazz-punk à cause de sa main droite tournée à l'envers comme celle de Gene Krupa, il joue à fond la caisse, soutenant un rythme aussi insoutenable que celui des Ramones, jamais un morceau lent pour souffler, on observe Billy et on se demande combien de temps il va tenir, on craint pour son petit cœur, mais Billy joue dans les Undertones et il ne lâchera pas l'affaire comme ça. Il revient pour les deux rappel et c'est lui qui va saluer le public le plus chaleureusement. On n'en revient pas de voir des morpions aussi gentils et aussi talentueux.
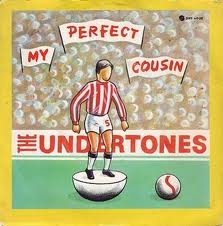
Il reste les deux plus grands. Les grands dadais du groupe, d'abord Michael Bradley, le bassiste, qui ne quittera pas sa veste en jean de tout le concert. Il joue sur une belle basse Rickenbacker et il n'en fait pas trop, il joue les mêmes dominantes depuis toujours et il ressent lui aussi une fierté inavouable à jouer les morceaux composés par les deux frangins piverts. Michael a un faux air de Jerry Lewis, il fait tout son possible pour se faire passer pour un gamin décontracté mais quelque chose de très sombre prend le dessus. Il fait parfois des commentaires en prenant bien soin d'accentuer son accent irlandais et pour se faire pardonner, il cherche à fabriquer quelques phrases en français. Admirable de sobriété, dans son jeu comme dans sa présence scénique, il montre à ceux que ça intéresse comment on fait pour jouer dans un groupe : jouer les chansons, rien que les chansons. Tout le reste n'est que littérature, comme disait Verlaine.
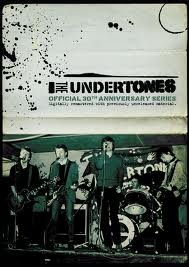
L'autre grand dadais, c'est la pièce rapportée. Comme Feargal faisait son boudin et qu'il ne voulait pas revenir jouer dans le groupe avec ses copains d'enfance, alors les autres ont fait signe à Paul McLoone. Curieusement, Paul peut chanter comme Feargal, d'une voix souvent suraiguë et puissante, une belle voix pop parfaitement adaptée aux hits que pondent les deux piverts de génie. Alors Paul arrive sur scène en jean moulant et en petit blouson de sky noir, celui qu'on met pour rouler en mobylette. Et il prend son rôle de remplaçant très au sérieux, il bouge énormément, secoue les épaules et les hanches, il fait parfois son Travolta puis saute en l'air comme Pete Townshend, mais pas aussi haut, et met dans l'interprétation des chansons toute la rage adolescente dont il est capable. Et il finit par faire oublier cette petite teigne de Feargal, ce qui est en soi un véritable exploit. Le public l'adopte et Paul lui retourne la politesse en mettant toujours plus d'enthousiasme dans son chant. Il finit même par être aussi rouge que Billy la tomate, qui bat le beurre derrière lui, et il emmène les Undertones au firmament pop, avec une admirable constance de pièce rapportée. Il s'investit tellement qu'on finit par le trouver excellent, alors qu'au début du set, on s'agaçait de ses manières. Il se révèle sous son vrai jour, inspiré, et même porteur de flambeau patenté. Il finira par nous mettre définitivement dans sa poche avec la seconde version de «Teenage Kicks», épaulé pour les chœurs par Damian et de Michael, eux aussi bien conscients de vivre un moment clé de l'histoire de l'humanité.
Signé : Cazengler, adolescent attardé.
The Undertones. Teenage Kicks - The Very Best of the Undertones. Salvo 2010
L'illustration : de gauche à droite : John, Damian, Feargal, Billy et Michael.
PARIS 11 / BROC'N'ROLL
espace Vintage Swing / 09 – 06 – 13
KING BAKER'S COMBO

Pas vraiment la foule des grands jours au Cour Debille. C'est que les rockers sont fatigués. Se sont couchés tard, pardon très tôt. A mes côtés Mister B marche comme un zombie, est rentré à six heures du mat et je l'ai réveillé à douze heures tapantes pour lui proposer la sortie parisienne. N'avait qu'à pas aller à l'autre bout de la planète, à La Chapelle Serval, assister au 4° Rockabilly Festival, et en plus il me fait râler “ Y avait plein de monde, et plein de supers groupes anglais”. Désolé petit père mais moi j'étais ailleurs sur scène, avec un cheval qui jouait les mustangs sauvages des westerns, alors tes britishs... Bref ce dimanche après-midi, les cats ronronnent sous la couette douillette, à cinq heures du soir l'on n'en compte qu'une infinitésimale poignée aussi frais que des gardons sortis de l'eau depuis quinze jours.

Je vous épargne la visite des étalages. Déjà qu'une broc sans stand de disques c'est un peu comme une Harley Davidson sans roues, même un épouvantail à moineaux refuserait de se vêtir avec les frusques censées réveiller nos concupiscentes pulsions de consommateurs frénétiques. Enfin, l'en faut pour tous les goûts... Ma fille – eh oui bande de chacals j'ai une fille belle et intelligente comme son père – en profite pour féliciter Turky – l'organisateur – de son petit mot à l'adresse des nazillons sur son facebook suite à l'assassinat de Clément Méric. Si les rockers se mettent à faire de la politique, où allons-nous ma bonne dame ?...
THE KING BAKER'S COMBO
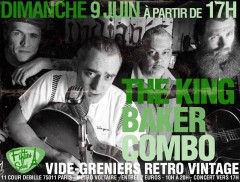
Le King Baker's Combo prend place en l' exigu espace imparti au concert. Deux figures connues, Vince qui officie aussi dans Hoochie Coochies et Burnin' Dust, Jim de Jim and The Beans, Carlito l'ancien gérant des Indians à Montreuil, et Blanco que je découvre.
Carlito officie à la batterie. Mais la messe est déjà dite. Marque la mesure, mais n'en fait pas plus. Assure le minimum syndical. Encore un qui a dû passer une nuit agitée. Heureusement que les trois autres bossent pour six. Vince astique sa double bass avec beaucoup plus de frénésie. Pas de soli à proprement parler mais de délicieux moments où l'on n'entend plus que lui avec les cordes qui rebondissent comme des balles de tennis. Souque ferme. Donne l'assise rythmique et propulse le combo en avant.

Pour les guitares c'est un vrai régal. Jim à la sèche électrifiée et Blanco sans cable, en acoustique. Doivent assurer un max pour donner une épaisseur au son. Jim, l'esprit un peu ailleurs, fermerait les yeux avec plaisir, semble tenir debout par la grâce de ses doigts qui s'appuient sur les cordes. Mais jamais au même endroit, s'agitent et gigotent de tous les côtés. Et comme Blanco n'est pas en reste non plus, à eux deux ils mènent un boucan d'enfer. Parfois ils se regardent, du genre “ Ah ! Je t'ai eu coco, tu ne t'y attendais pas à celle-là” et ils repartent avec encore plus de fougue. Tension roots à toute épreuve.

Mais la grenade sur le gâteau, c'est la voix de Blanco. Un mélange de hargne et de rage. Après son Long Blond Hair de Johnny Powers impossible de s'amouracher d'une brunette aux cheveux courts, en donne un vocal que l'on peut dire définitif tant sa voix colle à son jeu de guitare. C'est là un des grands secrets du rock, l'important ce n'est pas de faire mieux que, mais de trouver d'instinct la plus parfaite adéquation entre l'idée que l'on se fait d'un morceau et son interprétation personnelle.

Un Long Black Train de Conway Twitty sec et nerveux comme un crépitement de winchesters et une superbe reprise de Tired and Sleepy d'Eddie Cochran que je qualifierai d'intelligente tant on sent que Blanco se l'est appropriée. Font vite l'unanimité, auprès des danseurs comme des amateurs.

Plouf ! Dix superbes petites pépites et le set est déjà terminé. Heureusement qu'ils rajoutent très vite qu'un deuxième passage est prévu. L'on a frôlé la prise d'otages. Faut pas habituer le public aux trop bonnes choses, il s'y habitue très vite. L'intermède sera un peu trop long ( mais pas du tout blond hair ) à notre goût. Enfin ils reprennent leurs instrus.

Sont encore meilleurs qu'au premier set. Davantage rentre dedans et vitesse rapide. Nous envoient pour commencer un Rock Crazy Baby d'Art Adams entre les dents et ne baissent plus la garde jusqu'à la fin. Somptueuses parties de grattes sur All I Can Do Is Cry qui donne davantage envie de sauter au plafond que de pleurer. Le chant de Blanco est bien plus rockabilly que celui de Wayne Walker trop entaché de proximités countrisantes. Suivront un Blue Jean & A Boy Shirt de Glen Glenn à vous rendre zinzin et un Gone, Gone, Gone vers la fin pour nous avertir qu'ils vont eux aussi partir. Turky implore un rappel. Nous l'aurons, mais les rockers sont fatigués. Ne nous donneront pas plus.
Enfin on garde le souvenir de deux sets magistraux habités par la grâce, l'unique soleil de ce dimanche pluvieux.
Damie Chad.
( Photos récupérées sur le Facbook de King Baker's Combo )
HEROS OUBLIES DU ROCK’N’ROLL
LES ANNEES SAUVAGES DU ROCK AVANT ELVIS
NICK TOSCHES
( Traduction de Jean-Marc Mandosio )
( Editions ALLIA / 2008 )
Avec Nick Tosches, c’est dans la poche. Enfin, il y a matière à discussion. A l’origine ce sont des chroniques rédigées en 1979 pour le magazine américain Creem. S’agissait alors de parfaire la culture des jeunes ricains tout juste sortis de l’œuf qui abordaient les rivages du rock un peu après la bataille. Autant dire qu’ils ne connaissaient rien étant pour la plupart issus de la petite-bourgeoisie blanche besogneuse et bien-pensante. Qu’il ait pu exister un avant-Presley a dû leur apparaître comme un nouveau concept d’une radicalité absolue.
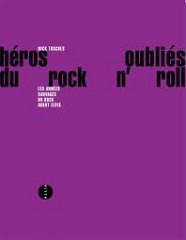
Pour un amateur averti de rockabilly, nous dirons qu’il n’y a pas beaucoup à boire et très peu à manger. Nous saluerons donc en premier Jean-Luc Mandosio qui a pris son rôle de traducteur au sérieux et qui ne peut voir traîner un mot d’anglais - serait-ce le titre d’une chanson ou l’appellation d’un label - sans en donner à la seconde même un équivalent en notre humble patois franchouillard.
DE CELEBRES INCONNUS
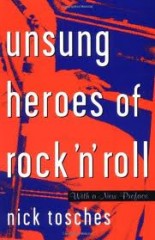
Jugez par vous-même : Bill Haley et Screamin’ Jay Hawkins parmi les inconnus faut oser. L’est sûr que Nick Tosches a ses têtes, il déteste le gros Bill, et a essayé de retrouver les survivants avant de les couler dans le marbre de sa prose moqueuse. Jay Hawkins, l’aurait pas dû lui rendre visite. L’on n’aime guère les gars qui se renient eux-mêmes. Le grand Jay noir nous fait son petit numéro de pleurnicheur : pour le monde entier il est le clown augustule de service qui sort de son cercueil en hurlant alors qu’il aurait été prêt à chanter de l’opéra si nous le lui avions demandé. Heureusement cette idée saugrenue ne nous a jamais traversé l’esprit, z’étaient peut-être tous pétés comme des coings dans le studio quand il a enregistré I Put A Spell On You, mais si Freud avait pu entendre ses beuglements de gorets énamourés jamais il n’aurait pensé que le désir primitif des animaux sexués que nous sommes puisse être jugulé par les retenues anti-éjaculatoires de notre inconscient.
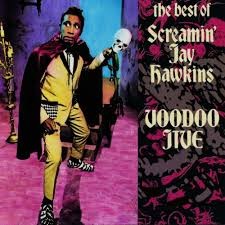
Pour Bill, Nickie s’en tire par une pirouette, ne parle que des ses premiers disques avant le rock autour de la pendule. Dans les trois dernières lignes l’est bien obligé de reconnaître que sans lui, Presley… N’a pas osé écrire un chapitre sur Elvis avant RCA, alors il se rabat sur le frère jumeau, Aaron qui aurait été recueilli par la cousine de sa mère et qui aurait enregistré deux disques… force du mythe qui happe l’écrivain qui promet de ne point s’y intéresser dans son titre… Preuve que les chemins du rock qui ne partent pas de Presley y mènent tout droit qu’on le veuille ou non.
THESE ET ANTITHESE
C’était mieux avant. En 1956, le rock est mort et enterré. L’idéal serait d’arrêter le processus en cinquante-quatre, juste avant que le natif de Tupelo ne franchisse le seuil de Sun, C’est que Nick Tosches possède sa propre chronologie de l’histoire du monde. 1939-1945 : commencement et fin de la seconde guerre mondiale. 1945-1955 : naissance et mort du rock’roll. 1956 - 2000 ( date du dernier ajout ) : circulez, il n’y a plus rien à voir.
Ce qui est fou c’est le nombre de témoins qui se bousculent au portillon pour revendiquer l’éminence de leur rôle dans l’invention du rock and roll. Pour ceux qui ont eu le mauvais goût de passer l’arme à gauche avant que Tosches ne les choppe en interview, ne vous inquiétez pas Nick sait faire parler les morts. Mais c’est comme pour le venin des serpents. Notre auteur vous inocule l’antidote avant la morsure. Prend soin de vous rappeler que l’expression rock and roll est aussi vieille que l’Amérique, que personne n’a jamais été assez malin pour déclarer qu’il faisait du rock and roll à l’instant même où il en faisait.
Pour cela tous les témoignages concordent : « Ah ! Si on m’avait dit que je faisais du rock, à l’heure actuelle je serais plus riche que Presley, plus célèbre qu’Elvis ! ». Tout le monde a le droit de s’accrocher à son rêve. Quoique ceux réalisés à postériori relèvent d’après nous de l’affabulation schizoprhénique. En plus, dans la plupart des cas l’on devine en sourdine le ressentiment des artistes noirs qui savent très bien qu’ils ne jouaient pas dans la même division que les petits blancs souvent ( mais pas toujours ) pas très doués.
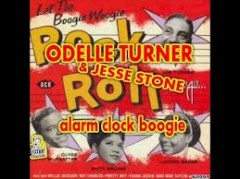
Pas besoin de foncer très loin dans le bouquin : le premier des vingt-huit portraits n’est pas terminé que Jesse Stone complice d’Ahmet Ertegun - fondateur d’Atlantic - se vante d’avoir inventé la rythmique rock : je cite : « Doo, da-doo, dum ; doo, da-doo, dum » à lui tout seul, pour les besoins de la cause : nécessité adolescente d’un beat de base et de danse qui soit ultra swinguant… Pas étonnant que l’on retrouve aussi les monographies de Louis Jordan et de Louis Prima. L’on comprend mieux pourquoi dans les décennies suivantes la musique noire s’est affadie en dance-music.
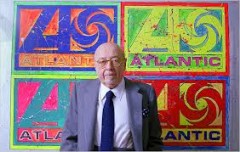
Dans l’éphéméride final qui couvre les années 1945-1955 est à peine mentionné en bout de course Bo Diddley auquel il n’est fait aucune allusion dans les deux cents pages de texte qui précèdent. Little Richard n’est même pas pris en compte et Chuck Berry est cité une seule fois, que ces trois rockers noirs soient hors-jeu du contenu de ce volume démontre que nous ne sommes pas en présence de héros oubliés du rock and roll mais à la recherche de précurseurs. Ce qui n’enlève rien à leurs talents ni à leurs mérites.
Ce qui est en jeu dans nos remarques précédentes c’est l’essence même du rock and roll perçu par beaucoup comme un simple exutoire d’une jeunesse à la recherche d’amusements joyeux et insouciants et par d’autres - dont nous nous réclamons - comme l’expression d’une rébellion métaphysique beaucoup plus profonde.
ACE DE PIQUE
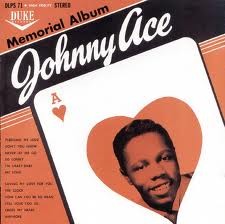
La dernière livraison - car la vingt-huitième sur Aaron Presley est hors-concours - est dévolue à Johnny Ace. Qui se souviendrait de lui de nos jours s’il n’avait eu la merveilleuse idée de se tirer une balle dans la tête le soir de Noël 1954 avant de passer sur scène ? Pouvait pas s’offrir un meilleur cadeau quant à sa postérité. Erreur tragique ou crime mystérieux ? L’on a évoqué de nombreuses hypothèses, de dettes non remboursées à une roulette russe qui aurait mal tourné. Nick Tosches avance une autre solution, mais il se rétracte aussitôt sous prétexte qu’il ne veut pas de procès… Quand on n’en dit pas assez, il vaudrait mieux se taire… Nous serions plutôt partisan d’un certain déséquilibre engendré par un succès répétitif et ultra-rapide. Cette disparition n’est pas s’en rappeler les franges d’ombre qui entoureront quelques années plus tard le meurtre de Sam Cooke. Le rock and roll n’est pas une partie de plaisir.
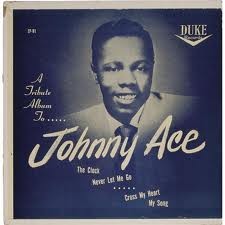
INNOCENCE
Et pourtant que de sexe ! Ne pensent qu’à cela. Même les gamines bien élevées comme Wanda Jakson qui déclare avoir le minou en éruption. Tout est prétexte à sous-entendus explicites. Salades salaces. Cramponnez-vous à ce qui dépasse car ça va secouer sec. Je vous passe les images romantiques à l’orientale du genre j’ai le nem tout ramollo… Vous rassure tout de suite, il n’y a pas que le sexe dans la vie. Il y a aussi l’alcool. Nos proto-rockers ne sont pas du genre à laisser les bouteilles à moitié pleines ou à moitié vides. Comme deux sur trois sortent de familles ultra-religieuses avec le papa prêtre ou pasteur, l’on se dit que les chemins de foi ardente qui débouchent sur tous les péchés ne sont pas si terribles que cela et que les voies du Seigneur sont bien plus pénétrables qu’on ne le croit.
QUI DE QUI ?

Débutons par celui dont le morceau - vous gouterez l’ambivalence de ce terme en en lisant la fin de cette phrase - I Got A Rocket In My Pocket fut le titre original de La Glorieuse Histoire du Rockabily de Max Décharné ( KRTNT 139 du 11 / 04 / 13 ), Jimmie Logsdon fan absolu de Hank Williams qui enregistra ses plus célèbres rockabilly sous le nom de Jimmie Lloyd, c’était en 1957, après Elvis donc, qui il est vrai à l’époque n’avalait pas autant de médicaments que lui. Un précurseur en quelque sorte. En plus Jimmie possédait la déplorable habitude de boire plus que de raison et d’avoir l’alcool triste, bluesy en sa jeunesse et plus tard country-tire-larmes.
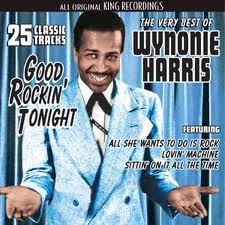
Pour Wyonnie Harris, né en 1915 - vingt ans avant the Pelvis - il n’y a pas photo, c’est bien qui a publié chez King - c’était prémonitoire ! - Good Rockin’ To Night qu’Elvis reprit sur son deuxième single Sun. Les témoins de l’époque et les mauvaises langues d’aujourd’hui prétendent que c’est à lui qu’Elvis a emprunté son jeu de jambes inimitables. En tout cas il est des similitudes étranges entre les deux carrières, Gros cachets, cadillac frime, amateurs de gent féminine, danseur, chanteur d’orchestre, vedette de film… mais rien à voir avec la bonne éducation de petit blanc du Sud. C’est un gros noir, sans complexe, arrogant, bagarreur, insulteur toujours prêt à traiter les femmes de salopes avant de les passer à casserole. Entre 1945 et 1955 il est le roi du rhythm and Blues et se permet de créer un classique du rock and roll - la fameuse Drinkin’Wine, Spo-0-Dee-O-Dee. Une personnalité encombrante, le showbiz se hâta de l’oublier dès que la relève blanche fut en ordre de marche sur le marché. Alcoolique et malade il décède en 1969, on se hâta d’enterrer son souvenir. Le pionnier des pionniers.
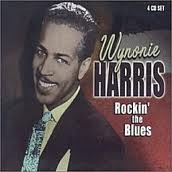
Par la suite Elvis préféra imiter la fin de carrière de Nat King Cole que celle de Wyonnie Harris. Discographiquement parlant car pour le reste… Du sirop de glucose avec une voix romantique à donner le sexe féminin à tous les anges du paradis. Avec parfois une goutte de whisky pour ne pas rejeter ceux qui auraient cédé aux joies infernales. Mais c’est le Nat King Cole du début qui est intéressant. Historiquement parlant parce qu’au seul point de vue musical vous avez le droit de ne pas opiner. Nat Cole est un pianiste remarquable, mais il agit en tant qu’adoucisseur : prend la folie du ragtime et la fureur du boogie-woogie, les assimile pour mieux les brider. C’étaient des chevaux sauvages, il leur enseigne le trot attelé et la marche au pas. L’élégance en plus, car la Cole attitude c’est presque la cool préservation. Un talent certain, il atonnifie le bleu indigo du blues en bleu lavandasse de Klein, agréable à l’œil et marque déposée pour éviter les imitations du produit formaté. Nat King Cole c’est le moment où le jazz se retourne vers ses origines pour les revisiter et les rendres plus lisses. Acceptables en un mot.
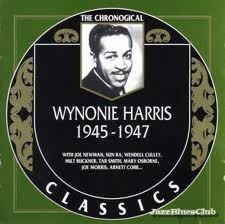
C’est un combat incessant. Certains à la Wyonnie Harris essaient de retrouver une sauvagerie originelle et d’autres comme Nat King Cole tentent de toucher un plus large public - comprenez blanc - en versant beaucoup d’eau dans leur whisky. Le rock and roll porte en lui ces deux postulations contradictoires. Joue tour à tour la pute aguichante et la vierge intègre. Mais tant qu’on peut y enfoncer son morceau, personne ne se plaint.
Ces héros oubliés du rock and roll de Nick Tosches nous aide à nous rappeler l’incontournable leçon de McKinley Morganfield, plus vous remontez vers la source d’un fleuve profond, plus l’eau devient boueuse. Et cette muddy water sera la seule qui étanchera votre soif. De connaissance.
Damie Chad.
LOOK BOOKS !
LA CITADELLE DES VIERGES NOIRES
MARC-LOUIS QUESTIN
Illustrations : Tiffanie Uldry / Préface : Pierre Brulhet
( Editions Unicité / Décembre 2012 )

Un truc à gothiques. J'entends vos dédaigneuses paroles et je vois votre moue sarcastique. Vous avez beau dormir la fenêtre ouverte jamais un méchant vampire ne vous a laissé la trace sanguinolente de son suçon sur votre cou. Vous êtes un esprit fort, vous n'y croyez pas. Mais vous êtes-vous demandé si les goules de la nuit croyaient en votre existence ? C'est une manière différente de poser le problème. De toutes les façons ce n'est pas le sujet du livre mais puisqu'il fait froid dehors, que votre électrophone est en panne, que votre copine s'est décommandée, bref parce que vous n'avez rien de mieux ou de pire à trastéger, en poussant un profond soupir de commisération, un verre de sky à la main vous vous installez dans votre fauteuil, et ouvrez le livre.
La nouvelle fantastique vous connaissez sur le bout des doigts. Vous en pondriez par dizaines si vous le vouliez vraiment. Un peu de peur, un peu de noir, un peu de sang, un peu de sexe, un peu de mystère, l'important c'est avant tout l'atmosphère inquiétante, cela s'obtient par le velouté du style. Vous ricanez une dernière fois, Marc-Louis Questin, ce n'est ni Edgar Allan Poe, ni Villiers de l'Isle Adam, ni Jean Lorrain, alors il a intérêt à avoir affûter son porte-plume s'il veut vous étonner.

Vous jubilez. Ah ! le blaireau ! Mais il ne sait même pas bâtir une intrigue qui tienne debout. Abandonne ses personnages au bout de quatre paragraphes, se soucie d'eux comme d'une guigne, part de tous les côtés. Personne ne lui a sussuré le grand secret de la nouvelle : un début, un milieu, une fin. Unité d'action, de temps et de lieu. Mais c'est quoi, c'est qui, ce mec ? Sait pas lire, sait pas écrire, on devrait lui interdire de tenir un stylo. Touche pas une bille. Doit être frappé du calot. Cela pour les dix premières pages.
Ceci pour les dix pages suivantes. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est à cent pour cent cinoque. Mais où il est allé cherché ce binz ? Ce n'est pas possible ! Et il croit que je vais marcher dans la combine. Alors là, ça devient étrange. Evidemment pris sous cet angle. Il exagère un peu, mais n'a peut-être pas tout à fait tort. Va finir par m'en boucher un coin, s'il continue. En plus il persévère sévère, n'a pas froid aux yeux le pépère. Les conventions littéraires ce n'est pas trop son truc, mais c'est tout de même bien foutu.
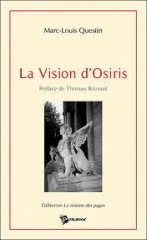
Faudra vous y faire. Vous aviez raison Marc-Louis Questin ce n'est ni Edgar Allan Poe, ni Villiers de l'Isle Adam, ni Jean Lorrain. Ni tous les autres que vous avez lus. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas moins bien. C'est différent. Vous raconte pas une histoire à la Lord Arthur Machen ( chose ) ou à la Lovecraft, non il n'imite pas les maîtres. Il propose un nouveau modèle. Un nouvel étalon. Or. D'abord il ne raconte pas une histoire. Pour la simple raison qu'il n'y a pas d'histoire. Et je ne dis pas cela parce qu'il y a vingt-trois nouvelles ( le chiffre de l'Eris) dans le volume.
Vous vous êtes levé de votre fauteuil et vous avez marché sur le plancher de votre chambre pour vous resservir un deuxième verre de sky. Crétinoïde ambulant ! Si je vous demande ce que vous êtes en train de faire vous me répondrez la bouche en coeur de boeuf, je marche sur le plancher de ma chambre. Et vous pensez que vous êtes en train d'arpenter la réalité du monde. A me dégoûter de l'espèce humaine !
Il est peut-être vrai que vous ayez commencé par marcher sur le plancher de votre chambre mais peut-être à un certain moment avez-vous marché sur la pensée du plancher que l'ancien locataire de votre chambre a projetée dans le monde. Pourquoi l'univers ne serait-il pas composé de courbes mathématiques, mentales et matérielles qui s'entrecroisent, s'emmêlent et s'entremêlent tel un noeud de serpents à mille têtes ? Dèjà Cantor avait entrevuu le problème avec sa théorie des alephs.
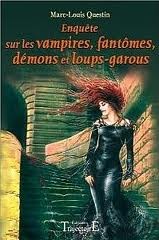
Evidemment cela change tout. Ce n'est pas seulement qu'à tout moment vous passez d'un plan à un autre c'est que vous êtes constituté de ces mille plans qui s'interpénêtrent en vous. En votre corps et en votre esprit. Actant et acté. Marionnette et marionettiste. Vous êtes ici et ailleurs. Vous êtes vous et d'autres. Alors maintenant, imaginez que vous écrivez une histoire de vampire. Vous aurez un mal fou à isoler l'unicité de votre personnage. Je est un autre a dit Rimbaud. Marc-Louis Questin raconte l'histoire de ce labyrinthe dont nous sommes constitués et de notre chair et de notre esprit et du rêve des autres, et des enseignements des mythologies et des cauchemars du monde et des batailles de montres antédilluviens et de bien d'autres choses encore. Mille chemins ouverts disaient Julien Green. Vous ne les parcourez pas, ce sont eux qui viennent à vous. Husserl lui-même dégoûté par le tollé général soulevé dans les milieux philosophiques par l'esquisse de sa théorie de l'intercommunicabilité des consciences l'avait sévèrement mise en veilleuse. Marc-Louis Questin en use comme d'un point de départ, a généralisé et unifié la pensée à tous les univers possibles et inimaginables.
Présent, passé, futur, mythes et modernités tout se mélange et se métamorphose en l'autre tout en gardant sa propre essence ontologique. A chaque pas vous empruntez un nouveau pont. Et poutant Marc-Louis Questin ne nous laisse pas dans cette incertitude généralisée. Nous prend par la main et nous guide. Thésée et le fil d'Ariane, mais plutôt comme Virgile vers l'Enfer de Dante, et Beatrix vers le paradis. La nature est un temple aux vivants pilliers nous a dit Baudelaire.
Je vous laisse à votre lecture. Marc-Louis Questin nous ouvre une des portes d'ivoire et de corne du rêve chère à Gérard de Nerval. Ce frère aîné de George Trakl. Grâce à lui vous entreverrez du Nouveau. Chef-d'oeuvre. Poésie absolue.
Ce livre est appelé à féconder bien des univers rock. La preuve on y entrevoit Ronnie Bird.
Damie Chad.
PASCAL ULRICH
( LES EDITIONS DU CONTENTIEUX / 30 pp / 15 E )
( Robert Roman / Lieu-dit- Bourdet
31 470 / France )
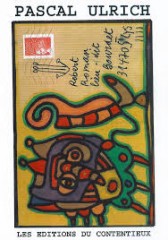
Pas vraiment un livre. Un signe aux vivants et au mort. Voici quatre ans que Pascal Ulrich a sauté la ligne. Par la fenêtre. N'a rien laissé derrière lui sinon des centaines d'enveloppes multicolores éparpillées aux quatre coins du monde. Va te faire feutre disait-il à son courrier et vous receviez chez vous des dizaines de visages grimaçants et torturés. Vous souriaient pas mais vous engageaient à les suivre. Artistiquement c'était un peu comme le visage du Cri d'Edward Munch repeint avec les couleurs psychédéliques de l'été de l'amour. Mais l'amour chez Pascal épousait souvent les formes de l'ironie pour ses contemporains et les traits de la haine pour nos pauvres institutions humaines.
Vous envoyait souvent des poèmes à l'intérieur. Me souviendrai toujours d'une lecture opérée lors d'un spectacle culturel dans une petite commune de la Brie. Le Conseil Municipal tout fier de son initiative était rassemblé au premier rang sur les inconfortables chaises du Foyer Rural Communal. Cela avait commencé très fort par un groupe d'handicapés mentaux qui avaient joué une pièce... Un vieux fond humaniste de charité chrétienne avait poussé la population locale effarée rassemblée en ce lieu à tout de même applaudir...
Ensuite j'ai déclamé quelques poèmes de Pascal Ulrich. Du genre – je cite de mémoire – ce matin je me suis levé de bonne heure et je ne suis pas digne de vivre : je n'ai pas encore tué mon maire, je n'ai pas encore tué mon député – stupeur dans l'assistance à dominance social-démocrate tempérée... Pascal ne faisait pas dans la dentelle libertaire. Une autre fois dans une église voisine profitant d'une autre manifestation à prétention hautement culturelle j'ai lu sa visite à la Cathédrâle de Strasbourg qui suscita bien des interrogations ravacholiennes chez les fidèles atterrés...
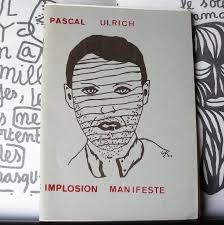
Robert Roman fut un des amis les plus proches de Pascal, a décidé de lui consacrer un ouvrage bio(pas du tout dégradable)graphique. Rassemble les documents. Cette plaquette constituée en majeure partie de reproductions couleur d'enveloppes colorées de Pascal est comme un prélude destiné à raviver le souvenir d'Ulrich, auprès des personnes qui l'ont connu et à donner un aperçu de son talent à ceux qui ne le connaissent pas encore.
Ne vous la procurez pas pour en faire un objet de collection. Ce serait trahir le cheminement de Pascal Ulrich qui s'efforçait de défoncer les portes afin d'élargir les horizons et d'ouvrir les fenêtres car il redoutait de se trouver enfermé, ne serait-ce qu'en lui-même.
Damie Chad.
TEQUILA BLUES
JEAN-MARIE GALLIAND
( Livre de Poche / N° 14 578 / 1998 )
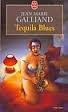
J'ai flashé sur le titre. Le blues et la téquila - deux des superbes consolations que le bon dieu a donné aux hommes pour s'excuser de les avoir virés comme des mal-propres du paradis terrestre - comme accroche coeur ce n'est pas mal du tout. En plus si sur la quatrième de couve l'on explique qu'au début des annézes 70, l'héroïne s'en est allé aux States jouer du saxophone, l'on prend les yeux fermés. Surtout que l'illustration d'Isabelle Dejoy nous a colorié une nénette genre un peu vulgaire, un peu trop grosse. Pas vraiment la joie jolie.
Pour la musique, faudra repasser. Ce n'est pas l'intérêt principal de Jean-Marie Galliand, à part quelques titres de standars de jazz éparpillés dans le texte, n'y a rien. Vous y apprendrez que l'on souffle dans un sax, et puis n'en demandez pas plus. Ce qui titille Galliand ce n'est pas le rock, mais le sexe. Ouf ! Nous sommes sauvés.
Ne criez pas victoire trop tôt. Rien de bien révolutionnaire. Ni même pornographique. Béatrice fait son éducation sentimentale : baisotte par ci par là, pas le genre nymphomane de service. Elle assume sa sexualité de jeune fille, les mauvais coups comme les bons. Reconnaît ses erreurs et évite de mentir sur la réalité de ses sentiments. Tombe amoureuse d'un voyou. Mais comme la morale est sauve, il terminera le road-movie en prison. Ce qu'il y a de terrible c'est que l'on a surtout envie de plaindre Zézette la chienne recueillie, au destin tragique. Le plus beau personnage du roman, nettement plus authentique que les clones de Woody Allen avec qui la demoiselle traîne un bon tiers du bouquin.
Béatrice retournera-t-elle à Paris ou continuera-t-elle en stop jusqu'au Brésil ? Le livre ne répond pas à cette angoissante question, tant mieux car il y avait longtemps que l'on avait envie de tourner la page.
Damie Chad.
EN UN COMBAT DOUTEUX
JOHN STEINBECK
( Livre de Poche / N° 262 – 263 )
Hyper-rock'n'roll. Pourtant c'est tout juste si on aperçoit durant une demi-ligne la forme d'une guitare. Tout les grévistes ne sont pas Woody Guthrie. Parce que la défaite en chantant... Sont mal barrés nos cueilleurs de pommes. Les propriétaires ont baissé la paye et la grève n'est pas au mieux de sa forme. Elle avait bien commencé mais les patrons ne sont pas nés de la dernière pluie. Savent se défendre bien mieux que ceux qui les attaquent. Ont la loi, le fric, la presse, et les milices fascisantes avec eux. Les autres, à part leurs colères passagères et leurs ventres creux n'ont pas grand-chose à offrir.
Nous sommes au lendemain de la crise de vingt-neuf. Les wooblies ( voir notre livraison 114 du 18 / 10 / 12 ) sont remplacés par les agitateurs communistes. Inutile d'appeler MacArthur à la rescousse, ne sont que deux. Décidés à tout pour réussir. Le combat est douteux car manipulatoire. Ne suffit pas d'expliquer aux prolétaires qu'ils sont des exploités. Le savent déjà et n'en sont pas pour autant en train de dépaver les rues. Faut créer la situation et profiter de toutes les occasions. Partie d'échecs avec le capitalisme qui vous mate.
Pas tout à fait seuls, non plus. Quelques leaders naturels – les doigts d'une unique main - un tout petit peu plus conscients que leurs camarade sur qui ils ont une certaine emprise. Et puis c'est tout, même si vous comptez cette foule d'ouvriers indécis et versatiles qui oscillent perpétuellement entre crises de rage et néfastes accablements. Autant vouloir pousser une montagne d'un coup d'épaule. Le combat est douteux car perdu d'avance.
Beau livre, mais guère jubilatoire. Aussi impitoyable qu'un western de Clint Eastwood. La violence n'est pas une solution mais une nécessité. Si vous ne voulez pas le combat, c'est le combat qui vient à vous. Inéluctable fatalité, Steinbeck ne se cache pas derrière des pauses romantiques. Juste derrière son titre. Mais qui doute de la réalité de la lutte des riches contre les pauvres ?
N'allez surtout pas inverser les termes de l'équation ainsi posée.
Damie Chad.
00:22 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/06/2013
KR'TNT ! ¤ 147. BOULE NOIRE / BALAJO / LUKY GAMBLERS / 4° ROCK THE JOINT
KR'TNT ! ¤ 147
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
07 / 06 / 2013
|
PROTOKIDS / PRIME MOVERS / GHOST HIGHWAY LUCKY GAMBLERS / HOT JUMPING SIX DALE ROCKA & THE VOLCANOES |
LA BOULE NOIRE / PARIS / 25 – 05 – 13
PROTO KIDS / PRIME MOVERS
LE JOUR DE GRAHAM DAY VIENDRA
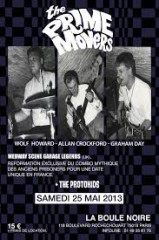
Lili ne connaissait pas les Prime Movers. Les Prime quoi ? Comme pas mal de gens d'ailleurs. Je l'avais invitée à venir les voir à la Boule Noire, et il me semblait opportun d'éclairer sa lanterne en situant le contexte. D'autant plus qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel : le groupe se reformait spécialement pour jouer à Paris. Impossible de rater ça.
Situer le contexte, oui, mais par où commencer ? Par un panorama de la scène Mod des sixties, véritable identité culturelle du rock anglais ? Par les Prisoners, groupe fétiche de la scène Mod anglaise des années 80 ? Par un portrait de Graham Day, l'une des figures légendaires du rock anglais contemporain ? Plus simple, car elle se souvenait vaguement de l'avoir vu accompagner Billy Childish à la basse. Le type flegmatique qui portait une tunique de l'armée des Indes ouverte sur une chemise à jabot bleu turquoise ? Yes darling.
Nous décidâmes de casser une petite graine avant de descendre dans le métro. Ça me laissait environ une heure pour évoquer les quatre insolentes merveilles que sont les albums des Prisoners, puis les trois majestueux albums des Prime Movers, (toujours Graham Day et son ami bassman Allan Crockford), puis les quatre monstrueux albums des Solarflares (même casting de rêve que les Prime Movers), puis les deux excellentissimmes albums de Graham Day and the Goalers qu'on trouve encore dans les bacs de certains disquaires raffinés. L'embêtant, c'est que je n'avais pas pensé à apporter de quoi illustrer musicalement mes propos, aussi décidai-je de mettre la pédale douce et de fermer provisoirement le robinet didactico-dithyrambic.
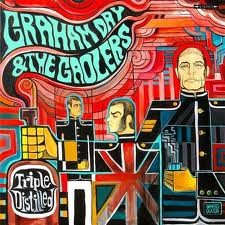
Nous nous régalâmes de bons maquereaux palpitants et de fenouil poêlé. Chez Lili, on se pourlèche toujours les babines. Nous arrosâmes cette bonne gamelle avec deux excellentes bouteilles de pif et hop, nous mîmes les bouts. Nous n'étions qu'à trois stations. Nous jaillîmes hors de la station Pigalle et fonçâmes droit sur l'entrée de la Boule Noire, située juste à côté de la Cigale. Nous nous attendions à trouver une salle pleine. Quelle déception ! Quelques personnes occupaient les bancs en bois situés de chaque côté du parterre. Pour ne pas céder au désenchantement, nous convînmes qu'au moins, les gens présents connaissaient leur affaire. Nous nous trouvions donc parmi les happy few. On pouvait même se laisser aller à éprouver une sorte de petite fierté. Mais qu'allait penser le pauvre Graham Day de tout ça ? Je vis exactement le même spectacle de désolation un soir de novembre 2005 au Nouveau Casino. Il faisait un froid de canard. Brian Auger arriva sur scène et salua un public composé d'environ douze personnes. Il ne cilla pas et remercia les courageux amateurs de s'être déplacés. Il nous expliqua qu'il venait du jazz, que son maître à penser s'appelait Jimmy Smith et soudain, il se pencha sur le clavier de son orgue Hammond et envoya la purée de son shuffle légendaire. On se vit alors tous catapultés en plein swinging London. Shout shabada, baby !
Nous fîmes nos emplettes au bar. Puis nous allâmes nous installer au pied de la scène. Il ne nous restait plus qu'à nous préparer psychologiquement à l'épreuve de la première partie. Une heure à tenir, au fond, ce n'est pas si terrible. Le nom du groupe prévu pour cette première partie n'inspirait pas confiance : les Protokids. En vérité, frères de la côte, je vous le dis, on s'attendait au pire. Du genre du duo immonde qui jouait l'autre soir en première partie de King Khan et BBQ au Gibus.
THE PROTOKIDS
Trois jeunes gens s'installèrent rapidement sur scène. Ils semblaient sortir d'une École Supérieure de Commerce ou d'un truc comme ça. Celui du milieu portait un polo blanc. Une sorte de Gérard Ménez jeune. Avec leurs T-shirts blancs, les deux autres faisaient plus banlieue ouvrière. Une fille s'installa derrière à la batterie, en polo blanc elle aussi, brune, cheveux taillés très courts avec deux mèches très longues effilées par devant les oreilles. Comme les banquettes en bois de la salle évoquaient des vieux souvenirs de salle de bal, on aurait dit un groupe de surboum. J'enfonçai la tête dans les épaules, m'attendant aux pires exactions.

Avec leur premier morceau, les Protokids annoncèrent la couleur : beat soutenu, grosse énergie, harmonies vocales en place, parfaite balance entre les deux guitares et la basse, speed pop musclée, chant bien en place et accrocheur, urgence et montée d'adrénaline, en un mot comme en cent, on retrouvait dans leur petit fourbi sonique tout ce qui faisait le charme des groupes de la scène Mod revival anglaise, ce petit quelque chose bien spécifique à l'Angleterre, qu'on ne retrouvera jamais dans aucun groupe américain : l'énergie, le talent et l'exubérance who-ish, cette pop magique claquée d'accords cristallins et ululée par des chouettes sous amphètes. Étrangement, les Protokids renouaient avec cette tradition cruciale.

On touche là très certainement au point le plus sensible de l'histoire du rock anglais. Les jeunes issus de la classe ouvrière se retrouvaient pleinement dans cette culture et dans cette musique. Dans un bel article sur les early Who au Marquee Club, Mick Farren décrivait l'incroyable tension régnant dans la file d'attente qui remontait jusqu'en haut de Wardour Street. Il comparait cette tension à celle qui règne dans un troupe prête au combat. Tout le monde se souvient du col roulé blanc frappé d'une cocarde tricolore que portait Keith Moon. Et quand on entend un morceau des early Who et qu'on ferme les yeux, que voit-on ? L'Union Jack !

Mais là, on ne voyait pas l'Union Jack, même avec un coup dans le nez. On assistait au set impeccable des Protokids. Ils enchaînaient les morceaux avec une aisance à peine croyable. Le chanteur guitariste prenait des solos courts et incisifs, en roulant sa langue sous la joue, comme un gamin embarrassé. Il n'y avait pas la moindre trace de prétention, dans leur jeu. «Geometric Boy» sonnait comme un petit hymne des rues du West End, on s'attendait à ce que le public reprenne le refrain en chœur, un peu comme dans «Hersham Boys» des Sham. Tension permanente et drumbeat à l'anglaise, rush vespa et virages à fond, éclat des chœurs et refrains mélodiques, tout y était. Ils semblaient aligner des classiques, on pouvait tendre l'oreille pour essayer de reconnaître les morceaux, mais non, apparemment, il n'y avait aucune reprise. Et c'est là où l'étonnement dépassa les bornes pour atteindre l'ombilic des limbes, ils jouaient leurs compos, comme la petite batteuse allait me le confirmer à l'issue du set. Celle-là, je peux bien avouer qu'elle m'a laissé comme deux ronds de flanc. On a parlé des groupes de la scène Mod revival des années 80 et 90, du label Detour et des Purple Hearts. Évidemment, ils étaient en plein dedans. Allan Crockford, coiffé d'un petit chapeau, était juste devant moi. Il devait être très impressionné, car il n'a pas quitté le groupe des yeux pendant tout le set. On était même très inquiets pour les Prime Movers. Allaient-ils oser monter sur scène après une telle démonstration de force ?
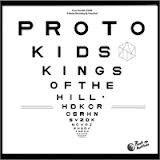
Grimpée sur le banc, Lili ne cachait pas son enthousiasme. La soirée s'annonçait bien et la salle commençait enfin à se remplir. On se contente parfois de peu pour se rassurer.
Voilà pour les Protokids. Prochain concert à la Mécanique Ondulatoire, le 15 juin. Et bientôt en tête d'affiche à l'Hammersmith Odeon (du moins l'espère-t-on). Ils vendaient 5 euros leur premier quarante-cinq tours. Pochette en noir et blanc bardée de pillules. Franchement, leurs morceaux sonnent comme des hits, mais le son du 45 t n'est pas bon. Quelques morceaux traînent sur Internet. Avis aux amateurs. On attend un album avec une impatience non feinte.
THE PRIME MOVERS

Alors qu'Allan Crockford branchait sa basse et que Wolf s'asseyait derrière les fûts et disposait précautionneusement au sol près de lui une bouteille de Ballantine's et deux canettes de bière, Graham Day arriva sur scène avec sa réserve habituelle. Il portait un polo noir. Il entra tout de suite dans la vif du sujet : «The Good Things», pièce pulsative, immodérée, terriblement accrocheuse, solo de wha-wha splashé à la gueule des dieux. Du haut de sa perfide modestie, Graham Day régnait sans partage. Le trio grésillait littéralement d'énergie pulvérisatrice. On palpait la tension. Du coup, on comprenait nettement ce que signifiait le fameux slogan des Solarflares : «Force feeding psychedelic punk chaos to the drooling masses since 1988» (Le groupe qui depuis 1988 gave les foules - comme les oies - de chaos punk psychédélique)

Les Prime Movers n'ont pas des allures de rock stars, loin de là. Graham Day ressemble à un moniteur de sport, Allan Crockford au pilier de comptoir du PMU et Wolf à un touriste bavarois. Mais ils perpétuent la brillante tradition du rock anglais. Abandonnés des dieux, ils ont contre vents et marées enregistré des albums irréprochables, bourrés de garage-rock incendiaire et de hits dignes de Who. Dans les années 80, le freakout des Prisoners n'intéressait plus personne. Ils ont partagé le sort des Flaming Stars et de Gallon Drunk, en sombrant dans les cercles cultissimes de l'underground britannique, alors que des groupes d'une invraisemblable médiocrité se partageaient les premières pages des magazines (on ne citera pas de noms, sauf si vous insistez).

Ils enchaînèrent aussitôt avec «Mary» puis une reprise de Jimi Hendrix, «Freedom» (qu'on trouve sur l'album posthume «Cry Of Love»), transformée en classique soul. Wha-whatée quand même, mais staxée jusqu'à l'os. On croyait entendre Steve Marriott. La voix de Graham Day, soulman mirifique, éclatait au grand jour. C'était assez bouleversant, pour être tout à fait franc. On ne comprendra jamais pourquoi un rocker de cet acabit reste dans l'ombre.

Parmi les grands chanteurs anglais, on cite couramment Rod Stewart, Chris Farlowe, Mike Harrison, Eric Burdon, Reggie King ou Steve Marriott. Bizarrement, on oublie toujours de citer Graham Day. Moddish maudit ?
Son dense et beat turgescent, voilà la règle chez les Prime Movers. Leur son sent bon la brique rouge des faubourgs anglais et le cheveu frangé. Ils n'ont pas d'autre ambition dans la vie que de faire rouler les hanches de leurs fans. Shake your hips ! Ils savent ficeler le stomper de piste de danse qui fera lever tout le monde. Leur son jute comme un gros bouton d'acné percé. Splash ! Droit dans le miroir de l'armoire à pharmacie. Ils réussissent l'exploit de mélanger la tension malsaine des Pretty Things avec le beat dynamité des Who, et de recouvrir tout ça d'harmonies vocales dignes des Hollies. Chez eux, il pleut des accords comme au temps béni des Move. Graham Day puise en permanence des accents toniques dans sa soute. Il connaît toutes les arcanes du r'n'b à l'anglaise, il rallume d'anciens brasiers, ceux qu'allumèrent jadis The Attack, The Creation, The Action, les Who, le Spencer Davis Group ou les fringants Artwoods. Sur scène, il rejoue le destin du rock anglais à la roulette. Il mise tout, tapis direct, car il sait qu'il ne peut pas perdre. Les Prime Movers ont tellement d'allure qu'ils donnent des leçons sans vouloir en donner. Graham Day peut même faire le méchant, mais sans toutefois égaler le génie vocal de Chris Farlowe. «You Want Blood» est une honnête petite bête de l'apocalypse. «You better treat me good», siffle-t-il entre ses dents et son solo coule comme une rivière de miel dans la vallée des plaisirs infinis. Et puis ils ont un sacré point commun avec les Sonics : la faculté d'exploser quand bon leur semble.

Pour les bassistes, le spectacle d'Allan Crockford sur scène est un pur régal. Il se lance pour chaque morceau dans de folles aventures batailleuses, avec un son moelleux, rond et sourd comme une menace. Son de basse idéal, continuellement présent et jamais dans le m'as-tu-vu. Il insuffle au freakout d'énormes doses mélodiques qu'il va tricoter en bas du manche. Sous des airs pépères, il est en perpétuelle ébullition. Il lui arrive même de faire un petit bond au début de certains morceaux. Ce mec est magnifique d'inspiration. Il doit éprouver l'immense fierté d'accompagner Graham Day. Ce groupe pue la cohésion à dix kilomètres à la ronde. Un modèle du genre. Pendant que Graham chante du gras de la glotte, Allan buzze around comme une bête. Quant à Wolf, il peut pétarader le mish-mash de Keith Moon quand il veut, aucun problème de ce côté-là. L'éruption permanente n'a pas de secret pour lui. La source d'énergie nitroglycérique, c'est lui. Mais on le regarde à peine. Sur scène on ne remarque jamais les bons batteurs. On ne voit que les mauvais.

Ils balancèrent aussi «I'm Alive», morceau plus ambitieux, digne de la grande mélasse fatidique des Prisoners, puissant des reins, monté sur un riffage moddish. Graham Day y coula un solo flash d'une infinie beauté boréale.
Et paf, «Love Me Lies» dans les dents. Graham chantait salement, il interférait dans une vieille vague déferlante à coups de gimmicks incendiaires. Il troussa son shake-out pernicieux et prit un solo gras, heavy comme pas deux, gluant et monstrueux.
Un set des Prime Movers peut vous mettre à plat, tellement ça pulse. Exactement comme quand on fréquente une nymphomane. L'aube approche, on y est depuis la veille, on croit qu'elle va enfin se calmer, et hop ! ça repart de plus belle, ça ne s'arrête jamais, elle vous tripote le caoutchouc, vous voulez dormir, mais bon, vous vous laissez faire. Les Prime Movers jouent à ce petit jeu : pas de rémission.

Il y eut quelques morceaux en prime, dont un fabuleux «Begging You», digne du Spencer Davis Group, insolent carrousel lancé à pleine vitesse dans le ciel plombé de Medway. Écœurant de classe, Mod authentique et sauvage, dégoulinant d'adrénaline, Graham Day crachait ses «Begging you» à la face de dieux. Cinquante ans après l'épiphénomène Mod, il réincarnait le mythe avec une éclatante autorité.
On ne peut pas se lasser de sa luxuriante extravagance, de son rock gorgé de purple flashes. Il allie l'ultra-puissance des harmonies vocales à l'imminence de riffs dévastateurs, il mêle l'explosivité des claquages d'accords et des drum-rolls à la suavité poppy des boisseaux de chants perchés. Si HP Lovecraft s'en mêlait, il dirait que ce monstre freakbeat polymorphe promène ses hideuses tentacules sur l'histoire du rock anglais.
Ce bougre de Graham Day est beaucoup trop doué. Il n'appartient pas au commun des mortels. Il étonne par l'affolante fréquence de ses réactions, par l'aspect frénétique de son inventivité, il place des gimmicks un peu partout, dans le moindre recoin, surtout là où personne ne les attend. Ce n'est pas chez les Prime Movers qu'on trouvera un blanc.
Ils mirent le turbo avec «I Am the Fisherman». Ils fonçaient ventre à terre sur une belle ligne de basse, ils ondulaient sous le vent, négociaient les courbes avec grâce, et puis soudain, des gros breaks beatlemaniaques éclataient, suivis de chœurs byrdsiens savamment irisés. On n'avait encore jamais entendu un truc pareil ! Pure sorcellerie.
Graham Day et ses amis nous laissent rêveurs. Perpétuateurs de tradition et hallucinants de véracité, ils ne sombrent pas dans le passéisme mais tendent au contraire vers le modernisme le plus exubérant. Ils vont même jusqu'à nous proposer les morceaux que les Who ont toujours rêvé de composer. Pas mal, pour des relégués.
Le retour au réel fut d'une rare brutalité. Ce n'est jamais simple de descendre d'un nuage. Nous décidâmes de redescendre à pieds pour digérer le plus lentement possible nos émotions, comme le font les gros anacondas de la forêt équatoriale qui viennent d'avaler leur cochon sauvage hebdomadaire. Lili avait adoré le concert. Nous papotâmes tranquillement sans trop chercher à expliquer le divin désordre qui régnait dans nos esprits. Comme elle parvenait à relier ses souvenirs entre eux, ça permettait de bricoler une conclusion de bon aloi. En arrivant à la Trinité, nous étions d'accord : l'esprit saint des Mods anglais nous avait illuminé.
Alors nous grimpâmes ensemble les marches conduisant aux portes de l'imposante église et depuis le perron, nous nous mîmes à haranguer les rares passants : «Prosternez-vous, mes frères car, oui, le jour de Graham Day viendra ! Les populaces du monde entier attendent depuis des siècles la venue de celui qui montrera le chemin droit devant. Vous avez cru pouvoir compter sur Jesus-Christ, puis sur Malcolm X et enfin sur le Che. Mais à chaque fois, des forces obscurantistes intervenaient pour tout gâcher : les Romains, puis la CIA et enfin l'armée bolivienne. Mais rassurez-vous, mes frères, sachez qu'au cœur de l'underground britannique brille l'étoile divine de Graham Day !»
Signé : le facétieux Cazengler
The Prisoners : A Taste of Pink/ The Wisermiserdemelza/ The Last Fourfathers/ In from the Cold.
The Prime Movers : Sins of the Fourfather/ Earth Church/ Ark.
The Solarflares : Psychedelic Tantrum/ That Was Then...And So is This/ Look What I Made Out of My Head/ Laughing Suns.
Graham Day and the Goalers : Soundtrack to the Daily Grind/ Triple Distilled.
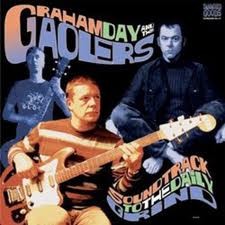
GHOST HIGHWAY
PARIS / BALAJO / 29 - 05 – 2013 /
La Salsote n'est pas parigote, elle ne mouillote et ne trempote point sa patote sur le pavé humide de la capitale, l'a du flair l'est restée au chaud dans sa panière alors que Mister B and Aïe ( ça fait mal ) nous filons dare-dare sur le bitume du onzième arrondissement le dos vouté sous une averse diluvienne. Serait-ce déjà le week-end que tels des chiens mouillés nous fonçons tête baissée vers notre gamelle rock'n'roll hebdomadaire ? Que nenni fidèles lecteurs, à peine trois jours d'écoulés depuis le concert des Ghost Highway de Crépy-en-Valois et nous remettons le couvert. Ce soir nous donnons dans l'acharnement thérapeutique, les Ghost fêtent la sortie de leur nouveau disque au Balajo, le devoir du fan fidèle étant d'être là, nous répondons présents à cette festive invitation.
Un bonheur n'arrive jamais seul. Au détour d'une rue, notre visage s'illumine, une boutique de disques ! Au sec ! Serions-nous nés sous une bonne étoile ? Hélas, Born Bad ! Terrible signe du destin ! Et prestigieux label du rock français. L'on en ressortira tout heureux une demi-heure plus tard tous deux porteurs d'une rare galette vinylique : un Billy Fury pour Mister B et un Little Richard live in Paris for me. Mais nous voici à destination. Rue de Lappe. En réfection, Beyrouth en 1988. Plus de chaussée, plus de trottoirs. Bordée de bars douteux dans lesquels se presse une jeunesse dépravée et assoiffée. La honte de la nation, dans leurs yeux avinés l'on devine qu'ils ne pensent qu'au sexe, aux excitants et aux musiques épicées, mais laissons ce douloureux sujet de côté, ce soir nous avons rendez-vous devant une véritable institution française. Le Balajo.
LE BALAJO
Croyez pas que le Balajo fût simplement le temple de la musack. Sûr à la suite de Jo Privat tous les accordéonistes véreux de la terre se sont donnés rendez-vous en cet endroit, mais admirateurs sans borne de Cliff Gallup et de Grady Martin inclinez-vous. Django Reinhart le père à tous les gratteux d'outre Atlantique fréquentait l'endroit. Plus les mauvais esprits de l'époque, de Louis-Ferdinand Céline à Marcel Aymé. Et Chuck Berry y a joué ! Une réputation des plus franchouillardes, mais une caution rock suffisante pour se sentir libéré de toute compromission !
M'attendais à un espace plus grand, une pièce d'entrée avec bar, vous y mettez au grand maximum cent cinquante personnes debout serrées comme des harengs en caque, la salle de spectacle proprement dite, faussement circulaire, encombrée de tables et de chaises, piste de danse au milieu. Dans un renfoncement est installé le matériel des Ghost. L'on me présente ce que l'on appelle pompeusement le fumoir, un mini-compartiment vitré, un aquarium avec les poisons rouges des bouts incandescents des cigarettes qui scintillent dans la pénombre de la salle.
Vingt heures que l'on nous avait dit. L'on ne nous avait pas précisé que c'était pour le cours de danse. Soixante pékins en couple qui s'essaient à danser le rock. Il est sûr que la nature est injuste et que certains sont moins aidés que d'autres. L'on a dû tomber sur l'atelier des blaireaux apprivoisés. La prof a beau s'époumoner sur son micro, c'est mou de chez mou de veau. Me suis toujours demandé pourquoi de tristes et naïfs individus dont l'âme doucereuse n'a manifestement jamais été dévastée par le big beat s'obstinent à vouloir apprendre à danser le rock. Expliquez-moi Docteur Rock les funestes raisons de cette pathologique addiction à une danse qui ne leur ressemble pas ? Terrible impression que certains confondent danse de saloon à la Peckinpah et danse de salon de tantine Ernestine...
Le monde arrive, la salle se remplit peu à peu mais sûrement. La kyrielle des fans habituels mais au grand complet, le club de danse qui ne hisse pas les voiles, et un public d'inconnus attirés par le bouche à oreilles. Au bas mots plus de cinq cents personnes. Des têtes connues, Eddie des Ol' Bry, Jean William Thoury, Tony Marlow et bien d'autres. Jull nous renseigne : une demi-heure du tour de chant habituel – discussion serrée sur le choix des morceaux – une demi-heure de pose et l'album en entier en deuxième partie.
PREMIERE PARTIE
Dès que Turky arrête la musique et annonce les Ghost c'est la ruée vers la scène. Les places sont chères surtout qu'un grand nombre de petits malins stationnent en premières lignes depuis longtemps. Dommage pour Phil qui s'est commandé un superbe costume de lin blanc coupe fifty, l'est tout beau dedans, en impose à la galerie, l'a de l'allure et de la prestance, mais relégué tout au fond l'on n'aperçoit plus que sa figure de temps en temps.
Zio se retrouve pratiquement au centre Jull légèrement en avant sur notre gauche et Arno plus à droite mais beaucoup plus avancé. Nos quatre baroudeurs ont réussi à adopter une position en quinconce ! N'ont pas dû se mettre d'accord car ils vont y passer une bonne partie du répertoire habituel. Une bonne heure. La foule remue et rugit de plaisir à chaque intro.

Du chaloupé ( mais du cat réussi ), Arno entonne la majorité des titres. Est en forme, la voix merveilleusement posée et bien en place. Balance aussi salement à l'harmonica. Lorsque Jull prend la rythmique pour Country Heroes, silence dans la salle, Zio ne touche plus ses cordes et soudain je réalise combien ce soir, tout comme le dimanche précédent, il est l'ossature dorsale du groupe. Dès le dernier sifflotement de Phil et l'extinction du miaulement de l'harmo d'Arno, Zio redémarre et le son prend une nouvelle ampleur. Faut avouer qu'ils bénéficient d'une sono parfaite, réglée au millimètre près.
Jull est sur la réserve. Surveille le beat, maîtrise le balancement syncopé très particulier qui définit toute une partie reconnaissable et inimitable du son des Ghost. Ca tangue dans le public. Sous extase. Au fond de la salle il y a encore des couples qui continuent leurs exercices de danse. Entre nous soit dit, feraient mieux d'arrêter leur gymnastique et d'écouter de toutes leurs oreilles pour tenter de saisir dans leur comprenette l'essence du rock'n'roll. Mais il n'est de pire sourd que celui qui ne sait pas écouter.
DEUXIEME PARTIE
Les Ghost remontent sur scène. C'est à croire que tout le monde connaît déjà par coeur les titres du nouvel album car très vite la salle reprend les refrains et réclame des titres précis. Nouveauté, les Ghost ont amené un piano sur scène, l'était dévolu à Jean-Pierre Cardot, mais il n'a pu se libérer, Arno le remplace. N'a pas choisi le plus facile, Crazy Arms de Jerry Lou, s'en sort bien malgré un faux départ. Sa voix imite les inflexions si caractéristiques du Killer, les Ghost ont modulé la tonalité, avec de tendres échos de nostalgie country et derrière Phil adopte un battement tout en souplesse moins pesant que la version de l'homme de Ferriday enregistrée pour Mercury.

Saute tout de suite sur Cause I forgot, un original des Ghost, ballade chantée par Jull appelée à jouer dans le répertoire le même rôle que Country Heroes toujours attendu et salué dans les concerts. Un titre à la hauteur de Hank William III, tout comme les trois autres composés par le groupe qui s'insèrent sans problème dans la nomenclature habituelle. Mais je vous renvoie à l'analyse du CD ci-dessous.

Filoche à cent à l'heure. Difficile de ne pas se laisser emporter par la suite ininterrompue des titres et de se livrer à une analyse plus objective que l'enthousiasme soulevé par la magie du live et le contentement de la foule qui applaudit et hurle à tout rompre. Le son n'est plus exactement le même. Les reprises sont retravaillées à la sauce Ghost, les élèves sont en train de revoir la leçon des maîtres pour en fournir des relectures plus savantes. Les nouvelles compos utilisent la guitare d'une autre manière. Elle ne sert plus de faire valoir à la mouture des morceaux, elle n'est plus le riff ponctuateur qui partage les eaux de la rythmique. Elle devient l'assise du morceau sur laquelle se greffent les autres instruments. Renversement hégélien de la structure de base. Les Ghost opèrent une redéfinition de leurs modes opératoires.

Mais la salle s'en fout et s'en contrefout. Elle est subjuguée et emportée par la marée musicale. Ne repartiront pas comme cela. Brouhaha de satisfaction qui ne demande qu'à être encore comblée. Devront encore se fendre du rappel habituel. Termineront totalement défaits sur Goin'up to the Country. Z'ont raison après un tel triomphe il est temps de retourner à la maison. En partant je récupère un flyer sur une table. Les Ghost Highway au Gibus en novembre prochain. Le groupe qui monte.
Damie Chad.
( Images prises sur la chaîne You Tube de chrisdixie1 qui fime la plupart des concerts auxquels RK'TNT assiste et qui propose des centaines de vidéos )
CROCKROCKDISC
GHOST HIGHWAY / BACK ON THE ROAD
Hey Miss Fannie / Hunter / Warm Love / Crazy Arms / Nervous Wolfman / Born To Love One Woman / Thunderstorms & Neon Signs / Female Hercules / Black Slacks / Teenage Heaven / She Said I Love You Baby / Cause I forgot / Whenever You're Ready / I'm Ready / Gone Ridin'.
Arno ( Vocals, guitar, piano, harmonica ) / Jull ( Vocals & lead guitar ) / Zio ( Bass ) / Phil ( Drums ) + guests : Jean-Pierre Cardot : piano on 8 & Jacques Gavard : guitar on 7 & 8.
BLR Studio / Rock Paradise / Rockers Kultur
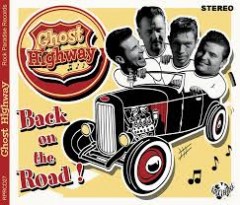
Indéniablement un bel objet. Unité esthétique de la pochette, recto, intérieur, verso et CD lui-même. Pour l'originalité du dessin, un hot Rod avec les quatre têtes découpées, je ne crierai pas au génie. Un peu trop classique, un peu trop attendu. Mais l'on ne juge pas un disque sur sa pochette, faut écouter avant tout.
Quinze morceaux. Certains déjà au répertoire depuis longtemps, d'autres nouveaux mais déjà entendues sur scène, des compos originales signées par tous les membres du groupe et des reprises inédites si je peux me permettre cette incongruité sémantique.
Hey Miss Fannie une reprise de 1952 des Clovers groupe noir de doo wop qui connut son heure de gloire lorsque Ahmet Ertegun les signa sur label Atlantic.( Rappelons que c'est en hommage à Ertegun que Led Zeppelin se reforma en 2007 ). Belle introduction, le piano bastringue et la guitare ont remplacé le sax des Clovers, le morceau sonne beaucoup moins rhythm'n'blues mais beaucoup plus honky tonk comme si les Ghost s'ingéniait à le faire remonter plus haut dans les racines de ses origines.
Hunter : cent pour cent Ghost, le son syncopé allié à des solo de guitare très électrique et à chaque fois on refile le bébé au vacillement de base. Une réussite, l'équilibre idéal entre l'ancien et le nouveau.
Warm Love : démo des frères Burnette de 1957, vais me faire des ennemis mais la version des Ghost me paraît supérieure à celle de la Burnette family, soli de guitare plus appuyés vocaux davantage ancrés dans la chair du hit, un peu trop virevoltants sur la démo. Une véritable recréation.
Crazy Arms : l'on ne présente plus la référence absolue la cover Sun ultime de Jerry Lee Lewis ( qui l'enregistra maintes fois ). Le piano et la voix de Jerry Lee font toute la différence avec les versions qui précédèrent sa propre reprise. Les Ghost s'amusent à y coller au plus près, jeu dangereux que celui de se rapprocher du son original du studio miracle. Jull se fait discret si ce n'est deux ébrouements de cordes qui ne dépassent pas quatre secondes laissant toute la place au piano et au chant d'Arno qui s'en tire très bien. Très beau travail à la rythmique de Zio et de Phil. Belle carte de visite à tous ceux qui auraient envie de remettre en cause la légitimité de la prétention à l'authenticité des Ghost.
Nervous Wolfman : contraste total avec le précédent, la guitare de Jull prend sa revanche soutenue par l'harmonica d'Arno, rythmique d'enfer sur une base blues. Une des plus belles réalisations du disque qui montre l'étendue du registre du groupe. Très rentre dedans. Trace sa route sans se préoccuper du paysage.
Born to Love One Woman : ( maigre programme ) écrit et enregistré en 1956 par Don Johnston mais surtout connue par la version de Ric Cartey de 1957. Les Ghost y rajoutent une voix et une guitare bondissantes qui dynamisent le morceau sans rien trahir de l'original. Retour au roots.
Thunderstone & Neon Signs : de Wayne Hancock que les Ghost affectionnent, né en 1965 et grand ami de Hank Williams III créateur de Country Heroes – nous sommes bien dans la même nébuleuse d'influence revendiquée. Indolence sudiste le morceau s'étire paresseusement, la guitare fait des bulles, ont évité l'accent nasillard de l'original, vous l'avez compris ce n'est pas mon morceau préféré.
Female Hercules de Bill Carslile yodeleur bondissant et chanteur country qui l'enregistra en 1954, les Ghost nous rejouent la même partition fidélité à l'esprit de l'original mais son survitaminé
Black Slacks, vieille paire de pantalons noirs qu'Arno enfile avec délectation à chaque concert produit par les Sparklestones en 1957, a tellement de plaisir à le chanter qu'il le dynamite de l'intérieur, par contre le découplement de la batterie opérée au milieu du morceau par les Sparklestones qui sonne un peu comme un solo des Blue Caps m'agrée davantage.
Teenage Heaven : pas un des morceaux les plus connus d'Eddie Cochran, difficile d'égaler la voix ample et grave d'Eddie, le solo de sax est remplacé par un piano à la Fats Domino, relecture intéressante mais l'apport essentiel me semble résider dans les dernières notes de guitare, c'est sans doute par là qu'il aurait fallu commencer en électrisant davantage le morceau.
She Said I love you baby : ce qu'ils font très bien sur l'original suivant avec une voix qui court en avant et qui s'étire comme une barre d'acier au laminoir. Très bon, avec ce hurlement de Jull en plein milieu.
Cause I forgot : le fameux numéro 12 qui dans les conversations se détache déjà. Un original dans la continuité du morceau précédent, très beau chant de Jull accompagné d'un super galop d'orchestre par derrière. Paroles d'une folle mélancolie. Idéal pour les passages radios.
Whenever You're Ready : écrite par Dorsey Burnette en 1956, un peu trop gentillette à mon goût, les Ghost en ont préservé l'aspect insouciant et adolescent en rajoutant une touche de coquinerie dans la voix qui sauve le morceau de sa fadeur initiale, un solo de guitare qui pousse le bouchon encore plus loin et Zio et Phil qui balancent comme des diables..
I'm ready : un morceau pour guitariste, c'est Hank Cochran qui chante encore un peu trop hillbilly et d'Eddie Cochran qui gretsche ses parties comme fou, Jull prend son pied à envoyer le morceau d'une seule traite alternant solos de guitare et inflation de la voix dans une optique davantage cochranesque.
Gone Ridin que l'on trouvait en 1984 sur le premier 33 tours de Chris Isaak, démonstration de guitare, urgence / éloignement / résurgence, à chacun de faire défiler ses propres images sur un tel scénario de base. La guitare de Jull emporte tout, à l'inverse de Chris Isaak il ne découpe pas le morceaux en plusieurs séquences, se lance dans une grande fuite en avant électrique. Les Ghost n'ont jamais sonné si fort.
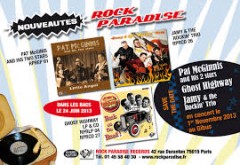
Tout ça ce n'est que de la dissection de cadavre. Coupez votre téléphone, fermez votre porte à clef, éloignez les âmes sensibles, sortez votre meilleur cigare, votre vintage bourbon, et poussez la sono ou le phono à fond. Offrez-vos quinze heures d'écoute sybaritique, passez et repassez chaque plage au moins vingt fois de suite et prenez votre pied à admirer le travail. Ce CD est un coffret de pierres précieuses dont vous allez savourer les teintes rares et les limpidités cristallines. Les Ghost ne refilent pas du toc. Les morceaux défilent et miroitent de toutes leurs subtilités. Un son d'une clarté absolu, l'on dirait qu'ils sont en train d'enregistrer dans la pièce à côté.
Les Ghost Highway sont un grand groupe. Non pas parce qu'ils répètent l'histoire du rockabilly qu'ils connaissent par coeur, mais parce qu'ils possèdent l'intelligence des nuances et qu'ils sont en train d'inventer un nouveau chemin pour ce style de musique. Ni copie conforme, ni psychobilly, ni wild, ni surfin, ni punkabilly, sont engagés sur une route des plus surprenantes. La galette est encore chaude que déjà l'on tire des plans sur la comète en imaginant ce que sera leur prochain disque. Ce Back on the Road soyons-en sûrs fera le bonheur du public mais ouvrira bien des débats chez les musicos, car la problématique du futur du rockabilly n'a jamais été aussi bien posée en France. Indispensable.
Damie Chad.
LA CALE SECHE / 31 – 05 – 2013
LUCKY GAMBLERS
La Cale Sèche, drôle de nom pour un rade où en toute innocence l'on entre pour s'arroser le palais de boissons capiteuses. De toutes les manières j'avais promis aux Lucky Gamblers de les revoir en concert, alors sèche ou pas, la teuf-teuf mobile ( pas bête à tout hasard elle a fait le plein avant de prendre la route ) me dépose à proximité de la rue des Panoyaux en plein Paname à Ménilmontant.
Première soirée printanière, les cafés et les locaux associatifs regorgent de monde, l'assistance déborde sur les trottoirs, pas de mal à repérer l'entrée de la Cale Sèche. Pas vraiment étroit mais pas large non plus. Le matos des Lucky est coincé dans le prolongement du bar et une espèce de cuisine ouverte. Une grosse marmite vaporise sur le feu. Affiche des Washington Dead Cats sur les murs, sur internet le lieu est catalogué dans la catégorie des bar-punk. Avec les punks faut se méfier, ils ont dû capturer un touriste japonais et le faire cuire à petits feux et gros flocons dans le chaudron communautaire. Hélas, la réalité est toujours au-dessous du mythe, à regarder le menu et à voir le cuistot remplir consciencieusement des saladiers, je dois déchanter, il semble que la spécialité de la maison soit le potage aux légumes. Beurk ! Comme chez votre grand-mère. Les japs peuvent se radiner tranquilles, n'ont pas de sushi à se faire. Quant à moi, je saute le plat principal et commande le café tout de suite. Désolé mais les rockers si vous leur enlevez le sandwich au cuisseau d'alligator...
En attendant le moulin est plein comme une huître, majorité d'étudiants qui discutent de leurs partiels. Qui très vite se révèleront n'être pas venus là par hasard. Les Lucky Gamblers possèdent apparemment leur public de fans. Le patron arbore un T-shirt des Pogues, ce qui ne l'empêche pas d'aller à 20 heures trente tapantes chercher séance tenante nos trois lascars qui discutent avec les copines sur le trottoir. L'anarchie oui, mais contrôlée.
THE LUCKY GAMBLERS

Pour les amplis, presque des transistors. Les fils grouillent sur le plancher emmêlés comme des scoubidous, derrière leur trois micros les Gamblers essaient de ne pas s'y prendre les pieds. Sont trop proches l'un de l'autre, mais on les sent à l'aise et heureux d'être là. Donnent un concert très différent de celui mis en oeuvre à Tournan-en-Brie ( voir KRTNT 137 du 28 – 03 – 13 ). Pas du tout le même son que sur le plateau de l'association Fortunella. Du coup les guitares d'Arnaud et d'Alexis sonneront malgré leur amplification beaucoup plus comme des sèches. En parfaite harmonie avec cette Cale peu humidifiée.

Ce qui est loin d'être désagréable mais qui change l'atmosphère des morceaux. Le premier set sonnera moins country qu'au pays briard, The House of the Rising Sun de par ses lourdes harmonies et sa gradation finale obtenue par le seul secours des choeurs nous plongera carrément dans une atmosphère très country blues. L'impression sera d'autant plus forte que François laisse filer sa partie de basse aux abonnés absents. On l'attendait avec sa double white bass mais il ne sent pas encore prêt de faire le saut et continue sur son électrique.

Sont méchamment applaudis à chaque fin de morceau et vivement encouragés pendant les chorus et les solos. Mais le meilleur de la prestation c'est quand Arnaud et Alexis rivalisent d'ardeur sur leur cordes. Ce qui arrive souvent. Ne se piquent pas les plans mais se poussent l'un l'autre à aller plus avant. Nous sortent une première compo pas piquée des hannetons dans le droit fil de l'ambiance qu'ils ont sue créer. Nous offrent aussi un Hurt de toute beauté, caschienne en diable et émouvante.

La séquence ne dépassera pas les trois quart d'heures. Trop peu. Trente minutes d'entracte à tirer la clope sur le devant du bar et à prendre des photos avec les amis. Les Lucky Gamblers sont sollicités de tous côtés. Rires, embrassades, amitiés. Rappel à l'ordre, du même qui regarde sa montre aux soutiers qui comprennent qu'il est temps de rentrer la marchandise dans la cale.

Un passager clandestin dans l'équipage. Arnaud et François ne sont pas encore dans la mâture. Un grand garçon châtain à la barbe veloutée s'est emparé du micro, et Alexis le présente comme un membre de son autre groupe. N'ai pas pu saisir son prénom dans les cris des spectateurs, mais je peux certifier qu'il possède une super voix, entre vieux bluesman alcoolisé et la râpe de Tony Joe White, n'est pas godiche non plus à la guitare avec laquelle il s'accompagne pour un second morceau. S'éclipse à la fin de sa chanson comme s'il espérait que personne ne l'ait remarqué... Raté.

Le deuxième set, encore plus court que la première partie sera d'une autre obédience. Musique plus nerveuse et vocaux plus incisifs. Des compos personnelles que l'on sent très électriques dans leur conception. Chaleur artique. Du jeté-frappé sans concession. A chaque fois c'est l'ovation. Lucky Gamblers nous dévoile une autre face de son image. Alexis parvient à unir ces deux facettes un peu antithétiques grâce à l'énergie vocale qu'il déploie, plus rauque et sombre quand il aborde le côté roots du répertoire et beaucoup plus entaché d'un phrasé british pour les morceaux originaux. Je ne sais s'ils en sont conscients mais les Lucky Gamblers tentent de faire couler en un même lit la boue alluvionnaire du Mississippi avec les brumes de la Sheaf. Rude travail en perspective.

Au terme de cette deuxième vision Les Joueurs Chanceux nous ont dévoilé un aspect de leur projet peu mis en valeur à Tournan. Qui suscite intérêt et attention. Il n'y a pas que le rockabilly pur et dur dans la vie. A suivre.
THE END
Dans la véranda du fond les amateurs de potage ont dû finir de laper leur écuelle car l'on fait signe au groupe de terminer au plus vite. Un rappel et c'est fini. Dix heures vingt-cinq. Est-ce une heure pour terminer un concert ? J'avais cru en avoir jusqu'à deux heures du matin. Mais l'on est déjà à fond de Cale.
Faute de mieux, je rejoins la teuf-teuf mobile. Ne tombe pas en panne sèche, elle.
( photos prises sur le facebook des Gamblers )
Damie Chad.
VILLENEUVE SAINT GEORGEs
/ 01 – 06 – 13 /
4 TH ROCK THE JOINT
HOT JUMPING SIX
DALE ROCKA & HIS VOLCANOES
GONER, GONER, GONER
Désolé mais lorsque je suis arrivé les Wild Goners étaient en train de signer leur 45 tours au bas de l'estrade. Vous vous doutez que ce n'est pas de ma faute, que c'est la teuf-teuf mobile qui sans m'en avertir a emprunté un mauvais embranchement sur le parcours, l'a fallu toute ma science autoroutière pour réparer les dégâts, des Wild Goners je ne dirai donc rien si ce n'est cette phrase « Les Wild Goners, ne sont pas wild, mais très rockabilly tout de même. » de Steve Rydell à qui j'achetais sa dernière production, le troisième tome de sa série Rockabilly Queens consacrée à Little Lou. Vous le chroniquerai, la semaine prochaine.
HOT JUMPING SIX

Viennent de loin, d'Allemagne, originaires de Berlin, la veille ils étaient en concert à Fribourg et les voici à Villeneuve Saint George. Y aurait de quoi former deux groupes de rockabilly tellement ils sont nombreux. Non pas six mais sept. Un orchestre de rhythm & blues. Joey le chanteur est au micro, un peu freluquet quant on le confronte à l'imposante stature de Maltze qui tient entre ses bras de géant un énorme saxophone baryton. Comme il souffle dans le modèle au-dessous, un simple saxophone ténor, Stefan n'est ni aussi grand ni aussi costaud. Guitare à notre droite, contrebasse sur la gauche, piano et batterie sont au troisième rang, point trop visibles.

L'ensemble déménage sec. Ambiance orchestre de bal des années quarante-cinquante. Retranché derrière son piano Sascha joue le monsieur Loyal, il annonce les morceaux avec une voix de publicitaire prêt à vous faire passer sa belle-mère pour Miss Monde et relance la machine par une formule choc du genre Here, we go ! Et ça repart pas au quart de tour, mais avec trois secondes de retard, le temps que Joey indique le tempo à ses camarades.

Faut du temps pour saisir les interventions de Dieter à la guitare, très concises mais indispensables à la gestion des morceaux. Au début question cordes l'on ne saisit que celles de Sasha sur sa basse. Une antiquité, toute noire, qui essaie d'imiter la forme de la guitare de Johnny Cash, écaillée de partout. En voici une qui a dû rouler sa basse dans tous les combos de la création. Son propriétaire n'a pas la beauté de la Venus de Milo, par contre il tricote allègrement de ses deux bras et de ses deux mains. Un concerto pour harpe et ouragan.

Les sax fournissent le bruit de fond et de front. Maltze se sert de son baryton comme d'une trompe tibétaine en pilotage automatique. Ne porte pas le groupe, il le pousse par devant de son souffle puissant d'éléphant en rut. Véritable joueur de Hamelin qui emporte le public à sa suite. Ne croyez pas qu'il se charge de tout le boulot. Stefan ne reste pas sur le bord de la route. Pique de ces solos à vous faire pâlir d'envie. Changera par deux fois de hanche qu'il rejette sur le plancher l'air mi-désabusé, mi-furieux. S'entendent comme des larrons en foire. Toujours un cuivre au feu. Ca pulse et ça éructe de tous les côtés.

Le miracle dans cette purée de poix c'est que Sascha parvienne à intervalle réguliers à délivrer quelques broutades de piano honky tonk qui ont pour seule fonction, non pas d'apaiser la fusion, mais au contraire de précipiter la fission. N'en oubliez pas pour autant Thomas le batteur, joue serré, au plus près des coupures rythmiques, le même rôle que la guitare, presque en retrait mais indispensable quant à l'architecture de l'ensemble.

Joey se débrouille bien au chant, un peu trop dans le style white rock des années soixante, je lui reprocherai sa voix justement un peu trop trop blanche, trop lisse, pas assez noire et râpeuse. N'empêche qu'il mène le set de main de maître et que le band captive l'attention d'un public qui à la base n'est point trop porté vers ce style de musique. L'on en redemanderait encore mais les bonnes choses ont toute une fin. Les recroiserai dans l'inter-set, le masque de la fatigue est sur leur visage. Ils ont tout donné et rien repris.

( photos prises sur leur facebook de plusieurs concerts précédents )

DALE ROCKA AND HIS WILD VOLCANOES

One, two, three, c'est... Trop tard vous avez raté le train. L'est déjà parti. Chez Dale Roka and his wild Volcanoes, il n'y a pas de fumeroles pour vous avertir de la future éruption. Irruption dans le bop sans crier gare. Ces italiens ils valent à eux quatre l'Etna, le Vésuve et le Stomboli. Ne s'arrêtent jamais. Enchaînent les morceaux comme vous les Jack Daniels à l'apéro. Des fous furieux, il est bien connu que l'on n'a jamais vu un rital s'arrêter à un feu rouge.

Le set n'a pas commencé depuis deux minutes que brusquement les cinq premiers rangs des spectateurs s'écroulent d'un seul coup. Non ce ne sont pas les gradins ( y en n' a pas ) ni le vide sanitaire qui vient de s'affaisser, seulement les trois cordistes qui nous font un plan à la Blue Caps, style poster réclame couleur pour les nouveaux kits de guitare Fender. Poses à la clapper boy, clin d'oeil à Tony Facenda, et le château de cartes se relève en une seconde et c'est reparti comme un piqué de spitfires. Au grand dépit des porteurs de portables qui ont raté la photo de la soirée. Ne le referont que deux fois au cours du set.

N'y a que Giovanni qui depuis sa batterie n'a pas participé à la fête. Est occupé ailleurs. En règle générale un batteur de rockab qui se respecte travaille quasi-exclusivement sur sa caisse claire, avec de temps en temps un coup sur la cymbale pour amortir les frais de son achat. Le Giovanni y frappe dessus comme un madurle sur son clairet, à croire qu'il voudrait tanner la peau de bison qu'il viendrait d'abattre d'un seul coup de baguette sur la tête. Mais c'est là un travail d'appoint. Doit être un adepte de la boxe française car lui il joue en premier lieu avec les pieds. Savates et tatanes sur la grosse caisse. Grêles de coups de bélier ininterrompue. Frappe continue. Concassage sempiternel. Quatre cents pulsations à la minute. Pas de répit. Pas de pitié. Drumming au marteau-pilon. Estampage maison. Sans façon. Tape comme une brute de décoffrage. Grosse Bertha à tir tendu. Missile tomahawk à domicile dans vos oreilles. Le train entre gare mais ne s'arrête pas.

Luca a laissé la banane sur le régime, crâne rasé et gueule d'intello trop malin pour laisser filer le TGV. Arbore une contrebasse deux fois plus large que lui, un bahut aux planches cirés de près, une mastodonte qui a dû couler des jours pépères dans un orchestre symphonique et qui est venu s'encanailler chez les rockers. Doit regretter le bon vieux temps car Luca lui tire sur les cordes comme lorsque l'on étripe un chat. Et puis il lui fait le coup Haley les gars – une larme pour Marshall Lytle qui vient de casser sa pipe – s'y allonge dessus, pendant que Massimo écarte les jambes pour jouer au petit train qui passe sur le viaduc, s'y posent dessus à deux, à trois, assis, debout, couchés, toutes les positions de la saine émulation virile de rockers en goguette qui s'amusent.

Gratte et chant Massimo donne le maximum. Parfois il se casse en deux et saute en arrière comme s'il était brutalement victime d'une crise cardiaque. L'on pense qu'il va s'effondrer définitivement sous nos yeux, mais non il se redresse tel un phénix et se porte en avant pour mordre le micro. Méchant. Vous fait tout ce que vous voulez, du Billy Lee Riley, du Billy Fury, du Flyin' Saucers

. Même pas besoin de demander. Vous sert le plateau repas, cuisson à l'étouffé et canard au sang. Apparemment sa maman ne lui a jamais appris que l'on ne trépigne pas sur place comme un enfant gâté qui veut la meilleure part du gâteau.

Sont infatigables. Ne savent pas ce que c'est qu'un mid-tempo. La lente prégnance hypnotique du blues ce n'est pas leur truc. Sont plutôt pour la morsure mamba. Faites gaffe au guitariste. Pas démonstratif, mais le rôle du second couteau qui vous en plante un entre les deux yeux et un autre dans le dos. Lorsqu'il hisse le drapeau blanc de sa mitraillette contrapunctique ce n'est pas pour une trêve et signer l'armistice. Vous lance des accords aussi redoutables que des étoiles de ninja en fureur. Pas du genre à vous jouer une symphonie lorsque deux coups de nunchaku vous règlent la situation en deux secondes.
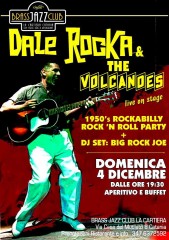
Ca fait un moment que l'orga tente des signaux désespérés le nez sur leur o clock, les Volcanoes foncent en prenant soin de ne pas les remarquer. Au bout d'une demi heure, ils font signe, ok ! ils terminent dans deux minutes. Enchaînent donc coup sur coup huit morceaux sur le même tempo de fous furieux et lorsqu'ils s'arrêtent... reviennent illico pour un rappel transcendantal.
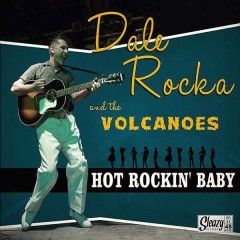
Descendent enfin de scène le dos voûté tels des vieillards asthmatiques qui entament leur dernière marche vers le cimetière communal. N'ont plus de jus. Ont laissé leurs instruments à terre qui gisent-là comme des poupées brisées... Lorsqu'un forcené dans le public réclame une dose finale, tout le monde s'écarte, à l'impossible nul n'est tenu... Maintenant je sais pourquoi la Tour de Pise est penchée, Dale Rocka and his Volcanoes ont dû donner un concert devant.
Les malheureux n'ont pas un seul disque à vendre. Z'en auraient fourgué quatre cartons. M'en fous, Mister B possède la collection complète de leurs 45 tours. Regrette déjà de ne pas être venu. Lot de consolation, Dale Rockers and His Volcanoes préparent un 33 tours. Vinyl, bien sûr. Ils ne donnent pas dans le simili vintage. Pure Wild Rockabilly !
( photos prises sur leur facebook de plusieurs concerts précédents )
Damie Chad.
01:13 | Lien permanent | Commentaires (0)