16/01/2014
KR'TNT ! ¤ 172. HOWLIN' JAWS / OL' BRY / JOE FOSTER / MARILYN MANSON /
KR'TNT ! ¤ 172
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
16 / 01 / 2014
|
HOWLIN' JAWS / OL' BRY / JOE FOSTER MARILYN MANSON |
12 – 01 – 14
L'ALIMENTATION GENERALE / PARIS
OL' BRY / HOWLIN'JAWS

Pas vu les Ol' Bry depuis le mois de mars et les Howlin' Jaws depuis avril, Doktor Rock m'a confirmé qu'un rappel était nécessaire, comme pour la malaria et le typhus, faut s'inoculer le microbe au plus vite, sinon l'étiolement nous guette, et la faucheuse se rapproche. D'ailleurs pourquoi ai-je raté les Howlin' en décembre ? Parce que j'étais au lit tout tremblant de fièvre. M'en suis sorti de justesse avec trois jours de perfusion rock à gros débit. Donc l'excuse du dimanche soir et du boulot tôt le lendemain matin, ne saurait tenir. La teuf-teuf mobile a compris que ma vie était en jeu, Mister B n'en revient pas, alors que toutes les places de stationnement sont systématiquement occupées sur des kilomètres de trottoirs, elle nous déniche un emplacement sur lequel on alignerait sans difficulté trois trente-huit tonnes, à deux cents mètres de l'Alimentation Générale.
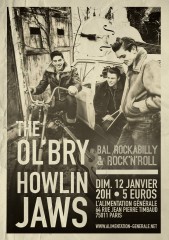
N'y a pas à se tromper d'éléphant. De l'extérieur, avec ses deux vitrines et les boiseries vintage d'époque d'après-guerre ( la première ! ) L'Alimentation Générale se présente comme une antique épicerie de détails, d'avant l'invasion des grandes surfaces. N'ont même pas changé le nom sur le fronton. L'ont gardé et adopté. Parfum rétro-bobo assuré, et gratuit. Petit hall d'accueil, cinq euros l'entrée, toujours le dimanche soir, nous apprend la sympathique ticketeuse.
Grande salle. Beaucoup de piliers et peu de tables. Sur votre droite un comptoir de quinze mètres de long. A gauche, ils ont vu beaucoup plus riquiqui pour la scène. Futurs musiciens postulants, faites un jeûne de trois semaines avant de vous risquez dessus, avec son trois mètres cinquante fillette, vous ne disposerez que d'un espace vital très limité. Mais le pire, c'est la déco. Z'auraient pu tout repeindre en rose bonbon ou en jaune canari, voire prêter les murs à une moyenne section d'école maternelle. Z'ont préféré, une espèce de géométrisation de formes simples ( rectangles + ronds ) style tapisserie design dans le style des années 70. Un gris-bleu d'une tristesse à vous faire prendre un alignement de tombes cimentées dans un cimetière de banlieue pour une toile de Matisse.

Bon, je ne suis pas ici pour vous faire suivre un cours d'art-déco. A huit heures pas un chat, à part les musicos attablés, le temps de dire bonjour et l'on part se faire un grec. Expression ô combien malheureuse quand on pense à la Grèce d'aujourd'hui – l'antique Hellade pour laquelle un Lord Byron ( un sacré rocker ) n'a pas hésité à sacrifier sa vie - rançonnée par le FMI et dépouillée par nos banques bien aimées. A neuf heures c'est rempli de jeunes et d'étudiants – beaucoup d'étudiantes en Erasmus - une majorité d'habitués pas spécialement fanatiques de rockabilly, mais venus là pour prendre du bon temps. Vont être servis. Chaud.
THE OL'BRY

Les Ol' Bry tentent de monter sur scène. Difficile, marchent sur des oeufs. Les instrus à eux tout seuls, c'est déjà un peu juste. Et comme les musiciens se présentent à cinq, il faut se serrer sur l'étagère. Mais vont vite nous faire oublier le confinement qui les étreint.
Eddie allume le feu, se projette comme un fou sur le Slipin' and Slidin' de Little Richard. Voix tonitruante avec derrière le combo qui pète le feu. Le sax de Rémy n'est pas assez en avant, faut le chercher, et c'est dommage car il souffle bien. Il en sera de même durant les premiers morceaux, jusqu'au Going Home de Gene Vincent où à la technique l'on comprendra enfin que le vieux rhymth and blues des familles sans cuivre, c'est un peu comme le coq au vin sans Bourgogne.
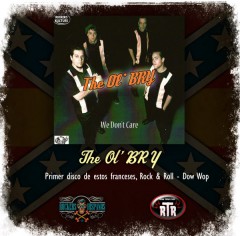
Mais je m'avance un peu, et je ne voudrais pas vous induire en erreur. Les Ol' Bry – c'est connu de tout le monde – sont célèbres parmi les combos de rockab actuels pour être celui qui a su inclure dans son son des relents frénétiques de Doo Wop, mais ce soir il apparaît nettement que le groupe a accentué son côté rockabilly. Moins de suavité dans la voix, le hoquet remplace l'onctuosité. D'autre part, dès le second morceau Eddie sort son arme maîtresse. Le groupe ne se contente pas de reprises. La moitié des titres du répertoire, comme le She Don't Care qu'il annonce, sont des compositions originales, entrecoupés d'hommages remémoratifs à des classiques du rock'n'roll et du rhythm an blues, ils ne déparent en rien la qualité de l'ensemble.
Mister B me souffle à l'oreille que le travail de Thierry sur sa contrebasse est souverain. L'est sûr qu'il bénéficie d'une retransmission technique sans faille mais c'est le swing à l'arrache qui fait toute la différence. Les cordes ronronnent comme des élastiques tendues à l'excès et toutes les intros et tous les ponts sont portés par ces vibrations qui s'entremêlent comme un noeud de serpents.
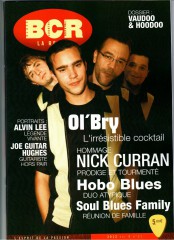
Eddie balance tellement que sur My Babe il casse une corde de sa rythmique, ce qui ne l'empêche pas de marquer avec une égale férocité le tempo. Le vieux blues de Willie Dixon écrit par Dixon pour Little Walter l'harmoniciste de Muddy Waters. Cette adaptation prend ici tout son sens, My Babe provient d'un gospel traditionnel notamment repris par Sister Rosetta Tharpe et reformulé par Buddy Holly sous le titre Not Fade Away. Jeu de passe habituel entre les racines noires et blanches du rock'n'roll. Crossroad.

Un Unchained my Heart, beau grain de gorge mister Eddie, ça râpe et ça fond, en même temps. Les demoiselles se trémoussent de plaisir devant la scène, ensorcelées, completely strolled. Ghost Highway en hommage amical aux Ghosts, et plus tard la reprise de Cause I forgot, en l'honneur de Mister Jull perdu dans la foule, pas besoin de monter sur l'estrade, Eddie reproduit à merveille le timbre de Jull.
L'hidalgo, derrière sa Squier Fender, c'est Diego, gravidad espanola sur le visage qui ne s'éclaire que rarement d'un sourire énigmatique lorsqu'il vous a piqué un petit solo dans le coeur, tiene dedos de oro, s'est dépris de toutes les fioritures latines qui enjolivaient son jeu au printemps dernier en faveur d'un phrasé beaucoup plus rêche et incisif, l'efficacité rock. L'enchaîne les morceaux sans s'attarder. Eddie a tout juste le temps de s'éponger la figure s'il ne veut pas prendre le train en marche. L'a laissé tomber sa chemise depuis longtemps, marcel et tatouage, il mène la danse sans faillir.

Rémy le sax et Marcelo le batteur ne chôment pas. Sont en croisade exponentielle. Plus le show avance plus ils envoient la pression, Rémy est en souffle continu, exhale une note ronde cuivrée comme une coulée de miel et Marcelo se livre à un incessant ballet, ne marque pas vraiment le beat, joue des séquences rythmiques avec introduction, suites et salut final. Faut voir comment il ponctue ses petites saynètes. Prestance et élégance.
Le taulier vient rompre le charme, encore dix minutes et ce sera tout. Eddie parvient à caser tout de même trois derniers morceaux. Nous quitteront sur un dernier Let me Dance endiablé, très boogie. Une compo. Pas de rappel, juste le temps de promettre un super set des Howlin' qui vont suivre. Descendent de scène sous les applaudissements d'un public ravi qui en reprendrait encore trois bonnes louches avec avidité. C'étaient The Ol' Bry-llants.
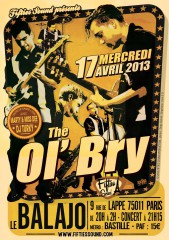
THE HOWLIN' JAWS
Sont déjà sur scène. Des crocs à rayer le plancher. N'ont pas branché leurs instruments que l'on sent l'électricité dans l'air. L'envie d'en découdre. Formation minimale. Trio, batterie, basse et guitare. Pas besoin de plus. Commando rock. Comme par miracle le public s'est épaissi. Pour le moment, ils sont penchés l'un vers l'autre, leurs silhouettes dessine comme un oeuf de tyranosaurus prêt à éclore. Une ogive nucléaire dont ils sont en train d'enclencher le compte à rebours.
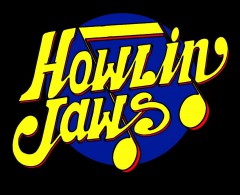
Sont polis, se présentent : « Bonjour, nous sommes les Howlin' Jaws », sont gentils car ils détestent vous prendre en traître. Leur premier morceau s'intitulera Danger. Ce sont les deux seules qualités que nous leur reconnaîtrons, car pour le reste, tout le reste, ils sont méchamment rock'n'roll. Si vous n'aimez pas, rentrez chez vous, fermez la porte à clef, fourrez-vous sous le lit, et attendez que le tsunami rock soit passé. Personne ne peut rien faire pour vous. Les chevaliers de l'apocalypse sont insensibles à la pitié. Côté sono, l'on s'affole un peu. Le sonorisateur est un peu trop cartésien : « Si la guitare jouait moins fort, l'on entendrait mieux la basse ». Ne pige pas les équations à entrées multiples, les Howlin' ne recherchent pas l'équilibre des fluides. Veulent que la guitare soit très forte et que la basse soit aussi très forte. Bien sûr, ça fait du bruit, mais c'est ce que l'on appelle le rock'n'roll. Sinon l'on jouerait du folk en acoustique. Et Djivan vous caresse les cordes de sa contrebasse d'un air dégoûté. Deux ou trois tâtonnements, et c'est réglé. Au maximum syndical. D'après moi l'on pourrait faire mieux. Mais l'on a évité le pire. Et puis le rock, c'est le son mais aussi l'énergie, et les Jaws en ont à revendre des tonnes. Sixteen exactement.

Donc danger. Sur toute la ligne. Djivan le grand est à la contrebasse. La tient un peu de guingois car il est hors de question que le manche vienne se balader devant sa figure quand il chante. Ce qui est sûr, c'est que dans le couple qu'il forme avec sa doublebass c'est Djivan qui est le dominant. Ne s'en laisse pas compter par une gonzesse. Rocker jusqu'au bout du slap. La voix s'est affermie, a pris une belle plasticité, ne patauge plus dans le yaourt, découpe les syllabes, elle est un serpent mamba qui épouse les sinuosités de la branche sur laquelle il s'est enroulé. N'attend plus que vous passez à proximité pour vous inoculer la mort sûre à dose létale. Djivan est habité par une indolence naturelle. Le serein détachement du chat qui regarde le spectacle du monde d'un air amusé. Malheur à vous qui vous apprêtiez à le caresser, c'est un tigre royal altéré de sang, qui bondit sur sa proie toutes griffes ensanglantées dehors. Ce garçon charmeur est dangereux. Dans la vie de tous les jours il doit parvenir à donner le change, mais une fois dans son groupe de rock, le fauve est lâché.

Donc péril. En la demeure. L'oeil bleu et le cheveu blond. Allure apollinienne. Lucas ne nous jette même pas un regard. Trop occupé par sa gratte. Sait s'en servir. A parfait son jeu depuis le printemps. L'était très bon. L'est devenu lui. N'aligne plus les plans. Est beaucoup plus libre. Souverain. Le seul à savoir où il va, et l'on suit les yeux fermés. Connaît de fameux raccourcis. Vous mène où il veut. Il frappe les cordes comme des étincelles de silex. Ne vous laisse jamais en paix. Pose hiératique, mais aux quatrième morceau ses mèches savamment peignés en arrière retombent de partout et forment comme une couronne de broussaille. Casque d'or, c'est ainsi que devait être Alexandre lorsqu'il menait la charge à Arbéles, cisèle des arabesques d'une élégance incomparable aussi brûlantes et ravageuses qu'un lance-flammes, tranchantes comme des sabres de samouraï. L'ivoire aiguisée des mâchoires, c'est lui. Grondement de train qui passe devant vous et vous laisse dans la stupeur de votre étonnement sur le quai désert. L'est déjà loin dans un somptueux bouquet de notes qui giclent de partout et vous traversent le corps comme des abeilles de braise.
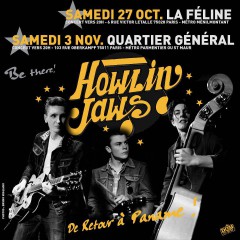
Donc pièges. Tout autour de vous. L'on ne le voit pas tout de suite. Comme tous les batteurs Crash Boum Hue, se bat derrière dans l'ombre. La frappe n'est pas lourde. Mais rapide. Ultra véloce. Avec les deux régiments de hussard qui caracolent devant sur sa droite et sa gauche, n'a pas intérêt à se laisser distancer. N'a pas le droit de laisser un espace vide par où l'énergie pourrait s'échapper. Fait la navette de l'un à l'autre tout en poursuivant son propre but. N'a pas le privilège d'être en retard. Pousse de temps en temps le vice jusqu'à être en avance, à leur ouvrir le chemin, à dégager le terrain à coups de nitro. Roulement de claquements secs, l'on a l'impression qu'il met la pédale douce sur un temps de suspension, mais c'est pour mieux laisser à ses deux acolytes l'opportunité de s'engouffrer ensemble dans la brèche qu'il vient d'ouvrir. Et il reprend son rythme infernal. La phalange au pas de course qui bloque toutes les issues de secours et qui interdit de retourner en arrière. Cours ou crève. Sans lui pas d'assise. Plus il tape, plus il s'aperçoit de la nécessité absolue de sa présence. L'en jubile. La joie irradie son sourire. A la fin il n'en peut plus, déborde d'euphorie, joue debout, et monte sur sa batterie.
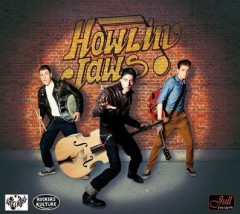
Les Howlin' culbutent le vieux rockab des familles. Lui foutent le feu au cul. Et le grand-père n'a pas l'air d'être mécontent de ce traitement de choc. S'en porterait même comme un charme. S'y prennent bien. Un tiers-temps rockab pour débuter, et un autre trente-trois pour cent du même acabit pour terminer. Attention ne donnent pas dans la reconstitution vintage. A chaque fois le pépé prend une sacrée dose de speed dans les rotules. De quoi dépoussiérer les oreilles et le plancher. Ca pète le feu dans les carburateurs. De quoi rendre les puristes du bon vieux temps un peu mi-figue, mi-raisin. C'est entre ces deux séquences – pas du tout radio-nostalgie - que ça se gâte. Pour tante Agathe. Qui pleure ses vingt ans. Qui ne reviendront pas. C'est qu'entre l'intro et la conclusion, ça dégénère sec. Les Howlin' ne sont pas à la recherche du temps perdu. Leur madeleine elle est terriblement électrique. Pas tout à fait psycho. Pas tout à fait garage. Mais foutrement rock'n'roll !
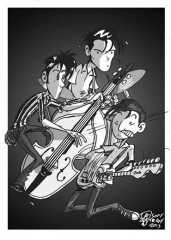
Déterrent les racines. Mais pas pour les regarder s'étioler au travers du verre protecteur d'une serre stérilisée dans l'air confiné des vieux souvenirs. Les ont transplantées dans la jungle du vivant. Un peu de terre de jeunesse, un peu de délire survitaminé, un peu de la violence du monde, et les surgeons d'un new-rockabilly pointent dru, débordant de sève et de vigueur. N'ont aucun regret. Le rock'n'roll n'est pas une plante qui se sent à l'aise dans les cimetières. Les Howlin' Jaws poussent à la roue. Ils ont tout compris.
RETOUR
Super concert. Discussion dans le fumoir. Comme un sas de sécurité, avant de replonger dans le magma des jours grisâtres. Merci les Ol' Bry. Merci les Howlin' Jaws.
Damie Chad.
( Les photos prises sur le Facebook des artistes ne correspondent pas à ce concert )
JOE FOSTER
FOSTER PUSSYCAT kILL ! KILL !
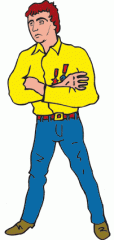
Le seul moyen de dénicher de l’info sur Joe Foster, c’est de suivre Alan McGee à la trace.
McGee fonda le label Creation au début des années quatre-vingt. Sur Creation, on trouvait le gratin du rock anglais : Primal Scream, les Boo Radleys, House Of Love, Teenage Fanclub, Ride, Nikki Sudden, les Bounty Hunters, Felt et bien sûr Oasis. La découverte d’Oasis fit de McGee un homme riche. Trop petit pour pouvoir gérer le succès commercial d’Oasis, il revendit Creation à Sony pour quelques millions de livres et il devint membre de la jet-set anglaise. Comme le font généralement les parvenus balzaciens, il ne put résister à l’envie de se mêler de politique et il entraîna Noel Gallagher dans les cercles du pouvoir, époque Tony Blair, l’une des périodes les plus fastes de l’histoire de l’hypocrisie politique à l’anglaise.
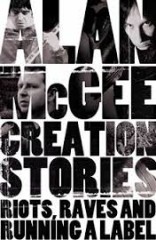
McGee raconte tout le détail de ses aventures dans «Creation Stories - Riots, Raves and Running A Label». Son autobiographie se casse en deux, comme celle de Johnny Cash : on a une première moitié absolument passionnante, émaillée de rencontres avec des personnages fascinants et enrichie de tout le détail d’une consommation de drogues pantagruélique, puis break et seconde partie pépère où il ne se passe plus rien d’intéressant.
Le break, c’est la cure de désintox. McGee et Johnny Cash passent tous les deux à la casserole et ça finit mal - Cash découvre Dieu et McGee le coca allégé. Ils se mettent alors à délirer comme des beaufs sur la grande beauté de leurs résidences et de leurs relations sentimentales respectives, et - pour Johnny Cash - sur la rareté de la maladie dont il était atteint et qui semblait faire sa fierté. Quand McGee fait son break, c’est-à-dire la petite dépression post-désintox qui va le conduire à l’abstinence de fait - celle que dicte la morale - il est tellement fier de cette déprime qu’il nous en tartine plusieurs pages, et c’est assez choquant car ça n’a strictement aucun intérêt. Comme dirait mon amie la rose, faire étalage de ses déprimes, c’est manquer singulièrement d’élégance.
McGee est un petit mec originaire de Glasgow. Roucmoute et laid comme un pou, il a la chance d’avoir des copains comme Bobby Gillespie et Robert ‘Throb’ Young. Et la malchance d’avoir un père qui vient lui taper sur la gueule en pleine nuit, alors qu’il est en train de dormir. Ce qui l’autorise à dire qu’après ça, on ne craint plus rien ni personne. Dans son livre, McGee se bâtit donc une réputation de graine de violence. Mais quand on voit sa bouille, on se dit qu’il ne devait pas impressionner grand monde, à part la concierge de l’immeuble. Il aurait fait un excellent personnage de fable pour La Fontaine.

Pendant la première partie de son livre, il roule sa caisse, et dans la seconde partie, il bat tous les records d’arrogance. Il se vante de tout un tas de conneries, comme par exemple d’avoir invité Bill Clinton chez lui et d’avoir rencontré Michael Jackson dans un jet. Il se vante même d’être devenu l’ami d’un McLaren qui mettait un point d’honneur à ne jamais payer une note au restaurant. Un boutiquier reste un boutiquier. Et chez McGee le parvenu, on retrouve tout ce qui chez un type comme Dave Grohl finit par donner la nausée. Quand on vient du monde magique des Mary Chain et de Primal Scream, on traîne théoriquement une sorte de parfum de légende, ce qui devrait induire une certaine tenue. Qu’on se rassure, le pauvre McGee n’a pas que des défauts, loin de là. Pourquoi Creation est devenu l’un des plus gros labels de l’histoire du rock anglais ? Tout simplement parce que McGee avait du flair.

Si vous cherchez des anecdotes croustillantes sur Jesus & The Mary Chain, alors il faut absolument lire ce livre. McGee rappelle qu’on doit la découverte des Mary Chain à Bobby Gillespie qui récupéra tout à fait par hasard une cassette sur laquelle se trouvaient des démos des frères Reid. Et crac, Bobby craqua. Il envoya les Mary Chain chez McGee qui venait d’ouvrir un club à Londres. McGee raconte leur arrivée au club : «Avec leur allure complètement débraillée, ces punk-rockers d’East Kilbride arrivaient six ans trop tard. Les frères Reid étaient la version punk des Bay City Rollers.» McGee décrit dans le détail le premier concert des Mary Chain à Londres - Jim & William Reid, Douglas Hart (bass) et Murray Dalglish (drums). Ils n’avaient jamais joué sur scène auparavant et William Reid ne savait pas régler son ampli. Derrière la console se trouvait Joe Foster lui aussi parfaitement incapable de régler une sono. Résultat : le niveau de feedback battait tous les records. C’était intolérable. Et le problème s’aggravait de morceau en morceau. Voilà comment naquit la légende du sonic storm des Mary Chain. Ils allaient faire du chaos sonique - trouvaille accidentelle - leur fonds de commerce. Bobby prit la place de Murray Dalglish à la batterie et McGee devint leur manager : «Je les comparais aux Sex Pistols et je me prenais pour Malcolm McLaren. Je voulais générer du cash à partir du chaos.» (Il semble assez fier d’avoir réussi à recycler le fameux «cash from chaos».)
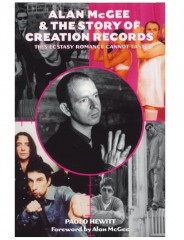
Grâce à McGee, on entre dans la loge des frères Reid, on les entend bougonner à longueur de temps, puis on les voit monter sur scène pour des sets violemment écourtés qui se terminent systématiquement en grosses shootes. (Lors d’un concert à l’Élysée Montmartre, Jim Reid envoya son pied de micro en fonte dans la gueule d’un type qui se trouvait au premier rang. Le pauvre malheureux fut aussitôt évacué sur un brancard - typical Mary Chain). L’une des anecdotes les plus succulentes du chapitre Mary Chain est celle de The Old Grey Whistle Test : les producteurs de la célèbre émission de télé invitèrent les Mary Chain à venir enregistrer leur morceau à onze heures du matin. Comme ça, ils étaient certains de les voir sobres. C’était fort mal connaître les frères Reid qui se levèrent à six heures pour aller s’arsouiller et arriver au studio complètement ivres. McGee : «Le groupe avait l’esprit punk et il régnait à leurs concerts une atmosphère de violence qui avait disparu depuis des années, en Angleterre. Plus les concerts étaient importants, plus la tension montait. Les Mary Chain arrivaient en retard sur scène. Ils agressaient aussitôt le public. Ils disaient aux gens de fermer leur gueule et d’aller se faire enculer. Ils les traitaient de branleurs. Cerise sur la gâteau, ils jouaient très peu de temps.»
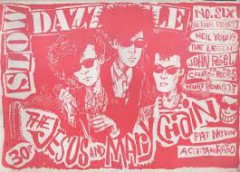
McGee fréquentait aussi les Primal Scream qui sont restés longtemps dans le peloton de tête des Shooting Stars à l’anglaise. Ils prenaient de tout, de l’héro, du crack et de la cocaïne : «Avec les drogues, les Primal Scream se comportaient exactement comme les Stones : au grand jour et dans la démesure - champagne, cocaïne, héro.» À l’époque où ils enregistraient «Give Out But Don’t Give Up», les Primal Scream étaient pour ainsi dire paralysés par les excès. Ils s’enfermaient des mois entiers en studio et s’envoyaient en l’air. Jimmy Miller qui les produisait mourut d’une petite cirrhose très peu de temps après ces fameuses sessions. «Ce ne sont pas les Primal Scream qui l’ont tué, mais ça n’a pas arrangé les choses.» Comme les sessions d’enregistrement ne donnaient rien, McGee eut la riche idée de les envoyer à Memphis, histoire de les éloigner de leurs dealers et de Candem, où ils étaient censés enregistrer. «Le premier type qu’ils ont rencontré était un chauffeur de taxi qui dealait de la coke. Quand je suis arrivé, ils prenaient cette coke, certainement la plus forte qui devait exister au monde. J’en ai pris une ligne ou deux et je suis resté collé debout contre un mur à Memphis pendant trois jours pour être sûr que personne ne se glissait derrière moi.» Comme ils n’avaient rien produit en dix-huit mois, les Primal Scream finirent par comprendre qu’il fallait arrêter les conneries. «Alors ils ont arrêté l’héro et ils sont devenus alcooliques.»

Dans Primal Scream, le personnage qui impressionne le plus McGee, c’est bien sûr Robert ‘Throb’ Young : «Il était le cœur palpitant du groupe. Il tirait sans doute son assurance de la grosseur de ses attributs.» Throb était l’un de ces purs rockers à l’anglaise, ceux qui jouent sur Les Paul et qui sortent un gros son. Il voyait plus Primal Scream comme des New York Dolls écossais et il fut hostile au virage acid house pris par le groupe pour «Screamadelica». Il détestait tellement cet album qu’il menaça cent fois de quitter le groupe. Mais bizarrement, il est resté.
Grâce à Throb, McGee fit un spectaculaire bad trip lors d’un voyage aérien : «L’hôtesse me demandait si j’avais pris de l’acide. Je voulais lui dire : ‘J’ai sniffé une ligne de coke aussi longue et aussi large que l’avant-bras de Robert Young’. Mais je ne l’ai pas fait.»
Très beaux portraits aussi d’Andrew Innes («Il a toujours été un bâtard cynique») et de Lawrence («Le premier album que Lawrence a enregistré pour moi était un truc de dingue : que des instrumentaux joués à l’orgue par Martin Duffy qui rejoignit Primal Scream plus tard.»)
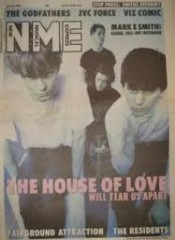
Clins d’yeux au Teenage Fanclub et à Guy Chadwick des House Of Love. Si on espère trouver dans ce livre des potins sur Oasis, c’est raté. McGee reste étonnamment discret sur les frères Gallagher, comme s’il avait peur de se faire casser la gueule.
Dès les premières pages, McGee fait l’éloge des Television Personalities. Il n’hésite pas à écrire qu’ils ont changé sa vie : «C’était en mars 1982, un concert Rough Trade. Quel set ! Il y avait une douzaine de copains à eux près de la scène. Ils portaient des costumes, têtaient des fume-cigarettes et se faisaient passer pour des aristocrates. Ed Ball jouait de la basse et Dan Treacy de la guitare. Joe Foster est monté sur scène pour chanter ‘Part Time Punk’ puis il a scié en deux la Rickenbacker de Dan Treacy, une guitare qui devait valoir au moins mille livres !»
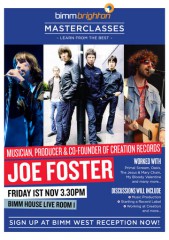
McGee allait ensuite embaucher Ed Ball et Joe Foster pour travailler chez Creation. Joe Foster sera aussi dans le bus, pour la première tournée des Mary Chain. «Joe Foster se prenait toujours pour Bob Dylan et il y avait une grosse consommation de speed dans ce bus. On faisait passer ça avec de la vodka polonaise.» D’après McGee, Joe Foster était un érudit des sixties. «Il connaissait les noms de tous les membres des Artwoods. Vous pouviez lui demander quel était le titre de la face B d’un single des Creation sorti uniquement en Allemagne, il vous répondait aussitôt. C’est lui qui m’a fait écouter le Velvet et les Byrds, et expliqué en quoi David Crosby était un compositeur de grand talent.» C’est la raison pour laquelle McGee va confier les clés de Rev-Ola, sa filiale de rééditions, à l’ami Joe. Tous les amateurs éclairés connaissent bien le fabuleux catalogue Rev-Ola.

Mais Joe Foster devint incontrôlable assez vite. II prenait trop de speed et il avait le coup de poing facile. Apparemment c’était le genre de mec qui ne discutait pas. Il fallait que ça parte. Un jour, il en colla une belle dans le museau du responsable du réseau de distribution Rough Trade. McGee trouva qu’il avait dépassé les bornes. Il demanda à Joe de faire un break. Le break dura sept ans.
McGee est tellement prétentieux qu’il se croit encore plus cinglé que Joe Foster. «Je fais partie du très petit nombre de gens qui peuvent gérer sa folie. Certaines personnes pensent que je suis encore plus cinglé que Joe - c’est horrible. J’espère qu’ils se trompent.»
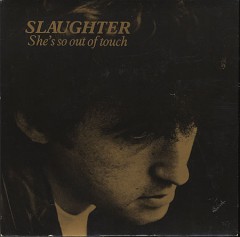
Existe-t-il un lien entre Joe Foster le boxeur fou et Slaughter Joe, son pseudo de rocker ? Au niveau punch, certainement. Pour preuve, cette fantastique anthologie sortie en 2003 sur Rev-Ola : «Zé Do Caixao. The Complete Creation & Kaleidoscope Recordings». Sur la pochette, Joe Foster a un faux air de Souchon, alors que sur les rares photos de son passage dans les Television Personalities, il a un petit côté Besancenot.
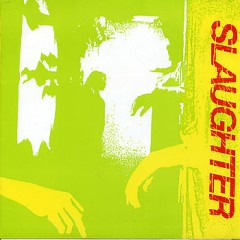
Au dos de la pochette de cette anthologie, on trouve un hommage signé Kim Fowley. Rien de moins. Joe et Kim se sont rencontrés lors de l’enregistrement de «Hidden Agenda» avec les BMX Bandits. Dès qu’il veut tout savoir sur les nouvelles tendances, Kim Fowley appelle Joe Foster. Pour Kim, Joe est le Sam Phillips, le Leonard Chess et même le Lee Hazlewood des temps modernes. Pour Kim, Joe est le grand spécialiste du garage anglais. Joe était à Detroit et on retrouve son histoire mêlée à celle d’Outrageous Cherry et d’Electric Six. Joe est une mine. Joe est partout. Il est aux origines de Jesus & the Mary Chain. Joe est aux sources de l’art-riot incarné par Brian Jonestown Massacre, Black Dice et BRMC. On parle ici de decadent feedback, de teenage riot et d’amplified dischord, de Pussy Galore, des Dirtbombs et des Butthole Surfers, de Dylan et de Nikki Sudden.
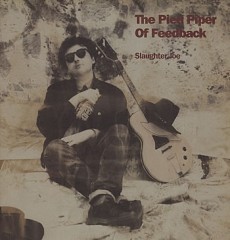
Quand on commence à écouter «Zé Do Caixao», on se fait tout de suite harponner par «Positively Something Wild», un morceau absolument monstrueux, ultra-dynamique, emmené par une basse qui fend l’eau comme un cuirassé. Slaughter Joe a tout compris. Il est classique jusqu’au bout des ongles. On comprend que Mick Collins et Kim Fowley tapent du pied en entendant ce fouillis de guitares hurlantes. Tout y est, rythme d’enfer et solo maigrichon doublé de Farfisa, maelström incompréhensible, vache à lait de tous les mythes du rock, pureté aérienne, hallucinant solo de guitare résumeur de toutes les punky-motions, absolue nécessité de l’urgence. Slaughter Joe envoie sa basse voyager. Le son est plein comme un œuf, comme chez Mick Farren. Les guitares pleurent des larmes de sang. «I Know You Rider» qui suit est un joli clin d’œil aux Byrds. Au moins, Slaughter Joe sait faire sonner une basse ! Le trois est une reprise du Thirteen Floor Elevator, «Fire Engine». Joe tape dans le royaume étoilé du psyché texan. «Sally Go Round the Roses» qui suit est un vieux hit daté de 63 des Jaynetts, un girl-group originaire du Bronx. Ça psychette d’entrée de jeu. On voit même rôder le fantôme de Syd Barrett. Des nappes de guitare acidulées flottent dans l’air épais. Joe chante à nouveau du nez, comme son idole Dylan. Joe est le trésor caché du rock anglais. Avec «If I Die Before I Wake», on retrouve le bon vieux Diddley beat. La basse radine sa fraise. C’est le meilleur son de basse de tous les temps. Basse voyageuse, idéale pour ce genre de groove harcelant. Joe glapit et ça lui va bien. La pulsation est irrésistible. Du bon gros Bo, mais gonflé à l’extrême, rond et plein d’une fermeté enviable. Joe s’y promène comme d’autres se promènent sur les remparts de Varsovie. Il connaît toutes les arcanes des Byrds, de Syd Barrett, de Bo Diddley, de Roky Erickson, de Bob Dylan, il boit à toutes les sources en même temps. Il travaille exactement au même niveau que Kim Fowley. «Napalm Girl», c’est Dylan dans le garage des Mary Chain. Effet sidérant. Slaughter Joe a exactement la même énergie et la même classe que le Dylan de 1965. C’est d’une fluidité et d’une perfection absolument écœurantes. Dylan et les frères Reid, quel bon mélange ! Il fallait y penser. Les petits Jesus sont ce qui est arrivé de mieux à la vieille Angleterre, avec les Pretty Things et les Sex Pistols. C’est une bonne chose que Slaughter Joe se retrouve dans cette triangulation. Il pointe le cœur de l’ouragan. Joe sait comment doit sonner une guitare. Il sait qu’elle doit cracher son venin et hurler sa douleur.

Et puis voilà «Tangerine». Et là, Joe se met à sonner comme le Dave Clark Five, son son s’envole tout seul. Il ramène à la surface toute la vitalité de la pop underground, Paul Revere & The Raiders et tout ce qu’on voudra. C’est trié sur le volet. Slaughter Joe fait exactement comme Nick Kent et Kim Fowley, il réinvente l’histoire du rock.
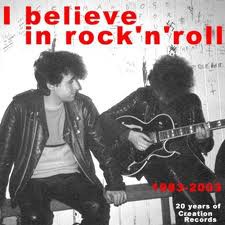
S’ensuit «The Lonesome Death Of Thurston Moore». Joe balance des cris splendides. Le morceau bascule dans une sorte de folie. En réalité, Joe Foster amplifie les effets qu’avait inventés Dylan. Et toujours cette basse fascinante, noyée sous des nappes épuisées de réverb. Un son comme on n’en voit plus guère de nos jours. Joe est un mec qui peut tout se permettre. On finit par voir en lui une sorte de caméléon super-naturel. Ça finit même par devenir inquiétant. Il n’est pas logique qu’un mec aussi brillant soit passé à la trappe. Ou c’est une conjuration, ou c’est un déni de justice. «I’ll Follow You Down» est probablement le grand classique de Joe. Voilà encore du pur Mary Chain. D’horribles guitares se mettent en branle. Le morceau noircit comme un ciel d’orage. D’hirsutes mécaniques de garage psyché rampent de chaque côté de la voix - Hey ! I’ll follow you down ! - On entre là dans un monde de pureté garage, avec un son tendu, serré, dangereux, moite, mortellement raide. C’est le soundtrack d’une catastrophe imminente, et Joe vous balance un solo d’harmonica digne de Van Morrison. On comprend que Kim Fowley soit tombé de sa chaise à ce moment précis. «Surely Some of Slaughters Blues» nous ramène chez Bob Dylan. C’est plutôt une bonne chose. Si on osait, on dirait que cet album est l’album caché de Bob Dylan. Tout y est, la puissance des compos, les orgies sonores, l’inventivité des temps modernes, la touche de génie, la frénésie, l’envie d’en découdre, la morsure du destin. «She’s So Out Of Touch» suit de très près et nous plonge dans le Velvet. Comme par miracle. Joe sort exactement le même son que celui de «Some Velvet Morning», avec les touches de xylophone. L’animal chanterait presque comme Lou Reed. Hallucinante symbiose. C’est à ne pas croire. Rien ne peut échapper à Joe Foster. Son tableau de chasse laisse rêveur. Il est constamment dans le vrai. Il ne touche qu’à ce qui est bon.
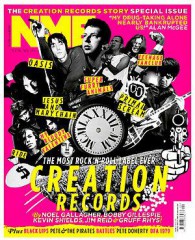
À part cette anthologie, il n’existe pas grand chose de Joe Foster sur le marché. Le seul album des Television Personalities auquel il participa fut «Painted Word». Fabuleux album bourré de petites pépites pop inspirées soit du Velvet, soit de Dylan. Ils réussissent le prodige de faire sonner «Stop And Smell The Roses» comme «All Tomorrow’s Parties», avec les accents gothiques de la voix de Nico. «A Sense Of Belonging» est une merveille digne des grandes heures de Dylan. «Say You Won’t Cry» revient aux atmosphères altérées du psyché délicat, finement teinté de gothique à la Nico et mêlé d’accents acides dignes des Byrds. Dan Treacy et Joe Foster n’avaient pas besoin de raconter leur vie. Il suffisait d’écouter leurs chansons pour savoir quels disques ils écoutaient. On trouve sur la face B une petite merveille de pop musclée intitulée «You’ll Have The Scream Louder», montée sur une ligne de basse entreprenante, ronde et présente, qui rebondit à chaque temps, parfois grêlée de notes doublées, fabuleusement souple, un modèle dynamique digne des grandes lignes de basse de Keith Richards. «Happy All The Time» est une féerie décadente mélodiquement parfaite et doublée d’accords incroyablement acides. Tout l’acid-rock londonien est là - I wish I was happy all of the time/ In my mind. L’autre grosse pièce de l’album est un nouveau clin d’œil appuyé au Velvet qui s’appelle «Back To Vietnam». Ils chantent ça à deux voix sur un riff répétitif qui évoque «Sister Ray» et qui renvoie, par l’acidulé du jeu des guitares, au puissant «Eight Miles High» des Byrds. En plein dans le mille. Long et beau comme du white heat velveto-byrdsien.
Signé : Cazengler, fosterisé du ciboulot
Alan McGee. Creation Stories - Riots, Raves and Running A Label. Sidwick &Jackson 2013
Slaughter Joe. Zé Do Caixao. The Complete Creation & Kaleidoscope Recordings. Rev-Ola 2003
Television Personalities. The Painted Word. Illuminated Records 1984
MARILYN MANSON
( + neil strauss )
MEMOIRES DE L'ENFER
( Traduction de Gilles Vaugeois )
( DENOEL X-Trême / Mars 2003 )
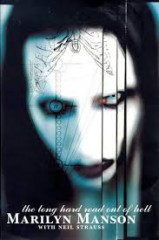
Plus de trois ans que le book séchait sur l'étagère musique de mon bouquiniste préféré. Trouvai toujours autre chose de plus intéressant à prendre. Marilyn Manson, je n'avais rien contre. Rien pour, non plus. Ma fille possédait un de ces CD... qu'elle écoutait dans sa chambre. Une anecdote plutôt sympathique à son sujet d'un ami pas du tout branché rock qui avait vu le film-enquête Bowling for Colombine de Michaël Moore. Deux lycéens qui avaient massacré au fusil semi-automatique douze de leurs condisciples et un professeur. L'était un peu choqué le copain : « De toutes les personnes interrogées tout le long du film, je n'en ai trouvé que deux qui tenaient des propos sensés, un flic très critique par rapport au rôle social de la police et de la justice, et un gars dont je n'ai pas retenu le nom, il était présenté comme un chanteur de rock – tu dois connaître, il porte un prénom de fille - qui a été l'unique intervenant qui ne se soit pas livré à un laïus bien-pensant sur les méfaits de la délinquance, mais qui s'est contenté de dire que l'on aurait mieux fait de s'inquiéter de ces meurtriers avant qu'ils ne passent à l'acte. »
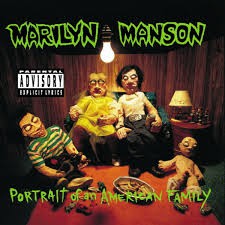
Comme il n'y avait rien d'intéressant sur le rayonnage, je l'ai pris pour les longues soirées d'hiver. Comme nous étions au mois de décembre, me suis dévoué. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse ! Surpris, m'attendais à un truc commercial torché à la va-vite pour les fans, beaucoup de photos, des déclarations à l'emporte-pièce et une mise en page éclatée pour occuper un maximum d'espace avec un minimum de bla-bla. Ben, non ! C'était un livre, un vrai, quelques illustrations, quelques reproductions de documents, et beaucoup de textes en petits caractères. Mais j'en reparlerai.
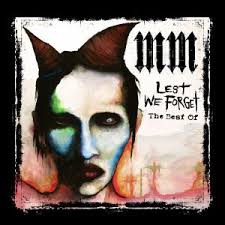
Mémoires de l'Enfer. Titre flon-flon. Frères croyants, je regrette de vous décevoir mais je vous avertis qu'en parfait mécréant, je n'ai jamais davantage cru au méchant Diable qu'au Bon Dieu. Je veux bien admettre que le grand cornu montre un peu sa protubérance dans le fameux croisement de Robert Johnson, et un tantinet sa patte griffue sur le volant du hot-rod de Race With The Devil de Gene Vincent, mais déjà avec les Rolling Stones il vous adresse un sourire des plus sympathiques, et dans la myriade des Hot Rails to Hell des groupes de heavy-rock, l'évocation de ce personnage de carton-pâte est un prétexte à d'homériques glissandos de guitares ultra-speedées et jouissives, l'a beau s'égosiller qu'il maudit votre pomme jusqu'au trognon, vous avez du mal à le prendre au sérieux.
Mais ne plaisantons plus. Ne confondons pas l'Enfer avec son supposé propriétaire. Marylin Monroe parle de cette indésirable contrée au même titre qu'Arthur Rimbaud qui y séjourna toute une saison. C'est que notre starlette rockeuse ne s'aventure pas plus que le père Rimbe dans les demeures infernales de Belzébuth. En voici deux qui ont tout compris. Et qui assument, n'accusent point les copains comme Jean-Paul Sartre qui déclarera que l'Enfer c'est les autres... Vont nous décliner leur enfer sous toutes les coutures. Encore que dans le bled paumé de son Ardennes natales, l'Enfer de Rimbaud reste légèrement étriqué. Tout se passe surtout dans sa tête. Au-dehors, ce n'est ni la foule, ni la joie. Quelques bocks de bière à la terrasse des cafés à zieuter les filles interdites et quelques cigarettes de hachich les jours de chance, tout cela ne va pas chercher bien loin. La poésie sera son refuge, la chanson de sa plus haute tour. Marilyn est nettement mieux loti. L'Amérique est immense et peuplée d'une foule de décavés et interlope... Sans compter les progrès techniques accumulés depuis un siècle... Quand on pense que Rimbaud ne possédait même pas un tourne-disque pour écouter Alice Cooper ! Ne vous demandez pas pourquoi il a si mal tourné.
LE CHRIST ROI

Né en 69 dans une famille américaine moyenne. L'enfer, autrement dit. Ne grattez point le vernis de surface. Sous les écailles la chair est beaucoup plus putréfiée que l'on aurait imaginé. Le père est un vétéran du Vietnam. La guerre ne l'a pas arrangé. L'a mis un couvercle sur ses cauchemars mais dessous la marmite est en ébullition. Le grand-père paternel est plus propre sur lui. Passe son temps à bricoler son circuit de train électrique dans son atelier qu'il s'est aménagé dans la cave de la maison. C'est là que le petit Brian et son cousin Chad ( non, non, ce n'est pas moi, je vous le jure ) sont pour la première fois confrontés aux dessous brûlants de l'iceberg humain, les deux enfants découvrent la collection des revues pornos du grand-papa, ses antiques sexual toys et quelques dessous féminins affriolants... De quoi alimenter de nombreuses phantasmagories.
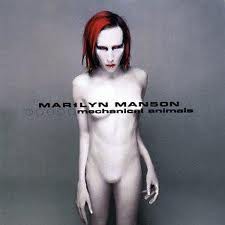
L'école est moins intéressante que l'antre du pépé. Les parents n'ont pas envoyé leur fils à l'école publique. Ont préféré payé la pension de l'Heritage Christian School, un établissement épiscopalien. Sont ainsi sûr que le rejeton sera élevé dans les vertueux chemins de la morale. Grosso modo, les épiscopaliens sont des catholiques qui refusent l'autorité du pape, aux USA la doctrine s'est fortement teintée de puritanisme protestant. L'on nettoie les corps, cheveux longs interdits, tenues décentes exigées, l'on passe l'âme l'âme à la machine à laver de l'armageddon trois fois par jour. La fin du monde est proche, peut-être avant le week end, tenez-vous à carreau car la colère de Dieu est terrible. Qui aime bien, châtie bien. C'est vrai puisque c'est écrit dans la Bible. Faites particulièrement gaffe, le Diable sait que dans quelques jours son règne sur cette terre sera terminé alors il lance ses dernières légions dans la bataille pour emporter avec lui un maximum de pêcheurs dévoyés dans les fournaises de l'Enfer. Ne cédez pas aux mirages du sexe ni aux sirènes des chants tribaux particulièrement pernicieux. Pour cette dernière recommandation l'on apporte des précisions et l'on cite des exemples précis : rock'n'roll, Kiss, groupes de hard rock... je vous laisse compléter la liste.
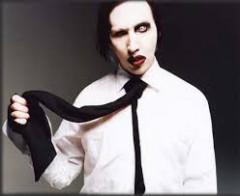
Hélas, j'ai le regret et le devoir de vous annoncer une terrible et triste nouvelle, le jeune Brian comprend tout à l'envers, il collectionne les revues honteuses, les revend à ses camarades de classe, etc, etc... et s'entiche des groupes de rock les moins recommandables comme Judas Priest ( rien que le non déjà ), Bon Jovi, AC / DC et quelques autres du même acabit... Un sale garnement qui commet toutes les crasses inimaginables pour se faire virer au plus vite de cet enfer scolaire. Comme ses parents envoient religieusement leur chèque à chaque échéance, l'on usera d'une grande et patiente mansuétude envers ce rebelle si remuant.
LE ROI DU MONDE
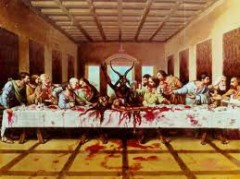
L'adolescence est un âge ingrat. Trop grand pour rester petit et trop petit pour devenir grand. Premier problème pour les garçons : les filles. Ne sont pas si coopérantes qu'on le souhaiterait. Le jeune Brian n'est pas un Don Juan. Espère beaucoup, mais du rêve à la réalité le fossé est large. Les premières expériences ne virent pas à l'extase. Heureusement qu'il y a le rock'n'roll et les copains ! Le rock présente des aspects frustrants. Coincés dans leur petite ville les adolescents américains n'en croient pas leurs oreilles : à la seule écoute d'un trente-trois tours de heavy-rock le chanteur a emballé douze nanas, remporté deux ou trois bastons, niqué une armada de policiers, avalé un demi-bocal de pilules, et convoqué deux ou trois fois le sieur Lucifer qui s'est servilement plié à ses quatre volontés. Le tout en moins de quarante-cinq minutes, chrono en main.

Mais il ne faut pas s'attarder sur ces aspects décourageants. Le rock est une sacrée décharge d'énergie. Délivre à tout moment un message subluminal accessible à tous. Do It Yourself, si ça te plaît, fais-le toi-même. Prends ta vie en main, bouge-toi le cul, secoue-toi les morpions, le premier crétin venu est capable de transformer son vide existentiel en opéra féérique. Suffit de vouloir. Nul besoin de courir au bout du monde, regarde autour de toi, il y a plein de grands frères qui ont déjà emprunté les chemins détournés. Se procurer de l'alcool est un jeu d'enfant, une âme compatissante vous passera votre premier joint, imbibez-vous, enfumez-vous, le reste viendra sans crier gare. Soyez un peu systématique et bientôt de vous-même vous demanderez davantage.
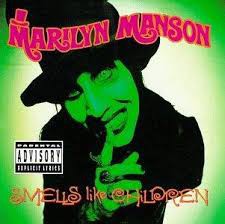
Eloignez-vous des centres villes, fréquentez les endroits discrets et retirés, propices aux trafics de toutes sortes, idéaux pour les fêtes un peu trashy-trashy. Derrière les cimetières, dans les masures abandonnées, vous pourrez tracer un cercle sur un vieux plancher démantibulé et récité les rituels interdits après avoir sacrifié quelques animaux innocents... Pour la suite de l'histoire, vous demanderez à ceux qui ont eu le courage de rester ce qui s'est réellement passé. A l'intérieur de votre tête. Ou à l'extérieur. Choisissez la solution que vous voulez, de toutes les manières l'Amérique est pleine d'adolescents détraqués. D'adultes aussi, mais ce n'est pas notre sujet. L'important est de passer à l'acte.
VERS LE ROCK
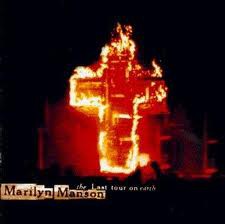
Dix-huit ans, Kid Brian s'éteint doucement, finira par laisser sa place à Marilyn Manson. La famille a déménagé, de l'Ohio l'on est descendu en Floride. Notre héros a décidé qu'il deviendrait écrivain, même si les revues refusent ses textes et ses poèmes. Obliquera vers le journalisme – Edgar Poe n'était-il pas directeur de journal ! – s'occupera de la rubrique rock. D'abord c'est un passionné, l'a aussi un job dans un magasin de disques. Commence par chroniquer les galettes et est bientôt chargé de réaliser les interviewes des vedettes rock qui passent à Miami. Rencontrera Debbie Harris ( l'importance de l'apparence physique ), Malcolm McLaren ( spécialiste de la manipulation des medias ) et Trent Reznor le leader des Nine Inch Nails ( un modèle musical à suivre ). Mais Bowie l'a prédit : il y a ceux qui écoutent la musique et ceux qui la font. Marilyn Manson décide de jouer dans la deuxième catégorie.
L'OUTRAGE
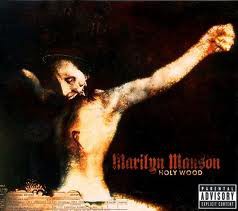
Depuis longtemps il se maquille les yeux. Beaucoup de noir. Marilyn Manson n'est pas un partisan de la discrétion. Tant à se faire traiter de pédé autant rajouter une touche de fond de teint, et pour faire totalement tantouze enfiler une robe. Parce qu'il aime ça. Mais aussi parce qu'il commence à théoriser sa démarche. L'Amérique est à l'image de l'être humain et de la lune. Une face sombre, une face ensoleillée. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ne nous refait pas le coup d'Al Jolson ou des Black Minstrels. La noirceur est à l'intérieur. Enfermée à triple tour dans la cage de notre boîte crânienne. Marilyn Monroe a décidé de laisser sortir le tigre altéré de sang qui est au-dedans de nous. Le laisse se pavaner en pleine ville. La bave aux lèvres assoiffées de sexe. Vous montre tout ce que la société fait semblant de ne pas savoir. La grâce féline de la fragile Monroe, la cruauté de Manson le gourou fou exécuteur de Sharon Tate. Vous pouvez inverser la donne : les turpitudes sexuelles de la Diva et la pureté des intentions du Mage Transcendantal.
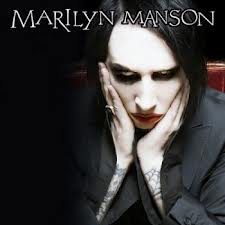
Pour l'image et la bande-son, ce sera du glam-indus, lourd, puissant et joué à fond les manettes, avec en bruit de fond, mais mixé très en avant, les poèmes du leader maximum. Marylin Manson, ne veut pas choquer pour choquer. Simplement pour tendre un miroir. Ne dites pas que je suis laid car je vous ressemble. Je ne suis que votre reflet. Si je vous fous la frousse, c'est parce que vous me faîtes peur depuis le jour de ma naissance. Si je suis l'excrément, votre société est la merde.

Le premier concert se déroulera en 1989, mais le premier album Portrait of An American Family ne paraître qu'en 1994. Les chaotiques concerts de Marilyn Manson attireront très vite l'attention des milieux conservateurs. C'est qu'il ne mâche pas ses mots, ni dans ses textes, ni dans ses interventions scéniques, ni dans ses déclarations médiatiques. Ne prend pas de gants pour se déclarer anti-chrétien. Dans un pays rétrograde comme les Etats-Unis, faut avoir un sacré culot pour bâtir sa crèmerie sur un tel concept. John Lenon avait dû faire ses plus plates excuses pour avoir déclaré que les Beatles étaient plus célèbres que le Christ. Marilyn Manson ne baissera jamais sa culotte – ou alors sur scène – nommera même son deuxième 33 Tours, Antichrist Superstar, afin que tous les born again de la terre sachent qu'il ne sera jamais des leurs.

Pour enfoncer le clou là où ça fait le plus mal – dans le corps du Christ – il accepte d'être nommé Révérend de l'Eglise de Satan d'Anton LaVey. Ce n'est pas du tout une renonciation de Marylin Manson à son athéisme militant. Pour Anton LaVey, Satan n'est pas un esprit, simplement un nom commode pour attirer la foudre des esprits étroits, et le nom de ce que nous sommes : l'homme. Un animal au même titre que tous les autres. Mais les puritains sont insensibles aux nuances. Brandissez l'épouvantail de Satan et les voici devenus fous. Anathèmes, dénonciations calomnieuses, manifestations, prières de rue, interdiction de concerts, tout est bon pour dénoncer la bête nuisible à abattre.

Quand on pense qu'en 1977, Patti Smith affirmait que Jésus était mort pour nos pêchés, mais par pour les siens, et que l'on voit la grande prêtresse spirituelle de l'amour avec un grand A qu'elle se targue d'être devenue de nos jours, l'on se dit que les amerloques ont sacrément le christianisme chevillé au corps pour qu'il transpire de la peau de ses enfants terribles si facilement... La geste de Marilyn Manson, ne nous en apparaît que plus belle et téméraire, très rock and roll pour le dire en trois mots.
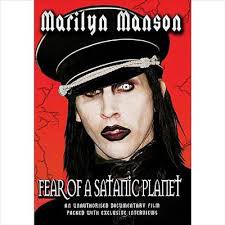
BON BOOK

Marylin Manson est le fils contre-nature d'Alice Cooper et d'Aleister Crowley. Pour le prophète 666 de la Bête nous vous renvoyons à notre trop courte chronique de la traduction de Magick opérée par Philippe Pissier ( livraison 162 du 07 / 11 / 13 ). D'Alice Cooper il tire son côté burlesque, grand guignol et grotesque, et d'Aleister Crowley son intransigeance intellectuelle, cette volonté iconoclaste de mettre ses mots en accords avec ses actes. Marilyn Manson est la face cachée et grimaçante de l'autre Amérique, celle de nos plus énormes fantasmes.
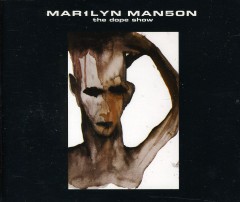
Lisez ce livre, il est beaucoup plus fort que le bouquin STP : A travers l'Amérique avec les Stones de Robert Greenfield qui comparé à cette autobiographie ressemble un peu à cinq rock stars en goguette dans un pandémonium de carton pâte. C'est dire s'il est bon. A déposer sur sa table de nuit pour les heures d'insomnie. Une bible. Pour que votre âme ne repose jamais en paix. Mais qu'elle se vautre ad vitam aeternam dans la luxure du rock and roll.
Damie Chad.
22:33 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/01/2014
KR'TNT ! ¤ 171. CHAIN & THE GANG / NICK KENT / LITTLE BOB / ALAIN GERBER
KR'TNT ! ¤ 171
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
09 / 01 / 2014
|
CHAIN & THE GANG / NICK KENT / LITTLE BOB / ALAIN GERBER |
CHAIN & THE GANG
15 – 11 -12 AU 106 / ROUEN
IN NOMINE ROCKUS ET GROOVUS
ET SVENONIUS SANCTI
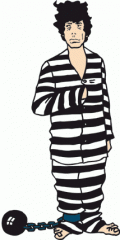
Ian Svenonius pourrait briguer le titre d’activiste anarcho-systémiste numéro un, toutes tendances et toutes époques confondues. Les anglo-saxons appellent ce genre de personnage «a brain», c’est-à-dire un cerveau. Il est court sur pattes, mais sa grosse tête abrite l’une des usines à idées les plus prolifiques de l’histoire de l’humanité.
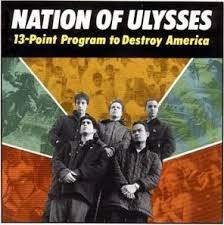
Ce petit brun originaire de Washington DC fit ses classes dans Nation Of Ulysses, quarteron de voyous hardcore qui n’ambitionnaient rien d’autre que de détruire l’Amérique. Ils avaient élaboré un plan en treize points qu’ils présentèrent au public dans un premier album intitulé «13-Point Program To Destroy America», sorti sur Dischord en 1991. Ian Svenonius monta ensuite les vénérables Make-Up pour diffuser dans le monde entier sa théorie stakhano-consumériste du Gospel yeh-yeh. Il lui suffisait simplement de claquer des doigts pour lever les foules. Plus besoin de jeter des bombes sur le passage des cortèges officiels. Les spécialistes de l’agitation révolutionnaire virent en lui un visionnaire et se mirent à écouter les fantastiques albums des Make-Up. L’espoir renaissait dans les réseaux de l’agit-prop clandestin. Le mythe du grand soir brillait à nouveau dans l’ombre des planques. Pour un peu, on aurait entendu claquer au vent le noir étendard de l’individualisme libertaire.
Ian Svenonius défraya ensuite la chronique avec Weird War, puis The Scene Creamers. Il y eut aussi l’épisode David Candy. Ses admirateurs n’en revenaient pas d’entendre des disques aussi viscéralement bons, aussi lourds de conséquences et aussi schtroumphés de modernisme hégélien. Album après album, Ian Svenonius semblait consolider sa position de figure de proue post-moderniste. L’étendue croissante de sa vision réconfortait les plus faibles parmi ses dévots. L’éblouissante qualité de son radicalisme funiculaire n’en finissait plus de faire baver ses plus vaillants disciples. Ils étaient unanimes pour dire qu’ils n’avaient jamais autant bavé.
L’écrasante majorité de ses valeureux disciples s’est donc résignée et accepte volontiers de continuer à baver. Après tout, la bave ce n’est pas si sale. En tous les cas, ça l’est moins que la morve. On peut baver sur sa copine, mais si elle vous voit faire couler un filet de morve sur sa peau, elle se montrera très certainement moins réceptive.
Et crac ! Ian Svenonius est revenu dans l’actualité avec Chain And The Gang. Comme prévu, on s’est tous remis à baver de plus belle. Et quelle actualité en trois ans ! Un concert à Rouen l’an passé, puis parution de trois albums mirifiques et d’un manifeste révolutionnaire, de quoi rendre malades d’indigestion les disciples les plus goinfres.
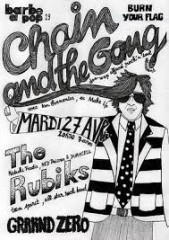
Sur scène, la petitesse de Ian Svenonius n’avait d’égale que la hauteur de sa classe. Il dansait des pas de deux discoïdes inconnus et créait la sensation. Il dansait comme un Dionysos garage en costume orange. Il chaloupait comme un Absalon florentin en quête de secrets alchimiques. Il baguenaudait comme un petit bouc émissaire humant l’air parfumé du printemps japonais. Il arpentait la scène d’un pas sauté qui nous préparait à l’idée du grand bond en avant. On aurait dit un Nijinski en boots, un Pierre Kropotkine en bordée chez Madame Claude, un Abel Paz livré aux démons du groove. Mais pour beaucoup de gens présents ce soir-là, il devait surtout passer pour un extra-terrestre. Quand on demande à un gars du coin de choisir entre le camembert et Zo d’Axa, il n’hésite pas une seule seconde.
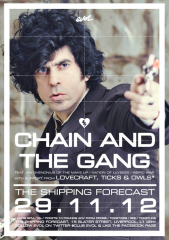
Autour de lui s’escrimaient des musiciens très jeunes, dont une petite bassiste métissée assez douée qui envoyait des grooves dignes de ceux de Michelle Mae (l’excellente bassiste des Make-Up). Ces pauvres jeunes gens s’escrimaient en pure perte, puisque le public attendait Ty Segall. Une fois de plus, c’était le monde à l’envers. Le programmeur avait inversé l’ordre hiérarchique. Il demandait au prince de jouer avant les manants. On aurait dû voir Chain & The Gang trôner en tête d’affiche, eh bien non. Trois ou quatre ans auparavant, on a constaté la même hérésie à Évreux : les Demolition Doll Rods jouaient en première partie des Black Keys ! C’est comme si on avait demandé aux Stones de jouer en première partie de Téléphone. Ou aux Cramps de jouer en première partie de Plastic Bertrand.
Ian n’est même pas venu signer les autographes. La petite bassiste métissée s’était chargée de la besogne. Elle n’a pas attrapé d’ampoules aux doigts, car il n’y avait pas grand monde, tout au plus deux ou trois ivrognes dont on faisait partie, mon gros nez rouge et moi.
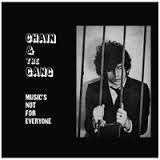
«Music’s Not For Everyone» date déjà de trois ans. On connaissait l’existence de cet album, mais il fallait rassembler au moins deux conditions pour le choper : un, se lever de bonne heure, et deux, avoir une veine de pendu. Mais ça vaut le coup de le traquer, franchement, car sur cet album se trouvent quelques bombes capables de faire rêver Ravachol. Avec «Why Not», Ian Svenonius nous embarque dans une espèce de jerk dindon qui est en plus malmené par un guitariste cruel. On est frappé par l’immanence du son. Le guitariste troue la paillasse du jerk d’un killer solo d’une rare violence. À part Ian Svenonius, personne n’ose s’aventurer dans ces régions avancées de la conceptualisation moderniste du son. D’ailleurs, si vous recherchez un r’n’b Dada du futur, vous le trouverez sur cet album. Il s’agir de «Livin’ Rough», qui fonce vers l’avenir comme une fusée ondulante. «It’s A Hard Hard Job» est une pièce gentillette et bien montée. Pas comme un âne, c’est vrai, mais pas loin. C’est de l’intéressant à la petite semaine, mais quand on entre dans l’univers tarabiscotant de Ian Svenonius, il faut rester sur ses gardes. Il peut chanter, comme c’est ici le cas, d’une voix au timbre oblitéré de fait, c’est-à-dire d’une voix martiale et frisée sur la frange.
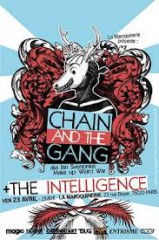
Puis il rallume les poudrières sataniques avec «Detroit Sound», pour lequel il emprunte un riff à Jimi Hendrix. Il chauffe le but en blanc et génère du gros son hurlé et bardé de chœurs. Puis il développe l’une de ses nombreuses théories : «Music’s Not For Everyone». Il explique que nous ne sommes pas tous égaux devant la musique. C’est une déclaration d’élitisme. Il la traite sur le mode du prêche incantatoire. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Il cite les noms de grands rockers et de grands jazzmen, expliquant qu’au final, le nombre de gens qui s’intéressent à eux est relativement bas, en pourcentage de la population mondiale. Il cite les noms de Little Richard et de Duke Ellington, et c’est complété par ceux de Bo Diddley, de Bobby Fuller et d’Helen Shapiro imprimés sur la pochette. Il revient ensuite à l’une de ses premières amours, le r’n’b, avec «(I’ve Got) Privilege». C’est syncopé à l’extrême, monté sur un riff de basse et des chœurs pervertis. Il fait monter la sauce - oh yeah-yeah-yeah - sur du violent riffage. Petit coup de génie, comme ça en passant. C’est meurtrier et bon, pourri de bassitude. Un modèle absolu.
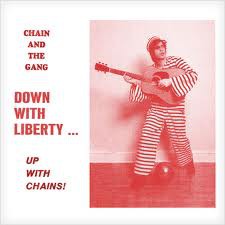
L’album suivant s’appelle «Down With Liberty... Up With Chains». Costume rayé et boulet au pied. «Chain Gang Theme 1 (I See Progress)» saute à la gorge de l’amateur imprudent. Voilà un bass doom de dub comme on n’en a encore jamais vu. Il chante ça à la ramasse, avec une désinvolture qui laisse coi. La basse, rien que la basse. Très énorme. Très devant. Il est très irrespectueux des articles du code pénal - Aieee chain gang ! - Dément. Paumé. Des contre-cœurs errants du middlewest éclatent les a-prioris parlementaires. C’était tellement culotté qu’on s’imagine qu’il improvise. «Trash Talk» ? Fabuleux. On se croirait devant un jukebox à Boulder, dans le Colorado. Voilà un hit hallucinant et fiévreux, embarqué à la fuzz, claqué de marrons, écœurant d’inventivité caractérielle. Mortel et donc à tomber. Le swing des bas-quartiers. On le réécoute plusieurs fois de suite, tellement c’est jouissif. Autre bombe noire à mèche courte : «Interview With The Chain Gang». Encore une forfaiture montée sur un riff fatal. C’est sa petite spécialité, son goût pour la déflagration. Un riff garage de fin des temps qui ferait danser le jukebox et les tables du bar de Boulder devant une assemblée ébahie, alors que sonnent les téléphones. Et ça repart, ça sonne, ça fait jerker les thyroïdes. On trouvera aussi sur cet album monumental du primitif à la sauce Svenonius : «(Lookin’ For A) Cave Girl». En fait, c’est du Bo svenoniussé. Bien vu car chanté à la ramasse-pas-mousse, une fois de plus. C’est même atrocement bien vu, et vraiment très spécial. Chute mortelle avec «Unpronounceable Name» qui est riffé sur du sax. Ian Svenonius entre au second couplet, après la fille et c’est brillant. Encore un épouvantable coup de son invention. Il sait ce qu’il faut mettre dans le cocktail Molotov pour pulvériser les hit-parades. Ian Svenonius est un génie du jerk libertaire. On entend en plus une mauvaise carne de solo. «Unpronounceable Name» restera l’archétype du groove sale hérissé de cris perçants. On ne trouvera ça nulle part ailleurs.

Le troisième album de ce gang informel s’appelle «In Cool Blood». Ian Svenonius commence par monter «Hunting For Love» sur un riff du type «My Generation». Le résultat est très décousu, mais comme toujours, très inspiré. Retour au Gospel yeh-yeh avec «Nuff Said». Vrai hit de sucre d’orge révolutionnaire dans sa forme supérieure. Ils chantent le tatapoum à deux voix. Excellence de ce procédé impartial et savamment maîtrisé. «(Living In The) Panther’s Cage» est une nouvelle pièce de Gospel yeh-yeh monté sur une délicieuse ligne de basse. C’est enveloppé, pesé et screamé. Ian Svenonius donne là une éclatante démonstration de la supériorité du groove post-groovy. Ils chantent à deux «You Better Find Something To Do» sur fond de riffage squelettique et de drumbeat tribal caoutchouteux. En gros, l’ambiance est malsaine et les screams n’arrangent rien. Avec «If I Only Had A Brain», Ian Svenonius avoue qu’il aimerait bien avoir un cerveau et on rigole en claquant des doigts, ce qui arrive assez rarement, on peut bien l’avouer.
Le manifeste reste un genre difficile. Les seuls qui s’en soient bien tirés, ce sont les Dadaïstes, car ils n’ambitionnaient rien d’autre que de défendre Dada : «Comment obtenir la béatitude ? En disant Dada. Comment devenir célèbre ? En disant Dada. D’un geste noble et avec des manières raffinées. Jusqu’à la folie. Jusqu’à l’évanouissement. Comment en finir avec tout ce qui est journalisticaille, anguille, tout ce qui est gentil et propret, borné, vermoulu de morale, européanisé, énervé ? En disant Dada. Dada c’est l’âme du monde, Dada c’est le grand truc. Dada c’est le meilleur savon au lait de lys du monde.» (Court extrait du manifeste Dada de 1916).
Par contre, les Futuristes de Marinetti et les Surréalistes tombés sous la coupe du despote Breton produiront des manifestes qui nous feront bâiller aux corneilles, et c’est peu dire. L’automatisme psychique de la pensée, et mon cul, c’est du poulet ? Tiens prends une aile, Dédé.
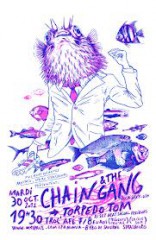
Cot ! Cot ! Ian Svenonius vient de nous pondre le sien : «Supernatural Strategies For Making A Rock’n’Roll Group», petit livre bleu qu’on peut glisser dans la poche poitrine de son bleu de travail. On en lira quelques pages à la pause en fumant une maïs, avant de retourner travailler sur la fraiseuse.
Pour élaborer sa stratégie, notre brillant théoricien a dû commencer par bâtir de solides fondations. Il a donc convoqué les esprits de Brian Jones, de Richard Berry, de Mary Wells, de Paul McCartney, de Buddy Holly, de Jimi Hendrix et de Jim Morrison. Tous ces grands esprits échappés du monde des vivants ont répondu aux questions du spirite Svenonius en développant des arguments rhétoriques très bien construits, admirablement documentés et qui s’abreuvent à la fois dans l’histoire, dans l’épistémologie, dans la philosophie rousseauiste, dans la géopolitique et dans la science des probabilités. Si vous cherchez dans ce livre des révélations sur la taille de la bite de Mick Jagger ou de celle de Long John Baldry, alors, il faut aller chercher ailleurs. Ian Svenonius reste fidèle à l’approche monacale du spiritisme et il n’est pas question pour lui de se hasarder dans les marécages. Il avance vers une lumière qu’il est à peu près le seul à voir, au risque de se retrouver seul au bout du chemin. Il faut bien avouer qu’on éprouve beaucoup de mal à entrer dans les pages de ce plaidoyer supernaturel. Il faut savoir montrer une confiance indéfectible pour piétiner les doutes qui surgissent à chaque page. Se foutrait-il de notre gueule ? Voilà une question à laquelle seul l’auteur peut répondre. Plutôt que de se perdre en conjectures, on préfère avancer. Comme toujours, on se dit qu’on finira bien par trouver chaussure à son pied. Il explique étape par étape comment monter un groupe de rock’n’roll. Il s’appuie sur des exemples concrets. Dans une première partie, il livre les secrets arrachés aux morts, puis dans une seconde partie, il décrit les principales étapes permettant de monter un groupe de rock : on fait une photo, on trouve un nom pour le groupe, on répète, on enregistre, on trouve un producteur, puis une camionnette et un label. Il explique ensuite comment traiter les questions du sexe et des drogues. Puis on passe en revue tout ce qui touche à la prestation scénique, au merchandising et à la communication. Viennent ensuite les problèmes liés au leadership et à la discipline. Puis il faut affronter la question des critiques et gérer le tripotage de l’image du groupe par les médias. Il ne manque rien. On trouve ici et là des fulgurances dignes d’un grand théoricien révolutionnaire. «Les Américains ne se sont pas rebellés à causes du poids des impôts ou parce qu’ils voulaient leur indépendance, mais parce qu’ils ne se sentaient pas dignes d’être des sujets britanniques. Ils ne voulaient pas briser les liens. Ils ont toujours imaginé qu’ils allaient pouvoir conserver un lien avec la monarchie anglaise, leur mère-patrie. Aujourd’hui encore, ils en veulent aux Français de les avoir aidés à conquérir leur indépendance. Les américains affichent leur mépris pour tout ce qui est français. Pour eux, les Français sont socialistes, feignants, prétentieux, mous et sales.» Ailleurs, Ian Svenonius développe sa théorie des gangs, origine et modèle du groupe de rock tel que nous le connaissons aujourd’hui : «Pour la plupart, les groupes - comme les gangs - ont choisi d’aller soit vers l’anarchie pure et dure (par exemple les Fugs), soit de se rapprocher des idées politico-mafieuses de leurs managers (par exemple Tommy James and the Shondells quand ils firent campagne pour Hubert Humphrey).»
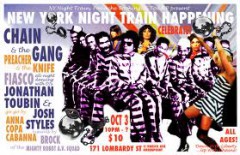
Dans le chapitre intitulé «Fixons les objectifs», Ian Svenonius fait un rapprochement pour le moins osé : «Aujourd’hui, les groupes de rock sont aussi éloignés de la musique que les Dadaïstes l’étaient de l’art. Mais les rockers contemporains n’ont pas le niveau de leur prédécesseurs.» C’est gonflé, car excepté quelques rares exceptions, on ne peut en aucun cas comparer les rockers de la fin du XXe siècle aux doctes Dadaïstes. La grande majorité des rockers sont des gens notoirement incultes, ce qui est normal, car on ne leur demande pas d’être férus d’histoire de l’art. En établissant ce genre de comparaison, Ian Svenonius fait de la provocation subversive. C’est comme s’il avait voulu établir un parallèle entre John Bon Jovi et Gandhi ou pire encore, entre Michael Jackson et Oscar Wilde.
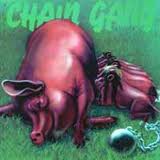
Chapitre drogues. L’auteur y voit l’internet comme la pire drogue des temps modernes : «L’internet est la drogue la plus dangereuse. Elle a une énorme influence sur la musique. L’addiction à la drogue internet n’est pas seulement tolérée : elle est encouragée de manière extrêmement agressive. Les effets sont terribles : on est constamment sollicité, on recherche en permanence des sources d’excitation et on finit par croire systématiquement à tout ce qu’on raconte sur le web. Quand ils se posent une question, tous les camés du web trouvent leur réponse au même endroit : Wikipedia. Il s’agit d’un terrible outil collectif - une version virtuelle des grandes pyramides d’Égypte - alimenté en permanence par des zombies fanatiques et non rémunérés. La drogue Internet pousse ces camés à fabriquer toujours plus de drogue - toujours plus d’internet. Ils produisent des pages web, des liens et ce qu’ils appellent du contenu. Grâce à eux, les puissants seigneurs du business internet s’enrichissent au-delà de toute mesure.»
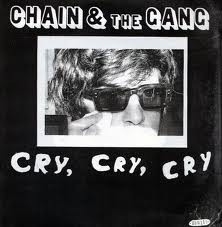
Dans le chapitre consacré au sexe, Ian Svenonius évoque bien sûr les groupies, mais aussi les couples normaux : «Les groupies et les cadavres n’étaient pas les seuls fantaisies sexuelles des stars du rock’n’roll. Ike et Tina Turner ont capitalisé sur leur relation agitée, avec des chansons comme ‘I’m Jealous’, ‘The Argument’, ‘A Fool In Love’, ‘Poor Food’ et ‘Tina’s Dilemna’. La nature explosive de leur vie conjugale leur servit à la fois de gimmick et de fil rouge, tout au long de leurs trois décennies de carrière en tant que duo.»
Ian Svenonius a dû en baver avec les critiques, car le chapitre qu’il leur consacre n’est pas vraiment cordial. «Si Little Richard démarrait sa carrière aujourd’hui, il provoquerait la colère des critiques. Ces messieurs n’accepteraient ni son humour, ni son numéro de cirque, ni ses costumes, ni les paroles Dada de ses chansons. Même chose pour Bob Dylan, Chuck Berry ou les Beatles. Les critiques verraient en eux des artistes comiques ou des fantaisistes, des gens qu’on ne pourrait pas prendre au sérieux, à l’opposé de groupes très respectés comme Sigur Ros ou Radiohead.» Puis il leur règle définitivement leur compte avec ça : «Tous les organes de presse ont décrété que les Strokes évoquaient les Ramones et Television, alors qu’ils n’ont absolument rien à voir avec ces deux groupes. Cela montre d’une part que les journalistes sont à la botte des publicitaires et d’autre part qu’ils ne savent plus traiter un sujet et encore moins parler de musique.»
Chacun trouvera dans ce petit manifeste teigneux assez d’eau pour alimenter son moulin. C’est là toute la force des ouvrages théoriques sans prétention : ils s’adaptent à toutes les tournures d’esprit et rendent les petits services escomptés.
Signé : Cazengler, back on the chain gang
Chain & The Gang. Music’s Not For Everyone. K Records 2009
Chain & The Gang. Down With Liberty... Up With Chains. K Records 2011
Chain & The Gang. In Cool Blood. K Records 2012
Ian F. Svenonius. Supernatural Strategies For Making A Rock’n’Roll Group. Akashic Books 2012
Chain & The Gang. 15 novembre 2012. Au 106 à Rouen.
APATHY FOR THE DEVIL
NICK KENT
LES SEVENTIES
VOYAGE AU COEUR DES TENEBRES
( Rivage Rouge / Poche / 2013 )
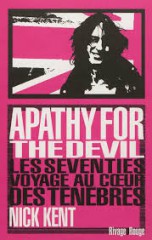
Né en 1951, Nick Kent n'aura guère connu les fifties. Beaucoup plus de chance avec les sixties puisque le 28 février 1964 – il n'a que douze ans - un de ses copains d'école dont le père organise des combats de catch et des spectacles pop lui permet d'assister à un concert des Rolling Stones au Sophia Garden de Cardiff. N'est pas donné à tout le monde de tomber tout petit dans le chaudron du rock'n'roll ! Evènement fondateur d'une existence vouée à la musique du diable. Devra attendre encore un peu. Le père ne goûte pas cette musique de sauvage. Pas le bruit des instruments mais plutôt la déviance comportementale que le déluge sonore suppose. Réaction petite-bourgeoise de ceux qui s'accrochent de toutes leurs forces aux parois du gouffre afin de ne pas céder à la fascination de la lave incandescente de la culture des basse-classes qui monte, monte, monte... et menace de tout submerger.

Rongera son frein en attendant que les barrières parentales tombent... Ne se débrouillera pas trop mal puisque il verra Dylan – complètement stoned – en 1966 et Hendrix, Pink Floyd, Move an the Nice ( really a nice day ) en 1967, Alvin Lee, Jeff Beck, Eric Clapton et quelques autres du même acabit en 1968... Le voici enfin seul dans une piaule d'étudiant du Bedford College ( in London ). S'intéresse à la littérature, mais pas à celle enseignée, les vieilles figures de proue de la littérature british l'assomment, l'est un lecteur de Truman Capote, partisan d'une écriture froide pour exprimer les brûlantes turpitudes des temps électriques qui se lèvent.
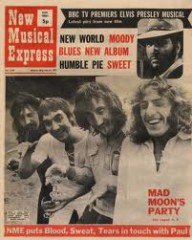
Les études ne le rattraperont jamais. La chance et le destin – l'autre nom de l'amère fatalité – lui tendent la main. Du premier coup ses critiques de disques sont acceptées et publiées par la revue underground Frendz qui n'a pas laissé d'aussi impérissables souvenirs que OZ et IT. Quelques mois plus tard il parvient à entrer dans l'équipe rédactionnelle ( section musique ) du New Musical Express ( NME ) qui tire alors soixante mille exemplaires mais qui surfant sur la vague pop ne tardera pas à tripler son tirage... Nick Kent et quelques autres jeunes loups ne sont pas étrangers par la pertinence de leurs articles ne sont pas étrangers à ce renouveau du magazine déjà âgé de vingt ans...
IN TOO MUCH...
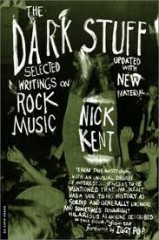
Nick lui-même n'a pas vingt ans qu'il est déjà au coeur de l'ouragan rock. Petit clin d'oeil à notre chronique de la semaine précédente du livre de Carol Clerk ( si bien traduit par notre cat Zengler préféré ) Hawkwind, la saga, Kent voisine avec le groupe à vocation interstellaire dont les membres ont parfois du mal à trouver pour la nuit une chambre accueillante... Toutefois notre journaliste est admis dans le saint des saints invité à couvrir les concerts des Rolling Stones et la tournée de Led Zeppelin...
Folle époque ! Nick Kent ne touche plus terre. Il est une personnalité reconnue du monde du rock, il s'habille comme une rock star – les anglais ont toujours eu un goût immodéré pour l'excentricité du dandysme – sa petite amie se nomme Chrissie Hynde, et il s'adonne sans retenue aux voluptés des paradis artificiels.

Bosse aussi un max. Vous pond des tartines au kilomètres. Fait bien attention à ce que la quantité ne nuise pas à la qualité. Essaie de parfaire son écriture. Fait d'une pierre deux coups. Se rend aux Etats-Unis – manière de renifler les nouvelles tendances mais surtout de rencontrer le dieu des journalistes rock, Lester Bang ( voir notre chronique 140 du 12 / 04 / 2012 ), le prophète inspiré de la revue CREEM de Detroit, le père des fulminations gonzo-rock, l'autorité intellectuelle suprême qui l'adoubera... Nous trace un très beau portrait du chantre de Detoit enfermé dans une solitude qui le retranche de toute véritable rencontre féminine... Un bien-aimé, mal-aimant.
LE FLAIR
La qualité nietzschéenne par excellence. Côté disque, en ce début de décennie il pleut des chefs d'oeuvres tous les jours. L'on ne demande qu'à le croire. Mais il faut savoir se méfier de l'esbroufe et du clinquant. Sous le vernis, découvrez le bon vinyl. C'est quand la vague vous submerge que vous avez la possibilité de prouver que vous êtes un bon nageur. Au coeur de la tempête Nick Kent essaie de garder la tête froide et la boussole pointée vers le futur du rock'n'roll.

Ne se réfère jamais aux pionniers, mais il a compris que le rock'n'roll ne survivra que s'il garde le contact avec la fureur sauvage des révoltes adolescentes originelles. Il a déjà rencontré à Londres l'homme qui incarne cette ultimité du rock, Iggy Pop qui a joué une folie ultime dans une salle pratiquement vide, il le retrouve à Détroit avec les Stooges pour un autre concert dévastateur.
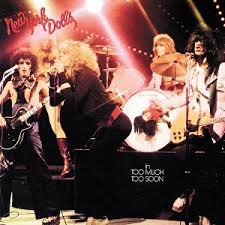
Avant de partir il côtoie plusieurs soirs de suite à New York Dolls « dans un rade quelconque de Manhattan comme le Kenny's » le groupe est à son meilleur niveau. N'était pas fait d'après lui pour les grandes salles, ne le dit pas mais pense très fort qu'ils sont avant l'heure un groupe de pub-rock beaucoup plus branché sur le rock'n'roll que sur le rhythm and blues.
LE REFLUX
Iggy, les Dolls, Nick Kent est un fin limier. A l'autre bout de l'arc-en-ciel, il établit la figure dominante du glam-rock, pas Marc Bolan, mais David Bowie. Showman irréprochable, faiseur de génie, mais surtout tête pensante du présent du rock. Celui qui remettra en selle Iggy et Lou Reed le rescapé du Velvet Underground et qui ne verra pas beaucoup plus loin que le bout de son nez coincé sur le haut des charts amerloques. Un Bowie qui s'enlisera dans le bourbier de la white dance soul music.
Seventies, qui s'affaissent sous leurs propres poids. Les groupes se meurent de leurs succès. Le fric, l'auto-satisfaction, la vanité et la poudre forment un cocktail étiolant. Du rock l'on est passé au prog. La musique se gonfle, le jabot des justes fiertés se transforme en goitre cancéreux. Nick Kent succombe à son tour. Il goûte à l'héro et va grossir le rang des junkies.
IN TOO MUCH ( 2 )
Rien de pire que de voir venir l'accident et de n'avoir pas su donner le coup de volant qui aurait permis de l'éviter. Stooges, New York Dolls, Nick Kent découvre le troisième pointillé qui mène à la renaissance du rock, Malcolm McLaren. Fréquente sa boutique spécialisée dans les vêtements pour Teddy Boys.
McLaren « est resté irrémédiablement bloqué à la fin des années cinquante. Gene Vincent, le psychopathe hillibilly, à la voix céleste, est sa référence ultime, le personnage qui résume le mieux sa vision du rock, une force indomptée et authentiquement subversive ». et voici que McLaren séduit par les Dolls essaie de relancer le groupe en train de couler... N'y parviendra pas, mais il saura rebondir sur son échec.
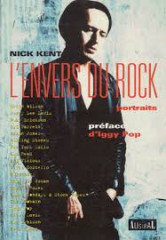
Nick Kent fait suivre à McLaren des cours de rattrapage. Lui parle du dedans du rock, a vécu assez prêt de l'intérieur des plus grands groupes pour comprendre les forces d'attraction qui les ont mis sur orbite et expliquer les forces répulsives qui les démolissent, les corrodent, les désagrègent. McLaren écoute et réarrange la sauce à son goût. Avant d'être un groupe les Sex Pistols seront un concept. Son concept. Ne lui reste plus qu'à remplir les cases de l'entité théorique avec de véritables êtres vivants. Si possible pas trop intelligents pour être plus facilement manipulables et pas très bons musiciens pour qu'ils n'aient point de désirs musicaux par trop personnels à vouloir exprimer.
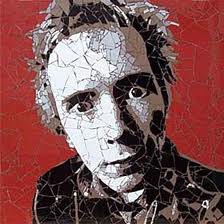
Tâtonnera quelques mois. Nick Kent se verra propulsé dans le groupe. Ne gardera pas trop longtemps la place offerte, trop accro à l'héro pour intuiter qu'il laisse passer sa chance. En profitera pour profiler la direction musicale de base ! Jouer aussi fortement, aussi rapidement, aussi violemment que les Stooges... Le conseil sera suivi à la lettre et à l'alphabet. Une manière tonitruante de cacher son incapacité stylistique. Que seraient devenus les Pistols si Johnny Lydon avait refusé de devenir le chanteur du groupe. Lydon n'aime pas le rock. C'est un voyou futé qui a des goûts arty. Un prolétaire débrouillard aux préférences petites-bourgeoises avant-gardistes. Ce qu'il aime, c'est le krautrock allemand de pointe. Les Stooges possédaient leur secret : s'inspiraient de Coltrane, cette façon de n'en finir jamais de remettre le couvert, d'avancer dans la puissance du morceau alors que tout autre l'aurait arrêté depuis belle lurette. Sans coda mais avec tête. Lydon apporte son truc en plus, les vociférations machiniques de Neu. Pouvez dire tout le mal que vous voulez de Malcolm McLaren mais la réalité a confirmé sa théorie. L'a sorti de son chapeau un des groupes essentiels de l'histoire du rock'n'roll. Un laborieux numéro de prestidigitateur qui s'est métamorphosé en magie rouge opérative !
GIMME DANGER
Pourquoi le punk – Nick Kent n'affirme pas qu'il a été l'initiateur du terme – est-il né en Angleterre et pas aux USA ? La question n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Des Dolls à Patti Smith, de Richard Hell aux Ramones, les States possédaient en magasin tout ce qu'il leur fallait avant la perfide Albion. Mais le pays était trop grand. Les milieux amerloc punk ne représentaient que d'invisibles points sur l'étendue continentale du pays. Noyés dans la masse. En Angleterre, le pays géographique est si étroit, que l'information circule très vite, et que la petitesse des lieux se révèle être une magnifique caisse de résonance. D'où l'importance des médias et de la presse, et pour le sujet qui nous occupe de la presse-rock.
Le journaliste-rock est un véritable porte-voix. Un article peut faire beaucoup de mal, une critique malvenue peut plomber les ventes d'un disque. Les musicos ont besoin des gratteurs de papier, mais il ne faudrait pas qu'ils en prennent trop à leur aise. Fâcheries et inimitiés sont à l'ordre du jour. Les menaces verbales peuvent être suivies de voies de fait.
Nick Kent n'échappe pas à la règle commune. Même s'il n'est plus le prince flamboyant qu'il a été, même s'il n'est qu'un junkie en manque, une épave qui roule de dealer en dealer... Se fera agresser à coups de chaîne à vélo par Sid Vicious, sur ordre de McLaren. Plus tard Sid s'excusera et Malcolm arrondira les angles. Mais la blessure est beaucoup plus morale que physique. Nick Kent se sent trahi par des amis, refoulé par son propre camp.
LES TENEBRES
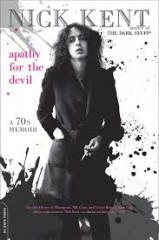
Cela avait si bien commencé ! Comme un rêve idyllique. Une utopie psychédélique qui s'est désagrégée de l'intérieur. Difficile d'arrêter la coupable, c'est une héroïne vénéneuse qui vous détruit en vous fournissant l'extase à répétition. La petite mort ad libitum avec pour point final, la grande camarde qui referme sur votre existence les parois du néant. Nick Kent ne s'en sortira qu'à la fin de la décennie suivante. Pourtant les ténèbres sont ailleurs. Le brown sugar n'est que la poudre aux yeux blanche. Pas de veine si vous en recevez, mais vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même.
L'on en meurt le plus souvent. A l'exception de Keith Richard qui se porte comme un charme. Nick Kent en est revenu. Ne l'a pas remporté par Metallic KO, l'en est toutefois ressorti vivant. Mais c'est un combat secondaire. A beaucoup plus souffert d'une contradiction idéologique. L'a appelé de tous ses voeux et de tous ses écrits à une renaissance d'un rock plus violent, primal et séditieux. Et lorsqu'il est advenu, en a été plus que déçu.
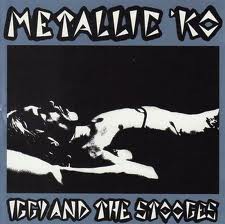
Le mouvement punk fut selon ses dires le triomphe d'une barbarie lumpen-prolétarienne. Sans doute était-il vrai que l'avenir des masses laborieuses était compromis. No future. Mais le punk aurait surtout oblitéré l'humanité de sa propre présence. Le pouvoir rock aux mains de brutes au cerveau cacahuète. L'on n'échappe guère à ses ascendances. Le fils met ses pensées dans les idées de son père. Le serpent se mord la queue. Nick Kent est trop clairvoyant pour ne pas se moquer de lui-même. Au bout de la nuit, l'on ne rencontre pas obligatoirement la lumière du matin.
ULTIMA
Trente ans se sont écoulés. Nick Kent vit à Paris depuis une vingtaine d'année avec la journaliste rock Laurence Romance. Ecrit toujours. Ecoute aussi du rock. Et d'autres choses. Til the end. Beautiful friend. Survivant.
Evidemment, ca fourmille d'anecdotes. Mais je n'ai pas voulu déflorer votre plaisir. Irremplaçable. Pas votre plaisir. Le livre de Nick Kent.
Damie Chad.
LITTLE BOB / LA STORY
( avec CHRISTIAN EUDELINE )
PREFACE DE JEAN-BERNARD POUY
( Collection X-Trême / Octobre 2010 )
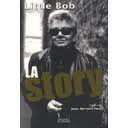
Du beau monde. Little Bob, Christian Eudeline, et Jean-Bernard Pouy, pour le même bouquin, c'est de la surenchère. Remarquons toutefois qu'Eudeline, ne montre pas le bout de l'oreille. A su s'effacer et laisser Bob se débrouiller tout seul. S'en tire comme un chef le Roberto Piazza, mais il est vrai qu'il est un spécialiste du micro. Par contre Jean-Bernard Pouy pond une préface à vous couper le souffle et les tentacules du premier poulpe qui passerait par là. Quatre pages et tout est dit. Si bien, que vous n'avez même plus envie de lire la suite. Quand l'avocat est bon, l'on se moque des dernières déclarations de l'accusé. A part que si tout le monde a envie de défendre Little Bob, personne n'oserait l'attaquer de quoi que ce soit.
A FRENCH PIONNIER
Etrangement ce n'est pas le nom que l'on cite en premier lorsque l'on évoque le rock français, l'est pourtant de la génération des Hallyday-Mitchell-Rivers, mais son blaze est arrivé plus tard aux oreilles des fans français. Ce qui ne l'a pas empêché d'être sur la brèche dès 1962 avec son premier groupe, les Apach's.

Au début je n'y ai pas cru. Me suis demandé où était l'entourloupette. Six pages de Rock & Folk consacrées à un groupe de rock français qui se prévalait de plus d'une dizaine d'années d'expériences diverses, à qui l'on réservait, dans le N° 96 de janvier 75, l'espace que l'on offrait d'habitude aux Stones, c'était étrange. Et puis l'a fallu se rendre à l'évidence quand les disques sont arrivés. Ce n'était pas mauvais du tout. C'était même très bon. Pas original pour un sou, mais il y avait cette voix qui vous secouait les tripes. Pas besoin d'entendre le Don't let me be misunderstood pour voir la relation avec Eric Burdon. Un timbre moins caverneux, mais plus rageur. Un organe qui d'office le classait à part de tous nos petits froggies à la voix si blanche. Hors concours. Mis sur la touche. Hors catégorie.
Et ce truc. Pas vraiment franc du collier. Chantait en Anglais. C'était bien un peu à la mode dans les années 70, mais il le faisait avec tant de conviction que tout de suite, l'on évacuait les soupçons de frime, et qu'on classait la Little Bob Story, du côté des fortes têtes, des rebelles tranquilles, qui s'inscrivaient dans une filiation courte mais signifiante, celle qui partait des Variations pour remonter à l'ange noir du rock'n'roll français, Vince Taylor.
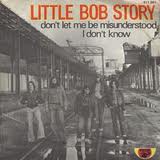
Tout s'explique en ce bas monde. Little Bob était un fils d'immigré, déjà adolescent lorsqu'il s'est retrouvé sous les pommiers de sa Normandie qui ne lui était pas natale. Qui ne lui fut même pas fatale. Car il s'en est bien tiré le petit rital. Connaissait déjà le rock 'n' roll quand il s'est radiné de par chez nous. Elvis, Bill Haley et Little Tony un spagheto de son pays qui chantait ( très bien, et à tort mésestimé en l'hexagone ) en anglais. Dans sa tête de cabochard, le rock se chantait en anglais. Raconte comment entre Johnny Hallyday et Vince Taylor, il avait opté pour le dernier des aigles.
Ensuite, il a fait comme tout le monde, s'est branché sur les Anglais, Beatles, Animals – je vous épargne le reste de la ménagerie – et en 65-67, il a pris le grand virage, pas celui de l'été de l'amour, mais la staxmania, le rhythm and blues cuivré de Memphis – à l'époque c'était un peu le parcours imposé et naturel – avec pour Bob une petite coloration un peu plus personnelle, cette inflexion black soul était en fait aussi un retour vers la note cyanosée du blues, Howlin' Wolf lui paraissant depuis l'achat de ses premiers disques aussi essentiel que Little Richard... Little Bob adore le rock and roll mais son être profond vibre davantage à la jactance dégoupillée du Rhythm and Blues. Le livre se termine au début de 2010, sur la formation de son deuxième groupe, Little Bob Blues Bastard. Tout un programme.
RECONNAISSANCE
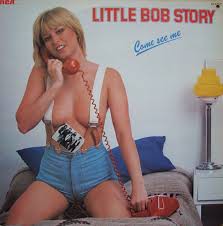
Nul n'est prophète en son pays. En Normandie Little Bob Story est une star, régionale. Dans les provinces voisines, il n'est connu que des amateurs. Les radios ne se précipitent pas pour l'inclure sur leur set-list. Ne mordra jamais sur le grand public. S'en fout, l'a trouvé mieux ailleurs. L'autre country du rock'n'roll. L'Angleterre. Il s'octroie le luxe de tourner in the old England, et la vieille dame l'accueille à bras ouvert. N'est pas un objet de curiosité, joue à jeu égal avec les Dr Feelgood, les Damned, Motör Head et quelques autres de la même engeance. Label qualité United Kingdom, de quoi forcer le respect de tous les petits frenchies. Même si le public préfère les alcools un peu moins forts, les sucreries pseudo-prog à la Ange, et si le métier lui recommande de délaisser la langue de Milton pour celle de Lamartine.
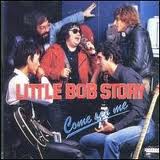
Mais le grand Bobbie n'en fait qu'à sa tête. Au début des années 80 il se fera doubler sur sa droite par des groupes français qui chantent en français, Little Bob n'atteindra jamais les scores de Trust et de Téléphone... Ne le regrette pas. Lui il a participé aux deux festivals punk de Mont-de-Marsan, et cela tout le monde ne peut pas en dire autant. Certains vivent dans le mythe qu'ils sont en train de construire et d'autres dans la pénible réalité des arrangements contraignants... Pour la petite histoire, j'étais bien au concert de Toulouse qui donnera naissance à un des morceaux phares de Little Bob, le fameux Riot in Toulouse. Sans y être, de l'autre côté des barrières, car les méchants CRS nous empêcheront d'entrer. Me suis souvent demandé pourquoi, sous prétexte de cette seule voie de fait à l'encontre des amateurs de rock and roll, les gouvernements successifs n'ont pas encore dissous ces fameuses compagnies républicaines d'insécurité publiques ! Dehors, dedans, ce fut une des plus légendaires soirées rock hexagonales. Merci à Little Bob.
STORY OF LITTLE BOB
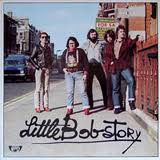
Ne pas se prendre les pinceaux entre Little Bob, l'homme, et Little Bob Story, le groupe. Aucun soupçon de mégalomanie dans cette appellation contrôlée qui fut imaginée par Bébert guitariste de Little Bob and the Blues Gun. Avant il y avait eu Little Bob and the Red Devils, et les Apach's qui le 12 janvier 1963 passeront au Golf-Drouot. Nous ne nous attarderons pas sur le va et vient des musiciens, les départs, le service militaire obligatoire qui sera un des grands facteurs de l'avortement de la première vague des groupes du rock français. Ce n'est qu'en 1975 que le groupe se stabilisera une première fois autour Mino, Barbenoire, Bibi et Guy-Georges. Et Little Bob, le meneur incontesté qui trimballe derrière lui dix longues années de galères et d'expériences diverses.
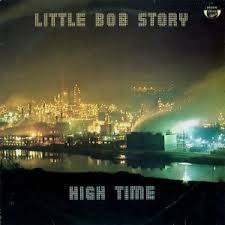
L'homme qui s'est fait tout seul. Qui ne prend pas le temps de réfléchir. Qui ne pense même pas à garder des témoignages auditifs de toutes ses pérégrinations. Pas de plan de carrière. Marche tout droit, ne regarde pas en arrière. La seule manière de ne pas s'arrêter en route. Se font récupérer par Jean-Claude Pognant qui à l'époque est le grand manitou underground de la pop française puisqu'il a lancé le groupe Ange et qu'il possède son propre label Crypto. Certes Jean-Claude Pognant n'est pas exempt d'une crédibilité rock'n'roll – je caresse encore amoureusement même si l'encre commence à s'effacer deux numéros de sa revue Rock'n'roll Actuality parue en 1967 – il n'est pas étranger à la l'organisation de l'avant-dernière tournée en France de Gene Vincent, mais totalement subjugué par la vague prog anglo-saxone des années 70, il désertera le rock and roll pur et dur en faveur de la pop-prog...
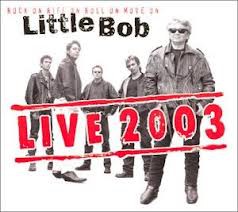
Little Bob ne mâche pas ses mots. A l'impression que les ventes de ses trente-trois tours parus chez Crypto, desquels il ne touchera pratiquement aucun émolument, a surtout servi à promouvoir les disques de formations un peu trop planantes à son goût comme Tangerine ou Wapassou... Mais les accords passés avec RCA – tout de même la major d'Elvis ! - se révèleront aussi décevants. L'antenne française du groupe est beaucoup plus spécialisée dans la variété que dans le rock !
LE MAL FRANCAIS
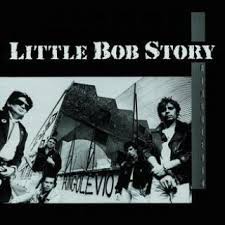
Ce ne sera guère beaucoup mieux chez EMI. En fait la superstructure musicale française est dirigée par des managers et des producteurs qui n'y connaissent rien en rock, ou qui méprisent trop le grand public – à qui ils ressemblent tant – pour leur servir de la bonne musique. Le rock n'est défendu que par de rares individus qui font ce qu'ils peuvent pour arracher un contrat, une avance, des heures de studios... une aide précieuse, mais parcimonieuse, à l'économie. Vous croyez avoir un appui dans la place mais le voici parti ailleurs sous des cieux plus hospitaliers, ou carrément viré.
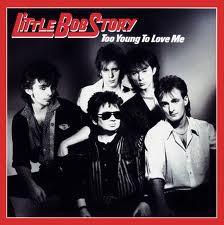
Difficile de progresser en de telles conditions. Little Bob qui vendait trente mille albums à ses débuts dépasse à peine les dix mille quinze ans plus tard. Quantités négligeables pour un gros label ou investisseur privé qui ne risque pas ses pépètes sans l'assurance d'un rendement maximum. Aujourd'hui Little Bob essaie de s'auto-suffire. N'a jamais été une rock'n'roll star – et ce n'était pas son but au départ – mais l'on sent que le rock-survivor qu'il est devenu aimerait avoir un peu plus de tranquillité d'esprit.
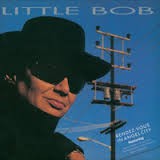
Ne se plaint pas. L'a pris du bon temps. La camaraderie entre copains, des concerts flamboyants, des grumeaux de speed gros comme des pruneaux d'Agen et des lignes de cocke à rendre jaloux la SNCF... Mais en a plus qu'assez de ces compliments mielleux prodigués par tout le milieu show-biz qui ne lui a jamais tendu la main, maintenant qu'il a acquis – à l'usure – le statut d'une institution inamovible. L'est devenu à son corps défendant la caution rock morale de la variétoche française... Un comble. Secrète blessure. L'homme se replie vers les siens, ses musicos et Mimie, sa femme adorée.
MUSIC

Evoque les tournées perpétuelles et les concerts qu'il démarche au téléphone. N'est-ce pas malheureux d'en être réduit à ce rôle de secrétaire après avoir tracé tant de glorieuses pages ! Nous avons déjà croisé cette même sensation de vide chez Dominique Laboubée dans les dernières années des Dogs. Un peu de mélancolie due à la jeunesse qui s'est enfuie sans crier gare, aux frères d'abordage qui se sont éloignés tour à tour, ou dont il a fallu se séparer pour incompatibilités diverses, et cette sensation que le rêve rock s'est écroulé comme un château de sable et qu'à près de soixante-dix balais, tout est à refaire.

Reste les disques, reprises et originaux. Petit Bob est fier de lui. A enregistré en Angleterre et aux USA, a partagé la scène avec les plus grands, pas dans l'ombre des géants mais en totale fraternité, nous ne citerons que sa collaboration avec Steve Hunter pour appuyer nos dires. Little Bob énumère ses morceaux un par un. Et les conditions des enregistrements. N'a pas toujours eu la haute main sur sa production. Manque de moyens, manque d'expérience, ingénieurs du son incompétents ou retors. La vie est une concession à perpétuité. Mais il ne mégote pas sur l'ensemble. Car il a fait ce qu'il a voulu. Et il n'a voulu que le rock'n'roll.
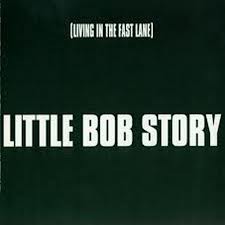
L'est sur sa rocky road blues à fond la caisse. Nous, l'on s'est glissés sur le siège arrière, et l'on n'est pas près d'en descendre. Livin' in the Fast Line.
Damie Chad.
LE ROI DU JAZZ
ALAIN GERBER
( Collection Je Bouquine / BAYARD / 1994 )
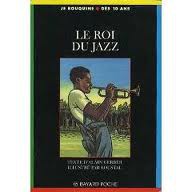
Un mini récit pour les pré-ados, mais un grand nom du jazz comme signature. Alain Gerber a longtemps imposé sa marque de fabrique dans le rayon jazz sur la radio d'état culturelle. A aussi écrit plusieurs romans monographiques sur les grands noms du jazz. Belle plume, un peu retenue dans ce livre pour les jeunes gens. L'a privilégié la clarté du style. Afin de se faire mieux comprendre.
L'histoire est tout simplement celle de deux gamins, un noir et un blanc, unis par une solide amitié. De bons sentiments certes, mais cela se passe dans la première moitié du vingtième siècle, en pleine période ségrégationniste. Gerber rajoute sa couleur préférée, celle du jazz, toute bleue. La suite de l'histoire est un peu inspirée de La Rage de Vivre de Milton Mezz Mezzrow ( voir notre chronique N° 108 du 12 / 07 / 12 ).
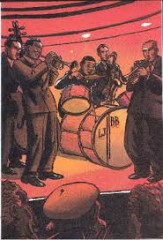
Agréable à lire. Un portail d'initiation facile à franchir pour nos têtes blondes et brunes qui n'ont aucune idée des origines de la musique populaire américaine. L'aurait fallu y adjoindre un CD avec quelques exemples sonores. Se sont contentés pour garniture des illustrations de Loustal. Très bande dessinée. Un trait explicite qui se contente d'illustrer le texte d'Alain Gerber. Personnellement je préfère ses jeunes filles nues et si innocemment perfides de ses albums pour adultes. Mais l'on ne peut pas tout avoir en ce bas monde cruel.
Damie Chad.
23:11 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/01/2014
KR'TNT ! ¤ 170. BLUE TEARS TRIO / HAWKWIND / CAROL CLERK
KR'TNT ! ¤ 170
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
03 / 01 / 2014
|
BLUE TEARS TRIO / HAWKWIND / CAROL CLERK |
BLUE TEARS TRIO
15 / 09 / 2013
AMERICAN CAR FESTIVAL / ECQUEVILLY ( 78)
13 / 12 / 2013
McDAID'S / LE HAVRE
LE TIR NOURRI DES BLUE TEARS
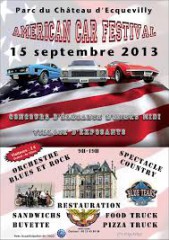
Tous ceux qui ont eu la chance de voir les grands concerts de Doctor Feelgood et d’Eddie & the Hot Rods à la salle Franklin savent que le Havre est la ville rock par excellence. L’est-elle encore aujourd’hui ? Plus autant, car les grandes affiches se raréfient. Disons que la qualité des petits concerts parvient à compenser l’absence dramatique d’événements marquants.
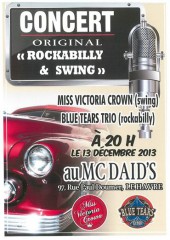
L’un des endroits recommandables du Havre est un pub qui s’appelle le McDaid’s. L’ambiance y est particulièrement bonne et animée. Mais ce qui fait le charme de l’endroit, c’est la salle en sous-sol qui est une vraie salle de concert : assez spacieuse, plafond bas, joli son bien ramassé et une seule petite marche d’estrade, ce qui fait qu’on reste à proximité du groupe qui joue. Comme dans tous ces endroits, la programmation se diversifie : ça peut aller du blues au festif irlandais en passant par du rock et de la chanson. Certains soirs, des groupes de rockabilly s’y produisent.

Les Russes de Stressor sont venus jouer au McDaid’s en mai dernier. Six mois plus tard, Miss Victoria Crown et le Blue Tears Trio se partageaient l’affiche. Nous eûmes droit à une petite heure de fraîcheur candido-swing avec la petite Miss puis ce fut un set solide, captivant et bien senti du Blue Tears Trio.

Comme le nom du groupe l’indique, ils sont trois : Didier, chant et guitare, Aymé, black stand-up bass et Frank, drums. Didier porte encore sur l’intérieur de l’avant-bras le nom de son groupe précédent, les Flamin’ Combo. Le groupe était basé au Havre. J’ai le souvenir d’un excellent concert au Bateau Ivre. Ils jouaient un fier rockab de puristes. À leur façon, ils portaient le flambeau. Avec les Blue Tears, Didier semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Comme s’il avait changé le moteur du groupe et qu’en plus il avait mis un tigre dans le moteur.

Le tigre s’appelle Frank. Frank le cogneur des basses œuvres, Frankie Teardrop le pulseur invétéré, Frank le pétaradeur impénitent, Frank l’empêcheur de tourner en rond, Frank le repousseur de retranchements. Tapis à l’affût derrière ses fûts, il guette le signal. Une fois lancé, rien ne pourrait plus l’arrêter. Il est le Jean Gabin du beat, c’est lui qui conduit la loco. Il rebondit sur son tabouret. Tout bouge, ses jambes, sa chaîne, ses bottes, ses bras, tout ! Il impulse une énergie considérable au trio. Du coup, on le sent vrombir. Ça cliquette dans la culbute. Ça ronfle sous les mesures. Ça tempête dans le tempo. Ça vroarme dans les couplets. Ça rugit sous le capot du vieux rockab qui ne demande qu’à foncer dans le prochain platane. Frank shoote une méchante dose de speed-swing dans le cul ridé du vieux rockab qui du coup retrouve son teint de vampire. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais sans l’immanence de son parfum de folie, le rockab redevient vite classique et on bâille aux corneilles, au risque de se décrocher la mâchoire. Ce n’est pas l’agilité des musiciens qui fait la grandeur du genre, c’est l’inhérence de sa folie. Les petits péquenots qui sortaient des champs du Deep South pour entrer dans des studios d’enregistrement n’étaient pas des premiers de la classe, au contraire. Carl Perkins et ses frangins buvaient leur mauvais whisky au goulot avant de commencer à enregistrer et Sam Phillips les laissait faire, car il savait qu’une fois pétés, ces bouseux allaient jouer comme des dieux. On retrouve cette folie dans les premiers tirs de Johnny et Dorsey Burnette, et dans «Love Me» de The Phantom. On la retrouve aussi chez cet énervé de Bobby Dean quand il claque «Just Go Wild Over Rock’n’Roll», chez Bill Allen, bien sûr, quand il embarque «Please Gimme Something» au paradis de la pure insanité cavalante. Chez Vince Maloy aussi, quand il nous met au tapis avec «Hubba Hubba Ding Ding». Il faudrait aussi citer Rick Cartey, Benny Ingram et tous les autres soiffards qui ont secoué les colonnes du temple. Frank ne boit plus depuis longtemps, mais il a compris ça : pour jouer cette musique, il faut savoir apporter autre chose que de la simple technique. Il faut amener l’énergie du diable.

Il a joué pendant longtemps dans des groupes de rock et écumé l’underground rouennais. Souvent en trio, puis dans les Nuts, un groupe de reprises qui ne se mouchait pas avec le dos de la cuillère puisqu’ils tapaient dans les classiques des Saints, de Frank Black, de Stiff Little Fingers, des Heartbreakers, des Flamin’ Groovies et d’autres cocos du même acabit. Il y avait dans ce groupe un excellent chanteur qui pouvait devenir un screamer fou et qui n’était autre que l’ex-chanteur du Big City Gang (l’un des deux groupes phares de la scène rouennaise des années soixante-dix). Frank arrivait torse nu sur scène quand les Nuts jouaient en concert et il poussait les hurlements de la crypte pendant les solos de guitare. Il amenait au groupe ce que les Anglais appellent la powerhouse. Il cognait tellement que les autres devaient monter leur volume s’ils voulaient s’entendre jouer. Ce sont des dynamiques internes dangereuses pour les tympans, mais le résultat était particulièrement excitant. Le plus beau cadeau qu’il fit aux Nuts fut de proposer une reprise de «Five Years Ahead Of My Time» des Third Bardo. Il la chantait en battant le beurre. Il avait pour ce classique garage jadis repris par les Cramps une affection particulière et il en hoquetait une version hantée aux accents particulièrement menaçants.
Frank fait partie des esprits éclairés et curieux qui vont fouiner partout. Il vous fera l’éloge du parolier Lemmy et avouera vouer un culte à Johnny Cash. Il peut passer de Rose Tattoo à Hank Williams, de Johnny Kidd aux Ramones, pas de problème, du moment qu’il se passe des choses intéressantes sur leurs disques.

Et puis un jour, il en a eu marre de jouer ici et là. Il prit alors la décision de revenir aux sources, c’est-à-dire au rockab. Rien de tel qu’un son de stand-up. Rien de tel qu’un classique de Carl Perkins ou de Johnny Powers. Mais ce n’est pas toujours simple de rentrer dans un groupe de rockab. Les gens qui savent le jouer constituent une véritable élite. C’est un style qui ne supporte pas l’amateurisme, et encore moins l’approximation. Jouer du rockab, c’est une fin en soi. Pas question de faire les choses à moitié. Et puis il y a le look. On ne fait pas n’importe quoi. On affiche sa passion clairement. On se coiffe comme ci et pas comme ça. Le rockab est un genre tellement puissant qu’il a survécu à toutes les modes et à tous les coups de laminoir, à toutes les tentatives de récupération et à toutes les dérives. Voilà en gros tout ce qu’on comprend quand on voit un groupe comme le Blue Tears Trio sur scène.
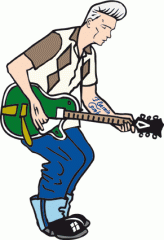
Didier joue sur une Gretsch solid-body verte. Dès le deuxième morceau du set, il tire l’overdrive avec «You Can Do No Wrong» de Carl Perkins, l’un des morceaux les plus harcelants de l’histoire du rock à cause de son riff obsessionnel qui nous faisait crier au génie à l’époque où on écoutait nos vieux coffrets Sun. Il est dessus, il l’embarque au chant et le riffe inlassablement, pulsé dans le dos par le rumble diabolique de la stand-up d’Aymé et par le hit-and-crash incessant d’un Frank ramassé sur ses fûts comme un boxeur impitoyable. Le ton est donné. Ils vont enchaîner une quarantaine de standards sans faiblir. Ils envoient rouler dans nos escarcelles deux reprises d’Eddie Cochran, «Baby Baby» et «Twenty Flight Rock» qui grâce à la rythmique sur-puissante prend une sorte de nouvel essor. Pourtant connu comme le loup blanc, le classique de Cochran sonne comme un sou neuf et nous cueille au menton. Rien de tel qu’une reprise inspirée pour nous faire retrouver la foi. Au fil des morceaux, on colle toujours mieux au set, à cause de l’épouvantable swing qui s’en dégage. Tout le monde sautille, comme dans un club de jazz à la Nouvelle Orleans, ça nous swingue tellement l’occiput qu’on donne carte blanche à nos épaules et à tout le reste. Sur scène ça swingue tellement que les mains de Didier sautent en rythme sur le beat. Ses tours de notes, ses carillons d’arpèges, ses courses de manche sautent sur le grill du beat, on voit sa main droite swinger les cordes comme s’il les frappait plutôt que de les plaquer. Tout semble possédé, même le chant, secoué et porté par la débauche cavalante. C’est swingué jusqu’à l’os du beat, surtout quand ils tapent dans les vieux classiques du doo-wop comme «She’s The Most» des Five Keys. Ils perdent complètement le contrôle du morceau et le swing les tient. Stupéfiant !

On voit rarement des groupes swinguer ainsi. Leur reprise de «Let’s Flat Get it» (Danny Wolfe) reste dans cette veine sublime. Ils balancent aussi une belle reprise de «Domino», ce gros hit mythologique composé par Sam Phillips pour son poulain Roy Orbison. Solides reprises du «Little Pig» de Dale Hawkins, du «Hot Water» de Big Sandy, de «Crazy Crazy Lovin’» de Johnny Carroll et overdose de swing pour le «Sneaky Pete» de Sonny Fisher. Même les poutres noires du plafond semblaient bouger. Impossible de résister à des telles bousculades émotionnelles. Le swing du rockab est le rythme naturel des blancs, comme le boogie est le rythme naturel des noirs. Un blanc ne saura jamais danser sur un boogie, mais il sentira son corps bouger en harmonie avec le swing du rockab. Histoire d’échapper à la routine, Didier lance une version bien speedée du «Cruising» de Gene Vincent et hop tout le monde part ventre à terre à travers les plaines du vieux far-west de fête foraine. Version épaisse et diablement inspirée de «Roll Over Beethoven». C’est un morceau cousu de fil blanc qu’on ne supportait plus d’entendre dans les seventies à cause des Stones et de tous les groupes anglais qui reprenaient Chuck Berry sur scène, mais là, dans ce contexte si particulier, ça passait comme une lettre à la poste, car les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes retrouvaient leurs repères. Les filles (qui sont toujours plus expressives dans un public que les garçons) appréciaient particulièrement ce bon vieux Beethoven puisqu’elles tapaient des mains et sautillaient comme les folles du pavillon des sauteuses de Sainte-Anne. Reprise inspirée du grand classique d’Hank Williams, «I’m So Lonesome» et d’un autre cut de Roy Orbison, «You’re My Baby». Swing mortel avec le riff de «All I Can Do Is Cry» de Wayne Walker, monté une fois de plus sur un beau beat tagaga qui ne plaisante pas. Le point fort du set est leur reprise du «Ice Cold» des Restless, combo de vétérans britanniques qu’on a vu jouer à Béthune cet été. «Ice Cold» est l’achétype du rockab moderne ensorcelant et secoué de l’intérieur par une sorte de syncope obsédante. C’est gratté jusqu’à l’os du swing et ça vous poursuit jusque dans votre sommeil. C’est l’un des morceaux qui illustre parfaitement cette désinvolture rockab de nuque rasée et de pas chaloupés qu’on ne voit pas ailleurs, cette classe innée du coup de peigne et du pli cassé sur la chaussure, ce dandysme de dos carré et de masculinité rock qui méprise le machisme, ce soin identitaire qui réfute toute forme de compromission et qui laisse la médiocrité à ceux que ça intéresse. «Ice Cold» dit la classe rockab mieux qu’aucun autre classique.

Ils ont bouclé leur set avec deux petites bombes : «Long Blond Hair» de Johnny Powers et «Flying Saucer Rock’n’Roll» de Billy Lee Riley. On sentait qu’ils puisaient dans leurs réserves d’énergie, car ils nous secouaient la paillasse depuis pas loin de deux heures.
Un vent glacial venu de la mer soufflait sur les rues du Havre. Il emporta les fumées qu’on dégageait et nous ramena illico aux dures réalités de l’hiver normand.
Signé : Cazengler, tear au flanc.
Blue Tears Trio. American Car Festival. Ecquevilly (78). 15 septembre 2013
Blue Tears Trio. McDaid’s (Le Havre). 13 décembre 2013
Photos Cat Zengler et Gisèle sur le facebook de Blue Tears Trio
HAWKWIND / LA SAGA
CAROL CLERK
( Traduction : PATRICK CAZENGLER )
( CAMION BLANC / Mars 2013 )
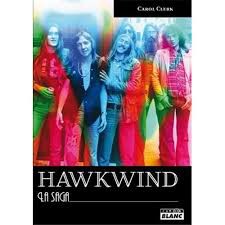
L'on ne parle plus beaucoup d'Hawkwind dans les milieux du rock français. Des années que le nom ne m'est pas apparu au hasard d'une conversation. Et pourtant les discussions sur le rock, c'est ma tasse de sky. Hawkwind, c'était un nom au début des années soixante-dix ! Le genre de groupe qui attirait la sympathie d'à peu près tout le monde. Nombreuses sont les chapelles rock et en ces temps lointains Hawkwind faisait l'unanimité autant chez les partisans d'un rock'n'roll dur et violent que chez les adeptes des plus marécageuses planeries progressives.
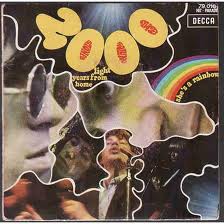
2000 Light Years From Home. Ce n'est pas le morceau le plus connu des Stones. C'est pourtant le plus réussi de ce qui dès le mois de décembre 1967 fut considéré comme la première et la plus magnifique plantade des Rolling, leur sixième 33 Tours , Their Satanic Majesties Request. Tellement foireux que l'on ne leur donnait quitus que de la pochette, en quadricolor tridimensionnelle, SVP.
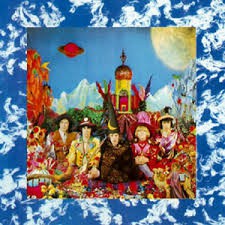
Il y avait dans ces deux mille années lumières comme une pré-référence au 2001 Odyssée de l'Espace de Kubrick en fin de production. Quatre minutes de glissade éternelle au fond du cosmos. Les Pierres Roulantes reconnurent très vite qu'elle n'étaient pas les mieux douées pour les voyages interstellaires et rangèrent leur 2000 Ligth Years From Home sur le rayonnages des curiosités incongrues et retournèrent se colleter avec la boue du delta originel qu'ils s'empressèrent d'épaissir dans les albums suivants.

Hawkind ce n'est pas autre chose que 2000 Light Years From Home. A une différence près. Pour explorer l'espace incommensurable les Stones s'étaient munis de que l'on trouvait de mieux à l'époque, à peu près l'équivalent musical d'une capsule Nasale et Géminique , un engin rudimentaire propulsé par la force centrifuge développée par un pédalo, Hawkwind avait anticipé, s'était construit le vaisseau amiral de l'Empire Contre-Attaque et il traversait les solitudes intersidérales à la vitesse de l'éclair. Jumpin' Jack Flash en quelque sorte. Un boucan d'enfer. Une forge de titans. Le beat primordial du rock'n'roll diddleyen accéléré et augmenté d'un tintamarre cyclopéen. Une dévastation généralisée. Une calamité excrémentielle tout droit sortie de la caverne des Enfers, une expectoration sacrificielle à la face de l'univers. Inutile de vous boucher les oreilles, la fureur d'Hawkwind triomphait de tous les blindages. En ces mêmes temporalités, Blue Cheer, Led Zeppe et quelques autres mettaient au poing la recette du heavy hard rock à partir d'élémentaires riffs de blues montés en sauce. Hawkwind fondait sa cuisine sur les déplacements tectoniques des affluents sonores. Vous étiez déjà sourds avant d'entendre. Pour les yeux il vous martelait sur la gueule des stroboscopes spiralés qui vous cisaillaient les rétines.
Et puis peu à peu, le vaisseau d'Hawkwind a quitté le firmament des rockers. Parti sur d'autres planètes. Passé de monde et de mode. De temps en temps une brève dans un magazine et puis plus rien... Jusqu'à ce pavé de 787 pages qui retrace l'histoire chronologique du combo en donnant la parole à la quarantaine de protagonistes qui firent partie de son incroyable odyssée. Pas d'interviews géantes mais un montage de répliques qui se répondent, s'opposent, s'accusent, s'agressent et parfois même se congratulent ( si, si, ça arrive ), langue de pute mais pas de bois. Carol Clerk ne prend jamais parti. Elle laisse dire. L'on ne se passe rien mais le plus incroyable c'est que ça ne dégénère pas en pipi de chat. Pas plus que les vérités, les mensonges ne sont jamais faciles à dire. Les égos et les rancoeurs s'entrechoquent, mais le plus grand gagnant de ces escrimes oratoires restent l'entité Hawkwind qui transcende toutes les contradictions.
GENESE ANGLAISE

L'histoire commence tôt. Avant même les fameuses sixties puisque en 1959 Dave Brock, le futur leader d'Hawkwind joue du banjo dans son premier groupe de... jazz ! Préhistoire du rock british. Partis du jazz-trad, une large fraction des musiciens anglais se dirigent vers le rock en faisant le détour par le blues. Dave Brock rencontre Eric Clapton et Keith Relf en train de monter les Yardbirds... mais la gloire ne viendra pas aussi vite que pour ces deux oiseaux. Quatre ans plus tard, Dave en est à son énième groupe... l'a parcouru l'Angleterre en long, en large et en travers mais il n'a pas encore trouvé la formule magique. Se tient trop près du blues.

Faudra attendre l'arrivée de Nick Turner. Un cheminement sensiblement identique à celui de Dave, mais Nick est plus intello. Il lit, voyage, joue du saxo, traverse les termitières mods, rockers, bikers, et finit par s'ancrer dans ce que l'on appellera plus tard le mouvement hippies lui-même enté sur l'explosion psychédélique hendrixienne... Il s'agit d'ouvrir toutes les portes, celles du cerveau et de la musique. Drogues et ivresses diverses seront nécessaires pour dynamiter les anciennes idées, les vieux réflexes, pour établir de nouvelles relations entre les individus, pour changer la vie et la musique.
Dave Brock and Nick Turner se retrouvent au même confluent. Avec leurs potes respectifs ils forment le Group X qui deviendra Hawkwind. L'enjeu n'est pas de composer des morceaux de musique calibrés à la perfection, mais de se mouvoir parmi des suites infinies d'explosions sonores et d'incroyables circonvolutions soniques. Nick n'est pas un virtuose du sax mais il souffle fort et se démène comme un fou, Dave ne se contente pas de jouer de la guitare, il jongle avec les pédales et bidouille les sons sur les premiers appareillages électroniques...
ENERGIE PHILOSOPHIQUE

Certains compareront les premiers disques d'Hawkwind avec le Atom Mother Heart des Pink Floyd – cela m'étonne - mais question vache les membres de l'Hawkwind ont surtout bouffé de l'enragée. Ont traversé dix ans de galère à jouer dans la rue, à pioncer sur le parquet des copains, à participer à des festivals gratuits, à donner des concerts pour toutes les causes perdues... n'en ont tiré aucune amertume. Ils y ont même puisé l'énergie des idéaux déçus que l'on ne remet jamais en question et que l'on poursuit jusqu'au bout.

Hawkwind n'est pas un groupe-marketing. S'est développé sur le terrain de la culture hippie anglaise. Dès qu'il apparaît le groupe trouve son public de fans qui le soutiendra envers et contre tout. En contrepartie Hawkwind leur apporte son énergie électrique. Très vite pour ne pas se répéter le groupe ne se contentera pas de balancer un rock primal, il l'étoffera de tout un arrière-plan philosopho-poétique à base de science-fiction et d'utopie psychédélique. Les titres des albums parlent d'eux-mêmes, In Search of Space ( 1971 ), Space Ritual Alive ( 1973 ), Warrior on the Edge of Time ( 1975 ).
LA TRILATERALE
Deux têtes pensantes dans un groupe, c'est une de trop. Avant de simplifier le problème, l'on commence par le complexifier. Vont en rajouter une troisième. Un peu particulière parce que Lemmy Kilmister c'est un peu comme ces torses sans chef que Rodin se plaisait à modeler dans la glaise et l'airain. Puissance virile brute éloignée des finasseries intellectuelles. L'abstraction absconse ce n'est pas le fort de Lemmy. Plutôt du genre à faire main basse sur les viles concrétudes charnelles. Adaptez un réacteur de 747 sur votre mobylette et venez m'en dire des nouvelles. Doté de cette arme de destruction massive, Hawkwind pète le feu et monte au zénith de sa puissance. Mais Lemmy partira au bout de deux ans fonder Mötorhead.

Pas de son propre gré. Mais pas contre son gré non plus. Ne nous attardons pas sur son cas. L'homme a de la ressource. S'en remettra comme d'un simple rhume. Entre Nick et Dave rien ne va plus. Rien ne va depuis le début. Dave est le chef et Nick l'inspirateur. L'on peut changer de navigateur mais pas de capitaine. Seul maître à bord, par définition. Une lutte sourde, un conflit larvé s'installe entre les deux hommes. Qui se répercutera parmi le reste du groupe, techniciens, roadies, musiciens, entourages...
Dave tient les comptes et selon certains il s'en tire à bon compte... Des divergences musicales s'affirment. La valse des musiciens ne fait que commencer. Du jour au lendemain, sans préavis l'on est remercié, en 1976 Nick Turner est débarqué...

SURVIVOR
Hawkwind semble touché au coeur mais l'astronef continue sa course. L'on joue toujours aussi fort, mais pas tout à fait la même musique. Beaucoup plus de clavier, beaucoup plus d'électronique, les morceaux sont mis en scène, interprétés, mimés, parfois l'on a droit à de véritables spectacles, à des spaces opera avec danseurs, chanteuses, costumes, light-shows de plus en plus sophistiqués... Le groupe caméléon change de nom comme de cordes de guitares. Certaines années sont bonnes, d'autres moins...

Des périodes creuses, mais tous les deux ans Hawkwind parvient à rebondir et à rétablir l'unanimité sur ses prestations scéniques. Le groupe est fécond, il use les musiciens, les presse comme des éponges et les rejette sans pitié, mais beaucoup reviennent, même ceux qui avaient juré de ne jamais remettre les pieds à bord....
D'anciens membres se retrouvent dans Space Ritual, un groupe encore plus Hawkwind qu-Hawkwind... certains fans le jugent plus authentique mais le centre de gravité attractif de la mouvance Hawkwind reste bien le vieux bâtiment du pirate Dave Brooks.
DARK SIDE

Les récriminations ne manquent pas. Dispute sur les contrats, les royalties, les accréditations sur les morceaux. Votre idéalisme risque d'en prendre un coup. Signer un contrat est facile, le respecter, le faire respecter, beaucoup moins évident... Mais décomptes et déboires exposés ne nuisent en rien à l'intérêt du récit. Il suffit de ne pas prendre parti et de s'amuser à voir le noeud de vipères s'exaspérer. Un seul conseil, si vous y mettez la main, tous ces reptiles seront d'accord pour vous piquer. Votre pognon.
SECOND LIFE

La saga d'Hawkwind en cache une autre, comme la forêt derrière le baobab, celle du mouvement des festivals gratuits, l'utohippiepie dans toute sa grandeur. Une dimension que la France n'a guère connue. Ou si peu, dans les seventies, mais entachée d'idéologie gauchiste. Rien à voir avec nos entrées en force dans les concerts. In England, toute une frange de la population qui vit en marge se retrouve et se regroupe régulièrement lors de manifestations libres et gratuites - le do It Yourself des punks n'est pas né ex-nihilo – des chevelus, des crasseux, des paumés, des rêveurs, des utopistes, qui se déplacent en bus et véhicules communautaires. Ca boit et ça se drogue. Des marginaux et des apôtres du New Age. Des adorateurs de la Mère Nature et du Soleil qui se donnent rendez-vous chaque année sur le signe mégalithique de Stonehenge pour fêter le solstice du Sol Invictus.
Toute cette sympathique mouvance traverse allègrement la septième décennie du siècle mais avec l'arrivée du libéralisme tatchérien dans les eighties les contrôles policiers deviennent de plus en plus tatillons et draconiens. Jusqu'à ce mois de juin 1985 où la police charge violemment la foule qui se dirige vers le l'arène des pierres dressées, casse systématiquement les pare-brises des véhicules, matraque femmes et enfants... La fin d'une époque. Le fric roi. L'interdiction des festivals gratuits.
RESISTANCE?
Cette interdiction peu démocratique – un peu tache d'huile et de sang – fut levée dans les années 90. Mais la police usa d'autres subterfuges – aussi violents mais plus subtils – afin de détruire de l'intérieur ces grandes fêtes anarcho-païennes. L'héroïne fut au mouvement hippie ce que l'introduction de l'alcool – l'eau de feu dévastatrice – fut aux tribus indiennes. La violence et le vol importés par des provocateurs se répandirent comme traînées de poudres dans les campements des babas pacifiques... Hawkwind contourna le problème en délivrant à ses fans passeports qui leur permettaient de se retrouver entre connaissances en des lieux beaucoup plus propices et sécurisés à de longues méditations musicales...
A chacun, sa réserve de survie. Les policiers se frottent les mains, ils possèdent la liste des participants. La liberté sous contrôle d'identité. Les utopies se rabotent aussi facilement que les planches des cercueils.
SURVIVOR II
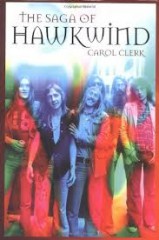
Hawkwind a survécu jusqu'à nos jours même si le livre de Carol Clerk paru en 2004 en Angleterre ne dépasse pas l'année 2005. Sa violence musicale a permis au tyrannosaure hawkwindien d'être avec les Stones le seul survivant de l'ère dinosauriale. Les punks l'ont, pour cette brutalité revendiquée, sans souci placé dans la lignée de leurs grands ancêtres, plus tard les aficionados des rave-parties, house-music et dance music, le révérèrent pour ses rythmiques hynoptico-électroniques. Jusqu'où est-on responsable de ses propres enfants ?
Hawkwind assome. Hawkwind assume.
POST-SCRIPTUM
C'est le premier livre de Carol Clerk que nous chroniquons, décédée en 2010, elle reste une des grandes plumes britanniques de l'écriture rock. Sans doute la recroiserons-nous en de futures kronics. Elle sut être dans sa vie comme dans ses livres, belle et authentiquement rock'n'roll. Raucous girl.

787 pages ! Autant dire que je n'ai fait que survoler le paquebot. A peine esquissé le portrait de trois musiciens alors que le livre s'étend assez longuement sur la biographie d'une soixantaine de personnages. Peut-être vous moquez-vous d'Hawkwind comme de votre première chaussette ( qui était un chausson rose ), lisez tout de même le book. En le parcourant c'est toute une tranche du rock anglais que vous traverserez. Il constituera un indispensable et considérable additif à L'Histoire de l'Underground Londonien de Barry Miles que nous avons chroniqué dans notre livraison N° 96 du 03 / 05 / 2012.
Et surtout, Mister Cat Zengler, chapeau pour la traduction ! Quelle clarté ! Quelle aisance ! Ca se boit comme du petit sky !
Damie Chad.
22:16 | Lien permanent | Commentaires (0)


