05/12/2013
KR'TNT ! ¤ 166. ERIC BURDON ( + ANIMALS ) / GHOST HIGHWAY / CHRONIQUES VULVEUSES ( fin )
KR'TNT ! ¤ 166
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
05 / 12 / 2013
|
ERIC BURDON ( + ANIMALS ) / CHOST HIGHWAY CHRONIQUES VULVEUSES ( The end ) |
OLYMPIA / PARIS XI / 26 – 11 – 13
ERIC BURDON
BURDON LE LA
(PART ONE)
«Bo Diddley est venu dans ce pays, l’année dernière/ On jouait au Club A Gogo, à Newcastle, la ville où j’ai grandi/ Un soir, la porte s’est ouverte et à notre grande surprise/ Est apparu le bonhomme en personne, Bo Diddley/ Accompagné de Jerome Green, son joueur de maracas/ Et de la Duchesse, sa super frangine/ On jouait ce morceau/ Puis sont arrivés les Rolling Stones et les Merseybeats/ Tout le monde prenait son pied/ Et j’ai entendu Bo Diddley s’adresser à Jerome Green/ Hey Jerome ! Que penses-tu de ces gars/ Qui jouent... nos morceaux ?/ Jerome a répondu : Où est le bar ? Montre-moi le chemin du bar.../ Alors Bo s’est tourné vers la Duchesse/ Il lui a dit : Hey Duch... Que penses-tu de ces petits jeunes/ Qui jouent nos morceaux ?/ Elle a répondu : Je ne sais pas. Je suis venue ici/ Pour voir la relève de la garde et tout le bazar/ Alors, Bo Diddley s’est tourné vers moi et a dit/ Avec les yeux mi-clos et un sourire au coin des lèvres/ Hey mec !/ Il a enlevé ses lunettes et a ajouté : Mec, c’est le pire tas de conneries/ Que j’ai entendu dans toute ma vie/ Hey Bo Diddley !» Eric Burdon chantait cet hommage génial en 1965 («The Story Of Bo Diddley», sur l’album «Animal Tracks»).

Vienne la nuit, sonne l’heure, les jours s’en vont et il demeure. Quarante-huit ans se sont écoulés sous le Pont Mirabeau, et pour Eric, rien n’a changé. Il vénère toujours autant Bo Diddley : «Il a passé sa vie à tenir sa guitare très bas/ À s’éclater en jouant le Diddley beat partout où il allait/ Depuis les rues du Mississipi jusqu’à celles de Tokyo/ C’est le plus africain des Américains que j’ai pu connaître/ Alors, je grimpe à bord du Bo Diddley Special/ À fond la caisse sur le Diddley beat/ Adieu Bo Diddley, adieu/ Tu vas nous manquer mais ton esprit demeure parmi nous/ Adieu Bo Diddley, adieu/.../ Bo Diddley est entré en trombe dans ma vie/ Comme un gros train fonçant dans la nuit/ Je n’oublierai jamais le jour où il a débarqué dans la ville où j’ai grandi/ Il a fait son numéro et cassé la baraque/.../Maintenant, je voudrais vous dire/ Ce que Bo Diddley avait de spécial/ Il avait la main aussi large qu’une assiette de fish and chips/ Il s’habillait comme le plus romantique des hommes/ Il portait une veste rouge à carreaux et un pantalon à rayures/ À la ville comme à la scène/ Il se baladait en scooter dans les rues de Clearwater, en Floride/ Avec sa guitare accrochée dans le dos/ Sa guitare était rouge et rectangulaire, vous savez/ Et ses derniers mots furent les mêmes que ses premiers mots/ Je grimpe à bord du Bo Diddley Special/ À fond la caisse sur le Diddley beat!»
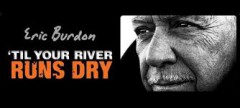
Quarante-huit ans plus tard, Eric Burdon rend un nouvel hommage à Bo (eh oui, 48 ans, presque un demi-siècle, c’est maintenant une histoire de vieux pépères - n’oublions pas que pépère Eric fête ses 72 ans). On l’entend chanter cette merveille absolue qu’est «Bo Diddley Special» sur son dernier album, «‘Til Your River Runs Dry», comme s’il bouclait la boucle, au terme d’un demi-siècle de «carrière». Comme si tous les disques sortis entre «Animal Tracks» et le dernier n’étaient plus qu’un alibi.

Les groupes anglais qui enregistraient des albums dans les années 1964 et 1965 tombaient tous dans le même panneau : l’overdose de reprises. Les Stones, les Kinks, les Troggs, les Stones, les Them et les Animals remplirent les faces de leurs premiers albums de reprises des gens qu’ils admiraient et qui avaient pour principale particularité d’être des Américains de race noire. Eric Burdon ne vénérait pas que Bo Diddley. Il vouait aussi des cultes à Ray Charles, John Lee Hooker, Fats Domino, Sam Cooke et Chuck Berry. On retrouve par conséquent des morceaux de tous ces gens-là sur le premier album des Animals paru en 1964. Eric Burdon sonnait déjà comme une superstar, il savait fendre son timbre et passer pour le white nigger number one, comme par exemple dans «The Right Time». Des blanches lascives balancent des chœurs derrière lui. La version de «Around And Around» que jouent les Animals est nettement moins sauvage que celle des Stones, mais c’est l’occasion d’entendre les monstrueuses basslines de Chas Chandler, qui pour beaucoup, fut le vrai héros des Animals. On l’entend aussi parfaitement dans «The Girl Can’t Help It». Le producteur Mickie Most eut le génie de mettre la basse de Chas en avant et c’est un vrai festival de pétarade. Chas n’arrête pas de voyager dans ses gammes et quand on joue de la basse, il fait partie des gens dont on va repomper les plans. Sur la reprise de «I’m In Love Again»(Fats Domino) Chas donne de l’air au morceau et les autres se fondent dans la masse. Hilton Valentine joue clair et très fouillé. Eric mouille bien ses syllabes. Mais ils se plantent aussi avec leur version trop sage et trop appliquée de «Memphis Tennessee». Si on la compare à celle de Jerry Lee, elle fait pâle figure. Lorsqu’ils tapent dans John Lee Hooker, avec cette reprise de «I’m Mad Again» («when I see my baby messin’ around - I’m mad like Sonny Liston - You know I’m mad like Cassius Clay»), on assiste à un échange guitare/orgue du meilleur effet, et digne de ce que fera plus tard Jimi Hendrix dans les jams célestes d’«Electric Ladyland». Pour l’époque, c’était bien vu.
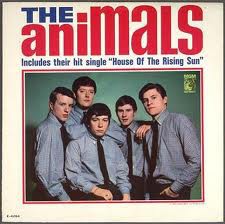
Bien sûr, dans ces années-là, on appréciait le côté wild-shouter d’Eric Burdon. Mais il passait largement après Phil May et Van Morrison, qui incarnaient la pure sauvagerie, celle qui nous mettait en transe.
En 1965 paraissait «Animal Tracks», le second album studio des Animals. C’est là-dessus que se trouve l’extraordinaire hommage pré-cité à Bo Diddley, «The Story Of Bo Diddley». On y trouve aussi deux hits faramineux des Animals, «We Gotta Get Out Of This Town» - hit signé Barry Mann/Cynthia Weil, embarqué par la basse de Chas et expédié au firmament par la voix grandiose d’Eric Burdon - et «Club A Gogo» - un hit qui leur va comme un gant, stompé à la bonne franquette et pianoté à la va-vite.
Mais les petits gars de Newcastle vont avoir toutes les peines du monde à tenir bon, sous la pression du succès. Alan Price et John Steel se retirent, remplacés par Dave Rowberry aux claviers et Barry Jenkins (ex-Nashville Teens) à la batterie. Changement de ton, et ça s’entend sur l’album suivant, «Animalism», qui sort en 1966. Le groupe est plus punchy, comme on peut le constater avec «All Night Long» qui ouvre le bal. Dave Rowberry y balance un solo d’orgue enragé et emporté par le délire, Eric chante à gorge déployée. Ils se vautrent une nouvelle fois en tapant dans «Rock Me Baby». Eric prend la version de haut, il jette tout son poids dans la balance, mais ça reste trop appliqué - surtout quand on connaît la version que va en faire le Jeff Beck Group avec Rod the Mod au chant. Hilton Valentine balance un petit solo vicelard, Eric hurle en fin de morceau, mais c’est déjà trop tard. Le gros défaut des Animals, ce fut d’avoir trop souvent les yeux plus gros que le ventre, comme par exemple avec cette reprise de Sam Cooke («Shake») qui fait partie des morceaux intouchables. Ils commettent une nouvelle erreur avec une reprise de «Lucille». On ne touche pas à Little Richard. Puis les malheureux s’attaquent à Wolf («Smoke Stack Lightning») mais c’est la pleine lune et les poils ne poussent pas sur les mains d’Eric. Heureusement, l’un des hits les plus déterminants des Animals se trouve sur cet album : la reprise du «Hey Gyp» de Donovan. Eric la burdonnise. C’est là que s’illustre le génie d’Eric Burdon - please gimme some of your love girl - l’embobineur number one de la perfide Albion. Dave Rowberry entre doucement dans le morceau avec des notes dansantes et Eric fait monter la température de façon prodigieuse - can’t you hear my heartbeat ! - et ils embarquent tout ça dans l’apothéose de l’apocalypse. J’ai le souvenir de ce morceau passant à la radio. Un gros poste de radio trônait dans la cuisine, posé sur le frigo. Ce morceau me rendait dingue.
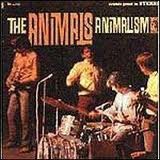
En 1966 sortait «Animalisms», considéré comme leur troisième album, en Europe. On retrouve Barry Jenkins et Chas en grande forme dans «Maudie». Hilton Valentine est passé à la fuzz et il en tartine «Outcast». Fulgurant ! L’overdrive de fuzz et le scorch d’Eric font des ravages. On danse tous dans le temple des silver sixties, ivres d’écho et de stomp. Sur la version de «Sweet Little Sixteen», Hilton balance à nouveau sa purée de fuzz. L’Animal frise la pure démence, pendant que Chas débite un drive d’enfer. D’album en album, les Animals s’amélioraient. Ils devenaient réellement impressionnants. Dans «Squeeze Her Teeze Her», il faut entendre le travail de Chas à la basse, c’est le travail d’un géant, il défonce tout et une fois de plus Mickie Most le met en avant. Chas multiplie les variantes et donne de l’oxygène au morceau. Ils tapent ensuite dans Screamin’ Jay Hawkins avec une reprise de «I Put A Spell On You» et enchaînent avec des gros hits sixties qu’on dansera dans le temple jusqu’à la mort, «That’s All I Am To You» et «She’ll Return It» qu’Eric embarque au firmament des hurleurs.

Pour couronner la première époque, les Animals enregistreront deux autres hits fondamentaux : «Inside Looking Out» - l’archétype de la montée au paradis, oh baby oh baby my rebirth, et la fin en apocalypse avec un Eric real-punk qui va bien plus loin qu’aucun punk n’ira jamais - et «See See Rider» qui reste pour moi la marque jaune des Animals dans l’histoire du rock - pur génie tourbillonnique - (qui était couplé à «Help Me Girl» sur un EP à pochette rouge - l’un des objets les plus brûlants de l’histoire de l’humanité - encore un coup de génie d’Eric qui nous rendait tous dingues - mais dingues à se rouler par terre).

Eric Burdon va se délocaliser - comme on dit aujourd’hui - et s’installer aux États-Unis. Il va remonter une nouvelle mouture des Animals. Barry Jenkins sera le seul rescapé de l’ancienne formule. Ils sortent en 1968 «The Twain Shall Meet», un disque qui se situait dans l’esprit du temps, plus psychédélique. Sur «Monterey», on entend Vic Briggs jouer de la basse et emmener le morceau, partir en vrille et tirer le groove psyché vers des territoires inconnus. Mais le reste de l’album pouvait provoquer un ennui certain et occasionner certains bâillements dignes des hippopotames du fleuve Niger. Toute la pétaudière animalière avait disparu, pour faire place à un son plus expérimental. L’album suivant s’appelait «Everyone Of Us». Eric Burdon est toujours aussi bien entouré : Barry Jenkins, Vic Briggs, et John Weider (futur Family) joue de la guitare comme un dieu. Zoot Money a remplacé Dave Rowberry aux claviers. Le premier grand choc de ce disque vient d’un instrumental, «Serenade To A Sweet Lady», emmené par la virtuosité frileuse de John Weider. On sent à chaque instant ce feeling dans le grattage des notes et ça provoque une sorte de révélation. On y admire la beauté subjuguante des climats. Curieusement, c’est l’un des morceaux les plus beaux d’Eric Burdon, et il ne chante pas. On restera surpris pendant des lustres par la qualité de ce morceau. Eric revient aux affaires avec le fabuleux «Year Of The Guru» - fantastiquement rythmé par sa diction, «My-leader-told-me-to-jump-in-the-river/ The-river-was deep and-the-weather-was-winter/ After-a-sailor-very-kindly-saved-me/ My-leader-told-me you’d-better-take-it-easy/ I-took-it-so-easy my-leader-called-me-lazy» (Mon gourou m’a dit de sauter dans la rivière/ La rivière était profonde et c’était l’hiver/ Un marin m’a sauvé la vie/ Et mon gourou m’a dit de prendre les choses plus légèrement/ Ce que j’ai fait et mon gourou m’a traité de feignant) - John Weider part en solo et Zoot pianote comme un dératé. Avec ces infusions de fuzz, le génie du rock anglais est de retour - «Now listen to this baby/ This-is-the-year-of-the-guru/ Now the-thing-to-do-is-to-ask-yourself/ What-can-a-guru-do-for-me?/ Then-you-say-to-yourself/ I gotta get a guru» (Maintenant écoute-moi bien ma poule/ Voici venu le temps des gourous/ Maintenant, tu dois te poser la question/ Qu’est-ce qu’un gourou peut faire pour moi ?/ Je dois me trouver un goulou-goulou goulou ! I got to get the goulou-goulou et ça finit en apocalypse, qui est le péché mignon d’Eric Burdon. C’est lui le grand finisseur de morceaux devant l’éternel. Il y aussi sur cet excellent album une version hantée de «St James Infirmary» sur laquelle John Weider envoie des lampées de haute voltige.
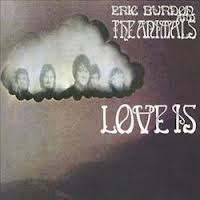
Le dernier album d’Eric avec les New Animals s’appelle «Love Is» et pendant trente ou quarante ans, les impressions sont restées mitigées. C’est un album extrêmement psychédélique avec des longueurs et de purs moments inventifs. «Ring Of Fire» et «Sky Pilot» sont des morceaux connus, mais ce n’est pas ce qu’Eric a fait de mieux, dans sa vie. Par contre «Colored Rain» vaut le détour. C’est une belle pièce de psyché dotée d’un solo bien gras de John Weider. Puis on découvre que ce solo s’éternise et qu’il reste très agréable à entendre, un vrai plaisir, franchement. C’est très sincère. On voit rarement passer des solos comme celui-ci, dans la rue. Il sort de l’ordinaire et dure aussi longtemps qu’un jour sans pain. Méticuleux et beau, languide et lancé vers l’avenir. Eric s’en donne à cœur joie lorsqu’il revient au micro. L’autre grosse pièce de ce double album, c’est «Gemini-The Madman». On se fait avoir et le Madman nous embarque pour Cythère. Le thème mélodique évoque la grandeur des Beatles.
Eric Burdon fait partie des gens qu’on aime bien, et donc, on s’arrange pour ne pas le perdre de vue. Il sera pendant quelques années un ami très proche de Jimi Hendrix. La nuit de sa mort à Londres, Eric le cherchera partout, en vain. Il aura beaucoup de mal à se remettre de cet épisode macabre.
En 1969, il devient le chanteur d’un groupe de funksters noirs (War) qui le recracheront comme un noyau deux ans plus tard, après deux albums et pas mal de concerts.

Les albums d’Eric avec War sont bons, mais il faut accepter le principe de variations sur des thèmes connus, comme «Paint It Black», «Nights In White Satin» ou «A Day In The Life». Les mecs de War jamment plutôt bien, basse, congas, flûte, et embarquent Eric dans des délires latino souvent excitants. La face 1 de «The Black-Man’s Burdon» était torpillée par un solo de batterie, ce qui suffisait, à l’époque, pour condamner tout l’album. Comme beaucoup de gens, je l’ai revendu, puis racheté pour pouvoir réécouter les fantastiques morceaux de la face 2 de ce double album, et plus spécialement «Beautiful New Born Child» qu’Eric chante à l’arrache et qui vire gospel. C’est la perle de l’album. «Out Of Nowhere» est un groove jazzy absolument fabuleux - I live in a notion of time where the past is lost in the future. Sur la face 3, «Sun/Moon» ensorcelle. Encore un groove majestueux, digne de ‘Trane - lay the blues for me ! Et «Gun» sonne comme un hit de James Brown. C’est dire si Eric chante bien. Mais ça, on le savait déjà.

Puis Eric fera quelques tentatives avec le bluesman Jimmy Witherspoon. L’album «Guilty» paraît en 1971. On les entend chanter de très belles choses à deux voix. Eric se sent comme un poisson dans l’eau et ça s’entend. L’ami Witherspoon embarque «Steam Roller» à la puissance des reins et ils tapent ensemble dans le heavy blues avec «Have Mercy Judge» et «Soledad», deux pièces de choix (très politisées) vraiment conseillées aux amateurs de heavy blues. Difficile de faire plus heavy. «Guilty» reste l’un des grands albums d’Eric Burdon. Ce fut pour lui une manière de revenir aux sources. Il monta ensuite The Eric Burdon Band avec une sorte d’enfant prodige de la guitare électrique, Aalon Butler. L’album «Sun Secrets» sortit en 1974. Eric allait cette fois sur le rock psychédélique et à l’époque, on est resté sceptique, malgré tout le buzz créé par la presse rock américaine autour de ce disque. Ce fut un peu le même problème qu’avec «I’m Back And I’m Proud» de Gene Vincent, dont on attendait monts et merveilles. En ces années-là, on écoutait tellement de bons albums qu’on devenait horriblement difficile. Le buzz créé autour de «Sun Secrets» retomba comme un soufflet. Schlouffff ! Eric avait cherché à rallumer le feu sacré en réinjectant de l’électricité dans «It’s My Life» et dans «Ring Of Fire». Il relevait un peu le niveau de l’album avec «The Real Me». Il y retrouvait sa carrure de géant. Même si l’album décevait un peu, on en revenait à la même conclusion : Eric Burdon était l’un des plus grands chanteurs de l’histoire du rock. Derrière lui, l’ami Butler reproduisait à la perfection les thèmes mélodiques des vieilles chansons et jouait la carte obsédante de l’omniprésence. On sentait qu’Eric passait à deux doigts du coup de génie.

Rebelote avec «Stop», sorti par la maison de disques en 1975. Ce sont des morceaux tirés des sessions de «Mirage», le double album prévu initialement. «City Rock» et «Gotta Get It On» sont des classiques burdonniques bien troussés, solides comme le roc, toujours intéressants comme le sont les morceaux de «Love Is». On part à l’aventure. On découvre. Eric embarque tout à la voix. C’est sa force. «I’m Lookin’ Up» est un gros groove funksté à la Burdon, finement emballé et nappé d’orgue, supérieurement chanté. Le grand Eric survole la terre, plein de majesté et d’ampleur. «All I Do» tire son riff de «Who Knows» du Band Of Gypsies et sur la face B, «Funky Fever» tape dans le mille, heavy comme l’enfer, idéal comme peut l’être le gendre qu’on reçoit à sa table. Eric chante avec sa tripe et les riffs tâchent la nappe. «The Way It Should Be» sonne comme un Zappa cut - n’oublions pas qu’Eric et Frank étaient liés - on sent dans ce morceau la présence des bêtes de Gévaudan. Pas de pitié pour les notes boiteuses. Ça file avec un solo rouge.
Les Animals se reforment en 1977 et enregistrent deux albums catastrophiques, «Before We Were So Rudely Interrupted» et «Ark». Catastrophiques parce que sans surprises. Pourtant on est content de revoir la formation originale, sur la pochette. Chas Chandler y a une fière allure. Sur Before, ils massacrent le «It’s All Over Now Baby Blue» de Dylan et pas mal de morceaux sont d’une rare inutilité. Eric Burdon tape dans Jimmy Reed avec une reprise de «As The Crow Flies», mais c’est un peu mou du genou. Le seul morceau sauvable de Before, c’est «Please Send Me Someone To Love», une reprise de Curtis Mayfield, dans laquelle Alan Price fait un solo d’orgue fabuleux. L’album n’avait aucune chance, car les Damned et les Pistols sortaient leurs albums la même année.
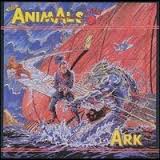
En 1977, Eric enregistra aussi l’album «Survivor». Ce disque a deux particularité. Il propose un superbe livret dont Eric signe les illustrations, et la plupart des morceaux sont signés Zoot Money, et c’est peut-être bien là que se situe le problème, car l’album est particulièrement insipide. On y entend des boogies qui n’ont aucune incidence sur l’avenir de l’humanité. Dommage, car Maggie Bell et PP Arnold font les chœurs. Le morceau sensible de l’album pourrait bien être une reprise de Brownie McGee, «I Was Born To Live The Blues», qu’Eric chante avec classe. Même chose pour le dernier morceau, «Po Box 500» : une histoire de taulard superbement chantée. Mais deux morceaux, ça ne sauve pas un album.
Il revient en 1980 avec «Last Drive» et une pochette fabuleuse digne du «Accelerator» de Royal Trux : l’illustration montre un mec au volant et sa passagère. L’album est massacré par une production «années quatre-vingt». Le premier morceau qui partait bien vire à l’heroic fantasy celtico-proggy à la Stivell. Effet dramatique. Eric tente de sauver quelques morceaux au chant, mais les prismes se fondent dans les miroirs, ce qui entraîne l’annulation de tous les effets. Sur «Dry», Eric revient à l’une de ses spécialités qui est le talking-blues. Il chante comme un géant, mais une horrible connasse vient hurler dans le fond du studio et ruine tous les efforts du pauvre Eric. Sur ce disque, tout vire au fucking rock FM. Un seul morceau échappe au carnage, le dernier : «The Last Poet». Il fait le taf tout seul, accompagné d’une basse et ça donne une ambiance vaudou. Il est le seul à pouvoir réussir un coup pareil.
1980 toujours, avec «Darkness Darkness» qui part mal, avec un son celtico-funky à la con. Mauvais contexte, mauvaise période. Ça ne peut pas fonctionner, même avec la voix qu’il a. Mais on écoute, car c’est Eric Burdon. Il retape dans Jimmy Reed avec une reprise de «Baby What’s Wrong», et là, il ne rigole plus. Le backing est bien propre sur lui, avec des pianotis de m’as-tu-vu et une rythmique bien lisse. Dommage. La version est bien trop polie pour être honnête. On appelle ça le boogie du dimanche. Encore un disque massacré par l’horrible production «années quatre-vingt». Tout est cousu de fil blanc et affreusement prévisible.
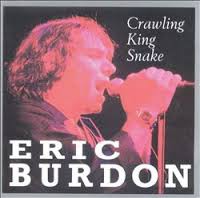
En 1982 et 1983, il parvient à caler deux bons albums : «Power Company» et «Comeback». On retrouve le Burdon qu’on aime, celui du rock trad et du blues rock. Vous trouverez trois gros trucs sur Power. D’abord un bluesy cut joué à la slide, «You Can’t Kill My Spirit». C’est du solide, du Eric-talkin’ - you can kill my body but - il hurle comme il faut et se racle bien la glotte. On retrouve l’immense Animal-shouter. L’autre grosse pièce de cet album s’appelle «Wicked Man», une fois de plus noyé de slide énervée. Idéal pour les amateurs de rock classique bien chanté. Il est à la fois Eric Burdon, Johnny Winter et Albert King, sur ce cut. Vraiment, ce mec est très fort. «Who Gives A Fuck» est l’un de ces gros heavy blues dont Eric raffole. Il est bien entouré, d’où la puissance du morceau, même si c’est cousu de fil blanc comme neige. Sur «Comeback», on trouve aussi trois grosses pièces qu’on ira écouter, si on aime bien ce petit mec. «No More Elmore» est une véritable merveille. Comme l’indique le titre, c’est un hommage à Elmore James : «Juste après avoir quitté l’école/ J’ai commencé à travailler/ Un jour je suis rentré chez moi/ Après une dure journée de travail/ J’ai pioché dans ma collection de blues/ Je voulais me reposer/ Et j’ai entendu qu’Elmore James était mort/ J’avais perdu un ami.» On reste dans le pur jus du blues avec «Crawling King Snake», un morceau déjà repris par Jim Morrison sur «LA Woman». Eric en fait une mouture primitive en diable - «I’m a crawling king snake baby/ And I rule my den» - il frise carrément le génie avec cette version et se fend d’un clin d’œil au Roi Lézard avec la fin du dernier couplet - «And we checked into the Chateau Marmont/ Sunset Boulevard/ Outside the windows cars». Petite reprise de «It Hurts Me Too» d’Elmore James pour la route et une fantastique balade océanique à la Burdon ferme le bal, «Bird On The Beach».

Il va encore frôler la catastrophe en 1988 avec l’abominable «I Used To Be An Animal» qui suivait de près la parution de son autobiographie. Avec cet album, il cédait aux sirènes de la mode, et à l’époque, elles avaient une sale gueule, puisque tout le monde écoutait Michael Jackson et trouvait ça bon. Eric a beau gueuler comme un veau dans «Goin’ Back To Memphis», on éprouve beaucoup de mal à lui pardonner cet écart. Lux Interior ne serait jamais allé dans ce type de production, même si un affairiste véreux lui avait fait miroiter des ventes spectaculaires et les millions de dollars qui vont avec.
En 2000, il sort «Lost Within The Halls Of Fame» et attaque avec un horrible rap. On reste donc dans la série noire. Par contre, son «New Orleans Rap» monté sur une ligne de contrebasse est une vraie merveille. Diction parfaite, on sent le retour du géant - hey music lover, take me to your places - et il boucle son affaire dans la pure Broadway fashion. Sur «Brand New Day», il refait son numéro de puissant chanteur indomptable, mais c’est tatapoumé à outrance. Tout au long de ce disque, il joue avec les genres, le disco, le funk, l’africain, le reggae, et - last but not least - on retombe sur des morceaux de l’album précédent. Berk.
Il faut attendre 2004 pour retrouver l’Eric de rêve. Il se trouve sur «My Secret Life». Avec son gros groove, «Highway 62» sonne comme un bel hommage à Gram Parsons. On sent le grand Burdon de l’entre deux eaux. Il rend un fantastique hommage à Chet Baker avec «Jazzman». «Heaven» est un morceau pourri de feeling. La voix d’Eric y vibre dans l’air chaud. Retour aux coups de Trafalgar avec «Devil Slide» : «You recall Big Red ?/ He spent most of his life out on the road/ Searching for that enigmatic devil slide but he could never forget/ What Muddy said : Glass is best/ We was on that midnight train, driving to San Sebastian, Spain/ When he took a dead bottle of Beaujolais/ Slipped his ring finger into its neck and broke off the remains/ Then he looked at me with a gleam in his eyes and said/ Eric, look out here comes the devil slide» (Vous vous souvenez de Big Red ? Il a passé sa vie sur la route à chercher le secret du slide du diable et il n’a jamais oublié ce que lui avait dit Muddy : le mieux, c’est le verre/ On était dans un train qui allait à San Sebastian en Espagne/ Il a pris une bouteille de Beaujolais, a glissé son doigt dedans et a cassé la bouteille/ Il s’est tourné vers moi, l’œil brillant et il m’a dit : Eric, voilà le slide du diable.) Morceau absolument remarquable. Puis il renoue avec le génie en rendant hommage à John Lee Hooker dans «Can’t Kill The Boogieman». Il veut carrément John Lee Hooker comme Président. Il fait littéralement exploser le morceau. C’est le plus grand hommage jamais rendu à John Lee Hooker.

On reste dans la même veine avec «Soul Of A Man» paru en 2006. Il tape dans le gospel chanté à deux voix et monté sur un groove de basse éléphantesque. C’est admirable. Eric s’arrache la gorge. Il fait son numéro de shouter-preacher et nous réconcilie avec la vie. Avec «Kingsize Jones», il passe au groovy-funk hyper-lourd et s’intéresse à l’entre-jambe de sa copine - «I worship the temple between your legs». Il aligne ensuite une reprise de Fred McDowell, «Red Cross Store», fabuleux jump blues puissamment stompé. Il chante ça à pleine poitrine, en pleine force de l’âge, derrière c’est battu à la forge - c’est même chanté à la forge - Eric le Viking bat l’enclume - Stone no more ! On va de surprise de taille en surprise de taille, sur cet album. Eric balance «Como Se Llama Mama», un boogie gras riffé sur un trombone à coulisse. Son «Feeling Blue» sonne comme le fantastique «Bigtime Operators» de Van Morrison. Belle dose de heavy blues avec «GTO» et reprise cuivrée du «Forty Four» d’Howlin’ Wolf. Pur génie d’interprétation. C’est rudement battu et secoué au tamis de plâtrier. Hallucinant. Son «I Don’t Mind» est un slow plein comme un œuf et il finit avec un boogie des enfers qui s’appelle «Circuit Rider».
Esoteric records fit paraître en 2009 un album inédit d’Eric Burdon, la fameux «Mirage» qui devait initialement sortir sous la forme d’un double album et qui fut enregistré pour faire la BO d’un film. Retour aux seventies avec ce gros rock électrico-funky du Eric Burdon Band qui reposait uniquement sur les qualités du chanteur Burdon. «Mind Arc» est un bon gros heavy blues savamment gratté à la guitare. Tous les morceaux de l’album s’ancrent dans le même genre de groove qu’Eric tire derrière lui, comme une locomotive. Pour l’anecdote, les paroles du morceau «Mirage» sont signées Jimi Hendrix.
Eric revient à l’inspiration séculaire avec son dernier album, «‘Til Your River Runs Dry». Hormis le coup de chapeau à Bo Diddley, on trouve sur ce disque deux ou trois pièces qui vont remettre du baume au cœur des vieux fans des Animals. On retrouve la voix incroyablement colorée d’Eric, reconnaissable entre toutes. Dans «The Devil & Jesus», il fait le clown avec sa glotte. Mine de rien, il nous renseigne sur sa façon d’être, illustrant le rôle que jouent le bien et le mal chez lui, comme Hergé le fit jadis avec l’ange gardien et le diable qui dialoguaient au-dessus de la tête du capitaine Haddock. Fallait-il ouvrir une bouteille de rhum ? Oui, évidemment, car tout vient de là. Du rhum. Sur la face B se trouve une autre prouesse signée Eric Burdon. C’est un grand talking-blues intitulé «Invitation To The White House». Ambiance jazzy-bluesy, celle qui lui va comme un gant. Et c’est fantastiquement vivant, faramineusement bon, autant que le Bo Diddley Special. Eric raconte son rêve. Le président l’a invité à la Maison Blanche et lui dit ceci : «Eric I’m sure glad you are here/ I’ve inherited a country that’s running wild/ he said I’m so frustrated I’m asking you for your advice» (Eric, je suis vraiment content que vous soyez là/ J’ai hérité d’un pays qui ne tourne pas rond/ Je suis tellement paumé que j’aurais bien besoin de vos conseils). Eric nous embarque alors dans son délire fabuleux. Il chante merveilleusement bien, il imite la voix d’un Président farfelu, et derrière, ça joue. Il en profite pour ressortir son vieux couplet anti-guerre : plutôt que d’aller guerroyer en Asie, pourquoi ne pas commencer par faire le ménage chez soi et faire la guerre à tous ces gangs qui font régner la violence dans les rues des villes d’Amérique ? «I know Mr President/ You’ve been given a loaded hand/ And war is our culture/ Ever since the world began/ I said bring them troops home/ And let’s fix that country first/ We have the right to happiness/ But you gotta get down in the dirt» (Je sais Monsieur le Président/ Que vous avez le doigt sur la gâchette/ La guerre est notre culture/ Depuis le commencement du monde/ Alors faites rentrer les troupes au pays/ Et commencez par nettoyer ce pays/ On a le droit de vivre heureux/ Mais vous allez devoir mettre les mains dans la merde). Sacré Eric, il réussira à nous épater jusqu’au bout.

L’Olympia était plein comme un œuf, par ce beau soir de novembre. Pas mal d’ex-fans des sixties, comme dirait Gainsbarre. Il y avait aussi pas mal de monde sur scène : deux guitares, deux claviers, drums, percus et basse. Morceau de welcomage et soudain on a vu arriver un petit bonhomme. Il courait presque, court sur pattes, en veste, T-shirt, foulard et lunettes noires. Eric Burdon, soixante-douze ans, voix intacte, légende vivante, survivor, mémoire du swinging London. Dès le deuxième morceau, il nous met au tapis avec une version monstrueuse d’«Inside Looking Out» - oh baby oh baby my rebirth ! - on sent couler la sève des sixties dans nos veines, on tape du pied comme un forcené et on beugle avec Eric, parce que c’est tout ce qu’il reste à faire - my re-birth ! my re-birth ! Même chose que lorsqu’on entend I Can’t get no ou People try to put us down, on ne peut pas résister. Secouage de tête, les cheveux dans les yeux. La magie des sixties est la plus puissante de toutes les magies connues. Évidemment, il va chanter «Don’t Let Me Be Misunderstood» et «House Of The Rising Sun» - que le public reprend en chœur, on ne pouvait pas échapper à ça. Il va même y avoir des longueurs, des morceaux un peu plus mous du genou, puis soudain on se réveille avec le «Bo Diddley Special» tiré de son dernier album et là, ça redevient sérieux. On retrouve l’Animal de 1964, petit, boutonneux, mal coiffé et disgracieux qui indisposait les dandies londoniens. Il enlève sa veste. Comme il ventripote un peu, son T-shirt passé par dessus le pantalon tombe à mi-cuisses. Il est comme une petite boule montée sur deux courtes jambes noires. On déteste voir les gens qu’on admire vieillir. On refuse de voir les dernières photos de Jerry Lee ou de Keith Richards. Ils sont trop amochés, alors on reste sur les bonnes images. Pareil pour Eric Burdon, même s’il déambule sous nos yeux, il reste ce petit mec au regard vif et mal coiffé photographié dans un champ avec ses copains de Newcastle. En rappel, il va balancer une version de «Boom Boom» ruinée par un long passage instrumental à la mormoille et «I’m Cryin’» - torpillé lui aussi par un solo de batterie - que tout le monde attendait. Puis on traverse le grand hall en sens inverse pour rejoindre le boulevard et on va casser la graine. Alors, on lève son verre de pinard à la santé d’Eric et on lui dit : «Tiens le coup, petit bonhomme, nous sommes encore tous là.»

Signé : Cazengler, animal de compagnie
Eric Burdon & The Animals. Olympia. Paris IXe. 26 novembre 2013
The Animals. The Animals. MGM Records 1964
The Animals. Animal Tracks. MGM Records 1965
The Animals. Animalism. MGM Records 1966
The Animals. Animalisms. Repertoire 1999
Eric Burdon & The Animals. The Twain Shall Meet. MGM Records 1968
Eric Burdon & The Animals. Every One Of Us. MGM Records 1968
Eric Burdon & The Animals. Love Is. Barclay 1968
Eric Burdon & War. The Black-Man’s Burdon. Liberty Records 1970
Eric Burdon & War. Love Is All Around. ABC Records 1976
Eric Burdon & Jimmy Witherspoon. Guilty ! MGM Records 1971
The Eric Burdon Band. Sun Secrets. Capitol 1974
The Eric Burdon Band. Stop. LA Records 1974
The Original Animals. Before We Were So Rudely Interrupted. Barn Records 1977
Eric Burdon. Survivor. Polydor 1977
Eric Burdon’s Fire Department. Last Drive. Melting Sound Music 1980
Eric Burdon. Darkness Darkness. Polydor 1980
The Eric Burdon Band. Comeback. Line Records 1982
The Eric Burdon Band. Power Company. Teldec Records 1983
Eric Burdon. I Used To be An Animal. Prime Cuts 1988
Eric Burdon. Lost Within The Halls Of Fame. Jet Records 1995
Eric Burdon. My Secret Life. SPV Recordings 2004
Eric Burdon. Soul Of A Man. SPV Recordings 2006
Eric Burdon. Mirage. Esoteric Recordings 2009
Eric Burdon. ‘Til Your River Runs
LAGNY SUR MARNE / 29 - 11 - 13 /
LOCAL DES LONERS
GHOST HIGHWAY
Jusqu'à maintenant Mumu a assuré comme Elvis sur son premier 78 tours Sun, nous a emmenés tout droit à Lagny par des routes qui ne sont même pas répertoriées sur les cartes de l'Institut Géographique National, mais dans la zone industrielle elle hésite un peu. Le GPS de secours patauge dans le vermicelle depuis dix minutes, mais non, Dieu tout impuissant n'abandonne jamais les rockers, hosanna sur les sistres et les encensoirs comme dit le grand Stéphane, patronymiquement Mallarmé, le local des Loners, tel un bunker de béton perdu dans la brume océane, se profile à l'horizon.
Quelques perfectos fantomatiques se pressent vers l'entrée illuminée. Fait frisquet et les nouveaux arrivants se ruent à l'intérieur. Me retrouve tout seul dans la nuit noire. L'occasion idéale de vider ma vessie incognito sur une palissade branlante. Mesdemoiselles, un peu de tenue, je vous en prie ! Je m'apprête à dégainer lorsque mon sang se fige et une rage citoyenne s'empare de moi. Mais que fait la police !
ROM – POINT
Je ne rêve pas. Cette lueur tremblotante au bout de ces ornières boueuses, et cette caravane en mauvais état, ce silence pesant à neuf heures du soir, c'est bien un ramassis de roms qui squattent un improbable terrain non viabilisé ! Par quelle inadvertance préfectorale sont-ils encore là ? Pourquoi les pelleteuses et nos CRS bien-aimés n'ont-ils pas accompli leur travail ? C'est pourtant facile de pratiquer un ratissage au bulldozer, en plus c'est vachement marrant, les femmes crient, les enfants pleurent, l'on a le droit de matraquer les hommes qui râlent, et l'on est sûr de gagner à tous les coups que l'on distribue gratuitement. Ca rappelle le bon vieux temps, des années 40, à la différence près qu'en cette magnifique époque les autorités léchaient les bottes des envahisseurs. Faut reconnaître qu'une panzer-division, ça ne rompt pas aussi facilement qu'une cabane en tôle ondulée. C'est bien connu, vaut mieux s'en prendre aux plus faibles qu'aux plus forts. L'Europe commence à puer salement des pieds. L'on ne combat pas la misère, l'on pourchasse les pauvres. Par contre la porte est grande ouverte pour la fuite des capitaux et des usines que l'on remonte ailleurs. Pas d'étrangers chez nous, c'est nous qui irons les faire travailler chez eux. Mais laissons-là ces tristes pensées. Nous sommes ici pour écouter du rock and roll. Vous savez cette musique inventée de toutes pièces par des émigrants qui fuyaient d'abominables conditions de vie de par chez eux. Tellement fauchés qu'ils ont dû emprunter un max d'éléments à des noirs encore plus pauvres qu'eux...
LONERS

Deux fois que l'on vient et deux fois que l'accueil est plus que sympathique. Rien à dire les Loners sont sympas. En plus ils écoutent de la bonne musique. Sans sectarisme beaucoup de rockabilly et de rock'n'roll mais Roland, le Prez, nous prévient que ce printemps nous aurons droit à un cycle hard. Ce qui ne me déplaît pas fondamentalement. Les Loners sont ouverts, reçoivent tout le monde dans leur local. Roland a cette magnifique parole « Je suis rocker avant tout, biker aussi, mais ce qui m'intéresse avant tout c'est l'être humain ». Saine philosophie avec laquelle je me sens pour ma part tout à fait en accord.
PREMIER SET
Beaucoup de monde. La salle est pleine comme un CD de trente-quatre titres, les Ghost sont sur la scène, un peu juste. Faudra tortiller du cou pour apercevoir Phil. Difficile de se frayer une place au premier rang. Tant pis, d'autant plus que la guitare de Jull résonne comme jamais. Plus électrique, plus cisaillante. A croire qu'il a changé ses réglages ou alors l'étroitesse de la salle qui comprime et durcit le son.

Mais ce soir celui qui donne le ton, c'est Arnô, une pêche extraordinaire, juteuse. Il ne chante pas, il se balade sur les morceaux. Emporte tout avec une facilité extrême. Survolté, il lâche entre deux hymnes rockabilly un de ses commentaires idiots dont il a le secret, tellement stupide que vous êtes obligés de rire, et le voici reparti au galop. N'y a qu'à entendre la manière dont il prononce le nom de Johnny Cash pour comprendre combien ce soir son âme virevolte en liberté telle un papillon ivre de whisky de contrebande au dessus de Folsom Prison. Blues joyeux...

Les Ghosts puisent pas mal dans leur dernier disque. Julien donne la réplique à Arnaud sur le Tired and Sleepy des Cochran brothers, et l'on frôle la félicité. Serais prêt à parier que Hank Cochran n'y a jamais mis autant de fougue. Moment de panique dans ma tête, chacun a chanté son couplet de Hello Mary Lou de Ricky Nelson, mais ensuite gratouillent consciencieusement leur swinguin'guitar, la bouche fermée, alors qu'une voix off nous offre en cadeau surprise la troisième strophe , cherchez l'erreur. J'ai trouvé l'intrus, c'est Phil qui nous gratifie d'une intervention impeccable.

Honhy Tonk, hurle Arnô speed sans préavis, s'est armé d'un harmo et le voici qui batifole sur d'exubérantes trilles, pendant que les autres se préparent pour l'autoroute fantôme, Arno se la joue toréador avec un peu de flamenco et puis glisse inexorablement vers des arpèges plus bluesy, nous sommes prêts pour l'autostrade du souvenir. Ca ressemble à une plaisanterie mais dans le fond c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. Blues et country sont congénitalement mêlés à la naissance. La chienne Amérique s'est faite couvrir par un mâtin aussi noir que la nuit et un autre plus blanc que deux western barrels, mais les deux bâtards qui sont nés de deux pères différents ont bien été recueillis dans la même matrice. Frères utérins.

La plus belle image du concert sera de Zio, accoudé sur sa basse, tête baissée, repliée sur lui-même, tout comme le penseur de Rodin, avant qu'il ne sorte de son rêve et que ses doigts n' égrènent les notes lourdes et lentes qui densifient le final de Lost Highway.
DEUXIEME SET

Tiens, les Ghost sont devenus le club des cinq. L'on a beau compter et recompter sur nos doigts, il y a un mec avec une guitare en plus, à côté de Zio. Ne se débrouille pas mal d'ailleurs, un jeu qui a tendance à fluidifier la guitare de Jull, mais ce n'est plus tout à fait les Ghost. C'est Arnô qui nous délivrera la clef de l'énigme, c'est Mister Jack, le guitariste de son ancien groupe Austin.

Ont joué longtemps durant le premier set, referont quelques morceaux, notamment le splendide Because I Forgot de Jull. Qui n'a qu'un seul défaut, trop court. Passe trop vite, l'on aimerait retenir cette mélancolie brute qui s'abat sur vous comme un chagrin d'amour, mais l'on n'a pas le temps de lécher nos délicieuses blessures suppurantes, celles dont on espère qu'elles ne se refermeront jamais.

Finissent le set en promettant de revenir pour un petit rappel. Bluffant, excitant et impeccable en même temps.
PETIT RAPPEL

Pour un rappel, ce fut un rappel. Presque une heure. Dans une ambiance de folie. Au bout de quatre morceaux, ils demandent à Titus, non pas l'empereur romain, mais un ancien du Golf, de les rejoindre sur scène. Ne vient pas seul, emmène avec lui son harmonica et c'est parti pour une demi-heure de boogie blues. Mérite le surnom du fils de Vespasien, le délice du genre humain, car il nous sert une confiture d'airelles bleues dont on se serait nourris jusqu'au petit matin. Dingue comme il s'intègre dans le rockab des Ghost, trouve toujours la porte d'entrée pour prendre sa place. Ne prend pas les escaliers de secours de l'old cow-country, impose sa marque bleue acétylène, Chicago indélébile. Un moment de grand frisson. Rage noire.

Mister Jack revient, les Ghost sont au bout du répertoire. Comme cadeau d'adieu ils nous offrent un Jump Jiggles and Shouts de Gene Vincent revisité à l'harmonica. C'est l'orgue à bouche qui se charge des brisures de rythme et des fulgurantes reprises, le dialogue guitare / batterie étant relégué comme au second plan. Curieux, intéressant et déroutant, comme toute nouveauté. Ca passe comme une lettre à la poste. Plus un petit Flyin' Saucers pour la route.

Descendent de leur piédestal sur les rotules. Ils ont tout donné. On a tout pris.
Damie Chad.
( Les photos ont été empruntées, elles sont de Martine Fifties, sur son Facebook )
CHRONIQUES VULVEUSES
TREIZIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
40
« Hi ! Hi! Hi »
Un ricanement que j'avais du mal à supporter. Une limousine noire freinait au bas des marches. Une vitre teintée s'abaissa, à peine, une fente, assez large pour laisser passer le bout du museau d'une kalachnikov, cette fois nous étions cuits. Le Proc n'avait pas dit son dernier mot. Devait être sacrément haut placé pour s'offrir trois petits refroidissements dans la cour du palais présidentiel. Le Chef se saisit d'un de ses Coronados. Je ne sais pas quelle surprise il nous réservait, car il n'eut pas à s'en servir. Une deuxième grosse cylindrée vint se ranger derrière celle du proc. Et comme une nuée de sauterelles s'abattant sur le dernier champ de maïs du Biafra lors de la grande famine, une horde de journalistes surgie de nulle part montèrent à l'assaut de la voiture. Télés, radios, quotidiens, hebdomadaires, une foire d'empoigne pire que l'ouverture des soldes aux Nouvelles Galeries. Nous ne voyions rien, mais c'était une véritable échauffourée devant les portières arrachées. A coup sûr le scoop de la semaine. Nous essayions de nous défiler en douce lorsque dans le brouhaha s'éleva un cri d'angoisse. Manifestement une jeune femme criait à l'aide.
En parfait gentlemen que nous étions, nous nous précipitâmes dans la mêlée, le chef armé d'un coronado 45 fendait les crânes sans rémission, j'envoyais de terribles manchettes sur les journaleux et Claudius ne se débrouillait pas trop mal ayant sorti de sa poche, une de ses dernières inventions, un distributeur automatique de coups de pieds au cul, ma foi assez efficace. En trois minutes nous étions maîtres de la situation. Nous pûmes alors d'un même mouvement nous pencher vers l'intérieur de la voiture. Trois petites oiselles recroquevillées sur leurs sièges levèrent des yeux éperdus de reconnaissance. Caramba ! Que bellisimas estan ! Le Chef offrit son bras à la brune piquante, Claudius se précipita vers la rousse incendiaire, et moi j'héritai de la blonde pulpeuse.
« Mesdames vous ne craignez plus rien, nous allons vous conduire en sécurité ! » Parfaitement rassurée par l'onctueuse voix cérémonieuse du Chef qui agit comme un calmant, les trois poupées nous prirent par le bras sans aucune crainte et nous entreprîmes de monter les marches en un galant cortège. Les journalistes claudiquants s'étaient regroupés en haut de l'escalier. Le commentateur de la chaîne nationale entama son laïus : « Ici Télé Tépabo, les six nouveaux ministres du gouvernement, entrent en ce moment même à l'intérieur de l'Elysée. Devant l'urgence de la situation, il n'y aura pas de réception en leur honneur, le Conseil des Ministres débutera à dix heures précises. »
Des huissiers nous menèrent par d'interminables couloirs. Nous en profitâmes pour lier davantage connaissance. « Oui, disait le Chef, chère Roselyne, je me sens seul, depuis que ma femme a été mordue par un coronado, un terrible serpent mexicain, el serpiente secunda, comme on l'appelle dans ce pays maudit où nous nous étions inscrits dans un voyage touristique, qui vous tue en une seconde... mais depuis que je vous ai vue, j'ai su que j'étais prêt à affronter tous les coronados du monde, rien que pour le plaisir d'entrevoir le jade de vos yeux s'illuminer !
-
Ô valeureux chevalier, je sais que vous ne mentez pas, que sans votre intervention, je serais morte étouffée ! Je donnerai mon âme et mon corps pour vous remercier, doux sauveur !
-
Je ne saurais vous priver de votre bien le plus précieux, je me contenterai de votre corps, inestimable trésor rougeoyant telle une fournaise de désirs. »
Claudius n'était pas en reste « Comment vous remercier ? susurrait la brunette
-
Êtes-vous folle ! Vous ne me devez rien. Vous avoir sauvée n'est pas un bonheur, mais un honneur. Toutefois, puisque vous insistez, je me contenterais d'une modeste obole, une mince mèche de votre toison pubienne – je la devine aussi mystérieuse que la nuit – ne pensez-pas que je sois un pervers, mais dans mon antre solitaire là-bas, au fin fond de l'Ariège, je me suis donné une mission, préserver un spécimen de la touffeur de chaque vulve qui passe à ma portée, le tout afin de léguer à l'Humanité future, en un herbier vulvestre unique au monde, un assortiment des teintes les plus merveilleuses de l'intimité féminine, je...
-
Je sacrifierai volontiers à la récolte de cette manne, à la seule condition que ce soit vous qui tinssiez, la serpe d'or du recueillement intime, cher affabuloscopeur.
Pour ma part j'avais récupéré Molossa dans le creux de mes bras. Elle connaissait sur le bout de ses pattes le processus à suivre. Elle inclina sa tête sur la poitrine de ma belle blondinette.
-
Voyons Molossa, on ne se comporte pas ainsi avec les dames, ôte ta truffe poisseuse de là, et je glissai ma main dans l'échancrure du corsage afin d'éloigner l'intruse.
-
Non, non laissez, j'adore les bêtes, ce n'est pas la peine de retirer vos doigts non plus. Depuis que je suis prêt de vous, je me sens tellement mieux.
Nous arrivions devant la salle du conseil. Un huissier s'interposa « Les chiens ne sont pas admis qu'elle attende devant la porte ! C'est le règlement » D'elle-même Molossa s'assit, mais à la lueur de ses yeux je compris qu'elle réservait un homme de sa femme à ce fonctionnaire trop zélé.
Au bout de la table il restait six fauteuils vides. Nous nous assîmes et regardâmes nos pairs. Costume, cravate, gueule de tarés congénitaux, le genre de bobeaufs qui n'ont pas l'habitude de traîner dans les concerts rock. J'en étais là de mes analyses lorsque tout le monde se leva. C'était le Président. Le front bas et l'air vaguement idiot. Il tenait sous son bras une tablette informatique dont il ne savait quoi faire. Il résolut de la déposer contre un des pieds de son fauteuil.
« Asseyez-vous. L'heure est trop grave pour que nous perdions du temps à présenter les nouveaux nominés. Monsieur Le Premier Ministre, voudriez-vous s'il vous plaît poser les problèmes un à un que je puisse indiquer les solutions idoines.
-
Des broutilles pour commencer, Monsieur le Président, dix millions de pauvres dans le pays.
-
Parfait, l'important est qu'ils gardent l'espoir de devenir riches. Le rêve est toujours préférable à la réalité.
-
Dix mille ouvriers réduits au chômage chaque jour.
-
Parfait, dans trois ans nous aurons résorbé la classe ouvrière en son entier. Qui pourrait s'opposer à ce que nous éradiquions les populations les plus fragiles de notre pays !
-
Certains jusqu'aux boutistes menacent de manifester dans l'ordre et la dignité !
-
Au moins on payera les CRS pour quelque chose. Rentabilité maximale. Mais vous vouliez, je crois, Monsieur le Premier Ministre, nous entretenir d'un problème nettement plus important que ces misérables affaires courantes que nous venons de traiter avec toute la pondération politique nécessaire.
FIN DU TREIZIEME EPISODE
CHRONIQUES VULVEUSES
QUATORZIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
41
Le premier ministre se leva. Debout sous sa calvitie il avait l'air de ce qu'il était réellement, un avorton méphitique, un sale trouduc venimeux qui aurait été bien mieux à sa place dans un cul de basse-fosse.
-
Monsieur le Président, messieurs les Ministres, le pays court à la catastrophe. Certes nous avons triomphé de par le passé de graves menaces, je me permettrais de citer afin de raviver votre mémoire, communistes révolutionnaires, syndicats d'action directe, terroristes, qui tous ont été réduits grâce à une lutte sans merci et une vigilance sans défaut à ne plus représenter que de minuscules franges de l'électorat citoyen. Hélas, l'hydre de l'anarchie renaît sans cesse de ses cendres, coupez une tête, il en repousse cent. Les foyers de rébellions se multiplient. Nous avons récemment engagé un combat sans merci contre les deux plus importants foyers d'infection galopante.
Un murmure d'inquiétude s'éleva de l'assistance apeurée suspendue à ses lèvres.
-
Je suis à même de vous révéler les premiers reculs de nos adversaires. Nos Services Secrets ont parfaitement réussi leur grande manipulation sous-titrée La Conjuration Vulveuse. L'Affabuloscope du Mas d'Azil est aux abois. Son créateur se voit dans l'obligation de le revendre. Je vous rappelle que nous avons voulu faire un exemple. Claudius de Blanc Cap fait partie de ces artistes qui par leur travail de sape méthodique mettent en doute le bien-fondé de la nature accaparatrice de notre Système Libéral. Tout artiste qui refuse de se soumettre aux diktats de la Société est un ennemi intérieur. Platon ne refusait-il pas aux poëtes, le droit d'entrer dans la Rébublique idéale ? Soyez sûrs que les mésaventures de ce Claudius, dès qu'elles seront portées par nos soins à la connaissance du public aideront à freiner l'ardeur de l'esprit critique des autres artistes. Ils nous mangeront bientôt dans la main et ne cesseront de vanter nos mérites.
Des applaudissements polis vinrent clore la première partie de l'exposé du prunch ministre.
-
Ces maudits artistes ne sont pas les seuls à s'opposer à la liberté républicaine. Nous avons dû éliminer le SSRR, les services secrets du rock'n'roll, mis en place par un précédent gouvernement imprévoyant. Ce n'est que le début, d'ici quelques mois nous diminuerons de moitié, sous le faux-prétexte de pollution sonore, la possibilité de promouvoir des concerts de groupes de rock sur le territoire national. Notre saine jeunesse privée de tels lieux de perditions retrouvera ainsi le chemin de l'obéissance passive. Les radios sont à nos bottes. Le...
La porte s'ouvrit brutalement. « Hi ! Hi ! Hi ! j'étais sûr de les trouver ici. » C'était le proc, vous l'avez deviné. Derrière lui s'affichait le sourire penaud de trois jeunes gens à l'air niais.
-
Agent 008, Monsieur le Président, en tant que chargé par votre auguste personne de veiller sur votre sécurité, je me permets de vous ramener les trois vrais nouveaux ministres, retardés par des encombrements incompréhensibles sur le Périphérique. Les trois zigotos mal fringués qui occupent leur place sont des imposteurs que je vais me faire un plaisir d'éliminer sur l'instant.
Et sur un dernier « Hi ! Hi ! Hi ! », il exhiba de sa poche un bon vieux gros magnum des familles, qui n'était pas de champagne. Il le pointa vers nous. Une joie sadique se lisait sur son visage. « Voyons, lequel des trois vais-je supprimer en premier ? Hi ! Hi ! Hi ! » Ce fut le Chef qui trancha le dilemme.
« Si vous le permettez, cher 008, je revendiquerai cet honneur. Périr de la main d'un bon tireur est une aubaine, en notre époque troublée. Toutefois, avant de tirer ma révérence à cette terre, j'espère que vous aurez le bon goût de me laisser me régaler d'un dernier Coronado, un simple N°1, un modeste cigarillo sans farce ni attrape !
-
Je vous accorde cette ultime faveur, car l'on se délecte davantage de l'échec de son ennemi lorsque la rage au coeur il fait face au peloton d'exécution que sur son cadavre qui ne ressent plus rien ! Mais trois minutes, pas une seconde de plus. Hi ! Hi ! Hi !»
Ce furent les trois minutes les plus longues de ma vie. Je l'avoue, j'avais les chocotes. Pour garder une contenance, l'air de rien, j'affectais de regarder au loin par la porte ouverte devant laquelle le Proc était planté, le pistolet au poing. J'osais espérer un ultime secours. Qui ne vint pas. La seule personne qui se présenta fut Molossa qui passa entre les jambes écartées de notre tireur d'élite en remuant la queue. Brave chienne, fidèle jusqu'à la mort, elle venait mourir dans les bras de son maître.
Le Chef alluma son cigare. Je remarquai que sa main ne tremblait pas. J'admirai son courage. Il exhala quelques bouffées de fumée avec cette tranquillité exaspérante et patronale du supérieur hiérarchique qui étudie son journal devant les sténos-dactylos accablées de travail.
« Une minute, Hi ! Hi ! Hi ! »
Silence de mort dans la pièce. Le Chef ne releva pas le chronométrage du Proc. Il ferma les yeux en guise de délectation. A ma grande surprise, je devinai à son regard par en-dessous qu'en fait il suivait la marche nonchalante de Molossa qui slalomait entre les fauteuils des ministres en se dirigeant vers nous...
« Deux minutes, Hi ! Hi ! Hi ! »
Un peu de cendre se détacha du Coronado et tomba sur le pantalon du Chef. D'un geste instinctif, il la rejeta à terre, cela ne dura qu'un dixième de seconde mais lorsqu'il reposa sa main sur le bureau, il tenait entre ses doigts un étrange objet. La tablette informatique que le Président avait déposée au pied de sa chaise et que Molossa nous avait ramenée dans sa gueule !
Ce fut comme une fusée, Molossa surgit de sous la table et bondit sur le Proc, le coup partit de travers mais ce fut le Premier Ministre qui l'accueillit, bien involontairement, entre les deux yeux. Si peu de cervelle se répandit sur la moquette que plus tard l'on se moqua de sa tête vide. Affolement généralisé, le Proc tirait dans tous les sens abattant au hasard quelques malheureux membres du gouvernement, plus l'huissier - qui lui avait interdit l'entrée - que Molossa ramena en le tirant par la jambe de son pantalon. Nous en profitâmes pour nous défiler du guêpier en courant, nos belles subjuguées par notre détermination accrochées à nos basques.
J'étais au volant de la limousines noire qui avait emmené nos trois demoiselles. La voiture du Proc juste derrière nous. A mes côtés par la fenêtre ouverte Claudius s'amusait avec mon Uzi, mais le capot blindé du Proc était à toute épreuve. J'étais à cent soixante sur les grands boulevards et l'enfoiré ne lâchait pas le morceau. Les pneus crissaient, mais le plus crispant c'était le Hi ! Hi ! Hi ! du Proc qui dominait le tumulte. Remarquez que le Chef commençait aussi à m'énerver. L'était assis derrière avec les trois donzelles, et tous quatre semblaient très intéressés par la tablette du Président qu'il avait posée sur ses genoux et dans le rétro, je le voyais pianoter, pénardos.
-
Chef, sauf le respect que je vous dois, ce n'est peut-être pas le moment opportun de lancer une recherche sur la vie sexuelle du poireau en Nouvelle-Calédonie sur Wikipédia !
-
Agent Chad ! Cessez de faire de l'esprit. Vous n'avez jamais entendu parler de la mallette présidentielle ?
-
Quoi ! - je fis une terrible embardée – vous voulez dire que Molossa a volé le dispositif de la force de frappe nationale !
-
Vous retardez d'une guerre Agent Chad. La bombe atomique est obsolète depuis plusieurs années. Nous sommes à l'ère des drones, aujourd'hui. Tenez, je tape la plaque d'immatriculation de la voiture de notre ennemi C0N 000 ARD, je frappe sur Entrée et c'est parti !
Il y eut comme un sifflement, un long tube d'acier venu d'on ne sait où survola notre voiture et s'encastra sur le véhicule du Proc. S'ensuivit une terrible déflagration.
-
Par contre ils ne fournissent pas la petite cuillère pour ramasser les morceaux, se désola le Chef. Voilà, c'est terminé. Tout est bien qui finit bien. N'est-ce pas mes chéries !
*
On n'entendit plus jamais parler de nos trois héros. Certains disent qu'ils sont entrés dans la clandestinité. D'autres qu'ils sont partis en Russie pour libérer les Pussy Riots de leur prison. Certains assurent qu'ils ont convolé en justes noces avec Roselyne, Brunette et Blondinette. Mais qu'ils ne furent pas heureux. Mais si, au coeur de la nuit, du plus profond de l'insomnie vous prêtez bien l'oreille, peut-être aurez-vous la chance d'entendre l'aboiement de Molossa, lancée sur une nouvelle piste...
THE END
23:17 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/11/2013
KR'TNT ! ¤ 165. MAC CURTIS/ CAT O'NINE TAILS / BIKERS / CHISTIAN VANDER / CHRONIQUES VULVEUSES ( 12 )
KR'TNT ! ¤ 165
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
28 / 11 / 2013
|
MAC CURTIS / CAT O'NINE TAILS / JEAN-WILLIAM THOURY / CHRISTIAN VANDER ( + Magma ) CHRONIQUES VULVEUSES |
|
RECTIFICATION Mister B se fend d'un coup de téléphone pour l'Epiphone. Car ce n'est pas sur une Gretsch que joue le guitariste de Roy Thompson & his Mellow King mais bien sur une Epiphone. (Voir chronique N° 164). Remarquez, ce lascar vous lui refilez la guitare en carton bouilli avec fil en plastique mou de votre petit frère, au bout de cinq minutes il vous en tirera un solo à rendre jaloux Chet Atkins. C'est cela la classe. |
MAC EST MORT
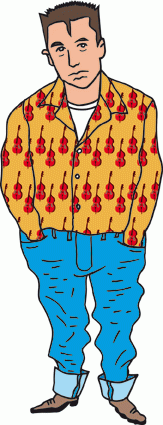
Pour une fois, on avait du grain à moudre avec le nouveau numéro de R&F. Belle interview de Jon Savage qui reste pour les lecteurs de «England’s Dreaming» le seul vrai spécialiste du punk anglais, puis deux belles pages sur Brigitte Fontaine, deux aussi sur King Khan (enfin), puis un très bel article sur Thee Oh Sees et puis une info coincée au bas d’une page de télégrammes : mort du «guitariste rockabilly Mac Curtis». Voilà comment s’achève dans la presse française le parcours terrestre d’un grand artiste texan.
Ça peut sembler grinçant de dire la chose comme ça, c’est vrai, mais au moins on a l’info, et c’est l’essentiel. On se dit : «Oh, mais ils sont très bien, ces gens-là, quelle culture !»
Dommage que Mac Curtis ne fasse pas l’objet d’un hommage plus appuyé. Il fait partie des Texans encore jeunes qui eurent le privilège de voir jouer sur scène l’Elvis de la période Sun et qui décidèrent de consacrer leur vie au rock’n’roll.

À quinze ans, il est pote avec Johnny Carroll et ils participent ensemble à tous les concours de rock des environs, ce qu’on appelait en France les radio-crochets. En 1956, Mac passe à la radio. Un mec le repère et le signe sur King, le label de Syd Nathan, basé à Cincinnati. King cherche un clone d’Elvis, pour faire du blé, comme Sun. Avec King, on entre dans la mythologie, même si Mac dit qu’il n’a jamais rencontré le boss Syd. Il va même jusqu’à se demander si Syd connaissait son existence. Car King est une usine. Mais pas n’importe quelle usine : une usine à mythe.
Mac enregistre seize cuts pour King entre 1956 et 1957, puis il est saqué. Son contrat n’est pas renouvelé. Petite consolation : les spécialistes considèrent Mac comme le vrai pionnier du rockabilly texan.

Au même titre que Sun, Chess, Specialty, Imperial, Okeh, Modern, Fortune ou Excello, King joue un rôle considérable dans l’histoire du rock américain. King est même considéré comme le label américain le plus légendaire et le label indépendant le plus important des années quarante et cinquante. Sur King on trouve absolument de tout : du gospel, du hillibilly, du western swing, du bluegrass, du blues, du jazz, du r’n’b et de la pop. Premier atout : Syd brasse tout, contrairement à Chess qui se spécialise dans le blues ou Atlantic qui louche sur le r’n’b. Deuxième atout : Syd monte King dans les années quarante après avoir été vendeur de disques. Il connaît donc parfaitement le marché et sait ce qu’aiment les gens. Il veut faire des disques pour «the little men». Troisième atout : il n’est pas raciste. Il embauche Henry Glover comme directeur artistique. Quatrième atout : il trouve une solution radicale chaque fois que se pose un problème. Problème de studio chez truc ou machin ? Pouf, Syd monte SON studio (concept repris par Chess et Sun). Problème de recrutement de session-men ? Pouf, Syd engage SON house band (concept repris par Stax et Motown). Problème de fabrication des vinyles ? Pouf, Syd monte SON usine. En 1945, il sort deux mille disques par jour. En 1951, il en sort un million par mois. Puis SON imprimerie, car il faut bien fabriquer les pochettes et tout le matériel de promo. Problème de distribution ? Pouf, Syd monte SON réseau de trente-trois bureaux à travers tout le pays. Il va même jusqu’à financer SA flotte de camions. King on the road. Il lance même SA gamme de tourne-disques. Aucun label n’est jamais allé aussi loin. Non seulement ce mec avait du génie, mais il avait en plus très bon goût. Car les grands artistes se bousculaient à son portillon. Les géants de la country comme Grandpa Jones et les Delmore Brothers sont sur King, avec ce country boogie qui est à l’origine du rock’n’roll. Le proto-rockab Moon Mullican, hard-rocking daddy, gros frappeur de clavier et principale influence de Jerry Lee, est sur King. Moon cassait la baraque bien avant que Bill Haley et Elvis ne s’y mettent. Les rois du r’n’b comme Wynonie Harris, Clyde McPhatter (chanteur des Dominoes, remplacé par l’ancien boxeur originaire de Detroit Jackie Wilson - après quoi Clyde monte les Drifters) et Hank Ballard & the Midnighters - sharp looking and hard-rocking - sont sur King. D’autres artistes faramineux comme Little Willie John (qui casse sa pipe au ballon), Esther Phillips (alors Little Esther) sont aussi sur King. Parmi les géants de l’époque, on trouve aussi Roy Brown (principale influence de James Brown) et le fabuleux sax alto Earl Bostic sur King. Syd embauche un rital nommé Ralph Bass et lui confie les clés de Federal, filiale de King. Bass découvre un groupe qui s’appelle les Flames et les signe aussitôt. Leonard Chess qui avait repéré ce groupe de Macon, Georgie, ne lui pardonnera jamais de s’être fait doubler sur ce coup-là. Bass fout les Flames en studio. Ils enregistrent «Please Please Please». Syd déteste ce disque. Mais il le fabrique quand même et prévient Bass que si ça floppe, il est viré. Mais Bass se marre car «Please Please Please» casse la baraque. Bass vient de découvrir Mister Dynamite, rien que ça. Plus tard, Bass ira travailler pour Leonard Chess à Chicago et produira les grands albums de Muddy Waters, de Wolf et de bien d’autres.
Syd Nathan a la main verte. Il ramène souvent dans ses filets de grosses prises, comme par exemple John Lee Hooker, en 1948. Un John Lee Hooker qui se moquait des contrats comme de l’an quarante et qui changeait de nom pour aller ramasser du blé là où on lui en proposait (il se fait appeler Little Pork Chops, John Lee Booker ou Birmingham Sam & His Magis Guitar). On trouve aussi le géant Albert King sur King, qui battait le beurre pour Jimmy Reed à Chicago avant de se tailler une réputation d’immense guitariste. Il a son premier hit sur King en 1961 («Don’t Throw Your Love On Me So Strong») puis il passe chez Stax avec armes et bagages pour faire les ravages que l’on sait. Comme John Lee Hooker, Albert King aimait jouer très fort. On dit de lui qu’il est le guitariste qui a influencé le plus de gens, dans le monde du blues et du rock. Un autre King sur King défraye la chronique du blues : Freddie King qui éberlue les jeunes loups britanniques des sixties : Clapton, Jeff Beck, Peter Green et Jimmy Page. L’ancien boxeur de la Nouvelle Orleans Champion Jack Dupree atterrit lui aussi sur King, ainsi que Memphis Slim. Ike Turner est sur King dès le début de sa carrière, il a déjà aidé Sun à démarrer et il est tellement brillant qu’il va rapidement connaître la consécration en embauchant Annie Mae Bullock, la blackette qui deviendra Tina Turner. Et pourquoi Charlie Feathers débarque un jour chez King ? Parce qu’il ne s’entendait pas très bien avec Sam Phillips. Il enregistre huit titres pour King en 1956 et 1957, huit bombes. Mais ça ne marche pas. Charlie Feathers trouvait que le son chez King n’était pas bon. Chez Sun, c’était mieux. Passer de Sun à King, c’était pour lui comme de passer d’une Cadillac à une Ford. Et comme le souligne si justement John Hartley Fox dans son ouvrage consacré à King, les singles King n’ont pas rendu Charlie Feathers riche, c’est vrai, mais ils l’ont fait entrer dans la légende. Hank Mizell et le fascinant Johnny Otis enregistrent aussi des singles magiques sur King. On trouve aussi sur King l’un des guitaristes les plus wild de l’histoire du rock : Johnny Guitar Watson qui aura - comme Mick Farren - l’immense privilège de mourir sur scène, au Japon, en 1996. Et si on remonte vers les couches supérieures de la célébrité, on tombe évidemment sur Mister Dynamite, l’extraordinaire Jaaames Brown, dont tous les hits sont sur King. Et c’est même James Brown qui a permis à King de survivre, grâce à ses 98 tubes entrés au Top 40, un record jamais égalé. James Brown sur King, c’est aussi l’histoire d’une shoote permanente avec Syd qui, comme bon nombre de boss, était un vrai rat. Exemple : James veut faire un album live et Syd qui n’aime pas l’idée lui dit : «T’as qu’à le financer !» Okay, James casse sa tirelire et enregistre «Live At The Apollo» qui devient le plus grand album live de tous les temps. Syd ferme sa gueule de rat et ramasse le pognon à la pelle.
Voilà dans quelle pétaudière Mac mit les pieds en 1956.

Bien sûr, on peut dire qu’il a bénéficié du prestige que lui apportait le label King, mais il n’était qu’un artiste perdu parmi tant d’autres et il n’a pas eu le type de soutien dont ont bénéficié les chouchous de Sam chez Sun : Jerry Lee, Johnny Cash, Carl Perkins ou Elvis. Mac a dû se débrouiller tout seul, comme des milliers d’autres apprentis sorciers, à l’époque, et il s’est probablement épuisé.
On trouve assez facilement une compile de ses grands classiques intitulée «Grandaddy’s Rockin’» et si on apprécie le bon rockab, alors ce disque est un vrai régal. On y retrouve tout ce qui fait la grandeur du genre : un vrai son de slap, un battage à la caisse et surtout une vraie voix. Ces gens avaient le génie du son. Le morceau qui donne son titre à l’album est un classique superbement orchestré, sec et raw to the bone. Aussitôt après on voit «Goose Bumps» fendre l’air, classieux et longiligne, Mac pose sa voix sur une guitare en cocotte de bras tatoué. On sent dès l’intro le son et l’attitude dont cherchaient à s’approcher les Stray Cats. Mais qui pouvait vraiment approcher l’épouvantable classe d’un combo de rockab texan des années 56-57 ? Personne, évidemment. Mac et ses musiciens personnifiaient cet art unique au monde, de la même façon qu’il n’existe qu’un seul Giacometti, qu’un seul Gauguin et qu’un seul et unique Manet. Mac Curtis, Charlie Feathers et Johnny Carroll sont inimitables. Il suffit de les écouter pour comprendre ce que ça signifie.

Sur «If I Had Me A Woman», Mac sort sa voix de cat qui dérape au bon endroit. Le morceau est rythmé comme dans un rêve. Essayez d’avoir ce son avec les copains, vous verrez bien que c’est quasiment impossible. On ne retrouvera jamais le son de cette stand-up sourde et de ce cliquetis agencé. Voilà le son pur, Texas me, baby, Texas-m’en cinq, Mac. Cet album ne peut qu’émerveiller l’amateur de son. «That Ain’t Nothing But Right» est un softy catwalk perlé de gouttes de guitare sur lequel se prélasse Mac le mec. Il prend «You Ain’t Treatin’ Me Right» du bas de la glotte. Mac le mythe assure bien, il fait passer l’émotion comme une lettre à la poste. On retrouve Mac de la voix mûre en face B avec «Say So». Mac est le mec qui tape dans le mille. Puis on tombe sur un vrai hit de juke, «Little Miss Linda», strummé à la mode texane. C’est à la postérité ce que l’océan est au peintre : un prétexte à la grandeur. Mac le mec tord son chant - she sucks me - et ulule sur déboulade de strum de haut vol. Si on veut s’épater, il suffit tout simplement de l’écouter chanter «Don’t You Love Me» : il va chercher des intonations à la Elvis. Et «What You Want» nous rappelle que les rockabs texans étaient déjà des punk-rockers, vingt ans avant cette pauvre cloche de Sid Vicious. Sur «What You Want», Mac sonne comme un délinquant. Uh ! Il te demande ce que tu veux d’une voix qui claque.
Comme son compatriote texan Ray Campi, Mac se retrouve vingt ans plus tard dans le salon de Ronnie Weiser. Tu veux une bière, Mac ? Oh yes, Ron ! Et si on enregistrait un p’tit disque, Mac ? Yeah, bonne idée, Ron ! Alors attends voir, j’appelle Ray !
Mac enregistre quelques albums sur le label Rolling Rock et crac, il relance sa carrière. Et quels albums ! C’est ce qu’il faut bien appeler de la belle musique américaine de très haut niveau.

Mac, Ray et Ron enregistrent «Ruffabilly» dans le salon de Ron en 1973. Ils ‘amusent bien, et ils sortent un album au son plus que primitif, un modèle du genre. Plus la peine d’aller chercher les singles Meteor, vous avez tout ce qu’il vous faut sur «Ruffabilly», le rough sound of the billy bop. Dès le premier morceau, Mac nous envoie au tapis. «Big D Woman» est une horreur rockab violemment slappée par ce bopping-génie de Ray Campi. Le morceau idéal pour tous ceux qui veulent en découdre avec le vrai son du slap. Quand on entend ça, on se croit dans le salon de Ron, on entend les doigts de Ray glisser sur les grosses cordes, c’est d’un primitif de rêve, avec un son très sourd. Heureusement que Ron ne disposait pas du petit matériel informatique à la mormoille qui permet aujourd’hui de bien lisser les sons des instruments, car on aurait jamais eu un disque aussi raw entre les pattes. Ils font ensuite une petite reprise sympa de «Baby Let’s Play House» et Ray fait un malheur sur sa stand-up. Il place ce qu’il faut bien appeler des descentes sauvages. On l’entend saccader ses ponts avec une ferveur malicieuse. Il est tout simplement monstrueux. Si on doit écouter un joueur de stand-up, c’est Ray Campi. Grâce à Ron et à sa prise de son amateur, on entend toutes ses notes et sa cadence. Ron a compris que le moteur du bop, c’est la stand-up et il la met devant. En fait il n’avait pas le choix, car le son de l’instrument s’imposait de lui-même dans le salon, vu qu’il n’y avait pas un bûcheron derrière la batterie et que la guitare restait discrète, comme l’impose l’art secret du rockabilly. La stand-up est le véritable heartbeat du rockab. Elle fait toute sa précieuse spécificité. On le comprend mieux quand un chanteur de rockab est accompagné par une basse électrique : le son retombe comme un soufflet. L’autre perle noire de «Ruffabilly» s’appelle «Fannie Mae», boogie de salon primitif en diable, finement teinté d’accordéon. Ray y prend un solo de punkster et démonte la gueule des dieux penchés sur lui. En écoutant ça, on se dit : «Bon, voilà encore un truc superbe et infiniment supérieur à tout le reste...» Mac, Ray et Ron réinventaient tout bêtement le rockabilly, un genre difficile et sacré, réservé aux très grands artistes américains. Mac, Ray et Ron étaient bons parce qu’ils ne vivaient que pour ça. La meilleure preuve est leur version de «Good Rockin’ Tonight», slappée à mort, chantée à la Elvis, hallucinante de véracité olfactive et boppée avec une incomparable hardiesse. Ray les bat tous. Par contre, les trois reprises de Johnny Carroll présentes sur l’album («Crazy Crazy Lovin’», «Wild Wild Woman» et «Hot Rocks») sont plus classiques et donc moins fulgurantes. Par contre, on voit ce fou de Ray prendre un solo infernal sur «Wild Wild Woman». Il en remet une couche dans «Sexy Ways» qu’il truffe de gimmicks diaboliques et qu’il transperce en plein cœur d’un solo de malade.

Ray doit se sentir bien seul depuis que Mac est parti. Tous ses fans espèrent qu’il va ressortir la stand-up de l’étui et qu’il va claquer quelques vieux hits de sa jeunesse.
«Good Rockin’ Tomorrow» sort en 1976. On retrouve la même équipe de surdoués et une nouvelle série de gemmes rockab de la meilleure eau. On prend «Good Rockin’ Tomorrow» dans les dents : effarant de classe mortelle, avec un slap insidieux. Mac tire tout à la voix et à coups de reins, et Ray cale ses descentes de slap démentes. On le voit claquer ses cordes comme un con. Rien qu’avec le premier morceau, on se retrouve au paradis. Rebelote avec «Wake Up Rock’n’roll», slappé dans la face du cut et Mac sabre ses hiccups avec la rage d’un rat texan. Le morceau est tellement excitant qu’on sacre Mac grand sachem de le Sierra. Encore plus wild, «Hard Hearted Girl», slappé par un Ray fou à lier. Encore meilleur, «Party Line», merveille tentaculaire qui nous suce les neurones, un truc à se pourlécher les babines. Mac chante ça de l’intérieur du menton et Ray claque son manche comme plâtre. Ça continue de monter en température avec «Rockabilly Uprising» et son heavy beating sérieusement éméché. Voilà l’archétype du rockab classieux joué en syncope et parsemé d’éclairs de guitare, aussi sérieux que les grands rockabs d’Elvis. Mac réinvente la magie Sun et on entend un incroyable solo foireux. Si avec tout ça, on ne se décroche pas la mâchoire, c’est qu’on a de la chance. Puis ils swinguent à la vie à la mort «Been Gone A Long Time». Au Texas, on ne plaisante pas avec le slap. On embarque à fond de train ou on n’embarque pas. Il n’existe pas de demi-mesure. Puis ils frisent le pur génie avec «Juice Box». Mac fait claquer chaque mot. Il maque le mythe. Il tape dans le tas. On croit qu’on a tout vu. Grave erreur, il reste encore une sacrée bombe sur ce disque : «Wildcat Tamer». Cette ultime boucherie texane bouscule la postérité d’un coup d’épaule. Ce slappy slop s’embarque pour Cythère en roulant des hanches sans aucune pudeur. Ray roule et place des descentes furtives à tous les coins de rue. Et la bopperie insensée de «Let’s Go» rentre toute seule au panthéon des merveilleux classiques, sans demander l’avis de personne.

Nouvelle galette magique sur Rolling Rock en 1978 : «Rock Me». Si on ne sait pas ce que peut donner un heavy rockab, alors il faut écouter «That’s How Much I Love You». Stupéfiant. Ray nous pulse ça à la stand-up. Sur «Turn Away From Me», on entend Kevin Fennell - des Rockin’ Rebels de Ray - prendre un solo d’une éblouissante virtuosité. Et ça continue comme ça jusqu’au bout. Mac chante cette pièce de country globale qu’est «Making It Right» d’une voix d’airain dans un gant de cuir noir. Il boppe les syllabes en vrai cat et on se retrouve avec un vrai hit de l’Amérique profonde sur les bras. Mac va chercher ses accents chauds à la Elvis. Il détient le pouvoir d’une telle profondeur. Encore une pure merveille avec «Real Good Itch», un cut de cat judicieux et bien enlevé, adroit et juteux, admirable et survoltant, solide et puissamment boppé par Ray la montagne. Ces mecs sont classiques jusqu’au bout des ongles. Ils déroulent leur boniment sur un joli background strummal et cascadé de chorus jaillis du fond de la vallée. La seule manière de qualifier «Suntan» qui ouvre le bal de la face B, c’est d’utiliser le latin : c’est un classicus cubitus es spiritus sanctus rockitus. Si vous ne deviez écouter qu’un seul morceau de l’album, ce serait celui-ci, ne serait-ce que pour la finesse de jeu du batteur. Il s’appelle Keith Landrum et il roulotte en retrait, d’une manière merveilleusement swinguante. Mac revient à l’Elvis avec «I’d Run A Mile For You», ballade terriblement globale, radieuse et aussi élancée que la Delage décapotée de Picabia. C’est une matérialisation de l’élégance suprême, l’édifiante classe smoothy d’un Mac hors pair. Il a cette douce exhalaison calorifique, celle qui allume tant de lanternes dans les caves libidinales des demoiselles d’Amérique. Mais Mac revient au rocky road beat avec «Good Love Sweet Love» et il balance ça avec un vrai tact de cat. Derrière, Kevin Fennell claque ses cordes pour couler un solo punk de bronze, ce qui donne une idée de la faculté de dépotage de nos amis. Encore un fabuleux cut de cat. Mac boucle son bouclard avec le fameux «Rock Me» de Piano Red qu’il découvrit à l’âge de quinze ans. Ray la montagne nous slappe ça aux petits oignons.

Pauvre Mac. Même si les crocodiles sacrés du Temple t’embarquent toi, ton nom et ton art au plus profond des eaux troubles de l’oubli, nous continuerons à sortir tes disques des vieilles pochettes usées pour les poser sur nos platines, histoire de poursuivre la lutte acharnée contre la médiocrité.
Signé : Cazengler, coMac troupier
Mac Curtis. Grandaddy’s Rockin’. Kay Records 1987
Mac Curtis. Ruffabilly. Rolling Rock 1973
Mac Curtis. Good Rockin’ Tomorrow. Rolling Rock 1976
Mac Curtis. Rock Me. Rolling Rock 1978
Jon Hartley Fox. King Of The Queen City. The Story of King Records. University of Illinois. 2009

22 - 11 – 13 / LA CALE SECHE / PARIS
CAT O' NINE TAILS
Tout comme les hordes germaines traversant le limes romain sur le Rhin gelé en 455 de notre ère, la teuf-teuf mobile fonce sur Paris. Sur notre passage les radars clignotent comme les guirlandes des arbres de Noël. Les feux rouges brûlent comme des torches. Les piétons épouvantés s'éparpillent sur les trottoirs. Si nous nous octroyons de telles privautés avec le code citoyen de la route, c'est que nous nous mettons en harmonie idéologique avec le festival culture bar bars. Rien n'y a fait, c'était perdu d'avance, sortis trop tard du boulot. L'on a gagné trente minutes sur notre chrono habituel, mais lorsque je pousse la porte de la Cale Sèche, le concert a déjà débuté depuis vingt minutes.

Me fraie un chemin au travers d'une foule compacte agglutinée devant le bar. Ah ! Ma bonne dame toute cette jeunesse dépravée le verre de bière à la main, de mon temps c'était des bouteilles de sky que l'on sifflait directement au goulot. Quelle décadence ! Ouf ! Ça y est ! Suis parvenu à pied d'oeuvre juste devant le groupe. On a dû lire la livraison 163 de Kr'tnt à la Cale Sèche car l'on a pensé à protéger les musicos. Un ruban rouge et blanc en matière plastique – le même avec lequel on entoure les entreprises chimiques classées Soweto 3 lorsqu'elles explosent afin de mettre la population à l'abri des émanations empoisonnées – a été tendu entre deux piliers. Le plus étrange c'est que tout le monde respecte si bien cette frontière symbolique que lorsqu'elle tombera personne n'osera franchir cette limite devenue invisible...
FIGURE DE PROUE
Je déboule en plein morceau. Je reconnais Jimmy Boy. Aucune idée de qui doit être ce brave garçon, mais laissez-moi vous dire qu'il filoche au minimum à vingt-cinq noeuds à l'heure. Les deux guitares à fond la caisse et l'étrave de la basse qui trace un noir sillon dans les lames sauvages. Faut-il le préciser, ce soir les Cat O' Nine Tails nous préparent le jus de chaussette sur leur cafetière électrique. Pour une fois ils ont l'autorisation de ne pas nous offrir leur nectar au papier filtre.

N'exagèrent pas non plus, n'ont pas emmené trois containers d'amplis et le batteur se contente d'une batterie électronique. Le kit parfait pour ne pas faire trop de bruit. Mais entre nous soit dit ça ne vaut pas les vieilles peaux. Pas comme celle du dessus, la voisine carabosse qui téléphone à la maison poulaga chaque fois que la porcelaine de Limoges se met à tinter dans son buffet. Il vaut peut-être mieux ne pas trop énerver tata-rabat-joie la bique carnée ennemie de la jeunesse qui niche à l'étage.
ARTIMON

Le chat à neuf queues frappe encore. Energie Noire, Fuel Conspiracy se succèdent sans coup férir. Mais peut-être ces deux mâts du répertoire sont-ils de ceux invitant les naufrages car Naufrage profile son trou béant à l'horizon. Le public est aux anges, l'âme sereine et les oreilles frangées d'écume, aucun spectateur ne se jette sur les canots de sauvetage. C'est que la chorale marine est aussi envoûtante que le chant des sirènes. Ne rêvez pas aux doux sopranos de charmantes demoiselles au torse dénudée. Nous sommes dans un choeur de matelots, voix viriles et rocailleuses, qui vous vrillent les tympans dans la plus pure tradition des hurleurs blues, soul, hard, stoners, bref des shouters d'enfer qui vous ragaillardissent le moral plus sûrement qu'une lampée de rhum.

MISAINE
Calme plat, plus une corde qui grince. Serait-ce déjà la fin ? Non c'est Marianne qui se présente à la coupée. Est accueillie par une bordée de vivats. J'ai oublié de le dire mais le public est pour beaucoup composé de jeunes demoiselles, comme si la gent féminine faisait bloc dès que l'une d'entre elles devient la figure de proue d'une manifestation musicale. Le lecteur soucieux d'approfondir notre docte contribution à la réflexion sociologique contemporaine se reportera sans tarder à notre chronique de la semaine précédente consacrée à Gizzelle.

Excusez-moi de me faire un coup de pub personnel, mais il faut bien que je meuble l'intermède car Dame Marianne prend son temps pour sortir son fleuret d'abordage de son étui. Ca y est, elle pose devant elle une espèce de partition mathématique constituée de fractions hâtivement griffonnée et met en joue. Pas nous, mais son altomètre serré entre son épaule et son cou.

C'est parti pour Black Cat Jack, le violon miaule comme une corne de brume et les guitares foncent dans une purée de poix à couper au couteau. Equipage de forbans en goguette. Le pont ruisselle de sang et les canons tonnent dans l'entrepont. L'on a hissé le drapeau noir et l'on s'arrache de la mer des Sargasses. Droit devant et vent debout. C'est la folie dans la bordée des spectateurs.
Changement d'ambiance. ( Oceano ) Nox a troqué sa guitare contre un banjo. Avec le crin-crin de Marianne nous voici au port dans un pub irlandais. Drunken Sailor, l'on reprend en choeur. Ambiance très Pogues. Les ivrognes nous marchent sur les mains. Post punk marin. Tellement bien, qu'ils la referont en rappel.
JETEZ L'ANCRE !
Car c'est la fin. Le bruit n'est autorisé que jusqu'à vingt deux ( les flics ) heures. La municipalité respecte le repos de ses honnêtes électeurs. Ai pris le rafiot en pleine couse. Une demi-dose d'amphétamine rock c'est mieux que rien. Mais même si c'est de la super qualité, ce n'est pas suffisant. Je rêve de revoir les Cat O' Nine Tails sur une scène aussi large que la baie de Douarnenez et des empilements de baffles jusqu'au pommeau du grand-mât. Avec l'effigie de Marianne sur les timbre-postes pour représenter la Première République Pirate.
Damie Chad
CHRISTIAN VANDER
A VIE, A MORT, ET APRES...
ENTRETIEN AVEC LE FONDATEUR DE MAGMA
PAR CHRISTOPHE ROSSI
( NAÏVE LIVRES / 2013 )
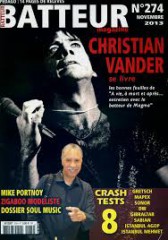
J'ai éprouvé un sentiment de honte. Je ne voyais que l'en-tête BATTEUR N° 274, Novembre 2013, tout au fond du présentoir, avec une dizaine d'autres revues qui cachaient la couverture. Non de Zeus, deux cent soixante quatorzième numéro, au jugé plus de vingt ans d'existence et je ne m'en suis jamais acheté un fascicule ! Il est des erreurs que l'on répare tout de suite, me suis emparé de l'exemplaire, l'ai déposé sur le comptoir du buraliste, ai payé et suis ressorti illico du magasin pour tomber nez à nez avec une jolie... Mais ceci est une autre histoire. Ce n'est que deux jours plus tard que j'ai retrouvé la revue sur la banquette arrière de la teuf-teuf mobile. Un rocker ne commet jamais d'erreur, Christian Vander en couverture ! Oh !Chouette ! un article sur le créateur de Magma, que non ! hibou et grand-duc ! l'annonce d'un livre d'entretien ! J'ai couru comme un fou chez mon libraire passer commande « Ah ! Ah ! Vous avez toujours des bouquins chez des éditeurs, peu commun ! ». Et deux jours plus tard, je tenais la merveille entre mes petites menottes innocentes...
ENTRETIEN
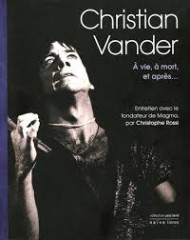
Christophe Rossi présenté sur le revers de la jaquette comme le rédacteur en chef de Batteur. C'est surtout un bon interviewer, ne profite pas de sa fonction pour raconter sa propre vie. Applique la seule bonne méthode possible pour une interview, questions courte et réponses longues. Faut obligatoirement connaître son sujet et ne pas viser à côté. L'est sûr aussi qu'il faut aussi avoir sous la main quelqu'un qui ait quelque chose à dire. Faites confiance à Christian Vander. L'homme sait structurer ses longs soli. Captive votre attention dès la première phrase et ne vous ennuie jamais. Amateurs d'histoires croustillantes, de révélations intimes scandaleuses, de ragots malfaisants sur de célèbres personnalités, vous risquez d'être déçus. Christian Vander ne donne pas dans l'anecdote. Parle, mais ne se met jamais en scène. Raconte sa vie de musicien et n'en dit pas plus. Pour une seule et bonne raison : seule la musique l'intéresse. Elague le quotidien, cet aspect commun et misérable du vécu humain que Nietzsche qualifiait de « trop humain ». La quête intérieure est plus essentielle que le paysage extérieur. N'emploie pas pour autant la langue de bois, ne règle pas ses comptes mais ne mâche pas ses mots. Les compliments, les reconnaissances, la gratitude, mais aussi les déceptions et les incompréhensions. Sans vantardise pour les premières et sans aucune récrimination pour les dernières. Prise en compte des évènements tels qu'ils se sont déroulés sans joie exubérantes ni colères rentrées, ni jalousies, ni désirs de vengeance. L'homme est au-delà de tout ressentiment.
BERCEAU JAZZ
Beaucoup de lecteurs de KR'TNT auraient aimé que dans leur enfance, Jerry Lee Lewis et Eddie Cochran passent régulièrement à la maison leur apprendre à tripoter le piano et à caresser la guitare. Rêve fou. Celui qu'a vécu éveillé Christian Vander dès son âge le plus tendre. Sa mère est une fan de jazz, elle le mène dès quatre ans dans les clubs les plus hot de Paris, et les plus grandes figures mythiques de la jazz musique noire, passent et même parfois logent dans son appartement. Des pointures comme Chet Baker ou Elvin Jones.
La suite de l'histoire se profile avec ses gros sabots dès qu'apparaît Elvin Jones. Comment ne pas vouloir devenir batteur, plus tard lorsque vous serez grand, lorsque le plus abouti ( formule à l'emporte-pièce ) des batteurs de jazz vous apprend les rudiments de son art. Lui procurera même en des circonstances rocambolesques sa première véritable batterie... Mais Elvin lui apportera un autre cadeau, bien plus précieux. Celui qui sculpte le futur de votre existence avant même que vous ayez commencé à vivre. Elvin fut le batteur de John Coltrane qui restera l'amour suprême de Vander. Reportez-vous à Villiers de L'Isle Adam pour entendre le véritable sens de cette expression en tant qu'intercession avec cette chose innommable que certains s'obstinent à appeler le divin.

Mais pour avoir été très tôt en contact avec la quintessence de l'énergie noire, la vie du jeune Vander n'en est pas pour autant tissée de fils roses. Passons sur les années malheureuses chez sa tante que nous décrirons comme un confinement carcéral en un lieu privé de musique pour nous retrouver dans la solitude de l'adolescence. La célèbre trilogie sex, drugs and rock'n'roll en cache une autre similaire mais peut-être plus primale, ass, dope and jazz. La mère de Christian Vander tombera pour trafic ( en fait consommation ) de produits illicites. Des années de prison. Vander très jeune se retrouve seul, abandonné de presque tous, face à sa batterie. La rage. La violence contenues explose sur les peaux. Vander sera un autodidacte. La vie est un combat contre tous. C'est en combattant – ne serait-ce que contre ses démons intérieurs – que l'on devient un guerrier.
RHYTHM AND BLUES
Le petit Vander commence à être connu dans les clubs de jazz. L'est doué, possède un savoir-faire indubitable, mais difficile de l'admettre dans la french family. A le mauvais goût de ne reconnaître pour maître que Coltrane – un amerloque certes, mais irrespect fondamentale des hiérarchies nationales – et puis surtout il joue avec trop de pêche. Trop de jus dans son jazz. L'est vite catalogué comme un twister. Commencera donc par jouer au milieu des années soixante dans des groupes de rhythm and blues qui nécessitent une énergie... disons plus appuyée. N'a pas l'impression de déchoir. Si en France les jazzeux se bouchent le nez devant de telles facilités, Vander sait que tous les musiciens noirs américains ont été bercés par cette musique, au sens laudatif du terme, populaire. C'est l'idiome de base, la langue vernaculaire du rythme et du blues, essentielle pour la transmission des racines originelles. Vander en viendra à s'exiler en Italie. Il y passera deux ans dans d'obscurs combos de rhytm and blues, jusqu'à ce que sans raison apparente il éprouve le besoin de rejoindre le sol natal.
L'APPEL DU ROCK
L'a tout juste vingt et un an lorsqu'il rentre en France au printemps soixante neuf. Le pays sort de la lessiveuse de mai 68. Le vieux monde est mort ( c'est du moins ce que l'on croit ) les champs du possible ne demandent qu'à être labourés. L'on a besoin d'horribles travailleurs. Très vite Vander s'aperçoit que les musiciens qui accueillent sans sourciller sa frappe monstrueuse sont ceux qui se réclament du courant rock. N'oublions pas qu'à l'époque la vélocité d'un Keith Moon et la puissance d'un John Bonham sont les parangons ultimes du battle rock.

Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Une génération de musicien rock est en train de naître sur le territoire hexagonal, mais l'on est encore loin du compte. Vander exige davantage que des imitateurs. Veut des personnalités et des créateurs. Pas question de se contenter de jouer correctement un riff, faut aussi une connaissance, une réflexion, une expérience de la musique encore inconnue sur la planète France. Faudra donc aller sur une autre planète, quitte à la créer de toutes pièces. Cet astéroïde fabuleux portera le nom de Magma.
MAGMA

Magma sera donc le seul groupe rock français capable de rivaliser avec les groupes anglais et américains. D'abord par son originalité et très vite par sa puissance de frappe. Suffit de le comparer avec l'autre french combo très légèrement antérieur à sa naissance, les Variations. Je les adore, ont été adoubés par Steppenwolf et New York Dolls mais il suffit d'écouter leurs disques réciproques pour entendre qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. Magma est ailleurs. Ce qui m'étonne le plus dans l'aventure Magma, c'est que le groupe de Vander soit très vite accueilli, comme faisant parti de la famille, par un public rock français pas du tout accoutumé à écouter de la musique si élaborée qui a néanmoins su faire preuve d'une ouverture musicale étonnante à l'époque. Vander y est pour beaucoup, pas besoin d'apprendre par coeur les deux cent soixante quatorze numéros de Batteur pour savoir que l'on tenait là un musicien hors-classe, d'une fougue, d'une violence et d'une justesse extraordinaires. L'évidence s'imposait.
L'emportait le morceau. Ce qui n'était pas donné d'avance. Magma c'était autre chose que le riif fabuleux de Whole Lotta Love, que Led Zeppelin avait piqué à Muddy Waters. Magma ne vous refilait pas le blues en douce. Bossait sur le rythme et redécouvrait d'instinct la complexité syncopale de la musique classique européenne vers laquelle beaucoup de jazz men ont longtemps tendu une discrète oreille, du genre voyons ce que nous offre la concurrence.

Magma c'était davantage Stravinsky que Chuck Berry. Avec la puissance de l'orchestre symphonique en pleine action mais décuplée par l'électricité. Musique savante follement attractive. N'importe qui ne pouvait postuler une place chez Magma. L'histoire du groupe est pleine d'arrivées et de départs. Certains s'en vont sur d'autres projets, mais d'autres s'aperçoivent que rester demanderaient des efforts d'apprentissage et de renouvellement qu'ils ne sont pas prêts – par paresse ou incapacité - à à fournir.
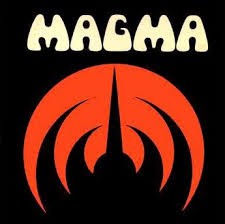
Vander n'en parle pas, l'évoque très superficiellement en trois lignes qui risquent de ne pas alerter un lecteur contemporain. Magma prend son essor au début des seventies, des années où domine un discours d'extrême-gauche marxo-anarcho-situationnistes. Magma ne colle pas à l'esprit festif de l'époque. Rien n'est plus éloigné du débraillé idéologique que les postures hiératiques de ses musiciens et leur musique souveraine. Leur langue – le kobaïen, importée de la planète Kobaïa, offre des intonations quelques fois un peu trop germaniques... Quelques critiques s'élèveront, on parlera d'une musique fasciste. En ces temps post-68, c'est une condamnation dont on ne se relève pas. Pire qu'une bulle d'inquisition prononcée à votre encontre dans l'Espagne Catholique du seizième siècle. Par sa seule présence scénique ( et discographique ) Magma pulvérisera ce genre d'anathèmes qui seront en trois mois renvoyés dans les poubelles de l'histoire d'où elles n'auraient jamais dû sortir.
SUITE SANS FIN
Pour beaucoup l'histoire de Magma se termine autour de 1978. Les temps ont changé. L'on parle moins de Magma qu'auparavant. Moi le premier je ne prête qu'un regard distrait aux différentes résurgences du groupe... La démarche magmaïque devient peu lisible. Mais Christian Vander continue son chemin. Le livre devient passionnant. Ce n'est plus l'histoire d'un batteur génial que nous suivons mais l'émergence d'un compositeur. Le musicien diabolique nous a longtemps caché l'ampleur de l'oeuvre.

Magma nous a donné des mouvements épars de trilogies. Durant des années de clandestinité médiatique Christian Vander a composé les fragments manquants. Une trilogie vandérienne, c'est l'équivalent d'une symphonie de Beethoven par l'ampleur du projet et des quatuors de Bartok pour la sidérante brutalité de son apport à la musique du siècle qui vient.
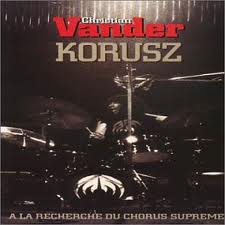
La batterie est devenue secondaire. L'en joue toujours. Mais après la composition. Le style a évolué. Ne cherche plus l'épate époustouflante rock'n'rollienne des concerts de Magma, retourne souvent d'où il est venu, au jazz. Avec un nouveau groupe Offering. Un peu à géométrie variable. Recherche ce que Miles Davis – à la démarche duquel il n'adhère pas – appelé la note bleue. Ne s'agit pas de faire rugir la cymbale comme un lion en colère, mais la faire feuler comme le tigre qui vous regarde de travers. Avant de se jeter sur vous pour vous dévorer. L'on change de plateau de jeu mais les règles sont toujours aussi dangereuses à suivre.

Magma-Vander est un phare dans la tempête. Possède sa maison de disque – le do it yourself punk est un concept applicable à toute sorte de musiques qui se veulent libres et dégagées de tout impératif commercial – ses rééditions et ses archives, ses propres revues, son interface net et même toute une collection de groupes divers qui empruntent le sillon tracé par ce grand défricheur qu'est Christian Vander. Qui continue sa route hors des sentiers qu'il n'a pas battus lui-même.
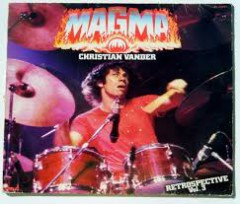
Peut-être n'aimez-vous pas le rock'n'roll, peut-être n'aimez-vous ni le jazz, ni le classique, peut-être n'aimez-vous pas la batterie, peut-être n'aimez vous pas la musique de Magma, peut-être même n'aimez-vous pas la musique elle-même ( l'on se demande alors ce que vous faites sur ce site ! ), mais que cela ne vous dispense pas de lire ce livre. Par-delà la vie d'un musicien et d'un fastueux instrumentiste, vous découvrirez la démarche d'un artiste d'une totale intégrité qui n'a jamais pactisé avec les médiocres nécessités de son temps mercantile. N'en tire aucune fierté démesurée. A d'ailleurs assez bien vécu de son art et jamais ne pose au poëte maudit ou incompris. Est simplement conscient de n'avoir pas renié sa promesse d'homme en mettant un mouchoir sur ses rêves d'enfant.
Damie Chad.
Concerts de Magma : voir : KR'TNT N° 126 du 10 / 01 / 13 article sur Rock'o'rico de Christian-Louis Eclimont
Pour en savoir plus : http://kosmicmu.blogpost.fr et facebook de Muzïk Zeuhl
JEAN-WILLIAM THOURY
BIKERS
Les morards sauvages à l'écran
de The WILD ONE à SONS OF ANARCHY
Un travail de bénédictin. Ce n'est pas tout à fait l'expression qu'il faudrait car le goût de la violence, du sexe, du stupre, de la jouissance sans entrave, de l'exaltation de la force, de l'alcool, des produits et des armes ne sont pas des vertus chrétiennes patentées. D'ailleurs l'occurrence des mots Hell et Enfer semble indiquer que les voies du seigneur ne se parcourent pas en moto. Âmes sensibles abstenez-vous de toquer à la porte de ce monde de plaisirs sulfureux. Vous risqueriez de vous y complaire. C'est tout le mal que nous vous souhaitons.
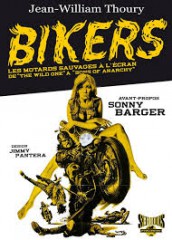
Près de quatre cents feuillets, des illustrations pleine-page et des photos mais beaucoup de texte. Cent scénarii de films racontés du début à la fin, avec en final un petit topo sur le réalisateur et les acteurs principaux. Plus un index qui vous épargnera des recherches fastidieuses, et un glossaire des termes spécialisés. Jean-William Thoury a dû y passer plus d'un long hiver à compiler une telle somme de renseignements et de connaissances. Je suppose qu'il s'est quand même offert le plaisir à chaque fois de revisionner le film. Doit avoir une sacrée dvdthèque.
L'on ne présente plus Jean-William Thoury, manager de Bijou, journaliste, écrivain, amateur de rock'n'roll. Nous le croisons parfois dans des concerts, ce n'est certainement pas un hasard si souvent il trimballe des gants de moto. Nous avons déjà chroniqué son irremplaçable livre sur Gene Vincent ( Voir KR'TNT N° 18 DU 27 / 09 / 10 ) paru au Camion Blanc. Ne manque pas de s'en référer à plusieurs fois à Race With The Devil, le titre totémique de Gene.
Au moment où j'écris cet article je projette de me rendre au local des Loners à Lagny sur Marne écouter les Ghost Highway. Cela relève d'une logique, les bikers ont très vite adopté le rock sous toutes se formes ( pionniers, rockabilly, stoner, hard... ) dès sa naissance. Ces deux univers sont proches, ils se recoupent tout en gardant leur singularité.
HISTORIC

Aussi étrange que cela puisse paraître un film comme L'Equipée Sauvage a peut-être beaucoup plus fait pour la naissance de l'esprit rock que l'enregistrement de Mystery Train dans les studios Sun, ou plus tard de Heartbreak Hotel par Elvis. Si Presley s'est jeté, sans prendre de garanties suffisantes quant au choix des tournages, dans sa carrière cinématographique, qui se révèlera à la longue si désastreuse pour son aura de rocker, c'est qu'il était subjugué par les apparitions de James Dean et de Marlon Brando. Je n'ignore pas bien sûr que notre musique vient de loin, qu'elle était déjà présente dans le rythm and blues noir d'après guerre et en gestation dans le hillbilly, mais ces racines ne touchaient que des publics limités. Si RCA sort son premier disque d'Elvis en 56, Blackboard Jungle date de 1953 et The Wild One et La Fureur de vivre de 1955.

L'on m'objectera que déjà en 1954 Bill Haley... oui mais Bill Haley n'opère pas la véritable coupure révolutionnaire et épistémologique du rock, il est un précurseur mais qui s'inscrit dans la mouvance de la musique rythme de son temps, conçue pour la danse. Chahuteuse mais pas séditieuse. Elvis apporte un plus, il offre en même temps, un impact énergétique bien plus dynamique et sensuel que le gros Bill, et le reflet de la tourmente adolescente que traduisent si bien les visages boudeurs et blasés de Skinny Jim et de Johnny Strabler.
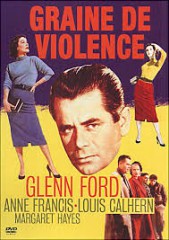
Graine de Violence et Rebel whithout a Cause traitent de l'ennui scolaire et existentiel des adolescents, cette nouvelle catégorie sociale en pleine émergence après la seconde guerre mondiale. Si ces deux films décrivent abruptement l'apparition de ce phénomène, ils ne proposent aucune solution. Au contraire dès le générique, The Wild One offre le pharamineux avantage de montrer qu'un autre monde est possible, que la révolte des enfants contre la morale privative et la vie étriquée des adultes ne se termine pas finalement par l'acceptation contrainte et forcée d'un ordre honni. L'ado n'est pas obligé de retourner contre lui – du mal-être passager au suicide définitif nombreuses sont les solutions - la violence coercitive que le monde exerce à son encontre. Il lui suffit de se doter de l'arme qui l'aidera à se délivrer.

Ce sera le cheval. De fer. La moto. Certes tous les amateurs de rock, ni tous les jeunes, ne se regrouperont pas en moto-club, mais parfois il suffit de savoir qu'une alternative existe pour se sentir mieux. Il existe mille manières d'exprimer sa révolte. Mais le choix des premiers american riders reste porteur d'une mythologie phantasmatique rarement égalée.
CINEMASCOPE
Nous nous laissons facilement manipuler par la lanterne magique. Certes notre esprit critique nous souffle que les les couleurs de l'écran ne sont guère l'exact reflet de la grisaille de notre quotidien, mais nous ne demandons qu'à faire semblant de le croire. La rutilance des choppers, les hordes sauvages, les filles nues, les règlements de compte, nous les vivons surtout par procuration au cinéma. Producteurs et réalisateurs sont engagés dans une course sans fin, chaque nouveau film doit se démarquer de ses prédécesseurs, le spectateur en veut pour son adrénaline d'où une surenchère. Toujours plus de sang, de sexe, de baston, de meurtres, de mort... Les séries télé ne feront que précipiter le mouvement, les saisons se suivent et n'ont pas le droit de se ressembler. La suivante doit surpasser la précédente.

La lecture à la suite des scénarii est assez éloquente. Vers le cinquantième je commençais à me dire que j'en savais assez pour en pondre un sur un coin de table, les mêmes plans, les mêmes scènes, les mêmes séquences, l'envie de déposer le bouquin et d'y revenir dans une quinzaine m'effleura. Mais ma persévérance fut remerciée, les histoires s'étoffent et se complexifient, le caractère des héros se module, les méchants ne sont plus aussi infâmes et les gentils ne sont plus de simples innocents. Vous serez jugé sur la noirceur de vos actes, mais l'on tiendra aussi compte de vos motivations secrètes. Il n'est pas sûr qu'elles soient plus pures que celles de vos ennemis. Les colombes ne sont pas aussi immaculées qu'elles le paraissent et les oiseaux de proie font preuve d'une cruauté que la raison peut comprendre.
L'AVERS DE LA MEDAILLE

Jean-William Thoury y revient plusieurs fois. Trop souvent les films se complaisent à dévoiler le côté obscur de la force. Il est entendu que les bikers ne sont pas des anges. Mais présenter les moto-clubs systématiquement comme des associations de malfaiteurs évacue bien des aspects positifs. Seulement un pour cent de ces organisations se classent d'elles-mêmes dans la catégorie des anti-sociaux et revendiquent une éthique de hors-la-loi. Ce sont celles-ci dont on parle le plus, les Hell Angels, Los Bandidos, les Outlaws, la police les surveille, la presse en fait ses choux gras, le cinéma s'en inspire... Certains d'entre eux participent même au tournage, comme figurants, comme conseillers spéciaux. L'on oublie que les moto-clubs fonctionnent aussi comme les antiques solidalités. Ce sont des ères de fraternité et de protection, des instruments de défense contre la dureté de la société. Facile de dénoncer les regroupements de motards très bruyants et très voyants. Mais il existe des groupes de pression, financiers ou institutionnels, pratiquement invisibles mais beaucoup plus nocifs pour la population citoyenne que les bikers jubilatoires. Si vous ne marchez pas sur la queue du crotale, toutes les chances sont de votre côté pour qu'il ne vous morde pas.
RESTRICTIONS
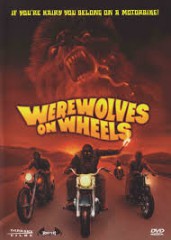
Maintenant l'on peut tout de même remarquer que beaucoup de bikers se définissent selon une idéologique droitière. Se réclament d'une individualisme anarchisant et forment des groupements collectifs dont le coeur, dans la grande majorité des cas, ne penche pas à gauche. Historiquement cela s'explique, les premiers bikers furent des soldats revenus des champs de bataille européens qui eurent du mal à se réadapter à la vie civile. On ne les attendait pas. Qui va à la chasse perd sa place. Ils se regroupèrent entre amis, mais en anciens combattants ils gardèrent dans leur nouvelle formation un goût prononcé pour la hiérarchie. Se sentant rejetés par le système, ils édifièrent leur propre mode de vie mais en reprenant pour modèle les idées d'ordonnancement de ce même système. En Allemagne d'après 18, l'on assista à un phénomène similaire, la naissance des Corps-francs.

Mais aux USA, à des milliers de kilomètres du conflit, les vétérans n'eurent pas l'occasion de remettre cela. D'autant plus qu'ils avaient remporté la victoire. Démobilisés, retournés à la vie civile, n'ayant aucune revanche à prendre, mais désirant vivre selon leurs envies, ils créèrent ces espèces de communautés d'un genre nouveau, en même temps dans le système et contre le système, qu'ils définirent comme des espaces de liberté. Ce ne sont pas des républiques pirates, Jean-William Thoury rappelle que beaucoup de policiers américains, une fois leur service terminé passent leur temps libre dans leur uniforme de biker... Contradiction skizophrénique sociologique ! Vous pouvez dénoncer les limites de telles expériences, mais il faut reconnaître que leurs existences, leur longévité ( plus de soixante ans pour les plus anciennes ) et leur prolifération dans de nombreux pays, attisent bien des rêves. Qu'on le veuille ou non, elles sont une des rares réussites de redéfinition et de reconstruction des liens collectifs détruits par l'implantation des sociétés industrielles.

C'est peut-être pour cela que se sont tissées de multiples accointances avec le rock'n'roll et les rockers, qui retrouvent en elles un parfum de cette ruralité perdue dont leur musique émana.
Ce beau livre de Jean-William Thoury – le tout premier de cette ampleur en langue française – est un plaisir des yeux et de l'esprit. Il est en quelque sorte authentifié par la préface – courte mais aussi tranchante que la lame d'un poignard – de Sonny Barger, le fondateur du Chapitre des Hells Angels d'Oakland.
Damie Chad.
CHRONIQUES VULVEUSES
DOUZIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
39
Plusieurs heures que nous roulions tassés dans notre cercueil comme Toutankamon dans son sarcophage. Une sourde inquiétude me minait le coeur. Il y avait longtemps que nous avions dépassé la SPA du Mas d 'Azil et même celles de Foix, de Toulouse, de Montauban, de Cahors, de Brives, de Limoges... Bref nous étions en route vers Paris. Je me dépêchais de faire part de mes réflexions au Chef qui crapautait sereinement son dix-huitième Coronado N° 12 :
« Très justes supputations, agent Chad, d'après mes calculs nous ne sommes plus loin de la capitale, il serait donc extrêmement judicieux que nous préparions la sortie de notre cheval de bois à roulettes.
-
Sans avoir l'air trop curieux j'aimerais bien connaître comment nous parviendrons à nous tirer de cette déplorable situation, s'enquit Claudius
-
L'enfance de l'art cher Claudius, pourquoi pensez-vous que sommes si serrés à l'intérieur de notre boîte mortuaire ?
-
Trois individus plus un chien dans une bière prévue pour un seul cadavre, la réponse tombe de soi, maugréa le Maître de l'Affabuloscope.
-
Pour un artiste vous manquez de perspicacité cher Claudius, n'avez-vous pas remarqué que dans ce que vous nommez notre malheur, dans leur précipitation les services du Proc m'avaient octroyé un modèle de cercueil XXL, ce qui m'a permis d'y bricoler un double fond.
-
Pour votre réserve de Coronados, Chef ?
-
Point du tout, vous allez voir, accrochez-vous aux petites herbes ! »
Nous ressentîmes comme une vibration sous notre ventre. Molossa émit un gémissement, mais très vite nous fûmes entourés par un bruit assourdissant, et le cercueil se mit à avancer et à reculer sur un rythme de plus en plus rapide. Il se catapultait si fort contre les portes blindées du fourgon qu'elles ne tardèrent pas à céder sous la violence des coups assénés, nous rebondîmes sur l'asphalte si brutalement que le couvercle se détacha, en une fraction de seconde nous nous retrouvâmes tous les trois assis dans notre cercueil roulant qui filochait au minimum à cent trente kilomètres heures, sur le Périphérique Lutéçois. Nous étions libres, à ceci près que nous roulions à contre-sens du flot de bagnoles qui se ruaient sur nous.
Le Chef rigolait comme un dément. Il tenait son boîtier électronique comme un téléphone portable et s'amusait à zig-zaguer entre les files de voitures. Nous devions ressembler aux quatre chevaliers de l'Apocalypse, dès qu'ils nous voyaient les conducteurs levaient les bras au ciel en se recommandant au Seigneur. Qui ne devait pas trop les prendre en pitié car les véhicules s'encastraient les uns dans autres, s'écrasaient sur les piles des ponts, certains prenaient feu, d'autres explosaient, des passagers affolés transformés en torches vivantes essayaient de se réfugier sur les terre-pleins centraux mais se faisaient systématiquement renverser sur la chaussée avant d'atteindre leur refuge salvateur.
Molossa excitée aboyait de toutes ses forces. C'était tellement mieux que dans un jeu vidéo que nous fîmes trois fois le tour du périph rien que pour jouir du spectacle. En fin de compte le Chef avisa une sortie et l'emprunta à un train de sénateur.
« Chef ! Fabuleux ! »
Pour une fois il fit le modeste : « Ce n'est presque rien, une broutille, sous le faux-fond – vous n'ignorez pas comme j'aime bricoler le dimanche matin chez moi, pendant que ma femme s'occupe dans la cuisine – j'ai adapté deux tuyères au propergol, vous savez ce carburant pour les fusées que l'on trouve en vente libre sur les marchés d'Afghanistan, j'ai simplement relié le tout à la commande du petit train téléguidé de mon filleul et vous avez vu le résultat ! N'importe quel mécano du dimanche peut vous monter un bidule pareil, en moins de vingt minutes ! »
Nous félicitâmes le Chef, louant son esprit inventif, renchérissant sur son ingéniosité diabolique. Molossa posa sa truffe humide sur sa cuisse gauche en guise de remerciement. Elle ne dit rien mais ses yeux dorés trahissaient sa profonde reconnaissance. Nous étions arrêtés à un feu rouge. Un peu grisés de notre succès. Des petits enfants manifestaient leur surprise :
« Regarde Maman, les trois monsieurs assis dans la grosse boîte à sucre en bois !
- Et le monsieur avec sa grosse cigarette qui fume, c'est le plus rigolo
-
Oui mais le chien noir est encore plus beau, pas vrai Maman !
-
Adorable mon chéri, mais retire ta main, il est peut-être méchant !
-
Mais non Madame, tu peux la caresser, elle est très gentille, elle s'appelle Molossa ! »
Le bambin tendit sa menotte et se mit à couiner comme un porc qu'on égorge, Molossa venait de lui sectionner deux doigts d'un coup de dents. J'eus le temps d'apercevoir les yeux horrifiés de Claudius. Déjà le Chef accélérait, avant que nous brûlions le feu resté au rouge j'eus le réflexe d'abattre la mère qui s'effondra sur le trottoir d'une rafale de mon UZI.
« Ne vous inquiétez pas Claudius, l'on a reconnu une agent secrète. L'on s'est échappés mais ils nous ont repérés. Sont à nos trousses. Ils ne reculeront devant rien pour nous éliminer. Faut vous enquillez cette idée-là dans la tête, le 008 ce n'est pas un amateur, la partie est loin d'être gagnée. En face ils sont prêts à tout pour nous neutraliser, nous sommes en zone noire, considérez que vous êtes déjà mort, cela vous aidera à survivre. Pensez à votre Affabuloscope que vous êtes obligé de vendre. Un conseil Claudius, à tout instant soyez méchant. »
Pendant que je briefais Claudius, le Chef fonçait comme un madurle sur les grands boulevards à tombeau ouvert. Pas de temps à perdre. Dans le flot de véhicules que nous remontions à toute vitesse l'on remarquait de plus en plus souvent les voitures bleues de la gendarmerie qui nous prenaient en chasse dès que nous les dépassions. De grosses berlines noires se mêlaient à la procession qui nous coursait. J'étais prêt à parier une crotte de Molossa que la plus grosse qui s'obstinait à ne pas nous lâcher d'un centimètre était piloté par 008 en personne. Difficile de le reconnaître derrière les vitres teintées, mais j'entendais un Hi ! Hi ! Hi! Si caractéristique. Un hennissement qui vous donnait envie d'ouvrir une boucherie chevaline.
Brusquement il y eut comme un flottement chez nos poursuivants, le Chef en profita pour accélérer, le cul d'une voiture se profila devant nos yeux horrifiés, d'un magistral tête à queue le Chef la dépassa, nous étions maintenant entre deux files de motards, Claudius désigna du doigt une espèce d'allée sur la droite, coup de frein, emportés par leur élan les deux files de motocyclettes qui nous entouraient continuèrent leur route droit devant, le Chef tourna sa manette à angle droit, nous virâmes sur deux roues, nous passâmes sous un porche et nous débouchâmes dans une vaste cour, le Chef freina une dernière fois juste devant des escaliers. Claudius ouvrait les yeux comme un merlan frit. Il venait de reconnaître l'édifice, il avait vu maintes et maintes fois cet endroit à la télévision.
Le Chef sauta allègrement hors du cercueil. Se tournant vers nous il eut cette phrase depuis lors devenue proverbiale : « Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints » et c'est d'un pas ferme que nous montâmes les marches du perron de l'Elysée.
FIN DU DOUZIEME EPISODE
22:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
22/11/2013
KR'TNT ! ¤ 164.SPYKERS / ATOMICS / MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND / ROY THOMPSON & HIS MELLOW KINGS / LIL'GIZZELLE / BLUE CHEER / NON! / SUBWAY COWBOYS / CHRONIQUES VULVEUSES
KR'TNT ! ¤ 164
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
21 / 11 / 2013
|
SPYKERS / ATOMICS / MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND / ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS / LIL' GIZZELLE BLUE CHEER / NON! / SUBWAY COWBOYS CHRONIQUES VULVEUSES |
16 / 11 / 2013 / SAINT MAUR DES FOSSES
SWING PALACE / ROCK AROUND PARIS
THE SPYKERS / THE ATOMICS
MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND

Banlieue chicos de Paris. Grosses villas individuelles, immeubles de standings, ce soir ce n'est pas fantasia chez les ploucs. Pas de morts dans les fosses communes à Saint Maur les Fossés. Sans Mumu, l'on aurait ramé un max, suivant ses indications la teuf-teuf se faufile dans des ruelles désertes, elle raccourcit, coupe et évite les encombrements avec une habileté diabolique. Un petit coup de GPS pour les trois derniers giratoires et nous voici devant le Swing Palace. Pas las du tout, l'on se précipite vers l'édifice – béton cossu – qui n'est pas tout-à-fait à la hauteur de son appellation. Nous, tout ce que l'on demande, c'est avant tout que ça swingue. A peine la porte principale poussée l'on nous dirige vers le sous-sol. Escalier blanc-hôpital de service qui nous mène à une salle souterraine - ce doit être un abri Atomics – un peu quelconque, un bar sur la gauche, une scène près de l'entrée, quelques chaises le long des murs, lumière bleuâtre qui nous habille d'une teinte cadavérique peu avenante, peu de monde. Tout de même Edonald fidèle au poste, sacs et appareils de photos en bandoulière, Thierry Crédaro et Fred, mais aussi Olivier Clément des Black Prints que l'on n'avait pas eu le bonheur de croiser depuis trop longtemps. Et puis les têtes connues vont se multiplier comme des croissants au beurre dans la vitrine d'une boulangerie.
THE SPYKERS

Enfin on va pouvoir les voir ailleurs que dans l'espace exigu du pub ADK de Roissy. La scène est tout de même un peu encombrée par le matériel des groupes suivants, ce qui les oblige à se placer les uns à côté des autres, sans pouvoir jouer sur la profondeur du lieu. Tout de suite l'on remarque Seb. N'est pas derrière la batterie mais assis sur son caisson, les jambes écartées, imperturbable il marque le rythme. De ce fait le combo se démarque de la plupart des groupes de rockabilly. Pas de caisse claire, mais un martelage incessant, plus puissant, plus grave, un peu comme les tambours indiens, original mais qui de temps en temps peut paraître monotone. Texas Joe – un surnom qui fleure bon le cowboy – est à ses côtés, guitare rythmique et au micro. Un peu trop près du cajon qui parfois lui mange la voix.

Ni blanc, ni rouge, l'on commence par la noirceur du blues. Bruno est à l'harmonica, et nous à Chicago avec Muddy Waters et Little Walter. Une autre facette des Spykers que nous découvrons avec ravissement. Roucoulades bluesy, kyrielles de notes qui s'échappent à jets continu de l'orgue à bouche intarissable, presque invisible dans les mains du géant qu'est Bruno. Un régal.

Deux antinomies à chaque bout de l'estrade. J. P. Jorge et sa contrebasse, toute la tradition rockabilly, slap et contre slap, assure le rythme et Eduardo, le jeune lead guitar, somme toute très électrique. Avec lui l'on quitte plaines et contreforts country pour la modernité des villes. Parfois il se lance dans de longues cavalcades, galope en tête et les autres s'engouffrent dans la brèche.

Bruno nous ramène dans le ghetto, le son est plus lancinant, le chant moins bondissant que celui de Texas Joe mais plus appuyé, courbé vers la terre. Le blues urbain dans toute sa splendeur et la ruralité du rockabilly, les Spykers alternent les climats. L'ensemble n'est en rien disparate. Les racines de la musique populaire américaine sont si emmêlées que l'on retrouve des échos des unes chez les autres. Les Spykers refusent de s'enfermer dans des territoires trop étroits. Ils ouvrent des portes, repoussent les limites des chasses gardées.
Thierry Creadaro est appelé pour les deux derniers morceaux. Deux tueries. En blanc et en noir. Rock et blues, les deux faces de la même carte à jouer. Les Spykers ont sorti le grand jeu. On les reverra avec plaisir.
THE ATOMICS

Rockin'trio sur scène. Pas de temps à perdre. N'ont pas commencé que c'est déjà parti. La faute à Raphaël. Doit avoir un compte à régler avec sa Gretsch, l'a beau être blanche, ne croit plus à son innocence. Vous la traite méchant, un dompteur altéré de sang qui entend régner en maître sur sa panthère albinos. Elle rugit et sort ses griffes. N'a pas le temps de s'occuper de ses deux complices. Mais ils connaissent l'animal. Lui fournissent le background nécessaire. la contrebasse démarre en trombe, pas question de laisser le soliste tout seul, bat-man barbichette en pointe mouline sur ses toms. Vitesse de croisière atteinte en dix-sept secondes, le restant ce sera de la course de côte. Incontrôlée.

Mais Raph la rafale ne se contente pas de si peu. L'est aussi au chant. Tout ce que vous voulez, le vibrato de Buddy Holly, comme le nasillement hillbilly. En grande forme. Bateau toute voile dehors sur la mer démontée. Pas possible, s'est fait poser une pile Atomics tout prêt du coeur. Inusable, guitariste sniper, méthodique qui ne rate jamais l'occasion de tirer plus vite que son ombre. Un show mené guitare battante. Evidemment derrière, le tambour major ne chôme pas. Et le contrebassiste slappe comme si son dernier jour était arrivé.

Pas d'attente, pas d'hésitation, pas de coupure. Un morceau n'est pas terminé que déjà les plans de base du prochain sont en gestation dans l'esprit des musicos. Jamais vu les Atomics jouer avec autant de célérité et de rage. Une énergie impériale. Ne nous laissent pas le temps de respirer, course-poursuite avec l'horloge du rock'n'roll dont les aiguilles sont devenues folles. De temps en temps, Raph nous signale en coup de vent que le morceau suivant est une compo. Ne se distingue pas des reprises habituelles. Le groupe a acquis une maturité évidente. Peut désormais voler sur ses propres ailles, l'on n'y verra que du feu. Qui brûle.

Nous filent la grande claque. Celle qui fait du bien en vous remettant les idées à l'endroit. Le combo va de l'avant. Tout droit. Ne s'arrête pas en route pour vous laisser admirer le paysage. Vitesse hot rods obligatoires. Pas la peine de demander à descendre. Refuseront tout net. Accrochez-vous aux herbes et essayez de survivre. Inutile de fermer les yeux, ça vous rentre par les oreilles. La salle est scotchée devant la scène et personne ne voudrait en perdre une miette.
En plus, malgré la dextérité de Raphaël c'est bien un groupe qui joue. Une entité. Une globalité agissante et bondissante. Chacun apporte sa quote-part au peau commun. Ensemble, chacun des trois essayant de fournir un maximum d'éléments aux deux autres. S'entraident et se propulsent. Pas de retardataire. Une troïka attelée au seul traîneau du rockabilly. Un triumvirat qui expédie les affaires extraordinaires.
Ce soir, les Atomics furent irradiants.
MARCOS SENDARRUBIAS & HIS BAND

Des inconnus. Par chez nous. On a un peu trop l'habitude de regarder toujours du même côté, comme si question rockabilly le monde se résumait à l'Angleterre et aux Etats-Unis. L'on en oublie de mater chez nos plus proches voisins. Pourtant en Espagne le mouvement rock est peut-être plus fort que de notre côté des Pyrénées. Nous mêmes n'avons jusqu'à maintenant chroniqué qu'un seul groupe espagnol Charlie Hightone and The Rock-It's ( voir KRTNT N° 109 du 13 / 09 / 12 ), aussi attendons-nous avec impatience ce mystérieux Marcos Sendarrubias & His Band.

Devaient être aussi pressés que nous de voir à quoi ressemblait le public français, les Atomics n'avaient pas fini de dégager leur matériel que déjà ils investissaient la place et commençaient à brancher leurs instruments. A première vue, rien ne ressemble plus à un groupe de rockabilly français qu'un groupe de rockabilly espagnol. Un chanteur à la rythmique au centre, un contrebassiste sur sa gauche, un lead guitar sur sa droite, le batteur en arrière. Jusque là rien que de très normal. Attendaient qu'on leur donne le top départ. Le batteur tapotait gentiment ses toms en suivant le rythme du morceau qui servait de fond sonore, et le contrebassiste caressait doucement ses cordes avec sollicitude.

Dernier regard, Marcos Sendarrubias s'assure que tout est en ordre, et c'est parti mon kiki. Focalisation totale sur le mec en complet marron qui cinq secondes avant se tenait tranquillement debout à côté de sa contrebasse. Métamorphose ! Le voici collé à sa big mama, ses mains baladeuses s'agitent et se mettent à slaper comme si la survie de l'univers était en jeu. Elles impulsent un rythme fou et tout son corps tressaute et entre dans une danse érotique copulatoire des moins équivoques. N'arrêtera plus de tout le set. Quand on reproche au rock and roll d'être une musique à forte connotation sexuelle, soyez sûr qu'il y a du vrai dans l'assertion. En voici un qui ne peut pas cacher ses ascendances psychobilly.

Dans son gilet panthère le guitariste est aussi immobile qu'un roc battu par les flots houleux de la tempête. Parfaite antithèse. L'un semble un agité perpétuel échappé de l'asile et l'autre reste en lui-même concentré sur son jeu et son instrument. Mais la musique parle pour lui. Si son acolyte envoie, lui réceptionne et renvoie vers la foule qui blêmit de plaisir. Arc électrique. Un jeu serré et tatillon. Ne laisse rien échapper. Restitue l'énergie pure.
Difficile d'entrevoir le batteur, les larges épaules de Marcos le cachent, jouera en quelque sorte dans un parfait anonymat. Marcos enlèvera vite sa veste country à parement fleuri. N'est pas né de la dernière pluie Marcos Sendarrubias, plus de vingt ans qu'il officie dans le milieu rock espagnol. A participé à une pléthore de groupe, du Doo Wop au rockabilly, tout cela pour confirmer qu'il bénéficie d'une solide expérience vocale. Le concert fut un régal. Beaucoup de titres inconnus. On reconnaîtra au passage les riffs de Brown Eyed Handsome Man de Chuck Berry et de Gonna Back Up Baby de Gene Vincent. C'est dans le rock des pionniers que Marcos puise la force séminale de sa musique.

A la fin du concert Marcos appelle Bruno des Spykers à monter sur scène et l'ambiance électrique se charge d'une teinte blues plus qu'alléchante. Nul doute que Marcos Sendarrubias est un activiste rock. L'a organisé des dizaines de concerts, nous n'en citerons que deux : ceux de Crazy Cavan et d'Ervin Travis. Son premier disque sur son propre label Carmela ( tout un programme ) affichait un titre qui sonnait comme une profession de foi It Ain't Nothing, But Rock'n' roll. Trois fois rien, mais du rock'n'roll.

Sa prestation fit l'unanimité. Mais l'homme est aussi d'une simplicité, et d'une générosité exemplaire, se mêle devant la porte à la cohorte des passionnés qui ont du mal à rentrer chez eux retrouver un quotidien moins enflammé que les heures qu'ils viennent de vivre là. Marcos discute le coup en anglais qu'il parle sans la moindre trace d'accent espagnol. L'internationale du rockabilly en action. Un frère d'armes.
*
Desconocidos. Aqui en Francia. Demasiado costumbre se tiene de mirar del mismo lado, como si el mundo se resumiera a Inglaterra y Estados Unidos cuando de rockabilly se trata. Incluso vamos olvidando de echar un vistazo a los vecinos mas cercanos. Sin embargo, en Espana el movimiento Rock es a lo mejor mas fuerte que de nuestro lado de los Pirineos. Hasta hoy solo cronicamos a un grupo de rock espanol Charlie Hightone and The Rock-It's ( ver KRTNT N° 109 du 13 / 09 / 13 ) es por lo que esperamos con tanta impaciencia conocer a este misterioso Marcos Sendarrubias y his band.
Les corrian tanta prisa a ellos tambien de conocer que pinta tenia el publico francés. Tan pronto cuando Los Atomics se largaron con sus cosas, que ya se habian apoderado del escenario y que iban empezando a enchufar sus instrumentos. A primera vista no hay nada tan parecido a un grupo de Rockabilly Francés como otro un grupo espanol. Un cantante a la ritmica en el centro, un contrabajo a la izquerdia, un lead guitar a la derecha y un bateria detras. Hasta entonces, todo normal. Esperaban que les dijeran que empezaran. El drummer golpeaba tranquilo sus tambores siguiendo el ritmo del titulo que servia de musica de ambiente y el contrabajo iba acariciendo suavemente las cuerdas con solicitud.
Ultima mirada, Marcos asegurandose que todo anda bien y todo empieza. Focalizacion total en el tio de traje marron quien cinco segundos antes, permanecia quieto de pie al lado del contrabajo. Metamorfosis, he aqui parece pegado a la big mama sus manos busconas agitandose se echa a golpear las cuerdas como si de supervivencia del universo se tratara. Sus manos van impulsando un ritmo loco y todo su cuerpo sobresalta y va entrando en un baile erotico copulador sin que dudara se pudiera. No parara hasta el final del set.En cuanto se le reprocha al rock que sea una musica con fuerte conotacion sexual no es una casualidad. Y he aqui uno que no puede renegar de sus ascendencias psychobilly.

En su chaleco pantera el guitarrista permanece tan inmovil como una roca en medio del oceano un dia de tempestad. Perfecta antitesis. Uno parece agitado, loco de atar escapado de un manicomio mientras que el otro, esta concentrandose en su juego y su instrumento. Pero la musica habla en su lugar. Si su complice envia, él la recepciona y la vuelve a enviar hacia la muchedumbre quien palidece de placer. Arco electrico. No deja nada escapar. Restituye la energia pura.
Nos cuestas ver a la bateria, sera por los anchos hombros de Marcos que lo oculta, tocara en un total anonimato. Enseguida Marcos se quitara la chaqueta con flores. No hay nacido ayer, ya hace mas de veinte anos que oficia en el mundo de rock espanol. Participo de un monton de grupos, du doo wop al rockabilly, eso para subrayar que se puede orgullecerse de una solida experiencia vocal. El concierto fue un deleite. Muchos titulos desconocidos. Se reconoceremos entre otros los riffs de Bronw Eyed Handsome Man de Chuck Berry y de Gonna Back Up de Gene Vincent. Es en el rock de los pioneros que va sacando fuerza seminal de su musica.
Al final del concierto Marcos llama a Bruno de los Spyker a que viniera al escenerio el ambiente se hizo electrico, se tinta con pinta de blues muy atractivo. No conviene dudar de que Marcos Sendarrubias sea un activista del rock. Organizo decenas de conciertas. Solo citaremos dos de ellos , los de Crazy Cavan y de Ervin Travis. Su primer disco salio de su propio label Carmela – vaya programa – anunciaba un tema que sonaba a profesion de fé. Ain't Nothing, But Rock'n' roll. Es nada, sino Rock'n'roll.
Su prestacion fue aprobada por todos. Pero el hombre es tambien de una sencillez y generosidad ejemplar, se mezcla con las cohortes de los aficionados a quienes les cuesta volver a casa para reanudar con un cotidiano menos apasionante que las horas acaban de vivir aqui Marcos charla en Ingles sin la menor punta de acento espanol. La internacional del rock se pone en movimiento. Hermanos de lucha.
( Special thanks to Beatriz )
Damie Chad.
17 / 11 / 2013 / PARIS
LA JAVA / FAUBOURG DU TEMPLE
ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS
LIL' GIZZELLE
La Java, un lieu mythique de Paris. Belleville populaire des années trente, le Rock et le Punk y ont débarqué, puis plus tard le commencement de la décrépitude avec l'invasion de la Salsa... Aujourd'hui la Java n'a plus le blues, elle monnaye son nom, elle vit sur ses acquis, elle est devenue un lieu branché, un endroit à la mode pour les soirées bobo-parigotes. Mais ce soir l'on y court, puisque Lil' Gizzelle y donne un concert.

L'entrée est au fond d'un faux passage. Tout de suite la caisse et un double-escalier qui vous descend au saint des saints. Une avant-salle avec bar – uniquement des boissons froides, licence IV - la salle proprement dite, étroite mais longue, un plancher central, piliers et nefs latérales sur les côtés. Au fond la scène, peu surélevée malgré ses deux niveaux. Le matos des Mellow Kings est en place. Jusque là tout baigne dans l'huile. Pedro, le batteur de Carl and The Rhythm All Stars, est à la console. Fait office de disc-jockey, vous balance des tubes de rhythm'n'blues à la pelle. Le temps de zieuter le stand de Wild Records, l'espace est envahi par des hordes de danseurs.
Va falloir se les fader durant près de trois heures. Pénible. Ce n'est pas qu'ils dansent mal – il est certain que la plupart fréquentent les cours de danse - mais donnent l'impression de suivre un entraînement de gymnaste. De tous âges ils se prennent tous trop au sérieux. S'exhibent plus qu'ils ne prennent du plaisir. Le rock'n'roll est en train de devenir une danse de salon. Se fait récupérer par les milieux semi-friqués de la petite-bourgeoisie qui prend le train à l'arrêt de la rébellion sans danger, soixante ans après Bill Haley.
ROY THOMPSON & THE MELLOW KINGS

Du monde sur la scène. Basse, batterie, piano forment la deuxième ligne d'attaque. Roy Thompson est au centre, cravate et guitare rythmique au cou, guitariste gretsch à sa droite, souffleur de sax à sa gauche. Tous des jeunes – Roy est l'aîné, c'est lui qui drive la barque – mais les autres souquent comme des fous. S'amusent. Ont autant de plaisir à jouer que nous à les écouter. De joyeux drilles. Avec Jean-Pierre Cardot au piano, l'on comprend que l'on ne va pas s'ennuyer. Larrons en foire et rires de bossus. Les trois du fond n'en ratent pas une. N'en finissent pas d'échanger des coups d'oeil complices. Se surveillent. Chacun en rajoute un peu au dernier moment, manière que les deux autres se sentent piqués au vif et veuillent à tout prix avoir la dernière note.

Devant c'est la danse des sax. Un seul souffleur mais deux appareils, en change à chaque morceau. Doit les laisser refroidir car il en sort un son brûlant qui vous ramone la colonne vertébrale. Pas besoin de section de cuivres. Fait autant de bruit qu'une fanfare à lui tout seul. Un sirop de glucose épais, onctueux à souhait. L'on en mangerait, nous enveloppe, nous enserre, nous colle à la peau comme une tunique de Nessus. Difficile de l'enlever.

A peine avez-vous trouvé votre équilibre mental que tout se déglingue au-dedans et au-dehors de vous. Le combo change de vitesse. Dérailleur en folie. A l'intérieur du même morceau, et de morceau à morceau. Du jump au boogie, du rhythm and blues pur Harlem au jazz le plus syncopé. Grand orchestre mais aussi subtilités harmoniques. Pas le temps de s'attarder, un riff de rock'n'roll et c'est reparti pour la folie noire.

Avec un batteur qui bouscule tout le monde. Un homme orchestre, de grands gestes à la Stravinsky dirigeant l'Oiseau de Feu. N'est pas établi sur une ligne rythmique qu'il rebondit ailleurs, surtout pas dans la direction précédemment infléchie. Retombe toujours sur ses pattes comme un chat qui fait semblant de tomber du toit. Vous rattrape tout son monde au dernier moment et ça a intérêt à filer droit.

Y en un autre dans son coin, et sous son chapeau, qui nous joue une drôle de musique. Normalement c'est le dernier truc que l'on entend dans un combo de rhythm and blues, c'est juste pour les gimmicks à la fin des lignes rythmiques, le couinement sympathique qui nous annonce que l'on vient de terminer une séquence et qu'une autre va tout de suite commencer, et ensuite l'on joue en rythmique pour ne pas se faire remarquer, c'est d'ailleurs de ce retrait que sont nés le groove et le funk, mais les Rois Moelleux ne sont pas pour rien affiliés à la scène rockabilly. La guitare ne saurait être un simple instrument d'accompagnement. Faut qu'elle prenne le devant de la scène. Ecoutez-moi, c'est moi qui suis la reine.
Le sax souffle, mais la Gretsch nous époustoufle. Damned, en voici un qui a dû s'endormir au premier carrefour. Touche pas comme un demi-manchot. Nous douche de stupeur. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il nous déboule un instrumental d'Ike Turner à vous rendre malheureux pour le reste de votre vie. N'avait pas atterri au studio Sun par hasard, the great Ike. Ce mec a contribué à la naissance de la guitare rock aussi bien que Graddy Martin ou Link Wray, et notre guitar héros de la soirée nous restitue la panoplie en entier. Ira jusqu'à mordre les cordes à la Charlie Patton. Superbe. Chapeau bas. Rien que pour cela, l'on n'est pas venu pour rien. Vous auriez entendu ce ronflement de Spitfire que tout comme moi, vous en deviendrez lyrique.

Mais avec Roy Thompson vous n'avez pas le temps de vous appesantir. Personne ne s'octroie une pause pipi et c'est reparti pour un tour. Toutes les cinq minutes, Jean-Pierre Cardot vous pète un cardan, et le grand escogriffe une durite sur sa caisse claire. Charivari non remboursé par la sécurité sociale, le pauvre piano bastringue doit subir une révision générale après chaque concert, ces touches d'ivoire ne vont pas faire de vieux os... N'y aura même pas besoin d'un rappel. Roy se contente de préciser qu'ils reviendront plus tard pour accompagner Lil' Gizelle. Personne ne rouspète, ont trop donné pour que l'on pense à demander du rabe. L'on est comblés, comme des roys.
UN BEMOL
Ca chauffait un peu. Beaucoup même. Entre deux titres Roy a demandé trois bières. Pour six gaillards recouverts de sueur. Elles tardaient à venir... Quatre ou cinq morceaux plus tard réitération de la demande. Ce coup-ci un quidam du staff s'est précipité. Vous avez tout faux. Ce n'était pas pour emmener tres cervezas muy frescas. D'abord les tickets de rationnement. Set interrompu. Les musicos ont dû fouiller dans leurs poches pour trouver le sésame liquéfiant. Quelle générosité ! Quel respect des artistes ! C'était organisé par la Baronne de Panam'.
LIL' GIZZELLE

Roy Thompson et son combo n'attendent plus qu'elle. Se démène comme des fous pour lui ménager une entrée tonitruante. La grande star arrive. Pas plus d'un mètre cinquante, sur boots à talons hauts. Sourire carnassier aux lèvres. Vingt-quatre ans et l'allure d'une insupportable gamine. L'on sent tout de suite l'enfant gâtée, la môme capricieuse, l'irréductible créature qui n'en fait qu'à sa tête, l'égo débordant sur les côtés comme un sombrero mexicain. Un charme fou. Des bras de camionneurs tatoués comme la Chapelle Sixtine, exquise et potelée, une jupe lamée qui arrondit sa cambrure, une poitrine de rêve, naturelle et féminine à l'excès, une présence. Une femme dans tous ses atours. Sans complexe.

L'arrive un verre de tisane à la main. De l'autre elle s'empare du micro et met tout le monde KO dès le premier hurlement. Un coffre. De pirates rempli de merveille. L'est enrouée mais pas muette comme une carpe. Elle jette et elle s'époumone. Les Mellow lui tricotent une chasuble d'or. Un peu de mal pour les contrechants, l'on sent que d'habitude elle doit monter beaucoup plus haut. L'on ne regrette même pas. S'excuse de son coup de froid. Mais depuis qu'elle est sur scène c'est plutôt le coup de chaud. L'est à trente pour cent de ses possibilités, mais bien au-dessus de la plupart. Et puis il y a cette indolence tranquille, ce sourire ravageur, de petite fille candide qui quoi qu'elle fasse sait très bien que tout lui sera pardonné.

Déjà sur scène ils sont tous à ses pieds. Roy Thompson qui la domine de sa grande taille la surveille comme si c'était la première merveille du monde. La protègent comme une rose fragile alors que l'on comprend qu'elle est capable de se défendre toute seule. Elle entonne un chant de guerre, se ruent derrière elle à toutes pompes, ah ces nappées de saxophone, et plaf, elle lève le bras, et tout s'arrête, et se brise, et s'écroule, et se reconstitue par miracle sur un rythme, un ton différents.

Lui mangent dans la main. Ne savent pas quoi faire pour lui complaire. Taquine, mutine, coquine, elle les aguiche un par un, et chacun se sentant pour un moment le roi élu de la fête, souffle, gratte, tape à s'en faire péter la sous-ventrière. M'étonne qu'il y ait une majorité de filles jeunes massées devant la scène, viennent prendre des leçons ! Le tout n'est pas d'être la plus belle, mais la plus vindicative, suffit de vouloir pour être la maîtresse de l'univers. Elle en profite, entre deux lampées de tisane elle ordonne les soli. Pas de jaloux, chaque musicien repassera plusieurs fois, et tous essaient de se surpasser. Seul Roy Thompson échappe à la corvée. Tient le rôle du traducteur. Ne comprend pas tout – nous, rien – alors il raconte la semaine de fous qu'ils viennent de passer avec elle durant cette tournée européenne. Ils en ont bavé, mais n'auraient pas donné leur place pour un empire. Est aussi une adepte de l'auto-médicamentation, elle s'administre de temps en temps des petits verres de téquila, et lorsque l'on voit son sourire l'on a l'impression que ça nous fait du bien.

Une majorité de morceaux de Lavern Baker dans son répertoire, rhythm and blues certes mais qui penche du côtés du screamin'rock. Elle n'a pas pu tout donner, mais nous on a tout pris. Jusqu'à la dernière miette. Ce n'est pas un hasard si elle est la vedette féminine du label Wild Records. Pas vraiment des mollusques chez Wild Records. Enregistrent un maximum de chicanos, des colériques, des excités, qui crient leur hargne et leur rejet. Sont un peu les nouveaux noirs des States, des citoyens de seconde zone qui ont des comptes à régler avec la vie.

Lorsque le set s'est terminé. N'y a plus beaucoup de monde. Les danseurs se sont éclipsés. Sont fatigués. Ils aiment secouer leur popotin sur des musiques rythmées, mais il ne faut pas que ça leur monte au cerveau. Ne veulent surtout pas réfléchir sur la signification de leur hobby stérile.
J'ai oublié de raconter la meilleure : à un moment Lil' demande à ce qu'on lui apporte un deuxième thé chaud. Flottement dans l'organisation, un employé s'empare du micro et explique que pour y avoir droit, il faut d'abord donner un ticket boisson. Réaction outragée du public. La Baronne comprend que cette intervention peu aristocratique ne fleure pas la générosité. Reviendra avec une carafe. Perso, si j'avais été Lil je me serais cassé aussi sec. J'ai du mal avec la pingrerie. Ce n'est pas une constituante de l'esprit rock. Peu rancunière Lil' nous octroiera tout de même faire deux morceaux au rappel. Prenons-en de la graine. De violence.
Damie Chad.
( Photos de Edonald Duck prises sur le facebook des artistes )
Blue Cheer, ça déchire
On a une petite actualité Blue Cheer, oh pas grand chose, mais tout de même de quoi replonger dans le monde à part de Dickie Peterson : la parution de «Blue Cheer 7» (l'album perdu) et d'un DVD, «Blue Cheer Rocks Europe», qui propose un concert enregistré pour l'émission Rockpalast, en Allemagne.
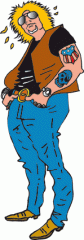
Pendant plus de quarante ans, Blue Cheer a su conserver son statut de mythe du rock américain. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas des masses qui ont su tenir la distance et rester fidèles à leur vision et donc à leurs fans. Comme le confie Dickie Peterson au cours de la longue interview incluse dans le DVD, Blue Cheer constituait sa vraie famille, puisque ses parents étaient morts quand il était encore très jeune. On le considère comme l'inventeur du heavy rock. Il suffit d'écouter ou de réécouter «Vincebus Eruptum», le premier album de Blue Cheer, pour comprendre ce que Dickie Peterson entendait par heavy rock. En réalité, il envisageait le rock comme un pilonnage d'accords de blues et une saturation extrême du son. Il se situait aux antipodes du son West Coast, gracile et aérien comme un papillon. Dickie préférait une bonne charge de mammouths. Son jeu favori consistait à enfoncer les clous à coup de masse, vous savez ces grosses masses qu'on utilise sur les chantiers pour cogner sur les clés de frappe et débloquer les écrous des couvercles d'échangeurs. Dickie Peterson ne raisonnait qu'en termes de puissance et de décibels. Les groupes de San Francisco cultivaient la dentelle florentine, le psyché bucolique. Dickie ne rêvait que de trous d'obus et de façades écroulées. Dickie Peterson avait une vision du rock tellement à part que son groupe se retrouva rapidement isolé. (On leur reprochait d'être «too loud and too simple» - trop bruyants et trop primaires). Quand on lui demande quels sont ses meilleurs souvenirs de concert, il cite aussitôt un concert au Grande Ballroom de Detroit en compagnie du MC5. Au moins, ceux-là parlaient le même langage.

Depuis la parution du premier album, les coups de chapeau se sont multipliés, surtout de la part des malheureux hardeux qui ont besoin de se raccrocher à des noms pour légitimer leur démarche. Alors, ils sont unanimes pour dire que Blue Cheer a inventé le heavy metal, sauf que Blue Cheer n'a rien à voir avec le heavy metal. «The Hunter» n'a jamais été un morceau de heavy metal, mais un morceau de heavy blues. Comme Lemmy, Dickie Peterson insiste sur la distinction. Il joue du rock'n'roll et ça n'a rien à voir avec le fucking metal.

D'ailleurs, dans l'interview, Dickie Peterson s'amuse bien avec ces histoires de parrainage. Il revendique l'invention du punk-rock et aussi du grunge. Force est de constater qu'il ne raconte pas d'histoires. Blue Cheer se retrouve bien à la source des vagues les plus agitées de l'histoire du rock.

Quarante ans, c'est long pour un groupe, surtout quand on y consomme énormément de drogues, comme c'était le cas chez nos trois amis de Blue Cheer. Après les deux premiers albums, la qualité va chuter et on les perdra de vue pendant vingt ans, en gros jusqu'à 1999, date de la parution d'un album enregistré live au Japon (et paru sur le label japonais Captain Trip) : «Hello Tokyo, Bye Bye Osaka», véritable résurrection de la Bête. Si on ne sait pas ce que heavy signifie, alors il faut écouter «Babylon», le morceau qui ouvre le bal. Sur cet album singulièrement ravageur, on a des morceaux de quatre minutes qui prennent leur envol comme des prédateurs d'acier noir dans un ciel embrasé. Blue Cheer inspire une sorte de terreur sacrée. Ce n'est pas un groupe qu'on admire, oh que non ! C'est un groupe qu'on vénère en tremblant. Hormis Monster Magnet, aucun groupe ne sonne comme Blue Cheer, aujourd'hui. Sur «The Hunter», la guitare d'Andrew 'Duck' McDonald et la basse de Dickie Peterson sont en saturation maximale, bien au-delà des normes autorisées. Dickie Peterson mitraille à coups de basse comme s'il était un fantassin de la Wermarcht acculé aux murailles de Stalingrad par une division de mongols cannibales. Ça devient hallucinant de violence carnassière. On pousse des aaahhhh ! et des uuuhhhh ! tellement on est emballé par toute cette démesure frénétique. Il faut avoir entendu un morceau comme «Girl Next Door» une fois dans sa vie pour comprendre ce que peut vouloir dire Richard Burton quand il évoque le musc nacré de l'Islam. C'est vrai que Peterson chante souvent en hurlant, comme si ses nerfs lâchaient, mais comment pourrait-on lui en vouloir ? Franchement, c'est impensable. S'il hurle, c'est qu'il en a besoin. Blue Cheer déverse ses tonnes de décibels sur la gueule des Japonais. C'en est presque comique ! Le solo de McDonald se répand comme de l'or liquide dans un vacarme assourdissant. Blue Cheer se situe au-dessus des lois. La guitare traîne en larsen sur les tap-tap de Paul Whaley et le gros riff de «Summertime Blues» vient tout écrabouiller. Aucun groupe n'a un son aussi atomique, au sens de la bombe. C'est tellement ravageur que ça en devient ubuesque. «Ankya very much !» Bon prince noir des galaxies acides, Dickie Peterson salue une audience japonaise complètement tétanisée. «Out Of Focus» ! C'est encore plus épais, plus pesant que tout ce qu'on ira imaginer. Plus sauvagement sombre, plus dramatiquement abyssal, plus génialement plombé que toutes les énormités du Vanilla Fudge.
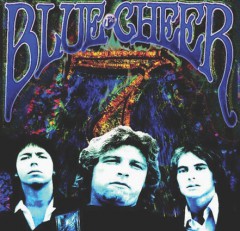
Dans un numéro de Classic Rock de décembre 2003, Dickie Peterson donnait une interview assez cocasse. «Les seuls avec lesquels ça gazait bien, c'était Big Brother And The Holding Company, qui s'habillaient comme nous, c'est-à-dire comme des hors-la-loi. Paul Whaley s'est tapé cette poufiasse de Janis (Joplin) pendant un bon bail. Ils restaient des journées et des journées entières à baiser comme des lapins dans un terrier. Alors des fois, il fallait que j'entre dans la piaule en fracassant la porte pour sortir la bite de Paul du cul de Janis, comme ça, plok !, le traîner jusqu'au van et filer à toute bombe, car nous avions un engagement des Hell's Angels pour un concert, et là terminé la rigolade, umph !» Plus loin, il répond à une autre question : «Quoi ? Hein ? Excusez-moi, je suis un peu sourdingue ! D'où vient le blaze de Blue Cheer ? C'est une bonne question ! Voici la réponse. Blue Cheer, c'est une fabrication spéciale de LSD d'Owsley Stanley». Il précise ensuite que le Magic Bus des Merry Pranksters était garé dans la cour. Dickie raconte qu'il commençait par s'envoyer une tablette, puis, comme il s'habituait facilement à tous les excès, il passait à deux, puis à trois et il finissait par en croquer neuf comme ça, comme d'autres croquent des tablettes de chocolat. Dickie peut se vanter de s'être goinfré d'acides et d'héro. Un vrai gosse. Le journaliste le branche ensuite sur la basse. C'est vrai que personne ne joue de la basse comme lui, en larsen, en feedback, en distorse et en accords. «Qui ? Hein ? Quoi ? Ah oui ! Lemmy Kilmister ! C'est le seul qui hurle et qui joue de la basse comme moi dans un trio tremblement de terre. On s'est rencontrés. On a parlé. Ugh !» En vrai ostrogoth, Dickie admire très peu de gens. Les rares qui recueillent son assentiment, c'est Jimi Hendrix ainsi que le Jeff Beck Group du temps où Rod Stewart occupait le poste de chanteur. «Le Jeff Beck Group, ouais, parce qu'ils sont passés comme une tornade à San Francisco. Hendrix, pour sa prestation nucléaire à Monterey où je ne suis pas allé, parce que ce soir là, j'avais invité une gonzesse avec des miches pas possibles chez moi. Au milieu du salon, il y avait une cheminée. J'ai mis le feu à deux ou trois billes de séquoia et on s'est retrouvés à poil tous les deux sur la fourrure du grizzly. J'étais en train de la défoncer en levrette quand soudain une trombe d'eau froide m'a coupé la chique. C'était ces abrutis de pompiers qui ont d'abord essayé de sonner à la porte, mais la musique était trop forte, alors ils ont éteint l'incendie en balançant de l'eau par le toit dans la cheminée». Dickie est mort de rire. Arf Arf. Plié en deux.
Le concert enregistré pour l'émission Rockpalast date de 2008. Paul Walhey est encore là, alors que Dickie le disait très malade, dans l'interview de 2003. Dickie porte un T-shirt Pirates (sans doute en l'honneur du groupe de Mick Green) et des lunettes noires sous sa crinière de vieux lion de la West Coast. Il porte aussi des bagues, des bracelets, des tatouages, un anneau des frères de la côte à l'oreille et il mâche un chewing-gum, ce qui est très pratique quand on chante. On voit des Jolly Roger sur les amplis. Dickie chante du gras de la glotte, comme le capitaine Flint, jadis, lorsqu'il hurlait ses ordres dans la tempête, au passage du Cap Horn. Il annonce «Parchman Farm», and it goes like this. On voit jouer l'inventeur du garage psyché. Blue Cheer, c'est aussi sacré que les Stooges. Andrew McDonald part en solo de wha-wha, comme au bon vieux temps. McDonald, nous dit Dickie dans l'interview, fait partie de la famille : il joue dans le groupe depuis vingt-deux ans (Par contre, pas un mot sur Leigh Stephens). Ils passent tous leurs classiques à la casserole et envoient une version honorable du «Summertime Blues» qui les a rendu célèbres. Ils jouent ce vieux classique avec la même énergie. Dickie annonce «Doctor Please» : «Il y a une rumeur qui dit que c'est une drug-song. Je veux en finir définitivement avec cette rumeur. C'est vrai... It's a drug-song !». Ils terminent leur set avec leur version de «The Hunter» qui est dix mille fois plus lourde que celle de Free. D'ailleurs, quand on y repense, Paul Kossof se coiffait comme Dickie Peterson, avec de grands mèches de chaume loin devant le visage. Pour cette version ultime de «The Hunter», Dickie va chercher au fond de son gosier des accents gutturaux qui font la grandeur du morceau.

Pour choper «Blue Cheer 7», pas d'autre solution que de le commander chez Bomp, comme au bon vieux temps. C'est un petit label texan nommé ShroomAngel qui s'est chargé de la besogne de réédition, et les liner notes sont signées Eric Albronda, premier batteur du groupe devenu par la suite leur producteur. En 1978, le groupe n'existait plus. Après six albums, Mercury-Phillips avait lâché le groupe. Mais rien ne pouvait arrêter Dickie. Il voulait redémarrer Blue Cheer coûte que coûte. Il le fit avec le guitariste Tony Rainer et un batteur nommé Michael Fleck. Dickie décida de repartir sur la voie du premier album et de revenir aux sources : le heavy blues.
Ils ouvrent le bal de l'album «7» avec une nouvelle version de «Summertime Blues». Joli shoot de heavy blues avec «Take Me Away», un cuissot de heavy bien gras, comme on les aime. C'est la face B qui va réserver son lot de belles surprises. Après une version outrancièrement psychédélique de «Out Of Focus», on tombe sur «Starlight», une petite pop-song montée sur un gros drive de basse. Joli coup. Une autre surprise arrive à la suite avec «Child Of Darkness», une superbe pièce de pop psyché jouée en cocotte et agrémentée de ponts superbes et très mélodieux, comme le jardin de Claude Monet à Giverny. La surprise est de taille car on ne s'attend pas du tout à trouver des morceaux de cette qualité chez un groupe comme Blue Cheer. Non pas qu'il faille les considérer comme des bas du front, mais leur fonds de commerce, ce serait plutôt l'assommoir. D'ailleurs, ils ramènent la grosse Bertha pour «Blues Cadillac».
Dickie Peterson a de sacrés points communs avec deux autres héros : Lemmy et Ron Asheton. Comme Lemmy, il est féru d'histoire. Lemmy se passionne pour la Seconde Guerre Mondiale et il dévore pas mal d'ouvrages très pointus sur la question. Il s'en est même fait une spécialité et comme beaucoup de gens très cultivés, il explique le monde contemporain à la lumière de l'éclairage historique. Dickie lui s'intéresse à l'une des sciences de l'antiquité, l'égyptologie. Quand le groupe tourne en Europe, il disparaît pour aller fureter dans les musées.
Le point commun avec Ron Asheton est beaucoup plus macabre. Ils sont morts tous les deux en 2009 (Ron, crise cardiaque et Dickie, petit cancer). Deux d'un coup. La nuit, quand le vent se lève, on entend rire la Grande Faucheuse, là-bas, au fond de la vallée.
Signé : Cazengler, triste cheer
Blue Cheer. Vincebus Eruptum. Réédité par Sundazed en 2010
Blue Cheer. Outsideinside. Réédité par Sundazed en 2010
Blue Cheer. Hello Tokyo, Bye Bye Osaka. Captain Trip 1999
Blue Cheer. Rocks Europe. Live at Rockpalast. DVD 2009
Blue Cheer. 7. ShroomAngel Records 2012
NON! de Dieu !
Allons donc ! Un disque dédicacé à Léon Bloy ! Avait-on déjà vu chose pareille ? Pas encore. Personne n'osait. Et pour cause.
Une dédicace de la sorte mérite qu'on lève son chapeau car elle révèle l'homme de goût... Un goût d'exterminateur de lieux communs et de pourfendeur de médiocres, par exemple. En fier disciple de Léon Bloy, le dédicaceur pourrait comme lui claironner : «Tous vous diront que je suis un monstre et qu'il n'y a pas de moyen d'échapper à ma dent féroce.»
Le dédicaceur s'appelle Didier Balducci. Baldu pour les intimes. Un Niçois qui voit la fuzz et la provocation comme les deux mamelles de l'hédonisme. On le retrouve dans trois groupes : les Dum Dum Boys dont la réputation n'est plus à faire, Die Idiots et NON!, qui est logotiquement parlant un dérivé de NEU!, l'âpre krautrock band d'antan.
Du coup, ça représente pas mal de disques, dans des genres différents : Dum Dum Boys, quintette à deux guitares avec des morceaux chantés en anglais et abondamment nappés de fuzz, Die Idiots, trio fuzzy qui propose aussi des choses en anglais, dans une veine similaire, et NON!, duo qu'on pourrait qualifier d'electro-pop, qui chante en français, mais qui par son énergie et sa fraîcheur de ton va beaucoup plus loin que les mièvreries artistement chroniquées dans les torchons parisiens.
Il faut donc aller farfouiller. Mon ami le vénérable Professor Von Bee m'ayant mis sur leur piste, j'y suis allé franco, appâté par «Je M'en Fous», un morceau fabuleux niché sur le second album de NON! Les curieux ne seront pas déçus. Loin de là. Baldu fait partie des gens qu'il faut suivre à la trace, car il est comme le lait oublié sur le feu, il déborde d'idées géniales. À sa façon, il incarne dans notre beau pays le pur esprit rock, et c'est tellement peu fréquent qu'il faudrait pouvoir le beugler sur tous les toits.
Commençons par l'album des Idiots. On y trouve Soulsheik des Dum Dum Boys au chant, et deux guitares fuzz tenues par Didier et Nitric Flash Dave. Le recto de pochette emporte la palme de l'ésotérisme le plus hermétique, puisqu'il s'orne d'un aimable trait lumineux, mais au dos, on peut apercevoir nos trois gaillards solidement attablés. Quelques objets encombrent la table, comme par exemple un ouvrage en anglais traitant de l'usage des drogues au cinéma, un CD de Neil Young, un autre CD qui est un Best Of de Burt Bacharach, un paquet de cigarettes, un petit tas de tabac en vrac et une pétoire de gangster, histoire de rappeler que les Idiots ne sont pas des plaisantins. Ils portent tous les trois des lunettes noires et affichent des mines claquemurées de croque-mitaines acariâtres. L'auto-dérision imprègne tellement cette image qu'on sent bien que ce disque échappe à l'ordinaire. Et de là à l'écouter, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement.

Les amateurs de bombes se pourlécheront les babines. On en trouve au moins trois sur ce disque, et des bien grosses. Rien qu'avec le premier titre, on est grassement récompensé d'avoir extrait l'album du bac où des toiles d'araignées commençaient à le couvrir. «You're Nothing New» sonne comme un authentique Detroit-rock en suspension, l'un des ces vieux rocks qu'on voyait tituber dans les ruisseaux qui firent les grandes rivières sans retour. Il faut les voir se jeter tous les trois à corps perdus dans le second couplet ! Du coup, nous voilà aux aguets pour la suite. Le second titre percute moins, mais une menace bourdonnante et affreusement permanente le hante. Ah la permanence ! Que deviendrions-nous sans elle ! La deuxième bombe se niche au bout de la face A. «Bad Trip» saute à la gorge, comme une giclée indus d'Al Jourgensen et ça embraye avec le riff stoogien de «1969», ce qui donne une précieuse indication sur la pureté des intentions de nos Idiots. Ils emmènent le bad trip jusqu'aux frontières de la mad psychedelia. It's a bad trip ! Ils ont du souffle et on raffole non seulement du souffle en tant que tel, mais aussi des groupes qui ont du souffle. Sur la face B se tapit une pernicieuse reprise des Stones («Miss You») et une autre bombe, «Come On», le genre de morceau un peu allongé qui peut éveiller dans certaines cervelles le souvenir des Black Moses et des Spacemen Three. Dans l'interview accordée à Dig It, Didier qualifiait le son des Die Idiots de fuzz rock trash. Au moins, c'est précis.

Avec les Dum Dum Boys, on reste dans un univers parallèle. L'excellent Soulsheik (Karim Badi) préside aux destinées vocales du groupe, mais attention ! Un démon œuvre sur ce disque. On le nomme dans les messes noires Erik 'Guy Pop' Fostinelli et il joue de la basse. On l'entend faire des ravages sur «Feelin' Motown» et «Jukebox Jesus». Rien de tel qu'un bon drive de basse pour embarquer un morceau. On se souvient des exploits de Chas Chandler dans les Animals. Il pétaradait avec une belle insolence et multipliait jusqu'à la nausée les figures de style. Avec ce coup de chapeau au Motown Sound agrémenté d'un solo de guitare parfaitement idoine, les Dum Dum Boys réussissent leur coup. Pour ceux qui aiment soigner la bande-son de leurs trajets routiers, «I Remember» est une pièce de tout premier choix. Ce mid-tempo entêtant est parfaitement indiqué pour la route. En l'écoutant, on voit défiler les paysages. «Speedin'/Come Down» se présente comme un assaut punk. On sent l'haleine chaude des juments, par un petit matin de janvier, sur la plaine d'Eylau, juste avant que ne sonne le clairon de charge. Juste après l'assaut, vous trouverez une méchante bombe : «Five Fingers And A Brain», qui renvoie aux grandes heures des Mary Chain. Quelle ampleur ! Voilà un morceau mélodiquement parfait et bourré de fuzz. Il claque au vent comme un classique. On croirait entendre l'un des hits des frères Reid, mais non, c'est un effarant classique des Dum Dum Boys, hautain, élégant et dévastateur, porté par le génie du gimmickage fuzz, five fingers et des pam-pam-pam qui évoquent les dérives mortifères de «Darklands».

Un nouvel album des Dum Dum Boys vient tout juste de sortir : «Alive In The Echo Chamber». On y retrouve les mêmes caractéristiques que sur l'album précédent. L'ensemble tient admirablement la route et on tombe de temps en temps sur de vraies bombes. «The Fuzz», par exemple, qui ouvre le bal. Le morceau sonne comme un hit glorieux. Sur «A Girl Like You», vous entendrez la basse entrer dans le morceau après le chant. L'effet en subjuguera plus d'un. Le morceau file tout droit, de façon admirable, comme certains exploits des Cosmic Psychos. Le son de la basse est incroyablement beau, bien sourd, et un killer solo vient rompre la mécanique du tout-droitisme. C'est tellement inspiré qu'on retrouve là encore la veine des Mary Chain. «The Endless Boogie» allume aussi le plafonnier, avec une entrée de la basse au deuxième tour et une tension perpétuelle alimentée par de discrets panaches de guitares incendiaires. Peu de gens se risquent à de tels subterfuges. On se réjouit d'une telle audace.
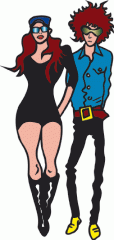
Retournez la pochette du premier album de NON! Vous y trouverez Didier et Karyn, aussi allongés qu'ils sont élégants. Karyn attaque «Je Suis Une Fille» d'une voix d'ingénue desaxée : «J'ai une chatte et un cerveau !» Excellente introduction au monde désenchanté des NON! Karyn fait sa Bardot dévoyée et Didier pulse le beat avec un art consommé. Par leur énergie, ils évoquent les Stereo Total qui savaient eux aussi embraser les imaginations (voici quelques années, des promoteurs peu scrupuleux commettaient l'erreur de programmer Stereo Total en première partie de certains concerts parisiens - le public était singulièrement miséricordieux car il tolérait les malheureux groupes qui osaient monter sur scène après Stereo Total - les Strokes, par exemple).

Le premier album des NON! grouille de gemmes rares : une sublime apologie de l'ennui («Tu M'ennuies»), un hommage au bubblegum monté sur un petit tempo scélérat («J'écoute Du Bubblegum»), une ode au désordre mental fagotée comme un gros jerk bas sur pattes («Stoned»), une parabole érotique de la meilleure eau («Canapé») et un pamphlet virulent, digne de Léon Bloy, visant cette infamie qu'est le monde de la pop-music conditionnée («C'est Ça La Pop Musique ?») Admirable de verdeur punitive. Avec une telle maîtrise du coup de hache, Didier Balducci peut largement se prévaloir de cette pensée bloyenne : «Je le confesse, il n'est pas en mon pouvoir de me tenir tranquille. Quand je ne massacre pas, il faut que je désoblige. C'est mon destin. J'ai le fanatisme de l'ingratitude.» La face B renferme aussi un joli lot de surprises : texte de qualité serti sur bourdonnement d'abeille solidement charpenté («Jamais»), apologie des intrusions coquines («Partout»), brillant hommage baudelairien à Elvis («Paradis Artificiels»), sommet du neurasthénisme provocatoire («Comme ça») - «Je crache sur la tombe des chanteurs morts/ Et je crache à la gueule de ceux qui vivent encore/ Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça.» Et vous finirez par la septième merveille du monde, «Quatre Accords Et Une Mélodie», brillant exercice de style dans lequel Karyn chante les quatre accords d'un tube qui réveillerait les morts. Et c'est là qu'on se frappe la paume : Bon dieu, mais c'est bien sûr ! Didier Balducci, il a du génie !

Le second album de NON! labourera encore plus profondément les cervelles. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler les disques parfaits. Aucun déchet ne souille cet album. Nos mâchoires se décrochent dès le premier morceau qui s'appelle «Plus Rien». En entendant l'intro, on croit que c'est pour rire, comme chez Taxi Girl, mais une grosse couche de fuzz nous tombe dessus. On passe de la rigolade au vrai jerk et on file danser au Bus Palladium jusqu'à l'aube, les cheveux dans les yeux et les muqueuses en émoi. «Si Tu Savais» ressemble à un hommage à Suicide. On redanse de plus belle dans le dérèglement prismatique que suggère le stroboscope. Les NON! nous offrent le meilleur disque de danse des temps modernes - «Si tu savais qu'il y en a eu d'autres avant/ et d'autres après/ et même pendant !» Karyn ne vous lâchera plus. La féline miaule, wouahh, et ondule dans la lumière blanche. Des reflets psychédéliques dansent sur la peau de ses cuisses. Impossible de rester assis dans une banquette. Avec «Extasie», on se retrouve avec une merveille digne de Stone et Charden, c'est du pur sixties sound taille basse, riffé à la sauce de la rue Fontaine. Karyn fait sa BB sous acide et allume tous les lampions - «Quelque chose de chimique ! Il n'y a que défoncée que je peux supporter la réalité» - c'est du Velvet chocolaté arrosé de fuzz bien rose. Et c'est là que votre destin va basculer : avec «Je M'en Fous», ces deux démons réinventent le nihilisme et la barbe de Bakounine dégouline de fuzz. Et là, une fois de plus, on crie au génie - «et vomir enfin/ le dimanche matin» - Elle clame qu'elle n'aime pas le travail, ce qui devrait plaire à Pierre Carles. Notons l'intrusion démoniaque de la fuzz à un certain moment. La face A s'achève avec «Tout Est Fini», zébré d'éclairs violents et mauves, installé sur une parfaite assise de fuzz, doté d'un beat dressé et lézardé. Voilà que point le matin et les corps tanguent encore, mollement pulsés par un beat turgescent. La face B emportera la bouche aussi sûrement que le piment de Cayenne qu'on vient de croquer accidentellement. «Pas La Peine» élève la guitare trash au rang d'art suprême. «Le Disco» envoie de longues giclées de fuzz dans la raie offerte du vieux disco. «C'est Ça L'amour» évoque les méandres bourbeux de la vie conjugale, «les surgelés chez Picart», et élève Didier et Karyn au rang de Stone et Charden du trash, comme s'ils s'étaient volontairement john-waterisés. Ils mettent un terme à l'hallali avec «La Mécanique De L'amour», un pamphlet organique - «le spermatozoïde, c'est comme le saumon, c'est con» - qui bascule dans l'héroïc fantasy et qui par certains côtés renvoie à l'abyssale plongée du Léo Ferré verdâtre d'«Il N'y A Plus Rien» vers l'au-delà du lieu commun.
Grâce au Professor Von Bee, j'ai pu entendre des morceaux de Screamplay, un 45 t solo de Karyn. Cinq morceaux décrochent violemment la timbale. Blong. Stoogerie abominable, «C'mon Everybody» nous envoie rissoler dans l'enfer du detroit-sound. Avec «Come With Me», on bat tous les records d'atomisation. On ne reverra pas de sitôt couler une telle purée, un déversement aussi pesant. C'est en quelque sorte du pachydermique enfoncé à coups de boutoir par des soudards tarasboulbiques du moyen-âge ivres de mauvais vin et de carnage. Il règne dans ce morceau une violence dont on n'a pas idée - «Everything is alright but she don't know» - c'est tellement riffé au fond du garage qu'on sent l'odeur de la graisse ambrée, celle dont on enduit les pignons des boîtes de vitesse. «I Don't Give A fuck» s'inscrit dans la grande veine provocatrice et bat tous les records d'agression sonique. Explosif et insultant ! Il y a dans ce morceau toute l'énergie de l'adolescent boutonneux qui s'arc-boute pour essayer de renverser un car de CRS. C'est le trésor trash dont a rêvé Ali Baba. Ce morceau contient une telle énergie qu'on l'entend siffler comme un boulet ramé envoyé dans la mâture d'un vaisseau amiral. Sus à l'Espagnol ! Pas de quartier !
Il existe encore un morceau de Screamplay qui s'appelle «Run» et qui rivalise d'ardeur avec les autres. Un courant violent l'emporte. De toute façon, il n'avait aucune chance, vu qu'il est trashé jusqu'au croupion. Complètement dévasté. Et même encore plus dévasté qu'on ne saurait l'imaginer. Rarement un morceau donnera aussi nettement cette sensation d'une course vers le néant. Il frise la démence. Avis aux amateurs.

Le phénomène NON! n'a rien de surprenant, étant donné le niveau d'érudition de notre trashman. On ne va pas très loin si on n'alimente pas sa cervelle. Meilleures sont les nourritures et meilleures sont les productions. C'est une règle qui se vérifie chaque fois que vous entrez dans une maison remplie de livres ou de disques. On est certain de ne pas s'y ennuyer. Les bibliophiles et les collectionneurs de disques ont certes leurs petits travers, mais ils ne vous parleront jamais du temps qu'il fait. Quand Didier Balducci évoque ses rockers et ses auteurs de prédilection, il cite en vrac les noms des Cramps, de Suicide, des Stooges, des Mary Chain, de Dashiell Hedayat, du Velvet, de Monsieur Quintron, des Subsonics, de Ian Svenonius, de Joris-Karl Huysmans, de Léon Bloy - comme on l'a vu - de Jules Barbey d'Aurevilly, de Pier Paolo Pasolini, d'Orson Welles, de Pierre Clémenti, d'Isodore Isou, et de quelques autres cocos du même tonneau. Il n'est donc pas surprenant que ses disques soient particulièrement inspirés. Comme le sont ceux des Cramps ou de Tav Falco, par exemple.
Alors que les Barracudas essoraient leurs chemises dans une pièce annexe du Batolune et qu'un fort vent d'Ouest fouillait les chevelures d'un public ravi et agglutiné sous un réverbère, le Professor fendit la foule jusqu'à notre petit groupe pour me remettre un cadeau : le nouvel album de NON! tout juste sorti du four, encore bien chaud et bien craquant.
Ce mini-album se joue en 45 tours. Il porte le doux nom de «Dé/composés» et propose neuf reprises pas piquées des hannetons. Notre apprenti-sorcier voit grand, puisqu'il ouvre un éventail qui va des Pretty Things jusqu'à la disco, en passant par des horreurs comme Elvis Costello et Cabaret Voltaire. Ces deux mets faisandés donnent justement au menu un caractère aventureux.
Tels deux vauriens en maraude, Didier et Karyn s'emparent d'un vieux hit magistral d'Electric Light Orchestra, «Don't Bring Me Down» et le bousculent sans ménagement. Avec une ardeur juvénile sans pareille, ils lui grillent la plante des pieds, lui arrachent tous ses secrets et le rebaptisent «À Quoi bon», le bourrent de paille et de propos nihilistes puis le plantent en plein champ les bras en croix pour le léguer à la postérité agricole. S'ensuit une reprise de «LSD» qui s'accommode d'une belle montée de la menace et qui s'affiche comme le point culminant de cette fière galette. Fidèles au rendez-vous, les deux z de la fuzz zèbrent la nuit d'un signe qui pourrait vouloir dire Tzara. Pas impossible, parce qu'on trouve de l'autre côté une reprise d'un groupe new wave nommé Cabaret Voltaire. Ce groupe tire son nom de l'endroit mythique où s'illustra Tzara, au temps où il séjournait encore à Zurich. On est hélas loin - pour ne pas dire aux antipodes - du noir cacadou et des poèmes chimiques. Et même si Karyn chante «Non Non Non» avec une adorable voix de canard, on sent la présence détestable du «Nag Nag Nag» new-waveux. Fort heureusement, nos deux vauriens en maraude reviennent à dada par la bande, car leur petit train tcootchoote à travers les Alpes sous l'œil torve d'une tome de chèvre embusquée.
Une chanson d'Ike and Tina Turner sert de vague prétexte à une apologie rigolote des drogues et avec «Plutôt Mourir», ils tapent dans la tripe disco à la mode de Caen. Voilà donc un bol de disco qui comme toujours s'accommode merveilleusement bien de la boîte à rythme. Comme toute disco, la chose tend invariablement vers l'irrésistible. Difficile de rester assis sur sa chaise. Dès le premières mesures de la chanson suivante, on reconnaît le «Pump It Up» de l'ignoble Costello, l'Elvis à deux sous stiffé sur le revers des vestes des petits punks qui avaient mauvais goût, l'Elvis incongru qui se posait comme une mouche verte sur la charogne du rock anglais. Le Pump à la mormoille devient «Mais Qu'est-ce Que Tu Veux Que Ça Me Foute». Beaucoup plus sexy, comme titre. Ils mettent ensuite les pieds dans le Devo avec «Une Semaine Chargée». Côté texte, c'est admirablement dévoté : «D'apéritif en digestif/ Je finis décontractée/ Carrément anesthésiée.» Il faut voir avec quelle trasherie goûlue elle envoie ça. Soyez certain que vous n'en perdrez pas une miette. Maintenant, les filles à la mode qui chantent du «rock» se prennent très au sérieux et on bâille aux corneilles. Ce qui ne risque pas d'arriver quand Karyn chante. On dresse l'oreille et on se marre comme un bossu. Histoire de finir en beauté, Didier tape dans Kim Salmon. «Too Much Music» sort de l'un des innombrables albums de l'ex-Scientist difficiles à localiser et que traquent inlassablement les pisteurs endurcis. Didier en fait un «Trop De Musique» dans lequel il règle quelques comptes ultimes avant de refermer sa boîte à camembert : «Tout le monde est artiste/ Tout le monde est musicien/ Moi.../ (Silence interminable)/ Pas !»
Comme on ne trouve pas forcément tous ces disques frais et roses chez les disquaires, le plus simple est de contacter directement Didier par mail à l'adresse indiquée ci-après. Vous verrez, c'est quelqu'un de très gentil et ses disques ont deux qualités majeures : ils sont excellents et vraiment pas chers, Nom de dieu !, comme dirait Catherine Deneuve dans «Dieu Est Un Fumeur De Havanes».
Signé : Cazengler, qui dit oui à NON!
NON! NON! Mono-Tone 006 - (Mono-Tone Records, The Sound of Emptiness)
NON! Encore Moins. Mono-Tone 010
NON! Dé/Composés. Mono-Tone 013 - 2013
Dum Dum Boys. Flash ! Trash ! Heat ! Mono-Tone 009 - 2011
Dum Dum Boys. Alive In The Echo Chamber. Mono-Tone 012 - 2013
Die Idiots. One Way Trip To Nowhere. Mono-Tone & Beast Records
CROCKROCKDISC
HONKY TONK TIME. THE SUBWAY COW-BOYS.
Big River / Honky Tonk Blues / Take Me Back To Tulsa / Tonight The Bottle Let Me Down / Walkin The Floor Over You / Ramblin' Man / Take This Job And Shove It / Lonesome On'ry And Mean / Get Rhythm / I Can't Help It / Mama Tried / White Lightnin' / Rawhide.
Vocal, Rhythm Guitar : Will / Lead Guitar : Fab / Doublebass : Matt /
Special Guest : fiddle : Alexis Routhiau.
Recorded and Mixed : Mister Jull ( B.L.R. Studio )
Mastered : Jean-Pierre Bouquet ( L'Autre Studio )
subwaycowboys@gmail.com / Will +33(0) 678-396-815

On les avait beaucoup appréciés en concert ( voir KR'TNT N° 146 du 30 / 05 / 13 ) à Longjumeaux, bar L'Excuse. On n'avait qu'un reproche à leur reprocher à ces étrangers qui venaient dans notre saloon préféré picoler notre sky, n'avaient même pas un disque à nous refourguer. On leur avait fait la morale à ces mauvais garçons, dans notre grande prairie parisienne si tu n'as pas un CD toujours à disposition dans ta poche revolver, c'est comme si tu n'existais pas. Z'ont retenu la leçon, la preuve nous en est donnée par cet artefact, en partie issu des studios, BLR qui n'arrête pas de tourner sur le poste depuis toute une semaine.
Maintenant les rôles sont inversés, c'est à nous de faire profil bas. Nous assènent la grosse artillerie. Bien sûr on kiffe le Honky depuis tout petit, mais là on est médusé. Certes tout le monde ( enfin presque ) peut faire le mariol dans un bar, mais sur un disque, il est impossible de tricher. Et faut avoir un sacré toupet pour s'attaquer à des monuments comme Johnny Cash, Hank Williams er Merle Hagard. C'est que dans ce cas-là le ridicule tue plus sûrement qu'une bastos de Smith & Wesson. Beaucoup tentent le coup, mais comme ils ne sont pas fous, il assaisonnent la sauce au goût rockabilly. Epice extraforte qui gomme les nuances, vous arrache la gueule et emporte votre approbation en moins de deux minutes.
Oui, mais les Subway Cowboys ne marchent pas à la mèche courte, préfèrent appuyer longuement longuement où ça fait mal, respectent l'esprit original du old country time. Un tiers de délire tarentulé, un tiers de prenante nostalgie, un tiers d'on ne sait quoi que faute de mieux nous nommerons le charme amerloque. Faut être né dans le Teenneesse pour le posséder, nous les petits froggies l'on est éliminé dès la naissance. Tous, sauf le grand Will. L'est parti neuf longues années tout seul avec sa guitare et ses grolles arpenter les States, plutôt les coins bouseux que les écoles de commerce. Autant vous dire qu'il manie la langue de Walt Withman à perfection ( bien mieux que Vince Taylor s'exerçant à chanter en français ), et ça s'entend dès qu'il ouvre la bouche.
Pourrait se suffire à lui tout seul, mais l'a trop fréquenté les juke joints pour ne pas ignorer qu'au jeu du poker menteur, lorsque l'on a un as dans son jeu, c'est encore mieux d'en avoir deux autres dans la manche. Et un dernier dans la poche au cas où. Donc Pat, le lead guitar, faites gaffe, ne montre pas sa patte à tout bout de chant, faut pas se laisser endormir par le rythme du train, vous case par-ci par là de ces petits solos de derrière les haricots à vous rendre jaloux, interventions meurtrières, ouvrez l'oreille et appréciez la précision des rafales.

Itou pour Matt, faut le mater un max pour entrer dans sa mathématique supérieure. Un doigté de fée, vous monte et descend des escaliers sur talons hauts. Tap, tap, tap, ce ne sont pas de grands coups de battoirs, non des pointes fines qui l'air de rien vous charpentent un morceau et vous le dotent d'une ossature impeccable. N'y a pas de batterie pour ponctuer, mais le Patt vous fout des virgules à bon escient pour que personne ne sorte des rails.
A eux trois, ils sont parfaits. La première fois que le violon d'Alexis Routhiau – l'est là sur neuf des treize titres – s'en est venu batifoler dans mes trompes d'Eustache, j'ai fait la grimace. Vous savez ces invités de la dernière minute que l'on n'attendait pas, bon ! l'a su gagner sa pitance. N'a pas mis les coudes sur la table et s'est abstenu de faire du bruit pour manifester ostensiblement sa présence, intervient à bon escient, l'a compris qu'il était là pour souligner et pas pour mener le bal. Sert de contre-chant aux instrumentistes, met en évidence leur rudesse campagnarde par l'évidence de son glissendo plus civilisé.
La voix de Will se joue des paroles, tantôt rêveuse s'allongeant sur les syllabes comme le patient sur le divan du psychanalyste, tantôt à double-sens, complice et moqueuse, pousse la corne mélancolique de la tristesse d'un long-horn qui voit se profiler à l'horizon les abattoirs de Chicago, yodelise à souhait dans la plus pure tradition des rodéos, vous promène aux quatre coins de l'Amérique populaire, loin des fantasmes starisés du cirque rock'n'roll.
Que des reprises. La set-list est éloquente. La corde est tendue entre de hauts sommets. Bonjour le vertige. Faut se balader sur le fil en évitant le moindre faux-pas. Ne se sont pas débinés en nous offrants quelques compos originales qui n'atteindraient pas à de telles altitudes. Le résultat est étonnant. Parcours sans faute. Ne donnent pas envie de chercher dans votre discothèque les versions classiques et brevetées. L'on se contente béatement de ce que l'on nous offre, parce que c'est aussi moelleux qu'un apple pie sorti toit droit du four à pain d'une ferme de Kentucky, l'on y croque le goût âpre des vertes senteurs de l'Amérique populaire. Comme on l'aime, joyeuse et rebelle.
A consommer sans modération.
Damie Chad.
CHRONIQUES VULVEUSES
ONZIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
37
La situation n'était pas presque. Elle était désespérée. Carrément. Rondement le Chef s'empressa de dissiper la pesante atmosphère de défaite qui planait en l'air.
« Claudius, vous qui êtes un bricolo du dimanche, pardon je voulais dire un artiste génial, pourriez-vous me confectionner à l'aide d'une vrille quelconque deux petits oeilletons sur les parois latérales de ma valise roulante, juste à cet endroit-là, et de la belle ouvrage s'il vous plaît, ne salopégez pas le boulot, il est quatre heures cinquante deux minutes dix-sept secondes, nous avons le temps, ces gens-là ne se permettront pas d'agir avant six heures tapantes. Agent Chad, munissez-vous d'une balayette, je tiens à laisser cet endroit aussi propre que je l'ai trouvé en rentrant, à la moindre trace de sciure sur le sol je vous radie des cadres ! Pendant que vous vous affairez à notre survie commune, je m'en vais fumer un Coronado N° 8, la situation l'exige. »
38
Six heures tapantes !
-
Hi ! Hi ! Hi ! ( je reconnus aussitôt le rire crispant du proc ), Vous êtes faits comme des rats, sortez un par un les mains en l'air, que l'on vous abatte sans rémission. Pour la cabote ne vous inquiétez pas, nous avons prévu un camion fourrière. Dès qu'elle sera à la SPA, nous nous dépêcherons de la faire piquer. C'est fou ce nous aimons les bêtes ! Hi ! Hi ! Hi !... Moins d'une seconde que j'attends, c'est beaucoup trop. Première compagnie de CRS, face au vantail droit ! Deuxième compagnie de CRS, face au vantail gauche. A mon commandement tirez lentement le battant vers l'extérieur. Bien parfait, arrêtez le mouvement, je me faufile dans l'espace de cinquante centimètres que vous avez dégagé, vous me laissez décharger mes 88 balles réglementaires, avant d'ouvrir en grand et de récupérer les cadavres. Hi ! Hi ! Hi !
Pas un de nous ne bougea. L'eussions-nous voulu que nous n'aurions point pu. Nous avions eu un mal fou à refermer de l'intérieur le cercueil. L'était prévu pour une place, et même en nous serrant un max, il y avait toujours la queue de Molossa qui dépassait et qui empêchait une parfaite jointure du couvercle. Le Proc s'impatientait, il tapait du pied et vociférait après les pauvres CRS qui n'y étaient pour rien. Il les envoya en hurlant fouiller le bâtiment, le rez-de chaussée et les deux étages « Bandes d'incapables, n'oubliez pas que je les veux morts ! »
Est-il nécessaire de préciser que dans notre cercueil régnait justement un silence de mort. Nous entendions les bleus qui montaient et descendaient les escaliers en courant et qui poussaient une exclamation de découragement chaque fois qu'ils ne nous trouvaient pas dans le placard qu'ils venaient d'ouvrir pour la cent-trente troisième fois. Au bout de deux heures de courses éperdues nous commencions à trouver le temps long. Le Proc aussi.
« Arrêtez ! Que pas un de vous ne bouge, je suis sûr que les trouve à moi tout seul en moins de trois minutes ! Laissez-moi me concentrer ! Dans la vie tout est une question de flair ! »
J'imaginais la scène, le Proc monologuant à haute voix avec autour de lui les CRS immobiles, stoppés dans leur élan, comme quand on joue à Un ! Deux ! Trois ! Soleil ! dans la cour de récréation, et que l'on reste debout sans bouger une jambe en l'air, en équilibre sur la pointe des pieds en une posture extravagante.
« De flair disais-je donc, snif, snif, mais quelle est cette délicieuse fragrance qui s'insinue en mes narines ! Ne serait-ce point l'odeur caractéristique d'un Coronado N° 12 ! Savez-vous qu'il n'y a au monde que deux personnes capables de fumer un Coronado N° 12 sans être pris de violentes quintes de toux suivies de longs vomissements ? Quant à l'identification de ces deux individus, c'est ultra-simple : un briseur de pianos louisianais connus sous le nom de Jerry Lee Lewis, et l'espèce d'imbécile patenté qui dirigeait il n'y a pas si longtemps que cela le Service Secret du Rock and roll. Hi ! Hi ! Hi ! Un proverbe austro-hongrois déclare que qui ressent l'atroce puanteur du Coronado 12, ne tarde pas en voir la fumée... tiens, que disais-je, regardez ce cercueil rangé contre le mur. Par ces deux ouvertures latérales, n'est-ce pas la puante fumée d'un Coronado 12 qui s'en échappe ! Vous m'embarquez le cercueil dans le camion de la fourrière. Ne l'ouvrez pas, je suis sûr qu'ils tous dedans, serrés comme des sardines sans huile. Une fois au refuge, on les piquera tous les quatre ensemble ! HI ! Hi ! Hi ! »
39
Quelques instants plus tard nous fûmes poussés par une cohorte de CRS tout joyeux de s'apercevoir que les roulettes de la boîte oblongue les dispensaient de tout portage jusqu'au fourgon de la SPA. Nous entendîmes les portes se refermer et la clef tourner dans la serrure.
-
Chef, quelle malencontreuse idée de vous mettre à fumer un Coronado N° 12, en de telles circonstances !
-
Votre subordonné a raison renchérit Claudius, votre triste addiction nous a conduit à notre perte ! Dire que dans une demi-heure nous serons obligés de quitter notre cercueil pour mourir ! En plus dans un chenil !
-
Wouaf ! Wouaf ! Cétait Molossa, apparemment la perspective de retrouver ses congénères l'enchantait. En sa pauvre âme innocente, elle n'avait jamais entendu parler des camps de la mort.
-
HI ! Hi ! Hi !
-
Chef, je vous en supplie, cessez d'imiter le rire idiot de 008. N'oubliez pas que si nous sommes en de si beaux draps, c'est un peu de votre faute et de votre Coronado N° 12.
-
Ah ! Soupira le Chef, tout grand capitaine est un incompris tant qu'il n'a pas apporté la victoire éclatante à ses hommes dubitatifs ! Ingratitude humaine, Ô Tempora ! Ô Mores ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie !
J'ai cru que sa voix allait se briser. Mais il tapota d'une main distraite le flanc de notre prison et nous demanda :
-
N'est-ce pas du du bois ?
-
Oui Chef, du chêne !
-
Du chêne que l'on abat pour le bûcher d'Hercule ! Ne comprenez-vous pas que ma prédiction se réalise. L'ennemi ramène le cheval de bois au coeur de sa forteresse. En s'emparant de ce cercueil il a signé son arrêt de mort.
Et le chef se mit à fredonner Whole Lotta Shakin' goin' on... La guerre de quatre pouvait commencer.
FIN DU ONZIEME EPISODE
01:28 | Lien permanent | Commentaires (0)


