10/04/2014
KR'TNT ! ¤ 184 : BUZZCOCKS / LOREANN' / SHORTY TOM AND THE LONGSHOTS / TINSTARS / SOUTHERNERS
KR'TNT ! ¤ 184
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
10 / 04 / 2014
|
PETE SHELLEY + BUZZCOCKS / LOREANN' / SHORTY TOM AND THE LONGSHOTS / TINSTARS / RUBY PEARL / SOUTHERNERS |
LA CLEF / SAINT GERMAIN EN LAYE ( 78 )
02 - 04 - 2014 / BUZZCOCKS
LES HITS LECHES DE PETE SHELLEY

Ah les Buzzcocks ! Comme on a pu les adorer pour leurs singles, et les détester à cause de leurs trois premiers albums ratés ! Ils font partie des survivants de la première vague punk de Manchester. Trente-sept ans après la bataille, ils sont toujours là, on ne va pas dire frais et roses comme des gardons, mais fidèles comme des paroissiens. Pete Shelley et Steve Diggle continuent de veiller au destin du groupe, épaulés par deux petits jeunes, Chris Remington (bass) et Danny Farrant (drums).
Pour remonter à la source du groupe, il faut entrer dans un collège technique bien sinistre de la banlieue de Manchester et filer droit au panneau d’affichage des petites annonces. Howard Trafford y a punaisé la sienne. Il cherche des gens pour monter un groupe, mais pas n’importe quels gens. Il faut qu’ils soient fans du Velvet et qu’ils écoutent «Sister Ray». Peter McNeish radine sa fraise et décroche l’annonce. Howard Trafford qui surveillait le panneau d’affichage à distance accourt et lui serre la pince. Il réussit à masquer sa déception car il aurait préféré voir arriver une petite gonzesse. Ils partent ensemble à l’aventure et montent un groupe qui va s’appeler les Buzzcocks. Ils n’ont absolument rien : pas de look, pas de chansons, pas de guitares, pas de rien. Ils trafiquent leurs noms, comme vont le faire quasiment tous les punk-rockers. Howard s’appellera désormais Devoto (il prend le nom d’un chauffeur de bus), et Peter prendra le nom que ses parents lui auraient donné s’il avait été une fille : Shelley. Avec deux autres compères, ils vont enregistrer le EP «Spiral Scratch» et entrer directement dans la légende. Tout simplement parce que «Spiral Scratch» est l’un des cinq meilleurs EPs de la première vague punk anglaise.

Puis, de single en single, les Buzzcocks vont devenir l’un des groupes les plus mélodiques d’Angleterre. Sur scène, c’est imparable. Ils alignent des hits faramineux, tout le monde les connaît et les chante en chœur, on se croirait à un concert des Beatles ou de Slade. On chante, on saute, on crie.

La Clef à Saint-Germain-en-Laye est une salle de rêve, on y descend comme en descend en enfer. Idéal pour recevoir cette poudrière à huit pattes que sont les Buzzcocks, ces lads de Manchester qui ont tout l’or du monde, c’est-à-dire les chansons. Sans les chansons, un groupe ne vaut pas grand-chose, comme nous le savons tous.

Steve Diggle arrive sur scène goguenard. Il paraît sincèrement ému de retrouver un public d’admirateurs. C’est un mec qui rigole de bon cœur et qui envoie des petits saluts aux fans. Il a ce sourire irrépressible des gosses timides et ravis. Il porte une chemise blanche à pois noirs et il joue sur une Telecaster blanche décorée d’un petit Union Jack. C’est le rocker anglais par excellence, présent, scénique, classieux, pas frimeur, qui bouge, qui claque ses accords avec un bras en l’air, qui saute et qui bouge sans cesse. Steve Diggle n’est rien d’autre qu’un punk-rocker qui monte sur scène pour prendre du bon temps avec son public. Tous les oiseaux de mauvaise augure qui passent leur temps à cracher sur le rock ou à prédire sa fin devraient voir Steve Diggle sur scène. Ça leur couperait la chique et ça les remettrait dans le droit chemin.

Par contre, Pete Shelley a pris un petit coup de vieux. Il porte une barbe blanche, il a rétréci mais il s’est épaissi. C’est une petite boule sur deux jambes fluettes. Il ne bouge pas. Il porte du noir, avec des mots imprimés sur la chemise, comme dans l’ancien temps des Punks de Manchester.

Mais la voix est là, intacte, cette voix perchée qui va si bien chercher l’harmonie. Les hits sont eux aussi au rendez-vous. Et quand les Buzzcocks ouvrent leur bal, ils le font avec une version terrible de «Boredom», le hit punk tiré de «Spiral Scratch». C’est la folie. La salle explose aussitôt. Et pourtant, on est dans une ville spéciale - je veux dire par là qu’il vaut mieux être très riche pour y vivre. Saint-Germain n’est pas une banlieue de Glasgow ou de Manchester. Mais le public réagit au quart de tour. On voit Pete Shelley jouer l’incroyable solo de «Boredom» sur une seule note. Magnifique pied-de-nez aux virtuoses à la mormoille.

Ceux qui ont vécu le punk anglais en direct en 1977 savent que les Buzzcocks faisaient jeu égal avec les Sex Pistols et les Damned. Il n’y avait rien de plus excitant qu’un concert des Buzzcocks à Londres. Et le miracle, c’est qu’ils sont toujours là et que des gens les acclament. Ils enchaînent avec «Fast Cars». C’est du délire. Ces hits punks mélodiques firent mouche en 77 et c’est toujours le cas aujourd’hui. Pete Shelley est l’un des grands compositeurs de pop anglaise, ne l’oublions pas. Niveau Lennon/McCartney. Le milieu de set est un peu moins volcanique, puis ça ré-explose vers la fin avec des hits fulgurants comme «Promises», «Love You More», «What Do I Get», et ils vont plonger la meute de fans dans la transe avec trois bombes en rappel : «Everybody», «Ever Fallen In Love» et «Orgasm Addict».
En 1977, pour beaucoup de gens, les Buzzcocks incarnaient l’avenir du rock anglais. Car ils composaient de véritables classiques, comme les Beatles et les Kinks avant eux. Ils s’inscrivaient dans la pure tradition de la british pop, riche en harmonies vocales et en mélodies imparables, même s’ils accéléraient le tempo. Howard Devoto quitta le groupe aussitôt après «Spiral Scratch» pour fonder Magazine. Pete Shelley poursuivit son petit bonhomme de chemin avec Steve Diggle. Comme ils travaillaient une image de modernité, ils s’adjoignirent les services d’un graphiste, comme Hawkwind le fit au début des seventies avec Barney Bubbles. Ils avaient déjà réussi à définir leur identité musicale, et ils sentaient qu’il fallait encore affiner leur spécificité avec une identité visuelle. D’où le graphisme très géométrique inspiré de Mondrian des pochettes des premiers albums et des chemises qu’ils portaient. S’ils avaient pu se transformer le visage pour ressembler à ceux que peignit Picasso dans sa période cubiste, ils l’auraient fait. La soif de modernité peut vous mener loin.

Quand un groupe lâche dans la nature des singles magiques comme «Everybody’s Happy Nowadays», on attend le Pérou. Je me souviens très bien du jour où je suis rentré à la maison avec leur premier album «Another Music In A Different Kitchen» sous le bras. Comme si c’était hier. J’ai mis le disque sur la platine et me suis frotté les mains, comme Ténardier lorsqu’il voit entrer les clients dans son bouclard. Je n’attendais rien de moins qu’une succession de chansons mirobolantes qui allaient me mettre dans un état d’extase comparable à celui que j’avais éprouvé le jour où je découvris «Strawberry Fields Forever». Premier morceau, «Fast Cars», sympa, emmené à fond de train, mais il n’y avait pas de quoi casser une patte à un canard boiteux. Puis «No Reply» et trois autres morceaux terriblement médiocres. Fucking Buzzcocks ! Quelle arnaque ! On allait de déception en déception. Malgré leurs indéniables qualités, «I Don’t Mind» et «What Do I Get» ne parvenaient pas à sauver le reste de l’album. Du coup, je l’offris à mon frère qui fut ravi. Le second album - «Love Bites» - fut accueilli avec une méfiance de paysan corrézien. Je commençai par le flairer, snif snif snif, puis je le mis sur la platine. Ce fut exactement le même scénario, avec une succession toute aussi impressionnante de morceaux médiocres. Il fallait attendre la fin de l’album pour tomber sur les coups de génie. Voilà bien le paradoxe buzzcockien : ils sont capables du pire comme du meilleur. Le pire chez eux sera cette propension à pondre du post-punk insupportable. Rappelons que le post-punk exacerbé fut l’un des fléaux des années quatre-vingt. Le meilleur, ce sont des morceaux faramineux comme «Nothing Left» - Shelley attaque - «I’m on my own now» - avec une voix de teenager désaxé, il crée une énorme tension et on sent tout au long du morceau une vraie pulsation, accompagnée de bouquets d’accords claironnants et de ponts merveilleux jetés par dessus le vide de Manchester - ou ce hit dément qu’est «ESP» - doté d’une monstrueuse intro, joué dans l’urgence, monté sur une sorte de gimmick lumineux - «do you believe in ESP» - ondes transmises de cerveau à cerveau - «a magnetic kind» - et Pete Shelley nous embarque dans une pièce de mad psychedelia hypnotique, drive derrière et gimmick devant, petites notes jouées à l’arrache, véritable coup de génie - «I don’t know what to do» - c’est hallucinant de vérité cryogénique tellement ça fume - jamais on ne reverra ça à Manchester - ESP !

En même temps que l’album sortaient sur single des morceaux magiques comme «Love You More», «Promises» - embarqué à la puissance des power-chords - «how can you ever let me down ?» Pete chante comme un dandy - et surtout «Lipstick», effarant, attaque perchée au chant puis ça vire sur les passages d’accords de «Shot By Both Sides», la classique de Magazine composé par devinez qui ? Pete Shelley, bien sûr. Après avoir découvert ces quelques morceaux, les amateurs de rock anglais réalisèrent que Pete Shelley avait du génie et qu’il était lui aussi capable d’embraser les imaginaires.

Avec le troisième album qui s’appelle «A Different Kind Of Tension», on se retrouve confronté exactement au même problème qu’avec les deux albums précédents : il faut attendre la fin du disque pour tomber enfin sur un titre convenable. Pete Shelley chante «I Believe» avec son fort accent cockney et inscrit le morceau au panthéon de la petite pop décadente.
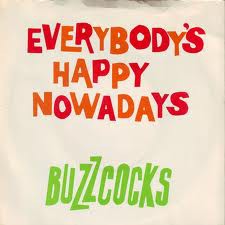
Au même moment sort le single «Everybody’s Happy Nowadays» et c’est le serpent du Loch Ness qui resurgit, un hit affolant de tension, efféminé au chant, tiraillé à la folle note, franchement l’un des hits les plus juteux de l’histoire du rock, nouveau coup de génie de l’ami Shelley, okay okay et doté du slogan punk absolu : «I was so tired of being upset, always wanting something I never could get» (j’en avais marre d’être écœuré, je voulais toujours des choses que je ne pouvais pas avoir). Du coup, si on souhaite garder ce qui est vraiment bien des Buzzcocks, il faut se débarrasser de ces trois albums (comme je l’ai fait) et ne garder que les singles, ou mieux encore, un Best Of du genre «Operators Manual» où sont entassés tous les coups de génie de Pete Shelley. Mais attention, ce genre de disque est dangereux car une overdose émotionnelle peut affecter votre système nerveux et entraîner certaines formes de dégénérescence.

En 1993, c’est-à-dire quinze ans plus tard, sortait un nouvel album intitulé «Trade Test Transmissions». Il présentait exactement les mêmes symptômes que ses prédécesseurs. Après deux premiers morceaux de bonne tenue («Do It» et «Innocent» - belle pop descendante à la Brian Wilson, troussée à la hussarde et chantée avec l’accent cockney, soulignée d’une fantastique partie de basse), le malheureux auditeur devait se taper une interminable série de morceaux médiocres. Mais sa patience était finalement récompensée par deux bonnes surprises. D’abord un vrai standard punk, «Energy», qui apportait la preuve de l’existence d’un dieu du punk-rock. Pete enfonçait le E de Energy et soignait ses chutes, pendant que derrière les autres faisaient oh-oh, le tout arrosé d’un killer-solo d’anthologie qui arrivait en dérapage contrôlé. Puis on tombait sur «Crystal Night», amené par une intro monstrueuse et chanté avec une morgue terrible. Morceau du même niveau que «ESP» ou «Everybody’s Happy Nowadays», épouvantable classique qu’on réécoutait plusieurs fois d’affilée pour faire durer l’extase le plus longtemps possible. Peu de gens savent provoquer une telle excitation. Eh bien, Pete Shelley détient ce pouvoir magique.

Cinq ans plus tard, on se prenait «All Set» dans les dents, un petit album qui avait l’air de rien mais qui regorgeait de tubes shelleyiens. L’ami Pete envoyait les grosses guitares et chantait «Totally From The Heart» d’une voix riche, grasse et candide. «Without You» était encore plus dévastateur, on avait là du vrai Buzz, Cock ! De haut vol, taillé dans la viande de la pop et le génie du Pete éclatait une fois de plus - «since you left me/ I live the day by day eh oh» - fantastique poussée de fièvre juvénile, rose et poppy, teenage et sucrée, chantée dans le jus, magique et classique, bourrée de grosses passades d’accords. «Your Love» sonnait aussi comme un gros classique des Cocks, Buzz, c’était riffé à l’arrache, monté sur une ligne de basse qui courait comme le furet, on renouait avec les Buzz d’antan, Cock. Ils sonnaient vraiment comme le MC5 de «Tonight». Et Steve Diggle chantait ses compos, alors on dressait bien l’oreille, car ce vétéran de la scène de Manchester en imposait avec des trucs comme «What Am I Supposed To Do» ou «Playing For Time», compos classiques qui sonnaient comme du rock de pirate viking. Steve Diggle ne s’est jamais foutu de la gueule des gens. Il a toujours cru en ce qu’il faisait. On pourrait très bien le considérer comme le soldat inconnu du rock de Manchester, un héros méconnu dont les compos sont invariablement excellentes. Chanteur, soliste, bête de scène, compositeur, Steve Diggle appartient désormais à la caste des héros du rock anglais.
Les Buzzcocks tapaient aussi dans le Ministry sound avec «What You Mean To Me». La chose était à la fois salée, brutale et claquée de grosses nappes indus et ça finissait par sonner comme un classique underground. Mais on risquait de trouver la chose trop solide pour être honnête. L’honneur de boucler cet excellent disque revenait à Steve Diggle. Il le faisait avec «Back With You», en grattant une guitare sèche et il tenait ses engagements, car la suite du morceau tenait bien la grappe.

Et pouf, trois ans plus tard ils reviennent avec un nouvel album, «Modern». On trouve là-dessus deux ou trois choses de très haut niveau, comme «Thunder Of Hearts», qui file à belle allure et avec une réelle ampleur. La power pop ? Pete Shelley s’y sent comme un poisson dans l’eau. Il y règne sans partage, tel un grand requin blanc. Il réédite l’exploit avec «Runaround», exemple parfait du hit pop porté par la diction du chanteur. Pete Shelley sait mâchouiller ses mots. «Under The Sun» va en épater plus d’un, c’est chaud dès l’intro, c’est même du pur jus de Buzz, Cock ! Une pure giclée de pop boutonneuse sevrée au drumbeat frénétique, un son unique au monde. Steve Diggle revient aux affaires avec un «Turn Of The Screw» battu à la diable et gimmické à la Johnny Thunders. Admirable. «Sneaky» est l’autre perle de ce disque. En voiture, c’est l’printemps !, pourrait dire Pete et vlan ! il nous balance un refrain miraculeux. On assiste une fois de plus à l’éclosion d’une power pop puissante et dégoulinante de jus. Pete Shelley donne tout simplement l’impression de sculpter son refrain pour en faire une œuvre d’art.

Ils restent dans la veine des gros tubes inconnus pour l’album suivant. Il n’a pas de nom. On l’appelle donc «Buzzcocks». On sent qu’avec l’âge, ils gagnent en force. «Keep On» est un morceau symptomatique de cette évolution. Ils frisent désormais le Hüsker Dü. Le bassiste Tony Barber produit maintenant les albums du groupe et on sent bien qu’il mastérise jusqu’à la limite de saturation. «Keep On» est un morceau d’une rare puissance, qui semble par moments saturée. Steve Diggle renvoie sa sauce avec «Wake Up Call», toujours aussi classique et admirable, même s’il recycle des vieux coups de notes tirées de «Shot By Both Sides».
On prend des mauvaises habitudes avec un groupe comme les Buzzcocks. On écoute leurs disques avec l’espoir d’y trouver des hits planétaires, tellement on les sait capables d’en pondre. Du coup, les morceaux moyens nous agacent.
Et quand on tombe sur un morceau comme «Friends», on se sent grassement récompensé, car voilà bien ce qu’il faut appeler une énormité. On prend ce morceau bourré d’échos des Beach Boys et de distorse en pleine poire. C’est en effet une pure démence de Beach Boys flavor pilonnée de frais. «Morning After» est aussi un morceau puissant chanté à coups de menton, mais Tony Barber fait trop de glissés de basse. Tout repose une fois de plus sur l’indicible génie de Pete Shelley. Les Buzzcocks nous font le coup du lapin avec «Lester Sands». Ils jettent des petits chœurs dans la fournaise du punk-rock de Manchester. Les Cocks retrouvent leurs marques, Buzz. «Morning After» est franchement digne de «Spiral Scratch».

Leur dernier album est un peu mou du genou. «Flat Pack Philosophy» n’aura quasiment aucune influence sur l’avenir du genre humain. On sent les Buzzcocks fatigués et ils entassent les morceaux de petite pop malencontreuse, comme ils l’avaient fait sur leurs trois premiers albums.Steve Diggle s’en sort mieux que Peter Shelley sur ce disque. Son «Big Brother Wheels» accroche bien. Il menace toujours la suprématie de brother Pete, mais en fait, il ne parvient jamais à faire exploser ses morceaux dans l’azur marmoréen. Ce privilège appartient à Pete et à Pete seul. Dommage, car sur cet album, les compos de Pete manquent de grandeur élégiaque. On s’ennuie un peu et l’écoutant mâchouiller ses mots. Ce disque semble aussi constipé que le sphincter d’un junkie. Il a beau pousser, oumf... Rien ne vient. Avec «Sound Of A Gun», Steve revient sur le chain gang. Attention, Steve Diggle est un dur de Manchester, question violence, il en connaît un rayon. Il adore se colleter aux gros durs des bars du port. Il adore le bruit du cuir frotté et adore sentir ses semelles coller dans la bière qui sèche.
Et puis sur scène, il a su conserver cette merveilleuse manie consistant à tourner la tête pour cracher par terre.
Signé : Cazengler, triplebuzz, cock !
Buzzcocks. Le Clef. Saint-Germain-en-Laye (78). 2 avril 2014
Buzzcocks. In A Different Kitchen. United Artists Records 1978
Buzzcocks. Love Bites. United Artists Records 1978
Buzzcocks. A Different Kind Of Tension. United Artists Records 1978
Buzzcocks. Trade Test Transmissions. Castle Communications 1993
Buzzcocks. Operators Manual - Buzzcocks Best. EMI 1991
Buzzcocks. All Set. I.R.S. Records 1996
Buzzcocks. Modern. Go-Kart Records 1999
Buzzcocks. Buzzcocks. Merge Records 2003
Buzzcocks. Flat-Pack Philosophy. Cooking Vinyl 2006
Sur l’illustration : de gauche à droite, Pete Shelley, Steve Diggle, Tony Barber et Danny Farrant
LE CESAR / PROVINS
05 - 04 - 14 / LORERANN'
Jour de marché à Provins. Du monde partout, je prends la sage décision de me réfugier dans mon troquet préféré, histoire de me jeter un petit noir – en réalité toute une tribu – dans le gosier. De loin je m'aperçois que j'aurai droit la totale, ils ont sorti la terrasse, le soleil, et les parasols. Mais quelle est cette silhouette qui s'agite en tenant dans ses mains, mais oui, par Zeus et Apollon, c'est une guitare, un objet aussi incongru dans les rues Provins qu'un sous-marin en goguette sur les sableuses dunes du Sahara ! Sans doute suis-je victime d'une insolation printanière, mais non, c'est bien une chanteuse avec micro, deux amplis et sa voix en bandoulière. En plus elle chante en anglais et je reconnais un vieux truc amerloque. M'assois illico et commande un double crachat de dieu pour me remettre de ma surprise.
LOREANN'
Loreann' – retenez bien ce nom – faut un sacré courage pour s'installer sur ces lattes de bois mal dégrossies, au ras des voitures qui n'en finissent pas de passer évitant de justesse de rouler sur les arpions fatigués des ménagères surchargées de paniers rebondis et empêtrées dans leurs encombrantes progénitures.
Malgré tout ce remue-ménage Loreann' affiche un calme olympien, elle est l'alcyon qui nidifie dans la tempête, insensible au brouhaha ambiant, créant par la seule magie de sa voix, une aire de tranquillité océane. Ne possède pas la puissance vocale d'un stentor. N'en a pas besoin. Elle a la finesse, la flexibilité et la subtilité, et cela suffit. Une fraîcheur extraordinaire qui roucoule comme l'oiseau que Joan Baez cache dans sa gorge. Se sert de son micro mais lorsqu'elle s'en éloigne je m'aperçois que son timbre n'en est que plus pur.
Des sets de vingt minutes entrecoupés de très courtes poses employées à avaler deux gorgées de bière et à répondre aux sollicitations diverses des clients séduits par sa prestation. Le patron a très vite ouvert la devanture du café pour qu'à l'intérieur les piliers de comptoir puissent eux aussi profiter de ces opportuns moments de grâce. Et pour une fois, ce n'est plus la foire d'empoigne et les vociférations habituelles qui prédominent...
Possède un répertoire varié, de Ray Charles à Bob Dylan, de Johnny Cash à Etta James. Touche folk dans son interprétation, guitare légère et un peu languissante, l'on décèle un tempérament méditatif que démentent en partie ses espiègles sourires. Plus elle chante, plus l'auditoire de hasard, un peu de bric et de broc, lui prête attention et se focalise sur ses interprétations. N'y aurait pas à chercher loin pour se laisser accaparer, le raffut des bagnoles, les interpellations qui se croisent d'un trottoir à l'autre, une course à faire, un ami qui passe, tout est réuni pour que chacun trouve motif à se distraire. Se passe exactement le contraire, son audience se fidélise et lui propose même quelques titres, souvent trop éloignés de son aire de prédilection. Anick et Richard de Corcova Duo ( voir KR'TNT 105 DU 05 / 07 / 12 ) se sont joints à moi et sont sous le charme.
Les deux derniers sets seront magnifiques, la voix s'est affermie mais maintenant Loreann' chante avec une conviction toute retenue, comme si elle nous chuchotait d'indicibles secrets. Les lignes mélodiques se chargent d'émotion, et l'attention du public se densifie. Cela se ressent dans la force des applaudissements qui suivent l'interruption des deux sets. On y perçoit le regret fervent que ces quart d'heures de toute beauté doivent s'achever... Il est quatorze heures, Loreann' remballe son matériel dans le coffre de la voiture... Nous la reverrons, nous la ré-entendrons.
Damie Chad.
CHÂTEAU DE CLOTAY / GRIGNY
ROCK'N'ROLL JAMBOREE IN ESSONE
05 - 04 – 14
SHORTY TOM & THE LONGSHOTS
Je m'attendais à une résidence royale. Rockabilly à Chambord ou à Azay-Le-Rideau, mais non c'est bien plus modeste, même si la teuf-teuf fait la fière, on lui bippe, rien que pour elle, le monumental monumental vert - les autres devront se contenter du parking communautaire de l'autre côté de la route - avec accès dans la cour d'honneur, juste devant une grande bâtisse, flanquée d'une salle de spectacle sur sa droite et d'une aile de logements – disons universitaires – sur sa gauche. L'ensemble est assez disparate, mais c'est rempli de jeunes gens accueillants. L'on m'explique que c'est une école de théâtre avec troupe d'apprentis artistes séjournant à demeure. Le tout sis près d'un lac, une manière très agréable de se laisser poursuivre par ses études...
L'endroit doit être connu comme le loup blanc par les jeunes de Grigny, quand j'ai demandé à tout un groupe attablé au fast-food local, dès que j'ai indiqué l'adresse, les sourires et les réparties ont fusé : « Pour un concert ? alors c'est au Palais de Cristal ! » Pour le palais de cristal, vous repasserez, ça ressemble davantage à un Mille Club pompidolien agrémenté de quelques baies vitrées...
En tout cas pour l'acoustique sous les poutres vertes il n'y aura rien à redire. L'est vrai que Mister Jull officie au pupitre, et qu'il n'est pas qu'un sorcier de la guitare. Carlos à l'accueil, normal c'est l'organisateur et avec lui l'on est assuré de la qualité, n'a pas l'habitude de faire passer des brelles d'occasion... Suis en avance, le temps d'engloutir un sandwich américain aussi volumineux qu'un tanker de de 500 000 tonnes flottant sur un océan de frites, de farfouiller dans les bacs à disques de (www)rocking-all-life-long(.com)– un sacré choix - et de mettre la main sur un EP américain de Gene Vincent que je ne possédais point, puis de discuter le coup avec l'Association Regagner Les Plaines, quant au combat contre la signature du prochain accord commercial CEE-USA qui prévoit la mise en coupe réglée des derniers secteurs d'économie européenne qui échappent encore à la main-mise des multi-nationales du pouvoir oligarcho-démocratique... et le concert commence.
SHORTY TOM AND THE LONGSHOTS
Trois sur scène – a band without drums –, costume classe western pour Tom et chemise verte pour les acolytes. Dom est à la basse, énorme, envahissante, un long cou de girafe monté sur un cul d'éléphant, doit falloir une camionnette pour la transporter. Les guitares de Tom et Bruno en paraissent minuscules.
Ca faisait un moment qu'ils tournaient autour de leurs instruments, n'arrêtant pas de vérifier ceci ou cela, repartant, revenant, des perfectionnistes. Et maintenant qu'ils sont sur scène l'on comprendre le motif de ces illusoires inquiétudes. N'ont plus le temps. La voix nasale de Shorty Tom en avant et sa guitare rythmique emporte tout sur son passage. Public conquis au bout de trente secondes. Pas de batterie, autant dire aucun moment de repos, faut alimenter le feu sans arrêt, n'y aura pas de bruit de fond, de cognée de bûcheron par derrière pour masquer les moments où l'on reprend son souffle où l'on se secoue les doigts pour chasser les crampes, les Longshots ont choisi le crissement rythmique de la scie pour emporter le morceau. Musique rurale. De l'époque où l'on sciait les arbres des Appalaches pour les étayer les boyaux des mines de charbon.

Les Longshots nous servent un rockabilly primal, du hillbilly de l'ancien temps mais sur un bop-tempo dévastateur. Enchainent les morceaux – déjà pas très longs - à une folle rapidité. La rythmique de Tom est si grêle et si speedée que parfois l'on a l'impression de percevoir le ring-ring fou d'un banjo de l'old time. Première fois que j'entends une partition de piano rag-time jouée à la gratte. Vitesse et célérité.
Faudrait pas perdre de vue, l'aile droite et l'aile gauche de la formation. Sous leurs chapeaux sont comme trois frères, le plus jeune en avant, haut sur patte mais pas très costaud, ni très épais, c'est pourtant lui qui déclenche les bagarres, et les deux autres sont obligés de le tirer de ce mauvais pas car sans eux il est sûr qu'il ne n'en reviendra pas vivant, mouline tellement de ses mains qu'il va perdre son souffle et s'asphyxier. Dom, le gars tranquille, un taiseux qui reste dans son coin, et qui ne cherche noise à personne mais quand le frérot a besoin d'aide, faut voir comment il aligne les claques sur les cordes. Le mec qui ne s'énerve pas, qui prend le temps de réfléchir un quart de seconde avant de frapper car il déteste le hasard, et il tombe toujours juste, pile à l'endroit où ça fait mal, ça vous descend sur le coin de la gueule, au moment où vous ne vous y attendiez plus. Et au cas où vous n'auriez pas compris, il vous rajoute en prime une double mourlane de derrière les fagots pour que vous vous enfonciez bien dans la tête qu'il est l'heure de rentrer à la maison.

Reste l'aîné, celui-là vous le laissez aux copains si vous voulez que votre mère vous reconnaisse le lendemain matin. Sur sa guitare il tricote de la dentelle, vous n'y prenez pas garde au début, parce que le petit dernier se met toujours devant sur la photo, mais Bruno c'est un artiste, vous tisse des arabesques, ni vu ni connu, il se faufile par les côtés, emprunte les venelles de traverse qu'il est le seul à connaître et vous tombe dessus à bras raccourcis, vous n'avez pas le temps de dire ouf, qu'il n'est déjà plus là; il danse et virevolte loin de vous, mais c'est pour mieux revenir, un artiste, un guitariste hors-pair qui jongle avec ses cordes comme le trapéziste de la mort. Attention, c'est lui qui vous portera le coup de grâce. Le blanc-bec devant peut l'entraîner dans les pires maelströms, assurance tout-risque le grand-frère le sortira sans encombre du guêpier dans lequel il se sera fourré.

Bruno doit être spécialiste en arts martiaux musicaux. Le voici devant sa steel guitar. Nouveau modèle, ressemble à un métier à tisser les bracelets de perles indiennes pour les enfants, rien à voir avec les anciennes version à pédale style machine à coudre Singer. La steel guitar reste par excellence le symbolique instrument de la country pleurnicharde qui transforme le glaçon de votre coeur en torrents de larmes chaudes. Shorty a précisé que c'était pour détendre l'atmosphère. Trois morceaux dont un instrumental Roadside Rag, un classique, qui subjugue l'assistance. Mais comment opère-t-il Bruno pour passer du plan vertical à l'horizontal sans se mélanger les doigts ! Doit être méchamment latéralisé. Nous enchante. Notons que Shorty adaptera sur les deux autres titres son phrasé à la nécessaire ampleur d'un chant moins rapide et que la contrebasse de Dom engendrera des harmonies d'une profonde nostalgie. Rien à voir avec l'urgence d'un Ramblin' on, d'un Candy Twist, d'un Beggin'Time ou d'un I've Got Just a Heart – s'ils continuent à le faire battre aussi fort, la crise cardiaque est pour bientôt - de la première partie du set.

Retour à l'urgence métronimique avec You're so Dub, mais c'est presque la fin, deux tartines au piment de cayenne pour le rappel et c'est terminé. Un set bien trop court. Première fois que Shorty Tom and The Longshots s'en venaient tirer le bison dans le bassin parisien, mais il est sûr qu'ils y reviendront. Sont déjà prévus pour le mois de mai au Cross Diner de Montreuil, vu la séduction du public, le bouche à oreille va fonctionner et il risque d'y avoir du monde.
THE TINSTARS

Chance pour nous, feront la balance durant l'entracte. De véritables pros. Sûrs d'eux mêmes, plaisantent entre eux, mais difficile de comprendre pourquoi, viennent de l'autre pays du fromage comme l'annoncera Edonald Duck, et j'ai laissé ma méthode Assimil du néerlandais facile à baragouiner à la maison. Reviennent très vite sur scène et le set démarre au quart de tour.

Décidément ce soir nous jouons au triomino. Encore un trio, rangé comme les précédents mais du plus âgé au plus jeune. Un géant massif à la contrebasse qu'il dominerait presque, en tout cas elle n'en mène pas large entre ses mains, elle obéit à la claque et à l'oeil. Pas du tout la grosse brute qui tape jusqu'à plus faim, pas question qu'elle se contente de mugir comme un moteur d'avion, le rockabilly exige du swing et de la sveltesse, elle a intérêt à ne pas se tromper dans les entrechats the big mama, en mouvement et en rythme, s'il vous plaît, on ne déroge pas à la règle mais on l'interprète avec subtilité. Le slap d'Andre c'est de la godille sur une mer mouvementée, le courant emporte la barque droit devant, mais il sait surfer sur le travers des lames, sans sourciller il oscille sur le dos écumeux de la vague et plonge avec dextérité dans l'abîme des creux dont il s'échappe sans même un sourire de commisération victorieuse à notre adresse. Le capitaine a la main sûre et ce n'est pas le typhon déchaîné par le reste de l'équipage qui pourrait le surprendre. Anneau de pirate à l'oreille gauche.

Anneau de pirate à l'oreille droite. Rick, blue eyed hansome man, doit attirer le regard des filles avec son regard azuréen et ses cheveux blonds rejetés en arrière, guitare acoustique à résonateurs portée haut devant, malmenée avec frénésie – deux jolies cordières se précipiteront pour remplacer un câble défaillant qui aura lâché dès le quatrième morceau. Il ne chante pas, il jette les lyrics à la pelle, à toute vitesse, les propulse et les enchaîne sans ménagement. Un homme pressé, non pas de nous quitter, mais d'entonner un nouveau morceau encore plus furieux que le précédent.

Le plus jeune. Sans anneau, une guitare à cornes – pas une Fender à tête de vache débonnaire – non plutôt celles du diable, resserrées et frondeuses, mais ce qui fait le plus peur c'est la tête en forme de proue de drakkar menaçante. Un engin taillé pour la rapine en haute mer. Bigsby Grady Martin. Enfin une Magnatone ( 57 ). Une reine des guitares rockabilly. Pour vous en convaincre réécoutez le Johnny Burnette Trio. Le genre de trophée qui se mérite. Sinon c'est un peu comme si vous vous promeniez avec un canon à particules mais que vous ne saviez pas vous en servir. Vous auriez très vite l'air si ridicule. L'est tout jeune Dusty Ciggaar, mais la valeur n'attend pas toujours le nombre des années. A la fin du set Edonald Duck viendra signifier que côté guitare l'on aura assisté à un moment historique.

C'est que Dusty nous aura offert un véritable festival de guitare rockabilly. La technique du léopard moucheté. D'abord je me tiens en réserve, tapi à même le sol, une véritable descente de lit inoffensive. Pour les regards distraits seulement, car je suis le fauve qui ne quitte pas sa proie du regard. Les muscles bandés, prêts à se relever au moment propice. J'exulte, je suis impatient, je me retiens avec peine, trop tard vous ne m'avez pas vu bondir, mes griffes déchiquètent un troupeau de gazelles sanglantes, mais déjà, ni vu ni connu, je suis retourné à mon poste d'observation, le regard braqué vers la suite du film, les doigts en suspend au plus bas des cordes, au plus près du chevalet, afin d'obtenir la plus grande puissance lorsqu'il s'agira de faire claquer le riff comme une étamine pourpre au milieu du carnage. Entre eux trois c'est un jeu. C'est une tuerie. Rick et André qui ne laissent pas un interstice de libre. A eux deux ils remplissent l'espace sonore, poussez-vous d'ici puisque nous y sommes et nous n'avons besoin de personne. Et puis entre deux respirations séquentielles se crée comme un vide d'un millionième de seconde et Dusty, la main gauche en haut du manche et la droite qui ne dépasse que très rarement le nombril de son instrument, s'engouffre dans la fente, la guitare en effraction qui se fraye un chemin comme l'on ouvre une porte à coups de pied de biche, le temps d'allumer en guise de signature un incendie flamboyant dans l'appartement visité. Il rajoute le bruit et la fureur, la foudre et le tonnerre.

Very Wild. L'on a eu droit à Pretty Baby, à Worried 'bout You, à Blue Moon mais avec All I Can Do Is Crying la salle explose et les Tinstars passent sur l'orbite supérieure. Ambiance de fou, avec Manu des Barfly qui torse nu nous fait une tattoo-parade délirante pendant que Dusty en embuscade piétine sur place avant d'intervenir de plus en plus fréquemment. Encore quelques fournaises et le groupe quitte la scène. Reviennent aussitôt en compagnie d'une des belles cordières.

Au chant et à la guitare, Ruby Pearl, robe rouge froufroutante, tatouage arabesque en bout de jambe gauche, longue chevelure brune dans le dos. Quart d'heure countrysant. Après la tornade qui vient de s'achever elle parvient à s'imposer sans peine. Belle voix et agréables inflexions. L'orchestre la soutient et lui brode de petits napperons d'amour pour chacun de ses trois morceaux. Rick et Ruby, dos à dos, nous la jouent mamours à la Johnny Cash in love with June Carter. Dans la vie, comme sur scène, ils forment un beau couple.

Le petit chaperon rouge passe en coulisse et les trois méchants loups hurlent à la mort sur un dernier morceau d'anthologie. Les Tinstars nous ont sonné. Merci Carlos.
Damie Chad.
( Plus de 100 photos sur le facebook de Edonald Duck )
CROCKCROCKDISC
THE SOUTHERNERS : ' R BIKE !!
MOTORBIKE / OKLAOMA BABY / LET'S GET IT ON / LOVE ME / GET RHYTHM / EILEEN / YOU ARE MY BABY / THE TRAIN KEPT A ROLLIN'
Vocal : Pascal « P'titLoup » Grolier / Vocal, Upright Bass : Pascal Albrecht / Drums, Backing Vocals : Yves « Vivi » Selem / Lead Guitar : Thierry Paulet / Rhythm Guitar : Michel Frugier
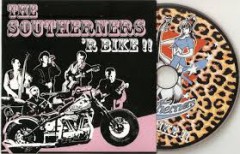
Bien sûr je me drogue. Tous les matins en me levant. Une injection ou un sachet en poudre. Par voie auditive. Je peux vous refiler le nom du produit. The Southerners, 'R Bike. Si votre dealer ne l'a pas, changez de fournisseur. Attention c'est dangereux, beaucoup plus performant que les cachets qu'avalait Johnny Cash dans sa jeunesse. Ne faites pas comme moi, souvent j'abuse, je m'enfile quatre doses d'affilée dans la cambuse avant de partir au boulot ou le soir avant d'honorer une gente demoiselle. Une seule prise et ça vous file du tonus érectus pour la semaine entière.
Vous reconnaîtrez facilement le flacon, rose comme l'aurore radieuse et noir comme la pénombre de la nuit. A l'intérieur, peau de léopard royal et logo pin up au nombril apparent et prometteur sur fond de drapeau sudiste. Provenance estampillée pure rock'n'roll. Huit cristaux à l'intérieur. Vous pouvez sucer voluptueusement, faites gaffe tout de même, ça arrache sec, parfumé au venin de crotale.
Moteur. Motorbike. A peine le temps d'enfourcher la bête qu'elle est déjà partie au trente-deuxième de tour. Im gonna leave this town to-nigth, perdent pas de temps pour expliquer le trajet. Accrochez-vous comme vous pouvez car ils se refilent le guidon à tour de chant, et ces reprises incessantes ne font que maintenir le rythme effréné. Montée d'adrénaline confirmée.
Oklahoma Baby, les mauvais garçons ont ouvert la cage aux oiseaux, en sort une une reprise de Johnny and The Jail bird - il y en aura une deuxième plus tard - balancée à la perfection. Les guitares s'en donnent à coeur joie. Entre parenthèses ces oiseaux d'englishes, couvée des années 80, sont revenus de leur migration - les rockers à la retraite s'ennuient très vite - sont en train de sortir un nouveau disque.
Reprise de Let's Get It On, un morceau d'Hershel Almond de 1959 – n'en a pas sorti beaucoup car il s'est par la suite lancé dans la politique – un véritable plaidoyer pour prendre la vie à pleine dents, les Southerners s'y affutent les canines et l'on peut se rendre compte qu'ils les ont longues, solides, tranchantes et bien aiguisées. Vous croquent le tout en deux minutes.
L'on quitte un peu la rythmique ted pour quelque chose qui au premier abord pourrait paraître plus reposant, normal c'est Love Me, du Buddy Holly, mais il suffit d'écouter l'entrelac des cordes pour s'apercevoir qu'ici les Southerners avancent avec davantage de subtilité. Jeux de voix, mais toutes ces articulations entre les péripéties vocales et les parties de guitare se révèlent être du transport de nitroglycérine.
Get Rhythm, la gymnastique reprend, le morceau casse-gueule par excellence qui ne tolère aucune défaillance. Si vous attendez le déraillement c'est raté. Les Southerners nous offrent une version impeccable. L'on aimerait qu'elle dure un peu plus, mais personne ne vous empêche d'actionner la touche re-play.
Eileen, très style sixties la jeune oiselle échappée de chez Johnny et ses drôles d'emplumés avec ses vap doo wap, les Southerners se laissent un peu mener par le bout du nez avant de la malmener dans le bon sens, l'on préfère de beaucoup la suivante, le You Are My Baby, you are my sugar, sure mais on le dissout dans un verre de viril bourbon, et tout de suite l'on s'aperçoit qui est le maître du jeu amoureux. Sexy ways.
Finissent en beauté, une version explosive du Train qui n'arrête pas de rouler de Johnny Bunette. Sauvage et démesurée. Un must.
Le problème avec ce CD c'est que c'est si bon, tonifiant comme un rail de cocaïne énergisante, que vous êtes obligé de le réentendre une fois de plus, et encore encore... Respectent la règle des trois unités, unité de son, unité de ton, unité de fond. Ces huit morceaux forment un tout, une production identique pour chacun, un parfait équilibrage entre voix et instruments aucune des deux parties n'empiétant sur le territoire du voisin, une grande cohérence entre le choix du répertoire et l'alternance des titres. Un tout indivisible. Une parfaite réussite.
Moi accro, vous voulez rire ! J'suis simplement accrock !
Damie Chad
23:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : buzzcoks, tinstars, shorty tom and his longshots, loreann'
03/04/2014
KR'TNT ! ¤ 183 : JIM JONES REVUE / BLACK MOSES / THEE HYPNOTICS / BLUE ÖYSTER CULT
KR'TNT ! ¤ 183
KEE P ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
04 / 04 / 2014
|
JIM JONES REVUE + BLACK MOSES + THEE HYPNOTICS / BLUE ÖYSTER CULT / |
LE TETRIS / LE HAVRE / 20 - 03 – 14
JIM JONES REVUE
LE PERIL JONES

Kick out the Jim Jones Jams, motherfuckers ! Jim jerke le junk depuis un bail. Jim Jones, c’est le Jesse James du jive anglais, le Gorge Jones du jingle-jungle, le Jack of all junks. L’Angleterre lui doit une fière chandelle. Sans lui et Ray Hanson, c’est-à-dire les Hypnotics, le rock anglais serait tombé dans un sacré cul de basse fosse. À la fin des années 80, Jim Jones a jammé comme un dingue pour sauver le rock anglais d’une mort annoncée.

Jim Jones et Ray Hanson n’écoutaient que des bons disques : Hendrix, Blue Cheer, les Cramps, les Stooges, le MC5 et les Dolls. Quand on écoute ces disques-là, on ne risque généralement pas d’infection. Ils mettaient un point d’honneur à se distinguer des groupes indie ou des groupes punk qui vieillissaient atrocement mal : ils se voulaient porteurs du flambeau et leur premier concert à Londres, ce fut en première partie de Tav Falco &The Panther Burns.

Comme on s’en doute, le parcours des mighty Hypnotics fut météorique : quatre albums, une série de concerts légendaires et pouf, terminé. Leur premier album était un live d’allure stoogienne qui s’appelait «Liver Than God», enregistré en 1989. Le bal s’ouvrait avec «All Night Long» qui ne laissait planer aucun doute sur leurs intentions : ils comptaient stooger exactement la même fournaise que les mythiques FunHousers et rien ni personne n’aurait pu les en empêcher. Jim allait même réussir à jerker des awite à la Pop. Puis, ils allaient taper dans le Big Blue Cheer Blast pour «Let’s Get Naked» et jouer franc jeu la carte du gros bastard rock américain. Et pour leur version de «Rock Me Baby», ils allaient emprunter un riff au MC5 et fournir à la postérité une belle pièce de blitz fumant. Puis, pour corser un peu plus cette sale affaire, ils allaient passer avec armes et bagages dans le camp hendrixien du Band of Gypsys et balancer «Justice In Freedom», histoire de nous faire croire qu’ils étaient sur scène le premier janvier 1970 au Fillmore East. Quelles sales petites frappes ! Ils commençaient franchement à nous indisposer. Mais nous ne savions pas qu’ils allaient continuer.

Leur second album éprouva en effet plus d’un système nerveux et réduisit en bouillie plus d’un cortex pariétal. Non seulement ils l’enregistrèrent au studio de Mark St John sur Wardour Street - le repaire des Pretty Things - mais ils s’ingénièrent en plus à stooger viscéralement leur pochette. Ils l’orangèrent à outrance, ils prirent des mines de merlans frits et cristallisèrent si bien leur déviance qu’on croyait vraiment tomber sur la suite de «Fun House». Ce disque infernal s’appelait «Come Down Heavy» et ça ne faisait pas référence à un saut en parachute, vous pouvez me croire. Phil May et Dick Taylor firent partie de l’aventure. Dave Garland, le mec qui avait enregistré Slade, se trouvait derrière la console. Hélas, cet album n’allait pas être du niveau de «Fun House», mais on y trouvait de bonnes choses, comme «All Messed Up» qui traitait de la problématique du fuck-shit up et les Hypnotics poussaient leur petit bouchon assez loin puisqu’ils flirtaient dangereusement avec le déflagratoire. Ray Hanson se livrait au jeu funeste du solo lance-flamme, comme s’il nettoyait des casemates après l’assaut de la tranchée. Ils allaient rester dans le brûlant avec le heavy groove de «Resurrection Joe» et ramener du fond des bois des accents lancinants connus comme le loup blanc. Puis ils allaient s’illustrer dans le genre épique et difficile du hard rock blues avec «Let It Come Down Heavy» et renouer avec le gras jadis cultivé par des groupes comme Dust et Sir Lord Baltimore. Comme Tintin, les Hypnotics allaient courir le monde et se faire des amis, comme Tad Doyle et Mark Arm à Seattle, puis les Black Crowes et The Cult dans des stades américains.

Et puis comme les Saints, ils passèrent du rôtissage en enfer à la sophistication des arrangements de cuivres pour leur troisième album, l’ambitieux «Soul Glitter And Sin». D’eux, on attendait tout. Surtout depuis que les Stones n’étaient plus capables de sortir un bon album. On allait trouver d’excellentes pièces sur ce disque, comme ce space-rock sanctifié qu’est «Shakedown», pas loin d’Hawkwind, monté sur de gros passages d’accords crampsy - pam pam pammm - et doté d’une belle tension. Puis on entendait des clameurs extraordinaires sur «The Big Fix», étonnant mélange de heaviness, de hurlements et de cris d’éléphants, une pièce accablante, solide et cuivrée à outrance, une épique poussée sauvage, avec des solos de sax jetés dans la confusion. Jim et les djeunes replongeaient de plus belle dans le lac de lave en fusion. «Point Blank Mystery» allait aussi nous sonner les cloches en tant que pulsatif extrême. On se sentait violemment poussé dans le dos par ce morceau rapide comme l’éclair, rempli de clameurs d’apocalypse, et ça repartait inlassablement, avec de nouveaux degrés de brutalité. Il s’agissait d’une matière sonique fulgurante car portée à l’émulsion, et puis il y avait ce «Soul Accelerator» bardé de gros effets et de clameurs de guitare, un son si épais qu’on le tenait pour valeur sûre, et on sentait monter une sorte de torpeur psychédélique qui nous emmenait dériver dans le temps. Il s’agissait là d'un morceau spectaculaire, au sens panoramique. L’intention nous semblait si merveilleuse.
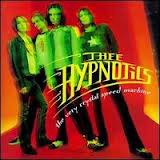
Et puis nous eûmes un quatrième et dernier hoquet hypnotique avec l’album «The Very Crystal Speed Machine». Un seul morceau sortait du lot, l’éléphantesque «Heavy Liquid», heavy comme ce n’est pas permis et même un peu ralenti du bulbe. C’est Ray Hanson qui se taille la part du lion dans ce cut, avec un son étranglé et outrancièrement psyché. La chose s’étend dans le temps et Ray Hanson a le temps de passer au wha-whatage puis il revient au gras du lard en gonflant ses notes comme des crapauds. Tout un art. On ne plaisante pas avec ce son-là. Sur d’autres morceaux comme «If The Greed Lord Loves Ya», ils tombent dans le petit rock à l’US mood un peu cucul la praline et on perd tout. Adieu veaux, vaches, cochons. Petit regain hypnotique sur le tard avec un beau balladit, «Down In The Hole», emmené à l’orgue, et serti d’un solo à l’étranglée de Ray Hanson. Et c’est bien screamé.
Jim géra le jive du split et monta un nouveau sac à mythes : Black Moses. Il récupéra son vieux copain bassman Graeme Flynn qui, par sa dégaine de loubard déhanché portant des chemises transparentes, évoquait une sorte d’Oliver Reed croisé au Malcolm McDowell d’Orange Mécanique. En 1977, Graeme Flynn aurait très bien pu jouer les Nasty Nasty avec les 999.

«Emperor Deb» fut le premier album de Black Moses. «Yr Gona Get It» renouait avec la rage incendiaire du MC5. Graeme Flynn allait prendre la main avec ses gros grooves de basse fuzz. Dans «Won’t Let Go», il était mixé devant, et tout le monde le sait, on joue mieux quand on est devant. On se sent investi d’une mission spéciale. Même chose sur «Cut It Out», Graeme Flynn bombardait ses cordes et on se retrouvait avec un truc malsain et définitif sur les bras. Le hit du disque s’appelait «Eye On You», au classicisme alarmant, belle pièce hachée menue et tapée à la syncope, et on arrivait sur un gros break de basse, un véritable coup de génie. Graeme Flynn entrait quand il voulait dans le morceau. Il était le killer tapi dans l’ombre. Il se baladait dans le fond, jouait des choses graves et revenait en break, mais de façon monstrueuse.

Un second album de Black Moses tomba du ciel en 2004 : «Royal Stink». Jim mit Dracula à la batterie. Avec ce nouvel album, on entrait dans les perfumed gardens de la trashitude inexorable. On pénétrait le cœur du culte. Ils ouvraient le bal des vampires avec «Can’t Breathe (Turkey Neck)», une belle jute de blues-rock de rêve, une trouée fantastique dans les lignes ennemies. Graeme Flynn s’annonçait par un coup de sirène et il se payait de sacrées parties de dégringolade à contre-courant, pendant que Jim Jones tenait bravement le cap en démultipliant les pelletées d’accords et les sock it to me à la Mitch Ryder. Jim Jones n’en restait pas là, non. Il doublait ses c’mon et endiablait jusqu’à la nausée un morceau déjà trop tumultueux. Dans «Better Believe», Graeme Flynn passait devant avec sa basse fuzz et on se retrouvait avec l’un des plus gros hits garage de l’underground britannique. Ses breaks de basse dépassaient une fois de plus l’entendement. Il amenait un son massif et dévastateur. Il entrait et il sortait du morceau comme une bite en folie. Uh !, ils envoyaient des coups dans l’estomac des anales. On assistait à la victoire ultime, celle de l’extrême percutance des riffs alliée au chant triomphant. Et puis on tombait sur «Stevie», morceau classique, hérissé de chœurs dollsy, bousculé par des montées d’emballements dynamiques et des retours au calme du plat de l’épée, une sorte de classique chanté avec ardeur et hanté par des clameurs incantatoires. Cut après cut, ils nous coulaient des lingots de power-rock flambés à la soul blanche. Avec «Lose Control», ils nous proposaient un mélange sulfureux de Led Zed et de riff hendrixien (celui de «Fire», comme par hasard) et Jim Jones allait retrouver l’ivresse des poussées plantiennes. Il chantait aussi «Thru You» avec la hargne des vainqueurs et claquait une intro classique pour «Royal Stink», morceau qu’il laissait fuir pour l’encercler aussitôt de riffs salement morcelés. Ça restait du rock extrêmement classique pour ce qui touchait aux pourtours, mais le noyau restait invariablement imprégné de trash-garage pur jus. «She Got Da Moves» volait bas, proche du peuple, filait de manière terriblement admirable et se heurtait à la violence du spasme des seventies. Il restait dans la fibre chaude des seventies pour boucler la boucle avec «Baj (Oh Yeah)», un simili-groove tourbillonnaire emmené à la basse fuzz avec de l’oh yeah à profusion.
Puis plus rien pendant quatre ans. Pas de nouvelles, pas de rien. Et soudain, on assista à une sorte de retour en force, avec The Jim Jones Revue et une fascination bien affichée pour Little Richard. Nous eûmes droit à un premier album spectaculaire et à une multitude de concerts en France.

Dès l’intro de «Princess & The Frog», on savait que ça allait chauffer dans les chaumières. Jim Jones balançait un brulôt digne de Little Richard et le portait à incandescence. Il savait monter à la hurlante sur tout le devant du couplet, exactement de la façon dont le faisait Little Richard voici cinquante ans. Et il enchaînait avec l’une des reprises du siècle, l’intouchable «Hey Hey Hey Hey» du Little Richard de l’ère Specialty, la sauvagerie du rock’n’roll à l’état le plus pur. Jim s’inspirait aussi directement de Little Richard pour «Rock’n’Roll Psychosis» et montait sa psychose sur une petite structure à la Stray Cats. En seulement trois morceaux, on avait compris que ce disque était une étuve. Graeme Flynn ne jouait pas, mais il produisait. Le seul défaut de ce disque, ce furent les tentatives rockab, comme «Fish 2 Fry» et la reprise de «The Meat Man» de Mack Vickery : le son de basse électrique ne passait pas. Dommage, car Jim Jones ergotait bien son chant. Il nous offrait en compensation une petite merveille intitulée «Make It Hot», belle pièce de juke, montée à l’accord, arrosée de flammes et judicieusement bégayée. On renouait avec le jive du junk à la Jim Jones. Il revenait à Little Richard avec «Who’s Got Mine» et son attaque pulvérisatrice et stupéfiante d’énergie. «Cement Mixer» renouait avec les grooves rampants de Black Moses. Notre ami Jones n’allait pas en rester là.

Deux ans après, il menaçait avec son deuxième album de venir nous brûler la baraque. Et crac, il revenait à son rock’n’roll incendiaire avec des cuts comme «Dishonest John» (mais il n’inventait pas le fil à couper le beurre) et l’explosif «High Horse» (bardé de pianotis, du cinquante ans d’âge qui n’intéressait pas grand monde à part les amateurs de cinquante ans d’âge). Jim Jones devenait de plus en plus indomptable, avec des morceaux comme «Foghorn», où il hurlait à l’ancienne mode et battait de nouveaux records de démesure. Il revenait à Little Richard avec «Premeditated» et parvenait une fois de plus à recréer la grande excitation et à jiver du Penniman, grâce à son timbre de voix identique et à sa jumping energy. Avec ce prodige, Jim Jones devenait l’égal des dieux. Mais sur «Burning Your House Down», il se prenait pour Tom Waits et redescendait d’un cran dans notre estime. Il remettait heureusement les pendules à l’heure sur la face B avec le brillant «Shoot First», une belle compo à propulsion lente, parfait exemple de l’extension du domaine de la lutte, heavy groove bien emmené et bien calibré. Puis il revenait à ses amours anciennes avec un «Righteous Wrong» digne de Black Moses, bardé de feeling, blasté de rock-blues au tempo lourd comme le pas du prêcheur dans le désert. Jim Jones nous gratifiait d’une agréable pulsion pulsative et couronnait son œuvre d’un final extatique. «Righteous Wrong» allait être le hit de ce second album, à défaut d’être celui du siècle.

On vit arriver dans la foulée «Here to Save Your Soul», une sorte de compile proposant des morceaux sortis sur des singles et qui ne figuraient pas sur les deux premiers albums. Comme «Big Hunk O’ Love», un petit rock à l’ancienne et conforme aux règles du genre. Et puis on tombait sur une surprenante reprise de «Good Golly Miss Molly». Jim Jones rendait une fois de plus un hommage exceptionnel à Little Richard, suprême de légitimité. Il avait une fois de plus le son, la folie et la fournaise. Il atteignait le point extrême de la véracité évangélique. À elle seule, cette reprise justifiait l’achat de la compile. Il réanimait encore une fois l’esprit de Little Richard avec «Freak Of Nature», une compo judicieusement enflammée. Il poussait le bouchon de sa voix si loin qu’on s’inquiétait pour lui. Il hurlait à s’en arracher les ovaires. Quelle suprématie !

Et comme on s’y attendait, le troisième album nous tomba sur le coin de la gueule, comme on dit sur les chantiers de bâtiment. «Savage Heart» allait révéler de nouvelles influences, comme celle de Richard Hawley et de Jon Spencer. En gros, Jim Jones se jonifiait. Il cherchait à toucher un public un peu plus large, ce qui est de bonne guerre. Comme il risquait de s’enfermer dans ce que les érudits des temps modernes appellent un trip passéiste, il lui fallait trouver un passage à travers les récifs pour rejoindre la haute mer. Avec «It’s Gotta Be About Me», Jim Jones revenait au heavy blues rock de facture classique, bien pesé et bien senti. Mais rien d’exceptionnel. «Never Let You Go» et «7 Times Around The Sun» allaient rester dans le gros rock bien charpenté et Jim Jones allait solliciter ses collègues pour obtenir des chœurs de chain-gang pareils à ceux enregistrés par Alan Lomax dans les pénitenciers du Deep South. Mais au fil des morceaux, on sentait bien que le torride n’était plus de mise. Il fallait attendre la face B pour trouver un peu de vaudou prometteur dans «In & Out Of Harm’s Way». «Catastrophe» sonnait comme un petit classique sans prétention, une sorte de garage à la harangue salée et tiré par un attelage guttural à travers les plaines sauvages, dans l’esprit de ce que font les gros screamers de honky-tonk. Et puis on finissait par tomber sur le gros morceau jim-jonien, «Eagle Eye Ball», du heavy sleazy garage blues, haletant dans l’ombre, un peu à la manière de ce que faisait Jon Spencer à ses débuts, dans «Cryptstyle», par exemple. Jim Jones allait-il renouer avec l’ancienne classe spencérienne ? Il savait parfaitement bien rallumer ce genre de chaudière, il l’avait déjà prouvé avec Little Richard. Puis il s’épanchait dans les visions océaniques typiques de Richard Hawley, avec un cut titré «Midnight Ocean & The Savage Heart». Sacré Jim, il restait toujours à l’affût de la qualité.

Bon, on arrête de raconter des conneries. La Revue s’installe sur la scène du Tétris, un lieu flambant neuf construit sur les hauteurs du Havre. Rupert Orton claque ses premiers accords de l’autre côté de la grande scène. Nick Jones bat le beurre, Henri Herbert affiche une mine de névropathe derrière son piano électrique et Gavin Jay, chapeau vissé sur le crâne, commence à tournicoter avec sa basse. Jim Jones arrive, effarant de classe et se campe derrière le micro pour attaquer «Where Da Money Go», tiré du troisième album. Cette rincette de blast nettoie bien la gorge et les oreilles. Jim Jones descend du punk-rock blues et des Stooges de la même façon que l’homme descend du singe. On sent qu’il nous embarque pour une heure trente de manège infernal. On ne se lasse pas de le voir bouger sur scène. Il devient meilleur à chaque concert. C’est la cinquième ou sixième fois qu’il vient jouer en Normandie avec cette formation et chaque fois il nous en bouche un coin. Ce qui frappe le plus chez lui, c’est l’élégance. On retrouve en Jim Jones tout ce qui fait le pur rocker anglais, une façon très particulière d’incarner le rock et qui n’existe pas de la même façon chez les Américains. Syd Barrett, Brian Jones, Nikki Sudden, Ray Davies, George Harrison et Jim Jones n’auraient jamais pu naître et grandir aux États-Unis. Ils tirent tous leur spécificité de la culture anglaise, infiniment plus raffinée que le triste modèle américain.

Ils enchaînent avec «Never Let You Go» et «Shoot You First». Ils vont rallumer le brasier du boogie incendiaire. On retrouve sur scène cette hallucinante fournaise sur laquelle flottent des pianotis. Jim Jones vient se planter au bord de la scène, il lève sa guitare en l’air et mime la baise en ondulant des reins. C’est un showman fantastique, il tire des notes de bas de manche qui sonnent comme des clameurs. Il finit par retirer sa veste. Comme toujours, il porte un gilet boutonné par dessus une chemise en tissu imprimé. Pantalon noir, ceinturon et chaussures deux tons, comme sur la pochette de «The Very Crystal Speed Machine».

Seuls les anglais osent porter ce genre de pompes. Jesse Hector en portait lui aussi. Ils enchaînent des pièces solides et ils attaquent «Rock’n’Roll Psychosis», sonic hell à l’état pur. Il manie le chaos comme les Chrome Cranks, il brûle les étapes comme les Oblivians, il joue sa carte de screamer jusqu’au-boutiste, comme Gerry Roslie et bien sûr Little Richard, mais comme il est en tournée, il doit penser à préserver sa voix. Il va quand même taper dans d’autres brûlots pennimaniens comme «Who’s Got Mine», se jeter à genoux avec sa guitare et venir de faire caresser l’entre-cuisses par les filles du premier rang. Il chauffe tellement la salle qu’on danse tous dans les premiers rangs. Jim Jones sait qu’il joue au Havre, capitale du rock en France et le public l’acclame comme un empereur. Emperor Jones ! Son classicisme finit par emporter tous les suffrages. Les ovations se succèdent. La communion sur l’autel du rock est devenue chose rare en France, alors n’en perdons pas une miette.

Signé : Cazengler, atteint de Jonisse.
Jim Jones Revue. Le Tétris. Le Havre (76). 20 mars 2014
Shindig! Quarterly N°1 2011. Thee Hypnotics - Sonic Accelerator
Thee Hypnotics. Liver Than God. Situation Two 1989
Thee Hypnotics. Come Down Heavy. Situation Two 1990
Thee Hypnotics. Soul Glitter & Sin. Situation Two 1991
Thee Hypnotics. The Very Crystal Speed Machine. SPV Recordings 1994
Black Moses. Emperor Deb. Luna Sound 2002
Black Moses. Royal Stink. Rootbag 2004
Jim Jones Revue. The Jim Jones Revue. Punk Rock Blues 2008
Jim Jones Revue. Burning Your House Down. PIAS Recordings 2010
Jim Jones Revue. The Savage heart. Play It Again Sam. 2012
Jim Jones Revue. Here to Save Your Soul - Singles Volume One. Punk Rock Blues 2009
Sur l’illustration, de gauche à droite : Henri Herbert, Nick Jones, Jim Jones, Gavin Jay et Rupert Orton.
Concert Jim Jones Revue in KR'TNT ! 88 du 08 / 03 / 12
BLUE ÖYSTER CULT
LA CARRIERE DU MAL
MATHIEU BOLLON & AURELIEN LEMANT
( Camion Blanc / Mai 2013 )
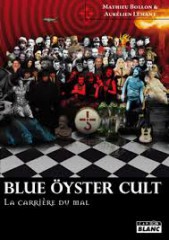
Le Culte de L'Huître bleue. Ceux qui ne connaissent pas risquent d'en rire. N'auraient pas tort, en langue français, une telle dénomination prête à sourire. Elle sent un peu trop le canular, qui, dans la vieille et raisonnable patrie de Descartes, oserait vouer un culte à une huître ? bleue de surcroît ! Le vieux fonds anti-religieux national flaire l'association bacchique d'étudiants de grandes écoles en goguette réunis en confrérie pochtronesque afin de fêter les résultats des examens... Amusons-nous, mais gardons notre sérieux !
Mais pour les connaisseurs le Blue Öyster Cult reste l'un des groupes mythiques du rock'n'roll, de la stature des plus grands, des plus légendaires, à part que, bizarrement sa renommée n'est pas si étendue que cela. J'ai été très étonné en juin 2012, la plupart de mes commensaux provinois qui se vantaient de posséder des tickets pour la prestation de Lou Reed au festival Confluences de Montereau, poussaient des trombines de quinze mètres de long lorsque je leur assurai que le groupe à voir ce n'était pas le petit Lou qui marchait sur trois pattes depuis des années, mais le Blue Öyster Cult dont ils n'avaient jamais entendu parler, certains prétendaient même que c'était vraisemblablement un disc-jockey avec sound-system relégué en fin de programmation pour faire danser les festivaliers...
Chez Camion Blanc ils n'ont pas hésité à mettre les grands plats dans les immenses marmites. Un pavé de 715 pages, rien que pour le Blue Öster Cult, un format normal et méritoire, à la démesure du groupe. Difficile de faire moins. Encore que, qualité de la reproduction des pochettes, ça laisse plus qu'à désirer. Z'auraient dû oser la quadri, car la photocopie des pochettes du Cult en noir baveux et blanc grisâtre c'est un peu décevant. Un peu comme si vous avez une repro en noir et blanc de Matisse le coloriste, sur le mur de votre salon. L'on fait confiance au lecteur pour qu'il se trouve des reproductions idoines sur le net. Un peu indispensable quand Mathieu Bollon et Aurélien Lemant s'occupent non pas de décrire les jaquettes des vinyls, mais de les décrypter. Car, cela vous sera répété plusieurs fois durant votre lecture, le Diable se cache dans les détails. Ne vous effrayez pas, vous n'avez même pas encore bougé d'un essieu sur les hot rails to hell. Mais ne commençons surtout pas par le commencement, car vous risqueriez de vous sentir perdus.
UN GROUPE DE HARD

Dans le sud de la France, l'on a d'abord eu accès au deuxième trente-trois tours du Blue Öyster, c'était un article de Rock'n'Folk, même pas une page entière, qui nous avait mis en alerte. L'a fallu faire le siège du disquaire – comprenez le revolver sur la tempe - pour qu'il nous dégote le premier. Des pressages français, beurk ! C'était en 1973, le premier choc pétrolier, les majors en profitaient pour vous refiler des galettes plus minces que du papier à cigarette. Rien que de les transporter du magasin à votre chambrette, elles étaient déjà voilées.

Ne nous plaignons pas, le vinyl maigrichon regorgeait d'un hard rock comme l'on n'en avait jamais ouï. Et pourtant l'on n'était pas des novices, Black Sabbath, MC 5, Stepenwolf, Grand Funk Railroad, Blue Cheer l'on cultivait toutes ces monstruosités en éprouvettes sur nos étagères, mais là c'était différent. Jusque là, l'on n'avait jamais entendu une huître crier comme cela. C'était nouveau, tous les prédécesseurs cités ne pouvaient cacher leur provenance : sortaient tous de l'oeuf cassé du rock'n'roll. Mais à cette époque les valves de l'huître étaient refermées sur leur sombre mystère. Le Blue Öyster Cult jouait si vite qu'il préfigurait le punk – mais en 72-73 qui aurait pu le comprendre, le rock était alors en éclosion perpétuelle, l'on pensait que la corne d'abondance de la créativité tous azimuts ne s'épuiserait jamais et que le besoin d'un bon coup de plumeau pour chasser les araignées du plafond ne serait jamais nécessaire. Mais ce n'était pas tout, comme dans les oeufs que le Cygne Divin déposa dans la matrice de Léda, au fond de la coquille gesticulait un second bébé.

N'imaginez pas qu'il ressemblait au Dirigeable. Non ce n'était pas un surpassement dans les chatoyances harmoniques, aucun redécoupage ou redéploiement acrobatiques de riff zeppelinien, le nourrisson royal n'était pas beau, bringuebalait de tous ses os, claquait ses mâchoires de caïman tellement fort l'une contre l'autre que l'on n'entendait plus que le cliquetis interminable de ses dents d'acier qui s'entrechoquaient. L'on parlait de hard rock, certains se gargarisaient de la nouvelle appellation heavy metal, mais malgré sa grandiloquence le Blue Öyster Cult posait les fondements du métal tel qu'il se conjugue de nos jours à Clisson, émérite patrie du Hellfest.

Le Blue Öyster Cult réalisa comme Wagner, une tétralogie immortelle, trois disques coup sur coup, 72, 73, 74, et un double en public en 1975. Se seraient arrêtés là, qu'aujourd'hui, ils seraient considérés comme le plus grand des groupes de hard-metal, un archétype indépassable, la statue du Commandeur prête à vous broyer si par malheur vous vous écartiez d'un millionième de millimètre des tables de la loi gravées à jamais dans leurs sillons de vinyl.
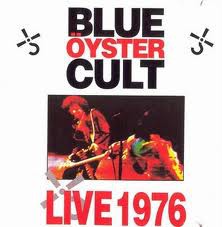
Vous pouvez rayer tout ce que vous venez de lire. Blue Öyster Cult n'a jamais été un groupe de hard.
THE REAPER

Il y avait eu des fuites. Le nouveau disque du Blue Öyster s'annonçait différent. Mais les bruits de chiotte et le tintamarre des poubelles ce n'était pas pour nous, l'on jugerait sur pièce. L'on a tiqué sur la pochette. Ca sentait l'arnaque, ce magicien dans sa cape bleue, avec ses cartes dans la main, ressemblait un peu trop à ce à quoi il disait être. Un charlatan. Le gars qui vous prévient : attention à vos arrières je vais vous le mettre, et vous n'avez pas le temps de vous retourner qu'il vous l'a bellement enfoncé jusqu'à l'os. Vous vous sentez stupidement ridicule, mais le mâle est fait ( et refait ). D'autant plus qu'il emmène votre petite amie en partant.

Disons-le tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. C'est un chef d'oeuvre. Ou plus exactement le disque s'ouvre sur LE chef d'oeuvre. Un seul, mais les autres titres vous n'avez plus aucune seconde d'attention à leur accorder. Le Cult aurait laissé toutes les autres plages vierges que vous n'auriez même pas eu l'envie d'exiger une ristourne financière. Don't Fear The Reaper, qu'ils vous avertissent. Pas la peine, tellement belles ces envolées moelleuses de guitares que vous êtes déjà au paradis. Et malgré vos fortes préventions anti-religieuses vous ne manifestez aucune envie d'en sortir. A l'époque, avec mon anglais rudimentaire j'avais échafaudé une interprétation personnelle, j'imaginais que the reaper c'était le croupier qui sur la table de jeu de la vie raflait votre mise avec cet insupportable sourire professionnel qui pour un peu vous transformerait en serial killer. Quoiqu'il en soit le reaper vous a rapté l'âme, et n'a aucune envie de vous la rendre. Vous la lui laissez en dépôt. Tout heureux, tout bêtement idiot.
Au dernier degré, car lorsque vous reprenez vos esprits vous êtes bien obligés de vous avouer que le chef d'oeuvre qui a englouti votre sens esthétique et moral, ne ressemble en rien à du hard rock. Attention, ce n'est pas rien, c'est aussi énigmatiquement brillant que cette pépite d'or des Byrds nommée So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star, avec ses arpèges de tungstène nappés de satin, L'huître Bleue nous aurait-elle refilé de la fausse monnaie ? L'est plus que temps de remonter la piste.
SOFT WHITE UNDERBELLY
L'Huître Bleue n'a pas mieux fait que nous, n'est pas sortie tout droit de la cuisse de Jupiter, mais du mol-sous-ventre de sa maman. D'ailleurs il en a longtemps porté le nom Soft White Underbelly, oui en anglais c'est beaucoup plus classe. Pour la fête des mères vous repasserez, ses géniteurs sont des hommes. Une reproduction par parthénogenèse. Pas tout à fait l'identique qui se reproduit à l'identique, plutôt les savants fous enfermés dans leur laboratoire qui essaie d'améliorer la malheureuse et chétive race humaine. Le fantôme du Docteur Frankestein, qui accoucha de sa créature après maints essais infructueux, présida à la naissance du monstre.

J'ai le regret de l'annoncer à tous ceux qui ne les aiment pas, mais le Blue Öyster Cult fut un groupe d'intellectuels. D'habitude deux ou trois camarades se rencontrent et n'ayant rien de mieux à faire ils décident de monter un combo de rock'n'roll. Pratique et efficace. Pour le SWU, la gestation fut plus théorique. D'abord l'on pense à la formule idéale d'un groupe de rock, au genre de musique qu'il devrait jouer, et selon la feuille de route ainsi obtenue l'on essaie de trouver des gars capables d'appliquer la recette. Rappelez-vous c'est ainsi que les New York Dolls se créèrent – s'agissait pour nos poupées chéries de fabriquer de toutes pièces les Rolling Stones américains – et c'est sur leur échec que Malcolm McLaren combina dans son esprit la (no)future réussite planétaire des Sex Pistols.
Mais il est temps de présenter les heureux papas. D'abord le chaudron, la revue Crawdaddy ! La première grande revue rock américaine, que dis-je le premier organe séminal de réflexion sur le rock'n'roll. Lester Bang, le critique rock par excellence et Patti Smith y publièrent maints textes et kronics, mais le maître d'oeuvre secret du mensuel fut Sandy Pearlman, des diplômes d'université à revendre, un fou littéraire, un amateur de rock'n'roll qui se verrait bien devenir le chaman tutélaire d'un groupe de rock qui marquerait son époque d'une empreinte irrémédiable, un peu comme ces empreintes de dinosaures conservées dans la boue fossilisée du jurrasique. Sandy traîne souvent avec un ancien condisciple de ses années d'étudiant Richard Meltzer, une plume renommée de Crawdaddy ! qui en 1970 donna au rock'n'roll ses titres de noblesse culturelle en publiant son ouvrage quasi philosophique titré Esthétique du Rock.
C'est Pearlman qui hâte la composition du groupe, ne sont pas tous encore là, mais ils vont arriver petit à petit. Le problème c'est que le plus grand des génies ne peut se servir que des matériaux à sa disposition. Qu'aurait imaginé Léonard de Vinci s'il avait eu accès à l'ordinateur ! Nous sommes en 1967, en plein été de l'amour hippie, le hard rock n'est pas une nécessité existentielle pour cette génération. L'on serait plutôt attiré par le psychedelic à la Hendrix. The first guitar hero, mais qui a mal tourné. L'est mort juste à temps, avant que l'on ne s'aperçoive qu'il était en train d'inventer cette pétaudière d'ennui que l'on nomme jazz-rock. Bien sûr tout le monde ne va pas si loin dans l'ignominie – plus par manque de dextérité instrumentale que par méfiance instinctive d'ailleurs – bref commence à s'installer ce qui s'appellera le progue. La musique progressive, les groupes qui se prennent pour les Beethoven électrifiés. Avec des mentors comme Pearlman et Meltzer le Soft White Underbelly obtint une session d'enregistrement chez Elektra qui s'avèrera un fiasco.
STALK FOREST GROUP

Changement de personnel, cette fois ils sont tous là : Eric Bloom ( chant, guitare ), Donald Roeser alias Buck Dharma ( lead guitar ), Allen Lanier ( clavier, guitare ), Joe Bouchard ( basse ), Alfred Bouchard ( batterie ), et pour effacer l'échec l'on repeint le nom sur la coque du bateau touché-coulé. Stalk Forest Group : Le Groupe de la Forêt aux Pieds de Champignon, z'en avaient peut-être grignoté un peu trop des bolets de Satan mexicains – mais le SFG sera lui-aussi recalé lors de son examen de passage chez Elektra.
C'est alors qu'intervient le troisième cavalier de l'Apocalypse – Murray Krugman, travaille chez Columbia - nous sommes en 1970 - qui sent le vent tourner et qui est à la recherche de groupes de hard rock. L'on change une équipe qui perd sans hésitation. Après quelques tergiversations sémantiques le groupe qui commence à enregistrer chez Columbia en 1971 se nommera Blue Öyster Cult.
BLUE ÖYSTER CULT

L'on change d'époque. Mais l'on garde les vieilles mythologies. Le rêve hippie a atteint son apogée à Woodstock, les Stones en signent la fin en paraphes de sang à Atlamont. Mais les Rolling n'y sont pour rien, les héros de la fête portent un autre nom : ce sont les Hell-Angels, les terribles Anges de l'Enfer qui refont un remake d'Hollister en direct, meurtre à l'appui, devant les caméras et sans truquage. L'équipée sauvage est de retour. Pearlman et Krugman décident d'en réaliser la bande-son. Pour le grondement des moteurs Kruggman s'en chargera à la perfection, se comporte même comme nos blousons noirs qui rajoutaient des mégaphones sur les pots d'échappement de leurs Gitanes Testi, mais comme il a davantage de savoir-faire et de moyens, il dote l'Huître Bleue de moteurs-auxiliaires pour fusées intercontinentales. Pearlman prend la direction des paroles. Equipée Sauvage, oui mais métaphysique. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans le cosmos. Lyrics à visées intergalactiques.

BLUE ROCKER CULT
Faut pas prendre les rockers pour des incultes qui auraient du mal à déchiffrer le o de Perfecto. Pearlman ramène sa vaste science. Pour les lecteurs de Kr'tnt qui voudraient soulever le coin du voile cher à Novalis, qu'ils se reportent à notre courte présentation indicative de la traduction de Magick d'Aleister Crowley par Philippe Pissier ( livraison 162 du 07 / 11 / 13 ), z'ou z'alors z'à notre livraison 172 ( du 18 / 01 / 14 ) le paragraphe sur Anton LaVey, le fondateur de l'Eglise de Satan, dans notre recension du livre sur Marylin Manson.
Satan, ses cornes et son trident, vous pouvez le jeter au feu, brûlera très bien comme une figurine en carton. La Carrière du Mal, le sous-titre du bouquin, rejetez votre bric-à-brac mystico-catholico-débilo-menthe-à-l'eau, est plus sérieux que vous ne le croyez. Vaudrait mieux regarder du côté ( non pas de chez Swan, même noir ) de Cthulhu – eh oui qui l'eût cru, lustucru, poil au cul – l'innommable, une simple image – des grands anciens qui manipulent le monde grâce à leurs agents secrets, regroupés dans la mystérieuse association du Culte de l'Huître Bleue. Vous êtes-vous demandés qui se cache derrière votre addiction au rock'n'roll. Ne nous refaites pas, comme Damie Chad, le coup des méchantes majors capitalistes, parce que là vous resterez accrochés comme le moustique dans la toile de l'araignée à l'écume de la futilité du monde. Cherchez plutôt dans les grimoires d'Edgar Poe, de Lovecraft, de Philip K Dick, et de quelques autres frères des mystères de l'ombre comme Arthur Machen...
SOUS LE SIGNE DE SATURNE
Ne vous fiez pas aux écorces mortes que le Cult vous lance à la face comme l'os de l'inculture populaire, sans viande ni cartilage. Faut bien que les chiens de garde du système aient de temps en temps une raison d'aboyer. Sans quoi ils finiraient par se poser des questions sur le pourquoi et le rôle de leur vigilance. Le troisième LP du Blue öyster Cult attira, pardon attisa, la vindicte des imbéciles. Déjà le bruit dégagé par les deux précédentes rondelles méritaient les qualificatifs d'agression de type faciste, le titre de leur deuxième album Tyranny and Mutation ne laissait aucune expectative au mot revolution ( en ces temps lointains l'on ne lui préférait pas encore le vocable beaucoup plus noble de Démocratie ), mais sur la troisième pochette l'aveu était d'une impitoyable netteté : elle était ornée d'un très beau dessin du premier chasseur à réaction de la Luftwaffe, le Messerschmitt 262, clair comme de l'eau de roche, les membres du Blue Öyster Cult étaient tous des néo-nazis. Cette mauvaise réputation leur collera à la peau pendant longtemps...
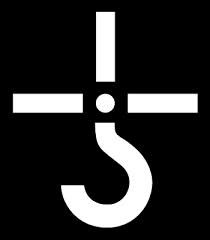
En plus, ils ne pouvaient pas sortir un record sans l'agrémenter de leur logo, la sinistre hook and cross, que l'on eût vite fait d'assimiler à la sawitska hitlériene. Manque de chance c'était le signe de Saturne. Pas celui qui présida en son heureuse jeunesse, l'Âge d'Or, mais le vieillard taciturne et taiseux, solitaire en son coin, qui ne pense qu'à dévorer une bonne fois pour toutes l'ensemble de sa progéniture qui l'a relégué aux calendes grecques, et sur la défaite de laquelle il compte exercer une terrible vengeance et bâtir son retour triomphal... Le rock comme une saturnale et Hécate qui s'en vient aboyer aux carrefours pour vous vous avertir que dans l'ombre de colossales forces travaillent à votre anéantissement, ne rêvent que de vous réduire en esclavage... Ne venez pas dire que vous ne saviez pas.
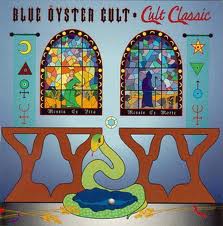
En tout cas, Mathieu Bollon et Aurélien Lemant se livrent à un scrupuleux jeu de piste. Tous les disques du Blue sont analysés titre par titre, les paroles remises dans leur contexte culturel, et leur sens ultime traqué et livré à votre entendement... Citent à plusieurs fois le nom de Raymond Abellio, romancier et mathématicien, un peu retombé aujourd'hui dans l'oubli, le théoricien de La Structure Absolue, qui se fit connaître dans les années soixante par son analyse du vingtième siècle en tant qu'époque du dévoilement des doctrines ésotériques tenues jusques là secrètes et à l'abri des regards profanes...

Sont tellement obnubilés par le message véhiculé par les lyrics du groupe qu'ils n'en effleurent que très partiellement l'analyse musicale, ou celle-ci ne venant qu'en contre-point explicatif de leurs révélations. Le moins que l'on puisse dire c'est que malgré la diversité des écrivains de métier et des écrivants d'occasion – chaque membre du groupe y participant peu ou prou, parfois de manière collective – le livret des paroles du l'Huître Bleue est traversé par une profonde unité thématique. Certes parfois un morceau établit une référence explicite à un titre enregistré une vingtaine d'années avant, mais l'on a surtout l'impression que - quel que soit le collaborateur externe au combo qui ait fourni un texte, que ce soit un admirateur de longue date dont les centres d'intérêt personnels sont voisins ou parallèles à ceux du Cult, ou un don de rencontre destinale venu de tout autre planète culturelle étrangère à la constellation cultienne - que tout ce qui entre dans l'axe gravitationnel du band fait ventre. Et pas mollement du tout. La bête phagocyte tout ce qu'on lui propose, se nourrit de tout ce qui passe à sa portée, l'ingère, le recycle, et le recrache à la gueule du monde telles les flammes d'un dragon dévastateur.

ERREMENTS
Avec le Reaper l'Öyster surprit son monde. Disons agréablement. Tout guerrier a droit à son moment de repos. Devant les exploits accomplis, on lui abandonne volontiers une couche voluptueuse. D'autant plus méritée, qu'elle est sise en plein drame shakespearien, puisque la dame appelée se doit de rejoindre son prince charmant sur son lit funéraire. Le Reaper n'est rien d'autre que la terrible Faucheuse qui vous passe de vie à trépas, afin que vous puissiez continuer vos amours dans l'autre monde, en toute quiétude. N'ayez pas peur du Reaper, il vous offre en cadeau bonux l'absolu du néant...
Mais avec Spectres (sorti en 1977 ) le grand Bleu nous déçoit. Nous sommes en pleine tourmente punk, et l'on aimerait que le Cult dresse sa tente au milieu des troupes rebelles, et que son étendard mène l'assaut, mais non le reptile déroule paresseusement ses anneaux au soleil. L'on s'attendait à plus, il y eut le moins. Le problème, c'est que des tartiflettes mal cuites, il y en eut d'autres dans la carrière du Cult. Et certaines mêmes indigestes. Mirrors, Club Ninja, par exemple qui mortifient les fans de toujours sans mordre d'une seule incisive sur le grand public.

L'est sûr qu'avec the Reaper et autres essais infructueux qui parsemèrent la route du mastodonte, le Blue Öyster Cult a essayé de s'extraire du public cent pour cent hard rock, formé de nombreuses hordes combattantes, toutefois une minime fraction des acheteurs de disques. Mauvais calcul qui lui fit perdre l'estime au début indéfectible que lui portaient ses cohortes d'admirateurs passionnés. L'Huître aurait vendu donc son âme contre le plat de lentilles de la célébrité. Et les royalties qui marchent de pair.
Bollon et Lemant n'évacuent pas cet aspect trivial des réalités pécuniaires. Mais ils proposent une deuxième lecture du phénomène, beaucoup plus romantique. Le Cult rentre dans le rang, profil bas et complaisance moutonnière. Le Cult qui avait pris de l'avance sur tous ses concurrents se laisse rattraper et même dépasser. Sonne parfois un peu trop comme les autres, s'inspire de Judas Priest ou de ZZ Top... Ce n'est pas qu'il serait incapable de faire mieux, mais pour vivre heureux, restons cachés. Règle d'or des terroristes qui transportent des matières fissiles, ne pas se faire remarquer, ressembler à tout le monde, point d'attitude provocatrice, le premier de la classe est espionné toutes les secondes par des yeux jaloux. Un bon groupe de hard, ni pire, ni meilleur que les confrères. Les mecs tranquilles qui ne cherchent pas d'histoire. Le vieux codex des alchimistes. Celui qui détient les secrets ne les transmet qu'avec la plus étudiée des discrétions...
EXPLOSIONS

Les bonnes résolutions ne tiennent pas ad vitam aeternam. Cachez la bête dans votre poche, sous votre mouchoir, cela ne l'empêchera pas de temps en temps de sortir la tête rien que pour voir si le monde extérieur existe encore. Je ne vous mens pas. L'a été prise en photo sur la pochette de Cultösaurus Erectus. Eloignez les femmes enceintes et les enfants. Vous éviterez fausses couches et crises d'épilepsie post-traumatiques. Hideuse la bestiole et les brames ferrailleux qu'elle pousse à l'intérieur, vaudrait mieux que votre psychiatre ne les entende pas, vous ferait enfermer pour dix ans, à titre préventif. Le Blue Öyster Cult tel que nous l'aimons. Avec le clin-d'oeil, nous sommes des dinosaures du rock, notre passé parle pour nous. Nous ne sommes pourtant qu'en 1980, mais le Cult a compris qu'il est le dernier spécimen d'une espèce en voie d'extinction. Ou de prolifération dégénérative.

Se battra jusqu'au bout pour sa survie. Des centaines de concerts. Des murs d'amplis aussi hauts que l'Himalaya, des light-shows de rayons lasers dignes de la guerre des étoiles, des claviers pyramidaux, des duels de guitares homériques... Tiendront quarante ans. Le combo est encore en vie aujourd'hui. Beaucoup des anciens membres ont décroché, sont revenus, sont repartis, Allen Lanier a rejoint l'autre côté du miroir au mois d'octobre 2013... En 2012, le groupe a fêté ses quarante ans par une tournée aux Amériques et en Europe, l'a sorti chez Columbia un coffret de dix-sept Cd, remastérisations, rarities et tout le bataclan. En cherchant bien, vous trouverez même les bandes du Soft White Underbelly et du Stalk Forest Group qui traînaient dans les tiroirs d'Elektra. DVD, vidéos sur le net...

TRAIT D'UNION
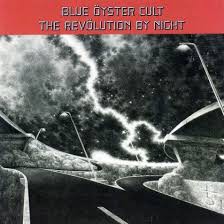
Le Culte de l'Huître Bleue n'a pas été le groupe que nous aurions aimé qu'il fût. S'en est approché, mais la fusée a dévié sa course. L'on ne sait pas trop pourquoi. Avoir tant de bonnes cartes en mains et jouer une si décevante partie ! Ce qui est sûr c'est qu'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Qui trop étreint, mal embrasse. Le Cult est un groupe trait d'union, l'a fait la jonction entre psyché et hard. Entre le prog et le heavy. En un certain moment même, il n'a pas su où il mettait les pieds, entre punk et métal extrême. D'autres l'ont tenté avant eux. Ou dans les mêmes temps. Comme Blue Cheer, mais en partant d'un projet initial moins ambitieux et beaucoup plus local. Et sans aller aussi loin.

Personnellement, je verrais le Blue Öyster Cult dans le prolongement des Doors. Blues Öyster Cult pour souligner la source de ces deux grands groupes américains, le blues originel, magnifié par la puissance orchestrale et réinvesti de sa grandeur natale par et dans le souffle de la poésie. Signe des temps et de la perversion typiquement rock and rollienne, la solitude du poëte maudit laissant place à un travail d'équipe, à un collectif de production culturelle américanisée... Passage de témoin. Carrière du Mal en sous-titre. A méditer.

Damie Chad.

22:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/03/2014
KR'TNT ! ¤ 182 :VANILLA FUDGE / SUBWAYS COWBOYS / ATOMICS / MEGATONS / DUKE ORPHANS / BIBLE PUNK
KR'TNT ! ¤ 182
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
28 / 03 / 2014
|
VANILLA FUDGE / BIBLE PUNK / DUKE ORPHANS / SUBWAY COWBOYS / THE ATOMICS / MEGATONS |
LE DIVAN DU MONDE / PARIS
14 - 03 - 14 /
VANILLA FUDGE
VANILLA RAPPELLE-TOI
QUE JE NE SUIS RIEN SANS TOI

Si on reconstituait la tablée des dieux de l’Olympe aujourd’hui, on y trouverait le Vanilla Fudge, Chris Farlowe, Howlin’ Wolf, Dave Wyndorf et Mark Lanegan.
Aussi loin qu’il m’en souvienne, les Vanilla Fudge ont toujours sonné comme des titans, même si certains de leurs albums n’étaient pas d’un abord facile.

Leur premier album fut un album de reprises. La version de «Ticket To Ride» avait quelque chose d’extatique au sens hallucinogène de la chose, chantée à deux voix et doublée d’une dentelle de guitare signée Vinnie Martell. À l’époque, Vinnie était encore un kid new-yorkais bien coiffé et souriant, comme on peut le voir au dos de la pochette de cet album paru en 1967. Deux ans plus tard, il allait changer de look et ressembler à un soudard espagnol du XVe siècle.
Sur ce premier album, ils recuisinaient aussi le hit des Zombies, «She’s Not There» et trempaient dans le jeu des dérives expérimentales. Sur l’autre face, on trouvait cette reprise de «You Keep Me Hanging On» des Supremes qui les fit connaître, bien grasse et noyée d’orgue, vautrée dans la puissance et bombardée de notes de basse. Tim Bogert allait devenir LE bassman américain. En 1967, il portait déjà des lunettes à montures d’écailles, comme celles de Woody Allen, et il allait tout au long de sa carrière conserver le même look, avec les cheveux un peu plus longs. Son compère batteur Carmine Appice allait former avec lui la rythmique de rêve que tenteront d’enrôler pas mal de gens. Jeff Beck réussira à enregistrer un album avec eux.

Sur ce premier album du Vanilla Fudge, on trouvait aussi une fabuleuse reprise de «Take Me For A Little While» (Dusty Springfield), qu’ils faisaient monter en mayonnaise. Quand on écoutait cette reprise d’une puissance quasi-indescriptible, on s’en décrochait la mâchoire. Ils faisaient monter leur truc cran par cran, un violent break de basse stoppait tout et la chape retombait ensuite.
Avec ce premier album, le Vanilla Fudge imposa un son unique au monde. La voix d’ange de Mark Stein était montée sur le shuffle le plus puissant qui se put concevoir à l’époque. Ni Graham Bond ni Brian Auger ne pouvaient rivaliser avec un tel son.

Mais après ça, les fans allaient en baver des ronds de chapeau. Il fallut une certaine constance pour accepter les deux albums suivants, «Renaissance» et «The Beat Goes On».

Au tout début des années 70, on trouvait facilement de beaux pressages américains de «Renaissance» dans les bacs des second-hand record shops de Portobello. On ramenait ça fièrement à la maison, on s’asseyait sur le petit lit, on s’allumait un stick bien mérité et on mettait le disque en route. Et crac, on avait la mâchoire qui se décrochait, car le Vanilla Fudge avait viré prog et toutes les compos s’égaraient dans les sables du désert, à l’exception de «That’s What Makes A Man» qui entrait dans la catégorie du balladif heavy. Sur l’autre face, Vinnie Martell tentait de sauver du désastre «Faceless People» en bavant du gras. Mais le reste de l’album était désespérément mou du genou et proggy. Rappelons que le prog et le rock FM furent les deux plus grands fléaux du XXe siècle.
Nouveau traumatisme avec l’album suivant, «The Beat Goes On», une espèce de collection d’exercices de styles qui montrait à quel point ces mecs étaient doués. Ils tapaient dans des trucs comme «Hound Dog», dans un medley Beatles, et recuisinaient le fabuleux «The Beat Goes On» de Sonny & Cher au shuffle, mais tout cela était coupé en rondelles et on se retrouvait avec une fois de plus un disque incroyablement baroque et foncièrement anti-commercial. Ils proposaient tout simplement une histoire de la musique à travers les âges, on passait du ragtime des années 30 aux élans classiques de La Lettre À Élise, dont visiblement Mark Stein était fan. Le Vanilla Fudge pouvait TOUT jouer. Et mieux que quiconque. Mais ce n’était pas ce qu’on attendait d’eux. On voulait de la viande. Du gros shuffle fumant. De la lourdeur phénoménale.

Il faudra attendre la parution de «Near The Beginning» pour renouer avec l’énormité, et notamment leur morceau phare, «Shotgun», qui reste l’archétype du rock colossal, du rock des titans, avec ce chaos de lignes de basses, ce shuffle des océans hugoliens, ces phrasés de guitare d’auberge espagnole, ce drumming poundé des galères phéniciennes, et ces explosions de bouquets de chœurs extravagants. «Shotgun» est une mine d’or Inca, un réservoir inépuisable d’explosivité hystérique et de relances mirifiques. Il n’existe pas de dimension plus spectaculaire que celle du Vanilla Fudge. S’il ne devait rester qu’un seul morceau de ce groupe, ce serait «Shotgun». On trouve aussi sur ce disque une version magistrale de «Some Velvet Morning», un hit de Lee Hazlewood. Ils en font la musique du paradis sur terre, le son de la pureté blanche et de l’excellence impavide, l’heureuse élection de l’élusivité fluide. Et puis des nappes d’orgue hautement significatives s’écartent comme des nuages pour laisser place au vide lumineux du dogme, On goûte cette subtilité longiligne, on voit au loin cette effluve s’étendre par dessus les cimes. Le Vanilla Fudge recherche l’extrême clarté de la pureté, le ton sensible du chant réduit à sa plus simple expression de filet harmonique douceâtre.

Le dernier album du mighty Fudge parut en 1969. Comme il s’appelait «Rock &Roll», on espérait voir arriver le plus gros disque de rock américain de tous les temps. Si un groupe était capable de ça, c’était le Fudge. Il faut quand même rappeler qu’à l’époque aucun groupe américain ne leur arrivait à la cheville. Pochette superbe, Rock &Roll en ultra-bold rouge sur fond blanc - radicalité bien affichée - et au dos, on les voyait tous les quatre photographiés sous des néons, affichant des mines patibulaires. Et crac, on se prenait «Need Love» dans les dents, une pétaudière secouée de télescopages, un véritable empire du chaos, ça hurlait à bon escient, ça nous shufflait dans les pattes, les notes de basse sifflaient dans tous les coins, c’était un vrai morceau sauvage, au sens de l’étalon indomptable. Mais la suite de l’album n’allait pas être à la hauteur de «Need Love», hélas. Malgré son soul-punk blast in the face, si big bash stab de bass dans le bide et son harsh break down in the guts, «Street Walking Woman» allait se perdre dans des accalmies. On soupçonnait le Vanilla Fudge de jouer avec nos nerfs. Sur la face B, ils tapaient dans Michel Legrand, avec une reprise héroïque de «The Windmills Of Your Mind», monstrueusement bien chantée par Mark Stein, grand amateur de cimes.
Un Mark Stein qui aime à s’exiler dans les limbes du Pacifique. Et on comprend que le Vanilla Fudge ne recherche pas le succès commercial. Tout ce qui les intéresse, ce sont les télescopages de trains de notes et les explosions faramineuses. Sur tous ces morceaux, Tim Bogert joue des trilles de notes en permanence. Dans le milieu new-yorkais, on l’appelle l’Omniprésent.
Avant de choisir le nom de Vanilla Fudge, ils s’appelaient les Pigeons. On trouve un album de reprises paru en 1973 sur lequel Mark, Tim et Vinnie (Carmine n’est pas encore là) tapent dans «Midnight Hour» (version swing), «Upset The People» (reprise de Charles & Inez Foxx, brillants swingers mal connus, mais on sent bien la magie des sixties) et «Mustang Sally» (reprise groovy, incroyablement décontractée).
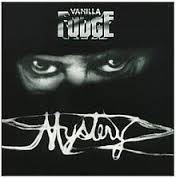
«Mystery» est l’album de la première reformation, en 1984. Comme l’indique la date, c’est une catastrophe. Le Vanilla Fudge nettoyait son son et tournait presque disco. C’est l’époque qui voulait ça. En plus, on avait déjà noté quelque chose de louche chez Carmine. Cet abominable frimeur avait co-écrit «Do Ya Think I’m Sexy», le fameux hit qui couvrit Rod Stewart à la fois de gloire et de honte. Le seul morceau intéressant de «Mystery» est la reprise du «Walk On By» de Burt Bacharach, rendu célèbre par Dionne Warwick (et ne venez pas me parler de la version des Stranglers, par pitié !) On retrouve dans cette version le mélange mélodie/soutien logistique qui fit la grandeur du Vanilla Fudge, et qui est aussi et surtout le secret de la victoire, comme l’indique Clausewicz.
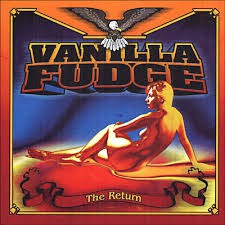
Le groupe se reforme une nouvelle fois au début du millénaire et nous balance en 2004 un brillant album intitulé «The Return». Bill Pascali remplace Mark Stein au chant et à l’orgue. On retrouve la puissance maléfique du groupe dès le premier titre, «Ain’t That Peculiar» et la guitare flash de Vinnie Martell. Pour cet album inespéré, ils vont rejouer leurs reprises des débuts, avec encore plus de verdeur, comme si cela était possible. «You Keep Me Hanging On» monte bien en température, et on assiste à la transformation alchimique de l’énormité Tamla en énormité Vanilla. C’est la grande transmutation des temps modernes. Ils transforment l’or du Tamla Sound en océan de vase. Spectaculaire. La mélodie se prête suprêmement aux coups de boutoir du bouc Vanilla. Version dévastatrice de «Shotgun», l’un des morceaux les plus énormes de l’histoire du rock américain, faut-il le rappeler ? Bill Pascali joue la carte du guttural. C’est monumental. Ça balaye les scories. Ils lèvent des vagues de shuffle démentes. Ils parviennent même à dégager les bronches des dieux nordiques. Et ils donnent le coup de grâce avec une resucée de «Take Me For A Little While», ce heavy Tamla sound qui est la marque jaune du groupe. Génie à l’état pur. C’est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Ils lâchent aussi une version rabelaisienne de «Good Lovin’», définitive, intense et brûlante, parcourue de solos de lave, l’archétype du hit puissant qui dégouline de partout, une sorte de hit ultime asphyxiant. La version de «Need Love» qui est sur ce disque sonne comme une déclaration de guerre à l’orgue. Aucun espoir de paix. Puis ses trois accords nous embarquant dans le plus délicieux enfer.

Il existe un live du Vanilla Fudge enregistré en Allemagne et qui donne une idée de la puissance dévastatrice du groupe sur scène, «Good Good Rockin’». Bill Pascali remplace l’immense Mark Stein et un autre rital du nom de Teddy Rondinelli se prend pour Vinnie Martell. Les pauvres Carmine et Timmy ne disent rien. Ils se contentent de subir. L’âge a ses raisons que le cœur ne veut connaître. Comme Russell Hunter et Duncan Sanderson (Pink Fairies) d’une part, et Billy Talbot et Ralph Molina (Crazy Horse) d’autre part, ils ont réussi, en n’étant que section rythmique, à préserver le nom du Vanilla Fudge. On retrouve sur ce disque toute la fantastique urgence et le son de cathédrale des disques d’antan. Dans l’imaginaire des rockers de banlieue, le Vanilla Fudge était aussi excitant que Little Richard. Ce sont des artistes dont on attendait tout, principalement de la sauvagerie et de la démesure. Ils mirent à bas bien des basiliques.
Ils démarrent ce set live avec «Good Good Lovin’» et bien sûr ils défoncent les annales de la postérité. Ils restent les plus grands pourvoyeurs de shuffle de l’histoire d’Amérique. Dès l’ouverture du bal, on se retrouve avec un truc épouvantablement destructeur sur les bras. C’est exactement la même chose que l’album live de Blue Cheer enregistré au Japon : on se retrouve plongé dans la fournaise de la légende. En seulement deux morceaux, on est au tapis : «Take Me For A Little While» et «Shotgun». Tout va dans la démesure. Ils sont pharaoniques. Ils défoncent tout sur leur passage. Ils lissent les grumeaux, ils rasent les montagnes. Ils posent une voix d’ange mélodique au sommet d’une machine de guerre sonique, certainement la plus puissante du monde. Avec le Fudge, tout n’est que force, caste et implosion. Ils replongent comme des marsouins dans une mer de lave. Ils nagent ouvertement, ils font des brasses expiatoires dont la mesure échappe à la raison. Bill Pascali va chercher le guttural. Et pour «Shotgun», Carmine prépare la sauce : puissant drumbeat et tout s’écroule comme les fameuses falaises de marbre de l’Apocalypse sur la gueule des dieux occupés à festoyer. Véritable punk blast, un genre qui n’existe pas ailleurs. Carmine le vital fait péter ses peaux dans une chaleur d’étuve. «Shotgun» est un immense classique, une masse impérieuse, l’un des plus gros cataplasmes de l’histoire du rock insurrectionnel. S’il est une musique épique, c’est bien celle-ci. Des giclées dans tous les coins, ça explose encore et encore. Puis nouveau raid sur «She’s Not There», c’est à l’image du Fudge, indécent de puissance voluptueuse. Dommage qu’ils fassent des morceaux de six à huit minutes, mais n’est-ce pas le temps qu’il faut à un monstre pour sortir de sa torpeur ? Ceux qui ont survécu à pareille vision sont les seuls à pouvoir le dire, mais il n’est pas sûr qu’on puisse trouver un survivant. Le monstre éveillé chope sa proie dans la seconde, tout le monde le sait.
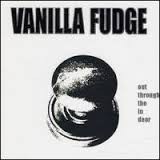
Faut-il en conclure que le Vanilla Fudge n’est bon qu’à faire des reprises ? On serait assez proche de la vérité, puisqu’une de leurs dernières manifestations est un album de reprises de Led Zeppelin, rien de moins. La bêbête s’appelle «Out Through The In Door». On retrouve nos alchimistes préférés dans la formation originale. La version qu’ils font de «Immigrant Song» est titanesque. «Ramble On» qui suit n’est pas vraiment une grande chanson de Led Zep. Le Vanilla Fudge transforme ce pauvre morceau en groove énorme. Les nappes d’orgue de Mark Stein balayent tout. Il répand des nappes gigantesques et majestueuses. Pour l’oreille, c’est une bénédiction. Le petit sucre d’orge de Led Zep est traîné par les cheveux jusqu’au sommet de la soul. Le miracle s’accomplit. Le Vanilla Fudge croise les prodiges de la soul blanche avec la puissance du grand rock américain. Difficile de faire mieux. Ils sont vraiment les seuls à opérer à cette altitude. «Dazed and Confused» est l’un des sommets du premier album de Led Zep. Mark Stein tient le morceau par la barbichette. Il se pose sur l’énorme drive de basse. Très vite, les claviers volent à son secours. «Dazed and Confused» est un blues prodigieusement désespéré. Mais Mark Stein ne va pas chercher les éclats déchirants de Robert Plant. Le Vanilla Fudge se focalise sur les questions de punch. Ils adorent jouer les puissances rampantes. Comme tous les morceaux du Led Zep I, «Dazed and Confused» est splendide, jusqu’au moment où ça se transforme en marécage. C’est le passage lugubre et ennuyeux où Jimmy Page joue de l’archet. Et puis la machine se remet en route, sauf que chez Vanilla Fudge, la machine est une grosse bête de compétition capable de rivaliser avec les Blue Flames ou le Family Stone de Sly. Le thème de «Dazed and Confused» est assez lourd. C’est d’ailleurs le fouillé des transitions qui rendit ce morceau impropre à la consommation de masse. Les gens ne savaient plus quoi faire des grands passages aléatoires où naviguait l’archet de Jimmy Page. «Baby I’m Gonna Leave You» est l’un des sommets de Led Zep I. C’est quasiment intouchable, comme l’est «Never Mind The Bollocks». Mark Stein prend doucement son envol. Il n’a pas froid aux yeux. Il s’attaque à un morceau parfait, admirablement chanté par Robert Plant. Mark Stein est un peu plus rustique au niveau chant. Ils ne sont bons que dans le groove. Il leur faut de la matière à groover. Mark Stein ne grimpe pas dans les aigus. Non, il ne veut pas. Il reste bien au sol. Ce mec a des qualités exceptionnelles. Il sait chauffer un couplet. Il a la voix des grands décideurs. Un couplet ne peut pas lui résister. Mark Stein a un charme fou. Un solo de guitare vient signifier l’envolée, alors qu’on attend le hurlement de Robert Plant. La version est épaisse, infiniment moins fine que l’original, mais elle a des qualités intrinsèques qui relèvent d’une mystique heavy - walking through the park/ evvvery day ! Dommage que le Vanilla Fudge n’ait pas tapé dans «Communication Breakdown» et «Since I’ve Been Loving You». On trouve aussi sur ce disque de reprises l’anodin «Moby Dick» et son pénible solo de batterie. C’est d’ailleurs «Moby Dick» qui a ruiné le Led Zep II.
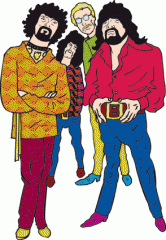
Le Vanilla Fudge a toujours adoré les friandises anglaises. Ce sont des amateurs de bonbons à la menthe. Du coup, les chansons de Led Zep sonnent comme de la variété dans les pattes des affreux new-yorkais. Ce ne sont pas les reprises du siècle. Il manque une chose capitale dans cet album de reprises de Led Zep : la démesure, celle à laquelle le Vanilla Fudge nous a toujours habitués. Ne nous morfondons pas trop vite car voilà Vinnie Martell au chant pour une reprise de «Rock’n’Roll». Leur version est cocasse. Vinnie Martell monte très haut pour retrouver les accents du chant hurlé de Robert Plant - houllière houillère ! c’est la bande-son de Germinal. La version est solide, pleine de vox et de notes d’Hammond. «Your Time is Gonna Come» vient aussi du premier Led Zep. Ce morceau est une bénédiction. On attend encore des miracles du mighty Fudge. Mark Stein joue un classique de l’orgue de barbarie en guise d’intro. Le Vanilla Fudge renoue enfin avec le shuffle. Mark Stein bat Robert Plant à la course. Il tortille son chant de manière subversive. Il en fait un gospel dantesque et la grande machine fudgienne se met enfin en route. Basse en folie, nappes d’orgue, démolition drumbeatique, ces gens-là n’ont plus rien d’humain.

Miraculeusement, le Vanilla Fudge débarque à Paris par un beau soir de mars. C’est la formation originale, mais sans Tim Bogert, remplacé par un certain Pete Bremy. L’air est doux et le métro gratuit, à cause d’un pic de pollution. Le Divan du Monde les reçoit. Pas de première partie. Wow, les voilà sur scène, à la fois humains et mythiques. Sans âge. Voici deux mille ans, des Grecs d’Athènes ou de Sparte les auraient acclamés comme des demi-dieux. Vinnie Martell, tout de noir vêtu, Gibson en main, au centre du monde. Derrière, Mark Stein, barbu et chevelu, assis derrière son orgue, impétueux, piaffant d’impatience. Plus haut sur l’estrade, Carmine Appice, tête de pirate, moustache en croc, et qui rend hommage au public et à Christophe, qu’il a accompagné à l’Olympia. Et puis le remplaçant de Timmy, Peter Bremy, casquette et T-shirt. Ils attaquent avec «Ticket To Ride» et chacun sent monter les frissons, car le son est là. Ils vont enfiler toute leurs reprises classiques comme des perles, «Some Velvet Morning», «Season of The Witch», «Take Me For A Little While», «Eleanor Rigby», «Bang Bang», «People Get Ready» et amener tout naturellement le parterre de dévots à l’orgasme intellectuel avec un «Shotgun» hurlé dans la fournaise, saturé de power-chordage, éclatant de puissance - it’s twiiiiiiiine time baby !

Signé : Cazengler, vanillé de longue date
Vanilla Fudge. Le Divan Du Monde. Paris XVIIIe. 14 mars 2014
Vanilla Fudge. Vanilla Fudge. ATCO Records 1967
Vanilla Fudge. Renaissance. ATCO Records 1968
Vanilla Fudge. The Beat Goes On. ATCO Records 1968
Vanilla Fudge. Rock & Roll. ATCO Records 1969
Vanilla Fudge. Near The Beginning. ATCO Records 1969
The Pigeons. While The World Was Eating Vanilla Fudge. Metronome 2001. 1973

Vanilla Fudge. Mystery. ATCO Records 1984
Vanilla Fudge. The Return. Worldsound 2003
Vanilla Fudge. Good Good Rockin’. Music Avenue 2005
Vanilla Fudge. Out Through The In Door. Escapi Music group 2007
De gauche à droite sur l’illustration : Mark Stein, Carmine Appice, Tim Bogert et Vinnie Martell
TOURNAN-EN-BRIE / 23 - 03 – 14
LA FERME ELECTRIQUE /FORTUNELLA
RIP IT UP PARTY ( II )
DUKE ORPHANS / SUBWAY COWBOYS /
ATOMICS / MEGATONS

Dans mes souvenirs l'entrée ressemble bien à La Ferme Electrique, la teuf-teuf effectue un tournant dans la Brie profonde et pile net devant un groupe de jeunes. A l'esprit vif, même pas besoin de demander « Oui, c'est bien ici le rockabilly ! » qu'ils me lancent sans attendre. Pile à l'heure et face au destin. Sept euros la soirée plus les plats de gaufrettes et de chips offerts à la cantonade, ce n'est pas ce soir que je connaîtrai les affres de la ruine. Il subsiste donc encore quelques bienfaiteurs de l'humanité, ici et là, prêts à secourir les rockers affamés.

La salle est longue et étroite. Pas la grande foule, à part les filles et les garçons du coin je connais tout le monde. Ouvert à tous, mais tous entre soi. Ambiance sympa propice aux discussions... Mister Eddie est sur scène. Joue le Monsieur Loyal, annonce le programme, c'est le grand manitou, l'homme-orchestre de la soirée. Ce qui tombe très mal. Parce qu'il va chanter sans musicos derrière lui.
DUKE ORPHANS
Faut le faire. C'est du sans filet. Ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Faut une sacrée entente et une super confiance. Sont trois unis comme les doigts de la main. Eddie, Thierry, Bruno. Doo wop ! Suffit pas de faire wap-doo-wap-wap et c'est dans la poche, c'est au millimètre, chaque voix à sa place, et surtout ne pas marcher sur les plates-bandes du copain. N'est pas le Golden Gate Quartet qui veut. Pour la petite histoire c'étaient les idoles d'Elvis. Ne faisait pas joujou de sa voix au hasard, le môme Presley, l'avait écouté les maîtres et s'il a été accusé d'être le premier blanc à chanter comme les noirs, ce n'était pas une contre-vérité.
Bien sûr, y a eu la flopée des groupes Doo wop, mais c'était un peu de la triche, avec des orchestrations orgasmiques à vous hérisser les polis du pubis, des voix de velours enrobées de miel instrumental. La stéréo avant l'heure, la musique et le vocal, servis ensemble, un délice des dieux, le crémeux et le crémant. Mais ce soir Eddie, Thierry et Bruno sont tout seuls. Le temps de prendre le la, et c'est parti mon kiki, ça glisse tout shuss. Attention sport d'équipe. C'est comme du parachutage de précision, ou comme quand on joue à chat dans la cour de récréation. A l'instant ultime et fatidique faut être perché et prendre son air innocent numéro 4. Celui qui va si bien à Eddie. Le doo wop c'est aussi l'art du mensonge par excellence, vous venez – vous ne savez pas comment, par instinct de survie ou crainte du ridicule – de zig-zaguer entre les rochers que les collègues ont jeté sur votre chemin, vous avez dix fois, vingt fois manqué d'arriver en retard et de vous retrouver coincé sous un gros Whom ! pachydermique du baryton et vous regardez le public, un petit sourire désinvolte aux lèvres, du genre « trop facile pour moi ». Et à ce petit jeu la gazelle Eddie fait fureur. Une voix fine de furet, au timbre très légèrement voilé, qui se faufile partout, avec un joli grain de rire entre les morceaux pour assurer la reprise de souffle et dissiper l'émotion.
Avec sa grosse voix d'ours de conte de fée Bruno dame les pavés. Là où il passe l'herbe ne repousse pas, faut se débrouiller pour que ça ne vous retombe pas sur les pieds, mais comme on est tous un peu maso, l'on aime bien cela et l'on prend garde de ne pas retirer l'oreille au dernier moment. C'est profond et sombre comme une goutte d'eau de mort et ça vous noie le cerveau à chaque coup de pilon. Thierry se charge du travail le plus ingrat, le gars qui réceptionne les avions de chasse sur le pont du port-avions, c'est la cheville ouvrière qui évite les catastrophes et l'on aurait tendance à l'oublier, mais c'est lui qui rétablit la balance entre le fort et le faible, vous dessine les dégradés afin que votre oeil ne soit ni ébloui, ni aveuglé.
Ne feront que sept ou huit morceaux, le temps de ravir le public. C'est un peu entre la bonne franquette Sinatra et le ré Charles, une merveilleuse ouverture a capella pour les orages électriques qui viennent. Nous, l'on en est restés sans voix.
SUBWAY COWBOYS

Le temps de revenir dans la grande salle, elle est un peu comme Bonnie Maronie, étroite et longue comme un paquet de spaghetti, Fab et Matt sont déjà debout sur la scène, il manque Will, c'est pourtant lui que l'on devrait voir en premier puisqu'il dépasse ses congénères de deux têtes, plus le chapeau qu'il coiffe pour se faire remarquer. Invisible ! Enfin je l'aperçois, l'est aplati contre le plancher dans la position d'un sioux agenouillé dans les pentes rocheuses des Black Hills, l'a un petit ennui avec le branchement de sa guitare, mais le revoilà qui enfin se relève pour entamer sans retard la cavalcade maudite.

Il y a longtemps que les Subway Cowboys sont sortis des souterrains du métropolitain. Galopent maintenant au grand jour, crinières au vent, et complaintes ardentes. Nous rejouent les scènes finales de La Loi de la Prairie – à moins que ce ne soit celles de La Prairie Sans Loi – ce qui n'est pas grave car nos outlaws du honky tonk gagnent à tous les coups. N'importent où qu'ils soient ils se tirent toujours d'affaire, à Tulsa comme à Reno, au fond de la mine comme sur les rapides de la Big River. C'est Will qui mène l'assaut avec sa voix de stentor - à côté de lui Johnny Cash a presque l'accent français – mais les deux autres ne le lâchent pas d'une semelle. Même que Fab adore de plus en plus jouer le pistoléro fou, il brandit sa guitare comme un torero son espalda et vous enfonce dans les oreilles de ces riffs qui vous massacrent les neurones par dizaine de mille à chaque fois. Et puis un petit pas en arrière et comme si ce n'était pas lui et il vous barjote trente secondes de rythmique avant – alors que vous lui aviez pardonné et que vous n'y faisiez plus attention – de vous tirebouchonner les sinus et les synapses avec un twang bazooka qui vous détruit définitivement le cerveau. Enfin, pour ceux qui en ont un. Ne vous posez pas des questions métaphysiques : du genre, mais pourquoi ils n'ont pas de batteur ? C'est inutile, ils ont le Matteau des Dieux. Doit toucher double-paye le Matt, avec sa double-bass c'est le boss qui vous marque le rythme encore plus sèchement qu'une caisse claire.

Bien sûr dans leurs chemises à carreaux ils n'hésitent pas à roucouler une ballade à fendre le cheatin' coeur de la plus sauvage des squaws comme de la pire des filles de mauvaise vie, mais très vite – après tout ce ne sont que des garçons qui jouent une musique populaire un peu fruste - ils sortent leurs grosses pétoires pour faire du bruit, des grosses boules de feu à la Jerry Lou, ils avalent des liqueurs de langues de crotales à la Big Bopper et menacent mélodramatiquement de mourir à la Buddy Holly, le jour venu..

En fait ce qu'ils aiment c'est le tape cul derrière les troupeaux. La grande vie, loin des villes décadentes et des filles araignées, pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais, pendant que Will annonce Rawhide, Matt se saisit de son archet – l'on pense que tel le divin Apollon il va trucider douze serpents à lunettes en six secondes, mais non, il s'occupe d'un animal vachement débonnaire. Frôle deux fois les cordes de sa contrebasse et vous vous retournez pour voir si un animal de la ferme ne se serait pas aventuré dans la salle de concert. Vous a produit deux meuglements si bien imités que l'espace d'un instant vous vous croyez transporté au Salon de l'Agriculture. N'auront pas besoin de faire un boeuf à la fin du concert puisqu'ils auront déjà fait la vache.

Honte et malédiction sur moi, j'ai oublié le titre du morceau – je subodore le Can't Help it d'Hankie, Williams de son nom de famille - mais plus tard il ressortira son archet et la Big Mama se mettra à pleurer des larmes de crocodiles comme s'il en pleuvait. Récoltent des applaudissements épais comme des trémies de blé in the corn-belt. Z'ont pétaradé des quatre fers, z'ont produit des décalcomanies de l'enfer à vous brûler le péritoine au fer rouge. Je termine sur la déclaration d'un rocker devant moi, au blouson chamarré des noms des plus grands : « C'est ce qui se fait de mieux et de plus original, pour le moment dans le milieu ( rockab ) ». Qui oserait dire le contraire ?
THE ATOMICS

Finie la verte prairie et les bouges innommables du sud profond, la révolution industrielle s'est achevée depuis longtemps, en voici trois qui marchent à l'énergie atomique. Me surprennent de plus en plus à chaque fois par la radicalité de leur démarche. D'une très grande simplicité. Une guitare qui allume le feu et les deux autres, basse et batterie, qui soufflent pour attiser les flammes.

A peine ont-ils démarré que ça irradie de partout. Impossible d'y échapper. La guitare vous poursuivrait jusqu'au fond de l'enfer si vous vous y réfugiez par inadvertance. Alignent les morceaux comme des wagonnets chargés de déchets nucléaires à haute combustion. Trois gars sans compromission qui jouent du rock and roll juste comme ils l'entendent, et qui ne s'égarent jamais dans des chemins de traverse. C'est un trio mais ils ne fonctionnent pas comme un trio de rock classique. Pas de chichi entre les musicos, on ne se fait pas des politesses aux feux rouges, on les brûle sans ménagement, ni crier gare. Au début, ça surprend parce qu'on espérait qu'ils respecteraient au moins les piétons sur le bord de la route. Ne tendez pas le bras dans le vain espoir de faire du stop. Ce n'est pas la peine, ils vous cueillent au passage et vous embarquent sur la banquette arrière, ensuite ils ne se préoccupent plus de vous. Sont trop occupés à accélérer toutes les dix secondes et à cisailler le frein à main. Font un peu la course avec le diable mais ils ont au moins cent mètres d'avance.

Barbichette pour le batteur et lunettes pour le bassiste, les seuls signes de reconnaissance. Sont concentrés, renfermés sur eux-mêmes, refermés sur leur musique. Certains jouent du rock and roll comme ils se font des oeufs à la barre fixe dans la poêle à frire. Ca ne leur est pas indispensable. Un passe-temps agréable, mais rien de plus. Just for fun, et pour que la jeunesse se passe. Peut-être parce qu'ils sont pressés de mourir. Les Atomics s'y accrochent comme si leur vie en dépendait. Donne tout et à fond. Pas de blabla, pas de chichi, ça vient des tripes. Une nécessité existentielle. Ne recherchent point les lauriers de César. Ne jouent point à la rock'n'roll star mais ils brillent comme des constellations dans la noirceur des jours perdus de notre existence. Le rock n'est que le reflet de leur authenticité. Ni puristes, ni wildos, tentent avant tout d'être eux-mêmes leur propre image du rock and roll. N'imitent pas les autres. Se contentent d'être tels qu'en eux-mêmes le rock and roll les change, et ce n'est jamais trop.

Le défaut c'est qu'on ne les voit pas passer. Une heure d'Atomics correspond à dix minutes de temps homologués par les chronomètres du quotidien. Ô temps suspends ton rock ! mais ça file à une vitesse vertigineuse. Vous n'êtes pas sorti de l'imaginaire d'un morceau qu'ils ont déjà entamé le suivant. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. C'est comme pour les sports de combat, ne pas se tétaniser, ne pas se fermer, ne pas asphyxier ses muscles par une trop grande tension, ne pas vitrifier son cerveau pour le transformer en carapace de tortue, car c'est alors qu'il cassera sous le moindre choc un peu fort. Au contraire s'ouvrir à l'autre, se laisser flotter dans l'influx des musicos afin de capter leur énergie et la leur retourner au moment voulu.

Ce qui ne manque pas de se passer. Lorsque la tornade est passée et que déjà ils commencent à débrancher les jacks, le public, qui se réveille au plein milieu des cauchemars existentiels habituels, bougonne. Eddie se précipite pour demander un rappel. Hélas trop court. Est-ce qu'une seule goutte de népenthès même administrée à dose fortement concentrée saurait nous suffire ? Non, l'on sort toujours trop tôt de l'ailleurs lointain du rock and roll. Merci, The Atomics.
THE MEGATONS

Trois fois trois neuf, jusques là. Mais les Megatons débarquent en force. Sont cinq. Comparés aux précédents, l'on dirait une armée. Portent l'uniforme, des vestes gris-souris ou General-Lee grey, pour la couleur, car pour l'aspect ils ressemblent à la tenue des méchants dans les vaisseaux des film de science-fiction. Portent une cocarde colorée sur le devant de la poitrine, avec quelque chose d'écrit dessus, mais ils se démènent tellement que malgré tous mes efforts je n'ai pas pu déchiffrer l'inscription apparemment personnalisée.

De toutes les manières je n'étais pas venu pour bouquiner. C'était à mes oreilles de travailler. Et avec les Mégatons pas besoin d'un sonotone. Ce sont de grands ados, très bruyants, les parents ne sont pas là, alors dans le garage ils empruntent la voiture du dimanche et filent faire un tour sur la corniche. Encore des fous qui ne savent plus où ils mis la pédale du frein. Pourraient ne pas trop se faire remarquer, mais non à chaque virage, le plus allumé de la bande vous file des grands coups de saxon pour que par-devant les automobilistes prudents se rangent sur le bas-côté de la route. Enseignent la prudence, mais ne l'appliquent guère.

C'est une ronde infernale qui ne s'arrête jamais avec l'autre, l'obsédé saxuel, qui s'en vient pousser sa corne de rhinoféroce en cuivre à tout bout de champ. Et le reste qui suit comme un seul homme. C'est du tout cuit, l'affaire est dans le sax avant même d'y être enfermée. Les Megatons se la donnent à coeur joie. Un chanteur qui hausse le méga ton chaque fois qu'il se jette dans un lyric, un batteur qui monte les oeufs en neige systématiquement dès que l'ambiance culmine dans les hauteurs, une guitare qui pousse les chorus sur le grill et un bassiste aussi solide qu'un roc dans la tempête. Bref ça vole haut, mais il reste toujours un pied solidement accroché au sable de la plage.

Rock ! Rock ! Rock ! Surf ! Surf ! Surf ! Tourbillon de hula hoop au clair de lune. Les filles dénudées passent sur la plage tandis que dans le lointain un sax-terrier n'arrête pas d'aboyer. La lune émet un rayon d'insouciance, les Megatons se lancent dans la danse du saxlp, et le public ondule au son de ce tohu-bohu généralisé. Les Megatons transportent toujours avec eux un petit grain de folie communicative. S'enracine très vite dans n'importe quel terreau. Pour l'extirper c'est très dur. Vos veines et vos artères lui servent de racine, il s'ancre en vous et refuse d'en sortir. Sortilège euphorique. Drogue douce qui s'insinue en vous et vous fait voir la vie en rose. Pas exactement le pink rockabilly officiel, mais une teinte qui s'en rapproche. Rock des campagnes, rock des villes et rock des plages, c'est le même rock, décliné autrement, mais avec, si l'on veut bien se donner la peine de gratter jusqu'au sang, la même pulsation de joie et de révolte mêlées.

Les Megatons nous entraînent dans une joyeuse sarabande. Jouent comme des malades, ne s'arrêteront qu'à bout de souffle, exsangues, vidés de toute énergie. Et le public vampire, regonflé à bloc, goinfré d'énergie optimisante jusqu'aux amygdales les ovationne une dernière fois. Ils ont tout donné. On a tout pris.
Damie Chad.
( Photos prises sur le Facebook des artistes. Correspondent au concert uniquement celles de Subway Cowboys )
LA BIBLE PUNK
35 ANS DE CONTRE-CULTURE MUSICALE
CHRISTIAN EUDELINE
( EDITIONS DIDIER CARPENTIER / 1013 )

Besoin urgent de remplacer Mon Manuel de Civilité Pour Les Petites Filles A l'Usage Des Maisons d'Education de Pierre Louÿs – mon livre aux pages collées et tachées de sperme n'étant plus que d'une lecture difficile – je me suis précipité chez mon libraire unique et préféré afin de me procurer un exemplaire vierge de toute bavure inopinée. Je reprenais mon souffle devant la vitrine – pas celle dévolue aux nouveautés littéraires mais l'autre consacrée aux articles de fantaisie et images saintes pour les jeunes communiantes, lorsque mon regard fut attiré par un gros carré d'un jaune criard de fort mauvais goût. Diantre, murmuré-je à part moi, ca ressemble comme deux jaunes d'oeuf à la pochette de Never Mind The Bollocks des Sex Pistols, banco, j'étais tombé juste : Punk, 35 Ans de Contre-Culture Musicale, c'était écrit en gros et en noir. Du même coup je compris comment ce brûlot de la punkitude honnie avait pu échouer su l'étalage réservé à l'édification de notre saine jeunesse : en lettrage plus fin, en un discret cartouche, apparut le mot qui avait dû induire une telle erreur d'aiguillage vers les pieuses étagères, LA BIBLE ! La Bible Punk, quel oxymoron comme disent les narratologues.

De Christian Eudeline. Vous ne confondrez pas avec son frère, Patrick Eudeline, celui dont vous dévorez en premier la chronique à chaque nouveau numéro de Rock 'n'Folk. Tous les deux passionnés de rock, et tous les deux écrivains. De Christian Eudeline, faut avoir lu Nos Années Punk sorti en 2002 qui reprenait toute une flopée d'articles éparpillés dans diverses revues. L'a remis les marmites sous le feu, douze ans après il est toujours intéressant de vérifier si les perspectives n'auraient pas changé.
Ne vous fiez pas aux photos. Le bouquin en est bourré, souvent plus belles les unes que les autres. Pleines pages et documents divers qui essaiment tout du long. Ne vous en tirerez pas en trois quarts d'heure. Il y a du texte. Répartis sur de vastes colonnes, bien écrit, rempli de renseignements et truffés d'anecdotes. Vous risquez de rester éveillés toute la nuit. En plus vous êtes obligé de réfléchir. Patrick Eudeline n'a pas donné dans la facilité. L'aurait pu se contenter de construire un dictionnaire. Sur le punk, c'est de tout repos, il y a longtemps que le phénomène a été circonscrit. Vous activez la mémoire et ça part tout seul. Pouvez commencer à dresser le plan sur le coin de la table. D'abord les précurseurs, Velvet Underground, MC 5, Stooges, New York Dolls, Johnny Thunders et l'on ouvre les hostilités avec les Pistolets du Sexe... D'ailleurs, c'est exactement comme cela que Christian Eudeline officie. Oui mais il ne faut pas prendre les rock critics pour des innocents aux mains vides. L'écriture de qualité est toujours au second ( au minimum ) degré. Si vous racontez l'histoire des Sex Pistols pour raconter l'histoire des Sex Pistols, c'est que vous êtes un âne bâté. Faut avoir une autre idée derrière la tête. Subliminale, plus ou moins appuyée, c'est elle que vous avez envie de partager avec vos lecteurs. Les plus intelligents, ceux qui vous devinent, alors que vous avancez masqué derrière le bouclier des mots apparents. Prenons un exemple au hasard, celui de Christian Eudeline, croyez-vous que ce soit par hasard qu'il ait découpé son gigot en trois morceaux. Première vague, Deuxième vague, troisième vague. N'a pas tort d'utiliser un couteau à trois lames pour rendre compte de l'ampleur dévastatrice du phénomène punk, mais nous sommes nés si avant la pluie que nous essayons de regarder plus profond que l'écume moutonnière qui coiffe les trois déferlantes de ce tsunami rock.

PREMIERE VAGUE

Treize groupes. N'insistons pas sur les Sex Pistols, il y a à peine quinze jours nous donnions la parole à John Lydon... Le Clash – l'autre grand groupe punk – quand je me suis fait opérer l'année dernière le toubib avait un grand poster du groupe dans son bureau, pour dire la reconnaissance sociétale obtenue par le groupe, par contre question fric l'aurait bien pris un dessous de table que je lui ai refusé, comme quoi, il n'avait pas très bien compris l'éthique punk. J'ai un ami, un sacré amateur, qui la semaine dernière vient de s'offrir – moyennant rétribution – l'intégrale de tous les concerts du Clash, des dizaines de Cd à la pelle, qu'il écoute religieusement soir après soir avant de s'endormir. Selon moi le Clash reste le groupe qui a mis à mal la prophétie majeure du punk définie et énoncée par les Pistols. Z'ont mêlé tellement d'ingrédients dans leur rock ( reggae, ska ) que lorsque le punk est mort son futur n'a fait que commencer. Quand la lessive qui arrache s'est faite rare, nombreux ont été les prétendants qui ont proposé des ersatz fabriqués à partir des seuls adoucissants que le Clash avait enfournés dans sa formule.

Damned, Buzzcoks, Siouxie, Generation X, l'on a l'impression de descendre une marche à chaque fois. Pas en leurs folles années de gloire, car ils ont joué leur rôle, parfois magnifiquement. Mais sur la longueur, aujourd'hui chacun de ces groupes ressemble un peu trop aux clones de leur passé. Parfois il vaudrait mieux mourir que se survivre. C'est la seule chose intelligente qu'a su faire Sid Vicious. Au passage Christian Eudeline y va d'une main très morte puisqu'il fait porter au gamin vicieux la responsabilité de l'assassinat de sa petite amie Nancy Spungen. C'est ainsi sur les frasques du deuxième vocaliste des Sex que se termineront les addenda de cette première partie. Certes ce n'est ni Roméo et Juliette, ni Tristan et Yseult, mais qui aurait cru que le petit Vicious atteindrait à un romantisme si déchiré ?

En attendant un saut de puce vers l'Irlande et les Understones, plus rock que punk d'après moi... et hop ! l'on se paye un grand pas en avant vers l'Ouest. Qui n'est pas le best, puisqu'il vient en seconde position. Nous voici dans la patrie de naissance du rock'n'roll, en Amérique avec Richard Hell, Ramones et Blondie, Christian Eudeline prend parti, le punk est né en Angleterre, les ricains peuvent revendiquer la paternité tant qu'ils veulent, le tribunal de l'Histoire ne la leur reconnaîtra jamais. Punk arty et quelque part so british avec Richard Hell, déglingué jouissif primaire pour les Ramones, et tartiné de joliesses disco-chic pour Blondie, la palette entière du punk, quand les ingénieurs ( ici du son ) amerloques se penchent sur un problème, ils proposent toujours de la high quality. Sont très forts en tout. Même pour le bio à base de matière fécale plastique.

Et bing ! L'on se prend deux tranches de mortadelle en pleine figure. Sans vous prévenir. Jusque là on était resté entre gens bien. Et paf ! sans crier gare surgissent deux unités de par chez nous. Deux groupes de petits franchouillards qui s'en viennent jouer dans le pré-carré des anglo-saxons. Débarquent sans complexe, Gazoline et Metal Urbain. Gazoline, deux 45 tours et puis s'en va. Surtout le chanteur Alain Kan qui douze ans après la dissolution du groupe s'évaporera sur le quai du métro, station Châtelet. Jamais réapparu depuis. Une légende. Metal Urbain, ce n'est pas la cerise sur le gâteau mais la guigne inlassable du rock and roll français qui les poursuit. Sont un peu en avance avec leurs rythmiques électroniques et terriblement politiciens avec leurs textes sous forme de slogans hurlés. C'est en Angleterre où on ne comprend pas les paroles qu'ils seront appréciés. En nos douces contrées ils ne parviendront pas à creuser leur trou. Illogiquement ils y resteront tout au fond.
Comme il ne faut pas exagérer, Patrick Eudeline se hâte de tirer le rideau. Il achève sa série sur les Saints ( qui n'en sont pas des petits ). Viennent du pays des dingos, un peu rustauds, habillés comme des ploucs, n'ont pas la dégaine parfaite mais savent faire du bruit avec leurs guitares.
DEUXIEME VAGUE

Suit la première de près. Mais il suffit de quelques mois pour que le paysage change de tout au tout. Le punk, c'est bien joli. Une révolution planétaire. Jusque dans l'hémisphère austral. Mais il faut se méfier de l'iceberg qui cache la banquise. Le punk a pris d'assaut la une des tabloïds mais ce n'est pas parce que l'on en parle dans les journaux que le phénomène réel correspond à son ampleur médiatique. Cas typique des minorités agissantes. Beaucoup de bruit ( et question décibels on ne reprochera rien au punk ) pour pas grand monde. Les majorités silencieuses n'écoutent pas les Sex Pistols. Elles préfèrent – et de loin – les rythmiques bien huilées et bien carrées de la disco. Les années quatre-vingt dégringoleront encore d'un étage avec la pop synthétique de bas étage.
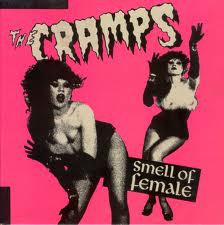
Sham 69, The Exploited, Misfits, Dead Kennedys, Flipper, des étoiles filantes, une pluie de météores au début, continuent sur leur lancée par la suite, mais sont déjà dépassés. Etrangement deviendront des groupes cultes ceux qui proviennent d'autres territoires que le punk. X, Pogues, Cramps, Pussy Galore, ne seraient jamais devenus ce qu'ils furent s'ils n'avaient pas été réveillés par la tornade l'électrochoc du punk. Mais comme le bon docteur Frankenstein ils se sont servis de l'orageuse électricité pour ranimer des cadavres oubliés dans le placard, vieux rock, chansons à boire, rockabilly et vieux blues du delta, ont repris une nouvelle jeunesse après ce traitement de faveur. Quant à Lords of The New Church faut les entendre comme la réfection des vieilles façades, Doors, Stooges, Thunders...
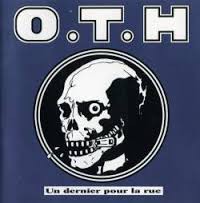
Et bling ! Ca recommence mais en pire. C'est tout le sauciflard que l'on attrape en pleine poire. La Souris Déglinguée, OTH, Oberkampf, Parabellum, et Béruriers Noirs, cinq français en vrac. Si une rondelle ne fait pas le printemps, cinq à la suite vous piquent et niquent la parole sans préavis. Sympathiques certes, cocoricotons sans tarder à plein gosier, mais est-ce vraiment du punk ? Plutôt des groupes de rock français. Si l'on suit la courbe qui part des Sex Pistols pour finir sur les Bérus, l'on est bien obligé de reconnaître qu'elle est en position descendante. Toute la différence entre l'action directe et la phraséologie anarchisante. Les Français sont de grands bavards. Causent beaucoup mais ne s'intéressent guère à la réalisation effective des belles idées.
TROISIEME VAGUE
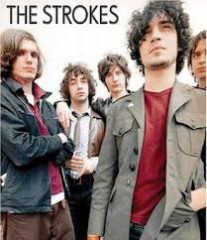
Un saut dans le temps. L'on enjambe allègrement toutes les nineties. Strokes et Libertines en figure de proue du troisième millénaire. Pas explicitement du punk, mais la renaissance – plutôt le retour – du rock. Le rap et bien d'autres musiques encombraient les oreilles des nouvelles générations. Leur a fallu ces deux intraveineuses pour les rappeler à leur devoir. Entretemps l'encéphalogramme de la bête n'était pas resté au calme plat. Offspring, Fugazi ou Dropkick Murphys avaient maintenu la combustion du flambeau, mais ce n'était pas encore cela. Parti de tous les côtés, vers le hardcore avec Rancid, vers les soixante-dix millions de disques écoulés avec Green Day. Pour faire bonne figure, l'on a sauvé deux frenchies de l'anonymat, Stupeflip et Les Sales Majestés. Christian Eudeline clôture son tableau de chasse sur les Vaccines et les Kills. La démarche nous semble trop globalisante. Récupération punk à la limite. La grenouille punk qui veut se faire aussi grosse que le taureau du rock and roll. L'on comprend l'Eudeline sur toute la ligne. Ne veut pas que le punk meure, alors il lui dresse le tableau généalogique de sa descendance. Tout ce qui fait un peu plus de bruit que la moyenne et qui roule en-dessus de la vitesse autorisée est annexé sans plus de façon car tout ce qui entre fait ventre. Vous croyiez que le punk était mort, ben non, it's not dead, et par-dessus le marché il est partout. Danger Zone, à force de le dénicher dans la moindre galette, on va finir par ne plus le voir. Partout et nulle part ne sont pas des frères ennemis. Plutôt des jumeaux qui s'entendent comme larrons en foire pour qu'on ne les distingue plus l'un de l'autre.

Fabriquer un futur au punk n'est peut-être qu'une manière de l'enterrer au plus vite. C'est un peu à ce jeu dangereux que s'est livré Christian Eudeline dans ce livre. Nous ne le critiquons pas, c'est de bonne guerre. Peut-être même que nous, fans des pionniers, agissons de même lorsque nous répertorions le moindre nouveau groupe de rockabilly à l'autre bout du monde. Le rock qui ne cesse de regarder derrière lui engendre, de par ce même mouvement de retour à l'origine, la nostalgie du futur.
Damie Chad.
01:52 | Lien permanent | Commentaires (0)


