13/06/2014
KR'TNT ! ¤ 193 : KID CONGO / JALLIES / LOREANN' / LE MONDE DU BLUES/
KR'TNT ! ¤ 193
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
13 / 06 / 2014
|
KID CONGO / JALLIES ( + simple minds ! ) / LOREANN' / LE MONDE DU BLUES / |
COSMIC TRIP FESTIVAL / 31 - 05 - 14
BOURGE / KID CONGO
CONGO A GOGO
Petit à petit, Kid Congo se transforme en Dada vaudou. Francis Picabia aurait adoré ses grooves lubriques et sa prestance ludique. Les gens qui écoutent ses disques en espérant trouver la suite des Cramps ou du Gun Club vont être un peu déçus. Avec ses derniers albums, Kid Congo est passé à autre chose, comme on dit dans le milieu des pompes funèbres.
Il a raison, car on ne peut pas singer les Cramps et le Gun Club ad vitam æternam. S’il est deux groupes qui ne se prêtent pas à ça, ce sont bien les Cramps et le Gun Club. Les Anglais s’amusent avec Ten Years After ou Thin Lizzy, mais c’est de l’humour anglais au énième degré. Nous autres pauvres français retardataires ne comprendront jamais rien à rien. Et c’est encore pire pour les populations du Sud de l’Europe.
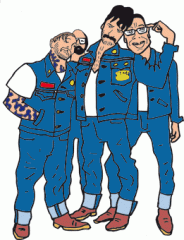
Kid Congo a bien réfléchi. Il faut savoir prendre du temps lorsque vient le moment de prendre une décision importante. Il s’est certainement dit ceci :
— Alors, je suis un rocker légendaire et les gens attendent de moi que je refasse du Cramps ou du Gun Club ! Pire encore : du Bad Seeds. Berk. Non, non, non et non ! Je dois réagir intelligemment sinon je vais finir coincé au fond d’une impasse et ça finira mal, comme on dit chez les éducateurs en milieu ouvert. Puisque je suis un grand sorcier, je vais inventer un nouveau genre musical. Facile avec mes gris-gris, mon JuJu et mon Kiki !

Il jeta alors de la poudre dans le feu et agita des maracas sacrés. Une semaine plus tard, il entrait en studio avec ses copains pour enregistrer «Philosophy And Underwear» qui passa délicieusement inaperçu dans les bouges de Macao. Avec «The Historia Of French Cuisine», le Kid avait décidé de faire du bon groove. L’idéal pour bien poser sa voix. Si on aime le bon groove et la voix bien posée, alors on se régale. Le Kid chante comme un charmeur. Il intoxique. On a droit un peu plus loin à une fantastique pièce de heavy rock intitulée «Even Though Your Leather Is Cliché», qui restera dans les annales. Voilà ce qu’il faut bien appeler du garage vaudou, et c’est une invention congolaise. Puis il croasse «The Weather The War» et partage le micro avec une nommée Little Annie. Les duos lui vont comme un gant. Il adore aller au plus bas de son baryton, comme on le voit à l’écoute de «House Of Cards», mais on s’ennuie un peu. Il nous réveille en sursaut avec «The Last Word», un petit garage bousculé et éminemment sympathique. Comme toujours, il recherche le bon esprit. Et forcément, il le trouve.
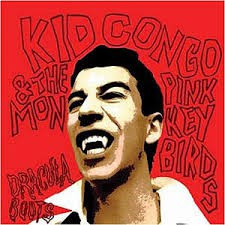
Quatre ans plus tard, il enregistrait «Dracula Boots», en hommage à un copain vampire qui battait tous les records de kitsch dans les Carpathes.
Voilà un album qui défie toutes les attentes. Comme il sort sur In The Red, on s’attend à du trash-garage fatal. Ce n’est pas du trash-garage fatal. Un horrible vampire rit sur la pochette, alors on se frotte les mains. Pas la peine de se frotter les mains. On se félicite d’avoir investi dans une valeur sûre, alors on allume un cigare. Pas la peine d’allumer un cigare. Kid Congo et ses drôles d’oiseaux roses tapent dans un registre inconnu.
Du coup, ça devient intéressant. Car il faut écouter tous les morceaux pour se faire une idée de la prouesse, comme on dit chez la duchesse de Guermantes. Si on rate un morceau, on passe à côté. Kid Congo s’appuie sur le bien-fondé d’un principe psychédélique pour chanter «I Found A Peanut». Quand il joue ce morceau en concert, il le présente en racontant qu’en 1965, des chicanos from East LA ont pris des acides et ils ont trouvé un peanut, c’est-à-dire une cacahuète. Alors, il nous embarque dans une belle pièce de tex-mex jive de la frontière. On goûte à l’excellence du jerk des bas-fonds de San Antonio, ce qui nous réconcilie avec l’immanence des hits de juke. S’ensuit un «Hitchhiking» plus serein, gras du riff, très linéaire, bien battu par le Pink Monkey Bird Ron Miller. Alors on commence à comprendre que Kid Congo cherche le groove de l’espace américain, le groove des trajets interminables à travers des terres abandonnées de Dieu et des hommes. Idéal pour passer des jours entiers à s’aimer, comme dirait Julien Clerc. Et puis on voit Kiki lancer quasiment tous les morceaux sur ses petits riffs de basse impeccables et bien secs : «Funny Fly» et surtout «Black Santa» pour lequel il s’est fendu d’un très beau riff vaudou. «Black Santa» est un morceau qu’on peut voir avancer d’un pas décidé vers son destin. En face B, on trouve de futurs classiques comme «Pumkin Pie» et «Bobo Boogie», puis un hommage à Tintin au Tibet, «Rare As The Yeti», plus rocky que les cuts d’avant. Kid Congo le prend d’une voix de maître chicano, le tout sur un déroulé parfaitement linéaire et minimaliste. Les fans les plus endurcis jugeront ce disque inutile.

Mais les fans les plus curieux feront l’effort d’écouter l’album suivant qui s’appelle «Gorilla Rose». Et là, bingo, car ça démarre avec «Bo Bo Boogaloo», belle musique de danse amenée par un petit groove de basse signé Kiki. Kid Congo et ses amis s’amusent avec le boogaloo comme des gosses qui font fumer un crapaud. «Goldin Browne» est un plus resserré, et c’est toujours Kiki qui mène le bal. Le Kid reste en voix off. C’est cousu de fil blanc mais ça intrigue. Kid Congo titille le groove et cherche l’hypnose vaudou. Avec «Bunner Mentality», il se rapproche de Mark E Smith dans sa façon de chanter, ce qui donne un résultat étrange et déroutant. Par contre «At The Ruin Of Others» vire plus joyeux, c’est une chanson à boire et de belles poussées de groove remontent à la surface. Kiki lance la machine de «Bubble Trouble» et nous embarque dans un instru hypnotique. Voilà une chose sauvagement bien embarquée. Sur la face B, Kid Congo secoue le cocotier du groove punk avec l’excellent «Our Other World» où il raconte son histoire de street-punk et il enchaîne avec un «Hills Of Pills» très laid-back, solidement accroché à la loco d’une rythmique impeccable.
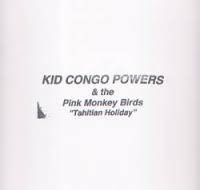
Si on veut choper «Tahitian Holidays», il faut le commander directement chez In The Red. On y retrouve l’ambiance du merveilleux concert de la Boule Noire et on se régale des commentaires de Kid Congo entre chaque morceau. Ils font une version droite et franche de «Goldin Browne», puis le bel hommage au tex-mex de la frontière («I Found A Peanut»), le clin d’œil à Tintin («Rare As The Yeti» - Beauty is as rare as the Yeti, lance Kid Congo d’une voix gourmande - you’re rare as the Yeti/ but not quite as pretty). Kiki lance le groove congolais de «Pumpkin Pie», puis c’est «La Historia De Un Amour», où le Kid parle plusieurs langues, comme un démon surgi d’un vieux bréviaire. Ils rendent ensuite hommage à Depeche Mode - People have their all personal Jesus, so we have our Kris Kringle JuJu - et Kiki kicke le groove de «Kris Kringle JuJu». En face B, Kid Congo revient au vaudou avec «Black Santa» et donne une leçon de French Cuisine, riffée avec une violence qui en dit long sur sa goinfrerie. Puis il rend hommage à Lux Interior - My friend now departed but not far away Lux Interior - avec une version classique de «I’m Cramped» suivie d’un coup de chapeau à son autre copain Jeffrey Lee Pierce - You’re just looking like an Elvis from hell - pour une version magistrale de «For The Love Of Ivy» - Aw... I’m gonna buy a graveyard of my own !

Le dernier album de Kid Congo s’appelle «Haunted Head». Belle pochette glamour et dérangeante. Un morceau titré «Lurch» nous plonge aussi sec dans un cimetière au beat pressé, pour deux minutes d’étrangeté hantée et honteuse. On s’incline devant tant de prestance, comme dirait le Bossu. On retrouve le petit beat alerte de Kiki sur «Su Su» - Ahhh miss Su Su they say you’re cuckoo - ils s’amusent bien - Ohhh miss Su Su you spread the JuJu. Et c’est là qu’on comprend l’originalité de la démarche. «Killer Diller» est beaucoup plus musclé, c’est un petit rock exacerbé aux paroles étranges - You know water seeks it’s own level. «Haunted Head» est encore l’un de ces morceaux étranges, habités et attachants dont Kid Congo s’est fait une spécialité. «Let’s Go» est une pièce d’exotica montée sur des noms de gens comme Elvis, les Supremes, Argento, the Meek, The Cap’n the Kiki, The Jesse & the Kid. Ils s’amusent comme des gosses. Pur dada. Et puis il y a aussi cette pièce gluante de fin qui s’appelle «Dance Me Swampy» aux paroles bien glauques - We’re smashed together in your little room/ Lots of bones, bad attitude/ Dangerous, funny, scarry and smart/ Stupid gorgeous ecstatic art.

Entre l’âge d’or Cramps/Gun Club et le Dada vaudou, Kid Congo a pondu pas mal de d’œufs en chocolat, et notamment un EP vaudou de Fur Bible sur New Rose. Dans le spectaculaire boogaloo intitulé «Plunder The Tombs», on entend la basse grondante de Patricia Morrison créer une sorte d’ambiance gothique moderne et incroyablement envoûtante. Le morceau se montre digne du fameux «Death Party» du Gun Club. On sent déjà chez le Kid un goût prononcé pour la basse devant dans le mix.

Il enregistra aussi un album avec Sally Norvell en 1994, mais ce fut une amère déception. On eut beau pleurer, ça ne changea pas grand-chose. Kid Congo ne chantait qu’un seul morceau en duo avec elle, «Mercy Mine» et le reste nous faisait bâiller aux corneilles.
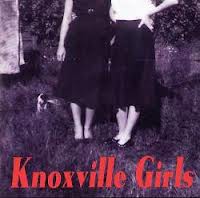
Si on veut du très gros Congo, alors il faut aller écouter dare dare les trois albums des Knoxville Girls. Contrairement à ce qu’indique le nom du groupe, ce sont des garçons. Rien que des gros bras du rock américain, comme Bob Bert au beurre et Jerry Teel à la basse, plus deux autres mecs qui s’appellent Jack Martin et Barry London. Une fois de plus, notre Congolais préféré se retrouve dans un super-groupe : Cramps, Gun Club, Bad Seeds et maintenant Knoxville Girls. Le premier album des Girls est une monstruosité lovecraftienne. «Sixty Five Days Ago» qui ouvre le bal tape dans le Memphis swing. Ça grouille de notes de slide échappées. On est frappé par la démence de la démarche ! On ne réunit pas une équipe pareille sans qu’il y ait de lourdes conséquences sur l’équilibre géopolitique du rock américain. «I Feel Better All Over» est encore plus diabolique. C’est avalé comme du macadam sous un bolide et ça surpasse tout ce qu’on connaît. Appelons ça de la country swinguée à mort, ou du trash-country punko-psychotique, celui que jouent les mecs tatoués et dévorés par des soifs innommables. «Two Time Girl» est atroce de punkitude. Berk ! On reçoit ce truc spongieux et puant dans la figure. Attention, on est là chez les punks de la frontière, rois de l’abomination expéditive. «NYC Briefcase Blues» est trashé d’avance. Bob bat le Bert. C’est un fou. On devrait l’enfermer. Ces types sont les meilleurs connaisseurs du rootsy trash punko-bronco d’Amérique. On peut faire confiance à Jerry Teel. Ils font du Dylan avant la lettre et le troussent à la Quantrill. Encore du country-rock des enfers avec «Warm And Tender Love», en plein dans le mille de l’intensité. Surpuissance carabinée. Une rythmique qui ne pardonne pas. Tout est complètement sourd, dingue, ébréché, traité au gros son, gonflé d’énergie rockab, atteint d’une démence de l’excellence. Pas d’échappatoire. Un modèle pour tous les casseurs de baraque. Ils nous font le coup du heavy blues avec «I Had A Dream», clin d’œil à Muddy balancé à la va-vite, ça trombone derrière avec les chœurs les plus dévastés de l’histoire des chœurs. Ça poisse de partout. On voit bien que tout est réinventable, même le doo-wop. Ils nous servent un trash d’omelette de mégot et de gerbe. Une nouvelle horreur surgit avec «One Solid Love», scream sublime, agression divine, battue par Bert, plongée dans une mare d’insanité atroce. Appelons ça le genius tender trash.

«In A Paper Suit», second album studio des Knoxville Girls, est du même niveau. Album épais zébré d’éclairs de génie trash. Ils font du Dylan à la cave avec «(Any Other) Loving Cup» et le bardent de coups de slide fantomatiques. «Oh Baby What You Gonna Do Now» est du garage haut de gamme, traité au coin de la rue et rencontré par un harmo, une slide et une nappe d’orgue. Le groove tient à la fois du souterrain et du dylanex, pulsé à l’harmo et jeté dans les orties. Jerry Teel nous chante ça aux petits oignons. Puis Kid Congo chante «Sophisticated Boom Boom», il fait ses manières avec une diction traînante et ça devient vite explosif, bubblegum boo boom, le Kid sait faire le con, solo étranglé, pure trasherie, atrocité incroyable de modernité. Le groove du siècle ? Allez savoir... Nouveau cut des enfers avec «In A Paper Suit» joué à l’envers au piano et par les guitares et poundé par Bob Bert. On revient au trash-country avec «Baby Wedding Bell Blues», avec son secoué. Nouvelle virée dans la stupéfaction. Rythmique rockab pour «That’s Alright With Me», génie pur, on voit passer le fantôme du Bengale, les Knoxville Girls trashent tout même l’esclandre. C’est tapé dans l’épaisseur d’un son de rêve. Jerry Teel prend «Butcher Knife» au chant, il stompe ça dans le marécage, au milieu des nappes d’orgue. On voit la température grimper aussitôt. Nouvelle pièce somptueuse et définitive. Le Kid chante comme un ogre dans «Drop Dead Gorgeous». Il traîne ses syllabes dans la boue. Pure décadence et solo d’une saleté impressionnante.

Évidemment, c’est sur l’album live «In The Woodshed» qu’on goûte le jus du groupe, un jus brun et épais. Si on veut avoir une idée de ce qu’est la modernité du trash, alors il faut écouter «Armadillo Roadkill Blues/I Feel Better». Si on veut avoir une idée de ce qu’est le swing à fond de train, alors il faut écouter «Sixty Five Days Ago». Si on veut ré-entendre le meilleur traînard de la décadence congolaise, alors il faut s’envoyer la version live de «Drop Dead Gorgeous». Si on ne vit que pour le trash nappé d’orgue et la fuzz de derrière les fagots, alors il faut écouter «My New Dinner». Si on ne sait pas ce qu’est un heavy blues dans l’excellence de la démarche chargé de chœurs de dingues, alors il suffit d’écouter la version live de «I Had A Dream». Si on veut aller voir à quoi ressemble le fond de la folie trash, c’est facile. Il suffit simplement d’écouter la version live de «NYC Briefcase Blues». Si on rêve de tomber dans un potager, d’écraser les courgettes et de se faire décoiffer par un vent de slide, il suffit d’écouter «Country Song (One More Thing)». Et pour ceux qui voudront tremper dans un complot trash fomenté contre la raison, le plus direct sera d’aller écouter «Truck Drivin’ Man».

Il existe une très jolie petite compile sortie en 2005, «Solo Cholo», sur laquelle on retrouve des pièces improbables parues ici et là, comme ces duos avec Lydia Lunch ou Jerry Teel. On ne retrouve qu’un seul titre de l’époque Knoxville Girls, «Sophisticated Boom Boom», et une magnifique reprise du «Virginia Avenue» (Tom Waits) que Kid Congo partage au chant avec Jerry Teel. Ils en font un groove puissant et hanté, un groove qui déraille, ivre de poison mortel. On retrouve aussi le fameux «La Historia de Un Amour» tirée du premier Pink Monkey Birds et un cut de cabaret vaudou, «Power», que Kid Congo traite à la Kurt Weil. C’est sans doute l’exacte merveille, il chante ça sous le manteau rugueux, d’une voix de baryton de velours. Le Kid se fait profond, bas et chaud. Ce cut se veut constitutif d’un univers réel, établi et généreux. Idéal pour mesurer la portée d’une vision comme celle de Kid Congo. Duo d’enfer avec Lydia Lunch pour «Parts Unknown», cut chauffé à blanc, ils se chantent l’un sur l’autre, se confrontent, Lydia veut le leadership, le Kid s’accroche. Il boucle cette belle compile avec «Plunder The Tombs», cette énormité qui date du temps de Fur Bible.

On en revient toujours à la même conclusion : l’idéal est de voir le groupe sur scène. En ce qui concerne Kig Congo, c’est flagrant. Alors, le voilà sur scène au Cosmic Trip Festival de Bourges. Il n’est pas tête d’affiche. Quoi ? On a réservé cet honneur aux Fleshtones ? Eh oui, le monde est ainsi fait. Mais le Kid a suffisamment de grandeur d’âme pour s’en moquer. On le voit installer son matériel sur scène. Il porte sa casquette de cuir noir et ses grosses lunettes de bigleux. Chez lui, pas de délire de roadies à la con, comme chez le Brian Jonestown Massacre. Il fait rapidement les réglages de sa petite Fender noire.

Lumière et les Pink Monkey Birds débarquent. Kid Congo incarne le cool américain mieux que personne. Il cultive l’art suprême de la présentation des morceaux. Il joue en rigolant comme un bossu et fait d’atroces grimaces de gamin déluré. Il est absolument sidérant de présence. Il danse sur les grooves, la bras en l’air. Sa tête dodeline. Kid Congo est devenu une véritable bête de scène, mais toujours dans ce qui l’intéresse, le bon esprit. Son parcours impose le plus grand respect et on le respecte d’autant plus qu’il semble tracer la voie du garage de l’an 3000. Il semble avoir inventé un style et son set impressionne au plus haut point. Ses grooves passent comme des lettres à la poste. Ce mec est incapable de la moindre frime. Attention, on n’est pas chez les Clash. Quand le Kid attaque son set avec sa petite casquette de cuir noir et ses grosses lunettes, on sent bien qu’il va casser la baraque. Et il la casse, plutôt dix fois qu’une, rien qu’avec ses trois reprises du Gun Club. La carnage commence avec «Ghost On The Highway» qu’il introduit avec une formule fantomatique. Puis il coupe la chique à tout le monde en passant aux Cramps pour balancer une version infernale de «Garbage Man» que Ron Miller frappe comme s’il était le batteur des galères. Retour au Gun Club avec une version hallucinante de «She’s Like Heroin To Me». Le garage ? Mais c’est Kid Congo. Inutile d’aller voir les autres groupes du festival. Ça pogote sec au pied de la scène. Alors, le Kid calme le jeu et s’adresse au meneur d’émeute torse nu : «You look just like... an Elvis from hell !» C’est l’apocalypse. La salle explose. On frise l’insurrection. Les Pink Monkey Birds surchauffent. Puis le Kid lève un bras pour ramener le calme et, hilare, il s’adresse à Dieu : «Gonna buy me a graveyard... of my own !» C’est à nouveau l’apocalypse. Une houle digne du Cap Horn balaye la foule. Des corps volent à la surface. L’animal n’en reste pas là. Il lève le bras et ramène le calme une troisième fois : «Well, jawbone eat... and jawbone talk !» Ça devient orgasmique. Ça gicle au plafond. Kid Congo règne sur la terre comme au ciel. Parmi les nappes de fumée artificielle, il sourit comme un crocodile, il dodeline, il bave même un peu. Il se réjouit et s’abreuve du chaos. Kid Congo est un personnage miraculeux. L’un des ultimes géants du rock.

Signé : Cazengler, gogo et gaga
Cosmic Trip Festival. The Wild’n’Crazy Rock’n’Roll Festival. 31 mai 2014. Bourges (18)
Fur Bible. Plunder The Tombs. New Rose Records 1985
Congo Norvell. Music To Remeber Him Back. Priority Records 1994
Knoxville Girls. Knoxville Girls. In The Red Records 1999
Knoxville Girls. In The Woodshed. In The Red Records 2000
Knoxville Girls. In A Paper Suit. In The Red Records 2000
Kid Congo Powers. Solo Cholo. Trans Solar Records 2005
Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Philosophy And Underwear. Trans Solar Records 2005
Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Dracula Boots. In The Red Records 2009
Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Gorilla Rose. In The Red Records 2011
Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Tahitian Holiday. In The Red Records 2011
Kid Congo & The Pink Monkey Birds. Haunted Head. In The Red Records 2013
De gauche à droite sur l’illustration : Ron Miller, Jesse Roberts, Kiki Solis et Kid Congo

FESTIVAL CONFLUENCES / MONTEREAU
06 – 06 – 14 / THE JALLIES
Plus d’un mois que je n’avais pas vu les Jallies. Le manque commence à se faire sentir. Et voici qu’arrive LA nouvelle. Elles jouent au off du festival Confluences de Montereau. Je saute, je bondis sur l’occasion. Je vais, je cours, je vole sur la route en ce vendredi soir prêt à débarquer sur les bords de la Seine. Les dieux du rock’n’roll sont avec moi, ont libéré une place au bord de l’eau pour que je puisse parquer mon char.
Il est 19h30 et les Jallies ne jouent qu’à 21h00. Je parcours les pelouses du parc des Noues pour prendre la température du festival. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est bien moins élevée que celle que le soleil déverse à flots sur nos épaules. Juste le temps d’apercevoir nos belles qu’elles s’éclipsent pour aller se préparer, se maquiller, se faire belles qu’elles disent. Bien plutôt pour se faire désirer.
Enfin l’heure approche. Le jazz band qui occupe la scène lance son dernier morceau, quitte les lieux. Elles se mettent en place. Et c’est parti. Tout de suite, malgré les aléas de réglage de la sono, le public est prévenu : they are the Jallies.
L’énergie est au rendez-vous. Les spectateurs ne s’y trompent pas. Ils étaient venus pour d’autres concerts ; ils se rassemblent, s’agglomèrent à l’entrée devant cette petite scène où Leslie se lance dans un Be bop a lula qui commence à donner des fourmis dans les jambes de la foule.
Energie donc. Plaisir aussi. La joie de nos musiciens se transmet à l’ensemble du public. Une véritable communion. Les titres s’enchaînent, entre reprises et compositions des Jallies, la température monte de plus en plus. L’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de kermesse qui était celle du festival plus tôt. De même que virevoltent de guitare en caisse claire nos trois grâces, le public crie, hurle son bonheur, son plaisir d’être là plutôt que devant les grandes scènes. C’mon everybody. C’est bien ici qu’il faut être.
Si Céline, Vaness et Leslie peuvent si bien voler de micro en micro, c’est parce qu’elles sont toujours soulevées par le fil, électrique bien sûr, de la guitare de Thomas qui les emmène vers les cimes, mais qu’elles restent reliées à la terre par la puissance tranquillement ravageuse de la contrebasse de Julio.
Tout le monde est happé par la musique. Vaness se lance dans Crazy legs. Les jambes s’affolent. Les danseurs montent sur les baffles. L’atmosphère s’électrise. La température monte encore au point que deux danseurs se lancent dans un strip-tease improvisé. Nous sommes partis pour écouter les Jallies jusqu’au bout de la nuit.
Par malheur, on vient les avertir qu’elles n’en n’ont plus que pour cinq minutes. Déjà une heure qu’elles sont là, que cela passe vite une heure, trop vite. Tout le monde est déçu, mais l’organisation est intransigeante. Il faut s’arrêter. Heureusement, avant de quitter la scène, elles nous remplissent d’espoir. Nous parvenons à réprimer le désespoir qui nous poussait vers le fleuve. Elles passent ce dimanche à Flagy. Ouf. La frustration ne permettra que d’aviver le désir.
Pour la suite de la soirée, nous ne pouvons que regretter qu’elle n’ait pas été à la hauteur de ce moment. Il fallait être bien simple d’esprit pour espérer retrouver le même plaisir avec Simple Minds.
Philippe Guérin.
08 – 06 – 14 / FLAGY
LES JALLIES

Ce n’est pas parce qu’on les a vues rapidement, trop rapidement, deux jours auparavant que l’on va bouder notre plaisir. Pleine d’admirateurs, la voiture survole l’asphalte surchauffé par ce brûlant soleil dominical. Dès que nous arrivons sur la place, les notes des Jallies se font entendre pour les difficiles réglages de la sono. Elles passeront outre ces aléatdéboires pour nous offrir encore une fois un concert d’une énergie folle.
Tout le village est en fête et les Jallies viennent couronner le tout. Comme les habitants du village ont de la chance. Le temps d’un verre et les voilà qui arrivent pour nous livrer un premier set. Rapide, le set ; le temps de l’apéritif et c’est déjà fini. Mais déjà toutes les Jallies dans ces quelques morceaux. Elles nous prennent, elles nous cueillent, elles nous nous attrapent, elles nous emmènent, elles nous enlèvent, elles nous ravissent. Et on en redemande. Encore et encore. Heureusement, nous n’aurons pas trop longtemps à attendre le deuxième set. Elle nous l’ont promis. Il sera plus long. Nous sommes sauvés.
Comme à leur habitude, elles passent de micro en micro. Elles étaient ici, on les retrouve là. Elles ne tiennent pas en place. Leur public non plus. Le devant de la scène se couvre de danseurs. A l’image du madison endiablé lancé par Céline avec Goodbye Bessie Mae.
L’ambiance monte, s’électrise. Il n’y a pas à dire, le courant passe, court des Jallies à l’ensemble du village. Que viens-je de dire ? Il passe. Non ! elles se retrouvent privées d’électricité. Tout a sauté. C’est là un coup à vouloir faire sauter tous les ingénieurs. Heureusement, tout revient vite, même pas le temps de fumer une cigarette notera Vaness. Cela ne les a pas déstabilisées pour deux sous. Elles recommencent à nous secouer comme si de rien n’était.
Elles puisent la force de leur musique dans l’énergie tellurique de la contrebasse de Julio. Celui-ci vient chercher au cœur de la Terre la puissance magmatique qui va provoquer l’explosion, l’éruption de ces forces primales dans leurs voix qui nous uppercutent de plein fouet. Les Jallies sont un volcan qui nous ensevelit avec délices sous les flots du rock’n’roll. Le Fujiyama mama asséné par Leslie avait déjà annoncé la couleur.
You’d better be good, répètent-elles à leurs souffre-douleur préférés. Ils n’ont pas de micro. La belle affaire ! ils répondront à chaque fois par la voix de leur instrument. Rien ne leur aura été épargné lors de cette soirée. Thomas devra même changer de guitare après avoir cassé une corde. Thats’s all right : they was good.
Heureusement pour eux, ils reçoivent du renfort : Nico monte sur scène et s’empare d’une guitare pour un dialogue musical avec Thomas. Ils sont bientôt rejoint par Alain au saxophone. Vont-elles crouler sous le nombre ? C’est bien mal les connaître. Loin d’être accablées par le nombre, elles en profitent pour s’élever encore plus haut.ce n’est plus l’éruption volcanique, c’est l’explosion solaire. Elles sont bien the Queens of Rock’nRoll.
Après près de deux heures, le set arrive à sa fin. Elles viennent de faire swinguer tout un village qui vient sauter et crier dans la reprise finale de Jumps, giggles and shouts que personne ne veut voir s’arrêter.
Il est de notre devoir d’avertir la population. Les Jallies sont, pour notre plus grand plaisir, une drogue dure avec accoutumance rapide. A consommer sans modération. We love them so.
PHILIPPE GUERIN
( PS : les photos du Grand Phil ont refusé de passer ! )
08 – 06 – 14 / FLAGY
LES JALLIES
Moi aussi j'étais à Flagy. Peut-être n'aurais-je pas dû. Car jusqu'à lors j'étais comme vous, un imbécile heureux. Ne le prenez pas mal. A la fin du deuxième paragraphe je sais que vous me donnerez raison. Sans les Jallies je ne serais jamais allé à Flagy. Ne savais pas qu'il existait un patelin de ce nom dans notre Brie bien-aimée. Un coin perdu. Même Christophe Colomb ne l'a jamais découvert, bref le bled introuvable par définition. Heureusement que le grand Phil possède son GPS, facile pour vous y rendre : vous délaissez Mortery – la mort s'y rit de vous - sur votre gauche et foncez à tombeau ouvert vers La Tombe. Les villages de France portent des noms charmants. Cinquante kilomètres en lignes droite au fin fond de la plaine briarde plate comme une limande, et vous tombez pile sur Flagy. Premier émerveillement, j'ignore comment ils s'y sont pris mais les Flagiens ont réussi à construire leur antre tutélaire sur une colline. Sacrément en pente, pas tout-à-fait l'a-pic des Grandes Jorasses, mais une très forte déclivité.

Flagy, six cent cinquante habitants, sept rues, une rivière et une église. Un trou, un rien, un néant. Méritent toutefois notre estime puisque en ce dimanche après-midi, ils reçoivent les Jallies pour l'apéro. Z'ont du goût, et si z'ont pas l'oseille z'ont l'oreille. Mais c'est lorsque l'on m'a distribué le prospectus que j'ai douté de la santé mentale des Flagiens. Les Jallies oui, mais ce n'est pas tout, du 6 juin au 25 juillet, tous les vendredis soirs, apéro-concert, avec chaque fois un groupe. De fieffés soiffards qui n'écoutent pas de l'accordéon et du flon-flon, tiens le 20 juin il y a les Shotguns LTD... pour le reste de la programmation wwwflagy.com, quand je pense qu'avec ses 12 000 habitants Provins ne nous offre que de la musique religieuse du dix-septième siècle... Ah ! si dans toutes les communes de France... ne rêvez pas, vous risquez d'y perdre votre sérénité !

AVANT-CONCERT
Le grand Phil arrête sa pfeut-pfeut voiture – c'est ainsi que la surnomme notre teuf-teuf mobile – sur la grand place du village. Nous sommes accueillis par les aériennes vocalises de nos trois précieuses. En pleine balance avec un méchant larsen qui se niche on ne sait où. Dix huit heures, trente-cinq degrés à l'ombre, la population s'est réfugiée sous les tilleuls devant l'Eglise. Sa porte est bien ouverte mais j'ai le regret de vous l'annoncer la gent flagienne me paraît fort mécréante, elle déserte les vêpres pour mieux rôder autour des marmites emplies à ras-bord d'un liquide punchy du meilleur aloi. Beaucoup de monde, des jeunes, des adultes, des familles, des célibataires, des grands-mères qui trottinent, des gamins qui courent partout, un véritable échantillon représentatif de la faune nationale, avec évidemment les rockers du coin qui ne manqueraient pas un set des Jallies pour rien au monde, Muriel et Billy drapé dans une chemise hawaïenne à rendre jaloux le King himself, Jean-Luc Fifties à qui j'ai chipé les photos pour illustrer l'article.
PETIT SET

Set à dix chansons. Une misère. But already in the pocket, n'ont pas entamé leur troisième morceau que déjà ça se masse devant l'estrade. Trois jolies brins de filles qui pétaradent, l'en faut pas plus pour égayer une escouade de village. Avec derrière deux gars pas manchots prêts à leur passer dans l'euphorie générale les cordes au cou, laissez-moi vous dire que ça ratiboise sec. Céline, Vaness, Leslie, difficile de donner le tiercé dans l'ordre, ce qui est sûr c'est qu'à toutes les combinaisons vous jouez gagnant. Régal des yeux et des oreilles, mais c'est déjà fini. Les organisateurs doivent être des admirateurs du divin Marquis de Sade, affiliés à la secte des adeptes de la cruauté mentale généralisée. C'est comme si vous repreniez à votre matou-cat les trois craquantes souris que vous venez de lui offrir. Elles promettent de revenir, le temps d'éponger l'apéro.
GRAND CONCERT

En plus elles ne nous ont pas menti, les revoici. Et c'est reparti pour une heure et demie. Sans interruption. Enfin presque, puisqu'elles font sauter l'électricité. Qui sera vite rétablie. Mais arrêtez de frétiller d'allégresse devant nos trois pimprenelles. Les Jallies c'est comme les anciens bateaux à vapeurs, tout beaux, tout propres, qui filaient par-dessus les flots azuréens, mais à l'intérieur dans les bas-fonds il y a les soutiers qui s'activent et n'arrêtent pas de jeter le combustible dans la fournaise. Deux souffre-douleurs qui n'en peuvent mais. Julio qui plante dans le granit du rock les poteaux sur lesquels reposent l'édifice. Et Thomas qui n'en finit pas de jeter des tonnes de TNT pour en éprouver la solidité. Guitare turbine qui fait éclater les vieilles cloisons rythmiques du swing et les speede à fond de course. Et Julios qui en rajoute, se sert de sa contrebasse comme d'une arbalète. Il pleut de partout des carreaux de mort dans l'architecture sonore maltraitée, elles peuvent danser la gigue par devant, les boys sont en train de dynamiter la basilique, et tous avec le sourire. Car c'est une fête. La passion de la destruction n'est-elle pas une création comme s'écriait avec une si juste raison le grand Bakounine ?

Vous dis pas le public. Ca batifole, ça rocke, ça rolle, ça strolle et ça madisonne, y a même un chien loup qui pose ses pattes sur les avant-bras de son maître et qui se permet quelques entrechats. Carnaval des animaux. Nos trois mignonnes se lancent dans un Shave Your Pussy des plus torrides immédiatement suivi d'un Stray Cat Strut en chasse. On ne les retient plus, les chats sont là et les souris dansent de plus belle. De plus en plus belles. Céline déchaînée qui tape l'assaut comme une forcenée sur la caisse claire, Vanessa qui jumpe jusque en haut des cocotiers avec sa voix enrauquée, Leslie qui arrache des dents d'alligator chaque fois qu'elle claironne un rock tonitruant, Vannes au micro, Leslie au tambourin, Céline partout à la fois qui bondit comme un feu follet, vous ne savez plus qui est qui, et puis durant deux fractions de seconde toutes les trois immobiles comme des jeunes filles sages de bonne famille qui vous font les choeurs style sixties nostalgie, avant de nous entraîner une fois encore dans leur tarentelle endiablée. Seraient-elles comme l'incarnation d'un rêve de Jean Lorrain, princesses d'ivoires et d'ivresse, fragiles, extatiques, cruelles, apparues sur cette terre pour nous faire oublier la décrépitude de nos existences ?

Plus on est de fous, plus on rit. Le sieur Nico est prié de se ramener dare-dare sur la scène. Nico là ! Et on lui fourre entre les mains la fender blanche de Céline. Sait s'en servir, joue plus aigu que Thomas, un style un peu plus insinuatif, qui se faufile entre les filles afin de leur insuffler que la force fidèle du rock ne s'enfuit jamais. Ce n'est pas tout, un certain Alain perdu dans l'assistance se fait apostropher. Julios lui intime l'ordre d'aller chercher son sax. Deux minutes ne se sont pas écoulées que le dénommé Alain apparaît en haut des marches et s'en va se planter à côté de Julios. Tranquille, pas affolé pour deux sous, les six autres engagés dans un rock de la mort ne s'intéressent plus à lui, et lui après avoir souffloté dans son bec, il vous commet deux longues traînées aboyantes de sax à la Bill Haley, puis s'apercevant que le morceau est trop bop, trop cadenassé sur lui-même, pour qu'il puisse déployer une telle fanfare triomphante, il change illico de mode d'intervention et vous expulse systématiquement entre deux syncopes de ces petites goualantes revigorantes qui vous feraient sauter au plafond si l'on n'était pas en plein air. En voilà un qui n'est pas né de la dernière pluie. Quarante ans de métier derrière lui, sur toutes les scènes françaises, a joué avec à peu près tout le monde depuis les premiers temps des Chaussettes Noires jusqu'aux Jallies d'aujourd'hui.

Que voulez-vous de plus ! Le show se termine en bacchanales, les filles frétillantes qui s'égosillent et les quatre musicos qui se repassent le solo à tour de rock and rôle. Alain n'a pas de micro – ce qui ne l'empêche pas de se faire entendre – mais Vaness lui braque le cromi jusqu'au fond du sax et il en sort de terribles râles de jouissances. Le brame du cerf le soir au fond du cuivre. Ca valdingue de tous les côtés, le public est aux anges ( les noirs, ceux de l'enfer ). Terminent en apothéose sur le Jumps Giggles and Shouts de Gene Vincent. Il y a des soirs comme cela où la vie vous offre ce qu'elle a de meilleur.

Damie Chad.
07 – 06 – 14 / LE CESAR / PROVINS
LOREANN'
Je suis à cent mètres du César, et la voix de Loreann' résonne comme si elle était à côté de moi. Allez savoir par quel mystère mais la halle couverte s'est transformée en caisse de résonance et inconsciemment marchands et acheteurs, bateleurs et badauds, ont baissé d'un ton, ils croient entendre mais ils sont déjà en train d'écouter.
Ne suis pas en avance. Midi passé et le set se termine à treize heures. Soixante petites minutes, oui mais des plus délicieuses, dont on garde longtemps le souvenir comme une fleur séchée entre les pages d'un livre. Le folk dans toute sa splendeur, comme des petites gouttes d'eau qui font floc floc sur les herbages du rêve. Les copains me parlent, m'interrogent, me questionnent mais je suis ailleurs emporté par la brise printanière loreannéenne en un autre monde de douceur, de calme. Je suis l'aigle qui plane et je suis l'escargot qui bave. Je suis un atome de mère nature. Je suis le tout et je suis le rien. Je ne suis plus un rocker ! Enfer et damnation, j'allais me perdre mais une voix me demande et m'ordonne de foutre le camp d'ici. Frère Jack m'a sauvé, merci Ray Charles et merci Loreann' qui a su et m'envoûter et me réveiller.
Un peu sorcière, un peu magicienne, Loreann', une simple guitare lui suffit pour prononcer ses incantations. C'est le rendez-vous du samedi, le rituel musical de la semaine. Une fille, une voix, un sourire. Avec ces trois seuls ingrédients vous pouvez composer un rock des plus terribles. Mais non, c'est du folk. Du folkloréann' !
Damie Chad.
LE MONDE DU BLUES
PAUL OLIVER
Traduction : HENRY KNOBIL / MAX ROTH
Préface : SIM COPANS
( Arthaud / 1962 )

Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la parution de ce livre. 1962, en Angleterre le british blues est encore en incubation, l'oeuf est fendu mais le poussin pas encore sorti de sa coquille, en France c'est une musique qui appartient encore aux aficionados du jazz, nos premiers rockers ne voient pas plus loin que le nez d'Elvis... La discographie française due à Jacques Demêtre est éloquente, c'est bien celle d'une autre génération. L'on y retrouve Memphis Slim et Champion Jack Dupree – qui avaient tous deux fait le choix de notre pays qui leur offrait des conditions de vie paradisiaques comparées à celles de leur patrie d'origine – mais point de BB King, point d'Howlin' Wolf, point de Muddy Waters, point de Robert Johnson, le rhinocérock n'avait pas encore poussé sa corne dans la mythologie électrique du blues.

Maintenant n'allez pas cracher sur Jacques Demêtre, il fut un pionnier, peut-être le véritable introducteur du blues par chez nous, explorant ce continent obscur que Charles Delaunay et Hugues Panassié avaient mentionné comme les sources perdues et taries du jazz... Un seul exemple pour donner une idée de l'importance de l'individu: il fut le découvreur de John Lee Hooker. Reconnaissance absolue.

Sim Copans, encore un américain de Paris, est arrivé avec the american troops qui débarquèrent en Normandie, vu sa connaissance du français – il fut étudiant à la Sorbonne – il est très vite affecté à la radio La Voix de l'Amérique... Résidant souvent dans le sud de la France il fut le créateur du festival de jazz de Souilhac, sa voix n'était pas inconnue des auditeurs, il présenta plusieurs milliers d'émissions sur le musiques populaires américaines sur les ondes françaises entre 1946 et 1973. Dans son introduction il nous met au fait de la personnalité de l'auteur : Paul Oliver. Né en 1927 en Angleterre, professeur d'université spécialiste d'architecture vernaculaire et spécialiste reconnu de... blues.
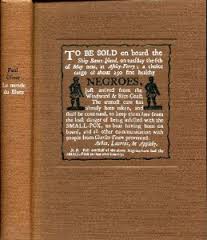
Encore que l'aspect purement musical du blues n'est que très peu évoqué dans le livre. Davantage un bouquin de sociologie que de musicologue. L'existence du blues est un pré-requis aux trois cents pages en petits caractères qui s'attachent à décrire avec minutie les conditions d'apparition du blues dans la communauté noire des USA. Blues Fell This Morning est paru en 1959, rappelons que Barack Obama naquit en 1961, que Malcolm X fut assassiné en 1965, Martin Luther King en 1968, et que donc au moment de l'écriture comme à celui de sa traduction la lutte pour les Droits Civiques est loin d'être terminée...
NAISSANCE DU BLUES
Vient de loin. D'Afrique. Tout le monde sait cela. Paul Oliver ne s'attarde guère sur ses racines originelles. Se concentre sur le sol américain. Se contente de citer une ancienne enquête menée au début du siècle précédent auprès de noirs nés au plus tard en 1860 qui sont tous d'accord pour affirmer que le blues existait déjà, en tant que forme constituée, avant leur naissance et ce depuis longtemps. Ce qui remet à sa juste place chronologique, l'invention officielle du blues par W. C. Andy né en 1873.
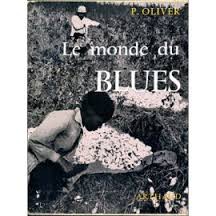
Le blues provient de l'esclavage comme le blé de sa semence. Il naît de la souffrance accumulée, de l'exil tout autant intérieur qu'extérieur, de cette déculturation accélérée que subirent les premiers esclaves ravalés au rang de bête de somme. Peut-être vaudrait-il parler de déshumanisation. Le blues naît à côté de l'évangélisation. En dehors des églises et des congrégations. Il est tout de suite reconnu par ce que l'on ne peut pas encore, vu son éparpillement géographique appeler la communauté noire, comme la musique du péché. Pas sciemment. Ce sont toujours les autres qui vous définissent comme un rebelle. L'esclave chante naturellement comme l'oiseau sur sa branche. C'est un moyen de communiquer avec les autres. De faire circuler des messages que les maîtres ne doivent pas saisir. Marmonnement des peines quotidiennes et cris d'appel, les hollers seront autant des cris de rage sourde que d'affirmation de soi.

La fin de l'esclavage ne sera pas le radieux matin espéré. L'esclave est libre. Il change de statut, il endosse un costume de torture nouvelle : du jour au lendemain il est devenu un pauvre. Dans le Sud on lui fera payer très cher sa pauvreté. L'on peut rester ou devenir riche sans posséder un seul esclave mais sans pauvre qui accepte de travailler pour une bouchée de pain, ce n'est pas possible. L'exploitation éhontée de son semblable est la condition sine qua non de création de richesse en économie libérale de capitalisme avancé. Les noirs pauvres possèdent un double avantage, ils acceptent de bosser pour encore moins cher que les blancs pauvres. Du coup cette catégorie sociale s'en trouve rehaussée : leur standing n'augmente pas d'un cent, mais il y a désormais plus pauvre qu'eux. La white trash people – vous traduirez par la saloperie blanche, car c'est ainsi qu'on désignait les basses classes – acquiert un subtil statut de quasi-gentry. Fauchés comme les blés certes, mais d'un niveau ontologiquement supérieur à ces maudits nègres, puisque blancs. De la couleur de Jésus Christ. L'idéologie raciste s'enracine très facilement dans les consciences populaires car elle vous octroie automatiquement et à moindre frais une supériorité théorique des plus flatteuses.

Attention, il ne faudrait pas que les choses changeassent trop vite. Tout sera fait pour maintenir les noirs dans une misère docile. Un bon nègre est un nègre qui travaille. Tous les autres n'ont aucune utilité sociale. Qu'ils disparaissent au plus vite. Qu'ils ne se fassent pas remarquer, qu'ils descendent du trottoir quand ils croisent une blanche femelle, que leurs gamins ne reçoivent aucune éducation, qu'ils se calfeutrent dans leur taudis, et même mieux qu'ils n'habitent nulle part, qu'ils errent loin de nos yeux, la police qui veille sur la sécurité des citoyens intègres aura ainsi l'occasion de les arrêter pour vagabondage. Une manière des plus légales pour s'adjuger une main d'oeuvre gratuite pour construire des routes, ensemencer les champs et consolider les digues. Beaucoup de travail et peu de nourriture, ces maudits nègres n'en finissent pas de rendre l'âme un peu trop promptement.

Dans le nord c'est un peu mieux. Mais pas beaucoup. Les usines ont besoin de beaucoup de bras, aussi les salaires sont-ils un peu plus élevés. Mais à la première récession on licencie d'abord les ouvriers noirs. Charité bien ordonnée commence toujours par les blancs. Lorsque viendra la grande crise, je vous laisse imaginer la panade dans laquelle se retrouveront les noirs...
INTERIORITE DU BLUES

Le blues vient du dehors mais il germe à l'intérieur. Il est la résultante de toutes les humiliations endurées depuis l'enfance, c'est le seul héritage que vous transmettent vos parents. Jour après jour la société vous rappelle à vos limites. Ce ne sont pas des couleuvres que vous avalez mais des anacondas géants. Certains s'étonnent que le blues n'ait véhiculé que très très peu de chant de révolte. Entre parenthèses, remarquons que de l'autre côté des péquenots blanc, le répertoire country n'est pas une pépinière de chants de colère. Ce qui est sûr c'est qu'un sale nègre n'avait pas intérêt à l'ouvrir en grand et tout haut. Valait mieux miser petit. Viol, pendaison, torture, meurtre, castration, brûlure, accident, éviscération, les policemen fermaient les yeux sur tout ce qui pouvait vous advenir. De toutes les manières c'était obligatoirement vous qui étiez en faute. Pour les blanc la justice faisait sans cesse preuve d'une magnifique compréhension, d'une indulgence sans limite... Le blanc n'est-il pas la couleur de l'innocence ? N'est-ce pas la Bible et Dieu qui l'affirment.

Le blues sera goguenard. Avance à mots couvert. Comme les légionnaires romains sous la carapace des boucliers de la tortue. L'on proclame une chose. Une fois. L'on se hâte de la répéter. Deux fois. On explicite quelque peu. Pas beaucoup. Et pif, l'on jette le contraire. Vite fait, bien fait. Une moitié de vers, un hémistiche maigrelet, pas plus. Vite l'on revient à ce que l'on était en train de dire. A vous de comprendre. De saisir l'essentiel du message. Ne vous trompez pas, ne tombez pas dans le panneau. Une vieille habitude de ne jamais crier la vérité haut et fort, de ne jamais répondre clairement ce que l'on pense. Parler pour soi. S'adresser à soi-même. Nettement suffisant. Evidemment vos congénères vous comprennent. Agissent de même. Connaissent toutes les ficelles. Pas besoin d'en écrire aussi gros qu'un dictionnaire. Quelques mots soulignés par ce qui pourrait passer pour un sourire idiot. Les nègres sont toujours contents. Oui missieu, bien missieu. A croire qu'ils n'ont jamais appris à dire non. Ce n'est pas de leur faute, les pauvres ils appartiennent à une race si inférieure.
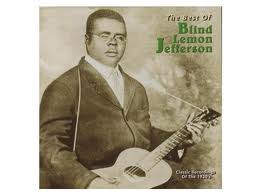
Le blues du désespoir, et le sourire aux lèvres. Très sarcastiques. Mais pour en sentir la cruauté, il faut être au courant. Ce sont des mots qui ne s'élèvent jamais au-dessus de la réalité qu'ils décrivent. Le blues est par essence naturaliste. Parfois vous lisez les paroles et vous ne comprenez pas de quoi ça cause. Quelle est la situation de départ ? Vous faut relire quatre ou cinq fois mais les phrases vous paraissent obscures. C'est un rien déroutant. Vocabulaire d'une extrême simplicité, construction des phrases des plus banales, et vous n'y entravez que couic. Le réalisme rural d'une nouvelle de Maupassant aussi difficile à décrypter qu'un sonnet de Mallarmé. La musique aide et dévoile des intentions enfouies, mais dans le livre sans le jeu musical qui vibre et colorie, le blues est d'une teinte foncée.

Notons le défaut majeur du bouquin : beaucoup de paroles traduites mais peu de textes attribués. L'on ne sait d'où ils proviennent, qui les a interprétés et enregistrés. Difficile à situer, d'autant plus qu'en leur grande majorité ils ne sont ni donnés en langue originale, ni attribués.
EXTERIORITE DU BLUES

C'est une histoire sans fin que raconte Paul Oliver. Pas de porte de sortie. Et celles du paradis sont fermées pour toujours. Nous conte un enfermement. La tour d'ébène dont nul ne s'échappera. Le peuple noir semble livré à un malheur irrémissible. Oliver n'a pas senti les craquements, la sourde colère qui se levait dans les ghettos. Toute révolte lui paraît d'emblée vouée à l'échec. Prononce un réquisitoire implacable à l'encontre de la société américaine, mais il dénie à la collectivité noire la possibilité de s'émanciper par une lutte radicale. Reste le nez trop près de son sujet. Nous peint une situation terrible, une analyse digne des marxistes les plus chevronnés, la sujétion des noirs en tant que guerre de classes. Mais il laisse soigneusement de côté l'aspect prophétique et révolutionnaire d'une telle description. De même il n'aborde pratiquement jamais les circonvolutions que le Capital est prêt à opérer pour circonscrire toute problématique porteuse de désordre. Il parle de classe noire aisée mais ne pousse pas le projecteur sur l'émergence d'une économie noire et d'une bourgeoisie noire ( Obama en étant un de ses représentants les plus notoires ) déjà en voie de constitution dans les années cinquante. De même il passe sous silence l'émergence d'une intelligentzia noire qui de Richard Wright à Langston Hughes a beaucoup oeuvré pour la reconnaissance culturelle du blues par les élites blanches.
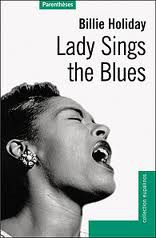
Le livre narre une histoire qui n'est pas encore terminée mais dont nous connaissons la suite. Il n'est pas rare de lire dans de récentes interviewes de blues(wo)men actuels comme Shemekia Copeland reconnus par certains pour être les plus intègres continuateurs du genre que le blues d'aujourd'hui ne saurait avoir une force d'expressivité aussi forte que celle produite par les grands ancêtres. La condition des afro-américains s'est considérablement améliorée depuis les temps héroïques reconnaissent-ils. Il reste encore beaucoup à faire se dépêchent-ils d'ajouter même si le plus dur est derrière eux. Le blues n'est plus soumis aux mêmes pressions sociales, il est déserté par les jeunes noirs qui le jugent pleurnichards et lui reprochent son manque de fierté. L'a été récupéré par les petits blancs européens, les fils adolescents gâtés et pourris de la middle class occidentale. L'ont transformé, l'ont électrifié à outrance, l'ont dévergondé, l'ont hard rocké à mort. Incapables qu'ils ont été de créer leur propre musique, leurs propres formes de rébellion. Cet épisode nous concerne de près, et nous ne sommes pas prêts d'en voir la fin.

Quoi qu'il en soit, Le Monde du Blues est un beau livre qui ne peut que passionner les amateurs de rock'n'roll. Ce damné bâtard du blues. Qui a parfois du mal à reconnaître son père.
Damie Chad.
01:43 | Lien permanent | Commentaires (0)
05/06/2014
KR'TNT ! ¤ 192 : GOMMARD / DATSUNS / LOREANN' / PATRICK EUDELINE / LAURENT CHALUMEAU / HOMESMAN
KR'TNT ! ¤ 192
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
05 / 06 / 2014
|
GOMMARD / DATSUNS / LOREANN' / PATRICK EUDELINE LAURENT CHALUMEAU / HOMESMAN |
MONTREUIL / 31 / 05 / 14
CROSS DINER / LE GOMMARD

Le grand Phil exulte, sa place au carrefour juste en face du centre commercial est encore une fois libre. Réservée par le préfet qu'il dit. On n'ose pas émettre des doutes car l'on est tout heureux de n'avoir pas à remonter trois kilomètres d'avenue à pieds. Autant lui laisser ses illusions jusqu'à la prochaine fois. Car l'homme vit davantage de rêve que de pain. Phrase due à la plume de je ne sais plus quel affameur du peuple.

Le temps de traverser la route et nous effectuons une entrée remarquable et remarquée – remarque toute subjective, les rockers c'est comme la bière, ça aime bien se faire mousser – dans le Cross Diner. Point trop de cats à l'horizon, normal, le Gommard finit de peaufiner sa balance, l'est donc encore tôt, mais le vieux réflexe atavique s'est encore une fois de plus vérifié, il est vrai qu'en règle générale les chats n'aiment pas les chiens. N'essayez pas de me contredire en m'assurant que votre siamois et votre pitbull dorment dans la même panière, ce n'était pas l'énonciation strictement zoologique d'une étude sur le comportementalisme animalier, mais une simple réflexion sur le fait que les publics rock ont du mal à se mélanger. Les amateurs de rockab ont tendance à déserter les groupes garage heavy blues punky rock ( appellation incontrôlée ), mais vous pouvez inverser les termes de l'équation sans problème. Cherchez l'erreur. Les tribus indiennes qui s'adonnèrent à ces dérives par trop identitaires en subirent les terribles conséquences.
Pour les malheureux qui n'auraient pas lu la cent quatorzième livraison de KR'TNT du 18 / 10 / 12, recension du livre IWW. Wobblies & Hobos de Joyce Kornbluh paru aux éditions de L'Insomniaque, et agrémenté d'un CD de chants de luttes sur lequel le Gommard interprète magnifiquement six titres gorgés de sèves rebelles, qu'à l'origine le caoutchouteux sobriquet Gommard désignait le chien d'Eric le batteur, qui s'en est allé rejoindre son frère Cerbère dans les Enfers toujours pavés de mauvaises intentions comme dirait Robert Johnson... Ne me reste plus qu'à citer la phrase définitive que Karen chargée de la programmation me glisse à l'oreille : « Le Gommard, c'est simple, c'est le meilleur groupe de Montreuil ! », alors les narvalos si vous n'avez pas compris que ce soir ça va saigner, allez vous faire soigner ailleurs.
KNOCKIN'...

Faut toujours un point noir dans la blancheur immaculée du Yin, le bonheur pourrait être parfait mais ce soir le destin aux ailes de fer rouillé s'est abattu sur Eric. Privé de concert, la première fois en sept ans que je ne suis pas sur scène, vient-il se plaindre. Accident de scooter, l'épaule recouverte d'une attelle-couffin aussi grande que l'Amazonie, l'a dû laisser sa place à un remplaçant, Yann. Mais pas question pour Eric de se coller sur une banquette et de regarder le train passer. Tourne autour du groupe comme un vol de vautours affamés qui accompagne le voyageur égaré dans le désert de la mort. N'a plus qu'un bras mais cela ne l'empêchera pas de jouer d'une batterie virtuelle, et de prouver geste à l'appui que réflexes intacts, il connaît tous les breaks au centième de seconde près, prévenant même un peu à l'avance Yann des plus surprenantes brisures de rythmes sur des morceaux trop vite répétés. Cinq sur scène, plus un coeur fou qui bat encore plus vite que les autres, à côté. Knockin' On The Heaven Door, jamais la formule de Dylan n'aura été aussi appropriée que pour ce batteur tapant sur la peau d'invisibles toms qui de toute la soirée ne se matérialiseront pas, malgré l'envie folle qui le tenaille.
PREMIER SET
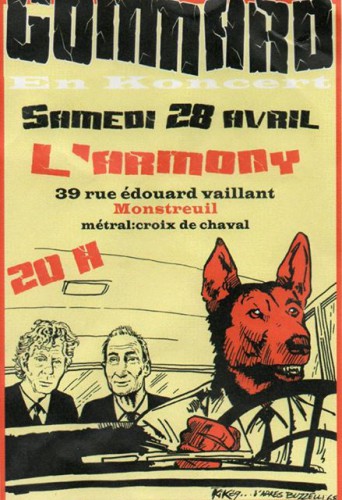
Dirty Water, vous annoncent la couleur tout de suite. Le Gommard ne donne pas dans l'azur cristallin. Ca cogne, ça plombe, ça rocke et ça rolle sans ambages. Viande bleue et blues saignant, de l'indigo et de l'outremer, c'est du foncé tout droit, et rien ne l'arrête. Quatre mesures et le public se presse devant l'orchestre. C'est du foncé défoncé. La lourdeur du blues et la rage du rock. Pas évident d'obtenir un tel alliage. Le Gommard y parvient d'instinct. Musique de rebelles. Le rock comme la mélodie de tous les massacres à venir.

Kik le grand est au micro. Malgré le volume sonore, la voix reste claire et vindicative. Un chanteur, un vrai qui impulse le mouvement qui donne la direction à suivre et qui caracole sur les puissantes ondes dégagées derrière lui. Possède sa boîte à trésors dans laquelle il s'en va ferrailler le temps d'en extraire son sabre de cavalerie, un harmonica à la tonalité souhaitée d'une dizaine de centimètres de long, mais quand il le colle à son micro qu'il referme sa main dessus et qu'il se met à souffler dedans l'on a l'impression que les eaux du Mississippi vous tombent en cataracte sur le dos.

L'est méchamment aidé par les deux guitaristes. Pierrot et Bob. Au début j'ai distribué les rôles, un rythmique et un soliste. Mais en fait c'est plus compliqué que cela. Deux solistes, mais qui ne jouent pas ensemble. Ou plutôt pour bien faire comprendre la subtilité de l'approche, deux solistes qui jouent ensemble mais chacun son solo. L'un qui appuie sur la règle et l'autre qui souligne à côté.

Honneur à Pierrot, cheveux gris et casquette plate, petit gabarit chétif, recroquevillé sur sa Gibson, concentré au possible, n'aime rien tant moins que de s'embarquer dans des chevauchées solitaires. Deux pédales à effets spéciaux à ses pieds, et c'est parti pour une tonitruante cavalcade. Les autres sont groupés et avancent du même pas, mais lui il se déplace sur les ailes pour effectuer d'improbables razzias, il apporte ce grain de folie sans lequel le rock est une plante morte qui n'a pas reçu l'eau nécessaire à sa survie. Parfois un peu desservi par la sono qui mange ses effets mais chaque fois que je le sens prêt à prendre la poudre d'escampette je laisse une oreille pour l'écouter et le suivre dans de chaotiques circonvolutions qui me ravissent.

De l'autre côté c'est le contraire. Max, géant débonnaire lui aussi sur Gibson, mais un tout autre jeu, beaucoup plus discipliné. Fidèle au poste et sans cesse attentif. Toujours là quand on a besoin de lui. Joue le rôle du renfort, l'apport décisionnel qui emporte le morceau et le bascule dans un bain de fièvre et de tourmente. Et plus la soirée s'avancera plus ses interventions gagneront en poids et en force, mais aussi en rapidité. Un oeil sur l'harmonica et un autre sur la basse de Bob. Enfin cette dernière il n'a pas vraiment à la surveiller, se présente d'elle-même, la troisième guitare solo de la soirée, à part qu'elle elle ne se repose jamais entre deux interventions. Flot continu de notes grasses et dodues, rallonge la sauce et la fondue; l'épaissit merveille. La noire pesanteur du blues incarné, mais avec cette vélocité adjacente qui est un peu la marque du Gommard.

Attention le blues rock du Gommard ne ressemble en rien au blues compatissant de petits blancs qui font acte de contrition et qui mendient leur pardon à l'on ne sait trop qui, c'est un blues rock de colère et de rage, des titres comme Wich Side Are You On ou le Rebel Girl de Joe Hill sont là pour rappeler que rien ne s'obtient sans la lutte. Le drapeau blues du Gommard est tâché du rouge sang des exploités. De tous pays, qui ne se sont pas encore unis.
De Love Potion N° Nine des Coasters au Going Back Home du bon vieux Dr Feelgood le Gommard décline toute une histoire du rock des racines noires aux rebellions blanches.
DEUXIEME SET
Démentiel. Le Gommard revient en force. Mettent la gomme avec L'Homme A La Moto qui n'est pas une originale d'Edith Piaf comme tant le croient mais une adaptation de Leiber and Stoller que le Gommard doit bien aimer puisqu'ils auront repris durant la soirée trois de leurs titres. Sixteen Tons de Merle Travis et Rusty Cage de Johnny Cash ( via Soundgarden ), le Gommard est décidément près des racines, comme par un fait exprès suivi de Preachin' The Blues de Robert Jonhson. Que du beau monde, mais le tout est distribué avec l'estampillage Gommard, asséné avec violence et énergie. La foule ondule salement. Beaucoup de borderlines, de ces individus qui vont jusqu'au bout de leurs délires et de leurs fièvres. La musique du Gommard vomit les tièdes.

Le combo tangue méchant. Yann s'enhardit, il se permet de quitter la binarité salvatrice de la caisse claire qui vous maintient sur la piste et vous empêche de vous égarer, mais un tantinet trop mécanique à la longue, pour des passes un peu plus alambiquées. Dédaigne un peu trop les toms mais instaure un effet de volume inspiré en tapant sur les cymbales. Kik est infatigable, pas une seule fois ne faiblit sa voix, et en plus il prend soin de son petit monde, indiquant de la main les baisses de tonalité et les reprises fulgurantes. Il demande à Eric de prendre un micro pour se charger des choeurs ( et plus si affinités ). Eric possède une voix superbe très sixty, qui me laisse admiratif. Mais déjà le groupe se surpasse sur Teenage Head des Flamin' Groovies – faut être sacrément sûr de soi pour taquiner ce genre de rhinocéros féroce – que Kik dédie à tous les adolescents attardés. Belle métaphore du public rock d'aujourd'hui. Un peu triste aussi quand on y pense. Mais la fureur du groupe sur Y'a du Baston Dans La Taule dissipe très vite les mélancolies qui voudraient pointer leur nez. Le titre est devenu l'indicatif de l'émission L'Envolée de Fréquence Paris Plurielle sur les prisons... A sa manière le rock du Gommard dégomme le système.

TROISIEME SET

Ce devait être un dernier morceau pour la route, un apéritif de fermeture en quelque sorte. Ils ont eu beau faire traîner Mustang Sally en passant le micro à tout le monde pour le refrain, personne n'a voulu leur céder le passage pour qu'ils puissent regagner le bar. Remarquez cette douce violence ils y ont cédé rapidement, tout heureux de nous refiler quatre petits rabes en plus. A la fin, ils étaient crevés mais Kik et Pierrot nous ont offert une petite dernière - exigée à haute voix par des fans décidés à avoir leur petite gâterie habituelle coûte que coûte - pratiquement a capella, sur fond d'un de ces solos charbonneux qui vous consument l'âme dont Pierrot a le secret.

Beau concert. Je ne connais pas tous les groupes de Montreuil. Mais Karen avait raison, ce soir ils étaient les meilleurs.
Damie Chad.
( Les photos prises sur leur facebook ne correspondent pas au concert du 31 mai. )
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 17 - 05 - 14
LES DATSUNS
LES DATSUNS NE SONT PAS DES VOITURES

Très mauvais souvenir du concert des Datsuns à la Boule Noire en 2006. Ça bâillait aux corneilles dans les premiers rangs. On voyait les frères Dalton du garage néo-zélandais faire leurs hystrionics sur scène et on ne savait pas s’il fallait rire ou pleurer, tellement c’était cousu de fil blanc. Ils nous resservaient toutes les ficelles de marabout des seventies, du sous Led Zep et de la petite blague à la Free, du pattes d’eph et de la chevelure dans la figure.
Il devait y avoir erreur ce soir-là, car on était venu voir un groupe garage dont le premier album tenait bien la route. Christian Datsun, Dolf De Datsun, Matt Datsun et Phil Datsun s’étaient glissés dans le revival garage de l’an 2000, avec les Strokes, BRMC, les Hives, les White Stripes, les Von Bondies, les Yeah Yeah Yeah, Jet, les Vines, D4, les Libertines, les Kills, les Lords of Altamont et des tas de groupes scandinaves comme les Flamin’ Sideburns, les Gluecifer et les Turbonegro. On ne savait plus où donner de la tête. Côté concerts, c’était de la folie. Et puis, le NME en rajoutait des caisses, vantait les mérites de tous les disques et faisait souvent sa une avec des photos fantastiques de Dolf De Datsun, en posture acrobatique avec sa basse Firebird.
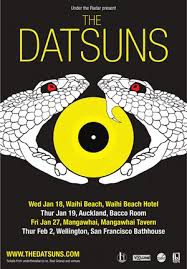
Il ne reste pas grand-chose de cette vague. Seuls les meilleurs ont survécu. Les Dirtbombs, les Black Lips et Wild Billy Childish sont toujours fidèles au poste. Et bizarrement, les Datsuns aussi, alors que personne n’aurait parié un seul peso sur leur capacité à traverser les années. Surtout en jouant un garage limite de ce qu’on appelait avant le rock high energy, un genre difficile qui en a ratatiné plus d’un. Franchement, on ne voit pas comment les Datsuns vont pouvoir continuer à ruer dans les brancards, comme ils le font depuis un peu plus de dix ans.

Leur premier album à pochette blanche est sorti en 2002. Il plut beaucoup aux amateurs. Sur dix titres, six étaient excellents. Ils démarraient avec «Sittin’ Pretty» et un gros enroulage riffique doublé d’un chant perché au sommet du rouleau. Ils sonnaient comme une mer déchaînée. Ils nous sortaient de la manche un blast boogie punk spontané, et on se régalait d’une telle ferveur. Cris, solos, toute la panoplie était au rendez-vous avec la lune, et le soleil était là aussi. Ce disque s’imposait comme un gladiateur vainqueur. On retrouvait cette exemplarité sonique dans le morceau suivant, «MF From Hell», chant perché d’intro et cocotage repris par le gras du riff. Leur truc était cousu de fil blanc américain. À l’époque, tous les groupes à gros bras tatoués sortaient ce son. C’était donc du sans surprise, avec des accidents rythmiques prévisibles. Pur seventies sound et le problème, c’est qu’avec les albums suivants, les Datsuns allaient s’enfermer dans ce son et s’y éteindre petit à petit.
«Lady» était bien drumbeaté, un brin heavy, un vague caractère de pépite. On les sentait affamés d’innovation. On voyait cette belle pièce se balancer sur un riff glissant. Les Datsuns arpentaient la foire à la saucisse du garage et s’amusaient du moindre riff. Ils nous faisaient le coup du solo en coin salement killer et amené de travers. Stomp d’intro pour «Harmonic Generator» et ils allaient chercher l’effet glam. Choix judicieux. On avait en prime des sales petites choristes malveillantes. Et ils nous tenaient en haleine tout au long du cut. Avec «What Would I Know», ils sonnaient comme Nashville Pussy et lançaient des assauts d’accords annonciateurs des pires exactions. Dans d’autres morceaux comme «At Your Touch», ils révélaient une tendance à singer AC/DC et ça sentait un peu la fin des haricots. Ils revenaient à un son plus proche de celui des Hellacopters pour «Fink For The Man», embarqué au blast. On y retrouvait tous les avantages du bon blast, la pression continue, les reprises impossibles, la glotte sanguinolente, les petites flammes crachées par les amplis, le pulsatif rythmique, le solo qui bande comme un âne et tout le folklore béni par certains, et honni par d’autres. Ils fonçaient comme le train fou qui avait déjà brûlé tout son charbon et nous offraient le spectacle ahurissant d’un joli break de calme shakespearien porté par la basse de Dolf. L’autre grosse pièce de cet album était «You Build Me Up (To Bring Me Down)», sleazy et troué de breaks sublimes, dans la veine du trash-punk blues de Jon Spencer et ils terminaient avec une autre énormité, «Freeze Sucker» dotée d’un gros refrain condescendant.
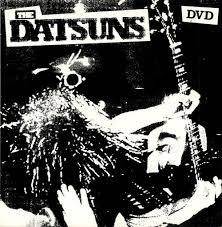
Deux ans plus tard sortait leur deuxième album, «Outta Sight Outta Mind». Avec un titre pareil, on pouvait s’attendre à un gros délire psyché, d’autant que la pochette, dans les tons hallucinatoires, les montrait de dos, s’enfonçant dans la forêt. Sur les trois premiers morceaux, on retrouvait la grosse débauche énergétique, le chauffage à blanc et le riffage alambiqué censé donner du souffle, mais il manquait l’essentiel : l’inspiration. On pouvait classer les Datsuns dans la catégorie des braves soldats du garage dont personne n’allait se souvenir après la bataille, même s’ils avaient vaillamment combattu et bien éclairci les rangs ennemis. Ils renouaient heureusement avec la réussite au quatrième morceau de l’album, «Messin’ Around», joué en boogie. On entrait toutefois dans les limites du genre. Ces kiwis savaient chauffer une salle, mais leur style composital restait trop comprimé. Avec ce morceau, ils se montraient dignes des Status Quo et ils parvenaient à forcer l’admiration. Dolf hurlait comme une sorcière de Walt Disney et un petit solo de wha-wha arrivait comme un charme. Ils revenaient dans le sillage des Hellacopters avec «Get Up (Don’t Fight It)», un morceau monté sur un riff de guitare. Finalement ce n’est pas si compliqué de monter un groupe comme les Datsuns : il suffit d’avoir le copain qui passe son temps à bricoler des petits riffs bien percutants sur sa guitare et puis on monte là-dessus des textes de circonstance. Avec ce morceau, on est dans cette configuration. Compo de salle de répète, sans idée harmonique. Et donc, avenir incertain. Il est rare qu’un riff ordinaire fasse date.

Petit coup d’exotisme avec «Hong Kong Fury», grosse intro admirable et balancement rythmique. On naviguait dans les mêmes eux que «Bangkok». On adorait ces virées en extrême-orient. Les Datsuns nous traitaient ça au goudron. C’était du salace et du bien garni, avec un solo glou-glou versé sur le riffage chinoisé. Quand on se retrouve face à un groupe comme les Datsuns, il faut savoir se montrer patient et tolérant. On finit toujours par être récompensé. «You Can’t Find Me» se retrouvait sous pression dès l’intro, et puis ça devenait le morceau intéressant de l’album, car ça pulsait bien et on plongeait dans un délicieux marécage de chœurs de folles, c’était encore une fois très bien vu et l’ami Christian décochait un solo sonique droit dans l’œil de la lune de Méliès.

En gros, les Datsuns mettent deux ans à préparer un nouvel album. «Smoke & Mirrors» est donc sorti en 2006, dans la plus totale indifférence. Les amateurs de garage ont fini par lâcher prise, sentant que le groupe tournait en rond. Et puis ce concert à la Boule Noire scella en quelque sorte leur destin. Tout le côté excitant du premier album s’était volatilisé. Leur seule chance de survie était d’aller sur le glam ou le boogie, c’est-à-dire de jouer la carte de l’efficacité. Ils devaient absolument éviter ces compos ambitieuses qui retombent comme des soufflets et qui furent l’apanage de la grande majorité des groupes des seventies.
Justement, on trouve deux morceaux intéressants dans «Smoke & Mirrors». Un stomp et un glam-rock. Comme son titre l’indique, «Who Are You Stomping Your Foot For» est un stomp, et même un bon stomp. Voilà une belle pièce de garage à cheval sur les époques, à la fois classique glammico-speedo et enlevée à la hussarde d’orgue battant. On sent bien que les Datsuns sont remontés à cheval car leur pounding est d’une puissance irrationnelle. C’est véritablement un morceau de batteur. Voilà ce qu’on appelle un train d’enfer, chez les cheminots de Sotteville. Cette belle pièce allongée et athlétique, suave et luisante, file sur l’horizon comme une balle perdue. Mais les morceaux suivants tournent assez mal, on va du Cockney Rebel au balladif atroce. Le riff de «Maximum Heartbeat» ne fait pas le moine. Dolf fait son Plant et Christian fait son tarabiscoteur, histoire d’épater la galerie des glaces du Palais de Versailles. Voilà un cut assez pompeux et un peu trop led-zeppien pour être honnête. Ils jouent «All Aboard» au bottleneck comme s’ils cherchaient la direction du Deep South en partant de l’étoile polaire. Du coup, ils s’égarent dans les seventies. Réveil en fanfare avec «Such A Pretty Curse», une petite pièce de garage stompée à la bonne franquette. On sent chez les Datsuns une nette tendance au glammage, ils frôlent parfois la tangente, mais ils retombent facilement dans leur passion du rock mal hurlé. Dommage qu’ils n’aillent pas franchement sur le glam, ça leur donnerait un certain cachet. Led-zepper ne leur apportera rien.

«Headstunts» accentue encore l’impression de déclin qui émane des deux albums précédents. On retrouve ce chant perché sur la montagne et ces chœurs aléatoires qui plombent les morceaux. Ils se comportent comme des gamins, ils retapissent tous les clichés du rock et il faut attendre «Highschool Hoodlums» pour retrouver un semblant de filon. Ils l’annoncent avec un drumbeat de hit à la Gary Glitter - one two three four ! - et les riffs pleuvent comme vache qui pisse. Grâce à ce coup de glam, ils retombent sur leurs pattes, et c’est stupéfiant. On les prendrait presque pour des Anglais, tant leur glam tâche bien les draps. L’autre bon morceau de l’album s’intitule «Pity Pity Please». On croirait entendre du Jane’s Addiction balayé par des vents de speedance écarlate et des remugles de wha-wha.

Leur dernier album s’appelle «Death Rattle Boogie». Ce disque malheureux illustre parfaitement ce qu’on sentait venir : la catastrophe. Pauvres Datsuns, ils se sont donné tellement de mal depuis des années pour en arriver là. À part le petit stomp de «Brain Tonic», pas un seul morceau n’est sauvable.

Tiens ! Ils viennent jouer à Rouen, alors on prend un billet. Comme bon nombre de groupes, les Datsuns donnent mieux sur scène qu’en studio. Phil arrive le premier sur scène avec sa Flying V. Il semble bien allumé. Au moins comme ça, on reste dans le folklore. Puis arrivent ses collègues Rudolf, Christian et un batteur. Ils attaquent leur set avec «Silver» - un nouveau cut ? - et «Sittin’ Pretty», tiré du premier album. En forçant une voix qu’il n’a pas, le chanteur bassman frôle un peu l’arnaque. Phil gratte ses accords mécaniquement et finalement, toute l’attention se focalise sur Christian Livingstone, le petit soliste arqué sur une Gibson Les Paul. Car tout repose sur ses frêles épaules, il enrichit considérablement les morceaux en titillant ses cordes de ses petits doigts et il réussit à injecter de la substance dans des morceaux pour la plupart désastreusement ordinaires. Sans lui, le groupe ne vaudrait pas un clou. Il multiplie les opérations de sauvetage, et vient se poster sur le devant de la scène pour poser un regard de guerrier apache sur le public docile. Ce mec dispose d’un talent avéré mais il le gaspille en essayant de sauver des morceaux mal gaulés et souvent insipides. Il place ses petits chorus de facture classique ici et là avec une ténacité qui l’honore et il finit vraiment par forcer l’admiration. Pas facile de jouer du rock seventies. L’histoire des Datsuns restera celle du groupe qui voulut led-zepper plus haut que son cul.

Signé : Cazengler qui préfère les Sun qui datent aux Datsuns
Datsuns. Le 106. Rouen (76). 13 mai 2014
Datsuns. The Datsuns. V2 2002
Datsuns. Outta Sight/Outta Mind. V2 2004
Datsuns. Smoke & Mirrors. Hellsquad Records 2006
Datsuns. Headstunts. Hellsquad Records 2008
Datsuns. Death Rattle Boogie. Hellsquad Records 2012
Sur l’illustration, de gauche à droite : Phil Sommervell, Rudolf de Borst, Ben Cole et Christian Livingstone

31 – 05 – 14 / LE CESAR / PROVINS
LOREANN'
Le temps d'avaler deux cafés brûlants. Coup sur coup. Ce n'est pas Loreann' qui est partie, mais nous. Rendez-vous d'urgence en tout début d'après-midi. Je sais c'est râlant que vous commencez à vous habituer à sa présence hebdomadaire, mais ce coup-ci c'est râpé. Comme le fromage. Consolation ultime, une superbe version de Blowin' in The Wind de Zimmerman Bob. Et il a fallu s'arracher à l'envoûtement de cette voix, pour vaquer à de vagues occupations. I don't think twice, ça me fait trop mal.
Damie Chad.
BOOKS
CE SIECLE AURA TA PEAU
PATRICK EUDELINE
( Editions Florent-Massot / 1997 )
Patrick Eudeline, j'ai des copains qui lui envoyaient des textes quand ses premiers articles ont paru dans Best, j'ai acheté le premier disque d'Asphalt Jungle le jour de sa sortie, et si je ne me jette pas avant toute autre lecture sur sa chronique mensuelle dans Rock & Folk c'est pour faire durer le plaisir, la jubilation n'en sera que plus forte, j'adore ses partis-pris et ses enthousiasmes, et son côté gladiateur qui descend dans l'arène pour ridicliser les Fauves aux dents élimés qui repartent la queue en tire-bouchon.

Il y avait tout de même un truc qui me turlupinait la teté, Ce Siècle Aura Sa Peau, son premier roman, en avoir entendu dire tant de bien et ne l'avoir jamais lu, c'est râlant, mais il ne faut jamais douter de soi-même, tout individu possède des ressources insoupçonnées. C'est en farfouillant dans ma cave que j'ai mis par hasard la main sur trois formats quasi-carrés, vivement colorés, ah! Oui ! Les trois bouquins que j'avais pris chez le bouquiniste pour les images sur la couverture. Et là mes yeux se dessillent, Car en bas ! Triple bus en haut ! comme disent les mexicains, dix ans que ça traîne sur les étagères et je réalise aujourd'hui que parmi ces trois incunables rock se trouve Ce Siècle Aura Ta Peau de Patrick Eudeline, certains jours l'on porterait soi-même sa tête recouverte d'un papier cadeau au bourreau.
Lorsque je remonte à l'étage avec mes précieux trophées la copine qui endosse à tout bout de champ le rôle de George Sand y va de son commentaire littéraire : « Qu'est-ce que c'est ! Ah ça rappelle Les Confessions d'un Enfant du Siècle de Musset ! », c'est exactement cela, poupée, lui répondé-je au petit-dèje, mais au temps du romantisme l'amour s'éclairait à la bougie, ici il marche à l'électricité, direct live branché sur le secteur. C'est de l'Eudeline haute tension. N'y mets pas la patte, tu risquerais de te brûler.
VINCENT & MARIE
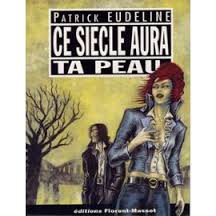
Comme Frankie and Johnny, l'ange noir et l'oie blanche à qui le bon dieu s'est donné sans confession, question annonciation symbolique au moins dès le début l'on sait que ça va mal se terminer, difficile de faire pire. Pour le décor c'est facile, les quartiers les plus pourraves de Paris du dix-huitième le plus craignos au Père Lachaise. Le cimetière c'est le point de mire et d'arrivée, mais ça vous l'avez déjà compris. Attention aux cartes postales chromatiques, ce n'est pas le Paris populaire bon enfant des années trente, Hôtel du Nord et Front Populaire. C'est le Paris de la débâcle, ni celle de 1870, ni celle de 1940, celle d'une autre génération, post-punk, post-eighties, appelez-la comme vous le voulez, de toutes les façons elle ne diffère en rien des autres, de toutes celles qui l'ont précédée, elle est perdue corps et bien.
Mais lorsque débute le roman il reste encore les corps. Celui du héros et de l'héroïne. Les temps sont durs. Si c'était de la poésie, Marie serait une épave baudelairienne et Vincent serait le manteau noir que Gérard de Nerval a transbahuté sur ses épaules les vingt dernières années de sa vie. Deux paumés, deux débris qui se cramponnent et s'agrippent aux petites branches du renoncement ou de la survivance pour ne pas basculer dans le vide abyssal que la vie a creusée sous leurs pieds.
Ne sont pas tous seuls. Sont les représentants d'une époque, d'une jeunesse où tous les rêves de grandeur étaient permis. La dope et le rock'n'roll coulaient à flots. Le fleuve semblait intarissable. La révolution culturelle que rien ne saurait arrêter. A part l'inertie des masses qui s'abreuvent sans fin aux mamelles de la pétoche sociale et de la variétoche nationale. Bref des laisser-pour-compte. Un plateau de télé pour les plus chanceux, distribution de coups de pieds au cul pour tout le monde. Le système ne fait pas de jaloux. Vous oublie plus vite que la prochaine mode.
Accrochez-vous à vos petites combines merdiques, maquez-vous, prostituez-vous, couchez à l'hôtel de la rue qui caille, avalez des médicaments de substitution, dépêchez-vous de disparaître. Pour Marie et Vincent, l'avenir est tout tracé. Il n'y en a pas. A part que, guigne amère sur le gâteau de merde, tombent amoureux au premier clin d'oeil.
INTERMEDE
Je dis amoureux et tout de suite vous entendez les petits oiseaux qui font cui-cui, et vous repeignez le décor en rose. C'est vrai que c'est cuit et que c'est rosse, mais vous vous trompez de vocable, le terme le plus important c'est tomber. Plus dure sera la chute et rien ne l'arrêtera. Deux gros câlins et puis plus rien. Vous épargne les détails. Soyez voyants mais pas voyeurs. Sachez regarder au travers de la chair les affres d'une société mortifère. Vincent et Marie font davantage mumuse avec Thanatos qu'avec Eros.
BEAUTIFUL FRIENDS
The end. Je vous avais prévenu, ce serait court. Trajet sans surprise. Le rock'n'roll ce n'est pas toujours le strass, le glam et les paillettes. Pour quelques élus peut-être. Mais pour le gros des troupes c'est un peu le miroir aux alouettes, les illusions perdues et la fosse commune.
Zoui mais. Car il y a un mais. Pas un joli mois de mai où l'on fait tout ce qui nous plaît, mais quand on y réfléchit bien les cendres froides du phénix sont aussi la preuve de son immortalité. Rien n'est définitivement perdu quand tout est foutu. Attention, pas le coup de la rédemption. Les christ qui vous promettent des monts et merveilles, on en rencontre à tous les coins de rue. Et Patrick Eudeline balaiera vos derniers espoirs sans pitié. Tuez le Christ il reste encore à avaler les épines. Genre de nourriture terrestre qui ne vous conduit pas au septième ciel.
Après l'amour, la mort. Mais après la mort ? Nos deux personnages ont trop erré dans le dédale des ruelles du septième cercle de l'enfer parisien pour croire à la possibilité d'un paradis. Mais à deux, quel que soit le prix à payer, si l'on a pris deux billets aller, l'un des deux héros ne peut-il se servir de l'un des deux sésames pour revenir à son point de départ. N'est-ce pas une manière, tel le doux Gérard, de traverser deux fois vainqueur l'Achéron ? Pour peu de temps sans doute, car la Camarde n'aime pas les resquilleurs, les petits malins qui descendent à l'avant-dernière station pour ne pas payer le prix fort. Quelques heures seulement, mais assez pour atteindre au moins une fois l'absolu, en allant jusqu'au bout du désir d'absolu.
Après, plus la peine d'en parler, l'hypothétique déchet n'a plus d'importance.
Un roman magnifique. Foutrement rock'n'roll.
Damie Chad.
UPTOWN
LAURENT CHALUMEAU
( Editions Florent-Massot )
Deuxième livre de la collection. Même type de couverture genre cacatoès réussi. Sorti aussi en 1997. Chez Florent-Massot on lançait la collection. De poche, mais un peu chère. Prohibitif pour bourse plate. Pas étonnant que ça n'ait pas marché. Visait un public assez étroit. Style lectorat Rock & Folk. Comme par hasard c'est dans cette revue que Laurent Chalumeau a publié son premier papier. Les Editions Florent-Massot ont dû changer maintes fois le fusil d'épaule. Débuter en 1994 par Baise-moi de Virginie Despentes était un coup de maître, pardon de maîtresse, pour douze ans plus tard produire Patrick Sébastien indique assez bien l'infléchissement d'une trajectoire passée sous la coupe de la grande distribution et l' assujétissement commercial au goût du plus grand nombre. Les Editions Florent-Massot fermeront en 2012.
Uptown est un recueil d'articles parus dans Rock & Folk et L'Echo des Savanes entre 1984 et 1989. Laurent Chalumeau sait de quoi il parle, durant sept ans il a sillonné aux frais de la princesse – en l'occurrence l'émission Marlboro Music diffusée sur les Radio-FM – les States en long en large et en travers. Plus tard, une nouvelle fois associé à Antoine de Caunes – il batifolera dans Nulle Part Ailleurs sur Canal +. Nous avons dans KR'TNT ! 84 du 02 / 02 / 12 chroniqué son réjouissant roman Bonus qui date déjà de l'an 2000.
NEW YORK – NEW YORK
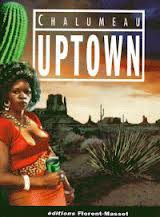
Uptown commence à New York et finit à New York. Des plages de Coney Island aux alentours de la 150° Rue. Cette dernière limite, imprécise et extensible. Mais le mieux c'est de ne pas s'attarder dans la grosse pomme. Le ver est toujours dans le fruit. Un petit tour à la campagne ne nous fera que du bien. Attention nous emmène dans des endroits pas folichons, genre pénitenciers et réserves indiennes, pour les amusements c'est rodéo et billards. Un peu western, un peu film des années cinquante. Pas spécialement rock – même si l'on y croise Johnny Cash, Bruce Springteen et Phil Spector, mais l'Amérique telle que toute une génération de gamins français a pu l'appréhender dans les films qui passaient à la télé le dimanche après-midi.
Années 80, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, le Viet-Nam, le crack et le sida sont passés par là. N'en parle pas. Mais le rêve américain s'est évaporé. Société qui vit sur ses propres mythes qui se rétrécissent de jour en jour. Le fric a pourri beaucoup d'idéaux. Les cow-boys sont promis à un prompt chômage puisque l'on transporte les troupeaux en camion, les indiens ne résistent toujours pas à l'eau de feu, les solitaires indomptés sont arrêtés par la police et jetés en prison, que vous portiez vos guêtres dans le Sud ou dans l'Ouest, vous risquez d'être déçus. N'y a que les gros affairistes et les petits trafiquants qui subsistent. Le dernier des hommes prophétisé par Nietzsche prolifère. Cette race dégénérée a envahi tous les comtés. Vous n'y échapperez pas.
Uptown c'est un anti-Kerouac. Nul besoin de psalmodier on the road again. Pourquoi aller si loin pour rencontrer de telles décrépitudes ! Cela n'en vaut pas la peine. Si vous venez d'acheter votre billet pour l'Amérique, revendez-le, ou mieux encore refilez-le à votre pire ennemi. Mais ne vous tirez pas non plus une balle dans la tête avec votre Smith & Wesson de collection. Vous avez un autre voyage, bien plus merveilleux, à accomplir. Qui ne vous demandera aucun effort. Pas cher, un cigare, un fond de whisky, un fauteuil et vous vous enfoncez avec suavité dans la prose de Chalumeau. Lui-même l'avoue dans sa préface, en ce temps-là il y croyait encore au rock'n'roll, à l'Amérique, et au personnage de l'écrivain, alors ses articles il les peaufinait aux petits oignons, et ça se sent, vous avez de ces clausules de paragraphes qui sont de petits bijoux d'or fin rehaussés de diamants.
C'est après, lors du retour, qu'il s'est aperçu qu'il avait perdu ses illusions. Se traite de mercenaire de la polygraphie. Se passe en quelque sorte au Chalumeau de la dérision et de la lucidité. Vous n'êtes pas obligé de lui accorder créance jusqu'au bout. L'a su garder une honnêteté intellectuelle. C'est déjà beaucoup que de ne pas être dupe de soi-même.
Et puis ne vous inquiétez pas trop, les mythes subsistent à tous les crépuscules.
Damie Chad.
WESTERN BOP
Croyait en être quitte à venir avec nous voir les concerts de rock le grand Phil, mais chez KR'TNT vous êtes vite repéré et mis à contribution. Comment tu possèdes une collection inépuisable de westerns en DVD, et en plus tu achèves de lire le bouquin dont on vient de tirer le dernier western Homesman, sorti le 21 mai dernier ?
Nous avait déjà donné une chronique sur Dialogue de Feu avec Johnny Cash comme acteur principal ( livraison 74 du 24 / 11 / 11 ), mais si l'on doit attendre cent-vingt numéros avant qu'ils ne se mettent à fournir la nouvelle rubrique Western Bop spécialement créée pour lui, l'on sent que les chasseurs de prime ne tarderont pas retrouver du travail sur le secteur provinois...

HOMESMAN / GLENDON SWARTHOUT
Traduction de Laura Derajinski.
( GALLIMEISTER / 2014 )
Auteur prolifique de westerns nous prévient la quatrième de couverture. Alors prolifique, on ne sait pas, seulement deux livres traduits aux éditions Gallmeister. Mais de westerns sûrement. Le chariot des pionniers sur et dans la couverture nous guide sur la piste, nous méguide plutôt. D’avancée sur une piste pour bâtir un territoire, il n’y a pas, il n’y aura pas.
Homesman nous raconte l’histoire d’un rebours. Ce n’est pas un échec, mais le refus d’une vie passée dans un esclavage domestique qui ne dit pas son nom. La liberté, quand elle ne peut pas se revendiquer haut et fort, quand elle est brimée par les conventions de la société et de la religion, quand elle est niée et bafouée dans l’intimité la plus profonde, ne peut se réfugier que dans la folie. Seule, celle-ci peut permettre d’atteindre ce que les hommes refusent d’accorder, de concéder, peut servir de refuge contre l’égoïsme masculin.
La patrie contenue dans le titre se situe non dans ce monde corseté et enfermé dans ses certitudes et ses croyances mais dans cet espace de liberté absolue que peut être la démence. La patrie des femmes ne se situe pas dans le monde de la raison et de la productivité, mais dans la musique et la poésie qui ne trouvent parfois leur refuge que dans la perte de cette raison, cette perte qui fait si peur aux hommes. C’est pour cela que Glendon Swarthout écrit un western féministe, un western qui refuse l’asservissement à la société.
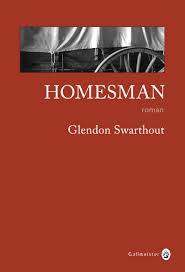
Ce retour dans une patrie par-delà bien et mal, au-delà de la raison humaine est aussi celui où l’on rejoint Briggs. La fascination des femmes pour la figure libertaire de Briggs met en exergue la liberté représentée par cet homme qui fait fi des conventions et des règles de la société. Elles le suivent parce qu’elles reconnaissent en lui un frère en refus des hommes, parce qu’elles voient en lui quelqu’un qui a osé échapper à ces règles qui les tuaient, parce qu’elles découvrent en lui une incarnation, l’incarnation de la liberté. Briggs est celui qui ne regarde pas en arrière, qui veut toujours something else, qui veut vivre sa vie telle qu’il l’entend et non telle que d’autres le voudraient.
Cette alliance de l’homme en marge, violent, ivrogne, mais de bon cœur, et de la femme qui se réfugie dans la religion et l’enseignement nous plonge dans l’univers et les personnages incarnés par Katharine Hepburn et John Wayne dans Une Bible et un fusil. Briggs est un avatar de Rooster Cogburn, comme Mary Bee Cubby est Miss Eula, mais une miss Eula qui ne parvient pas à s’imposer à la société, qui se détruit par la société.
Homesman dresse un constat bien cruel pour la société et le monde des adultes. Il faut se rapatrier dans l’enfance et ses rêves pour survivre parmi les loups. Le beau néologisme, « rapatrieur », de la traductrice, Laura Derajinski, prend ici tout son sens : l’homme est un apatride dans le monde raisonneur, seul le rejet des lois et la folie peuvent lui permettre de rentrer chez lui.
Glendon Swarthout aurait tout comme Huysmans pu intituler HomesmanA Rebours.
Philippe Guérin
23:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gommard, datsuns, loreann', patrick eudeline, laurent chalumeau, homesman
29/05/2014
KR'TNT ! ¤ 191 : MARTHA REEVES / JALLIES / LOREANN' / CAPTAIN BEEFHEART
KR'TNT ! ¤ 191
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
30 / 05 / 2014
|
MARTHA REEVES ( + VANDELLAS ) / JALLIES / LOREANN' / CAPTAIN BEEFHEART |
NEW MORNING / O7 - 05 - 14
MARTHA REEVES & THE VANDELLAS
MARTHA MY DEAR

Il fut un temps béni où Berry Gordy régnait sur cette planète sans partage. Martha Reeves et les autres reines de la soul dégageaient le passage et les petits blancs dégénérés n’avaient qu’à bien se tenir. Au temps de leur splendeur, Martha Reeves, Rosalind Ashford et Betty Kelley (rapatriée des Velvelettes en 1964 pour remplacer Annette Beard devenue mère de famille) enfilaient les hits comme des perles. L’usine à tubes Tamla Motown tournait à plein régime. Berry Gordy sortait des tubes planétaires à la chaîne. Motor City rumble, baby ! Il inondait littéralement le marché.
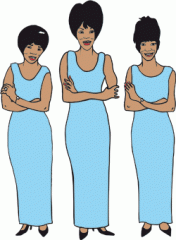
«Dancing In The Street» et «Heat Wave» font partie des plus gros hits de l’histoire du rock. Quand ça démarre, c’est comme «1969» des Stooges, «Gloria» des Them, «Chain Of Fools» d’Aretha, «One Hand Loose» de Charlie Feathers, «Summertime Blues» d’Eddie Cochran ou «The Last Time» des Stones : on se lève et on bouge son cul, parce que c’est impossible de faire autrement. Il faut situer Martha Reeves exactement au même niveau que Jerry Lee : monstres sacrés tous les deux, encore en vie après cinquante ans de bons et loyaux services dans l’une des industries les plus mortifères qui soient, capable de lever un ouragan d’un seul claquement de doigt, et puis on retrouve chez elle comme chez lui cette classe effarante, cette animalité électrique et cette façon de plonger un regard noir dans le vôtre. Martha Reeves était au New Morning par ce beau soir de mai, serrée dans une robe pailletée, et elle plongeait son regard dans celui des petits culs blancs agglutinés à ses pieds. On avait sous les yeux une mémère de 72 ans abîmée par le temps, mais cette femme de haute stature redevint comme par magie la superstar Martha Reeves en attaquant «Ready For Love», le premier morceau d’un set pour le moins dément. Et c’est là où les grands artistes noirs font toute la différence.

Ils dégagent une énergie considérable, plus que n’en dégageront jamais tous les groupes garage réunis. Dès le second morceau, «Come And Get Those Memories», Martha s’essoufflait et transpirait abondamment. Elle secouait un vieux tambourin et s’épongeait le front avec un grand mouchoir de dentelle noire. Entre chaque morceau, elle cuisinait le public et lui racontait des anecdotes. Elle parlait de ses peines de cœur et puis bam, elle attaqua «Nowhere To Run» comme au bon vieux temps, au temps où elle régnait avec ses deux copines Rosalind et Betty sur Detroit, Michigan, et qu’on la filmait sur une chaîne de montage, assise dans un coupé Mustang en cours d’assemblage. Motor City, baby ! Et Martha rallumait l’incendie. Derrière elle, les mercenaires envoyaient la purée Motown. Elle tapait ensuite dans l’un des plus grands hits de tous les temps, «Jimmy Mack», un Jimmy Mack en chair et en os - «Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack/ When are you comin’ back ?/ Oh, Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack» - une leçon de swing épouvantable et Martha semblait légère, elle retrouvait le secret de ses vieux pas de danse. Non seulement elle se révélait l’égale de Jerry Lee, de Marlene Dietrich, de Sister Rosetta Tharpe ou de Nina Simone, mais elle incarnait aussi la magie de la meilleure soul du monde, le Motown Sound - Oh, Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack - et les petits culs blancs entassés à ses pieds dansaient le jerk comme ils pouvaient. Il n’y avait qu’une seule femme noire, dans le premier rang et quand elle s’est mise à frapper des mains et à se déhancher, elle semblait possédée. Juste derrière nous se trouvait la petite batteuse des Protokids, elle aussi complètement possédée par le démon de la soul. Curieusement, la seule fois où j’ai senti une ambiance comparable d’hystérie collective dans un premier rang, c’était au concert de reformation des Stooges de Ron Asheton au Zénith de la porte de Pantin. Les filles d’un certain âge qui se trouvaient là collées aux rambardes étaient dingues d’Iggy. Elles chantaient toutes les chansons en chœur avec lui. Iggy Pop ? Un autre produit de Detroit, Michigan, comme par hasard.

Et bam, elle ressortait «Honey Chile» des oubliettes, mais sans les violons, et miracle, ça fonctionnait, elle rallumait tous ces vieux brasiers qu’on croyait avalés par Chronos, mais pas du tout, ce r’n’b restait, incarné par elle, d’une mordante actualité. Et un peu plus tard, elle annonçait «Heat Wave» en s’épongeant le visage, et on repartait aussi sec vers le jardin magique de notre adolescence. Les chœurs manquaient cruellement, et Martha le savait, alors elle palliait à ce manque du mieux qu’elle pouvait et faisait grimper ses yeah-yeah-yeah-yeah au firmament de la plus grande soul-music de tous les temps. Ne cherchez pas d’équivalent, ça n’existe pas. On profitait des morceaux plus lents pour l’observer, pour s’abreuver d’images d’elle, et puis - on l’attendait - elle annonça «Dancing In The Street», le hit que tous les groupes du monde ont rêvé d’avoir écrit, mais c’est elle Martha Reeves qui l’a eu dans les pattes et qui en a fait un hit planétaire - «They’re dancing in Chicago/ Down in New Orleans/ Up in New York City/ All we need is music, sweet music/ There’ll be music everywhere/ There’ll be swinging swaying records playing/ Dancing in the street» - et là tout a basculé dans la folie, les dimensions se sont mélangées, Martha Reeves nous a tous emmenés dans la lune, le New Morning a explosé, cette façon qu’elle avait d’appuyer sur le a de Chicago, puis de swinguer son down in New Orleans-up in New York City, et de pousser l’emphase sur le all de all we need, tout ça dépassait et de loin ce qu’on avait l’habitude de voir et d’entendre. On était frappé par l’éclat du génie de cette vieille lionne. Chaque fois qu’on voyait Jerry Lee sur scène, on croyait avoir une révélation du genre mystique et là, c’était à peu près la même chose. Martha Reeves sortait le grand jeu, le plus naturellement du monde.

Il faut désormais s’habituer à l’idée que ces géants et ces géantes de l’âge d’or vont disparaître et qu’il n’y aura malheureusement pas grand monde pour les remplacer. Amen. Et que le diable emporte les wannabees.

Un premier album de Martha & The Vandellas sortit en 1963. «Come And Get These Memories» proposait des belles compos signées Holland Dozier Holland. C’est l’époque de la pop joyeuse. Berry Gordy cherchait à pénétrer le marché des blancs. Rosalind Ashford et Annette Beard accompagnent Martha dans cette aventure. On voit que «Can’t Get Used To Losing You» est de la pop de blancs puisque c’est signé Doc Pomus et Mort Shuman, deux piliers du Brill. Puis on passe au niveau supérieur avec un groove bien balancé de Richard Berry, «Moments». Mais le reste de l’album est un peu mou du genou. L’époque voulait ça.

«Heatwave» est le second album de Martha & the Vandellas. Il s’ouvre évidemment avec le titre phare, la démence dans la tendance, pas de prudence dans l’excellence. En 1963, elle nous rivait déjà le clou, avec son énergie explosive. Les ouh-ouh-ouh sont expédiés au firmament à coups de clap-hands. Martha et ses copines vont chercher tout ça très haut. Elles piaillent comme des moineaux. Encore un coup fumant : «Then He Kissed Me», un fleuron de kitscherie de la pire espèce - I didn’t know just what to do/ So I whispered I love you/ And he said that he loved me too/ And then he kissed me, ce qui veut dire en gros, qu’elle ne savait pas trop quoi faire, alors elle lui a dit qu’elle l’aimait, et il lui a répondu qu’il l’aimait aussi et donc il l’a embrassée. «If I Had A Hammer» est l’une des chansons les plus galvaudées - en France par Cloclo, et ailleurs par Trini Lopez - mais Martha Reeves en fait un vrai truc, de sa voix grasse et pointue. Version fantastique. Ces filles là ne rigolaient pas. Elles se comportaient un peu mieux que les malheureuses petites connes qui osaient chanter devant les caméras françaises. Puis Martha Reeves nous fait le coup du r’n’b joyeux de la providence avec «Wait Till My Bobby Gets Home», orchestré par un big band des enfers. Martha Reeves nous fera danser jusqu’à la mort.
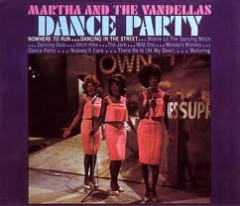
Ça commence vraiment à chauffer avec l’album «Dance Party», paru en 1964. «Wild One» est le prototype du hit Tamla parfait, avec une cymbale devant dans le mix. Alors ça percute et les Vandellas montent comme la marée. Ça pulse des reins avec «Nowhere To Run». La puissance dévastatrice de la ligne de basse restera dans les annales. Ça ne peut être que James Jammerson. D’autres monstruosités en face B : «Mobile Lil The Dancing Witch» (incroyablement funky pour l’époque, modèle du genre, animé de mauvaises intentions), «Dance Party» (un jerk très beau qui ne veut pas dire son nom et on patauge dans l’extrême qualité compositale, c’est orchestré avec un tact surhumain et chanté il faut voir comme), «Motoring» (gros r’n’b à l’ancienne qui roule tout seul, sérieusement gonflé comme un moteur, rythmique adroite et huilée, c’est pianoté dans le fouillis et la basse bat comme un cœur, the heart of soul, la machine Tamla ronfle pour l’éternité), «The Jerk» (embarqué à la bassline et soutenu aux cuivres - c’mon - solo claqué sobrement) et «Hitch Hike» (just perfect).

«Watch Out !» sort en 1966, en plein cœur de l’âge d’or. C’est le trio de choc composé de Martha Reeves, de Rosalind Ashford et de Betty Kelly. Le hit magique de l’album, c’est «I’m Ready For Love», doté d’une pulsation experte à la Supremes et d’une féérie vocale appareillée. Nocturne et excitant. Ce genre de cut nous rend encore plus nostalgiques de cette époque merveilleuse que furent les années soixante. La version de «Jimmy Mack» qui se trouve sur l’album est malheureusement lissée. Pas de basse devant. Rien ! Il faut absolument écouter la version remastérisée si on veut entendre le travail fabuleux de James Jammerson. On se régalera de «Let This Day Be», une pop song de haut rang montée sur une mélodie hollywoodienne. Encore une merveille de r’n’b sophistiqué avec «Happiness Is Guaranteed», pièce gantée de soie noire et finement dansante. On se croirait dans une ambiance de salle immense, comme dans certains hits des Supremes. C’est effarant de qualité chant et les arrangements font baver le profane. Mais l’album reste plutôt pop, avec des morceaux comme «What Am I Going To Do Without Your Love», chanson progressiste et ambitieuse qui fournit une nouvelle preuve de l’écrasante supériorité de Tamla sur l’ensemble de la pop américaine. Même chose avec «Tell Me I’ll Never Be Alone», petite perle de pop suprême du Michigan hantée par des voix d’anges à la peau noire. Un véritable pied de nez au Vatican.
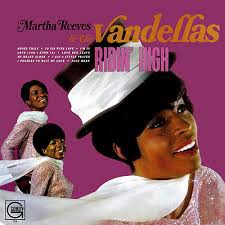
Magnifique pochette rose et blanche pour l’album «Ridin’ High». Betty Kelly a été virée et Lois, la sœur de Martha, a pris sa place. C’est un album gorgé de pur jus Motown, avec des classiques imparables comme «I Promise To Wait My Love» (petite perle de r’n’b sacrément secouée à la basse), «Honey Chile» (le r’n’b de rêve monté sur une rythmique mélodique, l’un des hits sixties les plus hanteurs de consciences), «(There’s) Always Something That Remind Me» (du Burt repris en France par Schmoll - Il y a toujours un coin qui me rappelleuh - oh wohoho - mais Martha crève l’écran, elle va si haut qu’on ne la voit plus, on savait qu’elle était une géante, mais quand on l’entend chanter ça, on se prosterne jusqu’à terre), «(We’ve Got) Honey Love» (jolie pièce de r’n’b ordinaire typique des Vandellas et c’est ce qui fait la force des Vandellas : chez elles, le morceau ordinaire prend l’allure d’un classique, comme chez les Supremes), «I Say A Little Prayer» (la voix de Martha est tellement colorée qu’elle peut transformer une platitude en chef d’œuvre impressionniste) et «Without You» (pas loin du très grand music-hall, c’est dire si).

«Suagar N’ Spice» est sans doute le meilleur album de Martha Reeves & The Vandellas. Sa sœur Lois et Sandra Tilley qui est très claire de peau accompagnent Martha (Sandra vient aussi des Velvelettes et elle remplace Rosalind). Elles ouvrent le bal avec un beau groove orchestré à l’ancienne, «Taking My Love (And Leaving Me)». Absolument énorme. Pure magie Tamla. Ambiance miraculeuse. «Shoe Leather Expressway» est aussi du grand art Tamla monté sur une ligne de basse extravagante. On est au royaume de la bassline. Celle-là danse et glougloute derrière le groove. Encore du groove doux et serein comme pas deux avec «You’re The Loser Now» et on passe ensuite au winner avec «I’m A Winner». Une fois de plus, on est confronté à la classe mortelle de Martha Reeves. C’est du niveau des grands hits d’Aretha et ça grimpe très vite dans les étages. Absolument fabuleux de r’n’bisme. Elles tapent ensuite dans un vieux hit de Gilbert Bécaud, «What Now My Love», et Martha n’a aucun problème pour grimper au firmament, elle a cette voix de rêve qui rend possible tous les décollages. Elle explose sans aucun effort. C’est d’ailleurs ce qu’on avait remarqué en la voyant chanter sur scène. Elle dispose de cette incroyable facilité à grimper dans les octaves. La face B reste d’une rare densité. «Loneliness Is A Lonely Feeling» est une nouvelle pièce de pop r’n’bique digne des Supremes. On trempe dans le même genre de complot. C’est puissant, chanté, orchestré et choristé. Tout y est. Appelons ça le vieux son des victoires. Toujours de la belle pop vandellique avec «I Love The Man». On reste évidemment dans le très haut de gamme, c’est swingué à la hanche, ça prend l’occiput et ça ne le lâche pas. Quand un cut comme «I Can’t Get Along With You» se met lentement en route, il faut s’attendre au pire, c’est-à-dire à un petit chef-d’œuvre ambivalent. On a même un prototype du r’n’b rentre-dedans avec «Heatless». Pur jus Tamla, voilà le fameux hit secret qui faisait danser les jukeboxes. Just lovely. Impossible de reste de marbre.

On arrive dans les années 70 et Tamla Motown entame son déclin. Le son se blanchit de plus en plus et Berry Gordy s’est réinstallé à Los Angeles. On fit tout de même un dernier test avec l’album «Black Magic» paru en 1972, et on était persuadé que c’était foutu d’avance. D’autant que la plupart des artistes soul viraient disco, de la même façon que les rockabs qui avaient en leur temps viré country. Ils avaient tout simplement joué la sécurité matérielle, ce qui est de bonne guerre. On trouve quand même quelques morceaux solides sur cet album tardif des Vandellas et notamment «Your Love Makes It All Worthwhile», monté sur un bon beat et finement discoïde. On voit cependant que le Motown sound reste en bonne santé. Elle retapissent un hit de George Harrison, «Something». Ça devient un groove orchestré relativement inspiré. Et puis, une bombe nous guette au coin du bois : «Tear It On Down», une énormité avec une basse poussée devant, dans une pure ambiance sixties. Voilà un vrai romper black. Le génie du Tamla sound se niche dans ces merveilles organiques bien ficelées. Une vraie carne de r’n’b, bien lestée, avec une belle assise rythmique. Les filles ont une classe folle. On les sent parfaitement à l’aise sur ce genre de stomp pulsé à l’extrême. On retrouve du beau r’n’b classique en face B avec «Bless You», plénitude Tamla et orchestrations seventies. R’n’b supérieur avec «In And Out Of My Life», emmené par un walkin beat. Merveilleuse pièce, groove somptueux. On reste en bonne compagnie. Il semble que Martha et ses amies aient réussi à sauver l’honneur du label. Elles retapent dans Burt avec «Anyone Who Had A Heart» et elles en font une merveille absolue qui scintille sous les lampions de la discothèque. Quand on voit les coiffures frisées de Martha et de ses amies sur la pochette, on les soupçonne d’avoir cédé aux sirènes de la mode. Retour au solide groove de basse avec «Hope I Don’t Get My Heart Broken». Voilà un exemple d’intégration groovy réussie. Très révélateur.

L’idéal pour tout amateur c’est un bon Best Of anthologique des enfers comme «The Definitive Collection», parue en 2008, avec un son remastérisé. Avec ça, on se fait sauter le caisson : «Nowhere To Run» (le hit absolu, le r’n’b dans toute sa splendeur, d’une élégante brutalité tribale avec des chœur yeah-yeaherques terriblement sexy), «In My Lonely Room» (la musique des jours heureux, on claque de mains avec Martha, hit monumental, c’est la vraie musique, celle des gens doués qui vont bien), «Dancing In The Street» (l’insurrection, on descend dans les rues, partout, à New Orleans, New York City, Chicago et Motor City, les villes brûlent. Pure dementia diabolica. Music everywhere, c’est stompé aux maracas, Martha et ses copines dansent dans leurs petites robes de taffetas, elles foutent le feu dans toutes les cervelles. Vous en connaissez beaucoup des mecs qui provoquent ça ?), «Quicksand» (personne ne peut survivre à une telle avalanche de hits planétaires. C’est clappé des hands, chanté perché, du Tamla à se damner, on explose de plein fouet, au paradis de la soul), «I’m Ready For Love» (vraie pépite de sexe torride, elles tirent le truc vers les cimes, Martha met sa voix sucrée en avant, festin pour l’amateur, elle relance avec candeur, d’une voix pointue comme pincée), «Wild One» (battu par derrière, machine Tamla, un truc unique au monde, l’éclat d’un pounding énorme, on a l’impression d’être sous une voûte avec elles, c’est grandiose et inspiré et ça colle des frissons un peu partout), «You’ve Been In Love Too Long» (à tomber, encore une horreur apocalyptique, les filles secouent les colonnes du temple, elles chantent le r’n’b le plus puissant de tous les temps, Martha fait la loco avec son chien habituel), «Jimmy Mack» (monté sur un délire de basse, deux notes viennent saturer au refrain sur Jimmy Oh Jimmy, voilà la bombe, on entre dans ce morceau comme dans un rêve, la voix de Martha se durcit lorsqu’elle attaque le pont, la basse de Jammerson passe devant et vrille, Hey Jimmy) et «Bless You» (plus funky, elles retournent directement au jardin magique, c’est d’un miraculeux qui dépasse la mécanique quantique, fraîcheur de peau et satin blanc, parfum des jours si profondément heureux, elles élèvent leur truc au sommet de ce qui est humainement acceptable en termes de plénitude, Martha my dear, tu nous rends si profondément heureux, nous autres petites brebis trottant dans les jardins enchantés des paradis artificiels, sous la douce emprise de l’opium de la soul et sous le regard bienveillant du dieu Berry).

On ne pourrait pas imaginer un monde sans Jerry Lee. C’est pareil avec Martha Reeves. Un monde sans Martha Reeves, ce serait comme un jour sans rhum à bord de la frégate de Bartholomew Roberts. Impensable.
Signé : Cazengler le Vandale.
Martha Reeves & The Vandellas. New Morning. Paris Xe. 7 mai 2014
Martha & The Vandellas. Come And Get These Memories. Gordy 1963
Martha & The Vandellas. Heat Wave. Gordy 1963
Martha & The Vandellas. Dance Party. Gordy 1964
Martha & The Vandellas. Watch Out ! Gordy 1966
Martha Reeves & The Vandellas. Ridin’ High. Gordy 1968
Martha Reeves & The Vandellas. Sugar’n’Spice. Tamla Motown 1969
Martha Reeves & The Vandellas. Black Magic. Gordy 1972
Martha Reeves & The Vandellas. The Definitive Collection. Motown 2008
De gauche à droite sur l’illustration : Rosalind Ashford, Martha Reeves et Betty Kelly.
MONTEREAU – FAULT – YONNE
23 – 05 – 2014 / L'ANTIDOTE
THE JALLIES
Comme souvent quand je vais voir les Jallies – allez savoir pourquoi – la teuf-teuf se remplit de présence féminine – comme si je n'étais pas capable de me débrouiller tout seul. Une véritable escort girls, même que la copine a filé rencart à une amie du coin, deux gardes du corps pour moi tout seul, c'est beaucoup – un véritable barrage filtrant de protection autour de mon auguste personne, je me demande si cette attention ne serait pas intéressée.
Un temps de chien, même que la Salsa est restée dans sa panière. L'on arrive tout dégoulinant d'eau, facile de repérer l'Antidote sur la place du Marché au Blé, une vingtaine de personnes se collent, le col relevé, la clope au bec, contre la façade. Fumer et se mouiller, les deux à la fois, l'alternative est interdite. Fait meilleur dedans, surtout que la Vaness se précipite dans mes bras... pour me vanter le croque-monsieur au maroilles, personnellement c'est plutôt de croquer les demoiselles qui me remonte le moral, mais faute de grive je passe une commande de toasts grillés au fromage chaud.
L'Antidote se remplit. Toute la jeunesse monteauroise semble s'y être donnée rendez-vous. Heureusement le local est assez grand, long et large. Le bar est tout au fond, le matos des Jallies est dans un renfoncement latéral accessible aux yeux de tous. Ambiance joyeuse de fin de semaine, tandis que les verres se vident la fièvre monte doucement, lorsque le groupe rejoint ses instruments, l'on pressent que la soirée sera chaude.
PARTY 1

Ca démarre sur les chapeaux de roue. Pas le temps de faire ouf qu'ils sont déjà sur la route, les trois meufs qui font la teuf à fond sur le titre éponyme. Les soutes devant, les soutiers derrière. Turbinent sec. En fait ne vous y trompez pas ce sont eux qui poussent à la roue. D'abord Thomas qui se calfeutre sous son chapeau feutre, ne va pas en rater une, sans cesse un break de guitare à pousser au coeur des braises. L'a adapté son style, joue plus serré, plus concis, mais avec des attaques ultra-violentes et always on the speed. Pas le temps de voir venir, avec lui il faut que ça dégringole - les minauderies des filles, tiens si moi je prenais la guitare maintenant à moins que peut-être que je garde mon tambourin parce que - elles ont intérêt à ne pas y passer trop de temps, car au bout de trois secondes il vous grille une intro à faire sauter les fusibles du quartier. De son côté Julios en rajoute, il tient enfin sa vengeance – brûlante – après des mois de martyre, qui devrait en toute équité lui valoir la canonisation le jour même de sa mort. Mais là, il est encore vivant. C'est pour sa contrebasse que vous pouvez vous faire de la bile. Fini l'époque où il en jouait. Désormais il lui arrache les cordes – à les entendre miauler on croirait qu'il est en train d'éviscérer un chat, mais non, c'est un tendre, un ami des bêtes, mais quand il slappe on dirait Bruce Lee dans la Fureur du Dragon. En plus il se retient. Après le set, je l'entendrai déclarer : « Non j'ai fait doucement, on a un concert demain, je ne voudrais pas m'arracher la peau des doigts ! ».

Remarquez devant, ce n'est guère mieux. Céline, la douce Céline, la tendre Céline, s'est métamorphosée en lionne. Incapable de rester en place, l'on ne voit que sa robe rouge qui zig-zague entre les instruments, difficile de la suivre des yeux, elle bouscule les tempos comme les déménageurs les armoires à glace d'une seule main, elle rugit et vous pousse la chansonnette comme d'autres vous plantent la baïonnette dans le coeur. Nous dévoile un aspect inconnu de sa personnalité, et vu les réactions du public l'on ne peut pas dire que ce soit déplaisant. Mais combien de facettes cachées possède-t-elle encore ?
Tiens un garçon de plus sur scène. Non je n'ai pas bu et je n'ai pas la berlue, c'est même une tête connue, Jérôme toujours présent lorsque les Jallies officient en leur fief, ouvre sans ménagement un étui posé au bord de la scène et en exhibe une trompette rutilante. Une place devant un micro, vous voulez rire, nul besoin, se cale sur le morceau suivant et vous le transforme en fanfare mexicaine, un peu comme la scène centrale du bal des villageois sous les arbres centenaires de La Horde Sauvage. Mais en plus sauvage. Sourire d'extase sur les visages autour de moi. Et cris de joie sur les dernières notes.

Je sens que les lecteurs s'impatientent, dans leur âme je lis qu'ils veulent Leslie. Des nouvelles de la nouvelle. Sont bonnes, très bonnes. Ses sourires chavirent les choeurs, s'amuse comme une gamine à renchérir sur les wap-doo-wap. A l'aise comme si c'était son cinquantième concert. Avec en plus un sourire à faire fondre un croquemort. N'y a pas que l'alcool qui fait briller les yeux des garçons autour de moi. Par contre quand elle chante ça fait mal. Très mal. Encore une mignonnette qui ne prend pas les pincettes pour vous asséner des atemis meurtriers. Coup sur coup elle enchaîne Johnny's Got A Boom Boom de la divine Imelda ( l'est vrai que nous sommes au mois de May ) et Train Kept A Rollin de Johnny Burnette. On a eu de la chance qu'aucune patrouille de pandores ne se soit aventurée sur la place, l'on était tous bon pour la garde à vue et le cabanon. Le café transformé en lunatic asylum. Hystérie collective prolongée. Comme aurait dit Balzac, c'était Leslie dans la vallée de la mort. L'a gagné ses galons, Leslie.
L'on enchaînera sur un boogie d'anniversaire, et le set culminera sur un Whole Lotta Shakin Goin' Home à faire jerker le vieux Jerry Lou comme au temps de sa jeunesse tumultueuse. Pour une fois dans sa vie, Vanessa sut faire preuve de sagesse en décrétant qu'il était temps d'arrêter le charivari avant que tout ne chavire définitivement et de reprendre ses esprits devant un verre ( un grand ) au bar.
PARTY 2

Euphorie à ras les amphores. Quatorze titres débités comme elles viennent de le faire, vous avez votre dose de rockab-swing-rollant pour le trimestre. Mais non, c'est reparti pour un tour. Replay. Same players shoot again. Niveau d'intensité garanti. En trente secondes tout le monde a oublié les trois quart d'heures de coupure. C'est ça l'effet Jallies. Suffit qu'elles ouvrent la bouche pour que l'univers prenne des couleurs. Elles repeignent votre vie en rose bonbon au poivre.
Les filles sont sur le devant de la scène et les garçons marnent derrière. Normal nous sommes en Seine et Marne. Les triplettes sont déchaînées, parfois il est difficile de savoir laquelle des trois chante en soliste, elles ne se volent pas les morceaux, elles les survolent, en repoussent les limites et les refrains, interchangeant à plaisir les rôles. Parfois les deux mecs les poussent un peu des épaules et imposent de ces petits soli de basse ou de guitare qui vous décoifferaient une armée de chauves. En plus ils reçoivent du renfort, un batteur fou qui s'adjuge la caisse claire de Vanessa – l'on se demande pourquoi puisqu'il tape aussi bien sur les murs – et qui mène une sarabande d'enfer. Est acclamé comme Cassius Clay lors de ses mémorables combats.

Quatre garçons pour trois filles, pour une fois ces demoiselles ont du souci à se faire. Vous voulez rire ? Ce n'est pas parce que je n'en ai pas encore parlé qu'elle est restée sur le banc de touche. Vanessa a encore travaillé son KO technique. Tout sourire et toute blondinette. Un mirage, un miracle. Mais vous n'avez pas intérêt à laisser traîner un standard ou un rockab de derrière les fagots aux alentours. Elle s'y jette dessus et vous le malmène sans plus de cérémonie. Vous le secoue dans tous les sens, vous l'essore et vous le transperce en moins de deux. Elle ne griffe pas mais elle mord à plein gosier. Vous ne savez pas où elle va chercher ça, mais sa voix est un sabre de samouraï qui dépiaute à la vitesse d'un rotor d'hélicoptère, peut aussi bien vous tisser un napperon de dentelle, mais la demoiselle a de l'appétit pour les chevauchées sauvages, frisson garanti, dans le filigrane de son grain de voix, vous percevez la démence du loup qui hurle à la nuit, les claquements secs des mâchoires de caïmans qui se referment sur une proie innocente, tout un monde de violence primitive et animale qui gît au fond de l'être humain. Des lèvres chatoyantes, des yeux qui pétillent de malice, et ce tréfonds de folie et de brutalité barbares au plus profond de nos gènes et que l'on se garde bien de réveiller, par peur. Mais elle, la Vaness, l'Artiste, la magicienne à l'ensorceleuse raucité, elle n'éprouve aucune crainte, elle a domestiqué la bête visqueuse qui dort, et elle vient lui manger dans la main, dès qu'elle le veut. Pour notre plus grand plaisir. La voix de Vanessa nous réconcilie avec cette part maudite de nous-mêmes qui nous effraie tant. Joyeuses Jallies, soyeuses Jallies, à profusion. Tant que vous le désirez. Mais n'occultez pas la face cachée et hécatienne du blues qui transite en sourdine sous tout cela.
PARTIR
Le concert finit en apothéose, cris, danses, émerveillements, et j'en passe. Jamais vu un public si jeune et aussi réceptif dans un concert de rockab. Plein de nouveaux morceaux au répertoire comme cet I Love The Bug ou Fishnet Stockings, mais je laisserai le mot de la fin à Julios sortant de scène la chemise dévastée de sueur : « Je ne sais pas si c'était rockab, mais à coup sûr c'était sacrément rock'n'roll ». Et je lui donne sacrément raison.
Damie Chad.
PROVINS / LE CESAR / 17 & 24 – 05 – 14
LOREANN'
17 / 05 / 2014
Suis un peu embêté pour écrire cet article. C'est Loreann' elle-même qui me l'a dit : « Ne dis rien, j'ai trop mal à la gorge, ce n'est pas génial aujourd'hui. » C'est sûr que malgré son col roulé elle est en plein courant d'air et qu'il souffle en permanence un petit vent glacé pas du tout agréable. Mais c'est une règle intangible : l'on ne peut être à la fois juge et partie. La preuve c'est que malgré la fraîcheur ambiante l'on est serré comme des harengs en caque sur cette terrasse et que personne ne manifeste l'envie de s'en aller. Les rares chaises qui se libèrent sont aussitôt réoccupées sans faillir. A croire que ce petit filet de voix dont elle médit si allègrement doit quelque peu réchauffer les coeurs et raffermir l'âme des impétrants.
Jacquie la Gratte est de retour, Loreann' lui laisse volontiers sa guitare le temps de siroter un thé bien chaud, l'en profite pour un intermède musical qui ne nous rajeunit pas, un pot-pourri des années soixante avec Da Dou Ron Ron de Johnny Hallyday, et Twist à St Tropez des Chats Sauvages. Plus tard ce sera un accordéoniste qui viendra de son propre chef l'accompagner sur un morceau de... que mon cerveau atrophié a oublié... Pas génial, c'est elle qui le dit, mais toujours le même intérêt de la part des auditeurs et ces musiciens de hasard qui s'en viennent témoigner leur sympathie. A la réflexion, ce ne devait pas être tout à fait comme elle l'a déclaré. Mais puisqu'elle ne veut pas que j'en parle, je me tais.
24 / 05 / 2014
Enfin presque. Parce que je vais vous parler de la semaine précédente. Submergé par des obligations je n'ai pas eu le temps d'écrire l'article. Alors je résume. Faisait beau temps. Les parkings étaient pleins mais sur le marché les vendeurs faisaient grise mine. Personne, pas de clients, les allées désertes. A peine trois ou quatre pèlerins. Le César est aux trois-quarts vides et la terrasse désertée. Ne me demandez pas où la population provinoise avait disparu, c'est un mystère.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu tort. Car Loreann' était là, fidèle au poste, et en pleine forme. L'a même fini par rameuter assez de monde pour remplir la terrasse, vraisemblablement au grand désespoir des marchands qui ont dû se voir, à grands regrets, arracher leur maigre clientèle... Un coup dur pour l'économie mercuriale de l'ancienne cité comtale, mais comme nous sommes de ceux qui pensons que les activités artistiques priment sur toutes les autres, nous n'en fûmes point désappointés.
Et Loreann', dans la blondeur de ses cheveux soulignée par un rayon de soleil venu tout exprès pour s'excuser de son manquement de la semaine précédente, déborde de vitalité. Du coup elle en a oublié un peu cette tristesse automnale de mélancolie qui embrume si délicieusement les harmonies de sa voix pour se mettre au diapason de cette atmosphère matinale printanière. Davantage de vigueur dans l'attaque des morceaux, nous avait jusques à lors celé cet aspect primesautier de son interprétation. Dans la rue vidée de son flot quasi ininterrompu de voitures sa voix s'élève et ricoche sur les façades. Idem pour la guitare, la fait résonner méchamment plus fort que d'habitude. Un ton plus haut mais toujours se dégage cette mystérieuse aura qui enchaîne le spectateur à rester encore une fois pour tenter d'en percer par une nouvelle écoute l'énigme irrésolue de cette attirance qui s'en dégage.

Violemment applaudie. En concert la veille, attendue ce soir-là en un autre lieu, Loreann' commence à agrandir le cercle des interventions. Comme j'ai posé sur la table friandises et cerises les copain s s'y jettent dessus comme poignée de moineaux affamés, mais Loreann' en rajoute une sur les gâteaux : s'est mise à composer. Excellente nouvelle. Plus qu'à attendre avec impatience.
Damie Chad.
CAPTAIN BEAFHEART / La Biographie
mike barnes
Traduction : PATRICK CAZENGLER
( Camion Blanc / Avril 2012 )
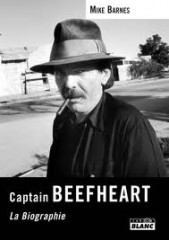
Captain Beefheart, Capitaine coeur de boeuf, ce n'est pas que je sois végétarien – j'aime plutôt le rock saignant – mais le Capitaine Beefheart j'avoue que je n'ai jamais trop adoré naviguer sous son pavillon, un pirate un peu trop arty selon mes goûts mais attention c'est notre Cat Cinglé national qui a mis la patte ( mais pas la trique ) à la traduction. Une véritable caution morale dirais-je car le Cat Zengler vous avez dû vous en apercevoir en lisant – non, je corrige : en apprenant par coeur ( de boeuf ) - ses chroniques consacrées aux émeutiers du rock qu'il n'apprécie pas trop les mous du genou droit. Ceux du gauche non plus.
Mike Barnes est un journaliste rock, la preuve il écrit dans Mojo, mais il participe régulièrement à The Wire le magazine de la musique différente, jazz, new thing, improvisation libre, contemporaine, électronique, expérimentale... quand on veut se rassurer, l'on dit post-punk, on a ainsi l'impression d'être encore en terre connue mais quand on y regarde de près, c'est un continent à la dérive qui a rompu toutes ses amarres avec nos roots chéries.
Généralement les rockers se bouchent les oreilles dès qu'ils entendent de lointain échos de cette pseudo-musique dégénérée. Sont plein de mépris et de hargne envers ses sous-civilisés qui produisent des horreurs sans nom et inaudibles. Attitude compréhensible mais qui ressemble trop à celle adoptée par tous ces individus collet-montés qui détestent cette musique de sauvages qu'est le rock'n'roll. A chacun ses barbares. Une identité – même de rocker - se bâtit autant par des conduites d'amicales ressemblances que par des refus affirmés et proclamés haut et fort. L'homme est un animal : en guise de territoire il se construit des frontières mentales infranchissables. S'y sent bien et au chaud, aussi à l'aise qu'un cadavre dans son cercueil capitonné. L'est comme la larve entortillée dans son cocon. Mais trop souvent il oublie de se métamorphoser en papillon.
Si Gene Vincent est selon les rockers une icône parfaite de la rébellion, Luigi Russolo en est une autre. Ne procèdent pas des mêmes racines, le premier était un gamin américain qui avait reçu en partage la musique populaire des USA, le second fut un italien, engagé dans les mouvements artistiques d'avant-garde du début du vingtième siècle, un héritier de la culture européenne savante et élitiste. En ce temps-là le Futurisme tentait de se mettre à l'heure de la fureur du siècle qui allait naître en 1914. C'est en 1913 qu'il publie L'Art des Bruits, le manifeste qui ouvrit la porte à toutes les cacophonies musicales qui s'en suivirent. Gene Vincent est né en 1935, Luigi Russolo est mort en 1947 et Captain Beefheart naquit en 1941. La chronologie permet de mettre en perspective des évènements qui en apparence n'ont rien à voir entre eux.
UN ENFANT GÂTE
Mais pas pourri dans l'oeuf. Tout petit l'était déjà en avance sur les proximales générations de baby boomers, ces insipides marmots américains à qui l'on passe tout sous prétexte qu'il ne faudrait point les traumatiser. Fils unique, le chéri de sa maman qui est à ses ordres. Aucune autorité parentale, il l'appelle par son prénom et se sert d'elle comme d'une servante obéissante et fidèle. Pas le genre à lui rappeler qu'il est l'heure de partir à l'école, lui il préfère rester à la maison. Facile à garder, ne fait pas de bruit, passe son temps à dessiner et à sculpter des animaux dans tous les morceaux de bois qu'il peut se procurer. Une forte personnalité.
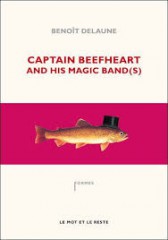
Bison buté qui n'en fait qu'à sa tête, mais il se fracassera sur le premier écueil : à seize ans ses parents s'opposent à ce qu'il aille en Europe dans une école d'art. Vocation contrariée. Pédalera quelques années dans la choucroute informe de l'adolescence et de la prime jeunesse avant de tirer les définitives leçons qui présideront à la manière dont désormais il guidera sa vie. Des préceptes simples qu'il appliquera avec une fermeté exemplaire : article 1 : toujours faire ce que je veux faire, article 2 : ne jamais écouter les autres mais agir en sorte que ce soit les autres qui m'obéissent, article 3 : ne jamais transiger sur les deux précédents commandements impératifs et absolus. Pouvez détester le Capitaine et le tenir en piètre estime, mais vous serez obligés de convenir que jusqu'à sa mort il ne dérogera pas une seule fois à ses propres principes éthiques. Une véritable personnalité de rocker !
ENVIRONNEMENT MUSICAL ( 1 )
Suffit d'un mauvais voisin qui donne le mauvais exemple pour que votre gosse tourne mal. Quoique pour le dénommé Van Vliet – l'autre nom du Captain Beefheart – l'on ne sait lequel influença l'autre. Se rencontreront à l'université d'Antelope, dans le Comté de Los Angeles. Beefheart + Zappa, les deux grands déjantés du rock sixties commencent à traîner ensemble. Très vite dans les clubs de blues et de rhythm and blues.
ZAPPA
Deux personnalités distinctes et surtout deux parcours différents. Zappa possède une solide formation de musique classique, s'intéresse à Stravinsky , Varèse le dodécaphonisme et tout ce qui suit. Mais Zappa bifurque, s'entiche de musique populaire et de guitare électrique. N'en abandonne pas pour autant ses bases classiques. Se servira du rock comme d'un cheval de Troie, autant pour le libérer de sa naïve simplicité que pour bousculer la musique contemporaine. C'est un compositeur, il écrit ses partitions, ses musiciens doivent les jouer à la note près, ce qui n'empêche pas que de temps en temps il ménage des plages soigneusement circonscrites d'improvisation. Il adore bousculer, mais avec ordre et méthode. Aimerait être reconnu comme un grand musicien, un grand compositeur. Que son nom devienne aussi célèbre que celui de Debussy.
Sûr de lui et plein de commisération pour l'ensemble des rockers qui pour la plupart jouent d'oreille et ont du mal à lire une portée en clef de sol... Voudrait les écraser tous, aimerait être la rock star suprême, le magnifique bordellisateur du siècle. Après moi, vous pouvez tirer la chasse sur tout ce qui m'aura précédé. Dans les années 70, une chambre d'étudiant sur deux offrait le célèbre poster de Zappa entièrement nu trônant sur ses chiottes. Tout un symbole. L'anar chie. Sur le monde qui l'entoure.
VAN VLIET

Aussi convaincu que le précédent d'être le génie du siècle. Pas le même bagage musical. Ne sait ni lire, ni écrire la musique. Ne sait jouer d'aucun instrument. Monstrueux déficit en faveur de Zappa. Pas étonnant que tous les deux se retrouvent dans les bars miteux à écouter du blues. L'on imagine mal les deux compères assister au Requiem de Fauré tout en dissertant doctement sur l'art du contrepoint. Van Vliet ne possédait pas la culture nécessaire pour prétendre partager de tels échanges de vue. Quant à penser qu'il aurait pu se taire et écouter religieusement le savoir de maître Zappa, c'est bien mal le connaître. Se sent beaucoup plus à l'aise avec la rusticité des structures du blues. Le blues c'est avant tout une question de feeling. Suffit de se laisser porter et de nager dans le sens du courant. Van Vliet trouve la solution. S'aperçoit qu'il possède une grosse voix, ne sait pas trop quoi en faire, alors il apprend à hurler et à hululer, chez lui il passe et repasse les disques de Howlin' Wolf et est très vite capable de l'imiter parfaitement. Bientôt il adjoindra à son talent de blues shouter le porte-voix naturel du blues : l'harmonica, qui n'est que la continuation instrumentale des cordes vocales et du soufflet des poumons.
ENVIRONNEMENT MUSICAL ( 2 )
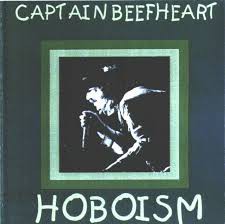
Tout le monde est OK avec le British Blues. De Cyril Davies à Eric Clapton, de John Mayal à Led Zeppelin, en passant par l'American Folk Blues Festival aux Animals, n'importe qui peut réciter la leçon. La même phénomène se produisit aux USA. Mais d'une façon un peu différente. Aux Etats-Unis tout est plus rapide. A tel point que le blues se confondit avec le rock. Aux Etats-Unis l'on a les moyens. Les adolescents commencent à entreposer du matériel dans le garage des parents, de mois en mois, les amplis se multiplient, en 1968 Blue Cheer déclare la guerre. Parient sur la force de frappe sonore. Contrairement aux anglais, à des groupes comme Cream, qui créent les bases du hard rock en jouant sur la perfection musicale des riffs découpés et articulés à outrances, Blue Cheer invente la charge éléphantesque qui écrase tout sur son passage. Point de subtilité et pas de quartier.
A Detroit City, Stooges et MC 5, sont eux aussi des adeptes des grandes vitesses, mais ce n'est pas seulement l'aiguille du compteur poussé au maximum qui les intéresse, c'est la suite, lorsque l'on a dépassé la zone rouge et que l'on continue à foncer, l'on arrive alors en des atmosphères de grandes turbulences, ce n'est plus le rythme qui compte mais la pâte sonore où l'on débouche, un no man's land chaotique, explosif, où rien ne ressemble à rien, où l'on ne sait plus si l'on produit du son ou du bruit. Maximum de décibels et plénitude des jouissances. La musique devient une expérience charnelle, une approche fulgurante de la modernité. A Love Suprême comme dirait John Coltrane. Born to Be Wild, en déclinaison rock.
Etrange musique qui prend son essor dans les gémissements hypnotiques du blues rural pour terminer dans les sphères les plus extrémistes du jazz non orchestral en empruntant the rock'n'roll highway. Le chemin est tracé. Suffit de l'emprunter. Par contre personne ne sait sur quoi il débouche...
L'ORCHESTRE MAGIQUE

De 1965 à 1968, Captain Beefheart brûle les étapes. Possède son groupe, le Magic Band, avec lequel il enregistre deux simples dont une reprise de Bo Diddley – a déjà l'intuition que tout son doit ressembler à une jungle luxuriante - Diddy Wah Diddy qui lui octroie un statut de groupe régional. Pas mal pour un début, mais A & M refuse les premières prises du premier 33, Safe As Milk. Trop violent, trop désordonné. L'on aime bien le Milk Cow Blues chez A & M, mais il ne faut pas que la vache soit trop folle. Captain comprend la leçon, veut bien mettre un peu d'eau dans son lait. L'embauche une jeune guitariste, Ry Cooder qu'il a déjà remarqué lors de différents concerts.

Ry Cooder c'est le roi de la slide, avec lui tout glisse comme sur du verre, vous ferait avaler un sabre d'abordage sans que vous vous en aperceviez. Quant au Captain, il se met à l'unisson, un coeur de boeuf tendre comme l'agneau qui vient de naître, s'en faudrait d'un millimètre pour que sa voix ne vienne pleurnicher dans votre mouchoir. Bon, de temps en temps ça se gâte, l'ensemble s'engouffre dans des rythmiques à la Doors et Le Ry vous tire de ses cordes de si étranges mélopées que l'ambiance devient carrément tordue. Mais l'amateur y retrouve ses petits assez facilement, d'autant que la guitare qui miaule vous permet de ne pas leur marcher dessus. C'est du binaire, du binaire tordu-bossu, psychédélique certes, avec des paroles un peu bizarres, mais enfin l'époque est à l'outrance. Le rock est en crise d'adolescence et les groupes ne savent pas quoi faire pour se démarquer. Parfois, ca tombe un peu à côté, certains passages ne dépareraient point dans un disque de Santana, cela pour vous faire comprendre que c'est un joyeux foutoir. Et quand on commence à se perdre l'on retombe sur un vieux riff de blues des familles qui vous rassure.
Le disque sort chez Buddah Records mais le pacha est déçu, le succès espéré se révèlera être un bide. Est surtout convaincu que la maison de disques ne lui a pas donné l'entière liberté, s'est senti brimé dans ses désirs. En retrait sur ses possibilités. Peut faire beaucoup mieux. Le deuxième album ne lui apportera pas plus de satisfaction, les bandes de Strictly Personnal seront trafiquées en son absence pour être mieux accueillies par le public... Beefheart s''en ouvre à Zappa qui se propose de l'enregistrer sur son propre label Straight Records en lui promettant tout le temps nécessaire.
TROUT MASK REPLICA
Ry Cooder fait un somptueux cadeau au Capitaine, il quitte le Magic Band dès les enregistrements terminé. S'éloigne pour d'autres aventures. A visualisé l'iceberg qui se profile à l'horizon, veut créer sa propre musique pas celle de Van Vliet, c'est qu'une fois que Zappa lui a donné carte blanche le Capitaine révèle sa véritable nature. Le leader charismatique se révèle tel qu'en lui-même l'auto-proclamation de son génie le dévoile. Un tyran. Mais un tyran bien-aimé de son peuple.
Commence par enfermer les musicos chez lui et les fait bosser comme des dromadaires. Les transforme en ses instruments. Doivent développer ses idées à lui. Leur donne des indications oiseuses et peu signifiantes, à eux de se débrouiller et de trouver. Bon prince, il les laisse travailler tout le reste de la journée et pour ne pas les déranger pendant ce temps il va s'amuser avec les filles et les grosses voitures. Pour les royalties c'est réglé comme sur du papier à musique, se créditera de l'intégralité des morceaux. En attendant il veille à la santé physique de ses musicos aimés, l'est sûr qu'au régime qu'il leur impose ils ne prendront pas de poids. Quant à lui le malheureux qui ne sait pas résister à ses mauvais penchants il emmène sa copine au restaurant.

Le résultat dépassera toutes les espérances, au début l'on n'entend que la voix du Capitaine qui écrase l'orchestration, comme vous ne comprenez pas l'anglais vous êtes dispensé de toute interprétation. Ensuite votre oreille est accaparée par un saxophone omniprésent. Non, ce n'est pas Jerry Rafferty, c'est le Capitaine, il ne sait pas en jouer, mais que cela ne vous empêche jamais de vous servir d'un instrument. D'ailleurs les musiciens qui derrière lui sont des cadors se voient imposer des tempos déstabilisateurs, rien ne tient debout, la rythmique boîte et se casse la figure à tous les pas. Le bon vieux tempo du blues est totalement dévasté, jeté à la poubelle, s'agit pas de chanter mais de dramatiser des effets de voix, parfois de temps en temps vous saisissez un riff mais dans la seconde qui suit, tout le monde s'emploie à le frapper par terre, à l'écraser à coups de bottes, à le hacher tout menu pour que désormais vous soyez convaincu que c'était une illusion musicale. Le Capitaine intervient souvent, il ne chante pas, il commente, il imite les voix off des films d'horreur, il vous raconte une histoire comme si vous étiez un petit enfant. La narration vous passe par dessus les neurones mais vous ne voulez pas vous endormir sur de si inquiétantes atmosphères, alors vous en redemandez encore et encore, à tel point que vous commencez par en devenir addict. Si vous survivez à la première écoute, si vous avez le courage de traverser la fosse aux serpents, il vous faudra l'écouter in extenso trente-cinq fois avant de vous rendre compte qu'une cohérence musicale gît au fond du marécage. Trout Mask Replica c'est une curieuse alliance de ménagerie du cirque Bouglionne, de recette de camembert frit et de rock'n'roll déjanté. Avec en fond des rengaines de vieux blues aussi venimeux que des aspics qui nichent dans les arbres fruitiers.
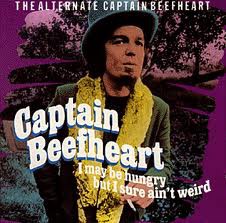
Le disque sortit en 1969, en avance de quinze ans sur son temps. Peu de succès, il faudra attendre l'explosion punk et plus tard la généalogie – bruitisme – dada - lettrisme – situationnisme - surréalisme - qu'en dressera Greil Marcus dans Lipstick Traces ( voir KR'TNT ! 1 136 du 21 – 03 – 2013 ) pour en évaluer la portée. Grâce à lui le rock s'est approprié toute une partie de la musique contemporaine. A ramené l'art de l'élite dans la rue. A détruit les tours d'ivoire compassées des musiques évoluantes.
COMMENT CONTINUER ?

Après un tel chef d'oeuvre, Le Capitaine aurait dû saborder son navire et se perdre corps et bien avec lui. Difficile de faire mieux. D'ailleurs il n'y parvint pas. Continua à enregistrer ses disques, mais aucun n'atteignit une si folle magnificence. Certains se vendirent beaucoup mieux que sa truite vagabonde, pas du tout chopinesque, mais musicalement ils se tiennent en retrait. Commercial. Diront les mauvaises langues. Les fans n'ont pas manqué de le lui reprocher. Un peu plus préhensibles par des oreilles habituées à des harmonies fluidifiées, modulerons-nous. Certains n'hésiteront pas à qualifier certains albums de soupe à l'eau sans sel. Le Magic Band changera souvent de musiciens, travailler trois années de suite dans l'équipage du maudit rafiot était usant. Le capitaine toujours aussi insupportable, usant de son ascendant naturel pour imposer ses vues et ses idées. Beaucoup partent fâchés, mais aucun ne regrettera son passage sur la nef des fous.

Toutefois les évènements finirent par se retourner contre le Capitaine. Une grande gueule qui promettait beaucoup et signait n'importe quoi sur un coup de Trafalgar. Se fâche avec Zappa qui question caractère lui ressemble beaucoup et qui finit par perdre le contrôle et la propriété de son propre label... Au début des années 80, il est difficile de se procurer les disques du Capitaine, trop de procès en cours... L'équipage des matelots excédés est de moins en moins chaud pour se lancer en d'épuisantes tournées qui ne leur ramènent que très peu d'argent...
DERNIER PORTRAIT

En 1982, le Captain n'a plus le beefheart à la tâche. Il abandonne la musique. N'y reviendra plus. Retourne à ses premières amours, la peinture. Avait souvent illustré ses pochettes de ses dessins mais là il a définitivement changé de cap. Finira par devenir un artiste connu, coté et respecté. Mais ses apparitions se font rares. L'aventurier se calfeutre chez lui, se débat contre la sclérose en plaques. Qui le maintient sur un fauteuil roulant et qui finit par triompher de ses entêtements magistraux en décembre 2010.

Captain Beefheart a été un pionnier en son genre, tout une partie de la musique d'aujourd'hui, Post-Punk, No Wawe, Indus, Noise, se réclame de son oeuvre... Loin de nos racines sacrées, mais seules survivent les espèces qui engendrent assez d'individualités déviantes pour pouvoir s'adapter à de nouvelles conditions imposées par les circonstances d'un univers en perpétuelle mutation. Ce n'est pas le monde qui a grandi, vous diront les lézards, ce sont les dinosaures qui ont rétréci.
Tirez-en les conclusions que vous voulez.
Damie Chad.
PS : si vous n'aimez pas le Capitaine, lisez quand même surtout si vous appréciez la belle prose françoise, Le Cat Zengler s'est surpassé.
22:05 | Lien permanent | Commentaires (0)


