20/03/2014
KR'TNT ! ¤ 181 : GODFATHERS / SPUNYBOYS / FABIENNE SHINE / LES ENNUIS COMMENCENT
KR'TNT ! ¤ 181
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
20 / 03 / 2014
|
GODFATHERS / SPUNYBOYS / FABIENNE SHINE LES ENNUIS COMMENCENT |
LE BATOLUNE / HONFLEUR
11 -03-14 / THE GODFATHERS
Ca Cogne Avec Les Frères Coyne
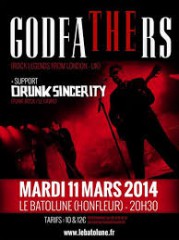
Les frères Coyne règnent désormais sur Londres. Les autres gangs ? Liquidés. Comme par enchantement. Personne n’ira accuser Peter et Christopher Coyne d’avoir fait le ménage. Ce serait beaucoup trop risqué. Et de toute façon, il n’y aura jamais de preuves. Ce sont des pros.
Comme le font quasiment tous les gangs, ils se montrent sous un jour respectable en exerçant une activité de façade. Les frères Coyne auraient très bien pu ouvrir un garage, une teinturerie ou un restaurant exotique. Ils ont préféré monter un groupe de rock. Et comme ils ont un sens de l’humour très abrasif, ils ont choisi d’appeler ce groupe The Godfathers. C’est un peu comme si les frères Kray avaient en leur temps monté un groupe s’appelant The Proud Killers. Mais les célèbres Kray twins n’ont jamais osé pousser le bouchon aussi loin. Attention, les frères Coyne sont d’une autre trempe. Pour eux, c’est un jeu que de s’afficher comme les parrains de la pègre dans les clubs et dans la presse musicale. Ils ne manquent pas de toupet. C’est leur façon de narguer ouvertement Scotland Yard et une opinion publique britannique toujours aussi attachée aux principes de bienséance.
En trente ans de «carrière», les frères Coyne ont perdu pas mal de lieutenants. Mais ils ont réussi à maintenir le niveau de leur activité de façade assez haut. Entre deux gros coups montés, ils ont toujours pris soin d’enregistrer un bon album studio. Aujourd’hui, on en dénombre six.
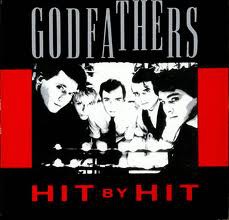
Peter et Christopher Coyne ont dû bien se marrer en choisissant le titre de leur premier album paru en 1986 : «Hit By Hit». Ça faisait probablement référence à leur technique d’interrogatoire. Elle consiste à taper méthodiquement dans le nez du captif. Un coup après l’autre. Et pif et paf. Ça finit toujours par marcher. En dépit de cet aspect trashy pas très sympathique, l’album est excellent. «I Want Everything» et «This Damn Nation» sont des énormités imparables. Peter Coyne chante avec la voix d’un prédateur et croyez-moi, il n’a absolument aucun effort à fournir. Ces mecs manient les guitares aussi bien que les calibres et on se retrouve avec un son plein comme un œuf, des clap-hands à foison et des chants tirés vers les cimes de la plainte. Quand on entend ça, on pense à tous ces vieux héros de la pègre comme Lucky Luciano ou Don Corleone. Nul doute qu’avec des guitares dans les pattes, ils auraient fait tout autant de ravages. «This Damn Nation» est un vrai festival de power-chords à l’anglaise, extrêmement convainquant. On sent chez ces rois de la pègre un goût prononcé pour le rock classique, une sorte de pub-rock solidement charpenté, pas loin de ce que faisait Doctor Feelgood sur ses deux premiers albums. «Can’t Leave Her Alone» sonne comme un vieux fonds de commerce judicieux dont les racines plongeraient dans la beatlemania. Ils sortent sur ce cut un son ample et radieux. On retrouve là cette radicalité qu’affichaient les Inmates dans «Meet The Beatles». Ils attaquent la face B avec une reprise somptueuse qu’ils continuent de jouer sur scène, le fameux «Cold Turkey» de John Lennon. Ce choix relève cette fois encore de l’humour le plus caustique, quand on sait que les frères Coyne contrôlent le trafic de stupéfiants à Londres, depuis qu’ils ont éliminé le gang des Pakis et celui des redoutables Grim Reapers de Glasgow qui avait racheté une centaine de pizzérias de quartier pour écouler de l’héro mal coupée à la tonne. Les frères Coyne ont transformé ces points de vente en «fast-food utilities» dans lesquels on sert de la dinde grillée, mais froide, comme dans la chanson. Ils reshootent de la vie dans les veines du vieux standard de John Lennon qui du coup prend l’apparence d’une belle énormité - I wish I was dead - et Peter Coyne pousse de véritables cris de guerre. Vous n’entendrez rien d’aussi sauvage ailleurs. «Sticks & Stones» est un rock sérieux et agressif, mordant et puissant. On sent la rogne des deux frères. On sent qu’ils aiment le steak saignant et le freakbeat fumant. On sent qu’ils adorent botter le beat, blaster le bulbe, brasser les bucks et briser des branches. On retrouve toute cette ultra-puissance dans «I’m Unsatisfied», toute cette viande rocky à l’anglaise, le même soin de remplissage du son, les mêmes riffs briseurs de crânes et toutes ces volées incendiaires. Ils font du MC5 à l’anglaise. Ils plongent le rock dans la marmite d’huile bouillante, comme s’ils y plongeaient la tête d’un chef de gang ennemi. Et leurs riffs incendiaires éclairent le smog londonien.
Quand cet album est ressorti vingt ans plus tard avec des bonus, on retrouvait sur le second disk des choses exceptionnelles, et notamment une version live de «Can’t Leave Her Alone» avec un son purement dollsy, plein du décousu de la bringueballe et de chorus improbables tirés de «Twist & Shout». Version fascinante. Peu de groupes ont à ce point singé les Dolls. Version live de «Cold Turkey» montée sur un drumbeat tribal. On sent bien la pulsation de la mort dans cette version et on plonge avec eux dans un océan de distorse. Ces types ont tout ce qu’il faut pour jouer un tel morceau, la violence et les couilles. Ils brassent le malaise. Ils font deux autres reprises à la suite, le «Blitzkrieg Bop» des Ramones et «Anarchy In The UK» des Pistols. Spectaculaire.
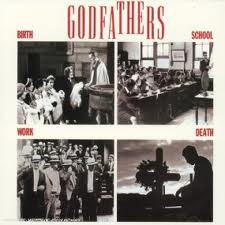
«Birth School Work Death» est sorti deux ans plus tard. Le morceau titre de cet album est monté sur un joli groove de basse de Christopher Coyne - And I need your sympathy/ There’s nothing in this world for me (j’ai besoin de votre sympathie, car il n’y a rien pour moi dans ce monde). C’est dur, mais c’est si vrai. «It’s So Hard» est un morceau épouvantablement bon, pas loin de ce que faisaient les Mary Chain. Les frères Coyne ne trempent pas que dans la violence. Ils trempent aussi dans l’excellence. Retour à leur sens de l’humour un peu particulier avec une véritable drug song, «When Am I Coming Down». Voilà un truc épais et psyché, une belle tranche fulgurante de freakbeat trippant. Peter Coyne se coince la langue dans les dents pour bien faire les choses et décrire sa vision du purple haze. Si Al Capone entendait ça, il serait plié de rire. Peter Coyne camé ? Warffff ! Warffff ! Il en avalerait son cigare. Pour «STB», ils retrouvent le gros son pub-rock à la Dave Edmunds. C’est du solide, du rock à toute épreuve. «Lover Is Dead» est une très belle pièce de power pop à l’anglaise qui force l’admiration.

«More Songs About Love And Hate» vaut son pesant d’or, avec des grosses pièces de r’n’b à l’Anglaise comme «She Gives Me Love», avec ses hits solidement drumbeatés comme «How Low is Low». Vraiment, les frères Coyne savaient cogner dans le mille. Quoi qu’ils fassent, c’est toujours du solide. Avec «I’m Lost And Then I’m Found», on reste dans le boogie à l’anglaise avec des paroles rococo, des histoires de princesse et de junkie friends. «I Don’t Believe In You» est beaucoup plus ambitieux, c’est un vrai cut de compétition. Ils rendent aussi un hommage à Johnny Cash avec l’excellent «Walking Talking Johnny cash Blues». Et Vic Maile nous produit tout ça aux petits oignons.
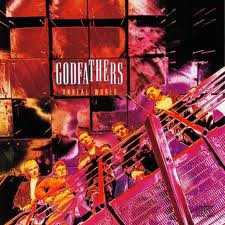
L’album suivant s’appelle «Unreal World». Encore un disque honnête qu’on écoute avec une sorte de respect. Des morceaux comme «Don’t Let Me Down» ou «King Of Misery» manquent de glamour, mais il est vrai qu’on ne peut pas tout avoir. Ils nous font le coup de la belle pop éthérée avec «Believe In Yourself». On retrouve des guitares grosses comme des boudins de Pithiviers dans «I’ll Never Forget What’s His Name». Ils nous servent ensuite une reprise des Creation sur un plateau d’argent : «How Does It Feel To Feel». Ils sont monstrueusement bons. Le guitariste de l’époque n’a rien à envier à Eddie Phillips. On se régalera aussi du joli shuffle de «Something Good About You», un cut bien emmené, drumbeaté à la sauvage, avec des pointes sévères suivies de gimmicks insistants. Refrain à l’anglaise dans un air serein plein d’extravagances harmoniques. C’est le batteur qui mène l’affaire. Il tarpouille dans le fromage. C’est admirable, très britannique. Encore une drug song intéressante avec «I Love What’s Happening To Me», grosse lancinance, c’est du Primal Scream à la ramasse, une drug song extrême, ils descendent à nouveau dans l’univers magique des Beatles, c’est bien vu et admirable, digne de «Strawberry Fields», digne du raffinement de Syd Barrett, avec de belles atmosphères passagères et des refrains à l’unisson - I know for sure - aimable descente dans le gros son électrique des années fastes. John Lennon serait fou de ce refrain. Magnifique d’excellence permanente. Il s’agit là probablement du plus grand hit involontaire des Godfathers.
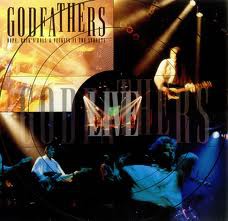
En 1992, ils sortent un premier album live : «Dope Rock’n’Roll & Fucking In The Streets». Tout un programme. On retrouve tous les hits des quatre premiers albums, comme cette vraie compo de truands qu’est «Obsession» et toutes les drug songs de rêve, «When Am I Coming Down», «I Love What’s Happening To Me» et «Cold Turkey». On retrouve aussi la belle pop élégante de «Don’t Let Me Down», embarquée au chant par Peter Coyne. Il chante ça en pur cockney et c’est une vraie perle de juke. Ils alignent leurs autres hits, des romp purs et durs comme «Cause I Said So» - riffé à la Cold Turkey et hardiment cocoté - «This Damn Nation» - bien allumeur et sacrément atmosphérique - et «This Is War» qui n’est rien d’autre qu’une pure stoogerie.
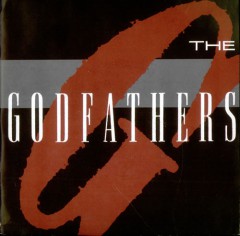
Nouvelle énormité des bas-fonds avec l’album «The Godfathers», que tout le monde appelle l’orange, à cause de sa pochette. Ils ont à cette époque Chris Burrows comme lieutenant affecté à la guitare. C’est un féroce. Il joue énormément de notes. On retrouve le son très guitaré des frères Coyne. C’est leur marque. C’est même une sinécure. La guitare ne lâche jamais la grappe du chant. «Trip On You» est une véritable horreur garage, une bête monstrueuse posée sur des gros pontons garage. En entendant ce truc-là, on comprend que les Godfathers savent défoncer un portrait. Chris Burrows s’y montre particulièrement incisif. On n’entendra pas souvent un guitariste aussi pointu dans l’acéré. «That’s The Way I Feel» est beaucoup plus joyeux, et même franchement cool et bien emmené. Pas de stress. On y va comme on y va, don’t break me down. Ça sent un peu le freakbeat et les ambiances garanties des sixties, c’est solide en l’état. Tout y est : le chant hargneux et les gros accords majeurs. That’s the way I feel et Christopher Coyne envoie ses chœurs, don’t break me down. Juteuse opération. Avec «Help Me Now», on tombe sur une vraie atmosphère et des montées en température. Fabuleuse cuisine psyché. Les frères Coyne sont de véritables démons. Ils nous sortent là un modèle de gros rock élégant et bardé d’accords écroulés, digne des grands classiques du rock anglais. Encore pire, «Losing My Mind», une nouvelle drug song puissante comme ce n’est pas permis - where’s my mind baby - on dirait les Stooges - I can’t seek the situation - ça grouille de gimmicks de dingue, c’est wha-whaté à outrance. Stupéfiant. Peter Coyne revient inlassablement, il harcelle le cerveau du captif. Attention, ce n’est pas fini. «She Said» part en bossa nova et baaam, ça tombe dans l’épique. Avec ce genre de mecs, il faut s’attendre à tout. Ça explose dans des conditions idéales et on entend un hymne - hey hey hey - c’est incroyable d’inventivité, on voit ces soudaines grimpettes dans l’oracle et tout éclate au grand jour et ce fou de Burrows n’en finit plus de faire vomir sa guitare. Ils ont aussi un vrai punk-rock, «Time Is Now», qui est d’une violence atroce, un véritable haut de gamme dans le genre. L’achat de la réédition CD de cet album est chaudement recommandé, car on y trouve un second disk bourré de bonus tous aussi explosifs les uns que les autres, comme par exemple ce «I’m Gone» qui est la vraie pétaudière de la Reine Pédauque. On y retrouve aussi la puissance tellurique de «Losing My Mind», l’indéniable classicisme de «Help Me Now» et l’attaque vicieuse de «Strange About Today»
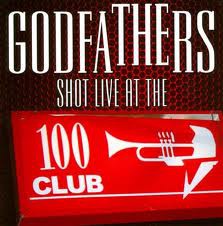
Ils fêtent leurs 25 ans de «carrière» au 100 Club de Londres et pour bien faire les choses, ils sortent un disque live, «Shot Live At The 100 Club», à la fois audio et en DVD. Rien de tel que de voir les frères Coyne en chair et en os à la télé, accompagnés de leurs nouveaux lieutenants, le terrible Del Bartle à la guitare et le petit Grant Nicholas aux drums. On voit jouer l’impayable Christopher Coyne, pieds plats et col Mao. Il balance ses grooves jambes écartées avec une fière allure de bassman Mod. Le gros Del fouille la graisse du son sur ses cordes de guitare. Après un instro d’intro à la Johnny Thunders, ils repassent tous leurs hits à la casserole, «I Want Everything» (I want it naowww !), «I Can’t Sleep Tonight» (et ses chœurs dignes des Dolls), «Love Is Dead» (pur jus dollsy, même son, même désaille, extraordinaire), «Just Because» (même son que le MC5), «Can’t Leave Her Alone» (dollsy à fond), «This Is War» (stoogy comme pas deux, on croit entendre «Loose» - now, look out !), «How Does It Feel To Feel» (pure démence, solo de Del et des chœurs en deux voix dissonantes, effarant), «How Low Is Low» (gluant et malsain), «This Damn Nation» (solide comme un coup-de-poing américain) et tout le reste est à l’avenant. Le disque idéal pour qui veut découvrir l’univers riche et interlope des Godfathers.
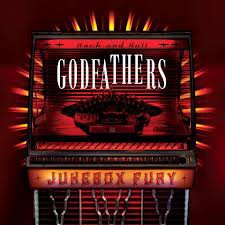
Leur dernier album en date s’appelle «Jukebox Fury». On passe du heavy rock sur-puissant de «Let Your Hair Hang Down» à de la pop anglaise («If I Only Could»). Il semble que ce soit Del qui fasse toute la couleur du son, désormais. Dans «Primitive Man», on retrouve la petite énergie de Doctor Feelgood. C’est solidement battu, chanté gras - daddy was a caveman, so was mum - voilà une belle pièce de pop longiligne portée par du beau guttural. «The Outsider» est raunchy en diable, amoché à la basse, binaire et tribal. Nos cocos nous servent ensuite sur un plateau une reprise de Link Wray, «I’m Branded», bien sentie et sanctifiée. Del se fâche. Il joue gras et fait de la bravache. Avec «Back In The Future», ils enfoncent leur clou dans l’os du rock. C’est puissant au sens anglais de la chose. Pas de place pour le moindre défaut. C’est même désespérant de puissance. Vraiment carré. On dirait du rock en acier. Dans l’esprit, ça pourrait évoquer Motörhead. Et là on tombe sur l’un des hits du siècle : «The Man In The Middle». Un vrai classique, emmené à la basse par Christopher Coyne, c’est le cut de la quête du Graal et derrière Del whawhate comme un démon d’Angleterre. Ces mecs sont même capables de balancer des hits planétaires. C’est là où on finit par les prendre au sérieux. Ils sont effrayants. Voilà le hit du grand banditisme. Peter Coyne sait litaner sur une mer de wha-wha. Et ils envoient exploser leur chanson en plein ciel. Alors ça devient hallucinant, car Del joue un solo de fond d’écran. Ils ne se contentent pas de tenir le milieu londonien et certains politiques par les couilles. Il leur faut aussi le rock. Voilà des gangsters qui méritent bien leur rang d Godfathers. Et pour ajouter une petite cerise sur le gâteau, ils envoient «Thai Night» qui sonne exactement comme un hit de John Lennon.
Les Godfathers étaient montés sur scène en avril 2013 à Beauvais devant une petite assemblée de curieux. La minceur du public n’eut pas l’air de les impressionner et ils firent feu de tous bois. On n’avait d’yeux que pour la classe de Christopher Coyne, le bassman Mod en col Mao qui jouait avec un aplomb de jambes écartées et une rogne édifiante. Ils nous firent le Grand Jeu, comme dirait Roger Gilbert-Lecomte et Del satura l’air beauvaisien de notes grasses dignes de Johnny Thunders. Au bar, la bière n’était pas bonne, mais la musique léchait nos plaies. Nous goûtions ce privilège assez rare de voir jouer au fond de l’Oise un vrai groupe anglais et il ne fallait pas en perdre une seule miette. Ils mirent fin à leur set avec le rituel «Cold Turkey» et disparurent dans les loges sans plus de cérémonie. La fin de la soirée fut assez pitoyable car personne ne vint butiner les disques étalés sur une petite table. Comme si on avait craint d’adresser la parole à de terribles truands. Ils allaient revenir signer des posters. On entendait la grosse voix de Peter Coyne tonner depuis les loges. Nous nous esquivâmes avant qu’il ne réapparaisse.
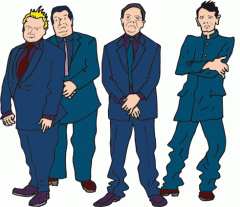
On allait les retrouver un an plus tard, sur la scène du Batolune, par une belle soirée de mars. Comme certaines bouteilles de vin, les Godfathers s’améliorent en vieillissant. Ils percutent de plus en plus et alignent autant de hits que Chuck Berry. Chaque fois on se dit qu’on a sous les yeux l’un des derniers grands groupes de rock anglais. C’est vrai que lorsqu’on fait les comptes, on réalise qu’il n’en reste plus des tas, par rapport au cheptel florissant du temps béni des seventies. Il reste Gallon Drunk, les Wildhearts, Jim Jones Revue, Motörhead, les Buzzcocks, les Pretty Things, The Bevis Frond, Mark E. Smith et puis voilà, on a fait le tour. (On parle ici des gens qui ont à la fois un parcours et des albums classiques au compteur). Les frères Coyne sur scène, c’est toujours expéditif. Ils ne chipotent pas. Ils plient le set d’un coup, enfilent les classiques et percutent comme des rois du ring. Tu veux un vrai shoot de r’n’b, comme disaient les Groovies ? Alors vas voir les frères Coyne ! Évidement, ils démarrent leur set avec «Public Enemy». Ils se radicalisent, Peter Coyne semble devenir de plus en plus méchant. Il promène ses petits yeux cruels sur le public, comme s’il cherchait à assouvir sa soif de violence. Il semble perdre patience, il souffle par les trous de nez, il est excédé par tout, les mouettes d’Honfleur, le genre humain, la routine des tournées, le manque de ferveur du public, il n’arrête pas de réclamer des applaudissements. On sent qu’il crève d’envie de sortir son Beretta et de tirer au hasard dans la foule. Son frère Christopher porte des lunettes à montures noires et un veston croisé qu’il va garder fermé jusqu’à la fin du set. Il patate ses cordes de basse sans médiator. C’est une technique de voyou de l’East End. Il place ses chœurs et joue serré. Il veille à la réputation des Godfathers. Et puis, sans qu’on sache pourquoi, les deux frères commencent à s’insulter. Quelle violence verbale ! Ils font ça en cockney. On frise la catastrophe, car Peter passe la main sous sa veste comme s’il allait sortir son calibre pour tirer une balle dans la bouche de son frère pour qu’il se taise, un peu à la manière de Joe Pesci dans Goodfellas de Martin Scorsese, sauf que là, on n’est pas au cinéma. Heureusement, le gros Del intervient et rétablit provisoirement la paix entre les deux frères. Del porte sa grosse veste en cuir de garde du corps et joue presque tous les morceaux du set sur une Strato. Ils enchaînent les hits - hit by hit - «She Gives Me Love», «Love Is Dead», «When Am I Coming Down», «Johnny Cash Blues», ils ne laissent aucun répit. Del récupère sa guitare rouge sur le tard et retrouve le gros son dollsy qu’il avait à Beauvais. Ils finissent bien entendu sur un «Cold Turkey» d’anthologie et disparaissent laissant le public dans un triste état. Les anglais ont un mot pour ça : screwed. Quand on fréquente les gens du milieu, il faut savoir s’attendre au pire.

Signé : Cazengler, le silly Coyne valet
The Godfathers. Le Batolune. Honfleur (76). 11 mars 2014
The Godfathers. Hit By Hit. Corporate Image 1986
The Godfathers. Birth School Work Death. Epic 1988
The Godfathers. More Songs About Love And Hate. Epic 1989
The Godfathers. Unreal World. Epic 1991

The Godfathers. Dope Rock’n’Roll & Fucking In The Streets. Corporate Image 1992
The Godfathers. The Godfathers. Intercord Record Service 1993
The Godfathers. Shot Live At The 100 Club. Secret Records Limited. 2011
The Godfathers. Jukebox Fury. Godfathers Recordings 2013
De gauche à droite sur l’illustration : Grant Nicholas, Del Bartle, Peter et Christopher Coyne
3 B / TROYES
14 - 03 – 14 / SPUNYBOYS
Quel est ce bolide qui fonce parmi la campagne désertée, traversant les villages endormis, sans respecter ni stops, ni feux, tandis que les radars clignotent comme des gyrophares sur son passage ? Vous l'excuserez, c'est la teut-teuf mobile qui urge – tel le bolide de Robur le Conquérant - vers sa finale destination, la bonne ville de Troyes. L'est partie bien tard de Provins et la voici crissant de tous ses pneus pour essayer à la manière de Marcel Proust de rattraper le temps perdu.
Un, deux, Troyes, c'est parti, je serre les fesses dans les tournants, avec un peu de chance j'arriverai pour le deuxième set. Au hasard j'enfile une avenue à toute vitesse : « Les 3 B, bien sûr je connais ( ah ! Les bonnes femmes dès qu'on leur parle de bouffe, de bière et de baise, elles en savent un rayon ), c'est simple, au deuxième rond-point vous tournez à droite, puis à gauche au deuxième feu et c'est la première à droite. » Le pire c'est qu'elle a raison, je déboule dans la rue Turenne, l'enseigne des trois B est sur ma droite et le parking sur ma gauche.
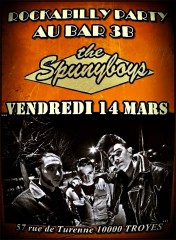
Plein de monde dehors. J'arrive pour la mi-temps. J'ai failli m'encastrer dedans. Aussi gros qu'un destroyer mais pressé comme je suis je m'arrête pile le nez dessus. Non de Zeus, c'est la monstrueuse banane de Rémi qui déborde sur la chaussée. « Salut les Spun's, j'ai raté la première partie ! » « Mais non, on n'a pas encore commencé ! D'ailleurs... » . Mais je ne les écoute plus, dans un troquet faut se faufiler dare-dare pour une bonne place.
Si le monde est petit le bar est étroit. Tout en longueur, je plonge entre les cuirs et parviens à me faufiler juste devant l'espace dévolu aux SpunyBoys, je peux même m'accouder sur un mur de séparation d'un box dont on a retiré les chaises et les tables. Deux mètres carrés avec une densité de population supérieure à celle de la plage de Copacabana un jour d'été dans l'hémisphère austral. Je respire et jette un coup d'oeil autour de moi. Je suis entouré de baleines, drossé contre une sirène qui m'accueille d'un charmant sourire.
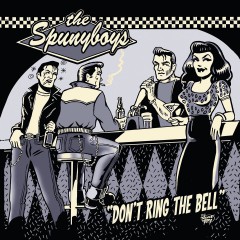
Non je ne divague pas, je ne suis pas en crise de délirium tremens, simplement au milieu du moto club Baleine & Sirène de Courbouvin, que je n'avais pas revu depuis la mémorable soirée de Courgivaud avec les Hot Chikens ( voir KR'TNT 138 du 04 / 04 / 13 ). Sympathiques retrouvailles, mais déjà les garçons tourbillonnants fendent la foule. La rock'n'roll cérémonie peut commencer.
ROCK AND ROLL !
Rémi ironise en s'emparant de sa contrebasse aussi blanche que la Moby Dick de Melville : « Enchantés d'être tous les trois à Troyes ! » Le jeu de mot est foireux précise-t-il mais il ne croit pas si bien dire car ce soir les SpunyBoys vont endosser le rôle du fameux cheval porteur de foudre et de désolation.

C'est à n'y rien comprendre, comment ces loustics peuvent-ils faire autant de bruit à trois ! A peine Eddie a-t-il frôlé les cordes de sa guitare que le baffle devant nous, nous envoie une chiquenaude à stopper un éléphant en pleine charge. Surprise et reflux général, mais comme l'on aime cela on repart de l'avant aussitôt. On connaît les Spuny, n'ont pas l'habitude de jouer dans les maisons de retraite.

Ce qu'il y a de bien avec les Spuny c'est que vous n'avez pas le temps de bricoler une mangeoire pour les petits oiseaux entre deux morceaux. Le premier n'est pas terminé que Rémi annonce déjà le suivant. Temptation Baby de Gene Vincent dont il précise au passage que c'est son chanteur préféré. Je ne saurais que l'approuver. Mais un Tempation Baby à la sauce Spuny, ça donne quoi ? En tant que trio de base, les Spuny ne peuvent rivaliser avec la richesse de l'orchestration originale. Choisissent la seule option possible, là où la voix de Gene bondit et rebondit sous les effets d'un galop de batterie orageuse, ils accentuent le beat initial pour mieux faire ressortir le tranchant de la guitare solo, les doigts de Rémi caracolent sur sa basse et Guillaume nous offre une frappe lourde qui nous ramène à tourbe prégnante du delta.
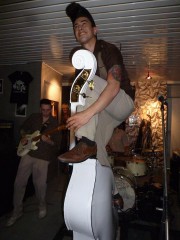
Un an que je ne les avais pas revus et je dois convenir qu'ils ont progressé. Ne nous servent plus les plans habituels du rock and roll, se sont emparés de la chose et l'ont façonnée à leur tempérament, un peu plus appuyée, un peu plus dure et un peu plus rapide que la normale. Quant au spectacle, inutile de l'attendre, se présente à vous dès les premiers instants. Il est impossible à Rémi de rester plus de six secondes en place. S'y morfondrait comme un morpion dans la culotte d'une bonne soeur. Cet homme est dangereux, il brandit à tout bout de champ sa contrebasse. A bout de bras, à bout de pied. S'y couche dessus de tout son long dans la position du missionnaire, ou au contraire s'en sert de perchoir, s'assoit sur la caisse – ressemble alors à un étrange échassier - comme sur un cheval de bois, le manche faisant office de hampe sur laquelle son bras monte et descend. La promène un peu partout dans le bar et finit par trouver un spectateur tout heureux que sa tête serve de réceptacle crânien à un cul de contrebasse. Le Christ a bien fini par trouver un volontaire pour l'aider à supporter sa croix pourquoi Rémi n'aurait-il pas droit à son porte-contrebasse ? Le tout est-il besoin de le préciser sans s'arrêter de slapper et de chanter.

N'y a pas que les américains qui ont chanté du rockabilly, les Spuny rendent hommage à Flying Saucers de Sandy Ford et bien sûr au parangon des groupes Ted, Crazy Cavan and his Rhythm Rockers. L'ambiance est trépidante. Des couples se forment et parviennent à danser un rock and roll sauvage sur une mini-surface où vous auriez du mal à garer un caddy. Ca bouge dans tous les sens et la salle entière reprend les refrains en choeur. Eddie n'y va pas de main morte, il casse une corde qu'il remplace en temps records, comme un changement de pneumatiques sur un circuit de formule 1. N'en est pas calmé pour autant. Se paye dès que l'occasion se présente des minis soli de vingt secondes qui éclatent comme des grenades sous-marines. Et entre temps il mène un train d'enfer assurant les rythmiques avec classe et brio.

Derrière Guillaume n'a pas le temps de regarder pousser les coquelicots. Tamponne ses futs avec une détonante alacrité. Stoppe le chuintement cristallin de ses trois cymbales avec la main. J'adore aussi ses ponctuations finales lorsqu'il tape une dernière fois ses toms et se lève à demi sur son siège croisant et décroisant ses bras en avant et se fige une nano-seconde dans cette position avant de repartir comme si de rien n'était. Devant guitare et basse font semblant d'échanger des coups de pieds, combat de coq à qui le lèvera le plus haut. Un set des Spun's n'est pas de tout repos.

J'ai omis de le préciser, mais derrière les musicos, il y a encore une grande table surchargée de clients. Force attractive du rock'n'roll, des dames d'un âge respectable mangent non pas une assiette de charcuterie à cinq euros que propose le bistrot, mais Rémi des yeux. N'en peuvent plus de cette jeune chair fraîche gigotante emplie d'ardeur, se lèvent et se rapprochent dangereusement. Même qu'une stationne longuement sur le câble électrique de raccordement, quitte à provoquer des micro-coupures de son.
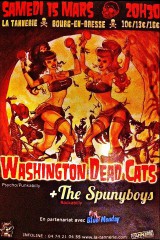
Les Spuny n'en repartent que de plus belle à chaque fois, remplissent notre besace de mirifiques cadeaux, un Johnny Horton heurté de plein fouet, à faire couler un pétrolier avec marée noire garantie, un Buddy Holly à pâmer les anges « All My Love, All My Kissin' » et toute la salle qui ponctue de monstrueux Oh Boy ! Sans compter leurs compos originales comme le superbe Trouble in Town qui possède tout ce qu'un morceau de rockabilly doit présenter pour être certifié avec en prime ce petit plus indiscernable qui n'appartient qu'aux plus grands, cette touche d'authenticity-high-quality qui fait toute la différence.
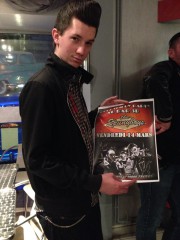
Le set se termine sur une version phantasmagorique de I'm comin' Home de Gene Vincent ( une adaptation-appropriation d'un titre de Bo Diddley ). Rémi brame comme un cerf en rut. Gronde et suffoque de toutes ses amygdales – qui saurait dire le nombre de culottes qui se mouillées en brûlants instants – réveille la bête en nous, celle qui ne dort que d'un oeil, et dont le beat du rock'n'roll accélère nos plus lubriques instincts de prédateurs inassouvis.
ENTRACTE
Le bar est tenu par deux alertes grand-mères qui distribuent les pressions et les gobelets de Jack à la pelle. Me demande pourquoi l'une d'entre elles déserte subitement en cet instant crucial son poste de travail alors que les clients assoiffés se pressent en masse. Dix minutes plus tard elle m'apporte elle-même la réponse. Elle tient en sa main une carte postale des Spunyboys, mais elle la retourne et désigne fièrement du doigt les trois signatures qu'elle s'en était allée quérir. Elle ne sait pas dans quel apostolat elle vient d'entrer. Groupie d'un jour, groupie toujours.
LONG LIVE !
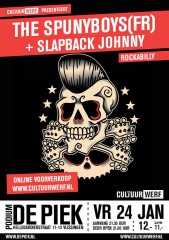
C'est reparti. Un peu mou du genou sur les trois premiers morceaux. Z'ont déployé une telle fougue et une telle entente durant le premier gig qu'ils patinent un peu pour raccorder le train au réseau. Mais très vite ils reprennent leur vitesse de croisière et nous entraînent dans leur folle sarabande. Dans le public, c'est l'extase. Jamais vu autant d'agitation dans un si petit périmètre. Les baleines tanguent comme un essaim de frelons prisonnier dans une bouteille. Sacré roulis, danse du scalp et puisque il est impossible de repousser les murs, le plus excité de tous monte sur les tables. Les Spunyboys arborent un sourire triomphal. Leur musique ne laisse pas la population locale insensible. Et puis que serait le rock'n'roll sans ce grain de folie qui emporte tout !
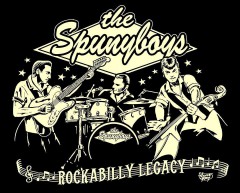
Les Spun's nous sonnent sur le ring avec Don't Ring The Bell et toute une flopée de molotovs du même acabit. Affirment qu'ils ne sont qu'un des maillons de la chaîne de transmission du Rock'n'roll Legacy et le confirment par cette énergie volcanique qu'ils diffusent autour d'eux. Quelques mots en hommage à Mathias, le fondateur de Rockxerre Gomina qui s'en est allé trop tôt. Un passeur. Que la terre lui soit légère. Ne lui feront pas une minute de silence, mais la salle se charge d'un grand charivari d'adieu. Et le cirque du rock'n'roll repart. Sont trop chauds pour s'arrêter. En plus ils sont bloqués comme dans une souricière. Faudra qu'ils montrent douze fois la patte blanche du rock'n'roll avant qu'on ne les laisse sortir ruisselants de sueur reprendre souffle sur la terrasse.
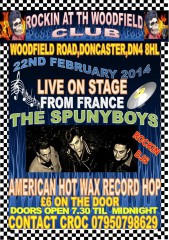
C'étaient les Spunyboys. Encore plus déments que les fois précédentes. Des braises vivantes. Des torches enflammées. Trois volcans en activité qui ne sont pas prêts de se refroidir.
Damie Chad.
PS : seront à Fontainebleau, bientôt.
( Phtos prises sur le facbook des artistes )
JEAN-ERIC PERRIN
SEXE, DROGUES & ROCK'N'ROLL
L'HALLUCINANTE SAGA
D'UNE MUSE ELECTRIQUE
( Romart Editions / 2014 )
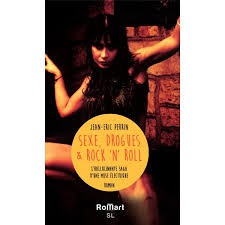
J'en connais – des malheureux – qui situeront plus facilement Jean-Eric Perrin que Fabienne Shine. Normal, Perrin c'est un vague souvenir, l'on trouvait son nom dans l'ours de Best, mais Shine, pas de lumière qui s'éclaire dans le cerveau, l'on profile une excuse vaseuse pour masquer son inculture, tu sais moi des Fabienne j'en ai connu un max, alors... arrête ton c'hard Ben Hur, comme je suis bon prince, je te refile son nom de famille, pas le premier légué par son paternel Essaiagh ( essayez de le prononcer et vous comprenez pourquoi elle ne l'a pas gardé ), mais l'autre celui de la notoriété rock : Fabienne de Shakin' Street.
A votre oeil lubrique qui s'allume à la seule évocation de ce groupe mythique des années 70, je vois que vous visualisez la bête, la féline panthère aux longs cheveux bouclés qui ruisselaient dans son dos, le même type de crinière que Robert Plant, mais en version démoniaque, plus noire que la nuit. D'ailleurs le hennisseur en chef de Led Zeppe ne s'est pas trompé, dès qu'il a vu la Fabienne, il s'est senti poussé des ailes d'étalon. Lui aurait bien brouté la touffe, mais il s'est fait doubler par un collègue.

Rock, sexe et rock'n'roll, l'éditeur n'a pas lésiné sur le titre. Pour la muse électrique faut regarder sur la quatrième de couve pour comprendre que le livre raconte la vie de Fabienne Shine, la chanteuse de Shakin' Street. Enfin presque. Parce que Shakin' Street n'apparaît que dans les cent dernières pages du bouquin. Avant d'être une rock-star, Fabienne a traîné ses guêtres ( disons ses jambes nues jusqu'en haut des cuisses, et beaucoup plus pour les intimes ) un peu partout. Mais pas n'importe où.
Petite précision avant d'entrer dans le vif de la sujette. Ce n'est pas une biographie. Le livre se présente comme un roman. Un roman autorisé, car pour publier tout ce qui est raconté, faut avoir reçu quelque assurance de ne pas se retrouver avec un procès pour diffamation sur le dos.
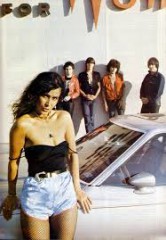
C'est un livre à thèse. Mais pas écrit par un universitaire. Une problématique toute simple, les glorieuses seventies furent des années d'une plus grande liberté que les moroses débuts de notre troisième millénaire. Nous traversons des lustres d'un puritanisme totalitaire qui se cache derrière les posters glacés des nudités étalées à tout vat. Mais que la chair est triste aujourd'hui, l'on ne lit plus de livres et l'on s'ennuie en baisant. Rien à voir avec le joyeux libertinage libérateur des années 70. Jean-Eric Perrin se donne pour mission de conter la vie d'une femme libre dans tous ses aléas. Sans vaseline ni moraline pour faire passer la pilule.
LE CINEMA
Mène à tout à condition d'en sortir. Encore faut-il y entrer. C'est le rêve de la petite beurette, née à Tunis de parents qui s'en vinrent chercher fortune en France. Manquerait plus qu'ils aient réussi ! Milieu culturel très pauvre. Fabienne n'a qu'une envie, celle de quitter un avenir de prolétaire. Commence à grimper les escaliers de la gloire par la plus basse marche, jeune fille au pair en Angleterre. Ce ne sera pas à moi les petits british mais la rencontre inopinée de Nico, qui l'emmène dans le baskstage des Byrds. Tout un symbole, la dolce vita du cinéma italien et le rock américain dans la proximité des stars.
Retour à Paris, job de vendeuse de bonbons – quand on pense qu'elle aurait pu finir comme Sheila – par l'entremise duquel elle rencontre le rebelle sans cause du cinéma français, Jean-Pierre Léaud. Les deux jeunes gens entameront une amitié amoureuse qui ne débouchera sur rien de concret... Un petit rôle dans Le Gendarme de Saint-Tropes ( non, non, ce n'est pas pour rire ) qui lui donnera l'occasion d'entamer une liaison avec... Charles Aznavour. Beaucoup d'apprentis rockers finissent dans la variété la plus insipide. Fabienne se débrouillera pour suivre le trajet en sens inverse.
Bientôt en Italie, amante de Klaus Kinski, drogues, saphisme, bout de film avec Fellini, et cerise sur le gâteau, liaison avec Alberto Moravia, l'écrivain fétiche post-fasciste de l'Italie, l'auteur du Mépris qui l'initie aux joies d'un érotisme cérébral un tantinet borderline... Premier compagnon attitré Richard Dayne Blandford, aventurier, trafiquant, d'un naturel jaloux, qu'elle trompera avec Richard Wright, le clavier du Pink Floyd. Déjà beaucoup mieux qu'Aznavour, mais il lui reste encore des progrès à accomplir.
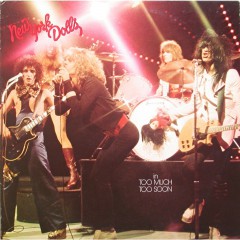
A Paris, Fabienne fréquente Philippe Garrel, cinéaste avant-gardiste, et la bande du Drugstore, fils à Papa pour la plupart, d'où émergeront quelques noms du rock français, Ronnie Bird, Alain Khan, et quelqu'un qui fera beaucoup pour la destinée rock de notre égérie, Marc Zermati... Mais la voici à New York, elle y côtoie une petite blondinette pas dégueu que vous connaissez mieux sous le nom de Blondie et retrouve Johnny Thunders le guitariste des Dolls... Reprise d'une première nuit d'amour qui avait eu lieu à Paris lors de la venue des Dolls en Europe...
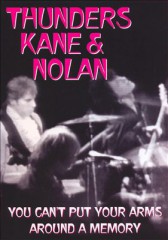
Petit séjour à la Jamaïque, en compagnie de Richard Dayne qu'elle plaquera pour filer avec Brad, pas le premier venu, dealer attitré de Keith Richards, qui l'emmène à Los Angeles, retrouver des gens très bien, des potes à lui. Sunset Boulevard. Hôtel Hyatt.
ROCK'N'ROLL !

On ne peut pas accuser Brad d'avoir bradé la vérité. Fabienne se retrouve au quartier général de Led Zeppelin. Les nouveaux rois du rock. Les seigneurs du tonnerre. L'idylle ne tarde pas à se nouer avec Jimmy Page. Amour partagé. Lui donne des leçons de guitare. Sont inséparables tout le temps de l'interminable tournée américaine de 1975. Fabienne découvre le rock de l'intérieur. Mais Page n'arrivera pas à quitter sa femme et sa fille, et vraisemblablement plutôt sa fille et la mère de sa fille, pour Fabienne. Les rockers n'abandonnent pas toujours les enfants à la Dass...

Après un passage mouvementée par l'Inde, Fabienne est de nouveau à Paris. Marquée ( à défaut d'être maquée ) par le virus du rock, elle monte un groupe - Zermati proposera de lui de le baptiser Shakin' Street, un titre du MC 5 - avec un ami Eric Lévi et d'autres intervenants Corinne Mariennaud et Louis Bertignac qui partiront bientôt former Téléphone...
SHAKIN'TREET
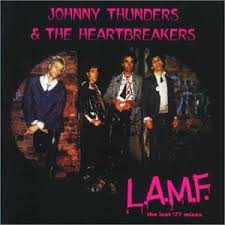
C'est le mauvais bateau. La nef pirate, pas le paquebot à croisières pépères. Shakin Street sera en 1976 et 1977 – grâce à Marc Zermati – au premier et deuxième festival punk de Mont-de-Marsan ( voir KR'TNT ! 177 du 20 / 02 / 14 ), ce qui les inscrit à toujours dans la légende du rock. En 1977, ils ont déjà ouvert en Angleterre pour les Heartbreakers de Johnny Thunders. A la même époque, le Père Noël avait offert à Fabienne un magnifique cadeau de Noël, elle passe le réveillon à Paris avec les Rolling Stones. Si vous avez fait mieux, vous me téléphonez. En 1978 paraît leur premier 33 Tours Vampire Rock, en 1979, ils partent enregistrer leur deuxième disque, Solid As A Rock, avec Sandy Pearlman, le producteur du Blue Oyster Cult dont ils feront les premières parties ainsi que celles de Black Sabbath. Ils sont devenus un groupe américain. Trop gros pour un large public français qui n'aime pas le rock chanté en anglais et trop petit pour le marché géant des USA.
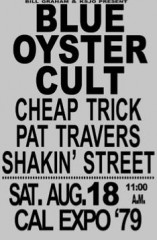
THE END
Revenu en douce France, le groupe s'étiole, surtout que Fabienne est de plus en plus souvent aux States, elle a commis l'irréparable. Elle s'est mariée. Pas avec un rocker. Avec Damon Edge, leader du groupe industriel Chrome. Le mariage tourne au cauchemar Damon boit et est d'une jalousie maladive.... Et Fabienne reste auprès de son mari pas marrant. Un peu incroyable cela, venant d'elle ! L'on aurait pensé qu'elle se serait tirée fissa.
Finira par creve,r at the Edge of the town, la laissant libre en 1995. Exerce un job aux States, de guide touristique... En 2004, 2008, 2009, Fabienne reforme le groupe. Ils enregistrent même un disque et donne des concerts, mais ce n'est plus comme avant. Plus personne ne les attend. Si ce n'est les nostalgiques de leur propre jeunesse disparue... Il ne faudrait jamais vieillir. Le bon temps est toujours derrière soi.
A BOUQUINER
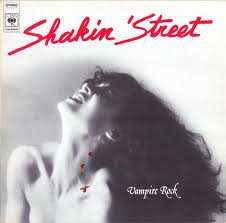
Comme un lièvre. Se lit comme un roman. Ca tombe bien, c'en est un. Shakin'Street restera comme l'un des tout premiers grands groupes de hard rock français. S'inscrit dans la série noire du rock national, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ravissent un public d'amateurs, trop peu nombreux pour leur assurer une zone de survie économique, et disparaissent trop vite sans avoir eu le temps de mûrir. Dans l'indifférence générale.
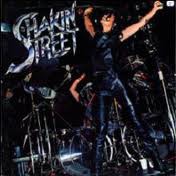
Ne reste plus que la chevelure de Fabienne Shine qui brille dans la pénombre comme un soleil noir. L'aura mordu la vie à pleines dents. Ses jours auront été bien plus beaux que la plupart de vos nuits.
Damie Chad.
KROCKROCKDISCS
SUPERFRIENDS / LES ENNUIS COMMENCENT
The Soviet Secret Bomb / My Radio / I Wanna Getcha / My Psycho Girl / In Space / La Belle Saison / Mexican Radio / Anthony's Gone / Spoutnik My Cat / Suspicion / Dominique Laboubée / Bottle Up & Go !
Atomic Ben / Gus Tattoo / Hugo le Kid / Arno KLX.

Dieu protégez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge. L'avait raison Voltaire, depuis que j'ai mes superfriends à la maison, je n'ai plus de temps à moi. Toujours cette maudite galette à repasser sans fin. Un véritable poison addictif. Pas plus tard que ce matin j'ai dû liquider au fusil à pompe le facteur qui voulait à tout prix me faire signer un reçu alors que j'étais en train de me pencher sur un dossier international particulièrement explosif.
Mon ami le commissaire ( voir KR'TNT 177 du 20 / 02 / 14 ) est venu pour m'aider à réparer les dégâts. J'ai signé une décharge ( au stylo, pas à la chevrotine ) comme quoi il avait glissé dans les escaliers. C'est bien gentil mais cet incident regrettable n'empêche pas que nous vivons dans une époque opaque. Prenez par exemple le premier morceau des Ennuis Commencent.
Figurez-vous que le chanteur Atomic Ben s'était entiché d'une blondinette sexuelle. Vous me direz que lorsque l'on s'appelle Atomic, l'est un peu normal que l'on soit attiré par une super bombe, oui mais quand il a été sûr de son affaire et qu'il a voulu lui mater les dessous d'un peu plus près il s'est aperçu que c'était une espionne soviétique. Jusque là c'est clair comme de l'eau de rock, mais c'est après que surgit le mystère. Comment font-ils pour obtenir ce son électrique rond comme une pierre roulante ? Question sans réponse alors je cherche.

Ca vient de loin, l'explique dans My Radio, déjà tout petit, il écoutait du rock'n'roll sur son transistor. Bref il a pris de mauvaises habitudes trop tôt, et n'a jamais pu s'en défaire. Parents surveillez mieux votre progéniture. Les gamins sont attirés par le vice comme le furent les romains de la décadence par le stupre. Si vous ne me croyez pas, allez sur la plage ( inutile de prendre votre maillot de bain ) 6, In Space dans lequel il passe en revue toutes ses idoles perdues dans l'espace. Remarquons qu'un gars qui cite Dominique Laboubée et Gene Vincent n'est pas dépourvu de finesse et d'esprit critique. L'a dû en passer des heures l'oreille collée sur le haut parleur. Les connaît toutes. Suis sûr de ce que j'avance. Donne des exemples comme Come On, un caillou de Chuck Berry que les Stones ont balancé dans leur propre miroir.
Bref en gros, les six premiers morceaux, électriques à souhait, du british sound comme l'on n'en fait plus, du blues survitaminé au rock'n'roll, ça vous a le dos rond comme un chat noir qui se hausse sur ses pattes et ça ronronne à plaisir. Une fois que vous avez goûté ce ron-ron vous en redemandez. Comment des petits français qui se permettent un truc de cette nature ? C'est impossible. C'est l'espionne soviétique qui a dû leur refiler les plans de fabrication que le KGB avait fauché aux englishes. Un véritable trafic international, puisqu'après ils appliquent la même recette à Mexican Radio. Je commence à piger, un complot interlope qui se transmet par les ondes radio.
Je transmets par téléphone mes découvertes à mon ami le commissaire qui me demande de ne pas ébruiter l'affaire. J'ai sûrement levé un gros lièvre, mais il faut se méfier des services secrets, m'assure qu'il passe tout de suite à la maison pour étudier la situation. Ca tombe bien, dix-sept millième six cent quarante huit fois que je passe The Soviet Secret Bomb de suite. Le voisin pète les plombs. Il me menace de faire sauter mon compteur électrique à la dynamite. L'est en train de sortir son briquet pour allumer la mèche lorsque mon ami arrive. S'interpose aussitôt. Pour le distraire de son noir dessin, il abat d'une balle dans la tête ses deux enfants qui admiraient l'exploit de leur père. En voilà deux qui ne suivront pas le mauvais exemple ronchonne-t-il avant de passer un coup de téléphone pour que l'asile psychiatrique vienne chercher un dément qui vient de tuer ses deux gamins dans son pavillon de banlieue. Les infirmiers l'emmènent alors qu'il hurle qu'il en a marre des ennuis qui commencent...
Enfin au calme nous pouvons continuer à décrypter les fils de l'affaire. L'on s'intéresse à My Psycho Girl et son introduction surfin-yé-yé et cet étrange solo de guitare à la Shadows saturée - aussi improbable qu'une girafe au cou court - l'est sûr que le groupe est une proie facile, lui suffit qu'une fille passe pour qu'ils perdent tous la tête et qu'ils vous pondent une espèce d' hippogriffe chimérique comme l'on n'en voit peu dans l'histoire du rock.
Regarde par la suite comme le climat change, me dit le Commissaire, Splish Splash , « cocaïne is on my head », sûr que ces petits gars ne mangent pas que les trous du gruyère, t'entends le riff, et la batterie, satané boulot, ce ne sont pas des songe-creux. Dès l'intro du morceau suivant mon chien se met à aboyer. J'explique : La Belle Saison, une reprise des Dogs, son groupe préféré. Du coup l'on se passe l'original des Dogs, rien à dire, ils ont su rester fidèle à l'ironie si subtilo-frenchy du combo de Rouen. De la belle ouvrage. Et puis après, il y a ce morceau Dominique Laboubée, rickenbakerien en diable, pour un peu l'on en chialerait. Emotion pure.
Pour Anthony's Gone et Spoutnik My Cat vaudrait mieux que ces titres ne soient jamais sortis. Dans vingt ans l'on se foutra de la majorité de la population française qui sera passée à côté de ces deux pépites. Ca crève pourtant les oreilles que ce sont des chef d'oeuvre de mélancolie catapultante. Un alliage par essence instable, ici miraculeusement réalisé. C'est dingue mais dans ce foutu disque tu trouves toute la tristesse de la vie – à te flinguer tout de suite tellement tu n'en peux plus – et en même temps l'optimisme du rock'n'roll, l'ouverture de tous les possibles.
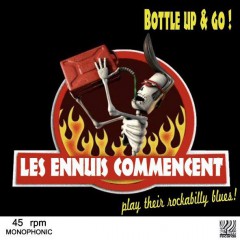
Faisons l'impasse sur le dernier morceau une reprise de John Lee Hooker, il y aurait trop à dire, ne serait-ce que sur la façon dont ils terminent avec ces points de suspension larséniques échoïfiés. Sur cette terre tout redevient poussière sauf le rock qui reviendra dans les eaux originelle du delta. Un peu comme l'or du Rhin. Ces mecs-là ils ont tout compris. La vie, le rock, les filles, le sexe, la mort, les excitants, le drame et la comédie humaine, tu trouves toute la panoplie sur ce disque. En plus ils savent jouer. Une réussite parfaite.
Vont faire des jaloux. Les ennuis continuent.
Damie Chad.
22:48 | Lien permanent | Commentaires (0)
13/03/2014
KR'TNT ! ¤ 180 : CAPITOLS / OBITS + HOT SNAKES / JOHNNY ROTTEN + SEX PISTOLS
KR'TNT ! ¤ 180
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
12 / 03 / 2014
|
CAPITOLS / OBITS + HOT SNAKES / JOHNNY ROTTEN + SEX PISTOLS / |
LOCAL DES LONERS
LAGNY-SUR- MARNE
07 – 03 – 14 / THE CAPITOL'S

Retour chez les Loners. Sûr y avait aussi Carl and The Rhythm All Stars à Montreuil, mais le choix n'est pas cornélien. Les Capitols possèdent les quatre as dans leur manche. Proposent une soirée hommagiale à Gene Vincent. Qui saurait résister à l'appel du plus mythique des rockers ? La teuf-teuf mobile fait la tournées des potpotes, Muriel, Billy, Mister B, nous voici déjà devant le local des Loners, barriques de feu devant la porte ouverte. Question chaleur humaine, les Loner's s'y connaissent.
Ne sont pas pressés les Capitols. L'on ne va pas se plaindre, plein de connaissances à saluer et surtout le temps de zieuter le monument. L'est négligemment couché par terre. Immense et en bois. Vu la vétusté ce doit être des planches recyclées de l'arche de Noé. Le déluge les a sacrément abîmées. Me suis pas trompé de beaucoup, de la dernière guerre. Mondiale. 1939, m'annoncera fièrement son propriétaire. Pas n'importe qui. Pascal. Le bassiste des Capitols. L'ancien lead guitar des Sprites.
Les Sprites ! Un groupe d'importance. Qui remonte à l'antiquité du french rockabilly. Dans les années 80, le premier combo français de qualité qui se soit consacré à reprendre l'oeuvre de Gene Vincent. Possédait une pêche admirable, mais sont arrivés trop tôt. Ne restent d'eux que quelques titres sur des 33 tours anglais. Compilation de groupes en pointe à l'époque. Et aussi quelques CD d'enregistrement d'un concert qui circule chez les fans. Nous avons précédemment rencontré le batteur, Red Dennis, au Rock & Boat qui officiait derrière Al Willis ( voir kr'tnt 176 du 13 / 02 / 14 ). Pascal Guimbard ne se retrouve donc pas là ce soir par hasard. Vient de rentrer en France après seize d'absence passées aux States. L'a croisé et joué avec beaucoup de monde. Ne se vante pas, l'on sent une modestie intrinsèque. Avoue qu'il n'écoute pas que le rockabilly de sa jeunesse. S'intéresse beaucoup au country et à bien d'autres musiques américaines.
PREMIER SET

Les premières notes de Bop Street retentissent... Les Capitols entament leur set. Troisième fois que je vois les Capitols et je m'aperçois qu'avec un répertoire sensiblement similaire, ils ne m'offrent pas le même show. Ne reproduisent pas à l'identique, n'ont pas pris le parti des interprétations figées que l'on réitère à chaque occasion. Vincent serait le premier à apprécier cette manière d'opérer de ré-habiter chaque morceau selon de nouvelles prétentions. Chaque titre originel est un diamant dont on peut varier à volonté les brillances et faire étinceler les éclats selon un nouvel éclairage.

Pascal ne slappe comme un sauvage sur son immense contrebasse. La picore d'un doigt presque distrait. Une caresse coulante qui contourne la tranchante agressivité des morceaux au profit d'un dynamo-swing des plus enlevés. N'oublie pas que Cliff Gallup était un fervent admirateur de Django. A Franky Gumbo de rétablir l'équilibre selon des secousses électriques propulsées à bon escient.

Steff est au chant. Vêtu d'une simple chemise noire, il a délaissé les tricots sweat rayés des Fifties pour une tenue plus classique qui ne rappelle en rien les cuirs funèbres et reptiliens de Gégène. De même, il ne cherche pas à décalquer le timbre si particulier de l'idole absolue que reste le créateur de Be Bop A Lula presque un demi-siècle après sa mort. Pas d'imitation. Essaie seulement de retrouver l'esprit de ces glissandi vocaux, de cette agilité suprême que possédait Vincent, ce qui donnait toujours l'impression qu'il chantait sur le fil d'un rasoir mentholé. Et il se débrouille bien, le Steff. Connaît les morceaux à merveille, ne les décline pas de travers ou à contresens des parti-pris de Gene.

Reçoit de l'aide de par derrière. De Didier le batteur. Pas l'exubérance juvénile de Dickie Harrell mais une maîtrise sans défaut. Pas l'obsession de la caisse claire feulée et feutrée mais la permanence d'un beat assuré, jamais embourbé dans un contre-temps et prêt à tous les démarrages fulgurants. La rigueur sèche de la frappe contrebalance la rondeur moelleuse du jeu de Pascal. L'on pourrait craindre un déséquilibre dans ces deux manières d'entrevoir la ligne d'horizon rythmique, mais au contraire cette divergence se traduit par une assise orchestrale des plus stables.

Ne déroulent pas que le collier des perles de Gene Vincent, entre un Teenage Partner dont on oublie l'écrin des choeurs mis très en avant dans la version la plus connue de Vincent parce que la voix de Steff monopolise la plus grande partie de l'espace sonore et une Race With The Devil dans laquelle Franky Gumbo ne force pas la note, les Capitols intercalent de nouvelles compos. Ce sont les titres du nouveau disque dont on nous annonce enfin – cela fait trois ans que nous l'attendions – la sortie imminente dans une petite quinzaine de jours. Ce sont les morceaux dans lesquels le band entre de plein pot et de plain pied. L'on a même l'impression que Franky donne alors tout son jus dans le gumbo. Remue la soupe avec dextérité, solos plus imaginativement personnels, et stridences plus appuyées. La salle ne ménage pas ses acclamations. Promettent de revenir pour deux autres sets.
DEUXIEME SET

Le retour. Plus dur, plus violent. Franky est davantage en avant, le set en est beaucoup plus électrique. Lignes de fuite et regroupements pour repartir aussitôt. Dans la ligne des Blue Caps. Montées en puissances et brisures éparpillantes. Avec en prime ces cristaux atomiques de retenue que sont des joyaux comme Jezebel ou Cat Man. L'urgence et le fourmillement des chevaux qui se pressent les uns contre les autres avant la charge. Who slapped John ? C'est la grande menace qui plane sur vous avant de se refermer et de vous enserrer dans sa poigne de fer rouge.

Ca survient comme un rêve d'orage. Steff est au summum de sa voix encerclée dans la frappe de la batterie. Ca passe et ça casse comme des poignées de grenades qui retombent en pluie d'acier. Les Capitols offrent encore des titres de leur futur album qui s'intègrent parfaitement avec la play-list spécial Gene. Pas des démarquages, des oeuvres à part entière qui leur définissent un style bien à eux. Des parallélépipèdes de force brute qui donnent envie d'écouter et de posséder le disque au plus vite.
SET TROIS

Les voici de nouveau sur scène. Mais ils vont s'échapper très vite. Steff a repéré les Ol' Bry dans la foule. Les appelle pour qu'ils les rejoignent sur scène. Refile même son Harmony Monterey à Eddie, Franky abandonne carrément sa duo jet 56 à Diego et Tuierry n'a qu'à ramasser la big mama de Pascal, leur laissent les clefs de la maison, sans préavis. N'y a que Didier prisonnier de ses futs qui est condamné à rester. Ce qui n'a pas l'air de l'ennuyer, l'est prêt à collaborer à l'aventure impromptue sans état d'âme.

Deux concerts dans un, nous sommes gâtés. Eddie a compris qu'après le set précédent des Capitols il doit mettre le turbo à fond les manettes pour relever le défi. Pas une seconde à perdre. Les temps morts sont les ennemis des instants magiques. C'est parti un Am I Blue à vous frictionner les oreilles pour le restant de l'année. Un rayon de miel, arrosé au jus de piment. Voudraient redescendre, erreur stratégique, la salle est prête à organiser un défilé de protestation s'ils persévèrent dans cette mauvaise idée. De toutes les manières les Capitols ne sont pas pressés.
Alors on se régale d'une suite Ol Bryenne des mieux venues. Pas un dessert de sucreries Doo Wop, plutôt une entrée teigneuse à la rockab de derrière les fagots qui vous incendie la gorge. Un must.

Enfin les Capitols consentent à revenir, mais il est hors de question qu'ils laissent les Ol' Bry s'échapper dans la nature. Steff et Eddie se décident pour un dernier lingot d'or liquide, un Folsom Prison Blues qu'ils chantent à deux. Font cela si bien que l'on se demande si Johnny Cash ne l'a pas composé pour eux. Je n'aurais pas dû écrire tant de bien sur eux car à la fin du morceau ils nous laissent tomber comme de vulgaires paires de vieilles chaussettes sales. Je me permets de leur rappeler que the great Cash a enregistré un minimum de soixante-dix albums et qu'en cherchant dans leur mémoire ils auraient pu trouver quatre ou cinq autres pépites. Que voulez-vous les rockers sont ainsi, plus vous leur en donnez, plus ils en veulent. Ne se contentent pas du pain des pauvres, vous avaleraient la brioche des riches sans coup férir si on les laissait faire. Merci les Loners pour cette soirée. Un bel exemple de camaraderie rock entre deux combos. Plus l'ombre tutélaire de Gene Vincent. Quand je vous dis qu'il en faut peu pour rendre les rockers heureux !
( Photosde Chris Dixie Straet prises sur le facebook des artistes )
Damie Chad.
106 / ROUEN
28 – 01 – 14 / THE OBITS
LE GROS BEAT DES OBITS
On avait un vague souvenir. Rick Froberg ? Bon dieu ! Mais c’est bien sûr ! Le concert des Hots Snakes au Nouveau Casino, par une chaude soirée de mai 2005 ! Deux guitaristes jouaient dans les Hot Snakes : Rick Froberg et John Reis, le mythique leader de Rocket From The Crypt. Bien sûr, c’est John Reis qu’on venait voir.
Pendant toute la première partie, John Reis se tenait au bar, coiffé comme Eddie Cochran, et il signait quelques pochettes de disques. On avait là un type d’une incroyable gentillesse, aussi facile d’accès et souriant que Phil May. Puis il était monté sur scène pour jouer comme un diable. Il moulinait tellement d’accords sur sa Les Paul blanche décorée de dragons qu’il donnait le vertige. Il n’utilisait aucune pédale d’effet. Il sortait un son direct sur le Marshall. Son son cru vrillait les tympans. Il balançait une incessante purée d’accords extravagants dont l’enchaînement relevait de la plus brutale virtuosité. Il jouait si fort qu’on n’entendait même pas Rick Froberg, planté de l’autre côté de la scène. Comme John Reis jouait à l’extrême droite et Rick Froberg à l’extrême gauche, le centre de la scène restait atrocement vide. Un bassman jouait un peu en retrait. Le pauvre Rick Froberg ne disposait pas du coffre permettant de couvrir un tel ramdam.

John Reis jouait comme un démon. Il remuait la tête en rythme d’avant en arrière, tel un dindon rockab. Il faisait le Cochran avec félinité. Il retombait parfois sur ses pattes, accompagnait ses breaks fulgurants de gestuelles jambaires. Ça tenait du prodige. Il transpirait à grosses gouttes. Même ses mains dégoulinaient. Il était certainement le plus grand rythmique de tous les temps. Il n’y avait pas deux accords qui fussent les mêmes et ses incursions dans les aigus en disaient long sur son abnégation. Il ne semblait n’être sur cette terre que pour le rock’n’roll. On voyait bien la furie pulser dans ses veines. Il grattait ses accords avec une main tordue comme celle d’un poliomyélite. Il turlupinait des moulinets à longueur de morceaux. Son jeu était d’une densité rarissime. Il se situait en dehors du commun des mortels. Avec lui, le rock fumait. Il moulinait industriellement. En pur killer de San Diego, il s’ingéniait à dépasser toutes les bornes.

N’oublions pas que Rocket From The Crypt fut à peu près le seul groupe américain (avec les Screaming Trees) à être encensé par la presse anglaise. Pour «Hot Charity», les Rockets avaient obtenu 10 sur 10 dans le NME, ce qui était exceptionnel, car en la matière les Anglais battent tous les records de chauvinisme. Ce soir-là, les Hot Snakes jouèrent une ribambelle de morceaux nerveux et souvent passionnants tirés de leur troisième album, «Audit In Progress». Ces rockers inaltérables bandaient leurs muscles. Rien ne pouvait leur barrer le chemin. John Reis était la plus grosse locomotive de l’histoire du rail.
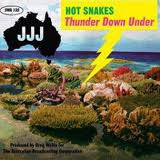
Pour retrouver l’ambiance de ce concert édifiant, il suffit d’écouter l’album live des Hot Snakes qui s’appelle «Thunder Down Under». «Braintrust» nous saute à la gorge, c’est un monstre garage-punk hérissé de gimmicks urgents que John Reis joue d’un petit doigt vicieux. Puis on entend clairement les orgues de Staline, il pleut des power-chords dans tous les coins, sous un ciel noir d’apocalypse. On se tape aussi le vrai punk exacerbé de «Think About Carbs», et Rick Froberg chante la glotte en sang d’une voix de kid nourri aux céréales. Il hurle comme un con sur la rythmique haut de gamme du gentil John, le type le plus charismatique d’Amérique. Autre point fort de ce set live, c’est «Plenty For All», bien poundé derrière, riffé sauvagement, mais le pauvre Rick force sa voix, il manque atrocement de coffre. Rick Froberg n’est pas Chris Farlowe, on l’aura bien compris. Mais le gentil John le laisse hurler dans la tempête sonique et joue ses arpèges jusqu’au bout. «Who Died», c’est l’enfer sur la terre, une stoogerie abominable, feu, flammes, fun, le magma coule. Tous ces morceaux sonnent comme des prouesses techniques. «Kreative Kontrol» est un autre morceau hanté par les gimmicks de John Reis. On entend des harmoniques de fond extraordinaires. Rick Froberg sonne comme un martyre hardcore. Il faut pouvoir le supporter.
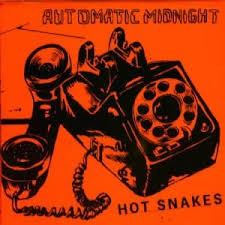
Le premier album studio des Hot Snakes s’appelait «Automatic Midnight». Sur la pochette, comme sur les pochettes des albums suivants, on trouve des dessins de Rick Froberg qui est illustrateur et graphiste à New York. Il avait dessiné un gros téléphone pour le recto et une voiture décapotable pour le verso. À l’époque de sa sortie, ce disque est un peu passé à l’as. À peine un article dans Spin, et bien sûr, on l’achetait parce qu’il s’agissait d’un side-project de John Reis (comme on achetait les disques des side-projects de Mark Lanegan, de J. Mascis, de Kim Salmon ou de Dave Kusworth). Le premier morceau de l’album s’appelle «If Credit’s What That Matters, I’ll Take Credit». On entendra rarement des trucs aussi saturés. Puis c’est bombardé d’accords. Ils sont complètement fous. Ils dépassent les bornes. On croirait entendre la révolution industrielle devenue folle. Seul John Reis pouvait provoquer un tel paroxysme. On retrouve cette énergie démoniaque dans «10th Planet», une belle pièce de garage punk battue comme plâtre. Ces types ont le diable dans le corps. Ils atteignent des niveaux inusités de densité sur-saturée et de grosse excitabilité carabinée. «Our Work Fills The Pews» est monté sur un beat vaudou et ça se met à cavaler. Encore une belle cochonnerie. Rick Frobert hoquette comme un déséquilibré tantrique. C’est l’un des morceaux les plus insidieux de l’histoire insidieuse. C’est la croix et la bannière. Encore une belle accroche mortelle. On retrouve la saturation optimale avec «Past Lives». La basse crache ses poumons. Horrible. Voilà la Dame aux Camélias de la basse dure. C’est d’une sauvagerie à peine croyable. C’est le son de basse dont rêvent tous les psychopathes. Bizarrement, la console n’a rien dit. Voilà encore une pièce d’une violence à peine descriptible. John Reis chante «Mystery Boy» et on sent tout de suite la différence. Il emmène tout à un train d’enfer, de façon puissante et dévastatrice. C’est à la fois éclatant et explosif. On retrouve le grain riche et total de la voix de John Reis. C’est une véritable orgie sonique digne des grandes heures de Rocket From The Crypt. Et puis l’album s’achève avec «Let it Come». On sent qu’il existe des forces souterraines dans le flux des Hot Snakes.
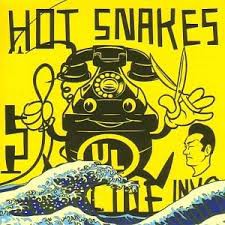
Leur second album s’appelait «Suicide Invoice». Ce fut un disque pour le moins aride, très bousculé, tourmenté et qu’on rangeait avec les disques garage, pour simplifier les choses. Car ce n’était pas que du garage, au sens où l’entendaient les concessionnaires. Les chansons des Hot Snakes étaient beaucoup plus tarabiscotées. On pourrait même dire torturées, mais cette impression était essentiellement due à la voix de Rick Froberg, qui est celle de l’hérétique brûlé vif en place de Grève. John Reis joue dans ce disque à pochette jaune son rôle de locomotive et il emmène un morceau comme «Gar Forgets The Insuline» à fond de train vers le néant. «XOX» est une belle pièce douloureuse et si on aime bien les belles pièces douloureuses, alors on se régale. Rick travaille ça au hurlement. Il crie vraiment comme s’il était ligoté au poteau du bûcher au moment où les flammes commencent à lui lécher le dessous des pieds. Dans «Who Died», on retrouve les bonnes dynamiques des Rockets. Le son est plein comme un œuf de ptérodactyle. Et puis, vers la fin du disque, on va trouver deux pépites garage, «Bye Nancy Boy» et surtout «Why Does It Hurt» qui est tout simplement défenestrateur, car enfoncé à coups de riffs et digne des gros bash-blasts du grand garage intercontinental. Mais ce n’est pas un disque évident, globalement. On l’écoute par curiosité, et peut-être aussi par sympathie pour John Reis.
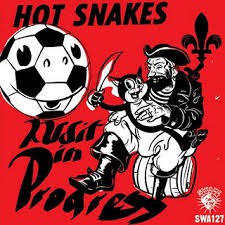
Le suivant, «Audit In Progress», était un gros baboum d’album. On retrouvait sur ce disque tout le percutant du concert au Nouveau Casino, toute la pétaudière rythmique qui n’avait de sens que par rapport à elle-même, car il n’était absolument pas possible de mémoriser le moindre refrain, la moindre fibre mélodique. Ils jouaient la pétaudière de la dérobade de San Diego de façon fulminante et dans une extrême tension pour le simple plaisir de la pulsion pulsative.

Ces dingues battent le fer sans arrêt, «Braintrust» et «Hi Lites» vont tout droit et Rick hurle à travers les flammes de son bûcher. Quand on l’entend chanter, on pense immédiatement à Oliver Reed dans «Les Possédés de Loudun». Les Américains adorent ce genre de disque. Ils qualifient ce rock de ‘edgy’, celui qui va danser la carmagnole au bord du gouffre. Pas de fioritures. Un peu de tarabiscotage, c’est vrai, mais dans les limites de l’acceptable. Le morceau titre de l’album est un garage typique du middlewest, celui qu’on joue à la fourche des deux rivières, là où le ciel se noie dans l’océan de verdure. John Reis rebâtit un monde dans l’espace délétère de la méthode imbue et le pauvre Rick se racle la glotte au sang pour emmener le morceau à l’assaut du néant. On finit par succomber à ce drôle de charme. Avec «Hatchet Job», ils foncent droit dans l’irrationnel rythmique et bâtissent un mur du son totémique gratté à la dure. On assiste au riffage le plus dingue de l’histoire du riffage. Il se dégage de ce morceau une énergie à couper le souffle. Ils épaississent l’atmosphère jusqu’à un taux jusque là ignoré des physiciens. Il coule de ce morceau un jus étrange et bienvenu. Ils nous refont le coup du riffage des fous de l’asile dans «The Mystic Decade», on s’épate de tant d’exactions. C’est épais et violent. On goûte de belles tranches d’apocalypse. Voilà du plombé de très grande envergure. Sur la pochette, Rick a dessiné un nazi qui shoote dans un ballon de foot tout en sifflant sa bière et un chat allongé sur les genoux du pirate va tenter de sabrer le ballon. Tout est dans l’écroulement des civilisations, dans la négation des visages, dans l’oubli de la raison. Avec «Lovebirds», ils forent des voies dans le gruyère de Giger à la recherche de passages inutiles. «Reflex» est un morceau pulsé jusqu’à la nausée. On connaît ce genre de pulsation extrême et on sait où ça mène. Les Californiens adorent rôtir dans les flammes du fameux Californian Hell. Sur ce disque tout est si dense qu’il paraît bien dérisoire de vouloir épiloguer. Tout est si poussé dans le dos qu’il paraît bien dérisoire de vouloir ergoter. Ce que font les Hot Snakes, c’est de la pure suprématie. Ils brisent les flux comme des brindilles et ils effarent l’infidèle.
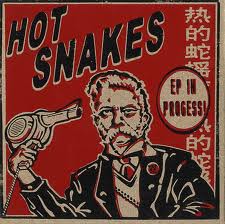
Aujourd’hui, les Hot Snakes n’existent plus, mais il court une rumeur de reformation. Rick Froberg n’est pas resté assis à se tourner les pouces. Il a remonté les Obits et décroché un contrat avec Sub Pop, qui reste un label de référence, aux États-Unis. Les Obits qui ne chôment pas ont déjà enregistré trois albums et comme ils passaient par Rouen pour jouer au 106, on a profité de l’occasion pour aller les applaudir.
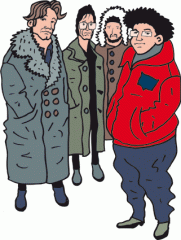
Sur scène, ça se passe exactement comme sur les disques. Pendant un bon moment, il ne se passe rien, on pense à autre chose, à tout et à rien et puis, clic, comme ça, sans qu’on sache pourquoi, ça se met à fonctionner. On sent bien qu’ils s’investissement dans leur musique et que leurs compos reflètent un gros travail en amont. Ça se voit. Presque trop. Ils sont extrêmement sages et concentrés. Ils travaillent des gros grooves et font parfois jaillir des purs moments d’émotion et on se rassure en se disant qu’au fond ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais à part Rick Froberg, aucun Obit n’a la dégaine d’un rocker. Le bassiste Greg Simpson joue posément sur sa basse Rickenbacker. Le petit Sohrab Habibion tisse sur sa guitare des trames qui viennent s’entrelacer avec le jeu un peu libre de Rick et derrière le batteur bat son beurre comme tous les autres. Il faut vraiment se pencher sur leur cas si on veut espérer en tirer quelque chose. Je veux dire par là que leurs morceaux ne sont pas d’une grande évidence.
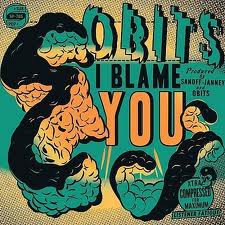
«I Blame You» fait partie de ces albums qu’on ne réécoute pas souvent, bien qu’ils sachent se montrer par certains côtés très sympathiques. «Widow Of My Dreams» semble être leur hit. Dans «Pine On» on tombe sur de bonnes idées de riffs et ça sent bon la poignée des gaz. Ils recherchent l’admirabilité des choses. En écoutant «Fake Kinkade» on sent que les anciens dieux de la puissance se sont penchés sur le berceau de cet album. Rick et ses amis sont vraiment décidés à en découdre avec l’adversité. Le beat des Obits se dresse fièrement. C’est le troisième morceau de l’album et jusque là, c’est un sans faute. L’oreille du vieux pingouin désarçonné se redresse. Dans «Two Headed Coin», on voit la voix de Rick errer comme une hyène sur un beat tendu et bien dru. On sent leur allant sous l’étoffe. Ils sortent un beat exotique pour «I Blame You», instro court et ambitieux. Le cocktail surprend par la verdeur de son ingéniosité. Les morceaux qui filent dans la nuit comme «Lilies On The Street» font beaucoup de bien aux équipes de la veille technologique avancée. Le bassman joue son motif avec une régularité édifiante. C’est un vrai mètre étalon. «Sud» est un morceau droit, très droit. Il ne s’arrête jamais et c’est très bien. Ils balancent une version grungy de «Milk Cow Blues» et terminent sur un garage de surboum, «Back And Forth», comme s’ils avaient décidé de réveiller nos plus bas instincts.
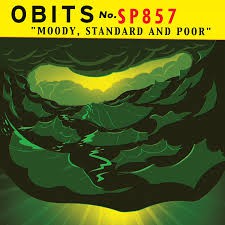
L’album «Moody Standard And Poor» intrigue aussi au plus haut point. Rick Froberg n’a pas vraiment de voix, alors il doit crier. Lui et ses amis semblent se jeter dans des grooves cavalants qui ressemblent à des combats perdus d’avance, comme avec «I Want Results». Il tapent dans le mille fois déjà fait, dans l’excellence du sert à rien, ils sont appliqués et convaincus, ce qui fait leur force. Pendant que Sohrab et Rick croisent leurs chorus, Greg le bassiste joue calmement. «Everything Looks Better Than The Sun» sonne comme un beat mille fois éculé. Pourquoi choisissent-ils de rester les deux pieds dans le même sabot ? Ils ne sortent pas de la routine du college rock cuit et recuit, et pourtant ils parviennent à lancer de petits éclairs intéressants. Ils travaillent les ambiances au corps, ils cherchent des passages dans les récifs. Il faudra fournir des efforts considérables pour comprendre leur démarche. C’est de part et d’autre un travail de fourmi. Avec «Killer», ils n’en finissent plus de poppiser dans la sub-popperie, et le mixeur complique encore les choses en sous-estimant la voix d’hérétique supplicié de Rick Froberg. «Shift Operator» sort enfin des caves de l’ordinaire. Voilà le lapin blanc qu’on attendait, plein de belles atonalités chromatiques et de déviations bienvenues. Dommage qu’ils n’aillent pas dérailler plus souvent. Les gros trucs sont sur la face B, et notamment «Naked To The World», grosse pièce garage inespérée et fièrement interprétée. «New August» est monté sur un beat drôlement rebondi. Ils font un tour à vide. Voilà leur truc : le groove. Le traitement avoiné des espaces intermédiaires. Ils ne s’embarrassent pas avec les sentiments. Ils automatisent leurs pulsions fictionnelles et bloquent le cap sur le cœur du ventricule. Très belle pièce, cisaillée à l’acide, roulée dans la basse, pétrie de mad psyché. Tout s’éclaire, le monde des Obits s’ouvre comme la vulve de Draculette et on fonce vers les profondeurs humides du monde sidéral.

«Bed And Bugs», leur troisième album, grouille de petites bêtes. Tous ceux qui ont chopé des morpions savent de quoi il s’agit. Rick le graphiste a encore fait des siennes en perçant la pochette du vinyle et en la décorant ce motifs géométriques. On se retrouve confronté au même problème : démarrage problématique, et puis, clic, ça accroche. Rick chante hurlé son «Taste The Diff» et son «Spun Out» et on tombe sur l’insidieusement rampant «It’s Sick», qui a la structure d’un gros hit garage-pop. Rick pousse son refrain dans les orties comme une grand-mère. Franchement, ce sacré coquin se plaît à cultiver le malsain. «This Must Be Done» gagne la sympathie. C’est un étrange morceau dont le fond grouille de petites guitares insidieuses. On sent chez ces gens-là une nette volonté de nuire aux oreilles d’autrui. Il cultivent le mystère et semblent ricaner comme des sorcières de Walt Disney. Rick chante très haut dès l’intro son «Pet Trust». Il nous vinaigre les oreilles. Il passe son temps à se racler la gorge. Le morceau reste terriblement ambitieux et fait partie de ceux qui nécessitent plusieurs écoutes. Et puis on tombe sur une petite perle qu’il faut bien qualifier de Dada : «Besetchet», un instro passionnant qui colle au palais comme un loukoum de Michel Tournier. C’est avec une ardeur renouvelée qu’on saute sur la face B et là on tombe sur «Operation Bikini», morceau pressé, au parfum post-punk et on se demande où ils vont chercher des idées pareilles. «Malpractice» se voit monté sur une ligne de basse rapide. Ils jouent là au jeu du calme avant la tempête, l’ancienne spécialité des Pixies. C’est très accrocheur et ça rétablit leur honneur. «This Girl’s Opinion» se caractérise par une bonne ambiance classique et une grosse tension d’accords pantelants. C’est en cocotant qu’ils cherchent leur passage à travers les récifs. On finit par tomber sur de vraies perles, comme «I’m Closin’ In», pur garage digne des géants des sixties. Voilà un morceau solide, bon et cuivré comme le guerrier Apache déterminé à poursuivre le combat jusqu’au bout. On se délectera de «Machines», morceau mystérieux qui aurait beaucoup intéressé Jules Verne et Rick nous dit adieu avec «Double Jeopardy», un instro mystique qui serpente dans la nuit étoilée comme un Arsène Lupin en rut.
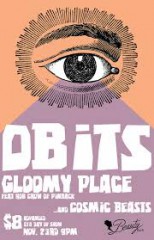
On finit par se faire avoir avec les Obits, même s’ils ne sont pas d’un accès facile. Mais leur manque total de prétention les rend infiniment sympathiques. Leur vraie force est certainement leur singularité. Ils défendent l’idée d’un rock ambitieux qui risque de les couper d’un monde devenu impitoyable et affamé de médiocrité.
Signé : Cazengler, sur l’orbite des Obits
The Obits. 28 janvier 2014. Au 106 à Rouen.
Hot Snakes. Automatic Midnight. Swami Records 2000
Hot Snakes. Suicide Invoice. Swami Records 2002
Hot Snakes. Audit In Progress. Swami Records 2004
Hot Snakes. Thunder Down Under. Swami Records 2006
The Obits. I Blame You. Sub Pop Records 2009
The Obits. Moody Standard And Poor. Sub Pop Records 2011
The Obits. Bed And Bugs. Sub Pop Records 2011
De gauche à droite sur l’illustration : Greg Simpson, Rick Froberg, Alexis Fleisig et Sohrab Habibion
SEX PISTOLS
ROTTEN PAR LYDON
Keith & Kent Zimmerman
( Camion Blanc / 2005 )
Les Sex Pistols auront fait couler davantage d'encre que de sperme. Alors autant donner la parole à leur porte-drapeau qu'à un quelconque chroniqueur. Johnny Lydon se raconte. Pas tout seul, ses propos sont coupés d'interventions plutôt courtes d'une vingtaine de témoins de l'apocalypse Pistols qui dans leur grande majorité ne font que confirmer – à quelques nuances près – les dires du principal narrateur. A de rares moments l'on donne la parole à quelques privilégiés dont les dires sont alors secondés de brèves interventions de Johnny.
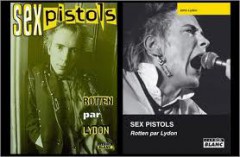
Le livre original est paru – voici longtemps déjà – en 1994 aux Etats-Unis. A une époque où le personnage était encore une figure mythique et avant-gardiste du rock'n'roll. Ces vingt dernières années, le chantre du punk a été rattrapé par une télévision qui cherche davantage les parts de marché publicitaires que le progrès intellectuel des masses. Malgré quelques gros mots judicieusement placés en direct la figure du leader charismatique a pâti de ses trop fréquentes apparitions. L'image publique de Johnny Lydon n'a pas la force décapante de la gueule vindicative du jeune Johnny Rotten. Il est toujours difficile de se survivre quand le meilleur de votre existence vous a été distribué à l'orée de votre jeunesse.
CLASSE
Consacre cent pages sur 460 à nous parler de ses années de pré-pistoléros. Johnny Rotten n'oublie pas d'où il est sorti. Pas uniquement du ventre de sa maman. Avant tout de la classe ouvrière. N'est pas un militant, ni un révolutionnaire, mais il tient à sa revendication. Fils de prolétaire. Un père qui ne fait pas de cadeau pour mieux enseigner la dureté de la vie à ses quatre garçons, une mère aimante et un taudis insalubre dont il retirera à l'âge de sept ans une méningite qui ne partira pas sans laisser quelques séquelles épileptiques et une étrange fixité du regard.

L'aurait pu en devenir idiot, mais l'année d'immobilité sur un lit d'hôpital lui permettra plutôt d'activer ses neurones. Ne faudra pas le lui faire. Acuité intellectuelle aiguisée. Ne sera plus jamais dupe de sa condition sociale. Sera un rebelle dans l'âme. Qui ne se berce d'aucune illusion. En développera un refus prononcé des conventions sociales. Ne dira jamais zut quand il pense merde. Les chockin' réactions de ses congénères et un sentiment d'auto-dérision prononcé lui permettront de développer un cynisme jusqu'au boutiste ravageur qui ne sera pas étranger à la glorieuse explosion des Sex Pistols.
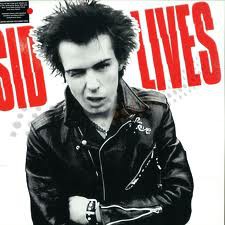
N'est pas seul. Ses amis ne valent guère mieux que lui. Surtout le jeune Simon Ritchie, plus tard connu sous le sobriquet de Sid Vicious, une espèce de taré congénital qui transcende son vécu familial dévastateur par une auto-suffisance narcissique des plus stupides. Une bande d'ados qui essaient de se faire remarquer comme ils peuvent. Le manque d'argent peut être un parfait aiguillon. Johnny déchire ses habits, les découpe et les raccommode avec des épingles de sûreté... Pour les distractions, l'on danse en boîte au mieux sur de la soul dégénérée au pire sur de la disco robotisée. A dix-sept ans il gagne sa vie en tant qu'animateur auprès de jeunes enfants. Leur enseigne le dessin. L'idée de former un groupe de rock ne lui serait jamais venue à la tête, s'il ne s'était mis à fréquenter la boutique de fringues d'un certain McLaren.
JUSTE UN HIC

N'y va pas pour la musique mais pour les habits à découper. Malcolm McLaren rêve de monter un groupe de rock. L'a déjà recruté trois musicos, Glen Matlock, Steve Jones, Paul Cook. Manque juste le chanteur. McLaren se garde le meilleur poste : sera le pygmalion du rock'n'roll, le manager producteur qui décide de tout. L'a des idées plein la tête. Dans le jargon de Johnny Lydon, cela se traduit par sale petit-bourgeois prétentieux à la con. Le courant ne passera jamais entre les deux hommes.
Faut attendre les dernières lignes du bouquin pour que Lydon révèle un geste de complicité entre lui et McLaren. Sinon il le critique tout du long, sans pitié. Tout ce qui vient de McLaren est frappé selon John d'une tare irrémédiable. L'accuse de tout et de rien, et même d'avoir fait foirer la réussite du groupe. De toutes les manières, Johnny Rotten a toujours raison, une autobiographie est de bien entendu un plaidoyer pro domo, mais avec Johnny ce sont sempiternellement les autres qui ont tort. Peut tout se permettre, mais ne laisse aucune excuse aux malheureux qui croisent son chemin.
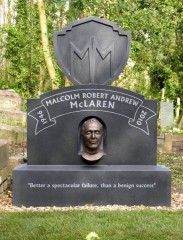
McLaren a défini sa feuille de route. Elle ne peut que plaire à Rotten, les Sex Pistols seront le groupe par qui le scandale arrive. Malcolm McLaren sera le grand Manipulateur. Fera faire et dire au combo, tout ce qui ne se dit pas et ne se fait pas selon les us et coutumes des sociétés policées. Les médias et l'opinion publique vont avoir droit à un traitement de faveur accéléré. Lydon endossera à la perfection le rôle du crieur public chargé d' ânonner l'interminable liste des calamités imminentes...
MAESTRO
Faut tordre le cou aux légendes. Au début avec les Sex Pistols, à part Glen Matlock, nous n'avons pas affaire à des virtuoses. Mais au fil des répétitions les progrès seront constants. Lydon qui ne sait pas chanter découvrira tout seul, comme un grand, comment il lui faut placer sa voix. Finira par trouver son style personnel si particulier. Les Sex Pistols se démarquent de tous les groupes : jouent plus vite et plus fort. Pas de finesse. Les grosses ficelles. Celles qui tiennent le mieux.
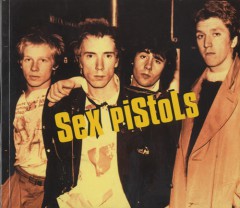
Le secret des Sex Pistols est tout simple. Alcool et speed pour accélérer les dissensions et surtout pas d'hypocrisie de façade. Les trois musicos n'aiment pas Johnny, Rotten ne supporte ni Matlock, ni McLaren. Et guère mieux les deux autres. Aucune estime entre ces individus. La haine est un ciment plus solide que l'amour. Aucune recherche d'harmonie inter-individuelle. L'on ne ne joue pas avec l'autre, mais contre. Les spectateurs ne sont pas mieux lotis. Rotten les supporte de moins en moins. Il déteste leur attitude de fans transis. Ne se réjouit pas de voir ses propres tenues de scènes adoptées et imitées par le public. Leur reproche leur manque de personnalité et leur uniformisation. Les traite de clones, il les insulte et les provoque. Les concerts deviennent de plus en plus violents. Les bagarres éclatent. Johnny ne s'en prive pas, il se jette dans la salle sans se préoccuper de ceux qui le réceptionneront. Les sinus bouchés il a pris l'habitude de cracher par terre pour dégager sa gorge. Sans le savoir il vient de lancer une mode. Les groupes seront désormais copieusement arrosés de glaviots admiratifs et vindicatifs, habits, visages et instruments dégoulinent de mollards visqueux.
PRECURSEURS
En quelques mois les Sex Pistols ont créé l'évènement. Le bouche à oreille a fonctionné. Toute une jeunesse se reconnaît en ce quatuor de choc. Le punk est né. Des dizaines de groupes leur emboîtent le pas. Lydon assure que le punk est bien né en Angleterre et pas chez les intellos de New York. L'a déchiré ses T-shirts bien avant Richard Hell. Patti Smith est une grand-mère entichée de poésie et les Ramones des gamins sans envergure. Minimise le rôle des New York Dolls et d'Iggy and the Stooges.... Seuls Johnny Thunders et les Heartbreakers trouvent quelques grâce à ses yeux. Encore que Thunders emmène en Angleterre deux fléaux mortels, Nancy Spungen et l'héroïne...
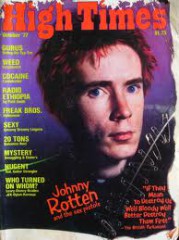
McLaren est aux anges. La mayonnaise prend encore plus vite qu'il ne l'espérait. L'est temps d'embraser le deuxième étage de la fusée afin de la mettre sur orbite médiatique. Quelques insultes proférées en direct à la TV aux heures de grande écoute et le tour est joué. Quelques vomissements en public et l'horreur est à son comble... Les journalistes suivent le groupe en cortège. Tout ce remue-ménage inquiète les autorités qui envoient ses policiers surveiller cette bande de gaziers par trop remuante et nauséabonde.
DIEU SAUVE LA REINE !

Un groupe ne peut pas vivre que sur des reprises. Ecrire des morceaux demandent quelques connaissances. Matlock veut bien se charger du fond musical mais pour les lyrics apparemment il manie mieux le médiator que la plume. Johnny s'en chargera. Pond coup sur coup deux bombes nucléaires, Anarchy In The UK et God Save The Queen, qui font sauter le jackpot et mettent le feu aux poudres. Le premier titre est une déclaration de guerre, mais le second est une intervention militaire. Lydon nous prend pour des imbécile. Est tout étonné des réactions du pouvoir et des foules. Notre but n'était pas politique, assure-t-il, nous étions à mille lieues de cela. A le suivre dans ses raisonnements, les gens se sont affolés pour un pet de lapin, beaucoup de bruit pour rien comme disait Shakespeare.

Les portes se ferment devant eux. Les municipalités annulent les concerts les unes après les autres. Sont obligés de tourner sous des noms d'emprunts mais le plus inquiétant n'est pas là. Une haine anti-pistols se développe parmi les beaufs de service qui hantent les rues de la capitale. D'autrepart les groupes de teddies voient d'un très mauvais oeil le mouv ement punk grandir un peu trop vite... Bref beaucoup trouvent en la défense de la Reine un formidable prétexte pour organiser la chasse à l'homme. Inutile de se plaindre auprès de la police, elle refuse d'accorder sa protection à de tels renégats de la monarchie. Violemment pris à partie Rotten recevra un coup de couteau dans la cuisse et une blessure à la main l'empêchera désormais de pratiquer la guitare. Les punks rasent les murs en espérant éviter toute malencontreuse rencontre assurée de se terminer par un passage à tabac.
Ambivalence de l'idéologie qui balance entre la remise en question radicale du système et le je m'en foutisme généralisé. C'est au nom de la premiere que Rotten obtient de McLaren la mise hors-circuit de Matlock. L'est viré du groupe pas tant parce que pour ne pas faire de peine à sa maman il descend de scène quand le groupe entame l'hymne royal mais pour sa gentillesse naturelle, son caractère de base trop conciliant qui préfère discuter, parlementer, temporiser et négocier que tout de suite s'opposer et agresser l'interlocuteur qui possède un point de vue différent.
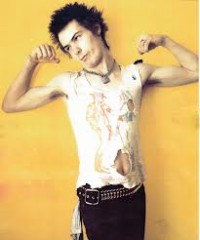
Sera remplacé par Sid Vicious. Rotten rétablit l'équilibre des forces. Ce ne sera plus un tout seul contre trois soudés mais deux contre deux. Le rapport des forces s'équilibre en sa faveur, surtout qu'il possède au plus haut degré l'art de parler. Une chance inespérée pour Sid, Rotten lui offre une très belle preuve d'amitié. Vicious ne saura pas s'en montrer digne. Au début il s'efforce de bien faire et apprend à jouer de la basse. Ne se débrouille pas trop mal. Y met tout son coeur. Qu'il va très vite tourner d'un autre côté. Se prend pour une rock and roll star, en aura tous les caprices, mais n'ira pas plus loin que la première groupie qui lui jette le grappin dessus. Nancy Spungen entre dans la vie de Sid, s'y installe pour toujours. A la vie, à la mort. En fait pas très longtemps mais elle n'en ressortira que les pieds devant. Nancy n'est pas une égérie romantique. Grossière, intéressée, une pute au petit coeur, elle subjugue le pauvre Sid en quelques heures. Sans doute le déniaise-t-elle côté sexe, mais elle l'initie à l'enfer de l'héroïne. Vicious deviendra une loque humaine incapable de tirer une ligne de basse. Le premier fâché sera Rotten qui comprend trop tard son erreur. Imputera la fin des Pistols en partie à la présence hébétée de Sid dans le groupe.
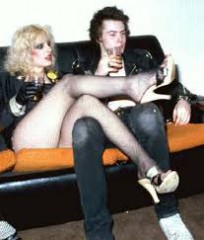
RECORD
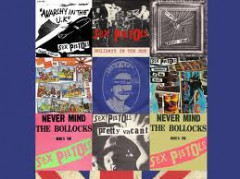
En attendant la chronique d'une mort annoncée, les Sex s'enferment en studio pour enregistrer leur album. L'aide de Sid est tellement peu opérative qu'ils se voient obligés de louer les services d'un bassiste de session. Ravaleront leur orgueil puisqu'ils jetteront leur dévolu dur un un certain... Glen Matlock qui accepte de revenir le temps des sessions sans se faire prier. Rotten regrette qu'il ne les ait pas envoyés chier. Le geste aurait été pistolien en diable. Mais Matlock est décidément prêt à toutes les concessions, il accepte le deal sans rechigner. Preuve qu'il n'a pas été renvoyé pour rien.
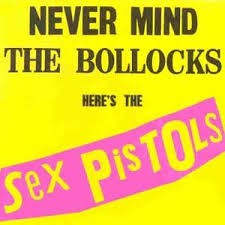
Le disque sera le chef d'oeuvre que l'on sait. Clouera le bec de tous ceux qui les ont devancés. Rien à jeter, surtout pas la pochette d'une crudité rudimentaire. Ca sort chez Virgin mais elle embaume le Do it yourself à plein nez. Découpage et bricolage de génie. Du grand art. Musicalement, c'est du rock. Only rock'n'roll. Du bruit et de la fureur. Et rien d'autre. N'ont pas commis l'erreur de l'arrière-fond ska-reggae qui gît au fond des silons des disques du Clash. Même si plus loin Lydon se vante d'avoir été le premier de la génération punk à apprécier le reggae de Jamaïque. Jah nous aurait donc préservés de la grande contamination !
THE END
De toutes les manières ce sont bien les Sex Pistols qui feront le clash final. Aux USA, McLaren les y a envoyés puisqu'il est impossible de tourner in the old England. L'est comme les journalistes attachés aux basques du groupes, il attend la moindre bévue qui tournera en scandale international. Mais les Pistols se méfient de tout, surtout de Sid dont ils appréhendent la moindre gaffe... Les concerts se passent plus ou moins bien. Ce n'est plus de la musique, c'est du spectacle. Rotten jettera l'éponge à la fin de la tournée.
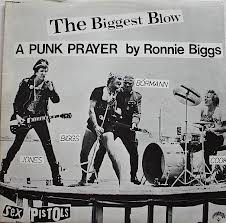
Vicious imprévisible, McLaren - qui projette un film avec Ronald Biggs, le héros du vol du train postal - inaccessible, Jones et Cook peu regardants sur la signification symbolique de la trajectoire du groupe, Rotten préfère partir. Pile à temps pour monter Pil, Public Image Limited...

LA GRANDE ESCROQUERIE

La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll, sortira en 1981. Entre temps Sid Vicious est mort d'overdose. L'on se demande encore si c'est lui qui quelques mois auparavant aura poignardé Nancy Spungen... Rotten crache sur the great swindle. L'accuse d'être un film sur McLaren et pas un film sur les Sex Pistols. L'a raison à cent pour cent. Mais il faut encore savoir ce qu'ont été les Pistolets du sexe. Un groupe de rock un peu en avance sur son temps, appelé à devenir culte auprès des générations futures, ou une opération de marketing d'un genre un peu spécial issue du cerveau embrumé de son concepteur Malcolm McLaren ?
Ce qui est sûr, c'est que contrairement à leur slogan, les Sex Pistols ont bénéficié d'un futur bien rempli. Je ne parle pas des reformations ( juste pour l'argent ) des années 1996, 2003, 2005, 2008... L'on sent que la question a turlupiné Johnny Lydon. Y répond en élargissant la problématique. Les Sex Pistols comme le groupe référentiel du mouvement punk. Le punk comme une révolution culturelle. En avance sur son temps et récupéré par la mode capitalistique, les mèches rouges de jeunes bourgeoises et leur jeans troués de marque... L'écume de la bêtise. Les crottes qui suivent le sillage du bateau d'où elles proviennent. Beaucoup plus important l'affirmation des individualités, notamment les femmes, premier mouvement où les filles furent traités comme les garçons... une coupure avec les vieilles lunes du romantisme réduites en miettes et remplacées par la toute puissance du désir de sexe aussi bien chez les cohortes masculines que féminines.
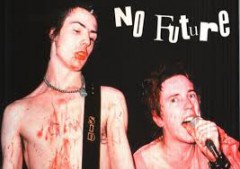
Avec tout de suite rétropédalage prophétique. Le No Future n'était qu'une annonciation. De 1975 à 1978, le punk n'était qu'une prévision. Le no future étaient pour les lendemains qui ne chanteraient pas. Pour aujourd'hui. Les temps étaient destinés à se durcir. Pas pour tout le monde. Pour la classe ouvrière, les pauvres, les rejetés du système... Le punk ne nous a pas menti. La réalité de notre monde présent qui n'est que le futur du punk est angoissante. La guerre de classe a été perdue. Assez pitoyablement. Faute de combattants. Les ilotes ont mis le masque des maîtres et ont déserté leur camp naturel. Préfèrent consommer que se révolter. Ca leur coûte cher, mais la vie n'a pas de prix.
ROCK ANGLAIS
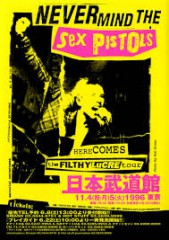
Vous pouvez préférer le groupe de votre choix. Mais quant au rock anglais, je n'en vois que deux qui se détachent. Ni les Animals, ni les Yardbirds. Trop refermés sur eux-mêmes et sur l'histoire du rock. Mais les Stones et les Sex Pistols. Pas parce qu'ils chantent mieux ou jouent mieux de la guitare que tous les autres, mais parce qu'ils sont les deux seuls dont la politique de déploiement a impacté le déploiement de la grande politique. Celle qui s'immisce et transforme la vie des gens. Les Stones par leur école de cynisme et les Sex Pistols pour la turbulence anarchisante des heures de récréation. Qui sont à prendre.
Sex Pistols, une leçon brouillonne d'énergie accumulée et déflagrative.
Merci Monsieur, petite gouape, Lydon.
Damie Chad.
23:49 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/03/2014
KR'TNT ! ¤ 179 : J.B LENOIR + SKIP JAMES / MEGATONS / BARFLY / NO HIT MAKERS / ANGRY BRIGADE / FRANCOIS GORIN
KR'TNT ! ¤ 179
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
05 / 03 / 2014
|
J.B LENOIR + SKIP JAMES / MEGATONS / BARFLY / NO HIT MAKERS / ANGRY BRIGADE / FRANCOIS GORIN / |
L'ENORME LENOIR
LES BLAZES DU BLUES
- 1er EPISODE -
C’est à Wim Wenders qu’on doit l’un des plus beaux films jamais consacrés au blues. On n’aurait jamais parié un peso sur un mec comme lui, sans doute à cause de sa bouille d’éternel étudiant et de ses films à tendance surréaliste, comme «Les Ailes Du Désir» ou «Paris Texas».
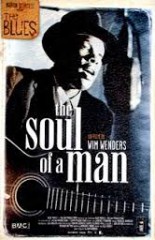
Et pourtant... «The Soul Of A Man» est un chef d’œuvre absolu. Wenders fabrique du mythe séquence après séquence. Il commence par nous embarquer dans l’espace pour un voyage sans retour, puis on retombe au Texas en 1930, on file ensuite à fond de train dans le Wisconsin et on finit par échouer à Chicago en 1960 chez J.B Lenoir. Tout cela sans avoir le temps de souffler. Car on va de plan magique en plan magique. Heureusement, le film est farci d’interludes dans lesquels on voit de pauvres petits blancs dégénérés comme Nick Cave ou Jon Spencer massacrer des classiques du blues, ce qui nous permet de retrouver notre respiration. (À noter que Wenders invite pas mal de gens dans son film. Parmi ceux et celles qui s’en tirent honorablement, il faut citer Lou Reed - brillant - et l’élégante Bonnie Rait qui salue un fantôme : «Hello Skip, whenever you are, that’s for you»).
Wenders, c’est tout simplement Rouletabille. Il fait de l’investigation. En 1977, il s’introduit nuitamment dans les locaux de la Nasa, en Floride. C’est l’été. Il va droit à la Chambre Jaune et oh stupeur, il tombe sur Voyager. Il découvre que ce malheureux rocket-ship est condamné à un voyage sans retour, au-delà des limites du système solaire. L’intrépide Rouletabille ouvre le couvercle de l’engin et plonge son visage dans une nappe de lumière blanche. Que voit-il au fond de l’habitacle ? Un disque d’or sur lequel sont gravés des messages en cinquante langues, des images et des échantillons musicaux ramassés dans le monde entier. Parmi ces échantillons se trouve «Dark Was The Night» de Blind Willie Johnson. Effaré, Rouletabille referme le couvercle. À qui est destiné ce disque d’or ? Mais aux Martiens, pardi ! Rouletabille est tellement bouleversé par sa découverte qu’il quitte aussitôt le laboratoire secret. Il retraverse la parc en évitant soigneusement les sentinelles et saute par dessus la palissade électrifiée. Il grimpe à bord de sa Delage et fonce à travers la nuit chaude de Cap Canaveral pour aller trouver refuge dans les bras de la Dame en Noir.
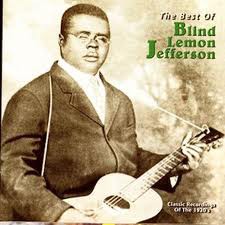
Wow Wim ! En quelques minutes, il rend au blues le plus spectaculaire des hommages. On aurait bien aimé qu’il fasse ce plan avec une chanson de Charlie Feathers, mais bon, c’est tombé sur Blind Willie Johnson. Wim n’a pas grand chose à raconter sur le pauvre Willie, à part qu’il est devenu aveugle à l’âge de sept ans. Encore une histoire à la con. Le père du petit Willie dit un mot de travers à la mère. La mère le prend très mal, elle se met carrément en pétard et balance de l’acide dans la gueule du gamin qui du coup devient Blind Willie Johnson. Comme «Dark Was The Night» figure sur le disque d’or, le pauvre Willie passe à la postérité inter-galactique.
Wenders utilise ce voyage dans l’espace comme une métaphore. C’est sa façon de rappeler la modernité du blues. Au Texas, en 1900, les nègres cueillaient le coton des blancs qui se goinfraient sur leur dos. Les pauvres nègres ne gagnaient pas un rond, mais ils jouaient la musique du futur.
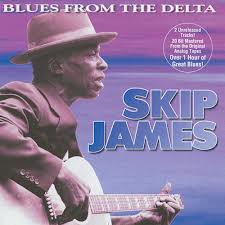
Encore plus spectaculaire : Rouletabille débarque à Bentonia, Mississipi, en 1931. Il est sur la trace d’un bootleger local, Nehemiah James, un grand nègre athlétique aussi beau que Denzel Washington. On le surnomme Skippy parce qu’il ne tient pas en place. Ses amis l’emmènent participer à un concours de blues in downtown Jackson, la grosse bourgade située au Sud de Bentonia. On présente Skip à H.C Speirs, un blanc syphilitique qui a déjà tout vu et tout entendu. Un nègre de plus ou de moins, bof. Quand Skip se met à chanter «I’d Rather Be The Devil» avec sa voix de castrat, le blanc sort brutalement de sa torpeur. Il flaire le jackpot. Il donne aussitôt un coup de fil à un collègue escroc et remet un billet de train à Skip. Il doit se rendre au studio Paramount de Grafton, dans le Wisconsin, pour enregistrer un disque. Rouletabille court après le train et parvient à choper le cul du dernier wagon et à se hisser sur le toit. À Grafton, on emmène Skip dans un studio aménagé au dessus d’une usine de fabrication de chaises. Skip sort sa guitare pourrie. Hop là ! Le blanc Laibley lui dit de la ranger et lui tend en échange une Stella 12 cordes. Wow ! Skip l’accorde en open D (ré) et tâte le son. Fine ! Une ampoule s’allume. Il attaque «Hard Times Killing Floor Blues», un truc de fou, chanté fantomatique, arpégé à la diable, riffé à la byzantine. Skip le héros, chapeauté et cravaté, miaule le blues des temps modernes. Planqué derrière un ballot de paille, Rouletabille écrase une larme. Skip attaque ensuite «Illinois Blues». Sa diction en impose au blanc Laibley - illi-onoye illi-onoye - puis c’est «I’m So Glad» avec un passage d’accords stupéfiant - dont va se régaler Jack Bruce, trente ans plus tard, avec Cream. Cette ordure de Laibley lui fait enregistrer dix-huit morceaux le premier jour et huit le lendemain, au piano. Skip a la classe, il s’accompagne aussi au piano et fait la batterie sur une planche avec le talon. Rouletabille voit le visage purulent du blanc Laibley se pencher vers Skip : «Cash ou pourcentage ?» Skip signe. Cash. Il quitte Grafton avec quarante dollars en poche. Pour lui, c’est une fortune. Mais c’est tout ce qu’il récupère pour vingt-six classiques. Il ne verra jamais ses disques, car la Grande Dépression va balayer Paramount. Rouletabille perd la trace de Skip. On dit qu’il chante dans l’église de son père qui est pasteur. Il devient une légende, mais il n’en sait foutre rien.
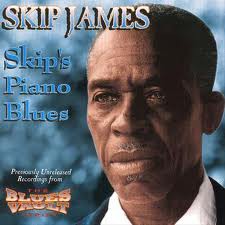
Alan Wilson, chanteur de Canned Heat, descend en direct de Skip, qu’il considérait comme le plus grand de tous les bluesmen noirs. Henry Vestine, guitariste de Canned Heat, fera partie de ceux qui iront voir Skip allongé dans son lit d’hôpital, en 1964. Dans le tas d’artistes qui ont tapé dans Skip, on trouve Sam Coones, Jack Bruce et Jeffrey Lee Pierce. Sam Coones démarre son fabuleux album «Blues Goblins» avec «Drunken Spree» qu’il plonge dans l’art skippique avec une délectation perverse. Il restitue l’art de Skip à coups d’arpèges à la fois maladifs et cristallins. Ça tourne comme un manège dans la nuit des morts. Il rince son hallucinant tarabiscotage d’un solo trash. «And if I thought she didn’t love me/ I’d take morphine and die.» Cette reprise est probablement l’hommage le plus vibrant rendu à Skip.
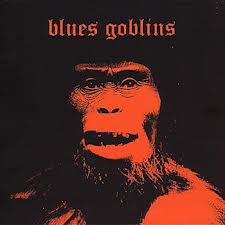
Sur son album «Paradise», Petit Vodo balance «Skip James At Paradise», un heavy doom des enfers - «I would have loved to meet Skip James/ When he was still on moonshine.»
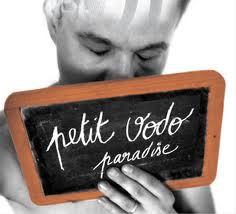
En 1992, Ramblin’ Jeffrey Lee & Cypress Grove enregistrent l’album du même nom, en l’honneur de Skip James (Cypress Grove Blues) et reprennent l’implacable «Hard Time Killin’ Floor Blues». Bluesman de haut niveau, Jeffrey Lee Pierce joue Skip à l’arpège clair et le chante perché et hanté. Il restitue à la perfection le balancement cadavérique de l’original.
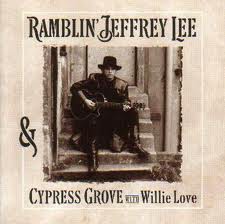
Rouletabille ne baisse pas les bras. Il fouille tout le continent. Trente ans plus tard, il retrouve Skip à l’hôpital de Tunica, dans le Mississipi. Il l’emmène jouer au festival de Newport devant 17.000 personnes. Rien que des petits blancs attentionnés. Skip ramène ses accords étranges et ses plaintes fantomatiques. Comme il ramasse enfin un peu de blé grâce aux droits d’auteur, il peut payer les médecins qui le soignent de son cancer. Rouletabille serre les poings. Quelle injustice ! Mazette, c’est Skip qui devrait s’acheter des manoirs et des Lamborghinis, pas Jack Bruce ! Rouletabille est profondément convaincu d’une chose : Skip est l’un des plus grands artistes de l’histoire de l’Amérique.
Mais à côté de J.B Lenoir, Skip est un nain. Pardon de dire ça, Skip, mais J.B dépasse largement les bornes. Skip a du génie, c’est vrai, mais J.B est un dieu du blues.
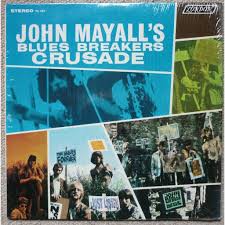
Étonnamment, sans John Mayall, personne n’aurait jamais entendu parler de J.B, par ici (même s’il a enregistré quatre singles sur Chess). Il faut remonter à l’album «Crusade» de John Mayall & the Bluesbreakers (avec Mick Taylor à la guitare). Mayall attaque «The Death Of J.B Lenoir» ainsi : «A car has killed a friend down in Chicago, thousand miles away/ When I read the news, night came early in my day» (Une voiture a tué un ami à Chicago, quand j’ai appris la nouvelle, le ciel s’est assombri). On ne dirait pas comme ça, mais Mayall est très sérieux quand il chante sa complainte. C’est le blues triste par excellence. Trois couplets, trois coups dans l’estomac : «J.B Lenoir is dead and it hit me like a hammer blow/ I cry inside my heart that the world can hear my man no more.» (J.B Lenoir est mort, j’ai reçu un coup de marteau sur la tête, et je pleure parce qu’on ne pourra plus entendre mon ami). Et ça, qui vaut tout l’or du monde : «J.B had a struggle playin’ unappreciated blues in vain/ Now the Blues has lost a king and I’ve lost a friend who died in vain.» (J.B s’est acharné à jouer le blues pour rien, maintenant un roi du blues a disparu, et j’ai perdu un ami qui est mort pour rien). J.B a bien de la chance de recevoir deux hommages aussi spectaculaires, celui de John Mayall et celui de Wim Wenders.
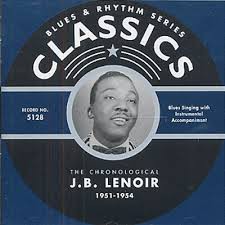
Rouletabille tombe par hasard sur le disque de Mayall. Qui est donc ce roi dont John parle ? L’investigation le conduit jusqu’au salon d’un couple de retraités. Ronnog ressemble à une grand-mère auvergnate et Steve, c’est un Zorba en marcel noir qui aurait pris un méchant tas dans l’œil droit. Rouletabille ravale sa salive car il a devant lui le couple le plus trash et le plus génial qu’il ait jamais croisé. Trente ans plus tôt, ces deux-là étaient étudiants et ils ont eu l’idée de faire un documentaire sur J.B Lenoir, alors quasiment inconnu en Europe. Premier documentaire en couleur : on voit J.B debout en queue de pie zèbre avec sa grosse guitare jaune et il attaque «I Feel So Good». À lui tout seul, c’est une pétaudière. Pas de batteur, pas de bassiste, pas de rien ! Un garage band à lui tout seul ! Il est monstrueux de classe et de puissance ! C’est le rock’n’roll des origines à l’état le plus pur. Il fixe la caméra avec un air incrédule. J.B et Martin Luther King se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Il a une technique de guitare époustouflante, un peu rustique, rêche, mal dégrossie, grandiose, fascinante. Tous les amateurs de blues doivent absolument voir J.B chanter et jouer «I Feel So Good». Ronnog et Steve ramènent leur docu en Suède. Ils sont sûrs que ça va intéresser la télé suédoise. Chou blanc ! Les connards de la télé veulent un docu en noir et blanc pour faire plus blues. Alors, Ronnog et Steve retournent voir J.B qui accepte de jouer quelques morceaux et de répondre à des questions. Il raconte qu’il est né à Tilton, Mississipi, et qu’il labourait. Il parle d’une voix rigolote, il bouge beaucoup la tête. J.B a quelque chose d’exubérant, d’incroyablement universel. En quelques mots, il crée une ambiance détendue. Il parle d’une voix chantante de ses quatre enfants et de l’aînée, Barbara Ann, pour laquelle il a composé une brand new danse song qui s’appelle «Round And Round». Et chaque fois qu’on voit J.B jouer, ça devient hallucinant. Il gratte ses accords et soudain il les quitte pour aller taper des trucs en bas du manche, tout en secouant la tête dans tous les sens. Aussi fascinant que Chuck Berry. Au chant, il peut grimper dans les aigus extrêmes. Il repasse un accord et glisse un triolet à la ramasse, comme si de rien n’était. C’est le mec le plus gentil et le plus drôle qu’on puisse imaginer. La rock star de nos rêves. On le voit attaquer «Slow Down», un swing dément - «Slow down/ Please let J.B step on board/ I wanna ride your train/ One time before you’re gone» - il est tout seul, magnifique d’aisance et de feeling, il claque des transitions miraculeuses - «I been a Hobo/ Mind you, all my life/ Don’t matter where I go/ I’m never satisfied». Bien entendu les connards de la télé suédoise refusent le second docu en noir et blanc. Miracle ! Rouletabille récupère la bobine du film et s’arrange pour qu’on puisse tous la voir, dans le monde entier. En guise de conclusion, Rouletabille soumet à notre réflexion un étrange paradoxe pré-socratique : comment peut-on être à la fois un artiste en avance sur son temps et faire la plonge dans un restau pour survivre ?
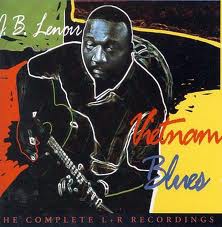
Dans ce docu, J.B ne raconte pas comment il a morflé quand il était gosse. Ugly. Il est allé s’installer à Chicago pour échapper aux pattes des blancs du Sud. Grâce au gentil Big Bill Broonzy, il a pu entrer dans le circuit des clubs de blues et vivoter en jouant ici et là. Il va surtout devenir l’ami de Willie Dixon qui le présentera à Phil et Leonard Chess. Parmi les connaisseurs, J.B est aussi réputé pour son engagement politique. En 1954, il enregistrait «Eisenhower Blues» pour se plaindre de la politique fiscale du Président - trop d’impôts - My money’s gone/ My fun’s gone - et il fut mis sous surveillance par le FBI. Il s’est engagé contre la guerre du Vietnam - son «Vietnam Blues» est l’une des chansons les plus engagées de l’histoire du militantisme aux États-Unis. En gros, il raconte que «pendant qu’on se bat au Vietnam, on nous tue dans le Mississipi, et tout le monde s’en bat les couilles» - nobody seems to give a damn. Il va encore plus loin en insinuant que son brother soldat tue un brother soldat vietcong - my brother may be killing their own brother they don’t know ! Puis il s’adresse à cette crapule de Nixon : «How can you tell the world we need peace/ And you still mistreat and killin’ poor me» et J.B balance là-dessus un solo dément. Mais comme beaucoup de ceux qui contestaient cette guerre, il n’avait pas compris que Nixon faisait tourner à plein régime son industrie d’armement et sa pétrochimie. Pour assurer le plein emploi chez lui, il exterminait la population d’un pays du tiers monde. Plus tard, l’Irak passera à la casserole, exactement pour les mêmes raisons.
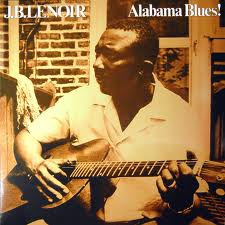
J.B est l’un des héros de la lutte pour les droits civiques. L’un de ses blues les plus magistraux s’appelle «Alabama Blues» : «I never will go back to Alabama, that is not the place for me/ You know they killed my sister and my brother/ and the whole world let them people go down there free» (Je ne retournerai jamais en Alabama, c’est pas un coin pour moi, ils ont tué ma sœur et mon frère et personne ne les traîne en justice). Dans le deuxième couplet, il raconte que son frère a voulu prendre la défense de sa mère et un flic l’a descendu («My brother was taken up for my mother/ and a police officer shot him down»). Et il met le turbo : «Alabama, Alabama, why you want to be so mean» (Alabama, pourquoi t’es un état si mauvais). Précision importante : l’Alabama a la réputation d’être l’état le plus raciste du Sud des États-Unis.

J.B en remet une couche avec «Shot On Meredith» : «June the 6th 1966/ They shot James Meredith down just like a dog» (Le 6 juin 1966, ils sont abattu James Meredith comme un chien). J.B fonce dans le tas. Puis, il interpelle le locataire de la Maison Blanche : «Mr. President I wonder what are you gonna do know/ I don’t believe you’re gonna do nothing at all» (Monsieur le Président, j’espère que vous allez faire quelque chose/ Vous ne pouvez pas rester sans rien faire).

Dans sa chanson-hommage, John Mayall évoque un accident mortel. J.B s’est retrouvé à l’hosto après un accident automobile survenu à Champaign, Illinois - illi-onoye illi-onoye - le 29 avril 1967. Les médecins ont jugé que ses blessures n’étaient pas si graves, après tout. J.B est rentré chez lui et il est mort dans la nuit d’une hémorragie interne. Deux ans avant Skip. Et trente ans avant Stiv Bators, renversé par un chauffard parisien et mort lui aussi d’une hémorragie interne après être rentré au bercail.
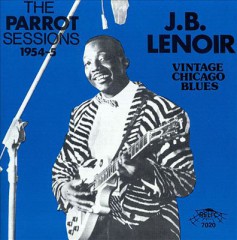
On trouve quelques disques du grand J.B Lenoir dans le commerce. Notamment un LP qui s’appelle «The Parrot Sessions 1954-55». Sur la pochette, on le voit rigoler de bon cœur. Il porte sa queue de pie zèbre. Ronnog expliquait à Rouletabille que J.B faisait faire ses vestes queue-de-pie par une couturière. Il en avait quatre : une verte, une gold, une noire et donc la zèbre. Les morceaux qu’il enregistra pour le label Parrot en 1954 sont essentiellement des jump-blues, mais des jump-blues un peu particuliers, chantés très haut perché et riffés. J.B définissait son style ainsi : African hunch with a boogie beat (un morceau africain avec un beat boogie) (Bo Diddley tenait le même discours). C’est là-dessus qu’on entend le fameux «Eisenhower Blues» qui attira sur lui l’attention du FBI. Il sort des heavy blues d’anthologie, comme par exemple ce puissant «Man Watch Your Woman», bien dans l’esprit de ce que fait Muddy à la même époque. Comme tous les autres nègres venus des états du Sud - Wolf, Muddy, Big Bill, Jimmy Reed ou encore Elmore James - J.B tire le blues du Delta vers le blues électrique de Chicago qu’on joue avec des groupes. Avec ses costumes et son énergie, J.B se fait remarquer. Il est même en avance sur son époque. Le mélange de sa voix chantante et de sa flash guitar fait des ravages, mais seulement dans les petits clubs où il se produit. On trouve aussi sur ce Parrot Sesssion des morceaux terribles comme «Eisenhower I’m In Korea» ou «I’m Gonna Die Someday». Et du désespoir à l’état pur comme «What Have I Done». Il ne prend pas beaucoup de solos, car ce n’est pas encore l’époque des solos de blues mais dans «We’ve Both Got To Realize», il place un solo magique de notes merveilleusement douces et lentes. «Sittin’ And Thinkin’» est un heavy blues monstrueux de feeling, il va chercher ça très loin dans le limon des origines - baby do you ever think of me !
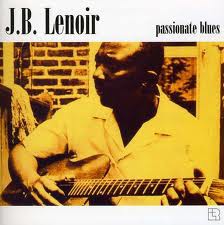
«The Passionate Blues» de J.B Lenoir devrait se trouver dans toutes les collections de disques. Sur 23 titres, une douzaine relève du pur génie. Ça démarre avec «Alabama Blues» puis il enchaîne avec le prodigieux «The Mojo Boogie». Il nous stompe à l’ancienne «The Whale Has Swallowed». Il joue «Move This Rope» en concassé. Un album de J.B est un véritable labyrinthe. Chaque morceau nous emmène dans un coin. On retombe ensuite sur le monstrueux «I Feel So Good», swingué par ce géant de l’Olympe. Qui joue comme ça aujourd’hui ? Certainement pas Pete Doherty. Fuck ! J.B sort d’un cloaque raciste pour dénoncer les ordures qui agissent en toute impunité. Dans «Alabama March», il accuse et joue des notes. Il ne parle pas de la femme infidèle qui s’est barrée avec un autre. J.B milite pour les droits élémentaires. Il dénonce les blancs qui tuent ses people comme des chiens. Avec «Talk To Your Daughter», il replonge dans le swing dément, il barre ses accords et égrène ses gimmicks à la revoyure. Il a le diable dans le corps, comme ce cher Raymond Radiguet. Retour au jump blues rond et délicieux avec «Good Advice». On danse avec lui. J.B n’a besoin de personne en Harley Davidson. Il est le Sartre du blues. Gentil comme tout. Sa guitare jaune s’appelle Castor. Alors on claque des doigts. Wow, J.B ! Il a cette incroyable virtuosité d’âme du copain qui vous donne tout ce qu’il possède. «I Want To Go» ? Le jump du matin, secoué aux percus. Fantastique ambiance fouettée. Avec «Down In Mississipi», il revient sur le thème qui l’obsède : la chasse aux nègres («They had a huntin’ season on a rabbit/ If you shoot him you went to jail/ The season was always open on me/ Nobody needed no bail») et on tombe à un moment sur «Voodoo Music» - the voodoo music gonna knock you crazy - pour lui c’est une partie de rigolade, J. B c’est Mandrake le magicien, il décide que le monde lui appartient, le temps d’une chanson fantaisiste - the voodooo, the Voodoooo ? et il remonte chercher ça au chant. Effarant.
Signé : Cazengler, jobard de J.B
Wim Wenders. The Soul Of A Man. The Blues, A Musical Journey Vol 1. DVD 2004
J.B Lenoir. The Parrot Sessions 1954-5. Relic Records Productions 1988
J.B Lenoir. Passionate Blues. Bellaphon 2002
Blues Goblins. ST. Off Records 2002
Petit Vodo. Paradise. Lollipop Records 2006
Ramblin’ Jeffrey Lee & Cypress Grove With Willie Love. New Rose 1992
CROSS DINER / MONTREUIL
28 - 02 – 14 / MEGATONS
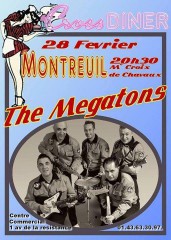
Sont là, tous les cinq sur l'estrade du Cross Diner. Sont déjà en train de jouer lorsque Mister B and I ( Aïe ! Aïe ! Aïe ! en retard ) poussons la porte. Faisons tout de suite une croix sur Dom. On ne le verra pas de tout le set. Non, il n'est pas en grève. On le détecte facilement à l'oreille car il n'arrête pas de marteler sa batterie. Mais ses camardes forment devant lui un paravent impénétrable. Ajoutez-leur cinq rangées d'aficionados qui ne quittent le devant de la scène et vous comprenez pourquoi il joue à l' Dom Invisible.

Jerry et son inséparable, son sax. C'est lui qui donne la couleur. Les Megatons sans Jerry c'est une bombe sans détonateur. Dessine l'ambiance, d'un coup de sax – n'est pas en porcelaine vu la manière frénétique dont il l'agite – il nous transporte au début des années soixante. Aux heureux temps de l'insouciance adolescente. Les Megatons jouent le rock d'après les pionniers et d'avant les anglais. Le rock de la jeunesse américaine qui s'est mise à imiter les idoles mythiques du first rockabilly. Les jeunes gens ne possédaient pas toutes les connaissances requises. Jouaient dans les dépendances de la maison, souvent le garage familial. Vous voyez débouler l'appellation incontrôlée. Rock Garage. Le premier, qui n'a pas encore l'aura que les compilation Nuggets bien des années plus tard lui apporteront. En ces temps-là le sax était un instrument bénéfique, son bourdonnement couvrait tous les manques et tous les défauts des guitaristes. En France, les groupes de twist, ravis de l'aubaine, l'accapareront.

Mais Jerry n'a pas à se faire du souci pour ses camarades. Les trois guitares assurent au maximum. Steph à la basse qui devrait de temps en temps se mettre un peu plus en avant, car les rares fois où il est intervenu en pôle position il a récolté de nombreux applaudissements pour la nerveuse rondeur de son swing. Modeste il se contente du rôle de courroie rythmique de transition qui entraîne le moteur, sans que l'on y porte – l'on s'habitue vite au confort maximum d'écoute - une attention spéciale. A l'opposé Charlie attire les regards. L'est sans arrêt à l'allumage. Lead singer, penché sur son Electro, il lance les morceaux d'autorité. Encore un qui ne tire pas la couverture à lui, Didac abat un super boulot sur sa lead guitar. Faut prêter l'oreille car les Megatons servent une marmelade à l'orange sucrée épaisse comme un matelas. Pas le temps de respirer. Ni eux, ni vous. Vous débutent les morceaux à la chaîne. A vélo, sixties obligent. Vous bourrent le mou ( et le dur ) sans vous laisser le temps de respirer. Le rock and roll est une musique rapide. Alors ils filochent à toute blinde sur l'autoroute des souvenirs. Vous avez quinze ans au bord de la mer, au camping des flots bleus et les filles sont vanillées comme des sucres d'orge. Qui oserait en demander davantage à la vie ? Tout et tout de suite, ce n'est pas une revendication, simplement le constat de la réalité.

Rock and roll un peu frustre qui ne se prend pas la tête et qui refuse de se perdre en longues et patientes recherche de virtuosités inatteignables. Les Megatons nous parlent de l'urgence du plaisir et bonheur. Ce white rock – mis au point par les fils de la petite bourgeoisie blanche américaine qui pour la première fois atteint à un semblant de statut d'autonomie vis-à-vis de l'autorité parentale – est aussi appelé surfin' rock. L'on glisse sur les joies de l'indépendance acquise comme des surfers sur la vague lisse. Enivrement des sensations qui démultiplient la griserie de la liberté obtenue si facilement.

Rock léger sans préoccupation métaphysique ou révolte psychique. L'on est dans un entre-deux, suspendus entre l'explosion du rockabilly encore empreint de ruralité et le repiquage anglais amélioré. Ce white rock inscrit aussi le rock and roll originel dans une dimension et une coloration urbaines qui ne le quitteront plus. En trois années le rock garage entreprend une mutation essentielle, la même que celle que connut le blues du Delta en s'invitant à Chicago. Mais la note bleue mit deux générations pour réaliser cette métamorphose. Le rock va plus vite.

Les Megatons ont compris que l'élément principal de ce type de rock and roll réside en l'énergie que l'on impulse à la pâte sonore. Nous en déversent des tombereaux à pleines pelletées. Vitesse hot rod. Ce n'est pas un hasard si le rock garage sera une des racines du punk. La vélocité du saxo relégué aux oubliettes des jours anciens étant remplacée par l'impulsion électrique des guitares. Un jour le white rock se transformera en wild rock. Mais ceci est une autre histoire. Les Megatons en restent aux temps de l'innocence. Qui sont aussi les plus proches de la perversité.

Le deuxième set sera encore plus fougueux. Jerry promènera son sax sur les tables des dîneurs enchantés de cet invité surprise rock and roll qui met si prestement les pieds dans les plats. Ensuite il y aura quelques agenouillements et roulades à même le sol des mieux venues. Nous apprécierons encore plus les trop rares morceaux instrumentaux dans lesquels le groupe développe une science consommée de la mise en place sonore. Si j'étais les Megatons, entre les deux longues parties de leur prestation j'intercalerai un mini-set purement instrumental. Suggestion purement personnelle. Les Megatons aiment jouer, vont nous donner une dizaine de fois le dernier morceau, mais il leur en reste toujours un à rajouter. Pour le plus grand assentiment du public qui en redemanderait jusqu'au petit matin. Hélas, tout a une fin. Même les concerts des Megatons. La seule note de tristesse de la soirée.
Damie Chad.
BO-WAY INK 1st TATOO CONVENTION
01 – 03 – 14 / BEAUVAIS
BARFLY & NO HIT MAKERS

T'as été où, tout tâtillon tatou ? As-tu tout étonné tâtonné ton nez tatoué ? Jusqu'à la sortie de l'autoroute, comme sur des roulette. Ensuite en théorie c'était tout simple, première à droite et cinquième sortie du rond-point. Le problème c'est que l'architecte qui a dessiné le paysage devait être un fan des giratoires, l'en a mis partout, tous les cent mètres une rondelle, des grandes, des petites, des moyennes, pour les noms des rues l'a fait très attention qu'ils soient illisibles depuis votre voiture. De très rares bâtiments dans le lointain. Une étendue toute plate sans rien dessus. Dans le Sahara vous avez au moins la chance – minime je vous l'accorde – de tomber de temps à temps nez à nez avec un dromadaire sauvage. Alors quand on a vu les phares de l'auto qui arrivait en face, l'on a placé la teuf-teuf en travers du chemin, la situation l'exigeait, pour glaner un renseignement utile. Banco, l'épouse du chauffeur savait ! Radieux sourire de la jolie brunette, qui nous dirige droit vers l'Hélicène.
Je m'attendais à un immense hangar pour parquer les hélicoptères, ce n'est qu'un modeste gymnase, tapi dans le noir absolu. Un individu à la démarche hésitante longeait la façade. « Vous cherchez l'Hélicène ? » M'enquis-je d'un ton empreint de curiosité compatissante. « Non, c'est ici, je cherche la porte d'entrée. » répond-il, un tantinet désespéré. On a fini par mettre la main dessus, la poignée.

On entre. Lumière. Sourire et chaleur humaine. Peu de monde à vrai dire. Les tatoueurs sont en leur grande majorité partis. N'est restée pour le concert qu'une centaine d'amateurs et les propriétaires des stands, habits, bijoux, peinture... Les sandwichs sont empilés dans le frigidaire, mais le café est au chaud dans son gobelet. Un coup d'oeil à l'immense mur d'escalade qui du sol au plafond occupe toute une longueur du bâtiment et je me dirige droit vers la scène où déjà officient les Barfly. Sont tous quatre vêtus d'une chemise de satin bleu sombre à paillettes miroitantes, dessinée et confectionnée par Billy qui m'accompagne dans cette lointaine virée. Ils ont la classe. Billy exulte.
BARFLY
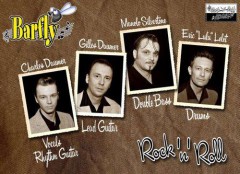
Si vous cherchez leur facebook, tapez Barfly Rock'n'Roll parce que des groupes ( pas uniquement musicaux ) qui revendiquent ce nom d'ivrogne, il y a en au minimum un dans chaque pays du globe terrestre. M'étonnerait fort d'ailleurs que nous soyons la seule civilisation intergalactique qui ait développé ce goût prononcé pour l'alcool. Mais ici, il s'agit bien de nos Barfly à nous, d'Ile de France. N'ont pas choisi leur nom à la légère : Eric Levet et Gilles Daumer faisaient autrefois partie des Booze Lovers, et Manolo Silvertone des Hot Rhythm And Booze ( voir livraison Kr'tnt 104 du 28 / 06 / 12 ). Déplorable exemple pour notre jeunesse, afin de monter les Barfly ils ont communiqué leur vice rédhibitoire à un jeune homme sans histoire à qui ils ont inoculé le virus du rock and roll. Mais tout nous porte croire que Charly Daumer était déjà contaminé depuis fort longtemps.
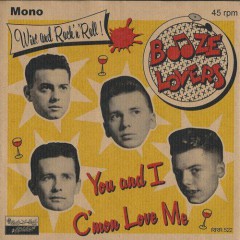
Rien à voir avec la mouche tsé-tsé. Impossible de s'endormir avec eux. Un tintamarre à réveiller un régiment. Les Barfly ramonent dur. Pas un boucan de tous les diables, ni un charivari pèle-mêle dans lequel tout se perd et ne se retrouve jamais. Derrière ses futs Eric Levet empile les cubes avec ordre et méthode, pose la base bien d'aplomb, avec efficacité et discrétion. Partout présent mais sait se faire oublier. Au fond de la scène, en retrait mais fait marcher son monde à la baguette. Poigne de fer dans une frappe de velours. Barbiche en pointe, pointe de tatouage qui remonte sur son cou, Manolo abat son bras chamarré sur Big Mama, opulente et imposante en sa robe de bois clair, il disparaît presque sous son volume XXL, ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas elle qui porte la culotte, la fait couiner à merveille et à ce petit jeu il est infatigable. Il apporte l'amplitude et la résonance nécessaire à l'habillage de la frappe sèche et ordonnatrice de son drummer. Gilles Daumer est à l'image de ses deux précédents acolytes. Peu démonstratif dans son attitude. Pas guitar hero pour deux sous. Mais un gratteux magnifique. L'a compris que pour intervenir à bon escient, il suffit d'être simplement toujours présent. En d'autres termes, il n'arrête pas d'alimenter le feu de la forge allumé par les deux autres. Perpétuellement sur le qui vive, mais en pleine action. Un oeil sur la guitare, et l'autre sur son neveu.

Le leste Charly, tient la rythmique mais il est avant tout un chanteur. D'ailleurs quand il la posera pour saisir le pied du micro à deux mains, personne ne s'en apercevra. L'est la figure de proue du groupe. Il apporte le souffle créateur. Une voix qui articule les syllabes et donne sens au flot musical généré par les trois compères. Avec Eric Levet qui découpe à la perfection et lui qui fignole le phrasé de chaque séquence le combo filoche sec. Rapide et moderne. Arrêt brutal, Charly s'assoit derrière le piano électrique Roland. On ne s'y attendait pas, mais aucune surprise quand il se met à marteler les touches à la Jerry Lee. Certes sa voix n'a pas la mâle onctuosité de notre vieux Jerry Lou, faudra qu'il ait éclusé dix mille milliards de verres de bourbon et fumé autant de millions de havanes avant d'avoir cette prétention, mais la jeunesse supplée à bien des manques. S'en tire très bien. L'a des inflexions juvéniles qui ne manquent ni d'audace ni de savoir faire.

Les Barfly décoincent la salle. S'en tirent brillamment avec les honneurs de la guerre. Unanimité parmi la foule assemblée. Ont réussi à satisfaire autant les partisans d'un retour aux roots que les amateurs d'une ligne beaucoup plus moderne.
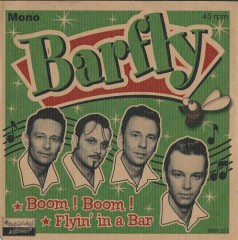
( Photos de scène prises sur le facebook des artistes. Ne correspondent pas au concert )
INTERMEDE
La boutique Morgane habille les jeunes filles. Comme elle vend des dessous chics et chocs, elle aurait plutôt tendance à les dévêtir. Sept jeunes naïades montent sur scène. Elles interprètent un semblant de mini-scénario – jeu de mines, jeu de coquines - qui n'a d'autre but que de leur permettre de prendre des poses suggestives. C'est la grande lascive qui lave plus blanc que blanc la noirceur de vos désirs reptiliens. Gardez ces seins proéminents que je saurais voir de mes mains. Quant à ces deux fesses potelées qui tanguent à ravir, elles ont de quoi laissé de cul tous les pères-la-morale de la planète. Borderline mais pas vulgaire. Lorsqu'elles descendent pour se faire photographier elles sont entourées par une nuée d'observateurs scrupuleux et attentifs. La chair fraîche attire toujours les ogres. Et les ogresses. Décadence de l'occident ou bas les masques de l'hypocrisie sociale ? En tous cas, les filles de l'Oise m'esgartoisent.
NO HIT MAKERS

Ce fut l'apothéose. Bien mal commencée puisque sur le premier morceau School of Rock'n'roll la voix d'Eric est inaudible. Mais le deuxième titre n'est pas lancé que la funeste désamplitude est renvoyée au tombeau et que pas une seule seconde elle ne reviendra hanter le plateau. Dès lors tout se passera comme dans un rêve. Le groupe ne fera peut-être pas de hit – quoiqu'un titre comme Soldier Of Peace en est déjà un en puissance – mais ce soir il fit un tabac. Monstrueux.

Très vite la salle s'agite. Trépigne et danse sur place. Les filles s'en mêlent et volent de cavalier en cavalier. L'euphorie s'empare de l'assistance. Qui n'hésite pas à monter sur scène. N'y a plus un contrebassiste mais trois, Larbi qui slappe et deux autres qui font semblant, ne le gênent pas mais sont si resserrés autour de la contrebasse que l'on ne devine plus quel est l'original et quels sont les imitateurs. A la batterie Dan s'est fait des amis. Avant qu'ils ne déboulent sur le plateau, à leur demande il leur a passé la fiole de bourbon ( ou de tout autre liqueur roborative, le laboratoire ne nous ayant pas encore livré les résultats de l'analyse ) qu'entre deux breaks il porte à ses lèvres, elle a fait le tour d'un groupe de rockers qui l'ont pratiquement vidée, maintenant ils sont autour de lui, ils boivent sa bière et entreprennent de eux aussi de taper sur des fut imaginaires afin de le seconder dans ses efforts. Mais ils ne sont les seuls, d'autres plus solitaires zigzaguent entre les musicos, y aura même un couple lancé dans un rock and roll acrobatique qui s'arrêtera en plein élan, the young gal immobile, stoppée en son élan, les muscles raidis, portée à bout de bras par son partenaire, lorsque le morceau se finira subitement. Tout ce tohu-bohu dans un si grand respect que Eric n'hésitera pas à encourager de futurs volontaires à les rejoindre sur scène.

Intense foisonnement. Moment de fête et de communion. Osmose totale entre le groupe et le public comme l'on n'en voit que très rarement. C'est que le combo déroule son set avec une vigueur inimaginable. La voix d'Eric est splendide, c'est elle qui emporte les instruments, elle les enveloppe et les infléchit de par sa seule souplesse à volonté. Les musicos donnent l'impression de courir derrière, de fait ils déroulent un tapis rouge de bombes incendiaires sur ses pas. No Hit Makers est une usine à tubes, lance-torpilles. Le groupe propulse ses morceaux comme les orgues de Staline sur le front russe. Ce n'est pas la brutalité tonitruante du psycho mais l'impétuosité du psyché, si vous parvenez à entendre la subtilité différentielle établie par la mise en perspective de ces deux concepts.

Faudrait citer toutes les interprétations, le Midnight Train, le groupe sait recréer la sourde angoisse qui minait la version de Johnny Burnette, Eric la dynamite tout en gardant cet arrière-fond country-type qui est une des clés souterraines de la beauté du titre, le Shake Your Money Maker dont la salle reprend le refrain en choeur, le All Ican Do is Cry, dont Larbi se voit déchargé des vocaux d'appui par ses deux fans enthousiastes qui s'en chargeront avec la plus sérieuse des applications. Pas de rappel, le groupe est allé jusqu'au bout de son énergie. Ils annoncent seulement que ce sera le dernier morceau. Et le moment magique d'empathie généralisée prend fin. Retour à la réalité mortifère de notre vécu humain. Trop humain. Nous qui pendant une heure avions partagé le rire des dieux. Merci les No Hit Makers.

( Photos de scène prises sur le facebook des artistes )
Damie Chad.
ANGRY BRIGADE
CONTRE-CULTURE ET LUTTES EXPLOSIVES
EN ANGLETERRE ( 1968 – 1972 )
SERVANDO ROCHA
( 296 pp / l'Echappee )
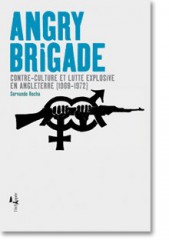
Les Brigades de la Colère. L'on en parle peu. Mieux vaut éviter les sujets qui fâchent. Qui de surcroît pourraient donner de mauvaises idées à une jeunesse dont un récent sondage mélodramatiquement susurré sur les ondes hertziennes nationales nous apprend que soixante et un pour cent de ses contingents seraient prêts à participer à des évènements de style Mai 68. Pour mieux comprendre ce dont il s'agit, pour situer le contexte historique, nous conseillons à nos lecteurs de se rapporter à quelques chroniques antérieures, celles consacrées au Hippie, Hippie Shake de Richard Neville ( KR'TNT 55 du 02 / 06 / 11 ), à L'Histoire de l'Underground Londonien de Barry Miles ( KR'TNT 96 du 03 / 05 / 12 ), et à l'hommage à Mick Farren prononcé par l'ami Cat Zengler dans la cent-cinquante troisième livraison du 28 / 08 / 2013 de votre rock'n'roll blog préféré. Mais aussi à la recension du monumental pavé de Carol Clerck, Hawkwind, La Saga, ( KR'TNT 170 du 03 / 01 / 14 ) ou encore Apathie For The Devil de Nick Kent ( KR'TNT 171 du 10 / 01 / 14 ). Vous n'oublierez pas non plus le Lipstick Traces de Greil Marcus in KR'TNT 136 du 21 / 03 / 13.
Mais arrêtons de tourner autour du pot à moutarde. 1967, l'été de l'amour ne tiendra pas ses promesses. Tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Le rock'n'roll survivra aux grandes messes de Woodstock et de l'Isle of Wight, mais la preuve est faite que le rêve hippie est un horizon de carton pâteux qui recule sans cesse dès que l'on essaie de se mettre en marche pour le réaliser. Une fois l'étiage supérieur atteint, il ne reste plus qu'à redescendre.
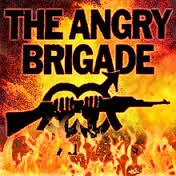
1968, la France contribue à sa manière au débat, durant son joli mois de mai. En quelques semaines elle bouscule les idées reçues sur l'inéluctabilité de la toute puissance étatique. Certes tout rentrera dans l'ordre lorsque le général de la Gaule troublionne sifflera la fin de la récréation mais l'idée qu'il suffit de peu de chose pour faire vaciller l'emprise autoritaire de l'Etat – ce léviathan à coercition fachisante – a frappé les esprits. A Londres c'est la grande ébullition. Suivie d'une non moins grande désillusion. La quartier de Notting Hill a été investi par toute une faune interlope de hippies et de freaks, musique psychedelic à tous les étages des squats, l'on s'essaie à d'autres modes de vie, amour libre et communauté, l'on écrit beaucoup, les brochures se multiplient, les revues comme IT, OZ, Friends ( bientôt Frendz ) parviennent à une audience internationale. Le pouvoir politique s'inquiète... la police devient suspicieuse, les médias font leur boulot de chien de garde des valeurs sociétales, conservatrices et puritaines. Un individu qui parvient à générer sa propre existence et ses propres réseaux d'entregent, d'information et de survie existentielle en dehors des institutions habituelles est de facto un être potentiellement dangereux puisqu'il remet en cause l'ordre naturel du fonctionnement de la société démocratique au service du déploiement idéologique et culturel de la domination du Capital.
Capital, le gros mot est lâché. Ces dernières années on lui a substitué celui moins connoté et d'apparence plus sympathique de libéralisme. Mais ce vocable ne désigne qu'un moment historique particulier de ses formes d'investissement économique sans remettre en cause les principes de confiscation des richesses collectives au profit d'une minorité privée. En soixante-huit, un autre rêve aussi s'écroule, celui du socialisme autoritaire qui a dirigé les révolutions russes et chinoises. Le résultat ( de la lutte) final(e) n'est pas à la hauteur des attentes. L'autre voie, celle de l'anarchisme anti-autoritaire initiée au confluent du la fin du 19° et au début du 20° siècles, et liquidée par le stalinisme triomphant, retrouve légitimité et partisans...
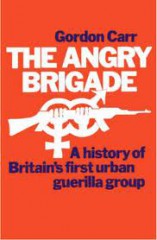
C'est tout naturellement d'Espagne – encore sous la botte de la dictature fasciste de Franco et terre de tradition et de lutte anarchistes – qui aidera à Londres au lancement d'un mouvement de protestation militante d'action directe. Rien ne sert de se lamenter. Il faut agir à temps. Beaucoup de jeunes hippies n'ont guère envie de passer leur journée assis en rond à se passer un joint communautaire, préfèreraient des activités collectives davantage efficientes. Des membres du Grupo Primero De Mayo, repliés sur la capitale anglaise serviront de détonateur. Ce sont des militants de la jeunesse anarchiste espagnole qui se sont fatigués des vieillotes pratiques de la CNT ( syndicat anarchiste espagnol ) engluées en un discours critique peu opératif. Ces jeunes gens désirent de l'action. Ils manient l'explosif, et n'hésitent pas à enlever le représentant espagnol au Vatican...
Ainsi naîtra in the old England la Brigade de la Colère. Mouvance radicalisée informelle qui manie autant le cocktail molotov et la bombe artisanale que le symbole. Se sont mis des garde-fous. S'en prennent aux biens mais pas aux personnes. Ce ne sont pas des terroristes, ils refusent le meurtre ciblé ou anonyme. Sont avant tout des intellectuels, des littéraires, qui ont compris que les mots sont encore plus meurtriers que les armes. Leurs communiqués affolent les policiers peu habitués à des textes de revendication qui ne correspondent pas à la phraséologie habituelle des communiqués émanant de cellules révolutionnaires classiques.
Les milieux politiques s'affolent, la Angry Brigade frappe fort, elle s'en prend aux domiciles de responsables politiques et économiques, aux locaux d'ambassades, aux sièges des banques... toujours en relation avec l'actualité. La police piétine. Parviendra à arrêter et à faire passer une douzaine d'individus en procès. Les juges auront du mal à établir la preuve de leur participation à la série d'attentats qui leur sont reprochés. Mais les condamnations seront lourdes. C'est que le système a compris le danger de ces groupes affinitaires. Aucune organisation ne les chapeaute, aucune structure de commandement qui puisse être neutralisée. Des amis, des connaissances, se réunissent, projettent une action, la réalisent, et aussitôt la mini-structure opérative se dissout à tout jamais. Pas de responsables, pas de traces.
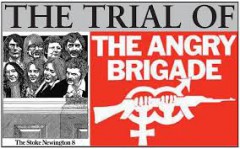
Les arrestations et les condamnations d'Anna Mendelsshon, de Chriss Bott, Hylary Creek, Angela Weib, Stuart Christie, John Baker, Jim Greenfield, Kate McLean et Jake Prescott, ne tariront pas la source des attentats. L'on a retrouvé chez eux des armes qui ont servi à quelques mitraillages, mais cela n'altèrera en rien la sympathie que leur porte la jeunesse de Notting Hill fatiguée des contrôles d'identité perpétuels, des perquisitions à répétitions et des garde-à-vues illégales exercées à leur encontre par les phalanges cochonneuses. Les grosses masses des majorités silencieuses ( qui n'en pensent pas moins ) ne témoignent d'aucune antipathie pour les colériques brigades.
En 1973, le Royaume-Uni retrouve son calme. La tempête est passée. Ouf ! L'Angry Brigade fut-elle un coup d'épée dans l'eau ? L'expérience acquise et les erreurs commises ne seront pas perdues, des militants anglais participent à la création des GARI ( Groupes d'Action révolutionnaire Internationalistes ) qui porteront de véritables coups de boutoirs au régime franquiste en Espagne. La condamnation à mort et l'exécution d'un militant du Gari, Puig Antich, sonnera le glas de la fin de la dictature...
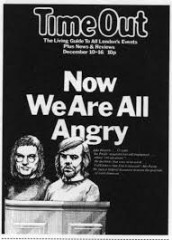
L'eau ne dort jamais longtemps. Entre la mise en veilleuse de la Brigade de la Colère et la la naissance de la mouvance punk, il ne s'écoule que quelques mois. La radicalité change de look, mais les revendications fondatrices restent les mêmes. Beaucoup s'étonnent que beaucoup de punks proviennent du mouvement hippie. Signe de méconnaissance de bien des éléments constitutifs de cette prétention des chevelus à vouloir changer la vie. La Angry Brigade a perdu une bataille, mais les punks ont annoncé avec leur No Future la perte de la guerre des rêves d'une vie meilleure, déclinée selon les canons d'une plus grande liberté individuelle, que soldera la défaite de la grève des mineurs britanniques en 1985. Margaret Thatcher ouvre l'ère du libéralisme triomphant.
Tout ce qui précède pour l'aspect historial. Nous avons volontairement omis dans notre compte-rendu toute analyse sur les rapports de la musique rock et la naissance de cette contre-culture dont accouchera l'époque. Nous vous renvoyons pour cela aux chroniques indiquées en tête de l'article. Mais le livre se révèle d'une brûlante actualité. Quarante années sont passées depuis, mais la situation n'a guère varié. S'est empirée, mais les analyses de la Angry Brigade semblent avoir été rédigées ce matin même. La critique situationniste de la transformation mortifère du travailleur esclavagisé en consommateur béat prêt à payer ce qu'il a produit apparaît d'une justesse prophétique. La nécessité d'une transformation radicale de notre système démocratique s'avère comme une nécessité inéluctable.
Reste à espérer que le rock and roll saura devenir la musique de ce grand chamboulement. Nous avons du souci à nous faire.
Damie Chad.
SUR LE ROCK
FRANCOIS GORIN
( Lieu Commun – 1990 )
Un livre c'est comme un palmier dattier, c'est la date qui est importante. 1990, ce n'est pas le meilleur millésime du rock and roll. Mais à chacun sa croix, François Gorin publie son livre à trente-trois ans. Nous raconte sa vie in rock. A ne pas confondre avec sa vie en rose. Commence par écrire dans Rock & Folk, se retrouve aux Inrock, passe au Matin et finit par pantoufler à Télérama en tant que critique de cinéma. Garde tout de même un pied dans la baignoire ( pas celle où est supposé être mort Jim Morrison ) par l'entremise de son blogue téléramien – surtout télérasien – Les Disques Rayés.

L'a fait comme comme tout le monde qui naquit dans les années cinquante, le petit François, l'a pris les sixties dans la tronche et quelque part – mais pas partout – il ne s'en est jamais remis. Alors au moment de rentrer dans l'âge adulte, il tire le bilan. Pas très glorieux. Pas celui du rock and roll. Le sien. C'est vrai que les Dieux ne l'ont pas aidé, l'ont laissé naître dans une famille unie, aimante – jusque là tout va à peu près bien – mais chrétienne. C'est un arrière-fond chez lui, doloroso. Le gars n'est pas joyeux. Contemplatif, se regarde un peu trop souvent le nombril sans céder au mortel péché d'orgueil. S'efface au maximum, parle de lui à la troisième personne, se réfugie souvent dans l'anonymat du pronom on, n'intervient dans le récit que lorsqu'il ne lui est pas possible d'en abstraire sa modeste personne. Ne devrait pas. Connaît beaucoup de choses. Comprend intuitivement ce qui se joue. Par-dessus le marché, il écrit bien. Très bien. Ses évocations, ses portraits sont de véritables poèmes en prose. Cherche le mot juste, comme beaucoup, mais lui il le trouve. Mais il n'aime que ce qui lui ressemble. L'on a les idoles que l'on mérite. L'on se regarde dans le miroir pour être Tartempion ou Trucmuche, mais l'on ne voit que soi. Ecce homo, comme disait Nietzsche.
Pourrait jeter un coup d'oeil sur le côté de la glace. Tout un peuple de hautes figures campent par là, mais Gorin ne les détaille pas. Ce sont les Elvis. Tresse sa couronne de laurier à Presley, puisqu'il est le premier des rockers. Difficile d'éviter le symbole. Mais les autres, cette pléthore de clones, il ne s'attarde guère. Expédiés en quelques phrases. Le blues, le rockabilly, les pionniers ce n'est ni sa tasse de thé, ni sa fiasque de whisky. En vérité mes très chers frères, Gorin n'aime pas le rock. Du moins pas le rock que j'aime. Je sais, je suis sectaire et je ne me soigne pas. Mais lui, il est carrément malade. Touché mortellement. L'est fou des beautiful losers. Nick Drake, Scott Walker, Brian Wilson, je n'ai rien contre. Surtout qu'il ne les ménage pas. Les plaint mais ne leur passe aucun travers. Néanmoins on le sent attiré par le gouffre de ces vies ratées. L'y retrouve inconsciemment la postulation pascalienne de l'homme malheureux parce que sans dieu. Au bout de la folie, du suicide et du renoncement, il n'y a rien. Le même vide que Gorin ressent lorsqu'il analyse le parcours de son existence. Il inverse la question fondamentale, pourquoi y a-t-il rien et non pas quelque chose, se demande-t-il. Dix-neuvième dépression nerveuse.
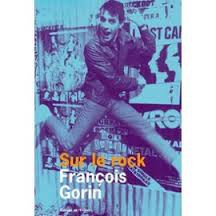
L'adore le tourment rédempteur, deux autres de ses phares – au sens baudelairien du mot – meurent assassinés, John Lennon et Marvin Gaye. Chez le second, c'est le père qui nous refait le coup du meurtre du fils – une histoire très connue au temps des pierres, pas celles qui roulent, mais celles qui poncent pilate. Quant au premier il est tué pour avoir chrié plus fort que Jésus, vingt ans auparavant.
Nous présente aussi Ray Davies et Van Morrison en grands seigneurs vaincus par l'usure du temps et la fuite de la gloire, fatigués et désabusés. François Gorin n'est pas tendre avec les survivants du rock. Il n'oublie pas de préciser – ce qui nous le rend très sympathique - que la survie commence dès que l'âge nous éloigne de notre enfance. Eux et nous. Se met dans le même sac. Parviendrait à nous refiler le blues sans en écrire trois mots.
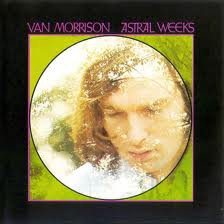
Pour le rock and roll, c'est raté. Préfère les ersatz. En pince pour Elvis, non pas le real pelvis, mais le Costello, car d'après lui tout est bon chez lui. Y revient souvent. Nous le ressert à toutes les sauces, mais Costello ce n'est pas la viande savoureuse du coustelou, juste les frites mal cuites qui l'accompagnent, quel que soit l'animal que l'on a égorgé avant de se lancer dans la grande cuisine rock and roll.
L' a des excuses. Difficile de sentir le caca quand on a le nez dedans. Faut prendre de la hauteur. Et 1990 c'est la fin de la décennie la plus pourrie de l'histoire du rock. L'intuite, se méfie du disco, reste très circonspect avec la new wawe, ne cède pas aux métamorphoses de Bowie le pygmalion, n'est point dupe des atermoiements discographiques de Lou Reed, n'apprécie pas la suspecte blancheur de Mickael Jackson, ne sait pas trop quoi penser du rap qui balbutie. J'en passe des meilleurs et des pires. Quand le combat cesse faute de combattants car il les a tous décriés, il sort les derniers soldats de plomb, Jacques Brel et Barbara. L'est comme Poutine, il va les chercher jusque dans les chiottes. Et pourquoi pas Marcel Amont tant qu'il y est ! Désillusion rock !
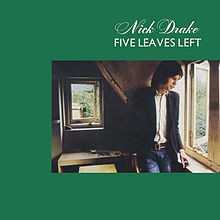
L'aurait mieux valu intituler le bouquin, Sur François Gorin, l'on aurait été contents : « Tu as vu le mec, il dit qu'il raconte sa vie mais il parle de rock and roll à toutes les pages ! ». Limitons les dégâts, terminons sur une note joyeuse : Si ce livre était une chanson, quelle serait-elle ?
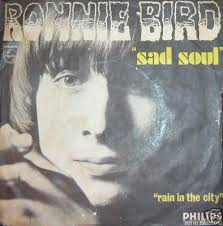
Sans hésitation.
Sad Soul, de Ronnie Bird.
Damie Chad.
22:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : no hit makers, skip james, barfly, megatons, j.b lenoir, françois gorin, angry brigade


