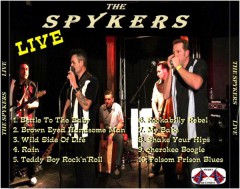01/05/2014
KR'TNT ! ¤ 187 : IKE TURNER / EDDIE COCHRAN / ROCK STORY / JAKE CALYPSO
KR'TNT ! ¤ 187
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
01 / 05 / 2014
|
IKE TURNER / EDDIE COCHRAN ROCK'N'ROLL STORY JAKE CALYPSO AND HIS RED HOT |
TURNER DE BREST !
LES BLAZES DU BLUES – 2e épisode (Part One)
«Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont autant contribué que Ike Turner à façonner la musique moderne américaine. Il était guitariste, pianiste, découvreur de talents, leader de groupe, producteur de disques, compositeur, spécialiste de l’envers du décor. Turner savait tout faire et il le faisait bien.» C’est ainsi que Jon Hartley Fox présente Ike Turner dans l’imparable «Story of King Records».
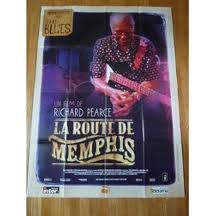
Ike le géant a tiré sa révérence en 2007, mais il existe encore des moyens de le voir en chair et en os. Il apparaît notamment dans «La Route De Memphis», un film de Richard Pearce & Robert Kenner (volume 2 de la série des sept films retraçant l’histoire du blues, produite par Matin Scorsese et sortie sur les écrans en 2004).
Pas facile de raconter l’histoire du blues à Memphis en quatre-vingt dix minutes. Les légendes se bousculent au portillon. Pearce et Kenner en ont choisi deux comme ça, vite fait - B.B. King et Rosco Gordon - et ils ont demandé à Bobby Rush de jouer le rôle du fil rouge. B.B. King et Rosco Gordon sont en fin de parcours : B.B. et Rosco ont quatre-vingt balais - et d’ailleurs, Rosco va casser sa pipe juste après le film. Par contre Bobby Rush qui est une force de la nature conduit toujours son autocar sur le fameux Chitlin’ Circuit. Il évoque ses quarante-et-un ans de métier et fait le con sur scène avec des danseuses pour le moins fessues.
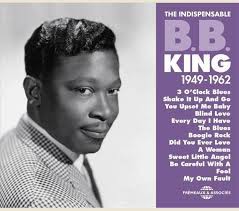
B.B. King rappelle que pendant toute sa jeunesse, il a parcouru huit kilomètres par heure, douze heures par jour pendant seize ans derrière une mule de labour. Faites le calcul, ça fait un sacré paquet de kilomètres. Rosco Gordon rappelle qu’il était une star en 1957 et qu’il a acheté une Cadillac à l’âge de quinze ans. On peut le voir dans le fabuleux «Rock Baby Rock It» de Murray Douglas Sporup, tourné en 1957, avec - entre autres - Johnny Carroll. Mais ça n’a pas duré, car le pauvre Rosco est allé ensuite travailler pendant vingt ans dans une blanchisserie du Queens à New-York pour gagner de quoi vivre. Quand il entre chez un disquaire de Memphis, il constate qu’il n’y a pas de disques de Rosco Gordon à la lettre G. Qui se souvient de Rosco Gordon ?
Dans ce film mal fagoté, on voit - hélas très peu de temps - deux des principales figures légendaires de la scène de Memphis : Rufus Thomas et Jim Dickinson. Rufus évoque WDIA, la première radio animée par des DJ noirs - qui passe de «coooold» à «hotttt, I mean hot, man !» - et qui touche quinze millions de noirs. Et Jim Dickinson rappelle qu’il a tout appris d’Alex, «l’ouvrier de ses parents» qui, justement, écoutait WDIA sur son poste de radio.
Par miracle, nos deux compères réalisateurs ont pensé à filmer Sam Phillips... Ouf !
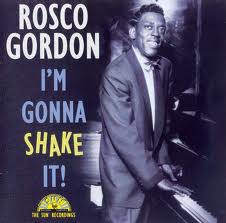
Petit rappel : quatre ans avant d’enregistrer le premier disque d’Elvis, Sam accueillait dans son studio les bluesmen noirs de Beale Street. Il a eu un sacré flair parce qu’il a enregistré Howlin’ Wolf, B.B. King, Rosco Gordon, Junior Parker et Ike Turner. Que des stars. D’ailleurs, quand on posait la question à Sam Phillips, longtemps après qu’il se fût retiré du business : «Quel est le plus grand artiste que vous ayez enregistré ?», il répondait sans l’ombre d’une hésitation : «Wolf !»
On tombe donc sur une courte scène d’anthologie tournée chez Sun et que doivent ab-so-lu-ment voir tous ceux qui considèrent Sam Phillips comme leur père spirituel. Ike entre dans le cadre de la caméra et vient serrer la pince d’un vieux Sam tout barbu. Deux héros à l’écran. On ne peut pas rêver plus belle rencontre. De sa voix traînante, Sam salue Ike : «Tu restes en bon état, Dieu est bon.» En effet, Ike est en forme olympique. Il porte un pantalon jaune et balance des grosses vannes en hurlant de rire. Il retourne le compliment à Sam : «La théière vaut bien la cafetière !» Puis il raconte que c’est B.B. King qui lui a refilé en mars 1951 le tuyau du blanc qui avait un studio d’enregistrement à Memphis. Il précise qu’à l’époque on appelait les disques des artistes noirs des «race records». Sam confirme que c’était une époque extrêmement compliquée : «Les gens de Memphis ne comprenaient pas ce que je fabriquais avec une bande de nègres !» Ike balance alors le compliment qui tue : «Quand je suis venu chez toi, je n’ai jamais senti de préjugé !» Évidemment ! Tout le monde sait que Sam est un mec bien, mais quand un tel compliment vient d’Ike Turner, ça vaut tout l’or du monde. Il règne quand même une certaine tension entre nos deux héros. Ils finissent par se chamailler. Alors Ike coupe court à la chamaillerie en annonçant qu’il doit aller pisser un coup. «Où sont les toilettes ?»
Comme dans tous les autres films de ce type («Only The Strong Survive», «Standing In The Shadow Of Motown»), on nous sert au dessert un grand gala à l’américaine, où les vieux de la vieille se produisent sur scène dans des costumes rutilants. Par miracle, on assiste à la balance du gala de Memphis. À peine deux minutes, mais ça suffit. On voit Ike faire hurler des notes sur sa Strato avec une terrible brutalité. Et là, on comprend enfin ce que signifie le mot punk.
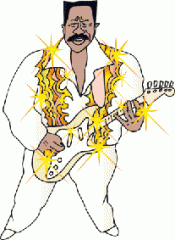
C’est en 2004 que j’ai eu la chance de voir Ike Turner sur scène au Méridien de la porte Maillot. Les Kings of Rhythm nouvelle formule montèrent sur scène très tard dans la soirée. Côté cuivres, le gang était plutôt musclé : deux joueurs de saxophone, un ténor et un soprano, plus un trompettiste affublé d’un chapeau de cuir noir et de lunettes rouges et qui allait jouer dans un style très fluide, un peu à la manière de Miles Davis. Avec en plus un blanc-bec à la guitare, deux vieux nègres aux claviers et un groover d’enfer sur une basse funky rouge, on avait là le meilleur orchestre d’Amérique. Après un petit instro de mise en bouche, Ike ramena sa fraise. On vit surgir un géant, comme dans les contes populaires ! C’était un mastodonte de la taille de Chuck Berry. On comprenait mieux comment ces gens-là avaient réussi à survivre à plusieurs décennies d’excès en tous genres et au poison de la haine raciale : grâce à leur constitution. Ike portait un costume de scène incroyablement funky, presque immaculé, orné sur la poitrine de pierreries étincelantes. Ses cheveux noirs et drus étaient taillés au carré. Son visage, comme ceux d’Arthur Lee et de Screamin’ Jay, ne portait aucune trace de vieillissement. Il avait une peau incroyablement lisse, pas une seule ride. Un vrai vampire. «Fink you !» Il accompagnait ça d’un sourire de fauve surligné d’une moustache en croc. Il s’installa derrière un piano électrique. On aurait dit un taureau assis derrière une table de camping. Il commença par taper dans les vieux classiques comme «Caldonia» et «Charlie Brown». «Fink you !» Ike attrapa ensuite une Strato en or pour jouer le blues. Il mit «Sweet Black Angel» au carré et prit un solo stupéfiant d’agressivité. Il tirait des notes lancinantes de véracité en bas du manche. Il jouait fort, le bougre ! Il passait en force, il martelait ses stridences. Il tordait le manche de la Strato. Il n’existe pas de guitariste plus physique, plus brutal qu’Ike Turner. Et guise d’apothéose, il nous balança dans les gencives une version carabinée de «Bo Diddley». Ce fut la fin de la première partie du set. Pour la seconde partie, il fit monter sur scène une clonette de Tina Turner : même voix, même couleur de peau, même coiffure, mêmes cuisses fermes, même poitrine apparente à travers la même mini-robe maillée. Mais avec vingt ans de moins. On s’est fait la cerise après deux morceaux. Nous étions venus voir jouer le bluesman de Clarksdale, Mississipi. La clonette n’avait aucun intérêt.
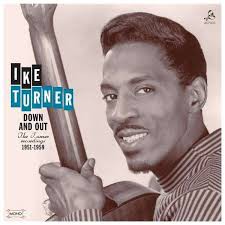
Jerome Records est un petit label espagnol qui vient de rééditer deux séries d’enregistrements de la période 1951-1959. Le premier album s’appelle «Down And Out» et le second «Real Gone Rocket». Sur «Down And Out», on a du pur Ike. Tout est bien, c’est swingué jusqu’à la moelle des notes. On entend le punk jouer de la guitare sur «Cubano Jump» et l’une de ses nombreuses poules, Bonnie, chanter sur «Looking For My baby». On entend sur ce disque du jump blues exceptionnel. Ike place un fantastique solo de guitare dans «I Wanna Make Love To You». Sur la face B se trouve une monstruosité nommée «Boxtop» qui est le premier essai de Tina Turner au chant. Ike balance sa purée. On entend ensuite chanter l’un des interprètes engagés par Ike, un type extraordinaire du nom de Tommy Hodge. C’est un screamer fou digne de Little Richard. «(I Know) You Don’t Love Me» réveillerait les trente-cinq mille morts du premier assaut au Chemin des Dames. C’est pas très compliqué : tous les morceaux de ce disque sont bons, à condition bien sûr d’en pincer pour le raw r’n’b et le jump blues d’antan.
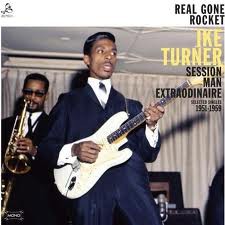
Sur «Real Gone Rocket», Ike fait le session man. Il accompagne des gens comme l’immense Sly Fox - Eugene Fox de son vrai nom - («I’m Tired Of Begging» avec un solo de brute) et sur la face B, on tombe sur les singles de la période King. «Just One More Time» frise la folie pure, tellement ça swingue. Voilà un son jamais égalé, monté sur une basse folle et grillé par un solo de sax d’un autre temps. «The Big Question» est un heavy jump haut de gamme, mais quand on a dit ça, on n’a rien dit. On ne peut qu’imaginer ce hit sortir d’un juke-box de Clarksdale, Mississipi, en 1955. Un peu plus loin, on tombe sur «Calling My Name», bardé de chœurs et inspiré comme ce n’est pas permis. Les notes de pochette indiquent qu’il s’agit probablement de la première apparition des Ikettes mythiques. Cerise sur le gâteau avec «Ho Ho», un instro d’Ike le fou qui claque ses notes en pleine cavalcade. Un son qu’on ne retrouvera, étrangement, que sur le premier album de Moby Grape.
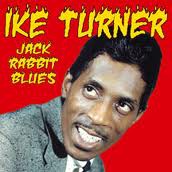
Autre cochonnerie : «Jack Rabbit Blues» qui rassemble les singles enregistrés entre 1958 et 1960. Ike le punk tournait à plein régime. Il portait une pompadour de quinze centimètres de haut et une fine moustache à la Little Richard. On trouve sur ce ramassis extravagant quelques abominations baveuses comme «Call Your Name» ou «Double Trouble», blues puissant grâce auquel Otis Rush vient nous rusher la ruche. Otis Rush toujours avec «Keep On Loving Me Baby», du boogie avant la lettre au parfum de nicotine et chargé des relents d’arrière-salle, énorme et exaltant. La valse des génies inconnus au bataillon se poursuit avec «I’ll Weep No More» où l’on entend un batteur dément fouetter ses peaux et Betty Everett chanter un gospel de tous les diables. Fabuleux jumping-blues des arcanes du sax et du sex de la baronne des cimetières avec «Tell Me Darling» et Ike attaque «My Baby Is Good ‘Un» à la guitare punk, un vrai truc de fou, comme on dit quand on perd les pédales. On tombe facilement dans les vieilles harangues des pêcheurs de harengs avec des morceaux comme celui-là. Dans «Walking Down The Aisle», Ike fait le con avec son baryton et dans «Box Top», Ike le géant croasse comme la grenouille crapautée. Magie pure et solo de rêve. Buddy Guy surgit dans «You Sure Can’t Do», un heavy blues bardé de cuivres. Buddy troue le cul du blues, et sa voix accroche comme un grappin planté dans la gorge de l’amiral d’escadre. À l’abordage ! On retrouve cette monstruosité qui s’appelle «Ho Ho». Ike joue comme le pire des punks. Il devient méchant et violent, il se conduit comme le voyou du quartier qui attache les chats à sa mobylette et qui les traîne dans les rues. Les guerriers apaches faisaient la même chose avec les tuniques bleues capturées vivantes. Yaoouuh Rintintin ! L’immonde Ike torture ses gimmicks, il les fait hurler. Ah le sale nègre ! Attention, ce n’est pas terminé car sur les quatre derniers morceaux, cette chienne lubrique de Tina vient nous hurler dans les oreilles. Une vraie cinglée. On aurait dû l’enfermer. Elle fout le feu dans la prairie. Avant elle, aucune Américaine n’avait osé hurler comme ça dans un micro. Mais ceci est une autre histoire, comme dirait l’oncle Paul.

Ace Records s’est aussi fendu d’une compilation des instros d’Ike sortis entre 1956 et 1964. On y retrouve le fameux «Ho Ho» et quantité d’autres perles de jukebox comme le diabolique «Steel Guitar Rag» dans lequel Ike sonne country. Au cas où personne ne l’aurait encore remarqué, Ike Turner est un vrai crack. Il sait tout faire. Sa country, c’est de la haute voltige. Par l’esprit, il bat tous les autres. «The Groove» est un instro absolument dévastateur. Ike claque le son, il pince des notes de fou, il affole ses gammes comme il affole les sens des femmes. Son instro est de la pure dynamite. Il balance ses coups de tremolo mortels et le sax le reprend. Dans «The Rooster», on l’entend écraser ses accords avec une violence digne de guerriers vikings ivres d’hydromel et de carnage. Cet instro est une véritable abomination. Le voilà parti en solo. On entend le son clair du petit freluquet noir perdu au pays des blancs, tout seul avec sa guitare. Mais on sent bien qu’il a des choses à prouver. Sur «Prancin’», on l’entend tirer une corde et la lâcher - tzzzzing ! Quelle brute ! Il embarque «Go To It/Stringin’ Along» à la guitare punk. Il joue le thème militairement, tout seul avec son médiator. Il ne dépend de personne en Harley Davidson. Tous les autres soldats sont morts. Il joue l’intégralité du morceau en solo. Sacré Ike. Il se savait invincible. C’est un petit nègre protégé par les dieux du rock, comme Chuck Berry.
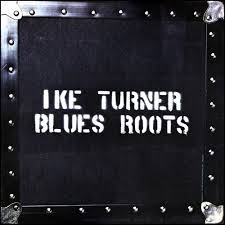
Dans les années 70, Ike va sortir deux albums solo, «Blues Roots» et «Bad Dreams», deux véritables bêtes bourrées de reprises triées sur le volet. C’est pour lui une façon de rappeler qu’il est en route depuis un bon moment et qu’il a connu et joué avec tout ce que le Deep South comprenait de légendes du blues et du r’n’b. Il fait par exemple une reprise de «The Things I Used To Do» de Guitar Slim, un blues de cabane de forêt et on entend Ike tordre le cou du cut avec une force de conviction à peine croyable. Il torche un solo au son clair d’une grande inspiration. Le hit de ce disque pourrait bien être «Goin’ Home», heavy blues traversé par un solo de trompette bouchée. Ike y joue son vieux va-tout de king of rhythm. Groove de génie avec «Right On» qu’il amène avec une classe épouvantable. On sent la patte du maître. Ike sait claquer un climat. Il fait monter la température et tape dans son baryton - hey baby right on. Pur génie. Ce mec est beaucoup trop doué. Même quand il sonne plus funky, comme dans «Think», on le suit à la trace. Il fait pleurer les notes de son solo de guitare. Il ne rigole pas. «That’s Alright» est monstrueux dès l’intro. Riff mortel, l’un des plus mortels de l’histoire du rock, instrumentation de punkster, c’est Ike qui joue dans le jus du juke, il pelote ce riff sourd qui vient du fleuve, puis il balance un solo dégueulasse sur deux notes et fait son voyou. Ike est une phénoménale ordure délinquante à la peau noire, un miracle qu’il n’ait pas été lynché par les blancs dégénérés. Et cette façon qu’il a de chanter ! Franchement, ça tétanise. Il reprend aussi le fameux «My Babe» de Willie Dixon, pompé sur «This Train» de Sister Rosetta Tharpe.

Sur «Bad Dreams», il tape une reprise de «Dust My Blues», le vieux classique d’Elmore James. Sa version est beaucoup plus étoffée que celles du Spencer Davis Group ou de Fleetwood Mac (transformée en «Dust My Broom»). Ike a fait venir les Ikettes et tout le tremblement de sa Revue. Il ramène toute l’énergie du gospel dans ce vieux classique et c’est là son trait de génie, c’est là que s’exprime sa grandeur d’âme. C’est ainsi que se chante le blues à Clarksdale, dans le Mississipi. Il finit en baryton, baby ride on, et monte dans le baryton, baby ride on. Effarant. Dans «Don’t Hold Your Breath», il part en baryton, c’est le punk qui conjure la poule - no no baby. Comme dans ses autres morceaux, il fait démarrer les percus au second ou au troisième couplet. Ike est un géant du son et du suspense. Son «Flockin’ With You» est complètement pourri de swing. On sent l’humidité du bayou, les syllabes mouillées et les vieux réflexes mississipiens. Il chante «Later For You Baby» les dents serrées. Il s’y tient. Il ne lâche pas le morceau. Il en veut. Il balance une cochonnerie de solo punk, une indicible horreur. Plus besoin de Wayne Kramer. Avec Ike Turner, on a tout ce qu’il nous faut. Groove faramineux : «Rats» : «There’s a whole lotta rats around/ Real rats, black rats, even white rats and you know what ?/ They all eat cheese !» (Il y a tout un tas de rats dans le coin/ Des vrais, des noirs, même des blancs, et vous savez quoi ? Ils mangent tous du fromage !) C’est une leçon de diction signée Ike Turner - Ride on mum ! - Ike règle ses comptes. Il fait ce qu’il veut - check it out ! Il finit cet album stupéfiant avec un gospel swing dément qui s’appelle «I Love The Way You Love».
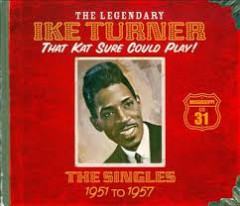
Mais s’il fallait faire un choix et ne retenir qu’un seul disque, ce serait «That Kat Sure Could Play». Il s’agit d’un petit coffret magique de quatre disques. C’est le même principe que dans les coffrets Bear Family : on suit chronologiquement TOUTES les sessions d’enregistrement auxquelles Ike a participé, entre 1951 et 1957. On va de studio en studio et bien sûr on se retrouve parfois au Memphis Recording Service de Sam Phillips ou chez Syd Nathan à Cincinnati. Ce coffret est brillant, car on y entend une quantité impressionnante d’artistes complètement tombés dans l’oubli et qui furent à cette époque de fantastiques shout-bam-ballamers. La plupart du temps, Ike fait partie du backing-band et il joue du piano ou de la guitare. Il est en studio avec des stars comme B.B. King, Wolf ou Elmore James, et beaucoup d’autres bluesmen aussi talentueux mais hélas inconnus au bataillon. Ike s’est frotté à tellement de grosses pointures qu’il n’est pas surprenant qu’il ait fini par devenir lui-même une grosse pointure.

Quand on entre dans cette caverne d’Ali-Baba, on tombe aussitôt sur Jackie Brenston & The Delta Cats (qui deviennent ensuite les fameux Kings Of Rhythm). «Rocket 88» est sympa, c’est vrai, mais «My Real Gone Rocket» est une vraie pétaudière. Épouvantable ! Dévastatrice ! Ça se passe chez Sam Phillips. Comme par hasard. En mars 1951. On n’était même pas nés. Toute la folie du rock était déjà là et ça gigotait pour de bon. Même chose pour «Independant Woman», monté sur un riff dément. Produit par Sam Phillips et sorti sur Chess.
Nous avions déjà deux sales punksters à cette époque : Ike et Wolf. En 1951, Wolf beuglait «How Many More Years» dans le micro de monsieur Phillips, Ike l’accompagnait au piano et Sam produisait. Et voilà le travail ! Existe-t-il un trio plus mythique ? Non.
Sur «Dry Up Baby» de Robert Bobby Bland, on entend Matt Murphy jouer un solo furibard. On l’entend aussi dans «Good Lovin’» et dans «Drifting From Town To Town». Ike accompagne au piano un certain Boyd Gilmore. Son «Ramblin’ On My Mind» est une sorte de «Dust My Blues» primitif. Ça va vous nettoyer les oreilles, je vous le garantis. Ike pianote comme un dingue, c’est plus fort que lui, il ne peut pas s’en empêcher. Pendant deux minutes, Boyd Gilmore devient un héros, avec son registre gras et puissant, puis il replonge dans l’abîme du temps. Avec «Whole Heap Of Mama», Brother Bell avait de quoi faire sauter la planète. Il nous balance un jump blues bourré d’énergie nucléaire, fendu par un solo de sax aux notes fondues. On retrouve l’admirable Rosco Gordon avec «No More Diggin’», un swing mémorable. On ne sait pas ce que fout Ike dans le studio, puisque Rosco joue déjà du piano. Drifting Slim ? Encore un fabuleux inconnu au bataillon.
On retrouve l’immense Boyd Gilmore dans le disk 2. Chant hurlé dans «All In My Dreams» et fantastique travail de shouter dans «Take A Little Walk With Me». À cette époque, Ike accompagnait pas mal de stars inconnues. On le retrouve avec Bonnie Turner pour «My Heart Belongs To You». Bonnie était excellente, elle y allait au culot du feeling. Si Ike est un héros, alors Bonnie est une reine. On retrouve ensuite le fameux «Looking For My Baby» magnifique de prestance. Bonnie et Ike s’échangent les couplets avec une classe insolente. Ces gens-là avaient un talent qu’on peine à mesurer. On ne peut que s’éberluer. On croise d’autres géants, comme Johnny Ace et Earl Forrest qui balancent «Trouble And Me», un blues cuivré qui s’écroule dans des flaques de bar-room brash. Ike pianote comme un dingue. Encore un cran au dessus avec Mary Sue et son «Everybody’s Talkin’», un swing dément, hallucinant de vérité pure. Baby Face Turner ? À tomber. Sorti sur Modern - l’un des labels des frères Bihari - «Blue Serenade» est une perle de blues de bastringue qui peut hanter les mémoires. Ike pianote. Encore pire : «Gonna Let You Go», soupe brutale, mal foutue, pur trash des origines. En 1952, Elmore James enregistrait «Please Find My Baby» et on sentait sa force. Comme si on pouvait la toucher. Il hurlait son blues et derrière, Ike swinguait, fier comme Artaban. On tombe ensuite sur les heavy blues rampants de Little Milton. Les géants pullulaient, dans les campagnes du Deep South.
C’est sur le disk 3 qu’on retrouve Eugene Fox, l’un des chanteurs les plus extraordinaires de tous les temps. Il fait du guttural et pousse le bouchon bien plus loin que Louis Armstrong ou Wolf. «Stay At Home» est du pur Fox, raunchy en diable. Ike y pond un solo de guitare dément. Eugene Fox est un méchant braillard. Quand il ne chante pas, il joue du sax. Un autre hurleur de gros calibre : Jesse Knight. C’est le neveu d’Ike, bassman dans les Kings Of Rhythm. Là, il balance un jump blues nommé «Nothing But Money» avec une rage digne de l’oncle.
Pour d’autres singles, Eugene Fox change de nom. Il devient The Fox ou The Sly Fox. «Hoo Doo Say» est une nouvelle énormité. Puis on retrouve «I’m Tired Of Beggin’» qui tient du pur génie. Ike s’amuse lui aussi à changer de nom et devient Lover Boy. Sur «Love Is Scarce», il pianote comme un fou à la surface d’un son épais et ça sonne comme un hit de Fats Domino. Vous tomberez aussi sur le fabuleux Lonnie The Cat. «The Road I Travel» est un jump blues magnifique et Lonnie The Cat fait déraper ses syllabes. Tous ces shouters étaient des artistes complets. En voilà encore un autre : Clayton Love. Il sonne comme Esquerita. Et Billy Gayles sonne comme Fats Domino. On a en prime la magie du son des années cinquante. Avec «Sho Nuff I Do», Elmore James est écœurant de classe. La voix + le son : tout est là. C’est l’équation magique. Swing fabuleux avec «Baby Wants», un single enregistré par The Flairs, dont le chanteur n’est autre que Richard Berry, le daddy de Louie. On sort épuisé de ce disk.
Eugene Fox attaque le disk 4 avec du pur jus de raw, «My Four Women». Il nous envoie directement au tapis. On y reste pour le morceau suivant : Sam Phillips accueille Little Milton dans son studio pour enregistrer «Looking For My Baby». Gros son bien sale et doucement cuivré par derrière. Ike claque ses notes dans «Go To It» et si on veut l’entendre jouer un gros solo de blues, alors c’est dans «The World Is Yours» de Johnny Wright. On l’entend aussi jouer des phrasés périlleux dans «I Wanna Make Love To You» des Trojans, groupe de doo-wop du Missouri. Parfaitement à l’aise, Ike part en solo et multiplie les figures de style aventureuses. Jamais on ne reverra un truc pareil. «I’m Tore Up» est un autre brûlot d’Ike chanté par Billy Gayles : jump blues cuivré avec un son sur-puissant. Là, on est chez King. Le son qu’ils sortent vaut celui de Nashville Pussy. On retrouve ce sacré shouter de Billy Gayles dans «I Had Never Known You». Ike joue de la guitare sur «What I Am To Do» des Rockers, un autre groupe de doo-wop signé sur Federal. Ike y coule des gimmicks infernaux à tous les coins de rue. Dans «No Coming Back» de Billy Gayles, qui est encore un heavy blues à la Fats Domino, Ike sort un solo des enfers. C’est à l’immense Jackie Brenston que revient l’honneur de boucler cet impitoyable panorama. Il peut chanter comme Little Richard et dans «Ain’t Got No There» des Stairs, Jackie descend dans le baryton des catacombes. Une fille chante avec lui. On a là l’un des singles les plus extraordinaires de cette époque. Jackie refait le screamer dans «Cryin’ Over You». Un bon conseil : allez fouiner du côté de Jackie Brenston. Il transforme tout ce qu’il touche en or. Et sans Ike, pas de Jackie Brenston. Sans Ike, pas de Billy Gayles. Sans Ike, pas d’Eugene Fox. Sans Ike, pas de Tina. Et sans Ike, pas d’Ikettes. Et sans Jackie Brenston, sans Billy Gayles, sans Eugene Fox, pas d’Ike.
C’est une façon comme une autre de rappeler l’incontournabilité d’Ike Turner. On parle aussi d’incontournabilité, quand on évoque le souvenir de Sam Phillips. Ce sont eux qui ont tout inventé, enfin dans la forme que nous connaissons et qui est parvenue jusqu’à nous. Ike et Sam ont connu les vrais trucs, ceux que nous ne connaissons pas.
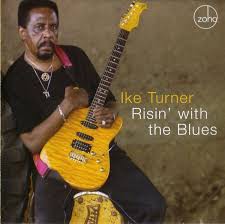
Le dernier album qu’Ike Turner enregistra avant de s’éclipser s’appelle «Risin’ With The Blues», comme par hasard. Quand sonne l’heure de la mort, on revient aux sources, inévitablement. C’est un album de blues au sens large, au sens où Ike l’entendait. Sa vision du blues englobait le funk et le jump blues. Il ne se limitait pas au blues électrique, comme le font par exemple Muddy Waters ou Buddy Guy. «Gimme Back My Wig» qui ouvre le bal est très funky en diabolo et la voix d’Ike, avec l’âge, s’est colorée. Il tape dans le heavy blues de desperado avec «Tease Me». Il nous renvoie tous au limon du Delta. C’est absolument fabuleux de boogie-mania. Pas de doute, Ike se souvient du vieil Eugene Fox. La puissance vient de là. Et de Wolf. Quasiment tous les morceaux de l’album sont bons. «I Don’t Want Nobody» est un joli jerk des catacombes. «Jesus Loves Me», un gospel bourré de heavy blues. Ike chante «Eighteen Long Years» avec une ferveur ravageuse et il revient au heavy blues avec «Rockin’ Blues», qu’il solotise à sec. Sur ce disque, tout est classique, chanté avec rage et inspiré. Il tire sa révérence avec «Bi Polar» (on l’accusait d’être un malade bi-polaire) - funky-blues des enfers de Dante, bien vu et étonnant, du pur Ike, cut d’une rare puissance, ultime spasme d’une vie entière consacrée à la musique de nègres.
Avec lui, c’est un son qui disparaît. Pffffuiiiittt ! Envolé ! Que reste-t-il aujourd’hui ? Tina Turner ? Vous rigolez ?
Signé : Cazengler, qui préfère Ike à Ikea
Richard Pearce & Robert Kenner. La Route de Memphis. The Blues, A Musical Journey Vol 2. DVD 2004
Ike Turner. Down And Out. Ike Turner Recordings 1951-1959. Jerome Records 2011
Ike Turner. Real Gone Rocket. Selected Singles 1951-1959. Jerome Records 2011
Ike Turner. Jack Rabbit Blues. Secret Recordings Limited 2011
Ike Turner. Blues Roots. United Artists Records 1972
Ike Turner. Bad Dreams. United Artists Records 1973
Ike Turner & His Kings Of Rhythm. Ike’s Instrumentals. Ace Records 2000
Ike Turner. Risin’ With The Blues. Zoho Roots 2006
Ike Turner. The Legendary Ike Turner. That Kat Sure Could Play. The Singles 1951-1957. Secret records 2010
EDDIE COCHRAN / STRING FEVER
String Fever / Nice 'n'Easy / Pushin' / Fast Jivin' / Guitar Blues / Jungle Jingle / Guybo ( 1 ) / Meet Mister Twendy / Scratchin' / Guybo ( 2 ) / Drum City / Strolin' Guitar / Fourth Man Theme / Song Of New Orleans / Hammy Blues / Jim Sand Witch / Have An Apple, Deary / Country Jam / Shotgun Wedding Theme / Chiken Shot Blues / Eddie's Blues / Lonesome Blues / Bread Fred / My Way / Jolly Bean / Don't Bye, Bye Baby Me / Rain / Gettin' Funky / Funk City / Undecided / Annie Had A Party / So Fine, Be Mine
Livret : Darrel Higham ( mai 2008 )
Rockstar : 2009.
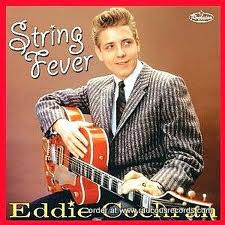
Longtemps que j'en rêvais, une collection de tous les instrumentaux d'Edie Cochran. Rien de plus pénible que de godiller entre les plages éparpillées au hasard des rééditions sur les différents trente-trois tours. C'est sorti depuis cinq ans chez Rockstar... Le son d'un CD n'est pas toujours parfait mais la technologie vous facilite la navigation. En plus ils ont demandé à Darell Higham de présenter. Comment ne pas craquer quand l'objet désiré vient de lui-même se nicher dans vos doigts alors que vous égreniez sans trop y croire les casiers du disquaire !
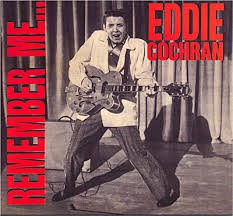
Eddie Cochran, chanteur et guitariste, artiste de scène et musicien de studio. Un garçon pressé à la poursuite du succès. Parti trop vite, à vingt et un ans, comme l'on quitte la table alors que l'on n'a pas encore terminé les hors d'oeuvre. L'on tilte toujours lorsque l'on regarde les autographes qu'il griffonnait à toute vitesse à ses fans, la plupart du temps il se contentait d'une formule toute faite, un peu à l'emporte-pièce qui le dispensait des développements fastidieux et incertains, mais qui depuis résonne étrangement, Don't Forget Me, comme s'il avait eu la prescience que le temps lui était compté. L'est parti sans avoir eu le loisir de jeter un regard sur le travail accompli, l'oeuvre qu'il laisse est à l'image de ces chambres d'ados sens dessous dessus dans lesquelles l'on ne peut plus marcher tellement le plancher est recouvert d'objets divers et hétéroclites dont on ne sait s'ils étaient destinés à finir à la poubelle ou à être conservés telles de précieuses reliques toute une existence.
C'est un peu le lot de tout le monde, lorsque vous êtes mort, ce sont les autres qui se chargent de vider les tiroirs et d'opérer le tri, et même vos amis les plus chers ne sont pas dans votre tête. Vous avez toujours des pensées secrètes, des projets dont vous n'avez encore parlé à personne. Pour Cochran, c'est un peu plus compliqué. L'était un jeune homme pressé non pas parce qu'il avait les dents qui rayaient le plancher et qu'il était prêt à passer sur votre cadavre si nécessaire. Son activité de musicien de studio montre qu'il ne s'économisait pas, certains de ses plus beaux solos sont sur les disques des copains, concorde aussi le témoignage des musiciens anglais, ne gardait pas ses secrets de fabrication pour lui, transmettait ce qu'il savait sans se faire prier.
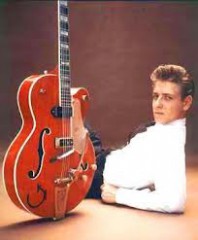
Cochran avait un énorme problème de plan de carrière. Né trois ans après Elvis, l'est arrivé un peu tard pour être tout à fait aux avant-postes. Il y avait ses désirs d'un côté, et tout le staff de la maison de disques derrière. En 1958 Elvis a déjà deux vies derrière lui. Une pour les garçons, un autre pour les filles et sa gloire participe des deux. Commence par être le prince créateur du rockabilly et continue par devenir la star des plateaux de cinéma. Et le gamin Cochran a été autant fasciné par la première que par la seconde. L'on sait aujourd'hui combien les films d'Elvis ont dévoyé le musicien, mais sans recul le jeune Eddie envisageait la problématique dans l'autre sens : le succès récolté au cinéma lancerait sa carrière de chanteur. Avait-il tort ou raison ? Une chose est sûre : le démarrage de Cochran piétinait. Côté Hollywood, les offres sérieuses de tournage tardaient à venir, côté rock'n'roll l'establishment avait réussi à glisser l'éteignoir sur l'incendie. Si Cochran et Vincent s'envolent pour l'Europe c'est bien parce que le rock qu'ils représentaient n'était pas des mieux vus.
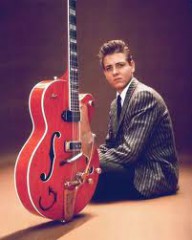
Lorsque la camarde le fauche, Eddie ne sait pas encore dans quelle direction il se dirigera : cinéma ou rock'n'roll ? Un destin à la Presley ou à la Vincent. Récupération ou jusqu'au boutisme ? Les fans ont tendance à indiquer une troisième voie : une authenticité et un savoir-faire musical qui lui auraient permis de s'inscrire sans trop de mal dans le devenir du rock anglais en pleine gestation. L'aurait évité le reniement à la Elvis et la sortie d'autoroute à la Craddock. Difficile de leur donner raison, même si je partage cette hypothèse haute. De toutes les façons toute une partie de la théorisation de la réponse se trouve dans son oeuvre instrumentale, c'est pour cela qu'elle nous intéresse au premier chef.
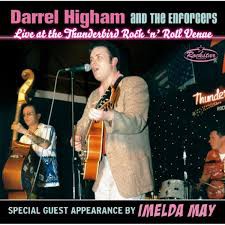
Eddie Cochran est un des plus grands chanteurs blancs de rock de sa génération. Darell Higham rappelle que c'est un peu par inadvertance. S'est mis à chanter ses propres morceaux parce qu'il n'avait pas dans son entourage d'artistes capables de les interpréter de façon adéquate. En composant s'était taillé un costume à sa mesure et personne n'arrivait à l'endosser sans paraître fagoté... Sa préférence allait à la guitare, devient dès quinze ans un petit prodige de l'appareil, pas du tout un virtuose à la petite semaine et encore moins un chien savant avec lequel les maîtres essaient de soutirer de l'argent au public. L'est le musicos de base, le collègue de studio qui assure mieux que tous les autres, qui propose une solution à vos problèmes, bref le gars sur qui l'on peut compter à coup sûr. Pas la bonne poire, mais le mecton irremplaçable qui a toujours quatre longueurs d'avance sur vous.
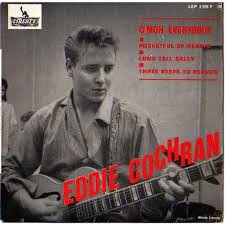
Sur son jeu de guitare, et sur les techniques d'enregistrement. Un peu la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on ne voit pas, cachée par l'autre qui du coup n'en paraît que plus volumineuse. Et pourtant au début des années soixante la guitare électrique est reine. Mais l'on prête plus facilement l'oreille à Duane Eddy et à Link Wray qui ne chantent guère. En Europe l'on est obnubilé par le son clair des Shadows, là encore cent pour cent instrumental. Le travail qu'ils effectuent derrière Cliff Richard on le porte au crédit du chanteur. De même l'on admire la Cadillac de Vince Taylor et l'on ne prête guère d'attention à Joe Moretie qui conduit la berline.
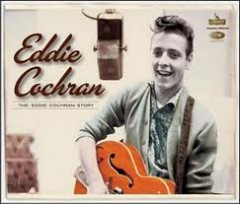
Mais tous ces guitaristes jouent un peu à rebours du style d'Eddie, ils ne recherchent pas vraiment le son mais une sonorité. Toute la machiste différence qui existe entre une jolie fille et une très belle femme. La deuxième génération, celle qui atteindra la gloire ( dont nous parlions dans notre article sur les Yardbirds ) Clapton, Beck, Page, ajouteront au premier rock anglais cette recherche du particularisme individuel qu'ils exprimeront dans les soli. C'est sans doute Big Jim Sullivan qui est resté dans l'ombre des studios, alors qu'il était aussi doué que les trois autres, qui s'inscrirait le mieux dans la lignée de Cochran. Ce n'est certainement pas un hasard s'il n'a pas voulu surfer sur la vague engendrée par les Stones. Guitariste de premier ordre, Cochran ne se met pas en avant, dans les concerts donnés en Angleterre il laissera souvent Joe Brown se charger du solo, lui-même n'assurant que la rythmique.
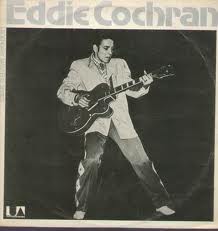
Darell Higham explicite cette attitude. C'est bien la guitare d'Eddie qui fait la beauté, l'originalité, et la force de morceaux comme C'Mon Everybody, Summertime Blues, Nervous Breakdown, mais c'est simplement un motif rythmique des plus vigoureux sans aucune démonstration de virtuosité individuelle. La guitare est jouée au service du morceau pas dans l'intention de mettre en valeur l'habileté du guitariste. Ce n'est pas un manque de savoir-faire. Eddie sait swinguer. A beaucoup écouté le jazz, ce qui lui donne cette aisance d'acclimatation à tout style de chanteurs dans les studios. Fait preuve d'une plasticité et d'une adaptabilité confondante, laissez lui cinq minutes et il tombe en phase avec vous, de la plus navrante variété à la plus haute voltige chromatique... BB King a déclaré que le seul blanc - avec qui il avait joué - qui était capable de sentir le blues comme un noir, s'appelait Eddie Cochran. Quand on réfléchit quelque peu à la naissance du hard rock, comment ses protagonistes ont pillé le répertoire blues pour asseoir l'architecture de leurs morceaux, l'on ne s'étonne plus de voir les Blue Cheer reprendre Summertime Blues, les premiers concerts de Led Zeppelin s'achever sur des reprises identiques, les Who choisissant pour leur Live At Leeds un titre de Cochran alors qu'il leur restait des tas de leurs propres morceaux.

C'est en cela que cet assemblage de pistes instrumentales est un peu frustrant. Eddie n'y va jamais plus loin que Cochran. L'ensemble part un peu de tous les côtés. C'est un peu la loi du genre, l'on ramasse tout, l'auditeur fera le tri. Des déchets bien sûr, mais l'on devine que Cochran les aurait de lui-même rejetés. Du meilleur, mais qui ne va jamais plus loin que ce qui existe sur la discographie chantée. L'on a l'impression que Cochran joue pour se chauffer les doigts ou l'oreille rivée sur la cohésion de l'orchestre. Parfois pour s'amuser. En fait si Cochran avait vécu, s'il avait eu l'opportunité de réaliser un disque instrumental, qu'y aurait-il mis de novateur ? L'énigme demeure et l'écoute obligatoire et irremplaçable de ces faces oubliées ne nous apporte rien de plus que nous ne sachions déjà.
L'on tire des plans sur la comète Cochran, mais elle passe si loin de nous, totalement insensible à notre présence...
Damie Chad.
ROCK'N'ROLL IS HERE TO STAY
UNE AUTRE HISTOIRE DU ROCK
BRUNO LESPRIT
( Robert Laffont / Avril 2014 )
Ce que c'est que d'être célèbre chez son libraire préféré ! Je venais, en toute innocence, commander un roman policier sur Elvis, lorsque Mis Panthera à la longue chevelure bouclée, moulée dans son inimitable démarche féline m'a interpellé : « J'ai pensé à vous M Damie Chad, on l'a mis de côté pour vous, ça vient de sortir ! » et elle m'a glissé un gros bouquin entre les doigts. Couverture rouge un peu cracra ( et pas du tout mimi ), ne devait pas y avoir d'illustrateur sous la main quand ils ont maquetté la couve, z'ont dû demander sans réfléchir au gars qui passait par hasard juste à ce moment pour relever le compteur d'électricité, l'on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Oui mais Bo Diddley nous a prévenus : You Can't Judge A Book Just Looking The Cover. Alors même si ce n'est pas beau, puisque c'est Bo qui le dit, on achète. En plus, le titre est alléchant Rock'n'Roll Is Here To Stay, un petit parfum teddy à ne pas dédaigner, et le sous-titre prometteur Une Autre Histoire Du Rock, enfin, l'on va déserter les grandes avenues pour se perdre dans de tortueuses venelles ignorées du grand public. De toutes les manières il est facile de me faire craquer, suffit de prononcer le mot rock'n'roll, c'est ma principale zone érogène, en plus servi very hot avec le si mystérieux sourire carnassier de Miss Panthera, j'ai dit oui avant même de regarder le laïus de présentation...
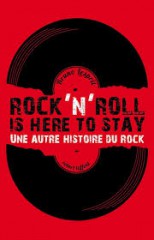
J'ai commencé à tiquer à la lecture des quatre lignes de la bio de l'auteur. Bruno Lesprit, pour moi inconnu au bataillon des rockers. L'a déjà commis un livre sur Bashung, en 2010. Un petit air de détrousseur de cadavre. En plus s'y sont mis à deux – en duo avec Olivier Nuc - avant que le corps ne soit trop froid. Nuc bosse au Figaro, pas vraiment le canard que j'achète pour me tenir au courant de l'actualité rock, et Lesprit au Monde. Je sais bien que par les temps de disette qui courent l'on s'attable au râtelier qui vous accueille sans trop faire le difficile, mais je me méfie. Le Monde avec sa pseudo-objectivité démocratique me débecte un tantinet, encore un paillasson que je ne prends même pas la peine d'ouvrir lorsque j'en trouve un exemplaire abandonné sur une banquette du métro. Mais assez de procès d'intention, passons aux actes et aux paroles, comme disait le grand Victor Hugo.
ROCK'N'ROLL !
C'est un mot magique. Qui recouvre de multiples acceptions. Pour Bruno Lesprit faut attendre les quatre dernières lignes pour qu'il nous livre enfin la clef d'or de sa petite cassette favorite. Peu de monde à l'intérieur, les Scènes d'Enfant de Shumann – le genre de révélation qui ne rime pas à grand-chose, c'est un peu comme si vous écriviez une monographie sur les dinosaures et que vous terminiez en disant que vous préférez les fourmis, par contre ça vous classe l'intello bobo aux idées larges, qui chérit le classique, mais avec l'esprit ouvert puisqu'il se pique de connaître aussi un bout de gras sur le rock'n'roll. Pour la disco rock, il y a tout de même un titre, attention messieurs Mesdames je tire le lapin rose de mon chapeau, c'est, mais oui, impensable, incroyable, inouï : les Beatles ! A la limite pourquoi pas. Pour une autre histoire du rock, c'est un peu râpé et point trop original, mais dans la série je continue de creuser ma tombe au bulldozer, je révèle le titre de mon album préféré : Abbey Road ! L'est sûr que lorsque l'on traverse sur les passages cloutés, l'on minimise les chances de se faire renverser par le hot rod du rock'n'roll lancé à toute vitesse.
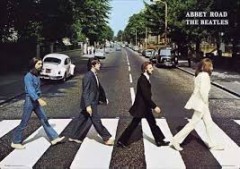
Mais il aggrave son cas. Il précise, Shumann et Abbey Road, ça c'est de la vraie bonne musique, et au cas où vous soyez totalement idiots, il ajoute que ce n'est pas comme le rock'n'roll. Faut être juste : il a de bonnes raisons de ne pas aimer le rock'n'roll : l'a attrapé des acouphènes au dernier concert de Metallica. A l'en croire c'est pire que des morpions avec la petite Suzie. Depuis il ne supporte plus le rock'n'roll et pour s'en défaire et s'en convaincre il a barbouillé sur plus de quatre cents pages ( grand format, petits caractères ) une contre-histoire du rock'n'roll dans laquelle il professe moultes critiques envers cette musique qu'il n'a même pas le courage de qualifier - en vieux réactionnaire décrépi des oreilles qu'il est devenu – de diabolique.
TETES DE PIPES
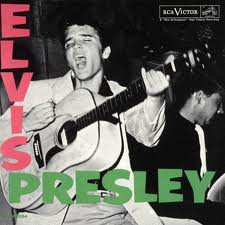
N'aime pas le rock'n'roll. Mais il y a trois figures mythiques qui le dérangent plus que toutes les autres. Sans doute, parce qu'elles le renvoient à un niveau symbolique, et à la puissance mille, à sa propre incomplétude. A tout seigneur, tout honneur. Le Roi Elvis d'abord. C'est facile et guère surprenant. Au contraire d'Eddy Mitchell qui assure qu'il a mis de l'eau dans son rock, mais qu'il salue son époque, Lesprit ne s'incline ni devant sa majesté ni devant les premiers temps d'innocence. Dites tout le mal que vous voulez de Presley, il le mérite, et je vous suivrai, mais Bruno Lesprit procède d'une autre manière : en abattant le chêne vénérable c'est toute la forêt du rock'n'roll qu'il espère mettre en coupe réglée. Il n'hésite pas à hurler avec les loups mais profite qu'ils aient le dos tourné pour infester les sentiers qu'ils ont l'habitude de fréquenter de pièges aux dents acérées. Leur casserait les pattes avec délectation.
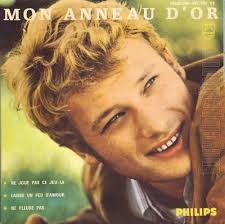
Suite logique : deuxième cible : Johnny Hallyday. Pluie d'exocets sur l'ambulance pour détruire l'hôpital qui est derrière. L'on comprend la démarche : Presley, c'est loin et il y a des tas de lecteurs qui n'écoutent que la production nationale. Donc il dénigre Johnny pour les dissuader d'écouter du rock français. De toutes les manières il limite the french rock à Téléphone à qui il reproche de s'être séparé, et à Indochine qui s'obstine à continuer. Dans les deux cas, ils ont tort.

Le troisième punching ball n'est pas un chanteur. L'a droit à son chapitre personnel. L'on sent la jalousie d'auteur. La vie est profondément injuste : Bruno Lesprit qui n'aime pas le rock'n'roll tape sur un collègue qui l'adore et qui est devenu la référence dans le milieu médiatique. La simple existence de Philippe Manoeuvre l'ulcère. L'a réussi là où lui il a échoué. L'on n'est pas obligé de souscrire à toutes les mues du directeur de Rock'n'Folk, mais même si on le déteste, au sortir du livre l'on est obligé d'admettre qu'il a mille fois fois plus de légitimité rock que son détracteur déclaré. Bruno Lesprit qui n'aime pas le rock'n'roll devrait d'abord balayer devant sa porte.
Je rectifie, il y a tout de même un rocker français qu'il porte aux nues. Ni Ronnie Bird, ni Noël Deschamps, ni les Variations, ni les Dogs, ni un autre du même acabit - n'en cite aucun de ceux-là – mais ne tarit pas de louanges sur Bashung. Sur lequel il a écrit un bouquin de circonstances, éditoriales et funèbres. Voir plus haut. Le serpent se mord la queue, reste ainsi fidèle à lui-même.
PLAY BLESSURE
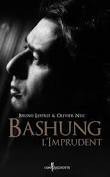
Mais pourquoi tant de haine ? Blessure secrète. Passe son temps à la lécher. En 1966, le grand Scmall chantait dans L'épopée du Rock : « Il y a quinze ans que cela dure, le rock'n'roll a la vie dure ! » Oui mais depuis il en est passé de l'eau sous le Pont Mirabeau, et le rock'n'roll est toujours là. Faudrait un psychanalyste pour clarifier. Il existe des tas de choses qui vous hérissent, mais vous faites avec. Vous essayez de ne pas y penser. Vous portez votre attention sur ce qui vous plaît le mieux : votre collection de timbres, la confection de confitures ou de cocottes en papier. Pas Bruno Lesprit. Fait une fixette. Sur le rock'n'roll. L'en est obnubilé.
Le rock est mort. En 1958. Ne chipotons-pas sur la date. Et depuis le scandale de sa survie chiffonne le cerveau meurtri de notre auteur. Incroyable mais vrai. Une génération rock est à peine sortie du radar du public que celui-ci se branche sur la suivante qui apparaît. Vous n'avez pas rangé les disques d'Elvis sur l'étagère que déjà vous écoutez les groupes anglais. N'allez pas croire que Bruno se plaigne parce que plus personne n'écouterait ses groupes ou son style préféré. British blues, pop music, punk et tous les autres, aucun genre ne trouve grâce à ses yeux. Les abomine tous. Peut leur reconnaître une ou deux maigres qualités mais la liste des défauts qu'il dresse est infinie.
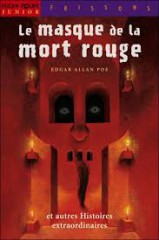
Le rock ne veut pas mourir. Il crève tous les deux ou trois ans mais il renaît scandaleusement de ses cendres. Phénix immortel. Bruno tord avec délectation le cou du nouveau-né mais déjà un petit-frère sort de l'oeuf pour le remplacer. Les années passent, le rock cède peu à peu du terrain devant de nouvelles musiques, les ventes s'effondrent, c'est un piège, la house, la disco, le hip-hop, le rap ne seraient-ils pas des formes dévoyées du rock ? A ce stade-là nous pouvons diagnostiquer une parano-rock. Le ventre de la bête est encore fécond. Des clones plus ou moins réussis sont engendrés. Le rock est mort, vive le rock. Les fantômes du rock hantent l'esprit de Bruno. L'en a peur. Faudrait l'enfermer, mais le rock est devenu une idée fixe, le masque de la mort rouge d'Edgar Poe qui pénètre malgré tout dans l'abbaye fortifiée et auquel nul n'échappera. Je suis hanté. Le rock ! Le rock ! Le rock ! Le rock !
LA MÊME HISTOIRE
Admettons que Bruno Lesprit fasse partie de cette large majorité de la population que le rock importune. Nous ne saurions le lui reprocher. Mais ce qui ne nous plaît guère c'est la malhonnêteté intellectuelle du sous-titre de son ouvrage. Une autre histoire du rock. Que non ! Surtout pas ! Nous met en scène une drôle d'histoire. Nous supprime le début. Le blues, le delta, en recollant les maigres allusions éparpillées dans le corps du texte, l'on n'arrive pas à une page in extenso. Comptez quinze lignes pour la country et une ignorance crade des pionniers. Eddie Cochran n'a jamais dû exister, Gene Vincent est cité quand il ne peut faire autrement. Ce sale bonhomme a tout de même influencé quelques individus qui poussent l'outrecuidance jusqu'à se réclamer de lui.
Bruno Lesprit se la joue connaisseur. Mais il ne s'écarte pas des grosses pointures. De la vulgate autorisée et médiatique. Passe même très rapidement sur les aspects les plus rock'n'roll des groupes dont il cause. Cherche la petite bête, le minuscule reproche à adresser à tout ce qui tout touche de près ou de loin à l'aspect rock des artistes mais il ferme délicatement les yeux lorsqu'il croise les mastodontes du rock'n'roll. Donne les noms et les expédie en deux lignes trop rapides pour être signifiantes.
Joue sans arrêt sur deux niveaux. La musique elle-même et la réception de cette musique par le public. Suit à la trace la politique des majors. La critique, en explique les dévoiements mais oublie de préciser que le rock subsiste - et a pratiquement toujours évolué et subsisté – à l'écart des récupérations médiatiques. Certes il existe un rock édulcoré, châtré, dans lequel beaucoup ont laissé plus que la peau de leur intégrité. L'appât du gain lorsque le succès devient énorme est une réalité avilissante. De nombreuses stars du rock se sont révélées aussi voraces que les actionnaires des fonds de pension qui régissent les lois du libéralisme actuels. Merchandising à outrance, et recyclage des vieux pots sous emballages préférentiels, le rock a participé sans vergogne du capitalisme consumériste. Les fans ne sont guère plus vigilants que leurs idoles. L'offre est toujours motivée par la demande.
Le rock est aussi victime de son succès. Se radiner chez soi en 1956 avec un disque de Little Richard sous le bras pour un adolescent blanc américain était un signe de rébellion sociétale et familiale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le rock est entré dans les moeurs. Souvent les ados écoutent les disques de leurs parents. Question révolte évidemment ça pèche un peu ! Mais ne peut-on pas aussi parler de transmission ? C'est bien sa mère qui a initié Bruno Lesprit à Schumann...
Le rock n'est que l'expression d'un malaise existentiel. Plus ou moins fort, plus ou moins violent. Les causes en sont multiples. Que les institutions aient tenté d'y faire barrage dans un premier temps n'est pas une surprise. Intimidation et interdiction sont les deux premières mamelles de la soumission au pouvoir. Ne marchent que pour les esprits faibles. Quand le mal est trop profond, l'on use de remèdes plus subtils. L'on vous offre des produits de substitution. Quand ils ne suffisent plus l'on officialise ce qui était jusqu'à lors interdit. Cela permet d'en atténuer la charge et de la stériliser.
Tout cela le pouvoir l'a essayé. Rien de pire qu'une dose de respectabilité pour vous anesthésier. Le rock entre à l'école. Il est enseigné dans les universités. L'on publie thèses et mémoires sur ses successifs avatars. Les générations s'installent peu à peu aux postes de maîtrise et de contrôle. Passent aux responsabilités avec armes et bagages. Ne laissent pas leur propre culture à la porte. Le rock perd son mordant. Devient le chaînon culturel des générations montantes. L'on n'y peut rien. Se lamenter ne sert à rien.
FRANC-TIREURS
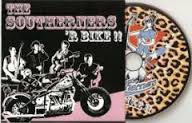
C'est comme les syndicats. De lutte à leurs débuts et qui aujourd'hui se sont transformés en courroie de transmission du pouvoir dit démocratique. Ne servent même plus à mettre de l'huile dans les rouages. Font partie des roues dentées qui font marcher et avancer le système. Ce qui n'empêche pas qu'un peu partout des luttes d'un genre nouveau se mettent en place. Ne sont pas encore victorieuses. Se heurtent à un ennemi qui a beaucoup appris des combats précédents. L'establishment en est même devenu plus aguerri, plus prudent, plus vicieux, plus efficace. Vous ne surprendrez pas un vieux singe avec des grimaces de l'ancien temps. C'est à vous d'en élaborer d'autres.

Le rock se trouve dans une situation similaire. Vous pouvez racheter le disque que vous avez dans votre collection depuis vingt ans en version collector, avec remastérisation et inédits. Quarante euros pour une major qui a le ventre bien plus gros que vos yeux. Le plaisir n'a pas de prix. Vous pouvez aussi le récupérer par d'autres moyens. Mais il suffit de porter ses regards autour de soi. Dans les bars, dans les cafés, dans des lieux interlopes il est facile d'entendre et d'écouter de nouveaux groupes qui jouent du rock'n'roll selon des optiques qui ne sont pas au premier chef commerciales. A vous de choisir et d'agir. Des réseaux sont en effervescence. Le rock est un combat dans lequel vous choisissez votre place. Arrêtez de vous plaindre. Cela vous permettra de rester jeune.

Bruno Lesprit est né en 1954, mais il donne l'impression de porter sur son dos toute la misère du rock'n'roll. Se complaît dans son impuissance. Le rock a vieilli, bien sûr. Des pans entiers de fans sont atteints de tristes suffisances pontifiantes. D'autres sont victimes de grandes sénescences. Inutile de gémir et de se plaindre. Coupez les branches mortes, brûlez-les pour vous réchauffer. Servez-vous des cendres comme engrais pour fertiliser les jeunes pousses. Soyez comme les harangueurs des medecine shows qui vendaient des flacons d'élixir de jouvence éternelle. C'est votre hargne, vos colères, vos révoltes qui remplaceront le venin de crotale.
Damie Chad.
CROCKCROKDISKS
FATHERS & SONS
JAKE CALYPSO
AND HIS RED HOT
CALL ME BABY / TORRID LOVE / TO MY SON & MY DAUGHTER / CASSIE MAGIKAL / I'M FED UP / CAUSE YOU'RE MY BABY / PASSION & FASHION / BORN & DIE / TELL ME WHY / THE RED HOT BOOGIE / BABY THAT YOU FALL / + POOR LITTLE FOOL / I'M FED UP / BORN & DIE / PLEASE BABY DON'T CRY / INDIAN BOPPIN'
Jake Calypso : vocal & guitar / Christophe Gillet : lead guitar / Tierry Sellier : drums / Guillaume Durieux : upright bass /
Décembre 2013 / Chickens Records
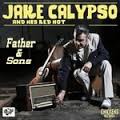
Quarante deux centimètres ( demoiselles ne rêvez pas ) c'est la hauteur de la pile de CD's que je n'ai pas encore écoutés et dans laquelle de temps en temps je viens farfouiller. Un coup de blues, en voyant sur le net les photos des Cent Ans de Rock'n'Roll organisés par Hervé Loison à Tournai le 19 avril, me suis aperçu que j'avais raté une mega fiesta rockabilly. Impardonnable ! C'est alors que je me suis souvenu que je possédais un CD de Jake Calypso tout neuf dans son emballage. Faute de grives, l'on mange des merles me dis-je en glissant la galette dans la machine. C'est ainsi que j'ai retrouvé mon sourire. Ce n'était pas un CD de plus, ou un CD de moins, pour tuer le temps, mais un chef d'oeuvre époustouflant, un trésor atomique que j'avais sans vergogne négligé. Pourquoi chercher le bonheur si loin alors qu'il vous attend sans bruit, tout à côté de vous !
Sans bruit. Ce n'est pas tout à fait l'expression adéquate. Call Me baby donne le ton, ambiance jumpin'-cowboy déjanté dans un saloon en délire, voix nasillarde empruntée au sud le plus profond, des yodels à la pelle manière de vous faire passer Jimmy Rogers pour un amateur qui n'arrive pas à faire démarrer son train... qui entre en gare dès le morceau suivant, Torrid Love, avec gloussement de poulette poursuivie par le chien de la ferme, la guitare de Christophe Gillet tinte comme des bielles en furie, on se calme sur To My Son To My Daugther, ambiance country de rigueur, la famille comme valeur refuge, enfin pas trop longtemps parce que sur Cassie Magikal le dad Loison se jette dans une espèce de rural rockab de derrière le tas de fumier qui dépiaute sec. Se passe des choses pas très catholiques dans les herbes hautes, l'est plus que magique cette Cassie à voir comme elle rocke et roule, l'on comprend les éclats de rire à la fin, I'm Fed appuie là où ça fait du bien, entre-toi bien ça là où je pense et le band par derrière qui ne s'ennuie pas alors que Loison hoquète comme un ara kiri ivre. Cause You Are My Baby s'énerve carrément, un piano bastringue pour soutenir les exercices de rigueur kamasutrique, c'est envoyé comme un hit de Little Richard de chez Specialty, ça slide de tous les côtés pour notre plus grand plaisir. Humour country sur Passion & Fashion, le trot du cheval, les cheveux dans le vent, le garçon vacher philosophe en dodelinant, Born & Die, hommage aux plus grands songsters des anciens temps, la steel ne pédale pas dans la choucroute, une compagnie de joyeux lurons qui ne boivent pas de l'eau fraîche sortie du puits, Hervé certifie qu'il s'inscrit dans cette lignée de chats de gouttières toutes griffes dehors, Tell me Why le grand classique de l'incompréhension mutuelle, pas désespéré pour un sou, chagrin de façade, rien ne vaut de folâtrer en toute liberté, The Red Hot Boogie, plus rien à chanter, chacun enfourche son instrumentale monture et galope à son gré, chacun son tour devant, seuls quelques youpies de joie pour indiquer que l'on ne s'arrêtera qu'à la prochaine taverne, Baby that You Fall, ça barde, et ça remue, Calypso ne mâche pas ses mots et l'orchestre turbine pour vous faire comprendre que vous avez intérêt à en prendre de la graine dans le corn belt de votre cerveau.

Bonus tracks en prime pour les chasseurs : une pseudo ballade qui chavire un peu trop, parfait pour le grand frisson, le Poor Little Fool est un peu toqué de la cafetière, une version différente de I'm Fed Up, impossible de choisir la meilleure, la guitare un peu plus métallique mais la voix qui ricoche sur des tôles ondulées comme des balles de Smith & Wesson, appellez le shériff car à la fin ça s'énerve un peu. Et l'on revient sur la parade des grands anciens, Born and Die, comparée à l'autre l'on dirait de l'acoustique avec la voix grave qui domine tout bien en avant. Please Baby Don't Cry ton vacher roucoule comme une tourterelle, les mauvaises langues diront qu'il ricane par-dessous comme une hyène, choisis la version qui t'agrée le plus, nous on a l'oreille sur les musicos qui ouvrent la piste. Les flèches volent, nous ont mené droit dans le territoire commanche et ces satanées indian boppin' nous ont attaché au poteau de torture et nous n'en menons pas large. Les riffs de guitare ont beau sonner comme le clairon du septième de cavalerie, l'on sait bien que c'est la fin. Pas d'inquiétude, l'on ne regrette rien.
D'ailleurs on remet le disque illico les coquelicots. Il y a tout de même un truc un peu embêtant. C'est que les ricains du côté du MississipI, ils risquent de nous faire un peu la gueule. A Memphis, à Nashville ils vous débitent des disques comme cela à la tronçonneuse, oui mais 99 neuf fois sur cent, ils n'arrivent pas à la hauteur de cette satanée galette. Ca sonne comme un Hank Williams qui aurait eu le whisky drôlatique. Lui qui l'avait si désespéré. L'on peut parler de gai savoir nietzschéen pour Jake Calypso. Joli foutoir, sacré bordel. Exceptionnelle réussite.
Father & Sons porte bien son nom et répond à son programme. Jake Calypso transmet ce qu'il a reçu, ce trésor de la musique populaire américaine il l'offre à sa descendance qu'elle soit de chair, d'esprit ou de passion. Nous sommes les héritiers d'un legs qui nous dépasse et nous écraserait s'il n'y avait pas parmi nous des porteurs de torches capables de rallumer les feux de la vie rebelle.
Je laisse les demoiselles faire une bise aux musiciens. Ils l'ont méritée.
Damie Chad.
23:23 | Lien permanent | Commentaires (0)
24/04/2014
KR'TNT ! ¤ 186 : DAVY O'LIST / BARFLY / YARDBIRDS / SPYKERS
KR'TNT ! ¤ 186
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
24 / 04 / 2014
|
DAVY O' LIST / BARFLY / YARDBIRDS / SPYKERS |
DAVY EST SUR O'LIST ROUGE

Depuis quelques années, le frétillant détective Bill Boquet s’était spécialisé dans l’élucidation des mystères du rock britannique. L’un de ses clients, journaliste pour le compte du magazine Uncut, venait tout juste de lui demander de retrouver la trace d’un certain Davy O’List, guitariste légendaire du Swingin’ London. Wow ! Pas évident. Boquet rouspétait :
— Holy shit ! Ça va être la croix et la bannière !
Effectivement, il ne disposait que de très peu d’indices. Ce petit monsieur O’List partageait apparemment le même sort que Syd Barrett, qui fut porté aux nues et qui disparut soudainement sans laisser de traces. Enfin, pas tout à fait. On savait Barrett de retour chez sa mom à Cambridge, et pour couper court à toute spéculation, il était entré dans une sorte de réclusion.
Bill Boquet n’avait aucune raison d’aller à Cambridge. Un, le pauvre Barrett avait fini par s’éteindre dans son lit, comme un notable du XIXe siècle. Et deux, ce parallèle avec Syd Barrett ne servait qu’à huiler une transition. Il fallait bien entretenir le tic tac de la raison mère...
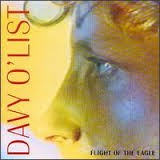
La seule piste sérieuse dont il disposait était celle de Richard Shirman, le chanteur de The Attack, qu’on avait aperçu quelque part dans l’Est de Londres. Bill Boquet mit ses plus fins limiers sur l’affaire et l’un d’eux finit par loger Shirman dans une fumerie d’opium de Whitechapel.
Bill Boquet bondit hors de son bureau, dévala l’escalier et courut héler un taxi.
— Mulberry Street ! Hâtez-vous car je suis pressé !
Le chauffeur ne répondit pas. Il lança son gros moteur Austin et alla se fondre dans le flot de véhicules qui alimentait l’incessant tournoiement de Charing Cross.
Bill Boquet arriva à l’adresse indiquée à la nuit tombante. Il frappa plusieurs coups à la porte vernie et une petite trappe à hauteur de visage s’ouvrit de l’intérieur. Bill indiqua au Chinois apparu dans le rectangle de la lucarne qu’il souhaitait voir Richard Shirman de toute urgence. Le Chinois hocha la tête et défit un gros verrou pour entrouvrir la porte.
— Vous me suivre, sir.
Bill Boquet emboîta le pas rapide du portier. Ils remontèrent un long couloir mal éclairé et débouchèrent dans une immense salle. Des centaines de fumeurs d’opium goûtaient l’ivresse des paradis perdus, allongés à même le sol sur des nattes. Des jeunes chinois veillaient à l’intendance, alimentant les flammes des lampes et bourrant les pipes à longs becs de boulettes soigneusement préparées. Le portier indiqua une niche dans un recoin obscur.
— Sir Shirman, là !
Bill Boquet approcha de la niche et vit Shirman, du moins ce qu’il en restait. Cet homme qui fut l’un des étalons les plus fringants du Swingin’ London n’était plus que l’ombre de lui-même. Physiquement, on l’avait à l’époque comparé à Jagger. Shirman eut le cran de tenir tête à Don Arden et il tomba plus de filles que n’en tombèrent Michael Caine et Terence Stamp réunis.
— Vous êtes bien Richard Shirman ?
L’homme ouvrit un œil. Il mit plusieurs minutes à réaliser qu’on lui adressait la parole.
— Pardonnez-moi de vous déranger dans un moment aussi précieux. Mon nom est Boquet, Bill Boquet. Ce nom ne vous dira rien. Mais vous pouvez peut-être m’aider. Je cherche des informations concernant votre ancien guitariste prodige, Davy O’List.
Un éclair de lumière traversa la rétine dilatée de Shirman.
— Aidez-moi à me redresser... Mettez-ces deux coussins... là... sous ma nuque... Merci.
Shirman parlait d’une voix extrêmement faible. Il fallait tendre l’oreille pour l’entendre.
— Vous arrivez à temps... car je vais sans doute mourir... dans les heures qui viennent... Je suis atteint de la même... maladie que Plonk Lane... cette fucking sclerosis... Donnez-moi ce verre... j’ai la gorge en feu...
Shirman vida son verre lentement. Il leva un doigt osseux et un jeune chinois accourut avec une outre et remplit le verre de Shirman.
— Merci... Tchang... et ça, maintenant... fit-il en lui tendant la pipe.
Tchang s’agenouilla pour préparer une nouvelle pipe. Il officiait avec des gestes de prélat. Il fit dorer la boulette sur la flamme et l’installa au fond du fourneau. Il souffla deux fois dans le bec pour amorcer la combustion et tendit ensuite la pipe à Shirman qui la prit en tremblant violemment.
Il tira une très longue bouffée et inhala la fumée en fermant les yeux. Son visage sembla s’adoucir.
— Je suis même... peut-être déjà mort...
— Pas à ma connaissance, Shirman. Regardez-moi, ai-je l’air du diable ?
— Let me please... introduce... myself...
Et il se mit à tousser si violemment qu’il perdit connaissance.
— By Jove ! Comment vais-je faire s’il meurt sous mon nez ?
Bill Boquet se pencha sur le visage de Shirman et se mit à lui tapoter doucement le menton.
— Shirman ! Shirman ! Revenez à vous, je vous en conjure !
Une poigne d’acier saisit le poignet du détective et l’immobilisa.
— Pas frapper mort-vivant. Interdit par règlement ! Compris ?
Bill Boquet leva la tête et découvrit le spectacle ahurissant d’un garde chiourme mongol torse nu au crâne rasé. Boquet resta figé comme une statue de sel. Cette apparition le médusait.
Par miracle, Shirman revint à lui. Il cligna des paupières. D’une main tremblante, il dirigea le long bec de la pipe vers ses lèvres et tira une interminable bouffée. Puis il ouvrit la bouche pour reprendre la parole :
— Davy, oui je l’ai connu en... 1964. Il apprenait... la trompette et le piano... au Conservatoire... Quand il a vu les Rolling... Stones, il a voulu... jouer de la guitare...

Richard Shirman parlait d’une voix d’outre-tombe. Il était à l’agonie. Ses paroles semblaient venir dans un dernier souffle. Bill Boquet tendit un peu plus l’oreille.
— On a monté un groupe... tous les deux... Il fallait un nom... The Attack... à cause de The Action... The Creation... ils avaient tous des... noms modernes... on a pensé s’appeler Evil Ankle... mais on voulait sonner... comme les Who... on a passé des annonces... Melody Maker... on a eu Alan Whitehead de Marmelade... batteur... et Bob Hodges... claviers... et Don Arden... comme manager... il cherchait un groupe... pour remplacer les Small Faces... qui voulaient le quitter...
Bill Boquet notait tout sur son calepin.
— Vous aviez aussi John Du Cann dans le groupe, non ?
— Ohhh, John est arrivé... après le départ de... Davy... On a fait deux singles... avec Davy... Puis Mayall a voulu... l’embaucher... pour remplacer Clapton et... Peter Green... Davy a dit non... mais comme nos singles... ne marchaient pas... il est parti jouer... dans The Nice... ils accompagnaient... PP Arnold sur scène...
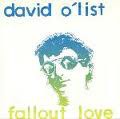
— Vous souvenez-vous des titres des chansons enregistrées avec Davy ?
— Je... Je... ahhhh my God...
Il fit un effort considérable pour continuer à respirer.
— R... P... argghhh !
Et sa tête roula de côté.
— C’est vraiment la croix et la bannière ! Qu’a-t-il voulu dire ? RP ? RP mon cul, oui !
Discrètement, Bill Boquet palpa les poches de Shirman. Il sentit la présence d’un objet dans la poche de sa veste. Il s’en empara et quitta les lieux aussitôt.
Il décida de regagner la station de métro à pieds. Il avait besoin de marcher. Il sortit l’objet récupéré sur Shirman et l’examina à la lumière d’un réverbère. Il s’agissait d’un CD de The Attack. Il sursauta en voyant le logo du label au dos du boiter :

— RPM ! By Jove ! Quel âne je fais ! J’aurais dû y penser !
Aussitôt rentré chez lui, il mit le disque de Shirman dans le lecteur de CD et écouta les quatre titres enregistrés par Davy avec The Attack. «Any More Than I Do» pulsait comme un hit freakbeat et on entendait Davy placer ses chorus piquants. Il y avait aussi une version moddish du fabuleux «Try It» des Standells qui aurait dû exploser en Angleterre. Et leur «Hi Ho Siver Lining» fut pris de vitesse par celui que Mickie Most fit enregistrer à Jeff Beck. Le festival s’achevait avec «We Don’t Know» un gros r’n’b secoué par les notes de guitare de Davy.

Comme c’était Chris Welch qui signait le texte du booklet, Bill Boquet prit rendez-vous avec lui dès le lendemain. Le vieux journaliste - authentique vétéran de la scène anglaise - le reçut dans le capharnaüm qui lui servait de bureau. Des piles de disques et de livres menaçaient de s’écrouler sur les visiteurs et il semblait qu’il restait à peine assez d’espace pour respirer. Personne n’avait dû faire le ménage dans cette pièce depuis un demi-siècle. Bill Boquet se mit à tousser.
— Désirez-vous une bière bien fraîche, sir Boquet ?
— Ah ce n’est pas de refus, merci, sir Welch !
Et il se remit à tousser de plus belle. Ce fut une quinte terrible. Il tressauta violemment dans son fauteuil et finit par cogner de l’épaule une pile d’environ trois mètres de haut qui s’écroula, entraînant dans sa chute d’autres piles, le tout dans un nuage de poussière apocalyptique. Bill Boquet parvint à dégager un passage pour respirer l’air saturé de poussière. Il toussa encore et tenta de se dégager en déchirant des pochettes d’albums qui devaient valoir des fortunes. Il y parvint au prix d’efforts surhumains. Il se hissa sur le sommet d’un épouvantable tas d’objets en vrac et rampa vers la porte. Il vit la main du pauvre Chris Welch qui sortait de l’amoncellement.
— Help ! Help !
Bill Boquet tenta de dégager le malheureux journaliste, mais ça semblait impossible.
— Sir Welch, je m’en vais quérir des secours !

— Non... il sera trop... tard... je suffoque... O’List était... mon ami... Emerson lui a volé... The Nice... qui était le groupe de... Davy... comme il lui a volé... le chapeau de Judy... Garland... un cadeau qu’elle lui... avait fait... à New York... arghhhh.... il l’a viré comme... un chien... Davy ne s’en est.... jamais remis...
— Il s’est arrêté de jouer du rock ?
— Ohhh pas du tout... Brian Ferry l’a choisi pour... fonder Roxy Music... mais le management... du groupe l’a viré... c’est pour ça qu’on... ne l’entend pas... sur le premier album... de Rox... arrghhhh...
— Je cours chercher les pompiers !
— Noooon ! Argghhhhh ! Jet ! Jet ! Arrrrr....
La main agrippa le collet du veston de Bill Boquet. Il eut toutes les peines du monde à la décrocher.
— Décidément, cette histoire, c’est vraiment la croix et la bannière ! Jet ? Qu’est-ce qu’il a voulu dire par Jet ?
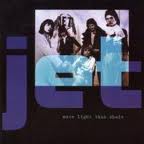
Bill Boquet n’était pas homme à renoncer. Le lendemain, il prit rendez-vous avec Mark Stratford, le boss de RPM.
— Sit down, Boquet !
— Thanx, mate !
En parfait caméléon d’investigation, Bill Boquet savait s’adapter à tous les styles d’interlocuteurs. Il rappela brièvement le but de sa visite et relata les derniers épisodes de ses pérégrinations. Stratford siffla longuement en haussant les sourcils.
— Blimey ! Ça ressemble en effet à une malédiction. Tu dois être le prochain sur la liste, non ? Ha ha ha ! Avec ta moustache, ton chapeau de baltringue et ton costume à rayures, tu me fais penser à Lord Carnavon ! Mais Davy, c’est quand même plus intéressant que les fucking pharaons ! Tiens écoute ça, c’est le groupe qu’il a monté avec Andy Ellison en 75. Tu vois qui c’est, Andy Ellison ?
— Celui qui a inventé l’électricité ?
— Ou t’es un sacré farceur, ou t’es un sacré blaireau ! C’est le chanteur des John’s Children et des Radio Stars !
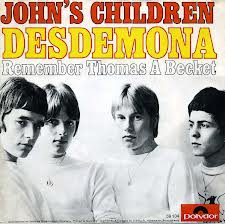
Stratford glissa une rondelle dans le lecteur et mit le volume à fond.
— Ho, c’est du bon glam ! s’écria Bill Boquet d’une voix de stentor, pour couvrir le ramdam.
— ‘Coute le solo de Davy, le morceau s’appelle «Brain Damage» ! Pur glam à la Bowie ! ‘Coute ce solo fulgurant !
— Pas mal, Stratford, mais c’est pas aussi bon que Jook...
— Tu connais Jook, toi ?
— Oui, grâce à une récente enquête. Un client m’avait demandé de retrouver la trace de Ian Kimmet, mais j’ai dû renoncer, car c’était vraiment la croix et la bannière.
— ‘Coute celui-là, c’est «Nothing To Do With Us», le cut n’est pas bon, c’est une compo de Martin Gordon. Il avait subi l’influence des Sparks qu’il accompagnait depuis leur arrivée en Angleterre, mais là, tu vas voir ce que tu vas voir...
Effectivement, on entendit un nouveau solo d’une rare démence. S’ensuivit «Tittle-Tattle» à nouveau perforé par un solo monstrueux signé O’List.
— Oh, l’incroyable folie liquide de ses interventions ! Un vrai paradis glam, avec les lignes de basse de Martin Gordon qui remontent sans cesse au front, le fabuleux drumming de Chris Towson et l’énorme talent d’Andy Ellison. «My River» est une compo de David, ‘coute sa belle saignée. Il est encore plus vindicatif que Luther Grosvenor, tu ne trouves pas ? Ça c’est «Cover Girl», tu entends le travail de dingue de Davy au fond ? Ce mec est un dieu du glougloutage psychédélique ! J’ai même récupéré des démos et cette version monstrueuse de «Desdemoda» qu’ils jouaient au temps de John’s Children. Ces mecs auraient dû tout casser, avec les solos liquides de Davy. T’entends ça ? Quel fluctuateur, ce Davy ! J’ai même des cuts qui étaient prévus pour le second album - jamais sorti - comme ce truc, «Around The World in 80 Minutes», encore plus glam que le glam de nos rêves les plus humides, un beau glam nerveux, perverti, aussi musclé des cuisses que Ziggy. Et ce gros solo de Davy ! Tiens ‘coute ça, «We Love Noise», avec un son plein qui dépasse l’entendement et le tourbillon de Davy ! Aw !
— Je peux voir la pochette, mate ?
— Attends, je vais t’en donner un neuf, comme ça tu pourras l’écouter chez toi. Les disques neufs sont rangés sur l’étagère, là-haut...
Stratford posa une chaise sur son bureau et il commença à se hisser laborieusement vers l’étagère du haut. Depuis le début de cette affaire, Bill Boquet était devenu superstitieux, et voyant son hôte prendre de tels risques, il s’écria :
— Non ! Redescends ! Je l’ai déjà !
Stratford se tenait en équilibre, perché sur le dossier de sa chaise. Il tourna la tête.
— Hein ?
Il perdit l’équilibre et tomba à la renverse à travers la fenêtre, dans un énorme vacarme de verre brisé. Par miracle, il réussit à s’accrocher du bout des doigts au rebord de béton de la fenêtre.
— Ne crains rien Stratford, je vais te sortir de là !
Bill Boquet agrippa les manches de Stratford et essaya de le tirer vers lui. Humpf ! Avez-vous déjà essayé de tirer quelqu’un vers vous à la force des bras ? C’est impossible. On ne voit ça que dans les films.
— Stratford, t’es trop lourd ! Je n’y arrive pas !
— Je... je... vais lâcher... aide... moi... Bo-bo-bo... quet...
— Stratford ! Accroche-toi ! Tiens bon ! Courage !
— Awww... je... vais... lâcher...
— Stratford, comment s’appelle ce groupe que tu viens de me faire écouter ?
— Dj’.... Dj’... Jet... ARRRRRRRR !
Et le malheureux lâcha prise. Bill Boquet le vit s’écraser au sol avec un plok déplorable.
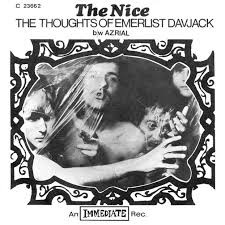
Le lendemain matin, Bill Boquet arriva au bureau avant la secrétaire. Il jeta trois bûches dans la cheminée et mit le feu en route. Puis il sortit le dossier O’List de la pile et le jeta dans les flammes, ainsi qu’une copie de «The Thoughts of Emerlist Davjack» des Nice qu’il avait acquise à prix d’or pour la verser au dossier. Il remplit ensuite un chèque, le signa et le glissa dans une enveloppe qu’il cacheta avant de la poser sur le bureau de la secrétaire, avec d’autres plis à poster. Bill Boquet remboursait toujours les clients qu’il ne pouvait satisfaire. Il avait toujours su distinguer la ténacité de l’obstination.
Signé : Cazengler, O‘Listérique.
Uncut #201 - Février 2014 - Davy O’List, story de David Cavanagh
The Attack. About Time ! RPM Records 2006
The Nice. The Thoughts of Emerlist Davjack. Immediate 1967
Jet. Jet/Even More Light Than Shade. RPM Records 2010
Nota bene : Bill Boquet aurait dû écouter l’album des Nice, par simple conscience professionnelle. Il se serait régalé du groovy «Bonnie K», une pièce furieuse et élégante digne de Jeff Beck. Et il serait tombé de sa chaise en écoutant «Rondo», car Davy y joue un solo qui est une véritable horreur de distorse, un insulte aux lois de la bienséance. Même chose avec «War & Piece», où Davy balance un solo affolant de modernité. À l’époque de ce premier album, Keith Emerson claquait le fouet sur scène et plantait des poignards dans le bois de son orgue Hammond.
18 – 04 – 14 / MONTREUIL
CROSS DINER / BARFLY
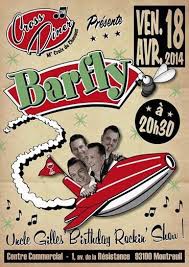
Les mouches ne sont pas toujours accoudées au comptoir, même celles qui se revendiquent d'être des piliers de bistrot, la preuve dès que l'on pousse ( mais peut-être se tire-t-elle ) la porte du Cross Diner, nous faut nous résigner à l'évidence, les maudits cyclorrhaphes ne nous ont pas attendus, sont en plein boulot, viennent d'entamer leur premier set, le temps de nous glisser à une table et il ne nous reste plus qu'à jouir du spectacle.
PREMIER SET / ALONE

Je n'ai envie de parler que de lui. Les autres ne sont pas pour autant des ousiders , bien loin de là au contraire, mais Eric Levet, le drummer m'a frappé en premier. Les Barfly on connaît un peu on les a déjà vus à Beauvais ( voir Kr'tnt ! 179 du 05 – 03 – 2014 ) et ce n'est pas un hasard si nous revenons ce soir, Billy and Me, on a même raflé Mumu au passage, mais là tout près de nous, dans cette scène exiguë comparée au vaste plateau de la Convention Tattoo, c'est une autre paire de moufles, on pourrait les toucher de la main, on les voit tous les quatre en action, de très près, et on en prend plein les mirettes. Enfin, surtout les oreilles, car Eric Levet percute très sec. Un batteur comme je les aime. Pas de rodomontades. Le coup et c'est tout. Pas besoin d'écrire un poème après. Ni d'espérer que le clapotis sonique cessera bien un jour. Ne joue pas au yo-yo vibraphonique. Simplement le coup suivant qui précède le prochain. Mais un monde en soi à chaque fois. Auto-suffisant. De l'achevé. De l'accompli. Pas une dégringolade chaotique et tumultueuse, qui n'en finit pas de rouler sur elle-même afin de trouver sa place. Affûte sans tergiverser Eric. Faut le voir, l'est dans le mouvement, enchaîne les uppercuts sans mollir. Bat ses tambours comme s'il cognait dans une bagarre de western. Le mec dangereux que l'on évite de prendre tout seul, car il distribue sans discontinuer. N'a pas l'air méchant de loin, mais de près c'est une machine qui calcule froidement la trajectoire la plus opératoire et qui vous envoie un boulet de canon sur votre arcade sourcilière – là où ca saigne le plus - pour que votre figure ressemble très vite à un steak tartare qu'il vous sert avec des petits oignons piquants.

Avec un tel moteur à l'arrière qui vous pousse la carrosserie, les Barfly filochent sans demander leur reste. Le problème c'est qu'ils en ont aussi disposé un rotor sous le capot avant. Pour le moment, d'appoint. S'appelle Charlie, c'est pas un papa puisqu'il est tout jeune – vingt-deux ans - et ce n'est pas non plus du tango qu'il joue. Méchamment rock. L'est au micro et vous déglingue les titres à toute vitesse comme un russe qui vous descend douze litres de vodka en guise de pré-apéritif. Et comme il n'est pas manchot, il s'active aussi à la rythmique. La vie est injuste, il y a des gars qui sont naturellement doués. Vous ne pouvez rien y faire. En pointe, entraîne les autres, et ne tolère aucun retard. Mais ce premier set s'achève un peu trop vite. Crazy Little Mama, Pressy Missy, Betty Ann et Rockin' Family pour clôturer les festivités. L'on serait bien resté un petit moment supplémentaire à bavarder avec les membres de cette famille, mais comme ils promettent de revenir, on les laisse partir. Avec acclamation et prix spécial du jury.
DEUXIEME SET + PIANO

Pas un demi-queue avec caisse de résonance de vingt mètres de long, un simple Roland sans pédale mais avec électricité. Aussi plat qu'une planche à repasser, et structure un peu maigrichonne. Solide, nous pouvons le certifier. Car ce sale gosse de Charlie va le maltraiter. Que dis-je le tyranniser, et même le martyriser. Commence par s'éclaircir la voix, caresse doucement deux ou trois touches, lorsque subitement le voici terrassé par une crise de folie furieuse. Terrasser n'est pas vraiment le mot, car il semble ne pas toucher terre une forme extraordinaire. Rire de hyène hystérique à la Jerry Lou dans son micro et il se lance dans une série rock'n'roll high voltage avec trombe pumpin' piano et hurricane ricanant en accompagnement. L'emporte la salle au septième ciel et même plus haut, dans l'empyrée du rock'n'roll. Les Barfly sont comme des mouches ivres enfermées dans une bouteille de Southern Comfort dont quelqu'un aurait refermé le goulot. Vrombissent comme des guêpes en colère, le dard en avant.

N'y a que Manu sur sa contrebasse qui garde son calme. Ne vous apitoyez pas, je vous parle de la manière dont il maltraite son instrument, s'en tire très bien, avec une efficacité rare et croyez moi avec Eric qui ponctue le rythme si sèchement, ce ne doit pas être facile de faire pousser des plantes grimpantes sur des bambous plantés si serrés. Mais Manu vous glisse des slaps acérés comme des lames de couteau qui vous traversent la colonne vertébrale entre les cartilages disquaires sans effleurer la moelle épinière. Horlogerie et chirurgie de précision. Grand siècle. D'ailleurs ce soir, il garde une attitude très digne, très straight, très smart, l'on se croirait dans un salon sous Louis XV, avec les réparties acidulées. Du haut des vingt centimètres de l'estrade il domine Charly accroupi sur son piano. Alors il en profite, entre les quatre secondes qui séparent deux morceaux il laisse tomber une petite remarque si perfidement empoisonnée qu'elle vous détruit une réputation pour vingt ans. Que des compliments, mais si bien tournés qu'ils vous étranglent de rire, et Charlie coupe court, he cuts accross shorty pour le dire à l'amerloque, et redémarre aussi follement. Quand le set est terminé, une évidence s'impose : l'on tient là un super bon groupe de rock and roll.
TROISIEME SET + SAX

Les Barfly c'est comme les mousquetaires, ils sont quatre. Mais voici le cinquième. Quand il est rentré, l'on s'est douté de quelque chose. Jerry des Megatons ne se trimballe pas avec un étui pour cigarettes d'un mètre soixante de long, comme à notre connaissance il n'est pas non plus un tueur appointé de la mafia, ce ne devait pas être une mitraillette qu'il transportait dans sa valise. Banco, c'était son sax. Ne se fait pas prier lorsque les Barfly l'appellent pour les rejoindre. « Tant que vous voulez, j'adore jouer » déclare-t-il et c'est-là qu'il nous étonne et nous séduit. Faudra même après le premier morceau lui conseiller de hausser le ton. Ne prend ni la grosse tête ni la vedette. Par un coup de sax magique le son Barfly reste le son Barfly ne se colorise pas en Megatons sound. Jery accompagne, il n'accapare pas. N'impose pas son instrument, s'abstient de prédominance sonore. Il apporte un plus, mais n'efface pas le reste de la compagnie. Respect.

Nous n'en oublions pas pour autant d'Artagnan. Me tourne souvent le dos quand il joue mais je sais reconnaître un bon guitariste, les yeux fermés. Bon sang ne saurait mentir c'est l'uncle Gill de Charlie. Pourquoi certaines familles sont-elles prédestinées au rock'n'roll ? Je vous donnerai pas la réponse ce soir, suis trop occupé à écouter. On ne peut pas dire qu'il joue, il intervient. Ne suit pas une partition intérieure, il écoute les autres et il leur répond. Vous pouvez y aller les gars, posez-moi le problème et je le résous. Devrait ajouter qu'à ce petit jeu il est infaillible. Comparé à tous les autres guitaristes vus sur scène, il possède un truc en plus : on dirait qu'il joue en direct. Plus live que les autres. Ses trois comparses foncent comme des madurles et vous posent la Rosalie sans frein devant le tournant. C'est réglé comme du papier à musique, droit dans le mur, vont capoter comme une pub pour le sida, ben non, parce que l'oncle Gill il vous négocie le virage à sa manière, avec aqua-planning contrôlé de bout en bout mais toujours en accélération. Leur communique le péchon. Faut voir comment à chaque reprise Eric re-beurre les biscottes des deux côtés, plus rapide et plus sec, dans la foulée grandissante du tempo. Manu qui ne perd jamais son flegme, se remet dans la balance comme vous boutonnez chaque soir depuis vingt ans votre veste de pyjama. Mais le jeune Charlie, ça l'émoustille. Quand il était sur son piano l'on voyait que la façon dont la guitare répondait à ses chorus le galvanisait. Comment je pompe comme un shadock sous cocaïne sur mes 188 touches et il passe en trombe devant moi avec ses cordelettes ! Et vlang il repartait pour un tour. Mais maintenant qu'il a repris sa rhythm guitar et qu'ils sont à égalité, il ferraille dur. Le disciple ne dépasse pas le maître, mais le duel amical le charge encore plus de hargne.

Le septième homme n'est pas loin. C'est le chanteur des Megatons, s'appelle aussi Charlie, a du mal à quitter son verre de bière qu'il emmène jusqu'au micro. L'en profite pour faire comme Charlie, y va piano, laisse le jeune rocker se charger avec brio de la moitié du vocal. C'est la fin. Une soirée d'enfer. Le facebook des Barfly se nomme Barfly Rock N Roll. N'a pas volé son nom.
Damie Chad.
( Photos prises sur le facebook des artistes : au piano concert à Chavin, les autres au bar L'Excuse à Longjumeau )
THE YARDBIRDS
GREG RUSSO
( Camion Blanc / Mai 2010 )
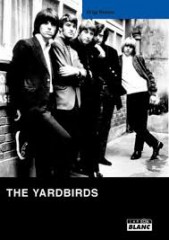
Un pavé, digne des barricades de 68. Cinq cents quatre vingt deux pages. Je rassure tout de suite ceux qui n'aiment pas lire. Le texte proprement dit s'arrête à la page 331. La seconde moitié du bouquin est réservé pour les super-fans qui veulent tout savoir, la liste des concerts, la disco de A à Z, et celle des volatiles de la basse cour est des plus complexes, avec les pochettes, les titres, les notes et les photos qui changent selon le pays d'édition, mais avec aussi la composition des morceaux, ici l'on rajoute une intro, là on supprime un solo, souvent l'on jongle avec les numéros des alternate takes, parfois on laisse les dialogues des musicos, souvent on les remplace par un autre fragment... c'est un peu comment devenir schizophrène en trente minutes... Mais que ne ferait-on pas pour les Yardbirds !
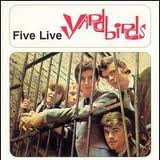
Greg Russo lui-même n'a pas su résister à la pression. A très vite été atteint du syndrome maniaco-dépressif du gars qui ne veut rien oublier. Le détail est l'arbre mort derrière lequel se cache la sylve de l'essentiel. Le genre de type qui vous indique le numéro de la porte des studios tout en ayant l'humilité de préciser qu'il est hélas incapable de dire s'il faut tourner à droite ou à gauche au fond du couloir. Bref, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les Yardbirds il vous le note scrupuleusement afin de parfaire votre culture générale de cloporte alzheimérisé. Je ne voudrais pas paraître un cuistre à la recherche de la plus minimale des erreurs mais j'ai tout de même relevé une omission. Trois fois rien, j'ai presque honte d'en parler, il manque à mon humble avis un tout petit quelque chose à ce squelette dont il a numéroté, sérié et radiographié les os un par un avec une exemplaire minutie. C'est un peu comme dans La Montagne Magique de Thomas Mann lorsque sa copine de sanatorium lui refile sa photo, la radiographie de ses poumons. L'aurait préféré un portrait de son minois ( peut-être même de son minou ), parce que les Yardbirds ce fut tout de même un groupe de rock music, et cet aspect du phénomène Greg Russo n'en parle point. C'est un peu dommage. Connaît tout et ne dévoile rien. Un exemple des plus significatifs : dans la dernière partie il passe en revue l'oeuvre des quatre ( oui quatre ! ) guitaristes qui se sont succédés dans le groupe, pas une seule ligne dans laquelle il essaierait d'analyser et de comparer le style de ces virtuoses du manche. Pourraient jouer au handball ou collectionner les timbres poste que l'on n'en saurait pas plus sur leur personnalité. L'on sort de cet opuscule un peu déçu, Greg Russo n'a pas su nous faire vibrer, s'est abstenu d'allumer la torche de la poésie.
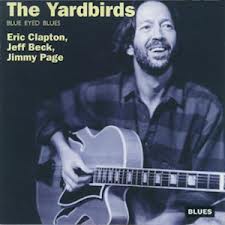
YARDBIRDS !
Nos contemporains citent volontiers les Kinks, les Animals, les Pretty Things, les Stones, voire même les Beatles, et relativement peu souvent les Yardbirds. J'en connais même qui poussent le vice jusqu'à connaître les Hollies et les Creation mais qui marquent un temps d'incertitude quand on cite les emplumés. Faut leur filer les quatre points cardinaux ( Clapton, Beck, Page, Led Zeppe, enfoncez-vous ça dans la tête comme les quatre pointes dans les membres du corpus-christi, pas Agatha, l'autre ) pour qu'ils comprennent l'importance du bestiaux.
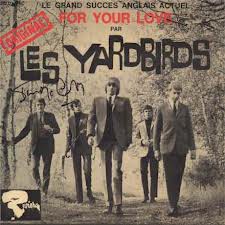
J'ai passé tout un dimanche après-midi de 1965 à monter la garde à côté du transistor pour réentendre une deuxième fois le For Your Love des Yardbirds sur Europe 1, j'avais subodoré, avec raison, qu'il y aurait quelque chance pour que les programmateurs le remettent à l'antenne, quatre heures de résultats sportifs pour moins de trois minutes de bonheur intense et absolu, c'était cher payé, mais à l'époque ce genre de considération n'était pas de mise, du coup je n'ai même pas jeté un la moitié d'un oeil de taupe sur la compo de sciences naturelles du lundi matin, oui mais j'avais entendu les Yardbirds. Dans le vie, je peux me vanter d'avoir de temps en temps effectué les bons choix.
BRITISH BLUES
Il est des mystères insondables. Pourquoi à l'aube des années 60, un embryon de la jeunesse anglaise – plutôt d'origine petite-bourgeoise – se passionne-t-elle pour le rural country blues américain ? Pourraient directement se brancher sur le rock'n'roll des pionniers, mais non, ils se rabattent sur le côté noir de la force. Certains se branchent directement sur le rhythm'n'blues saisissant d'instinct la puissance brute qui se dégage de ces brûlots, cette génération a les dents longues, elle est pressée, elle n'entend pas perdre son temps dans l'apprentissage douloureux du jazz devenu avec les génies du bop une musique trop évoluée pour des musiciens qui sortent à peine de l'oeuf de l'adolescence. Mais beaucoup d'autres ne s'arrêtent pas en si bon chemin, descendent beaucoup plus bas, quelque part entre Chicago et le delta. Je ne crois pas au mythe de la remontée vers l'origine. L'explication me paraît beaucoup plus pragmatique. Qu'est-ce que l'on entend dans le blues ? Le chanteur, oui bien sûr, mais surtout la guitare qui grince atrocement. C'est elle qui descend la gamme pentatonique et la remonte aussitôt. Pas la peine de savoir déchiffrer le solfège. Suffit de tendre l'oreille. Tout est donné, pas d'embrouille. Tu reproduis tel quel et tu obtiens le produit idoine. Tu suis la recette. Plutôt celle des oeufs brouillés, que celle du cassoulet que Jean Parvulesco appréhendait comme un véritable traité d'alchimie secret accessible aux seuls initiés. Simple comme bonjour. Faut aussi que les doigts traficotent un max, car si les vieux bluesmen trituraient de drôles de tacots d'occasion, ils savaient négocier les épingles à cheveux les yeux fermés. Avec un Big Bill Broonsy ou un Robert Johnson comme maîtres vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent de poche en leçons de guitare. Avec un simple tourne-disques, vous devenez aussi performant, côté espionnage industriel, que les services les plus sophistiqués de l'Intelligence Service.
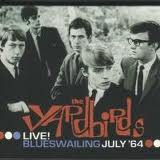
Y avait un piment supplémentaire. La rareté des disques. Fallait se lever pour les trouver. Cela vous donnait l'impression de faire partie d'une mouvance séparée du reste de la société, une élite quasi-clandestine, à chacun sa manière pour se procurer son sauf-conduit. Tout le monde n'est pas comme le jeune Top Topham dont le père possède possède une formidable collection de disques de blues... Ce qui ne l'empêche pas de prêter une attentive esgourde aux guitares de Buddy Holly et de Gene Vincent. Même lorsqu'ils commenceront à enregistrer les Yardbirds continueront à fouiner dans le bleu rayon de papa Topham. Beaucoup des morceaux des Yards seront de fait des démarquages de vieux blues.
Les fans de blues fréquentent les sections que nous qualifierons d'arty. S'y regroupent les élèves que l'école ennuie, leur est dispensé un enseignement un peu moins étouffant et disciplinairement plus ouvert. Mais la vraie vie se déroule ailleurs que dans les cours. Ceux qui sont attirés par la musique ont tendance à former des orchestres. Formations instables qui se côtoient et s'entremêlent. Selon les affinités électives les groupes se font et se défont. Souvent l'on marche en tandem, si le copain change de crèmerie on le suit. Petit monde, où tout le monde se connaît. Chis Dreja est le copain de Top Topham. Un camarade d'école porte le nom d'Eric Clapton... Nos deux inséparables montent un groupe, parfois ils sont rejoints sur scène par un certain Jimmy Page... Plus loin Paul Samwell-Smith et Jim McCarthy naviguent de groupe en groupe, sont passionnés de blues, mais écoutent aussi Shadows et Buddy Holly... Seront rejoints par le dénommé Keith Relf... A ce petit jeu de chaises musicales, les futurs Yardbirds auraient pu se croiser sans cesse sans se rencontrer réellement, d'autant qu'autour d'eux vibrionnent quantités de musiciens en herbe, plus ou moins haute... toujours est-il que dans l'été 1963, le groupe prend forme. Se nommera les Yardbirds, un synonyme de hoboes, ces chemineaux qui couraient les routes et les trains au temps de la grande récession. Clochards en vadrouille ou en geôle, les Yardbirds qu'ils soient en liberté ou en cage, sont des oiseaux de mauvais augure pour les assis et les repus.
L'ENVOL
Les Yardbirds ne sont pas des oisillons tombés du nid avant de savoir voler. Ils ont cumulé les expériences, ils savent jouer et au milieu des autres groupes ils tirent assez bien leur épingle du jeu. Mais ils souffrent d'un terrible handicap. Ne sont pas arrivés les premiers. Les Rolling Stones sont descendus en trombe du cocotier du Rhythm and Blues. Ils auront toujours un couloir de retard sur les hommes de Brian Jones. Cela pèsera très lourd dans leur carrière, surtout que dans le peloton de tête l'on trouve des grosses pointures comme les Animals et les Kinks. La concurrence est rude.
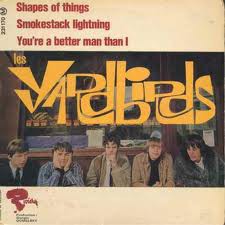
Mais comme toujours notre principal défaut est aussi notre meilleure qualité. Les Yardbirds ne produisent pas une musique qui puisse être estampillée Yardbirds. Ne proposent pas du produit fini, léché comme un chaton par sa maman. Ils donnent du béton armé, mais brut de décoffrage. En fait ils décoffrent devant vous. Pas plus que vous ils ne savent l'aspect final que prendra la chose. A découvrir in situ. Les Yardbirds sont un groupe de scène. Ils ne rejouent pas deux fois le même morceau. Ils expérimentent. Varient les détails à l'infini. Se moquent du définitif. Vous pouvez les voir dix fois de suite, vous aurez chaque soir votre surprise empaquetée avec soin. Un groupe excitant qui ne se repose pas sur ses lauriers. Aussi lorsque les Stones décident de prendre Andrew Loog Oldham pour manager, Giorgio Gomelsky qui se retrouve le bec dans l'eau du jour au lendemain jette son dévolu sur les Yards sans hésiter. Seront désormais le groupe résident du Craw Daddy, le club Rhythm and Blues le plus branché de la capitale. C'est parti pour la grande aventure. Mais papa Top Topham – grand amateur de blues devant l'éternel – craque, pas question que son fils se transforme en saltimbanque. Lui confisque sa guitare et lui enjoint de choisir un métier d'avenir... Sera remplacé par Eric Clapton. La légende est en marche.
YARDBIRDS WITH CLAPTON
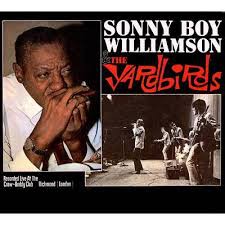
Clapton reçoit un superbe cadeau, qui se révèlera vite empoisonné, pour son entrée dans les Yardbirds, le groupe accompagnera Sonny Boy Williamson II en concert. Il est même prévu d'enregistrer un disque sur scène avec l'harmoniciste dès décembre 1963. Le trente-trois tours sortira en 1966. Notons que les Animals produiront aussi le leur. Qui me semble supérieur, mais je ne voudrais pas ouvrir une guerre civile parmi les fans. La réalité est parfois plus rugueuse que le rêve. La confrontation entre les jeunes blancs becs et la légende noire n'est pas toujours évidente, les premiers sont à l'aube d'une carrière prometteuse, Rice Miller a roulé et cabossé sa bosse dans bien des galères. Ne portent pas le même regard sur la vie. Les Yards ont les doigts sur la couture de l'harmonica – celui de Sonny, pas celui de Keith Relf – Miller est à la déjante, en a vu beaucoup d'autres, ne prépare rien et improvise sa set list in progress action. Est beaucoup plus branché sur la sape et l'alcool. L'est le vieux rooster au milieu des tendres poulets, les subjugue davantage par son verbe que par son implication musicale. Clapton le roi du blues, laissez-moi rire. Un amoureux transi qui ne sera jamais capable de lui sauter dessus et de le copuler avec vaillance. Un sacré guitariste, oui. Mais qui fait dans la dentelle. Le maître de la fluidité. Capable de riffs monstrueux, mais tout de suite si impeccablement maîtrisés qu'ils perdent toute leur saveur séminale. Ne croyez pas que je n'aime pas, j'ai été plus tard féru des Cream, mais le style Clapton me paraît comme sa voix, trop haut perché, un poste idéal pour voir le paysage, mais comme le corbeau de la fable il laisse tomber le fromage lorsque le renard du rock'n'roll pointe son museau. Face à Rice Miller, Clapton ne saura pas s'imposer. Reste dans l'ombre se replie dans le rôle de l'accompagnateur rythmique sans imagination ni énergie.
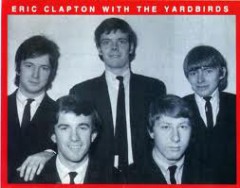
Dès le mois de février 1965, Clapton quittera les Yardbirds déplorant l'évolution par trop commerciale du groupe. Je n'y crois guère. Plutôt des problèmes d'égo auxquels Clapton ne saura jamais faire face. Préfère se démettre que l'affrontement. Se retire dans sa tour de blues ivoirin. Mais surtout l'évolution naturelle de la musique rock qui devient de plus en plus violente. D'abord parce que les groupes de plus en plus nombreux doivent à tout prix se singulariser par rapport aux concurrents, ensuite parce que les innovations techniques apportées par les fabricants de guitares et d'amplis, ouvrent des possibilités qui ne demandent qu'à être explorées. La course au bruit est ouverte ! Et le sieur Eric préfère les climats tempérés. Plus tard quand il tuera le shérif ce sera avec des balles molles.
YARDBIRDS WITH BECK
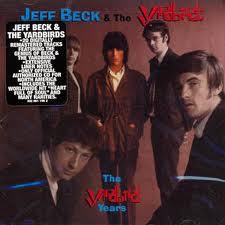
En fait les Yardbirds souffrent d'un problème qu'ils auront du mal à surmonter. L'arrivée de Beck recommandée par l'ami Jimmy Page va résoudre la problématique d'une étrange manière, en prenant le taureau par la queue. Puisque le groupe n'est pas au mieux dans les studios, autant mettre encore plus le paquet sur scène. Les Yards qui étaient renommés pour leurs prestations vont développer une esthétique rock qui influencera toutes les seventies.
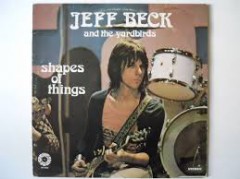
Dès les premiers concerts Jeff Beck fait la différence. Vous voulez du riff, eh bien en voilà, rififi on stage et à gogo, du découpé spécialement pour vous à la pédale ouah-ouah – celle qui fait miauler les guitares comme des chats – ou distordu à la main et au chalumeau et la fuzz-tone – celle qui fuse et qui détone – et qui permet d'en faire des tonnes. Possède le dernier cri des gadgets électroniques. Jeff le grand chef. Vous mène le combo sur le sentier de la guerre, de la première à la dernière note.
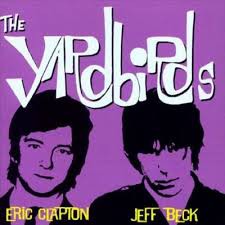
Sur la guitare Beck et ongles. N'est pas un fan de Gene Vincent et des Blue Caps pour rien, le nouveau guitariste. Triture sa gratte comme Cliff Gallup, mais la donne est changée. C'était la voix de Gene qui était au centre du tableau. Les casquettes bleues opéraient sous forme de commando, on pose la dynamite et on se retire pour laisser au Screamin' Kid toute la place, l'on revient pour refaire monter la mayonnaise mais c'est le lead-singer qui termine le boulot. Désormais ce sera l'inverse, de temps en temps Keith Relf intervient, juste le temps de laisser le guitariste reprendre souffle, et puis il s'éclipse pour que le festival puisse commencer. Des notes qui volent et qui pleuvent de tous côté sur le champ de bataille. A la batterie Jim McCarthy décompose les breaks, là où trois coups de baguettes magiques suffiraient il vous en colle trente à la suite sur un rythme légèrement décalé par rapport à lui-même, le moindre morceau vous prend des allures d'infinitude, l'auditeur est en voyage vers les limites de l'univers qui reculent à chaque fois qu'il se rapproche de son but qu'il n'atteindra jamais, trace la ligne d'horizon sonique. Inutile de lui intimer doucement la basse, car Paul Samwell-Smith a compris qu'il n'existera dans un tel tintamarre que si son instrument s'impose aux autres. Vous croyiez que je resterais en retrait me contentant de tisser l'ombre dans laquelle votre intention est de me reléguer, c'est raté, c'est moi qui ratiboise gratis, je patauge avec mes pataugas, flac-flac dans les flaques, ça gicle de partout et j'asperge tout le monde, faite gaffe, c'est de l'eau lourde. Au cas où vous ne seriez pas convaincu, l'on a encore le cheval-léger Chris Dreja à jeter dans la mêlée. Seconde guitare, comme les deuxièmes couteaux dans les westerns, qui passent par derrière pour vous trancher la gorge.
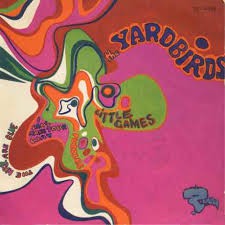
Les Yardbirds révolutionnent le rock. Alors que la plupart des groupes se retrouvent la verge flapie après avoir tiré deux ou trois coups, alors que les Beatles s'enferment dans la joliesse des arrangements et que les Rolling qui ont trouvé la quadrature du cercle rythmique ne changeront plus jamais leur formule, les Yardbirds défrichent de nouveaux territoires. Sont un peu trop en avant pour le public qui adore les voir en concert mais qui n'achète pas leurs disques. C'est que bizarrement ce rock haché cru menu demande à l'auditeur une certaine réceptivité intellectuelle. Certes de temps en temps vous reconnaissez un couplet et un refrain, mais les meubles ne sont plus à leur place habituelle. Des architectes fous ont inventé le plan mouvant, la disposition des pièces change sans arrêt, faut avoir une sacrée boussole intérieure pour savoir où vous êtes exactement.
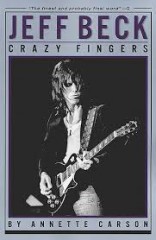
Des ventes qui ne crèvent pas le plafond et des tournées incessantes pour remédier au manque des royalties. De quoi fatiguer les meilleurs. Paul Samwell-Smith met les bouts en 1966. Chris Dreja prend la basse, laisse sa place à une vieille connaissance, un certain Jimmy Page.
YARDBIRDS WITH JIMMY PAGE
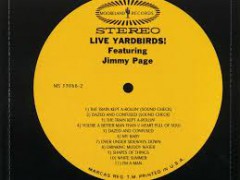
Deux superbes guitaristes dans un groupe, c'est toujours un de trop. Jeff Beck s'en va. Fatigué par les incessantes tournées aux States où le le groupe reçoit un accueil plus chaleureux qu'en sa patrie natale. Et puis surtout dans sa tête des idées toutes nouvelles sur le futur du rock. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le nouveau compère rumine à peu près les mêmes dans son cerveau. Mais pour le moment, l'est plein d'élan et d'enthousiasme. N'a pas chômé entre temps. Musicien de studio aguerri et renommé. Connaît beaucoup de monde, et s'est confronté aux multiples et contradictoires desiderata de ses clients. Le nouveau chef cuisinier a touché à tous les plats et goûté toutes les épices.
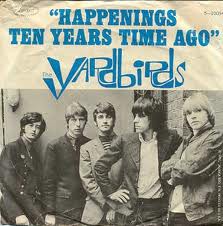
Etrange groupe qui s'améliore chaque fois que le meilleur de ses éléments le quitte. Le groupe continue sur sa lancée, ne vend pas davantage de disques, tourne tout autant si ce n'est plus, mais il gagne davantage d'argent. Grâce au nouveau manager, un géant nommé Peter Grant ( voir KR'TNT 14 du 21 / 01 2010 ). Un ancien qui a travaillé avec Gene Vincent pour le compte de Don Arden et qui a compris comment les musiciens se font arnaquer et qui pense que l'on peut distribuer les cartes d'une autre manière...
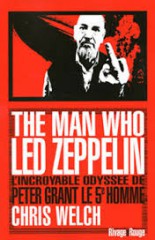
L'on est toujours trahi par soi-même. En 1968, Jim McCarthy et Keith Relf jettent l'éponge. Ont besoin de repos. Décident de quitter le navire. Un peu amers, se sont battus pendant des années pour imposer une certaine idée du rock et c'est Jimmy Hendrix qui est en train de récolter les graines distordues qu'ils ont semées... Sans oublier Clapton qui fait un malheur avec les Cream, la même chose que les Yards mais en plus coulant, avec le vieux beurre des Yards il a fabriqué une crème fraîche avec ajout de sucre pour faire passer l'amertume du blues...

Jimmy Page reste aux commandes pour honorer les contrats. Pour les derniers concerts, l'équipage tout entier s'étant fait porter pâle, il déniche trois autres musicos, John Paul Jones, Robert Plant et John Bonham... N'a pas spécialement envie de changer de nom mais Keith Relf commet l'erreur de sa vie... Les nouveaux Yardbirds prendront le nom de Led Zeppelin...
LES HERITIERS
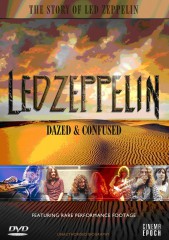
En 1969, Led Zeppelin n'est que la suite directe des Yards. Page reprend Dazed and Confused longuement mis au point avec les Yards, n'oublie pas non plus son archet qui faisait déjà chavirer les salles, mais très vite il s'aperçoit qu'il a dénichés les bons numéros, un arrangeur de premier ordre avec Jones qui tout de suite saura trouver dans les studios la recette magique de reproduction de la puissance du son scénique dans des sillons du disque, un batteur qui frappe plus fort que n'importe qui et un hurleur qui possède une étendue vocale bien plus grande que Keith Relf. The last but not the least, Peter Grant est là : poigne de fer dans un gantelet d'acier : il apporte au groupe trois éléments indispensables qui lui ont toujours manqué : une autonomie sécuritaire autarcique, une liberté artistique totale, une indépendance financière. Pour la première fois un groupe de rock'n'roll n'est plus dépendant de sa maison de disque. Ce que les Beatles et les Stones mettront des années à acquérir, Led Zeppelin l'obtiendra en quelques mois.
L'HERITAGE
Les Yardbirds auront posé les fondements du hard rock, l'on pourrait appeler leur style le yard rock. Ne sont pas les seuls, mais l'on ne prête qu'aux riches. Même s'il est de bon ton aujourd'hui de faire la fine bouche devant ce genre musical et ses dérivés métalliques et de lui préférer le bon vieux rock'n'roll des familles mis au point par les Stooges, MC 5 et New York Dolls. Il y avait une démesure phonique en gestation chez les Yards qui fut totalement réalisé par le Zeppelin durant les seventies. Même si au final le Dirigeable s'est écrasé sous la lourdeur de son propre poids. Peut-être même heureusement avant de s'engloutir dans les sables mouvants du prog. Là où Jeff Beck s'est maintes fois enlisé après les flamboyances du Jeff Beck Group...
En 1992 Chris Dreja et Jim McCarthy ressuscitent les Yardbirds. S'entourent de bons musiciens et vogue la galère. Les musées m'ennuient, Radio Nostalgie aussi. Le but n'est pas de se survivre, mais de créer du nouveau. Ô Mort, vieux Capitaine !
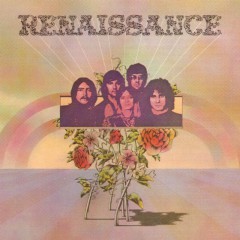
Dès 69, Jim McCarthy et Keith Relf fondèrent Renaissance qui eut ses heures de succès mais dont ils s'évadèrent assez vite. En 1976, Keith Relf meurt chez lui d'un méchant feedback électrique, alors qu'il travaillait à de nouveaux morceaux pour – ironie du sort – Renaissance. Mais peut-on trouver meilleure mort pour un rocker que d'être tué par sa guitare ?
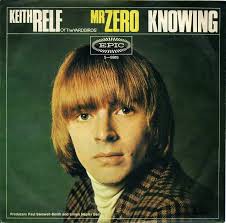
En tout cas, un véritable point d'orgue pour mettre une fin à cet hommage aux Yardbirds.
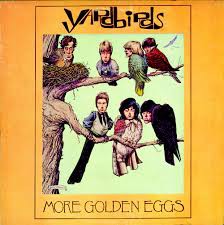
Damie Chad.
KROCKROCKDISCS
Je connais Mimile, un gars a priori irréprochable ( comme vous et moi, surtout moi ) et ce soir-là quand je l'ai aperçu l'avait tout pour être heureux. C'était aux Bordes ( voir Kr'tnt ! 184 ), savait qu'il y avait quatre supers combos à passer, mais il avait une drôle d'attitude, marchait un peu courbé, comme s'il portait tous les péchés du monde sur son dos. Ce n'est pas son style, alors entre les groupes de fans qui discutaient je l'ai observé du coin des yeux. Ce n'était pas une souffrance morale qui lui donnait cette démarche un peu trop penchée en avant ou ramenée de temps en temps un peu trop en arrière pour être naturelle. Tenait une boîte sur ses avant-bras. Papillonnait de groupe en groupe sans vraiment s'arrêter, parfois il ouvrait son carton à secrets mais j'étais trop loin pour voir quelle illicite marchandise il transportait.
Je connais Mimile, plutôt le gars à trimballer un coffre de pirate qu'une boîte de chocolats. Je sais bien qu'on approchait de Pâques mais ce n'est pas une raison pour me prendre pour une cloche. J'ai profité de ce qu'il était en train de discuter avec Mumu et Billy pour me rapprocher l'air de rien – le même que prend Mortimer quand il s'apprête la main au collet de l'ombre jaune ( tome 4 page 42 ) – alors il a entrouvert le mystère, et m'a proposé le deal : cinq euros contre le disque des Spykers, le genre de proposition qui ne se refuse pas.
THE SPYKERS.
My Little Girl / Fast Car / You Don't Love Me / Big River
Texas Joe : lead vocal + rhythm guitar / Jorge : double bass / Seb : Drums & cajon / Eddie : lead guitar / Bruno : harmonica, rhythm guitar, vocal )
Jull Records – BLR Studio.

Belle pochette, fond orange mordorée, le groupe en bas de pochette qui pose devant un hot rod customisé avec une fausse calandre de ( rock'n')rolls Royce à moins que ce ne soit de Bentley's. Au verso, les cinq tout en haut, instruments en main. Le compact reproduit le recto de la pochette. Belle ouvrage due à Thierry Varlet, Patrick de Rock Paradise et Mimile.
Vous ne connaissez pas les Spykers : un truc pour ne pas vous tromper, sur scène le batteur utilise un cajon sur lequel il est assis, et ils possèdent deux guitaristes rythmiques dont un qui joue de l'harmonica à la Little Walter. Un groupe de rockab qui cherche la difficulté tentant d'allier deux musiques cousines – le rock électrique des petits blancs au blues noir électrifié – mais qui de temps en temps s'ignorent... Racines communes mais co(rock'n')rolles séparées.
Quatre titres, ne râlez pas en disant que vous auriez préféré un album entier, réalisez plutôt que vous êtes entrés en possession de deux singles. Les signatures des deux premiers morceaux vous y invitent : tous deux étant signés de Nelson Carrera et des Spykers.
My Little Girl – un rythme légèrement syncopé, un peu bousculé à la Buddy Holly – logique pour établir le lien avec le rhythm and blues noir, Holly s'étant beaucoup inspiré du jungle sound – ici transformé en jungle beat – de Bo Diddley. Bruno à l'harmo mais le pont se traverse à la manière rockabilly, l'harmo vient rouler dessus, deux passages, et puis s'éclipse au profit de la guitare, qui se pose exactement là où devrait se trouver l'orgue à bouche.
Fast Car déboule à toute vitesse. La voix s'amuse et fait le gros dos comme le font tous les cats depuis que le rockabilly existe. Originalité le morceau accroche presque les trois minutes sans jamais lasser.
Deuxième single : You Don't Love Me de Junior Wells, l'autre harmoniciste de Muddy Waters. Bruno s'en donne à coeur joie mais les Spykers réussissent l'improbable : ce pur morceau de blues électrique ne jure pas le moins du monde avec le titre suivant : le Big River, un des tout premiers de Johnny Cash enregistré chez Sun. Il y a de l'intelligence dans la coexistence pacifique de ces deux titres : la Big River est bien celle qui borde le Delta. N'oublions pas que les américains nomment le vieux blues, country blues rural. Une étiquette qui réunit les deux branches du fleuve séparées.
Sur You Don't Love Me, l'on dirait que l'harmonica vient à la rescousse de la guitare, sans qu'aucun des deux instruments ne lutte pour imposer sa prépondérance. C'est la voix qui établit le lien, qui passe le témoin. Big Rivers est noyé de guitares, l'on reconnaît la patte de Mister Jull sur la manière d'envoyer les riffs.
L'ensemble s'écoute bien, il y a plus de finesse là-dedans qu'une rapide audition ne le laisserait supposer. Deux ans que de concert en concert les Spykers peaufinent leur son. Ont réussi à trouver l'équilibre. Se sont installés sur la fourche de l'arbre au surgeon originel des deux branches maîtresses du rock and roll, et d'après moi ils ne sont pas près d'en redescendre. Depuis dix jours le disc revient systématiquement sur la platine. Un signe qui ne trompe pas. Une belle réussite.
Damie Chad.
23:51 | Lien permanent
18/04/2014
KR'TNT ! ¤ 185 : GALLON DRUNK / SOUTHERNERS / ROCKIN' HELLFIRE / TWANGMASTERS / JAGUARS / LOREANN' / GANGS STORY
KR'TNT ! ¤ 185
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
17 / 04 / 2014
|
GALLON DRUNK / LOREANN' / SOUTHERNERS / ROCKIN' HELLFIRE / TWANGMASTERS / JAGUARS / / GANGS STORY / |
BATOLUNE / HONFLEUR ( 76 )
11 – 04 – 14 / GALLON DRUNK
GALLON DRUNK PREND DU GALON

Souvenez-vous. Les Gallon Drunk sont arrivés dans la mouvance des Cramps et du Gun Club. Fin des années 80, James Johnston et Max Décharné décidèrent d’entrer en résistance et de continuer à jouer du rock vaudou, même si commercialement, ils se condamnaient aux ténèbres de l’underground pour l’éternité. Ils ne voulaient pas prendre part au petit ballet minable de la Britpop orchestré par un New Musical Express finissant. Comme tous les groupes installés dans le sombre panthéon de l’underground, les Gallon Drunk cherchaient à se distinguer du lot par un son et une attitude, exactement de la façon dont avaient procédé Lux Interior, Jeffrey Lee Pierce, Graham Day et Billy Childish.
Bien sûr, nous autres pauvres frenchies n’avions qu’une vision limitée de ce que représentait Gallon Drunk. Il aurait fallu vivre à Candem et fréquenter les mêmes pubs qu’eux pour se faire une idée un peu plus réaliste. Pour entrer dans leur monde, nous n’avions pas d’autre choix que d’écouter les disques.

S’il est une chose qui frappe quand on les écoute, c’est bien l’âpreté du son et du propos. Ils naviguent quasiment dans les mêmes eaux que Nick Cave, mais avec une dimension voodoo en plus. Et les trois quarts de leurs morceaux sont montés sur des grooves de basse.
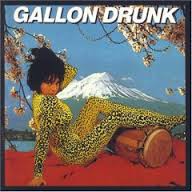
Leur premier album ne vieillit pas trop mal. Sur la pochette, une belle tigresse se prélasse devant le Fujuyama, les pieds posés sur un tambour vaudou. Les quatre premiers morceaux présentent un intérêt anecdotique et puis «Ruby» finit par éveiller l’intérêt, grâce à un beau groove hypnotique et à quelques accents de folie. C’est battu par Max Décharné, le pire zombie de l’underground. La chose est relativement diabolique, il faut que vous soyez prévenus. On sent bien qu’ils cherchent la petite bête. L’autre mamelle des Gallon Drunk, c’est le trash. «Draggin’ Along» en est une belle illustration, avec sa basse pouet-pouet en avant et le trash qui sort par les trous de nez. Spectaculaire. C’est une vraie expérience sonique, pour qui veut bien s’y prêter. Si on apprécie le non-conformisme, on est servi. Ils posent les bases du boost. Voilà comment naît une légende. Ils reprennent aussi le fabuleux «Please Give me Something» de Bill Allen, qui est aussi un morceau fétiche de Tav Falco. Belle reprise, car poussive et trash. Le clou du spectacle est «Gallon Drunk», l’hymne des boozards, avec de belles parties de gratouille. James Johnston bleurke, il sait y faire, ça hic ici et là, ils sont véritablement cocasses. Même les guitares titubent. Il faut le voir pour le croire.
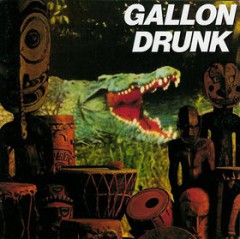
Quatre ans plus tard sortait un second album, «You, The Night And The Music», qui reprenait dans les grandes lignes les déclarations d’intention du premier album : groove, exotisme et furibarderie à tous les étages. «Some Fool’s Mess» est certainement le morceau le plus connu du groupe. Pur groove voodoo emmené à la basse. Ils jouent ça accroupis dans l’ombre. «Two Wings Mambo» monte d’un cran dans le voodoo. Voilà le beat le plus jungle de Londres, bardé de coups de guitares cisaillées, tribal en diable. Le zombie Max bat comme un sorcier guinéen. Il sait converser avec l’esprit de la forêt primitive. Belle pièce d’exotica. Le groove est rond et froid comme ce python endormi à l’ombre du palétuvier. Le chant est quasiment un chant de guerre incantatoire. James Johnston laisse ses gênes s’exprimer. C’est somptueux et bien tendu sur la durée. Le fait que ce soit interminable ajoute encore au charme discret de la bourgeoisie. C’est une sacrée pièce, tenace et fourbe, elle nous observe à travers une petite lucarne. Heureusement, ils reviennent à des choses plus civilisées pour le morceau suivant, «You, The Night And The Music», jazzifié de main de maître, un peu Monky sur le pourtour. «Night Tide» et «The Tornado» accrochent bien et sèment le vent dont on récoltera les futures tempêtes.
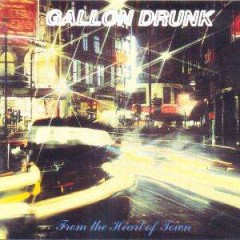
Ambiance nocturne pour «From The Heart Of Town». Belle pochette digne du Martin Scorsese de la grande époque (Taxi Driver et la bande-son de Bernard Herrmann). Ambiance enfumée et groove de basse pour «Arlington Road», éclats hébétés de fin de nuit alcoolisée. Nous avons tous connu ces moments sublimes et incertains, coiffés par un solo de sax. «Bedlam» est un big blast impérial. On sent chez eux une volonté de percer vers le ciel. Mais on reste dans le nocturne et l’urbain. Jolie ambiance éruptive avec l’arrivée des cuivres. Les Gallon Drunk cultivent la tension, ils sont comme la braise sous la cendre, au moindre souffle, ils prennent feu. Ils sont probablement les sournois greasers de cette époque. «Loving Alone» est une pièce de kitsch imposante, mambo de Candem, étrange métissage, mais recherche de la distinction à tout crin. Ça passe par des choix risqués, mais le résultat épate. Sur «Push The Beat Out», Max le zombie bat des breaks de la retape qu’il faudrait pouvoir qualifier d’historiques.
Mais pour Max, ça s’arrête là. Il quitte le groupe. Idem pour Mike Delanian. Ian White remplace Max à la batterie et Terry Edwards le sax-man fait son entrée comme membre permanent.
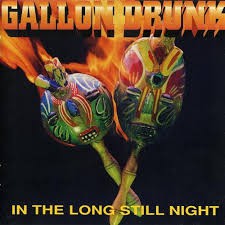
«In The Still Long Night» comporte aussi son joli lot de bonnes surprises. On retrouve les sales grooves qui se faufilent sous le lit, avec des cuts comme «Up On Fire». Les gens normaux appellent ces grooves des sales bêtes. Il faut rester prudent avec ce genre de groove, car il n’en finirait plus de nous tourmenter la conscience. Avec «It’s All Mine», ils nous sortent la vieille recette de l’explosivité. Voilà un morceau étrangement collant, bien pulsé à la basse. Nappes d’orgue, sax étranglé et pulsation extrême de la basse qui gargouille dans son coin comme une oie décapitée. On sent de la férocité dans les ténèbres. James Johnston ne chante pas, il murmure dans le secret de la tombe, il suggère le glauque absolu. Il plante des c’mon dans son stuff comme on plante des pic-pics en bois dans les cubes de vache-qui-rit pour préparer l’apéro du samedi soir. On trouve d’autres morceaux intéressants sur ce disque, comme «Eternal Tide (propice à toute forme de dérive), «The Big Pay-Off» (joli groove de shuffle) et «Some Cast Fire» (sacrément dense), mais rien qui puisse marquer la mémoire au fer rouge.
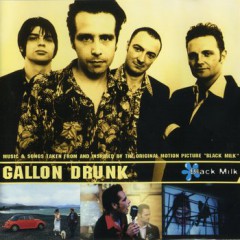
L’album «Black Milk» est en fait la bande son du film Black Milk tourné par un cinéaste grec, Nicholas Triandafyllidis. Voilà un disque étrange, dont les morceaux sont souvent longs et entreprenants, toujours basés sur des grooves de basse. Cinq morceaux se distinguent du lot : «Blood Is Red» (Vooddo is blue, sugar is sweet and revenge is sweeter, nous dit la voix et ça part sur un groove discoïde diablement inspiré), «Can You Feel It» (avec une pure accroche garage et on part sur un long groove electro-trash de la patate chaude, vraiment dansant, plein de wha-wha et de tribal, très bien travaillé sur la durée), «At My Side» (pur jus Gallon, chanté au premier degré du sol humide de la cave, c’est cherché et c’est trouvé, à condition de ramper, bien sûr), «Hypnotised» (bombé à la basse mambo, gras et gros comme un porc tatoué de Delvoye) et «One More Time» (belle pièce de balladif mélodique influent - and it’s gone gain - puissant et terrible - and there’s nothing left to say - bien grondant, avec l’effet du danger dans le dos).
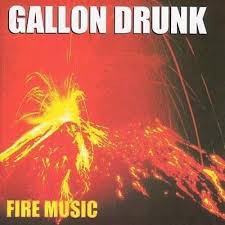
Quand «Fire Music» est sorti, on végétait en plein dans le début du millénaire. Ce disque rôti par les torrents de lave est bourré de grooves barbares, mais on sent une certaine baisse d’inspiration. Ce n’est pas qu’on s’ennuie, n’exagérons pas, mais les mets proposés manquent un peu de sel, ce fameux salt of the earth cher à nos vieux Rolling Stones. Dommage, car le disque s’ouvre sur un véritable hit interplanétaire, «Outside Of Love», une sorte de miracle mélodique inattendu qui ramène Gallon Drunk à son rang de très grand groupe anglais. Cette chanson monumentale, d’une absolue pureté mélodique, me hantait à l’époque. Chaque fois que je montais dans le métro, elle me revenait en écho et si j’avais été romantique, elle m’aurait certainement brisé le cœur. Ce genre de beauté touche les couches les plus profondes de l’émotion, et même si le reste du disque n’est pas à la hauteur de cette merveille, on se trouve largement dédommagé de l’emplette. D’autant plus que ce double album vinyle valait une petite fortune. C’est vrai qu’à la suite, on trouve des grooves balladifs assez intenses, souvent bardés de chœurs ou de parties de cuivres, mais ça s’arrête là. On sent nos amis lancés à la recherche de passages, comme le furent jadis les navigateurs, lorsqu’ils exploraient des mers inconnues. Les Gallon Drunk hispanisent un peu les choses, comme dans «Forget All You Know» et reviennent enfin au sortilège avec «Series Of Dreams», où James Johnston monte doucement sa petite mélodie à la Mary Chain comme une sorte de mayonnaise.
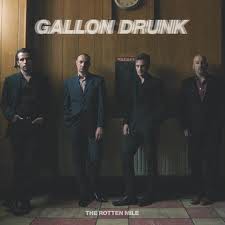
On pourrait presque dire que «The Rotten Mile» est l’album de la maturité. On y trouve des chansons énormes et inquiétantes, comme le morceau titre, qui a quelque chose de moyen-âgeux dans la violence faite à l’homme. Enterré vivant. Temps noir et maudit, groove du supplicié, pouls malade, solo écartelé. La perle de ce disque est sans doute «Down At The Harbour», que James Johnston situe en 1823, les marins embarquent - six ans après, vous souviendrez-vous de nous ? - sacrément temporel, excellence du voodoo monté sur un riff entêtant, ambiance macaotique - à bord une fille dit de tuer le capitaine et d’envoyer un message à Londres disant que nous avons disparu au bout du monde - «that we’ve fallen off the edge of the world». «Grand Canal Union» est sacrément hoché du menton. Voilà une sacrée toupie abandonnée, une belle furie de sax, une sainte horreur brutale. Ils sont enragés. C’est encore pire que Grinderman. Jamais ils ne vont se calmer, c’est ce qu’on ressent à l’écoute de «On Ward 10». C’est l’horrible morceau subliminal qui monte par la jambe du pantalon. Le genre de morceau qui ne lâche pas sa proie, même mort. «Bad Servant», c’est le punch du glauque - «Here we are/ On a mess/ In a car/ You and I/ On this night/ A bad servant and a slave/ One passed out and one betrayed». Fantastique ambiance mortifère. Le morceau idéal pour accompagner un suicide. Et puis voilà «All Hands At Sea», encore une belle image de perdition, mais cette fois c’est une stoogerie broyeuse de gorges. Digne du Gun Club, saxé dans le vent brûlant, c’est du napalm en guise de brillantine, une coulée d’extrémisme purulent - «And there’s really nothing left to say» - le sax traîne, malaise intense et les dieux vomissent. La chose est complètement dévastée.
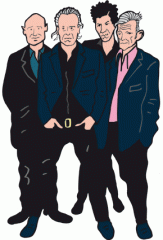
Tous ceux qui ont vu Gallon Drunk en concert le savent bien : Gallon Drunk est avant tout un groupe de scène. Les grooves à climats sont propices aux explosions et James Johnston passe beaucoup de temps à se rouler par terre. C’est l’un des showmen les plus spectaculaires d’Angleterre.
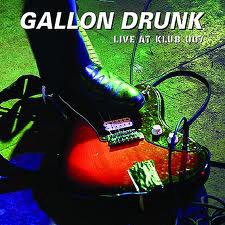
L’album live «Live At Klub 007» est l’album qui colle le mieux à la réalité de Gallon Drunk. Ça démarre avec une version explosive de «The Rotten Mile», ils poussent le jeu de l’exacerbation assez loin, comme s’il n’existait plus de limite. Ils cultivent la surchauffe et le goût des domaines inexplorés. Ils traitent de l’impossibilité des choses. Dans leur version de «Some Cast Fire», on sent l’aboutissement de tout un art de la tension extrême. Ils relancent encore et encore. Ils sont maintenant les seuls à cultiver cette folie du son et à développer une passion pour le concassage des atomes. La version de «Running Out Of Time» est un pur chef-d’œuvre d’explosivité de l’intensité. «Put The Bolt In The Door» devient un heavy blues gluant. Ils transforment «Bad Servant» en énormité séculaire, ils rendent le groove furieux et embarquent l’auditoire dans la démence. Ils semblent atteindre le sommet de leur art nécrosé. Mais quand arrive le stoogien «All Hands At Sea», on recommande son âme à Dieu. C’est vraiment la seule chose qui reste à faire. Ce morceau est à la fois dévasté de l’intérieur et de l’extérieur. C’est plein comme un œuf pourri. Pas de place pour la bricole. Ça pulse dans tous les coins, nappes d’orgue, sax, folie, drumbeat, incantations de comptoir. Pas de clémence dans la démence, pas d’échappatoire, on finit aplati sous une semelle, comme le mégot qui n’avait rien demandé à personne. Cette puissance quasi-industrielle relève des couches supérieures de l’infériorité. Alarmant, quant aux conséquences de cet assaut sur la libido des tympans.
Leur bassman Simon Wring a cassé sa pipe en 2012. Le groupe a décidé de continuer, mais en annonçant la couleur. Leur album s’appelait «The Road Gets Darker From Here», ce qui voulait dire en gros qu’à partir de là, le ciel s’assombrissait.
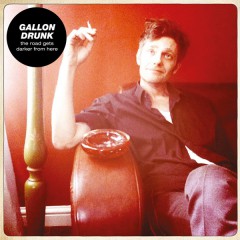
L’album démarre avec du pur garage d’heavy doom, «You Made Me», qui sonne bien les cloches, gras et vaudou comme pas deux. En vieux fan de Gallon Drunk, on ne peut que se régaler de cette pièce fumante à la fois kitsch et criante de modernité mordante. Avec «A Thousand Years», James Johnston nous replonge dans la désespérance aggravée, dans le groove privé d’espoir. Il prend soin de fabriquer d’extraordinaires atmosphères vérolées qui nous inspirent une sorte de terreur douceâtre, et on s’y étend comme dans un cercueil, le cœur en marmelade et les yeux humides, regrettant pour de bon d’être venu au monde, car enfin, c’est prouvé, il n’est pas de vie qui vaille d’être vécue. Puis on retourne le disque pour écouter la face B et on tombe sur «Killing Time», une petite pièce tendue à l’extrême et où des péripéties soufflent sur la braise pour mieux défigurer le ciel noir de menace. La chose est encore une fois hautement atmosphérique, étrange et violente. Sax et chaos, harmonica par là-dessus, typical Gallon Drunk. Arrive enfin le groove vaudou tant attendu, «The Big Breakdown», monté sur un riff typique de John Lee Hooker. Ça ressemble à un vieux réflexe délinquant, un tic admirable de véracité combinante. Énorme et malencontreux. À se damner pour l’éternité. Écoutez ce truc, «The Big Breakdown», ça fout tout par terre. C’est incroyablement proche, dans l’esprit, de ce que bricolaient les vieux sorciers du North Mississipi Hill Country Blues. Hypnotique et vainqueur, emporté par l’harmo, dément et basique, totalement salvateur. On salue l’excellence de la démarche qui vaut toutes les surenchères du monde. La guitare sonne comme une trompette de l’apocalypse. Le joli riff se cale bien dans le mortier. On l’entend bruire d’éclats soniques. On sent l’art du fouillis dans le fouillé des fuyards. On trouve après ça un heavy-heavy blues nommé «I Just Can’t Help But Stare», plombé jusqu’à l’os. On ne s’en sortira pas. De l’autre côté de l’Atlantique, on a les Chrome Cranks. De ce côté-ci, c’est Gallon Drunk. Ils se partagent le royaume du chaos.
Leur dernier album vient tout juste de sortir. «The Soul Of The Hour» reste évidemment dans le même esprit que ses prédécesseurs. Ils démarrent doucement avec «Before The Fire», et une longue intro pianotée. Rien ne presse. Ils prennent leur temps. Ils ont raison, après tout. Il faut savoir donner du temps au temps. Mais ça sonne comme du Nick Cave, c’est trop sombre et trop statique. On sent qu’ils ne vont pas bien. Heureusement, ils reviennent au pouvoir avec «The Dumb Room», le heavy trash, le vrai, le blues du dirt hole. Ils veulent sonner comme les Chrome Cranks - «It’s endless, useless/ Quite our style/ Primeval/ Ice age/ Dumb.» James Johnston sait écrire des chansons. «The Exit Sign» est aussi une énormité. Ian White qui a remplacé Max Décharné bat le beurre bien droit. L’excellence de la méthode vaut tout l’or du monde. La chose se veut spectaculairement hypnotique, elle part dans le cyber-space hawkwindien à travers un nuage de zigouiguis à la Dikmik. Sur la face B, on trouve un morceau de belle pop têtue, «Over And Over», une pop revenue de tout, bien relayée par la scansion «over and over». On sent la belle allure et le port altier - «Wine on the sheets/ And the clothes on the floor» - et la chose s’enfonce dans le crépusculaire. Mais il semble au sortir de cet album que les crocs de nos amis londoniens se soient émoussés. On ne va quand même pas en faire une maladie, n’est-ce pas ?

On se souvient de ce concert terrible à la Maroquinnerie en 2007, c’était une véritable révélation sonique. Rarement on avait vu un mec aussi démantibulé et aussi incontrôlable. Tous les morceaux étaient comme des torrents de lave qui rougeoyaient dans la nuit, comme sur la pochette de «Fire Music». James Johnston fouillait les entrailles de ses grooves et se jetait à terre pour y gratter des explosions de barrés distordus. Il passait de la guitare aux claviers, il tournoyait au cœur du cyclone, il jetait son pied de micro devant lui et le premier rang n’avait qu’à bien se tenir, il perdait son harmonica, retrouvait sa guitare, il rampait, frappait des accords ouverts à coups redoublés, il fomentait des complots contre la raison, il redonnait du sens au rock. Il réincarnait la sauvagerie du rock qu’on croyait perdue, il se noyait sous ses mèches devenues rebelles et gluantes, il encanaillait ses compos, il tirait tout le son vers le bord du gouffre. Rien ne pouvait l’arrêter. Il sombrait dans la folie, récupérait sèchement son pied de micro et il se jetait sur ses claviers comme s’il allait les détruire.
Un concert quelques années plus tard au Point Éphémère se révéla moins violent, mais tout aussi intense, infernal et groovy. Les parisiens ont toujours été friands de Gallon Drunk.

Et l’atmosphère s’est encore épaissie au Batolune d’Honfleur par cette belle soirée de printemps. Ce fut pour le public clairsemé un shoot de groove d’une noirceur inconvenante, d’une intensité proche de la bestialité rituelle, celle qui provoque l’hypnose, voire la commotion. James Johnston et ses compagnons d’infortune ont ouvert leur bal des maudits avec l’interminable dérive malsaine de «Before The Fire» et refermé le chapitre de leur set brûlant avec un groove encore plus cuisant. Ils ont fait rissoler quelques titres du dernier album comme «The Exit Sign» et ce «Soul Of The Hour» totalement privé d’espoir, comme si l’espoir n’avait jamais servi à rien. Comme le groove d’ailleurs. Puis «Hanging On» et «KillingTime» tirés du dark album et surtout l’imparable «Bad Servant». Tout cela dans une spectaculaire atmosphère de fin du monde et de réinvention du rock, mais un rock plus noir et plus désespérant que jamais, gluant d’énergie malsaine et fier d’être condamné à errer jusqu’à la fin des temps dans les ténèbres de l’underground.
Signé : Cazengler, Drunk tout court
Gallon Drunk. Le Batolune. Honfleur (76). 11 avril 2014
Gallon Drunk. Gallon Drunk. Clawfist 1988
Gallon Drunk. You, The Night And The Music. Clawfist 1992
Gallon Drunk. From The Heart Of Town. Clawfist 1993
Gallon Drunk. In The Still Long Night. City Slang 1996
Gallon Drunk. Black Milk. Everlasting Records 2000
Gallon Drunk. Fire Music. Sweet Nothing 2002
Gallon Drunk. The Rotten Mile. Fred Label 2007
Gallon Drunk. Live At Klub 007. Sartorial Records 2008
Gallon Drunk. The Road Gets Darker From Here. Rough Trade 2012
Gallon Drunk. The Soul Of The Hour. Cloud Hill Recordings. 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Terry Edwards, James Johnston, Leo Kurunis et Ian White
( Voir aussi : KR'TNT ! 139 : La Glorieuse Histoire du Rockabilly de Max Décharné. )
ROCK 'N' ROLL PARTY N° 6
LES BORDES ( 89 500 ) /
12 – 04 – 14 / FOYER RURAL
SOUTHERNERS / ROCKIN' HELL FIRE
TWANGMASTERS / JAGUARS

Les campagnes françaises débordent de bordes : ces antiques fermes isolées, éparpillées très méthodiquement sur l'ancien quadrillage romain des terres divisées en carrés - à mettre en valeur, souvent distribués aux légionnaires à la retraite – ont parfois donné naissance à de gros hameaux ou à de maigres villages. Ce préambule pour vous expliquer qu'arriver aux Bordes, en plein milieu de nulle part, dans une incertaine cambrousse sise au loin du côté de la bonne ville de Sens, exige pour les parisiens une sacrée dose de courage et par-dessus tout d'avoir le rock chevillé au corps.
Pas si difficile que cela, puisque à peine quitté l'axe principal de nombreuses flèches jaunes dûment orientées vous amenaient en douceur jusqu'au Foyer Rural désiré. Une orga de pro, avec les Teds aux commandes pas de souci à se faire, la logistique est au-rendez-vous, le petit doigt sur la couture de la drape-jacket. N'empêche qu'il y aurait pu y avoir deux fois plus de monde... Dommage pour ceux qui ne sont pas venus, car ils ont raté un super-concert, et pour ceux qui sont venus aussi puisque Fifi, le responsable, un peu dépité, annonce que désormais il organisera ses Rock'n'Roll Parties en Allemagne... Espérons qu'il reviendra sur cette décision qui priverait le public français de multiples grosses pointures rockabilly européennes...

Grande salle, bar au fond, scène en face – correcte mais on aurait pu souhaiter deux mètres de plus en profondeur – trois fournisseurs de disques, des sacs pour les ladies, des babioles à blouson pour tous, le bonheur du rocker à portée de la main sur les étalages. Tout cela ne serait rien sans tous les fans qui se retrouvent ou se découvrent venant d'horizons divers, du Nord, d'Espagne, et même de chez les Loners de Lagny-sur-Marne.
SOUTHERNERS

Commencer par les Southerners, c'est d'entrée mettre la barre au maximum de sa hauteur. Drapeau anglais en fond de scène – l'Angleterre étant d'origine le pays d'incubation du mouvement ted – P'tit Loup en drape jacket bleu-royal, Pascal drapé dans un rouge princier éclatant, Yves, Thierry, Michel sanglés dans leur tunique rebelle, sont tous là, invités cadeau pour l'anniversaire de Fifi. Pour les présentations, nous arrêterons-là car ils sont déjà partis sur Motorbike. Pas plus de quinze secondes pour qu'ils s'installent dans leur scansion si particulière. N'y a plus qu'à écouter.

Une musique et des voix. P'tit Loup entonne, Pascal répond, et le dialogue débute, Yves, Thierry et Michel, parfois seuls, ou à deux ou à trois, entrecoupent, véritable choeur de tragédie grecque qui souligne les moments cruciaux de l'action. Pascal appuyé sur sa contrebasse est le dieu tonitruant de l'Olympe, sans cesse en train de menacer, le verbe haut et l'intervention vindicative. P'tit Loup est le héros sur qui pleuvent les rafales colériques de la divinité. Se donne du mal pour échapper à son destin de rocker. Les chiens de l'enfer hurlent après lui et ne le lâchent pas. Au deuxième morceau – Eileen, le tour de chant est basé sur le disque que nous avons chroniqué dans notre précédente livraison – s'est déjà débarrassé de sa redingote et de sa sousjacket – très classe en sa chemise blanche. Trop de fils sur la scène trop encombrée ne lui permettent pas une gestuelle débridée, mais tous ses mouvements sont empreints d'une élégance féline. Nous offre le chant, et la danse. Le rock and roll vécu de l'intérieur entre beauté sauvage et trépidation rythmique. Pascal est venu nous visiter, nous les simples mortels, bientôt rejoint au milieu du public, par P'tit Loup qui s'en vient implorer le tonnerre de la contrebasse, en vain car la rebelle colère du rock'n'roll n'a pas de fin... Et tous deux remontent sur l'estrade pour continuer à libérer les forces du kaos...

Le loup-cervier ne prend même pas le temps de retrouver son souffle entre deux morceaux. Derrière sa batterie Vivi relance sans arrêt la machine. L'orchestre embraye à la seconde mais P'tit Loup est déjà aux avant-postes, et c'est reparti pour un tour de fou. Sans doute pensaient-ils finir sur leur extraordinaire version de The Train Kept A Rollin, pour laisser la place aux autres groupes, mais il est hors de question de les laisser s'échapper au bout de dix malheureux – toutefois flamboyants – morceaux. Et le public et Fifi ne leur permettent pas de se défiler si rapidement. Nous entraînent alors dans la ronde des hymnes à la gloire des Teddies boys qui mettent le feu à la salle.

Nous laissent estomaqués. Le groupe ted dans toute sa splendeur. Violence et retenue. Maîtrise et soumission. Un des premiers groupes français qui a su garder trente après intact l'impact de la fièvre adolescente. Un métier indéniable, une entente rodée au millimètre, mais recouverts par une envie folle de tout donner comme si c'était la première fois qu'ils montaient sur scène.
ROCKIN' HELLFIRE
Des montagnes sur scène. Imposants, dans leurs sombres habillements, statiques, nul sourire sur les lèvres de tout le set, les Rockin' Hellfire ne sont pas là pour rigoler ou passer du bon temps. Viennent d'Espagne, aussi austères qu'un tableau du Greco et aussi sérieux qu'un torero avant la mise à mort. Un germain dans le lot. Pas n'importe qui, le chef, Zlatko, l'ancien rythmique de Black Raven, un groupe culte encore en exercice. Malgré son costume trois pièces gris, l'a tout gardé de la noirceur du corbeau, pas le foutraque volatile de la fable, mais celui d'Edgar Poe aux yeux brûlants d'un feu éternel, perché sur le buste pallide de Pallas – selon la traduction de Stéphane Mallarmé.

Electricité froide. Impassibles et impeccables. Une ambiance de feu glacé. Un son lourd comme une chape de plomb. Ils alignent les morceaux comme des cercueils un jour d'exécution générale. Doivent réveiller en nous nos instincts les plus hideux, car nous devons l'avouer, nous aimons cela. Ces sueurs de suaires qui coulent en larmes de gel le long de notre moelle épinière, nous adorons. Ca nous réchauffe le coeur. Même quand ils nous joueront Broken Heart.

Terriblement anglais dans leur répertoire. Des dignitaires qui reprennent du Vince Taylor et du Johnny Kidd ne peuvent pas être absolument mauvais. Et pourtant leur Brand New Cadillac avec la poupée qui ain't never (more ) comin' back sonne comme le glas funèbre qui annonce la nuit de votre enterrement. Slatko vous mâchonne les paroles du bout des lèvres comme s'il mastiquait un chewm-gum d'angoisse pure. Pour une simple minette impertinente qui vous plante sur le trottoir, le combo vous brosse un drame humanitaire encore plus tragique que le génocide du Ruanda. Même traitement pour Shakin' All Over, la partie de jambes en l'air, il vous la transforme en séance de cour martiale, aucun souci à vous faire, vous n'en réchapperez pas.

Ne bougent pas d'un centimètre et vous vous apercevez que la grande menace vous enveloppe. Aucun indice auquel vous pourriez vous raccrochez, ni au feutre noir de David qui lui donne l'air inquiétant d'un agent secret, ni le Johnny Cash, the man in black, qui vous tire dessus avec sa guitare, sur le t-shirt de Mariano, ni l'étole léopard cruel sur la veste de Luis le guitariste, vos poils se hérissent lorsqu'ils abordent I Fought the Law, pour sûr vous n'avez pas affaire à de minables petites frappes de bas-quartiers. Ce sont des seigneurs, des saigneurs sans pitié qui vous transpercent le corps de leurs échardes électriques.

Rockin'Hellfire vous joue le rock comme un oratorio de mort. Ne vous ont pas trompé sur la destination finale. Visent les profondeurs infernales. Et vous les suivez sans une hésitation, sans un regret. Voyage au bout de la nuit. Le rock conçu en tant que road movie on the 666 avenue. Leur Teddy boy Boogie est repris en choeur mais avec ces enchanteurs de Hamelin, on irait au cimetière en chantant. C'est cela le Hellfire Rock'n'roll et vous ne pouvez que crier après eux I'm Comin' Home.

Superbe prestation.
TWANGMASTERS
Changement de décor et d'époque. Le drapeau anglais reste bien collé à sa place, sur le mur de fond de scène. C'est à l'intérieur de vous que vous enlevez les voiles noirs de crêpe et de deuil que votre imaginaire avait placardé sur votre cerveau durant le set des Rockin Hellfire. Les Twangmasters eux aussi sont habillés de noir, mais ce n'est pas la même chose, leurs blue-jeans nous le confirment. Ce n'est pas la teinte dont on se pare qui colorie la vie, mais notre volonté de la peindre d'une telle ou telle autre couleur. Il fut un temps où les Twangmasters étaient quatre, mais le batteur s'est retiré. Auraient pu arrêter l'histoire à cet instant-là, ou en embaucher un nouveau. Ont préféré compter sur leur propres forces et continuer à trois. Le rock n'est-il pas une musique en perpétuelle recomposition ?

Vêtus de noir mais très premiers Blue Caps. Paul Barton est au four et au moulin. Au chant et à la batterie. Joue debout à la Dickie Harrel, caisse claire, un tom et les deux cymbales, desquelles il ne prolonge jamais les vibrations arrêtant de la main si nécessaire le ruissellement du métal. Un son très primitif, le même que vous trouvez sur les premières versions de Chuck Berry – avec en plus le piano en moins – ce n'est pas un hasard si le set débute par Too Much Monkey Business.

Son primal, récuré jusqu'à l'os. Ne vous servent même pas le nécessaire, seulement l'indispensable. C'est peut-être pour cela que vous ne rejetez rien. Faut entendre leur All I Can Do is Cry, pas de trémolos romantiques dans la voix, adieu à la grandiloquence narcissique du chagrin, la douleur uniquement, la jouissance de la souffrance, rien de plus. L'essentiel. Sur Crazy Legs ils parviennent à découper juste l'ossature rythmique du morceau, de véritables hyènes carnassières, inutiles de repasser après, n'abandonnent tibias et fémurs qu'après en avoir extrait la substantifique moelle.

Il y en a un pourtant que ça fait rigoler, c'est Carl Gunther, à dada sur sa contrebasse qui s'amuse comme un gamin. Un pitre sous ses cheveux blonds coupés rasibus qui cherche à établir le contact avec le public. N'en oublie pas de bosser pour autant, d'abord il envoie une giclée de notes rondes et swinguantes qui s'éparpillent dans toutes les directions, sa manière à lui de tresser le schéma rythmique du titre tout en laissant assez d'espace pour que le Barton puisse bastonner à sa guise dans les espaces ainsi délimités. Et puis il vous regarde et se marre comme un bossu. N'en oublie pas pour autant de faire péter le mur du son sur ses cordes qu'il triture comme des élastiques géants.

Du coup l'on en oublierait presque, malgré son imposant gabarit, Alain Wilson qui s'active sue sa lead guitar. Pas le genre de jeu à épater le touriste. Se contente d'encercler et faire tenir ensemble la production des deux précédents. Fait le lien, pose la charpente et monte les murs, tandis que les deux autres passent le crépi et posent les tuiles. Mais le gros oeuvre indispensable, il s'en charge. Le rôle du berger qui rassemble le troupeau. Faut entendre son boulot sur le Maybeline et le Long Blond Hair de Johnny Powers.

Les titres défilent vitesse grand V, servis par la voix chaude de Paul qui les expédie sans fioritures, un Cheatin' Heart sans naïf émerveillement, un Folsom Prison sans mélodramatisation, un Blues Stay Away From Me sans mélancolie. Nous ne sommes pas au Cours Florent, The Twangmasters ne surjouent pas leurs interprétations. Ils jouent du rock'n'roll, uniquement du pure rock'n'roll, et quand vous les écoutez vous comprenez qu'il ne vous manque plus rien pour être heureux dans votre misérable existence. Pas d'emballage, pas de papier fantaisie ni de petits rubans roses, le cadeau tout seul. Superbement suffisant.
THE JAGUARS
Cinq sur scène, dont quatre rangés en rang d'oignons par-devant et le batteur par derrière. Commencent si cool qu'on ne fait pas attention à la beauté du son. Sont à la parade, l'on se croirait dans un groupe de Do Woop, se balancent en rythme et en cadence, les trois guitares et le chanteur, et une fois l'on se tourne tous ensemble vers la gauche, et attention cette fois sur notre droite, bien, tous ensemble, maintenant on recommence, et derrière son micro Dave Rivers arbore son sourire dentifrice N° 1, c'est quoi ces blaireaux, se croient à la revue de l'Alcazar, pincez-moi, je rêve. Ces jaguars seraient-ils des fauves d'opérette ?

C'est à cet instant que votre cerveau ne répond plus. Collapsus intégral. Vos neurones ne sont plus qu'un immense vortex qui tournoie sans rémission dans votre boîte crânienne. Inutile d'appeler le docteur. C'est sans remède. Ce phénomène attentatoire porte un nom, vous êtes une victime collatérale de ce terrible virus foudroyant dont on répète avec terreur le nom dans les laboratoires de recherche médicale qui luttent sans succès depuis soixante ans contre cette mortelle pandémie, c'est le R'n'R. Surtout évitez de fréquenter les cirques et les ménageries, la virale bactérie s'attaque d'abord aux félins, mais se transmet très facilement à l'homme.

Vous servent très vite un instrumental pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du désastre. Très sixties, un son à la Shadows comme les Shadows n'ont jamais été capables d'en fournir. Normal, l'ont légèrement survitaminé. Vous repérez très vite, sur votre gauche, le coupable, je vous donne son nom Andy Wren, non il ne joue pas de la lead guitar, il vibratophone à la folie, un véritable maniaco-bigsbryseur, vous fait avaler des couleuvres d'acier suédois par centaines, ces maudits reptiles s'échappent de sa guitare et s'en viennent pondre des myriades d'oeufs empoisonnés dans votre cerveau malade. Ah, vous vouliez du rock and roll, eh bien en voici. Et puis pour se foutre de votre gueule ils entonnent tous en choeur She-she-she Litlle Sheila pour soutenir Mister Dave Rivers qui les embarque dans une mélopée infernale, son sourire de Monsieur Loyal du Rock'n'roll toujours aussi épanoui sur ses lèvres.

Les Jaguars s'amusent. Mais à coups de griffes. Vous déchirent tout du long, vous broient les os sous prétexte de vous mordiller amicalement, vous éviscèrent sans plus de prudence, vous laissent retomber tout pantelant, avant de revenir vous retaper à grands coups de barre de fer sur les incisives. Tous méchants. Même Eddy Gentry sur sa batterie. Une mine inquiète, toujours en train de s'assurer de ce que font les autres, mais un véritable psychopathe du caisson. Le gars têtu qui n'en démord jamais. Un méthodique. L'a divisé son champ d'action en quatre ou cinq secteurs. S'occupe de chacun d'eux, mais à chacun son tour. L'un après l'autre, change systématiquement de zone à chaque nouveau morceau, mais alors il ne la lâche plus, la bombarde et la pilonne sans pitié. Le genre Attila qui fait bien attention à ce qu'après un concert pas un poil de chacal ne repousse sur la peau de ses toms. N'épargne aucun centimètre carré. Comment voulez-vous que les guitares ne se sentent pas soutenues dans leurs méfaits harmoniques avec un tel exemple !

Nick Grammon est à la rythmique, c'est le plus jeune, Dave le laissera chanter à deux reprises. Encore un à qui sa maman n'a jamais appris à dire s'il vous plaît, vous tisse des murs de flammes de quinze mètres, ratiboise sec et ne jette jamais d'eau sur l'incendie qu'il vient d'allumer. Tony Casey est à la basse. Soi-disant. Parce qu'il ne s'en sert pas pour planter un bulbe de tulipe tous les vingt centimètres. Serait plutôt du genre plante rampante et carnivore qui s'entrelace à tout ce que produisent ses trois congénères. Basse Fender à manche très long, comme un jour sans pain, et il a une faim à dévorer le monde.

L'est vrai que sur sa lead, Andy Wren donne le mauvais exemple. Avec une leçon en prime. Démonstration gratuite. Ecoutez et vous comprendrez. Comment au tournant des années soixante le rock est-il passé du son guitare claire à la Hank Marvin à ce qui deviendra l'urgence métallique des premiers grands groupes anglais. Des Shadows aux Who, du surfin' à l'électricité. Ou comment l'on a scié les barreaux de la cage et lâché le fauve en liberté. Sans surveillance. Andy Wren n'a pas été le guitariste des Avengers pour rien. Ne devaient pas y avoir beaucoup de puristes dans l'assistance car je n'ai entendu personne crier au loup. Les Jaguars ont laminé le public. Et vous n'aviez pas intérêt à vous rendre car ces maudites bestioles n'étaient pas d'humeur à faire des prisonniers.
Little Sister, Matchbox, School of Rock'n'roll, Johnny B. Goode, les titres se succèdent, un déluge de feu et d'acier sans fin. Le moins effrayé de tous, c'est Dave River, un elfe, un feu follet qui survole les flammes de l'enfer avec une facilité démoniaque. Pas le moindre signe d' essoufflement, jerke autour du micro, se jette à terre tout en continuant à chanter comme s'il était assis dans une bergère Louis XV. Très british, en somme.
Des gentlemen ? Non beaucoup mieux, des rockers. Merci Fifi.
Damie Chad.
( des centaines de photos sur les facebooks d'Edonald Duck et Petite Grenouille )
LE CESAR / PROVINS
12- 04 – 2014 / LOREANN'
Parfois la vie vous a un de un ces goûts de revenez-y, pas du tout vérolé. Me pointe de bonne heure – contrairement à mon habitude – sur le marché de Provins because ma journée est chargée en évènements divers lorsque, devinez le nom de la personne que j'aperçois en premier, avec sa guitare, sur la terrasse du César. Loreann' ! Pour ceux qui ne connaissent pas reportez-vous à la précédente livraison N° 184. Marx disait que l'histoire ne se répète pas mais que parfois elle bégaie. Me semble revenir dans le passé de l'Humanité, juste d'une semaine, ce n'est pas grand chose, mais c'est juste un début.
Bref Loreann', ses cheveux blonds, sa guitare folk, sa voix ensorceleuse, rien que pour moi. Des standards américains, rien que pour moi, par exemple une version de Mister Tambourine Man susurrée d'une manière à vous rendre jaloux. Et comme la dernière fois, le même phénomène de remplissage de la terrasse, les clients en veine de générosité qui lui offrent à boire et son chapeau qui n'arrête pas de recueillir les euroïques piécettes... Et l'ami Richard qui revient s'asseoir à mes côtés.
Nouveauté, Démocrite avait raison, l'on ne trempe jamais les lèvres dans le même verre de Jack. D'un deuxième étui, cette fois elle extrait une Epiphone – le modèle copié tout droit ( enfin presque ) sur la Gretsch d'Eddie Cochran. Tout de suite le récital vous prend une autre ampleur. Rien à dire, l'électricité est une découverte qui a plus fait pour le bonheur des hommes que l'invention des bombes à fragmentation. Du coup il y a même Jackie La Gratte, une figure folklorique de la cité, qui s'en vient fredonner J'avais Deux Amis du grand-père Schmall, dédié à Eddie Cochran et Buddy Holly. Décidément quand l'on prend les rockers par les sentiments...
Loreann' a repris son instrument et entreprend de ré-enchanter notre univers, le pire c'est qu'elle y réussit et que je dois me défiler, le devoir m'appelle, suis obligé de m'arracher après une ultime poignée de titres talentueux. Le lendemain Richard me raconte qu'il est resté et qu'ils ont beaucoup parlé guitare. Normal, il est prof de guitoune à ses heures gagnées sur la cruauté du monde. Un dernier coup d'oeil à la silhouette de Loreann', sûr qu'on la reverra, elle chante trop bellement pour ne pas l'écouter.
Damie Chad.
GANGS STORY
YAN MORVAN – KIZO
( La Manufacture de Livres – 2012 )
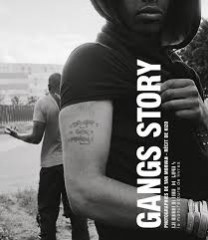
Avant tout un gros et beau bouquin de photos. Qui était déjà paru au début du millénaire aux Editions Marval, spécialisées dans les livres ( évidemment ) photos. Les vues de Yan Morvan étaient-elles alors accompagnées de commentaires ? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que cette nouvelle mouture est illustrée d'un récit de Kizo, ex-membre de la Mafia Z, gang de la ville de Grigny qui regroupait des jeunes du quartier de la Grande-Borne. Le mot récit semble un peu mal approprié – Kizo ne raconte ni hauts faits de guerres ni anecdotes significatives, il sait rester discret et ne nous livre que l'écume des apparences indéniables. Ses interventions se limitent à quatre introductions qui n'excèdent pas six pages pour la plus longue.
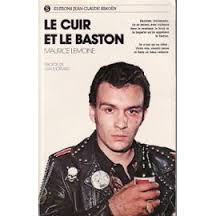
On ne peut pas dire que Yan Morvan publie ce livre par hasard. C'est après avoir fortuitement rencontré Johnny, un rocker charismatique de Montreuil, qu'il s'est retrouvé voici près de quarante ans à photographier les rockers français dès 1975, à l'époque ses photographies étaient parues aux Editions Jean-Claude Simoëns en 1977 dans Le Cuir et Le Baston, avec un commentaire assez politico-moralisateur de Maurice Lemoine. Ce livre est aujourd'hui qualifié comme le premier ouvrage français qui s'intéressait aux rockers français. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'en 1975 Ken Pate nous avait offert l'inoubliable Roquette Rockers... Quoi qu'il en soit Le Cuir et Le Baston ouvrit la porte de Paris-Match à Yan Morvan. Un grand professionnel, à la personnalité un peu borderline, se trouva ainsi mis sur les rails... Beaucoup de ces premières photos se retrouvent d'ailleurs dans Gangs Story.
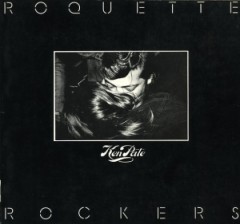
Car Gangs Story ne débute vraiment qu'en 1975. Certes, dans sa monographie Kizo remonte aux premiers Blousons Noirs des années 60 mais à cette époque là Yan Morvan était encore trop jeune...
ROCK' N' GANGS
Les mauvais garçons ont toujours fait phantasmer. Les jolies filles, mais aussi les petits bourgeois et les poules mouillées. Se présentent comme le rêve réalisé de multiples projections de volontés de puissances qui resteront soigneusement cadenassées à double-tour et avec chaînes ( à vélo ) dans la robinetterie intérieure de nos méandres cervicaux. Il ne reste que très peu de témoignages sur les premières bandes de blousons noirs en France, on ne les connaît pratiquement que par les reportages effectués par la grande presse d'époque, hostile bien entendu, à ces fils perdus du prolétariat. Ils avaient pourtant trouvé leur boussole, la musique - largement dispensée à tue-tête par les enceintes des auto-tampons et des chenilles des fêtes foraines, ils se reconnaîtront dans les idoles maudites du rock'n'roll - Gene Vincent, Vince Taylor, Eddie ( don't forget him on this April 4 th ) Cochran... Les bandes d'alors sont un délicieux ramassis exubérant d'enfants de prolétaires, gitans, narvalos et arabes, qui pressentent qu'ils seront les exclus des trente glorieuses qui se profilent à l'horizon... A peine nées elles vivent déjà dans la nostalgie d'un âge d'or américain qui ne durera pas longtemps et qui ne s'est pas vraiment déployé en France... D'un niveau social très limité elles seront assez fortes pour créer la première french-rock mythologie mais incapables de créer les codes écrits et artistiques facilement transmissibles d'une véritable contre-culture... Ces bandes fonctionnent en milieu clos, en réseau fermé d'auto-initiation individuelle et familiale.
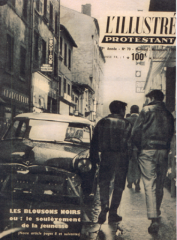
Le rock est une condition nécessaire de survie mais pas suffisante. Insensiblement l'on passera des bandes de blousons noirs aux rockers animés par un esprit de résistance à l'évolution d'une musique qui est déjà en train de changer et de brouiller ses propres codes. Les rockers seront d'instincts conservateurs, ce qui plus tard se transformera en l'adoption d'une idéologie réactionnaire. Mais il reste encore bien des étapes à franchir pour en arriver là : des faits significatif et quelque peu contradictoires se déroulent au milieu des années 60 aux USA.

L'explosion hippie avec son idéologie petite fleur bleue – du moins telle qu'elle est présentée sur les médias nationaux est en totale opposition avec la violence revendiquée du premier rock'n'roll. Idées pas si courtes que cela pour qui prend la peine de s'y pencher, mais cheveux longs et tenues négligées. A mille lieues du bon goût gominé des rockers. Mais les hippies ne sont pas les seuls à arborer des looks hirsutes. Les reportages sur les Hells Angel's d'Amérique dont on causera de plus en plus à la fin de la décennie ( Atlamont, articles fascinés dans Match, Easy Riders ) apportent une nouvelle esthétique. Les Hell's Angels descendent tout droit de L'Equipée Sauvage – et il est difficile de refuser une telle caution originelle – ces anges de l'enfer sont bien les enfants du rock, ils en portent le blouson emblématique, même s'ils ne sont pas spécialement fixés sur les pionniers, ils ont une prédilection affichée pour un rock and roll hard et violent. Evidemment ne sont pas tout lisses sur eux, arborent des tignasses emmêlées et ont les mains souvent empreintes de cambouis... Le livre commence à cette époque lorsque la bande de Répu et celle de Crimée se fixent sur l'est de la capitale. Ces premiers Hells Français imposeront leur marque de fabrique sur tous les mouvements de jeunesse qui suivront : la multiplication des motos-clubs de bikers certes, mais surtout cette idée qu'une bande se doit de construire sa propre économie de survie... Les hippies sont de grands consommateurs de drogues, un marché libre de toute intrusion réglementaire est à la portée de main de qui saura s'en saisir.

Les premiers rockers ont affaire à une forte concurrence. D'autant plus qu'une scission s'établit à l'intérieur du mouvement. Autour des années 76-77 arrivent sur le marché français des tas de compilations jusque-là introuvables. Au lieu de refourguer un inédit d'Eddie Cochran au milieu de onze titres que l'on possède déjà en six exemplaires, les majors, et puis de plus petits labels qui sautent sur l'opportunité, sortent des catalogues américains tous les petits pionniers dont on connaissait le nom mais que l'on n'avait pratiquement jamais entendus. Le mouvement rockabilly des années 80 prendra racine sur cette manne musicale inespérée. Sera dans un premier temps porté par les groupes de jeunes qui repassent la barre symbolique des sixties : les Fifties entendent montrer au monde entier qu'ils font une croix sur l'évolution du rock. Ne portent plus obligatoirement le blouson de cuir noir – tout de même un peu morbide – se vêtent de sweaters colorés, verts et rouges. Les mexicaines à talons biseautés et à bouts pointus sont délaissées en faveur des creepers two tones... Disques ou sapes, tout cela coûte de l'argent, les Fifties sont dans l'ensemble d'un milieu social plus élevés que les premiers rockers. Ce phénomène est aussi l'indice que le rock'n'roll est en train d'être adopté par des couches de plus en plus larges de la jeunesse...

Mais l'époque est propice aux changements. En Angleterre le mouvement Teddy prend de plus en plus d'importance. Ne s'agit pas uniquement de fringues et de looks, de nombreux combos opèrent un retour vers le rock des pionniers et le rockabilly, ils en accélèrent légèrement la cadence jusqu'à créer un effet hypnotique qui plonge les auditeurs dans une nouvelle addiction... En France les milieux rock tendent de plus en plus l'oreille vers ce mouvement qui possède sa propre organisation, ses us et coutumes, ses signes de reconnaissance, ses réseaux, ses concerts...

Mais les rockers n'en croient plus leurs yeux. Jusque alors s'ils étaient la dernière roue de la charrette sociale, ils détenaient au moins une place de premier, en commençant par la fin. Ce qu'il y a de pire n'équivaut-il pas à ce que le monde offre de meilleur ! A un niveau symbolique, sûrement. Et voici qu'ils se font doubler sur leur gauche. Grâce aux lois du regroupement familial promulguées par Valéry Giscard d'Estaing, les cités se remplissent de travailleurs africains... Une nouvelle génération de kids encore plus fracassée que le lumpen-prolétariat national commence à apparaître. Les bandes de rockers l'ont mauvaise. Ne font pas contre mauvaise fortune, bon coeur. Au contraire, elles se rétractent sur elles-mêmes et recherchent dans la seule histoire qu'elles connaissent des barrières de protection. Se définissent comme les petits-blancs américains du Sud qui subirent la concurrence déloyale des salaires allouées à la main d'oeuvre noire des esclaves libérés de la servitude. Vikings et Rebelles se ceignent de l'étamine sudiste et ne tardent pas à adopter une idéologie pour le moins racisante. La bourgeoisie peut continuer à dormir sur ses deux oreilles, tant que les pauvres se bastonnent entre eux, elle a encore de beaux jours à couler...
HIP'N'GANGS
Les gamins des cités ne sont pas plus bêtes que les autres. Même si la population s'est modifiée et provient en grande partie de l'Afrique Noire. Une nouveau style de bandes de jeunes est en train de proliférer. Encore une fois on copie l'Angleterre où des mouvements similaires à ceux qui viennent de se passer en France se sont déroulés. Dans les suburbs de London, les Skins à têtes rasées – un contre-courant du mouvement mods - ne supportent plus la forte prédominance de l'émigration étrangère – jamaïcaine notamment – dans leurs quartiers. Les fils de prolos, la boule à zéro, les Doc Martin aux pieds, organisent la chasse aux noirs ou aux pakistanais. Ratonnent sec à coups de battes de base-ball.

Ici, autour du Golf-Drouot, des groupes informels de Black Panthers qui écoutent du rock'n'roll noir ( Little Richard, Esquerita, Rhythm'n'Blues, James Brown... ) se lancent à la poursuite des Rebelles... qui sont remplacés par une nouvelle génération de jeunes gens, des bandes de skins qui ne s'inscrivent plus dans la tradition d'écoute des pionniers... Mais très vite apparaissent de nouvelles troupes qui décident de chasser de Paris, les redoutables bandes de Skinheads français qui se sont rapidement accoquinées avec les groupuscules d'extrême-droite. Dans les années 80, la donne change, les bandes ethnicisées des cités délaissent totalement le rock au profit du Hip-Hop et du Rap. Ducky Boys, des Black Dragoons, pourchassent les skins et les obligent à raser les murs. Se surnomment les Redskins car en ces années-là le mythe de la révolution est encore vivace et positivement connoté. Ils ont gagné la guerre, même si les braises sont toujours brûlantes. La mort de Clément Méric en juin 2013 dans une bagarre opposant militants antifas et skins d'extrême-droite est là pour nous rappeler que l'incendie peut reprendre à tout moment.

Kizo ne cache pas sa sympathie pour les Redskins, l'on peut dire qu'il fait partie de cette mouvance idéologique - antiraciste, antifasciste – même si son engagement ultérieur nous montre qu'il n'est pas dupe des travers de son propre camp. Car le combat ne cessa pas faute de combattants. Les bandes de redskins alliées dans leur lutte contre les skins se trouvèrent fort dépourvues après leur victoire. N'avaient plus qu'à rentrer chez elles... où elles s'ennuyèrent comme des rats morts. Quand on n'a plus d'ennemis, il faut vite s'en créer d'autres... Faute de mieux les bandes organisèrent la guerre des gangs. Au début just for fun, ensuite pour défendre leur territoire, ensuite pour réglementer tous les trafics imaginables sur la zone impartie...

Kizo en sa prime jeunesse se donna sans compter dans la lutte fratricide qui opposa les bandes de Grigny de Corbeil et d'Evry. Il est revenu de cette violence gratuite – pas si gratuite que cela car les bénéfices engrangés ( drogues, prostitution, voitures volées, etc... ) forment de nos jours une véritable économie parallèle, dont on ne sait où se perdent les ramifications... Les quartiers tenus par les bandes sont aujourd'hui les plus calmes. Le commerce n'aime guère les affrontements qui obligent la police à intervenir et à fourrer son nez un peu partout... Imaginez que par hasard vous tombiez sur un flic et un journaliste intègres, jusqu'où remonterait le scandale ? Parviendrait-on à l'arrêter avant ? Le blanchiment d'argent sale demande tant de complicités ! Kizo déplore cette évolution, il essaie d'entraîner les jeunes de sa cité à pratiquer le sport...

Le livre ne porte aucun jugement moral. Il égrène les faits. Ceux qui sont connus. Pour le reste ( tout le reste ) il les tait. Aujourd'hui histoire semble faire une pause. Mais l'eau qui dort est la plus menaçante. L'on se retrouve assez loin du début. Entre les bandes de blousons noirs désargentées des années 59 – 62, adeptes d'une petite délinquance qui n'a jamais été le moyen d'un véritable enrichissement personnel, et l'iceberg monétaire qui se profile sous les circuits parallèles des cités, il existe un véritable fossé. Pour la suite j'imagine que d'autres mafias doivent contempler le magot avec envie. Je ne pense pas par exemple que la série d'éliminations systématiques qui secoue actuellement les quartiers chauds de Marseille soient uniquement dues à de jeunes imbéciles qui jouent aux têtes brûlées. Combats de pieuvres redoutables et d'eaux profondes, les cervelles qui commandent les retors tentacules sont hors de portée. Du moins de la nôtre.
Yan Morvan est revenu à plusieurs reprises sur le sujet. Notamment en 1994, il fréquente ainsi Gui George sans se douter qu'il tient dans son viseur un des plus célèbres serial-killers français. Toutes ces photos sont dans le livre. Je vous laisse découvrir leur intransigeante netteté. A voir. Et à méditer.
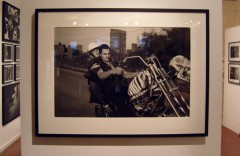
Cette guerre des Gangs raconte l'institutionnalisation – quelque part étatique pour ceux qui savent lire entre les lignes de nos deux antépénultièmes paragraphes – de la violence du rock'n'roll. Le système capitaliste est d'une très grande perversion. Vous retourne toujours le cran d'arrêt avec lequel vous l'agressiez dans le dos. En vous laissant croire que c'est vous qui avez porté le coup !
Damie Chad.
00:14 | Lien permanent | Commentaires (0)