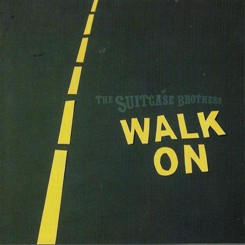04/09/2014
KR'TNT ! ¤ 199 : NEW CHRISTS / ALEXIS EVANS / THREE GAMBERROS / SUITCASE BROTHERS / CHINO AND THE BIG BET / FRENCH BLUES ALL STARS / JUKE JOINTS BAND / JEAN-LUC TUDOU
KR'TNT ! ¤ 199
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
04 / 09 / 2014
|
NEW CHRISTS / ALEXIS EVANS / THREE GAMBERROS SUITCASE BROTHERS / CHINO AND THE BIG BET FRENCH BLUES ALL STARS /JUKE JOINTS BAND JEAN-LUC TOUDOU |
ROUEN / LES TROIS PIECES /
12 – 07 – 14
LA RESURRECTION DES NEW CHRISTS
Après l’explosion en vol des Radio Birdman en 1978, Rob Younger remonta les New Christs. On les attendait un peu comme les messies. On savait Robbie et ses sbires capables de transformer l’eau en vin, et nous ne fumes pas déçus.

Ils font partie des mecs qui ont continué à faire du rock envers et contre tout. Leur intégrité leur a coûté cher puisqu’ils sont restés célèbres dans l’underground. On ne les a jamais vus en couverture des magazines. Tant mieux pour nous et tant pis pour eux. Mais quand ils viennent jouer en Europe, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on assiste à des concerts explosifs. Le dernier concert des New Christs à la Maroquinnerie en 2006 fut une belle pétaudière. La salle était pleine à craquer de connaisseurs et tout le monde a salué Robbie et ses amis comme il se devait. On avait sous les yeux des ressuscités, au sens propre du terme. Robbie le fantôme n’était plus que l’ombre de lui-même, mais à sa façon, il redonnait à la notion de chanteur de rock tout son sens.
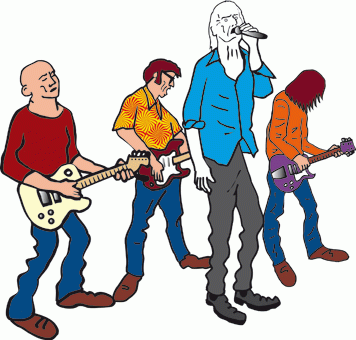
Il avait tout du vieil ami qu’on aime bien. Il semblait doux et sincère, avec un faux air de Wes Studi. Il portait un vieux T-shirt noir usé jusqu’à la corde, un vieux jean noir qui lui pendouillait au cul et des vieilles boots à élastiques. Rob ne savait pas bouger sur scène. Il se débrouillait comme il pouvait, roulait ses poignets et secouait les cuisses. Il dansait un jerk curieux et privé de connotations. On ne pouvait que l’admirer, car c’était très courageux de sa part. À côté de lui, le bassman Jim Dickson, sosie de Jean Bouise, deux mètres de haut, jouait la bouche ouverte.

Il aura fallu attendre huit ans pour revoir les New Christs sur scène. Pas une grosse scène, c’est vrai, mais on ne va pas se plaindre. Après tout, ils sont plus à leur aise dans une cave de la chrétienté des origines que sur une grande scène parisienne. Des Christs, ça doit rester dans les ténèbres de l’underground. Sinon, ça finit mal.

Nous eûmes donc droit à un set torride des messies du rock australien par cette chaude soirée de juillet. Ce qui frappe chez eux, c’est la densité de la présence et du son, certainement favorisée par l’exiguïté des lieux. On pourrait même appeler leur set un concentré de dynamite. Avec les New Christs, on a tout : le son plein du groupe à deux guitares, le showmanship d’un chanteur devenu légendaire et une belle série de compos qui défient le temps par leurs qualités à la fois rocky et mélodiques, des hits fameux comme «Coming Apart», «We Have Landed», «Woe Betide» ou «Like A Curse». Ils vont même jusqu’à poivrer leur rappel d’un medley Stooges/Stones/Johnny Kidd faramineux : «Down In The Streets»/«Play With Fire»/«Shaking All Over». Rob Younger est resté le grand meneur qu’on a toujours connu et il semble même se bonifier avec l’âge. Ce soir-là, il semblait même beaucoup plus solide qu’avant, plus intense et plus possédé. Il devait sentir qu’il avait derrière lui l’un des derniers grands groupes de rock du troisième millénaire : Jim Dickson, basse, Stuart Wilson, drums, Brent Williams, guitare & claviers et Dave Kettley, guitare (sosie de Chris Masuak et ça lui pose un problème car partout, dit-il, on le prend pour Masuak - ils ont tous les deux le crâne rasé et brillant comme une boule de billard).

Leur premier album était une compile de singles : «Divine Rites». Le son des New Christs n’avait plus rien à voir avec celui de Radio Birdman. Ils gagnaient en épaisseur et dégageaient un fort parfum de sortilège, comme dans «Like A Curse». Avec ce vieux single, Rob Younger créait les conditions de l’ambiance, telle qu’on allait la retrouver sur les albums suivants. Chris Masuak est encore dans le groupe à l’époque de «Sun God» et on se régale de son solo incendiaire, bien suspendu au dessus des gouffres béants. «Addiction» qui datait de 1987 était un gros rock solide porté par le son de basse de Jim Dickson qui venait d’intégrer le groupe. On avait là un énorme frichti de garage avec un jeu de guitare digne de celui du MC5, une rythmique détroitisée et fantastique d’à-propos. «I Swear» est une autre énormité nappée d’orgue et «You’ll Never Catch My Wave» brille de mille feux, doté d’une attaque imprévisible et d’une sorte d’allégresse délavée qui ressemble à un geste de lassitude royale. Ce cut superbe sonnerait presque comme un hit des Stones. En plus, ils le swinguent aux clap-hands. Puis Nick Fisher bat «I Saw God» à l’arrache. Encore un cut puissant et atmosphérique qui impose le respect. Et ça se termine avec une belle énormité, «Headin’ South» heavy garage dum dum bien épais quant au son, toujours poundé dans les profondeurs, c’est-à-dire dans l’excellence du pulsatif - celui dont on rêve en dormant.
Les New Christs vont-ils réussir à sauver l’humanité ? C’est ce qu’on verra dans les prochains épisodes.
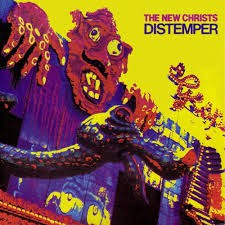
Quand est paru «Distemper», leur premier album studio, on s’est jeté dessus. Pas de souvenir précis des circonstances, mais ça devait correspondre à un manque. D’autant qu’ils ouvraient le bal dans une ambiance stoogy avec «No Way On Earth» et un beau son de basse bien rond. On sentait tout de suite la force d’un son plein. Ils allaient inaugurer une fastueuse série de morceaux bien bourbeux et vraiment donner la mesure en face B avec des énormités comme «Circus Of Sour» qui sonnait alors comme un hit planétaire, une merveille montée sur un beat bien sourd et galvanisée par un gimmickage élégant. En fait, élégance, c’est le maître mot des New Christs. Au fil des morceaux, on sent le son qui se profile. Et Robbie sait relancer un assaut - Circus of sa-our ! - C’est du très gros niveau, et la basse broute la motte avec ténacité. L’autre gros cut de ce premier album, c’est «Coming Apart», un uptempo speedo-speedah qui ne recule devant aucun excès. Un solo incendiaire vient fouiller ses entrailles - I understand what you’re going through - et un fort vent d’excellence nous éloigne du rivage.

«Lower Yourself» restera pour beaucoup de gens le grand album classique des New Christs. Sur ce disque, quatre titres sont des preuves de l’existence de Dieu, leur père. Dès les premières mesures, «We Have Landed» sonne comme un énorme hit intemporel. Ça tarpouine dans la bassine. Ils clament qu’ils sont redescendus sur terre, et ils balancent un refrain mélodique qu’on chante avec eux à tue-tête. Quelle épaisseur, non mais quelle épaisseur, et quelle authenticité mystique ! Quelle pureté de foi ! Quelle lumière dans le regard intérieur ! Quelle prestance œcuménique ! Ils réussissent là où les Lords Of The New Church ont lamentablement échoué. Ils créent une atmosphère biblique qui se répand à travers le monde et qui illumine les âmes. C’est un disque très excitant, car ils ne grimpent pas au faîte de la gloire, non, ils préfèrent graviter dans la bonne zone. Le morceau titre est une vraie bombe mystique. On sent une remontée par les basses. Toute l’épaisseur du son monte au cerveau. Il faut entendre Robbie le messie chanter à contre-courant. Cette grosse compo est si magistrale qu’elle épouvante le commun des mortels. On tombe rarement sur des disques qui ont un tel aplomb. Aw, Robbie le ressuscité de la rédemption remonte du fond du puits d’ascenseur qu’on voit sur la pochette. Sa puissance est telle qu’il faut de bonnes oreilles pour la recevoir. Ah ! fait-il en donnant un coup de hanche. Fascinante expérience. «Jenny» sonne comme un balladif uptempique et fait généralement un carton sur scène. On retrouve la dimension biblique de la puissance du son, l’épaisseur des gros accords rustiques, la belle décoction des battements d’extraction garage. Et cette façon qu’a Robbie le messie de conduire son couplet, d’un coup de rêne - yah ! - on sent le seigneur chez lui. On retrouve le gros descendant des catacombes avec «Fuzz Expo» que Robbie chante avec une classe effarante. Il croise la basse sur les remparts, alors que la nuit tombe. On fourbit les armes de la purée. Les loups hurlent dans les collines - in the shadows - c’est une curée courue d’avance, surgit un solo d’une perversion épouvantable, et on monte directement au paradis du garage christique. Robbie tartine les murs de la ville de génie, ça joue à la nausée, des vagues de solos submergent les remparts, c’est absolument indécent de grandeur. «Fuzz Expo» tétanise les populations. On trouve encore une autre énormité sur ce disque, «Truly Unaware», embarquée à la basse grasse, gonflée d’abcès de guitare et Robbie piétine dans des flaques de pus. Monstrueux d’exemplarité. Ça gicle dans les remugles. S’ensuit «Big City» qui est un gros truc de type Suicide, un vrai hit mortel doté d’un potentiel évangélique.
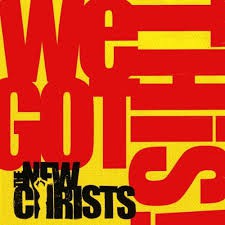
Ce qui est bien avec les New Christs, c’est qu’on peut acheter les disques les yeux fermés. Rob Younger fait partie des gens qui ne nous prennent pas pour des cons et qui s’efforcent de maintenir un très haut niveau de qualité, comme ont pu le faire Chris Bailey et Frank Black. Tous ceux qui connaissant «We Got This» savent de quoi je parle. L’album est sorti en 2002 dans une quasi indifférence. Mais quand on l’écoute, on se dit qu’on est sur la bonne voie et que l’heure de la rédemption finira pas sonner. Car forcément, ces mecs ont une forme de génie. L’intro du morceau titre ne serait-elle pas l’intro du siècle ? Allez savoir. Riff violent et Ah ! de Rob. Alors ça pulse. Riff signé Mark Wilkinson. Ils passent une sorte de sixième vitesse au dernier couplet. On n’avait encore jamais vu ça. Belle pièce de garage high energy avec «He’s Too Slow», emmenée à fond de train roboratif et cette façon qu’a Robbie de lancer un ah ! au sortir d’un virage dangereux ! Ils adorent foncer. Robbie chevauche toujours en tête avec une voix le plus souvent geignarde, mais il pleure des larmes de sang, des lacrima christi dont on se pourlèche les babines. Bien élongué sur la distance, voilà «Impeachment», lancé au pas de l’étalon et battu à l’écarlate, fond de train et grande élégance, on retrouve constamment ces deux mamelles sous leurs tuniques. Et puis on tombe sur la huitième merveille du monde, «Spit It Out», qui fit pas mal de ravages dans les cervelles, à la Maroquinerie. Balade de rêve - on l’accuse de sonner comme un morceau de Téléphone - The things I kill & the things I save - c’est d’une puissance qui dépasse la tempérance de la puissance - spit it out how small is your blues oh oh oh - beauté dévastatrice. En concert, Robbie a rendu pas mal de gens dingues avec ce hit. Il reste encore une belle pièce sur cet album : «Khartoum», exotica d’accords plombés et terribles, Robbie chante ça avec la résignation et la hauteur de vue d’un officier en veste rouge planté sous le soleil ardent du Soudan - Oh please !

«These Rags» est une compilation de plusieurs EP. Autant dire qu’il s’agit encore une fois encore d’un gros tas de dynamite. Il suffit juste d’entendre le premier cut, «Only A Hole» pour voir dans quoi on met les pieds. Ça saute aussitôt, bam ! gros pounding des enfers d’Australie. Il se dégage de ce hit une certaine grandeur extravagante. On voit bien que depuis lors, Robbie et ses apôtres sont installés dans l’extrême suprématie. Même chose pour «These Rags», où on retrouve cette allure suprême, cette quintessence de la puissance qui prend ses racines à la fois dans la mélodie et dans l’énergie garage. Robbie propose une fois de plus ce mélange unique d’ambition compositale et d’ampleur visionnaire. Encore une vraie pièce avec «The Way You Suck Me Down», rock-song imparable, grandeur et décadence portées par la voix d’un Robbie supérieur en tout. Il monte très haut dans la volonté d’élévation de l’âme. Avec «No Love Again Today», Robbie bat le rappel des blasts de basse - Cumon ! - et chevauche un riff garage indomptable. «Woe Betide» est une nouvelle merveille excessive d’accélération progressive, solide et merveilleuse, chantée à la pousse-toi-de-là-que-je-m’y-mette. Véritable énormité, mais avec les New Christs le mot énormité relève de l’euphémisme, alors on est bien embêté. C’est vrai que les New Christs ne font que s’empêtrer dans l’excellence. «Pedestal» est une pure stoogerie, totalement au-dessus de tout ce qu’on imagine ordinairement. Idéal pour ceux qui aiment les Stooges. Exceptionnel pour ceux qui aiment le rock. Bardé de riffs incendiaires et inspiré comme ce n’est pas permis. Pendant que Robbie éructe, les fans exultent. Pas de meilleure configuration possible. Il embarque «In State» à la mode sauvage et boucle la boucle avec une reprise sur-puissante : «The Seeker» des Who. On entre là dans le délire d’un très grand groupe underground. Leur version est superbe d’allant. Ils font de ce vieux classique des Who un garage monstrueux d’abattage.
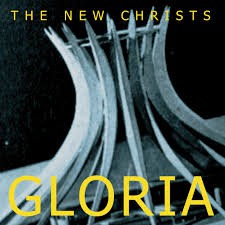
«Gloria» est passé quasiment inaperçu en 2009. L’album était dans les bacs d’un disquaire parisien et on ne savait pas d’où il sortait. Le nouveau New Christ ? Le mec n’était pas sûr. Encore une fois, c’est un très gros disque. Dans l’atmosphérique «Try Something», Robbie revient comme un fantôme, sa voix se fait plainte dans les couloirs d’un château désert et autour de lui résonnent des chœurs de ghoules. Morceau grandiose qui vaut bien les grandes heures de Mark Lanegan. Nous sommes de retour dans la cour des géants de l’underground. Belle pièce tendue que ce «My Existence», chantée sous le boisseau, riffée comme il faut, à l’australienne, sans honte ni prétention. Les New Christs perpétuent la notion de bon groupe de rock, une notion qu’ont perdue les Stones, par exemple. Encore une merveille : «The Wheel», noyée d’orgue et cadenassée par un riff pesant et pachydermique, sertie d’un solo de mélasse de fuzz, équipée de ponts de cristal puis plongée dans l’eau trouble d’un solo liquide. Les chœurs sonnent comme des ouvertures célestes, Robbie fait ses ah-ahhh habituels. Il domine son univers. On retrouve son chant de possédé de Sydney dans «The Posse», encore un morceau lancinant et beau, captivant et inspiré. Encore du flux tendu avec «Animalisation», embarqué au sacré beat de précipitation australienne, cousu de fil blanc comme neige, mais sacrément bienvenu, car joué avec un enthousiasme que rien ne saurait démentir. Du panache, rien que du panache. Robbie accroche sa couronne de loser au clou d’une certaine légende. «On All Fours» est un morceau salement bien foutu, sans violence ni éclat particulier. Le rock des New Christs s’impose comme un rock à guitares avec un singalong pointu-perché qui évoque vaguement la silhouette du pendu au sommet de la colline. Grosse ambiance avec des chœurs perdus dans les douves. Les albums des New Christs sont véritablement hantés. Ils terminent sur un hit brillant, «Bonsoir À Vous».

Comme beaucoup de grands groupes de rock, les New Christs donnent leur pleine mesure sur scène et c’est bien cette évidence que l’album «Live» met en lumière. Ils attaquent avec deux classiques, «Coming Apart» (vraie bête de somme de garage impérieux, tiré au chant d’une voix plaintive) et «We Have Landed» (solide comme le chevalier en armure, puissant et emmené à l’horizon du refrain). S’ensuit «The Wheel», terriblement lourd, comme si les quatre sabots du percheron s’embourbaient dans la boue du champ sous le poids des armes et de l’armure. Leur set d’alors comprenait aussi «We Got This», vieille battue d’accords louvoyés, cut idéal pour le combat de scène et ils enchaînaient avec «On Top Of Me», fabuleux et famélique. On trouve sur la face B deux grosses versions, «No Way On Earth», monté comme un âne garage et ronflé à la basse, pur jus christique et surtout le mirobolant «Bonsoir A Vous», tiré de l’album «Gloria», habile façon de saluer l’assemblée avec une certaine flamboyance. On y retrouve l’extraordinaire descente de manche de Jim Dickson. C’est à ce genre de classique qu’on peut évaluer la grandeur d’un groupe comme les New Christs.

«Incantations» vient de sortir sur le label havrais ressuscité, Closer. On y retrouve le principe de la grosse basse baladeuse de Jim Dickson et l’ultra-richesse des couches de guitares. Solide pièce d’intro que ce «Ghostlike». «Waves Form» est une belle purée lourde de sens, typique des Christs éternels. Heavy punk classique et inspiré. Le riffage ne faiblit pas, chez eux. Encore une belle pièce musculeuse avec «It Means Everything», dotée de belles plâtrées d’accords épais et de la science du maintien. S’il est un groupe qui peut se vanter d’avoir un port altier, c’est bien le groupe de Rob Younger. «It’s Not A Game» reste dans la bonne veine, bien monté, sourd et bon. Mais sur la face B, ils sont hélas un peu mous du genou. «Unless» voudrait bien passer pour un cut solide, mais cet imbécile refuse obstinément de décoller. Carré, certes, mais privé de l’allant d’antan. Les disques restent bien à l’image de la vie : on ne peut pas tout avoir. Ce serait trop facile.
Signé : Cazengler, grenouille de bénitier
New Christs. Le Trois Pièces. Rouen. 12 juillet 2014
New Christs. Divine Rites. Citadel 1988
New Christs. Distemper. Blue Mosque Records 1989
New Christs. Lower Yourself. Citadel 1997
New Christs. We Got This ! Laughing Outlaw Records 2002
New Christs. These Rags. Citadel 2002
New Christs. Gloria. Impedance Records 2009
New Christs. Live. Pitshark Records 2011
New Christs. Incantations. Closer 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Dave Kettley, Jim Dickson, Rob Younger et Brent Williams.
BLUES IN SEM / 09 - O8 - 14
ALEXIS EVANS / THREE GAMBERROS
SUITCASE BROTHERS
CHINO AND THE BIG BET
FRENCH BLUES ALL STARS
Le plus petit festival de blues de la planète coincé à flanc de montagne dans un espace pas plus grand qu’une cour de récréation de village de campagne. Sur deux niveaux, en terrasses pour reprendre la terminologie géographique en vigueur. Faut laisser la voiture à l’extérieur du village car les rues ne sont pas assez larges… Mais d’année en année les amateurs restent fidèles et reviennent soutenir cette ultima thulée du blues à 2000 mètres au-dessus du niveau du Delta.

N’y a que pour l’ouverture que ça coince, une orga paranoïaque de chef de gare qui s’obstine à n’ouvrir qu’à seize heures trente précises alors que le bon peuple du blues piétine devant les métalliques barrières depuis le début de l’après-midi… Après c’est au compte-gouttes devant l’unique guichet. Sans doute une manière de vérifier la théorie mathématique des catastrophes communément appelée des engorgements bouchonnants. Z’ont pas encre compris que les temps morts sont une excellente manière de faire fonctionner la pompe à bière sans interruption. Treize ans que cela dure, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
ALEXIS EVANS

Vient de Bordeaux. Avec tout son orchestre. Pour le blues, faudra repasser, c’est du rhythm and blues avec cuivres - ne sont que deux et un troisième ne serait pas de trop pour avoir un bon son Stax de derrière les fagots - un pianiste avec piano droit et orgue électrique - l’antique organum des congrégations religieuses que les formations R’N’B ont embarqué avec elles quand elles ont quitté le gospel pour la musique du diable - qui ne se débrouille pas mal du tout, poussant des cris d’encouragement et virevoltant sur ses deux claviers, guitare basse et batterie, et enfin Phil Evans au chant et à l’épiphone jaune.

Nous ont fait peur à la balance. Se sont lancés dans une espèce de slow variétoche qui n’augurait rien de bon. Mais non, c’était pour tromper l’ennemi car quand ils nous le ressortent en troisième morceau, l’ont sacrément remplumé et habillé de neuf. Puisque l’on parle de vêtement, c’est vrai que les orchestres noirs de rhythm and blues des années cinquante arboraient des tenues de maquereau aussi discrètes que des robes de cacatoès, mais en 2014 tous ces grands garçons engoncés dans leur costumes tout neufs avec leur mirifique cravate fête des pères, font un peu vieux jeu.

En tout cas ils vont tirer leur épingle du jeu. S’affirment de plus en plus à chaque nouveau titre, ont aussi leurs compos qui ne déparent pas dans l’ensemble même qu’elles seraient les meilleures surprises du set. Se retireront sous les applaudissements d’un public pas conquis mais sympathisant. Une formation qui a certes besoin de grandir, encore un peu verte, mais qui dans les années futures risque de laisser le souvenir d’une pépinière de talents. A éclore. A surveiller. Un petit côté bons élèves, de ceux qui rendent les copies sans faute d’orthographe, sans tache et sans reproche, mais une fois qu’ils auront fait un petit tour auprès des radiateurs, ces défauts disparaîtront. La bonne musique, c’est comme les filles, ça aime les cancres.
THREE GAMBERROS

Ne gambergez pas, Gamberros signifie mauvais garçons. Vous remarquerez tout de suite que le sommet du triangle est occupée par une fille, Loretta. Deux mama’s côte à côte puisqu’elle tient la contrebasse. Elle chante aussi - notamment une très belle version de Jackson - dans le rôle de June Carter, c’est Mig ( un fameux chasseur ) Toquereau qui prend celui de Johnny Cash - mais pas trop d'honneur aux gerces, car les deux autres fripouilles ne lui en laissent pas placer une. Surtout Mig avec sa grosse voix nasillarde qui fait tout pour attirer l’attention sur lui, une fois je prends la guitare et une fois je prends la mandoline. N’oubliez pas que jusque dans les années 1920, il se vendait dix fois plus de mandolines que de guitares.

Anthony Stelmaszack accoudé sur sa guitare se présente comme le lymphatique de service, l’antithèse de son acolyte à l’activité débordante, mais mine de rien il abat aussi son boulot, il chante ( pas assez à notre goût ) et sait aussi se servir de son harmonica mais va surtout nous donner un des plus beaux moments du festival, une cavalcade sans fin à la guitare slide, d’une tristesse infinie et d’une délicatesse dérangeante. De celle qui vous oblige à penser que vous vivez votre vie avec la maladresse d’un éléphant dans un magasin de terre mal cuite. Du blues à l’état pur.

D’autant mieux venue que le répertoire est avant tout très country. Ne m’en plains pas mais après le rhythm and blues de la première partie, l’on peut se demander si l’on est bien dans un festival de blues. Le blues serait-il si en crise qu’il en viendrait à picorer dans le pré carré de ses voisins ? Angoissante question, à la laquelle, chers lecteurs, il sera répondue dans les deux compte-rendu suivants. En attendant régalons-nous avec les Three Gamberros qui en ces temps éhontés d’augmentation du prix des cigarettes font un tabac. Pas tout à fait de Virginie, mais de quelque part entre le Texas et les Appalaches.
SUITCASE BROTHERS

Pas énormément de bagages puisqu’ils ne sont que deux. Deux frères, du même sang, Victor est à l’harmonica et Santos à la guitare. Se partagent le chant, mais Santos prend la plus grande part du gâteau. L’est sûr qu’avec un harmo dans la bouche, c’est plus difficile. Guitare acoustique, car l’on plonge dans le rural blues, le Piedmont Blues si l’on veut être précis, celui qui s’est développé dans le doux état de Virginie. Sont se font fait remarquer à Memphis ( Tennessee ), pourtant ils ne viennent pas de si loin, juste de l’autre côté des Pyrénées, tra los montes comme ils disent, d’Espagne. Vu la situation du pays, c’est normal qu’ils aient le blues.
Ca s’entend dès les premières notes, l’on a affaire à des virtuoses. Sont tout jeunes, mais ils ne sont pas nés de la dernière pluie, connaissent leur racine sur le bout des doigts et des lèvres. Le public se laisse embarquer sans demander son reste dans le train bleu. Beau numéro, l’harmo fait son shuffle comme si vous étiez dans la locomotive. Récoltent des applaudissements par centaines, soulèvent l’enthousiasme… je dois être le seul à ne pas partager l’allégresse générale. Certes ils sont doués, jeunes, beaux et sympathiques et malgré l’obstacle de la langue ils arrivent à communiquer avec le public. Certes ils connaissent toutes les recettes, et font ce qu’il faut au moment où il le faut. Rien à leur reprocher. Si ce n’est que s’installe en moi un sentiment étrange, d’entendre des gens follement centrés sur leur passion mais qui ne poussent pas la musique qu’ils aiment dans le sens d’une remise en cause de ses attendus, c’est bien d’être à genoux devant les grands ancêtres, mais c’est encore mieux de bousculer les traditions. Ce qu’ils font quelque peu, puisqu’ils possèdent une aisance technique que beaucoup de pionniers du blues n’avaient pas toujours… Mais ils avaient le mojo, ce que je traduirai, en dehors de toute facétie sexuelle, comme l’ancrage dans l’air de leur temps pourri. Nous ont fait une belle démonstration mais je n’ai pas vu le sang bleu de la terre couler…
Un sentiment personnel que Mama Puertas – la mère de nos deux bons petits gars - qui vient en rappel chanter, la gorge pleine de soul, une sourde mélopée sur Memphis, Tennessee, ne partagera pas.
CHINO AND THE BIG BET

Ne les ai pas vus s’installer sur scène, ni débuter leur session. Trop occupé que j’étais à discuter avec Jean-Luc Tudou l’auteur de Chicago, Terre Promise De La Guitare Slide, suis donc revenu à toute vitesse au premier rang. Tiens, c’est Caldonia, me suis-je dit sans y faire davantage attention en me glissant tant bien que mal au travers de l’épaisseur de la foule.

C’était bien Caldonia. En compagnie de trois gars. Tout d’abord une espèce d’escogriffe, guitare résonateur en main, de minces favoris en arc de cercle, tout longiligne dans un invraisemblable costume lamé myrtille. Le contrebassiste costume gris souris blanche a la tête rasée à la chauve qui peut. Le gars qui s’escrime sur la caisse claire de la batterie Gretsch est caché par les deux autres, vous remarquerez toutefois sa boucle d’oreille. Ca c’est pour l’image.

Pour le son il vous faut attendre. C’est Caldonia vous disais-je. Profitez en pour sortir le chien et faire le tour du pâté de maison. Ca y est, le riff est revenu. Vingt quatre secondes de délices, maintenant vous avez le temps de vérifier les devoirs du fiston. Attention, c’est reparti pour vingt quatre secondes édéniques. C’est terminé, oui déjà, rien ne vous empêche d’essuyer la vaisselle. ( Vous n’êtes pas obligé de m’obéir systématiquement, pensez à conserver votre dignité ). Vous ne savez plus où vous en êtes, et Chino qui se marre, la main suspendue au-dessus de sa poele à frire, avant de vous lancer le riff que vous attendez sans plus y croire.

Chino and theBig Bet. Il y en a qui interprètent et d’autres qui déconstruisent. Ces trois mousquetaires font partie du second groupe. Eux, ils vous livrent la locomotive en pièces détachées. Comptent sur l’intelligence de l’auditeur pour recoller les morceaux. Vous livrent du vrac. Blues en puzzle, swing en capilotade. S’amusent comme des dératés. Et vous suivez, comme les rats le joueur de flûte de Hamelin. Vous avez une excuse, des super musicos comme ceux-là vous n’en rencontrez pas quatre dans un festival, et eux ils sont déjà trois. Prenez Rod Deville, l’on dirait que quatre cordes sur sa contrebasse c’est beaucoup trop, se contente d’en pincer deux, de temps en temps. Comme chez le docteur, respirez lentement, mais il vous enfonce à chaque fois un clou dans le cerveau. Joue une drôle de chose, d’ailleurs ça s’apparente aux désharmonies de la New Thing, en voici un qui prend son monde à rebrousse corde. De pendu. Totalement moderne et en même temps ça sonne comme une boyau de chat tendu sur une boîte à cigare. De la musique qui boite et qui refuse la facilité de la mélodie pour mieux vous en souligner les jointures secrètes.
Giggs Nother, peux pas vous expliquer ce qu’il trifouille sur sa caisse claire, ses mains étaient hors de mon champ de vision, je peux simplement affirmer qu’il se sert des cymbales en s’interdisant d’y toucher - ce qui est assez difficile, mais c’est à comprendre comme le dit qui est exprimé dans le non-dit - quoi qu’il en soit, il n’accompagne pas les deux autres, il les raccompagne, même quand ils prennent des chemins séparés, il est en même temps et avec le loup et avec le petit chaperon rouge.

Sourire sardonique de Chino. Les doigts de sa main droite cerclés de fer se hâtent avec lenteur sur la grille de son presse purée. Et pourtant il est le guitaro le moins pressé du monde. Bottleneck sur sa main gauche, celle qui caresse avec nonchalance son manche. Pause pipi, toutes les trente secondes, et la foule se pâme et halète incapable de prévoir le moment exact où il remettra les gaz. Toujours une seconde après ce que vous aurez jugé comme le temps réglementaire. Attention parfois il s’énerve et tout y passe, un petit solo comme en trouve dans toutes les panoplies des guitar héros de la planète rock, plus tout ce qui lui traverse le cortex, un extrait de Carmen, une citation presleysienne, un refrain emprunté à Edith Piaf, une dédringolade d'escalier à la Django, et que sais-je encore. Avec lui le blues est un ogre qui avalerait le monde entier si on le laissait faire.

Chino chante, sans avoir l’air d’y toucher. Mais ne vous rate jamais. Incroyable mais vrai, voici qu’ il joue très sérieusement durant deux minutes sans s’arrêter. Mais il prend une mine désolée et coupe court sans plus de politesse. Vient d’Argentine, ne parle pas français, vous apitoie si fort que vous lui refileriez un bifton de cinquante euros rien que pour lui remonter le moral. Mais dans un incertain mélange d’anglais de fragnol, il nous explique qu’il a besoin de l’assistance, lui faut habiller sa chanson, lui donner des couleurs, pour en chasser le blues poisseux qui la dénature, bref il nous prie de faire les chœurs, comme dans les années soixante. Un sourire démoniaque auréole ses canines. Le ridicule n’a jamais tué le rock. Mais lui il le désosse. Massacre à la résonateuse.

Indolence naturelle. La classe. Chino And The Big Bet revisitent la musique populaire américaine. Vous font goûter aux spasmes des entrailles et aux affolements du cœur. Un boucher. Qui en bouche un coin à tout le monde. Rappels obligatoires. Chino vous livre un peu de son secret. A enregistré trois CD, tous trois nommés Six. Six-six-six. Le chiffre de la bête. Pas besoin d’en dire plus aux amateurs de blues, Robert Johnson en filigrane. Chino And The Big Bet puisent aux racines. Par pour en refaire d’identiques. Mais pour les ronger. Jusqu’à l’os. Et en retirer la substantifique moëlle. Celle qui permet d’emprunter les sentiers de la création. Are you experienced ? serais-je tenté de vous demander si vous ne les avez pas encore vus. Et puis ces cigarettes tenues avec l’élégance flegmatique d’un Mink de Ville...
FRENCH BLUES ALL STARS

Dernier groupe de la soirée. Classique. Le bon vieux blues électrique de Chicago, avec la crème des musiciens de blues français, notamment Stan Noubard Pacha à la guitare solo. Pas évident de passer après le Big Bet. Mais ils s’en tirent avec les honneurs de la guerre. Plus le bœuf final qui réunit un peu tout le monde. Rien de nouveau sous le soleil noir du blues, mais le public qui danse ne les laissera partir que bien tard.
Très bonne treizième édition de Blues In Sem. L’on peut partir tranquilles dormir sur nos deux oreilles. Rassurés, avec Chino and the Big Bet, le futur du blues commence à poindre.
Damie Chad.
( Message personnel : Je ne suis pas arrivé à retrouver au dernier moment la clé avec les photos prises par la divine Patou et Eric ! )
LA CAMONETTE IN CAMON
20 - 08 - 2014
JUKE JOINTS BAND

Un coup de chance inespérée. La teuf-teuf qui s’arrête auprès d’un platane de la charmante bourgade de Camon - Camon qui repose dans son nid de collines ariégeoises avec ses mille terrasses, sa roseraie, son château-abbaye, pas tout à fait le nombril du monde mais le paradis assuré des pécheurs, bref un village prospère au temps des dernières croisades, juste avant la guerre de cent ans et qui n’en finit pas de couler des jours paisibles, oublié de tous. Faut-il tourner à gauche ou à droite ? Point du tout une interrogation politique, simplement la recherche de la route la plus courte pour revenir à la maison, car quand l’aigle est blessé ne retourne-t-il pas vers les siens ? Je ne suis pas blessé mais c’est la copine qui pousse un cri, aurait-elle été transpercée par une des mortelles flèches de l’Eros Sauvage qui se manifeste dans les lieux sauvages et isolés propices aux abandons les plus lascifs ? Non ! ses yeux exorbités, son bras tendu, désignent une affichette bleue, les trois initiales sacrées, JJB ! Juke Joints Band, en concert, le lendemain soir, ici même sur le boulingrin ( pierreux ).

L'on arrive un peu en retard. Je ne vous dirai pas pourquoi. Sont tous au fond du parking. Un brouhaha monstre. Tous attablés, près de deux cents affamés, des jeunes, des vieux, des villageois, des touristes, des toute belles et des moins beaux, des serveuses qui courent partout de la cam(i)onnette où s'agitent les cuistots aux tréteaux gargantuesques, les plateaux recouverts de madrés de canard et de panini appétissants, fument les crêpières et se débouchonnent les bouteilles de rosé à tire-larigot, de gamins fendent la foule en poussant des hurlements sur leur vélos sans pédales.
JUKE JOINTS BLUES
C'est la cohue, c'est le tohu, c'est le bohu, et de sous la tente rouge posée face aux ripailleurs sort un potin infernal. Le Juke Joints Blues a sorti le grand jeu, au moins trois guitaristes qui rivalisent d'ardeur, je presse le pas pour assister à ce festival de guitares en folie. Furieuse. Tout faux. Sur toute la ligne. Ne sont que deux. Je précise, Chris le microphoneur, pardon le mégaphoneur, et Ben avec son acoustique. Electrifiée, certes. Mais enfin il ne faut pas exagérer. La fait sonner comme un orchestre à cordes endiablées. En fin de soirée, il avouera que le bout de ses doigts le brûlent. Pas la peine de demander pourquoi. N'est pas avare de fricassées d'ongles.

Pour le larynx de Chris, je n'ai pas eu de révélation. Je le subodore sanglant et en sale état. Car comment sortir autant de pierrailles et de ferrailles d'un simple gosier. Nous crache des sabres comme d'autres les avalent. Mais les siens sont ébréchés et rouillés. Rien qu'à les imaginer vous en trembleriez, mais à les entendre c'est une toute autre histoire, cimeterres de pirates qui vous hachent le blues menu menu pour mieux vous le transfuser par les oreilles. Glapissements de renard enfumé dans son terrier avec la meute des cordes de la guitare de Ben assoiffées de carnage qui aboient et hurlent à la mort. Mais le Chris il arrive toujours à s'échapper, l'on ne sait pas comment, par une de ses modulations barbaresques dont il a le secret, et il détale le museau au vent, hululant sous les étoiles, avec la horde canine à ses trousses. Fin du premier set. Sauvé par le gong.

Doivent aimer cela. Car ils y reviennent prestement. Pas le temps de vous ennuyer durant la mi-temps. Sont pressés. Pas de terminer mais de recommencer. Et Ben vous incendie les arpèges du blues comme si sa vie en dépendait, et Chris qui chante comme l'on prend une assurance sur la mort. Les tripes dehors et le coeur bouillonnant. Tourbillonnant. Un vibraphone en colère et en rut. La haine et l'amour en même temps. Quand l'un s'avance c'est l'autre qui se rapproche. Sont tous les deux au prise avec le fantôme du blues, celui qui court du delta à Chicago et qui ce soir tonne à coups de Camon.

L'est arrivé avec son ampli et sa valise à bouts de bras. C'est Thierry Kraft avec son éternelle étole de léopard sur le cou. Revient de vacances. Mais incapable de résister à aider les copains. S'installe pendant que les deux autres ramonent le rhythm and blues, cherche un micro, finira par se greffer sur celui de Ben – qui pousse de temps en temps une goualante de renfort pour soutenir Chris – et puis il farfouille dans sa valisette si longtemps que l'on oublie sa présence, et puis c'est comme une coulée de chantilly amère sur la tristesse du monde, un ourlet de larmes sur la désespérance de l'existence et il s'enfuit s'asseoir à la table d'une jolie blonde. Papillonnera ainsi, tantôt auprès de sa belle, tantôt l'harmonica sur le micro sur des tempos de plus en plus syncopés. Finira par se joindre à la touffe gesticulante de danseurs qui s'est formée.
Tandis que Ben et Chris poussent leur blues, comme Sisyphe son rocher, sur les crêtes soufrées du rhythm and blues. Le laissent retomber, le beau basalte bleu, le roc(k) azuréen qui mord, morceaux après morceaux sur nous, pauvre foule grouillante et extatique qui en redemandons toujours davantage, afin que chaque pierre roulante nous farine l'âme. Ca sonne comme les premiers Stones. Et je ne serai pas le seul à faire cette remarque la soirée terminée. Avant dernier concert de la tournée d'été de Juke Joints Band, la veille ils ont mis le feu à Mirepoix, un concert d'anthologie, que j'ai raté. On devrait leur interdire d'arrêter, ils sont trop bons.

J'en ai oublié Maëve, la serveuse, qui s'en est venue assurer le chant sur le Sittin' On The Dock Of The Bay, s'en est est bien sortie, faut dire qu'elle fait partie d'un groupe local Sun Fish dont je ne sais rien, si ce n'est qu'avec Maëve ils ont fait bonne pêche.
Damie Chad.
( Les photos ne correspondent pas au concert )
CHICAGO
TERRE PROMISE DE LA GUITARE SLIDE
JEAN-LUC TUDOU
( 154 pp / Avril 2014 / CAMION BLANC )
Un conseil d’ami avant d’ouvrir le bouquin, branchez-vous sur http://www.mixcloud.com/Galaxieslide ou alors sur www.rdautan.ffr, vous y trouverez la bande son qui va avec. C’est que Jean-Luc Tudou anime toutes les semaines une émission radio sur R d’autan ( que n’en emporte pas le vent ) consacrée à la guitare slide. Le samedi à 13 H 30.

Deuxième suggestion amicale, avant de lire prenez le temps de regarder les images. Je sais, généralement chez Camion Blanc les repros photos sont déplorables. Mais là ils ont fait un effort. Pas eux. Mais l’illustrateur Pascal Weiss. A donné une vingtaine de portraits et de scènes de genre, des symphonies en gris, qui attirent et retiennent l’œil. Si vous voulez la couleur, procurez vous le N° 16 de Le Fil Qui Chante, le magazine tarnais et gratuit de l’art de vivre quelque part entre Albi et Toulouse. Vous y retrouverez trois illustrations du livre mâtinées d’un rose puce maladif, d‘un bistre la carotte inquiétant. Un truc malsain à vous refiler le blues pour trois jours. L’esprit du blues capturé live au bout d’un crayon à sale mine. Des espèces de sépia être heureux existentiels.
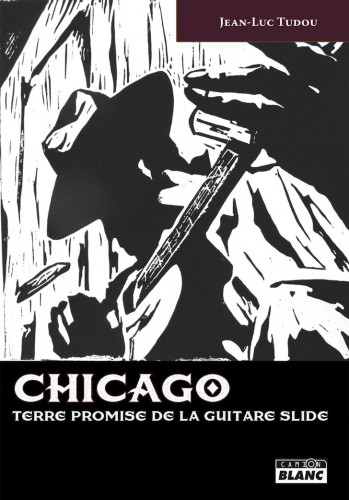
Jean-Luc Tudou est membre très actif de la Toulouse Blues Society qui fait beaucoup pour la propagation de la musique bleue en Midi-Pyrenées. Ce Chicago Terre Promise De La Guitare Slide est le troisième tome d’une trilogie qui raconte l’histoire de la guitare slide, dont les deux premiers fascicules sont en cours d’écriture et en attente d’édition.
COUTEAUX ET TESSONS
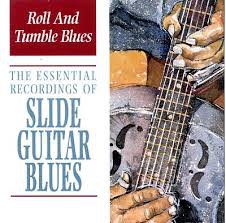
Saisissez-vous d’une bouteille par le goulot, cassez-la sur le rebord de la table et balafrez-en la gueule du gars en face de vous. Ne vous a peut-être rien fait, mais il a déjà le tort d’exister, alors pour lui apprendre à vivre, finissez de le tuer à coups de couteaux. Et pourtant rien n’est plus doux, plus poignant, plus plaintif que le son d’un couteau ou d’un goulot de bouteille qui glisse sur les cordes d’une guitare. L’archet du pauvre. Qui en a eu l’idée, le premier ? Le plectre d’Apollon sur la lyre ou un négrillon qui s’amusait à faire du bruit avec n’importe quoi sur un fil de fer tendu sur une clôture ou un mur ? Toujours est-il qu’un jour un, puis deux, puis trois, puis dix joueurs de blues - mais peut-être de simples songters sans exclusive prétention stylistique - se sont mis à faire un doigt à leur guitare. Ou à leur public. Cerclé de verre ou fer, l’index, le médium, ou le majeur, carapace de cristal ou armure de métal, à l’attaque des cordes, les prenant de revers pour les mieux entendre hululer à foison.
TAMPA RED

Lorsque l’on veut faire vite l’on attribue ( d’indien) l’invention du bottleneck à Tampa le rouge. L’on a toujours besoin de référence sacerdotale. C’est vrai que Tampa Red présente le profil idéal. N’a pas eu la malchance d’un Charley Patton ou d’un Son House, l’a pu enregistrer tout ce qu’il a voulu quand il a voulu. Les autres ont tiré le diable par la queue et il n’a pas été souvent propice en les temps préhistoriques du blues au rendez-vous discographique. Pour Tampa Red le sédentaire, ce fut en quelque sorte plus facile. N’a pas sempiternellement couru dans le delta, est monté très vite à Chicago, et a pu enregistrer entre 1928 et 1955 plus de trois cents morceaux. Une mine, un exemple.
Un technicien hors-pair, un des pères fondateurs du blues, mais d’un blues que l’on pourrait qualifier d’heureux. Cette chienne de vie ne lui a pas lancé quelques uns de ses plus féroces molosses au derrière. J’ai déjà parlé de ma déception aux premières écoutes de Tampa, un son trop grêle, certes en prêtant attention à ses arabesques l’on est obligé de reconnaître qu’il a un sacré doigté, mais il manque la lancinante complainte des vies perdues. Un Verlaine qui n’aurait pas rencontré Rimbaud. Un blues qui jazze un peu trop.
REFLEXIONS
C’est qu’une guitare toute seulette n’attire point trop l’attention et la tentation est grande de s’entourer d’une formation un peu plus étoffée, un deuxième guitariste, une basse et pourquoi pas quelques cuivres. L’orchestre de blues est une nécessité, c’est aussi l’occasion de la perdition. L’électricité arrivera à point nommé pour éviter les dérives par trop éloignées. Pour un certain temps.
Les premiers enregistrements de blues, Ma Rainey, Ida Cox et toutes les autres sont orchestrés, très loin de la rudesse des pionniers du delta. C’est souvent parce que l’on a rien que l’on s’investit d’une esthétique du dépouillement et de la pureté. C’est après avoir conquis le monde que les Romains ont abandonné sans trop d’hésitation leur légendaire sobriété de mœurs.
L’union fait la force. Dans un monde hostile mieux vaut être accompagné que solitaire. Dans le delta les chanteurs se regroupent. Si l’on peut établir sans trop de problème des filiations très précises c’est que le blues est une musique de cooptation. Les plus jeunes qui rêvent de prendre la route suivent les vieux routiers pour profiter de leur expérience tant musicale qu’existentielle. C’est avec de réelles connaissances que Jean-Luc Tudou redescend l’embrouillamini de ces filiations congéniales dont on ne mesure plus aujourd’hui l’importance. Un seul fil rouge pour ne pas se perdre ou s’égarer, pour apercevoir la lune noire du blues regardez d’abord le doigt entubé qui la désigne.
LA NUIT DU FAUCON
Suivre Robert Nighthawk accompagné de son cousin Houston Stackhouse qui navigue dans le delta. Il rencontre du beau monde Jimmie Rodgers, Charley Patton, Robert Johnson, Sonny Boy Williamson et même Muddy Waters qui plus tard le reconnaîtra comme un de ses pères spirituels, dixit Jean-Luc Tudou. Un personnage essentiel qui sessionna au côté d’un vétéran comme Sleepy John Estes et fit dresser l’oreille de Mike Bloomfield. Toute la trajectoire du blues, incarnée en une seule existence. Né en 1909, mort en 196?, il reste par bien des aspects un virtuose du slide lumineux, pas très éloigné de la lucidité apollinienne de Tampa Red.
ELMORE JAMES
Dionysiaque. Son Dust My Broom emprunté à Robert Jonhson qu’il côtoya reste une des plus grandes flambées de guitare jamais enregistrées. Hendrix a pu jouer des milliers de notes plus rapidement que lui mais sur aucun de ses chef d’œuvre il n’égalera la force primitive d’Elmore James, sans parler de cette voix grondante, impétueuse comme un torrent de montagne qui se précipite sur vous. Je considère comme une chance inconsidérée d’avoir acheté très jeune, par instinct, sans savoir qui c’était, ce disque. Torride initiation au blues. Elmore est mort comme il a vécu. Trop vite à quarante cinq ans. Elmore James, c’est la dernière station avant la rock city. Route directe. En pente. Sans freins. Jean-Luc Tudou raconte que Brian Jones se faisait prénommer Elmo. Dis-moi le nom de ton dieu et je te dirai ce que tu créeras.
MUDDY WATERS

On ne le présente pas. C’est Son House qui mettra Lomax ( voir KR’TNT 119 du 22 : 11 : 12) sur la piste du jeune Morganfield. Muddy Waters sera celui qui métamorphosera le vieux blues du Delta en Chicago Blues. La rudesse initiale teintée d’une plus grande violence, mais encore retenue. N’est pas tout seul pour cette transformation alchimiste, bénéficiera ( mais est-ce le mot juste ) du label Aristocrat devenu Chess et d’une pléthore de musiciens qui tels Little Walter et Jimmy Rogers n’attendaient que la venue d’un patron qui imprimerait une direction, de celles dont l’évidence s’impose à tous, après coup. Muddy Waters, c’est les Rolling Stones avec quinze ans d’avance… Ne vous affolez pas, à l’époque il était impensable qu’un simple noir puisse devenir une star mondiale. Se contentera de définir les tables de la loi, dont jamais personne n’osera faire tabula rasa.
LE CHAÎNON MANQUANT

L’arlésienne du blues, mais contrairement à l’héroïne de Daudet on ne voit que lui. Mais quand on s’aperçoit de sa présence, manque de chance, il vient de mourir. Assassiné. A deux pas de la route de la gloire. C’est du moins ce que l’on espère pour lui. Rien ne dit qu’il ne serait pas revenu à un anonymat des plus collectifs puisque partagés par tant d’autres. Au pire, une redécouverte par l’American Folk Blues Festival - un peu comme si vous gagniez le jackpot du loto à quatre-vingt six ans, ça fait toujours plaisir mais ça arrive un peu tard - au mieux une carrière à la Muddy Waters, la sensation d’avoir ramassé tout le coton dont des petits malins vont retirer les bénéfices de la vente.
Son destin - l’avait le visage d’un mari jaloux - en a décidé autrement, le seul à prendre la bonne route, celle du diable revendiquée. La mort c’est toujours plus romantique. Un peu embêtant aussi puisque vous ne pouvez pas faire demi-tour. Mais pas de regrets à avoir. En moins de quarante morceaux Robert Johnson a montré et démontré tout ce que l’on peut faire à la guitare. Un slide que l’on peut qualifier de diabolique.
N’a pas laissé des admirateurs derrière lui, mais des orphelins. Stupéfaction ! Avoir ignoré un si grand artiste ! L’avoir laissé croupir dans sa misère ! Pour éteindre le sentiment de culpabilité, l’on s’est intéressé à tous ceux qui l’avaient connu de près ou de loin. A la recherche du témoignage clef qui expliquerait tout. Comme s’il y avait quelque chose à déchiffrer ! Penché aussi sur les musiciens qui l’ont écouté et jammé avec lui, comme si par miracle ils nous auraient restitué en leurs parcours la future évolution avortée du maître fauché à vingt-sept ans.
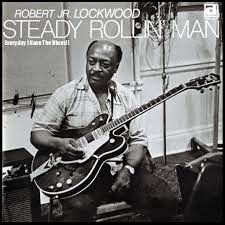
Jean-Luc Tudou s’attarde sur Robert Jr Lockwood, le neveu de Robert Johnson, qui accompagnera Muddy Waters, et qui deviendra une référence pour B.B. King et Elmore James. Puis Johnny Shines qui durant deux années fera route avec Robert Jonhson. Puis David Honeyboy Edwards présent sur les lieux du drame final qui accompagna aussi Charley Patton, Son House, Sonny Boy Williamson…
Il n’y a pas que Robert Johnson dans le blues. Elmore James eut aussi ses héritiers. William Henderson cousin de Sony Boy Williamson qui fut musicien d’Elmore et beaucoup plus connu, Hound Dog Taylor, qui sut se faire reconnaître par le public rock grâce à son slide virulent.
I HÂVE THE BLUES
Jean-Luc Tudou suit les carrières beaucoup moins connues de Earl Hooker, De Joseph Benjamin Hutto et de John Littlejohn. Des pages qui restituent tout un pan de l’histoire du blues laissé trop souvent dans l’ombre. Car déjà la lune du blues change de quartier et c’est son halo blanc qui commence à briller de mille feux. Ironie du destin, c’est un fils d’une honorable famille blanche qui va tout jeune se laisser dévoyer par les démons du blues. Mike Bloomfield adoubé à dix-sept ans par Muddy Waters. Caution morale exemplaire. Rappelons-le c’est Bloomfield qui tient la guitare lorsque Bob Dylan électrifie son folk à New Port en 1965, une date qui marque un tournant dans la longue saga du rock and roll. Mais peut-être l’écart était-il trop grand entre la ruralité de Sleepy John Estes et le foisonnement pré-Hendrixien, Bloomfield miné par un usage immodéré de la drogue perdra peu à peu cette flamboyance intérieure qui en fit l’enfant génial du blues. Meurt laminé à trente sept ans.

John Paul Hammond Junior suivra un chemin similaire à celui de son père John Hammond Senior qui fut le premier blanc à s’intéresser à Robert Johnson. Mais il arriva trop tard, après la bataille. Le fils se revendiquera toujours de cet étrange héritage en quelque sorte mort né et si le nom de Robert Johnson ne quitte plus les feux de la rampe depuis un demi-siècle il peut se vanter d’être un peu à l’origine de la perpétuation du mythe. Se mettra à la guitare mais à notre goût il est davantage un homme qui a plus fait pour le blues par son engagement que par sa musique. De grosses pointures comme Duane Allman, Jimi Hendrix et Eric Clapton croiseront sa route, mais il est davantage un catalyseur qu’un créateur.
Faudrait encore parler de Paul Butterfield l’harmoniciste et de Johnny Winter ce dernier, décédé à peine même pas un mois et demi, ce 15 juillet 2014 et à qui Michel Casoni, consacre une très belle nécrologie dans le Rock & Folk de septembre, une pierre tombale qui s’inscrit dans la lignée de ces stèles hommagiales à tous les grands du blues que mois après mois, depuis deux ans, Casoni s’emploie à ériger, afin de construire pierre après pierre une nouvelle histoire du blues.
ET APRES ?

Reste encore des grands noms comme Canned Heat avec Alan Wilson et Creedence Clearwater Revival avec John Fogerty, mais l’âge d’or jette ses dernières pépites. Chicago n’est plus la reine de la musique. Pas un orchestre de rock qui ne présente pas son morceau attitré à la guitare-slide. Un must transformé en gimmick. Dans leur grande masse les jeunes blancs d’aujourd’hui font comme les jeunes noirs du demi-siècle précédent, s’éloignent à leur tour du blues. Les conditions de vie ont changé. Le prolétariat est convaincu de ne plus exister. L’économie libérale l‘amuse et l’occupe avec cette misère intermittente qui se développe à de nombreux étages de notre société. Le blues a perdu sa charge émotionnelle et le rock son esprit de révolte… Musiques de niche où l’on se couche sans penser à montrer les dents et à mordre….
Par bonheur il existe encore des Jean-Luc Tudou pour ranimer les flammes. Tous les amateurs de blues et de guitare ont intérêt à se jeter sur ce livre qui regorge d’informations et qui dénote des connaissances encyclopédiques mais surtout une inaliénable ferveur envers la musique du diable et ses mélopées slidées. A lire absobluesment.
Damie Chad.
PS : lire aussi in KR’TNT ! 198 du 28 / 09 / 14, le bel article de notre Cat Zengler sur Johnny Winter.
22:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/08/2014
KR'TNT ! ¤ 198 : JOHNNY WINTER / BLOOMING TRACZIR / MORAND CAJUN BAND / PATHFINDERS / HOOP'S 45 / JUKE JOINTS BAND
KR'TNT ! ¤ 198
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
28 / 08 / 2014
|
JOHNNY WINTER / BLOOMING TRACZIR / MORAND CAJUN BAND PATHFINDERS / HOOP'S 45 / JUKE JOINTS BAND / STOP II |
ELEMENTAIRE, MON CHER WINTER
Les blazes du blues - 11e épisode
Johnny Winter chante le blues depuis un bon paquet d’années. Si on fait les comptes, ça doit bien faire 45 ans. Chaque fois qu’il sortait un nouvel album, j’allais l’acheter. Automatiquement. Il fait partie des gens qu’on suit comme un chien fidèle. Même encore aujourd’hui. Johnny atteint la barrière fatidique des 70 ans, mais aux yeux de tous ceux qui l’ont vénéré, il reste le grand Johnny Winter, le rocker flamboyant et le fils spirituel de Muddy Waters, le demi-dieu hermaphrodite fellinien et le junkie fantôme, l’allumeur de brasiers et le plus charmant des hommes.
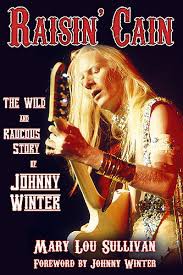
Oui, parfaitement, le plus charmant des hommes. C’est ainsi que le décrit Mary Lou Sullivan dans son livre passionnant, «Raisin’ Cain. The Wild And Raucous Story Of Johnny Winter». Johnny Winter aura passé sa vie à démontrer qu’on n’a pas besoin d’être brutal et atrocement con pour faire du rock et devenir célèbre. D’un côté, vous avez des gens comme Axl Rose, JJ Burnel et Sid Vicious, et de l’autre vous avez Johnny Winter. Comme le disait si bien Makhno aux prisonniers qu’il allait fusiller : «Choisi ton camp, camarade !»
Johnny l’albinos vit le jour à Beaumont au Texas. Son père John Dawson Winter Jr était originaire de Leland, Mississipi. Rien qu’avec l’acte de naissance, on a déjà une partie de la mythologie. Sa mère Edwina fut catastrophée à la naissance de Johnny. Dans le Deep South, on regardait les albinos de travers, comme les nègres. Ces pauvres cloches de médecins dirent à Edwina qui était de nouveau enceinte qu’elle ne risquait rien. Un autre albinos ? Oh, une chance sur un million. Et pouf, Edgar vint au monde, aussi albinos que son frère.
Tout petit, Johnny ressemblait déjà à une sorcière de Walt Disney. Mais la sorcière de Walt Disney allait grandir et tomber plus de filles que n’en tombèrent jamais tous ceux qui se moquaient de lui.
Le premier disque qu’acheta Johnny ? «Somebody In My Home» d’Howlin’ Wolf. Les dés sont jetés. Puis il s’offre «She’s Nineteen Years Old» de Muddy Waters et scelle ainsi son destin. Johnny apprend à jouer le blues en voulant jouer les notes de Muddy qu’il entend sur ce single Chess. Par ici, on faisait la même chose avec «Satisfaction» et «Gloria». Puis Johnny cassa sa tirelire pour s’acheter un premier album. Évidemment, ce fut le fameux «Best of Muddy Waters» sur Chess, celui que Jagger avait sous le bras la première fois qu’il rencontra Keith Richards sur un quai de gare. Puis Johnny tomba dingue de Jimmy Reed - «Nobody else sounded like Jimmy». (Personne ne sonnait comme Jimmy.) Johnny mit les pieds dans le plat de la mythologie. Grâce à Jimmy Reed, il intégra la notion de son. Il découvrit Clarence Garlow, un as du zydéco, qui lui apprit la technique de la troisième corde non tendue - unwound third. C’est à lui qu’il dédicacera son album «Guitar Slinger» en 1984. Johnny séjourna un temps à Chicago et s’extasia du style de Mike Bloomfield. Puis il devint pote avec Keith Ferguson, légendaire bassman qui joua sur les quatre premiers albums des Fabulous Thunderbirds. Keith et Johnny sont une sorte de condensé du mythe texan, comme l’était avant eux le tandem Mac Curtis et Ray Campi. Dans les jukebox de Port Arthur, on entendait surtout Little Walter, Muddy Waters, Lazy Lester et Jimmy Reed, comme le rappelle Uncle Joe Turner. Il parle bien sûr de l’époque où il rencontra Johnny pour monter le trio fatal, avec Tommy Shannon à la basse.

Ils démarrent avec «Progressive Blues Experiment», l’une des pierres blanches de l’histoire du blues électrique. Au moins, avec «Tribute To Muddy», les choses sont claires. C’est du vrai heavy blues avec du deep blue sea et des women fishing after me. Johnny fait le mannish boy des enfers. Il accompagne longuement le beat de ah-ah-ah et il revient à la rolling stone. Puis il embarque une version de «Help Me» sur un gros swing texan. Sa version est beaucoup plus musculeuse que celle d’Alvin Lee qu’on trouve sur le premier album de Ten Years After. Johnny taille sa route, high on the beat. C’est racé et puissant, et donc lourd de conséquences. Son «Mean Town Blues» est drivé au beat et son «Black Cat Bone», monté sur un swing extravagant, figure parmi les grosses pièces de blues moderne.
Paul Oscher jouait de l’harmo dans le groupe de Muddy, au moment où Johnny démarrait sa carrière : «Il y avait un tas de bluesmen dans le circuit à ce moment-là. Magic Sam et T-Bone Walker étaient encore en vie. Il y avait aussi Junior Wells, Otis Rush. Les blancs qui jouaient le blues, on les comptait sur les doigts d’une main : Paul Butterfield, Charlie Musselwhite, moi, Johnny Winter, John Hammond Jr, et Mike Bloomfield.»
Johnny essaye de signer un contrat en Amérique, mais c’est trop compliqué et il prend l’avion avec son pote Keith Ferguson pour aller démarcher les labels anglais à Londres. Mike Vernon de Blue Horizon se montre intéressé, mais finalement c’est Clive Davis de Columbia qui signe Johnny, l’emportant de peu sur Jerry Wexler qui voulait un albinos sur Atlantic. Et cet album mirobolant qu’est le premier album CBS de Johnny Winter sort en 1969. Willie Dixon participe à la curée. Et pour simplifier tous les problèmes administratifs, Johnny et ses amis enregistrent l’album à Nashville.

«Johnny Winter» s’ouvre sur «I’m Yours And I’m Hers», énorme de puissance texane. Avec sa voix de géant, Johnny prend la tête de la meute. Il joue un solo riche de mille variantes épouvantables en continu, coule d’une note à l’autre avec effusion, mais il y a surtout l’arrache monstrueuse de sa voix. Tommy Shannon et Uncle Joe fournissent le meilleur tapioca rythmique d’occident. «Be Carefull With A Fool» est le heavy blues de base, le modèle absolu, chanté avec rage. Johnny s’en va hurler certaines syllabes avec une classe impérieuse. Willie Dixon joue de la stand-up sur «Mean Mistreater». Version de choc. Et puis voilà «Leland Mississipi Blues», ah yeah, oh yeah, le blues rock des origines du rock. Véritable leçon de garage blues, pièce déterminante, Johnny double le chant à la guitare. Il invente le style gueulard doublé de phrasé singeur. Il accompagne chacune de ses errances vocales de lignes aigres et justes et reste dans l’excellence gutturale.
Johnny devient une superstar. Il tombe toutes les filles qu’il veut (comme Muddy : une régulière à la maison et des filles différentes tous les soirs en tournée). Et il se régale de toutes les drogues qui lui passent sous le nez «LSD and mescaline. I did everything. I liked mescaline and psilocybin mushrooms - they give you a nice high without makin’ you nervous or jittery like speed did. Mushrooms were the smoothest. I did ‘em a couple times a week.» Puis il passe à l’héro. «I snorted it for about a year before I started shooting it. I had no problem getting needles - you could buy needles in Texas at the drugstore. Red and Tommy started taking it same time I did.» (J’ai tout pris, du LSD, de la mescaline. J’aimais la mescaline et les champignons. On trippe mieux avec les champignons qu’avec le speed qui vous rend nerveux. J’en prenais deux fois par semaine. J’ai sniffé de l’héro pendant un an puis j’ai commencé à me shooter. Je n’avais pas de problème pour acheter des seringues. Au Texas, on les trouve dans les drugstores. Red et Tommy ont commencé en même temps.)

Arrive fin 69 l’un des plus grands disques de l’histoire du rock : «Second Winter». Pochette et photo intérieure signées Richard Avedon, le photographe le plus renommé de l’époque. Johnny : «I liked the posters Richard Avedon had done of the Beatles, that’s why I picked him.» (J’aimais bien les posters que Richard Avedon avait fait des Beatles. C’est pour ça que je l’ai choisi.) «Serve me right to suffer/ Serve me right to be alone/ You know I’m still livin’ a memory». C’est avec ces trois phrases qu’il attaque «Memory Pain». Chaque fois qu’il voit une femme, ça le fait souffrir - makes me think of mine - Lord I just can’t keep from cryin» - la basse de Tommy se balade tranquillement derrière. Voilà le Texas blues des enfers. «I’m Not Sure» est un énorme groove de basse. Tous les ingrédients de l’énormité du blues sont présents dans ce morceau. Johnny le héros percute inlassablement ses cordes. Toujours dans l’archétype du heavy sound, Johnny écrase le champignon avec «The Good Love» et va chercher de l’incroyable guttural. Le son remplit la carlingue. Johnny bat tout à plates coutures et Uncle Joe martyrise ses cymbales. Sur la face rock, il envoie une version de «Highway 61 Revisited» historique. C’est un vrai coup de génie. Johnny sonne comme Mike Bloomfield et Dylan à lui tout seul. Fabuleuse machine rythmique. Il semblerait qu’on n’en ait jamais vu d’aussi bonne. Tommy remonte sur deux ou trois notes et Uncle Joe bat la campagne. On est sidéré par leur classe démentielle. La troisième (et dernière face) est celle du pur génie. «I Love Everybody» est un morceau ultra-chanté - Well I’m goin’ to the South - et toujours cette énorme basse derrière. C’est le blues des guerriers commanches, le blues brillant et panaché. Aucun rocker ne peut sonner aussi bien que Johnny Winter. Il passe au boogie blues avec «I Hate Everybody», accompagné par un grand orchestre et Johnny le jazzman nous sort un jive de virtuose. Et puis voilà l’une des perles du siècle, «Fast Life Rider», joué dans l’esprit fife and drums. Uncle Joe bat le beat des collines qu’entendait Kenny Brown quand il était petit. Johnny joue le blues dans le fond du studio. Il s’envoie des zones d’écho. Reprise au thème. Don’t buy my ticket !
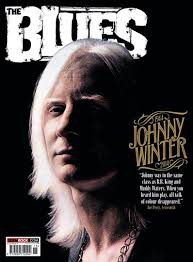
C’est grâce à Steve Paul - l’impresario du groupe - que Johnny rencontre Rick Derringer, alors leader des McCoys. Steve Paul les installe dans la maison voisine de celle dans laquelle il a installé Johnny et son groupe, à Staatsburg, à 150 km de New York. Steve Paul est un peu comme Andrew Loog Oldham : il a ses têtes. Pour lui, seul compte Johnny. Il se débarrasserait bien d’Uncle Joe et de Tommy. Ce n’est pas un hasard s’il a ramené les McCoys dans les parages. Ça commence par des petites jams informelles. Uncle Joe n’est pas dupe du petit jeu merdique de Steve Paul : «He was the kind of guy who always had a strategy, an underhanded strategy. He was a bit of an unsavory person.» (C’était le genre de mec qui montait toujours des plans en douce. C’était un type pas très sympathique.) Et crac, cette ordure de Steve Paul persuade Johnny de virer ses meilleurs copains. Uncle Joe et Tommy sont des gens bien. Ils pardonneront à Johnny. Tommy : «He is still my friend. Uncle John and I forgot about all of that.» (Il est toujours mon pote. Uncle John et moi avons tout oublié de cette histoire.)

La stratégie de Steve Paul est de conquérir le public rock et donc Johnny doit aller sur un son plus rock. «Johnny Winter And» annonce la couleur. Et quelle couleur ! À part un morceau, l’album est raté. «Guess I’ll Go Away» marque bien le virage rock. Johnny rentre dans le lard du rock avec une compo alambiquée pleine de rage texane. C’est une belle vacherie épaulée au phrasé de guitare, et suivie d’une belle envolée qui sent bon le génie wintérien. Johnny adore partir en vrille dans l’œil du cyclone. Puis le gentil Johnny accepte de chanter cette daube qu’est «Rock’n’Roll Hootchie Koo». Il revient ensuite à ses racines avec «Prodigal Son», mais la chose vire pop. Atroce. Il tente de revenir au blues hendrixien avec «Nothing Left» et au guttural avec «Funky Music» qui n’a rien de funky.
Soudain, c’est la frénésie : couvertures de Creem Magazine et de Rolling Stone, un album live bardé de reprises incendiaires de Chuck Berry, des fringues flashy, des boots et des bijoux, le superstardom à l’américaine et les stades remplis à ras bord. En 1970, Johnny se retrouve aux funérailles de Jimi Hendrix en compagnie de Miles Davis et de Buddy Miles. Et il devient ce qu’on appelle un full-blown junkie. «I felt terrible. Physically and mentally. You just felt bad, felt like nothing else would help to get you back on track but doin’ some heroin. You hated yourself. As soon as that started to happen, I wanted to get away from it, but I couldn’t get away from it on my own.» (Je me sentais misérable. Physiquement et mentalement. Tu te sentais si mal que rien ne pouvait plus t’intéresser à part le prochain shoot d’héro. Tu finis par te haïr. Dès que j’ai senti que ça commençait à mal tourner, j’ai voulu arrêter.) Alors, il décide de faire un break. Peu importe le temps que ça prendra, mais il ne veut plus continuer comme ça. Bobby Caldwell quitte le navire et monte Captain Beyond avec deux ex-Iron Butterfly et Rod Evans, le premier chanteur de Deep Purple. Rick Derringer entre dans le groupe d’Edgar. Seul Randy Jo Hobbs reste sur le pavé. Johnny passe neuf mois à l’hosto et il ne veut voir que ses vieux copains du Texas, Uncle Joe et Keith Ferguson. Pas question de voir la gueule des new-yorkais dont il commence à se méfier. Ils ont bien profité de Johnny, et s’il s’est retrouvé dans cet état-là, ce n’est pas un hasard. Le road-manager Teddy Slatus le gavait de cachets. Rick Derringer avait bien compris que Slatus piégeait Johnny. Mais personne ne pouvait intervenir. Johnny faisait confiance à Slatus.

Johnny fait une apparition sur l’album live d’Edgar qui s’intitule «Roadwork». Pas mal de bon funk et de grosses reprises de r’n’b sur cet album («Can’t Turn You Loose»). En fin de face B, Edgar annonce a little surprise for you tonight au public - hey Johnny et tout de suite, l’album prend de la hauteur, car c’est lui le boss, Johnny est l’un des géants du rock, ne l’oublions pas.

En sortant de l’hosto, Johnny reprend le collier et enregistre «Still Alive and Well» avec une nouvelle équipe. C’est l’un de ses meilleurs albums. Sa version de «Rock Me Baby» (créditée à Big Bill Broonzy et Arthur Crudup) est une version de rêve. Johnny l’embarque directement au paradis. Le groupe a changé. Randy Jo Hobbs joue de la basse et Richard Hughes de la batterie. C’est une version complètement diabolique. Johnny porte des bijoux. Il louche. Il a une classe folle. C’est lui le rock’n’roll animal. Todd Rundgren produit quelques morceaux. Avec Rock Me, on se trouve au cœur du rock blues texan le plus génial. Toujours du gros rock blues avec «All Tore Down» renversant. Il faut voir comment Johnny déchire sa voix pour fendre l’âme du fan. Il est l’un des seuls à savoir chanter avec autant de gras dans la voix. Johnny Winter est inégalable. On est cueilli au menton par un solo fulgurant. Deux reprises des Stones en face B : «Silver Train» (admirable) et «Let It Bleed» (sublime). Johnny gratte sa national pour jouer «Too Much Seconal», un vrai blues doublé à la flûte. Johnny raconte qu’il mélange le Seconal et le whisky. Aw.

«Johnny Winter And Live» est certainement l’album le plus connu de Johnny. Toutes les versions contenues sur cet album sont incendiaires. Son «Good Morning Little Schoolgirl» battu par Bobby Caldwell est fabuleux de désossé. Retour au blues avec «It’s My Own Fault» et fuck Steve Paul et ses stratégies de marché. Joli clin d’œil aux Stones avec «Jumping Jack Flash». Et puis, en face B, on tombe sur un medley connu comme le loup blanc et on chope une version endiablée de «Mean Town Blues». Johnny et ses amis sont littéralement possédés. Johnny tombe sur le râble du cut et le met en pièces. Tempo infernal, riffs descendants et pétaudière continue. Bobby Caldwell n’est pas toujours au carré, ça va trop vite, beaucoup trop vite. Le thème est très ardu. Johnny n’est pas un bricoleur du dimanche, t’as intérêt à te caler sur les huitièmes diminuées sinon t’es cuit. Oh, il n’est pas méchant, mais c’est qu’il est trop doué. Il joue technique avec naturel. On assiste à un duel de guitares avec Rick Derringer. Le petit Rick a les yeux cernés. Il porte un gros crucifix sur la poitrine. Johnny et lui semblent ranimer la flamme de «Deliverance». Johnny harangue l’esprit du blues - hey hey hey. C’est le morceau de l’album qu’il faut écouter. Tout l’art de Johnny s’y trouve dûment concentré : sa technicité texane et son goût pour les flammes de l’enfer et le guttural du diable. Prodigieux. Il faut l’entendre relancer la machine en multipliant les exercices de haute voltige.

Puis sort «Saints And Sinners», avec toute l’équipe Edgar/Derringer/Hartman/Caldwell/Richard Hughes. Johnny porte la barbe. Il reprend «Blinded By Love», un cut funk-soul d’Allen Toussaint, et en fait une version passionnante. Puis on tombe sur une version stupéfiante de «Thirty Days» de Chuck Berry. C’est troussé à la hussarde, c’est-à-dire au swing texan. On a là l’une des plus grosses reprises de Chuck de l’histoire du rock. Refrain de génie avec accélération et chorus énorme envoyé à la revoyure, et une ligne de basse qui remonte à contre-courant. Un modèle du genre. «Bad Luck Situation» est une compo de Johnny, bien rock et bien tapée, avec des yeah et des ouh bien sentis. C’est ce qu’on pourrait appeler du gros rock texan avoiné au phrasé boogie secoué.

Voulant toujours mieux capitaliser sur la renommée de Johnny, Steve Paul monte le label Blue Sky pour sortir un nouvel album, «Johnny Dawson Winter III», un album considéré comme l’un des plus faibles. Fort belle pochette. On retrouve les fantastiques Randy Jo Hobbs et Richard Hughes sur «Rock’n’Roll People» chanté avec la hargne habituelle. Ils forment tous les trois un trio infernal. Johnny semble au mieux de sa forme. C’est en écoutant «Self-Destructive Blues» qu’on réalise à quel point Johnny et Jimi Hendrix ont su réinventer le blues rock. Voilà encore une pièce énorme, embarquée à la texane. Johnny nous sort le grand jeu guttural et ça reste l’excellence des descentes riffées dans l’art de la tradition. «Raised On Rock» fait aussi partie des belles pièces de rock seventies, fabuleuses car enjouées, solidement charpentées et tenues par un refrain infernalement mélodieux chanté à l’unisson. Pure magie d’époque. «Mind Over Matter» est encore un cut d’Allen Toussaint. De la part de Johnny c’est à la fois judicieux et courageux. Johnny ne fait rien au hasard. Il traite ce groove funky de la Nouvelle Orleans au guttural. Puis on tombe sur un «Pick Up On My Mojo» solidement rythmé à la syncope. On entend rarement des choses comme celle-ci. On retrouve la puissance du trash-blues torrentiel habituel, mais monté sur une base funky. Extraordinaire.

C’est encore à Richard Avedon qu’on doit la fantastique pochette de «Together» qui réunit les deux frères. On trouve deux coups de génie sur cet album. Reprise de «Harlem Shuffle», le morceau fétiche de Vigon. Le guttural a rendez-vous avec la soul. Version superbe et imbattable. Puis ils tapent ensuite dans «You’ve Lost That Loving Feeling». Ils osent. Leur couleur vocale est différente de celle des Righteous Brothers , mais Edgar réussit à descendre dans son baryton. Ils essaient ensuite de grimper et atteignent leurs propres cimes. Pur génie. Ils tapent dans l’intouchable avec une fabuleuse différence d’approche.
Johnny commence à se lasser du rock. Au fond, ce n’est pas son truc. Il reçoit un coup de fil lui proposant de produire son héros Muddy Waters, alors c’est comme une révélation divine. Ça signifie pour lui qu’il est grand temps de revenir aux sources. Il se pointe à une répétition de son groupe et annonce tout simplement aux autres qu’il arrête tout.
Johnny n’a pas une très haute opinion des frères Chess : «I don’t think he (Muddy) had a good relationship with Leonard and Marshall Chess. He said Chess wasn’t doin’ a lot to promote his albums, and he didn’t make much money from his old records. He wasn’t getting the proper control and respect.» (Je ne crois pas que Muddy avait une bonne relation avec Leonard et Marshall Chess. Il disait que Chess ne faisait pas grand-chose pour la promotion de ses albums et ses vieux albums ne lui rapportaient pas grand chose. Il n’avait ni le respect ni le contrôle qui lui étaient dus.) Et ils s’embarquent tous les deux dans la fantastique aventure de l’album «Hard Again». Muddy : «This music makes my pee pee hard again, so I’ll name it Hard Again». (Cette musique me refait bander. Aussi je vais appeler l’album Hard Again.) Et c’est une fois de plus Richard Avedon qui fait l’image de couve. Muddy fut shooté avec les vêtements qu’il portait et ça s’est fait aussitôt. Comme le disque.
Johnny est content du résultat : «Those records made Muddy’s carreer happen again. bein’ affiliated with Columbia and Blue Sky helped - ‘cause he made the money he was supposed to make - instead of not getting the money like in the Chess days.» (Ces disques ont fait redémarrer la carrière de Muddy. Ça l’a bien aidé d’être en cheville avec Columbia et Blue Sky. C’est la grosse différence avec l’époque Chess où il ne ramassait pas un rond.) Et crac. Muddy et Johnny s’amusent bien ensemble. Muddy l’invite chez lui pour l’anniversaire de Koko Taylor. On aurait bien aimé être là, nous aussi.
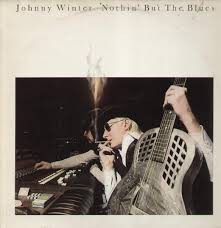
Johnny sort ensuite un pur album de blues, «Nothing But The Blues» avec l’orchestre de Muddy, James Cotton à l’harmo, Bob Margolin et Pinetop Perkins - «Better than a British blues band ‘cause the British stuff wasn’t real». (Meilleur qu’un groupe de british Blues parce que le british blues n’était pas authentique.) Mais Steve Paul n’est pas content. «Steve Paul didn’t particulary like me doin’ that but I had the power to do what I wanted.» (Steve Paul n’appréciait pas que je fasse ce disque, mais j’avais le pouvoir de décider de ce que je voulais faire.) Encore heureux ! Avec «Tired Of Tryin’», Johnny grimpe directement au paradis et ça s’entend. Voici une nouvelle leçon de maintien extraordinaire. «Sweet Love And Evil Woman» est du typical Johnny, boogie blues guttural et bien balancé. Blues de rêve avec «Everybody’s Blues». Quelle veine ! Il a derrière lui le meilleur orchestre du monde. Les vieux blackos sortent le grand jeu. Johnny ramène son gros guttural et ça devient énorme. Ce blues est bardé d’étonnantes atonalités. Ce sont les chœurs d’artichaut choo-choo qui provoquent le trouble. Pur chef-d’œuvre. Face B, on tombe sur un «Mad Blues» qui porte bien son nom, car swingué à l’excès. Willie Smith bat comme un diable. James Cotton ne lâche pas l’harmo. Ce sont des forcenés. Le boogie blues rôtit en enfer. Willie Smith bat ça exactement comme «Fast Life Rider». En plus il est devant dans le mix. Voilà un modèle d’incongruité bluesy.
Quand Johnny est interviewé à la télé pour parler des drogues, il provoque un petit malaise. Avez-vous un message pour les jeunes Américains ? Johnny réfléchit une minute et croasse : «Well, I’ve always thought anything that doesn’t kill you makes you stronger.» Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Censuré.

En 1978, Johnny entre de nouveau en studio pour enregistrer «White Hot & Blue». Bizarrement, l’album n’accroche pas. Il fait tout à l’ancienne, jazzifie un peu sur «Walking By Myself» et multiplie les variations de boogie-blues. En face B, on trouve reprise de Taj Mahal, «EZ Rider», mais les autres morceaux restent d’une grande banalité.

Dernier album paru sur Blue Sky, «Raisin’ Cain». Steve Paul arrête son label parce que ça ne rapporte pas gros - «There wasn’t any big money in it». Johnny connaît bien le côté rapace de son impresario : «He was making good money off of all us but he wanted big money. He wanted something huge. Selling almost a million copies, like the Beatles or the Rolling Stones.» (Il gagnait pas mal de blé sur notre dos, mais il voulait gagner beaucoup plus, vendre des millions de disques, comme les Beatles ou les Rolling Stones.) Johnny est toujours incroyablement enthousiaste. Son «Sittin’ In The Jail House» reste du boogie blues classique et sans histoires. Guttural et wintérisation des choses. Par contre, sa reprise de «Like A Rolling Stone» renoue avec l’inspiration. En face B se trouve une beau heavy blues, «Wolf In Sheep’s Clothing» bien classique. C’est tout ce qu’il sait faire, mais il le fait à la perfection.
Quand Johnny se rend aux funérailles de Muddy, il chiale comme un môme. «I was trying to talk to B.B. King and I couldn’t even talk to him I was crying so much. It hit me hard. I missed all the times we had recording together and getting to know him.» (J’essayais de parler à BB King, mais je n’y arrivais pas car je pleurais trop. Ça m’a tué. Les moments que j’avais partagés avec lui pour enregistrer et apprendre à la connaître me manquaient.)

Et puis Johnny se décide à virer Steve Paul et il demande à Teddy Slatus son road manger de devenir manager tout court. Fatale erreur. C’est aussi l’époque où Johnny commence à se faire tatouer. Les tatouages de son pote Keith Fergusson l’intriguaient. Et Spider Webb, le tatoueur de Keith, lui dit que tatouer une peau blanche comme la sienne, c’est un vrai rêve de tatoueur. Autre événement de taille : Johnny rencontre Bruce Iglauer, le boss d’Alligator, un label qu’il a créé à seule fin de sortir les albums de Hound Dog Taylor. Le premier album que Johnny sort sur Alligator s’appelle «Guitar Slinger». Mais la relation avec Iglauer est compliquée. On retrouve le boogie-blues de rêve avec «Don’t Take Advantage Of Me», monté sur une rythmique souple et ronde. Pour ce disque, Johnny a recruté Casey Jones et Johnny B Gayder qui ont accompagné Albert Collins. Là, on ne rigole plus. Toujours du heavy blues avec «Iodine In My Coffee» et un balladif passionnant en face B avec «Kiss Tomorrow Goodbye».

Il fait un deuxième album avec Iglauer, «Serious Business». On découvre avec une certaine surprise un gros son métallique sur «Master Mechanic». Comme à son habitude, Johnny y va de bon cœur. Il a une nouvelle section rythmique. Gros son bien sourd sur «Sound The Bell» et il fait sa sorcière de Walt Disney pour «Murdering Blues». Il soigne la tradition du heavy blues texan. On reste dans l’underground de la routine en face B avec «Unseen Eye» et on se régale d’un «Give it Back» bien poundé dans lequel Johnny se racle la glotte au sang.
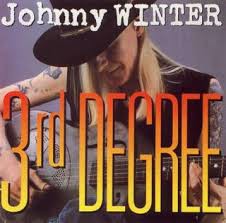
Un troisième album sort sur Alligator : «Third Degree». Et là Johnny tape dans JB Lenoir (reprise démente de «Mojo Boogie»). Il invite du beau monde, Doctor John et ses vieux amis Uncle John et Tommy Shannon. Cette vieille section rythmique fait merveille sur «See See Baby». C’est un bonheur que de les retrouver en compagnie de Johnny. Puis il dobrote «Bad Girl Blues» à l’ancienne. Il prend ses aises, yeahhh, turn around. Sur «Broke And Lonely», Uncle John fait sa locomotive. Brave ami.

Pour «Winter of 88», Terry Manning est engagé comme producteur. Manning est une figure légendaire de Memphis. Il a commencé comme ingénieur du son chez Stax puis a travaillé au studio Ardent. Il a produit des disques des Fabulous Thunderbirds et de ZZ Top. Mais Johnny ne comprend rien à sa technique de production. Manning demande à Johnny d’enregistrer des petits bouts de morceaux. Ils ne s’adressent plus la parole. «I never had a producer as bad as him. He knew exactly what I wanted but he didn’t want to do it. He was so bad. I almost got in a fistfight with him.» (Je n’ai jamais connu de producteur aussi mauvais que lui. Il savait exactement ce que je voulais, mais il ne voulait pas travailler comme ça. J’ai failli lui mettre mon poing dans la gueule.) L’incroyable de cette histoire, c’est que l’album est monstrueux. «Close To Me» est monté sur un heavy bass drum. Johnny opère un sacré retour en force, épaulé par des chœurs à la ramasse. Même si les ingrédients sont les mêmes, ce morceau force la sympathie. Johnny Winter reste le héros de nos quinze ans, avec une constance qui en impose. Il recherche en permanence le beat du blues. Sur la pochette, on voit le dragon qu’il s’est fait tatouer sur la poitrine. Il est à l’image de ce dragon. Il revient toujours. Nouveau heavy rock ardu et bien troussé : «Stranger Blues». On y va. On adhère. Johnny retrouve sa veine du bras. Il nous fait du grand Winter. Cut bien chanté, beat estimable. Un certain John Crampton bat le beurre et l’ami Jon Paris joue de la basse. Johnny envoie sa purée légendaire. Il a sa propre virtuosité. C’est un sacré furet. On le voit filer à l’horizon de la légende. Toujours du heavy blues avec «World Of Contradiction». L’héritage de Muddy est entre de bonnes mains. En face B se trouve l’excellent «Lightning», puissant, traité à la Bo Diddley, avec une basse pouet pouet devant toute. Il faut voir l’efficacité d’un tel processus d’explosivité. Avec «Show Me», Johnny se fait plus stonesy que les Stones.

Pour «Let Me In», tout se passe bien. Johnny embarque directement «Illustrated Man» au guttural. L’illustrated man, c’est lui, le tatoué - I’ve got tattoos everywhere ! Puis avec un petit coup de main de Dr John, il tape dans le «Barefooting» de Robert Parker. Puis il renoue avec la magie en attaquant «Blue Mood», un heavy blues de jazz joué à la corde pincée. C’est tout l’art de Johnny : il va là où les autres n’osent pas aller. Il joue comme Wes Montgomery - everywhere I listen to the music/ It drives me back to my homeland. Il joue comme un dieu sur tapis de stand-up. Ce mec a toujours été un génie et il en rajoute une petite louche destinée aux malheureux qui n’ont rien compris. Après 20 albums, Johnny Winter est encore capable de jouer un cut inspiré. Qu’on se le dise. Puis il s’amuse comme un fou avec le fameux «Sugaree» repris par Au Bonheur des Dames - Oh les filles, elles me rendront marteau ! S’ensuit un vrai blues rock végétatif intitulé «Medecine Man» et là, on tape dans le cœur de la mythologie du blues texan. Sacré Johnny, il va perpétuer la grosse tradition jusqu’à son dernier souffle, et rien que pour ça, il est admirable. Tous les pseudo-diggers qui creusent les seventies devraient écouter ça avant d’aller se faire soigner par un psy. Car toute l’effarence des seventies s’y trouve dûment concentrée. Avec «You’re Humbuggin’ Me», Johnny embarque son monde au gimmick, puis il arrive aussitôt au micro. Quel fabuleux cavalier. Il chevauche à fond de train. «Got To Find My baby» est un cut beaucoup plus ambitieux et syncopé à outrance. Il tire ensuite sa révérence à Jimmy Reed avec une belle reprise de «Shame Shame Shame» et boucle l’affaire avec une autre reprise, le «You Lie Too Much» de Dr John.
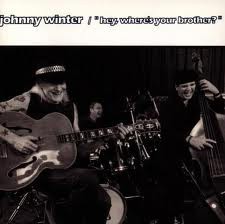
Il enregistre «Hey Where’s Your Brother» au même endroit et avec la même équipe. Pour être tout à fait franc, c’est vrai qu’on finit par ne plus suivre le détail des équipes. Il attaque en force avec une déclaration d’intention : «Johnny Guitar». «They call me Johnny Guitar !» Gros son, - I play rock’n’roll - on le sait, mais c’est toujours bien quand il le redit, des fois qu’on ait pas compris. Superbe et supérieur, admirable en diable, sacré Johnny, il sait rester en flux tendu, comme ses compères texans les Zizimen. Il ne peut pas s’arrêter comme ça. «She Likes The Boogie Real Low» : voilà encore une leçon de maintien extraordinaire. Il embarque ça au riff jumpy de jazz-band démentoïde et nous donne une pure leçon de swing. Puis on a un slow effarant qui s’intitule «Please Come Home For Christmas». Edgar vient chanter avec son frère. C’est une vraie perle, ce qu’on appelle un duo d’enfer. Ils sont très forts, capables des merveilles, comme on l’a vu dans l’album «Together». Leur version est monstrueuse, Edgar va chercher son falsetto et Johnny reste dans les graves. On a le même genre de magie que chez les Righteous Brothers. Avec «You Keep Sayin’ That You’re Leaving», on a le blues dégringolé de sa chaise. Johnny le chante, yeah, avec l’abandon du Texas. Il coule tout seul. Quelle misère de bonheur que de le voir s’écouler ainsi. Heavy blues à la ramasse avec «Blues This Bad» et swing à la revoyure avec «No More Doggin’», secoué par une rythmique de malades. Attention, cet album date de 1992, c’est-à-dire de 22 ans. Quasiment tous les morceaux de l’album sont exceptionnels, rudes, carrés et inspirés.
C’est Rick Derringer qui déclenche l’alerte. Johnny prend trop de médicaments et c’est cette ordure de Teddy Slatus, devenu alcoolique et tyrannique, qui le gave de cachets. En plus, Derringer accuse Slatus de détourner l’argent que gagne Johnny. Pour pouvoir rouler Johnny, Slatus l’affaiblit en le médicalisant à outrance. Il empêche même les gens de l’approcher. Pour Derringer et d’autres amis de Johnny, l’urgence va être de virer Slatus en qui Johnny a toujours une confiance aveugle. Slatus détient tous les droits et il paye un avocat pour veiller sur son business. Un journaliste qui ose provoquer Slatus déclare : «Teddy Slatus est un monster !» Edgar dit à son frère que Slatus est un escroc. Rick Derringer lui répète la même chose. Alors Johnny en parle à Slatus qui devient fou de rage. Il s’étrangle et frise l’apoplexie. Il ne supporte pas qu’on l’accuse de vol alors qu’il fait tout ce qu’il faut pour le bien de Johnny.

En voyant «Im A Bluesman» dans les bacs, on hésitait un peu. On craignait de s’ennuyer. Quelle grave erreur ! L’album est stupéfiant d’énergie. On saute en l’air dès le morceau titre de l’album, ça pète et ça pisse à tous les étages, comme dirait Gainsbarre - Cause I’m ready to play - c’est le Texas qui parle avec de gros moyens. Johnny Winter est toujours partant. Il reste un fabuleux entertainer. Heavy blues de luxe avec «Cheatin’ Blues», I can’t believe et compagnie. Heavy boogie avec «Lone Wolf» et retour au heavy blues avec «The Monkey Song» que Johnny chante avec la voix d’un vieil homme. C’est étrangement beau. Il joue un solo à la goutte de note et il repart en seigneur. Dans «Shake Down» il nous fait un solo étranglé - turn around/ Hit the ground/ Shake down no no no - ça sonne comme un hit. Johnny is the beast ! It’s the price to pay. Il prend «Sweet Little Baby» à la Chuck, mais comme c’est un carnassier texan, il réinvente. D’ailleurs, il réinvente en permanence. Il a derrière lui une grosse équipe, alors il en profite. Il finit par se perdre dans la virtuosité. Johnny Winter est l’un des très grands héros du rock américain. Avec «That Wouldn’t Satisfy», il sort le bottleneck du bord du fleuve et fait son génie du blues. Puis on tombe sur une monstruosité nommée «Sugar Coated Love», un boogie blues de Lazy Lester dément, pur boogie d’americana que Johnny embarque au guttural. Il veille au grain. Quelle panacée ! Et il termine ce fantastique album avec un stomp qui s’appelle «Let’s Start All Over Again», beau, dur et dressé, râpeux, rond et humide comme le gland d’un amoureux transi.

Le dernier album en date de Johnny s’appelle «Roots». Retour aux sources avec un album de blues classique et un peu ennuyeux. On y sent la fin de parcours. Pourtant, le son de l’album est bon. Mais on connaît toutes les ficelles de Johnny. On se réveille en face B avec une version stupéfiante de «Dust My Broom», raunchy et incroyablement raclée au chant. Ça sent le vieux bois verni, les vieux accords et les vieux doigts patinés par le temps.
C’est l’harmoniciste James Montgomery qui réussit à amener Johnny chez un médecin qu’il connaît. Le médecin demande à Johnny de vider sur la table le petit sac en cuir qu’il porte attaché au cou. Johnny s’exécute. Le médecin pousse un hurlement. Il n’a jamais vu autant de cachets ! De la méthadone et d’autres trucs en pagaille. Monsieur Winter, vous avalez tout ça tous les jours ? Mais ce n’est pas possible ! Mais si. Cadeau de cette ordure de Teddy Slatus. Johnny est aussitôt pris en charge par des spécialistes qui vont l’aider à décrocher du Risperdal et de la Klonopin. Onze ans d’addiction. Il lui faudra un an pour décrocher de ce traitement de cheval. Redevenu lucide, Johnny sera éternellement reconnaissant à James Montgomery de l’avoir sorti de cet enfer. Car il commençait à avoir de sérieux problèmes, du genre bloblote, ce qui n’est pas vraiment idéal quand on joue de la guitare. Puis Johnny finit enfin par comprendre que Teddy lui vole son blé. Alors il le vire et demande à son guitariste Paul Nelson de le remplacer. Ouf ! Le cauchemar s’achève enfin. Cette ordure de Slatus va mal finir. Un jour, ivre-mort, il tombe dans un escalier et se tue. On ne l’a même pas poussé.
C’est grâce à Paul Nelson qu’on a pu revoir Johnny sur scène en France. Un vrai miracle.
D’ailleurs, il devait revenir jouer au Havre le 29 novembre. On se frottait les mains. Mais il a cassé sa pipe en Suisse, dans une chambre d’hôtel. Johnny était en tournée. Il a failli mourir sur scène comme Molière et comme Mick Farren. La classe.
Signé : Cazengler, alias Johnny Wintare
Disparu le 16 juillet 2014
Johnny Winter. The Progressive Blues Experiment. Sonobeat 1968
Johnny Winter. Johnny Winter. CBS 1969
Johnny Winter. Second Winter. CBS 1969
Johnny Winter. Johnny Winter And. CBS 1970
Johnny Winter And. Live. CBS 1971
Johnny & Edgar Winter. Roadwork. Epic 1972
Johnny Winter. Still Alive And Well. CBS 1973
Johnny Winter. Saints & Sinners. CBS 1974
Johnny Winter. Johnny Dawson Winter III. CBS 1974
Johnny & Edgar Winter. Together. Blue Sky 1976
Johnny Winter. Nothing But The Blues. Blue Sky 1977
Johnny Winter. White Hot And Blue. Blue Sky 1978
Johnny Winter. Raisin’ Cain. Blue Sky 1980
Johnny Winter. Guitar Slinger. Sonet 1984
Johnny Winter. Serious Business. Alligator Records 1985
Johnny Winter. Third Degree. Sonet 1986
Johnny Winter. The Winter Of 88. MCA 1988
Johnny Winter. Let Me In. Point Blank 1991
Johnny Winter. Hey Where’s Your Brother ? Point Blank 1992
Johnny Winter. I’m A Bluesman. Virgin 2004
Johnny Winter. Roots. Sonobeat 2011
Mary Lou Sullivan. Raisin’ Cain. The Wild And Raucous Story Of Johnny Winter. Backbeat Books 2010
20 - 07 - 2014 / REALMONT ( 81 )
BLOOMING TRACZIR / MORAND CAJUN BAND
PATHFINDERS / HOOP’S 45

La teuf-teuf ronchonne, la pluie battante sur l’autoroute qui empêche toute visibilité, elle s’en moque, elle en a vu d’autres mais dès que l’on aborde les nationales du Tarn, une froide colère la ronge. N’ont pas inventé le fil à couper le beurre dans le département mais ils ont résolu le problème des vitesses excessives, limitation à 70 km / heure généralisée sur les derniers quarante kilomètres du parcours, crusin’ mais pas race with the Devil, ce n’est pas par ici qu’elle pourra jouer au Hot Rod Gang.

Dix-septième festival Re’ Al Croche de Réalmont, trois jours - c’est la programmation du dernier qui nous séduit - dédiés aux musiques que l’on aime, Rock, Country, Blues, Rockabilly, Cajun. Realmont bourg typique du midi-pyrénéen, sa place entourée d’arcades, ses longues allées bordées de platanes. Le festival s’étire en longueur, trois cents mètres de comptoirs sans interruption sur votre droite, boutiques de fringues et d’accessoires divers sur votre gauche, avec disquaire spécialisé en bout de chaîne. Deux scènes. La plus grande inutilisable car la pluie de la nuit s’est infiltrée dans les prises électriques, et scène d’appoint pratiquement en début du mail sur laquelle se dérouleront les concerts de cette fin d’après-midi et de la soirée.
Attardez-vous sous la halle couverte du marché. Squattée par une impressionnante flottille de Cadillacs, Chevrolets et Pontiacs. Uniquement des gros modèles. Des tanks, des paquebots, des mastodontes de quinze mètres de long, à croire qu’en région parisienne les collectionneurs qui paradent dans les diverses manifestations teuf-teuf vintage américaines ne possèdent que des répliques en modèles réduits Dinky Toys.
BLOOMING TRACZIR
J’arrive pile-poil lorsque les Blooming Traczir entament leur show. Du blues rock bien appuyé qui tache. Sans prétention mais du solide à toute épreuve. Meubles de jardin qui peuvent passer quinze hivers dehors sans en être affecté. Le vernis ne craquèlera pas, aucune éraflure possible. Inaltérables. Pas prétentieux pour une clef de sol, des ados de quarante printemps qui continuent de jouer leur rock garage sans se poser de questions existentielles sur la survie des dinosaures. Ils aiment ça et nous aussi. Des gens qui restent fidèles à leur rêve et qui reprennent pour la quatre centième fois le You Really Got Me des Kinks sans tergiverser. Aucune hésitation, aucune surprise. Un super guitariste qui vous débite ses soli comme un charcutier ses tranches de mortadelle, faite maison, premier choix, garantie bio. Plus les trois autres acolytes qui lui affûtent les couteaux. Un regard sur les jambes de la chanteuse qui assure en toute simplicité, en toute efficacité.

L’on aimerait davantage, du trashzir, du bloom-dooming, de l’esbroufe et du glamour. Mais non ce sont des fantassins du rock. De cette piétaille indispensable aux victoires des généraux. Mais ici, il manque un stratège aux plans audacieux. Sont applaudis pour leur vaillance mais les spectateurs auraient aimé assister à quelque haut-fait d’arme. Z’ont les bases mais comme aurait dit René Char il leur faut maintenant rechercher le sommet.
MORAND CAJUN BAND

Nouvelle-Orléans. Respect. Toute la musique que nous aimons vient de là. Enfin une partie. Le jazz plutôt, mais le rock a aussi d’autres racines dans les Appalaches et le haut du Delta. Ne cherchons pas le Bâton Rouge pour nous faire battre. Car pour le Morand Cajun Band il n’y a pas photo, sont prêts à crier toutes les cinq minutes Lafayette nous voilà. Le cajun français vit actuellement un renouveau. Historialement logique puisque à l’origine la Louisiane, allons z’anciens enfants de la patrie, flon-flon et cocorico. Dans l’insouciance des gaies musiques de la lointaine acadie doit demeurer un ancien fonds franchouillard, agréable aux narines de quelques uns de nos contemporains.

Bons musiciens, zique entraînante. Sauront se tirer d’une situation difficile lorsque l’électricité claquera. Ni une ni deux, violon en tête, percus et guitares descendront de scène et s’en viendront faire un tour parmi les spectateurs, frappent des mains, escaladent les tables de la buvette, se taillent un franc succès et se retrouvent devant leur micros à l’instant précis où la fée électrique daigne revenir.
Sympathique. Connaissent leur boulot. Dommage qu’ils se sentent obligés de présenter chaque morceau en spécifiant à chaque fois que celui-ci a été écrit trois, quatre, dix ans avant tel standard du rock and roll. Entre parenthèses les similitudes ne sont pas aussi évidentes qu’ils le prétendent. Mais ce n’est pas le plus important, la musique populaire américaine n’est qu’une vaste entreprise de recyclage, cette particularité est l’essence même de sa singularité, tous genres confondus, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les modes et de renaître sempiternellement de ses cendres. L’on garde la viande ou le poisson mais on invente une nouvelle béchamel et comme dirait Hank Williams avant de repasser le bébé country aux rockers, en avant le gumbo.
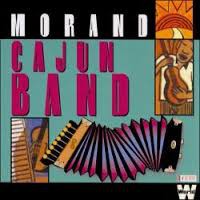
En plus quand on cherche la petite bête au rock and roll, on la trouve. Le cajun est une excellente musique de danse, fun, fun, fun, comme chantaient les Beach Boys sur les plages de l’insouciance sixties. Mais le rock and roll s’est vite chargé du bruit et de la fureur de son siècle. Certes à ses débuts un aspect danse de salon plus ou moins acrobatique, mais s’est aussitôt teinté d’une dramaturgie existentielle très éloignée des joyeuses exubérances de nos modernes amateurs de cajun. Z’ont repeint l’âme noire de leur musique en rose pimpant. Le rock and roll a choisi au contraire de noircir le bleu originel tout en le soulignant de longues trainées sanglantes. De la physique des corps à la métaphysique du métabolisme.
Agréable. Mais je les laisse partir sans regret. Le bonheur de la phalange d’amateurs de danses countries - étrangement une majorité d’individus du sexe mâle - qui n’ont pas raté un seul rigodon. Increvables. Infatigables. A plus amer, vont nos rêves, dixit Saint-John Perse.
PATHFINDERS ( I )
Mois de juin décevant. Il se murmurait que les Pathfinders feraient un concert en région parisienne en cette période pré-vacancière. J’ai eu beau envoyer mon âne de sœur sur la plus haute tour, l’on n’a rien vu venir. Pas même un peu de poussière poudroyant sur le sentier de ses découvreurs. J’avais adoré leur premier CD ( voir KR’TNT 174 du 30 / 01 / 14 ) mais une question ne cessait de me turlupiner. Comment font-ils ! Et peut-être même Comment font-elle ? Le disque super, un des meilleurs scuds cent pour cent rhythm and blues enregistré en ce pays - peut-être même le meilleur mais à ce niveau là, les premières places c’est au centième de seconde près. Oui, mais lors de l’enregistrement ils avaient bénéficié d’une locale et superbe formation de cuivres. Comment Lil'lou se débrouille-t-elle en concert pour poser sa voix sur son minuscule rock and roll trio, me demandais-je. Facile de mener la charge lorsque derrière vous les canonnières aplanissent le terrain. Mais sans artillerie d’appoint qui déblaie le chemin, comment s’y prend-elle ? Le problème me hantait mais je ne parvenais pas à résoudre l’équation.
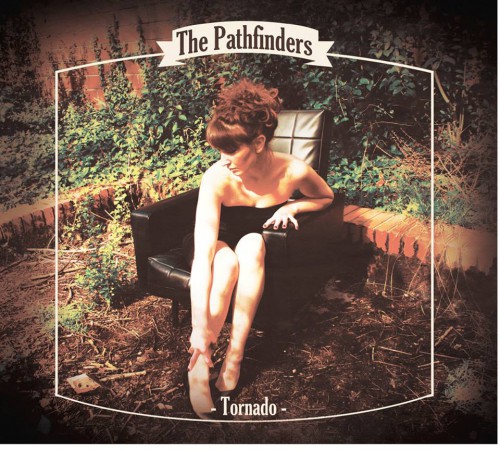
J’ai regardé rockarocky une dernière fois avant de partir pour l’Ariège, tiens les Hoop’s dans le Tarn, le 20 juillet, deux heures de route, je leur ferai la surprise. C’est en cherchant des renseignements sur ce bled perdu de Réalmont que je suis tombé sur le programme du festival. Enfer et damnation ! Non seulement il y a les Hoop’s mais en plus ils ont programmé Patfhfinders juste avant. C’est-ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups de bol ! Il en faut peu pour faire le bonheur d’un rocker.
PATHFINDERS ( II )
Je décompte sur mes doigts. Un, deux, trois. Guitare, basse, batterie. Pas un de plus, pas un de moins. Tous les trois seuls sur la scène. Dans les coulisses latérales, à la vue de tous, il y a bien un saxophoniste d’appoint qui tourne en rond comme un lion en cage en mordillant son instrument, talonné par le taon de l’impatience, mais pour le moment il ne compte pas. Une instru enlevée mais que je qualifierai de débonnaire. Un tempo souple aux forts relents jazzy et pouf, trente-cinq secondes après, sans préavis - l’on a bien vu Lil'lou surgir de l’escalier dans sa robe à fleurs, mais l’on ne s’est pas méfié - d’entrée de jeu à la seconde où tout sourire elle s’empare du micro, c’est Hiroshima mon amour. Explosion atomique.

Vous parle pas des musiciens. Il n’y a pas deux minutes c’étaient d’inoffensifs promeneurs, vous les auriez engagés les yeux fermés pour le cours de danse charleston de votre fille, et maintenant un gang de tueurs en série. Le plus méchant avec sa coupe rockab fifties c’est Guy le soliste, vous enfonce le couteau dans le ventre puis il tire et vous arrache consciencieusement dix mètres d’intestin tout en filant un solo sans fin à vous découper en l’œsophage en rondelles. Le plus brute c’est Baptiste, le batteur qui frappe sans discours mais avec méthode. Vous assène des coups vicieux comme si vous étiez son sparrin-partner préféré. Aucune surprise, pas le genre à surgir par derrière, ça tombe toujours à l’endroit précis où vous attendez l’onde de choc, vous aimeriez lui échapper mais il vous rattrape et vous passe à tabac sans ménagement. Enfin l’autre, le plus traître s’arrange toujours pour s’abriter derrière la silhouette de Lil'lou, se cache derrière une fille, vous ne le voyez pas mais il vous dézingue de ses cordées de basse qui vous broient les jambes comme les bolas des gauchos argentins qui s’enroulent autour des pattes des autruches.

Des mauvais garçons. Qui donneront le mauvais exemple à notre saine jeunesse. Enfin à ceux qui espèrent devenir de jeunes cadres dynamiques. Comme si ça ne leur suffisait pas de dégager une onde sonore phénoménale, passent le plus clair de leur temps à tirer voluptueusement sur leurs cigarettes. Au début ils ont interloqué le staff des danseurs de country, mais au troisième morceau ils se sont aperçus que ces trois enfants du chaos n’étaient pas les fils du désordre, fournissaient une musique charpentée et ordonnée. Nul besoin de ponctuation cuivrée pour indiquer l’armature des morceaux, procurent à Lil'lou les lourdes draperies dont elle a besoin pour vêtir son chant. La preuve étant faite que les Pathfinders n’ont nul besoin de fanfare cuivrée pour leur set, l’on permet à Sylvain, l’invité surprise de la dernière heure, de monter sur scène avec son saxophone rugissant.
Voilà, vous en savez assez pour comprendre la rutilante puissance de ce groupe. Je vous quitte. El l’on passe aux Hoop’s. Comment ? J’aurais oublié quelqu’une ? Ô pauvres humains remplis d’illusion fraternelles, vous croyez donc que le plaisir de voir Lil'lou se partage ? Non, jamais ! Enfin puisque vous insistez et que je suis dans mon jour de grande bonté, voici la fin de l’histoire. Que vous ne méritez en aucune façon.

Nous en étions donc au début lorsque la bombe atomique a éclaté. Comment de ce mignon petit être de chair à l’apparence si fragile peut-il surgir un tel grondement apocalyptique ? Mystère de la nature. Debout devant le micro, seuls ses bras bougent, mais l’on sent l’énergie sous pression qui traverse son corps, emplit ses poumons, souffle en tempête sur ses cordes vocales et s’exhale de sa gorge comme un cri tumultueux de libération. I Want Some More, My Wolf, les titres parlent d’eux-mêmes et sont profession de foi, davantage de la vie, davantage de sauvagerie. Une voix rhythm and blues et un phrasé rock, puissance noire et sapience blanche intimement mêlés, Lil'lou opère cette impossible transfsion. N’arrache pas les mots à la Little Richard, les propulse à la Tina Turner - car c’est à ce niveau de qualité que les comparaisons doivent être établies - plus femelle qu’Amy Winehouse et plus instinctive qu’Etta James. Quelques mots au public pour reprendre souffle et « Venga ! Venga ! » elle repart en courant se mesurer avec le taureau noir des soulsisters américaines. Jusqu’aux danseurs qui s’aperçoivent que quelque chose est en train de se passer et qui pour la plupart arrêtent leurs quadrilles pour écouter. La foule se masse devant l’estrade fascinée par cette bête de scène, ce dragon lanceur de flammes en éruption. Woodoo Woman, Bury My Love, Tornado, chaque morceau comme autant de fournaises rougeoyantes, l’on se dirige avec regret vers la fin du set. Les passages sont minutés, mais l’organisation craque et l’on aura droit à trois rappels. FABULIL'LOUSA !
Fin de la partie. Ovation triomphale. Les Pathfinders se partagent les tâches. Les garçons font le ménage, ils rangent leur matos et Lil'lou tout sourire, toute fraîche comme si elle venait de lire le journal, vend et signe des CD à la pelle. Peut être fière d’elle. Un concert mémorial.
Pour sûr, les Pathfinders ont trouvé le real and pure sentier du rock and roll !
HOOP’S 45
Pas facile de passer après the voice. Mais les Hoop’s montent sur scène le sourire aux lèvres. Demandent juste trois minutes pour quelques réglages de sono. Nous pondent tout de go un bijou de précision extrême un petit Oh ! Boy ! parfaitement en place. Le présentateur résumera la situation en peu de mots : « Un groupe qui fait une telle balance sur un morceau de Buddy Holly ne peut pas être tout à fait mauvais ! » Frémissement dans le public, l’on sent qu’il y a des connaisseurs dans la place. Fin de soirée, toute une partie de l’assistance familiale de l’après-midi a ramené les gosses à la maison mais il reste un fort contingent d’amateurs en symbiose totale avec la musique proposée par les Hoop’s.

Et puis sur cette scène pro il y a le son, rien à voir avec le sympathique concert dans l’étroitesse du resto de Montreuil ( voir KR’TNT ! 196 du 03 / 07 / 14 ). De la première à la dernière note, les Hoop’s survoltés survolent. Un set de rêve. Tous en grande forme. Kévin sous son chapeau et à la batterie ne bride plus ses coups. Franchement et toute la gomme. Pousse au rythme comme d’autres au crime. Pas un frappé qui ponctue, mais qui glisse et entraîne, slippin’ and slidin’ dirait Little Richard dont les Hoop’s reprennent comme par hasard Long Tall Sally et Rip It Up, une frappe rapide et courte comme s’il était urgent de ne pas s’arrêter, de ne pas s’appesantir sur le temps, de provoquer une espèce de battement hystérique d’un cœur qui se dérègle. Le Twenty Flight Rock d’Eddie Cochran interprété en second morceau s’avère être le parangon de cette prestance rockabilly qui joue sur l’urgence et la suffocation.
Le mec aux manettes derrière sa table de mixage ne doit pas être né de la dernière pluie. J’ai rarement entendu une guitare rythmique vibrer aussi impérieusement dans un concert. Pas question pour elle de servir de bruit de fond ou de faire tapisserie. Elle sonne, elle colorie, elle impose et implose cette rapidité flamboyante qui est la marque fondamentale du style des Hoop’s. Steph en est comme libéré, peut se consacrer au chant. Et il envoie méchant. L’est en train de carburer sur Mystery Train lorsque Lil'lou qui trépigne dans le public me demande à l’oreille si je crois qu’elle peut le rejoindre sur scène. Si je crois ! Elle y va, elle y court et elle y vole. Et nous laissons faire notre reine. Moment de rêve, Lil'lou et Steph se partagent les couplets, chacun gardant son style, tous deux éblouissants, une illustration merveilleuse de la transmutation qui s’opéra dans les studios Sun grâce à Elvis, comment le rhythm and blues noir passa le témoin au rock and roll blanc. Pas question d’arrêter le convoi à la première gare. L’est des plaisirs et des moments de grâce qu’il convient de faire durer. Max vous prend sur sa bolid Gretsch de ces tournants en épingle à cheveux à vous faire remonter l’estomac dans la boîte crânienne et Richard entreprend de se jeter à sa poursuite avec sa basse trucker, pour un peu l'on se croirait dans Duel de Spielberg. Lil'lou en profite pour s’éclipser, pas folle la guêpe elle vient de scier les câbles du frein, aux Hoop’s de se débrouiller.

Ca n’a pas l’air de les inquiéter, non seulement ils ne cherchent pas à ralentir mais ils accélèrent. Richard ouvre le bal sur Stray Cat Strut, le chat fou qui au trentième étage ondule sur la gouttière branlante, c’est lui, tempo félin, les yeux fermés, ne joue pas avec ses doigts qui se sont transformés en griffes rétractibles, de temps en temps Max lui lance une souris électrique à toute vitesse entre les pattes, ce qui ne l’émeut pas plus que les miaulements de désespoir que s’amuse à pousser Steph, un truc à alerter la SPA. L’en faut plus pour déranger matou Richard dont la basse chaloupée nous fait ronronner de plaisir. Ce n’est pas terminé que l’on change de décor. Bagarre générale, pas à O.K. Corral mais au King Creole, Horions à tous les horizons, Richard balance des uppercuts par-en dessus, Max la menace vous enfonce trois ou quatre crans d’arrêts dans le dos, tandis que Kevin distribue les coups de massue sur la tête. Quant à Steph s’énerve vraiment et il gagne par KO technique chaque fois que sa voix explose sur le refrain.

De drôles de manières de calmer l’ambiance, Memory, tous les zombies de la terre se donnent rendez-vous autour de votre tombe, Un Gene And Eddie en grande pompe distribué savamment à coups de savates, celle-ci en plein dans le plexus pour Cochran et celle-là dans le buffet pour Vincent, mais déjà retentit le riff démoniaque de Summertime Blues. Un titre qui devrait être déclaré patrimoine mondial de l’humanité. Un appel à la transe que la foule reprend en chœur. Plus tard ce sera My Baby Left Me ce blues désabusé d’Arthur Crudup qu’Elvis avait transformé, dix ans avec les Stones, en revendication érotique de toutes les frustrations adolescentes. Presley, Cochran, Stray Cats, c’est entre ces trois phares baudelairiens du rock and roll que les Hoop’s 45 ont installé leur camp de base, un vieux fond de blues survitaminé à la nitroglycérine, une infernale rythmique sans cesse s’échoïfiant dans la reprise du même pattern, sans cesse opérant cette traversée du gué qui nous mène de la rive du même au rivage de l’autre par la grâce opérative de ce sempiternel retour reptilien qui ne se mord jamais la queue, et une volonté affirmée de faire voler tous les clichés établis d’un rétro-revival enfermé en d’étroites limites répétitives au profit d’une modélisation d’un son qui tout en respectant l’essentiel d’un héritage incomparable en redéfinit les contours pour les mieux approprier à notre époque. Toute la différence qui existe entre les reprises et un répertoire. Ce dernier terme à mettre en relation avec par exemple la musique classique pour reprendre un concept de Patick Eudeline. Tout cela traduit par la guitare de Max intensément électrique qui pousse Richard à s’aventurer dans des lignes de basse de plus en plu acrobatiques.

Un Ubangi Stomp aussi délirant que les descriptions des forêts américaines par Chateaubriand, les Hoop’s sont lancés dans une danse sauvage et échevelée, la fin du concert sur les chapeaux de roue, l’assistance prise de tremblements hypnotiques, si ça continue nous allons devenir tous fous. Z’en rajoutent une pincée avec une pincée d’un Johnny qui n’a jamais été aussi bon que ce soir-là, attention surchauffe générale. L’est sûr que les durites de notre cerveau vont éclater, mais Zeus tonnant, ami des rockers, le dieu des orages électriques, fait preuve de son infinie magnanimité en nous épargnant d’irrémédiables dommages. Une pluie fine et froide commence à tomber. Les rappels en seront écourtés, deux misérables morceaux alors que c’était parti pour durer jusqu’au petit matin. Ah ! Mes amis ! Quel concert ! Vous n’y étiez pas ? Et vous n’avez pas honte ! Vos petits enfants vous le reprocheront sur votre lit de mort.

Réalmont, Pathfinders, Hoop’s 45, j’y étais.
Damie Chad.
( Les photos glanées sur le net ne correspondent pas aux concerts )
CLERMONT ( 09 ) / 25 - 07 - 2014
LE SOULEILLA / JUKE JOINTS BLUES

L’a fallu faire demi-tour, la teuf-teuf y était passé devant sans que l’on s’en aperçoive. Au fin-fond du séronais, un paysage de rêve, des pentes herbeuses peuplées de vaches rêveuses, de sombres forêts à flanc de coteaux, le départ d’une voie romaine pour on ne sait où, la splendeur des pré-pyrénées en fin de journée ensoleillée. Peu de monde, de rares habitations, nous ne sommes pas loin du Mas d’Asil où se déroulaient les aventures de l’agent des Services Secrets su Rock and Roll dans notre feuilleton de la rentrée dernière ( voir KR’TNT ! des numéros 155 à 166 ).

Le Souleilla ( pour vous conformer aux incongruités de la graphie occitane vous prononcerez Souleillo ) sis en un croisement à trois pattes. Une ancienne école transformée en bistrot culturel. Un pari risqué, ouvert depuis le cinq avril mais déjà riche pour ce seul mois de juillet d’une dizaine de dates, musique et théâtre. L’on y fait feu de tout bois, épicerie fine et de première nécessité, viande et repas végétariens, brocante échangiste tous les dimanches après-midi, du miam-miam à vous pourlécher les babines, un accueil familial et chaleureux avec chaton fou et border-collie câlineur. Le rêve de tous les countries boys de France et Navarre.

Programmation mensuelle un peu axée sur l’Amérique du Sud, nous n’avons rien contre mais aux condors qui passent par-dessus les hauts sommets andins nous préférons de beaucoup les bleus moustiques du delta qui possèdent cette nocive particularité de vous trouer sans pitié et sans regret l’âme et la peau. Bizarrement ce soir est signalée à proximité des eaux truiteuses de l’Arize la dangereuse présence d’un unique et inquiétant représentant de la faune insectiale locale en lequel par on ne sait quel mystère de mimétisme animal se seraient transplantés les gènes infectieux de ces crotales volants mississippiens. Les entomologistes distingués l’ont savamment étiqueté du surnom latin de Jukus Jointus Bandus que nous désignerons par la seule nationale traduction franchouillarde autorisée : The Juke Joints Blues.
JUKE JOINTS BLUES

Sont trois. Même pas besoin d’être quatre comme les chevaliers de l’Apocalypse. Damien Papin à la contrebasse. Ben Jacobacci à la guitare. Chris Papin au chant. Pourrait faire au moins semblant de tapoter de temps en temps un tambourin, mais non il se contentera de chanter. Doit avoir une sacrée confiance en ses deux acolytes pour faire par derrière le raffut nécessaire sur lequel appuyer sa voix. C’est qu’il possède un véritable organe, pas un filet de voix papillon, et encore moins mignon. Plutôt écorché table de dissection. Et les deux autres à ses côtés tranquilles, les fesses nonchalamment accoudées sur leur chaise haute. Ben face à vous, sa stature imposante, sa barbe noire, et sa queue de cheval ( sauvage ), qui vous regarde pénardos les bras posés sur sa guitare, comme s’il s’apprêtait à consulter le programme télé avant d’allumer son poste pour son feuilleton favori. Damien comme en extase devant sa big mama. Amour incestueux, la tient étroitement embrassée, les yeux fixés sur le manche, assis de profil sur son pliant comme un suppliant agenouillé devant son idole dans un temple païen. Trop occupé pour vous jeter un simple regard.

C’est parti. Chris annonce la couleur. Who’ll Stop The Rain de Creedence Clearwater Revival. La moiteur du Sud, et l’humidité du bayou. Se sert de sa voix comme un alligator de ses mâchoires. Ne broie pas du noir, mais du bleu très sombre.

Ben est à la guitare acoustique. Electrifiée. Vous ne voudriez tout de même pas qu’il ait les cordes en véritable boyau de chat comme au temps de Big Bill Bronzy ? Authenticité rime avec électricité. Ne l’oubliez pas. Ca ne vous suffit pas les miaulements de gouttière écorché en rut de Chris ? Pour Ben, nous vous proposons deux options. Soit vous dites qu’il n’a pas fait un seul solo de toute la soirée, soit exactement le contraire, que durant les deux sets entiers il n’a joué qu’un seul et unique solo en continu. Personnellement nous avons un faible pour la deuxième mouture. Six cordes sur sa guitare. Jusque là rien de très original. Mais faut voir tout le boucan qu’il vous en tire. Basse et mélodie. Chant et contre-chant. Point et contrepoint. Dégomme les triples croches comme vous les topinambours. Au fusil de chasse. Se passe toujours quelque chose sur sa guitare. Un solo ? Vous voulez rire, en assure trois en même temps. Un peu comme les films du cinéma muet passés en accéléré. Difficile de savoir où il pose les doigts. Je vous rassure, il ne rate pas son cordage, et ça s’entend. Elles vibrent comme l’élastique de l’arc d’Ulysse quand il a commencé à clouer les prétendants à coups de flèches. Le problème c’est que c’est nous qui avons le mauvais rôle et qui sommes transpercés de ses dards meurtriers chaque fois qu’il accroche une corde. La solution c’est qu’il n’arrête pas une seconde et que l'on doit être maso car l'on aime cette délicieuse souffrance. Les fameuses blue notes, elles en voient de toutes les couleurs, arc-en-ciel à tous les étages, vous les balance par grappes de cent. Un mec économique, une guitare et vous entendez un orchestre symphonique. Mais carrément plus givré que celui des concerts Lamoureux.

Le pire c’est qu’il n’est pas seul. Le Chris avec son feulement de tigre énamouré il a besoin de jouer en stéréo. Alors de l’autre côté il a à peu près le même outillage. Damien, le démon. Bon sang ne sachant mentir, il a commis d’office le fiston à ce travail de titan. Bonne pioche. Une bonne grosse contrebasse taillée dans le bois dont on fait les éléphants, c’est énorme, pachydermique et rudimentaire. Animal placide, dont on n’attend que l’écho sonore de ses plonks plonks, avec le cornac qui slappe sur sa trompe pour amuser la galerie et donner l’illusion que c’est lui qui mène le train. Un allègre trot de sénateur. Oui, mais avec Damien, c’est toute autre chose. Danse du scalp et hache d’abordage. L’a un compte à régler avec Calamity Jane. Et la bougresse n’a aucune envie de se laisser faire. L’est obligé de la malmener. Un tout petit peu. Un chouïa. Juste ce qu’il faut pour lui montrer qui est le maître d’œuvre. Faut voir les rugissements du public chaque fois qu’il s’énerve. Mais là aussi nous n’avons pas à faire avec un adepte du courant alternatif. Le genre de gars qui ne débande jamais, la main dans les entrailles à lui en tordre le clitoris. N’ai jamais entendu une contrebasse hululer comme cela. De douleur et de plaisir. Du début à la fin. Mais qu’elle est cette galopade de mustangs déchaînés ? Qu’est-ce que cette caisse ? Un presque rien qui fait toute la différence, c’est Damien qui en martèle les flancs à coups de poings. Damien qui mord sans temps mort et Ben qui benne l’eau du bain et le bébé sans remords, le Chris il peut être tranquille.

Moi je m’inquièterais, avec ces deux zozos toqués qui sonnent comme du Stravinsky et du Bartok, je me ferais tout petit, me mettrais dans mon coin pour mieux les écouter et prendre mon pied, et puis à quoi bon se précipiter sur le taf quand il y en a deux qui font tout le boulot ? Le Chris c’est pas le genre à descendre de sa croix sous prétexte qu’il y a deux larrons qui font ça très bien. Veut sa part du gâteau. Alors il nous gâte. Tout y passe, du JJ Cale, Du Keb Mo’, du Sonny Boy du Tony Joe White - il tape aussi bien chez les noirs que chez les blancs, chez les vétérans que sur les nouvelles recrues - faudrait que j’écrive un livre de trois cents pages pour vous décrire les trésors d’inventions de nos deux cordistes, trente pages rien que sur les regards de complicité rigolarde qu’ils échangent chaque fois que l’un d’eux vient de pondre un œuf de rhino féroce, mais ce serait trop long. Alors je reviens sur notre french blues shooter préféré. Gosier de fer rouillé. Je n’ai pas dit grondement unilatéral. Y a des froissements de nuances, des satinades de grognements, des engorgements d’intonations inouïes, toute la lyre des sentiments, le noir du désespoir, le rouge baby gone, le bleu des tristesses infinies. Harmoniques spléniques et baudelairiennes, les aboiements de cette chienne de vie qui vous saute à la gorge et vous inflige les cruelles blessure de la mort sûre.

L’auberge n’est pas immense mais la salle s’est remplie. Principalement des gens du coin qui crient leur admiration sans pour cela cesser de rire et de s’interpeler. Comme par magie l’on retrouve la folle ambiance captée sur les premiers disques publics de BB King… Deux sets, le deuxième très long, trois rappels et personne ne voudrait les laisser partir. Chris prend la parole pour un ultime morceau, en français, précise-t-il, mais avec l’aide du public, et chacun de reprendre en chœur avec lui Le Temps des Cerises. Merveilleux tableau, les bigarreaux sanglants de la Commune se mêlent aux bleus du blues en un magnifique fondu enchaîné. Si la musique bleue du Mississipi maintenant séculaire nous touche tant encore aujourd’hui et si de simples frenchies parviennent à la jouer et à la faire vivre avec autant de justesse que The Juke Joints Blues, c’est bien parce qu’elle transporte en son sein des cris de rage et des expériences de luttes similaires à celles partagées dans un passé pas si lointain - pour ne pas dire dans la nécessité d’un futur immédiat - par les peuples de par ici.

Nous terminerons sur cette image d’une petite fille qui après l’ovation finale s’en vient chuchoter à l’oreille de Chris : « C’était génial ! ». Les incandescentes graines du blues n’en finissent pas de germer…

Damie Chad.
( Photos facebook des artistes, concert du lendemain à Montbel )
CASINO D’AX - LES - THERMES / 31 - O7 - 2O14
STOP II

Non je ne suis pas devenu milliardaire depuis ma dernière chronique. Je ne me suis pas non plus amusé à perdre la fortune que je n’ai pas au bandit manchot. Ne vous méprenez pas le Casino d’Ax-Les-Thermes c’est un établissement pour curistes pauvres aux voies respiratoires mal embouchées qui veulent se donner l’illusion de jouer dans la cour des riches. Vécu quatre ans à Ax dans ma folle jeunesse et n’y ai jamais aperçu une rolls négligemment garée sur la pelouse interdite, vous êtes en Ariège un département qui ne roule pas sur l’or. Sa principale richesse touristique, l’ours pyrénéen sauvage et en liberté n’y pullule plus depuis longtemps, malgré d'écologiques et controversés essais de réinsertion...
Mais ce soir en haut des escaliers est installée une hideuse structure métallique ( excusez-moi, c’est de l’art ) censée décorer un comptoir branlant qui ne débite que la bière. Normal, dès qu’il y a un bar, c’est qu’il y a de la pression. Ne nous plaignons pas, le concert est gratuit et se passe dans une grande salle, vidée de tout son mobilier, avec scène, enceintes et stand de mixage dans le fond.
STOP II

Z’ont fait la balance tout l’après-midi. Une chose m’inquiète pour un groupe présenté sur le prospectus comme un retour à l’authenticité du blues originel - je n’y prête qu’une oreille intermittente - ils sont sacrément électriques. Je n’ai rien contre l’électricité, mais je crois point que dans le delta Son House ou Ligthning Hopkins branchaient directement leur guitare directement sur prise de la première centrale mississipienne rencontrée. L’est sûr que depuis ces temps anciens de l’eau boueuse a emporté bien des digues de certitudes mentales… Wait and see, comme disent les Japonais. Du moins ceux qui parlent anglais.
Gros débit. Suffit de rentrer dans la pièce pour comprendre. Les Stop II ne sont que deux. Les petites grenouilles du bayou qui veulent devenir aussi imposantes qu’un alligator ont intérêt à gonfler le volume. Ne s’en privent pas. Balancent la moutarde à plein pot. Deux guitares et rien de plus. Pour le rythme Xav tape la mesure comme un madurle sur sa pantoufle phonique. Rien à voir avec le piétinement métaphysique des premiers enregistrements de John Lee Hooker, non l’insistance, la redondance avec lesquelles il s’escrime sur cette malheureuse pédale ressemble plutôt à ses gros flon-flon de basse dans les enregistrements disco. L’on se croirait dans une boîte de nuit.

Comme en plus il hurle à l’emporte-pièce et à saturation dans son micro, il suffirait qu’il accélère et précipite la scansion de sa chaussure stompboxique pour que l’on se trouvât transporté à l’époque bénie des groupes punk de 1977. Heureusement de temps en temps il laisse le chant à son compère Bess qui lui abandonne un peu trop souvent son Epiphone rose pailleté au profit d’une washboard un peu trop monotone, ou alors pour varier les plaisirs il s’empare d’une cloche trop vacharde pour être aussi honnête qu’une montagneuse Mississipi Queen et sensée peut-être rappeler la ruralité du first country blues. Nous le regrettons d’autant plus qu’il parvient à faire sonner sa gratte comme une douze cordes. Avec lointain écho banjoïsant.
Le set est plein de petits trésors comme cela, mais il faut y faire gaffe comme ce ton nasillard du meilleur effet sur Lovesickblues de Hank Williams. Mais Xav le forcené vous harponne les tympans de sa six cordes. Joue sur le mode d’une incessante rythmique dévastatrice - implacable et tétanisante - qui noie les beaux effets de glisse qu’il tire de son bottleneck. En oublie que la plupart du temps il tient le rôle de guitariste soliste. Ainsi lorsqu’il annonce le I love You since I die de Robert Jonhson ( confusion entre Since I've Been Lovin' You et Travelling Riverside Blues d'après moi ), il devrait s’abstenir de rappeler que Led Zeppelin a aussi repris le morceau. Car les riffs de guitares entrecroisées piste sur piste de Jimmy Page sont d’une complexité inouïe comparée à son tangage brutal et monocorde.

Le public apprécie et en redemande. A leur douzième morceau seront obligés de repiocher dans la set list. Eux aussi prennent leur pied. Se lancent des private jokes incompréhensibles si l’on n’appartient pas au groupe de connaissances qui sont venues les encourager et les soutenir. En une petite heure le concert est terminé. Alors que la salle restera désespérément vide jusqu’à deux heures du matin. J’en ressors mi-figue, mi-raisin. Peu d’imagination, très répétitif dans la manière d’aborder les morceaux, quitte à reprendre Johnny Cash autant écouter de près le boulot que firent Luther et Carl Perkins sur toute une partie de sa discographie. Le rentre-dedans ne doit pas avoir pour corollaire l’évacuation de toute subtilité.
Grand succès toutefois. C’est vrai qu’ils filent davantage la pêche que le blues. La Melba mais pas le Delta. Blues garage.
Damie Chad.
14:48 | Lien permanent | Commentaires (1)
10/07/2014
KR'TNT ! ¤ 197 : HIPBONE SLIM & the KNEE TREMBLERS / MARIANNE / WASHINGTON DEAD CATS / RHESUS HK / T.A.N.K. / GHOST HIGHWAY / HOWLIN'JAWS / 80 OUTSIDERS / ARPEGGIO OSCURO /
KR'TNT ! ¤ 197
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
10 / 07 / 2014
|
Cette 197 ième livraison de KR'TNT sera la dernière de la saison. KR'TNT prend des vacances après quarante-cinq épisodes sans interruption. Nous savons qu'il vous sera très dur de survivre sans votre dose de KR'TNT hebdomadaire mais il est inutile de songer au suicide puisque nous serons de retour le dernier jeudi du mois d'Août. KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME ! |
|
HIPBONE SLIM & THE KNEE TREMBLERS / MARIANNE WASHINGTON DEAD CATS / RHESUS HK / T.A.N.K / GHOST HIHWAY / HOWLIN' JAWS / 80 OUTSIDERS / ARPEGGIO OSCURO |
30 mai 2014 / Bourges (18) / Cosmic Trip Festival
The Wild’n’Crazy Rock’n’Roll Festival
HIPBONE SLIM & THE KNEE TREMBLERS
HIPBONE FRANQUETTE
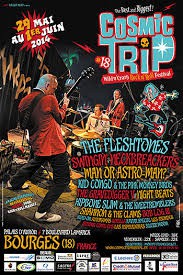
Sir Bald Diddley, alias Hipbone Slim, est certainement le mec le plus drôle et le plus doué de sa génération. Qu’il touche au garage ou au rockab, il tape chaque fois en plein dans le mille. Et les paroles de ses chansons sont généralement tordantes. Dans «Bald Head Hairy Guitar», il lance : «Baldhead I don’t care/ I ain’t got no use for hair» - il n’a pas besoin de cheveux, par conséquent il s’en fout d’être chauve. La tournure de langue est tellement bonne qu’elle est quasiment intraduisible. Chez Sir Bald, on se marre et on claque des doigts. Pas mal d’albums au compteur et pas un seul déchet. Comme Wild Billy Childish ou le Révérend Beat Man, il grenouille activement dans les circuits underground et remplit les bacs des disquaires spécialisés, souvent au rythme de plusieurs albums par an. Et quand on a compris que ce mec est très fort, alors on le suit à la trace. Après une série d’albums faramineux sortis sur son label Alopecia Records, il est passé sur Voodoo Rhythm, le label du puissant Révérend Beat Man, pour une série d’albums encore plus terribles. Et depuis 2010, d’autres albums du même acabit sortent sur Beast Records, LE label français par excellence.

Alors, on est allés le voir jouer sur scène au Cosmic Trip Festival de Bourges, le gros rassemblement annuel de tous les garagistes de France et de Navarre. Même endroit, mêmes canards dans la rivière, mêmes silhouettes incertaines de Rubemprés dans les rues pavées, mêmes spécialités à la cantine berrichonne et même ambiance dans la grande salle où passaient les gros bonnets du garage. Tête d’affiche du vendredi soir : les Swingin’ Neckbreakers. Tête d’affiche du samedi soir : les Fleshtones. Les programmateurs avaient dû se tromper. Hipbone Slim jouait en ouverture de soirée le vendredi, devant un maigre public. Le samedi, Kid Congo se retrouvait pris en sandwich entre un groupe grec improbable et les Fleshtones. L’ordre de passage des groupes était un peu bizarre, pour ne pas dire farfelu. Swingin’ Neckbreakers : on a réussi à tenir deux morceaux. Même ennui avec les Fleshtones. J’avais fait avec eux un dernier essai en 2009 au Nouveau Casino. Et quand ils sont montés sur le bar pour danser comme les filles des Folies Bergères, j’ai bien senti qu’on était loin du bon vieux garage, celui des Gories, de BBQ et de Momo Man. Alors à Bourges, ça a été vite réglé et ça s’est terminé au bar, où curieusement il y avait foule. Nous n’étions donc pas les seuls à trouver les Fleshtones un peu ringards.

Par contre, Hipbone Slim et Kid Congo ont en quelque sorte sauvé l’honneur d’un festival qui comme bien d’autres, semble être en passe de devenir l’ombre de lui-même. Les bars de Rouen ou du Havre se montrent beaucoup plus audacieux sur les choix de programmation et ça paye. Les gens qui se déplacent dans ces bars voient de vrais groupes, pas du garage de Télérama. À Bourges, on aurait bien aimé voir des groupes de garage pur comme les Masonics, The Len Price 3 ou Graham Day. Pour ne parler que des Anglais.

Sir Bald est arrivé sur scène accompagné de Gez et de Bruce Bash, the cream of the crop. Ils avaient une allure de groupe rockab, sans doute à cause de la vieille contrebasse qui sentait le vécu. Plus de guitare carrée ni de moustache pour Sir Bald. Il jouait sur une Gisbson SG, avec un son sec. Quelle classe. Ce mec avait de quoi faire sauter dix fois le toit du ballroom. Il essayait constamment d’impliquer un public un peu mou du genou et faisait pas mal d’efforts pour parler en Français. Il annonçait ses titres et précisait chaque fois que le disque correspondant était en vente over there. Il nous a balancé «Trainwreck» tiré de son tout dernier album, «Baldhead» tiré de «Ugly Mobile», «Warpath» tiré de «Square Guitar» et l’effarant «Primitive Rock» qui fit bien rire les chanceux qui comprenaient l’Anglais. Son set était un bel exemple de mélange réussi de garage, de rockab et de boogaloo. Il était moins explosif que le Révérend Beat Man, mais sa prestation valait cent fois le déplacement. Sans lui, le festival n’aurait eu quasiment aucun sens. On lui reproche d’être à cheval sur plusieurs genres, mais c’est justement ça qui fait sa force, car il est bon partout, que ce soit en garage sixties de type Pretty Things ou rockab à la Meteor. Et on a sous les yeux un petit bonhomme qui reste concentré et qui joue comme un beau diable. Par ses fringues, son chapeau, sa petite corpulence et sa façon de se déplacer, il évoque ces vieux potes gitans qu’on a tous eus. Il a ce côté enfant de la balle tombé de la roulotte, ce côté guitariste manouche qui joue comme un dieu parce qu’un grand-père lui a mis un guitare dans les pattes et un mégot dans la bouche à l’âge de trois ans. Un veinard.

Pour chanter son dernier cut, «Baldhead», il enleva son chapeau. C’était un peu comme s’il se mettait à nu. Et tout à coup, il devint incroyablement vulnérable. Il n’est pas certain que ça ait plu, car si on ne comprend pas les paroles qui sont hilarantes (ain’t got no use of hair - je n’ai pas besoin de cheveux), l’image du petit bonhomme chauve peut se retourner contre lui. Surtout que le public se déplace pour voir des rock stars. Pas un Zanini en chemisette qui fait un peu de rockab.
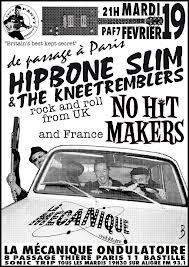
Et pourtant, c’est l’homme du sans-faute, aussi bien sur scène que dans sa discographie cavalante. Dans les années 90, l’animal commença à sortir des disques de surf et de garage assez monstrueux sur son label Alopecia. Sir Bald Diddley And His Right Honourable Big Wigs faisaient claquer l’étendard sanglant de la révolte.

«Surfin’ With» parut en 1992. Recommandé à tous les amateurs de surf-garage. Tout est instro sauf deux titres, «Sally Mae» qu’il passe à la moulinette surf-garage, mais qu’il rend bien bourbeux et raclé dans la dégaine, et «Snake Eyed Woman», qu’il embroche au dessus des flammes de l’enfer du rock’n’roll de carton-pâte. Il fait aussi du garage sleazy avec «Fiery Eyes», pure ramasse et Liam Watson enregistre tout ça chez lui à Toe Rag.

«What’s In Your Fridge ?» parut dans la foulée. On y retrouve ces instros surf-garage chauffés à blanc. Dans le morceau titre, Sir Bald prend un beau solo killer qui annonce un avenir radieux. On a même du scream en fin de cut. Ils font une jolie parodie de «Surfin’ Bird» avec «Bird Dance Beat» et font du groove crampsy avec «Untamed Love». Ils semblent vraiment fascinés par le hit culte des Trashmen car ils refont une autre mouture de «Surfin’ Bird» intitulée «Don’t You Know It» où on entend Sir Bald hurler comme un démon de train fantôme. Raaaahhhh ! Alors que sur la pochette, il ressemble à Tintin, avec sa houppette.
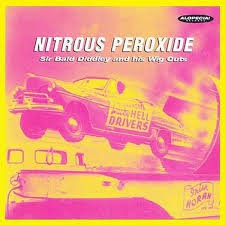
Attention ! «Nitrous Peroxyde» est un gros disque garage bardé d’énormités. Après un instro surf d’intronisation, un truc appelé «Somethin’ Don’t Add Up» nous saute à la gorge. On roule à terre. Rude combat. Impossible de le décrocher. Trop puissant. Digne des trogglos des sixties, ceux qu’on voyait jouer dans des cavernes en plastique. Pour se débarrasser de ce groove vénéneux et poilu, il faut s’appeler Hercule. Si ce n’est pas le cas, c’est foutu. Arghhhhh ! Malédiction ! Puis Sir Bald nous fait le petit coup de Link Wray classique de ces années-là, histoire de nous montrer qu’il a reçu une solide éducation. Et paf ! On se reprend une terrible tarte avec «Shake A Keg». Avec ce garage vitupérant, Sir Bald se donne la voix et les moyens d’écraser le son comme un vieux mégot pour que gicle le jus de nicotine le plus abject qui soit. Baldie est tout simplement exemplaire. Pire encore, il balance un solo glou-glou à la Dave Davies. Wow Sir Bald, fais-moi mal ! Wow Sir Bald, t’es bald as love ! Wow Sir Bald, tu bardes sec ! Nouvelle tarte dans la ‘djueule - comme dirait notre héros national - avec «Don’t Badmouth Me», pièce de garage crasseux, poisseux et tout ce qu’on veut, avec de l’harmo rance et des gros accords fritonneux dont le gras traverse le papier du charcutier. Ah le cochon ! On patauge dans l’excellence de la mouvance. Encore une bombe sur la face B avec «Fell For You», l’un des garage cuts les plus dirty du monde - pas darty, mais dirty - doté de toute l’agressivité des Pretties, et c’est même encore plus rude, comme si les élèves dépassaient les maîtres. Ah quelle joie irréelle que de retrouver ce riffage cisaillé ! Des accents lamartiniens nous emportent la bouche. Rien qu’avec cet album pantelant, Sir Bald mérite la couronne de roi du garage anglais. Et il ne va pas en rester là, le bougre.

En l’an 2000, Sir Bald Diddley & His Wigs Outs sont en plein boum. Ils sortent «The Baldy Go», un album terrible sur Sympathy For The Record Industry, le meilleur label de l’époque avec Crypt. Grosse pochette rouge et Sir Bald porte un toque en peau de panthère. Ça part en trombe avec «Self Destruct», un garage agressif à l’anglaise, avec le chant mauvais comme pas deux et l’harmo, une ambiance Pretties abominable. Le morceau suivant est aussi diabolique. «Handsome Beast» flirte avec le Diddley Beat et en plein morceau, il lance la dynamique des Pretties. Sir Bald réanime l’esprit garage des sixties, le vrai, celui des caves humides des banlieues de Londres, quand tous ces fils de dockers avaient le feu sacré. Puis il tape dans le registre des early Kinks pour lancer «Overplayed Your Hand», salement riffé et monté sur un gros beat turgescent. Sir Bald s’en vient trouer le cul du cut avec un solo au vitriol. C’est sa grande spécialité. Il troue tout ce qu’il veut. On se croirait chez les Kinks, mais avec un chanteur délinquant. Pour «Flattered To Deceive», il part en mad psyché avec un gros thème gras qu’il monte en doublon sur le mid-tempo. Belle ambiance, sauce harmo, pur jus freakbeat acid test de toast de thé brit d’âge d’or. Quel album ! On comprend que Long Gone John ait flashé sur Sir Bald. «Eyes Bigger Than Your Belly» est encore une belle cochonnerie animée des pires intentions. Chez Sir Bald, tout est très dense, bien joué et prodigieusement inspiré. Il va même conclure avec un punk-rock à l’harmo, «You Do My Head In», très yardbirdsien dans l’esprit.
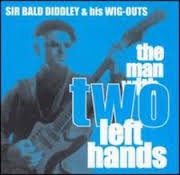
L’album suivant s’appelle «The Man With Two Left Hands». Grosse pochette bleue. Cette fois, il porte une casquette. Encore un album assez dévastateur. Il commence par faire du gros Memphis sound avec «Where’s McComb» et il passe à la pop anglaise avec «Bad Times». Il se montre digne des géants du freakbeat anglais, du style de ceux qu’on retrouve dans les vingt volumes de Rubbles. Sa pop est de la race de celles qui s’accrochent, de celles qui refusent d’être emportées par le vent. C’est de la pop de souche anglaise. Et voilà la bombe : «She’s So Illusive», une sorte de mad psyché à la fois arrogante et terrifiée, sertie sur un gimmickage au long, comme n’ont jamais su en jouer les Anglais. C’est à cet instant précis qu’on constate que Sir Bald dégouline de génie. Avec ses deux mains gauches, il se permet toutes les audaces. Chacun de ses disques sonne comme une bénédiction, un antre de la mesure pleine, un palais de la découverte, un refuge pour chiens sans colliers, un repaire encore frais. Il attaque son «Snake Eyed Woman» avec une classe effarante. Il s’y montre digne des pionniers du rock. Les accords de «I Fell Off The Wagon» sont ceux de «Louie Louie», et il les gratte avec une ostensibilité confondante. Nouvelle pétaudière avec «Third Eye» - Awite now ! - Toujours ce gimmickage prédateur, il entre dans le biseau du biz-biz avec un mordant inadmissible. Il chante son truc avec des accents merveilleusement corrompus. Il dit qu’il voit avec son troisième œil. Il crie et part en solo, un solo qui affole les moineaux et il claque les notes martelles de Charles Mortel.
La série d’albums de Hipbone Slim sortis sur Voodoo Rhythm est ahurissante de modernité et de rage rockab. Sir Bald joue en trio avec deux légendes à roulettes, Bruce Brand, drums, et John Gibbs, double bass. Pas plus légendaires que ces deux mecs, en Angleterre. Ils ont fait partie de tous les coups fumants : Milkshakes, Masonics, Kaisers, Wildebeasts, Headcoats, Mighty Caesars, Holly Golightly, vous voyez le genre ?

Curieusement, «Snake Pit» qui sort en 2003, n’est pas le meilleur de la série. On sent que Sir Bald cherche sa voie. On a une version de «Fiery Eyes» slappée sec et un «Close My Eyes» qui sonne comme du Elvis. Oui il peut le faire. On passe au rockab crampsy avec «Ain’t Nobody Else», qu’il chante d’une voix de trembling boogaloo. En face B, il envoie une pièce épaisse et bien rampante, «You Done This», montée sur du slap bien sourd et des congas et on finit par tomber sur une véritable perle, un vrai hit rockab, «When You Do The Things You Do». C’est d’une authenticité effarante et c’est là qu’on comprend que ce mec n’est pas un amateur. «When You Do The Things You Do» aurait très bien pu être enregistré au Texas en 1956. Alors avis aux amateurs.

Le texte qui accompagne l’album suivant, «Have Knee Will Tremble», reste un modèle d’humour rococo. Beat Man - sûrement lui - raconte l’histoire des Kneetremblers, un gang chicano qui s’installa à El Paso dans les années 50 pour y semer la terreur. «Si tienes rodillas, temblaras», tes genoux vont trembler, mon coco. Pour une fois qu’une pochette est drôle, il faut en profiter. Mais ce n’est pas tout. L’album révèle l’éclatant génie de Sir Bald. Si on aime bien le son du bon slap, alors c’est un album de rêve. Dans les deux premiers cuts, «Blind Eye» et «One Way Street», Sir Bald met le slap en avant toute. Monstrueux ! À se damner pour l’éternité ! On se croirait chez Lew Williams ! On entre dans le disque d’Hipbone Slim comme dans l’eau bleue d’un lagon rockab tropical. C’est un immense réconfort pour les oreilles et pour le bulbe rachidien. En plus, l’animal plante un solo offensif en plein cœur du cut-vampire. Rhhhaaaaaaaaaaa ! Disque après disque, Sir Bald reste passionnément étourdissant. Il est vraiment doué. «One Way Street» est un mid-tempo de classe supérieure complètement délinquant et slappé avec la pire malveillance. D’autres éclats de génie hipbonien se nichent sur la face B, et notamment «I Fell Off The Wagon», pied de nez aux mythiques hobos, avec un son rockab classique et un slap en devanture. C’est tapé profond dans l’inconscient collectif de la banane sacrée. Sir Bald n’a pas de banane, mais il incarne l’esprit de la banane. Il fait bander le rockab. Son trio vaut tout l’or du monde. Encore un magnifique mid-tempo rockab avec «Lonesome And Loathsome», cuisiné à la sauce du Deep Sud avec un chant bien perché. Sir Bald va chercher des accents de désolation et ça reste admirable de pureté institutionnelle. Démence dans la slappance avec «What Enough Happenin’», un vrai hit rockab. Sir Bald amène une contre-mélodie dans le contre-courant de la stand-up. On se croirait vraiment chez Meteor en 1956, avec Charlie Feathers dans les parages. Puis il fait son Gene Vincent avec «If Only» et rebascule dans la sauvagerie rockab avec «Man With A Plan», où l’on voit Sir Bald tirer le diable par la queue. Ah ! le diable adore ça.
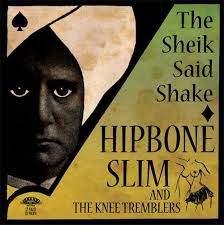
Les choses se corsent encore avec «The Sheik Said Shake», l’album suivant. Sir Bald rend un hommage fulgurant à son héros Bo avec «We All Got Somebody That We Want To Kill» - Hey Bo Diddley ! Pur Diddley beat. Admirable et sans prétention. Puis il nous sort de sa manche l’un de ses hits planétaires, «I Hear An Echo», espèce de petit rock tagada qui se profile à l’horizon. Un truc digne de «Brand New Cadillac», quant au filigrane. Dans le morceau titre de l’album, Sir Bald nous gratifie d’une grande variété de climats. Voilà encore un cut admirable d’orientalisme larvé. Derrière, ça joue berbère, avec, évidemment, du Diddley beat en fond de trame. On pense à l’époque où Bo jouait sur un gros bouzouki. Sir Bald renoue allègrement avec l’immense transe berbère de Rachid Taha, le Sheik des Batignolles. Puis John Gibbs nous slappe «Dead Man’s Shoes» à l’ancienne. Magnifique d’essence rapide. C’est à la fois Sonny Boy Williamson et Pat Cupp, riffé sévère et léché d’accolade - Dead man shoes don’t fit so good - une belle régalade d’enfilage de perles, tout est du pur vintage caressé, dans l’éthique de l’esthétique psychotique. Brillant, comme dirait Dizzy Detour. Puis Sir Bald sous offre une gros cut boogaloo sur un plateau : «Brand New Head». On y sent la décontraction du fantasme à la croisée de tous les garages et c’est une bouffée d’air considérable. Sur la face B se nichent d’autres perles rares, comme «Diddley Squat» (grosse présence de la basse qui avance comme une main baladeuse), «Buried Next To You» (dans l’esprit des Cramps et strummé rockab, excellence de la tempérance, c’est l’un des grands éclats rockab des temps modernes, véritablement accrocheur, balade bananée à col ouvert par un soir d’été grandiose), et «Pempelem» (reprise rockab, solide et exotique, avec un son plein comme un œuf, l’intention est pure, Sir Bald is the cat, il fait swinguer son Pempelem avec une incroyable gourmandise, dans le respect des dramaturgies du texte originel).

Sir Bald multiplie les projets, comme le fait Wild Billy Childish. On l’a reconnu en 2008 sur la pochette de l’album «The Electrifying Sounds Of The Kneejerk Reactions». Bruce Brand et Gez Gerrard sont là, eux aussi. Cet album est un classique du garage moderne. Après avoir rendu des hommages fabuleux à ses héros rockab et à son dieu Bo, Sir Bald rend hommage aux early Kinks et aux Pretty Things. Attention, cet album est une bombe atomique. On est sonné dès l’intro avec «Self Destruct», un garage indiscutable d’authenticité. Garage impavide en qui tout est comme en un tigre aussi subtil que carnassier. Sir Bald ne plaisante pas avec le binarisme et les solos déboîtés. Encore une belle pièce à la Bo avec «Handsome Beast». Le Diddley beat y prévaut comme une bête. Puis il monte son «You Electrify Me» sur le «Oh Yeah» des Shadows Of Knight et fait preuve d’un stoïcisme à toute épreuve. Clin d’œil faramineux aux Stones et aux sixties boomers d’Amérique avec «Who’s The Ostrich Now». Sir Bald va chercher ses réflexes dans le pot commun de l’inconscient collectif. Attention à la face B, car ils passent aux Pretties avec «Fell For You». Non seulement il faut oser le faire, mais il faut surtout savoir le faire. Pretties for ya, du pur Sir Bald, comme une évidence. Puis il passe au pur jus Kinky avec «Don’t Underestimate My Love», reprise déguisée, - Girl ta ta ta you really got me now - et c’est là où Sir Bald est très fort, c’est qu’il réussit à aller chercher des accents à la Ray Davies. Il reste branché sur les Kinks pour «Won’t Let You Down», sixties punk so far, dirty et bas du front, et solo à la Dave Davies, ouch. Il nous envoie directement au tapis.

Quatrième album de Hipbone Slim sur Voodoo Rhythm : «The Kneeanderthal Sounds Of», le pire de tous. Pur Diddley beat avec «Eye Of The Storm», salubre et salutaire, effarant d’énergie. Sit Bald jette du rockab dans son Diddley beat. Encore de l’énergie à revendre avec «Hung Drawn and Quartered» qui est secoué au slap. On se croirait une fois de plus au Texas en 56. Ce mec est un dingue doué de tous les dons du diable. Encore une énormité explosée au slap : «Whatever Happened To My Love». Coup de génie, un de plus, il passe à l’extrême barbarie secouée et déviante, et défonce la rondelle des annales. On trouve un brin de boogaloo en face B avec l’immense «Dig That Grave», hanté par des zombies. Puis on tombe sur l’un des plus beaux hommages jamais rendus au dieu Bo : «Primitive Rock» - «When the sun goes down I rock around/ Doing a primitive stomp to primitive sound» - c’est apocalyptique de qualité supérieure, n’allez pas perdre votre temps ailleurs, Hipbone Slim c’est comme la Samaritaine, on y trouve tout ce qu’on cherche. Et surtout la classe - «Grab my baby by the hair/ We’re gonna rock it everywhere» (j’attrape ma femme par les cheveux, on va s’éclater dans la cambuse) - comique et sérieux, real primitive. À tomber. Encore un coup de Trafalgar fulgurant avec «I’m The Leg» où il fait son Slim Harpo. C’est complètement dingue de virtualité cabalistique - «When I got a movin’ baby you don’t stand a chance» - Ce mec affole. Il n’arrête pas de déconner - «I got a leg bone, I got a knee bone, I got a hipbone, I got a trombone, yeah ! - C’est comme ça du début à la fin. D’ailleurs, c’est là où Sir Bald dépasse les bornes. Cet humour ravageur qu’il distille à longueur de morceaux s’inspire directement de celui de Bo Diddley.
Bo raconte qu’un jour à Chicago son batteur Billy Drowning et son bassiste Jesse James Johnson sont entrés dans un magasin de jouets pour s’acheter des revolvers de cow-boys. Ils sont ressortis du magasin harnachés comme des desperados, portant leurs flingues à la hanche. Évidemment, au coin de la rue ils sont tombés sur des flics. «Come here boy, what’s your name ?» Jesse répondit «Jesse James», puisque c’était son nom. Alors, l’œil mauvais, le flic s’est tourné vers Billy : «Toi, si tu me dis que tu t’appelles Billy the Kid, ça va barder !» Et Billy répondit d’une voix blanche : «My name is Billy». Cette histoire se trouve dans la bio de Bo, l’un des livres les plus drôles et les plus vivants qui soient. L’auteur George T. White eut l’intelligence suprême de s’effacer pour donner la parole à Bo.
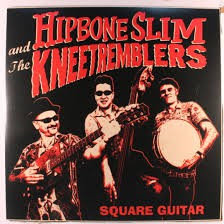
En 2010, Sir Bald et ses copains se sont retrouvés sur Beast Records, le petit label rennais qui grimpe dans les estimes. «Square Guitar» est le premier album Beast et ça démarre avec du pur Bo. Non, franchement, on ne peut pas espérer plus Boyen que «Square Guitar», avec un solo en hoquet au mal de mer et un backing inventif à couper le souffle. Jungle jingle avec «Hindin’ To Nothing» et un joli son de stand-up. Sir Bald chante vraiment comme un dieu. Il va chercher des accents américains à la frontière. Justement, il passe à l’indienne avec «Warpath», et c’est sa poule qui est sur le sentier de la guerre et qui veut le scalper - «I’m in a heap big trouble man, I better pray/ She’s gonna have my scalp today» - et c’est d’autant plus hilarant qu’il est chauve. Il reste dans le grand Bo et il a tout compris. Encore du gros balancé comique avec «Bullnoose», où il se retrouve au volant de sa Cadillac dans un champ face au museau d’un taureau - «I said bull noose daddy can’t you see/ Three’s a crowd, two is company» - fabuleux et inspiré comme pas deux. Puis il passe au Sonics Sound avec «Birdman». Boogaloo voodoo en face B avec «Snake Dancer», beat jungle, admirable à bien des égards, mystérieux et percé d’un solo oriental. Et Sir Bald recoiffe sa couronne de rockab king pour un hallucinant «Half Crazed Daddy», nerveux et sec, dans le pur esprit - «Half crazed daddy, let’s have some fun» - Renversant. Toujours cette distance humoristique avec «One Eyed Monkey» : Sir Bald nous emmène dans la jungle rencontrer un singe borgne et il traite ça au slap - «Way down in the jungle is a coconut tree/ There’s a one-eyed monkey tellin’ how it should be» - magnifique, une vraie histoire en trois couplets coconut jungle et si tu n’es pas d’accord avec le singe, tu vas devoir te battre avec lui. Nouvel hommage spectaculaire au dieu Bo avec «Why Ain’t Bo On My TV ?», aussi fulgurant que ceux d’Eric Burdon - «Let me tell you the story of Ed and Bo» et Sir Bald fait frissonner sa guitare carrée.

On reste dans les histoires de guitares carrées et chevelues avec l’album «Sir Bald’s Hairy Guitar», sorti lui aussi sur Beast. Et c’est une bête. Quatre énormités s’entassent sur ce disque. «Hold On Here I Come», belle pièce de rockab mid-tempered battu jungle et chanté à la rockalama des grandes heures des dudes d’antan. Sacré chanteur que ce bon Sir Bald. Des spécimens comme lui, vous n’en verrez pas beaucoup dans les parages. Il faut l’entendre lancer son solo avec des cris de bête. Il a tout compris au film. «Run Me Ragged» est aussi embarqué au petit riff rockab, avec une belle profondeur. Un vrai hit de juke. Le son, toujours le son, rien que le son. Il balance un solo de malade mental. Ah, on peut dire qu’il sait fournir l’avoine aux rockers de banlieue. Sur la face B, «What I Gotta Do» guette le promeneur inconscient comme un vautour. Puis on retrouve le fameux «Birdman», pétri dans le binaire d’antan, le côté sale du grand garage de Baldie, avec le solo pourri de génie à la clé - «My mama told me you’re a big bird now/ Jump out of the tree» - Ahhhh ! Gros clin d’œil aux Cramps, évidemment. Puis c’est l’uppercut fatal avec «Tide Gonna Turn», garage métabolique serti d’un solo de notes tirées et d’un riffage de basse de rêve. Quel son !

Sur la pochette de «Ugly Mobile», Sir Bald brandit sa square guitar comme une hache. C’est là qu’il se vante d’être chauve - «I’m the baldhead shiny man ! Baldhead baby !» - et ça swingue. On a encore du so-solid stuff avec «Sally Mae», énorme, chanté et drôle, avec des chœurs bien swingués. Le coup de génie se trouve en face B et il s’appelle «Indestructible Love». Sir Bald raconte à sa poule qu’elle peut le jeter aux lions, lui attacher une pierre au pied et le jeter à l’eau, l’asperger d’essence et le faire brûler, mais jamais elle ne pourra détruire cet indestructible amour - «Hate me, cremate me, burry me way down deep/ Don’t you know that I’ll come back and I’ll haunt you in your sleep !» - tordant et sacrément bien foutu. Il revient à l’énergie rockab avec «Number One Son». C’est d’une classe insolente, comme toujours. Il chante ça comme un Texan, d’une voix de nez perchée.

Sur «Sir Bald’s Battle Of The Bands» sorti en 2013, on retrouve des morceaux enregistrés avec des formations diverses et variées, comme Louies & the Louies, en trio avec deux Espagnols qui ont accompagné sur scène des géants comme Ronnie Dawson. On trouve aussi deux morceaux des Kneejerk Reactions, avec Gez et Bruce, et donc du garage énorme comme en témoigne ce «Things Are Turning Ugly», de base Kinks et soloté à la Dave Davies. Sir Bald est l’incarnation du garage anglais. Il en a l’esprit et le son. Il fait un autre groupe qui s’appelle les Beat Seeking Missiles et «Drive Like An Italian» vaut sacrément le détour. C’est le romp de rêve, le vieux hit qu’on adore sans savoir d’où il sort. Dans ce groupe, on retrouve un mec de Supergrass. Apparemment, un album est en cours de réalisation chez Dirty Water Records. Encore un autre groupe avec Sir Bald & the Crowntoppers, encore du garage haut la main. Sir Bald fait très exactement ce qu’il veut. Tu veux du garage, du vrai ? Tiens en voilà. Il perpétue la meilleure tradition, celle qui vient des Pretty Things et des frères Davies. Killer solo, évidemment. Puis ça part en shuffle. Incroyable mais vrai. Ça chauffe bien aussi avec les Legs. C’est même du gros sérieux. Ce serait une grave erreur que de prendre cet album à la légère. Il donne une nouvelle indication du niveau auquel navigue notre Sir Bald chéri.

Hipbone Slim & The Knee Tremblers sortaient l’an passé «Go Hog Wild», un 25 cm sur un petit label nommé Folc Records. On retrouve sur ce disque dense le mélange habituel de rockab, de boogaloo et de garage auquel l’indicible Sir Bald nous habitue depuis vingt ans. «Crawl Back To Me» tape au cœur du standard rockab, sourd et pulsé. Uns fois de plus, on se croirait chez Meteor en 1956. Et les violentes montées en puissance n’arrangent rien. Sir Bald tape dans le rockab crabe, celui qui avance de travers sur un inexorable mid-tempo. Il passe ensuite au John Lee Hooker jive pour «Shrunken Head». On croit toujours avoir fait le tour du boogie, et Sir Bald se pointe pour nous montrer qu’on se trompe, avec une belle démonstration de boogie-boogah d’une élégance qui dépasse toutes les bornes, absolument toutes. Sir Bald est une sorte de touche-à-tout de génie, comme le fut Kim Fowley pendant quatre ou cinq décennies. Sir Bald mène à bien toutes ses entreprises et ses disques sont là pour en témoigner. Il faut l’entendre chanter «Good For Nothin’». Ce qu’on entend là, c’est tout simplement la meilleure voix de Memphis. Il revient à son boogaloo chéri avec «Onga Bonga Rock». Il adore se balader dans la fête foraine et s’amuser à faire le goo-goo muck pour effaroucher les jeunes filles. L’exotica de pacotille est sa religion. Comme on l’a vu sur scène au Cosmic, il adore Gene Vincent et le rock’n’roll. Alors on se régalera de «Food Man Chew» où en plus il vante les mérites du cannibalisme - Miam Miam, fait-il, en mastiquant un mollet. Et le coup fatal s’appelle «The Twitch», un rockab dément à la Charlie Feathers en partance pour Byzance, avec le gros slap de Gez derrière. Sir Bald revient au second couplet en frissonnant de froid. Il reste incroyablement pur dans son attaque rockab. Il sait tout de la grandeur de l’expressionnisme rockab qu’a si bien incarné Charlie Feathers. On voit bien que ce mec a le feu sacré. Son rockab balaie tout le spectre du genre et il multiplie à l’infini le bop de langue.

«The Out Of This World Sounds Of Hipbone Slim» vient tout juste de sortir. Pas le temps de souffler, avec cet exterminateur d’oreilles. Nous avons pour commencer une parfaite mise en bouche avec «Sabretooth» et son slap bourbeux. Sir Bald tire ça à l’énergie de la voix. Excellent. Il fait le tigre, évidemment. Roarrrrr ! «Eary On The Eye» est savamment slappé. Pur jus rockab, une fois de plus. Magnifique de déviance éprouvée. Gez slappe ça sourd. Sir Bald chante avec une belle hargne d’anthologie. Dans «Wig Wam», il raconte l’histoire de Bald Eagle et de ses braves. Aigle Chauve, ça va de soi. On entend même voler les tomahawks. Il invente un nouveau genre, le mambo garage, pour «Pretty Plaid Skirt (And Long Black Sox)». C’est possédé par le diable - yeah yeah - avec à la clé un solo de fou échappé de l’asile de Rodez. Sir Bald promène ses doigts sur son manche comme d’autres promènent leur cul sur les remparts de Varsovie. Il sait marier le Bo avec le Screamin’ Jay. Il est à la croisée de tous les bons plans. Il faut bien admettre que ce mec a une vision. Le dernier morceau de l’album est un chef-d’œuvre de heavy blues chanté à l’arrache : «The Wolf Is At Your Door». Ce fourbe génial glisse des wolferies dans le groove du slap. Avant lui, personne n’avait osé faire une chose pareille. Et pour corser l’affaire, Bash nous bat ça rockab à la ramasse. C’est une pièce qui pantèle et qui fume, un pur hit hipbonien, une véritable bénédiction fatale. Dans ce morceau, on retrouve absolument tout ce qu’on aime dans le rock. Fréquenter Sir Bald, c’est une façon d’entrer en osmose avec le cosmos.
Signé : Cazengler, Sir Bof
Cosmic Trip Festival. The Wild’n’Crazy Rock’n’Roll Festival. 30 mai 2014. Bourges (18)
Sir Bald Diddley And His Right Honourable Big Wigs. Surfin’ With. Alopecia Records 1992
Sir Bald Diddley And His Right Honourable Big Wigs. What’s In Your fridge ? Alopecia Records 1994
Sir Bald Diddley & His Wigs Outs. Nitrous Peroxyde. Alopecia Records 1996
Sir Bald Diddley & His Wigs Outs. The Baldy Go. Sympathy For The Record Industry 2000
Sir Bald Diddley & His Wigs Outs. The Man With Two Left Hands. Corduroy Records 2001
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. Snake Pit. Voodoo Rhythm 2003
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. Have Knees Will Tremble. Voodoo Rhythm 2004
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. The Sheik Said Shake. Voodoo Rhythm 2008
The Kneejerk Reactions. The Electrifying Sounds Of. Screaming Apple 2008
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. The Kneeanderthal Sounds Of. Voodoo Rhythm 2010
Sir Bald’ Hairy Guitar. Beast Records 2010
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. Square Guitar. Dirty Water Records 2011

Hipbone Slim & The Knee Tremblers. Ugly Mobile. Beast Records 2013
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. Sir Bald’s Battle Of The Bands. Beast Records 2013
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. Go Hog Wild. Folc Records 2013
Hipbone Slim & The Knee Tremblers. The Out Of This World Sounds Of. Beast Records 2014

De gauche à droite sur l’illustration : Sil Bald, Gez Gerrard et Bash Brand.
FESTIVAL MELOMANIES / ROMILLY SUR SEINE

La teuf-teuf erre un peu dans l'antique cité gallo-romaine de Romulius. Faut dire que Romilly-Sur-Seine est construite toute en longueur et que les organisateurs se sont contentés d'un panneau à l'entrée de la ville et d'un autre, quatre kilomètres plus loin, juste à la sortie. Pour le reste débrouillez-vous. C'est un peu de ma faute, vingt-quatrième édition du festival et c'est la première fois que je m'y rends. Pourtant ce n'est même pas à quarante kilomètres de la maison. Oui mais c'est dans le département voisin, et L'Aube et la Seine & Marne s'ignorent consciencieusement, une frontière morale encore plus infranchissable que le Mur de Berlin, avant la fin de la Guerre Froide. J'avoue aussi que la programmation des années précédentes n'était point trop à mon goût.
Ouverture des portes à vingt heures trente qu'ils annoncent sur le prospect, faudra poireauter trois bons quarts d'heures avant que l'on nous laisse investir le lieu. Une grande scène, toute noire et bourrée de matos, tout de suite ça sent l'orga respectueuse des musicos et du public. J'ai oublié de préciser que le festoche est gratuit et qu'il s'étend sur cinq soirées. Pour la boisson, la bouffe et les bonbons – c'est gentil de penser aux enfants – les prix sont plus que modiques, pas de stress, ambiances sympathique et populaire. L'est sûr qu'à ce tarif les jeunes du cru ont compris qu'ils n'ont pas à bouder leur plaisir. Sont venus en nombre et l'enceinte se remplit d'une foule sereine et souriante.
01 - 07- 2014
MARIANNE / WASHINGTON DEAD CATS
MARIANNE
Non, excusez-moi de vous décevoir, contrairement à ce que l'on aurait pu supposer Marianne n'est pas une jolie fille, mais un groupe de garçons. Cinq pour être précis. Les régionaux de l'étape du jour. Alex au chant, c'est Flo à la batterie et pas les deux Thom qui sont préposés à la rythmique et à la basse, David est le roi de la lead guitar. Formation classique. Rock français, comprenez que les paroles ne sont pas en anglais. Un peu de rébellion et pas mal de critique sociale. Marianne regarde un peu trop Noir Désir. Quelques injections de poésie en moins. Sympathiques, mais pas mon sirop préféré. N'auront droit qu'à une dizaine de titres. Auraient doublé la mise qu'ils ne m'auraient pas davantage convaincu. Trop l'impression que pour eux le rock est né en France dans les années 80, racines trop courtes.
WASHINGTON DEAD CATS
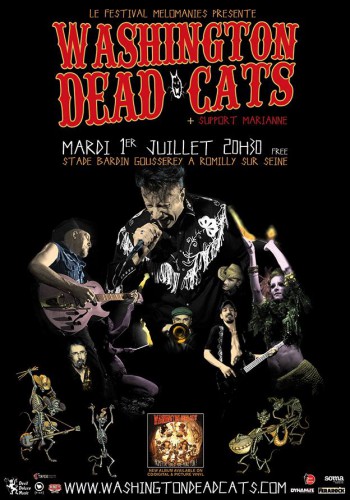
C'est pour eux que je suis venu. Sont dans le métier depuis trente ans, mais pas encore l'occasion de les voir. Le groupe psychobilly le plus célèbre du pays, ce qui ne veut pas dire le meilleur. Sont de la mouvance Béruriers Noirs, des alternatifs inter zones mordant aussi bien sur le punk, le rockab, le ska, et autres facettes. Un peu anarchisants et antifachistes, surtout connus pour les homériques batailles de légumes qu'ils provoquaient durant leurs concerts, du temps de leur folle jeunesse. C'est sûr qu'un jet d'artichauts c'est moins dégoûtant qu'un glaviot de fond de gorge et nettement plus écolo-destroy dans l'esprit. Bref des allumés de première qui se définissent comme punkabilly.

Trois devant, trois derrière. Première ligne au centre Mat dans une chemise country à frange que n'aurait pas renié Roy Rogers, à sa droite Lord Fester, gentilhomme de fortune, arborant couvre-chef de pirate homologué cent pour cent Caraïbe, à sa gauche Carlos et sa basse. Deuxième ligne. A l'extrême gauche Seaweedyo, pas un marin d'eau douce de la batterie, en fait avec Mat et Fester ils forment à eux trois le triangle maudit des Bermudes. Dispensateurs d'énergie infinie. Sur sa droite, The Molls est à la trompette et Kallhim au saxophone, les autres font tellement de boucan que l'on a du mal à saisir leurs interventions, semblent un relégués au bruit de fond.

Mat mène le bal dans sa chemise rouge. Chante et saute. Saute et chante. Une voix infatigable, peut crier et hurler tout son soul sans que les cordes vocales cassent. Pour les bonds en hauteur reportez-vous au genre d'acrobaties auxquelles se livrait Pete Townshend avec les Who. La guitare en moins. Car celle-ci c'est le Lord festin d'amirauté qui s'en charge. Vous bazarde des riffs qui ressemblent à des bordées de canon. Et il ne tire pas à blanc. Un équipage de vieux pirates qui n'ont pas froid aux yeux. Z'ont l'habitude des coups de vent et des abordages.

La section cuivre parvient maintenant à se faire entendre. Jouent rarement ensemble. A toi mon vieux pour ce coup-ci, c'est moi qui prendrai le chorus suivant, le sax semble vouloir avaler le micro et la trompette souligne les moments décisifs. Sur un des morceaux le trompettiste s'emparera d'une acoustique et se débrouillera mieux que bien, apportant un parfum rhum-raisin très particulier dans le magma sonore. Tous deux délimitent la base d'un second triangle dont Carlos est le sommet. Très remuant d'ailleurs. Tête folle et mouvante. L'élément incontrôlable qui intervient à volonté. Quelques grenades sur la tête de l'ennemi ne peuvent pas vous faire de mal.
Les frères de la côte ont le sourire aux lèvres. Seaweedyo martèle un rythme incessant. Le public danse sur place et leur est tout acquis. C'est huilé à la perfection avec tout ce qu'il faut de semblant de spontanéité et de fraîcheur pour plaire. Des loups de mer qui sont revenus de tous les naufrages et qui n'entendent pas s'en laisser conter. Terriblement entraînant. Très festif. Trop festif. Quelques accélérations punks pour rester fidèles à leur légende, deux titres vaguement rockabilly, quant à la folie psycho elle s'est transformée en bonne humeur généralisée. De la belle ouvrage, mais le navire navigue en eau calme et ne s'approche pas des récifs par trop aiguisés. Ce n'est pas ce soir que la coque and roll s'ouvrira en deux comme la quille du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Hélas ! L'on pensait chercher fortune au bout du monde en des contrées inexplorées et tout se déroule, comme une croisière programmée, à la bonne franquette.

Un moment de joie et de défoulement. Sur le dernier morceau Mat s'affuble d'une défroque de léopard qu'il jette sur son épaule comme une toge romaine. Mais il ne suffit pas de se draper de la peau du guépard pour l'avoir tué. Les cats ont en général la vie plus dure que cela. Les Washington Dead Cats ronronnent un peu trop sur le canapé du bien-être. Reçoivent toutes les caresses du monde, mais nous les préférons plus faméliques.

02 - 07 – 2014
RHESUS HK / T.A.N.K
Soirée métal. Comme par hasard la copine prétexte d'une grande fatigue. La veille pour les chatons facétieux de Washington elle s'était montrée très enthousiaste, mais les filles n'aiment pas s'amuser avec les chars d'assaut. Elles regardent les grands gamins que nous sommes avec commisération, et soupirent avec condescendance... L'enceinte est remplie à ras bord. Beaucoup de fans, mais tout le monde a fait un effort, c'est une incroyable collection de T-shirts qui s'offrent au regard. Toute l'histoire du hard sur mannequins, de Deep Purple à Trivium. Le métal décline ses divisions. Mais déjà Rhesus HK monte sur scène.
RHESUS HK

Human Karactéristics de Rhesus : assez difficiles à définir, un combo qui n'a pas encore parfaitement modelé son image mais qui possède de sérieux atouts. Apparaissent de prime abord comme des gars sympathiques mais un groupe de métal se doit avant tout de correspondre à sa propre auto-mythologie. Il ne suffit pas de bien jouer, il faut proposer du rêve, du cauchemar et de l'angoisse à l'imaginaire des fans. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain, lui faut aussi la violence idéographiée et scénarisée des jeux du cirque. Les politiciens sont parfaitement au courant de cette double postulation, même si à notre époque les foules anonymes se contentent d'ersatz frelatés. Le succès du métal en tant que genre réside justement en ces emblématiques engrammes musicaux que les grands groupes parviennent à créer. Dans nos sociétés marchandes l'emballage est le premier et principal vecteur publicitaire du produit. Si le métal en ses nombreuses déclinaisons séduit tant d'adolescents et de jeunes en révolte, plus ou moins conscientisée, contre l'existence unidimensionnelle et préfabriquée qui les attend, c'est qu'il s'est paré des couleurs fascinantes des écailles du serpent. Dans la scène primitive du jardin paradisiaque ses yeux ne se sont pas portés sur le sexe dénudé d'Eve – rompant ainsi la sainte trinité du rock'n'roll – mais sur la promesse de mort du reptile originel. Aux roses épineuses de l'éros le métal a préféré la sombre noirceur de thanatos. Ont été ainsi ressuscitées les danses macabres médiévales, ces charrettes rituelliques du passage de la grande faucheuse suivie son cortège de zombies assoiffés de notre sang et de monstres répugnants qui ne sont que les prophétiques dessins grossièrement coloriés des emprisonnements divers qui nous guettent afin de nous maintenir dans le carcan des vies serviles que la modernité nous réserve. Alors quand Vincent nous salue d'une manière par trop débonnaire, nous promettant une super soirée, l'on préfèrerait une entrée en matière beaucoup plus rentre-dedans. L'on aimerait mieux entendre se soulever les pierres tombales des vieux cimetières sous la lune chers à Lovecraft ou au moins ouïr dans les bas-fonds nauséeux de notre inconscient le miaulement sinistre, annonciateur du désastre, du chat noir d'Egard Poe.

Pourtant Vincent est un poème à lui tout seul, ajoutez-en quatre comme moi et vous aurez une idée du gabarit de la bête sous ses cheveux bouclés. Arbore un immense t-shirt noir de Motorhead comme une déclaration de guerre. Sûr qu'ils ne vont pas nous jouer de la musique de premiers communiants. L'a pas saisi le micro que l'eau des bénitiers a dû croupir instantanément dans les églises à dix kilomètres à la ronde. Une voix de sulfure, un glapissement hypnotiseur, un raquèlement de reptile en rut, et la musique derrière qui vous tombe dessus comme une chape de plomb liquide. La batterie lourde comme une moiteur d'orage qui part en Flèche, la basse de Geoffrey qui déploie les bannières noires du désespoir, et les deux guitares de Marcus et de Blake qui vous hachent le tout menu, menu. Les séquences sonores se succèdent, pas trop vite, l'on perçoit très bien la pulsation binaire de base qui nécessite des plans relativement longs pour dresser les décors mentaux.

Public un peu mou qui va s'y mettre peu à peu pour finir en un pogo d'enfer. Trois ou quatre fois Vincent interrompt la montée en puissance du show pour faire la promo de T.A.N.K., c'est très bien de penser aux copains mais pour le moment c'est le sang du Rhesus HK que l'on aimerait voir couler à flots. Lorsque Sénèque s'est ouvert les veines, n'a pas passé son temps à prédire ce qui se passerait après lui, s'est contenté de jouir de la mise en scène de son propre trépas, n'interrompez pas notre petite mort extatique de coureur de concerts pour nous signaler que celle qui vient après sera encore meilleure.

Parfois maladroits, leur manque une vision d'ensemble, un projet architectural sonore et imaginal, mais les fondations sont solides. Une prestation qui finira par emporter l'adhésion du public, davantage métal rock que métal death à mon humble avis, définition qui a son importance car c'est sur la réalité de ce que l'on est que l'on construit les plus belles machines de guerre et non pas sur la fantômatique matière dont on s'imagine être constitué. Genre de groupe dont un producteur pygmalion aimerait s'occuper. Empli de possibles qui ne demandent qu'à se matérialiser. Encore faut-il reconnaître dans la couvée les oeufs de feu et de dragon.

Rhesus HK, bon sang ne saurait mentir. Laissez-lui le temps de coaguler.

T.A.N.K
THINK OF A NEW KIND

L'acronyme est un programme à lui tout seul. Les chenilles du blindés sont une chrysalide. Le métal conçu comme un augure d'annonce nouvelle. Le volume sonore vous submerge mais tout se passe dans la tête. Derrière les parois étanches de la boîte crânienne, les écoutilles sensorielles fermées à tout jamais, que l'on appelle aussi les portes de la perception. Deux images sont dressées sur la scène. Un scaphandrier qui semble sorti tout droit des illustrations de Vingt Milles lieues Sous La Mer, l'homme dans son aquarium de verre, réduit à ses seules forces, et sur le second panneau une espèce de mutant, silhouette humaine encore mais dont la langue est une longue queue de reptile, un horrible travailleur, un destructeur d'anciennes stèles, un forgeron wagnérien qui n'en finit pas de battre le fer tant qu'il est poussière agglomérée de foudre. La tétralogie comme l'anneau de feu et du métal le plus précieux et oeuf originel de tous les groupes de métal. La musique comme la philosophie s'expérimente à coups de marteaux.

Trois en lignes longues chevelures tourbillonnantes et guitare à fond la caisse. Et sur les caisses derrière Clem caché par une forêt de cymbales dressées comme des totems claniques. N'ont pas commencé depuis quarante secondes que l'on est transporté dans un autre univers. Bye ! Bye ! Romilly et les copains, nous vivons une expérience de transformation génétique. Nous sommes des mutants. C'est désormais du métal liquide et mercuriel qui coule dans nos veines. La violence peut être aussi régénératrice. Le rock conçu comme un véhicule de délocalisation. Ces chaînes du cerveau que l'on abat pour le bûcher d'Hercule.

A la guitare Symheris, cheveux blonds de sirène, ces oiseaux de malheur au chant mélodieux qui s'emparent de vous pour mieux concasser la moelle de vos os sur les blancs rochers de son repaire. L'est accroché à son instrument comme le naufragé sur son radeau. Parfois ses deux mains montent sur le manche, ses doigts s'accrochent aux cordes comme des pattes d'araignées et dans la tempête sonore qui submerge tout l'on entend comme des notes féériques, des perles de cristal qui tombent une à une dans la fournaise et l'on a l'impression d'un chant d'alcyon qui suspend pour quelques secondes la colère de l'orage, un leurre pour que le tsunami redouble d'efforts et emporte à jamais les frêles coquilles de nos âmes vers d'épouvantables naufrages.

Raf est au chant. Frêle comme une aile de goéland que l'on aperçoit de temps en temps battre selon les reflets de la lune noire dans le maelström barbare qu'est devenu l'espace. S'avance et recule. Ne prend le micro que le temps d'injurier les dieux de l'abîme en un étrange sabir guttural, qui résonne comme des fragmences de rêves éteints. Cendres d'empires et pires que cendres. Puis il se retire au fond de la scène, mais revient fidèle au rendez-vous des flots qui recouvrent le monde de leur haine salée.

Le jumeau démoniaque de Symhéris se nomme Oliv. Noires sont ses lignes de basse, ne ponctue pas le halètement incessant de la batterie de Clem, tout comme Edd à la rythmique, donnent l'illusion – mais en est-ce vraiment une ? vu la richesse du son, de jouer en solo. Une prestation impeccable, du début à la fin. Pogos déclinés sous toutes ses formes de la bourrade amicale aux deux camps qui s'affrontent avec des mineaux d'une dizaine d'années qui traversent ces champs de forte amplitude chaotique pour mieux sentir l'ivresse du danger, Raf qui passe en rafale porté sur le dos à bouts de bras, T.A.N.K. soulève l'enthousiasme. De grande classe. Un set haletant. Un grand groupe.

Many t(h)ank(s).

( Somptueueuses photos signées LOR prises sur le facebook de Rhesus hk )
MELOMANIES
Y avait trois autres journées, un lundi ludique dénommée soirée humour ( !!! ) avec Radio Vitriol et Andreas et Nicolas, le genre de truc qui ne me fait pas rire, rock celtique et festif le jeudi avec les Ramoneurs de Menhirs et Seagulls Are Drunk, je ne me prononcerai pas même sous la torture, le doute de l'ignorance devant être porté au bénéfice de l'accusé, et reggae le jour du poisson en compagnie de The Riots et Isow, un style de musique qui m'a toujours coupé l'herbe sous les pieds.
Pour tous les goûts. Z'auraient quand même pu rajouter un dimanche rockab !
Damie Chad.
03 – 07 – 2014 / HD DINER OPERA / PARIS
GHOST HIGHWAY
Que se passe-t-il ? Attroupement devant les cafés. Paris serait-il en train de glisser vers un soulèvement populaire ? Hélas ! Non ! Ce ne sont que les fous du foot qui attendent la victoire de la France comme si leur sort allait s'en trouver subitement amélioré ! Le sport est devenu le second opium du peuple, d'autant plus dangereux que le premier, l'ancienne religion et son cortège de conservatismes et d'asservissements sociaux et culturels n'en finissent pas de relever la tête. Le temps de garer la teuf-teuf et la grande parousie nationale s'est dégonflée comme une baudruche crevée. Têtes baissées les supporters déçus regagnent tristement leur logis ramenées à l'étroitesse rabougrie de leur existence... Le coeur n'est plus à la fête.
Assistance parsemée dans le HD Diner Opéra qui a préféré miser sur le rockabilly que sur le grand écran footballistique. Quatre juillet, fête nationale américaine, rien à faire, ce soir l'on n'échappe pas aux pavillons parcellaires, vivement que la grande étamine noire de l'Anarchie triomphante recouvre les haillons colorés des différences identitaires à sinistre dessein savamment entretenues et cornaquées par les oligarchies financières qui gouvernent le monde. En attendant une femme et son enfant assis au bas d'un arbre juste en face de l'entrée du Diner mendient leur pain dans une indifférence quasi générale. La misère nous souhaite bon appétit.
GHOST HIGHWAY
Les Ghost sont en place quand Mister B and I pénétrons dans le bar. Nous sommes accueillis par That's Alright Mama joliment balancé. Sont dans leur coin, Phil dans l'encoignure, Jull serré contre le mur, Arno à ses côtés et surprise c'est Djivan des Howlin qui officie à la contrebasse. D'ailleurs ses deux complices des Canines Hurlantes sont venus le supporter. Ambiance décontractée, les Ghost filochent droit sans embardée. Un magnifique 'Cause I Forgot une compo de Mister Jull, un Hello Mary Lou qui permet à Phil de se charger de toute une partie du vocal, et pour le final un Folsom Prison Blues des mieux envoyés bientôt suivi d'un Flyin' Saucers Rock'n'roll à vous faire croire que les martiens sont en train de descendre de leur soucoupe sur le champ de Mars.

Fin du premier set. Les Ghost passent à table, chacun vaque à ses connaissances personnelles, cigarettes sur le trottoir, discussions diverses... Deuxième service, j'ai la chance d'avoir le nez à quatre-vingt centimètres de la guitare de Jull. Situation idéale pour lui piquer tous ses plans, le problème c'est que je suis incapable de faire vibrer correctement une seule corde. Pourquoi les Dieux ont-ils été si cruels envers ma modeste personne ? Pour Mister Jull, c'est le contraire, à vous faire crever de jalousie. Tant de facilité c'est à vous dégoûter. Jamais pressé et toujours sûr de lui. Comment vous dire ? Ne court pas après l'accord, pas le genre de gigolo à piquer un cent mètres après le bus, attend placidement sous l'abribus qu'il s'arrête juste devant lui et que les portes s'ouvrent en grand pour le laisser monter. Suffit de saisir l'instant. Concept philosophique du kairos longuement mis au point par les penseurs de la Grèce antique. L'instant K des sophistes – si l'étude des écrits de Gorgias et Protagoras vous rebute, servez-vous de la théorie du point G censé vous faire parvenir au summum de l'orgasme féminin, tout de suite je m'aperçois que votre intérêt se réveille – il ne s'agit ni de partir à temps ni d'éjaculer précocement, mais après une fine analyse de la situation initiée par les pairs du combo ou la partenaire en recherche d'absolu, d'intervenir au meilleur escient pour transcender une banale position de départ. Vous avez noté que cette façon d'entrevoir les ou la chose est en totale différenciation avec les théories restreinte ou généralisée de la relativité tant einstenienne que quantique. Bref pour Mister Jull l'accord riffique parfait est avant tout propice. D'où ce son très particulier des Ghost qui n'appartient qu'à eux.
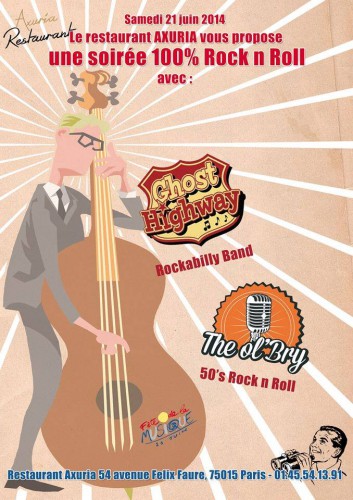
Phil est en grande forme, son petit espace de survie il l'agrandit en augmentant le volume sonore de sa frappe, vous ne me voyez pas, eh bien vous m'entendrez. Djivan se retient, n'est pas avec ses frères des Howlin, ici pas question de passer en force, il s'applique consciencieusement tout en prenant son air matois de cool cat qui n'attend que la première occasion pour se laisser aller à de plus sauvages chevauchées. Arno soulève l'enthousiasme de la salle et reçoit force applaudissements d'encouragement, s'y reprend à plus de dix fois pour parvenir à chanter l'intro de That's What Daddy Wants, étranglé d'un rire inextinguible dès les quatre premiers mots.
Lucas des Crocs Criants prend la gretsch de Jull sur Country Heroes tandis que Arno officie à l'harmonica. L'en profite le Lucas pour recréer la partie guitare à sa guise, nous gratouille une espèce de polyphonie intermittente des plus savoureuses, joue exactement ce à quoi l'on ne s'attend pas mais l'on est obligé de reconnaître la diabolique finesse de son interprétation. Il y a ceux qui suivent les recettes et ceux qui innovent pour relever les saveur.
Rien n'est à jeter dans ce second set qui débute par Matchbox et se termine par Johnny Law. Un Cherokee Boogie que l'on crédite souvent à Johnny Horton mais que pour ma part j'attribuerais plutôt à Moon Mullican, un des rares maîtres que ce soit reconnu Jerry Lee Lewis. Un Nervous Wolfman plus que réussi - les Ghost sont au mieux de leur forme sur leurs propres compos – et un Tired & Sleepy qui fit l'unanimité.

C'est fini. Et c'est là que survient l'amère déception : l'on croyait que les Howlin' Jaws allaient se mettre au boulot, mais la direction ne leur accordera pas la permission d'après-minuit. Heureusement que Phil possède l'antidote à mon chagrin. « Tu ne voudrais pas cela ? » me demande-t-il et il sort d'une boite en carton une dizaine d'exemplaires du nouveau 45 tours des Hawlin !
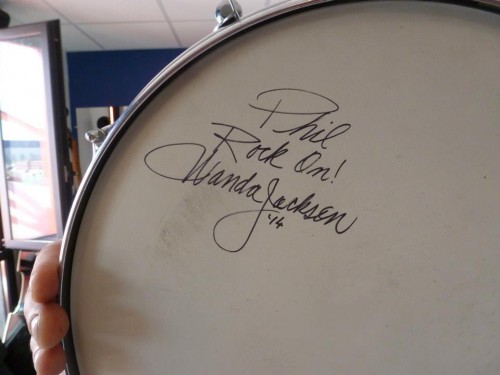
Les Ghost remballent leur matériel, dimanche Phil, Jull et Eddie et Thierry des Ol' Bry accompagnent Wanda Jackson sur scène à Tours. Adoubés par la légende.
THE HOWLIN' JAWS
SLEEPWALKIN' / BUMBLEBEE BOP

SPARKLY DESIGN / BLR STUDIO
Recorded Live At BLR STUDIO / 45 R.P.M
Belle pochette, style anglais, les trois Hawlin' vous regardent et dardent une moue de sourire franchement peu appuyé, blazers à glissières et cravates. Sobre, sur le fond moutarde de fines raies blanches comme une lointaine réminiscence du logo Sun. En banderolle noire, tout en bas une profession de foi : This some kind of stereophobic rock'n'roll sound. Tout un programme. Un bel objet digne des incunables du rock.
SLEEPWALKIN' : face A : ça devrait être interdit de laisser les somnambules courir sur les toits à cette vitesse. Accrochez-vous aux cheminées car les Hawlin' ne vous lâcheront plus, rien que les Ah ! Ah ! persifleurs de Lucas sont une invitation programmée au suicide. Aucun répit, de solo de guitare en break de batterie, font tous ce qu'ils peuvent pour précipiter un funeste trébuchement. Des garnements incorrigibles. Je ne parle pas des slaps de contrebasse, à croire que Djivan s'amuse au karaté à casser les tuiles et Baptiste qui suit immédiatement en portant le coup de grâce. Quant à Lucas il a la gratte expéditive, le premier à vous pousser sur la gouttière branlante. Des assassins en puissance. Le pire c'est qu'on le repasse dix fois de suite. On a toujours une petite préférence pour les seria kikllers rock'n'roll.
BUMBLEBEE BOP : face B : z'ont été punis de leur méchanceté, transformés en vilains bourdons. A eux de montrer comment ils savent s'y prendre. Ce n'est pas de tout repos. Des aviateurs fous qui ne maîtrisent leur appareil qu'avec difficulté. Une piste cahotante, parviennent à s'élever au-dessus de la cime des arbres, font les fiérots, pensent maîtriser l'univers, hélas en prenant davantage de l'altitude ils s'aperçoivent que ca tangue méchant. S'embarquent dans un piqué à vous oublier dans votre culotte. Redressent la situation on ne sait comment mais faut entendre les cris dans le cockpit pour comprendre que rien ne s'arrange et que tout s'aggrave. Se termine trop brutalement pour que l'on ose espérer un atterrissage en douceur. Quoique ces fous furieux soient encore capables de s'en tirer vivants et de nous refourguer dans trois mois un second 45 du même acabit.
Vous avez compris : accrochez-vous aux petites herbes car ce 45 tours risque de vous refiler le vertige jusqu'à la fin de vos jours. Médecine pas douce du tout. Mais très efficace au niveau rock'n'roll.
Damie Chad.
Nota : un petit test marrant : faites tourner le S(p)leepwalkin en trente-trois tours et vous croirez entendre un disque de british blues, entre Stones et Animals. Des petits gars vraiment pas sérieux, normal des rockers !
OUTSIDERS
80 FRANC-TIREURS DU ROCK
ET DE SES ENVIRONS
GUY DAROL
( CastorMusic ) / Juin 2014 / 450 pp )
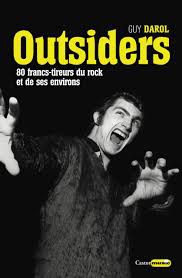
Chez Castor ( la dénomination complète se lit Le Castor Astral ) ils ont commencé dans les années soixante-dix par des recueils de poésie de parfaits inconnus, de vingt pages dactylographiées et ronéotées + couverture en carton coloré montée sur agrafes branlantes, quarante ans plus tard ils publient de véritables bibles de cinq cents pages en tout petits caractères. J'aurais beaucoup de choses à redire sur leurs choix poétiques qui privilégient des formes d'écriture selon mes propres présupposés esthétiques un peu trop faciles mais par contre leur collection musique me paraît nettement plus diversifiée et engageante.
Guy Darol un fan de Zappa, je vous conseille de visiter son blogue sur le net, des dizaines d'ouvrages chroniqués depuis des années sur différents journaux. Musique bien sûr mais aussi beaucoup de littérature et pas nécessairement ceux que l'on trouve en tête de gondole dans les grandes surfaces et malheureusement aussi de plus en plus souvent chez les petits libraires obligés de suivre le mouvement... je ne partage pas toujours ses choix mais je m'incline devant sa curiosité d'esprit et ses analyses pénétrantes.
Avis aux fans de rockabilly, tout surpris de retrouver l'ancêtre du psychobilly en première page. C'est uniquement parce que Hasil Adkins s'est mécaniquement imposé selon l'ordre alphabétique. Car par la suite les purs rockers se font un peu rares, un bel article sur Screamin' Lord Sutch en fin de parcours, avec au milieu une monographie sur Kim Fowley qui présida à la naissance du I'm Back, I'm Proud de Gene Vincent, et grosso modo c'est à peu près tout. C'est que Guy Darol est beaucoup plus attiré par cette mouvance qui s'est cristallisée autour de Captain Beefheart pour se perdre aujourd'hui dans l'estuaire du Noise. Evidemment si votre esthétique culmine avec les solo de Hank Marvin, vous êtes vite déçus. N'est pas non plus un monomaniaque, éprouve une tendresse toute particulière pour les réprouvés du folk et les dérangés du psychedelic.
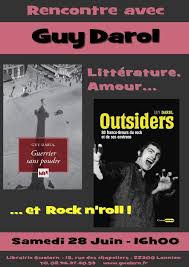
A mon humble avis, l'aurait dû ranger par ordre chronologique de date de naissance, l'aurait ainsi permis de mieux cartographier toute une génération née dans les années de la deuxième guerre mondiale, avec les précurseurs des années trente et les derniers arrivant des glorieuses sixties.
Reste à se demander pourquoi tous ces héros sont restés sur les bas-côtés de l'Avenue de la gloire. Facile de répondre qu'ils ne correspondaient pas au goût du public. Le livre permet de comprendre combien celui-ci est façonné par les intérêts pécuniaires des compagnies de disques qui préfèrent vendre des disques que prendre des risques. Ne sont pas des associations humanitaires à buts non lucratifs dont la fin ultime serait l'amélioration de l'espèce humaine. Mais ce n'est pas tout, que l'individu ne se décharge pas systématiquement sur le système.
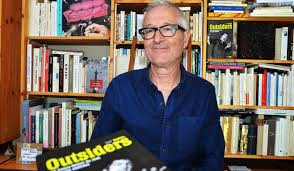
L'existe trois types de victimes plus ou moins consentantes. Ceux qui en toute connaissance de cause refusent la célébrité, qui préfèrent vivre dans un anonymat qui leur laisse toute liberté de circuler à leur guise sans être poursuivis par des hordes de fans en furie. Ceux qui depuis qu'ils sont tout petits sont déjà frappés de la cafetière, des paranoïaques congénitaux qui s'imaginent qu'à trois ans un monstre est sorti de la télévision pour les dévorer, des skizoïdes à double inconstance, gentil garçon côté pile et déglingué notoire côté face. Vous ne pouvez pas faire grand chose pour eux. Même la médecine se révèle impuissante. Enfin le gros du bataillon, ont eu vingt ans autour de Woodstock, l'abus de LSD, de petites fumées et diverses autres substances hallucinogènes les a implacablement détruits. Pour un Hendrix étouffé dans son propre vomi combien d'illustres inconnus obligés de se retrouver en asile psychiatrique pour comportement erratique. On a cru que l'on ouvrait les fameuses portes des perceptions chères à Jim Morrison quand souvent on ne faisait que refermer sur soi les portes de l'enfer du manque et de la pleine folie.
Difficile de gérer de tels types d'artistes. Guy Darol se contente de les disséquer, avec tendresse. Ne porte à leur encontre aucun jugement moral. Déroule les faits mais ne se pose pas en pépé-la-morale. Souligne avant tout leur contribution à la saga du rock'n'roll. Certains inconnus sont bien plus dignes d'estime que des vedettes mondialement reconnues. Beaucoup sont venus trop tôt pour être compris et les autres trop tard pour être jugés avec bienveillance. Le dictat des modes est un couperet aussi tranchant que la guillotine. Toutes les chroniques sont bâties sur le même modèle : commencent par une évocation poétique de la trajectoire et finissent par une courte discographie, souvent de récentes rééditions. Car la vraie vie de ces existences ratées ne se résument pas en une monographie centrale constituées de lettres et de mots, ils ont avant tout produit des musiques, curieuses, novatrices, oubliées... Le mieux est de lire en farfouillant dans sa bibliothèque à la recherche des disques perdus, et les oreilles surfantes sur le net via YouTube et consorts.
Guy Darol nous apprend – qu'il en soit remercié - à être modestes : nous sommes loin de tout connaître, nous dessine la cartographie de continents auditifs sur lesquels nous n'avons jamais abordé, nous remet en perspective des faits auxquels nous n'avions prêté que peu d'importance, bref il chamboule quelque peu la représentation d'une histoire du rock que nous croyions définitives et inamovibles. Le bouquin est un peu trop épais pour l'avoir sans cesse sur soi, dans la poche revolver entre votre fiole de whiskies et vos bank-notes en papier de monnaie de singe. Dommage. Car c'est de l'or en barre.
Damie Chad.
L'ARPEGGIO OSCURO
www.arpeggio-oscuro.fr
Suivez avec nous chaque semaine le nouveau roman-feuilleton imaginé par Hervé Picart, l’auteur de L’Arcamonde. Accompagnez le musicologue londonien Vernon Gabriel, amateur de rock patiné et d’instruments millésimés, dans l’étrange enquête qu’il doit entreprendre sans l’avoir souhaité. Découvrez le lien improbable qui unit d’idéalistes musiciens du Siècle des Lumières et les membres d’un groupe de heavy metal tarabiscoté, disparus les uns après les autres, tous victimes de leur quête d’un schéma harmonique périlleux. Pénétrez au cœur du mystère de L’Arpeggio Oscuro.
Est-il besoin de spécifier que le dénommé Hervé Picart tenait la rubrique des disques de Hard-Rock dans la légendaire revue BEST ?
Mis en ligne toutes les semaines depuis la fin 2013, 33 épisodes déjà parus.
Bonne lecture !
22:41 | Lien permanent | Commentaires (0)