28/03/2014
KR'TNT ! ¤ 182 :VANILLA FUDGE / SUBWAYS COWBOYS / ATOMICS / MEGATONS / DUKE ORPHANS / BIBLE PUNK
KR'TNT ! ¤ 182
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
28 / 03 / 2014
|
VANILLA FUDGE / BIBLE PUNK / DUKE ORPHANS / SUBWAY COWBOYS / THE ATOMICS / MEGATONS |
LE DIVAN DU MONDE / PARIS
14 - 03 - 14 /
VANILLA FUDGE
VANILLA RAPPELLE-TOI
QUE JE NE SUIS RIEN SANS TOI

Si on reconstituait la tablée des dieux de l’Olympe aujourd’hui, on y trouverait le Vanilla Fudge, Chris Farlowe, Howlin’ Wolf, Dave Wyndorf et Mark Lanegan.
Aussi loin qu’il m’en souvienne, les Vanilla Fudge ont toujours sonné comme des titans, même si certains de leurs albums n’étaient pas d’un abord facile.

Leur premier album fut un album de reprises. La version de «Ticket To Ride» avait quelque chose d’extatique au sens hallucinogène de la chose, chantée à deux voix et doublée d’une dentelle de guitare signée Vinnie Martell. À l’époque, Vinnie était encore un kid new-yorkais bien coiffé et souriant, comme on peut le voir au dos de la pochette de cet album paru en 1967. Deux ans plus tard, il allait changer de look et ressembler à un soudard espagnol du XVe siècle.
Sur ce premier album, ils recuisinaient aussi le hit des Zombies, «She’s Not There» et trempaient dans le jeu des dérives expérimentales. Sur l’autre face, on trouvait cette reprise de «You Keep Me Hanging On» des Supremes qui les fit connaître, bien grasse et noyée d’orgue, vautrée dans la puissance et bombardée de notes de basse. Tim Bogert allait devenir LE bassman américain. En 1967, il portait déjà des lunettes à montures d’écailles, comme celles de Woody Allen, et il allait tout au long de sa carrière conserver le même look, avec les cheveux un peu plus longs. Son compère batteur Carmine Appice allait former avec lui la rythmique de rêve que tenteront d’enrôler pas mal de gens. Jeff Beck réussira à enregistrer un album avec eux.

Sur ce premier album du Vanilla Fudge, on trouvait aussi une fabuleuse reprise de «Take Me For A Little While» (Dusty Springfield), qu’ils faisaient monter en mayonnaise. Quand on écoutait cette reprise d’une puissance quasi-indescriptible, on s’en décrochait la mâchoire. Ils faisaient monter leur truc cran par cran, un violent break de basse stoppait tout et la chape retombait ensuite.
Avec ce premier album, le Vanilla Fudge imposa un son unique au monde. La voix d’ange de Mark Stein était montée sur le shuffle le plus puissant qui se put concevoir à l’époque. Ni Graham Bond ni Brian Auger ne pouvaient rivaliser avec un tel son.

Mais après ça, les fans allaient en baver des ronds de chapeau. Il fallut une certaine constance pour accepter les deux albums suivants, «Renaissance» et «The Beat Goes On».

Au tout début des années 70, on trouvait facilement de beaux pressages américains de «Renaissance» dans les bacs des second-hand record shops de Portobello. On ramenait ça fièrement à la maison, on s’asseyait sur le petit lit, on s’allumait un stick bien mérité et on mettait le disque en route. Et crac, on avait la mâchoire qui se décrochait, car le Vanilla Fudge avait viré prog et toutes les compos s’égaraient dans les sables du désert, à l’exception de «That’s What Makes A Man» qui entrait dans la catégorie du balladif heavy. Sur l’autre face, Vinnie Martell tentait de sauver du désastre «Faceless People» en bavant du gras. Mais le reste de l’album était désespérément mou du genou et proggy. Rappelons que le prog et le rock FM furent les deux plus grands fléaux du XXe siècle.
Nouveau traumatisme avec l’album suivant, «The Beat Goes On», une espèce de collection d’exercices de styles qui montrait à quel point ces mecs étaient doués. Ils tapaient dans des trucs comme «Hound Dog», dans un medley Beatles, et recuisinaient le fabuleux «The Beat Goes On» de Sonny & Cher au shuffle, mais tout cela était coupé en rondelles et on se retrouvait avec une fois de plus un disque incroyablement baroque et foncièrement anti-commercial. Ils proposaient tout simplement une histoire de la musique à travers les âges, on passait du ragtime des années 30 aux élans classiques de La Lettre À Élise, dont visiblement Mark Stein était fan. Le Vanilla Fudge pouvait TOUT jouer. Et mieux que quiconque. Mais ce n’était pas ce qu’on attendait d’eux. On voulait de la viande. Du gros shuffle fumant. De la lourdeur phénoménale.

Il faudra attendre la parution de «Near The Beginning» pour renouer avec l’énormité, et notamment leur morceau phare, «Shotgun», qui reste l’archétype du rock colossal, du rock des titans, avec ce chaos de lignes de basses, ce shuffle des océans hugoliens, ces phrasés de guitare d’auberge espagnole, ce drumming poundé des galères phéniciennes, et ces explosions de bouquets de chœurs extravagants. «Shotgun» est une mine d’or Inca, un réservoir inépuisable d’explosivité hystérique et de relances mirifiques. Il n’existe pas de dimension plus spectaculaire que celle du Vanilla Fudge. S’il ne devait rester qu’un seul morceau de ce groupe, ce serait «Shotgun». On trouve aussi sur ce disque une version magistrale de «Some Velvet Morning», un hit de Lee Hazlewood. Ils en font la musique du paradis sur terre, le son de la pureté blanche et de l’excellence impavide, l’heureuse élection de l’élusivité fluide. Et puis des nappes d’orgue hautement significatives s’écartent comme des nuages pour laisser place au vide lumineux du dogme, On goûte cette subtilité longiligne, on voit au loin cette effluve s’étendre par dessus les cimes. Le Vanilla Fudge recherche l’extrême clarté de la pureté, le ton sensible du chant réduit à sa plus simple expression de filet harmonique douceâtre.

Le dernier album du mighty Fudge parut en 1969. Comme il s’appelait «Rock &Roll», on espérait voir arriver le plus gros disque de rock américain de tous les temps. Si un groupe était capable de ça, c’était le Fudge. Il faut quand même rappeler qu’à l’époque aucun groupe américain ne leur arrivait à la cheville. Pochette superbe, Rock &Roll en ultra-bold rouge sur fond blanc - radicalité bien affichée - et au dos, on les voyait tous les quatre photographiés sous des néons, affichant des mines patibulaires. Et crac, on se prenait «Need Love» dans les dents, une pétaudière secouée de télescopages, un véritable empire du chaos, ça hurlait à bon escient, ça nous shufflait dans les pattes, les notes de basse sifflaient dans tous les coins, c’était un vrai morceau sauvage, au sens de l’étalon indomptable. Mais la suite de l’album n’allait pas être à la hauteur de «Need Love», hélas. Malgré son soul-punk blast in the face, si big bash stab de bass dans le bide et son harsh break down in the guts, «Street Walking Woman» allait se perdre dans des accalmies. On soupçonnait le Vanilla Fudge de jouer avec nos nerfs. Sur la face B, ils tapaient dans Michel Legrand, avec une reprise héroïque de «The Windmills Of Your Mind», monstrueusement bien chantée par Mark Stein, grand amateur de cimes.
Un Mark Stein qui aime à s’exiler dans les limbes du Pacifique. Et on comprend que le Vanilla Fudge ne recherche pas le succès commercial. Tout ce qui les intéresse, ce sont les télescopages de trains de notes et les explosions faramineuses. Sur tous ces morceaux, Tim Bogert joue des trilles de notes en permanence. Dans le milieu new-yorkais, on l’appelle l’Omniprésent.
Avant de choisir le nom de Vanilla Fudge, ils s’appelaient les Pigeons. On trouve un album de reprises paru en 1973 sur lequel Mark, Tim et Vinnie (Carmine n’est pas encore là) tapent dans «Midnight Hour» (version swing), «Upset The People» (reprise de Charles & Inez Foxx, brillants swingers mal connus, mais on sent bien la magie des sixties) et «Mustang Sally» (reprise groovy, incroyablement décontractée).
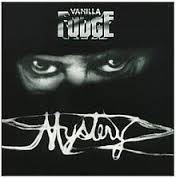
«Mystery» est l’album de la première reformation, en 1984. Comme l’indique la date, c’est une catastrophe. Le Vanilla Fudge nettoyait son son et tournait presque disco. C’est l’époque qui voulait ça. En plus, on avait déjà noté quelque chose de louche chez Carmine. Cet abominable frimeur avait co-écrit «Do Ya Think I’m Sexy», le fameux hit qui couvrit Rod Stewart à la fois de gloire et de honte. Le seul morceau intéressant de «Mystery» est la reprise du «Walk On By» de Burt Bacharach, rendu célèbre par Dionne Warwick (et ne venez pas me parler de la version des Stranglers, par pitié !) On retrouve dans cette version le mélange mélodie/soutien logistique qui fit la grandeur du Vanilla Fudge, et qui est aussi et surtout le secret de la victoire, comme l’indique Clausewicz.
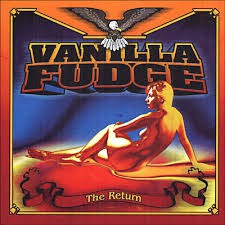
Le groupe se reforme une nouvelle fois au début du millénaire et nous balance en 2004 un brillant album intitulé «The Return». Bill Pascali remplace Mark Stein au chant et à l’orgue. On retrouve la puissance maléfique du groupe dès le premier titre, «Ain’t That Peculiar» et la guitare flash de Vinnie Martell. Pour cet album inespéré, ils vont rejouer leurs reprises des débuts, avec encore plus de verdeur, comme si cela était possible. «You Keep Me Hanging On» monte bien en température, et on assiste à la transformation alchimique de l’énormité Tamla en énormité Vanilla. C’est la grande transmutation des temps modernes. Ils transforment l’or du Tamla Sound en océan de vase. Spectaculaire. La mélodie se prête suprêmement aux coups de boutoir du bouc Vanilla. Version dévastatrice de «Shotgun», l’un des morceaux les plus énormes de l’histoire du rock américain, faut-il le rappeler ? Bill Pascali joue la carte du guttural. C’est monumental. Ça balaye les scories. Ils lèvent des vagues de shuffle démentes. Ils parviennent même à dégager les bronches des dieux nordiques. Et ils donnent le coup de grâce avec une resucée de «Take Me For A Little While», ce heavy Tamla sound qui est la marque jaune du groupe. Génie à l’état pur. C’est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Ils lâchent aussi une version rabelaisienne de «Good Lovin’», définitive, intense et brûlante, parcourue de solos de lave, l’archétype du hit puissant qui dégouline de partout, une sorte de hit ultime asphyxiant. La version de «Need Love» qui est sur ce disque sonne comme une déclaration de guerre à l’orgue. Aucun espoir de paix. Puis ses trois accords nous embarquant dans le plus délicieux enfer.

Il existe un live du Vanilla Fudge enregistré en Allemagne et qui donne une idée de la puissance dévastatrice du groupe sur scène, «Good Good Rockin’». Bill Pascali remplace l’immense Mark Stein et un autre rital du nom de Teddy Rondinelli se prend pour Vinnie Martell. Les pauvres Carmine et Timmy ne disent rien. Ils se contentent de subir. L’âge a ses raisons que le cœur ne veut connaître. Comme Russell Hunter et Duncan Sanderson (Pink Fairies) d’une part, et Billy Talbot et Ralph Molina (Crazy Horse) d’autre part, ils ont réussi, en n’étant que section rythmique, à préserver le nom du Vanilla Fudge. On retrouve sur ce disque toute la fantastique urgence et le son de cathédrale des disques d’antan. Dans l’imaginaire des rockers de banlieue, le Vanilla Fudge était aussi excitant que Little Richard. Ce sont des artistes dont on attendait tout, principalement de la sauvagerie et de la démesure. Ils mirent à bas bien des basiliques.
Ils démarrent ce set live avec «Good Good Lovin’» et bien sûr ils défoncent les annales de la postérité. Ils restent les plus grands pourvoyeurs de shuffle de l’histoire d’Amérique. Dès l’ouverture du bal, on se retrouve avec un truc épouvantablement destructeur sur les bras. C’est exactement la même chose que l’album live de Blue Cheer enregistré au Japon : on se retrouve plongé dans la fournaise de la légende. En seulement deux morceaux, on est au tapis : «Take Me For A Little While» et «Shotgun». Tout va dans la démesure. Ils sont pharaoniques. Ils défoncent tout sur leur passage. Ils lissent les grumeaux, ils rasent les montagnes. Ils posent une voix d’ange mélodique au sommet d’une machine de guerre sonique, certainement la plus puissante du monde. Avec le Fudge, tout n’est que force, caste et implosion. Ils replongent comme des marsouins dans une mer de lave. Ils nagent ouvertement, ils font des brasses expiatoires dont la mesure échappe à la raison. Bill Pascali va chercher le guttural. Et pour «Shotgun», Carmine prépare la sauce : puissant drumbeat et tout s’écroule comme les fameuses falaises de marbre de l’Apocalypse sur la gueule des dieux occupés à festoyer. Véritable punk blast, un genre qui n’existe pas ailleurs. Carmine le vital fait péter ses peaux dans une chaleur d’étuve. «Shotgun» est un immense classique, une masse impérieuse, l’un des plus gros cataplasmes de l’histoire du rock insurrectionnel. S’il est une musique épique, c’est bien celle-ci. Des giclées dans tous les coins, ça explose encore et encore. Puis nouveau raid sur «She’s Not There», c’est à l’image du Fudge, indécent de puissance voluptueuse. Dommage qu’ils fassent des morceaux de six à huit minutes, mais n’est-ce pas le temps qu’il faut à un monstre pour sortir de sa torpeur ? Ceux qui ont survécu à pareille vision sont les seuls à pouvoir le dire, mais il n’est pas sûr qu’on puisse trouver un survivant. Le monstre éveillé chope sa proie dans la seconde, tout le monde le sait.
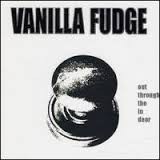
Faut-il en conclure que le Vanilla Fudge n’est bon qu’à faire des reprises ? On serait assez proche de la vérité, puisqu’une de leurs dernières manifestations est un album de reprises de Led Zeppelin, rien de moins. La bêbête s’appelle «Out Through The In Door». On retrouve nos alchimistes préférés dans la formation originale. La version qu’ils font de «Immigrant Song» est titanesque. «Ramble On» qui suit n’est pas vraiment une grande chanson de Led Zep. Le Vanilla Fudge transforme ce pauvre morceau en groove énorme. Les nappes d’orgue de Mark Stein balayent tout. Il répand des nappes gigantesques et majestueuses. Pour l’oreille, c’est une bénédiction. Le petit sucre d’orge de Led Zep est traîné par les cheveux jusqu’au sommet de la soul. Le miracle s’accomplit. Le Vanilla Fudge croise les prodiges de la soul blanche avec la puissance du grand rock américain. Difficile de faire mieux. Ils sont vraiment les seuls à opérer à cette altitude. «Dazed and Confused» est l’un des sommets du premier album de Led Zep. Mark Stein tient le morceau par la barbichette. Il se pose sur l’énorme drive de basse. Très vite, les claviers volent à son secours. «Dazed and Confused» est un blues prodigieusement désespéré. Mais Mark Stein ne va pas chercher les éclats déchirants de Robert Plant. Le Vanilla Fudge se focalise sur les questions de punch. Ils adorent jouer les puissances rampantes. Comme tous les morceaux du Led Zep I, «Dazed and Confused» est splendide, jusqu’au moment où ça se transforme en marécage. C’est le passage lugubre et ennuyeux où Jimmy Page joue de l’archet. Et puis la machine se remet en route, sauf que chez Vanilla Fudge, la machine est une grosse bête de compétition capable de rivaliser avec les Blue Flames ou le Family Stone de Sly. Le thème de «Dazed and Confused» est assez lourd. C’est d’ailleurs le fouillé des transitions qui rendit ce morceau impropre à la consommation de masse. Les gens ne savaient plus quoi faire des grands passages aléatoires où naviguait l’archet de Jimmy Page. «Baby I’m Gonna Leave You» est l’un des sommets de Led Zep I. C’est quasiment intouchable, comme l’est «Never Mind The Bollocks». Mark Stein prend doucement son envol. Il n’a pas froid aux yeux. Il s’attaque à un morceau parfait, admirablement chanté par Robert Plant. Mark Stein est un peu plus rustique au niveau chant. Ils ne sont bons que dans le groove. Il leur faut de la matière à groover. Mark Stein ne grimpe pas dans les aigus. Non, il ne veut pas. Il reste bien au sol. Ce mec a des qualités exceptionnelles. Il sait chauffer un couplet. Il a la voix des grands décideurs. Un couplet ne peut pas lui résister. Mark Stein a un charme fou. Un solo de guitare vient signifier l’envolée, alors qu’on attend le hurlement de Robert Plant. La version est épaisse, infiniment moins fine que l’original, mais elle a des qualités intrinsèques qui relèvent d’une mystique heavy - walking through the park/ evvvery day ! Dommage que le Vanilla Fudge n’ait pas tapé dans «Communication Breakdown» et «Since I’ve Been Loving You». On trouve aussi sur ce disque de reprises l’anodin «Moby Dick» et son pénible solo de batterie. C’est d’ailleurs «Moby Dick» qui a ruiné le Led Zep II.
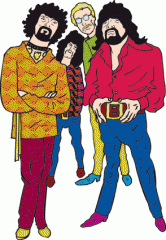
Le Vanilla Fudge a toujours adoré les friandises anglaises. Ce sont des amateurs de bonbons à la menthe. Du coup, les chansons de Led Zep sonnent comme de la variété dans les pattes des affreux new-yorkais. Ce ne sont pas les reprises du siècle. Il manque une chose capitale dans cet album de reprises de Led Zep : la démesure, celle à laquelle le Vanilla Fudge nous a toujours habitués. Ne nous morfondons pas trop vite car voilà Vinnie Martell au chant pour une reprise de «Rock’n’Roll». Leur version est cocasse. Vinnie Martell monte très haut pour retrouver les accents du chant hurlé de Robert Plant - houllière houillère ! c’est la bande-son de Germinal. La version est solide, pleine de vox et de notes d’Hammond. «Your Time is Gonna Come» vient aussi du premier Led Zep. Ce morceau est une bénédiction. On attend encore des miracles du mighty Fudge. Mark Stein joue un classique de l’orgue de barbarie en guise d’intro. Le Vanilla Fudge renoue enfin avec le shuffle. Mark Stein bat Robert Plant à la course. Il tortille son chant de manière subversive. Il en fait un gospel dantesque et la grande machine fudgienne se met enfin en route. Basse en folie, nappes d’orgue, démolition drumbeatique, ces gens-là n’ont plus rien d’humain.

Miraculeusement, le Vanilla Fudge débarque à Paris par un beau soir de mars. C’est la formation originale, mais sans Tim Bogert, remplacé par un certain Pete Bremy. L’air est doux et le métro gratuit, à cause d’un pic de pollution. Le Divan du Monde les reçoit. Pas de première partie. Wow, les voilà sur scène, à la fois humains et mythiques. Sans âge. Voici deux mille ans, des Grecs d’Athènes ou de Sparte les auraient acclamés comme des demi-dieux. Vinnie Martell, tout de noir vêtu, Gibson en main, au centre du monde. Derrière, Mark Stein, barbu et chevelu, assis derrière son orgue, impétueux, piaffant d’impatience. Plus haut sur l’estrade, Carmine Appice, tête de pirate, moustache en croc, et qui rend hommage au public et à Christophe, qu’il a accompagné à l’Olympia. Et puis le remplaçant de Timmy, Peter Bremy, casquette et T-shirt. Ils attaquent avec «Ticket To Ride» et chacun sent monter les frissons, car le son est là. Ils vont enfiler toute leurs reprises classiques comme des perles, «Some Velvet Morning», «Season of The Witch», «Take Me For A Little While», «Eleanor Rigby», «Bang Bang», «People Get Ready» et amener tout naturellement le parterre de dévots à l’orgasme intellectuel avec un «Shotgun» hurlé dans la fournaise, saturé de power-chordage, éclatant de puissance - it’s twiiiiiiiine time baby !

Signé : Cazengler, vanillé de longue date
Vanilla Fudge. Le Divan Du Monde. Paris XVIIIe. 14 mars 2014
Vanilla Fudge. Vanilla Fudge. ATCO Records 1967
Vanilla Fudge. Renaissance. ATCO Records 1968
Vanilla Fudge. The Beat Goes On. ATCO Records 1968
Vanilla Fudge. Rock & Roll. ATCO Records 1969
Vanilla Fudge. Near The Beginning. ATCO Records 1969
The Pigeons. While The World Was Eating Vanilla Fudge. Metronome 2001. 1973

Vanilla Fudge. Mystery. ATCO Records 1984
Vanilla Fudge. The Return. Worldsound 2003
Vanilla Fudge. Good Good Rockin’. Music Avenue 2005
Vanilla Fudge. Out Through The In Door. Escapi Music group 2007
De gauche à droite sur l’illustration : Mark Stein, Carmine Appice, Tim Bogert et Vinnie Martell
TOURNAN-EN-BRIE / 23 - 03 – 14
LA FERME ELECTRIQUE /FORTUNELLA
RIP IT UP PARTY ( II )
DUKE ORPHANS / SUBWAY COWBOYS /
ATOMICS / MEGATONS

Dans mes souvenirs l'entrée ressemble bien à La Ferme Electrique, la teuf-teuf effectue un tournant dans la Brie profonde et pile net devant un groupe de jeunes. A l'esprit vif, même pas besoin de demander « Oui, c'est bien ici le rockabilly ! » qu'ils me lancent sans attendre. Pile à l'heure et face au destin. Sept euros la soirée plus les plats de gaufrettes et de chips offerts à la cantonade, ce n'est pas ce soir que je connaîtrai les affres de la ruine. Il subsiste donc encore quelques bienfaiteurs de l'humanité, ici et là, prêts à secourir les rockers affamés.

La salle est longue et étroite. Pas la grande foule, à part les filles et les garçons du coin je connais tout le monde. Ouvert à tous, mais tous entre soi. Ambiance sympa propice aux discussions... Mister Eddie est sur scène. Joue le Monsieur Loyal, annonce le programme, c'est le grand manitou, l'homme-orchestre de la soirée. Ce qui tombe très mal. Parce qu'il va chanter sans musicos derrière lui.
DUKE ORPHANS
Faut le faire. C'est du sans filet. Ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Faut une sacrée entente et une super confiance. Sont trois unis comme les doigts de la main. Eddie, Thierry, Bruno. Doo wop ! Suffit pas de faire wap-doo-wap-wap et c'est dans la poche, c'est au millimètre, chaque voix à sa place, et surtout ne pas marcher sur les plates-bandes du copain. N'est pas le Golden Gate Quartet qui veut. Pour la petite histoire c'étaient les idoles d'Elvis. Ne faisait pas joujou de sa voix au hasard, le môme Presley, l'avait écouté les maîtres et s'il a été accusé d'être le premier blanc à chanter comme les noirs, ce n'était pas une contre-vérité.
Bien sûr, y a eu la flopée des groupes Doo wop, mais c'était un peu de la triche, avec des orchestrations orgasmiques à vous hérisser les polis du pubis, des voix de velours enrobées de miel instrumental. La stéréo avant l'heure, la musique et le vocal, servis ensemble, un délice des dieux, le crémeux et le crémant. Mais ce soir Eddie, Thierry et Bruno sont tout seuls. Le temps de prendre le la, et c'est parti mon kiki, ça glisse tout shuss. Attention sport d'équipe. C'est comme du parachutage de précision, ou comme quand on joue à chat dans la cour de récréation. A l'instant ultime et fatidique faut être perché et prendre son air innocent numéro 4. Celui qui va si bien à Eddie. Le doo wop c'est aussi l'art du mensonge par excellence, vous venez – vous ne savez pas comment, par instinct de survie ou crainte du ridicule – de zig-zaguer entre les rochers que les collègues ont jeté sur votre chemin, vous avez dix fois, vingt fois manqué d'arriver en retard et de vous retrouver coincé sous un gros Whom ! pachydermique du baryton et vous regardez le public, un petit sourire désinvolte aux lèvres, du genre « trop facile pour moi ». Et à ce petit jeu la gazelle Eddie fait fureur. Une voix fine de furet, au timbre très légèrement voilé, qui se faufile partout, avec un joli grain de rire entre les morceaux pour assurer la reprise de souffle et dissiper l'émotion.
Avec sa grosse voix d'ours de conte de fée Bruno dame les pavés. Là où il passe l'herbe ne repousse pas, faut se débrouiller pour que ça ne vous retombe pas sur les pieds, mais comme on est tous un peu maso, l'on aime bien cela et l'on prend garde de ne pas retirer l'oreille au dernier moment. C'est profond et sombre comme une goutte d'eau de mort et ça vous noie le cerveau à chaque coup de pilon. Thierry se charge du travail le plus ingrat, le gars qui réceptionne les avions de chasse sur le pont du port-avions, c'est la cheville ouvrière qui évite les catastrophes et l'on aurait tendance à l'oublier, mais c'est lui qui rétablit la balance entre le fort et le faible, vous dessine les dégradés afin que votre oeil ne soit ni ébloui, ni aveuglé.
Ne feront que sept ou huit morceaux, le temps de ravir le public. C'est un peu entre la bonne franquette Sinatra et le ré Charles, une merveilleuse ouverture a capella pour les orages électriques qui viennent. Nous, l'on en est restés sans voix.
SUBWAY COWBOYS

Le temps de revenir dans la grande salle, elle est un peu comme Bonnie Maronie, étroite et longue comme un paquet de spaghetti, Fab et Matt sont déjà debout sur la scène, il manque Will, c'est pourtant lui que l'on devrait voir en premier puisqu'il dépasse ses congénères de deux têtes, plus le chapeau qu'il coiffe pour se faire remarquer. Invisible ! Enfin je l'aperçois, l'est aplati contre le plancher dans la position d'un sioux agenouillé dans les pentes rocheuses des Black Hills, l'a un petit ennui avec le branchement de sa guitare, mais le revoilà qui enfin se relève pour entamer sans retard la cavalcade maudite.

Il y a longtemps que les Subway Cowboys sont sortis des souterrains du métropolitain. Galopent maintenant au grand jour, crinières au vent, et complaintes ardentes. Nous rejouent les scènes finales de La Loi de la Prairie – à moins que ce ne soit celles de La Prairie Sans Loi – ce qui n'est pas grave car nos outlaws du honky tonk gagnent à tous les coups. N'importent où qu'ils soient ils se tirent toujours d'affaire, à Tulsa comme à Reno, au fond de la mine comme sur les rapides de la Big River. C'est Will qui mène l'assaut avec sa voix de stentor - à côté de lui Johnny Cash a presque l'accent français – mais les deux autres ne le lâchent pas d'une semelle. Même que Fab adore de plus en plus jouer le pistoléro fou, il brandit sa guitare comme un torero son espalda et vous enfonce dans les oreilles de ces riffs qui vous massacrent les neurones par dizaine de mille à chaque fois. Et puis un petit pas en arrière et comme si ce n'était pas lui et il vous barjote trente secondes de rythmique avant – alors que vous lui aviez pardonné et que vous n'y faisiez plus attention – de vous tirebouchonner les sinus et les synapses avec un twang bazooka qui vous détruit définitivement le cerveau. Enfin, pour ceux qui en ont un. Ne vous posez pas des questions métaphysiques : du genre, mais pourquoi ils n'ont pas de batteur ? C'est inutile, ils ont le Matteau des Dieux. Doit toucher double-paye le Matt, avec sa double-bass c'est le boss qui vous marque le rythme encore plus sèchement qu'une caisse claire.

Bien sûr dans leurs chemises à carreaux ils n'hésitent pas à roucouler une ballade à fendre le cheatin' coeur de la plus sauvage des squaws comme de la pire des filles de mauvaise vie, mais très vite – après tout ce ne sont que des garçons qui jouent une musique populaire un peu fruste - ils sortent leurs grosses pétoires pour faire du bruit, des grosses boules de feu à la Jerry Lou, ils avalent des liqueurs de langues de crotales à la Big Bopper et menacent mélodramatiquement de mourir à la Buddy Holly, le jour venu..

En fait ce qu'ils aiment c'est le tape cul derrière les troupeaux. La grande vie, loin des villes décadentes et des filles araignées, pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais, pendant que Will annonce Rawhide, Matt se saisit de son archet – l'on pense que tel le divin Apollon il va trucider douze serpents à lunettes en six secondes, mais non, il s'occupe d'un animal vachement débonnaire. Frôle deux fois les cordes de sa contrebasse et vous vous retournez pour voir si un animal de la ferme ne se serait pas aventuré dans la salle de concert. Vous a produit deux meuglements si bien imités que l'espace d'un instant vous vous croyez transporté au Salon de l'Agriculture. N'auront pas besoin de faire un boeuf à la fin du concert puisqu'ils auront déjà fait la vache.

Honte et malédiction sur moi, j'ai oublié le titre du morceau – je subodore le Can't Help it d'Hankie, Williams de son nom de famille - mais plus tard il ressortira son archet et la Big Mama se mettra à pleurer des larmes de crocodiles comme s'il en pleuvait. Récoltent des applaudissements épais comme des trémies de blé in the corn-belt. Z'ont pétaradé des quatre fers, z'ont produit des décalcomanies de l'enfer à vous brûler le péritoine au fer rouge. Je termine sur la déclaration d'un rocker devant moi, au blouson chamarré des noms des plus grands : « C'est ce qui se fait de mieux et de plus original, pour le moment dans le milieu ( rockab ) ». Qui oserait dire le contraire ?
THE ATOMICS

Finie la verte prairie et les bouges innommables du sud profond, la révolution industrielle s'est achevée depuis longtemps, en voici trois qui marchent à l'énergie atomique. Me surprennent de plus en plus à chaque fois par la radicalité de leur démarche. D'une très grande simplicité. Une guitare qui allume le feu et les deux autres, basse et batterie, qui soufflent pour attiser les flammes.

A peine ont-ils démarré que ça irradie de partout. Impossible d'y échapper. La guitare vous poursuivrait jusqu'au fond de l'enfer si vous vous y réfugiez par inadvertance. Alignent les morceaux comme des wagonnets chargés de déchets nucléaires à haute combustion. Trois gars sans compromission qui jouent du rock and roll juste comme ils l'entendent, et qui ne s'égarent jamais dans des chemins de traverse. C'est un trio mais ils ne fonctionnent pas comme un trio de rock classique. Pas de chichi entre les musicos, on ne se fait pas des politesses aux feux rouges, on les brûle sans ménagement, ni crier gare. Au début, ça surprend parce qu'on espérait qu'ils respecteraient au moins les piétons sur le bord de la route. Ne tendez pas le bras dans le vain espoir de faire du stop. Ce n'est pas la peine, ils vous cueillent au passage et vous embarquent sur la banquette arrière, ensuite ils ne se préoccupent plus de vous. Sont trop occupés à accélérer toutes les dix secondes et à cisailler le frein à main. Font un peu la course avec le diable mais ils ont au moins cent mètres d'avance.

Barbichette pour le batteur et lunettes pour le bassiste, les seuls signes de reconnaissance. Sont concentrés, renfermés sur eux-mêmes, refermés sur leur musique. Certains jouent du rock and roll comme ils se font des oeufs à la barre fixe dans la poêle à frire. Ca ne leur est pas indispensable. Un passe-temps agréable, mais rien de plus. Just for fun, et pour que la jeunesse se passe. Peut-être parce qu'ils sont pressés de mourir. Les Atomics s'y accrochent comme si leur vie en dépendait. Donne tout et à fond. Pas de blabla, pas de chichi, ça vient des tripes. Une nécessité existentielle. Ne recherchent point les lauriers de César. Ne jouent point à la rock'n'roll star mais ils brillent comme des constellations dans la noirceur des jours perdus de notre existence. Le rock n'est que le reflet de leur authenticité. Ni puristes, ni wildos, tentent avant tout d'être eux-mêmes leur propre image du rock and roll. N'imitent pas les autres. Se contentent d'être tels qu'en eux-mêmes le rock and roll les change, et ce n'est jamais trop.

Le défaut c'est qu'on ne les voit pas passer. Une heure d'Atomics correspond à dix minutes de temps homologués par les chronomètres du quotidien. Ô temps suspends ton rock ! mais ça file à une vitesse vertigineuse. Vous n'êtes pas sorti de l'imaginaire d'un morceau qu'ils ont déjà entamé le suivant. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. C'est comme pour les sports de combat, ne pas se tétaniser, ne pas se fermer, ne pas asphyxier ses muscles par une trop grande tension, ne pas vitrifier son cerveau pour le transformer en carapace de tortue, car c'est alors qu'il cassera sous le moindre choc un peu fort. Au contraire s'ouvrir à l'autre, se laisser flotter dans l'influx des musicos afin de capter leur énergie et la leur retourner au moment voulu.

Ce qui ne manque pas de se passer. Lorsque la tornade est passée et que déjà ils commencent à débrancher les jacks, le public, qui se réveille au plein milieu des cauchemars existentiels habituels, bougonne. Eddie se précipite pour demander un rappel. Hélas trop court. Est-ce qu'une seule goutte de népenthès même administrée à dose fortement concentrée saurait nous suffire ? Non, l'on sort toujours trop tôt de l'ailleurs lointain du rock and roll. Merci, The Atomics.
THE MEGATONS

Trois fois trois neuf, jusques là. Mais les Megatons débarquent en force. Sont cinq. Comparés aux précédents, l'on dirait une armée. Portent l'uniforme, des vestes gris-souris ou General-Lee grey, pour la couleur, car pour l'aspect ils ressemblent à la tenue des méchants dans les vaisseaux des film de science-fiction. Portent une cocarde colorée sur le devant de la poitrine, avec quelque chose d'écrit dessus, mais ils se démènent tellement que malgré tous mes efforts je n'ai pas pu déchiffrer l'inscription apparemment personnalisée.

De toutes les manières je n'étais pas venu pour bouquiner. C'était à mes oreilles de travailler. Et avec les Mégatons pas besoin d'un sonotone. Ce sont de grands ados, très bruyants, les parents ne sont pas là, alors dans le garage ils empruntent la voiture du dimanche et filent faire un tour sur la corniche. Encore des fous qui ne savent plus où ils mis la pédale du frein. Pourraient ne pas trop se faire remarquer, mais non à chaque virage, le plus allumé de la bande vous file des grands coups de saxon pour que par-devant les automobilistes prudents se rangent sur le bas-côté de la route. Enseignent la prudence, mais ne l'appliquent guère.

C'est une ronde infernale qui ne s'arrête jamais avec l'autre, l'obsédé saxuel, qui s'en vient pousser sa corne de rhinoféroce en cuivre à tout bout de champ. Et le reste qui suit comme un seul homme. C'est du tout cuit, l'affaire est dans le sax avant même d'y être enfermée. Les Megatons se la donnent à coeur joie. Un chanteur qui hausse le méga ton chaque fois qu'il se jette dans un lyric, un batteur qui monte les oeufs en neige systématiquement dès que l'ambiance culmine dans les hauteurs, une guitare qui pousse les chorus sur le grill et un bassiste aussi solide qu'un roc dans la tempête. Bref ça vole haut, mais il reste toujours un pied solidement accroché au sable de la plage.

Rock ! Rock ! Rock ! Surf ! Surf ! Surf ! Tourbillon de hula hoop au clair de lune. Les filles dénudées passent sur la plage tandis que dans le lointain un sax-terrier n'arrête pas d'aboyer. La lune émet un rayon d'insouciance, les Megatons se lancent dans la danse du saxlp, et le public ondule au son de ce tohu-bohu généralisé. Les Megatons transportent toujours avec eux un petit grain de folie communicative. S'enracine très vite dans n'importe quel terreau. Pour l'extirper c'est très dur. Vos veines et vos artères lui servent de racine, il s'ancre en vous et refuse d'en sortir. Sortilège euphorique. Drogue douce qui s'insinue en vous et vous fait voir la vie en rose. Pas exactement le pink rockabilly officiel, mais une teinte qui s'en rapproche. Rock des campagnes, rock des villes et rock des plages, c'est le même rock, décliné autrement, mais avec, si l'on veut bien se donner la peine de gratter jusqu'au sang, la même pulsation de joie et de révolte mêlées.

Les Megatons nous entraînent dans une joyeuse sarabande. Jouent comme des malades, ne s'arrêteront qu'à bout de souffle, exsangues, vidés de toute énergie. Et le public vampire, regonflé à bloc, goinfré d'énergie optimisante jusqu'aux amygdales les ovationne une dernière fois. Ils ont tout donné. On a tout pris.
Damie Chad.
( Photos prises sur le Facebook des artistes. Correspondent au concert uniquement celles de Subway Cowboys )
LA BIBLE PUNK
35 ANS DE CONTRE-CULTURE MUSICALE
CHRISTIAN EUDELINE
( EDITIONS DIDIER CARPENTIER / 1013 )

Besoin urgent de remplacer Mon Manuel de Civilité Pour Les Petites Filles A l'Usage Des Maisons d'Education de Pierre Louÿs – mon livre aux pages collées et tachées de sperme n'étant plus que d'une lecture difficile – je me suis précipité chez mon libraire unique et préféré afin de me procurer un exemplaire vierge de toute bavure inopinée. Je reprenais mon souffle devant la vitrine – pas celle dévolue aux nouveautés littéraires mais l'autre consacrée aux articles de fantaisie et images saintes pour les jeunes communiantes, lorsque mon regard fut attiré par un gros carré d'un jaune criard de fort mauvais goût. Diantre, murmuré-je à part moi, ca ressemble comme deux jaunes d'oeuf à la pochette de Never Mind The Bollocks des Sex Pistols, banco, j'étais tombé juste : Punk, 35 Ans de Contre-Culture Musicale, c'était écrit en gros et en noir. Du même coup je compris comment ce brûlot de la punkitude honnie avait pu échouer su l'étalage réservé à l'édification de notre saine jeunesse : en lettrage plus fin, en un discret cartouche, apparut le mot qui avait dû induire une telle erreur d'aiguillage vers les pieuses étagères, LA BIBLE ! La Bible Punk, quel oxymoron comme disent les narratologues.

De Christian Eudeline. Vous ne confondrez pas avec son frère, Patrick Eudeline, celui dont vous dévorez en premier la chronique à chaque nouveau numéro de Rock 'n'Folk. Tous les deux passionnés de rock, et tous les deux écrivains. De Christian Eudeline, faut avoir lu Nos Années Punk sorti en 2002 qui reprenait toute une flopée d'articles éparpillés dans diverses revues. L'a remis les marmites sous le feu, douze ans après il est toujours intéressant de vérifier si les perspectives n'auraient pas changé.
Ne vous fiez pas aux photos. Le bouquin en est bourré, souvent plus belles les unes que les autres. Pleines pages et documents divers qui essaiment tout du long. Ne vous en tirerez pas en trois quarts d'heure. Il y a du texte. Répartis sur de vastes colonnes, bien écrit, rempli de renseignements et truffés d'anecdotes. Vous risquez de rester éveillés toute la nuit. En plus vous êtes obligé de réfléchir. Patrick Eudeline n'a pas donné dans la facilité. L'aurait pu se contenter de construire un dictionnaire. Sur le punk, c'est de tout repos, il y a longtemps que le phénomène a été circonscrit. Vous activez la mémoire et ça part tout seul. Pouvez commencer à dresser le plan sur le coin de la table. D'abord les précurseurs, Velvet Underground, MC 5, Stooges, New York Dolls, Johnny Thunders et l'on ouvre les hostilités avec les Pistolets du Sexe... D'ailleurs, c'est exactement comme cela que Christian Eudeline officie. Oui mais il ne faut pas prendre les rock critics pour des innocents aux mains vides. L'écriture de qualité est toujours au second ( au minimum ) degré. Si vous racontez l'histoire des Sex Pistols pour raconter l'histoire des Sex Pistols, c'est que vous êtes un âne bâté. Faut avoir une autre idée derrière la tête. Subliminale, plus ou moins appuyée, c'est elle que vous avez envie de partager avec vos lecteurs. Les plus intelligents, ceux qui vous devinent, alors que vous avancez masqué derrière le bouclier des mots apparents. Prenons un exemple au hasard, celui de Christian Eudeline, croyez-vous que ce soit par hasard qu'il ait découpé son gigot en trois morceaux. Première vague, Deuxième vague, troisième vague. N'a pas tort d'utiliser un couteau à trois lames pour rendre compte de l'ampleur dévastatrice du phénomène punk, mais nous sommes nés si avant la pluie que nous essayons de regarder plus profond que l'écume moutonnière qui coiffe les trois déferlantes de ce tsunami rock.

PREMIERE VAGUE

Treize groupes. N'insistons pas sur les Sex Pistols, il y a à peine quinze jours nous donnions la parole à John Lydon... Le Clash – l'autre grand groupe punk – quand je me suis fait opérer l'année dernière le toubib avait un grand poster du groupe dans son bureau, pour dire la reconnaissance sociétale obtenue par le groupe, par contre question fric l'aurait bien pris un dessous de table que je lui ai refusé, comme quoi, il n'avait pas très bien compris l'éthique punk. J'ai un ami, un sacré amateur, qui la semaine dernière vient de s'offrir – moyennant rétribution – l'intégrale de tous les concerts du Clash, des dizaines de Cd à la pelle, qu'il écoute religieusement soir après soir avant de s'endormir. Selon moi le Clash reste le groupe qui a mis à mal la prophétie majeure du punk définie et énoncée par les Pistols. Z'ont mêlé tellement d'ingrédients dans leur rock ( reggae, ska ) que lorsque le punk est mort son futur n'a fait que commencer. Quand la lessive qui arrache s'est faite rare, nombreux ont été les prétendants qui ont proposé des ersatz fabriqués à partir des seuls adoucissants que le Clash avait enfournés dans sa formule.

Damned, Buzzcoks, Siouxie, Generation X, l'on a l'impression de descendre une marche à chaque fois. Pas en leurs folles années de gloire, car ils ont joué leur rôle, parfois magnifiquement. Mais sur la longueur, aujourd'hui chacun de ces groupes ressemble un peu trop aux clones de leur passé. Parfois il vaudrait mieux mourir que se survivre. C'est la seule chose intelligente qu'a su faire Sid Vicious. Au passage Christian Eudeline y va d'une main très morte puisqu'il fait porter au gamin vicieux la responsabilité de l'assassinat de sa petite amie Nancy Spungen. C'est ainsi sur les frasques du deuxième vocaliste des Sex que se termineront les addenda de cette première partie. Certes ce n'est ni Roméo et Juliette, ni Tristan et Yseult, mais qui aurait cru que le petit Vicious atteindrait à un romantisme si déchiré ?

En attendant un saut de puce vers l'Irlande et les Understones, plus rock que punk d'après moi... et hop ! l'on se paye un grand pas en avant vers l'Ouest. Qui n'est pas le best, puisqu'il vient en seconde position. Nous voici dans la patrie de naissance du rock'n'roll, en Amérique avec Richard Hell, Ramones et Blondie, Christian Eudeline prend parti, le punk est né en Angleterre, les ricains peuvent revendiquer la paternité tant qu'ils veulent, le tribunal de l'Histoire ne la leur reconnaîtra jamais. Punk arty et quelque part so british avec Richard Hell, déglingué jouissif primaire pour les Ramones, et tartiné de joliesses disco-chic pour Blondie, la palette entière du punk, quand les ingénieurs ( ici du son ) amerloques se penchent sur un problème, ils proposent toujours de la high quality. Sont très forts en tout. Même pour le bio à base de matière fécale plastique.

Et bing ! L'on se prend deux tranches de mortadelle en pleine figure. Sans vous prévenir. Jusque là on était resté entre gens bien. Et paf ! sans crier gare surgissent deux unités de par chez nous. Deux groupes de petits franchouillards qui s'en viennent jouer dans le pré-carré des anglo-saxons. Débarquent sans complexe, Gazoline et Metal Urbain. Gazoline, deux 45 tours et puis s'en va. Surtout le chanteur Alain Kan qui douze ans après la dissolution du groupe s'évaporera sur le quai du métro, station Châtelet. Jamais réapparu depuis. Une légende. Metal Urbain, ce n'est pas la cerise sur le gâteau mais la guigne inlassable du rock and roll français qui les poursuit. Sont un peu en avance avec leurs rythmiques électroniques et terriblement politiciens avec leurs textes sous forme de slogans hurlés. C'est en Angleterre où on ne comprend pas les paroles qu'ils seront appréciés. En nos douces contrées ils ne parviendront pas à creuser leur trou. Illogiquement ils y resteront tout au fond.
Comme il ne faut pas exagérer, Patrick Eudeline se hâte de tirer le rideau. Il achève sa série sur les Saints ( qui n'en sont pas des petits ). Viennent du pays des dingos, un peu rustauds, habillés comme des ploucs, n'ont pas la dégaine parfaite mais savent faire du bruit avec leurs guitares.
DEUXIEME VAGUE

Suit la première de près. Mais il suffit de quelques mois pour que le paysage change de tout au tout. Le punk, c'est bien joli. Une révolution planétaire. Jusque dans l'hémisphère austral. Mais il faut se méfier de l'iceberg qui cache la banquise. Le punk a pris d'assaut la une des tabloïds mais ce n'est pas parce que l'on en parle dans les journaux que le phénomène réel correspond à son ampleur médiatique. Cas typique des minorités agissantes. Beaucoup de bruit ( et question décibels on ne reprochera rien au punk ) pour pas grand monde. Les majorités silencieuses n'écoutent pas les Sex Pistols. Elles préfèrent – et de loin – les rythmiques bien huilées et bien carrées de la disco. Les années quatre-vingt dégringoleront encore d'un étage avec la pop synthétique de bas étage.
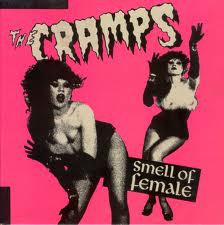
Sham 69, The Exploited, Misfits, Dead Kennedys, Flipper, des étoiles filantes, une pluie de météores au début, continuent sur leur lancée par la suite, mais sont déjà dépassés. Etrangement deviendront des groupes cultes ceux qui proviennent d'autres territoires que le punk. X, Pogues, Cramps, Pussy Galore, ne seraient jamais devenus ce qu'ils furent s'ils n'avaient pas été réveillés par la tornade l'électrochoc du punk. Mais comme le bon docteur Frankenstein ils se sont servis de l'orageuse électricité pour ranimer des cadavres oubliés dans le placard, vieux rock, chansons à boire, rockabilly et vieux blues du delta, ont repris une nouvelle jeunesse après ce traitement de faveur. Quant à Lords of The New Church faut les entendre comme la réfection des vieilles façades, Doors, Stooges, Thunders...
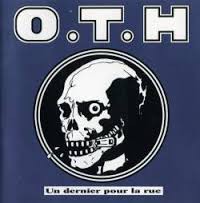
Et bling ! Ca recommence mais en pire. C'est tout le sauciflard que l'on attrape en pleine poire. La Souris Déglinguée, OTH, Oberkampf, Parabellum, et Béruriers Noirs, cinq français en vrac. Si une rondelle ne fait pas le printemps, cinq à la suite vous piquent et niquent la parole sans préavis. Sympathiques certes, cocoricotons sans tarder à plein gosier, mais est-ce vraiment du punk ? Plutôt des groupes de rock français. Si l'on suit la courbe qui part des Sex Pistols pour finir sur les Bérus, l'on est bien obligé de reconnaître qu'elle est en position descendante. Toute la différence entre l'action directe et la phraséologie anarchisante. Les Français sont de grands bavards. Causent beaucoup mais ne s'intéressent guère à la réalisation effective des belles idées.
TROISIEME VAGUE
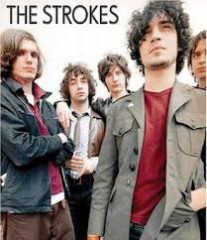
Un saut dans le temps. L'on enjambe allègrement toutes les nineties. Strokes et Libertines en figure de proue du troisième millénaire. Pas explicitement du punk, mais la renaissance – plutôt le retour – du rock. Le rap et bien d'autres musiques encombraient les oreilles des nouvelles générations. Leur a fallu ces deux intraveineuses pour les rappeler à leur devoir. Entretemps l'encéphalogramme de la bête n'était pas resté au calme plat. Offspring, Fugazi ou Dropkick Murphys avaient maintenu la combustion du flambeau, mais ce n'était pas encore cela. Parti de tous les côtés, vers le hardcore avec Rancid, vers les soixante-dix millions de disques écoulés avec Green Day. Pour faire bonne figure, l'on a sauvé deux frenchies de l'anonymat, Stupeflip et Les Sales Majestés. Christian Eudeline clôture son tableau de chasse sur les Vaccines et les Kills. La démarche nous semble trop globalisante. Récupération punk à la limite. La grenouille punk qui veut se faire aussi grosse que le taureau du rock and roll. L'on comprend l'Eudeline sur toute la ligne. Ne veut pas que le punk meure, alors il lui dresse le tableau généalogique de sa descendance. Tout ce qui fait un peu plus de bruit que la moyenne et qui roule en-dessus de la vitesse autorisée est annexé sans plus de façon car tout ce qui entre fait ventre. Vous croyiez que le punk était mort, ben non, it's not dead, et par-dessus le marché il est partout. Danger Zone, à force de le dénicher dans la moindre galette, on va finir par ne plus le voir. Partout et nulle part ne sont pas des frères ennemis. Plutôt des jumeaux qui s'entendent comme larrons en foire pour qu'on ne les distingue plus l'un de l'autre.

Fabriquer un futur au punk n'est peut-être qu'une manière de l'enterrer au plus vite. C'est un peu à ce jeu dangereux que s'est livré Christian Eudeline dans ce livre. Nous ne le critiquons pas, c'est de bonne guerre. Peut-être même que nous, fans des pionniers, agissons de même lorsque nous répertorions le moindre nouveau groupe de rockabilly à l'autre bout du monde. Le rock qui ne cesse de regarder derrière lui engendre, de par ce même mouvement de retour à l'origine, la nostalgie du futur.
Damie Chad.
01:52 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.