28/08/2014
KR'TNT ! ¤ 198 : JOHNNY WINTER / BLOOMING TRACZIR / MORAND CAJUN BAND / PATHFINDERS / HOOP'S 45 / JUKE JOINTS BAND
KR'TNT ! ¤ 198
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
28 / 08 / 2014
|
JOHNNY WINTER / BLOOMING TRACZIR / MORAND CAJUN BAND PATHFINDERS / HOOP'S 45 / JUKE JOINTS BAND / STOP II |
ELEMENTAIRE, MON CHER WINTER
Les blazes du blues - 11e épisode
Johnny Winter chante le blues depuis un bon paquet d’années. Si on fait les comptes, ça doit bien faire 45 ans. Chaque fois qu’il sortait un nouvel album, j’allais l’acheter. Automatiquement. Il fait partie des gens qu’on suit comme un chien fidèle. Même encore aujourd’hui. Johnny atteint la barrière fatidique des 70 ans, mais aux yeux de tous ceux qui l’ont vénéré, il reste le grand Johnny Winter, le rocker flamboyant et le fils spirituel de Muddy Waters, le demi-dieu hermaphrodite fellinien et le junkie fantôme, l’allumeur de brasiers et le plus charmant des hommes.
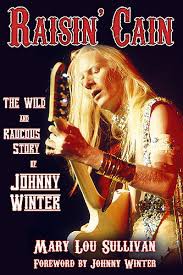
Oui, parfaitement, le plus charmant des hommes. C’est ainsi que le décrit Mary Lou Sullivan dans son livre passionnant, «Raisin’ Cain. The Wild And Raucous Story Of Johnny Winter». Johnny Winter aura passé sa vie à démontrer qu’on n’a pas besoin d’être brutal et atrocement con pour faire du rock et devenir célèbre. D’un côté, vous avez des gens comme Axl Rose, JJ Burnel et Sid Vicious, et de l’autre vous avez Johnny Winter. Comme le disait si bien Makhno aux prisonniers qu’il allait fusiller : «Choisi ton camp, camarade !»
Johnny l’albinos vit le jour à Beaumont au Texas. Son père John Dawson Winter Jr était originaire de Leland, Mississipi. Rien qu’avec l’acte de naissance, on a déjà une partie de la mythologie. Sa mère Edwina fut catastrophée à la naissance de Johnny. Dans le Deep South, on regardait les albinos de travers, comme les nègres. Ces pauvres cloches de médecins dirent à Edwina qui était de nouveau enceinte qu’elle ne risquait rien. Un autre albinos ? Oh, une chance sur un million. Et pouf, Edgar vint au monde, aussi albinos que son frère.
Tout petit, Johnny ressemblait déjà à une sorcière de Walt Disney. Mais la sorcière de Walt Disney allait grandir et tomber plus de filles que n’en tombèrent jamais tous ceux qui se moquaient de lui.
Le premier disque qu’acheta Johnny ? «Somebody In My Home» d’Howlin’ Wolf. Les dés sont jetés. Puis il s’offre «She’s Nineteen Years Old» de Muddy Waters et scelle ainsi son destin. Johnny apprend à jouer le blues en voulant jouer les notes de Muddy qu’il entend sur ce single Chess. Par ici, on faisait la même chose avec «Satisfaction» et «Gloria». Puis Johnny cassa sa tirelire pour s’acheter un premier album. Évidemment, ce fut le fameux «Best of Muddy Waters» sur Chess, celui que Jagger avait sous le bras la première fois qu’il rencontra Keith Richards sur un quai de gare. Puis Johnny tomba dingue de Jimmy Reed - «Nobody else sounded like Jimmy». (Personne ne sonnait comme Jimmy.) Johnny mit les pieds dans le plat de la mythologie. Grâce à Jimmy Reed, il intégra la notion de son. Il découvrit Clarence Garlow, un as du zydéco, qui lui apprit la technique de la troisième corde non tendue - unwound third. C’est à lui qu’il dédicacera son album «Guitar Slinger» en 1984. Johnny séjourna un temps à Chicago et s’extasia du style de Mike Bloomfield. Puis il devint pote avec Keith Ferguson, légendaire bassman qui joua sur les quatre premiers albums des Fabulous Thunderbirds. Keith et Johnny sont une sorte de condensé du mythe texan, comme l’était avant eux le tandem Mac Curtis et Ray Campi. Dans les jukebox de Port Arthur, on entendait surtout Little Walter, Muddy Waters, Lazy Lester et Jimmy Reed, comme le rappelle Uncle Joe Turner. Il parle bien sûr de l’époque où il rencontra Johnny pour monter le trio fatal, avec Tommy Shannon à la basse.

Ils démarrent avec «Progressive Blues Experiment», l’une des pierres blanches de l’histoire du blues électrique. Au moins, avec «Tribute To Muddy», les choses sont claires. C’est du vrai heavy blues avec du deep blue sea et des women fishing after me. Johnny fait le mannish boy des enfers. Il accompagne longuement le beat de ah-ah-ah et il revient à la rolling stone. Puis il embarque une version de «Help Me» sur un gros swing texan. Sa version est beaucoup plus musculeuse que celle d’Alvin Lee qu’on trouve sur le premier album de Ten Years After. Johnny taille sa route, high on the beat. C’est racé et puissant, et donc lourd de conséquences. Son «Mean Town Blues» est drivé au beat et son «Black Cat Bone», monté sur un swing extravagant, figure parmi les grosses pièces de blues moderne.
Paul Oscher jouait de l’harmo dans le groupe de Muddy, au moment où Johnny démarrait sa carrière : «Il y avait un tas de bluesmen dans le circuit à ce moment-là. Magic Sam et T-Bone Walker étaient encore en vie. Il y avait aussi Junior Wells, Otis Rush. Les blancs qui jouaient le blues, on les comptait sur les doigts d’une main : Paul Butterfield, Charlie Musselwhite, moi, Johnny Winter, John Hammond Jr, et Mike Bloomfield.»
Johnny essaye de signer un contrat en Amérique, mais c’est trop compliqué et il prend l’avion avec son pote Keith Ferguson pour aller démarcher les labels anglais à Londres. Mike Vernon de Blue Horizon se montre intéressé, mais finalement c’est Clive Davis de Columbia qui signe Johnny, l’emportant de peu sur Jerry Wexler qui voulait un albinos sur Atlantic. Et cet album mirobolant qu’est le premier album CBS de Johnny Winter sort en 1969. Willie Dixon participe à la curée. Et pour simplifier tous les problèmes administratifs, Johnny et ses amis enregistrent l’album à Nashville.

«Johnny Winter» s’ouvre sur «I’m Yours And I’m Hers», énorme de puissance texane. Avec sa voix de géant, Johnny prend la tête de la meute. Il joue un solo riche de mille variantes épouvantables en continu, coule d’une note à l’autre avec effusion, mais il y a surtout l’arrache monstrueuse de sa voix. Tommy Shannon et Uncle Joe fournissent le meilleur tapioca rythmique d’occident. «Be Carefull With A Fool» est le heavy blues de base, le modèle absolu, chanté avec rage. Johnny s’en va hurler certaines syllabes avec une classe impérieuse. Willie Dixon joue de la stand-up sur «Mean Mistreater». Version de choc. Et puis voilà «Leland Mississipi Blues», ah yeah, oh yeah, le blues rock des origines du rock. Véritable leçon de garage blues, pièce déterminante, Johnny double le chant à la guitare. Il invente le style gueulard doublé de phrasé singeur. Il accompagne chacune de ses errances vocales de lignes aigres et justes et reste dans l’excellence gutturale.
Johnny devient une superstar. Il tombe toutes les filles qu’il veut (comme Muddy : une régulière à la maison et des filles différentes tous les soirs en tournée). Et il se régale de toutes les drogues qui lui passent sous le nez «LSD and mescaline. I did everything. I liked mescaline and psilocybin mushrooms - they give you a nice high without makin’ you nervous or jittery like speed did. Mushrooms were the smoothest. I did ‘em a couple times a week.» Puis il passe à l’héro. «I snorted it for about a year before I started shooting it. I had no problem getting needles - you could buy needles in Texas at the drugstore. Red and Tommy started taking it same time I did.» (J’ai tout pris, du LSD, de la mescaline. J’aimais la mescaline et les champignons. On trippe mieux avec les champignons qu’avec le speed qui vous rend nerveux. J’en prenais deux fois par semaine. J’ai sniffé de l’héro pendant un an puis j’ai commencé à me shooter. Je n’avais pas de problème pour acheter des seringues. Au Texas, on les trouve dans les drugstores. Red et Tommy ont commencé en même temps.)

Arrive fin 69 l’un des plus grands disques de l’histoire du rock : «Second Winter». Pochette et photo intérieure signées Richard Avedon, le photographe le plus renommé de l’époque. Johnny : «I liked the posters Richard Avedon had done of the Beatles, that’s why I picked him.» (J’aimais bien les posters que Richard Avedon avait fait des Beatles. C’est pour ça que je l’ai choisi.) «Serve me right to suffer/ Serve me right to be alone/ You know I’m still livin’ a memory». C’est avec ces trois phrases qu’il attaque «Memory Pain». Chaque fois qu’il voit une femme, ça le fait souffrir - makes me think of mine - Lord I just can’t keep from cryin» - la basse de Tommy se balade tranquillement derrière. Voilà le Texas blues des enfers. «I’m Not Sure» est un énorme groove de basse. Tous les ingrédients de l’énormité du blues sont présents dans ce morceau. Johnny le héros percute inlassablement ses cordes. Toujours dans l’archétype du heavy sound, Johnny écrase le champignon avec «The Good Love» et va chercher de l’incroyable guttural. Le son remplit la carlingue. Johnny bat tout à plates coutures et Uncle Joe martyrise ses cymbales. Sur la face rock, il envoie une version de «Highway 61 Revisited» historique. C’est un vrai coup de génie. Johnny sonne comme Mike Bloomfield et Dylan à lui tout seul. Fabuleuse machine rythmique. Il semblerait qu’on n’en ait jamais vu d’aussi bonne. Tommy remonte sur deux ou trois notes et Uncle Joe bat la campagne. On est sidéré par leur classe démentielle. La troisième (et dernière face) est celle du pur génie. «I Love Everybody» est un morceau ultra-chanté - Well I’m goin’ to the South - et toujours cette énorme basse derrière. C’est le blues des guerriers commanches, le blues brillant et panaché. Aucun rocker ne peut sonner aussi bien que Johnny Winter. Il passe au boogie blues avec «I Hate Everybody», accompagné par un grand orchestre et Johnny le jazzman nous sort un jive de virtuose. Et puis voilà l’une des perles du siècle, «Fast Life Rider», joué dans l’esprit fife and drums. Uncle Joe bat le beat des collines qu’entendait Kenny Brown quand il était petit. Johnny joue le blues dans le fond du studio. Il s’envoie des zones d’écho. Reprise au thème. Don’t buy my ticket !
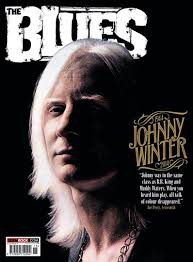
C’est grâce à Steve Paul - l’impresario du groupe - que Johnny rencontre Rick Derringer, alors leader des McCoys. Steve Paul les installe dans la maison voisine de celle dans laquelle il a installé Johnny et son groupe, à Staatsburg, à 150 km de New York. Steve Paul est un peu comme Andrew Loog Oldham : il a ses têtes. Pour lui, seul compte Johnny. Il se débarrasserait bien d’Uncle Joe et de Tommy. Ce n’est pas un hasard s’il a ramené les McCoys dans les parages. Ça commence par des petites jams informelles. Uncle Joe n’est pas dupe du petit jeu merdique de Steve Paul : «He was the kind of guy who always had a strategy, an underhanded strategy. He was a bit of an unsavory person.» (C’était le genre de mec qui montait toujours des plans en douce. C’était un type pas très sympathique.) Et crac, cette ordure de Steve Paul persuade Johnny de virer ses meilleurs copains. Uncle Joe et Tommy sont des gens bien. Ils pardonneront à Johnny. Tommy : «He is still my friend. Uncle John and I forgot about all of that.» (Il est toujours mon pote. Uncle John et moi avons tout oublié de cette histoire.)

La stratégie de Steve Paul est de conquérir le public rock et donc Johnny doit aller sur un son plus rock. «Johnny Winter And» annonce la couleur. Et quelle couleur ! À part un morceau, l’album est raté. «Guess I’ll Go Away» marque bien le virage rock. Johnny rentre dans le lard du rock avec une compo alambiquée pleine de rage texane. C’est une belle vacherie épaulée au phrasé de guitare, et suivie d’une belle envolée qui sent bon le génie wintérien. Johnny adore partir en vrille dans l’œil du cyclone. Puis le gentil Johnny accepte de chanter cette daube qu’est «Rock’n’Roll Hootchie Koo». Il revient ensuite à ses racines avec «Prodigal Son», mais la chose vire pop. Atroce. Il tente de revenir au blues hendrixien avec «Nothing Left» et au guttural avec «Funky Music» qui n’a rien de funky.
Soudain, c’est la frénésie : couvertures de Creem Magazine et de Rolling Stone, un album live bardé de reprises incendiaires de Chuck Berry, des fringues flashy, des boots et des bijoux, le superstardom à l’américaine et les stades remplis à ras bord. En 1970, Johnny se retrouve aux funérailles de Jimi Hendrix en compagnie de Miles Davis et de Buddy Miles. Et il devient ce qu’on appelle un full-blown junkie. «I felt terrible. Physically and mentally. You just felt bad, felt like nothing else would help to get you back on track but doin’ some heroin. You hated yourself. As soon as that started to happen, I wanted to get away from it, but I couldn’t get away from it on my own.» (Je me sentais misérable. Physiquement et mentalement. Tu te sentais si mal que rien ne pouvait plus t’intéresser à part le prochain shoot d’héro. Tu finis par te haïr. Dès que j’ai senti que ça commençait à mal tourner, j’ai voulu arrêter.) Alors, il décide de faire un break. Peu importe le temps que ça prendra, mais il ne veut plus continuer comme ça. Bobby Caldwell quitte le navire et monte Captain Beyond avec deux ex-Iron Butterfly et Rod Evans, le premier chanteur de Deep Purple. Rick Derringer entre dans le groupe d’Edgar. Seul Randy Jo Hobbs reste sur le pavé. Johnny passe neuf mois à l’hosto et il ne veut voir que ses vieux copains du Texas, Uncle Joe et Keith Ferguson. Pas question de voir la gueule des new-yorkais dont il commence à se méfier. Ils ont bien profité de Johnny, et s’il s’est retrouvé dans cet état-là, ce n’est pas un hasard. Le road-manager Teddy Slatus le gavait de cachets. Rick Derringer avait bien compris que Slatus piégeait Johnny. Mais personne ne pouvait intervenir. Johnny faisait confiance à Slatus.

Johnny fait une apparition sur l’album live d’Edgar qui s’intitule «Roadwork». Pas mal de bon funk et de grosses reprises de r’n’b sur cet album («Can’t Turn You Loose»). En fin de face B, Edgar annonce a little surprise for you tonight au public - hey Johnny et tout de suite, l’album prend de la hauteur, car c’est lui le boss, Johnny est l’un des géants du rock, ne l’oublions pas.

En sortant de l’hosto, Johnny reprend le collier et enregistre «Still Alive and Well» avec une nouvelle équipe. C’est l’un de ses meilleurs albums. Sa version de «Rock Me Baby» (créditée à Big Bill Broonzy et Arthur Crudup) est une version de rêve. Johnny l’embarque directement au paradis. Le groupe a changé. Randy Jo Hobbs joue de la basse et Richard Hughes de la batterie. C’est une version complètement diabolique. Johnny porte des bijoux. Il louche. Il a une classe folle. C’est lui le rock’n’roll animal. Todd Rundgren produit quelques morceaux. Avec Rock Me, on se trouve au cœur du rock blues texan le plus génial. Toujours du gros rock blues avec «All Tore Down» renversant. Il faut voir comment Johnny déchire sa voix pour fendre l’âme du fan. Il est l’un des seuls à savoir chanter avec autant de gras dans la voix. Johnny Winter est inégalable. On est cueilli au menton par un solo fulgurant. Deux reprises des Stones en face B : «Silver Train» (admirable) et «Let It Bleed» (sublime). Johnny gratte sa national pour jouer «Too Much Seconal», un vrai blues doublé à la flûte. Johnny raconte qu’il mélange le Seconal et le whisky. Aw.

«Johnny Winter And Live» est certainement l’album le plus connu de Johnny. Toutes les versions contenues sur cet album sont incendiaires. Son «Good Morning Little Schoolgirl» battu par Bobby Caldwell est fabuleux de désossé. Retour au blues avec «It’s My Own Fault» et fuck Steve Paul et ses stratégies de marché. Joli clin d’œil aux Stones avec «Jumping Jack Flash». Et puis, en face B, on tombe sur un medley connu comme le loup blanc et on chope une version endiablée de «Mean Town Blues». Johnny et ses amis sont littéralement possédés. Johnny tombe sur le râble du cut et le met en pièces. Tempo infernal, riffs descendants et pétaudière continue. Bobby Caldwell n’est pas toujours au carré, ça va trop vite, beaucoup trop vite. Le thème est très ardu. Johnny n’est pas un bricoleur du dimanche, t’as intérêt à te caler sur les huitièmes diminuées sinon t’es cuit. Oh, il n’est pas méchant, mais c’est qu’il est trop doué. Il joue technique avec naturel. On assiste à un duel de guitares avec Rick Derringer. Le petit Rick a les yeux cernés. Il porte un gros crucifix sur la poitrine. Johnny et lui semblent ranimer la flamme de «Deliverance». Johnny harangue l’esprit du blues - hey hey hey. C’est le morceau de l’album qu’il faut écouter. Tout l’art de Johnny s’y trouve dûment concentré : sa technicité texane et son goût pour les flammes de l’enfer et le guttural du diable. Prodigieux. Il faut l’entendre relancer la machine en multipliant les exercices de haute voltige.

Puis sort «Saints And Sinners», avec toute l’équipe Edgar/Derringer/Hartman/Caldwell/Richard Hughes. Johnny porte la barbe. Il reprend «Blinded By Love», un cut funk-soul d’Allen Toussaint, et en fait une version passionnante. Puis on tombe sur une version stupéfiante de «Thirty Days» de Chuck Berry. C’est troussé à la hussarde, c’est-à-dire au swing texan. On a là l’une des plus grosses reprises de Chuck de l’histoire du rock. Refrain de génie avec accélération et chorus énorme envoyé à la revoyure, et une ligne de basse qui remonte à contre-courant. Un modèle du genre. «Bad Luck Situation» est une compo de Johnny, bien rock et bien tapée, avec des yeah et des ouh bien sentis. C’est ce qu’on pourrait appeler du gros rock texan avoiné au phrasé boogie secoué.

Voulant toujours mieux capitaliser sur la renommée de Johnny, Steve Paul monte le label Blue Sky pour sortir un nouvel album, «Johnny Dawson Winter III», un album considéré comme l’un des plus faibles. Fort belle pochette. On retrouve les fantastiques Randy Jo Hobbs et Richard Hughes sur «Rock’n’Roll People» chanté avec la hargne habituelle. Ils forment tous les trois un trio infernal. Johnny semble au mieux de sa forme. C’est en écoutant «Self-Destructive Blues» qu’on réalise à quel point Johnny et Jimi Hendrix ont su réinventer le blues rock. Voilà encore une pièce énorme, embarquée à la texane. Johnny nous sort le grand jeu guttural et ça reste l’excellence des descentes riffées dans l’art de la tradition. «Raised On Rock» fait aussi partie des belles pièces de rock seventies, fabuleuses car enjouées, solidement charpentées et tenues par un refrain infernalement mélodieux chanté à l’unisson. Pure magie d’époque. «Mind Over Matter» est encore un cut d’Allen Toussaint. De la part de Johnny c’est à la fois judicieux et courageux. Johnny ne fait rien au hasard. Il traite ce groove funky de la Nouvelle Orleans au guttural. Puis on tombe sur un «Pick Up On My Mojo» solidement rythmé à la syncope. On entend rarement des choses comme celle-ci. On retrouve la puissance du trash-blues torrentiel habituel, mais monté sur une base funky. Extraordinaire.

C’est encore à Richard Avedon qu’on doit la fantastique pochette de «Together» qui réunit les deux frères. On trouve deux coups de génie sur cet album. Reprise de «Harlem Shuffle», le morceau fétiche de Vigon. Le guttural a rendez-vous avec la soul. Version superbe et imbattable. Puis ils tapent ensuite dans «You’ve Lost That Loving Feeling». Ils osent. Leur couleur vocale est différente de celle des Righteous Brothers , mais Edgar réussit à descendre dans son baryton. Ils essaient ensuite de grimper et atteignent leurs propres cimes. Pur génie. Ils tapent dans l’intouchable avec une fabuleuse différence d’approche.
Johnny commence à se lasser du rock. Au fond, ce n’est pas son truc. Il reçoit un coup de fil lui proposant de produire son héros Muddy Waters, alors c’est comme une révélation divine. Ça signifie pour lui qu’il est grand temps de revenir aux sources. Il se pointe à une répétition de son groupe et annonce tout simplement aux autres qu’il arrête tout.
Johnny n’a pas une très haute opinion des frères Chess : «I don’t think he (Muddy) had a good relationship with Leonard and Marshall Chess. He said Chess wasn’t doin’ a lot to promote his albums, and he didn’t make much money from his old records. He wasn’t getting the proper control and respect.» (Je ne crois pas que Muddy avait une bonne relation avec Leonard et Marshall Chess. Il disait que Chess ne faisait pas grand-chose pour la promotion de ses albums et ses vieux albums ne lui rapportaient pas grand chose. Il n’avait ni le respect ni le contrôle qui lui étaient dus.) Et ils s’embarquent tous les deux dans la fantastique aventure de l’album «Hard Again». Muddy : «This music makes my pee pee hard again, so I’ll name it Hard Again». (Cette musique me refait bander. Aussi je vais appeler l’album Hard Again.) Et c’est une fois de plus Richard Avedon qui fait l’image de couve. Muddy fut shooté avec les vêtements qu’il portait et ça s’est fait aussitôt. Comme le disque.
Johnny est content du résultat : «Those records made Muddy’s carreer happen again. bein’ affiliated with Columbia and Blue Sky helped - ‘cause he made the money he was supposed to make - instead of not getting the money like in the Chess days.» (Ces disques ont fait redémarrer la carrière de Muddy. Ça l’a bien aidé d’être en cheville avec Columbia et Blue Sky. C’est la grosse différence avec l’époque Chess où il ne ramassait pas un rond.) Et crac. Muddy et Johnny s’amusent bien ensemble. Muddy l’invite chez lui pour l’anniversaire de Koko Taylor. On aurait bien aimé être là, nous aussi.
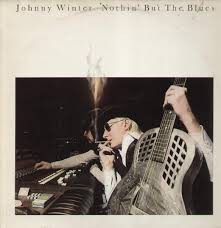
Johnny sort ensuite un pur album de blues, «Nothing But The Blues» avec l’orchestre de Muddy, James Cotton à l’harmo, Bob Margolin et Pinetop Perkins - «Better than a British blues band ‘cause the British stuff wasn’t real». (Meilleur qu’un groupe de british Blues parce que le british blues n’était pas authentique.) Mais Steve Paul n’est pas content. «Steve Paul didn’t particulary like me doin’ that but I had the power to do what I wanted.» (Steve Paul n’appréciait pas que je fasse ce disque, mais j’avais le pouvoir de décider de ce que je voulais faire.) Encore heureux ! Avec «Tired Of Tryin’», Johnny grimpe directement au paradis et ça s’entend. Voici une nouvelle leçon de maintien extraordinaire. «Sweet Love And Evil Woman» est du typical Johnny, boogie blues guttural et bien balancé. Blues de rêve avec «Everybody’s Blues». Quelle veine ! Il a derrière lui le meilleur orchestre du monde. Les vieux blackos sortent le grand jeu. Johnny ramène son gros guttural et ça devient énorme. Ce blues est bardé d’étonnantes atonalités. Ce sont les chœurs d’artichaut choo-choo qui provoquent le trouble. Pur chef-d’œuvre. Face B, on tombe sur un «Mad Blues» qui porte bien son nom, car swingué à l’excès. Willie Smith bat comme un diable. James Cotton ne lâche pas l’harmo. Ce sont des forcenés. Le boogie blues rôtit en enfer. Willie Smith bat ça exactement comme «Fast Life Rider». En plus il est devant dans le mix. Voilà un modèle d’incongruité bluesy.
Quand Johnny est interviewé à la télé pour parler des drogues, il provoque un petit malaise. Avez-vous un message pour les jeunes Américains ? Johnny réfléchit une minute et croasse : «Well, I’ve always thought anything that doesn’t kill you makes you stronger.» Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Censuré.

En 1978, Johnny entre de nouveau en studio pour enregistrer «White Hot & Blue». Bizarrement, l’album n’accroche pas. Il fait tout à l’ancienne, jazzifie un peu sur «Walking By Myself» et multiplie les variations de boogie-blues. En face B, on trouve reprise de Taj Mahal, «EZ Rider», mais les autres morceaux restent d’une grande banalité.

Dernier album paru sur Blue Sky, «Raisin’ Cain». Steve Paul arrête son label parce que ça ne rapporte pas gros - «There wasn’t any big money in it». Johnny connaît bien le côté rapace de son impresario : «He was making good money off of all us but he wanted big money. He wanted something huge. Selling almost a million copies, like the Beatles or the Rolling Stones.» (Il gagnait pas mal de blé sur notre dos, mais il voulait gagner beaucoup plus, vendre des millions de disques, comme les Beatles ou les Rolling Stones.) Johnny est toujours incroyablement enthousiaste. Son «Sittin’ In The Jail House» reste du boogie blues classique et sans histoires. Guttural et wintérisation des choses. Par contre, sa reprise de «Like A Rolling Stone» renoue avec l’inspiration. En face B se trouve une beau heavy blues, «Wolf In Sheep’s Clothing» bien classique. C’est tout ce qu’il sait faire, mais il le fait à la perfection.
Quand Johnny se rend aux funérailles de Muddy, il chiale comme un môme. «I was trying to talk to B.B. King and I couldn’t even talk to him I was crying so much. It hit me hard. I missed all the times we had recording together and getting to know him.» (J’essayais de parler à BB King, mais je n’y arrivais pas car je pleurais trop. Ça m’a tué. Les moments que j’avais partagés avec lui pour enregistrer et apprendre à la connaître me manquaient.)

Et puis Johnny se décide à virer Steve Paul et il demande à Teddy Slatus son road manger de devenir manager tout court. Fatale erreur. C’est aussi l’époque où Johnny commence à se faire tatouer. Les tatouages de son pote Keith Fergusson l’intriguaient. Et Spider Webb, le tatoueur de Keith, lui dit que tatouer une peau blanche comme la sienne, c’est un vrai rêve de tatoueur. Autre événement de taille : Johnny rencontre Bruce Iglauer, le boss d’Alligator, un label qu’il a créé à seule fin de sortir les albums de Hound Dog Taylor. Le premier album que Johnny sort sur Alligator s’appelle «Guitar Slinger». Mais la relation avec Iglauer est compliquée. On retrouve le boogie-blues de rêve avec «Don’t Take Advantage Of Me», monté sur une rythmique souple et ronde. Pour ce disque, Johnny a recruté Casey Jones et Johnny B Gayder qui ont accompagné Albert Collins. Là, on ne rigole plus. Toujours du heavy blues avec «Iodine In My Coffee» et un balladif passionnant en face B avec «Kiss Tomorrow Goodbye».

Il fait un deuxième album avec Iglauer, «Serious Business». On découvre avec une certaine surprise un gros son métallique sur «Master Mechanic». Comme à son habitude, Johnny y va de bon cœur. Il a une nouvelle section rythmique. Gros son bien sourd sur «Sound The Bell» et il fait sa sorcière de Walt Disney pour «Murdering Blues». Il soigne la tradition du heavy blues texan. On reste dans l’underground de la routine en face B avec «Unseen Eye» et on se régale d’un «Give it Back» bien poundé dans lequel Johnny se racle la glotte au sang.
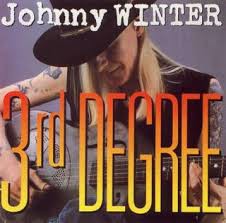
Un troisième album sort sur Alligator : «Third Degree». Et là Johnny tape dans JB Lenoir (reprise démente de «Mojo Boogie»). Il invite du beau monde, Doctor John et ses vieux amis Uncle John et Tommy Shannon. Cette vieille section rythmique fait merveille sur «See See Baby». C’est un bonheur que de les retrouver en compagnie de Johnny. Puis il dobrote «Bad Girl Blues» à l’ancienne. Il prend ses aises, yeahhh, turn around. Sur «Broke And Lonely», Uncle John fait sa locomotive. Brave ami.

Pour «Winter of 88», Terry Manning est engagé comme producteur. Manning est une figure légendaire de Memphis. Il a commencé comme ingénieur du son chez Stax puis a travaillé au studio Ardent. Il a produit des disques des Fabulous Thunderbirds et de ZZ Top. Mais Johnny ne comprend rien à sa technique de production. Manning demande à Johnny d’enregistrer des petits bouts de morceaux. Ils ne s’adressent plus la parole. «I never had a producer as bad as him. He knew exactly what I wanted but he didn’t want to do it. He was so bad. I almost got in a fistfight with him.» (Je n’ai jamais connu de producteur aussi mauvais que lui. Il savait exactement ce que je voulais, mais il ne voulait pas travailler comme ça. J’ai failli lui mettre mon poing dans la gueule.) L’incroyable de cette histoire, c’est que l’album est monstrueux. «Close To Me» est monté sur un heavy bass drum. Johnny opère un sacré retour en force, épaulé par des chœurs à la ramasse. Même si les ingrédients sont les mêmes, ce morceau force la sympathie. Johnny Winter reste le héros de nos quinze ans, avec une constance qui en impose. Il recherche en permanence le beat du blues. Sur la pochette, on voit le dragon qu’il s’est fait tatouer sur la poitrine. Il est à l’image de ce dragon. Il revient toujours. Nouveau heavy rock ardu et bien troussé : «Stranger Blues». On y va. On adhère. Johnny retrouve sa veine du bras. Il nous fait du grand Winter. Cut bien chanté, beat estimable. Un certain John Crampton bat le beurre et l’ami Jon Paris joue de la basse. Johnny envoie sa purée légendaire. Il a sa propre virtuosité. C’est un sacré furet. On le voit filer à l’horizon de la légende. Toujours du heavy blues avec «World Of Contradiction». L’héritage de Muddy est entre de bonnes mains. En face B se trouve l’excellent «Lightning», puissant, traité à la Bo Diddley, avec une basse pouet pouet devant toute. Il faut voir l’efficacité d’un tel processus d’explosivité. Avec «Show Me», Johnny se fait plus stonesy que les Stones.

Pour «Let Me In», tout se passe bien. Johnny embarque directement «Illustrated Man» au guttural. L’illustrated man, c’est lui, le tatoué - I’ve got tattoos everywhere ! Puis avec un petit coup de main de Dr John, il tape dans le «Barefooting» de Robert Parker. Puis il renoue avec la magie en attaquant «Blue Mood», un heavy blues de jazz joué à la corde pincée. C’est tout l’art de Johnny : il va là où les autres n’osent pas aller. Il joue comme Wes Montgomery - everywhere I listen to the music/ It drives me back to my homeland. Il joue comme un dieu sur tapis de stand-up. Ce mec a toujours été un génie et il en rajoute une petite louche destinée aux malheureux qui n’ont rien compris. Après 20 albums, Johnny Winter est encore capable de jouer un cut inspiré. Qu’on se le dise. Puis il s’amuse comme un fou avec le fameux «Sugaree» repris par Au Bonheur des Dames - Oh les filles, elles me rendront marteau ! S’ensuit un vrai blues rock végétatif intitulé «Medecine Man» et là, on tape dans le cœur de la mythologie du blues texan. Sacré Johnny, il va perpétuer la grosse tradition jusqu’à son dernier souffle, et rien que pour ça, il est admirable. Tous les pseudo-diggers qui creusent les seventies devraient écouter ça avant d’aller se faire soigner par un psy. Car toute l’effarence des seventies s’y trouve dûment concentrée. Avec «You’re Humbuggin’ Me», Johnny embarque son monde au gimmick, puis il arrive aussitôt au micro. Quel fabuleux cavalier. Il chevauche à fond de train. «Got To Find My baby» est un cut beaucoup plus ambitieux et syncopé à outrance. Il tire ensuite sa révérence à Jimmy Reed avec une belle reprise de «Shame Shame Shame» et boucle l’affaire avec une autre reprise, le «You Lie Too Much» de Dr John.
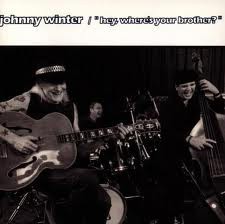
Il enregistre «Hey Where’s Your Brother» au même endroit et avec la même équipe. Pour être tout à fait franc, c’est vrai qu’on finit par ne plus suivre le détail des équipes. Il attaque en force avec une déclaration d’intention : «Johnny Guitar». «They call me Johnny Guitar !» Gros son, - I play rock’n’roll - on le sait, mais c’est toujours bien quand il le redit, des fois qu’on ait pas compris. Superbe et supérieur, admirable en diable, sacré Johnny, il sait rester en flux tendu, comme ses compères texans les Zizimen. Il ne peut pas s’arrêter comme ça. «She Likes The Boogie Real Low» : voilà encore une leçon de maintien extraordinaire. Il embarque ça au riff jumpy de jazz-band démentoïde et nous donne une pure leçon de swing. Puis on a un slow effarant qui s’intitule «Please Come Home For Christmas». Edgar vient chanter avec son frère. C’est une vraie perle, ce qu’on appelle un duo d’enfer. Ils sont très forts, capables des merveilles, comme on l’a vu dans l’album «Together». Leur version est monstrueuse, Edgar va chercher son falsetto et Johnny reste dans les graves. On a le même genre de magie que chez les Righteous Brothers. Avec «You Keep Sayin’ That You’re Leaving», on a le blues dégringolé de sa chaise. Johnny le chante, yeah, avec l’abandon du Texas. Il coule tout seul. Quelle misère de bonheur que de le voir s’écouler ainsi. Heavy blues à la ramasse avec «Blues This Bad» et swing à la revoyure avec «No More Doggin’», secoué par une rythmique de malades. Attention, cet album date de 1992, c’est-à-dire de 22 ans. Quasiment tous les morceaux de l’album sont exceptionnels, rudes, carrés et inspirés.
C’est Rick Derringer qui déclenche l’alerte. Johnny prend trop de médicaments et c’est cette ordure de Teddy Slatus, devenu alcoolique et tyrannique, qui le gave de cachets. En plus, Derringer accuse Slatus de détourner l’argent que gagne Johnny. Pour pouvoir rouler Johnny, Slatus l’affaiblit en le médicalisant à outrance. Il empêche même les gens de l’approcher. Pour Derringer et d’autres amis de Johnny, l’urgence va être de virer Slatus en qui Johnny a toujours une confiance aveugle. Slatus détient tous les droits et il paye un avocat pour veiller sur son business. Un journaliste qui ose provoquer Slatus déclare : «Teddy Slatus est un monster !» Edgar dit à son frère que Slatus est un escroc. Rick Derringer lui répète la même chose. Alors Johnny en parle à Slatus qui devient fou de rage. Il s’étrangle et frise l’apoplexie. Il ne supporte pas qu’on l’accuse de vol alors qu’il fait tout ce qu’il faut pour le bien de Johnny.

En voyant «Im A Bluesman» dans les bacs, on hésitait un peu. On craignait de s’ennuyer. Quelle grave erreur ! L’album est stupéfiant d’énergie. On saute en l’air dès le morceau titre de l’album, ça pète et ça pisse à tous les étages, comme dirait Gainsbarre - Cause I’m ready to play - c’est le Texas qui parle avec de gros moyens. Johnny Winter est toujours partant. Il reste un fabuleux entertainer. Heavy blues de luxe avec «Cheatin’ Blues», I can’t believe et compagnie. Heavy boogie avec «Lone Wolf» et retour au heavy blues avec «The Monkey Song» que Johnny chante avec la voix d’un vieil homme. C’est étrangement beau. Il joue un solo à la goutte de note et il repart en seigneur. Dans «Shake Down» il nous fait un solo étranglé - turn around/ Hit the ground/ Shake down no no no - ça sonne comme un hit. Johnny is the beast ! It’s the price to pay. Il prend «Sweet Little Baby» à la Chuck, mais comme c’est un carnassier texan, il réinvente. D’ailleurs, il réinvente en permanence. Il a derrière lui une grosse équipe, alors il en profite. Il finit par se perdre dans la virtuosité. Johnny Winter est l’un des très grands héros du rock américain. Avec «That Wouldn’t Satisfy», il sort le bottleneck du bord du fleuve et fait son génie du blues. Puis on tombe sur une monstruosité nommée «Sugar Coated Love», un boogie blues de Lazy Lester dément, pur boogie d’americana que Johnny embarque au guttural. Il veille au grain. Quelle panacée ! Et il termine ce fantastique album avec un stomp qui s’appelle «Let’s Start All Over Again», beau, dur et dressé, râpeux, rond et humide comme le gland d’un amoureux transi.

Le dernier album en date de Johnny s’appelle «Roots». Retour aux sources avec un album de blues classique et un peu ennuyeux. On y sent la fin de parcours. Pourtant, le son de l’album est bon. Mais on connaît toutes les ficelles de Johnny. On se réveille en face B avec une version stupéfiante de «Dust My Broom», raunchy et incroyablement raclée au chant. Ça sent le vieux bois verni, les vieux accords et les vieux doigts patinés par le temps.
C’est l’harmoniciste James Montgomery qui réussit à amener Johnny chez un médecin qu’il connaît. Le médecin demande à Johnny de vider sur la table le petit sac en cuir qu’il porte attaché au cou. Johnny s’exécute. Le médecin pousse un hurlement. Il n’a jamais vu autant de cachets ! De la méthadone et d’autres trucs en pagaille. Monsieur Winter, vous avalez tout ça tous les jours ? Mais ce n’est pas possible ! Mais si. Cadeau de cette ordure de Teddy Slatus. Johnny est aussitôt pris en charge par des spécialistes qui vont l’aider à décrocher du Risperdal et de la Klonopin. Onze ans d’addiction. Il lui faudra un an pour décrocher de ce traitement de cheval. Redevenu lucide, Johnny sera éternellement reconnaissant à James Montgomery de l’avoir sorti de cet enfer. Car il commençait à avoir de sérieux problèmes, du genre bloblote, ce qui n’est pas vraiment idéal quand on joue de la guitare. Puis Johnny finit enfin par comprendre que Teddy lui vole son blé. Alors il le vire et demande à son guitariste Paul Nelson de le remplacer. Ouf ! Le cauchemar s’achève enfin. Cette ordure de Slatus va mal finir. Un jour, ivre-mort, il tombe dans un escalier et se tue. On ne l’a même pas poussé.
C’est grâce à Paul Nelson qu’on a pu revoir Johnny sur scène en France. Un vrai miracle.
D’ailleurs, il devait revenir jouer au Havre le 29 novembre. On se frottait les mains. Mais il a cassé sa pipe en Suisse, dans une chambre d’hôtel. Johnny était en tournée. Il a failli mourir sur scène comme Molière et comme Mick Farren. La classe.
Signé : Cazengler, alias Johnny Wintare
Disparu le 16 juillet 2014
Johnny Winter. The Progressive Blues Experiment. Sonobeat 1968
Johnny Winter. Johnny Winter. CBS 1969
Johnny Winter. Second Winter. CBS 1969
Johnny Winter. Johnny Winter And. CBS 1970
Johnny Winter And. Live. CBS 1971
Johnny & Edgar Winter. Roadwork. Epic 1972
Johnny Winter. Still Alive And Well. CBS 1973
Johnny Winter. Saints & Sinners. CBS 1974
Johnny Winter. Johnny Dawson Winter III. CBS 1974
Johnny & Edgar Winter. Together. Blue Sky 1976
Johnny Winter. Nothing But The Blues. Blue Sky 1977
Johnny Winter. White Hot And Blue. Blue Sky 1978
Johnny Winter. Raisin’ Cain. Blue Sky 1980
Johnny Winter. Guitar Slinger. Sonet 1984
Johnny Winter. Serious Business. Alligator Records 1985
Johnny Winter. Third Degree. Sonet 1986
Johnny Winter. The Winter Of 88. MCA 1988
Johnny Winter. Let Me In. Point Blank 1991
Johnny Winter. Hey Where’s Your Brother ? Point Blank 1992
Johnny Winter. I’m A Bluesman. Virgin 2004
Johnny Winter. Roots. Sonobeat 2011
Mary Lou Sullivan. Raisin’ Cain. The Wild And Raucous Story Of Johnny Winter. Backbeat Books 2010
20 - 07 - 2014 / REALMONT ( 81 )
BLOOMING TRACZIR / MORAND CAJUN BAND
PATHFINDERS / HOOP’S 45

La teuf-teuf ronchonne, la pluie battante sur l’autoroute qui empêche toute visibilité, elle s’en moque, elle en a vu d’autres mais dès que l’on aborde les nationales du Tarn, une froide colère la ronge. N’ont pas inventé le fil à couper le beurre dans le département mais ils ont résolu le problème des vitesses excessives, limitation à 70 km / heure généralisée sur les derniers quarante kilomètres du parcours, crusin’ mais pas race with the Devil, ce n’est pas par ici qu’elle pourra jouer au Hot Rod Gang.

Dix-septième festival Re’ Al Croche de Réalmont, trois jours - c’est la programmation du dernier qui nous séduit - dédiés aux musiques que l’on aime, Rock, Country, Blues, Rockabilly, Cajun. Realmont bourg typique du midi-pyrénéen, sa place entourée d’arcades, ses longues allées bordées de platanes. Le festival s’étire en longueur, trois cents mètres de comptoirs sans interruption sur votre droite, boutiques de fringues et d’accessoires divers sur votre gauche, avec disquaire spécialisé en bout de chaîne. Deux scènes. La plus grande inutilisable car la pluie de la nuit s’est infiltrée dans les prises électriques, et scène d’appoint pratiquement en début du mail sur laquelle se dérouleront les concerts de cette fin d’après-midi et de la soirée.
Attardez-vous sous la halle couverte du marché. Squattée par une impressionnante flottille de Cadillacs, Chevrolets et Pontiacs. Uniquement des gros modèles. Des tanks, des paquebots, des mastodontes de quinze mètres de long, à croire qu’en région parisienne les collectionneurs qui paradent dans les diverses manifestations teuf-teuf vintage américaines ne possèdent que des répliques en modèles réduits Dinky Toys.
BLOOMING TRACZIR
J’arrive pile-poil lorsque les Blooming Traczir entament leur show. Du blues rock bien appuyé qui tache. Sans prétention mais du solide à toute épreuve. Meubles de jardin qui peuvent passer quinze hivers dehors sans en être affecté. Le vernis ne craquèlera pas, aucune éraflure possible. Inaltérables. Pas prétentieux pour une clef de sol, des ados de quarante printemps qui continuent de jouer leur rock garage sans se poser de questions existentielles sur la survie des dinosaures. Ils aiment ça et nous aussi. Des gens qui restent fidèles à leur rêve et qui reprennent pour la quatre centième fois le You Really Got Me des Kinks sans tergiverser. Aucune hésitation, aucune surprise. Un super guitariste qui vous débite ses soli comme un charcutier ses tranches de mortadelle, faite maison, premier choix, garantie bio. Plus les trois autres acolytes qui lui affûtent les couteaux. Un regard sur les jambes de la chanteuse qui assure en toute simplicité, en toute efficacité.

L’on aimerait davantage, du trashzir, du bloom-dooming, de l’esbroufe et du glamour. Mais non ce sont des fantassins du rock. De cette piétaille indispensable aux victoires des généraux. Mais ici, il manque un stratège aux plans audacieux. Sont applaudis pour leur vaillance mais les spectateurs auraient aimé assister à quelque haut-fait d’arme. Z’ont les bases mais comme aurait dit René Char il leur faut maintenant rechercher le sommet.
MORAND CAJUN BAND

Nouvelle-Orléans. Respect. Toute la musique que nous aimons vient de là. Enfin une partie. Le jazz plutôt, mais le rock a aussi d’autres racines dans les Appalaches et le haut du Delta. Ne cherchons pas le Bâton Rouge pour nous faire battre. Car pour le Morand Cajun Band il n’y a pas photo, sont prêts à crier toutes les cinq minutes Lafayette nous voilà. Le cajun français vit actuellement un renouveau. Historialement logique puisque à l’origine la Louisiane, allons z’anciens enfants de la patrie, flon-flon et cocorico. Dans l’insouciance des gaies musiques de la lointaine acadie doit demeurer un ancien fonds franchouillard, agréable aux narines de quelques uns de nos contemporains.

Bons musiciens, zique entraînante. Sauront se tirer d’une situation difficile lorsque l’électricité claquera. Ni une ni deux, violon en tête, percus et guitares descendront de scène et s’en viendront faire un tour parmi les spectateurs, frappent des mains, escaladent les tables de la buvette, se taillent un franc succès et se retrouvent devant leur micros à l’instant précis où la fée électrique daigne revenir.
Sympathique. Connaissent leur boulot. Dommage qu’ils se sentent obligés de présenter chaque morceau en spécifiant à chaque fois que celui-ci a été écrit trois, quatre, dix ans avant tel standard du rock and roll. Entre parenthèses les similitudes ne sont pas aussi évidentes qu’ils le prétendent. Mais ce n’est pas le plus important, la musique populaire américaine n’est qu’une vaste entreprise de recyclage, cette particularité est l’essence même de sa singularité, tous genres confondus, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les modes et de renaître sempiternellement de ses cendres. L’on garde la viande ou le poisson mais on invente une nouvelle béchamel et comme dirait Hank Williams avant de repasser le bébé country aux rockers, en avant le gumbo.
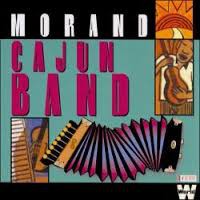
En plus quand on cherche la petite bête au rock and roll, on la trouve. Le cajun est une excellente musique de danse, fun, fun, fun, comme chantaient les Beach Boys sur les plages de l’insouciance sixties. Mais le rock and roll s’est vite chargé du bruit et de la fureur de son siècle. Certes à ses débuts un aspect danse de salon plus ou moins acrobatique, mais s’est aussitôt teinté d’une dramaturgie existentielle très éloignée des joyeuses exubérances de nos modernes amateurs de cajun. Z’ont repeint l’âme noire de leur musique en rose pimpant. Le rock and roll a choisi au contraire de noircir le bleu originel tout en le soulignant de longues trainées sanglantes. De la physique des corps à la métaphysique du métabolisme.
Agréable. Mais je les laisse partir sans regret. Le bonheur de la phalange d’amateurs de danses countries - étrangement une majorité d’individus du sexe mâle - qui n’ont pas raté un seul rigodon. Increvables. Infatigables. A plus amer, vont nos rêves, dixit Saint-John Perse.
PATHFINDERS ( I )
Mois de juin décevant. Il se murmurait que les Pathfinders feraient un concert en région parisienne en cette période pré-vacancière. J’ai eu beau envoyer mon âne de sœur sur la plus haute tour, l’on n’a rien vu venir. Pas même un peu de poussière poudroyant sur le sentier de ses découvreurs. J’avais adoré leur premier CD ( voir KR’TNT 174 du 30 / 01 / 14 ) mais une question ne cessait de me turlupiner. Comment font-ils ! Et peut-être même Comment font-elle ? Le disque super, un des meilleurs scuds cent pour cent rhythm and blues enregistré en ce pays - peut-être même le meilleur mais à ce niveau là, les premières places c’est au centième de seconde près. Oui, mais lors de l’enregistrement ils avaient bénéficié d’une locale et superbe formation de cuivres. Comment Lil'lou se débrouille-t-elle en concert pour poser sa voix sur son minuscule rock and roll trio, me demandais-je. Facile de mener la charge lorsque derrière vous les canonnières aplanissent le terrain. Mais sans artillerie d’appoint qui déblaie le chemin, comment s’y prend-elle ? Le problème me hantait mais je ne parvenais pas à résoudre l’équation.
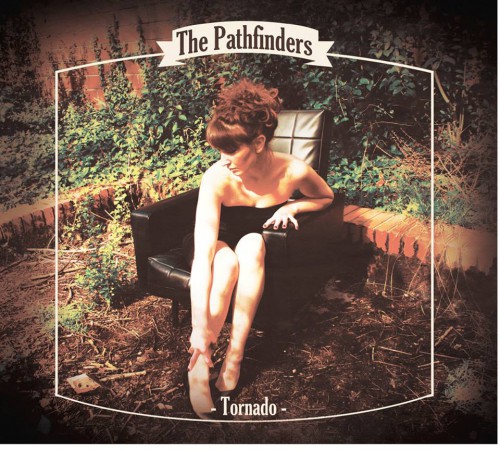
J’ai regardé rockarocky une dernière fois avant de partir pour l’Ariège, tiens les Hoop’s dans le Tarn, le 20 juillet, deux heures de route, je leur ferai la surprise. C’est en cherchant des renseignements sur ce bled perdu de Réalmont que je suis tombé sur le programme du festival. Enfer et damnation ! Non seulement il y a les Hoop’s mais en plus ils ont programmé Patfhfinders juste avant. C’est-ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups de bol ! Il en faut peu pour faire le bonheur d’un rocker.
PATHFINDERS ( II )
Je décompte sur mes doigts. Un, deux, trois. Guitare, basse, batterie. Pas un de plus, pas un de moins. Tous les trois seuls sur la scène. Dans les coulisses latérales, à la vue de tous, il y a bien un saxophoniste d’appoint qui tourne en rond comme un lion en cage en mordillant son instrument, talonné par le taon de l’impatience, mais pour le moment il ne compte pas. Une instru enlevée mais que je qualifierai de débonnaire. Un tempo souple aux forts relents jazzy et pouf, trente-cinq secondes après, sans préavis - l’on a bien vu Lil'lou surgir de l’escalier dans sa robe à fleurs, mais l’on ne s’est pas méfié - d’entrée de jeu à la seconde où tout sourire elle s’empare du micro, c’est Hiroshima mon amour. Explosion atomique.

Vous parle pas des musiciens. Il n’y a pas deux minutes c’étaient d’inoffensifs promeneurs, vous les auriez engagés les yeux fermés pour le cours de danse charleston de votre fille, et maintenant un gang de tueurs en série. Le plus méchant avec sa coupe rockab fifties c’est Guy le soliste, vous enfonce le couteau dans le ventre puis il tire et vous arrache consciencieusement dix mètres d’intestin tout en filant un solo sans fin à vous découper en l’œsophage en rondelles. Le plus brute c’est Baptiste, le batteur qui frappe sans discours mais avec méthode. Vous assène des coups vicieux comme si vous étiez son sparrin-partner préféré. Aucune surprise, pas le genre à surgir par derrière, ça tombe toujours à l’endroit précis où vous attendez l’onde de choc, vous aimeriez lui échapper mais il vous rattrape et vous passe à tabac sans ménagement. Enfin l’autre, le plus traître s’arrange toujours pour s’abriter derrière la silhouette de Lil'lou, se cache derrière une fille, vous ne le voyez pas mais il vous dézingue de ses cordées de basse qui vous broient les jambes comme les bolas des gauchos argentins qui s’enroulent autour des pattes des autruches.

Des mauvais garçons. Qui donneront le mauvais exemple à notre saine jeunesse. Enfin à ceux qui espèrent devenir de jeunes cadres dynamiques. Comme si ça ne leur suffisait pas de dégager une onde sonore phénoménale, passent le plus clair de leur temps à tirer voluptueusement sur leurs cigarettes. Au début ils ont interloqué le staff des danseurs de country, mais au troisième morceau ils se sont aperçus que ces trois enfants du chaos n’étaient pas les fils du désordre, fournissaient une musique charpentée et ordonnée. Nul besoin de ponctuation cuivrée pour indiquer l’armature des morceaux, procurent à Lil'lou les lourdes draperies dont elle a besoin pour vêtir son chant. La preuve étant faite que les Pathfinders n’ont nul besoin de fanfare cuivrée pour leur set, l’on permet à Sylvain, l’invité surprise de la dernière heure, de monter sur scène avec son saxophone rugissant.
Voilà, vous en savez assez pour comprendre la rutilante puissance de ce groupe. Je vous quitte. El l’on passe aux Hoop’s. Comment ? J’aurais oublié quelqu’une ? Ô pauvres humains remplis d’illusion fraternelles, vous croyez donc que le plaisir de voir Lil'lou se partage ? Non, jamais ! Enfin puisque vous insistez et que je suis dans mon jour de grande bonté, voici la fin de l’histoire. Que vous ne méritez en aucune façon.

Nous en étions donc au début lorsque la bombe atomique a éclaté. Comment de ce mignon petit être de chair à l’apparence si fragile peut-il surgir un tel grondement apocalyptique ? Mystère de la nature. Debout devant le micro, seuls ses bras bougent, mais l’on sent l’énergie sous pression qui traverse son corps, emplit ses poumons, souffle en tempête sur ses cordes vocales et s’exhale de sa gorge comme un cri tumultueux de libération. I Want Some More, My Wolf, les titres parlent d’eux-mêmes et sont profession de foi, davantage de la vie, davantage de sauvagerie. Une voix rhythm and blues et un phrasé rock, puissance noire et sapience blanche intimement mêlés, Lil'lou opère cette impossible transfsion. N’arrache pas les mots à la Little Richard, les propulse à la Tina Turner - car c’est à ce niveau de qualité que les comparaisons doivent être établies - plus femelle qu’Amy Winehouse et plus instinctive qu’Etta James. Quelques mots au public pour reprendre souffle et « Venga ! Venga ! » elle repart en courant se mesurer avec le taureau noir des soulsisters américaines. Jusqu’aux danseurs qui s’aperçoivent que quelque chose est en train de se passer et qui pour la plupart arrêtent leurs quadrilles pour écouter. La foule se masse devant l’estrade fascinée par cette bête de scène, ce dragon lanceur de flammes en éruption. Woodoo Woman, Bury My Love, Tornado, chaque morceau comme autant de fournaises rougeoyantes, l’on se dirige avec regret vers la fin du set. Les passages sont minutés, mais l’organisation craque et l’on aura droit à trois rappels. FABULIL'LOUSA !
Fin de la partie. Ovation triomphale. Les Pathfinders se partagent les tâches. Les garçons font le ménage, ils rangent leur matos et Lil'lou tout sourire, toute fraîche comme si elle venait de lire le journal, vend et signe des CD à la pelle. Peut être fière d’elle. Un concert mémorial.
Pour sûr, les Pathfinders ont trouvé le real and pure sentier du rock and roll !
HOOP’S 45
Pas facile de passer après the voice. Mais les Hoop’s montent sur scène le sourire aux lèvres. Demandent juste trois minutes pour quelques réglages de sono. Nous pondent tout de go un bijou de précision extrême un petit Oh ! Boy ! parfaitement en place. Le présentateur résumera la situation en peu de mots : « Un groupe qui fait une telle balance sur un morceau de Buddy Holly ne peut pas être tout à fait mauvais ! » Frémissement dans le public, l’on sent qu’il y a des connaisseurs dans la place. Fin de soirée, toute une partie de l’assistance familiale de l’après-midi a ramené les gosses à la maison mais il reste un fort contingent d’amateurs en symbiose totale avec la musique proposée par les Hoop’s.

Et puis sur cette scène pro il y a le son, rien à voir avec le sympathique concert dans l’étroitesse du resto de Montreuil ( voir KR’TNT ! 196 du 03 / 07 / 14 ). De la première à la dernière note, les Hoop’s survoltés survolent. Un set de rêve. Tous en grande forme. Kévin sous son chapeau et à la batterie ne bride plus ses coups. Franchement et toute la gomme. Pousse au rythme comme d’autres au crime. Pas un frappé qui ponctue, mais qui glisse et entraîne, slippin’ and slidin’ dirait Little Richard dont les Hoop’s reprennent comme par hasard Long Tall Sally et Rip It Up, une frappe rapide et courte comme s’il était urgent de ne pas s’arrêter, de ne pas s’appesantir sur le temps, de provoquer une espèce de battement hystérique d’un cœur qui se dérègle. Le Twenty Flight Rock d’Eddie Cochran interprété en second morceau s’avère être le parangon de cette prestance rockabilly qui joue sur l’urgence et la suffocation.
Le mec aux manettes derrière sa table de mixage ne doit pas être né de la dernière pluie. J’ai rarement entendu une guitare rythmique vibrer aussi impérieusement dans un concert. Pas question pour elle de servir de bruit de fond ou de faire tapisserie. Elle sonne, elle colorie, elle impose et implose cette rapidité flamboyante qui est la marque fondamentale du style des Hoop’s. Steph en est comme libéré, peut se consacrer au chant. Et il envoie méchant. L’est en train de carburer sur Mystery Train lorsque Lil'lou qui trépigne dans le public me demande à l’oreille si je crois qu’elle peut le rejoindre sur scène. Si je crois ! Elle y va, elle y court et elle y vole. Et nous laissons faire notre reine. Moment de rêve, Lil'lou et Steph se partagent les couplets, chacun gardant son style, tous deux éblouissants, une illustration merveilleuse de la transmutation qui s’opéra dans les studios Sun grâce à Elvis, comment le rhythm and blues noir passa le témoin au rock and roll blanc. Pas question d’arrêter le convoi à la première gare. L’est des plaisirs et des moments de grâce qu’il convient de faire durer. Max vous prend sur sa bolid Gretsch de ces tournants en épingle à cheveux à vous faire remonter l’estomac dans la boîte crânienne et Richard entreprend de se jeter à sa poursuite avec sa basse trucker, pour un peu l'on se croirait dans Duel de Spielberg. Lil'lou en profite pour s’éclipser, pas folle la guêpe elle vient de scier les câbles du frein, aux Hoop’s de se débrouiller.

Ca n’a pas l’air de les inquiéter, non seulement ils ne cherchent pas à ralentir mais ils accélèrent. Richard ouvre le bal sur Stray Cat Strut, le chat fou qui au trentième étage ondule sur la gouttière branlante, c’est lui, tempo félin, les yeux fermés, ne joue pas avec ses doigts qui se sont transformés en griffes rétractibles, de temps en temps Max lui lance une souris électrique à toute vitesse entre les pattes, ce qui ne l’émeut pas plus que les miaulements de désespoir que s’amuse à pousser Steph, un truc à alerter la SPA. L’en faut plus pour déranger matou Richard dont la basse chaloupée nous fait ronronner de plaisir. Ce n’est pas terminé que l’on change de décor. Bagarre générale, pas à O.K. Corral mais au King Creole, Horions à tous les horizons, Richard balance des uppercuts par-en dessus, Max la menace vous enfonce trois ou quatre crans d’arrêts dans le dos, tandis que Kevin distribue les coups de massue sur la tête. Quant à Steph s’énerve vraiment et il gagne par KO technique chaque fois que sa voix explose sur le refrain.

De drôles de manières de calmer l’ambiance, Memory, tous les zombies de la terre se donnent rendez-vous autour de votre tombe, Un Gene And Eddie en grande pompe distribué savamment à coups de savates, celle-ci en plein dans le plexus pour Cochran et celle-là dans le buffet pour Vincent, mais déjà retentit le riff démoniaque de Summertime Blues. Un titre qui devrait être déclaré patrimoine mondial de l’humanité. Un appel à la transe que la foule reprend en chœur. Plus tard ce sera My Baby Left Me ce blues désabusé d’Arthur Crudup qu’Elvis avait transformé, dix ans avec les Stones, en revendication érotique de toutes les frustrations adolescentes. Presley, Cochran, Stray Cats, c’est entre ces trois phares baudelairiens du rock and roll que les Hoop’s 45 ont installé leur camp de base, un vieux fond de blues survitaminé à la nitroglycérine, une infernale rythmique sans cesse s’échoïfiant dans la reprise du même pattern, sans cesse opérant cette traversée du gué qui nous mène de la rive du même au rivage de l’autre par la grâce opérative de ce sempiternel retour reptilien qui ne se mord jamais la queue, et une volonté affirmée de faire voler tous les clichés établis d’un rétro-revival enfermé en d’étroites limites répétitives au profit d’une modélisation d’un son qui tout en respectant l’essentiel d’un héritage incomparable en redéfinit les contours pour les mieux approprier à notre époque. Toute la différence qui existe entre les reprises et un répertoire. Ce dernier terme à mettre en relation avec par exemple la musique classique pour reprendre un concept de Patick Eudeline. Tout cela traduit par la guitare de Max intensément électrique qui pousse Richard à s’aventurer dans des lignes de basse de plus en plu acrobatiques.

Un Ubangi Stomp aussi délirant que les descriptions des forêts américaines par Chateaubriand, les Hoop’s sont lancés dans une danse sauvage et échevelée, la fin du concert sur les chapeaux de roue, l’assistance prise de tremblements hypnotiques, si ça continue nous allons devenir tous fous. Z’en rajoutent une pincée avec une pincée d’un Johnny qui n’a jamais été aussi bon que ce soir-là, attention surchauffe générale. L’est sûr que les durites de notre cerveau vont éclater, mais Zeus tonnant, ami des rockers, le dieu des orages électriques, fait preuve de son infinie magnanimité en nous épargnant d’irrémédiables dommages. Une pluie fine et froide commence à tomber. Les rappels en seront écourtés, deux misérables morceaux alors que c’était parti pour durer jusqu’au petit matin. Ah ! Mes amis ! Quel concert ! Vous n’y étiez pas ? Et vous n’avez pas honte ! Vos petits enfants vous le reprocheront sur votre lit de mort.

Réalmont, Pathfinders, Hoop’s 45, j’y étais.
Damie Chad.
( Les photos glanées sur le net ne correspondent pas aux concerts )
CLERMONT ( 09 ) / 25 - 07 - 2014
LE SOULEILLA / JUKE JOINTS BLUES

L’a fallu faire demi-tour, la teuf-teuf y était passé devant sans que l’on s’en aperçoive. Au fin-fond du séronais, un paysage de rêve, des pentes herbeuses peuplées de vaches rêveuses, de sombres forêts à flanc de coteaux, le départ d’une voie romaine pour on ne sait où, la splendeur des pré-pyrénées en fin de journée ensoleillée. Peu de monde, de rares habitations, nous ne sommes pas loin du Mas d’Asil où se déroulaient les aventures de l’agent des Services Secrets su Rock and Roll dans notre feuilleton de la rentrée dernière ( voir KR’TNT ! des numéros 155 à 166 ).

Le Souleilla ( pour vous conformer aux incongruités de la graphie occitane vous prononcerez Souleillo ) sis en un croisement à trois pattes. Une ancienne école transformée en bistrot culturel. Un pari risqué, ouvert depuis le cinq avril mais déjà riche pour ce seul mois de juillet d’une dizaine de dates, musique et théâtre. L’on y fait feu de tout bois, épicerie fine et de première nécessité, viande et repas végétariens, brocante échangiste tous les dimanches après-midi, du miam-miam à vous pourlécher les babines, un accueil familial et chaleureux avec chaton fou et border-collie câlineur. Le rêve de tous les countries boys de France et Navarre.

Programmation mensuelle un peu axée sur l’Amérique du Sud, nous n’avons rien contre mais aux condors qui passent par-dessus les hauts sommets andins nous préférons de beaucoup les bleus moustiques du delta qui possèdent cette nocive particularité de vous trouer sans pitié et sans regret l’âme et la peau. Bizarrement ce soir est signalée à proximité des eaux truiteuses de l’Arize la dangereuse présence d’un unique et inquiétant représentant de la faune insectiale locale en lequel par on ne sait quel mystère de mimétisme animal se seraient transplantés les gènes infectieux de ces crotales volants mississippiens. Les entomologistes distingués l’ont savamment étiqueté du surnom latin de Jukus Jointus Bandus que nous désignerons par la seule nationale traduction franchouillarde autorisée : The Juke Joints Blues.
JUKE JOINTS BLUES

Sont trois. Même pas besoin d’être quatre comme les chevaliers de l’Apocalypse. Damien Papin à la contrebasse. Ben Jacobacci à la guitare. Chris Papin au chant. Pourrait faire au moins semblant de tapoter de temps en temps un tambourin, mais non il se contentera de chanter. Doit avoir une sacrée confiance en ses deux acolytes pour faire par derrière le raffut nécessaire sur lequel appuyer sa voix. C’est qu’il possède un véritable organe, pas un filet de voix papillon, et encore moins mignon. Plutôt écorché table de dissection. Et les deux autres à ses côtés tranquilles, les fesses nonchalamment accoudées sur leur chaise haute. Ben face à vous, sa stature imposante, sa barbe noire, et sa queue de cheval ( sauvage ), qui vous regarde pénardos les bras posés sur sa guitare, comme s’il s’apprêtait à consulter le programme télé avant d’allumer son poste pour son feuilleton favori. Damien comme en extase devant sa big mama. Amour incestueux, la tient étroitement embrassée, les yeux fixés sur le manche, assis de profil sur son pliant comme un suppliant agenouillé devant son idole dans un temple païen. Trop occupé pour vous jeter un simple regard.

C’est parti. Chris annonce la couleur. Who’ll Stop The Rain de Creedence Clearwater Revival. La moiteur du Sud, et l’humidité du bayou. Se sert de sa voix comme un alligator de ses mâchoires. Ne broie pas du noir, mais du bleu très sombre.

Ben est à la guitare acoustique. Electrifiée. Vous ne voudriez tout de même pas qu’il ait les cordes en véritable boyau de chat comme au temps de Big Bill Bronzy ? Authenticité rime avec électricité. Ne l’oubliez pas. Ca ne vous suffit pas les miaulements de gouttière écorché en rut de Chris ? Pour Ben, nous vous proposons deux options. Soit vous dites qu’il n’a pas fait un seul solo de toute la soirée, soit exactement le contraire, que durant les deux sets entiers il n’a joué qu’un seul et unique solo en continu. Personnellement nous avons un faible pour la deuxième mouture. Six cordes sur sa guitare. Jusque là rien de très original. Mais faut voir tout le boucan qu’il vous en tire. Basse et mélodie. Chant et contre-chant. Point et contrepoint. Dégomme les triples croches comme vous les topinambours. Au fusil de chasse. Se passe toujours quelque chose sur sa guitare. Un solo ? Vous voulez rire, en assure trois en même temps. Un peu comme les films du cinéma muet passés en accéléré. Difficile de savoir où il pose les doigts. Je vous rassure, il ne rate pas son cordage, et ça s’entend. Elles vibrent comme l’élastique de l’arc d’Ulysse quand il a commencé à clouer les prétendants à coups de flèches. Le problème c’est que c’est nous qui avons le mauvais rôle et qui sommes transpercés de ses dards meurtriers chaque fois qu’il accroche une corde. La solution c’est qu’il n’arrête pas une seconde et que l'on doit être maso car l'on aime cette délicieuse souffrance. Les fameuses blue notes, elles en voient de toutes les couleurs, arc-en-ciel à tous les étages, vous les balance par grappes de cent. Un mec économique, une guitare et vous entendez un orchestre symphonique. Mais carrément plus givré que celui des concerts Lamoureux.

Le pire c’est qu’il n’est pas seul. Le Chris avec son feulement de tigre énamouré il a besoin de jouer en stéréo. Alors de l’autre côté il a à peu près le même outillage. Damien, le démon. Bon sang ne sachant mentir, il a commis d’office le fiston à ce travail de titan. Bonne pioche. Une bonne grosse contrebasse taillée dans le bois dont on fait les éléphants, c’est énorme, pachydermique et rudimentaire. Animal placide, dont on n’attend que l’écho sonore de ses plonks plonks, avec le cornac qui slappe sur sa trompe pour amuser la galerie et donner l’illusion que c’est lui qui mène le train. Un allègre trot de sénateur. Oui, mais avec Damien, c’est toute autre chose. Danse du scalp et hache d’abordage. L’a un compte à régler avec Calamity Jane. Et la bougresse n’a aucune envie de se laisser faire. L’est obligé de la malmener. Un tout petit peu. Un chouïa. Juste ce qu’il faut pour lui montrer qui est le maître d’œuvre. Faut voir les rugissements du public chaque fois qu’il s’énerve. Mais là aussi nous n’avons pas à faire avec un adepte du courant alternatif. Le genre de gars qui ne débande jamais, la main dans les entrailles à lui en tordre le clitoris. N’ai jamais entendu une contrebasse hululer comme cela. De douleur et de plaisir. Du début à la fin. Mais qu’elle est cette galopade de mustangs déchaînés ? Qu’est-ce que cette caisse ? Un presque rien qui fait toute la différence, c’est Damien qui en martèle les flancs à coups de poings. Damien qui mord sans temps mort et Ben qui benne l’eau du bain et le bébé sans remords, le Chris il peut être tranquille.

Moi je m’inquièterais, avec ces deux zozos toqués qui sonnent comme du Stravinsky et du Bartok, je me ferais tout petit, me mettrais dans mon coin pour mieux les écouter et prendre mon pied, et puis à quoi bon se précipiter sur le taf quand il y en a deux qui font tout le boulot ? Le Chris c’est pas le genre à descendre de sa croix sous prétexte qu’il y a deux larrons qui font ça très bien. Veut sa part du gâteau. Alors il nous gâte. Tout y passe, du JJ Cale, Du Keb Mo’, du Sonny Boy du Tony Joe White - il tape aussi bien chez les noirs que chez les blancs, chez les vétérans que sur les nouvelles recrues - faudrait que j’écrive un livre de trois cents pages pour vous décrire les trésors d’inventions de nos deux cordistes, trente pages rien que sur les regards de complicité rigolarde qu’ils échangent chaque fois que l’un d’eux vient de pondre un œuf de rhino féroce, mais ce serait trop long. Alors je reviens sur notre french blues shooter préféré. Gosier de fer rouillé. Je n’ai pas dit grondement unilatéral. Y a des froissements de nuances, des satinades de grognements, des engorgements d’intonations inouïes, toute la lyre des sentiments, le noir du désespoir, le rouge baby gone, le bleu des tristesses infinies. Harmoniques spléniques et baudelairiennes, les aboiements de cette chienne de vie qui vous saute à la gorge et vous inflige les cruelles blessure de la mort sûre.

L’auberge n’est pas immense mais la salle s’est remplie. Principalement des gens du coin qui crient leur admiration sans pour cela cesser de rire et de s’interpeler. Comme par magie l’on retrouve la folle ambiance captée sur les premiers disques publics de BB King… Deux sets, le deuxième très long, trois rappels et personne ne voudrait les laisser partir. Chris prend la parole pour un ultime morceau, en français, précise-t-il, mais avec l’aide du public, et chacun de reprendre en chœur avec lui Le Temps des Cerises. Merveilleux tableau, les bigarreaux sanglants de la Commune se mêlent aux bleus du blues en un magnifique fondu enchaîné. Si la musique bleue du Mississipi maintenant séculaire nous touche tant encore aujourd’hui et si de simples frenchies parviennent à la jouer et à la faire vivre avec autant de justesse que The Juke Joints Blues, c’est bien parce qu’elle transporte en son sein des cris de rage et des expériences de luttes similaires à celles partagées dans un passé pas si lointain - pour ne pas dire dans la nécessité d’un futur immédiat - par les peuples de par ici.

Nous terminerons sur cette image d’une petite fille qui après l’ovation finale s’en vient chuchoter à l’oreille de Chris : « C’était génial ! ». Les incandescentes graines du blues n’en finissent pas de germer…

Damie Chad.
( Photos facebook des artistes, concert du lendemain à Montbel )
CASINO D’AX - LES - THERMES / 31 - O7 - 2O14
STOP II

Non je ne suis pas devenu milliardaire depuis ma dernière chronique. Je ne me suis pas non plus amusé à perdre la fortune que je n’ai pas au bandit manchot. Ne vous méprenez pas le Casino d’Ax-Les-Thermes c’est un établissement pour curistes pauvres aux voies respiratoires mal embouchées qui veulent se donner l’illusion de jouer dans la cour des riches. Vécu quatre ans à Ax dans ma folle jeunesse et n’y ai jamais aperçu une rolls négligemment garée sur la pelouse interdite, vous êtes en Ariège un département qui ne roule pas sur l’or. Sa principale richesse touristique, l’ours pyrénéen sauvage et en liberté n’y pullule plus depuis longtemps, malgré d'écologiques et controversés essais de réinsertion...
Mais ce soir en haut des escaliers est installée une hideuse structure métallique ( excusez-moi, c’est de l’art ) censée décorer un comptoir branlant qui ne débite que la bière. Normal, dès qu’il y a un bar, c’est qu’il y a de la pression. Ne nous plaignons pas, le concert est gratuit et se passe dans une grande salle, vidée de tout son mobilier, avec scène, enceintes et stand de mixage dans le fond.
STOP II

Z’ont fait la balance tout l’après-midi. Une chose m’inquiète pour un groupe présenté sur le prospectus comme un retour à l’authenticité du blues originel - je n’y prête qu’une oreille intermittente - ils sont sacrément électriques. Je n’ai rien contre l’électricité, mais je crois point que dans le delta Son House ou Ligthning Hopkins branchaient directement leur guitare directement sur prise de la première centrale mississipienne rencontrée. L’est sûr que depuis ces temps anciens de l’eau boueuse a emporté bien des digues de certitudes mentales… Wait and see, comme disent les Japonais. Du moins ceux qui parlent anglais.
Gros débit. Suffit de rentrer dans la pièce pour comprendre. Les Stop II ne sont que deux. Les petites grenouilles du bayou qui veulent devenir aussi imposantes qu’un alligator ont intérêt à gonfler le volume. Ne s’en privent pas. Balancent la moutarde à plein pot. Deux guitares et rien de plus. Pour le rythme Xav tape la mesure comme un madurle sur sa pantoufle phonique. Rien à voir avec le piétinement métaphysique des premiers enregistrements de John Lee Hooker, non l’insistance, la redondance avec lesquelles il s’escrime sur cette malheureuse pédale ressemble plutôt à ses gros flon-flon de basse dans les enregistrements disco. L’on se croirait dans une boîte de nuit.

Comme en plus il hurle à l’emporte-pièce et à saturation dans son micro, il suffirait qu’il accélère et précipite la scansion de sa chaussure stompboxique pour que l’on se trouvât transporté à l’époque bénie des groupes punk de 1977. Heureusement de temps en temps il laisse le chant à son compère Bess qui lui abandonne un peu trop souvent son Epiphone rose pailleté au profit d’une washboard un peu trop monotone, ou alors pour varier les plaisirs il s’empare d’une cloche trop vacharde pour être aussi honnête qu’une montagneuse Mississipi Queen et sensée peut-être rappeler la ruralité du first country blues. Nous le regrettons d’autant plus qu’il parvient à faire sonner sa gratte comme une douze cordes. Avec lointain écho banjoïsant.
Le set est plein de petits trésors comme cela, mais il faut y faire gaffe comme ce ton nasillard du meilleur effet sur Lovesickblues de Hank Williams. Mais Xav le forcené vous harponne les tympans de sa six cordes. Joue sur le mode d’une incessante rythmique dévastatrice - implacable et tétanisante - qui noie les beaux effets de glisse qu’il tire de son bottleneck. En oublie que la plupart du temps il tient le rôle de guitariste soliste. Ainsi lorsqu’il annonce le I love You since I die de Robert Jonhson ( confusion entre Since I've Been Lovin' You et Travelling Riverside Blues d'après moi ), il devrait s’abstenir de rappeler que Led Zeppelin a aussi repris le morceau. Car les riffs de guitares entrecroisées piste sur piste de Jimmy Page sont d’une complexité inouïe comparée à son tangage brutal et monocorde.

Le public apprécie et en redemande. A leur douzième morceau seront obligés de repiocher dans la set list. Eux aussi prennent leur pied. Se lancent des private jokes incompréhensibles si l’on n’appartient pas au groupe de connaissances qui sont venues les encourager et les soutenir. En une petite heure le concert est terminé. Alors que la salle restera désespérément vide jusqu’à deux heures du matin. J’en ressors mi-figue, mi-raisin. Peu d’imagination, très répétitif dans la manière d’aborder les morceaux, quitte à reprendre Johnny Cash autant écouter de près le boulot que firent Luther et Carl Perkins sur toute une partie de sa discographie. Le rentre-dedans ne doit pas avoir pour corollaire l’évacuation de toute subtilité.
Grand succès toutefois. C’est vrai qu’ils filent davantage la pêche que le blues. La Melba mais pas le Delta. Blues garage.
Damie Chad.
14:48 | Lien permanent | Commentaires (1)



Commentaires
Merci Damie Chad pour ta belle chronique, et ta superbe plume... Quelle écriture... Chapeau !!!
Écrit par : Chris Papin | 30/08/2014
Les commentaires sont fermés.