17/12/2014
KR'TNT ! ¤ 214. MATTY JAMES / JALLIES / MEGATONS / GHOST HIGHWAY / ROBERT JOHNSON / SCREAMIN' JAY HAWKINS
KR'TNT ! ¤ 213
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
18 / 12 / 2014
|
MATTY JAMES / JALLIES GHOST HIGHWAY / MEGATONS / ROBERT JOHNSON / SCREAMIN' JAY HAWKINS |
LA MIRABELLE / PONT-AUDEMER ( 27 )
08 - 11 - 2014 / MATTY JAMES
MATTY A DU MATOS

Quel piège ! Le concert de Matty James était organisé dans un petit restaurant de Pont-Audemer, à cinquante bornes de Rouen, un samedi soir ! Comme il fallait prendre la bagnole, ça voulait dire en clair qu’on devait choisir entre l’apéro, la bouteille de vin au repas, le pousse-café renouvelable ou les bières après le repas. Pire que le Choix de Sophie. En outre, traverser une partie de la Normandie à cette heure-là, c’était quasiment la même chose que de traverser la Sierra Nevada au temps des guerres menées par cette immonde canaille de George Crook contre les Apaches. Non seulement on risquait l’embuscade, mais bien pire, on risquait aussi la déshydratation. De la même façon que McClure, on redoutait mille fois plus le parcheminage du larynx que de tomber vivant aux mains des guerriers apaches. Dans la bulle au-dessus de la tête - la même que celle qu’on voit au-dessus de la tête du Capitaine Haddock - le combat faisait rage entre l’ange gardien et le petit diable rouge qui disait : Vas-y mon gars ! L’ange gardien prônait plutôt la prudence et recommandait de rester assis bien au chaud près de la barrique de rhum.

Rien n’est plus radical qu’un bon verre de rhum pour s’éclaircir les idées. On fit alors une synthèse du combat idéologique entre les forces du bien et du mal et décision fut prise de gagner le charmant village de Pont-Audemer et de se livrer à tous les excès. Comme ça au moins, on ne fâchait personne. On découvrit en outre qu’il existait une autoroute entre Rouen et ce charmant village qu’on surnommait la Venise blanche parce qu’elle fut à une époque la «plaque tournante» d’un intense commerce d’héro (allez savoir pourquoi les plaques tournent). La Venise blanche ne figure pas dans les dépliants que distribue l’office du tourisme local. Ce genre d’info circule sous le manteau et rend la localité beaucoup plus pittoresque qu’elle ne paraît. On arrive effectivement dans un endroit charmant et ce qui frappe le plus l’étranger, disons que c’est le calme. Mais un calme étrange qui doit remonter à l’époque de Gustave Flaubert. À 20 heures, les ruelles sont désertes et de fort belles demeures cossues n’attendent que la visite d’Arsène Lupin ou d’un trio de cambrioleurs à casquettes.
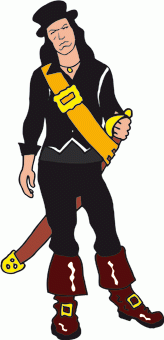
Matty James se produisait à La Mirabelle, un petit restaurant du centre-ville. Il s’agissait en fait d’une minuscule auberge dans laquelle s’entassait une bonne vingtaine de personnes. Au premier coup d’œil, on vit Matty James et son tourneur attablés autour d’un bon repas. Les rockers d’outre-Manche s’arrangent toujours pour se faire remarquer, mais au fond, ils ne le font pas exprès. Ils se distinguent du commun du mortel par une sorte de classe naturelle. On les reconnaît immédiatement, de la même façon qu’on identifiait au temps de Flaubert un saltimbanque par sa seule allure. Matty James portait un petit chapeau noir. De longues mèches de cheveux noirs de jais s’en échappaient et des rouflaquettes épaisses lui dévoraient les joues jusqu’au bas des mâchoires. Il portait des habits sombres et des médailles tintinnabulaient autour de son cou. Mais le détail physiologique qui frappait le plus chez lui était la grosseur de la tête. Il avait le visage massif et vaguement inquiétant d’un capitaine de flibuste, une tête encore jeune mais comme bosselée par le nez et le front et sous les arcades scintillait un regard d’une extrême vivacité. Matty James était infiniment plus crédible que Johnny Depp. Il n’avait pas besoin de souligner son regard au khôl pour se donner un air romantico-féroce. Matty James semblait naturellement romantico-féroce. En plus, le rencontrer dans une auberge, c’était comme de rencontrer Long John Silver à l’auberge de l’Amiral Benbow ou le mystérieux Petit Radet dans un caboulot enfumé de Brest. En outre, l’intrigue se déroulait à terre, comme chez Mac Orlan.
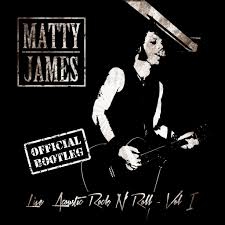
On fit rouler les apéros et la patronne nous dressa une petite table juste en face du coin où devait chanter Matty James. Nous n’étions qu’à deux mètres du pied de micro. Nous saucions encore nos assiettes lorsque Matty vint se poster derrière son micro avec une belle guitare noire. Il attaqua aussitôt son set acoustique. Nous fûmes donc pris dans la nasse : devant nous le chanteur et dans notre dos le maigre public qui acclamait. Continuer à se goinfrer devant un artiste qui chantait était parfaitement incongru. Les bruits de fourchettes et de mastication ne pouvaient que nuire à la qualité du spectacle. Matty chantait debout et il grattait ses accords avec l’assurance d’un vrai loup de mer. Il sortait un son plein et dense de sa caisse et son œil perçant semblait parfois nous harponner. Entre deux couplets il éloignait la tête du micro pour gratter quelques brassées d’accords, puis il revenait brusquement se caler face au micro. Il balançait son grand corps au vent du beat. On l’aurait cru posté sur un gaillard arrière. Il avait cette silhouette haute et massive du hardi capitaine lancé à la poursuite de l’Espagnol. Quel personnage fantasque ! Vous n’en verrez pas souvent d’un tel calibre. Il chantait d’une belle voix grave et affichait une fière allure. Il ne portait pas de bottes à grands rabats graissés à l’huile de phoque, mais de simples creepers noires. Il semblait connaître les limites de la prestation acoustique et tentait du mieux qu’il le pouvait de compenser l’austérité du set par de l’intensité expressive, mais rien n’est plus périlleux que cet exercice. Alors bien sûr, les gens discutaient, buvaient, s’agitaient, s’embrassaient, on voyait passer des plats et des filles virevoltantes et faciles d’accès nous bousculaient gentiment. Au milieu de tout ce fatras, Matty James poursuivait son périple acoustique et promenait son œil perçant sur les alentours. Il savait rester imperturbable et hermétique aux tentations de défaitisme. Il mit la petite auberge en fête avec une reprise de «Dirty Old Town». Toute l’assistance se mit à chanter en chœur avec lui, comme si elle s’était trouvée sur le pont d’une frégate après le partage du butin, au moment où on met les barriques de rhum en perce. Il régnait là le genre d’ambiance dont on n’ose même plus rêver. Les filles gueulaient à tue-tête, les hommes rigolaient en se tenant la bedaine à deux mains, on remplissait des verres, on tirait sur des bouffardes, et la vie redevenait facile. Matty James proposa de faire «a little break» puis il revint chanter quelques classiques des Stones, du type «Sweet Virginia» et «Dead Flowers» que tout le monde reprit évidemment en cœur - I know you think you’re the queen of the underground/ And you can send me dead flowers every morning - Il n’en fallut pas davantage pour créer une sorte de magie de l’instant. Michel Butor aurait même surenchéri en invoquant le génie du lieu.

Matty James avait commencé une petite tournée en France, pour assurer la promo de son album «Last One To Die», récemment paru. Le set de Pont-Audemer était sa troisième date. Le peu d’affluence ne semblait pas l’affecter. Il devait ensuite gagner d’autres villes et jouer en tout une bonne quinzaine de fois à travers notre doux pays. Il bénéficiait du soutien de Tyla, le leader des Dogs d’Amour, crédité sur l’un des titres de l’album. Mais pour le reste, Matty se débrouillait tout seul. En lisant les informations contenues dans le booklet de l’album, on vit qu’il jouait de tous les instruments. Comme Todd Rundgren ou J. Mascis, Matty James était capable d’enregistrer un album tout seul. Et quel album ! Et pour compléter cet insolent palmarès, Matty James avait créé son label à seule fin de pouvoir naviguer librement dans les eaux troubles du music-business. Et comment s’appelle son label ? On vous le donne en mille : Pirate Heart. S’il est un mec qui pratique l’art de la cohérence avec fermeté, c’est bien Matty James l’Irlandais. Voilà un nom avec lequel il va falloir compter et dont la réputation va gagner tous les océans, n’en doutons pas.

Dès le premier monceau de l’album, on est frappé par la qualité du son. «Leaving» sonne comme un rock classique de haut rang. On sent chez l’Irlandais un goût des profondeurs et des aurores boréales, un goût affirmé pour le son rugueux et sourd. Avec «Up In Smoke», il révèle un appétit démesuré pour le rock anglais bien enraciné dans la stonesy et claqué à l’accord sédentaire. Quelle prestance ! En écoutant le disque, on revoit le mouvement de son poignet droit, cet automatisme fascinant qui évoque le mouvement perpétuel et qui nous renvoie directement à certaines œuvres de Jean Tinguely. Matty James est à la fois surprenant et élégant. Il injecte un solo d’harmo dans le son plein, puis il enchaîne avec un chorus à la Johnny Thunders et des chœurs dignes des Dolls. Il y a là de quoi affoler les plus blasés d’entre-nous. Matty semble savoir combiner toutes les bonnes influences. «Never Learn» est un balladif bien joué, c’est vrai. Ce mec y croit dur comme fer. Il dispose de la voix et du culte des grands crus. Il s’inscrit dans la meilleure tradition qui est celle du rock classique anglais. Il ne cherche pas à épater la galerie où à suivre les modes comme Primal Scream. Il sait exactement ce qu’il veut. Il claque ensuite une belle intro à l’accord pour «Same Old Me» et va plus sur la pop. On sent chez lui le grand écouteur de disques, car on a déjà entendu cette pop bien chevillée mille et mille fois. Tyla des Dogs d’Amour joue du bottleneck sur «Last One To Die». Alors, Matty James et le légendaire Tyla nous plongent au cœur de la pétaudière des pubs anglais. L’irlandais semble gagner encore de l’assurance, d’autant que Tyla fait de beaux backings. Leur numéro est admirable de tenue. Matty James sait monter des expéditions, c’est évident. Il semble que le distributeur Cargo Records ait conditionné Matty comme rocker sombre irlandais à connotation Dogs d’Amour pour tenter de le vendre en Europe, mais Matty James n’a pas besoin de ces petites combines de marketing pour exister artistiquement. Il va de soi que ce mec est doué. Quand on le voit gratter sa guitare, on sent bien qu’il est dessus. «Better Days» sonne aussi comme un gros hit power-poppy. Dommage que Matty n’ait pas pu mettre la gomme dans la petite auberge, car on sent bien l’amateur de gros son. Il a du tirant d’eau. Il boucle son frichti avec un admirable «This One’s For» et voilà le travail.
Signé : Cazengler, démâté par Matty
Matty James. La Mirabelle. Pont-Audemer (27). 8 novembre 2014
Matty James. Last One To Die. Pirate Heart Records 2014

12 / 12 / 2014 – MONTEREAU-FAULT-YONNE
L'ANATOLIE / THE JALLIES
La teuf-teuf fait la gueule. Aller en Anatolie, elle refuse. Trop loin pour ses soupapes. Tant pis, on prendra la toto-trinette du Grand Phil. Dès qu'il y a les Jallies qui passent, le Grand Phil est toujours partant. Jusqu'à l'autre bout du monde. Je n'ai jamais compris pourquoi. En plus l'Anatolie, ce n'est pas si loin qu'il n'y paraît. En plein centre de Montereau. Si vous n'êtes pas capable de trouver c'est que vous êtes en fault.
Rue couverte. Café turc. Des gars qui tiennent le mur. En plein centre ville, pas le coin le mieux famé de la cité. Peu de monde à l'intérieur, à part les Jallies au grand complet en train de dévorer de somptueuses brochettes au poulet. Nous ne tarderons pas les imiter tout en reluquant les lieux. Le bar dans le prolongement de la porte d'entrée qui occupe tout un mur, les parois peintes en un rouge sang de bœuf éclatant, plafond bas stratifié de noir. Les instrus de nos idoles posés à terre entassés dans un coin du restaurant. Heureusement que les filles arborent de fines tailles de guêpe et non pas l'embonpoint graisseux des poulardes du Gers. La mise en scène ne sera pas des plus faciles, se glisser entre les trois micros sans les faire vaciller se révèlera une mission impossible. Les garçons relégués derrière entre les amplis ne sont guère mieux lotis. Certes il y a de la gêne, mais ne vous inquiétez pas dès les premières notes le plaisir sera aux avant-postes et l'on part sans s'en douter pour une furieuse soirée rock and roll.
POUR COMMENCER
Sont coincés dans la vitrine, malgré cette surface vitrée peu phonique toute la soirée le son sera d'une limpidité extraordinaire. Comme quoi il ne faut jamais désespérer des circonstances. Trois morceaux n'en faut pas plus pour atteindre le paroxysme. Le café s'est miraculeusement empli. Ça déborde dans la rue, toute la soirée ce sera un défilé permanent de curieux qui s'en viennent soutenir le groupe, qui repartent au-dehors boire un coup et qui reviennent admirer le show. C'est que devant l'orchestre ça ne chôme pas. Les danseurs sont là. Les dames s'y risquent un peu mais s'en lassent vite. Ce sont les hommes qui mènent la danse. Se démènent comme s'ils étaient atteints de la danse de Saint Gui. J'ignorais cette flagrante spécificité du peuple turc : ils aiment s'amuser et ne font pas semblant. Des forcenés, des fauves lâchés dans l'arène, infatigables, qui s'en viennent chercher régulièrement les convives encore assis pour les faire entrer dans leur tourbillon chaotique. Point de première jeunesse, l'on sent que le rock and roll et son déchaînement musical est perçu comme l'exutoire attendu et rêvé de bien des frustrations sociales. Une ambiance de rêve, c'est ainsi que l'on devait s'amuser dans les juke joints du Mississippi et les bals de campagne dans les granges des Appalaches. Le rock and roll plonge ses racines dans la sève brute des milieux populaires. Le public rock quelque peu vieillissant et devenu révérenciel quant aux artistes du genre a adopté des conduites de connaisseurs patentés un peu trop téléguidées. Ce soir ce sera la résurgence de la force brute des premiers défoulements libérateurs qui dans les années cinquante choqua tant la bien-pensance des adultes et des autorités emmitouflés dans les vieux dogmes de l'acceptation servile des hiérarchies sociales et des morales religieuses étriquées.

Et les Jallies sauront instinctivement s'adapter à cette ambiance âpre et chaude comme une gorgée de venin de crotale. A l'arrière garde Thomas fait sonner comme jamais sa guitare, pas un interstice dans lequel il ne glisse la note poivrée de ses accords. Julien n'a pas le temps de s'attarder à rêvasser sur sa contrebasse. Faut que sa double-bass fournisse deux fois plus de swing que d'habitude. Et il s'y emploie avec célérité. Tire sur ses cordes à les arracher ou les frappe à les rompre, produit un roulement, un grondement continu qui sert d'assise à tout le groupe. La première ligne des amazones tient merveilleusement le choc. Elles ne chantent pas, elles survolent. Mouettes rieuses qui se fondent dans l'écume de la vague déferlante. Pas question de céder un pouce de terrain. Elles ne contiennent pas, elles titillent, elles provoquent, elles jouent les pies jacassantes qui viennent arracher l'anneau d'or qui orne votre oreille de pirate. Vous en voulez encore, et bien en voici et Leslie nous offre un Tunnel Of Love à exciter l'exploration vénéneuse de tous les souterrains de velours de la création. Avec en prime ce train de Johnny Burnette que vous n'arrêterez jamais dans aucune des gares de votre vie. Le rock vous rappelle souvent vos échecs les plus cuisants pour mieux vous inoculer la rage de vivre. Inutile de tricher la vie n'est pas rose, mais la fureur de vivre d'un rouge écarlate.

POUR FINIR

L'inter set sera assez court. Ce qui réjouit tout le monde. Faut battre le fer tant qu'il est chaud et les danseurs ne demandent qu'à reprendre la piste de leur mise en scène égotiste. Ce n'est pas une communion, un contact furtif d'épidermes comme un frottement d'allumettes et une promesse d'une flambée future ou possible que nos acteurs recherchent. Se défont très vite des rares postulantes pour retrouver leur solitaire exhibition. L'on ne danse pas qu'avec son corps, mais surtout à l'intérieur de soi, l'on quitte sa chemise, l'on se pavane fièrement en exhibant la blancheur de sa peau et les contours bleutés de ses tatouages, mais le plus important est ce qui se joue dans votre tête, l'expression de votre désir que vous dramaturgez à loisir et à foison. Nos danseurs ne sont pas pétris des règles de l'amour de grande courtoisie, se permettent des gestes et des mots que l'on pourrait juger un tantinet déplacés. Vanessa la blondinette, n'a pas la langue dans sa poche. Vous apostrophe les zigotos déviationnistes et les refourgue dans le droit chemin de quatre petits mots bien sentis. Ne tourne pas sept fois sa langue avant d'invectiver. Interpelle et ramène les aiguilles de la pendule à l'heure idoine avant que la situation ne devienne incontrôlable. Et elle se remet à chanter la voix encore plus rauque et débordante de gouaille. Maîtresse oiselle qui ne s'en laisse pas conter. L'est des limites à frôler – cela fait partie du jeu – mais à ne pas franchir. Le rock and roll est aussi un art de la corde raide.

Et chploum ! un individu non identifié, enveloppé dans son manteau s'immisce en plein milieu du groupe. Rassurons-nous, c'est Jérôme qui arrive juste à temps pour son solo, sort sa trompette de son étui parvient à trouver un semblant de place, de biais, son cornet juste sous le manche de guitare de Céline, pousse sa goualante et sa tâche terminée il s'aperçoit qu'il est entré dans un brasier vivant. Le genre de situation qui ne se renouvelle pas souvent. D'habitude il vient pousser un ou deux solo puis repart tranquillement, ce soir pas question de rater une seule miette du festin. Restera jusqu'à la fin, en instrument d'accompagnement qu'il fera rugir comme des barrissements d'éléphant, façon de rajouter de l'huile brûlante sur les flammes déjà hautes.

Les demoiselles ne perdent pas le nord. En profitent pour présenter deux nouveautés, une dans le premier set – excusez-moi, j'ai demandé le titre mais l'ai oublié – un truc hyper swinguant destiné à guérir les paralytiques coincés dans leurs fauteuils roulants – et un Communication, une véritable tronçonneuse musicale pour entrer en osmose avec les publics frénétiques. Ce soir c'est vraiment bien choisi. Céline s'en donne à coeur joie en meneuse de revue tambour battant. Entre temps l'ambiance est encore repartie à la hausse. Les danseurs recouverts de sueurs, le bar assiégés de buveurs impénitents qui toutes les trente secondes hurlent Be Bop A Lula She's my baby ! comme cri de guerre...
Le rappel se termine, noyé par une interminable pluie de mercis que les frénétiques danseurs lancent aux trois filles avec autant de ferveur qu'une bénédiction papale. L'on a l'impression que pour beaucoup ce fut la soirée de leur vie. Elles ont gagné une rude bataille, elles passent comme souveraines, et les voix de remerciement sont pleines de respect. Les gars préposés aux cordages n'ont pas démérité mais l'enjeu était ailleurs. Peuvent être fières d'elles, elles nous ont donné une véritable soirée de rock and roll. Après cela, beaucoup de concerts risquent d'avoir un goût un peu fade, un peu aseptisé.
Damie Chad.
( Photos FB des artistes prises le lendemain au Club 931 de Chavin )
13 / 12/ 14 – LE GIBUS CAFE / PARIS
MEGATONS – GHOST HIGHWAY
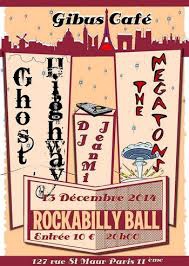
Les provinciaux à Paris, ce n'est pas de la balle. L'on arrive tout fiers, tout farauds devant le Gibus cinq minutes avant le commencement des festivités. Impossible de passer la porte d'entrée, le Gibus nous fait le coup du magicien qui sort quarante lapins à la queue leu leu de son chapeau. Une tripotée d'ados qui défilent devant nous en rangs épais, une marée humaine interminable. L'on arrive tout de même à se glisser jusqu'à la caisse. Mon oeil exercé et quelque peu suspicieux lorgne sur un bout de papier. Fait sombre comme quand vous tentez de vous suicider dans votre congélateur et que vous avez rabattu le couvercle, je ne peux pas lire, mais de visu, le programme semble avoir été changé. Les Ghost Highway ? C'est bien ici ? S'avèrera que non. Faisions fausse route et mauvaise adresse. C'est au Gibus Café, au métro Parmentier. Eh va donc patate, faut s'extirper de cette masse gélatineuse d'adolescents – que des garçons, pas la moindre souris – et galoper vers le filtre à caféine au plus vite.
Huit heures vingt, l'on déboule tout essoufflés devant la devanture espérée. Respirons, pas d'affolement, Mister Jull flâne encore sur le trottoir. L'on a tout notre temps pour saluer les habitués – les rockers ne sont peut-être pas fidèles en amour, mais question concerts, seraient-ils à l'article de la mort, qu'ils ne sont pas prêts à rater un rendez-vous – Jull nous présente l'adorable Marion qui tient une boutique Tattoo à Figeac.
J'imaginions un club ou une boîte, mais non c'est un simple café avec un comptoir des plus banals mais au fond l'on a dégagé les chaises et installé une petite scène. Rien à voir avec les Arènes de Nîmes. Pas très grand, mais pas exigu non plus.
MEGATONS
L'on n'est pas méchants, si ça ne tenait qu'à nous l'on aurait poussé les murs, car les trois guitares tiennent tout juste. Jerry est par derrière avec son sax, et Lulu en quarantaine dans le coin. Pour ceux qui suivent nos pérégrinations, c'est bien le même Lulu qui officie chez les Barfly que nous sommes allés voir la semaine dernière. Comme par hasard, Manu le contrebassiste des piliers de bar est au premier rang, pour apporter son soutien moral aux copains.

C'est parti. Ce qu'il y a de bien avec les Megatons c'est que l'on est sûr que la soirée va rocker comme sur des roulettes. Plein pot et plein gaz. Ne s'arrêtent jamais en route pour rafistoler le pot d'échappement avec du fil de fer. Groupe garage, mais qui ne bricole pas. Peuvent remplacer la gazoline par du kérosène et multiplier par huit le nombre de chevaux, mais ce sont des pros attentifs à la belle ouvrage. Faut que ça glisse sans bruit, comme une corvette qui file sur la mer déchaînée. C'est qu'ils sont partisans de la vitesse pure. Jerry enfourne une lampée d'air dans les poumons et se met à souffler sans discontinuer dans son saxophone. Peut tenir des minutes entières sans donner l'impression de s'étoffer. L'a de la réserve. Et les autres embrayent sur le tapis rutilant du sax sans crier gare. Lulu, une frappe moins dure que pour les Barfly, plus souple, plus coulante, les guitares de Charlie et de Didac en roue libre, mais qui appuient sans qu'on s'en aperçoive sur l'accélérateur pour rajouter un peu de speed dans la machine, et Steph qui soutient le tout sur sa basse électrique coulissante.
Le rock des Megatons ne donne pas dans la métaphysique. Hymne à la jeunesse éternelle qui prend le temps de vivre vite et de rire à tout berzingue. Aucune envie de faire un beau cadavre et de basculer dans la fosse finale. C'est du rock and roll qui caracole sur la joie de vivre et l'insouciance des parties adolescentes. Take a good time. Le programme est limité mais agréable à suivre. Fun à fond. Une philosophie facile mais dont on se dépêche de mettre en pratique les préceptes si peu contraignants. Rock hédoniste de sybarites convaincus.

Attention les Megatons adorent négocier – en position de force – les virages en épingles à cheveux et n'hésitent jamais devant une sortie de route qui vous émoustille les écoutilles. Ne se présentent pas comme un wild wild rockin' band pour rien. Sixties road. Sous l'impeccable beauté de la carrosserie, il y a des centaines de mustangs sauvages qui piaffent d'excitation. Ce qu'il y a de terrible avec les Megatons, c'est que l'on se demande pourquoi ils arrêtent. Nous l'on aurait continué tout droit jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à la prochaine plage de sable blond de Californie, mais non ils ont coupé le contact et nous ont laissé en rade sur le bord de la highway. Réveillons-nous, faut finir le chemin à pieds. Nous ont fait croire pendant plus d'une heure que l'on était immortellement jeunes et beaux, et il nous faut retourner dans notre déplorable présent.
GHOST HIGHWAY

Objection votre honneur. Ce ne sont pas les Ghost Highway au grand complet. Pour Jull Gretschy et Phil, pas de problème, ce sont bien les membres originaux. Mais les deux autres, on ne dira rien parce qu'on les aime beaucoup et qu'ils sont du genre surdoués, mais Thierry et Eddie, sont avant tout les deux cinquièmes des Ol' Bry. Z'ont compris la recette du pudding anglais. Prenez deux musiciens par ici, deux autres par là, et hop en moins de cinq vous avez formé un super-groupe. Ce n'est pas tout. Faut encore que la pâte prenne, sans quoi ça risque de claudiquer dur. Pas de panique ce soir ce sera l'osmose parfaite.

Arno absent, Jull se chargera de la plus grande partie des vocals. L'est aussi à la guitare. Pardon, c'est une erreur. L'est le préposé à la finesse et au doigté. Un petit bail que je n'avais écouté les Ghost. C'est somptueux, Phil derrière qui cadre les morceaux et Jull qui peaufine. Chaque note jouée comme un solo. Mise en évidence. Comme soulignée, attendue, caressée, flattée, une demi-seconde peut-être, mais de gloire absolue. S'agit pas de la dégager au plus vite, pousse-toi de là qu'une autre prenne ta place. L'on n'a pas dépassé les trente secondes sur Snatch It & Grab It que l'on comprend que ce soir l'on voyage au pays de la beauté et de la subtilité. Ce soir l'on revisite l'histoire du rockabilly, mais on a le guide adéquat qui nous explique les origines agrestes et campagnardes de cette musique, pas encore électrifiée à outrance. L'on n'assène pas, l'on nuance.
Petite rectification, tout en douceur certes, mais le swing est là. Les sabots ne s'enlisent pas dans le fumier non plus. Y en a deux qui pressent le mouvement. Le père et le fils. En continu pour Thierry. Par saccades pour Eddie. Thierry assure un boulot prodigieux. Faut pas que la basse s'en vienne brouter dans le pré carré de Mister Jull, tout en aidant Phil à planter les clôtures. Doucement la basse par devant, et au marteau-piqueur par derrière. Une corde pour la tendresse et une autre pour la rudesse. Partition participative. Suis dans la totale incapacité d'expliquer comment il s'y prend, mais il réussit son affaire avec une constance exemplaire. Une bi-latéralisation schizophrénique. Peut-être a-t-il mis au point son jeu de basse coulée lorsque les Ol Bry en leur début louchaient un peu vers le style plus harmonieux du Doo wop. Pour le claquement de closure je pense que question slap rockab il pourrait nous en apprendre jusqu'à demain matin.
Mais jetons-nous sur le rejeton. Une grosse acoustique qu'il tient à hauteur du coeur comme Elvis. Justement Burning Love se profile à l'horizon, juste après le Cheatin' Heart d'Hank Williams. Eddie, tout ému de jouer avec les Ghost. Ne tient pas en place. Ça lui vient comme des bouffées délirantes. Se lance dans des rythmiques de fou. Laboure les cordes de son engin avec frénésie. Flirte avec le cabanon et la douche froide. Mais non, se calme aussi inexplicablement qu'il vient de se comporter comme ces forcenés que l'on est obligé d'abattre au fusil à pompe pour leur faire entendre raison. Un jeune garçon sage, beau gentil et poli, vous lui laisseriez même emmener votre fille au bal. Mais non voici que ça lui reprend. Cycle d'auto-destruction programmé. Un véritable danger public. Un électron libre du rockab en pleine éruption. Et après la crise, la séquence apaisement qui recommence.

L'est temps de dire bonjour à Marylou. Pas de jaloux, chacun son couplet, Jull, Eddie et Phil qu'il ne faut pas oublier sur sa batterie. Je le soupçonne même d'avoir un penchant particulier pour la demoiselle ainsi nommée. Son morceau fétiche en quelque sorte. Plus tard ce sera sa partie sifflée – attention les lourdauds, c'est lui qui siffle pas le public qui le siffle - sur Country Heroes, d'autant plus nécessaire que l'harmonica d'Arno n'est pas là pour assurer l'atmosphère nostalgie.
Etrangement le fait d'avoir à assurer les vocaux semble avoir libéré Mister Jull, sort davantage sa voix, on le sent très à l'aise, il en veut, il ne se débarrasse pas du boulot, articule et interprète, l'est dans le morceau, descend dans le tréfonds de ses moelles, le vit à fond, et le charge d'intensité dramatique. Tous les titres issus du dernier disque sont donnés au public avec une force et un aplomb considérables.

N'est pas monopolisateur le Jull, laisse aussi le micro à Eddie qui démontre que ce n'est pas par hasard qu'il est le chanteur attitré des Ol'Bry. L'appelle aussi Lucas et Baptiste – respectivement guitariste et batteur des Howlin' Jaws – à la rescousse pour qu'ils nous montrent ce qu'ils savent faire. En deux morceaux ils ont convaincu l'assistance. A peine vingt titres et c'est la fin. Jull aperçoit Thibaut Chopin au fond du bar. L'est prié de venir taper le bœuf ( pauvre bête ) pour deux derniers morceaux. Se saisit de la contrebasse de Thierry – n'est pas un manchot non plus – mais c'est sa voix traînante et qui imite à la perfection l'accent légèrement nasillard du Sud profond que je préfère. Voudrais pas passer pour l'enfant gâté de la soirée, mais enfin, Jull aurait pu terminer sur un petit Eddie Cochran. Je lui aurais laissé le choix du titre. Je ne suis pas difficile, moi. Juste un peu gourmand. Et j'ai l'impression à ne pas avoir été le seul de l'assistance à avoir eu un petit creux.
Damie Chad.
( Photo Megatons ne correspond pas au concert )
LE DIABLE ET MOI
MICHEL LAUWERS
( Editions Murmures Des Soirs / 324 pp )

Un livre qui parle de Robert Johnson ne peut pas être tout à fait mauvais, m'étais-je dit en passant commande du volume sur la foi de quelques critiques élogieuses parues dans différentes publications spécialisées en blues. Et puis le nom de la maison d'édition qui vaut son pesant de frites – ce sont des Belges – Murmures Des Soirs, tout de suite vous avez envie que l'on vous susurre des gentillesses dans le creux de l'oreille. Méfiez-vous s'ils ont une collection érotique, ils en possèdent une autre, fantastique – n'est-il pas d'ineffables secrets secrets dont la révélation n'apporte aucune joie – mais aussi celle homophoniquement intitulée Soirs Noirs, riche uniquement, à ce jour, de deux titres, L'Arme Blanche – ce qui s'appelle jouer avec les contrastes – et Ce Diable et Moi de Michel Lauwers.
Le Diable et Moi est un roman. Hanté par la sombre figure de Robert Johnson et donc par la logique même de son sujet enté sur une réalité historiale, sinon objective, du moins objectale. Raconter la vie d'un personnage ayant réellement existé et dont on connaîtrait tous les actes importants et essentiels de son existence n'offre guère de surface jubilatoire d'envol à un romancier. Par une chance extraordinaire, l'on ignore presque tout de Robert Johnson, et surtout de ce moment paroxystique de la vie, sa mort. Laissez votre portable dans votre poche et épargnez-vous le prix de la communication. Tout autant que vous je peux vous blablater la version communément admise de la triste fin de notre héros empoisonné par un mari jaloux. Comme quoi, en matière de mœurs, débrouillez-vous pour toujours agir en toute discrétion, méditez cette sordide aventure et prenez-en de la graine avant de la planter dans la première bouche d'ombre entrouverte qui passerait à portée de votre sexe...

Michel Lauwers ne se laisse pas entraîner par la légende johnsonienne. Il est un écrivain doué d'un esprit positiviste qui prend bien soin de ne pas marcher sur les serpents à sornettes qui pullulent dans la biographie de Robert Johnson. Commence par se débarrasser de ce qu'il met au premier plan de son titre. Exit le grand Satan. Un bon coup de pied au cul de votre intellect et hop il bazarde le méchant croquemitaine dans les poubelles de l'historiographie des contes à dormir debout, icelui du diable rencontré au carrefour. Autant croire au Père Noël ! Soyons sérieux. A la fin du bouquin, il ne se montre pas plus bête que vous, vous explique l'importance symbolique des croisements dans les anciennes civilisations sans crier au savoir perdu, par miracle retrouvé en notre modernité... De même il n'est pas plus tendre avec les partisans des études sociologiques qui tiennent compte de la magique opérativité civilisationnelle des pratiques cultuelles étrangères à notre legs cartésien convaincu de l'inanité des forces spirituelles. Le vaudou, bon pour les vieilles femmes et les âmes simples insensibles au ver rongeur du doute, n'est qu'un vain simulacre démontre-t-il dans un des chapitres les plus jouissifs de son récit.
Nous dresse un portrait peu sympathique de l'étoile morte du blues. L'on reçoit encore sa lumière dans la première partie du bouquin mais elle s'avère blafarde et point illuminante. Un gars peu conciliant, qui vous regarde de haut, prend de vous tout ce qu'il peut tirer, et vous rejette ensuite comme la peau de l'orange qu'il viendrait de vider de sa chair. Particulièrement malappris et profiteur avec ces dames. Un charme indéniable mais une attitude sans vergogne.

Un gars pressé. A peine arrivé, déjà reparti. Ne s'attarde pas à réparer le mal que son égoïsme a causé. Ne l'excusez pas en élevant sa stature au niveau byronien d'un Don Juan mythique, les pactes faustiens n'engagent que ceux qui croient à de telles fariboles. Alain Malox – ce n'est pas le nom d'un médicament mais un clin d'oeil à un Alan Lomax le folkloriste plusieurs fois croisé en nos chroniques, ne serait-ce que dans la livraison précédente consacrée à Muddy Waters – petit dessinateur sans envergure de pochettes de disques de blues de la compagnie Vocamount – bonjour Vocalion - sise à Chicago, est envoyé dans les états du Sud afin de tirer au crayon le portrait d'un certain Robert Johnson dans le but strictement commercial de posséder un document iconographique de première main à apposer sur la proximale parution de ses enregistrements.
Evidemment Alain Malox ne mettra jamais la main sur Robert Johnson. Lui faudra plusieurs mois avant de le localiser, mais il arrivera trop tard. L'est déjà mort et enterré depuis trois jours. La longue enquête se termine sur un échec frustrant au bord de la tombe refermée. Il y a un deuxième cadavre. Parfaitement vivant, je vous surprends. Celui de notre Malox pour qui la vraie vie ne fait que commencer. Va enfin être confronté à la noirceur bêtifiante de l'Homme animal et à la blancheur réconfortante de la déesse Femme. Jeu de couleur pas du tout subtil : les policiers porcins qui représentent la noirceur humaine sont des blancs racistes qui se moquent des lois de protection des citoyens dont ils sont censés veiller à la vertueuse application, et l'égérie féminine du livre est une belle prostituée noire. L'incarnation parfaite de ce que les alchimistes appellent le vitriol ardent. A ne manipuler qu'avec précaution. Faut d'ailleurs viser d'abord à une métamorphose personnelle avant de s'attaquer à une telle entreprise. Alain Malox ne s'en doute pas. Fonce sans réfléchir. L'est vrai que l'amour est aveugle, mais il faut ensuite assumer. Les mentalités mississipiennes ne sont pas prêtes à accepter les rencontres inter-raciales. L'aura davantage de chance avec la force brute de la bêtise policière. Lorsque les coups arrivent ils vous font mal, mais ils vous apprennent aussi à vivre. Rien de mieux qu'une bonne raclée pour comprendre que l'on ne survit dans la jungle humaine qu'en acceptant le combat. Rien ne sert de fuir et de ramper. L'on ne se défile pas en douce. L'on fait front et ce que l'on désire, on n'hésite pas aller le chercher.

Pour l'histoire d'amour, Michel Lauwers vous laisse le champ libre. Selon que vous êtes un indécrottable optimiste ou un forcené pessimiste. Pour Robert Johnson je reste beaucoup plus dubitatif. La question soulevée par le livre est des plus simples. Elle peut s'énoncer clairement : quel est le nom de l'assassin de Robert Johnson ? Faudra en corolaire rajouter une explication si l'on écarte la rage d'un mari cocu. Michel Lauwers nous livre le coupable à la fin du bouquin, ligoté comme un saucisson dans les rets de la bonne conscience. Ne vous donnerai pas son nom. Si vous voulez le savoir, lisez le livre. Non ce n'est pas de la cruauté mentale de ma part, c'est surtout parce qu'il ne vous dirait rien. C'est que dans son pseudo-docu-fiction notre auteur a quelque peu biaisé avec la vérité historique, il change les patronymes des personnages ayant réellement existé. N'a aucune envie d'accuser d'un crime avéré des personnes qui lui furent parfaitement étrangères. Difficile d'ancrer le récit de la mort du malheureux Johnson dans le terreau de son existence familière sans attenter à la respectabilité de ses proches. Mais Michel Lauwers a plus d'un tour dans sa plume de romancier. Il ressuscite le mort. Non pas Robert Johnson, faites preuve d'un peu d'imagination nom de Dieu. Celui qu'il a lui-même envoyé ad patres, le pauvre diable in person relégué dans l'enfer idéologique des vieux racontars, le fameux mythe du carrefour, qui ne fonctionne que si on lui adjoint en filigrane son contraire angélique, le gentil bon dieu des fois naïves. Celle du charbonnier dont se prévalait le pieu Paul Claudel.
Retour aux racines du blues. Le bon chemin de l'Eglise ou le mauvais sentier du juke joint. En des temps anciens la seule liberté de choix offerte au peuple noir. Encore que ces descendants d'esclaves, habitués à la moindre resquille dès que les maîtres avaient le dos tourné, ont quelque peu triché. Beaucoup ont passé le meilleur de leur vie dans les barrel houses les plus mal famés à boire de l'alcool de contre-bande et à lutiner d'accortes mamas pour opérer une stratégique retraite dans les chapelles du Seigneur lorsque la vieillesse se profilait à l'horizon avec son cortège de misères tant physiques que morales. Faut bien faire une fin.

Pour Alain Malox, ce sera un début. La larve humaine de l'employé modèle perce enfin le cocon des existences grisâtres. Robert Johnson peut rester enrubanné dans les ligaments momifiant du mythe, Alain Malox lui se prépare à se colleter avec le réel de son inscription sociale. Entre le Diable et Moi, l'a compris que puisque l'on ne vit qu'une fois, l'a intérêt à s'occuper en priorité de sa propre personne. Les mythes peuvent vous aider à vivre. Surtout par procuration. Attention danger ! Michel Lauwers nous donne une bonne leçon existentielle. Les morts avec les morts. Les vivants avec les vivants.
Damie Chad.
( Tableaux de Pascale Lauwers )
SCREAMIN' JAY HAWKINS
THE SINGLES COLLECTION
THE ORIGINAL HIT SINGLES + BONUS ALBUM
Disc One : I PUT A SPELL ON YOU / LITTLE DEMON / YELLOW COAT / PERSON TO PERSON / I HEAR VOICES / THIS IS ALL /SHE PUT THE WHAMEE ON ME / FRENZY / ASHES / JUST DON'T CARE / YOU'RE ALL MY LIFE TO ME / EVEN THOUGH / NOT ANYMORE / PLEASE TRY TO UNDERSTAND / I IS / YOU MAKE ME LOVE YOU ( I DIDN'T WANT TO DO IT ) / TALK ABOUT ME / WELL I TRIED / I FOUND MY WAY TO WINE / BAPTIZE ME ON WINE
Disc Two : THERE'S SOMETHING WRONG WITH YOU / ALLIGATOR WINE / THE PAST / ORANGE COLOURED SKY / AMPIT N° 6 / DARLING, PLEASE, FORGIVE ME / TAKE ME BACK / HONG KONG / WHY DID YOU WASTE MY TIME ( with TINY GRIMES ) / NITTY GRITTY ( with SHOUTIN' PAT ) / TAKE ME BACK TO MY BOOTS / + Bonus Tracks : TEMPTATION / IF YOU ARE BUT A DREAM / OL' MAN RIVER / I LOVE PARIS / SWING LOW, SWEET CHARIOT / DEEP PURPLE.
NOT NOW MUSIC 2013.

Une petite notice accompagnatrice qui n'apporte que quelques maigres renseignements et pas grand-chose sur les dates d'enregistrement. Dommage Screamin' Jay Hawkins méritait mieux. Ses héritiers directs ont fait pire. Ont viré à la poubelle tous ces costumes de scène et une foultitude d'objets. De quoi remplir un musée. Les dieux du rock ont été cléments, ont guidé un fouineur de bennes à ordures vers le coffre à merveille dont le contenu s'est retrouvé aux enchères en ce ce début d'année. Les collectionneurs argentés auront limité le désastre. Cette triste anecdote a eu l'avantage de ramener le projecteur sur cet incomparable artiste qui s'est éteint à Paris au tournant du millénaire, en l'an deux mille.
Screamin' Jay Hawkins fit une deuxième carrière en Europe, les USA qui furent pourtant le pays qui introduisit la notion de burlesque, par l'entremise des premiers spectacles de Black Faces, dans la musique noire - assez fortement pour finir par instiller le blues d'une dimension comique qui peut paraître surprenante quand on n'y réfléchit pas assez - l'ont très vite oublié. C'est que le rire de la dérision en plus d'être le propre de l'homme comme l'affirma Rabelais est une aussi une arme d'autodéfense des plus efficaces. Remarquons que les européens jetèrent très vite un voile pudique sur les premières manifestations du grotesque, telle qu'elles apparurent lors de l'édification de la Maison Dorée de Néron. Il fallut que ce soit Edgar Allan Poe qui recueillit ce chat noir mal-aimé dans ses Tales Of The Grotesque And Arabesque pour que la monstruosité insinuante fit son chemin dans l'imaginaire interdit des amerloques.
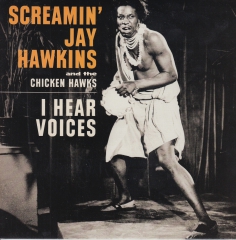
Le CD n'adopte pas l'ordre chronologique. Pour des raisons commerciales évidentes l'on a placé I Put A Spell On You en pole-position. Nous préférons pour notre part suivre la courbe temporelle. Nous ajouterons que si le mouvement rock a très vite classé Screamin Jay Hawkins dans le lot informel des pionniers, il procède avant tout des racines noires de ce même rock and roll, ayant d'abord travaillé – saxophone et piano - avec Fats Domino et des pointures trop méconnues telles que Wynonie Harris. Sur ses premiers titres l'on retrouvera la guitare de Mickey Baker qui lui aussi finit par s'installer en France. Il y est mort en novembre 2012 voici déjà deux années, et nous rappellerons toujours avec plaisir qu'il donna un sérieux coup de main à un des french rockers des plus émérites, Ronnie Bird.
1954 : I Found My Way To Wine, l'intro évoque irrésistiblement le Goin'Home de Gene Vincent – lui-même inspiré de Bo Diddley – mais l'on retombe dans un blues que j'appellerai orchestral, la charge émotive de la voix étant mangée par l'instrumentation, le Please Try To Understand de la face B bascule dans la supplication amoureuse, faut suivre le piano et la voix pour trouver la sauvagerie, les cuivres nappant le tout de sucre candi.
1955 : Well I Tried, toujours la même dichotomie, un côté âpre et mélodramatique dont la voix et un sax solo se gargarisent tandis que piano et sax baryton nous livrent un enrobage quasi grand public que le You're All My Life To Me accentue, pas tout à fait les gémissements de l'adolescent frustré, mais le vieux beau qui voit ses proies habituelles s'éloigner.

1956 : This Is All, la bête se réveille. N'est pas encore sorti de sa caverne d'hivernage, mais le ton se fait plus tranchant et vindicatif. Les cuivres ont beau faire des ronds de jambe, l'on sent que le dégel arrive. She Put The Whammeee On Me : la situation se tend. L'on n'est pas là pour plaisanter. La gent femelle produit de drôles d'effets sur le gazier. Commencez à numéroter vos abatis, l'on sent qu'il n'en faut pas beaucoup pour renverser le vase de nitroglycérine. Les cuivres se la jouent modeste et baissent le ton.
1956 : Even Though, tout va mieux, l'on calme le jeu. On se croirait chez Frank Sinatra. Le même style variéto-jazzeux mais avec une voix d'ours mal léché. A du mal à rester dans sa boîte. Ça dépasse dans tous les coins. Talk About Me, la même salade, une musique guillerette, mais des appuyés de voix à la Little Richard prometteurs. Ne vous laissez pas abuser par l'insouciance du vibraphone, ce n'est pas mal du tout.
1956 : I Put A Spell On You, l'on n'y peut plus rien. Rien ne l'arrêterait. Le rock Shouter est né. Enregistré au cours d'une biture monstre. Tous pétés comme des coings, un sax qui rampe vers vous comme un anaconda affamé et le Jay qui pique une crise délirium tremens. Z'ont préféré couper les micros à la fin avant que ça ne devienne incontrôlable. Little Demon, sorti de sa coquille, danse sur tous les sommets du monde. Bouffe les mots et les recrache aussitôt.

1957 : You Made Me Love You, les cuivres essaient de pousser la chansonnette, il s'en fout le Jay leur passe dessus à contre-chant. Cause à sa minette et plus rien ne compte. Rugissement de rut en prime. Darling Please Forgive Me, un moine fou se masturbe en hurlant sous les voûtes séculaire de la chapelle, un pieux organiste essaie de la recouvrir avec son harmonium, c'est une erreur.
1957 : Frenzy, les shadows en fond de transistor et un vieux dégueulasse qui cavale après les nymphettes, vous imaginez la scène, l'après-midi d'un faune shouter qui a envie de s'amuser. Sacrément rock and Roll. Person To Person, une intro à la Platters et une explication au téléphone. Fait le méchant, mais l'on n'y croit plus. Après les douteux agissements de la face A, il fait profil bas. Le naturel au galop dans les dix dernières secondes.
1958 : Alligator Wine : c'est comme Frenzy mais en pire. Certains ont le vin triste. Ce n'est pas le cas de notre Silène qui barbote dans la cuve tel un alligator dans un poulailler. There's Something Wrong With You, la même chose que I Put A Spell On You, légèrement plus délayé, un démarquage, vous me ferez le plaisir de préférer l'original. Une mention spéciale toutefois au sax qui pète longuement à la fin du morceau.

1958 : Armpit # 6 : entre les pileux dessous pas très ragoûtants et les voix de dessins animés. Il vaudrait mieux ne pas chercher à savoir. Cela sent trop mauvais. The Past, l'hypocrite à grosse voix qui fait semblant de regretter mais qui n'a pas d'autre personne sous la main pour tirer un coup.
1962 : I Hear Voices, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Folie dure et film d'horreur. Je comprends pourquoi il existe des asiles psychiatriques. Just Don't Care : fallait réparer les dégâts, l'on a fait au plus vite avec ce qui traînait dans les studios, faute de demoiselles l'on a pris un choeur de mecs, on a préféré ne pas trop l'énerver.
1962 : Ashes, sixties, cette fois on lui a glissé un choeur de poulettes, il fait le joli coeur et prend une voix mélodramatique, tu sais poupée j'ai beaucoup vécu, avec le ton sur lequel lui répond la fillette, ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Nitty Gritty : sympathique mais pas essentiel, la décennie fabuleuse s'achève.

Pour le reste du disque ils ont puisé un peu partout sans souci de date et de cohérence. Yellow Cat, un vrai faux blues, avec des déchirements forcené de coeur. I Is du même tonneau que le précédent. Baptize Me In Wine, les vignes du Seigneur vendangées par le diable, un gong Hong Kong, une très belle illustration de yaourt chinois nécessaire à votre ouverture culturelle personnelle. Temptation, un véritable générique de film, If You're But A Dream, le genre de croonerie que Presley réussissait sans faillir, mais tout le monde n'est pas Elvis. Respectabilité noire : Ol' Man River, des larmes d'alligator qui sonnent plus faux que faux. En plus il le fait exprès. Ne respecte même pas l'esclavage, un iconoclaste qui se fout de tout. Tant pis pour les pète-sec qui n'ont jamais admis son Constipation Blues, absent de cette compilation. I Love Paris, entre Les Frères Jacques et le jazznavour. N'y tient pas longtemps. Trop grosse voix. Un truc qui a dû inspirer certains des derniers errements d' Iggy l'Iguane. Swing Low, Sweet Chariot, vous écouterez de préférence la version de Pétula Clark. Deep Purple, vous êtes sûr que c'est Screamin Jay Hawkins ? En tout cas un parfait comédien du rock and roll. Mais que peut-on attendre d'un gars qui a passé la moitié de sa vie dans un cercueil à se tordre de rire ! L'est sûr que s'il y en a un aujourd'hui qui se retourne dans sa tombe, c'est bien lui, Screamin' Jay Hawkins. L'incomparable. N'avait pas un seul défaut. L'était le défaut à lui tout seul.

Pour résumer : un objet incontrôlable dans votre discothèque, mais indispensable.
Damie Chad.
22:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
10/12/2014
KR'TNT ! ¤ 213. LORDS OF ALTAMONT / BARFLY / MUDDY WATERS / LITTLE RICHARD
KR'TNT ! ¤ 213
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
11 / 12 / 2014
|
LORDS OF ALTAMONT / BARFLY / MUDDY WATERS LITTLE RICHARD |
CAEN ( 14 ) / 15 - 10 - 2014
BIG BAND CAFE / LORDS OF ALTAMONT
ALTAMONT LA-DESSUS
ET TU VERRAS MONTMARTRE
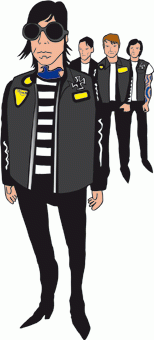
Les Lords Of Altamont avaient pourtant tout ce qu’il fallait pour rendre un homme heureux. À commencer par un leader prestigieux, Jake Caveliere surnommé The Preacher, ex-écumeur de maisons de corrections et ex-membre des Fuzztones, qui affiche une image soigneusement travaillée de biker tatoué satanique et de hellraiser du Farfisa. Ensuite un bon label, puisque leur premier album paru en 2002 sur Sympathy For The Record Industry fit sensation dans le Clochemerle des garagistes. Long Gone John gérait alors son label en parfait visionnaire. S’il donnait sa chance à un groupe en publiant un premier album, il fallait dresser l’oreille vite fait.
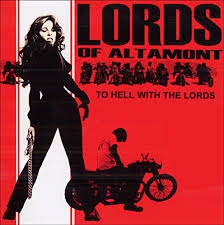
C’est vrai, la pochette de «To Hell With The Lords Of Altamont» se distinguait du lot. Les Lords voulaient s’enraciner dans la mythologie des Hells Angels. Alors là bravo ! En plein dans le mille ! À l’époque, on a gobé ça sans discuter. Les Lords semblaient vouloir prendre la suite de Steppenwolf et des Stones qui firent un temps joujou avec la fumante mythologie des gangs de bikers californiens.

The Preacher conduit des grosses motos. Allez voir les interviews qui sont en ligne, vous verrez, il en parle savamment. La moto et le rock ont toujours fait bon ménage. Mais là, il entre dans un domaine qui était traditionnellement réservé au Grateful Dead, à Blue Cheer et à Canned Heat, qui étaient les groupes favoris des Angels californiens. Les Lords semblent vouloir réactualiser cette tradition disparue comme par enchantement dans les années 80. On avait presque oublié ce bel épisode de la saga du rock californien, les photos de Bob Hite et de Henry Vestine grimpés sur des Harleys et coiffés de casques allemands, celles de Dickie Peterson en compagnie de son manager Gut, Angel de son état, le livre de Hunter S. Thompson et les mémoires de Sonny Barger. Les films de Kenneth Anger, ces ouvrages et ces images constituaient les fondements du fameux Californian Hell. Avec la parution du premier album des Lords et l’arrivée de la série «Sons Of Anarchy», cette mythologie sembla connaître un certain regain d’intérêt. «Sons Of Anarchy» propose en effet un astucieux mélange de pseudo-Barger (à travers le personnage de Clay, interprété par Ron Perlman - qui fut aussi le savoureux Salvatore possédé par le diable dans «Le Nom de la Rose», tiré du roman d’Umberto Eco) et de Kurt Cobain (à travers le personnage de Jax).

Dans un cas comme dans l’autre, on est assez loin des réalités du mythe, telles que les décrit Hunter S. Thompson. Les Lords font du garage et tentent de vendre des albums de rock en exploitant une imagerie, et la série américaine recycle (avec pas mal de brio) un vieux fleuron de la sub-culture américaine. Le seul problème, c’est que les Hells Angels n’ont jamais été un phénomène de mode. Loin de là. Ils se voulaient simplement les héritiers d’un mode de vie. Ils n’inventaient rien. Pendant plus d’un siècle, l’Ouest américain a grouillé d’aventuriers qui méprisaient les lois et les juges. Les Hells Angels revendiquaient exactement le même genre de liberté. C’est ce qui fit leur grandeur. Mais comme le dit si bien William Burroughs dans «The Thanksgiving Prayer», l’American Dream est mort - Thanks for the last and greatest betrayal of the last and greatest of human dreams (merci d’avoir trahi le dernier et le plus grand rêve de l’humanité) - Les Angels connurent les pires ennuis. Le pouvoir américain s’acharna sur eux - comme il s’acharna sur les Black Panthers - et leur refusa ce droit fondamental à la liberté, alors que la constitution américaine est précisément fondée sur cet idéal de liberté. Voilà ce qu’on appelle dans le jargon des philosophes de comptoir une impasse paradoxale.

Notons au passage que les grands capitaines de piraterie s’inspirèrent du même idéal de liberté absolue. Traqués par les marines de guerre anglaise et espagnole, les derniers capitaines de piraterie durent aller se réfugier à Madagascar où ils fondèrent une colonie nommé Libertalia.

Mais avec «To Hell With The Lords Of Altamont», on était loin de tout ça. L’album tenait bien la route, c’est vrai, mais il manquait le petit quelque chose qui fait la différence, la fameuse étincelle qui met le feu eux poudres dans les albums des Gories et des Mummies, par exemple. Deux morceaux des Lords sonnent comme des classiques des Cramps («Too Old To Die» monté sur le même beat que «Garbage Man» et «Three», beat crampsy noyé d’orgue, ce qui amène un brin de grandeur pharaonique). The Preacher chante «Come On» avec une belle hargne pressée - la même que celle d’Iggy dans «Search And Destroy» - On trouve en face B un gros r’n’b sixties nommé «Come On Up», un truc capable de rendre n’importe quel jukebox heureux. Les deux énormités des Lords se trouvent en fin de face B. «Stripped Down» est embarqué à l’énergie, mais c’est une énergie peu commune, quasiment surhumaine, une énergie de guerrier tatoué échappé d’une saga de Tolkien. Et «Born To Lose», heavy groove qui se hisse sur la croupe d’une grosse bassline et dont le poids pèse comme une malédiction. Leur retour de groove vient de loin, certainement de «I’m A Man» du Chicago Transit Authority. C’est dire si ce groupe est attachant, car il est comme la dinde de Noël, farci des meilleures influences. Et ils tirent une fabuleuse énergie des profondeurs de la terre.
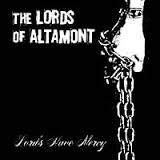
L’album suivant, «Lords Have Mercy», est nettement meilleur. Il s’ouvre sur une belle dégelée de psycho-fuzz intitulée «Cyclone», embarquée à la moutarde qui monte au nez du riff. Jake The Preacher harangue comme s’il emmenait une armée à l’assaut d’une forteresse imprenable. Et quasiment tout l’album va danser sur des charbons ardents. Ce disque est bourré d’une énergie spectaculaire. On le sent en écoutant «Burried From The Knees Down». Le cut explose dans sa coque. Ces gens-là ne savent faire qu’une seule chose dans la vie : pulser le beat jusqu’à plus soif. Ils sont la réincarnation de Vulcain occupé à marteler ses enclumes jour et nuit, sans jamais s’accorder le moindre répit. Ils sont au garage ce que le marteau-pilon du Creusot fut à la métallurgie technoïde du XIXe siècle : un monstre productiviste noyé dans les fumerolles. Nouvelle attaque à la fuzz pour «Action». Ce genre de riff cisaille le concept même du riff à la base. Le cut fonctionne comme un retour de manivelle. Quel choc - Action ! Action ! - Ça sonne comme un hit famélique, digne des hauts faits d’un Godefroy garagiste de bouillon intemporel, car grandiose et nappé d’orgue. Ces gens-là ne vivent que pour l’Action ! Plus loin, ils lâchent une belle purée d’orgue pour lancer «She Cried», reprise d’un vieux hit de Jay & The Americans. S’ensuit un «Velvet» vachard et violent, beaucoup trop explosif, beaucoup trop garage. Même trop parfait. Trop chanté. Trop riffé. C’est le cut idéal pour l’amateur extraverti. Retour à la violence de bon aloi avec «Project Blue». Ça nous piétine la tirelire et franchement, on adore ça. Autant le dire franchement. Gandhi nous enseignait de tendre l’autre joue, alors on tend l’autre joue. C’est dire à quel point ces gens-là sont brillants. Et la fête se poursuit avec «Live Fast», une énormité cabalistique digne de Question Mark & The Mysterians. C’est un hit garage de première importance. En somme, ce n’est pas compliqué : tout est bon sur cet album. Autant se faire une raison. Ils tapent dans un bon vieux beat anglais avec «Tough As Nails» et allument une reprise de «Time Has Come Today» des Chamber Brothers, mais il serait bon de rappeler, Nathanaël, que des gens-là sont des démons.

Encore pas mal de dégâts à déplorer avec «The Altamont Sin». La moto est revenue sur la pochette, chevauchée par une dame. C’est l’album des killer solos, du style de celui qui traverse «Gods & Monsters». Les Lords sont devenus avec ce troisième album de vrais forçats du garage. Ils ont su créer leur propre orthodoxie. Il leur manque juste l’élégance compositale. On pourrait presque les accuser de vouloir rester dans l’obscurantisme garage des vieux volumes de Peebles, ceux qui craquent. «Going No Where Fast» est une belle pièce excédentaire du commerce ferrailleur. C’est poundé à la vie à la mort. Le drumbeater porte tout le cut à bout de bras. Ils expédient tout ça en enfer sans discussion. Joli solo à l’ancienne, avec coulée de notes fumantes, killerique à souhait. On reste dans le glouglou inflammatoire avec «Lightning Strikes». Les Lords ont parfois de sacrés éclairs de génie. Le couleur de bronze s’appelle Siggs De Villa. Il joue un solo de rêve en suspension. Rien que pour ça, il faut écouter cet album. Grâce à ce solo, il opère une mise en perspective du son. Pas mal, non ? Retour à la manie de frappadingue avec «Hold Fast». On en ravale sa salive. Les Lords disposent d’énormes stocks de répondant. Il ne faut pas essayer de leur expliquer ce qu’est le garage. Et voilà un nouveau killer solo qui ne pardonne pas. On en trouvera un autre dans «Driving Too Fast». Chez eux, c’est génétique. Ils solotent de la même façon qu’ils tirent sur la poignée de gaz. Vroaaaarrr ! «Living Hell» est carrément stoogy. Ils sortent le son de «1969». Oh la la, c’est à tomber. Et ils finissent avec une belle reprise de Roky, «Don’t Slander Me». Pleurésie garantie.

«Midnight To 666» fait aussi partie des grands disques de garage exacerbé. Attention à la saturation du son. Les Lords dépassent un peu les normes. «FFTS» explose un peu les oreilles. Si on aime bien le bon garage, alors ce disque est idéal. Dans «Get In The Car», on se régalera d’un beau solo liquide. Ils passent tous les poncifs du genre à la moulinette et c’est précisément la raison pour laquelle on les admire. Belle drug-song que ce «Gettin High (On My Mystery Plane)», titillé dès l’assaut par un ingrat vibrillonnage psyché. Voilà ce qu’on pourrait appeler un joli coup de freakbeat envoyé dans la barbe du marché de Wall Street. «Save Me (From Myself)» est transpercé au lance-flammes. Floooofff ! Les Lords ont acquis une sorte de maturité dans la brutalité. Une sorte de maîtrise du radicalisme. Un goût prononcé pour l’exécution sans jugement. Une expertise de la poigne. Ils savent jouer des épaules et des climats. Leur ronde infernale finit par bien virevolter. Fantastique cut que ce «Soul For Sale», bâti sur la menace d’un grand broutage de motte. Lâchez les moutons ! C’est nappé d’orgue et heurté au petit gimmick. Sur la face B, on trouve une héroïque reprise de Tommy James, «I’m Alive», une power-pop à gros biscotos. Ils mériteraient presque une décoration pour cet exploit. The Preacher sait prêcher dans le désert, n’en doutons pas un seul instant. Avec «Turn Me Down», ils sonnent un peu comme les Pistols, ce qui les met en danger, car on pourrait les accuser d’embourgeoisement et pire encore, d’exotisme. Puis ils reviennent pounder à fond de beat «Bury Me Alive». Oh, ça se passe dans un graveyard. Ils font une reprise des Dead Boys, «Ain’t It Fun» et si on aime la purée de fuzz définitive, alors on se régalera avec «Synanon Kids», cut idéal pour allumer une cave remplie de teenagers défoncés. Jake The Preacher hurle dans le désastre de ses nappes d’orgue et un effroyable killer solo vient le mordre à la gorge, alors forcément il s’écroule sur son clavier en bavant de l’écume blanchâtre.
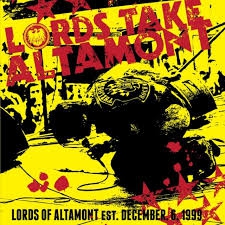
Leur dernier album qui vient de paraître est un véritable coup de maître. Avec «Lords Take Altamont», ils rendent hommage aux groupes qui ont joué au fameux festival gratuit d’Altamont, en 1969 : Flying Burrito Brothers, Stones, Santana, CSN&Y et Jefferson Airplane. On trouve sept reprises des Stones sur cet album et ce sont sept véritables coups de génie. Personne mieux que les Lords ne sait endiabler une reprise des Stones. Il suffit juste d’écouter «Live With Me» et on sera fixé. C’est tellement puissant qu’on prendrait presque ça pour une anomalie. Tout vibre dans l’anormalité du contexte d’écroulement para-sismique. C’est la pire version qui se puisse imaginer sur cette pauvre terre. Elle est tout simplement hallucinante d’explosivité abyssale. On tombe un peu plus loin sur une version apoplectique de «Stray Cat Blues». La version rôtit en enfer. Les Lords tournent la broche. Ça rissole. C’est absolument grandiloquent. Le jus dégouline dans les fondements de la raison. Quand les Lords tapent dans les Stones, ils deviennent tout simplement des géants du rock. Mais ce n’est pas tout. Ils font aussi subir les pires outrages à «Love In Vain». Voilà une version exemplaire qui balaye celle des Stones. Attention à «Gimme Shelter». On sent bien que le Preacher adore les Stones. Il lui faut ce jus de Stones pour resplendir au sommet des montagnes. Pas de hit plus faramineux que «Gimme Shelter». Pure magie. Ils font bien évidemment une version exceptionnelle de «Sympathy For The Devil». Jake Caveliere peut chanter comme Jagger, pas de problème. Ce cut est considéré comme intouchable, mais les Lords le bouffent tout cru. Ils font aussi une version absolument démente de «Monkey Man» et expédient le petit «Jingo» de Santana au firmament des reprises. Mais comment osent-ils ?

On voit les Lords assez régulièrement en France. Les concerts parisiens n’avaient pas laissé de souvenirs impérissables. Sans doute y avait-il à cette époque trop de bons groupes garage de type Dirtbombs, Soundtracks Of Our Lives ou Flamin’ Sideburns. Les concerts rouennais n’avaient pas non plus provoqué d’extase. Pourtant, Jake Caveliere est excellent sur scène. C’est la raison pour laquelle on retourne toujours le voir jouer. Si on se met à snobber ce genre de mec, c’est foutu. En allant à Caen, on espérait secrètement le voir jouer les superbes reprises des Stones qui se trouvent sur son dernier album. Raté. Jake tape dans tous ses albums pour monter son set. Il retourne chercher «Cyclone», Buried», «Action» «Velvet», «$4.95» et «Live Fast» sur «Lords Have Mercy», «Hold Fast» et la reprise de Roky (avec laquelle il boucle les rappels) sur «The Altamont Sin» et «Getting High» sur «Midnight To 666». Les deux seuls cuts qui sortent du dernier album sont «Black Queen» (CSN&Y) et le fantastique «3/5 Of A Mile In Ten Seconds» de l’Airplane. Sur scène, il est entouré par une nouvelle équipe, mais ça ne change rien au son. C’est Jake qui incarne le groupe, de la même façon que Chrissie Hynde incarnait et incarne toujours les Pretenders. Une fois arrivé sur scène, il refait tout son cirque, il shoote, il screame, il blaste, il pulse son shuffle, il grimpe sur son clavier, il joue les locos et il en donne au public pour son argent. Ah tu voulais du garage ? Tiens, voilà du garage ! Et du gros ! Du bien nappé d’orgue ! Comme Jim Jones, il prend les cervelles d’assaut, au sens où on l’entendait au Moyen-âge. Alors que la scène rougeoie, une clameur s’élève et les oreilles sifflent.

Signé : Cazengler, Altamonté sur ses grands chevaux
Lords of Altamont. Big Band Café. Caen (14). 15 octobre 2014
Lords of Altamont. To Hell With The Lords of Altamont. Sympathy For The Record Industry 2002
Lords of Altamont. Lords Have Mercy. Fargo 2005
Lords of Altamont. The Altamont Sin. Gearhead Records 2008

Lords of Altamont. Midnight To 666. Fargo 2011
Lords of Altamont. Lords Take Altamont. Gearhead Records 2014
LAGNY-SUR-MARNE / 05 – 12 - 14
local des loners
BARFLY

J'ai vérifié. Au moins deux ans que l'envie de les revoir me tenaillait. Tout cela pour vous dire combien je les avais appréciés dans cette zone industrielle perdue de Beauvais. Oui mais ces sales mouches bourdonnaient en des endroits improbables à des dates impossibles. Mais bon, comme disait ce bon vieux Albert la perception du temps est toute relative, et je dois me rendre à l'évidence objectivale du calendrier, c'était à peine au mois de mars dernier ( Voir KR'TNT ! 179 du 06 / 03 / 14 ) ! Aussi quand je les ai localisés au local des Loners, à Lagny-sur-Marne, la teuf-teuf a traversé à toute blinde la Brie pluvieuse. Tellement rapidement que l'on est arrivé dix minutes avant l'ouverture des portes. Je sais que cela fait un peu pilier de bar, mais l'on est reparti à leur fermeture.
SET ONE
Il y un piano électrique posé devant la scène, mais il ne servira pas de tout le set. Charlie reste obstinément devant son micro ; parfois il pose sa Gretsch rouge sur son support, mais non c'est pour avoir les mains plus libres. A sa droite c'est son oncle, uncle Gilles, le guitariste. Une génération de plus. L'expérience de la vie lui appris qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors il va directement à l'essentiel. Ne s'embête pas avec les entremets. L'a fait table rase des fioritures. L'est comme ces gourmets qui dans les langoustes farcies au caviar ne se préoccupent que des oeufs de l'esturgeon. Pourquoi s'embêter avec la pâte du choux quand la crème est si savoureuse ! Des guitaristes j'en ai vus quelques uns, ces kronics peuvent en témoigner. Mais comme lui jamais. C'est le lead guitar. Vous entendez, pas un rythmique. Non un guitariste rithffique. C'est plus rare. Le seul que je connaisse. S'est délesté de toute la carrosserie. Tout ce qui n'est pas riff, il l'a porté à la déchetterie. Oui mais que met-il entre deux riffs. Un autre riff. Et entre ce dernier et le suivant. Rien. Rien ? Si un autre riff. Le genre d'architecte qui bâtit les tours du château-fort mais pas les courtines qui les relie. A la place il construit un donjon. Conséquence d'un tel parti-pris. Elémentaire mon cher rifftson, les Barfly déménagent sec. Pas de temps mort. Ni pause, ni soupir. Dégomment les morceaux à une vitesse folle. On ne s'appesantit pas sur les malheurs de l'humanité. Une volée de bois vert. Une pluie de gifles. N'a point trop de place, sur cette mini scène pour les grandes manœuvres, mais n'arrête pas de tourner sur lui-même, le Gilles agile. Lui faut faire deux pas sur le côté pour lancer le riff, et une fois celui-ci parti il volte sur lui-même comme un boomerang qui revient se nicher dans les doigts qui l'ont projeté et qui tout de go le réexpédient. Méchamment efficace.
Avec un tel moulin à vent par devant, vous avez intérêt à ce que derrière les meules tournent sans anicroche. Lulu se charge de cette difficile tâche. Pas question de tapoter en touriste sur la caisse claire. Faut y aller franco de port. Et Lulu s'en donne à cœur joie. Pas de répit. Comment fait-il le dos collé contre le mur, droit comme un I pour frapper si sec et avec une telle force ? Prolixe et inventif. Jamais le même tour. Une passe en plus, une passe en moins, mais la frappe juste. Tambourinades indiennes et claquements secs de colts de cow-boys. Un véritable western. La prairie sans loi et la loi de la prairie. Gilles peut lancer ses riffs à gogo, Lulu les retient prisonnier dans un corral sonore. Pas de panique, c'est du rock et c'est du roll, et voici le rock and roll si vous n'aviez pas compris où l'on voulait en venir. The big beat.

Fut un temps dans la préhistoire du rockabilly où la basse tenait lieu de batterie. Mais avec un frappa-dingue aussi performatif que Lulu l'on pourrait subodorer qu'il ne reste plus à Manu qu'à jouer les plantes vertes. Pas du tout, mais alors pas du tout son avis. N'y a pas que la rythmique dans la vie. La contrebasse c'est aussi la reine du swing. Attention, n'allons pas nous perdre dans les jazzeries sans fin. Slappe peu Manu, mais il crochète les cordes. Un jeu qui permet d'ouvrir les portes. Il s'insinue le Manu, comme ces couteaux qui se plantent dans votre chair alors que vous n'en demandez pas tant. Entre la faucille du riff et le marteau du drum, Manu se fraie son chemin. Chaque note comme un drapeau noir que l'on agite les jours de grande colère. Moins de bruit. Mais aussi persuasif.
Bref un trio démoniaque. Plus Charlie qui s'en vient rajouter de temps en temps la fraise rouge de sa Gretsch. Uncle Gilles, le riffeur fou, ne lui laisse pas beaucoup d'espace mais il est assez malin pour jouer en contrepoint de Manu, et ruse subtile avec lui-même. Les autres peuvent mener la grande farandole du scalp, le Charlie joue tout seul. C'est ce que l'on croit. Mais en fait, il est aussi coupable que les autres. Peut-être même que c'est lui qui est à l'origine du ramdam. L'est comme le tigre altéré de sang qui ne peut pas voir une douce gazelle sans se jeter dessus pour l'égorger. Montrez-lui deux lignes de lyric quelconque et il s'en empare, et les avale en une fraction de seconde. C'est pour mieux vous les recracher comme s'il avait dans sa précipitation fourré en sa bouche un serpent venimeux. Il ne chante pas. Il vous agresse. Vous déverse un trop plein d'énergie en forme de déluge. Ne croyez pas qu'il va se calmer, qu'après l'intro il vous prendra une petite allure pépère qui nous mènera en clopinant à la fin du morceau. C'est qu'avec Tonton Gilles qui vous bazarde un riff toutes les six secondes, le Charlie l'a intérêt à ne pas faire le charlot et à rester sur la brèche. Du vent dans les voiles, et ce n'est pas prêt de mollir. Charlie il vous balance le rock comme un capitaine pirate hurle dans son porte-voix lors d'un abordage. Pourrait porter une croix rouge avec un panneau clignotant marqué « Urgence Rock And Roll ».
C'est cela les Barfly en action. Et le public qui n'est pas rassasié, et qui en redemande.
SET TWO
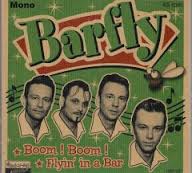
Il y a toujours ce piano électrique devant la scène et les Barfly debout sur leur piédestal qui poussent la chansonnette. Mais assaisonnée à leur goût. Very hot and speed. Wildest in the garage. Un must of rock and roll. Et pourtant l'on n'a encore rien vu. Même si l'on a déjà beaucoup entendu. Enfin Charlie cuts across shorty. Descend de l'estrade pour s'installer devant la bête. Brrrr ! Personne n'a froid, c'est seulement le feulement du killer who is comin' home. Enfin pas tout à fait. Charlie a compris que rien ne sert de vouloir imiter l'enfant terrible de Ferriday. Certes il est difficile de s'asseoir devant un clavier sans penser à Jerry Lou, ce serait suicidaire, mais il faut savoir se démarquer sans s'interdire quelques citations. Mais je parle, je parle et il y a déjà longtemps que les doigts de Charlie font la course entre eux.
Ne croyez surtout pas que les trois autres en profitent pour siroter une bière les orteils des panards en éventail. Turbinent toujours autant même si on les zieute un peu moins. Ce sont les Barfly sur scène, et ils ne sont pas prêt à baisser le son. Mes yeux cherchent les mains de Charlie, en constants mouvements, et je comprends pourquoi il joue si sauvagement bien. N'a aucun mérite. Des doigts d'une longueur démesurée, de véritables serres d'aigles qui n'ont aucune difficulté à couvrir les touches et à voler par-dessus. La vie est injuste quand je regarde mes moignons de lilliputien. En plus il vous bazarde du bout des lèvres de ces chahuts à damner tous les saints du paradis.
Remontera sur scène après un long intermède pianistique étourdissant. Les Barfly ne quittent pas le comptoir du rock de bon gré. Arrêtent quand ils n'en peuvent plus. Sauf Lulu qui me paraît frais comme un gardon.
SET THREE

Et ils reviennent, le sourire aux lèvres et le riff toujours aussi coupant. Sont un peu moins performants. Mais uniquement entre les morceaux. Car les six secondes passées en courts conciliabules pour choisir un titre sur la set list, ils reprennent la charge comme un troupeau de bisons piqués par un essaim de taons voraces. Droit devant et le rock and roll en ligne de mire. Avec piano. Sans piano. Sont toujours les Barfly. Un sacré combo de rock'n'roll. Seulement rock and roll. Mais nous n'en avons jamais demandé autant. On n'aurait pas osé. Oui, mais les Barfly l'ont fait.
Damie Chad.
BARFLY : FLYING TO THE BAR.
FRANKIE CALLS US. LION OF ROCK'N'ROLL. SCREAMIN' AND SHOUTIN. CHARLIE'S MY NAME. LEAVE, LEAVE, LEAVE. CRAZY LITTLE MAMA. LITTLE PRINCESS. ROCKIN' FAMILY. UNCLE GILLES. FLYIN' IN A BAR. BLOODY HELL ( I LOVE YOU ). BARFLY.
GILLES : lead guitar. LULU : drums. CHARLIE : singer. MANU : Bass.
Guest : JERRY des Megatons sur trois pistes.
Recorded at BLR studio by Mister Jull.
On : Rock'n'Roll Rhythm Records
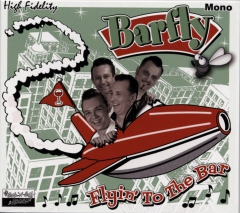
Plum ! Plum ! Plum ! Nous volent dans les plumes dès les trois premières secondes, Charlie maltraite son piano dès le premier morceau, l'est vite rejoint par les trois autres sur le second. Lion Of The rock, un pareil programme vous donne des ailes dans le dos. Chacun a décidé de montrer ce qu'il sait faire, Charlie qui miaule comme un vieux greffier énamouré on a tin heat roof, Lulu qui festivalise son savoir-faire, et la guitare de Gilles qui sonne comme celle de Buddy Holly. Charlie's My Name, une batterie équatoriale, un riff démoniaque et Charlie qui se prend pour une corne de brume. Manu qui remet le couvert de trois entailles profondes chaque fois que vous croyez que ça va s'arrêter. Je ne vous mentionne même pas les singes qui piaillent sur les lianes. Screamin' and Shoutin', Charlie chante du rock and roll, vous avertit en vous fracassant la tête contre les murs, mais les Barfly, ils sont comme cela, et il faut avouer que se faire remettre les idées en place ne peut pas faire du mal. Leave, Leave, Leave, retour – n'ayez pas peur on ne l'a jamais quitté - au pur rock'n'roll, le piano entame une course de côtes avec le saxophone de Jerry des megatons, le feu qui dévore et la trompe de la mort qui appelle du renfort. Si vous en sortez vivant ce n'est pas de votre faute. Le hasard qui vous a épargné. Crazy Little Mama, manquait plus qu'une fille pour semer l'hystérie dans les coins. Quant à Charlie, sûr que le stupre lui monte à la tête. Mais ne doit pas être le seul à la manière dont les autres boutent le feu en chœur. Little Princess, décidément les filles les enfièvrent. Au début du morceau savent encore se tenir mais quand il s'agit de passer le pont, ils s'énervent salement. Rien à faire, c'est de famille, ce n'est pas sur Rockin' Family qu'ils ont décidé de se calmer. Tapent à votre porte comme si c'était la Saint-Barthélémy. Insistent au prochain morceau. Boom Boom, petite crise de folie collective. Désolé mais ça ne se soigne pas. L'on n'a pas encore trouvé la molécule qui pourrait les remettre dans le droit chemin de la triste normalité. Second portrait de famille : Uncle Gilles - le neveu a de qui tenir - un sacré lascar cet oncle Gilles, l'en profite pour balancer des riffs meurtriers comme d'autres des grenades dans les tranchées de 14. Et le sax qui souligne toutes les mauvaises embrouilles dont il s'est rendu coupable, au moins depuis le ventre de sa mère, vu le profil de l'artiste. Quatre secondes de répit, Charlie imite Elvis le croonw-gospeller de nos rêves, mettez-vous à l'aise afin de signer votre testament car les Barffly ignorent le sens des mots pause et respiration dès qu'ils Put A Record. Z'en profitent pour nous refiler tout de suite après leur hymne national : Flyin' In A bar, écoutez les mouches voler en escadrille et vous comprendrez qu'elles ne carburent pas au sirop de grenadine sans colorant. Rajoutez une pin up qui se radine et Bloody Hell ( I Love You ) vous serez en état de comprendre que la lave sort du volcan. Pour un peu le Charlie en glousserait comme Charlie Feathers, mais non, il préfère faire le cake pour avoir le droit de dévorer le cookie. Deuxième hymne emblématique au cas où vous ne vous en seriez pas aperçu - serait temps quand même que vous fassiez un effort, c'est le dernier - que vous chevauchez une tempête qui se nomme Barfly.
Mille pour mille rock and roll !
Une médecine dont on ne se passe pas. Ne comptez pas sur moi pour que je vous prête le scud. L'est trop précieux. N'insistez pas, même pas la pochette qui est une parfaite réussite. Des rockers et en plus des esthètes. Ne le commandez pas au Père Noël, serait capable de le garder pour lui. Et il aurait raison !
Damie Chad
MUDDY WATERS
MISTER ROLLIN'STONE
DU DELTA DU MISSISSIPI
AUX CLUBS DE CHICAGO
ROBERT GORDON
( RIVAGE ROUGE/ Novembre 2014 )
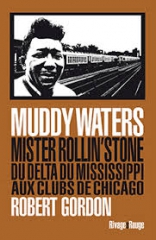
Introduction de Keith Richards, décidément se débrouille toujours pour glisser son petit lick de guitar hero chaque fois que l'occasion se fait sentir. Et même là où on ne l'attend pas comme dans la livraison précédente ( la 212 ). Vous allez me dire que le bouquin est consacré à Muddy Waters et pas à Keith Richards. Sans doute avez-vous raison, mais qu'aurait été le british Blues si Muddy Waters était resté coincé par les caprices d'un cruel destin dans le delta toute sa vie ? L'est sûr qu'avec des « si » l'on mettrait toute l'eau du Mississippi en une seule bouteille, mais je crains qu'il n'en aurait que plus vite crevé cette digue de verre. Le titre américain pour être moins accrocheur n'en est pas moins très allusif : Can't Be Satisfied, The Life and Times of Muddy Waters : pour les petits français l'éditeur Rivage Rouge a préféré souligner au feutre rouge la parenté évidente.

Robert Gordon – vous ne confondrez pas avec son homonyme le chanteur qui participa au renouveau du rockabilly dans les années 80, notamment en enregistrant avec Link Wray – est un écrivain ami de Peter Guralnick - duquel nous avons chroniqué, entre autres, les deux volumes sur le blues et le country parus dans la même collection Rivage Rouge - a beaucoup écrit sur Elvis Presley et la musique sortie du chaudron bouillonnant de Memphis, tant au niveau du rockabilly que de la soul. L'était temps que son Muddy Waters sorti en 2002 aux Etats-Unis soit enfin traduit en français en ce millésime finissant de 2014.

MUDDY WATERS
A priori Muddy Waters, l'on connaît. Facile à ranger. Rayon blues, deuxième tiroir. Chicagoan blues. Electrifié à mort. Juste au-dessus du premier casier, blues rural. Le titre est assez éloquent : du delta à Chicago. Merci à la géographie qui nous permet de visualiser les deux endroits mythiques avec précision. Plusieurs milliers de kilomètres entre les deux. Il est impossible de prétendre imiter l'éléphant qui se trompe. Hélas les apparences sont trompeuses. Les novateurs ne sont souvent que des héritiers. Il n'est pas difficile de démêler l'écheveau des fils entremêlés. Robert Gordon n'a pas connu Muddy Waters, c'est un livre basé sur les témoignages en quelque sorte de seconde main de ceux qui ont peu ou prou côtoyé le musicien, d'autre part Muddy n'était qu'un pauvre noir, l'on se souciait peu, en ses époques de grande ségrégation, d'amasser des documents sur ce genre de citoyen de troisième zone. Les noirs étaient alors considérés à la façon des intouchables. Devaient se faire oublier. S'écraser, s'applatir, ne pas parler haut ni chanter trop fort. Même si la symbolique noirceur de leurs visages crevaient la neige de l'écran du réel. Le bon nègre était invisible, inodore et inaudible. Par contre, disponible dans les parages immédiats afin, de répondre sans hésitation à tout besoin de réquisition. L'on se souvient de la surprise des Stones, en visite dans les locaux Chess, lors de leur premier voyage aux USA, s'apercevant que l'ouvrier qui était en train de repeindre le plafond n'était autre que leur idole : Muddy Waters. L'anecdote répandue par l'escogriffe Keith, visiblement sous produit, est sujette à caution, mais si signifiante !
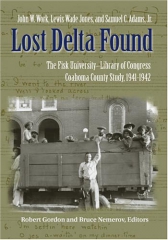
Mais Robert Gordon en rajoute une couche. Plutôt du noir que du blanc. Le livre s'ouvre par la scène qui permettra à Muddy Waters de faire décoller sa carrière. Alan Lomax, le mythique Alan Lomax ( voir notre kronic 119 du 22 / 11 / 12 ) qui s'en vient, alerté par la rumeur publique, enregistrer ce chanteur de blues inconnu dont il ignorait tout avant que son nom ne revienne systématiquement sur les lèvres de ses semblables. Lomax le sauveur, l'archange justicier qui grâce à ses pérégrinations dans le Sud a permis de conserver nombre d'enregistrements d'inconnus dont le souvenir de l'existence serait définitivement perdu aujourd'hui, s'il n'avait effectué cet inouï travail de collectage au travers des états du delta... Lomax a lié bien des amitiés avec des bluesmen, pourtant il ne serait jamais arrivé, à cause de l'étroite surveillance des police locales, à entrer en contact avec la communauté noire, de surcroît par instinct méfiante, sans JoHn Work ce professeur de l'université noire de Memphis qui lui sert de caution introductive colorée et qui en théorie partage à égalité la réalisation du projet. Lomax le traite de haut, ne le citera qu'une seule fois en cinq cents pages, tel un personnage secondaire, anecdotique et superfétatoire. La gloire ne retiendra qu'un seul nom sur son carnet... Indécrottable mentalité paternaliste de la suffisance blanche !
VIE POURRIE

Au vu des canons de l'époque Muddy Waters n'a pas eu à se plaindre. L'aurait plutôt été gâté par la vie. Le père planta la graine et disparut... La mère s'en fut à Stovall. Le jeune McKinley Morganfield y retrouvera un oncle, des cousins, sa grand-mère. Une grande plantation de treize cents hectares. C'était un bon choix. Le travail était dur, mais le patron, le Colonel Stovall, veillait à ce que ses métayers puissent manger tous les jours. Cela nous semble un minimum vital, dans beaucoup d'autres endroits ce n'était pas le cas, les ardoises au magasin local se devaient de ne pas dépasser le prix de vos futurs bénéfices réalisés sur la prochaine récolte de coton... La corde au cou du pendu pour la vie...

Enfant, il trainait dans les eaux des marécages, d'où le boueux surnom de Muddy qui lui fut attribué. Devint un jeune gars costaud et débrouillard. Capable de bosser sans rechigner dans les champs de coton toute la journée et d'être encore plein d'énergie une fois le soleil couché. Sut très vite s'y faire avec les filles, trafique de l'alcool clandestin. Mais l'essentiel est ailleurs. A commencé comme tous les gamins à se fabriquer une guitare à partir d'une boîte comme caisse de résonance. Le blues est là. Il ne le quittera blues jamais de sa vie.
COUNTRY BLUES
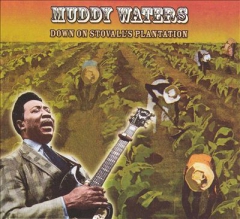
Muddy Waters les a tous rencontrés. Un jour ou l'autre sa route a croisé celle d'un Son House ou d'un Charley Patton. Immergé dans le rural blues jusqu'à plus soif. Regarde, admire, pique quelques plans, est subjugué. N'en prend pas pour autant la route. Tourne dans les bals de campagne et les juke joints perdus mais il ne s'envole pas plus loin que son ère naturelle d'habitation. Connaît ses limites psychiques et musicales. N'est qu'un pauvre noir illettré. La ville lui fait peur. L'est devenu le seul soutien financier de sa grand-mère. Puis ce Robert Johnson sur qui il tombe un jour par hasard. Un attroupement s'est formé. Muddy se retrouve au premier rang. Mais il n'y reste pas. S'enfuit, traverse la masse agglutinée autour de l'aède. Ce type joue trop bien de la guitare. L'est déjà tout ce qu'il n'est pas encore. Une légende vivante.
Mais l'on n'échappe à Robert Johnson. Si vous refusez d'aller à lui, c'est lui qui vient à vous. Depuis sa tombe. Entre chez vous sans prévenir. Je ne vous roule pas dans la farine. L'émission King Biscuit Time sur la radio KFFA – crée en 1941, spécialement conçue pour capter le public noir – diffuse le blues, pour la première fois sur toute l'étendue du delta. Elle est menée de main de maîtres par Sonny Boy Willamson II, Rice Miller, et Robert Lockwood Junior. Ce dernier fut le beau-fils de Robert Johnson et reçut des leçons de guitare de son beau-père... Le monde du blues est plus petit qu'on ne le croit.
Muddy Water fut invité à venir jouer en direct à King Biscuit Time, sa popularité en fut accrue, mais il a compris qu'en stagnant à Stovall, il resterait jusqu'à la fin de sa vie un second couteau. Le delta n'est plus le seul réceptacle du blues. Le centre de gravité du blues s'est déplacé à Chicago.
CHICAGO
Ce n'est pas un hasard. C'est à Chicago que les noirs du Sud profond émigrent en masse. Les salaires y sont deux fois plus élevés que dans le delta qui subit sa révolution agraire imposée par la mécanisation intensive. Un tracteur remplace avantageusement une cinquantaine d'ouvriers... Dans la grande ville industrielle, le racisme revêt aussi une apparence moins frontale, moins humiliante.
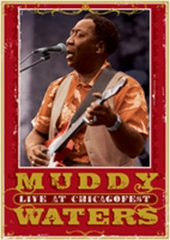
Mais à Chicago, Muddy Waters n'est qu'un parfait inconnu. C'est dans la ville des abattoirs géants qu'il va bouffer – artistiquement parlant – de la vache enragée. Personne ne l'attend. Dans les bars et les salles de spectacle, les bonnes places sont prises depuis longtemps. L'on y joue un blues rapide, carré, peu émotionnel, lisse et superficiel... La musique émotive chargée des angoisses et des brûlures du delta que joue Muddy rappelle trop de mauvais souvenirs à une population qui veut oublier ses racines serviles et s'enivrer de cette factice liberté qui lui paraît une pure merveille... Tout nouveau, tout beau.
Muddy travaille dur toute la journée, c'est le soir et la nuit qu'il sacrifie aux démons du blues. Un combo se réunit autour de lui. Rencontre un double de lui-même au parcours étrangement similaire, le guitariste Jimmy Rogers. L'a déjà frayé avec des pointures comme Bukka White et Robert Lookwood, un véritable musicien qui saura rester en retrait, à Muddy les glissandi en chute libre au bottleneck, lui par derrière il ouvre les parachutes harmoniques au bon moment. Blue Smithy arrive à point nommé, une espèce de pionnier de la guitare électrique, une oreille sur Charlie Christian et la deuxième tendue vers Arthur Crudup – celui-là même dont le jeune Elvis reprendra le That's All Right ( Mama ) – un technicien hors pair capable non pas de régler tous les problèmes que doit affronter un guitariste, mais de proposer une solution et surtout d'expliquer le surgissement de toute problématique... Apportera sa précieuse expérience à Muddy Waters qui vient d'abandonner la guitare acoustique typique du delta blues au profit d'une électrique qui deviendra l'instrument emblématique de ce city blues qu'il est en train, avec quelques autres, de mettre au point. Refus d'une virtuosité jazzistique au profit d'une plus grande violence, d'une plus grande force. Ne pas se perdre dans de stériles exhibitions, transmuer le feu rampant du delta en incendie identitaire. Désormais le serpent endormi du blues dans la moiteur étouffante du Sud relèvera la tête à la moindre approche. Blue Smity qui ne fera pas partie de la formation régulière de Muddy aura été un parfait initiateur.
Muddy participe à ses premières sessions d'enregistrement en tant que musicien accompagnateur. Pour la seconde il n'osera jouer en slide. Ce n'est pas dans l'air du temps. Cela rappellerait trop les origines paysannes d'une musique qui se veut moderne. Quitte à y perdre son âme.
L'ESSOR
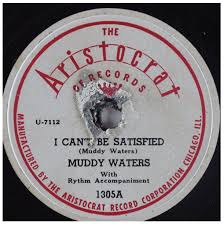
Muddy s'est acheté une voiture avec l'héritage de sa grand-mère qui vient de mourir. Avec Baby Face Leroy à la batterie le combo possède une assise rythmique incandescente. Leroy ne laisse jamais mourir l'ambiance. Mais c'est l'arrivée de Little Walter qui fera monter la mayonnaise. Un cheval fou de l'harmonica. Faudra que Muddy et Rogers lui apprennent à maîtriser sa fougue naturelle. L'est déjà un maestro mais a tout à apprendre. Toute sa vie il restera un étalon indomptable. Sont désormais le groupe attitré du Zanzibar, bar reconnu pour la qualité de ses prestations. Muddy y restera de 1946 à 1954. L'ambiance est survoltée, l'écoute est loin d'être religieuse, les bagarres sont fréquentes, l'alcool coule à flots mais les amplis des musicos recouvrent le tapage.
Avoir un bar, une boîte de nuit, est un moyen de s'enrichir. La famille Chess des juifs venus d'Europe de l'Est l'ont vite compris. Les deux fils, Phil et Leonard secondent leur père avec intelligence. De redoutables organisateurs qui gagnent suffisamment d'argent pour être un jour en mesure de penser à l'investir. Se décideront pour Aristocrat une mini compagnie de disques locale qui marche bien et dont ils deviennent les principaux actionnaires. Aristocrat n'enregistre que de la musique blanche mais les frères Chess sont des pragmatiques. Ils côtoient dans leur boîte de nuit des tas de groupes noirs qui ne demandent qu'à être enregistrés... quand la matière première est abondante, pas chère et disponible et que vous possédez l'industrie de transformation adéquate, faudrait être idiots pour ne pas tenter sa chance. Mais Phil et Leonard sont prudents, inutile de produire du tout venant, autant chercher la qualité et la nouveauté. Sommy Golderg le talent-scout noir embauché par les frères Chess ne tarde pas à entrer en contact avec Muddy Waters qui au pied levé se voit demander de montrer ce qu'il sait faire sur une guitare. Pour la petite histoire la démonstration se fera sur la guitare de Lonnie Johnson.

Premier enregistrement abracadabrant Muddy choppé en son boulot se retrouve seul au studio avec les musiciens maisons de Sunny Land Slim avec qui il avait déjà jammé. Leonard qui n'y connaît pas grand-chose en country blues – ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques idées sur son évolution citadine - impose la mise en avant du pianiste au détriment de la guitare de Muddy. Le single qui sortira en avril 1948 n'est pas un chef d'oeuvre mais Gipsy Woman et Little Anna Mae suffiront à attirer l'attention des amateurs sur Muddy.
Pour sa deuxième session, Muddy impose sa guitare, Leonard ne comprend pas, I can't be Satisfied ne le satisfait pas du tout et quant Feel Like Goin' Home il le renverrait bien chez lui, mais c'est une femme qui sauve la situation, Evelyn Aron, l'associée des frères Chess pousse à la roue. Le disque sort du jour au lendemain, et le tirage est épuisé le soir même... Le disque percute, sera un catalyseur pour B.B. King encore dans sa ferme et un magnifique accélérateur de la carrière de Muddy, désormais lui et son band sont demandés par tous les clubs, et partageront la tête d'affiche avec les stars reconnues comme Big Bill Bronzy et Memphis Minnie.
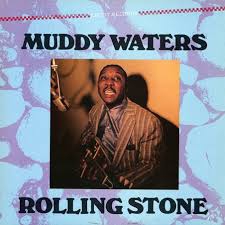
Leonard n'attachant pas ses dollars avec des saucisses, Muddy et son groupe font des extra sur de petits labels... Mais Muddy tient à sa revanche sur le destin. Une tournée dans le delta qui passe obligatoirement par Stovall où il est reçu avec tous les honneurs. Enregistre tous les jours pour King Biscuit Time et donne une session historique de huit morceaux pour le label Parkway. C'est là qu'il enregistre pour la première fois Rumblin' and Tumblin'. Que Chess se dépêchera de lui refaire réenregistrer avec un autre morceau appelé à devenir célèbre, un certain Rollin Stone...
LES ANNEES FASTES

Entre 1951 et 1955 le groupe de Muddy se trouve à l'épicentre du blues. Les musiciens vont et viennent; Otis Spann apporte son piano, Junior Wells remplace Little Walter qui entame en solitaire une carrière météorique, mais la place de l'harmoniciste reviendra finalement à James Cotton. Muddy ne retient pas ses musiciens et les laisse tenter leur chance ailleurs, c'est la rançon de la gloire.

Muddy acquiert une maison qui devient un centre névralgique du blues, loue des chambres à ses musiciens qui jamment sur de nouveaux morceaux... que Muddy finit par signer. Agit comme Willie Dixon, monstrueux contrebassiste qui recycle sous son propre nom le répertoire du vieux Sud... Pratique courante, la débrouille individuelle flirte sans cesse avec une certaine malhonnêteté intellectuelle du droit d'appropriation.

C'est la saison des morceaux d'anthologie, le Such A Fool, le Hoochie Coochie Man, le Manish Boy, tous ces titres qui mettent en avant la sexualité accaparatrice de Muddy qui ne se gêne jamais pour sauter sur la femme des autres. Il a la bite conquérante et un comportement que les ligues féministes jugeraient machiste. Mais Muddy est toujours prêt pour le bon temps. Ce blues ardent colle parfaitement à la nouvelle sensibilité noire qui s'installe in the black communauty. Rien de révolutionnaire, peu de revendication sociale, mais la fierté revendiquée de personnalités qui prennent conscience de leur droit au bonheur.
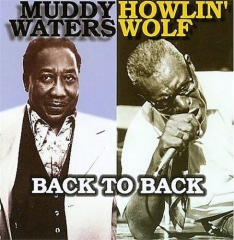
C'est de Memphis et d'un certain Sam Phillips que proviendra le premier concurrent de Muddy, le redoutable Howlin' Wolf, dont Leonard Chess rachètera le contrat aux disques Sun. Il y avait de la place pour deux à Chicago mais l'égo d'Howlin' ne supportera pas le succès de Muddy. Le monde est en train de changer et Muddy ne s'en aperçoit pas. Le danger ne vient pas du loup ombrageux mais de ce qui est en train de se concocter dans les marmites noires de Sun et aussi avec un certain Bo Diddley. Le blues électrifié de Muddy Waters qui commence à mordre sur le public blanc est en train de faire un bâtard dans le dos de la musique, il s'appellera le rock and roll.

LE TROU BLEU
Les années suivantes furent décevantes pour le blues en général et Muddy Waters en particulier. Chess mise tout sur un nouveau venu qui était venu le voir sur la recommandation de Muddy lui-même. Lorsque Chess vendait 50 000 exemplaires d'un disque de blues c'était un super succès. Mais titres de Chuck Berry se comptaient en centaines de mille. Le rock accapara les premières places. Tout allait trop vite pour Muddy surtout les guitares rock. Durant deux ans il n'osa plus en jouer sur scène. Dut embaucher un autre guitariste Pat Hare car Rogers le quitta aussi. Se contenta de chanter dans les clubs de Chicago qui bradaient les prix d'entrée...
Faute de mieux et en désespoir de cause il accepta de partir en tournée en Angleterre. Autant dire pour une planète inconnue. L'invraisemblable se produisit, les salles étaient pleines, des passionnés de blues envahissaient les coulisses afin de lui poser des questions de spécialistes en mal d'infos. Muddy et Otis Spann jouaient avec Chris Baker, pionnier émérite du blues anglais. C'est au sortir d'un de ces shows qu'Eric Burdon décida de former les Animals...
RICOCHETS MULTIPLES
Si the white british people avait plébiscité Muddy, pourquoi les américains ne feraient-ils pas de même ? C'est au festival de jazz de Newport que la consécration eut lieu. Le public folk formé d'intellos et d'étudiants réservèrent un accueil enthousiaste à John Lee Hooker et Otis Spann. Mais Muddy Waters fit éclater toutes les barrières. Muddy apportait sur un plateau les salaces cochonneries que tous les intellectuels rêvent de faire sans oser l'avouer publiquement. Muddy agita son mojo frénétiquement, sans équivoque sur un fond d'électricité crépitante.
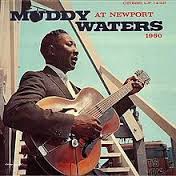
Aux States, le jeune public noir délaisse le blues lui préférant la soul. Muddy compense cette désaffection par l'arrivée de plus en plus nombreuse de jeunes blancs. Le milieu folk se passionne pour le premier Waters, celui des premiers enregistrements réalisés à Stovall par Lomax et les premières pistes chez Chess. L'on recherche la pureté originelle du blues. Ce qui ne rentre pas dans les vues de Leonard décidé d'atteindre encore une fraction plus importante du public blanc en rajoutant une section de cuivres sur ce qui deviendra la partie la plus mauvaise de la discographie de l'artiste.

A chacun son Muddy Waters. Ce qui paraît le plus important c'est ce surgissement d'un blues blanc américain autour du musicien Paul Butterfield. Ce qui amènera Marshall le fils de Leonard à faire enregistrer Electric Mud, un disque rempli de pédale wha-wha destiné aux oreilles des hippies. Descendu par la critique l'album qui était bien parti n'ira plus bien loin. D'autres essais suivront, mieux réussis comme celui enregistré avec Paul Butterfield. Mais les coups durs viennent toujours d'où on les attend pas. Leonard ne sait refuser les six millions et demi de rachat de la compagnie Chess offerts par GRT, il désire investir dans le cinéma. Les Black Panthers ne sont pas étrangers à ce choix. Pressions discrètes mais ils misent davantage sur le film que sur le vieux blues pour sensibiliser les black people... Leonard ne verra pas son projet se concrétiser. Une crise cardiaque l'emporte à cinquante deux ans. Phil est débarqué de la compagnie, Marshall reste en place mais GRT malgré toutes ses promesses de continuation entreprend de gérer l'entreprise comme des comptables plus soucieux de profits que de musique...
Le groupe achève sa tournée lorsqu'une voiture percute le véhicule des musiciens. Deux morts, deux blessés graves Muddy passera trois mois à l'hôpital...
TIL THE END
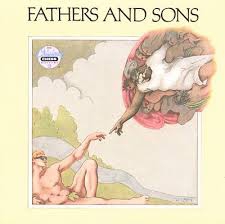
Le vieux lion se relèvera. C'est un petit homme mais un grand monsieur qui viendra tirer Muddy de la panade. S'appelle Scott Cameron et restera avec le vétéran jusqu'à la fin. Scott changera de braquet. Fini les concerts dans les clubs miteux du bas Chicago. Beaux hôtels et grandes salles. Scott l'emmène en Angleterre pour les London Sessions ( 1971 ) qui relanceront sa carrière. Muddy bénéficie de la reconnaissance et de l'estime de bien de jeunes musiciens blancs qui ont appris à jouer sur ses disques. Scott lui met les points sur les I en lui expliquant les malhonnêtes contrats que les nouveaux patrons d'Arc la maison d'édition de Chess lui ont fait signer... En 1975, Muddy profite du fait que RTS revende la compagnie pour s'en aller.
Sa carrière remonte la pente, Muddy s'occupe de sa vie d'homme. Sa femme morte il se préoccupe des enfants naturels qu'il a semés de ci, de là, les adopte et les fait venir chez lui. La cohabitation avec sa progéniture officielle tourne parfois à l'aigre. Muddy donne l'impression de régler le passif d'une vie dissolue... Des regrets qui selon les principaux intéressés viennent un peu tard...
Mais le plus beau reste à venir. Hard Again enregistré avec son groupe sous la houlette de Johnny Winter. Dix ans, nous sommes en 1975, que Muddy n'a pas sonné aussi fort. Winter a su respecter le vieux maître en le poussant dans ses retranchements. C'est le chant du cygne. Ce qui suivra sera de qualité mais pas du même tonneau. Quelques tournées, le groupe toujours aussi mal payé alors que l'argent coule à flots le quitte. Muddy le remplace illico... Les récompenses affluent, le président Carter l'invite à la Maison Blanche, les Grammies Awards pleuvent... Mais c'est déjà la fin. Atteint d'un cancer des poumons Muddy s'éteint doucement chez lui le 30 avril 1983. Une page de la musique moderne se tourne...
UN BEAU BOOK

Rempli jusqu'à la gueule d'anecdotes et de renseignements. Ne vous contentez pas des notes de bas de page, il y en a près de deux cents feuillets, relégués après les appendices. Robert Gordon cite ses sources en recopiant des pleines feuilles de témoignages. Petit défaut, c'est sans doute l'aspect musical de l'oeuvre qui est un peu laissé dans les marges. Mais vous vous en moquez, vous avez tout Muddy Waters dans votre discothèque personnelle.
Damie Chad.
LITTLE RICHARD
SELECTED SINGLES 51 – 56

TAXI BLUES / EVERY HOUR / GET RICK QUICK / THINKIN' 'BOUT MY MOTHER / WHY DID YOU LEAVE ME ? / AIN'T NOTHIN' HAPPENIN' / I BROUGHT IT ALL ON MYSELF / PLEASE HAVE MERCY ON ME / ALWAYS / RICE, RED BEANS, AND TURNIP GREENS / DIRECTLY FROM MY HEART TO YOU / LITTLE RICHARD'S BOOGIE / I'M JUST A LONELY GUY / TUTTI FRUTTI / SLIPPIN' AND SLIDIN' / LONG TALL SALLY.
SAGA : ALL STARS SERIES. Record : NO. 984 061-0
Here's Little Richard est le premier album de Little Richard paru en 1957. M'a toujours estomaqué. Pas moins de six classiques du rock dessus : Tutti Frutti, Ready Teddy, Slipin' and Slidin', Long Tall Sally, Rip It Up, et Jenny Jenny. Proposez-mieux si vous pouvez. En plus le petit Richard cosigne cinq des six morceaux. Semental, comme disent les Espagnols pour désigner un étalon. Et en prime, se cachent deux petites merveilles, True Fine Mama et She's Got it, que j'adore.
En des âges lointains d'innocence rock and roll, on a longtemps cru que c'était les premiers morceaux enregistrés par Mister Penniman. N'en n'était rien. Entre 1951 et 1956, vingt-quatre titres furent pressés et commercialisés sous la forme de douze singles. Ce CD - l''ai trouvé l'année dernière en Espagne - Tutti Frutti, Selected Singles 51-56, en présente seize. En manquent dix qui aurait permis de posséder l'intégrale 51-56. Ne rêvons pas, l'eût été plus judicieux d'y inclure les deux seuls morceaux mis en boîte en l'an de grâce 1953 ( Ain't That Good News / Fool At The Wheel ) et ne mettre que les deux premières pistes gravées en mars 1956. Mais chez Saga l'on ne vise pas à l'exhaustivité. L'on préfère consacrer un CD ( voire un double ) à chaque grande figure du jazz, du blues et du rock. L'on y mêle grands succès et titres plus rares, pour attirer autant le grand public que l'amateur éclairé.
Méchamment instructif. Le king du rock and roll n'a pas commencé par des rocks torrides à se jeter par la fenêtre. Les titres rapides ne sonnent pas comme du rock. Même pas du proto-rock. Sont les derniers rejetons du swing, un peu malingres et décadents. La voix de Richard en est la principale cause, ne rebondit pas comme une balle de ping-pong selon les courbes de l'orchestration, a été taillée trop grande. Ecrase tout. L'éléphant qui se sent de trop dans la cage de l'ours. Quand il s'essaie à imiter Louis Jordan, prend une voix fluette comme si son gosier s'était brusquement rétréci.
La majorité des titres proposés sont des morceaux lents. Ça la fout un peu mal pour un futur prince du rock. Tout de suite s'insinue l'insidieuse question. Pourquoi flirter de si loin avec le blues ? Qui croira que Little Richard n'avait pas assez de feeling pour chanter le blues ? Prenez par exemple le début de Why did You Leave Me ? C'est presque aussi beau que de l'Eric Burdon, mais ensuite vous pataugez dans un passage qui fleure pas bon l'eau de rose et vous terminez sur une bluette à la Platters. A croire que déjà à l'époque l'on visait le tendre coeur d'artichaut des ménagères de plus de quarante ans.
Ce flirt quasi variétoche nous pourfend l'âme. L'on essaie d'accuser des arrière-fonds de tonneau jazz pas nettoyés, mais c'est une fausse piste. Peut essayer de nous égarer le smallito Richardo avec sa voix de femme larmoyante sur cette parodie de blues qu'est Please Have Mercy On Me. Pour un peu on en chialerait d'émotion si ce n'était ce saxophone qui tirebouchonne dans les coins. Always nous révèle le pot aux roses, cela ne vient pas du blues, ça provient du gospel, d'un côté le tourment et le désespoir du pauvre pêcheur et de l'autre les mamas qui font les jolies chœurs pour vous soutenir le moral. Après l'office la fièvre du samedi soir. Mais faut tout de même se taper l'harmonium sur Rice, Red Plans and Turnip Greens.
L'on arrive vers la fin du disque. Little Richard trouve enfin la porte de sortie. Le boogie-woogie, tout est là le swing se métamorphose en balancement, et les choeurs masculins ont manifestement écouté Bill Haley. Un petit faux pas de Johnny qui se paye un petit solo de vibraphone bon à jeter à la poubelle mais furieusement à la mode à l'époque. I'm Just A Lonely Guy, un slow mais Richard a compris, on ne chantonne pas pour séduire les filles, on crie et on leur gueule dessus pour qu'elles comprennent vite qui est le patron.
Qui en douterait après avoir écouté les trois deniers morceaux ? Métamorphose accomplie. A rock and roll king est né. Total respect.
Damie Chad.
22:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/12/2014
KR'TNT ! ¤ 212. ROBERT THROB YOUNG / TYLER HART TRIO / MISS VICTORIA CROWN / REBEL RIDERS / CORRUPTED / BLUE TEARS TRIO / KEITH RICHARDS
KR'TNT ! ¤ 212
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
04 / 12 / 2014
|
ROBERT THROB YOUNG / TYLER HART TRIO MISS VICTORIA CROWN / REBEL RIDERS CORRUPTED / BLUE TEARS TRIO / KEITH RICHARDS |
THROB SE DEROBE

Oh mince ! Throb est mort ! Terminé pour Primal Scream. D’ailleurs, c’est terminé depuis un moment, puisque Throb avait quitté le groupe en 2006. La fin des haricots primaires ne date donc pas d’hier.
On l’avait repéré sur les photos du groupe. Ce n’est pas Bobby Gillespie qu’on regardait, mais Robert Young dit Throb. De la même façon qu’on ne voyait que Brian Jones sur les photos des Stones. Ce mec avait beaucoup d’allure, avec sa crinière brune, son expression évaporée et son pantalon de cuir. En tous les cas, son allure en imposait beaucoup plus que celle de Bobby Gillespie qui a toujours eu l’air d’un gamin, celui qu’on voyait jouer de la batterie debout derrière les frères Reid.
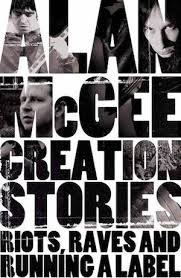
Dans «Creation Stories», le livre de souvenirs d’Alan McGee, on trouve des choses intéressantes sur Throb et Primal Scream qui furent un temps les figures de proue du label Creation. «He was the heart-thob of the band. Even then, he may have got his confidence from his physical attributes». Pour McGee, Throb était le cœur battant du groupe et vu qu’il était monté comme un âne, McGee en déduisait que sa virilité lui donnait une certaine assurance. Il est vrai que Bobby et McGee n’étaient pas jojo quand ils étaient jeunes, alors que Throb bénéficiait déjà du prestige d’un vrai mâle. On a tous connu ça dans nos petites bandes de gamins : il y avait celui qu’on admirait parce qu’il avait déjà de la moustache et qu’il pouvait baiser une fille plusieurs fois de suite. Le détail anatomique que donne McGee n’a l’air de rien, comme ça, mais dans l’histoire du rock, on le croise à tous les coins de rues. Voilà l’exemple le plus connu : conseillé par Kim Fowley, PJ Proby clama sur tous les toits de Londres que sa bite était plus grosse que celle de Jagger. Ça fit sensation et Jagger le prit très mal. Autre exemple : pour couper court à certaines rumeurs malveillantes, Keith Richards prétendait dans ses interviews qu’il pouvait être un hard-fucker quand il le fallait. On sait aussi que les Plaster Casters de Chicago furent ébahies par les mensurations d’Eric Burdon et que la chambre d’hôtel de Jimi Hendrix ne désemplissait pas. Jimi consommait les filles par paires, blanches et blondes de préférence. Le sexe est l’essence même du rock. Et curieusement, les récits les plus prudes sont ceux des groupies de renom, du type Pamela Des Barres dont les trois livres font bâiller aux corneilles, comme d’ailleurs celui de Sharon Sheeley, la fameuse «fiancée» d’Eddie Cochran. Sharon est aussi asexuée que Pamela. Elle raconte par exemple qu’elle parvint à s’introduire - avec sa sœur - dans la chambre d’hôtel d’Elvis pour y entretenir une relation de copinage avancé. Exploit qu’elle renouvela avec Don Everly, Ricky Nelson et Eddie. Voyez ce qu’en disait l’intraitable Damie Chad dans sa chronique du 15 mars 2012.
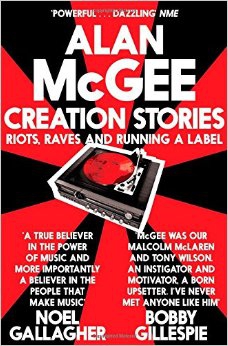
L’autre point capital que développe McGee dans son livre, c’est la carrure de Throb qui était celle d’une vraie rock star. Il évoque l’épisode «Screamadelica» et la vague acid-house qui ravagea l’Angleterre en 1990 : «Robert Young, the degenerate rocker, hated it. Really hated it. I understand why - they were about to record a classic two Les Paul rock and roll album. He was the happiest he’d been with his role in the band since it had started. He wanted Primal Scream to be the New York Dolls and didn’t need acid house interfering with that.» Effectivement, Thob a détesté les machines. Il voulait sonner comme les Dolls et enregistrer du rock à deux guitares, alors forcément, la house ne pouvait pas lui plaire. Et d’ailleurs, «Screamadelica» a dérouté pas mal de fans, même si l’album connut en Angleterre un énorme succès commercial. C’est justement là le problème. On avait l’impression à l’époque qu’ils vendaient leur cul. Jamais les Cramps ni les Ramones ne se seraient prêtés à un tel jeu. Dans l’opération «Screamadelica», les Primal Scream perdirent toute leur crédibilité. Rien n’est pire qu’un groupe qui comme une girouette tourne aux quatre vents. McGee raconte que pendant l’enregistrement de «Screamadelica», Throb menaçait de quitter le groupe. Forcément, dans le son du groupe, les machines avaient remplacé les guitares. Primal Scream n’était plus un groupe de rock‘n’roll. Ils étaient devenus de simples opportunistes. Quel gâchis ! Les débuts de Primal Scream semblaient pourtant prometteurs.

«Sonic Flower Groove» se présentait sous les meilleurs auspices puisque Throb et Bobby avaient fait appel à Mayo Thompson (ex Red Krayola) pour le produire et à Pat Collier (ex Vibrators) pour l’enregistrer. On était alors en plein dans le phénomène Paisley Underground et les Écossais s’y prélassaient, portant des chemises à pois, des pantalons de cuir et ils rêvaient de sonner comme les Byrds, sauf qu’ils n’étaient pas les Byrds. Ils proposaient une petite pop mal chantouillée et grattaient des arpèges douceâtres. On sentait dans ce disque l’adolescent boutonneux et l’érudition de magazine. Un cut comme «Silent Spring» était atrocement fleur bleue. On surprenait ici et là une belle envolée au détour d’un couplet, mais l’illusion frappait par sa brièveté. On avait l’impression d’entendre de la petite pop indie de vache maigre. Avec «Love You», ils spectorisaient, on sentait des velléités de grandeur incommensurable, mais cette belle tentative se noyait dans un océan de platitude et le malaise était d’autant plus fort qu’on croyait entendre les Mary Chain. C’était pompé, comme l’était «Leaves», qui sonnait aussi comme du Mary Chain. Il fallait attendre le dernier cut, «We Go Down Slowy Rising» pour renouer avec une sorte de balladif west-coast ambivalent, une sorte de belle pop lumineuse tournée vers le soleil. Ce disque retombait comme un soufflet. Dommage, car la pochette en imposait. Je n’eus d’ailleurs aucun mal à le revendre.

Throb passa de la basse à la guitare pour l’enregistrement de «Primal Scream», le second album paru en 1989. On y trouvait de jolies choses, notamment «Ivy Ivy Ivy», chargé de toute la puissance d’une power-pop d’excellence. Les deux guitaristes, Andrew Innes et Throb s’en donnaient à cœur joie. On avait là un hit flamboyant. La fête continuait avec «She Power», claqué aux accords secs. On comprenait que Throb n’était pas un plaisantin. Les Primal sortaient même de leur manche une belle stoogerie, «Gimme Gimme Teenage Head», pourrie de dynamiques fringantes et extatiques. Ces gens-là maîtrisaient bien la technique de la propulsion nucléaire. Ils reprenaient la formule Ivy Ivy pour bricoler un «Lone Star Girl» foncièrement inspiré - Oh oh oh Wendy ! - et on assistait alors à une fantastique explosion d’énergie. C’est avec cet album qu’ils devinrent des héros. Mais pas pour longtemps.

Vint le temps de «Screamadelica». L’album fit d’eux des stars en Angleterre, mais ce disque fut pour d’autres une véritable imposture. Ils l’attaquaient pourtant avec une belle pièce de Stonesy, «Movin’ On Up». Ils poussaient même le vice jusqu’à y réinjecter les chœurs de gospel de «You Can’t Always Get What You Want» et Throb y balançait un solo digne de Keith Richards. Mais après, ça dégénérait. Les cuts à la mormoille se succédaient mé-ca-ni-que-ment. Le groupe se ridiculisait. Pire encore : dans «Damaged», Bobby ne chantait pas si bien. Il affectait une voix qu’il n’avait pas. Arnaque suprême. Voilà ce qui arrive quand on demande à un batteur de chanter. Un cut comme «I’m Coming Down» montrait bien leur incapacité à composer. Et le pauvre Bobby chantait de plus en plus mal. Ce disque inepte fit un carton spectaculaire. Quand on ouvrait le NME, on pataugeait dans la bave des dithyrambes. On se demandait même à l’époque si les journalistes de rock anglais ne s’étaient pas livrés à l’un de leurs sports favoris : le cynisme.
On le sait, les Primal Scream ne bâtissaient pas leur réputation sur la qualité de leurs disques, mais sur leur consommation de drogues. Les photos de l’époque nous montrent le plus souvent le groupe titubant dans un joli brouillard druggy d’yeux mi-clos et de mèches de cheveux collées. Ces images fantastiques nous rappelaient évidemment celles du MC5 faites après un concert dans un backstage de Detroit. McGee explique que les Primal Scream rivalisaient ouvertement de débauche avec les Stones : «The Primals took drugs in a really obvious, Rolling Stones-madness way - champagne and cocaine and heroin.» Dans son récit, il entre dans les détails et décrit le passage du groupe à la freebase, une passion terrible à laquelle David Crosby s’adonna lui aussi et à laquelle il consacre un fascinant chapitre dans le premier tome de ses mémoires.

Même après le désastre de «Screamadelica», on a continué d’écouter les albums de Primal Scream. On espérait retrouver le fameux son des deux guitares des origines. Pour «Give Out But Don’t Give Up», McGee pensa bien faire en envoyant le groupe enregistrer à Memphis. Il voulait surtout les éloigner des dealers de Camden. Au moins, là-bas, ils allaient pouvoir décrocher de l’héro. Manque de pot, le premier type qu’ils rencontrèrent en arrivant à Memphis fut un chauffeur de taxi dealer de coke. McGee : «By the time I got there they were on the strongest coke I’d ever tried, perhaps the strongest coke known to mankind.» Quand McGee vint les rejoindre, il découvrit «la coke la plus forte du monde». Il raconte ensuite qu’il en sniffa une ou deux lignes et qu’il resta collé pendant trois jours contre un mur pour être bien certain que personne ne se glissait derrière lui. Comme les Primal passaient leur temps à s’envoyer en l’air et qu’ils ne produisaient plus rien, McGee les mit devant leurs responsabilités : «Clean up or ship out.» Ou bien vous vous désintoxiquez, ou bien vous disparaissez. «So they gave up heroin and became alcoholics». Ils décrochèrent de l’héro pour devenir alcooliques. Classique.
Au fond, c’est peut-être la raison pour laquelle on restait tellement attaché à ce groupe : ce goût prononcé pour l’autodestruction. «Give Out But Don’t Give Up» avait tout pour plaire : l’album fut enregistré au studio Ardent à Memphis par Tom Dowd (McGee affirme que Tom Dowd avait des problèmes d’audition, qu’il a planté la production et qu’il a fallu solliciter Drakoulias le vampire). Parmi les invités, on notait les noms de David Hood et de Jim Dickinson. Mais le résultat fut lamentable. «Rocks» fut le hit de ce malheureux album. Au moins, Throb y sauvait l’honneur en claquant de gros accords, soutenu par le blast des Memphis Horns. Le beat de «Rocks» était tellement lourd qu’il nous semblait entendre douze batteurs jouer ensemble. I faut d’ailleurs voir le clip vidéo de «Rocks», un clip joliment décadent pour lequel Bobby s’est maquillé comme une pute pré-pubère. «(I’m Gonna) Cry Myself Blind» avait une fois de plus quelque chose de déroutant : le pauvre Bobby chantait encore plus mal que Keith Richards. On tombait ensuite sur «Funky Jam» chanté par George Clinton. Comment l’amateur de rock pouvait-il s’y retrouver ? C’était impossible. On passait de «Rocks» à du mauvais funk. Encore plus atroce : «Big Jet Plane», un balladif mal chanté. Par contre, avec «Call On Me», ils revenaient à la stonesy. On y entendait Jim Dickinson pianoter et un gros solo de guitar god à l’Anglaise remontait le moral des troupes. Mais ce pauvre album était gangrené par de la mormoille suprême. Nouveau sentiment d’arnaque.

Mais impossible de décrocher. On s’est jeté sur «Vanishing Point» comme la vérole sur le bas-clergé quand il est arrivé dans les bacs en 1997. Quel souvenir en garde-t-on ? Celui d’avoir bâillé aux corneilles en l’écoutant. Écoutez «Get Duffy» et vous comprendrez. Ils ramenaient leurs fucking machines pour «Kowalski» et «Star». On ne trouvait pas la moindre trace de compo dans ce disque. Rien. Ils se raccrochaient une fois de plus aux Stones avec «Medication» - Get my prescription filled - comme diraient les Stones, et le morceau était soutenu au sableur, comme chez Ike Turner. On assistait épouvanté au retour des machines dans «Motorhead» qui forçait quand même la sympathie car Throb y bricolait un son touffu et assez excitant, mais le reste de l’album inspirait une sorte de pitié.

«XTRMNTR» paru en l’an 2000 bénéficiait d’un son très agressif. On sentait un sursaut, au moins dans un morceau : «Accelerator». On y retrouvait la trace de Throb et de sa violence écossaise. Ses parties de guitare y étaient diaboliques. Il n’existait alors rien d’aussi dévastateur. On entendait même les bons vieux c’mon, les guitares repartaient à l’attaque et poussaient le son dans ses retranchements. Les notes de guitare nettoyaient les tranchées comme des lance-flammes. Mais le reste de l’album virait à l’indus. Trop de machines. Une fois de plus, les Primal perdaient leur âme, car ils n’avaient pas la classe d’Alan Vega. Le morceau intéressant de l’album restera probablement «Blood Money» amené par une intro de basse de Mani, transfuge des Stone Roses. Ils rajoutaient par là-dessus des couches de trompettes et de bruitages, et ça ne tenait que par la bassline sourde et grondante. Et parce que Bobby ne chantait pas. Avec «MBV Arkestra», ils se prenaient carrément pour Sun Ra. Quel attrape-nigaud ! Les seuls qui soient habilités à jouer à ce petit jeu en Angleterre, ce sont les Spiritualized de Jason Pierce. Heureusement, les Primal finissaient sur une bonne note, avec «Shoot Speed/Kill Light», un shoot de mad psyché pris à la gorge par une basse agressive qu’on faisait monter en première ligne dans le mix sauvage. C’est là, dans ce genre de circonstances que les Primal exprimaient le mieux leur petit côté dopey m’as-tu-vu. Ils créaient une belle tension psychédélique et c’était d’autant plus étrange qu’elle semblait perdue à la fin d’un disque vertigineusement insipide.

On trouvait encore trop de machines sur «Evil Heat». On ne pouvait pas s’empêcher de penser que cette manie de recourir aux machines masquait un vide sidéral. Les Primal n’ont jamais réussi à composer un seul hit qui soit digne de ce nom, alors que leurs collègues d’écurie - les Boo Radleys, Teenage Fanclub ou Oasis - les enfilaient comme des perles. Avec «Detroit», ils revenaient à ce que les Anglais appellent les basics - back to the basics - et c’était d’autant plus réussi que Jim Reid chantait. D’évidence, «Rise» était un morceau sur-produit, chanté en traître et battu aux grelots sur la grosse caisse. On admirait cette belle science d’un son percé par les coups de guitare throbbiques. C’est à ce genre d’enfer sonique qu’on mesurait la grandeur de Throb, guitar-god de Glasgow. Il se tenait derrière le beat et Mani nous refaisait le coup de la basse métronomique. Le résultat était assez stupéfiant. Il se produisit avec ce morceau une sorte de miracle sonique. Dommage que Throb n’ait pu fixer le cap pour le groupe. L’idée de Dolls à l’Écossaise faisait rêver. «City» était une pure jute de rock anglais stoogée jusqu’à la moelle des os. Throb s’illustrait par des solos imparables. Nous nous trouvions donc enfin au cœur du mythe throbien. Ils firent aussi une version électro du vieux coucou de Lee Hazlewood, «Some Velvet Morning», montée sur le riff de Norman Greenbaum, mais les machines aseptisaient l’élan vital. Puis on assistait au grand retour des power-chords avec «Skull X». Back to the terrain de prédilection de Throb. C’était admirablement bien ficelé. Bobby chantait comme Dylan et Throb claquait son chordage à bras raccourcis. On atteignait là le sommet de l’art Primal. Ils se montraient enfin capables de pulser des dynamiques monstrueuses. Il arrive parfois qu’on se félicite d’avoir acheté un disque. Ce fut ici le cas.

«Riot City Blues» est probablement l’album le plus brillant de Primal Scream. C’est aussi le dernier album bénéficiant des services de Throb. Les Primal reviennent aux sources avec un rock classique extrêmement bien foutu, comme par exemple «Country Girl» qui a l’allure d’un hit dylanesque. Ils reviennent ensuite à la stonesy avec «Nitty Gritty». On y entend un joli solo pincé dans l’arrimage du power-chordage. C’est chanté aux chœurs et on goûte avec délectation le grand fourbi stonien d’accords glissés et claqués. On reste dans le solide et le bien envoyé avec «Suicide Sally & Johnny Guitar», rocké à l’os du jambon. Throb - ou Andrew Innes - y tire un solo comme on tire les vers d’un nez. Cette fois, Bobby chante bien, il aboie correctement ses awite, on sent l’homme d’âge mûr mal rasé avec des yeux humides d’interférences. Le son du groupe se veut carnassier. Throb y va de bon cœur. Il avait raison, le groupe n’a jamais été aussi bon que lorsqu’il tapait dans le rock classique à deux guitares. Pour lui, c’est une reconnaissance. Le groove de «When The Bomb Drops» se veut encore plus rampant. Les Primal retrouvent leurs vieux réflexes de mad psyché et nous embarquent pour une énorme virée au cœur des mille et une nuits de Damas ou d’ailleurs, mais quelle envolée ! Ils en remettent une deuxième giclée et provoquent une sorte d’explosion firmamentaire. Voilà ce qu’il faut bien appeler un voyage intersidéral d’essence rare. Avec «The 99th Floor», ils semblent renouer avec l’énergie du Dylan électrique de 66. Ils sortent le même genre de battage et Bobby chante ça à l’arrachage de glotte gluante. C’est joué serré, poussé dans le dos, c’est une belle horreur de cavalcade. Bobby se prend pour Joe Foster. Le résultat est une fois de plus explosif. Throb devait se sentir arrivé au paradis. Ils rendent ensuite un bel hommage aux Dolls avec «Dolls (Sweet Rock And Roll)», effrayant d’efficacité dévastatrice et bardé de chœurs dollsiens, comme par hasard.
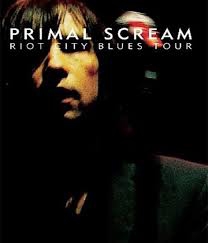
«Riot City Blues Tour» est paru en 2007 sur DVD. Un guitariste a remplacé Throb. Le seul intérêt de ce DVD se trouve dans les bonus : on y voit Throb jouer dans deux ou trois clips. Par contre, aucune trace de Throb dans «Black To Comm» - Primal Scream et MC5 - paru en 2011 sur DVD. Plus rien, vide, nettoyé.
Depuis que Throb est rentré dans l’ombre, deux nouveaux albums de Primal Scream sont arrivés dans les bacs des disquaires. Primal Scream sans Throb, ça n’a plus aucun sens. Comme dirait Bill Bocquet, que peut-on bien faire d’un groupe qui a perdu son âme ?
Signé : Cazengler, screamadelicoco
Disparu le 11 septembre 2014
Primal Scream. Sonic Flower Groove. Elevation Records 1987
Primal Scream. Primal Scream. Creation Records 1989
Primal Scream. Screamadelica. Creation Records 1991
Primal Scream. Give Out But Don’t Give Up. Creation Records 1994
Primal Scream. Vanishing Point. Creation Records 1997
Primal Scream. XTRMNTR. Creation Records 2000
Primal Scream. Evil Heat. Sony 2002
Primal Scream. Riot City Blues. Sony 2006
Primal Scream. Riot City Blues Tour. DVD 2007
Alan McGee. Creation Stories - Riots, Raves and Running A Label. Sidwick & Jackson 2013
ROCK IN GOMETZ-LE-CHATEL ( 2 )
TYLER HART TRIO / MISS VICTORIA CROWN
REBEL RIDERS
La teuf-teuf hésite. Reconnaissons-lui que Gometz-le-Chatel c'est moins connu que Memphis in the Tennessee. Suis sûr que là-bas elle me déposerait devant Graceland sans aucune hésitation après m'avoir promené tout mon soul sur Beale Street, mais ne rêvons pas, faut-il vraiment s'engager sous ce portique de ferraille qui barre la route ? Une voiture se positionne à ma hauteur, j'abaisse la vitre : « Le Centre Culturel Barbara ( le nom m'écorche la bouche, pourraient pas l'appeler Dickie Harrell par exemple, ce serait nettement plus classe ) c'est par ici ? ». Une dame au charmant sourire me répond : « C'est pour le rock ? Je crois bien, je suis déjà venue l'année dernière, mais dans le noir je ne reconnais pas ! » . Moi non plus, dans cette pénombre un cachalot blanc n'y retrouverait pas ses douze baleineaux. Mais voici qu'un troisième véhicule nous tire de l'incertitude, vu la coupe de la patache ce ne peut-être que des rockers. Z'étaient même à Toury la semaine dernière. Que voulez-vous les concerts rock attirent les rockers comme les chacals de Béthune la malédiction.

Personne ne s'attarde sur le parking. Une température idéale. Pour les ours blancs sur la banquise près du pôle Nord. Ouf ! dedans bien au chaud ! Je ne parle pas des radiateurs mais de l'ambiance et de l'accueil chaleureux des organisateurs. Je me précipite sur le stand de disques, impressionnante collection de 33 centimètres de Johnny Burnette, mais ma prunelle obstinée de lynx fureteur a déjà dégoté le 25 cm de Gene Vincent que je n'ai pas. Trop tard, une féminine main accaparatrice me prévient qu'elle vient juste d'exercer son droit de préemption. En lot de consolation, j'ai droit à un sourire et l'on me désigne deux autres merveilles de Gégène... que je possède déjà. Quand je m'évertue à vous dire que la société est mal faite, croyez-vous que j'exagère ? Pas la peine de vous mettre à pleurer non plus. Je vous en prie gardons notre dignité, surtout que le concert commence.
TYLER HART TRIO

Baptême du feu, c'est leur premier concert. Le public se rapproche. Suffit de quelques secondes pour couler un groupe quand on se présente devant un aréopage de connaisseurs. C'est toujours plus facile dans un rade perdu au bout de la nuit devant des clampins rassemblés là par le hasard et la nécessité des solitudes entrecroisées. Mais ici, le verdict sera sans appel. Ou un bloc compact vivement intéressé devant l'estrade, ou un délitement progressif vers le bar. L'on n'espère pas des miracles mais presque, un maximum syndical de qualité certifiée conforme et – c'est là le plus difficile – un minuscule démarquage qui fait toute la différence. Rassurez-vous, le Tyler Hart Trio a su séduire.

Trois sur scène, les deux frangins, l'aîné à la guitare, le puiné à la batterie, tous deux en chemise blanche et Oregon Jack tout de noir vêtu à la contrebasse. C'est maintenant, ou jamais. One, two, three et c'est parti. Vous vous attendiez à quoi ? Ne vous laissez pas induire en erreur par la cravate noire de Tyler. S'en débarrassera d'ailleurs très vite. Chic anglais d'apparence, mais le son grêle, rêche et rugueux qu'émet sa Gretsch nous emmène tout de suite en pleine campagne. Pas un hasard s'ils reprendront deux morceaux d'Hank Williams. Pas country carte postale pour un cent, mais salement hillbilly, le Tyler l'a dû encorder avec du fil de fer, même pas besoin de fermer les yeux pour voir les longhorns derrière avec les deux autres marlous qui font du rodéo sur leurs mustangs. C'est que caracole sec à ses côtés. C'est comme cela que les frères Perkins devaient sonner avant que Sam Phillips ne rajoute la réverb par dessus et les enjoigne de ne pas essayer de passer le Rubicon du rockabilly en force tant qu'il n'aurait pas effectué les réglages adéquats.

Eux, ils n'ont pas de temps à perdre. Tyler chante très prêt du micro comme s'il bouffait de la vache enragée, et les deux autres le suivent de prêt, ne le lâchent pas d'un centimètre ce qui nous donne de purs instants de plaisirs qui vous prennent à contrepied. Nous refont plusieurs fois le plan-séquence, fermeture des portes, non-non c'est encore ouvert, voix, guitare, contrebasse arrêtent de bosser, et blang ! blang ! la batterie rouvre le bal, brisure ponctuante qui s'inscrit tout en la dynamitant dans la parfaite continuité rythmique. Clôt la partie en le même temps qu'il la relance sur un tempo encore plus fougueux. Comme quand le chien saute sur le canapé ou vous êtes en train de folâtrer avec votre voisine. Vous ne l'attendiez pas, mais lui aussi amène son lot de caresses. C'est là que vous vous apercevez qu'ils sont trois à jouer, ensemble. Tristan le drummer se rappelle à tout instant à notre souvenir. Musicien à part entière qui intervient au même titre que les autres.

Jackie fait main basse sur sa contrebasse, faut voir comme il l'empoigne et la cogne. Mais c'est pour la bonne cause. Celle du Tyler Hart Trio. Sont unis comme les trois têtes de Cerbère devant la porte des Enfers. Pas de problème le public est prêt à les accompagner jusqu'au bout dans les territoires interdits. Ovation finale. Ils ont intérêt à continuer. Sont trois mais ils apportent un son neuf. A suivre.

MISS VICTORIA CROWN

L'était encore une petite fille lorsqu'elle avait surpris - agréablement - son monde, l'hiver dernier au New Morning lors de la fête de Rockers Kulture organisée par Tony Marlow. N'était déjà pas dans le créneau « enfant génial » qui ne mène généralement pas bien loin, mais elle a méchamment poussé depuis. Pas en taille, mais s'est transformée en demoiselle pleine d'assurance et d'ascendant. Simple et souveraine. Fière mais humble. Tranquille elle attend que les musiciens s'installent. Cette sérénité m'avait déjà étonnée au New Morning. Qu'elle le veuille ou non, c'est sur elle, sur ses frêles épaules, que repose le show. Et elle reste là, toute calme, dans sa longue robe noire à motifs rouges de princesse. L'est au centre. A sa droite, Cyril debout devant sa caisse claire et ses ses cymbales, et Vincent à la guitare électro-acoustique. De l'autre côté c'est le clan des rockers, Little Nico à la guitare électrique et Zio qui se hâte de brancher sa contrebasse, reconnaissable entre mille avec sa photo géante de Marlon Brando dans L'Equipée Sauvage.

Un dernier regard pour s'assurer que tout est en place, et sa voix s'envole pour ne plus jamais se reposer. L'est comme ses oiseaux migrateurs qui traversent les océans ne prenant de repos que dans la quiétude de leur envol. Sacrée technique. Attaque le mot de haut, tel un aigle qui s'abat sur sa proie. Facile au début d'un vers ou d'un couplet, mais c'est chaque vocable qui est ainsi mis en valeur. Essayez en parlant sur une simple phrase et vous verrez la difficulté. L'a beaucoup écouté Imelda May, sa façon de se précipiter sur la prime syllabe, de la maintenir en l'air, sans jamais laisser tomber ou avaler les suivantes. Infatigable. D'autant plus que ce soir, aucun cuivre n'est là pour lui permettre de respirer le temps d'un tortueux solo. Du coup un concert qui sonne beaucoup plus rockab que swing.

Autour d'elle les musiciens s'en donnent à coeur joie. Longtemps que je n'avais vu Zio si heureux. L'a pris vingt ans de moins. D'abord il sourit, ensuite il vous tape de ses accords sauvages comme l'on chiquenaude la croupe d'un étalon pour le faire démarrer encore plus vite, slappin' and slidin' avec la fougue de Little Richard. Si vous rajoutez Cyril qui semble avoir entamé une course de vitesse avec ses cymbales, vous commencez à vous inquiéter pour la petite reine. Inutile, peuvent battre des ailes tant qu'ils veulent, elle là-haut, elle gazouille avec les anges. Pas des saintes-nitouches, sûr qu'ils ont aussi laissé traîner leurs ailes dans les travées de l'enfer, car la demoiselle rien ne l'effraie. Se joue des difficultés, le timbre malicieux quand il faut charmer et la flambée d'énergie pure lorsqu'il s'avère de remettre de l'ordre dans le paddock. Le sourire enjôleur et la morsure du serpent. Comptez trois demi-secondes entre chaque titre et elle est déjà à la fin du morceau. De Janis Martin à Edith Piaf en passant par Nancy Sinatra. J'ai failli m'évanouir quand j'ai aperçu la set-list qui traînait sur les planches. Quatre feuillets ! Pas étonnant qu'elle ait pu remplir les rappels sans problème.

Mais nous n'en sommes pas encore là. Little Nico, se tient derrière elle. La guitare en bandoulière et le riff en cascade. Quelques éclats de rire complice avec Zio, mais toute son attention sur Victoria. Servie sur un plateau. Aux petits soins. N'est pas difficile à contenter, tant qu'elle a un micro où lancer sa voix, elle est dans son élément. N'empêche que c'est plus facile quand on sait pouvoir compter sur l'orchestre et Nico vous brode de ses petits arrangements de toute finesse et de toute tendresse qui conforte l'impression d'aisance vocale si particulière de la damoiselle. C'est qu'il a fort à faire Nico, les trois autres ne donnent pas dans la romance sucrée, faut aussi qu'il tienne tête à la rythmique endiablée de Vincent qui pousse grand-vent. Beaucoup de teddies dans l'assistance, des gars qui ne se contentent pas de demi-mesure. Pour eux le rockab commence aux quarantièmes rugissants, aussi ils n'aiment point trop l'eau tiède. Et personne ne se plaint ! Tout le monde en redemande. Miss Victoria Crown mérite bien sa couronne. Sa voix et ses quatre musicos déchaînés en sont ses plus beaux fleurons.

Premier concert en Île-de-France. La place-forte de Gometz-le-Chatel est tombée en deux heures. A qui le tour ?
REBEL RIDERS
Les Rebel Riders sont sur scène. C'est le nouveau groupe d'Andy Rebel, qui pour cause de santé défaillante avait dû arrêter la légendaire formation des Skyrockers. Toujours suivi de Tony fidèle au poste à la basse électrique. Des gueules marquées par les chienneries de la vie, mais debout contre vents et marées. Des teds de l'époque Cavan, droits dans leurs boots. Sont secondés par deux zicos qui officient aussi dans Rip It Up, Simon et Steve – si j'en crois le flyer du spectacle, mais j'émets quelques doutes, car il me semble aussi s'appeler Fred ou Peter.

Réglons-lui son compte en premier. On ne l'aura entendu que deux fois durant tout le set. Juste à la fin, et à la fin du rappel. C'est lui qui clôture en un boucan d'enfer. Et alors on réalise combien il a été essentiel au son du groupe. De taille moyenne, la figure mangée par ses maudites cymbales – quel que soit l'endroit d'où j'ai tenté de l'apercevoir – installé juste dans l'axe d'Andy the rebel frontman, l'est carrément invisible. Et inaudible. Soyons précis, l'a porté le combo sur ses épaules, rentre-dedans et drumin' d'enfer. Pas une seconde de silence. Toujours une baguette qui boute le feu sur la peau d'un tom. Tonnerre roulant de mille sabots de chevaux au galop, ou cents motos plein pots, si fort, si présent que l'on n'y pense plus, tellement il nous a englobé dans sa pâte sonore. L'on n'y porte pas plus attention qu'à l'air qui nous entoure, mais c'est lui qui nous transporte au coeur rougeoyant de la fournaise rock and roll. He's a real king drummer !

Idem pour Simon Reeve. Lead guitar. Même manière de jouer. Sans se montrer. Indistinct. Colle à la musique. La sert mais ne s'en sert pas pour se faire valoir. L'est comme son acolyte, semble ne pas savoir ce que c'est qu'un solo. Les virtuoses ne sont que des menteurs. Suffit de suivre le mouvement, ne jamais laisser baisser le rythme, entretenir la flamme à tout instant, jamais un riff plus haut que l'autre mais une incandescence inimaginable. Le rock est un moloch infernal dans le brasier duquel l'on sacrifie son orgueil, pour ne pas avoir à rougir de ses moindres faiblesses.

De l'autre côté de la scène Tony n'en pense pas moins. Imperturbable, réfugié dans sa tronche de boucanier, le visage marqué de trop de combats, de la même race et dans la même danse que les deux autres. Ne pas se mettre en avant, mais projeter des grondements de bête fauve comme un félin en colère qui signale sa présence pour que l'on sache qu'il vaut mieux ne pas venir lui marcher sur la patte. Ca giscle de partout, vous recevez les éclats mais c'est comme les radiations atomiques. Sur le coup on n'y fait pas gaffe. C'est après que ça vous consume littéralement.

Les trois autres ne se préoccupant que de rock and roll, c'est à Andy qu'est dévolu le rôle d'interface avec le public. Se présente sans arme. Même pas une acoustique dans les mains pour se donner l'illusion d'être utile à quelque chose pour une fois au moins dans sa vie. Tout de noir vêtu, se contente d'un micro. Mais avec pied. Le tient un peu à la Gene Vincent. Le tient un peu à la Sandy Ford. Le tient beaucoup à la Andy Rebel. Encore qu'il n'en fait pas trop. Se contente d'être. C'est plus difficile et ce n'est pas donné à tout le monde. Cela nécessite de la force et du charisme. L'en a à revendre, mais ne l'étale pas en vitrine. Souvent il s'immobilise le micro levé tête en bas, il attend que la vague de lave bouillonnante des zicos passe et il reprend ses pérégrinations sur la scène.

S'appuie en quelque sorte sur sa voix. Ni éraillée, ni de stentor. Mais solide et flexible. A la Johnny Kidd ai-je tout de suite pensé dès le premier morceau, et très vite sont arrivés Please Don't Touch et Shakin' All Over suivi plus tard d'Endless Sleep. Un I fought the Law et un Race with the Devil pour montrer que l'on est du mauvais côté celui, des perdants magnifiques et de ceux qui tutoient le diable. Plus les classiques Ted, Teddy Boy, Teddy Boy Boogie, Motorbike, et même Rockabilly Rules des chats de gouttière. Un set qui défile à vitesse grand V. Un public chaud comme de la poudre à canon enflammée qui chante en coeur et s'égosille jusqu'au fond des tripes. Rien à dire, quand les englishes foutent les mains sous le capot du rock, le moteur ne tarde pas à rugir.
Un petit rappel. Mais personne n'en demande davantage. Les Rebel Riders ont fait une démonstration assez éloquente pour ne pas exiger d'explications supplémentaires. Sont venus, nous ont vus, nous ont laissés sur le cul. Des Césars du rock.
SUIVEZ LES BOEUFS
Exemple à suivre. Il se fait tard, mais tant pis, trois boeufs à la queue leu leu, Little Nico, Zio, Cyril, Jull des Ghost qui nous a concocté durant toute la soirée une sono radieuse, plus des amateurs du public et de l'orga. Un régal, même que sur les réseaux sociaux, ceux qui étaient partis un peu trop tôt, alertés par la rumeur faisaient part de leurs regrets.

Ce ne sera que partie remise, un Rock in Gometz-le-Châtel N° 3 se profile pour le mois de mars, le 28 – écrivez-le en grosse lettres sur le pare-brise de votre voiture, bande d'alzhemeiriens - qui sera suivi de près par un numéro quatre. Programmation en cours. Souhaitons-leur d'avoir la main aussi heureuse que pour ce dernier weekend de novembre. Mais on leur fait confiance.

Damie Chad.
( Photos prises sur le FB de Rockin Lolo qui en réuni près de 300 venues d'une dizaine de participants )
CORRUPTED
THATCORRUPTED SOUND !
HI-HO SILVER / GERONIMO STOMP / THE BOY WHO DARED TO ROCK / HEART ATTACK / SWEET SPIRIT OF DIXIE / CAN'T JUDGE A BOOK / THAT CERTAIN FEMALE / REBEL TILL THE END ! / TEMPTATION BABY / FOOL'S PARADISE / SEXY WAYS / RITA / TILL THE FOLLOWING NIGHT / THE DAY THE WORLD TURNED BLUE.
TEXAS : bass / YANN : Vocal & Guitar / JACKY LEE : Drums.
Bonus Tracks : DO WHAT YOU DO / CAT TALKIN' / GIRL IN RED / OL' MOSS BACK.
YANN THE CORRUPTED + JACKY LEE on guitar.
Rebel Music Records. Voir : wwwrockabillyrecords.de

Franchement ne l'achetez pas. Si avant de vous endormir il vous faut la douce berceuse de la petite musique de nuit de Mozart pour faire des beaux rêves. Par contre si vous déplorez ce genre de lamentables et décadentes habitudes, précipitez-vous, il est pour vous. Et dès que l'on a annoncé au micro que le CD des Corrupted était disponible – à Toury, lors de la mémorable soirée avec les Rough Boys – ce fut une véritable ruée. Vers l'or. Les précieuses galettes, se sont envolées comme des crêpes à la chandeleur. Le commentaire avait été bref : « Achetez-le, car c'est du lourd ». Le genre de message qui provoquent des réactions instinctives chez les rockers.
Sûr que l'on ne nous a pas trompés sur la marchandise. C'est bien du lourd. De l'ultra lourd. Je répète mon avertissement : âmes sensibles abstenez-vous. Piétons passez à gauche. Zone dangereuse. Toute personne appréhendée sans son laisser-passer sera impitoyablement abattue sur place. Tout ce que les amateurs distingués ne peuvent supporter. Quelque part ils ont raison. Une petite apparence d'agression gratuite. Que voulez-vous parfois le rock remonte vers sa source ! L'irrésistible fureur de tout renverser, le monde et tout ce qu'il contient, à grands coups de tatanes, juste parce que la colère vous saisit et qu'il faut qu'elle éclate au plus vite, pour remettre les pendules à l'heure. Et puis n'est-ce pas la meilleure façon de s'amuser ?
S'y sont mis à trois. Ont fait un carnage et n'ont pas demandé à ce qu'on les retienne. Pas le temps d'attendre que l'inspiration vienne. Uniquement des reprises. C'est quand on connaît ses tables de multiplications par coeur qu'on peut les réciter à toute vitesse. Aussi envoient-ils sec. Dératisent et ratiboisent. Ne demandez pas s'il y a des survivants après leur passage. Du brut, du décoffrage. Du béton armé. Tous crans d'arrêt dehors. Une batterie qui drume à mort, une guitare qui fonce, une basse électrique qui alimente le courant. Et Yann qui hurle, crie et s'époumone. Ne font pas des trous dans la dentelle. Le genre de voyous qui saccagent les pots de fleurs des vieilles grand-mères. Just for fun. Des iconoclastes. Jusqu'au si crépusculaire Day Where The World Turned Blue de Gene Vincent qu'ils métamorphosent en hymne guerrier.
Après cela, ils n'ont plus de retenue. Les quatre Bonus Tracks nous entraînent en une course mortelle.
CorrupTed. Parce qu'ils s'inscrivent dans la mouvance Ted. Corrompu parce qu'il est difficile d'amasser tant d'énergie brute avant que la tension n'explose tous azimuts. Lorsque les fruits sont trop mûrs ils tombent et leur suc survitaminés génèrent de nouvelles pousses qui produisent des arbres encore plus grands et plus forts.
Pardonnez-moi, mad'noiselle, j'allais oublier la couverture, vous tenez vos promesses. A l'intérieur ça rocke et ça roule dur.
Violent et généreux.
Damie Chad.
BLUE TEARS TRIO
WHAT A ROCKABILLY SHOW !
AIN'T IT WRONG / ONE MORE SHET / TRAIN KEPT A ROLLIN' / RIGHT ROUND THE CORNER / HER LOVE RUBBER OFF / SNEAKY PETE / GHOST MEMORIES / DOMINO / WHAT I GOT FOR YOU / ROCKABILLY BOOGIE / TRAIN KEPT A ROLLIN ( alt track ).
DIDIER : guitar & vocal / AIMé : slap & vocals / FRANK : drums & vocals
www.infogroupe.combluetearstrio
Contact : bluetearstrio@hotmail.com
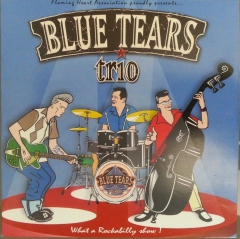
Belle pochette, arrière-fond bleu – normal quand on s'appelle Blue Tears – mais le dessin stylisé dû à pk n'invite pas à verser des larmes. Ou alors seulement d'alligators. Affamés et qui attendent leur pitance.
Boppin'trip dès le premier morceau tout en finesse et en recherche de son racine. N'est-ce pas très bon ? N'allez pas chercher pourquoi dès les morceaux suivants l'on retrouve Carl Perkins et Johnny Burnette. Une étonnante version de A Train Kept A Rollin qui nous ramène dans un boppin'swing très différent des interprétations actuelles de ce classique qui est avant tout pour les groupes l'occasion de foncer à toutes vapeur dans les plaines sans fin de l'Ouest. Les Blue Tears savent le faire aussi, en donnent en bout du CD une prise alternative davantage rentre dedans avec un sax qui imite à la perfection le sifflet des locos. Le son change en douceur mais en profondeur. Le rythme s'accélère sur Right Round The Corner. C'est la guitare de Didier qui s'insinue sans se faire remarquer dans la section rythmique et qui peu à peu prend une place prépondérante qui éclate vraiment sur Her Love Rubbed off.
Come back à un bop plus académique sur Sneaky Pete où basse et batterie prennent leur petit solo de démonstration. Retour à une guitare et une voix plus western sixties sur Ghost Memories, l'alliance impossible parfaitement réussie de l'ancien et du moderne. Un travail d'orfèvre dans la même veine d'or sur Domino les voix réalisant l'impossible jonction effectuée entre ce que l'on pourrait schématiquement définir comme l'essence du rockabilly américain et le premier rock and roll de nos amis les englishes en 1960. Un pas en arrière avec What I Got For You de l'autre côté de l'Atlantique, au coeur de la pureté originelle, et un Rockabilly Boogie chanté un peu à la manière de Bill Haley avec une guitare qui batifole bien en avance sur le temps évoqué.
Un disque subtil. Qu'il est impossible d'écouter d'une oreille distraite. Une traversée de l'histoire du rock and roll, mais presque en catimini. Ne sont que trois et c'est l'habileté des musiciens qui supplée à toutes les variations orchestrales qui se jouent entre 1954 et 1963. Une écoute agréable si l'on préfère rester en surface mais qui devient prodigieusement intéressante si l'on se pique d'as au jeu. De longues discussions le soir au coin du feu entre passionnés. Ce CD pose la question essentielle : comment jouer du rockabilly aujourd'hui ? quand on ne veut pas être une pâle imitation – en langage djeun l'on dit un clone interchangeable - d'artistes par définition inimitables, ni dégoter un petit rôle dans Le cinquième Retour de la Momie.
Une pochette en carton, toute fine. Mais le contenu oblige le détour. L'on n'attend plus que de voir le groupe, qui tourne surtout en Normandie, à la prochaine soirée de Rockers Kulture, le 16 janvier 2015. Avec impatience.
Damie Chad.
GUS & MOI
L'HISTOIRE DE MON GRAND-PERE
ET DE MA PREMIERE GUITARE
KEITH RICHARDS / THEODORA RICHARDS
( mICHEL LAFON / 2014 )
Pour les inconditionnels des Rolling Stones. C'est le grand Phil qui l'a trouvé pour moi au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. Non ce n'est pas un livre sulfureux pour les ados glissé en douce dans une collection de jeunesse afin de les initier aux saines joies du sexe, de la drogue et du rock and roll. Offre la configuration d'un album pour les enfants ceux qui fréquentent les écoles primaires. Les charmantes têtes blondes de notre nation. Et dedans, vous trouverez une belle histoire que vous pouvez raconter sans problème à votre insupportable marmaille pour les endormir. Je ne sais pas si elle les ravira. Les jeunes générations ne doivent avoir qu'une vision très approximative et très lointaine des Stones. Soyons cruels, ne doivent pas connaître. Alors ce petit garçon qui rend visite à son papy qui ne lui prête pas sa guitare pour mieux attiser son envie de jouer, je ne pense pas qu'ils vont la redemander quinze fois de suite. Surtout qu'il n'y a pas l'ombre d'un vampire ou d'un mort-vivant qui viendrait inopinément apporter un peu de suspense au scénario. Peut-être qu'une petite-fille romantique dont le grand-père adoré vient de mourir versera-t-elle une douce larme d'émotion mais ce sera tout. Je récapitule : si vous pensiez l'offrir à Noël au fils de votre voisin, chassez cette idée ridicule de la confiture qui vous tient lieu de cerveau.
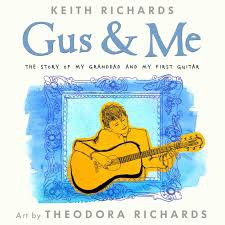
Par contre si vous êtes un amateur des Stones, prenez les yeux fermés car voyez-vous c'est un produit typiquement Stones. D'abord ça ne sort pas de la famille. Quand il y a de la thune les Stones sont à la hauteur de leur réputation. Pas intérêt que ça rapporte à un tiers. Pour les dessins, c'est la fille de Keith qui s'y est collée. Mannequin de métier. A travaillé pour les plus grands. Question physique je reconnais qu'elle n'est pas mal du tout. Par contre pour le dessin j'ai quelques doutes. Elle est aussi bonne que moi. Mon propre père était peintre, mais je n'ai pas hérité de son talent. Si vous voyez ce que j'insinue. Elle a griffonné des crobars sur des bouts de papier au stylo bille, et puis l'éditeur s'est débrouillé avec. Question staff les Stones s'y connaissent. Savent recruter la bonne équipe pour résoudre les mauvais problèmes. Là ils ont eu besoin de toute une armada. L'est vrai qu'ils ont dû bosser un max. Sont parvenus à tirer quelque chose de potable – je n'ai pas dit de transcendantal – avec des gribouillis infâmes. Merci aussi aux coloristes, qui ont secondé les trois directeurs artistiques, s'en sont donnés à coeur joie, et je ripoline une page en noir, l'autre en bleu, la suivante en jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mêmes celles qui n'en font pas partie. Avec des effets de camaïeu – aïe mes aïeux ! - et de dégradé dévergondé.
Pour le texte papa Keith a suivi la même méthode. L'a fallu qu'il se fasse aider par Barnaby Harris et Bill Shapiro, et pourtant je vous jure que ce n'est ni du Marcel Proust, ni du Stéphane Mallarmé. Peut-être une légère panne d'inspiration ? Grand-papa Gus a dit se retourner dans sa tombe ou dans son urne funéraire. A mourir de rire qu'il a dû se dire. Le fiston ne se laisse pas faire dans la vie. Un truc à enchanter tous les Téléramas de la Terre. N'était pas encore sorti que j'avais déjà entendu une pieuse chronique sur France-Inter. Question subsidiaire : que faire d'un tel bouquin une fois les dix minutes que nécessite sa lecture achevée ? La réponse est facile : vous découpez les repros des photos de la famille Richards et vous les versez dans l'épais dossier de coupures de presse sur les Stones qui s'entasse depuis un demi-siècle sur votre bureau. Comme quoi avec les Rolling rien ne se perd. Tout se recycle.

Bon je vous quitte. J'ai autre chose à faire. Quoi donc ? Tiens me relire une page de Life d'un certain Keith Richards. Vous connaissez ?
Damie Chad.
19:56 | Lien permanent | Commentaires (0)



