18/02/2015
KR'TNT ! ¤ 223. ERVIN TRAVIS / SUPERSUCKERS / SCORES / MUFFINS / LOU REED
KR'TNT ! ¤ 223
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
19 / 02 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / SUPERSUCKERS SCORES / MUFFINS / LOU REED |
ERVIN TRAVIS NEWS
La solidarité s'organise autour d'Ervin Travis atteint de la terrible maladie de Lyme très peu traitée en France. Sur le Facebook
Lyme - Solidarité Ervin Travis
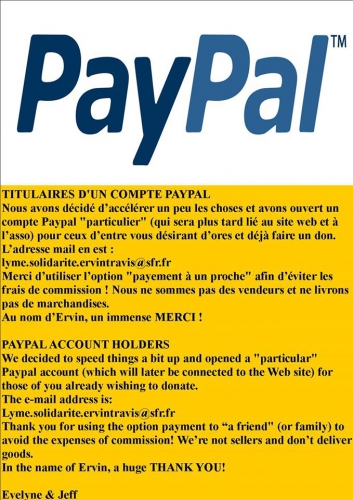
LE SUPER CURSUS
DES SUPERSUCKERS

Curieusement, les Supersuckers produisent l’effet inverse de celui que produisent les trois quarts des grands groupes de rock : ils sont meilleurs sur leurs disques que sur scène. Attention, ça ne veut pas dire qu’on bâille aux corneilles quand ils jouent sur scène. Mais leur set est tellement monolithique que l’heure paraît parfois bien longue. En tous les cas, ceux qui dans le public ne semblent pas connaître les morceaux décrochent assez vite. Ce soir-là au 106, la salle se vidait en cours de set. Comme si l’univers des Supersuckers restait impénétrable, comme si ces rockers américains étaient tellement calaminés qu’ils n’étaient plus accessibles. En gros, les Supersuckers fonctionnent comme un rouleau compresseur qui se met en route en début de set et qui s’arrête brutalement au moment des adieux. Entre les deux, ces vétérans du garage-punk américain ne font que brûler méthodiquement leur énergie comme on brûle du carburant lorsqu’on avale l’autoroute au mépris des limitations de vitesse. Leur truc, c’est de foncer, pas de réfléchir. Leur référence, c’est l’americana white-trash, celle qui plonge ses racines dans un monde de bars, d’alcool, de filles faciles, de pipes, de tatouages, de bagarres violentes, de canons sciés, de gros camions, en gros tout le folklore inepte qu’on retrouve dans les mauvais films américains des vingt dernières années. Une réalité qui ne peut en aucun cas nous intéresser dès lors qu’on ne la vit pas, et il n’est pas certain du tout qu’on aimerait la vivre. On laisse tout ça aux amateurs de folklore.
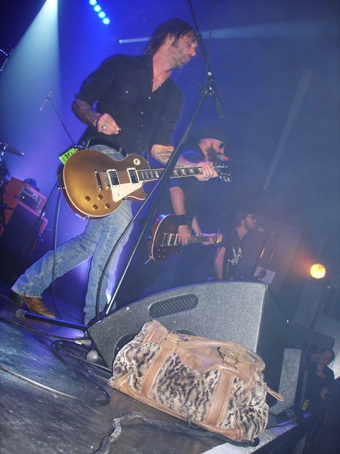
Alors, pourquoi écoute-t-on encore leurs albums et pourquoi va-t-on encore les voir sur scène, sachant que les précédentes tentatives se sont toujours soldées par le même constat d’ennui larvé ? Tout bêtement parce qu’à une époque, leurs albums épataient les obsédés du son. Tout bêtement parce que le chanteur Eddie Spaghetti fait partie des grands chanteurs de rock américain. Et tout simplement parce que Dan Thunder Bolton sait faire parler la poudre, pour employer la terminologie d’usage chez eux à Tucson, dans l’Arizona.

Pour les situer, on pourrait les comparer à Nashville Pussy ou même à Motörhead. On les accuse à tort de flirter avec le hard, mais tout comme Lemmy, ils n’ont jamais mordu le trait. Leur rock reste du heavy rock, au sens de la densité du son - et non du rythme - et leur seule tare consiste parfois à basculer dans le punk-rock américain. Ils sonnent alors comme les New Bombs Turks et tous ces groupes américains insupportables et proches du hardcore qui ont embouteillé les circuits dans les années 1990 et 2000.

En réalité, les Supersuckers s’apparentaient aux grands groupes de trash-rock signés par Tim Warren sur son label Crypt, comme par exemple les Dirtys, les Devil Dogs et bien sûr les fameux Nine Pound Hammer de Blaine Cartwright - qu’on retrouva par la suite dans Nashville Pussy - Mais les Suckers préféraient rester sur SubPop qui était encore dans les années 90 une vénérable écurie de soudards.
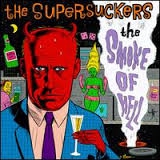
Le diable en personne apparaissait sur la pochette de leur premier album. «Smoke Of Hell» s’ouvrait sur une vraie débinade de garage-punk. «Coattail Rider» fumait comme une smoking beast. Avec les Suckers, on ne pouvait que recourir systématiquement à cette imagerie de bolide lancé à plein régime sur une autoroute. Impossible de faire autrement. Le rock des Suckers sentait le pneu brûlé. Attila s’était réincarné en Eddie Spaghetti. Mais leur rock restait irrémédiablement conventionnel. Simplement, ils le densifiaient à outrance, et c’est en cela qu’ils se distinguaient des autres groupes. Ils affichaient leurs couleurs : la violence et la mort. D’ailleurs, ils avaient un cut intitulé «Hot Rod Rally» qu’Eddie introduisait d’un coup d’Awit’. Dans «Sweet N Sour Jesus», le beat était tellement percuté qu’il rebondissait, comme quand on tape au marteau sur une enclume. Même chose avec «Retarded Bill», dont le beat rebondissait de coups redoublés. Et puis un miracle se produisait en fin d’album avec «Thinkin’ Bout Revenge», qui sonnait comme un hit de démiurge, avec sa mélodie posée sur le toit du monde. Ils embarquaient leur truc au fil mélodique d’un thème éperdu et c’était beau comme une évasion de Sing Sing. Du coup, on prit les Suckers au sérieux.
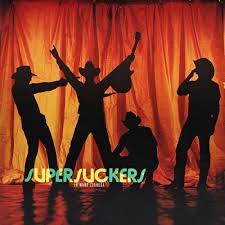
De là naquit une sorte de passion pour ce groupe bourru. En 1994 parut «La Mano Cornuda» et ils semblaient vouloir passer aux choses sérieuses. «Creepy Jackalope Eye» nous sonnait les cloches d’entrée. Bang ! Dans le nez ! Trente-six chandelles. Cui cui cui. Car il s’agissait là d’une merveille de rock, un rock ambitieux et puissant comme un seigneur mérovingien. Ce hit monté sur un thème intrinsèque fonctionnait comme tous ceux qu’on mémorisait à vie. Puis ils se livraient avec les morceaux suivants à leur petit jeu préféré de l’agression sonique. Les Suckers ne se sont jamais embarrassés avec les détails. L’image du rouleau-compresseur leur allait comme un gant. Ils poundaient leur frichti jusqu’à la nausée, comme savaient aussi si bien le faire les gens de Rocket From The Crypt. Eddie Spaghetti chantait ses trucs à la puissance dix de l’exponentiel. Non seulement il y avait du Attila en lui, mais il y avait aussi du Raspoutine. Leur «Mudhead» devenait tellement énorme qu’il en paraissait illusoire. Ils atteignaient une sorte d’au-delà de l’outrecuidance stroumphique. Dan Bolton partait en solo et les immeubles s’écroulaient autour de lui. Il y avait du Blue Cheer en eux. Ces destructeurs s’auto-détruisaient dans une sorte d’invraisemblable carnage sonique. Ils jouaient tout à outrance et c’est précisément ce qui les rendait si fascinants. Ils surjouaient tellement leur «Glad Damn Glad» que les notes fondaient comme fondent les atomes dans le processus de fission nucléaire. Enfin, c’est l’impression qu’ils pouvaient laisser.
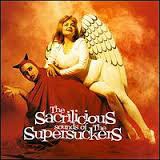
À la parution de leur troisième album, «The Sacrilicious Sounds Of The Supersuckers», on proclama sur tous les toits que c’était leur meilleur album. Rick Sims des Gaza Strippers faisait alors partie de ce gang de brutes. Oui, car deux huitièmes merveilles du monde se nichaient sur cet album. La première était une confession du diable, «Born With A Tail», une belle pièce de power-pop musculeuse chantée à l’étranglée de Boston et admirable de tenue - Can’t wait till I get my turn to burn in the infernal fire - Eddie faisait rissoler son génie guttural à la broche - I’m evil yeah and I’m free, let’s go to hell - Et la seconde merveille s’intitulait «My Victim», montée sur un cocotage infernal. Il s’agissait là d’une authentique énormité pyramidale. Eddie déclenchait l’arrivée d’un solo avec un vrai let’s go ! Alors Dan Bolton lâchait une belle colique sonique et quelques tonnes de flic-flocage, puis il remontait l’extraordinaire fil mélodique, avec évidemment des chœurs dans la mêlée. L’auditeur ordinaire pataugeait dans la démence. Flic floc. Oh yeah ! En plus, c’était cuivré ! Eddie finissait son cut du diable en singeant Otis dans «Try A Little Tenderness» - Got-a Got-a. C’est dire si. Ils proposaient d’autres gros cuts sur ce disque, du genre «Marie» (heavy balladif, diablement inspiré - They say that no one wants to grow up to be a junkie but I think he did), «Ozzy» (bel hymne à l’Ozzy drumbeaté à la vie à la mort, pièce de slab ultime - Eddie fait comme Napoléon, il s’auto-couronne empereur du power) et «Run Like A Motherfucker» (Rick Sims chante comme un freluquet, ce qui permet d’apprécier l’écart avec un chanteur comme Eddie).
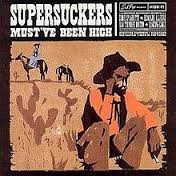
«Must’ve Been High» fut un album country destiné à tromper l’ennemi. Eddie y bouffait la country toute crue, sans sel et sans mayonnaise. Crouch crouch ! «Dead In The Water» était monté sur le beat ancestral de Johnny Cash, mais avec par derrière une sorte de grosse envergure d’échappatoire. L’erreur serait de prendre les Suckers pour des demeurés. Avec ce disque, ils ouvraient au contraire un spectaculaire champ d’action. On avait même des violons dans «Barricade» et dans «Hangover Together». Eddie chantait ça au titubé, dans la profondeur d’un gosier décapé par des alcools de contrebande. Kelley Deal (sœur jumelle de Kim) duettait avec l’ostrogoth. Ils nous sortait ensuite de son chapeau «Non Addictive Marijuana», une jolie pièce de country dopey - A big shot of whisly and a big shot of cocaine - Et on se régalait d’une fantastique ambiance country. Pire encore : ils attaquaient «Blow You Away» au banjo de «Delivrance». Quelle énergie ! Le mec qui jouait du banjo s’appelait Brian Thomas, un vrai fou. «Hangliders», le dernier morceau de l’album était aussi une petite merveille, un bel instro tagada plein d’allant et vertueux, absolument génial car coloré à la slide et animé de bonnes intentions. Le beat était celui d’un cheval qui traverse une plaine du Wyoming au triple galop. À écouter le matin au petit déjeuner.
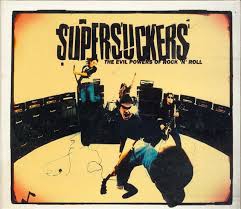
Avec «The Evil Powers Of Rock ‘N’ Roll», les Suckers firent encore monter les enchères. Aucun groupe de rock - même Motörhead - ne peut sortir un son aussi extrême dans la densité - C’mon - C’était quasiment intenable quand on écoutait ça au casque. On sentait une surtension et une surexposition des atomes du son et au milieu de tout ce délire baroque, Dan Bolton partait en solo - Awite ! On ne pouvait plus faire autrement que de prendre les Suckers au sérieux. Ils étaient tellement puissants qu’ils finissaient par nous fasciner, comme les phares fascinent le cerf surpris la nuit au milieu de la route. Les Suckers n’étaient rien d’autre que la meilleure fournaise qui se put imaginer. Ils enchaînaient avec «Cool Manchu» et ils récidivaient. Purée de guitares et couplets explosifs. Ils poussaient leur bouchon aussi loin qu’ils le pouvaient. Ils visaient la fameuse intensité edgy, leur musique ronflait comme les flammes de l’enfer, et avec ses solos, Dan Bolton semblait jeter de l’essence dans le brasier. Si on aime bien avancer à quatre pattes, alors il faut écouter cet album des Suckers. On en sort brisé. Un cut comme «Stuff And Nonsense» était beaucoup trop violent pour une oreille de chrétien. Le son des Suckers est une aberration de trash-garage démentoïde. Et ça fait d’eux des géants. Ils ne vivent que pour la fournaise. Le génie d’Eddie c’est ça : bam ! En plein front. Pas de palabres. Même si on n’était pas trop porté sur le punk US des années 80 et 90, on était bien obligé de reconnaître qu’un cut comme «Fistcuffs» dépassait les bornes. Eddie l’attaquait avec un oh ! puis ça devenait une merveilleuse pièce de punk-rock haleté. Et comme à son habitude, ce démon de Dan Bolton entrait là-dedans avec un solo de non-retour. Les Suckers déferlaient comme les Huns - Awite ! Avec une barbarie sans nom. Leur clameur s’étendait sur toute la plaine et le ciel rougissait jusqu’à l’horizon. Les seuls qui auraient pu se mesurer à eux étaient sans doute les trois misérables brutes de Hüsker Dü. «My Kiss Ass Life» était encore plus heavy et donc sans pitié. Eddie jouait une ligne de basse qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à celles que jouait Kim Deal dans «Gigantic». On pataugeait dans des mares noirâtres alors que les flammes de la ville en feu éclairaient la nuit. Le rock des Suckers transcendait la notion même de barbarie. Ils nous plongeaient au cœur de leur monde et ça pouvait devenir irrespirable. Ils jouaient le boogie des soudards, Eddie vomissait ses textes, mais my God, quel chanteur ! Il n’a jamais baissé sa garde. Et on l’entendait toujours chanter - pas hurler - au dessus du fracas des armes, toujours coiffé de son Stetson. Cet album dépassait en intensité tout ce qu’on connaissait alors, même le prodigieux «No Sleep Till Hammersmith» de Motörhead. Eddie savait cuisiner ses spaghettis, comme on pouvait le constater une fois encore avec «Hot Like The Sun», une nouvelle explosion de barbarie sonique - Aw shit - C’était même beaucoup trop dense et malheureusement, on commençait à les soupçonner d’avoir un certain génie.
C’est vrai qu’Eddie Spaghetti est un personnage impressionnant. C’est lui qui signait les posters après le set du 106. Il portait toujours son Stetson noir et ses Ray-Ban. Sa barbichette noire lui donnait une allure de prêtre orthodoxe russe et pour corser l’affaire, il parlait d’une voix d’outre-tombe. On ne voyait pas se yeux et il restait insensible aux compliments. Mais dès qu’on lui parlait de sa ligne de basse dans «Bubblegum And Beer», il hochait la tête et souriait.
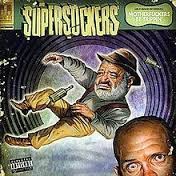
Quand «Motherfuckers Be Trippin’» parut en 2003, on s’attendait au pire. Et le pire était au rendez-vous. Les Suckers commençaient par pulvériser «Rock’n’Roll Records» à coups de gimmicks tintin la praline. Ces mecs n’avaient jamais rien respecté, mais là, ils montaient encore d’un cran dans l’abjection pulvérisatrice. Ils enfilaient tout à la hussarde, ça pulsait dans tous les coins et dans tous les trous à la fois. Quelle bande de dingues ! Personne n’aurait pu les calmer. «Rock Your Ass» était aussi beaucoup trop intense, comme chanté dans la chaudière. Trop trop. Chez eux, tout était trop, la glotte, le grattage, too much. Avec «Pretty Fucked Up», on réalisait à quel point les Suckers pouvaient être dangereux, non seulement pour les oreilles, mais aussi pour l’équilibre du monde civilisé. Avec ce cut immonde, ils devenaient indescriptibles de dégueulerie. C’était un peu comme s’ils déversaient leur truc à la benne. Comment pouvaient-ils réussir un tel prodige ? Bonne question. Et on tombait un peu plus loin sur «Bubblegum And Beer», leur hit suprême. Si on ne devait conserver qu’un seul titre des Suckers, ce devrait être celui-ci. Eddie jouait sa bassline derrière. Quand Dan Bolton partait en solo, Eddie le rattrapait au vol. On avait ensuite une autre pièce d’excellence dévastatrice, «Sleepy Vampire», nouvelle preuve des bienfaits de l’embrasement. Ils parvenaient une fois de plus à ouvrir un véritable espace sonique. Ils travaillaient aussi l’harmonie avec « A Good Night For My Darling». Eddie faisait basculer son truc dans le cratère d’un volcan et Dan Bolton rajoutait un petit coup de lance-flammes, histoire de bien finir le travail. Une vraie bande de pyromanes. Et l’intro de «Damn My Soul» était une intro de destruction totale. En redorant leur blason de brutes géniales, ils imposaient un immense respect. Eddie introduisait «Someday I Will Kill You» avec un Eoohhh de ventru transpercé par une épée. Le punk-rock des Supersuckers takes no prisonners, comme aiment à le dire les Anglais. Dan Bolton continuait d’envoyer ses giclées de notes perfides et on basculait dans un au-delà du punk-rock, dans un univers inconnu de bouillie sonique inaccessible aux autres groupes. Lemmy donnerait sans doute toute sa collection de dagues SS en échange du secret de cette fulgurance. L’écoute de cet album fut à la fois une épreuve et une sorte de ressourcement. N’oublions pas qu’on vit d’oxygène et d’énergie. Et que le chaos est source de vie.
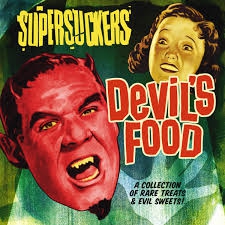
«Devil’s Food» n’était pas un nouvel album, mais une collection d’inédits. On y retrouvait le fracas habituel, mais ça restait du Sucking classique. Cet album fait partie de ceux dont on peut se passer. Il vaut mieux écouter et réécouter les deux albums précédents, si on veut se payer un petit shoot d’adrénaline. On trouve quand même deux ou trois bricoles sur «Devil’s Food», et notamment une exceptionnelle version country de «Born With A Tail». Le morceau titre vaut aussi son pesant d’or et «Sail On» bat tous les records de destroyerie mélodique. N’oublions jamais que les Suckers sont capables des pires prodiges. Avec «Kid’s Got It Comin’», ils lâchent une petite bombe garage agitée par la dynamique du foutoir apostolique.
Le problème avec un groupe comme les Supersuckers, c’est qu’à la parution de chaque nouvel album, on attend d’eux des miracles, comme au temps des Kinks ou de Jimi Hendrix.

On voyait les Suckers gesticuler sur la pochette de «Get It Together». On sentait alors qu’ils prenaient bien soin de rester dans le cadre du bon vieux rock de chemises à carreaux. Ça commençait à chauffer avec «Paid», une belle pièce de heaviness capable de nettoyer les conduits de cheminée. Dan Bolton harcelait toujours la note folle au coin du bois. Ce mec a toujours été bon. Il fait partie de ce que les journalistes américains appellent les meilleures gâchettes du rock. On se régalait aussi de «When I Go I’m Gone», bien balancé sur le beat. On avait l’impression que les Suckers cherchaient une nouvelle voie, craignant de tourner en rond dans le vieux carnage sonique. Ce cut joyeux et musculeux était probablement l’une de leurs plus belles réussites. Ce rock d’hercule de foire leur seyait à merveille. Ils évoluaient, exactement de la même façon que les Black Lips, en composant de vraies chansons, et du coup, on les prenait encore plus au sérieux. On tombait ensuite sur une autre merveille d’allure martiale, «Sunset On A Sunday», une espèce de rock idéal et imparable.
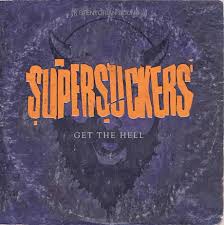
Les Suckers tournaient en France pour promouvoir leur nouvel album «Get The Hell». Sur scène, Eddie rappelait qu’il était en vente over there et il ajoutait : You need it ! C’est vrai qu’on need it, car il renferme son petit lot d’énormités cavalantes. Comme l’indique son titre, «Get The Hell» est une belle fournaise. Les Suckers travaillent désormais au râteau. Ils râclent profondément dans la pâture. On sent en eux les rustiques compatriotes du diable. Leur plus gros défaut - qui est aussi leur principale qualité - est qu’ils ne savent pas jouer doucement. Vous voudriez les entendre gratter une mandoline au coin de la cheminée ? Quelle blague ! Les Suckers sont les rois du fuck, comme le montre «Fuck Up» - I’m a fucked up/ I’m so fucked up - et ça descend admirablement. Ça sonne même comme le hit dont on a toujours rêvé. Les Suckers savent calibrer les perles. Avec «Pushin’ Thru», ils proposent l’archétype parabolique de la puissance guerrière. Ils éclatent de grandeur sonique, de beat-it et d’aplomb guitaristique. «Disaster Bastard» est une merveilleuse harangue de fond d’underground. Eddie continue de jouer son rôle à la perfection, celui d’un Lemmy chanteur-bassman chapeauté à la voix rauque, un intense leader paradoxal, une sorte de vertueux malfrat, un prédicateur du néant white-trash. Une fois de plus, leur cut s’achève au cœur de l’incendie de Rome. Avec «Shut Your Face», on retrouve ce bulldozer de fête foraine des premiers albums. Les Suckers adorent écraser les pâquerettes. Ces gens-là n’ont même pas besoin d’essence. Ils finissent cet album solide avec «Rock On», une reprise de Gary Glitter. Non mais franchement, a-t-on déjà vu des glamsters avec du poil aux pattes ?

Bon, c’est vrai, tout cela semble un peu trop idyllique. Il faudrait quand même leur trouver un petit défaut, non ? Le voilà : ils vendent des T-shirts noirs décorés d’un Jolly Roger, celui de Calico Jack avec les deux sabres croisés sous le crâne. C’est là où le bât blesse, car on ne trouve absolument aucune trace d’utopie dans le monde des Supersuckers.
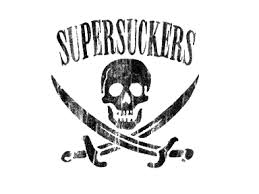
Signé : Cazengler l’ensucké
Supersuckers. Le 106. Rouen (76). 3 octobre 2014
Supersuckers. The Smoke of Hell. SubPop 1992
Supersuckers. La Mano Cornuda. SubPop 1994
Supersuckers. The Sacrilicious Sounds of the Supersuckers. SubPop 1995
Supersuckers. Must’ve Been High (country). SubPop 1997
Supersuckers. The Evil Powers of Rock ‘N’ Roll. Koch 1999
Supersuckers. Motherfuckers Be Trippin’. Mid-fi Recordings 2003
Supersuckers. Devil’s Food (collection d’inédits). Mid-fi Recordings 2003
Supersuckers. Get it Together. Mid-fi Recordings 2008
Supersuckers. Get The Hell. Acetate Records 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Dan Bolton, Scott Churilla, Eddie Spaghetti et Marty Chandler
NANGIS / 14 – 02 – 15
Service Municipal de la Jeunesse
SCORES / MUFFINS

Nangis, vous voulez rire. La teuf-teuf se marre, je ferais mieux de m'y rendre à pieds, c'est le bled à côté, autant la laisser ronfloter pénardos sur le trottoir. Avec ses trois cent mille kilomètres au compteur elle mérite un peu de repos, d'ailleurs un brin de méditation zen ne me ferait pas de mal, au lieu de me rendre chez ces ferrailleurs ( à la manière dont elle prononce ce mot, l'on sent qu'elle n'aime pas ) de hardos... Comme ce n'est pas une mauvaise fille, elle consent à m'amener. Un peu cabocharde, elle me fait le coup de m'arrêter devant la piscine municipale – sous le fallacieux prétexte que j'aime regarder les jeunes naïades en maillot de bain – et repart aussi sec vers la gendarmerie en m'assurant que ce sont des gars très sympas avec une petite cellule de dégrisement spécialement préparée pour ma pomme. Pourrie, précise-t-elle. Et hop ! joignant le geste à la parole elle s'arrête juste en face de chez messieurs les pandores.
Non, ce n'est point de l'impertinence. La fidèle teuf-teuf m'a déposé à moins de quinze mètres de l'entrée du SMJ de Nangis. Chers lecteurs ayons une pensée émue pour cette municipalité qui s'est délicatement souciée de mettre sa turbulente jeunesse sous la protection rapprochée des autorités militaires. Mais délaissons ces sombres pensées philosophiques pour nous intéresser à l'architecture des lieux. Trois fois rien, mais bien torché. Quatre murs – on suppose d'un ancien bâtiment en ruines – que l'on a gaillardement recouvert de tôle ondulée. Tout est dans l'habillement, des cintres de bois qui dessinent des débuts d'arcs d'ogives, un hâtif quinconce d'espaces en guise d'entrée accueillante et derrière un muret qui l'encercle une arène, d'une quinzaine de mètres de diamètre, ainsi délimitée qui sert de salle de spectacle, au fond à droite des tentures cachent le prolongement latéral d'une autre pièce. L'on s'y sent bien. Comme chez soi. Cinq euros l'entrée, deux euros pour les encartés, et lorsque je cherche ma monnaie pour le café, l'on m'apprend que les boissons sont à volonté et gratuites. Je salue cette belle initiative.
Public varié, majorités de jeunes, mais pas mal d'adultes aussi, qui viennent trouver en cette soirée festive distraction et chaleur humaine, et familles avec enfants. Le rock deviendrait-il une musique populaire ?
SCORES
Cri de la Betterave, Nemours, Nangis, cornaqués par Martial Biratelle, Scores arpente la Seine & Marne, et nous essayons de ne pas les perdre de vue chaque fois que l'occasion se présente. Jeunes et doués, talentueux sur scène. Des adeptes du hard, ne s'inscrivent pas dans les tribus de l'âge du métal, proviennent plutôt de l'époque du rock dur taillé à coups de marteaux thoriens, mais si elle est une science des plus signifiantes la généalogie des plus lointaines ascendances ne peut que se mettre à l'écoute des héritiers. Ce sont eux qui préparent les futures fureurs.

Rentrent sur scène un par un, mais sont cinq unis comme les doigts complices du guitariste sur ses cordes. Shadows, dès le premier morceau Scores dévoile en pleine lumière les arêtes cubiques de ses compositions. Empilements géants mais disposés au millimètre près. Tout est en place, rien ne dépasse. Le chaos mais pas le désordre. Le tonnerre mais pas le bruit. Mise en place d'une netteté extraordinaire. Et pourtant.
Et pourtant Scores repose avant tout sur la pulsation énergétique de Nicolas. N'arrête jamais. C'est quand il laisse un temps en suspens une fraction de deux secondes que vous vous apercevez que votre cœur inconsciemment s'était mis à battre à son rythme, s'était laissé emporter dans cette incessante scansion animale, et durant ce fragment de silence suspendu vous avez cette impression de ne plus respirer, de manquer d'air, de suffoquer, mais la résonnante retombée des baguettes vous délivre de cette faille respiratoire dans laquelle vous vous sentiez happé comme une aspiration êtrale venue de l'intérieur qui vous effondrerait sur vous-même. Ce n'était qu'une illusion, le rapace qui s'immobilise au plus haut de son vol pour fondre sur sa proie et s'abattre à la vitesse d'une pluie de météorites qui rebondissent de parois en parois sur les pentes vertigineuses des plus hautes montagnes. Nico, toujours là jamais las, éparpille ses battements d'ailes sur ses peaux, une pluie ruisselante qui n'en fait qu'à sa tête, mais en si totale harmonie avec les nécessités rythmiques des guitares que l'on est bien obligé de reconnaître qu'à chaque fois le hasard est muselé et vaincu. Je ne sais comment il se débrouille mais dans le même break il assure en une étrange triophonie le soulignage de la ligne mélodique qui vient de s'achever, l'accompagnement du plan en train de se dérouler, et l'annonce de la séquence suivante. Et l'infernal tournoiement ne cessera pas de tout le set.

Les trois guitares devant. Car l'on ne peut parler de section rythmique proprement dite, Timothée bien qu'il ait souvent une oreille dressée vers la batterie, joue ses lignes de basse par en-dessous. Peut cavaler comme un athlète qui s'entraîne pour le marathon Nicolas, c'est Timothée qui lui déroule l'épais tapis rouge de laine moelleuse sous ses pieds, c'est plus facile quand le copain vous arase les obstacles au rouleau compresseur. L'appuie partout où ça pourrait faire mal. Peut-être le rôle le plus ingrat car le moins spectaculaire, mais si le son de Scores est si équilibré c'est bien parce que Timothée a nettoyé le terrain. Toute pyramide repose sur sa base.
Guitare à gauche, guitare à droite. Tout le reste entre ces deux gerbes de feu électrique. Simon torse nu sur ses solos et Léo qui court-circuite sur sa Gibson. L'un qui panache et l'autre qui ramifie. L'un qui jette et l'autre qui arabesque. Le tranchant d'un côté et le barbelé de l'autre. Deux styles très différents mais complémentaires. Coruscant pour Simon, sinusoïdal pour Léo. Ne se regardent jamais. N'en ont pas besoin. Chacun sûr de l'autre. La flamme et la braise. La pointe et le fil. Au final l'épée qui tue.
Benjamin au centre, armé de son seul micro. Gesticule tout son soul. Perfecto et voix. Tout un programme. Annonce l'orage et prophétise l'ouragan. Moins en avant qu'à Nemours, laissant davantage d'espace visuel à ses camarades. Ne se glissant en première ligne que lorsque les parties vocales l'imposaient. Tout en tenant parfaitement son rôle.
Dix morceaux et pas un de plus. Le set s'achève sur un coup de Hammer à renverser les murs de l'Enfer. Une prestation de toute beauté, très rock and roll dans l'âme, chaleureusement acclamée par un public conquis et surpris d'une telle maturité.
MUFFINS
Deuxième partie. Trois zigotos sur scène. Un super batteur, un guitariste qui touche, et un bassiste qui de temps en temps caresse sa basse. Ce pourrait être très bien. Mais il y a un hic, la biscotte qui tombe du mauvais côté. Font du rock. Ce serait parfait s'ils ne faisaient que du rock. Mais non, ce sont des h'artistes. Le rock n'est qu'un faire-valoir. Le beurre que l'on rajoute sur le deuxième côté de la tartine. J'ai dû me tromper d'adresse. Café-théâtre. Un remake de la bande du Splendid, trente ans après.

Tout ce que je n'aime pas. La chanson sketch, interprétée à la perfection. Genre mecs sympas à la cool qui ne se prennent pas au sérieux. Avec derrière un professionnalisme de requins de studios, de l'improvisation étudiée au millimètre près. Le rock au service de la rigolade. C'est moi qui le dis, car eux sont atteints du syndrome français de la chanson à texte. Attention au deuxième degré, la chute est préparée avec parachute ventral de sécurité. Tradition franchouillarde qui remonte à Boris Vian, le rock comme strapontin. L'on se moque de ce dont on se sert. Gaité-lyrics et prétention intellectuelle très rive gauche avec une greffe prononcée rock alternatif hexagonal des années quatre-vingt dix. Tout ce que les Berruriers Noirs n'ont jamais osé commettre, les Muffins s'en chargent. C'est que même si on ne les aime pas, les Bérus étaient porteurs d'une certaine révolte que l'on pourrait qualifier de militante contre la société, les Muffins sont plutôt branchés critique boboïste. Acerbe mais pas trop, l'on n'est pas dupe mais tout se termine sur un grand sourire. Si nous ne pouvons pas être heureux, soyons joyeux. L'amère pilule n'en passera que mieux. Se moquent de tout, sauf d'eux-mêmes. L'auto-dérision n'est pas leur tasse de thé vert.
Faut reconnaître que ça marche. Que toute une partie du public est ravi comme un poisson rouge à qui l'on vient de changer l'eau de son bocal. Je remarque toutefois que ceux qui arborent les looks les plus hardos restent de marbre. Sont comme moi, ont l'air de s'ennuyer. Un peu comme dans les repas de communion où au dessert il faut s'enquiller l'arrière-grand-père qui veut à tout prix interpréter Marinella de Tino Rockssi. Grand succès auprès des enfants. Musicalement, il y en a pour tous les goûts, un petit bout de rock par ci, un éclat de hip-hop par là. Et tout à l'avenant. Sont prudents, jamais trop longtemps pour vous permettre de vous lasser. Mais assez pour étaler leur savoir et vous faire croire que vous connaissez tout. Ce n'est pas un concert. Plutôt un spectacle de cabaret. Live sur scène, mais surtout mise en scène.
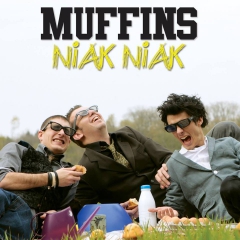
Une mécanique bien huilée. Pas très loin des ces spectacles de clowns des années cinquante sous les grands chapiteaux itinérants dont les parties musicales clarinettes et grosses caisses servaient à faire avaler aux spectateurs l'indigence des propos et des blagues qui tombaient à plat. A part qu'ici les paroles sont devenues chansons et de ce fait s'intègrent mieux dans le filage du spectacle. Point de temps mort. A la guitare Francis est le grand farineux celui qui mène le jeu et qui initie les situations, Peter est l'Auguste lunaire chargé de jouer tous les rôles, ce qui explique pourquoi la plupart du temps sa basse repose sur son support, et Flavien avec sa batterie tient lieu de la fanfare tonitruante reléguée sur son podium qui accompagnait l'entrée et la sortie des pitres. Est appelé à intervenir très souvent, et pour soulever l'enthousiasme général, et pour mettre en marche les gadgets sonores pré-enregistrés qui ponctuent le déroulement des numéros.
Comedia dell arte du pauvre éclairée à l'électricité – rien à voir avec la chandelle verte du Père Ubu - toute dimension burlesque et grotesque ayant été gommée au profit d'une dérisoire mise en cage du rire dans cette hérésie post-moderne du bon-moment-convivial-passé-ensemble. Un bon spectacle – si vous aimez que l'on vous caresse dans le sens du poil - mais qui n'a rien à voir avec le rock and roll. Et vous savez que moi qui ne suis pas du tout sectaire je n'aime que le rock and roll.
Damie Chad.
( les photos ne correspondent pas au concert, sauf la première de Scores prise pendant le soundcheck )
LOU REED / UNE VIE
MICK WALL
( traduction de Michel Assayas )
( ROBERT LAFONT / Octobre 2014 )
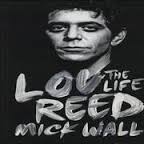
OPA sur Lou Reed. Deux livres assez platement intitulés Chansons ( 1967 – 1980 : Tome 1 ) et ( 1982 – 2000 : Tome 2 ) parus chez Points en septembre de l'automne dernier, immédiatement suivis en octobre de la traduction de la bio de Mick Wall. La mort pousse à la consommation. L'on n'aura jamais autant parlé de Lou Reed dans nos média depuis sa disparition. Doit en rire dans ses volutes dissoutes dans le nirvana.

Mick Wall n'est pas un inconnu pour ceux qui lisent la presse spécialisée britannique. A longtemps collaboré à Kerrang ! la bible hebdomadaire des amateurs de death metal qui fut à l'origine un simple numéro spécial de Sounds. Lancera le magazine Classic Rock spécialisé dans les articles de fond sur le rock des années 60 et 70, une véritable mine d'or pour bien des journalistes de notre presse nationale. L'est surtout connu pour ses rapports privilégiés avec des groupes comme Black Sabbath et Gun's N' Roses, des accointances qui ne restèrent pas toujours au beau fixe...
Pour cette vie de Lou Reed, Mick Wall donne l'impression de ne pas s'être beaucoup fatigué. Disons qu'il a fait vite. Faut battre le cadavre tant qu'il est chaud. Moins de trois cents pages, un très gros tiers pour le Velvet Underground, un petit tiers pour la grande période – celle qui court de son premier album personnel à Coney Island Baby - et les trente dernières années au pas de charge... Plus on avance moins on aperçoit Lou Reed en chair et en os. Son personnage se confond de plus en plus avec sa discographie, soigneusement épluchée, titre par titre, à chaque nouvelle sortie d'album. J'ai bon dos de critiquer, j'ai dû laissé tomber Lou Reed après la sonnerie de The Bells en 1979. Depuis Sally Can't Dance la production de Lou Reed m'ennuyait terriblement. J'achetais, j'écoutais, repassais deux ou trois fois un ou deux morceaux qui auraient pu... mais qui ne tenaient pas le coup dès la seconde écoute, je renfilais la galette dans la pochette et je classais dans le placard des revenez-y-pas.
M'avait un peu déçu le Lou qui n'était pas vraiment sorti du bois lors de son concert à Colomiers ( Hall Cominges – 16 mars 1975 ), voix éteinte, orchestre atone, faisant son job avec l'enthousiasme avec lequel vous vous jetiez sur votre version latine en classe de quatrième, le mec qui vient-là pour toucher son fric et qui se fout de son public. L'on était très loin de Rock And Roll Animal ! L'aurait mieux fait de laisser chanter un roadie à sa place. Dans la série j'ai vu la légende et m'en suis plus mal porté après qu'avant, je peux témoigner.
VELVET UNDERGROUND
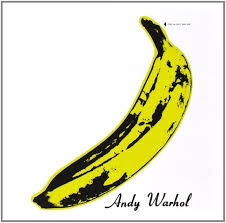
Ce qui m'a toujours agacé avec le Velvet Underground, ce n'est pas le souterrain, c'est le velours. D'abord question souterrain c'est un peu râpé lorsque l'on s'affiche avec Andy Warhol que je considère davantage comme un publiciste qu'un artiste. Un homme qui avait tout compris, que pour acquérir la gloire auprès du vulgati populi, il vaut mieux sembler être qu'être dans la royale présence heideggerienne de l'Etre. Paraître ou ne pas paraître, that is the question. L'a tout de suite pigé ce qu'il pouvait tirer du Velvet : un groupe qui jouait à fond, un chanteur à la voix bourdonnante et obsédante, une batteuse moissonneuse incapable de changer de tempo, un violoniste cacaphoniste, un truc infâme qui dégageait un bruit infernal assez proche des fameux bruiteurs de Luigi Russolo, bref il emmenait partout le groupe avec lui, c'était son générique à lui. Son leitmotive personnel. Pas totalement tombé sur la cacahouète non plus Andy, savait que l'on vous pardonne tout à condition que vous soyez joli même si vous n'êtes pas poli. Comme Maureen Tucker n'était pas l'équivalent plastique de Blondie, s'est dépêché de mettre a beautiful mannequin dans la vitrine. Ce fut Nico. Une belle plante, une blonde pulpeuse - la stature de ces anciens germains qui effrayaient tant les légionnaires romains râblés et basanés – mais par chance dotée d'une belle voix. Un morceau de choix. C'est le côté velours qui m'a toujours dérangé dans le Velvet. Le gant pour vous passer sur les fesses à deux faces. Côté mou, côté dur. Le deuxième disque du Velvet est un chef d'oeuvre. Le White Heat White Light vous transforme les expérimentations de Stockhausen ou le Pli selon Pli de Pierre Boulez en comptines enfantines pour cours de maternelle. La voix de Lou passée au papier verre y est pour quelque chose, mais le maelström violonique avec l'archet qui renverse toutes les mesures de John Cale pour beaucoup plus. Anecdote personnelle : le troisième opus du Velvet était à l'époque difficile à trouver, les critiques dithyrambiques parues çà et là me mirent en chasse. Trois mois plus tard je posais enfin la précieuse mousseline sous le saphir impatient. Flop de chez flop. John Cale avait été remercié par tête Reed. L'avait déjà obtenu la peau de Nico, pouvait maintenant jouer au poète maudit. Hélas ce n'était pas Rimbaud mais François Coppée. Musicalement la Saison En Enfer avait laissé la place aux Vers d'amour et de Tendresse. Le côté velours avait repris le dessus. Pour sûr les Humbles dont nous parlait Lou Reed n'étaient pas les pauvres humiliés du doux François, Lou tapait plutôt du côté du lumpen-prolétariat, des marginaux, des déclassés, des mutants sociaux fiers de leur hétérodoxies, du sexe à toison, de la drogue à foison, les pédés, les trans, les queers, toute cette faune totalement cachée en ces temps de grandes pruderies et de fortes hypocrisies, mais d'une grande banalité aujourd'hui. Certes Lou Reed fut un des tout premiers à diriger le projecteur sur cet effrayant et fascinant rebut sociétal, mais au passage il en avait oublié l'outrance musicale du rock and roll. Le Velvet Underground fut un grand groupe, le premier qui avait compris que le rock présente deux facettes, le son et l'image. L'infatigable Andy Warhol fut le géniteur de cette gémellaire attirance. Notamment avec la fameuse pochette à la banane qui ne faisait que déplacer le fameux régime de Joséphine Baker vers une lecture plus gaiement virile. A la même époque Jim Morrison et les Doors adoptèrent une autre manière de concevoir le rock : le son et le sens. Le public intello-rock se dépêcha de décréter qu'en fait Lou Reed avait, avant les morrissiennes Portes ( de l'Enfer et du Paradis ), engendré la sainte trinité fondatrice du rock, le son, l'image et le sens.
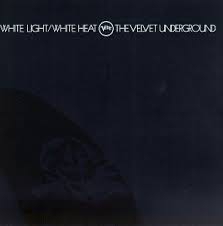
LE GRAND LOU REED
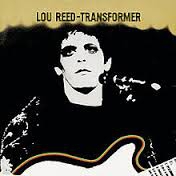
Tout cela Lou Reed le magnifia en son véritable unique hit, Walk On The Wild Side où il parvint enfin à accoucher de sa propre parturience grâce à David Bowie qui lui permit de voir plus clair en son esprit embrumé, une nouvelle version de I'll Be Your Mirror en quelque sorte, et qui opéra selon un dédoublement salutaire.
Auprès de Bowie, Lou Reed avait acquis une stature internationale. Les ventes ne suivirent pas à sa grande déception, mais dans la mythologie rock il faisait désormais jeu égal avec les plus grands. Duplicité de Lou qui aux deux moments les plus proéminents de sa carrière eut besoin du secours d'un autre artiste pour se sentir pleinement lui-même. Suis totalement d'avis que Lou a dû souffrir toute son existence de troubles schizoïdes. Souterrain et velours, déviance et normalité, pulsion de mort et appétence de vie. Deux disques vont coup sur coup mettre en épingle ces deux facettes. Berlin et Rock And Roll Animal.
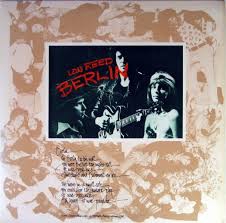
Berlin est bâti à partir de morceaux écrits à l'époque du Velvet Underground. Le mettrai en parallèle avec L'Opéra des Quat'Sous de Brecht et Kurt Weill – dont comme par hasard l'on retrouve un extrait sur le premier trente-trois tours des Doors – avec cette différence près que Brecht est porté par un enthousiasme révolutionnaire – certes déjà assombri en 1928, date de la première présentation, par la montée du nazisme – optimisme qui n'existe plus dans l'imaginaire reedien fondé sur la mythologisation des bas-fonds new yorkais.
Berlin est une oeuvre totale qui raconte une histoire – pas une collection de bonnes chansons – qui contient une véritable weltanschauung digne de la tétralogie de Wagner. Mais les dieux et les héros ont laissé leur place aux drogués et aux prostituées. Le monde a glissé dans la fange du désespoir. Le cycle de la laideur ne se refermera jamais plus. Un chef d'oeuvre que le monde du rock refusa d'entendre. Quatre ans avant les punks Lou Reed est le premier à nous apprendre que l'avenir est une utopie avortée. No future ! proclame-t-il, mais les punks possèdent une énergie et une violence qui leur permettront de faire passer leur no message. Lou Reed nous le sert sur le plateau à fromages de la dépression.
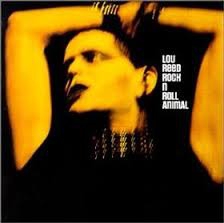
Les guitares de Steve Hunter et de Dick Wagner sont pour beaucoup dans la théâtralité de la musique funèbre qu'exhale cette oeuvre nauséabonde. Berlin est une oeuvre alchimique inversée qui transforme l'or en matière noire. L'or du Rhin métamorphosé en eau de boudin. Avec Rock and Roll Animal, Lou Reed et ses deux fabuleux bretteurs vont changer de dimension. A la lente agonie de la voie humide invertie ils vont substituer la voie sèche directe et silexique, la piste de feu et de foudre. Ce disque est une des plus profondes mutations rock jamais réalisée, jamais captée par un magnéto, la névrose intellectuelle abandonnée au profit de la vigueur animale. Lou Reed n'ira jamais plus loin.
L'EN-DECA
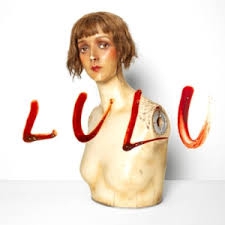
Après cela, Lou Reed fut repris par ses vieux démons. L'est redevenu lui-même et Mick Wall ne nous aide pas à l'adorer. Nous présente un individu empli de jalousies et de contradictions. Pas pire que nous. Mais si terriblement trop humain. Mais si épouvantablement caméléonesque. Un Lou Reed qui enregistre des disques que nous jugeons faiblards n'est pas une catastrophe en soi. Il y a des milliers d'autres morceaux et des centaines d'autres rock and roll singers à se mettre sous la platine, mais un Lou Reed qui a chanté – et qui a même bâti son image sur cela - les charmes et les tourments de l'héroïne et des déviantes pharmacopées et qui vingt ans plus tard interdit aux drogués de rentrer dans ses concerts, nous déçoit. Ce n'est sûrement pas un hasard si tant de larmes de condoléances furent versées lors de sa disparition. Le mauvais fils était revenu à la maison. Ne sortait plus avec un travelo. Ne se droguait plus. S'était marié avec une adorable femme, Laurie Anderson. Walk on the right side, baby. The borderline walks the line.
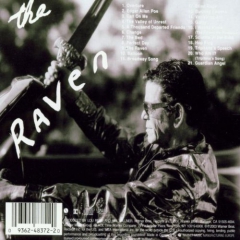
Mick Wall nous explique que Lou Reed fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Nous sort la dernière carte biseauté, celle que l'on cache dans le revers de son veston et que l'on ne jette sur le tapis qu'en dernier recours, celle de l'anarchiste qui possède le droit de se contredire lui-même. Faudrait prendre le temps d'explorer sa discographie, écouter par exemple le Lulu ( 2011 ) avec Metallica qui fut si décrié par les critiques que sans l'avoir entendu l'album nous est d'emblée devenu attractif et regarder d'un peu plus près The Raven ( 2003 ) d'après l'oeuvre d'Edgar Allan Poe. Cette revendication totémique de l'oiseau odinique nous agrée. C'est-là un signe de reconnaissance qui ne trompe guère. Nous y reviendrons.
Damie Chad.
( Pour le troisième album du Velvet and others le lecteur pourra se rapporter à l'article Rideau pour Lou Reed sur RR'TNT ! 162 du 07 / 11 / 2013 de notre Matou Zengler préféré )
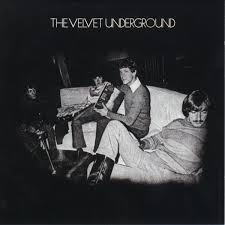
15:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/02/2015
KR'TNT ! ¤ 222. ERVIN TRAVIS / KIM FOWLEY / PULSE LAG / MARIANNE / K-RYB / RAMBLIN MEN / MR WHITE / HANK WILLIAMS
KR'TNT ! ¤ 222
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
12 / 02 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / KIM FOWLEY / PULSE LAG / MARIANNE / K-RYB / RAMBLIN' MEN / MR WHITE / HANK WILLIAMS
|
NEWS FROM ERVIN TRAVIS
La solidarité s'organise autour d'Ervin. : la journée solidarité du 08 février 2015 à Graulhet a été un franc succès. Merci aux organisateurs et aux musiciens : Something Else - Nashville - Taxman - Dr Pick Up - Young Wild Boars qui ont permis de récolter près de 1700 euros. Photos et compte-rendu sur le FB Lyme – Solidarité Ervin Travis. Ervin n'a pu résister au plaisir de passer derrière le micro... La rage de revivre rock qui revient ! C'est bon signe !

FEU FOWLEY
(Part one)
— Tu dors pas ?
— Non...
— Prends-moi dans tes bras...
— Tais-toi, bitch !
— Ça va pas non ? Faut aller te faire soigner, mon p’tit gars !
— Oh Rox, c’était pour rire, tu sais bien. Tu sais qui parlait comme ça aux filles ?
— Les mufles ne m’intéressent pas.
— Kim Fowley ! L’autre jour, au salon du Molay, un pote m’a dit que Kim Fowley venait de casser sa pipe alors forcément je pense à lui. J’essaie toujours de reprendre contact avec les morts...
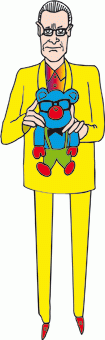
— Tu me fais le coup à chaque fois. Une nuit entière sur Jack Bruce, une autre sur le petit organiste des Small Faces, me souviens pas de son nom, et une autre sur Paul Revere. Là j’imagine que c’est parti pour le restant de la nuit... Oh ce n’est pas grave, il est déjà trois heures, et demain, c’est samedi... Tu veux un verre de rhum ?
— Bonne idée ma puce.
— Tu l’aimes bien, ce fameux Kim Fowley. Souvent, quand on reçoit du monde à dîner, tu racontes des épisodes de son histoire. C’est vraiment vrai ce que tu racontais l’autre soir quand La Bloque et Tina étaient là ?
— L’histoire des Hollywood Stars ? Belle histoire, pas vrai ? Kim Fowley savait tout faire : enregistrer des albums solo, produire des groupes de surf, tirer des filles, et surtout monter des projets extraordinaires. Il se demandait quel était le groupe dont rêvaient les kids de Los Angeles et il le fabriquait. Kim Fowley fabriquait principalement du rêve, c’est pour ça qu’on l’admirait. En 1973, il avait eu la vision de New York Dolls californiens. Pour monter ce projet ambitieux, il avait comme seul point de départ son chauffeur, un certain Mark Anthony, un type qui avait déjà une gueule de rockstar puisqu’il ressemblait à Anthony Hopkins, et qui savait chanter et jouer de la guitare. Puis il est allé chercher les autres un par un : Terry Rae, un batteur et sosie de Paul McCartney, Ruben de Fuentes, Bobby Drier et Michael Rum...
— Oui d’accord, mais l’histoire du pacha, tu l’as inventée, n’est-ce pas ?
— Rox, ma puce, pourquoi me demandes-tu ça ? Tu ne me fais pas confiance ?
— Bien sûr que si, mais il t’arrive parfois de mordre le trait et de travestir la réalité quand ça t’arrange...
— Il n’y a pourtant rien d’extravagant dans le fait que Kim Fowley soit allé demander conseil à son ami Ali Pacha au Yémen ! Les Hollywood Stars ne décollaient pas, et Kim Fowley ne comprenait pas pourquoi. Le groupe disposait pourtant de tout l’arsenal nécessaire à l’explosion : le look, le son et surtout les chansons, des compos de Kim Fowley, donc des hits. La machine à rêve s’était enrayée et Kim était désemparé. Son ami Ali Pacha était le seul à pouvoir l’aider...
— Tu me fais rire avec ton Ali Pacha... Pourquoi pas Ali Baba, tant que tu y es ?
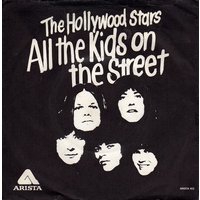
— Ce n’est pas du tout la même histoire. Tu mélanges tout... Bon, bref, Kim saute dans un avion et va au Yémen. Il fait écouter «All The Kids In The Street» à son ami Ali Pacha et forcément, Ali Pacha trouve ça très bien. Les filles du harem aussi, puisqu’elles viennent danser ! Mais tu vois, ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est le fait qu’Ali Pacha soit le maître spirituel de Kim Fowley. Il lui apprend à rester modeste dans le processus d’élaboration des rêves ainsi que dans le négoce du plaisir. Quand Kim se plaint que la réalité a dévoré son rêve des Hollywood Stars, tu sais ce qu’Ali Pacha lui répond ?
— Non...
— En aucun cas la réalité ne peut agir sur un rêve que tu as décidé de bâtir... Et il ajoute même qu’à sa connaissance, c’est impossible. Tu vois, on croise des êtres exceptionnels au cœur de la mythologie de Kim Fowley ! Attends, ce n’est pas fini ! Ali Pacha lui redit ce qu’il avait déjà dit plusieurs fois : ne vois que les solutions, et c’était d’autant plus courageux de sa part qu’il détestait l’usage du mot solution.
— Oui, mon p’tit cœur, c’est impressionnant, mais ton histoire de lampe magique ne tient pas la route une seule seconde ! La lampe magique que Pacha offre à Kim, c’est ça ta fameuse solution ?
— Rox, la lampe, c’est à la fois la solution d’Ali Pacha et une métaphore, évidemment. Pour faire redémarrer un rêve, il faut bien utiliser une métaphore, sinon, c’est impossible, voyons, tu le sais bien. Kim Fowley est rentré à Los Angeles avec sa Solution et donc les Hollywood Stars ont décollé et sont devenus un groupe culte. Et culte, tu sais ce que ça veut dire : les disques restent à moisir dans les bacs parce que personne n’en veut, même à neuf euros. Mais à l’époque de la parution de leur seul et unique album sur Arista, les Hollywood Stars sont devenus énormes pour tous les lecteurs de Bomp, forcément. Et ce génie de Kim Fowley n’a fait que ça toute sa vie, monter des groupes de rêve comme les Runaways ou encore Venus & the Razorblades, attends la liste est longue !
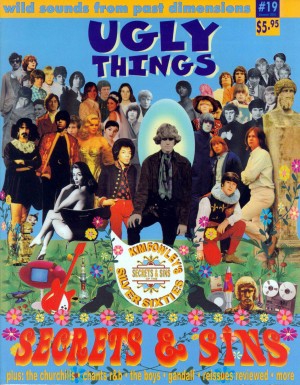
Il a aussi enregistré et produit les pires singles de l’histoire du rock, ceux que Norton a commencé à compiler sur quatre volumes, et puis il y a tous ses albums, et puis il y a aussi toute sa littérature, des textes fabuleux publiés par Mike Stax dans Ugly Things, on en trouve aussi sur les pochettes de quasiment tous ses albums, et puis tu as son livre, publié chez Norton, enfin, il y en a partout, dans tous les coins, il a produit tout au long de sa vie, son œuvre est considérable, ça donne un peu le vertige...
— Moi je préfère le vertige de l’amour...
— Rox, tu crois que c’est vraiment le moment de me tripoter ? Je te parle de Kim Fowley !
— Justement, tu m’as expliqué qu’il méprisait toutes les drogues sauf le sexe. Je trouve ce genre d’homme intéressant... Mmmm... Et l’histoire que tu racontais l’autre soir, quand tes copains de la musique sont venus manger, celle des bites chez Proby... Je n’en crois pas un mot, bien sûr, mais j’aime bien l’entendre quand tu la racontes...
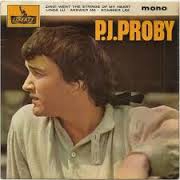
— Je savais bien que cette histoire allait te plaire. Toi, dès qu’on voit des bites en vadrouille, ça t’intéresse. Cette histoire, c’est du pur Fowley. Figure-toi que ce mec débarque à Londres en 1964 et qu’il s’installe chez PJ Proby, son compatriote californien envoyé là pour remplacer Elvis qui n’est jamais allé en Angleterre, tu vois un peu le travail ? Et dans la maison où vit Proby se trouvent aussi Vivian Prince, le premier batteur fou des Pretty Things et Phelge, un proche des Rolling Stones. Ils partouzent tous les jours et Kim raconte qu’il se balade dans un slip de gonzesse et qu’il y a découpé un trou devant pour faire passer sa bite. Quand on sonne à la porte, c’est lui qui va ouvrir, tu vois le tableau, ha ha ha ! Sex & drugs & rock’n’roll, baby ! Et qui sonne à la porte ? Vince Taylor qui voulait rencontrer PJ Proby ! Oui car c’est l’époque où les artistes étaient curieux les uns des autres et ils cherchaient tous à se rencontrer pour échanger des idées. Quand Vince s’installe à côté de PJ et de Kim dans la banquette, les autres sont en train de baiser Anna The Potato Girl sur le tapis du salon. Je te passe le détail.
— Mais l’histoire de la bite à Proby qui traverse Anna, c’est vraiment n’importe quoi... C’est l’un de tes fantasmes !
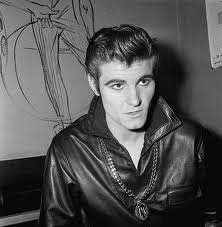
— Rox, arrête de toujours vouloir tout rationaliser ! Putain, on est à au cœur du mythe ! Tu comprends ce que ça signifie d’avoir deux titans comme Kim Fowley et Vince Taylor dans une banquette ? Même dans tes rêves les plus fous, tu ne verrais jamais ça. Et pourtant, cette rencontre eut lieu dans la vraie vie, à Londres, en 1964. Quand Vince a dit à Kim qu’il n’avait pas besoin d’aller à Vegas pour détrôner Elvis parce qu’il était Dieu, c’est tout à fait logique que Kim lui ait demandé de prouver qu’il était Dieu ! Grave erreur que de mettre Vince Taylor au défi ! Alors Vince a tendu un doigt ganté de noir et les portes d’un placard se sont ouvertes toutes seules. Ça ne suffisait pas à Kim, alors Vince a tendu le doigt vers le mur et, crrrrrrac, une grosse lézarde est apparue, du sol au plafond. Il faut comprendre à travers ces phénomènes que TOUT est possible dans ce genre de contexte, tu comprends ? Mais Kim était un peu comme toi, il pensait qu’il y avait un truc ou que la maison était un peu ancienne. Et donc c’était normal que les murs se lézardent. Il rappela à Vince que Dieu ne s’amusait pas à ouvrir des portes de placard mais qu’il avait créé les animaux. Piqué au vif, Vince pointa son doigt ganté de noir sur les fesses de PJ qui était en train de tirer Anna et il créa le Probytosaurus Rex, la bête à deux dos.

— C’est là où la bite de Proby traverse Anna et ressort pas sa bouche. C’est presque du Alien ton histoire. Tu veux bien essayer pour voir si ça marche avec moi ?
— Reverse-moi d’abord un verre... Et quand je passe un disque de Kim Fowley, tu aimes bien ?
— Oui, il y des morceaux qui me font penser à ton autre héros, Captain Beefheart...
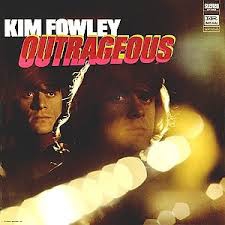
— Ah oui, c’est l’époque «Outrageous» et «I’m Bad», des disques qu’on écoutait tout le temps quand on était encore au lycée. Qu’est-ce qu’on pouvait adorer ça avec le frangin, des trucs comme «Animal Man» - I’m vulgar ! I’m mean yeah ! - et t’avais une fille qui arrivait dans la chanson et qui disait d’une voix de nympho humide - Man you’re so rough and so big - et Kim éjaculait ! «Outrageous» était le premier album trash-punk de l’histoire du rock. «Nightrider» en était le chef-d’œuvre, il hurlait pendant tout un couplet - aooouhhh ouahhhhh aouhhhhh ouahhhhh - et il se forçait même à vomir - arrrrrglllhhhh arrghlhhhh - ah le con ! Depuis, personne n’a jamais réussi à faire mieux ! Il rotait dans «Barefoot Country Boy» et il se remettait à vomir - argghhh - il en toussait, le con, et dans un spasme ultime il lâchait : rock’n’roll ! Pure auto-dérision d’un génie en herbe ! Là où tous les autres faisaient ça sérieusement, même Captain Beefheart, Kim Fowley tournait tout en dérision. Quelle rigolade ! Il se faisait photographier dans un trou d’eau ligoté avec des chaînes, tu vois le délire ? Et sur la pochette de «I’m Bad», il ressemblait à un homme de Cromagnon, alors qu’en réalité il était très beau. Ah, l’album «I’m Bad», c’est tout un poème ! C’est là-dessus qu’il sonne comme Beafheart, dans «Gotta Get Close To You» - closeeeer arghhhh - il était complètement barré et sur ce disque tout était joué à la slide. Dans «Queen Of Stars», il draguait une fille - Look out look at my eyes/ Touch my skin see my hair - et il poussait des cris d’orfraie, il avait de la bave, un vrai psychopathe ! Et dans «Fobidden Love», on avait un numéro de basse dément signé Pete Sears. Quand j’écoutais «I’m Bad», le morceau titre de l’album, j’avais toujours l’impression d’assister à la naissance d’un mythe, car Kim s’annonçait ainsi - Here I come rockin’ down the lane/ wild as a sunshine, gentle as a pain - Figure-toi qu’on appelle ça des vers classique, ma puce...
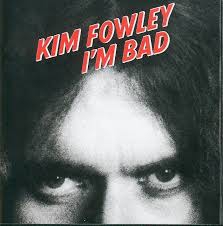
— Il a fait beaucoup de disques ?
— Oh oui ! Disons une petite trentaine en son nom, mais tu le retrouves partout dans l’histoire du rock, en tant qu’auteur, manager ou producteur. Son curriculum donne le vertige et aujourd’hui, si tu veux tout savoir de son curriculum, c’est dans Wiki. Pas la peine de te fatiguer à chercher dans les vieux fanzines pour retrouver les infos. Tu cliques dans Kim et tu as tout tout tout et le reste, comme on disait avant dans SLC. C’est vrai que j’ai toujours admiré Kim Fowley, et ça, depuis l’origine des temps. Ses premiers albums n’étaient pourtant pas très spectaculaires. Il faisait comme tous les autres, du bon rock californien formaté pour les radios. De mémoire, son premier album s’appelait «Love Is Alive And Well». Tu y trouvais trois petites merveilles : «Flower Dum Dum», petit groove West Coast soutenu aux clap-hands sur lequel il jivait et ça allait devenir l’une de ses spécialités, par la suite, ces longues impros sur lesquelles il récitait des textes d’une musicalité extraordinaire, du type de celle que tu trouves dans les bons disques de rap. Il y avait aussi «This Planet Love», monté sur un pur Diddley beat. Mais il y avait surtout «Reincarnation» qui sonnait comme un hit des Seeds et qui avait déjà ce parfum d’éternité propre à Kim Fowley. C’est surtout dans le garage que s’est exprimé le génie de Kim Fowley, tu comprends. Il savait brûler comme l’homme de la Mancha, tu sais brûle encore...
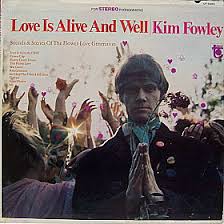
— Oui, brûle encore, même trop, même mal... Je commence à m’assoupir, mon p’tit cœur... Tes litanies m’assomment...
— Je réponds à ta question, c’est bien toi qui m’as demandé s’il a fait beaucoup de disques, pas le pape !
— Oui, mais tu ne vas pas me raconter les trente albums, tout de même ?
— Faudrait savoir ce que tu veux. Ou alors tu m’accuses de raconter des histoires à dormir debout, ou alors tu me reproches de t’endormir avec mes considérations critiques. J’essaye simplement de te donner les éléments qui vont de permettre de comprendre pourquoi cet homme a joué un rôle si capital dans l’histoire du rock. Au passage, je te rappelle que l’histoire du rock est aussi l’histoire artistique la plus riche de ce dernier demi-siècle. En tous les cas, je suis persuadé que le rock a touché beaucoup plus de gens que m’importe quel autre phénomène culturel, politique ou religieux, et John Lennon, même s’il le disait par pure provocation, avait bien raison de dire que les Beatles étaient plus populaires que le Christ. C’était hélas mathématiquement vrai. Et Kim Fowley a joué un rôle prépondérant dans cette aventure extraordinaire, car c’était un visionnaire, au même titre que Jeffrey Lee Pierce, Lux Interior, Sam Phillips ou Phil Spector. Il a su créer tout un monde, avec ses héros et ses légendes, ses disques et ses destins. Et ce mec m’accompagne depuis 1964, t’as qu’a faire le compte, ça fait cinquante ans ! Alors, tu comprends, ça ne relève pas de la petite anecdote. Et je vais même te dire encore mieux : il a toujours su rester dans le groove, c’est-à-dire qu’il a su traverser les époques et les modes en restant Kim Fowley le visionnaire, et il a fait comme Jerry Lee, au lieu de se faire bouffer par les tendances, c’est lui qui les a bouffées toutes crues !
— Puisque tu parles de Jerry Lee, il me semble me souvenir d’une autre histoire que tu racontais avec Gene Vincent...
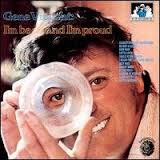
— Oui, c’est l’époque où Gene Vincent n’avait plus de contrat, donc plus de blé. Quand John Peel a appris ça, il a proposé à Gene Vincent d’enregistrer un album sur le label qu’il venait de créer avec son agent et complice Clive Selwood, Dandelion Records. Gene Vincent était l’un des héros de John Peel. Pour être sûr du coup, Peely demanda à Kim de produire le disque. Mais apparemment, ça ne s’est pas bien passé dans le studio, même si on voit aujourd’hui des photos des sessions où tout le monde a l’air de bien s’entendre. Kim aurait interdit la boisson dans le studio, ce qu’il faisait systématiquement avec les autres musiciens, quand il produisait un enregistrement. Pire encore, il aurait dit à Gene : «Hey toi, tu vas me chier une de tes grosses merdes pour teenagers» et bien sûr Gene l’aurait pris complètement de travers. Pour Gene Vincent, c’était l’album de la dernière chance. Ici en Europe, on attendait cet album comme le messie. On partait du principe que ça allait rester dans la veine de «Bird Dogin’» qui était le meilleur titre de Gene Vincent. Manque de pot, quand l’album est arrivé, ce fut une atroce déception. Toute la niaque de «Bird Doggin’» avait disparu. Pffff ! Volatilisée ! Plus rien ! Avec les copains, à l’époque, on a vécu ça comme une tragédie. Dans cet album, ça se barrait dans tous les sens, il y avait de la country et des balades... Tiens ressers-moi un glass, ma puce.
— Il n’a jamais joué dans un groupe, ton fabuleux visionnaire ?
— Non, Kim Fowley a toujours préféré faire cavalier seul. Comme il avait eu un succès d’estime avec ses premiers albums, il a continué de la jouer à l’Américaine, en artiste solo, tu vois, comme Elvis, Dylan ou Jerry Lee. Pas besoin d’être dans un groupe. Dans sa première époque, il a fait deux autres albums relativement intéressants, «Good Clean Fun» et ««The Day The Earth Stood Still». Il a fait chanter son ami Rodney Bigenheimer sur «Search For A Teenage Woman» et le résultat est stupéfiant, car Rodney n’a pas de voix, il chante même un peu faux, mais la balade est si tendre et si féerique qu’on se fait avoir - Oh teenage woman wof wof I love you I want you - On les voit tous les deux, Kim et Rodney, à la fin de ce fantastique film qu’est «The Mayor Of Sunset Strip». Ils sont attablés sur une terrasse, à Los Angeles, Kim porte un costard rouge et il dit : Eh oui, on est encore là ! Puis il fait un doigt de fuck à la caméra. Et dans «Motorcycle», on entend Kim faire la moto - rrrrrum-ba-ba-ba-ba ba-ba - Et tu sais d’où ça vient ?
— Quoi, la moto ?
— Ben oui, le rrrrrum-ba-ba-ba-ba ba-ba ! Ça vient des Rivingtons, l’aube de la sauvagerie ! C’est Kim qui a produit le fameux hit des Rivingtons, «Papa Ouh Maw-Maw» qui allait devenir le «Surfing Bird» des Trashmen et que tu as entendu quand on est allés voir les Cramps à l’Élysée Montmartre. Et sur Stood Still, il balançait sa première mouture de «Night Of The Hunter», une vraie pop de jerk à la Fowley ! Il écrivait alors des morceaux avec son copain Skip Battin qu’on allait retrouver dans les Byrds ! C’est sur cet album qu’on trouvait l’énorme «The Man Without A Country», bien tortillé à la tortillette, quasiment hypnotique, il poussait des awite awite d’aliéné et il laissait planer pendant tout le morceau l’immense doute d’un beat hypno. Ah ma puce, quel chef-d’œuvre ! Tu sais, il a bouclé ce que j’appelle son époque classique sixties avec l’un des plus beaux albums de rock de tous les temps, «International Heroes». Tu vois, j’ai tellement adoré cet album et le morceau «International Heroes» en particulier que j’ai encore le refrain en tête - International heroes, International heroes, we got the teenage blues/ The change has got to come soon/ Else we’re going to lose - Une merveille absolue, ça aurait dû être un hit planétaire. Oui, ça sonnait comme un hymne, comme «Like A Rolling Stone» ou «All You Need Is Love». On était en plein glam et Kim s’était maquillé pour faire la pochette. Charlie McCraken de Taste jouait sur cet album, tu te rends compte ? Il y avait aussi un folk-rock digne des Byrds sur cet album faramineux : «Somethning New», une chanson incroyablement mélodique digne du Dylan de 65 - Looking for something to do/ Looking for something to say/ Something new it’s probably true/ It’s the shiny new way !
— C’est vraiment dommage que tu chantes faux. Mais pourquoi il n’est pas devenu aussi célèbre que Madonna, Michael Jackson ou Sting ?
— Je t’en prie, ne me parle pas de ces gens-là et surtout pas de Stong !
— C’était pour te taquiner, mon p’tit cœur. Mais tu sais, ton fantastique visionnaire extraordinaire et bli-bli-bli et bla-bla-bla, il n’est pas très connu. Avant de te rencontrer, et avant que tu m’offres ses albums pour mes anniversaires sans jamais te poser la question se savoir si ça va vraiment me plaire, je n’avais jamais entendu parler de lui ! Et pourtant, je faisais comme toutes les filles de mon âge, j’écoutais les chansons du hit-parade à la radio. Alors oui les Rolling Stones et les Beatles, je connais. Les Bee Gees aussi. Mais Kim Fowley ? Jamais entendu une seule chanson de ce charmant monsieur !
— Attends attends, je reviens sur ce que tu disais avant. Les albums que je t’ai offerts ne te plaisaient pas ?
— Oh tu exagères ! Je n’ai pas dit ça ! Figure-toi que je les ai bien écoutés, mon p’tit père ! C’est pas difficile, ça fait quatre ans qu’on vit ensemble et tu m’en as offert quatre, tu vois !
— Et ça t’a vraiment plu ? Tu saurais m’en parler un peu sérieusement, parce qu’à chaque fois que je t’ai demandé si ça te plaisait, tu m’as répondu oui, mais tu ne m’as jamais dit pourquoi ces disques te plaisaient...
— Parce que je ne suis pas comme vous, monsieur Raymond la Science, je n’ai pas besoin d’éplucher les cuts comme tu dis à longueur de temps. Ça me plait parce que ça me plait et puis voilà, on ne va pas en faire une toute une histoire !
— Tu pourrais au moins me dire quels sont les morceaux qui t’ont plu !
— Oh je ne sais pas, moi, attends j’essaye de me rappeler... Celui où il tient un nounours rouge...
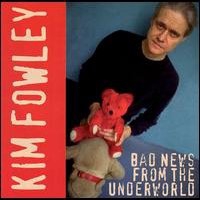
— Ah oui, «Bad News From The Underworld» ! C’est un album un peu post-punk. Kim Fowley y fait sa petite gouape des bas-fonds. Tu te souviens des titres ?
— «Factory» ?
— Oui, «Face On The Factory Floor», c’est bien speegdy gonzales. Tu avais aussi «Zero/Zero», et «Invasion Of The Polaroid People», où il faisait le con. Et «Wormculture», l’album où il croise les bras, tu sais il porte une écharpe blanche...
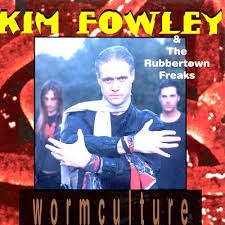
— Ah oui, avec ses copines ils s’amusent à faire les vampires de Dusseldorf. Sa copine Andrea chante vraiment bien. J’ai vraiment adoré cet album. Il parle beaucoup de sexe avec ses amies...
— Il disait souvent qu’il partouzait dans des décapotables avec des couples de lesbiennes. Sur cet album, tu devrais te souvenir de «Rubbertown Freak», tu sais il chantait comme ça - Rubberton freak ! Rubberton freak !
— Ah oui, le gros jerk !
— Un vrai garage pouilleux à la Kim Fowley, bardé de guitares grasses et qui sent bon la fosse à vidange et l’huile saumâtre ! Et ces chœurs de volontaires ! Quelle fantastique excavation de cave de fosse ! Quel tempo combattant ! Tu avais aussi «Momma’s Got A Shotgun» - I put the gun in your mouth and I want to see your smile ! - À la fin, Andrea se marrait, c’était encore du Grand Guignol signé Fowley ! Puis il y avait une autre énormité, «Bad Radiation Day», un pur chef-d’œuvre de dépravation garage - I can’t move and I can’t talk aaah aaaah aaah aaah - et ce travail de guitares grasses derrière ! Encore un garage à la ramasse ! Encore un coup de génie de Kim Fowley ! Ça sonnait comme tout ce qu’on aimait - Bad radiation day ! - Il chantait ça à la bonne franquette d’accords violents et de chœurs d’affranchis ! Et «Let The Madness In», tu l’as bien aimé ?
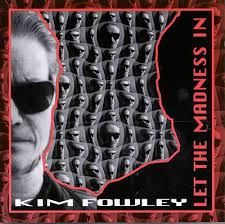
— C’est lequel ?
— Sur la pochette, on voit la moitié de son visage en noir et blanc...
— Ah oui ! C’est un peu électro... J’aime bien «Sex On Television». Une fille entre dans la voix basse du chanteur, c’est un truc qui me plait beaucoup. Très sensuel...
— Sur cet album, tu as surtout «Midnight Tragedy» - it’s okay ! - Ça démarre dans le marais des sons, tu sais, et ça devient vite monstrueux, comme s’il sortait une statue des marais, on sent l’énergie fondamentale de Kim Fowley qui s’arrache à la glaise des concepts avec une mélodie ! Quel génie ! En fait avec cet album, il s’est enfoncé dans l’électro avec la force d’un mousquetaire. Mais quelle puissance ! Tu te souviens de cette chanson où il parle de la mère d’Orson Welles qui jouait du piano, avec sa double pulsion électro et piano ?
— Vaguement... Il chante aussi deux chansons à propos de Tori Amos, non ?
— Oui, «Tori Amos Drinks Teardrops In The Twilight Zone» ! Dément ! Il s’enfonce dans l’enfer électro et il fonde le temple de la compréhension percussive ! C’est surhumain. Il y a aussi «Ride», dans le même genre, où il drive le beat électro. Il est fantastique, l’ambiance est faite de clameurs électro. Il finit avec un autre coup de génie, «Lipstick Lesbians», un pur délire, il balaye tout le cirque des Primal Scream, on entend des voix de Vampirellas, c’est furieux, énorme, complètement dévastateur ! À tomber dans le coma des cons !
— Mais le dernier, je ne l’ai pas aimé du tout. Le rouge, avec les gouttes de mercure sur la pochette ! Trop de machines et trop d’effets. En plus, tu sais que je n’aime pas cette musique violente. Je me suis vraiment demandée si tu n’avais pas profité de mon annive pour pouvoir écouter ce disque...
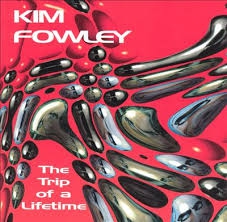
— Tu plaisantes ? «The Trip of A Lifetime» est pourtant un bon album, même s’il est électro. Kim Fowley crée des ambiance pour se livrer à son sport favori qui est le talking jive, voilà, c’est tout. Il s’amuse à pulser le beat des machines. C’est l’époque où il fréquente les Écossais et «Here Comes Norman» n’a rien d’électro, c’est gratté à la sèche et même drôlement mélodique. Il y a aussi un cut qui sonne comme du garage arabe de Rachid Taha, «Susan Walks», un vrai prodige, il déclame, parle de trash et de cash - Nobody’s reading in the 21st century - voilà ce qu’il prédit. Il sait poser sa voix dans les ambiances électro, comme Alan Vega. C’est parce que tu aimes bien Alan Vega que je t’ai offert ce disque. Un truc comme «Smokescreen», c’est excitant au possible. Et puis il y a ce voyage dans l’espace avec des femelles extraverties qui s’appelle «Future Pilot Excursion». Et il reprend aussi son vieux hit, «The Trip». Sur le deuxième disque, tu as une pièce de génie, «Festival Of Sun Reading» avec ses amis de Teenage Fanclub. On se demande d’ailleurs ce que ça fout sur cet album, tu ne crois pas ? Puisqu’on parle de ça, Kim Fowley s’est mis très vite à faire des albums en collaboration avec les Écossais de BMX Bandits. «Hidden Agenda At The 13th Note» est un album live un peu étrange, parce qu’on croirait entendre Jim Morrison. On sent que Kim Fowley est dans la résurgence des vieux mythes de la scène californienne. Il pose des conditions, exactement comme le faisait Jim Morrison sur scène. Les BMX créent des ambiances de groove et Kim se livre au talking jive. Il peut broder comme ça pendant des heures avec rien, crabmeat baby c’mon, c’est un sacré baratineur. Il fait aussi monter des filles sur scène pour dialoguer avec elle, il y a une qui fait «suicide !» et Kim fait «teenage !» Il fait aussi régulièrement du recyclage de «Gloria», comme dans «The Secret», et ça reste toujours incroyablement vivant. «Volcano», c’est du pur Morrison ! C’mon ! yeah yeah ! C’est monté sur les accords de «Mona». On trouve aussi sur cet album une version complètement trash de «Do You Want To Dance», du vrai trah-punk embarqué en enfer - Are we having a party or what ? - Il a aussi fait avec Chris Wilson un disque enregistré live à Berlin, «White Negroes In Deutschaland». Il y présentait Chris comme un survivant et un vieil ami qui est devenu son Keith Richards sans prévenir. Kim dit aussi qu’il avait fait ce disque «pour la seule joie de paraître stupide en public, pour rester non commercial, bien garage, Monsieur Mauvais Goût/Qui S’y Croit à un niveau horrible». Puis il revenait à sa passion pour les éclairs de génie - Sometimes I hear the guitar of Arthur Lee ! - Et il soignait sa réputation d’empereur du trash avec «Rockin’ in The Balkans» en pétant dans le micro - Serbs ! Slovacs ! Muslims ! You’ll die in your sleep ! Prout ! Prout ! - Il était mort de rire - Slavia ! Before the flood ! - Il a aussi collaboré avec Matthew Sweet d’Outrageous Cherry à Detroit pour un album fantastique, «Michigan Babylon» !
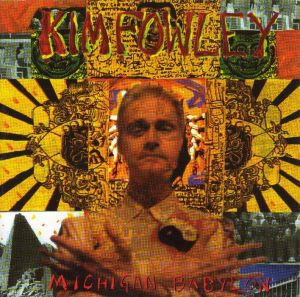
Tu trouveras très peu d’albums de ce niveau dans l’histoire du rock, ma puce ! Là on entre dans le pur Detroit sound et on retrouve le groove épais dont les Stooges ont fait leur fonds de commerce. Il règne dans ce disque une ambiance terrible, un côté théâtral à base de sacrifices humains. «Questions Answers», c’est à la fois malade et babylonien, fabuleusement cadavérique. J’appelais ça à l’époque le génie malade de Kim Fowley. Pour ce disque, il s’était complètement renouvelé, tu te rends compte ? «Lions In The Street» est aussi une pure énormité, grattée par Matthew Smith, un mec qui va au wha-wha des bas-fonds ! C’est le fils spirituel de Ron Asheton et comme Kim sonne comme Iggy, alors tu comprends ça devient gravement exceptionnel ! «Lions In The Street» est typiquement un hit d’Iggy post-stoogien, sauf que Kim sonne la charge avec un dégueulis de distorse comme on n’en avait encore jamais vu ! Terrifiant d’allure dégommatoire ! Figure-toi que par le génie du son, Kim Fowley parvenait au même résultat que Mick Farren ! Il n’y a pas de hasard, ma cocotte. À ce niveau, on ne croise que des génies. Son «Skin Deep Electric Green» est superbe d’intention malveillante, voilà le groove malsain par excellence. Fantastique ! «Sex With Strangers» est encore un truc à se relever la nuit - wild and anonymous there’s no problem being alone - Il lance ça avec des revoyures de garage flamboyant, et ça nous fait une extraordinaire envolée de garage punk mélodique. Attention, Kim met les pieds dans le génie sonique de Matthew Smith, alors ça prend une tournure spectaculaire. Dans «Palace Of Ice», Kim se laisse couler dans le ruisseau comme le Christ, pour sauver le rock. Il sauve le monde avec son talking jive dans une ambiance profondément atmosphérique et plombée au beurre, et c’est jivé derrière avec tellement de violence ! Ça joue, mais c’est une horreur ! Le pauvre Kim Fowley n’a même pas idée de ce qui se trame derrière lui ! C’est de la démence pure, on est là dans l’explosivité maximale, énorme et catastrophique ! Sur un autre morceau, tu as Mary Respreto des Detroit Cobras qui vient lui donner la réplique. Et dans «Detroit 2000», il chante exactement comme Bob Dylan ! Incroyable, avec la pince à linge sur le nez ! Il a aussi travaillé avec Ben Vaughn, enfin, c’est un peu plus compliqué que ça. Ben Vaughn qui l’admirait lui a envoyé une cassette avec des carcasses de morceaux et Kim est allé en studio mettre des voix dessus, et c’est devenu l’album «Kings Of The Saturday Night».
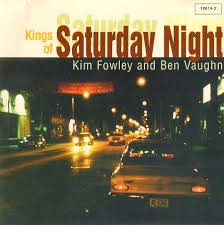
Il voulait mélanger Slim Harpo, John Fogerty et les Standells et faire des versions cajun de chansons de Déesses Espagnoles. Il voyait Ben Vaughn comme un Nick Lowe américain avec le cerveau de Sam Phillips et il appréciait sa musique qu’il qualifiait de mélange de rockabilly et de folk-rock. Cet album est du pur Kim Fowley, tout en ambiances et chanté au prêche psychédélique, presque monocorde - Who can I trust in a city in shock - demande-t-il dans un «Cities In Shock» posé sur le riff de «Gloria». La plupart des morceaux pré-enregistrés étaient des structures classiques garage - Action and Satisfaction - et Kim Fowley se livrait à ses extravagances habituelles, à son délire imprécateur. De grosses lampées de fuzz nappaient «Bad Man Bangin’» et on trouvait aussi sur cet album des grooves à la Suicide comme «Livin’ On The Edge». Mais le plus souvent, le doom tentaculaire revenait avec des morceaux comme «Dark & Empty Rooms». Fantastique album, si tu savais ! L’autre grand disque collaboratif de Kim est plus récent. Il date de 2003, si mes souvenirs sont exacts et il s’appelle «The West Is Best». Kim l’a enregistré avec Roy Swedeen. Tu vois qui c’est ?
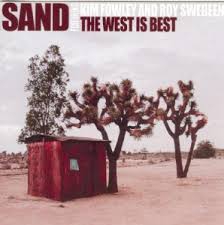
— ....
— Rox ? Tu dors ?
— ...
— Tu sais, Roy Swedeen, c’était le batteur des Misunderstood ! Kim et lui se partagent les morceaux. Kim attaque «Underground garage» à l’édentée. Il dit que «Road To Hollywood» lui fut inspiré par le gant noir du mec de Music Machine, tu sais, Bonniwell ! Il y a des morceaux de Swedeen qui sonnent comme du pur Billy Gibbons, sur cet album. Kim Fowley revient avec «Trailer Parks After Dark», où il traite d’une notion fondamentale de sa mythologie, les white trash roots, c’est-à-dire ses racines white trash. Il rappelle que son père Douglas Fowley était un B-movie actor et il en profite pour balancer une sacrée country de malheur ! Rox tu dors ?
— ....
— Tu sais, dans les seventies et les eighties, il s’est enfoncé dans une sorte d’underground et il a continué d’enregistrer des albums sur des petits labels qui avaient pour vocation d’être charitables avec les losers. Car on considérait alors notre héros comme un loser, alors que les albums restaient d’un très bon niveau. J’ai toujours fait l’effort de les rechercher et de les écouter. Ce mec ne m’a jamais déçu. Il a toujours su maintenir son cap, qui est celui d’un novateur. J’aime bien les novateurs...
— Oh non... Pitié ! Je te vois venir... Tu ne vas pas recommencer avec Apollinaire !
— Ah tu ne dormais pas, je m’en doutais... Rassure-toi, ma cocotte, je te redirai le Pont Mirabeau une autre fois, car on est loin d’en avoir terminé avec Kim Fowley.
— Quoi ? C’est pas encore fini ?
— Non mais tu rigoles ? Je ne t’ai pas dit pourquoi les albums des années de vaches maigres étaient importants ! C’est important que tu le saches, si tu ne veux pas mourir idiote !
— Merci !
— Tu sais bien, chaque fois que je le peux, j’essaye de te rendre service !
— Arrête de me prendre pour une conne !
— Ce que tu peux être susceptible, quand même ! Ressers-moi un verre, s’il te plaît...
— La bouteille est vide. Tu n’as qu’à bouger ton cul et aller en chercher une autre dans la buanderie. Et puis arrête un peu de boire, tu vas passer la journée à dormir et moi je vais devoir attendre que monsieur se réveille pour aller faire un tour !
— On ferait mieux d’aller boire un café, le jour se lève. Ce n’est pas maintenant qu’on va se rendormir...
— Vas-y si tu veux, moi je reste au lit, bien au chaud, mmmm...
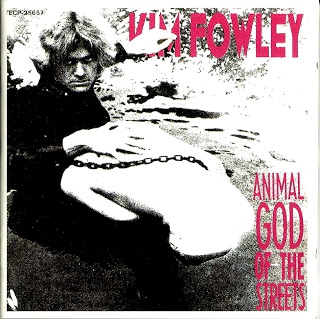
— D’accord, alors je reprends... Les années de vaches maigres et les labels improbables. Là dedans on trouve «Animal God Of The Street», paru sur Skydog, que j’avais été chercher à l’Open Market, rue des Lombards. C’était une sorte de sanctuaire tout bétonné et Marc Zermati portait une moustache rasée au milieu, ce qui veut dire qu’il ne lui restait plus que les deux crocs de chaque côté de la bouche. Ce disque est devenu un objet cultissime, mais ce n’est pas le meilleur album de Kim Fowley. J’adorais «Ain’t Got No Transportation» qui était une sacrée leçon de tatapoum, Kim jouait son va-tout au tape-cul de la rue Lepic ! Il faisait une fausse fin et un redémarrage terrifiant - Get my voodoo magic ! - Il était déjà complètement allumé puisqu’il poussait ses onomatopées.
«Living In The Street» est un album nettement supérieur et sur la pochette il commençait à développer son image de Dorian Gray du rock’n’roll. Il attaquait avec «Motorboat», un truc énorme tapé à l’outrance du son, on aurait dit un cut produit par Phil Spector. C’est l’époque où il travaillait avec Michael Lloyd qui allait fonder The West Coast Pop Art Experimental Band, un groupe devenu culte avec trois albums psyché. Avec «25 Hours A Day», Kim se prenait pour Gary Glitter et Ian Hunter ! Il respectait toutes les règles de l’art suprême. «Big Bad Cadillac» était une énormité démoniaque. Kim faisait la Cadillac en rotant - My baby threw up in a big bad Cadillac - C’était le rock de la gerbe, extrême, sonnant et trébuchant. Tout était bon sur ce disque, on n’en revenait pas à l’époque. Avec «Hollywood Nights», il disait vouloir imiter les New York Dolls ! C’était encore une énormité, un pâté de basse au croupion, un truc de fou, chanté à la décoincée et pulsé au pouet pouet de la désaille. Quelle énergie démente ! Le booting courait après le chant - Don’t cry bye bye - Puis il revenait à son cher Diddley beat avec «Thunder Road», qu’il chantait à l’arrache de la montée, et encore une fois, c’était à tomber. Vers la fin, il revenait à Dylan avec le morceau titre. On retrouvait un peu de sa passion pour Dylan dans l’album «Sunset Boulevard», paru à la fin des seventies et produit par Earle Mankey qui fit partie de la première mouture des Sparks avec son frère. Kim chante «In My Garage» exactement comme Dylan chante ses rengaines, en tirant certaines syllabes. Ah oui, on a aussi ce qu’il appelle du white trash on fire, «North American Man», un cut monté sur un beat r’n’b vraiment raunchy et suivi à la petite nappe d’orgue. Il y a aussi sur cet album un véritable radio hit, «Control», mais ça, peu de gens le savent. Dommage. «Control» sonnait comme un vieux hit bubblegum.
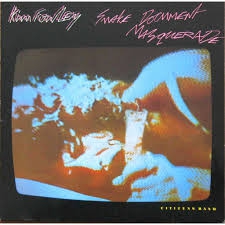
Sur «Snake Document Masquerade», Kim s’amusait avec la disco, eh oui, il n’y a pas de sot métier ! Il s’amusait aussi avec le raggamuffin, mais quand il revenait au garage, alors je te prie de croire que ça faisait des étincelles ! «Snake Document Masquerade» est un authentique classique garage. On ne sait pas d’où sortait cet album, «Automatic», une sorte de compile avec sur la pochette une photo de Kim le glamster, comme sur «International Heroes», avec son manteau de fourrure et son T-shirt Space Age. Il s’agissait d’une sorte de compile où on retrouvait notamment «Shine Like A Radio» qu’il avait composé pour les Hollywood Stars et que Blue Cheer jouait sur scène. C’était un heavy groove californien tapé au drumbeat des contreforts de Topanga, tu peux me croire ! En tous les cas, c’était un vrai hit, ma cocotte ! C’était drumbeaté comme dans un rêve ! Il y avait un autre morceau de batteur sur ce disque, «Vision Of The Future». Cette compile était louche, mais les morceaux ne l’étaient pas ! Le dernier album de cette période bizarre était «Hotel Insomnia», il y proposait du groove nocturne et un peu de country traînarde. Tous les morceaux de la face B étaient grattés à l’acou au coin du feu et révélaient son côté intimiste. Mais je peux bien te le dire, je ne l’ai pas écouté souvent, car il est un peu ennuyeux.
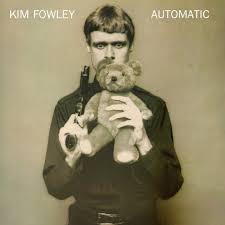
— Je te signale que tu aussi, tu es ennuyeux. Tu voudrais bien faire une pause ? On pourrait faire un petit calin, mmmm, en plus tu m’as l’air d’être en forme...
— Mais Rox, je ne t’ai pas encore parlé des deux plus grands albums de Kim Fowley !
— Quoi ? C’est pas encore fini ? Ça fait trois heures que tu me fatigues avec ton Kim Fowley ! Il y a vraiment des moments où je me demande si tu es quelqu’un de normal... Tu verrais ta tête quand tu racontes tes albums et tes histoires à dormir debout ! Si tu veux, je peux donner l’adresse d’une copine qui est psy. Elle s’appelle Christiane. Elle est très bien, elle pourrait t’aider...
— Je crois que ce serait plutôt à toi de te faire soigner, ma garce ! Chaque fois qu’on reçoit du monde, tu t’arranges pour que ça tourne en partouze ! Heureusement que nous avons des amis compréhensifs et cultivés !
— Oh, tu ferais mieux de te taire, tu es bien content quand tu as d’autres filles à tripoter, hein, mon cochon ! Vous les hommes, vous êtes bien tous les mêmes ! Vous êtes pudibonds quand ça vous arrange, mais dès qu’un sein apparaît, hop ! On remballe toutes les leçons de morale ! Tu crois que je ne t’ai pas observé ? Tu n’es pas le dernier à te mettre à poil ! Surtout quand on joue au strip poker ! Ah là, Môsieur adore perdre ! Môsieur ne fait plus son mauvais joueur !

— Oui, cause toujours... C’est surtout depuis que je t’ai refilé les romans de Michel Houellebecq que tu te crois tout permis. Je suis certain que ces livres ont eu une influence considérable sur ta libido, et je trouve même ça plutôt bizarre, car c’est écrit du point de vue masculin et souvent ce n’est pas très flatteur pour les femmes...
— Mon pauvre ami, tu te fourres le doigt dans l’œil ! Et jusqu’au coude ! J’aime bien ce qu’écrit Houellebecq, il y a un souffle, c’est vrai, mais si un auteur a de l’influence sur ma libido, ce n’est pas lui, ce serait plutôt Catherine Millet... C’est autre chose ! Et quel souffle ! Tu sais qu’à travers elle, j’ai compris que l’extrême sensualité était l’expression de la liberté absolue ?
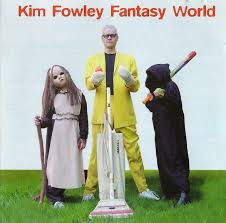
— Alors justement, puisque tu parles de souffle, en voilà. «Fantasy World» est l’un des plus grands albums de Kim Fowley. Et tu sais pourquoi ?
— M’en fous !
— Parce qu’il l’a enregistré avec Francis McDonald des BMX Bandits. Kim dit qu’en McDonald, il y a une part Dave Edmunds, une part Todd Rundgren, une part Brian Wilson et une part Phil Spector pré-Beatles ! Sur ce disque, tout est claqué à l’accord majeur écossais ! À commencer par «Schoolgirl X». Avec «22nd Century Boy», Kim grimpe au faîte de la gloire du glam et du monde situationniste ! Il fait son Ziggy Dracula, the King of Noise, il trempe dans l’excellence juvénile avec la gravité d’un vieux junkie du Hollywood des années vingt !
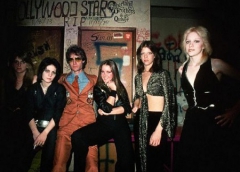
Il ressort même pour cet album des morceaux qu’il avait composés à l’époque des Runaways, comme «My Baby And I» que Joan Jett trouvait trop wimpy. Mais c’est de la pop pimpante, embarquée au vent du Brill par l’invraisemblable Francis, un producteur digne de Jack Nitzsche. C’est claqué aux cloches et Kim chante ça à la démesure ! Encore pire : «Misery Loves Company», un cut gratté à l’insidieuse et balancé au pur jus garage californien. C’est d’une grandeur d’harmonique et de science garage californienne qui dépasse tout ! Kim tape dans la foison de son de Moby Grape et dans l’envergure des Byrds, mais il va beaucoup plus loin que tous les autres, tu sais pourquoi ?
— M’en fous !
— Parce qu’il a la voix ! Kim dit de «Fantasy World» que c’est un radio-hit et il a raison ! C’est de la power-pop de premier rang et il tient tout à la voix. Il nous ressort un glam magique avec «Children Of The Night» et figure-toi que «Liquid Refreshment For The Soul» fut rejeté par les Byrds qui trouvaient cette chanson trop organique ! Mais Kim Fowley chante mille fois mieux que Roger McGuinn ! C’est important de le rappeler ! Bon puisque je vois à ta tête que tu es complètement fascinée par Kim Fowley, je vais te parler de l’autre grand album, «Adventures In Dreamland» paru assez récemment, enfin quand je dis récemment, c’est une façon de parler, puisqu’il date de dix ans.
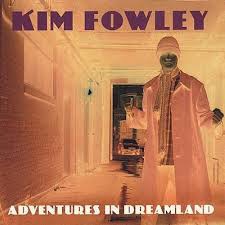
C’est un album important parce que Kim y envoyait des messages à Rodney Bigenheimer, Phil Spector et Gene Vincent. Et à son chien ! En compagnie de Roy Swedeen, il retrouvait les accents dévastés de «Michigan Babylon». Tout le disque est infiniment laid-back. Avec «Ballad Of Phil Spector», il nous ramène au cœur de la légende. Il chante comme Dylan. C’est tout de suite de très haute volée. Il raconte la légende de Phil Spector. Les juke-boxes dansent dans le ciel étoilé. Il n’y a rien de plus dense que ce type de chanson dédiée. Kim Fowley retrouve un fil mélodique pour dire ce qu’il pense du génie de Phil Spector - He’s already been punished by the curse of genius - et il profite de l’occasion pour rappeler qu’il a chanté sur l’album «Phil Spector 1976-1979» avec Cher, Dion et Nilsson. Même chose pour «Ballad Of Gene Vincent» : pur génie et chant dylanesque. «Redlight Runners» est une chanson idéale pour la route, avec un tempo tex-mex. Si Kim ne conduit pas et qu’il fait appel à des chauffeurs, c’est pour ne pas devoir être grossier avec les autres conducteurs. Le tempo est plus énervé et il en profite pour ressortir ses vieilles onomatopées - chapapa ouk mow mow - C’est un vrai carnassier - Oumh pah pah redlight runners/ We’re gonna ride all night long runrun run runrun ! - Et comme je te l’ai dit tout à l’heure, il consacre aussi une chanson à son chien Boxey, «The Dog Next Door», un boxer nain qu’il adore. Il y parle de rubber girls et de lesbian warriors. Fantastique ! «Mrs Bigenheimer» est un clin d’œil à Liz, la femme de Rodney. Kim Fowley raconte ses souvenirs d’une époque complètement révolue, mais il s’accroche, c’est un nostalgique. Qui va s’intéresser à tout ça aujourd’hui ? Kim Fowley se bat avec ses fantômes. Cette chanson est du pur John Cale - When did she go ? Nobody knows - Oh il faudrait aussi que je te parle de Fire Escape, ce projet de dingue qu’il avait monté avec Michael Lloyd, Sky Saxon et Mars Bonfire ! Leur album «Psychotic Reaction» est un album de reprises ! On y trouve du Seeds, du Count Five, du Music Explosion et du Kim Fow...
— Je vais préparer le café. Tu viens ?
— Ça t’embête si je mets quelques morceaux pendant qu’on déjeune ?
— Si c’est un moyen de ne plus t’entendre bavacher, oui, je veux bien. Tu me soûles ! J’ai la tête qui tourne ! On dirait que c’est moi qui ai fini la bouteille de rhum !
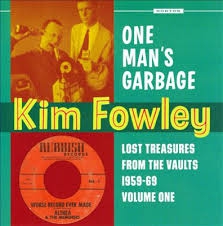
— Regarde, ce sont les albums Norton que Billy Miller a fait paraître depuis quatre ans ! Tu vois, ce sont tous les singles obscurs que Kim a enregistrés ou produits entre 1959 et 1969 !
— Tu veux un toast ?
— Non, pas tout de suite. Attends, je vais te mettre un morceau... Ça s’appelle «Mocassin» et le groupe s’appelle les Blue Bells !
— ...
— Pas mal, hein ? Il y a une histoire poilante autour de ce cut. Kim raconte qu’il partageait à l’époque un appart avec Derry Weaver et Mark Lindsay, tu vois qui c’est Mark Lindsay ?
— Ton café va refroidir...
— C’est le chanteur des Raiders. Bref, ils adorent un dieu nommé Azor. C’est une ampoule rouge qu’ils actionnent discrètement à l’aide d’un fil de pêche. Quand des filles arrivent dans l’appart, Kim et ces copains demandent au dieu Azor s’il veut voir les filles se déshabiller. Alors Azor clignote. Ça veut sire oui. Tu vois, ils s’amusaient bien ! Oh et puis ce truc. Ça s’appelle «Dedication Time» par Althea & The Memories, des doo-wop girls from the ghetto ! Écoute !
— Mais elles chantent faux ! C’est atroce !
— Mais oui ! Figure-toi que Kim Fowley voulait produire les pires disques de l’histoire du rock ! Il avait même créé le label Rubbish Records pour ça ! Tiens et puis, ça, «Surf Pigs», une démo qu’il avait enregistrée avec Mars Bonfire et que Ron Asheton avait entendue. Ron voulait que Kim chante dans les Stooges après le départ d’Iggy ! Kim a dit non ! Pas mal, hein ? Il a produit pas mal d’instros de surf avec des groupes comme les Renegades ou les Gamblers dont il disait qu’ils étaient GOD, tu vois un peu le travail ?
— Non, pas du tout !
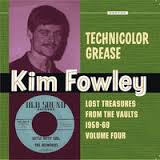
— C’est dingue, sur ces albums Norton, tout est bon, incroyablement inspiré et désuet en même temps, comme si ça appartenait à une autre époque. Tiens il y avait ça, un groupe qui s’appelait les Rituals, avec PJ Proby !
— Ton Proby de la bête à deux dos ?
— Oui, Kim le connaissait du temps où il s’appelait Jett Powers et qu’il jouait du rockab en Californie, de la même façon qu’il connaissait Sky Saxon du temps où il s’appelait encore Richie Marsh.
—On dirait du Chuck Berry, ton machin !
— Oui, tu as raison, c’est repompé sur «Johnny B Goode», mais ce n’est pas grave, tout le monde faisait ça à l’époque ! Tiens et ce «Ghost Train» par les Renegades ! Pur génie ! Comme dirait Miriam Linna dans sa présentation, c’est du jaw-dropping assuré. Il produisait aussi un groupe qui sonnait comme les Coasters, les Knights Of The Round Table. Kim voulait qu’ils montent sur scène dans des armures, mais ils n’ont pas voulu. Son idée a été reprise plus tard par les blackos de Parliament/Funkadelic qui montaient sur scène en armures et qui se battaient entre eux à l’épée. Tiens, et ça, «More Marathon» par Skip & Johnny, du garage d’antho - and round and round - qui préfigure l’un des plus gros coups de Kim Fowley, les fabuleux Belfast Gypsies. Alors là, on ne rigole plus. Tu vas trouver «Gloria’s Dream» des Belfast Gypsies sur une compile que tout amateur de rock éclairé devrait posséder, «Impossible But True - The Kim Fowley Story». «Gloria’s Dream», c’est l’heure de gloire de Kim Fowley. Il avait réuni les vestiges des Them après le départ de Van Morrison, c’est-à-dire les frères McAuley, pour enregistrer ce que je considère être le plus gros classique garage après «Gloria». Le problème encore une fois, avec ce genre de compile, c’est que tout est bon. Beaucoup trop bon ! Évidemment, c’est sorti sur Ace. Tiens écoute ça ! «Justine» par The Rangers ! C’est du punk avant l’heure et c’est d’une rare violence, tu ne trouves pas ? Et ça, c’est encore un cut diabolique des Rangers... «Reputation» !
— Tu devrais peut-être baisser un peu, parce que les voisins doivent encore dormir !
— Quoi ? Tu veux écouter ça en sourdine ? T’es folle ou quoi ? Tiens ! Je le mets à fond ! Fuuuuuck the neighbours !
— On sonne à la porte... Démerde-toi avec les voisins et baisse le son, on ne s’entend plus là-dedans !
— Si tu y vas, je te fais un bisou, d’accord ?
— D’accord. J’y vais...
— Attends Rox, tu ne vas pas y aller dans cette tenue, quand même !
— Et alors ?
— C’est bon, reste assise, j’y vais !
Traversé rapide du couloir. Ouverture de la porte. Le voisin docker en robe de chambre, avec un grand sourire aux lèvres.
— Bonjour m’sieur, excusez du dérangement, j’ai été réveillé par vot’ musique...
— Désolé... Un petit moment d’égarement. Ça ne se reproduira plus.
— J’crois que vous avez rien pigé. C’est quoi vot’ musique ?
— Les Rangers...
— Vache de bien ! C’est un groupe d’où ?
— Venez, entrez, on va boire un café et je vais tout vous expliquer ! Vous connaissez Kim Fowley ?
— Non.
— On va arranger ça.
Signé : Cazengler, complètement fowleyssivé
Disparu le 15 janvier 2015
Kim Fowley. Love Is Alive And Well. Tower 1967
Kim Fowley. Outrageous. Imperial 1968
Kim Fowley. Born To Be Wild. Imperial 1968
Kim Fowley. Good Clean Fun. Imeprial 1968
Kim Fowley. The Day The Earth Stood Still. MNW Swenden 1970
Kim Fowley. I’m Bad. Capitol Records 1972
Kim Fowley. International Heroes. Capitol Records 1973
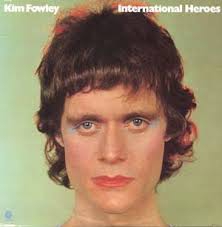
Kim Fowley. Animal God Of The Street. Skydog 1974
Kim Fowley. Living In The Streets. Sonet 1977
Kim Fowley. Sunset Boulevard. PVC Records 1978
Kim Fowley. Snake Document Masquerade. Antilles 1979
Kim Fowley. Automatic (Kim Fowley’s Story part Two). Secret Records 1980
Kim Fowley. Son Of Frankenstein. Moxy Records 1981
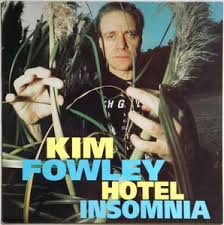
Kim Fowley. Hotel Insomnia. Marilyn Records 1992
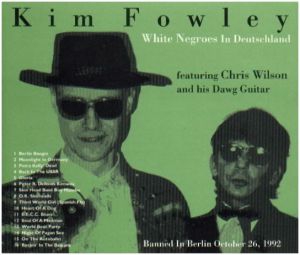
Kim Fowley & Chris Wilson. White Negroes in Deutschland. Marilyn Records 1993
Kim Fowley & Rubberton Freaks. The Wormculture. Alive Records 1994
Kim Fowley. Bad News From The Underworld. Marilyn 1994
Kim Fowley & Ben Vaughn. Kings Of Saturday Noght. Sector 2 Records 1995
Kim Fowley. Let The Madness In. Receiver Records 1995
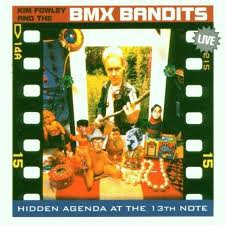
Kim Fowley & The BMX Bandits. Hidden Agenda At The 13th Note. Receiver Records 1997
Kim Fowley. Michigan Babylon. Detroit Electric 1998
Kim Fowley. The Trip Of A Lifetime. Resurgence 1998
Kim Fowley. Sex Cars And God.
Kim Fowley & Roy Swedeen. The West Is The Best. Zip Records 2003
Kim Fowley. Fantasy World. Shoeshine Records 2003
Kim Fowley. Adventures In Dreamland. Weed Records 2004
Kim Fowley & John York. West Coast Revelation. Global Recording Artists 2011
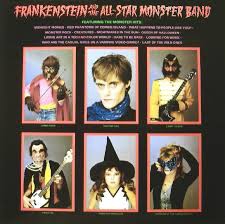
Kim Fowley is Frankenstein And The All-Star Band. Fuel 2000 Records 2013
Kim Fowley. Detroit Invasion. The End Is Here 2014
Impossible But True. The Kim Fowley Story. Ace Records 2003
One Man’s Garbage. Lost Treasures From The Vaults 1959-69 Volume One. Norton records 2009
Another Man’s Gold. Lost Treasures From The Vaults 1959-69 Volume Two. Norton Records 2009
King Of The Creeps. Lost Treasures From The Vaults 1959-69 Volume Three. Norton Records 2012
Technicolor Grease. Lost Treasures From The Vaults 1959-69 Volume Four. Norton Records 2014
Kim Fowley. Lord Of Garbage. Kick Books 2012
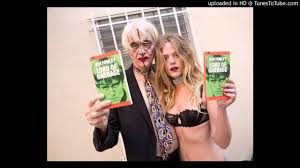
MONTEREAU-FAULT-YONNE
07 – 02 – 15 / LE BEBOP
PULSE LAG / MARIANNE / K-RYB
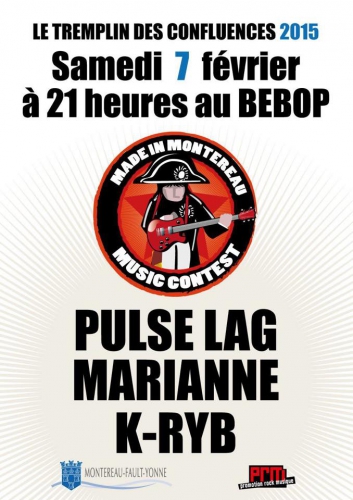
Ouragan de plaisir sur la maison, trois chats, trois chevaux, trois jeunes filles ont squatté la demeure. Je ne vous raconte pas le ravissant chaos. Une semaine pleine. Du coup je n'ai pas pu me rendre au concert des Howlin' Jaws à Paris la semaine dernière et ce samedi soir maintenant que le calme est revenu il est trop tard pour filer à Troyes au concert des Ringstones. Pas de 3B, ce qui n'empêche pas malgré l'heure tardive d'appliquer le plan B. En un quart d'heure, je puis être à Montereau, suffit que la Teuf-teuf accélère un peu et brûle quelques feux rouges. Fait un froid de loup, la route est déserte et mon fidèle carrocksse file sur l'asphalte gelé comme le démoniaque engin de Robur Le Conquérant. Rien à dire, quatorze minutes dix-sept secondes plus tard, je m'engouffre dans le Bebop. Comme le héros de Jules Verne, je suis le Maître du Monde.
Du monde mais pas la foule des grands jours. L'est vrai que la bise est glaciale et vous invite à rester chez vous. C'est pourtant la première soirée du Tremplin des Confluences pour les groupes régionaux, avec à la clef, un passage sur une des scènes du festival Confluences de Montereau. L'y est déjà passé du beau monde, Lou Reed, James Brown et Blue Oyster Cult.
PULSE LAG

Déjà rencontré au tremplin de Meaux, il n'y a même pas un mois ( voir KR'TNT 218 ), tellement obnubilé par le jeu des guitaristes et de la chanteuse que j'en ai oublié de parler du batteur. Impossible de le zapper aujourd'hui sur l'étroite scène du Bebop. Surtout qu'il a une belle frappe compacte et ogivale. Par ce dernier adjectif j'entends qu'il délimite avec une extrême précision l'espace musical, l'écrin rockailleux dans lequel ses trois autres complices vont tresser leurs interventions. Coincée entre les deux guitares Margot n'a guère de place. Par contre elle a de la voix. L'en fait ce qu'elle veut. Elle est le centre convergent du groupe, au point focal de la perspective rétinienne, mais elle donne à chacune de ses interventions l'impression de surgir de nulle part. Surprend toujours. Elle l'arrache, un squale qui attaque au moment où on l'attend le moins, alors que l'on le guette et que l'on ne le quitte pas des yeux, un vocal qui resplendit et qui illumine, gorgé de soul et de hargne. N'en profite pas, ne passe pas son temps à discourir, dit ce qu'elle a à dire, et se tait, se colle au micro et laisse à ses acolytes le temps de s'exprimer. Parfois elle pousse l'humilité jusqu'à s'accroupir afin que l'on puisse mieux saisir le fraternel duel de la guitare de Théo et la basse de Thomas. De la belle ouvrage, du piqué-brodé sur doublure. Moins funk qu'à Meaux, plus subtilement rock and roll. Un jeu frotti-frotta, ôte-toi de là que je m'y mette, pousse-toi un peu que je te montre, mais sans aucune animosité, ne se marchent jamais sur les pieds mais s'interpellent amicalement, on laisse au confrère le temps d'être incisif et on répond en doublant la mise. Avec Tristan qui tomme par derrière pour planter les pieux du paddock, c'est un régal de les écouter. Ça tourne à la perfection comme une horloge suisse et ça coupe comme un couteau helvète. Et voici Margot qui vient nous rappeler qu'un combo de rhythm and rock sans lead singer c'est comme un coffre sans trésor. L'a compris quelque chose d'important – il existe une pléthore de soul women dont on peut s'inspirer, mais il ne faut pas se focaliser sur une seule et surtout ne pas chercher à imiter. Construit son propre phrasé, mon larynx et rien d'autre. Une personnalité qui s'affirme et qui rayonne. Se laisse emporter, par elle-même, sur le morceau final elle nous livre un impro-scat délirante qui laisse la salle pantoise. En plus ils jouent leurs propres compos. Pas des trucs informes qui tiennent davantage du recueil de citations, point de ces infâmes miscellanées fourre-tout de forts en thèmes qui recrachent sans âme leurs leçons apprises par coeur. Non de véritables architectures sémantiques, pas des châteaux de cartes prêt à s'écrouler à la moindre brise. Font preuve de maturité, de réflexion, de feeling cérébral. A tel point que le set terminé un de mes voisins se demande s'ils ont pensé à protéger leurs créations par un quelconque copyright. Quarante minutes dont il n'y a pas à jeter une seconde.
MARIANNE

Encore un groupe déjà croisé. Ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. C'était en juin dernier au festival de Romilly-sur-Seine ( voir KR'TNT ! 197 ) en première partie de Washington Dead Cats, mais j'ai fini par reconnaître Alex le chanteur. Une voix qui porte ( et fenêtres ) qu'il peut égosiller à volonté. L'est devant et les autres derrière. David et Thom aux guitares, un nouveau bassiste qui donne là son premier concert avec le combo, et Flo le batteur. Tout ce monde se démène comme de beaux diables. Un, deux, trois et c'est parti. Qu'importe si l'on n'arrive jamais. C'est à fond de train et au grand galop. Les effets de style à la Marquise de Sévigné, ce n'est pas le genre de la maison. Le rock and roll ne respecte pas les règles c'est bien connu. Les paroles des morceaux vous mettent les circonflexes sur les e qui en oublient d'être muets. C'est un rock pour malentendants. Toute la gomme dans les sonotones et ça tamponne dans les tympans crevés. N'ai rien contre. Le rock cavale ou crève l'oreille ouverte ne me déplaît pas, mais il faut éviter la monotonie. Alex ne chante pas vraiment, il pousse la loco un peu hors des rails mais sans engendrer les catastrophes espérées, adopte trop souvent un phrasé qui flirte avec le rap. Des lyrics à dominante sociale qui dénoncent le mal-être dans nos têtes. Des textes à la démonte-pneu, qui manquent un peu de finesse. A leur décharge je reconnais que ce n'est pas facile ni d'ajuster la langue de Molière au rock and roll, ni de l'expectorer en la rendant aussi coupante que le coutelas d'abordage de l'anglais. Efficace mais un peu brut de décoffrage. Marianne manque d'un soupçon d'originalité. Doit y avoir trois cents groupes en notre bel hexagone qui atteignent un tel niveau. Mais ce n'est qu'un début, le minimum de qualité requis pour changer de tablature, faudrait viser une subtilité instrumentale plus originale. Sympathique mais pas transcendantal.
K-RYB

Il n'est jamais trop tard pour faire des expériences. Première fois que j'assiste à la présentation d'un groupe de hip hop électro. D'habitude j'évite. Le peu que j'entends à la radio ne m'incite guère, à poursuivre plus avant. Mais là, je suis bloqué, si je veux assister à la proclamation des résultats, faut bien que j'écoute le troisième concurrent. Deux gars d'allure sympathique et plutôt timides qui sont longtemps restés assis près de moi. Echangeaient des regards interrogatifs pendant que Marianne faisait pleuvoir ses ondées tempétueuses de guitares électriques. Perso, je pense que le jeu est un peu faussé d'avance, faire concourir un groupe non instrumental avec des combos traditionnels c'est un peu comme participer au Vents des Globes avec une barque à rames. En tout cas nos deux naufragés ne se défilent pas. Eric installe sa platine sur une table et K-Ryb au micro. L'Eric s'active sur ses boutons qu'il manipule à foison. L'en sort une musique un peu aigrelette, je m'attendais à une rythmique implacable, un beat d'enfer suffocant qui vous concasserait la moelle épinière, mais non, c'est tout doux, tout gentil, tout mignon, une quasi imitation de violons synthétisés dans le style variétoche larmoyante. J'entrevoyais déjà le rougeoiement des cités enflammées, mais non, ce sont des tendres, regrettent la laideur du monde et de notre quotidien, pleurent sur la mort de l'épouse bien aimée, toute une partie du public – sont venus pour eux - balance la main pour marquer la mesure, l'on se croirait à l'Eurovision. Pas vraiment très rock. Par contre le K-Ryb vous balance des textes longs de six kilomètres sans hésiter une seule fois. Une performance mémorielle devant laquelle je m'incline. Que voulez-vous que je vous dise ! Je ne fais pas partie de cette mouvance, sont à vingt mille lieues ( sous la mer ) de mes préférences musicales. Je leur souhaite tout le bonheur possible dans leur entreprise...
RESULTATS
On ne vote pas. Il y a un jury prévu pour cet office. Nous ne saurons jamais de qui il est composé au juste. Vingt minutes d'attente et voici la proclamation des résultats. Troisième position K-Ryb, sage et logique décision. Deuxième : Pulse Lag. Premier : Marianne, pour leur professionnalisme est-il précisé. A ce compte-là j'ai préféré « l'inexpérience » de Puise Lag. Même si Marianne n'a pas totalement démérité. Puisque je n'ai en aucune manière droit au chapitre – et n'aimerais être membre d'aucun petit comité décisionnel de ce genre, tout en étant bien conscient qu'une décision collective puisse s'avérer aussi aberrante – je n'ai plus qu'à retrouver la fringante teuf-teuf mobile qui hennit d'impatience à l'autre bout de la rue. L'a compris que dans la vie il faut que ça pulse. Lag.
Damie Chad.
HANK WILLIAMS & FRIENDS
THE RAMBLIN'MEN
MOVE IT ON OVER

HEY GOOD LOOKING / LONE GONE LONESOME BLUES / LOVESICK BLUES / THERE A TEAR IN MY BEER / WHEN THE HOOK OF LIFE IS HEAD / MY SWEET LOVE AIN'T AROUND / KAW LIGA / RAMBLIN MAN / I'M SO LONELY I COULD CRY / YOUR CHEATIN' HEART / ROCKIN' CHAIR MONEY / MOVE IT ON OVER
MICHEL BRASSEUR / COLIN PETIT / CHRISTOPHE GILLET / FABRICE MAILLY / GUS / THIERRY SELLIER / GUILLAUME DURIEUX / ETIENNE DOMBRET / JAM JAM / ALAIN CHINA / MARC DESCAMPS / HERVE LOISON
Chickens Records / 2014.

Les cent ans du rock and roll. A Tournai. Ne comptez pas sur vos doigts. N'est pas aussi vieux que cela. Mais toutes les idées qui vous invitent à faire la fête sont bonnes. Tout a commencé lorsque Michel Brasseur et Hervé Loison se sont aperçus qu'ils atteignaient en même temps l'âge canonique de cinquante ans. Ont décidé de fêter leur jubilé ensemble. Presque, avec leurs groupes Smooth And The Bully Boys pour le premier et Hot Chikens pour le second, et quelques invités de marque comme Steve Hooker, Lubos Bena & Bonzo Radvany, Victor Huganet, Charlie Roy & The Black Mountain, douze heures de show ininterrompu... L'occasion était trop belle, se sont retrouvés à douze pour enregistrer un disque, les apôtres se sont trouvés un dieu digne de leur folie : le père putatif du rock and roll : Hank Williams. L'enregistrement s'est déroulé à la bonne franquette, certains étant présents sur quelques titres, d'autres sur beaucoup, chacun selon son instrument, voire sur plusieurs. Au résultat une croustillante galette dont nous nous empressons de goûter toutes les parts.
J'avoue avoir imaginé le pire quand Hervé Loison m'a tendu le disque : « Que des morceaux de Hank Williams, mais pas trop plan-plan tout de même ! » Avec ces énergumènes j'ai une fraction de seconde imaginé le pire. Une course à la mort post-punk pro-garage, genre Never Mind The Bollocks en plus speedé. Le Hank William découpé à la machette, essoré à la machine à laver et passé à la moulinette. Ça ne m'aurait pas déplu, car j'aime pousser les pépés dans les orties, mais alors pourquoi spécialement s'attaquer à l'immortel auteur de I'm So Lonely I Could Cry ?
Ben non, ne se sont pas conduit comme des vandales. Pourtant la piste était toute tracée, du yodel de Williams, suffit d'un glissement de glotte pour s'engouffrer dans les gloussements de gorge d'un Charlie Feathers, et hop un hoquètement de plus et nous voici dans les turpitudes vocales et grognassières d'un Jake Calypso. Bien non, nos garçons vachers amateurs d'hillbilly foutraque et de rockabilly épileptique n'ont pas été vaches, ont enfilé leurs habits du dimanche pour descendre en ville chez Uncle Hank. Ont simplement insisté sur l'aspect honky tonk de l'oeuvre. Z'ont laissé le fiddle au grenier et remisé la pédale ( pas la vha-wha, la sting ) à la cave et se sont contentés du minimum vital : contrebasse, guitare and drum. Un coup d'harmonica pour faire plus blues cow-boy que moi tu meurs, un soupçon de washboard pour montrer que l'on n'a aucune prévention contre les antiquités, et hop, c'est parti comme en quarante, pardon comme dans les forties.
Appliqués comme des enfants sages. S'agissait pas de se vautrer dans les coins. Total respect pour le grand-père mais pas non plus un job d'embaumeurs de cadavres dans la grande pyramide. Lui passent un sacré coup d'aspirateur sur les côtelettes. Lui font reluire l'osserie au kérosène. Ce n'est pas le grand bal de charité donné par la section des hémiplégiques du canton. En pleine forme les gus. Vous retaillent la charpente à grands coups de hache. Les vieilles poutres ils vous les changent par des poutrelles d'acier nickelés. Quel pied ! L'ancêtre Williams n'avait jamais osé sonner aussi Honky Thank ! Lui ont refait les rotules et changé la visserie. Lui ont retiré ses costumes démodés et bouffés par les mites et les ont remplacés par un perfecto de cuir noir inusable, avec un gros badge I Love Country ( pour ne pas dépayser les visiteurs ), quant au chapeau d'apparat de rodéo l'ont caché sous une meule de foin, et lui ont gominé la calvitie naissante. L'y gagne en prestance le pépère. L'en est le premier content. Tout joyeux. Pour un peu il nous danserait le hully gully, mais non ce n'est qu'une légère touche rock and roll. Imaginez qu'il ait vécu quinze ans de plus et que Hank et Elvis aient enregistré un disque en commun pour relancer leurs carrières respectives, le Williams aurait apporté ses compos et le Presley un peu d'électricité... Vous en rêvez déjà encore ? Ce n'est pas la peine, les Ramblin' Men l'ont fait.
MR WHITE
SINGS HANK WILLIAMS
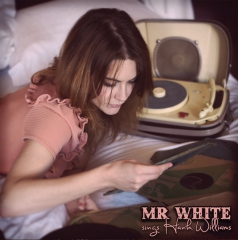
I'M GONNA SING / JAMBALAYA / I CAN'T HELP IT / CALLING YOU / NOBODY'S LONESOME FOR ME / I SAW THE LIGHT / ALONE AND FORSAKEN / HEY GOOD LOOKING / WON'T YOU SOMETIMES THINK OF ME / THERE'S A TEAR IN MY BEER ( live ).
2013.
Lui, ne s'y est pas mis à douze. L'a fait cela tout seul. Ce n'est pas que personne n'ait voulu l'aider, ce n'est pas qu'il pense qu'il est le meilleur de tous. Non c'est un solitaire. On ne l'a pas souvent aperçu dans le nord de l'hexagone – à ma connaissance il n'a commis que deux rapides apparitions parisiennes – mais c'est un lonesome cow-boy, débarque dans les bars et les saloons avec des bandes pré-enregistrées et ses guitares, et il vous fout à lui tout soul un souk d'enfer. Le lecteur se reportera à notre livraison KR'TNT ! 153 du 28 / 09 / 2013, et nous avons encore un de ses disques à chroniquer...
Seul, mais l'a quand même mis une jolie fille sur la pochette, a Lovesick Blue Girl, a Pink True Fine Nostalgia Gal for The Lovesick Blues Boy. L'en remercie deux autres dans les notes et cite quelques amis qui l'ont encouragé et aidé à enregistrer. Sinon il s'est chargé à lui tout seul de tout l'orchestre, guitares, basse, orgue, harmonica, cymbales... n'y a que pour le banjo qu'il a fait appel à Laurent Béteille et à Patrick Constant pour l'accordéon. Rien qu'à lire ce début de paragraphe vous commencez à entrevoir la réalisation du projet qui s'inscrit entre renouvellement et fidélité.
L'a bossé les arrangements, l'a redéfini les rythmiques, ne pas cloner, redessiner à son idée. A changé les couleurs musicales, a maté les documents d'époque pour s'inspirer. Ainsi sa version de I Can't Help It en duo avec Catia Ramalho est un clin d'oeil à celle donnée à la télévision ( sur NBC, la séquence est sur You Tube pour les esprits curieux ) par Hank Williams et Anita Carter qui fit partie de la queue de comète de la Carter Family, la formation ultérieure nommée Mother Maybelle And The Carter Sisters... De même son interprétation de Nobody's Lonesome For Me est précédé d'un document d'archive, Hank Williams s'apprêtant à chanter au Grand Ole Opry avec la merveilleuse voix... du speaker qui l'introduit. L'on se croirait sur un champ de course avec Sea Biscuit.
Ne reste plus qu'à chanter. Et Mr White s'en tire très bien. Ne nous lasse pas une seconde à jouer à Lassie, Chien Fidèle. N'est pas le vulgaire toutou collé aux basques du Maître. L'accompagne mais ne le suit pas. Chasse pour son propre compte. Suit ses propres pistes, ses siennes intuitions. Ne se colle pas un chewing gum entre les dents pour imiter l'accent du deep south made in Alabama ( sweet home ). Ne nous la fait pas non plus à la Oxford-Cambridge, le cul aussi pointu que le gosier, nous le fait à la Mr White et l'on n'en voit pas de toutes les couleurs. Pas le temps de s'ennuyer. Chaque morceau est un parti-pris et une invention.
Iconoclaste parfois. Son I Saw The Light accentue l'aspect aérien que Williams donna à ce gospel. Avec Mr White, l'on donne carrément dans la joyeuseté irrespectueuse, l'on sent le fagot. Tant que l'on aborde ce douloureux problème, je ne voudrais pas attirer les foudres de l'inquisition, mais son autre gospel I'm Gonna Sing, avec son exubérance de nègres dévoyés ne pourrait qu'inquiéter le Klu Klux Klan. Le gumbo de Jambalaya est avalé en une seule goulée qui accentue son typique aspect de fête orléanaise. Dans la même veine le Calling You n'est pas s'en rappeler le traditionnel Colinda. Un appel à la danse, au plaisir païen de secouer son corps, Mr White nous offre un Hank Williams souriant et heureux de vivre. Jusqu'à Nobody's Lonesome For Me qui nous est vaporisé sous une forme quasi guillerette. Et le reste à l'avenant, même si l'harmo sur I Can't Help It tire vers la tristesse du blues.
Hank Williams en joyeux drille ? Hank Williams en gai-luron ? Chassez le naturel, il revient au galop. Alone And Forsaken – dont le chant de Williams n'est pas sans préfigurer la violence de Dylan - ici récité comme un poème de Wordsworth étale les plis noirs du désespoir. Encore plus sinistre avec ses nappées d'orgue mortuaire que la version de Williams elle-même. Une parfaite réussite. Une roche noire et solitaire qui projette son ombre funérale sur tout le disque. Retournement de situation. Mr White a compris Hank Williams beaucoup plus profondément qu'il n'y paraît. Derrière le rire, l'angoisse. Au bout de l'existence, le néant de la mort. Mr White a su tirer le rideau noir.
HANK WILLIAMS
JAMBALAYA
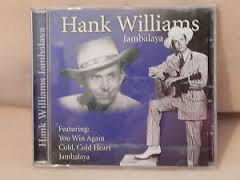
LOVESICK BLUES / YOU WIN AGAIN / COLD COLD HEART / JAMBALAYA / WEDDING BELLS / ( LAST NIGHT ) I HEARD YOU CRYING / YOUR CHEATIN'HEART / I'LL NEVER GET OUT THIS WORLD ALIVE / HEY GOOD LOOCKIN' / I CAN'T HELP IT ( I'M STILL IN LOVE WITH YOU ) / WHY DON'T LOVE ME / RAMBLIN' MAN / I SAW THE LIGHT / THE LOST HIGHWAY / I'M SO LONELY I COULD CRY.
Black Cat 2003.
Indépassable. Insurmontable. Inimitable. Et pourtant dès les premières notes l'on entre dans un autre monde. Cette voix nasillarde, cet accent traînant, cette pedal-steel guitar qui pleure en sourdine, ce violon qui gémit, bienvenue au pays des cow boys de pacotille. Il y a longtemps que l'Ouest n'existe plus, l'on est bien après la grande dépression, l'on a même franchi victorieusement la deuxième guerre mondiale. L'Amérique domine le monde. N'y a que dans le cœur des hommes que tout va mal. Hank Williams sera le transcripteur du malaise existentiel de ses contemporains. Les loosers au lonely heart ont leur chantre. Mais le personnage est beaucoup plus ambigu qu'il n'y paraît. Faut entendre en contrepoint comme il se fout des chagrins d'amour dans ses roucoulements yodélisés. N'existe pas de chanteur plus désenchanté que le souriant Hank Williams. Vous écrivait de sublimes chansonnettes à la chaîne. Tout le monde ne peut pas être enfermé à Perchman. Le blues du blanc c'est lui. L'habit ne fait pas plus le moine que le cow-boy d'opérette. Whisky, morphine et os en miette. Le country man était du moule dans lequel on fait les Gene Vincent. Un rocker dans l'âme qui épuisait les chants du possible. Trop lucide pour croire en la possibilité de la révolte. Et Elvis n'avait pas encore ouvert l'hôtel des coeurs brisés. Ses chansons comme un aller-simple sans retour vers nulle part. Pas étonnant que souvent dans les ponts – l'est rusé, aime se la couler douce, donne tout l'espace à ses Drifting Cow-boys - l'on entend le souffle chuintant du shuffle interminable. Comme la locomotive en cavale du père toujours absent... Le premier à faire une carrière. Sans Colonel Parker pour tracer les limites. Son exemple a dû beaucoup faire réfléchir Elvis. N'y a pas que les chansons à succès dans la vie, il y a aussi la vie, et ça c'est beaucoup plus difficile à gérer. Williams n'a pu compter que sur sa famille, sa soeur, sa femme. Pas pour rien qu'il n'était pas mort depuis trois mois que naissait – une rendue pour deux prêtées - sa fille naturelle. Conçue hors mariage. Comme un ultime pied de nez à cette lumière d'absolue moraline qu'il décrétait avoir vue. Le blues est la musique du diable et le honky tonk celui de l'absence de dieu. Malgré son succès, sa position de vedette, Hank fut un solitaire, blessé au plus profond de lui. Essayait de se racheter une conduite sur la banquette arrière de sa voiture. C'était déjà trop tard. L'est arrivé au terminus trop tôt.
Nous reste ses chansons. M'ont toujours fait penser à une éponge imbibée de tristesse que l'on presse entre ses mains pour en chasser l'eau croupie. Mais il en reste toujours une dernière goutte. Celle qui s'infiltre dans votre âme et qui vous inocule le bacille du désespoir à la première seconde. Prend bien soin de vous, fait tout ce qu'il peut pour vous dissuader d'y porter la main. Sourire niais et parole à l'eau de rose. Je t'aime, toi non plus. Une savonnette pour glisser dessus et vous enfuir avant d'être pris dans les rets du spleen. Hank Williams c'est comme l'alcool, vous savez qu'à forte dose, cela va vous faire du mal. Mais vous retâtez du goulot sans regret comme le nourrisson qui tête sa mère. Une drogue. Douce. Dure. Comme vous voulez. Tout dépend de la manière dont vous la regardez. Mais l'on y revient. Pas une simple dose, tout un disque entier. Question de mesure. L'on prend tous les risques. Car le grand Hank est au fondement de tout. Un cador de la musique populaire américaine, l'idole d'avant le rock and roll blanc. Celui qui fit la liaison entre le honky tonk et le western swing. Celui qui en quelque sorte coupa les amarres pour que le bateau ivre de ce qui allait devenir le rock and roll puisse prendre sa course dans les torrents. Rafting Williams. En eaux troubles.
Damie Chad.
21:54 | Lien permanent | Commentaires (0)
04/02/2015
KR'TNT ! ¤ 221. ERVIN TRAVIS / JACK BRUCE / JOAN BAEZ / CHARLEY PATTON
KR'TNT ! ¤ 221
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
05 / 02 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / JACK BRUCE / JOAN BAEZ / CHARLEY PATTON |
ERVIN TRAVIS
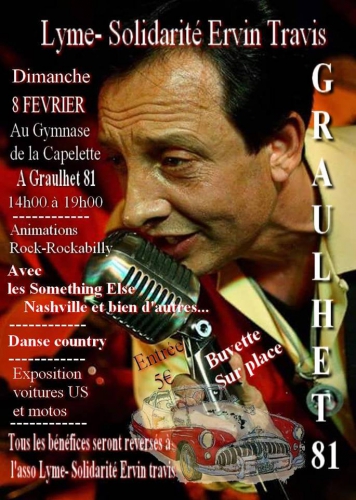
Nous le répétons, Ervin Travis ne va pas bien. Miné depuis longtemps par la terrible maladie de Lyme, il est actuellement dans une phase d'évolution critique qui nécessite des soins coûteux qui ne peuvent être dispensés qu'en Allemagne. Nous sommes de tout coeur avec lui dans ce combat. Mais par rapport à la semaine dernière, la donne a changé, les messages de solidarité affluent sur le facebook Lyme – Solidarité Ervin Travis - et déjà sont prévus deux concerts de soutien dont nous avons mis une affiche ci-dessus. Toutes les initiatives seront biens reçues. Amis rockers, à nous de jouer. Toutes nos sympathies à Ervin.
BRUT DE BRUCE
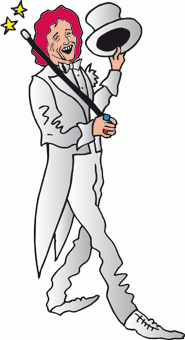
— Ça n’a pas tenu ?
— Non.
— Pas de chance, Jack...
— Tu l’as dit...
— À tous les coups, ils t’ont greffé un foie pourri...
— J’en sais rien, mec. Par contre, je sais que j’en avais assez. J’avais constamment la gerbe. Avec la vie que j’ai menée, c’est normal qu’un truc ait fini par lâcher. On est bien peu de chose, mec, c’est mon amie la rose qui me l’a dit ce matin.
— Tu as commencé à te shooter de bonne heure, d’après ce qu’on raconte...
— Comme j’étais fasciné par les jazzmen qui étaient tous des junkies, y compris Charlie Mingus, j’étais forcément fasciné par les drogues. À mes yeux, c’était un style de vie. Je voulais faire partie de ce monde-là. Je vénérais Charlie Haden et Scott LaFaro, junkies notoires. Tu sais par qui Ginger fut initié à l’héro ?
— Phil Seaman ?
— Non, Dicky Devere. C’était facile de se procurer de l’héro à Londres jusqu’en 68, car les docteurs la prescrivaient, notamment Lady Isobel qui signait ses ordonnances sur la banquette arrière de sa Bentley. Ginger faisait partie de ses patients, comme d’ailleurs Chet Baker et Dexter Gordon quand ils étaient de passage à Londres. Je me suis toujours shooté direct, je ne la sniffais pas comme le faisaient Eric, Leslie West ou Corcky Laing, je voulais le vrai truc, celui de Charlie Parker, de William Burroughs ou d’Anna Kavan, tu vois ce que je veux dire ? Ginger disait tout le temps qu’il ne pouvait pas bien jouer s’il n’avait pas pris un hit. Même chose pour moi. J’avais une vision purement romantique de tout ça. Je voyais un monde et je ne pouvais l’explorer qu’à la lumière d’un shoot d’héro. Avec Leslie West et Corky Laing, on a battu tous les records ! Tu vois, nous avions deux priorités. La seconde était la musique et la première l’héro.
— C’est l’époque des deux albums de West Bruce Laing ?
— Oui. Le cirque a commencé en 1972. Je m’étais pointé au studio au volant de mon Adams Probe, le coupé sport qu’on voit dans «Orange Mécanique», un modèle unique. Je remplaçais Felix qui était trop stoned.
— Pappalardi ?
— Oui. On a signé pour un million de dollars avec Clive Davis chez CBS. On tournait partout dans le monde. Leslie se goinfrait d’héro et de pâtisseries. Et moi je buvais comme un trou, en plus du reste. Dans l’avion, Leslie pétait. Il lui fallait deux sièges pour s’asseoir. Ce porc était ingérable. Mais sur scène, on s’entendait bien, car c’est un guitariste très mélodique, avec une vraie niaque.

— À mon sens, West Bruce Laing fut l’un des plus gros power trios de l’histoire du rock, certainement bien meilleur que Cream ! J’ai adoré «Why Dontcha», ton premier album avec Leslie et Corky. Ça fourmille de hits terribles là-dedans, notamment «Out In The Fields» que tu chantes. Tu y développes une vision spectaculaire du mélopisme ambitieux et on entend Leslie glisser quelques giclées dans l’effroyable embrasement crépusculaire. Et dans «The Doctor», on t’entend lâcher des triplettes cavaleuses au gré d’invraisemblables dérives actives. Tu as une façon de jiver la jam qui m’en a bouché un coin. Toi et Leslie êtes vraiment deux furibards ! Et en écoutant «Pleasure», j’ai toujours eu l’impression que tu inventais des gammes qui n’existaient pas ! C’est dingue, non ? Et tu as cette façon de croiser tes lignes cavaleuses avec celles de Leslie, et ça, on ne l’entendait jamais dans Cream, où chacun semblait jouer dans son coin. Dans ce boogie dévasté qu’était «Pleasure», non seulement tu ramenais tout le feeling du monde, mais tu y shootais en prime une dose de folie virtuose. J’avais l’impression d’entendre le plus gros morceau de basse de tous les temps. Oh, il y a aussi ces riffs de piano et de guitare qui donnaient à «Scotch Knotch» une sourde atmosphère originale. Leslie y prenait un solo salace et toi tu glissais des lignes de basse ahuries ! Et puis «Pollution Woman» aurait très bien pu se retrouver sur «Disraeli Gears», non ?
— Normal, Pete Brown l’a co-écrit avec moi, comme tous les hits de Disreali.
— Cette façon que tu as de chanter ça, décalée, à contre-pied. Ce cut est d’une modernité qui défie toute concurrence. Tu la dotais de tous les parements d’une ambition démesurée. J’ai aussi adoré le deuxième album.
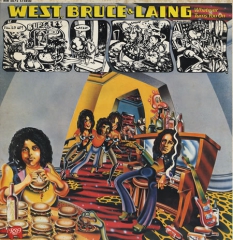
— J’ai fini «Whaterver Turns On You» tout seul à Londres. Leslie et Corky avaient quitté le groupe, épuisés. Ils étaient rentrés à New York.
— Ah bon ? Pourtant l’album sonne comme celui d’un groupe au sommet de sa forme ! J’adore la puissance et la heavyness de «Token», ce cut bovin, gras et muddy qui vire à la jam informelle. J’étais aussi subjugué par «Sifting Sand». L’incroyable de cette histoire, c’était que Leslie et toi vous pouviez vous entendre sur des terrains aussi aventureux. L’étrangeté y prédominait de manière endolorie, l’écho se chargeait de nappes égarées et de bribes mélodiques oubliées de Dieu. C’était incroyable d’entendre un truc comme ça dans l’album d’un power trio sur-puissant. Et tu continuais à filer dans les eaux molles de la nature morte avec «November Song». Tes manèges faisaient bon ménage avec les pachydermeries de Leslie et tu nous chantais ça de ta voix perchée. Et puis Leslie aimait bien revenir à ses routines montagnardes, comme avec «Rock And Roll Machine». Il retrouvait ses vieilles tendances défenestratrices, son jus sortait par tous les orifices du morceau, et toi tu multipliais les retours de manivelles, les départs de gammes insensées, les déviances impardonnables, les allers secs et tu finissais par rejoindre le thème comme si de rien n’était. C’est vrai que Ginger te reprochait d’en faire trop ?
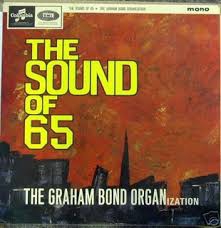
— C’est une vieille histoire qui remonte à l’époque où on jouait avec Graham Bond. Il me disait que mes basslines étaient trop «busy». Il me reprochait d’en faire trop. Mais je ne faisais que jouer la mélodie, comme la jouaient tous les grands bassmen de Motown et James Jamerson en particulier ! Comme j’avais réponse à tout, Ginger ne pouvait plus me schmoquer, alors il m’a collé une lame sous le nez et m’a dit de dégager. J’ai dû quitter le groupe. C’est Eric qui m’a fait venir dans Cream. Je croyais que Ginger s’était calmé. Pas du tout. Il me reprochait tout le temps de jouer trop fort. Il s’en prenait toujours à moi. Je me souviens de lui avoir sauvé la vie, un nuit où il avait overdosé. En revenant à lui, il m’a remercié en me disant d’aller me faire enculer. Pas mal, hein ?
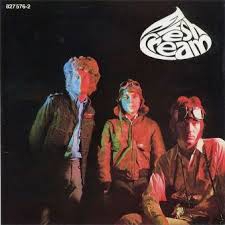
— Eric et Ginger peuvent te remercier, car sans toi, Cream serait resté un groupe de blues-rock ordinaire. Il n’y a qu’à écouter «Fresh Cream», le premier album, pour voir que c’était mal barré. Vous repreniez «I’m So Glad» de Skip James. Il a touché des royalties ?
— Je m’en suis occupé personnellement. Quelques années plus tard, on faisait une balance pour un concert de West Bruce Laing aux États-Unis. Une petite bonne femme noire attendait dans un coin. Elle voulait me voir. Et tu sais pourquoi ?
— Euh...
— Elle voulait me remercier. C’était la veuve de Skip James. Elle venait me dire que grâce à cet argent, Skip James était mort dans la dignité.
— Bon d’accord, mais il n’empêche que «Fresh Cream» n’était pas très bon. À la même époque, Peter Green et Alvin Lee faisaient de bien meilleurs albums ! Par contre, avec «Disraeli Gears», on a eu l’impression très nette que tu ramenais dans le groupe une sorte d’exigence mélodique. Les chansons que tu composais avec Pete Brown...
— Pas Pete, Pit !
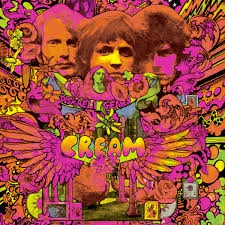
— Oui, Pit Brown, les chansons que tu composais avec lui s’élevaient comme des montagnes à travers les brumes psychédéliques. Ces chansons étaient d’une effarante modernité ! C’est quasiment le seul album où Clapton a su tenir son rang de God. Mais il bénéficiait d’une conjonction idéale puisqu’il liait son destin au tien. Il suffit de ré-écouter «Strange Brew» pour réaliser à quel point tu étais bon. On entendait tes notes de basse voyager à travers le velouté bien gras que sortait Clapton sur sa SG - Strange brew killed what’s inside of you - Ce hit fa-ra-mi-neux a bercé mon adolescence, au moins autant que «Helter Skelter» ou «Strawberry Fields». Tu incendiais les plaines infinies de mon imaginaire. Tu me faisais découvrir l’onctueux. «Sunshine Of Your Love» est devenu le hit de Cream, mais ce n’était pas forcément le meilleur morceau de l’album. Le vrai hit de «Disraeli Gears» se trouve en face B. C’est «Swchllbbrrr». Jamais réussi à le prononcer. Comment tu prononces ça ?
— Swlabr !
— Swchllbbrrr ?
— Non ! Swlabr ! Ça veut dire She Walks Like A Bearded Rainbow !
— Bon, bref, tu démarrais sur une grosse attaque - Come to me in the morning leaving me at night - et ça prenait aussitôt l’allure d’un hit parfait, tenu par des liants bien gras. Clapton envoyait un solo racé et fin comme une anguille, puis tu reprenais à l’onctuosité du chat perché - So many fantastic colours makes me feel good - Alors le trio décollait comme l’hydravion d’Howard Hughes ! On trouvait d’autres merveilles sur cet album parfait, par exemple «World Of Pain», où le gras de ton chant se mêlait au gras de la guitare, ou encore «Dance The Night Away», qui est une pure élévation de mad psychedelia. Vous faisiez monter la sauce tous les trois avec un art consommé et ça filait dans le ciel étoilé comme un tapis volant. «Blue Condition» était un véritable chef-d’œuvre de laid-back - No relaxation no conversation no variation/ In a very dark blue blue condition - On sentait bien les abus. Il y avait encore plus léthargique : «We’re Going Wrong», que tu portais à l’harmonie vocale du navigateur en solitaire, mais avec une énergie considérable.
— L’enregistrement de cet album ne s’est pas très bien passé, en vérité. J’avais amené d’autres chansons en studio et notamment «Theme For An Imaginary Western», mais Ginger et Eric n’en voulaient pas. On a fait une démo, mais elle a disparu. Mystère et boules de gomme. En plus, Ahmet Ertegun voulait absolument qu’Eric soit le leader et qu’il chante. Pour lui, la star, c’était Eric. Moi, je devais rester dans un coin. Heureusement, Eric n’avait pas la grosse tête et il a insisté pour que ce soit moi qui chante.
— On retrouve «Theme For An Imaginary Western» sur ton premier album solo, non ?
— Oui, ça et «The Clearout» que j’avais aussi amené à la session de Disraeli.
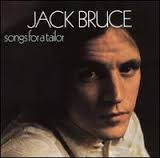
— J’ai adoré «Songs For A Taylor». C’est avec cet album qu’on a commencé à te suivre à la trace, nous autres les petits Français. J’étais dingue de Theme et ce côté mélopif mélodique à deux paliers qui va se perdre dans les lointains impétueux...
— C’est Chris Spedding qui jouait sur cette version.
— Wow ! Tu choisissais les meilleurs ! Avec Theme, tu semblais dominer le monde. Tu devenais une sorte de héros à l’Anglaise. «Weird Of Hermiston» impressionnait encore plus, sans doute à cause de cette veine jazzy et de ces tempêtes climatiques. Et «Never Tell Your Mother She’s Out Of Tune» aurait très bien pu se retrouver sur Disraeli, non ?
— Pour sûr ! Derrière, j’avais George Harrison et toute l’équipe de Colosseum, Dick Heckstall-Smith, Jon Hiseman...
— Tu chantais ça haut perché avec une sorte d’élégance byronienne et tu faisais brouter ta basse. On sentait en toi une sorte de détachement, comme d’ailleurs avec «Boston Ball Game». Avec les copains au lycée, on disait que ce morceau était très décollé de la routine, tellement il allait à contre-courant des tendances d’alors. La cerise sur le gâteau était bien sûr «To Isengard» que tu chantais à la glotte perchée et que tu dotais d’un final jazz-rock éblouissant. On détestait le jazz-rock, mais bizarrement, on admirait le tien. L’album suivant fut aussi un bon régal. On s’est jetés sur «Harmony Row» comme le Comte Orloff sur une famille de paysans du Danube. Je me souviens d’avoir écouté à longueur de temps «Escape To The Royal Wood», d’avoir navigué au long de ce poème fleuve, sous les hautes falaises silencieuses. Ça avait même par son baroquisme un petit côté dada. J’aimais bien aussi «Morning Story» que je trouvais admirablement torturé. Je me disais qu’une chanson devait être fière d’être torturée par toi. Une sorte de démesure s’élevait de ce tas de notes. Tu n’as jamais su faire les choses comme les autres ! «Post War» était encore plus étrange !
— J’adore fondre trois chansons en une seule. C’est mon principe de surenchère.
— Et «Victoria Sage» ! Il semble que tout Mansun vienne de là. Mélodiquement c’est parfait et tu chantes ça d’une voix de castrat. Ensuite tu nous a bien roulé la gueule avec «Things We Like» ! Belle pochette, avec ta Ferrari et tes chiens, on est tous tombés dans le panneau et on s’est retrouvés avec un album de jazz dans les pattes !
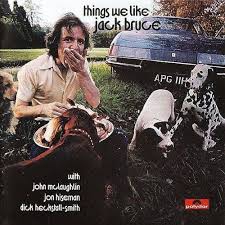
— Oui, je voulais faire un album de jazz. Ginger et moi on n’a jamais réussi à prendre la pop au sérieux. On venait du jazz. C’est la raison pour laquelle on était tellement à l’aise quand on jouait sur scène avec Graham Bond ! Mais la grande différence qui existait entre nous et les autres groupes anglais de la même époque - indépendamment du niveau technique - c’était l’attitude. Les rockers anglais des années 63 et 64 étaient appliqués. Ils s’ingéniaient à singer les artistes noirs qu’ils admiraient. Même les Stones et les Pretty Things s’appliquaient. Nous on ne s’appliquait pas. On swinguait. Aw mec, qu’est-ce qu’on a pu swinguer au Klook’s Kleek ! Ce n’est pas pour me vanter, mais on avait facilement dix ans d’avance sur tous les autres groupes de la scène anglaise. On était les hommes libres de la scène anglaise.
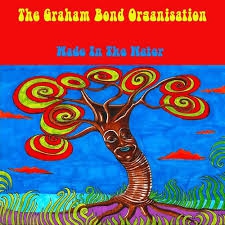
— Sur les photos de l’époque, on aurait pu vous prendre pour des gangsters de l’East End. Vous aviez des mines patibulaires et vous portiez des costumes stricts. Ce fut exactement la même chose pour les Flamin’ Groovies qui préféraient swinguer, alors que tous les autres groupes californiens se convertissaient au psychédélisme. Il y a deux ans, je me suis offert le coffret «Wade In The Water» du Graham Bond ORGANization et je peux bien t’avouer que je suis tombé au moins vingt fois de ma chaise en écoutant les quatre disques de ce coffret. Quand on écoute la version de «High Heel Sneakers», il ne reste plus qu’une chose à faire : recommander son âme à Dieu. Car cette version fusille les sens. Vous étiez vraiment des fous dangereux ! Ça tirait à boulets rouges. Tu étais le pire des quatre à cause de ton omniprésence dévastatrice. Tu sous-tendais tout. Tu portais le chaos. Tu semblais sortir d’une messe noire du chanoine Docre. Plus maléfique encore, Ginger faisait scintiller ses cymbales. Et Graham Bond était un screamer dément, le premier punk anglais. Il suffisait d’écouter «Half A Man», ce heavy blues cuivré qu’il chantait du gras de la glotte. Ce vieux Graham avait du génie ! On allait de surprise en surprise, même quand on avait la prétention de bien connaître les morceaux. Exemple : «Farewell Baby» était une pop-song, mais derrière, c’était l’enfer sur la terre : on entendait le beat souterrain du géant Ginger et tu claquais les boyaux de ta stand-up. Franchement, ça n’arrêtait pas. Déluge de swing sur déluge de swing. TOUS les morceaux sans exception relevaient de la monstruosité. Par exemple, «So-Ho», tellement typique de l’année 1964. On avait là un hallucinant festival de swing et tu partais en vrille. Du jamais vu alors, et du jamais revu depuis. Dans «Cabbage Greens», on trouvait les bases de ce qui allait devenir «Walking In The Park», la compo de Graham Bond qui allait rendre Colosseum célèbre. Le disk 1 du coffret était overdosaïdal, mais le disk 2 était encore pire ! On tombait sur une version punk de «Green Onions». «Long Tall Shorty» ? Monstrueux. Désolé, Jack, mais il n’y a pas d’autre mot pour qualifier ça. Vous souffliez le roof, comme vous dites en Angleterre. La version de «Long Legged Baby» était bourrée d’astéroïdes. Ça partait à fond de train. En comparaison, les punk-rockers de 1977 étaient des petits rigolos. Graham balayait tout sur son passage. Il aurait dû s’appeler Attila Bond. Il cavalait en tête. Absolument stupéfiant !
— On jouait rarement deux fois la même chose. Comme on était des musiciens de jazz, on improvisait en permanence.
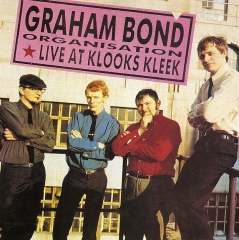
— Oh et puis cette version de «Hoochie Coochie Man» que Graham noyait sous ses grosses nappes d’orgue. Il yeah-yeah-yeahtisait à outrance et pilonnait le vieux classique de Muddy Waters. Et toi tu envoyais les chœurs. C’était tellement chauffé à blanc que ça semblait hors de contrôle. Il y avait aussi le fabuleux album «Live At Klook’s Kleek» dans lequel on t’entendait prendre un solo de basse sur «Big Boss Man». Ton solo sonnait comme un solo de guitare ! C’est à mon sens le plus grand solo de basse de tous les temps. Tout y était, l’invention, le jus, la jute, l’excuriation des abîmes collatéraux, l’impénitente épistémologie du beat métrique. Tu jugulais le jus, tu jouais avec le jive, tu gérais les génomes, tu ne jurais que par le jus !
— Il y a vraiment des moments où tu m’énerves un peu avec tes phrases ronflantes. Tu ne pourrais pas essayer de dire les choses plus simplement ? Parfois, j’ai l’impression que tu racontes des conneries aussi grosses que toi...
— C’est de ta faute, Jack, c’est toi qui m’inspires toutes ces déblatérations ! Que veux-tu, la fréquentation intensive des génies me fait perdre les pédales. Et encore, je t’assure que je fais des efforts pour ne pas trop m’éloigner de la quincaillerie des signifiants, mais ce n’est pas facile ! En tous les cas, j’espère que je ne porte pas ombrage à ton génie...
— Tu te fous de ma gueule ?
— Vous autres les Écossais vous êtes des gens bizarres. Je comprends mieux pourquoi Ginger avait tant de mal à te situer.
— Occupe-toi de tes oignons. Bon, tu commences vraiment à me fatiguer. Je vais aller faire un tour. Il y a un pub, dans le coin ?
— Mais Jack, tu es au paradis ! Tu ne trouveras que des rivières d’eau claire et des bois enchantés.
— Pas de salles de cinéma ou de clubs de jazz ?
— Non. Par contre, tu vas faire des rencontres intéressantes. Tu vas revoir des gens que tu connaissais et d’autres que tu admirais. Et la seule chose que tu puisses faire, c’est raconter ta vie, ou développer une pensée philosophique, si tu en as les moyens intellectuels. Mais avant que tu ne partes, j’aimerais bien te dire que j’ai a-do-ré toute l’époque où tu enregistrais avec Robin Trower !
— Oui, Robin et moi on s’entendait bien. Il avait un vrai son, comme Leslie, mais moins mélodique. Il était à la fois funky et hendrixien. Unique en Angleterre. Brillantissime ! J’ai toujours admiré ses albums, même au temps de Procol, et chaque fois que je le pouvais, j’allais le voir jouer sur scène.

— «Truce» était un bel album, en effet. Dans «Gone Too Far», on vous entendait vous amuser tous les deux comme des fous, Robin partait en solo et toi tu tricotais une bassline infernale. Le gros cut de cet album était «Fall In Love». Robin y tirait bien la caravane des rois mages au clair de lune. Après Leslie West, c’était pour toi le guitariste idéal, non ?
— C’est sûr. Dans «Shadows Touching», on jazzait à l’harmonie de la dérive. J’adorais jouer du funk avec Robin, comme dans «Fat Cut». Et Robin embarquait «Little Boy Lost» derrière le comptoir. Il n’avait pas oublié ses racines blues-rock.
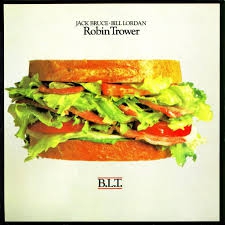
— «BLT» était aussi un bel album. On voyait bien qu’un cut bien gras, bien potelé comme «Into Money» avait été nourri à la ferme ! Et sur «No Island Lost», on sentait que vous vous entendiez comme deux larrons en foire ! Vous sortiez même le meilleur heavy blues d’Angleterre. Ah quelle tarpouillade ! Robin suivait ton chant au gras de guitare, note à note. Il faisait preuve d’une telle mansuétude ! On aurait eu tort de vous prendre pour des bricoleurs du dimanche, car vous faisiez littéralement partie des joyaux de la Reine. Oui, Jack, ce n’est pas la peine de me regarder comme ça, votre rock était du pur brut de prédilection. «Feel The Heat» semblait enthousiasmé de l’intérieur. Vous aviez une vraie santé compositale, en fait. Et au bout de ce disque qui était de nature à édifier les édifices, on tombait sur un heavy blues joué à la gloire du soleil couchant. Robin partait en solo et croisait délicieusement ta basse pouet-pouet. C’est dingue ce que vous saviez vous croiser, alors que dans Cream, c’était chacun pour soi, surtout dans les albums live. Mais l’album le plus dément que vous ayez enregistré, c’est bien «Seven Moons». Robin semblait alors au sommet de son art guitaristique. Et toi, dans «Lives Of Clay», tu semblais perché au sommet de ta grandeur. Tu avais un incroyable timbre de titan, yeah ! Et Robin prenait un solo dramatiquement recroquevillé. «Lives Of Clay» sonnait comme l’un des hits de Disraeli, à cause des solos en suspension de Robin et de ton jeu de basse. Les notes de guitare étaient rondes et belles comme des bulles. Ah quelle énormité ! Et «Distant Places Of The Heart» était encore plus lugubre que «We’re Going Wrong» qui se trouve sur Disraeli - Drift into the distant places of the heaaaart - C’était magnifique et désespéré - Hopeless past - Et l’incroyable solo de Robin était à l’avenant, puissant de noirceur ultimate. Et ça n’en finissait plus de ruer dans les brancards. Je me souviens de «She’s Not The One» dont tu stompais certains passages à la basse. Tous les solos de Robin sonnaient comme des événements telluriques d’une extrême violence, il suffisait d’écouter son killer solo dans «So Far To Yesterday» pour s’en convaincre. Je disais à mes copains : si vous tenez à savoir ce que signifie l’expression Géants du rock anglais, écoutez «Seven Moons». Mais ça les faisait rigoler. «Just Another Day» était un morceau lent, et forcément, Robin y plaçait un solo de rêve. Et toi tu mordais dans ta mélodie à pleines dents, enfin celles qui te restaient. Vous étiez vraiment deux pépères héroïques. Vous faisiez trembler les colonnes de la maison de retraite, pas vrai ?
— T’as vraiment un problème, hein ? C’est plus fort que toi, tu ne peux pas t’empêcher de te foutre de la gueule des gens !
— Mais enfin Jack, t’as plus vingt ans ! T’as vu ta bouille ? Regarde-toi dans un miroir ! T’es un vieux croûton, et c’est tout à ton honneur de rocker comme ça ! Aucun groupe anglais ne peut aujourd’hui sortir le son que vous sortez sur «Just Another Day», sauf peut-être les Wildhearts. Toi et Robin êtes des géants de l’âge d’or et c’est normal qu’à un moment on vous retrouve dans la salle des fêtes de la maison de retraite ! On va tous y passer, il n’y a rien de moqueur là-dedans. Tu as la gueule qui tombe, tu ronfles en dormant et tu fais chier ta poule qui ronfle aussi, tu perds tes dents et tes cheveux, voilà, c’est comme ça ! Mais ce que vous avez de plus que tous les autres, Robin et toi, c’est votre génie de rockers britanniques. Vos chansons résonnent dans le cosmos, au beau milieu du ballet des lueurs astrales. Et le funk mental de «Perfect Place» ! Robin y glougloutait ! Tu savais de quoi tu parlais quand tu chantais You gonna burn away too fast, pas vrai ? Et tu grimpais dans les octaves ! Et ça continuait comme ça jusqu’à la fin du disque avec des horreurs cataclysmiques comme «The Last Door», embarqué par un drive puissant et Robin balançait son napalm là-dedans et toi, Jack le diable, tu chantais sous le couvert, tout en disposant tes notes de basse cardinales. Vous étiez incroyables de férocité, tous les deux. Et cette ordure de Robin torturait son solo avec un acharnement punkoïde, arrghhh ! C’était à la fois irréel et aveuglant de splendeur. Désormais, on ne peut plus se passer des solos vitrioliques de Robin. Et vous ameniez un blues, oui, un vrai blues magique, un blues des enfers qui se moquait des modes. Pour moi, cet album est resté un diamant pur, un disque irréprochable, l’un des albums classiques du rock anglais - But how would I feel if this was happening to me ? Et «Come To Me» semblait sortir tout droit de Disraeli, avec sa heavyness et ses solos en suspension. Là, tu nous as tous bien bluffés, Jack !
— On a même ressorti cet album en version live, tellement on s’amusait bien à jouer ces morceaux !
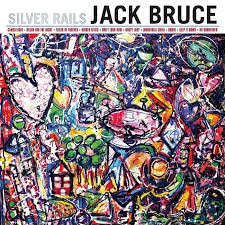
— J’ai bien aimé ton tout dernier album, «Silver Rails», qui s’ouvrait sur «Candlelight», du très haut de gamme mélodique. Et là tu parlais de la mort, comme Dylan dans son dernier album - The sunshine peels your skin/ The dance of death is on its way - Et je disais à mes copains : profitez-en les gars, vous n’êtes pas près de revoir passer un mec comme Jack ! Ils se pâmaient de rire quand je leur disais ça. Dans «Reach For The Night», tu revenais à la mort - You got so many miles/ Can’t just end dead/ Got rollin’ instead - tu pensais que tu ne pouvais pas mourir après tout le chemin que tu avais parcouru, pas vrai ? Et Robin revenait jouer avec toi sur ce fabuleux blues-rock qu’est «Rusty Lady». Sacré Robin, on l’entendait faire la corne de brume vers la fin du cut. L’autre merveille de cet album était «Industrial Child», avec sa mélodie suspendue dans le temps, à peine pianotée. Mais là où tu as encore réussi à nous bluffer, c’est avec «Drone» que tu jouais à la basse fuzz, seul avec un batteur. Alors là, bravo. Car c’était quelque chose de surnaturel.
— Je n’ai besoin de personne en Harley David-son !
— Alors faut-il considérer que «Keep It Down» est ta dernière chanson ?
— Je crois que le compte y est. C’est assez con à dire, comme ça, mais je préfère être mort, car je ne souffre plus. Si tu veux écouter des chansons de Jack Bruce, tu as de quoi faire avec tous ces albums enregistrés depuis cinquante ans, tu ne crois pas ?
— C’est drôle que tu me dises ça... Regarde ! La seule chose que j’aurais voulu ramener ici, c’est ce beau coffret blanc qui s’appelle «Can You Follow».
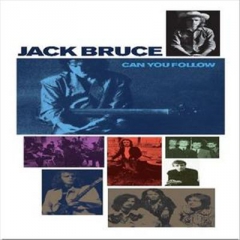
— Ah oui ! J’ai veillé à ce qu’il soit assez complet. Ça commence avec Cyril Davies et le Graham Bond Quartet. Tu as aussi les morceaux chantés par Duffy Power. Shouter extraordinaire ! Niveau Joe Cocker. Ginger, Graham et moi, nous l’avons accompagné à l’époque. Depuis, il est tombé dans l’oubli. Quel gâchis ! Il y a aussi les bricoles que j’ai enregistrées avec John Mayall et Manfred Mann, et bien entendu, les premiers morceaux de Cream, comme «Wrapping Paper». Et à la suite, il y a un choix de morceaux tirés de tous mes albums solo. Et comme tu dois le savoir, Pit Brown est toujours resté dans les parages. À l’époque de Cream, Ginger était très jaloux de notre créativité et de la complicité qui nous liait Pit et moi. Il se prenait pour le patron de Cream, mais il ne l’était pas. Pauvre Ginger, ses compos n’étaient pas bonnes, mais personne n’aurait osé le lui dire.
— Oui, sur le coffret, on trouve tous les morceaux datant des années 77-78. Qui pouvait encore t’écouter à ce moment-là ? Personne, évidemment. Tu étais trop parfait. Chacune de tes chansons en comprenait plusieurs. Alors que «New Rose» et «Pretty Vacant» sonnaient comme de nouveaux classiques. Et tu as joué aussi avec Gary Moore ?
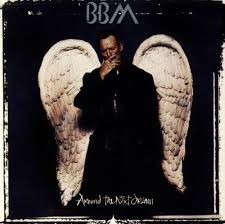
— Oui, BBM, c’est-à-dire Bruce Baker Moore. On a enregistré l’album «Around The Next Dream». Avec Gary, on voulait revenir au son de Cream et voir si on ne pouvait pas donner une suite à Disraeli.
— Oui, mais là, vous êtes peut-être allés un peu trop loin. Il y a trop de son sur cet album. Il est évident que «Waiting In The Wings» sonne comme du post-Cream, mais Moore est beaucoup trop incisif. Et Ginger battait avec une espèce de brutalité, comme un bûcheron canadien, sans doute pour se moquer de vous deux. Mais avec «City Of Gold», on finissait par se faire avoir et à tomber sous le charme du heavy blues. Là vous étiez dans le pur post-Cream et tu saluais les départs en solo de Gary Moore, ce bavard impénitent. Il dévorait tout. Toi et Ginger, les deux vieux, vous sembliez cavaler après lui et tu le rattrapais au chant de ta voix tremblée - My home of sand outside the city of gold - Vous redeveniez un power-trio de rêve !
— C’est le guitariste de blues que j’aimais bien en Gary. Jouer «Can’t Feel The Blues» avec ce mec était un vrai bonheur, tu peux me croire. Il semblait toujours partir à la chasse, il renversait le beat et ça devenait prodigieusement heavy pour Ginger et moi. Et on l’entendait se balader dans les bois, c’était son truc et il n’en finissait plus de faire gicler sa mayonnaise. Les Irlandais ont ça de commun avec les Écossais : l’énergie animale. Quand il faut démolir le mur du son, tu peux compter sur eux.
— C’est vrai que l’énergie qui circule dans «Glory Days» est explosive. Vous frisiez le Swlllbbrrr. On avait là une fantastique leçon de psyché et Moore bardait ça d’accords déglutis. Il chargeait la barque et toi tu amenais tout à l’unisson de la crème de la crème. En plus, Ginger te battait le beurre avec une niaque de vieux briscard. Vous formiez une sacrée équipe ! C’est assez bête à dire, mais on voit passer très peu disques de ce niveau, par les temps qui courent. «Why Does Love (Have To Go Wrong)» aurait aussi très bien pu sortir de Disraeli.

— J’aimais bien Steve Hunter aussi. Très bon guitariste. Il jouait sur «Out Of The Storm» sorti sur RSO en 1974. Les gens du label RSO ne comprenaient rien. J’étais beaucoup trop créatif pour des gens comme ça. À ce moment-là, je ne faisais pas de pop, mais du Monk.
— Je garde le souvenir d’un album jazzifié dans l’air raréfié. Tu cherchais la difficulté, me semble-t-il. Tu semblais te perdre dans «Golden Days», comme si tu avais rompu toutes les amarres. Tu frisais l’admodestation grégorienne et tu ne semblais viser qu’un seul objectif : la beauté plastique. Jim Keltner s’amusait bien lui aussi. On vous entendait faire les fous lui et toi dans «Timeslip» et tu prenais un solo de dingue. Puis tu as monté ce groupe avec Carla Bley et Mick Taylor qu’on pouvait entendre sur l’album «Live 75». Tu y reprenais des classiques deltaïques du genre «Can You Follow» et «Morning Story». Tu allais là où le vent te portait. Comme tous les grands jazzmen, tu donnais l’impression d’être libre. On sentait ta passion immodérée de la fuite, au sens symphonique du terme. Ah bien sûr, on a dû t’accuser de progger, mais tu étais beaucoup moins prétentieux que tes collègues de Yes ou d’ELP. J’aimais bien aussi écouter «Keep It Down» et le jeu d’interventions délicates et sensibles du pauvre Mick Taylor. Mais les autres morceaux avoisinaient la demi-heure et on sentait qu’ils étaient réservés aux gens qui avaient du temps pour ça. Car il faut disposer de beaucoup de temps libre pour écouter des morceaux aussi longs et aussi ennuyeux, pas vrai, Jack ?
— Faut savoir ce que tu veux mon pote. Vous les Français, vous êtes tous un peu comme ça, pas très nets, un peu faux-culs. Dis-toi bien une chose : quand on joue avec le feu, c’est-à-dire le free-jazz, il faut aller au bout de sa logique, mec, qui est la liberté absolue. Rien ne doit entraver ton désir d’expansion.
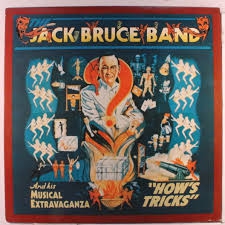
— Il était bien ton groupe quand tu as enregistré «How’s Tricks» en plein cœur de la vague punk en 1977. Hughie Burns était un guitariste incisif, pas vrai ?
— Me souviens pas...
— Tes compos étaient très jazzées et donc beaucoup trop ambitieuses pour le public rock. Avec «Without A Word», tu lançais un mélopif qui s’étendait jusqu’à l’horizon et en plein milieu tu démarrais un solo de basse frénétique. Franchement, c’était gonflé de ta part. Et comme la basse était bien mise en avant dans le mix de «Johnny B77», on pouvait apprécier ta science des transitions. Tu chantais «Times» très perché, comme si tu étais encore dans Disraeli. Ma chanson préférée sur cet album était «Lost Inside A Song», une chanson étonnamment solide, chantée, composée et interprétée. Tu chantais ça avec une telle ardeur ! Et quel festival tu faisais avec «Waiting For The Call» ! Tu jouais tellement heavy...
— J’adore prendre le heavy blues par les cornes, mec.
— Mais le chef-d’œuvre de cet album, c’est bien «Something To Live For». Tu le tenais sous le boisseau de l’harmonique et tu montais un peu le ton, au fur et à mesure.
— J’adore tirer sur les syllabes. Elles sont élastiques.
— Ce qui est dingue, c’est qu’il se produit sur chacun de tes albums des événements extraordinaires. On croit qu’on va écouter un album de pop anglaise un peu au dessus de la moyenne, mais non, c’est du Jack Bruce ! Ton monde est complètement à part.

— Avec «How’s Tricks» j’ai essayé de me rendre accessible, comme d’ailleurs avec «I’ve Always Wanted To Do This». J’avais récupéré Dave Clemson à la guitare et Billy Cobham à la batterie. Mais ça n’a pas marché, tous les morceaux retombaient à plat. Mes compos étaient sans doute trop pop pour Clem qui était un vrai guitariste de rock et pour Billy qui était un vrai batteur de jazz-rock. Le seul morceau inspiré de l’album était «Dancing On Air»...
— Ah oui, le cut qui sonne comme «Jack’s Talking» de Dave Stewart.
— C’est une coïncidence, mec. Je visais l’espace létal du groove.
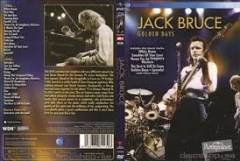
— Oui c’est vrai qu’on te voit jouer le morceau dans le film «Golden Days» et tu fais bien dégorger le groove. C’est d’ailleurs cette formation avec Clemson et Cobham qui est filmée au Rockpalast en 1980. Sur scène, les morceaux passent bien. Tu les secoues un peu et tu les fais vibrer. J’aime bien aussi ton récital solo au piano, filmé en 1990, qu’on trouve à la suite sur ce DVD. Mais puisqu’on parle de films, je peux te dire que j’ai adoré le film que Tony Palmer t’a consacré en 1969, «Rope Ladder To The Moon» !
— Ah oui, c’est une vieille histoire ! Il m’avait demandé de marcher à travers les slums de Glasgow et de raconter mon enfance. J’ai connu cette époque où il n’y avait pas de salle de bains ni d’eau courante à la maison et des vitres cassées aux fenêtres. Glasgow était encore une ville sinistrée par les bombardements. Rien n’avait changé depuis la guerre. Le pouvoir central avait complètement abandonné les Écossais. Alors il fallait réfléchir et trouver un moyen de s’en sortir. J’ai fait l’école royale de musique, mais il n’y avait pas de débouchés, alors je me suis retrouvé window cleaner. Je me faisais de l’extra-money en jouant de la stand-up dans un jazzband. Puis j’ai quitté Glasgow, j’ai joué trois ans avec Graham Bond. On jouait tout le temps et on ne gagnait pas beaucoup de fric, mais je t’ai déjà raconté cette histoire.
— Dans le film, tu dis que Cream fut le premier groupe à avoir du succès parce que c’était un groupe de vrais musiciens.
— Oui, je disais peut-être ça par provocation, mais au fond je ne suis pas quelqu’un de sectaire. J’aime tout ce qui est bon, que ce soit dans le classique, le blues, le jazz ou la pop, Bach, Ornette Coleman...
— Un autre guitariste que tu appréciais beaucoup, c’est Vernon Reid de Living Color. On le retrouve sur un bon paquet d’albums, si je me souviens bien...
— Oui, il jouait sur «A Question Of Time». Ginger aussi, d’ailleurs. Je trouvais que Vernon Reid était un guitariste très inventif, bourré d’énergie.
— Dans «Life On Earth», on t’entend traverser son solo à contre-courant. Mais le vrai hit de cet album transgressif, c’est «Hey Now Princess». Tu avais tout là-dedans, le vrai blues rock, le beat fabuleux de Ginger et le solo diabolo de Jimmy Ripp. Il me semble que tu avais aussi Albert Collins sur un morceau...
— Ah oui, sur «Blues Can’t Lose». Mais il est resté assez discret.
— «Obsession» était bien grassouillet, aussi. Encore un cut qui aurait pu se trouver sur Disraeli. Mais le morceau qui m’épatait vraiment était «Let Me Be», il était très introspectif, comme chargé de ton mystère intérieur. Et dans «Only Playing Games», tu nous sortais une mélodie expiatoire relayée par des chœurs de gospel ! Vraiment, tu auras tout fait pour épater la galerie ! Et donc, ça se passait bien avec Ginger ?
— Pour mes 50 ans, j’ai remonté un groupe avec Blues Saraceno et lui. On partait en tournée. Je croyais que ça allait bien se passer. Ginger et moi, on était un peu comme James Jamerson et Benny Benjamin, ou si tu préfères, Sly & Robbie. Mais quand on s’est retrouvés dans le hall de JFK, c’était bizarre. Ginger est arrivé et n’a rien dit, même pas bonjour. Quand je lui ai demandé d’écouter l’album dont on allait jouer les chansons, il m’a répondu qu’il n’en n’avait rien à foutre de ce fucking rock’n’roll. Les répétitions furent catastrophiques et quand on s’est retrouvés sur scène au Bayou, à Washington, on a atteint des sommets. Ginger gueulait pour qu’on joue moins fort, lui, on ne l’entendait pas, Blues Saraceno ne comprenait rien à ce qui se passait et le public commençait à s’énerver. Alors j’ai dit dans le micro à quel point je haïssais Ginger Baker, j’ai posé ma basse et je me suis barré. Fin du set. C’est la raison pour laquelle jouer avec un mec comme Vernon Reid, ça me repose. Il est aussi sur mes albums récents, «Shadows In The Air» et «More Jack Than God». Dr John était là aussi pour quelques morceaux...

— «Shadows In The Air» est l’un de tes meilleurs albums, pas de doute. Tu as des envolées catégoriques dans «Get Into The Fields». On dirait que Vernon Reid vient enflammer la plaine. Son groove funky sur «52nd Street» est un modèle du genre et ton chant dans «Heart Quake» se perd dans les champs. Cet album est vraiment fascinant, car toutes les chansons sont bonnes et captivantes, comme ce heavy blues, «This Anger’s A Liar», que Vernon joue bien gras. Et là où tu m’as le plus bluffé, c’est avec ta reprise de «Sunshine Of Your Love» ! Clapton est revenu le jouer avec toi, mais c’est accompagné aux percus, comme si tu voulais nous faire oublier Ginger, ta bête noire. Ta version est stupéfiante de professionnalisme et Clapton est bien meilleur qu’à l’époque de Disraeli. Pur génie aussi ton «Direction Home», un groove de rêve, et ce «Dark Heart» que tu mènes à la mélodie chant ! Et le coup fatal, c’est le «White Room» que vous reprenez en fin d’album, toujours aux percus et tabassé aux arpèges. Quel son dément !
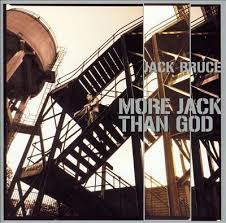
Dans «More Jack Than God», tu reprends aussi deux vieux classiques de Cream, «We’re Going Wrong» et «I Feel Free». Vernon Reid plonge dans le gros bouillon laid-back de Going Wrong avec un incroyable élan. Vous jouez ça dans une espèce de court-bouillon apoplectique. On dirait que Vernon Reid s’amuse à faire sauter les concepts à la dynamite. Mais il est encore plus diabolique dans «I Feel Free» et ta bassline semble devenue folle. On dirait que tu te venges de l’époque où Ginger se moquait de toi en t’obligeant à porter cet affreux bonnet d’aviateur en cuir.

— Ginger est aussi sur «Cities Of The Heart», un double album live sur lequel joue aussi Clem. On a réussi à sortir une fantastique version de «First Time I Met The Blues». On y retrouvait cette effervescence qui était devenue mon obsession. Ah, on a aussi repris «Born Under A Bad Sign», un hit d’Albert King que j’ai toujours adoré. Maggie Reilly chantait avec moi sur deux ou trois morceaux, comme «Ships In The Night», mais elle n’était pas juste, enfin je veux dire que nos voix ne s’accordaient pas bien.
— Tu reprenais aussi tes vieux classiques comme «Never Tell Your Mother She’s Out Of Time» et «Theme For An Imaginary Western», qui tu tirais une fois de plus à l’infini.
— Oui, et Gary était revenu jouer «NSU» avec Ginger et moi. On a rarement eu une telle puissance de feu !
— C’est sûr, ta bassline sonnait comme la chute d’un chapelet de bombes et Ginger battait ça au tom bass. Et en plein dans la fournaise, Moore partait en solo et toi tu revenais le croiser au sommet des flammes. Vous étiez monstrueux, ça je m’en souviens. Et ça continuait avec «Sitting On Top Of The World» et surtout «Politician» qui était assez ennuyeux sur «Wheels On Fire» et qui prenait avec Gary Moore une drôle de consistance. Il semblait incontrôlable ! Son gras traversait le papier gras. Il en rajoutait des louches et des louches. Quand même à un moment, tu aurais dû le faire taire !
— Impossible. On a aussi rejoué «Spoonful» avec lui, et on l’a cuit à l’étuvée. J’ai fait d’autres albums, à la même époque, «Somethin Els» et «Monkjack».
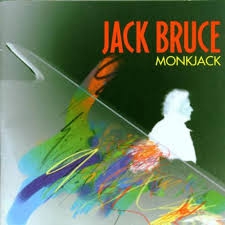
— Oh oui, je me souviens très bien de «Slouldn’t We», sur «Monkjack», tu y déconstruisais des harmoniques et tu t’amusais à contrecarrer les ambivalences, à la manière d’un Francis Poulenc qui serait subitement devenu cocaïnomane, c’était quand même assez gonflé de ta part ! Et d’autant plus intéressant, car profond comme le néant. Avec «David’s Harp», on se serait cru sur un album de Keith Jarrett, et avec «Time Repairs», tu restais dans le déroulé du dévolu. Tu avais même réussi l’exploit de nous sortir un poème lettriste avec «Laughing On Music Street» ! Tu y pianotais à l’ombre d’une jeune fille en fleur courtisée par Isodore Isou. Et on retombait fatalement sous le charme de «Weird Of Hermiston», ce classique miraculeux tiré à l’harmonique de la désespérance et qui semblait flotter entre deux airs, piano et orgue, véritable chef-d’œuvre d’élégance suspensive.
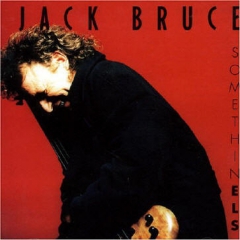
— Eric était revenu jouer sur «Somethin Els», et on avait d’excellents morceaux comme «Will Power». Maggie Reilly duettait à nouveau avec moi sur «Ships In The Night», mais on a une fois de plus raté l’unisson, car elle chantait plus haut que moi, ou l’inverse, je ne sais plus.
— «Close Enough For Love» était terriblement ambitieux, on aurait dit que tu chantais ça depuis la cime de l’Everest ! Il n’y avait que l’épique qui t’intéressait à l’époque !
— Tu aurais vécu comme moi dans les Highlands, tu comprendrais mieux. Ce que tu appelles la dimension épique correspond à ce vertige qu’on éprouve face à l’infini du ciel, par dessus un loch. J’appelle ça le sentiment d’éternité, un moment de perdition pour l’homme moderne, qui réalise subitement qu’il n’est ab-so-lu-ment rien du tout, à peine une ombre de passage sur cette terre. J’ai essayé de traduire ce sentiment musicalement. Le fait de réaliser qu’on est rien est une sorte de délivrance. On se débarrasse alors de tout ce qui ne sert à rien. Je crois même que les gens qui ont la foi débouchent sur le même genre de conclusion. Voilà où mène l’infinie dérive pernicieuse du jazz ! Aux yeux des profanes, tu te perds, mais à la fin de ta vie, tu te retrouves. La mélodie finit toujours par croiser l’étoile polaire, tu comprends ce que je veux dire ?
— Oui, j’entends bien ton petit couplet spirituel, d’autant plus que «FM» qui se trouve aussi sur «Somethin Els» sonnait comme un Gymnopédie d’Erik Satie. Tu t’es toujours arrangé pour subjuguer les gens. Surtout avec ce thème astucieusement déconstruit. On se serait cru dans le salon de Sonia Delauney en 1920 ! Puis tu soufflais le chaud et le froid : le froid avec une version de «The Wind Cries Mary» complètement foireuse et le chaud avec «Lizard On A Rock Rock» qui sonnait comme un fabuleux concassage de Captain Beefheart ! Tu faisais danser les crabes des cocotiers ! Par contre, ton album «Jet Set Jewel» n’a pas très bien marché, n’est-ce pas ?
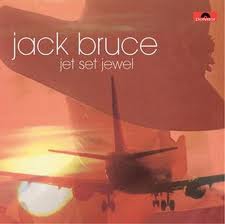
— J’étais peut-être trop gourmand. Pourtant je faisais des concessions en reprenant «Neighbour Neighbour», un vieux standard qu’avait repris en son temps le Spencer Davis Group. J’adore ce genre de morceau, car il me permet de jouer à la surface des choses. Je ne vis que pour l’empire de la musicalité. C’est devenu une évidence.
— Oui, une fois plus, on sentait que tu jazzifiais dans l’air raréfié d’un ciel tuméfié. Mais tu savais rester incroyablement captivant. Tu y chantais le jazz à la cassure de ton et ta basse côtoyait les accidents de parcours. C’était ta façon de rendre la situation explosive, pas vrai ?
— Et pourtant, en chantant «She’s Moving On», j’avais le sentiment d’être providentiel, au sens où l’était John Len...
— Oh ! Regarde qui arrive ! C’est Saint-Pierre ! Il vient te souhaiter la bienvenue et te donner la clé de ton bungalow. Bon, je te laisse, Jack, à bientôt et encore merci pour tous ces bons disques !
Signé : Cazengler, Bruce de décoffrage
Disparu le 25 octobre 2014
The Graham Bond ORGANization. The Sound Of 65. Columbia 1965
The Graham Bond ORGANization. There’s A Bond Between Us. Columbia 1965
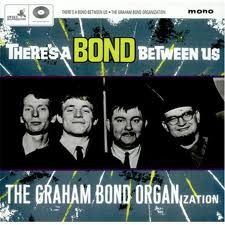
The Graham Bond ORGANization. Live At Klook’s Kleek. Charly Records 1999
The Graham Bond ORGANization. Wade in The Water. Coffret 4 disques Repertoire 2012
Cream. Fresh Cream. Atco 1966
Cream. Disraeli Gears. Polydor 1967
Cream. Wheels On Fire. Polydor 1968
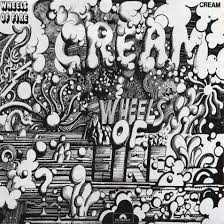
Cream. Goodbye. Polydor 1969
Jack Bruce. Songs For A Tailor. Polydor 1969
Jack Bruce. Things We Like. Polydor 1971
Jack Bruce. Harmony Row. Atco Records 1971
West Bruce Laing. Why Dontcha. CBS 1972
West Bruce Laing. Whatever Turns You On. CBS 1973
Jack Bruce. Out Of The Storm. RSO 1974
Jack Bruce. How’s Tricks. RSO 1977
Jack Bruce. I’ve Always Wanted To Do This. Epic 1980
Robin Trower/Jack Bruce. BLT. Chrysalis 1981
Robin Trower/Jack Bruce. Truce. Chrysalis 1982
Jack Bruce. Automatic. Intercord 1983
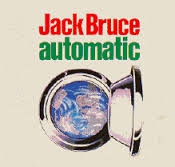
Jack Bruce. A Question Of Time. Epic 1989
Jack Bruce. Somethin Els. CMP Records 1993
Jack Bruce. Cities Of The Heart. CMP Records 1994
BBM. Around The Next Dream. Virgin 1994
Jack Bruce. Monkjack. CMP Records 1995
Jack Bruce. Shadows In The Air. Sanctuary Records 2001
Jack Bruce. More Jack Than God. Sanctuary Records 2003
Jack Bruce. Jet Set Jewel. Polydor 2003
Jack Bruce Band. Live 75. Esoteric Recordings 2003
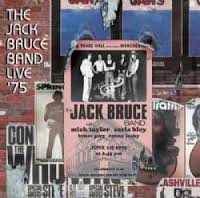
Jack Bruce & Robin Trower. Seven Moons. Evangeline Records 2008
Jack Bruce. Silver Rails. Esoteric Antenna 2014
Jack Bruce. The Anthology. Can You Follow. Esoteric recordings 2008
Harry Shapiro. Jack Bruce Composing Himslef. Jawbone Press 2010
Jack Bruce. Rope Ladder To The Moon. Tony Palmer. DVD 2012
Jack Bruce. Golden Days. Rockpalast 1980 et 1990. DVD Eagle Vision
ET UNE VOIX POUR CHANTER…
MEMOIRES / JOAN BAEZ
( 1987 / 536 pp / Livre de Poche 6881 )
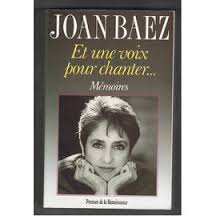
Mémoires mais pas d’outre-tombe. Les a publiées alors qu’elle n’avait pas encore fêté son demi-siècle. Le besoin de faire le point à la mitant de son existence. Mais aussi de rappeler au public qu’elle existait. Les eighties furent terribles pour Joan Baez, trop vieille pour être l’égérie des nouvelles générations et en total porte-à-faux idéologique avec les nouvelles valeurs de ces années funestes qui virent le triomphe du libéralisme financier.
N’ai jamais été trop fan de Joan Baez. A part sa version de The Night They Drove Old Dixie Brown - le dernier disque qu’elle sortit chez Vanguard - que j’ai adorée. Mais Le folk n’étant que le versant nord de cet énorme massif musical montagneux que dans le sud on appelle country, il me sembla nécessaire de ne pas céder à un réflexe sectaire et de tourner fort impoliment le dos à cette grande demoiselle folkleuse lorsque mon bouquiniste me tendit l’exemplaire fort défraîchi -l’a dû longtemps dormir au fond d’une malle dans un grenier humide - de ses Mémoires.
MUSIQUE
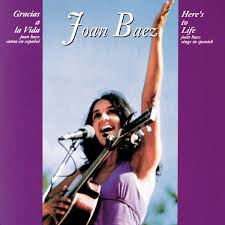
Procurez-vous un Greatest Hits de la belle et vous en saurez davantage en lisant les notes de la pochette qu’en étudiant le bouquin. Parle de sa carrière - aucune nuance péjorative dans mon propos - mais très peu de sa musique. S’y étend un peu à ses débuts, lorsqu’elle raconte son adolescence, qu’elle écoute la radio, rhythm and blues et daube variétoche, lorsqu’elle gratte sans arrêt sa guitare enfermée dans le désordre de sa chambre, lorsqu’elle chante pour les copains dans son lycée, et surtout lorsqu’elle découvre qu’elle possède une très belle voix, un soprano de rêve une limpide fluidité à laquelle tout public a envie de s’abreuver quelle que soit la chanson qu’elle interprète. Evidemment ça aide. Deviendra professionnelle presque sans s’en apercevoir. Une montée progressive mais irréversible, passe doucement mais sûrement des petits cachets de quelques dollars au statut de reine du folk sans difficulté majeure.
MILIEU
Provient d’un milieu intello. Le père est une grosse tête, un matheux, un chercheur qui sera entre autres professeur d’université. Préfère sa conscience à son avancement. Travailler à l’amélioration des nuisances de la bombe atomique le met mal à l’aise. Deviendra un pacifiste convaincu. Dans les actes et les idées. Philosophie non-violente qu’il transmettra à sa fille. Cela et la couleur un peu trop bronzée de sa peau. Joan avec sa belle chevelure de jais passe facilement pour une jeune fille noire à la peau claire. Se tient dans l’entre-deux du racisme. De quoi la sensibiliser à la cause noire.
Le paternel lui refile aussi un cadeau empoisonné. Famille quaker, les dimanches aux assemblées de Dieu à faire acte de contrition et d’examen de conscience. Joan ne perdra jamais la foi. Elle est bien la fille de cette Amérique blanche et puritaine que nous n’aimons pas.
CONTRADICTIONS

Cause peu de musique mais beaucoup d’elle. Trois sœurs aînées, une mère aimante, une enfance heureuse. Une adolescence tourmentée. Pas de révolte contre la famille. Tout se passe dans la tête. Dans le corps aussi. Sous forme de somatisations excessives, vomissements retenus, malaises, nervosités… Les hormones travaillent son sang de jeune femelle en mutation. Les sixties sont la décennie de la libération sexuelle. Etrange que pas une seule fois Joan ne fasse le rapport entre sa foi chrétienne peu encline à favoriser les élancements de la chair et cette liberté de l’esprit et du corps suscitée par l’air du temps.
Mettra du temps à se libérer, les quatre ans passés avec son copain, puis plus tard son mariage avec David se révèleront être un fiasco. Joan l’amoureuse se range inconsciemment dans le rôle de la bonne épouse. A du mal à s’y plier. Les désirs sont nombreux et multiformes… Plusieurs années avant d’accepter son autonomie comportementale et d’abandonner son rôle symbolique de chaste épouse au profit de celui de prédatrice clairement affirmé et revendiqué. Folk and sex. Les bons sentiments cèdent le pas aux bons sextiments.
BOB DYLAN

L’enfant terrible et le couple de légende. N’est pas tendre avec son compagnon mythique mais lui pardonne tout. Après en avoir dressé un portrait au vitriol. Dylan le chantre de la contestation sociale. Le premier masque qu’on lui ait posé sur le visage. Certes les temps étaient en train de changer et il existait une concomitance parfaite entre les paroles du barde et la situation de l’époque. Tous ces intellectuels qui participèrent à la lutte des droits civiques et très vite s’engagèrent contre la guerre au Vietnam, et au-delà de ces prises de position politique s’amorçaient déjà la critique virulente de notre société de consommation et les premières sensibilisations écologiques. Une pincée de mysticisme et vous tenez entre les mains les dogmes des futurs hippies.
Dylan était bien conscient de tout cela mais il n’avait pas la fibre militante. Voulait bien écrire la feuille de route mais refusait de s’y conformer. Adoptera une conduite d’égotiste et de malappris. Dans la vie de tous les jours, il ne fera que ce qu’il voudra. Devient totalement étanche à toute proposition qui ne recoupe pas avec la plus grande exactitude ses propres désirs. Son statut de star - et même de gourou pour les idiots utiles qui le vénèrent comme un dieu et qui disent amen à tous ses actes - lui sert de bouclier. L’écrit des chansons. Point à la ligne. Géniales, cela va de soi. L’est sûr de sa valeur. Et de son côté manipulateur, la face sombre de son personnage qu’il assume en toute simplicité. Pour le reste cause toujours, tu m’intéresses. Quant à la cause du peuple ce n’est pas son principal souci.

Joan Baez sera la dernière informée de l’existence de Sara. Dont il aura des enfants. Qui partage avec lui la pochette de Freewhilin’… et dont elle tentera dans la mesure de ses moyens de protéger la douce délicatesse… Elle ne le dit pas, et ne le pense pas, mais à relire ces pages et les scènes qui quelques années plus tard les remettent face à face, se dégage la pénible impression que Mister Zimmerman tambourine à la porte de l’affectivité joanique chaque fois qu’il pense que cela peut être bénéfique à son plan de carrière fantasmatique. Car à proprement réfléchir il n’a plus vraiment besoin d’elle.
POLITIQUE
Peu de musique. Mais beaucoup de politique. Les deux lui paraissent indissociables. Et elle met ses actes en accord avec ses croyances. Chante gratuitement ou laisse son cachet à de nombreuses associations dont elle partage le combat. Elle n’a cure ni des avertissements et des menaces de la police ni des tentatives de déstabilisation et des coups tordus perpétrés à son encontre par la CIA. Courageuse et obstinée. Les différents chapitres du livre sont dans leur plus grand nombre consacrés aux différentes luttes qu’elle soutiendra tour à tour. Un petit côté dame patronnesse et de charité qui déplaît à notre sensibilité de mécréant franchouillard.

Ne s’attarde pas trop sur les Droits Civiques. Portrait un peu rapide de Martin Luther King. Et décapant quand elle nous apprend qu’il s’enferme dans sa chambre avec de jeunes groupies… Pour leur octroyer les connaissances bibliques nécessaires à leur éducation de pècheresse. L’image du saint homme en sort un peu écorniflée. Que voulez-vous, les noirs ne sont pas entièrement blancs. De la lucidité lorsqu’elle décrète que la victoire obtenue sur le chapitre n’est que l’arbre qui cache la forêt des haines raciales et des misérables conditions de vie qui restent l’apanage de la très grande majorité de la population noire.
VIETNAM

Les jeunes générations habituées au peu de manifestations suscitées par les dernières et actuelles guerres en Libye, en Irak et en Palestine doivent avoir du mal à mesurer l’ampleur de la vague de subversion soulevée aux USA ( et ailleurs ) par le conflit vietnamien. Joan Baez soutiendra les mouvements d’insoumission de dizaines de milliers de jeunes garçons qui refusèrent l’incorporation. Le chapitre le plus poignant du livre conte sa visite au Nord-Vietnam aux moments même où son propre Etat bombarde le pays. Ne cache ni sa peur ni sa rage. Son récit des abris surchargés, ses visions cauchemardesques de quartiers détruits et de civils morts par centaines sont assez éloquentes pour comprendre l’effrayante horreur de la guerre.

DERIVES
L’idéologie de la non-violence prônée par notre chanteuse possède ses limites. Ses développements attirent en un premier temps la sympathie. L’on se détourne souvent avec horreur des va-t-en guerre, mais ce consensus de la raisonnabilité anti-guerrière possède un redoutable défaut. Il prête facilement le flanc à touts sortes de manipulations. L’URSS et les USA ne s’en privèrent pas. Faire pression sur le gouvernement adverse en retournant contre lui sa propre opinion publique est de bonne guerre. Les Russes menèrent une vaste campagne politique contre le déploiement des missiles Pershing en Europe. Mais à ce petit jeu la CIA fut beaucoup plus habile puisqu’elle parvint à faire partager ses propres vues aux plus farouches des partisans qui la veille encore s’opposaient à ses troubles menées métapolitiques. Joan Baez - belle prise - tomba dans le panneau, la tête la première, à son insu, en toute inconscience, encore aujourd’hui elle reste dupe de ses errements et les revendique avec fierté.
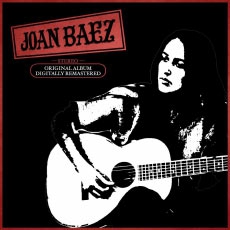
Il faut avouer que la stratégie de la CIA menée de front avec la complicité agissante des groupements économiques fut particulièrement subtile. Beaucoup se laissèrent prendre au piège. Amnesty International fut le sucre destiné à attirer les abeilles de la non-violence. Sous prétexte de défendre des militants emprisonnés, et dans les pénitenciers des régimes despotiques d’Amérique du Sud ou d’Asie, et dans les geôles des pays totalitaires de l’Est, fut menée une vaste opération de déstabilisation idéologique des régimes communistes et par contre coup des forces progressistes des pays européens. Dans les mêmes moments sous couvert de promouvoir les vertus indépassables de la démocratie l’on instilla à fortes doses dans les cervelles des élites et du peuple la croyance que celles-ci marchaient de pair avec les bienfaits du libéralisme économique… L’on connaît aujourd’hui les résultats désastreux de ces préceptes qui ne visaient qu’à une mondialisation accrue de l’accumulation des richesses dans les mains d’une oligarchie dont il faudra bien se débarrasser un jour ou l‘autre. Vraisemblablement pas par un bulletin de vote.
Joan Baez devint un peu la marraine officieuse des révoltés à la réflexion plus courte que leurs idéaux. Après avoir soutenu les dissidents d’Union Soviétique qui dans leur majorité se révélèrent plus tard pour un retour vers l’obscurantisme tsariste et orthodoxe des plus étroits, c’est avec la Pologne de Solidarnosc qu’elle connaît un véritable orgasme idéologique lors de sa rencontre avec Lech Walesha. Défaille de joie devant l’œuvre accomplie par ce suppôt rétrograde du catholicisme, le bras séculier de l’Eglise en sainte mission salvatrice. Ce sont les polonaises interdites du droit d’avorter qui doivent la remercier chaque fois qu’elles font l’amour.
MUSIQUE
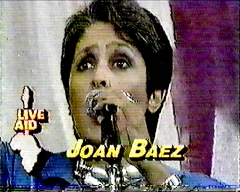
Le plus terrible c’est que cette dérive politique se traduit aussi dans ses choix musicaux. Le livre se termine sur la grotesque farce du Live Aid de Bob Gelfof. La bonne conscience du rock and roll. Mille millions de larmes sur les malheureux et par ici les dollars. Est toute fière d’avoir été invitée, elle la survivante de Woodstock, pour ouvrir le festival. Commencera par chanter Amazing Grace, son vieux fond puritano-quakerien indécrottable. Dans ce vaste cirque médiatique elle remarque et tombe en admiration devant le nouveau prêcheur des eighties : Bono de U2. Difficile de faire un plus mauvais choix. Mais quand on se laisse guider par son instinct…
Quelques pages pour les remerciements et les proches. Ne lui reste plus qu’à nous avouer qu’elle se sent maintenant apaisée, a fait son deuil de sa célébrité passée, indique que ce sont encore ses premiers disques qui se vendent le mieux, que par goût et nécessité commerciale elle touche un peu à tout, du meilleur country à des chansons qu’elle aime moins, et le livre se termine.
Depuis l’écriture du livre ( 1985 ) elle a continué son petit chemin de bonne femme, avec des hauts et des bas, pour ceux qui veulent en savoir plus, elle sera à l’Olympia pour toute une semaine à partir du 7 Octobre… Si le cœur vous en dit… Personnellement je serai vraisemblablement à un concert de Rockabilly.
Damie Chad.
( rédigé en juillet 2014 )
CHARLEY PATTON
ELECTRICALLY RECORDED : HIGH WATER EVERYWHERE
HAMMER BLUES ( Take 1 ) / I SHALL NOT BE MOVED ( Alternative version ) / HIGH WATER EVERYWHERE ( Pt 1 ) / HIGH WATER EVERYWHERE ( Pt 2 ) / I SHALL NOT BE MOVED / RATTLESNAKE BLUES / GOING TO MOVE TO ALABAMA / HAMMER BLUES ( take 2 ) / JOE KIRBY / FRANKIE AND ALBERT / MAGNOLIA BLUES / DEVIL SENT ME THE RAIN BLUES / RUNNIN' WILD BLUES / SOME HAPPY DAY / MEAN BLACK MOAN / GREEN RIVER BLUES
CHARLIE PATTON : voice and vocal / HENRY SIMS : fiddle.
All tracks recorded in Grafton, Wisconsin / Octobre 1929.
Monk / BO Box 31 / 50 065 ( Firenze ). Italie.
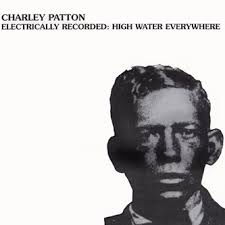
Petit label italien spécialisé dans les rééditions vinyl de blues. Lorgne aussi un peu sur le jazz, notamment notre héros national Reinhardt Django qu'à l'époque on ne considérait pas comme deux roms de frites, et ne dédaigne pas non plus le country puisqu'ils sont aussi fans de la Carter Family. Un catalogue peu épais que nos amis rockers ne manqueront pas de visiter. De la belle ouvrage, du 180 grammes et des pochettes plus ou moins stylées. Celles de Charley Patton, hélas ! légèrement indigentes. L'ai trouvé cet été à Toulouse, dans une petite boutique, facile à repérer, il y avait les Swinging Dice, tels des requins affamés, qui fouinaient dans le bac aux trésors...
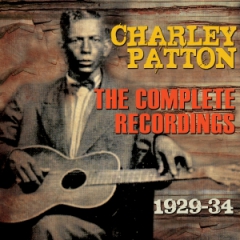
Moi aussi je suis Charlie. Patton exclusivement. Un précurseur. C'est qu'avant Charley Patton, n'y avait rien. Plus de trace dans la boue du Delta. L'on ne remonte pas plus loin. Discographiquement parlant. Car avant, à l'origine, les renseignements se font rares. Toutefois Patton n'est pas apparu sur terre par le miracle du Saint Esprit. Il y eut un précurseur qui lui enseigna la guitare. L'on possède le nom. Henry Sloan. Serait né en 1870. N'a jamais enregistré. Du moins l'on n'a rien retrouvé, même si sur You Tuble on lui attribue une reconstitution anonyme. Dans les années trente l'on disait que Charley avait repris pratiquement sans changement quelques morceaux dont le célèbre Pony Blues... L'on ne remonte pas plus loin qu'Henry Sloan, alors certains se sont mis à rêver, ont décidé de lier la silhouette évanescente d'Henry Sloan à une autre, encore plus fantomatique, celle de cet inconnu – un pauvre noir, un chemineau, a lonesome hobo - que W. C. Handy ( 1873 – 1958 ) aurait en 1903 entendu jouer une étrange musique sur le quai de la gare de Tutwiler grattant les cordes de sa guitare avec son couteau et dont revenu chez lui il aurait retranscrit la ligne mélodique de ce qui allait devenir Memphis Blues et Saint Louis Blues, les premiers blues officiels jamais composés... Le professeur de Charley Patton et l'inconnu de Tutwiler seraient donc une seule et même personne. Rien ne prouve cette trop séduisante théorie. Rien ne l'infirme non plus. L'histoire est tentante, une ligne droite parfaitement répertoriée : Henry Sloan, Charley Patton, Robert Johnson, Muddy Waters, Rolling Stones : la ligature fondatrice originelle authentiquement reconstituée... Et quand on pense qu'avant de découvrir Elvis Presley, Sam Phillips avait recommandé aux frères Chess Howlin Wolf, le grand rival de Muddy Waters, l'on se dit que les racines du rock and roll tournent en rond dans le même pré carré... D'autant plus qu'Henry Sloan aurait lui aussi migré vers Chicago, et puis serait mort dans l'Arkansas en 1948 – goûtez l'ironie de l'élève qui devance le maître dans la tombe puisque Patton naît vers 1890 a quitté notre vallée de larmes en 1934. Nous remarquons aussi que Charley Patton et Robert Johnson ont sur leur chemin tous deux trouvé un initiateur au talent, disons diabolique.
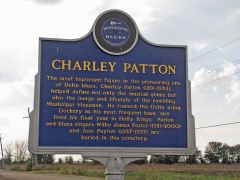
Avec Charley Patton nous tenons enfin notre premier bluesman dument répertorié. Son House, et Robert Johnson lui doivent tout. C'est lui qui a leur a servi de modèle. La star que l'on imite. Un homme libre dans sa tête, a refusé de marner sang et eau dans une plantation, tout jeune sur la route avec sa guitare et quelques compagnons d'infortune. Une grande gueule qui aime à se faire remarquer, qui n'a pas peur de faire le coup de poing si nécessaire. N'enregistrera qu'à la fin de sa vie entre 1929 et 1934, notamment pour Paramount et Vocalion, moins d'une centaine de morceaux avant de s'écrouler trahi par son coeur aux alentours de ses quarante ans. C'est qu'il ne l'a pas ménagé son muscle cardiaque. L'alcool, les filles et les concerts. Les bagarres et les cops. Passera par la case prison. N'en ressortira pas calmé. Un showman extraordinaire, une voix de stentor capable de couvrir - sans micro est-il utile de le préciser - les ambiances houleuses des barrel houses, parfois il joue de la guitare, souvent il la frappe. Soigne ses tenues de scène, Hendrix s'est inspiré de sa manière de triturer les cordes de sa guitare derrière la tête... Vous emballe le public et les minettes à la chatte brûlante en moins de deux. Ne joue pas exclusivement du blues, ne dédaigne pas les chansonnettes et tout le reste, rag, jazz, trad, standards, l'important ce n'est pas l'objet, mais ce en quoi votre désir le transforme. Il est la première idole noire du Delta, le rat des champs encore sauvage qui n'a rien renié de son authenticité si on le compare aux souris des villes déjà policées que sont Bessie Smith ou Ida Cox, la face sombre du blues. L'on ne connaît de lui qu'une seule photographie – encore moins que Robert Johnson – un regard brûlant qui n'est pas s'en rappeler celui d'Arthur Rimbaud, mais avec en plus la tranquille assurance de l'homme accompli qui maîtrise son destin de feu.
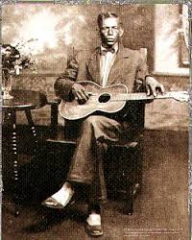
Henry Sims et Charley Patton fréquentèrent la même école. Sims tourna avec Patton, l'accompagnait au violon et en juin 1929 il participa à la séance enregistrements de son ami, qui lui-même tint la guitare durant la sienne dans laquelleil mit les quatre seuls titres qu'à ma connaissance nous possédons de lui. Sims est un parfait passeur : il joua du violon sur le deuxième enregistrement de Muddy Waters pour Lomax en 1941. Mourut à Memphis en 1958. Le monde du blues n'est guère plus grand qu'un timbre-poste.
Un Hammer Blues, ce que l'on peut appeler une frappe lente, la guitare qui se balade tranquille, toute l'intensité dans la voix dont le grain est picoré par le souffle de l'enregistrement, mais la poisse vous gagne sans que vous y preniez garde. I Shall Not Be Moved, chant de triomphe qui contraste avec la poignante tristesse du précédent. De l'impertinence dans la voix, cette résolution n'est pas sans évoquer les hymnes contestataires folk pour le mouvement des droits civiques, trente ans plus tard. High Water Everywhere, Un pur country blues en ses débuts, mais très vite l'ire vocalique surgit emmenant avec elle un tempo martelé sur le bois de la guitare. Ce n'est pas que le Mississippi qui déborde, c'est la sourde colère impuissante des miséreux qui ont tout perdu qui s'exprime charriant au fond de son lit d'angoisse un courant souterrain de rage qui ne demande qu'à éclater. Blues limoneux. High Water Everywhere, la deuxième partie, la même force mais le rythme est ralenti, l'urgence est partie mais la gravité de la situation n'en est que plus vive. Les témoins racontent que Patton ne jouait jamais cette version en public. Ne devait pas aimer ce sentiment d'impuissance devant la montée des eaux de la désolation, le blues vécu comme une impasse. I Shall Not Be Moved, une version plus posée, débute plus lentement comme s'il prenait son temps, pour affirmer ses prétentions, la suite part comme un refrain entêtant répété à l'infini. Rattlesnake blues, le violon s'insinue et se glisse entre les interventions vocales comme une langue de serpent sifflante, le serpent du blues vous a inoculé son venin et cela vous brûle les chairs à tout jamais. Une voix menaçante qui ne trompe pas son monde sur ses mauvaises intentions. Going To Move To Alabama, presque gai, ça sonne hillbilly à se croire dans les Appalaches, le fiddle d'Henry Sims n'est pas pour rien dans cette cavalcade de country line. Les racines du rock presleysien sont ici évidentes. Hammer Blues, deuxième prise, le rythme reste le même mais la voix a perdu toute trace émotionnelle, comme si c'était un combat perdu d'avance de vouloir arrêter le martellement sans saveur du spleen vénéneux, moins romantiquement poisseux, une voix blanche comme ayant perdu toute humanité avec en prime une pointe accentuée de lassitude sur la fin. Le blues dans sa plus terrible nudité traumatique. Joe Kirby, beaucoup de friture, mais le violon d'Henry Sims fraye le chemin, un véritable duo avec la voix, la tambourinade de la guitare passant en second plan, Patton raconte et Sims commente. Un jeu un peu monotone. Ce n'est pas Paganini, mais l'essence du blues réside peut-être en cette répétition insistante aussi conceptuelle que l'idée la plus lourde de l'Eternel Retour du Même chez Nietzsche. Frankie and Albert, chanté mais presque chantonné, le blues comme un transmetteur de légende, mais c'est la guitare qui parle le plus, le riff joue à cache-cache avec les lignes de basse, une superbe partie de chat perché. Magnolia blues, une voix arrachée, qui traîne les voyelles, un véritable blues shouter, guitare et violon presque discrets sur la première moitié du morceau reviennent en force par la suite, mais Patton va chercher au plus profond de sa gorge pour rester maître de l'histoire. Devil Sent The Rain Blues, ne se promène pas que dans les carrefours, Satan est la matière même du blues, l'Adversaire par excellence au bonheur de l'Homme, l'on touche à la métaphysique, à l'essence de l'être. Runnin' Wild Blues, un peu d'assurance dans ce monde de brute, ce morceau fleure bon l'enthousiasme presque militant, un vocal joyeux, non sans une pointe d'auto-ironie soulignée par les interventions d'Henry Sims, j'espère mais je n'y crois point. Some Happy Day, sonne un peu comme un blues sur ses premières mesures mais l'on retombe vite dans ce folk blues qui est aussi une caractéristique de l'art de Patton, le blues est un creuset et l'on a jeté bien des éléments disparates dans la marmite du Diable pour obtenir la teinte idoine. Mean Black Moan, un blues sans prétention mais d'une efficacité redoutable, Sims fait du Henry et Charley du Patton, sans surprise, mais vous ne ferez jamais mieux. Green River Blues, mouline grave à la guitare, l'on croirait qu'ils sont trois, mais non Patton joue sur trois niveaux différents. Sans oublier de chanter. Peut-être la meilleure introduction pour saisir son jeu et avoir le fil d'Ariane qui permet de le suivre dans les autres morceaux. C'est que Charley Patton ne pose jamais les problèmes, il se contente de les résoudre. Vous file ses solutions comme des évidences. Tellement facile que vous pourriez le cataloguer de gratouilleux à la cool, alors qu'il se livre à d'étranges acrobaties, en gros c'est le genre de gars qui vous range treize oeufs dans une boîte de douze casiers. Pouvez recompter, il y en a bien treize à la douzaine chacun dans son alvéole. Sidérant. Sans tricherie. Sans filet, mais retombe sur ses pieds. Impossible n'est pas Patton. Le mec vous emmène à travers un labyrinthe, vous le fait traverser les yeux grands ouverts, et ce n'est que lorsque vous ressortez que vous vous apercevez que vous avez marché sur la queue de l'alligataure affamé qui vous attendait pour son petit déjeuner sans dommage. D'ailleurs vous a bouffé la jambe gauche, il serait temps de vous en apercevoir.

L'on n'écoute pas Charlie Patton en faisant la vaisselle. Faut prendre le temps, se poser, écouter, analyser, à première oreille, c'est vieillot et mal fagoté. Erreur funeste, c'est du concentré. Sans démonstration. Et puis cette voix grasseyante dans laquelle vous vous engluez comme des mouches sur du papier collant. L'on se prend à rêver à la qualité sonore des enregistrements qu'il aurait pu nous laisser s'il avait vécu jusqu'au blues revival des années soixante...
Damie Chad.
15:40 | Lien permanent | Commentaires (0)


