13/03/2014
KR'TNT ! ¤ 180 : CAPITOLS / OBITS + HOT SNAKES / JOHNNY ROTTEN + SEX PISTOLS
KR'TNT ! ¤ 180
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
12 / 03 / 2014
|
CAPITOLS / OBITS + HOT SNAKES / JOHNNY ROTTEN + SEX PISTOLS / |
LOCAL DES LONERS
LAGNY-SUR- MARNE
07 – 03 – 14 / THE CAPITOL'S

Retour chez les Loners. Sûr y avait aussi Carl and The Rhythm All Stars à Montreuil, mais le choix n'est pas cornélien. Les Capitols possèdent les quatre as dans leur manche. Proposent une soirée hommagiale à Gene Vincent. Qui saurait résister à l'appel du plus mythique des rockers ? La teuf-teuf mobile fait la tournées des potpotes, Muriel, Billy, Mister B, nous voici déjà devant le local des Loners, barriques de feu devant la porte ouverte. Question chaleur humaine, les Loner's s'y connaissent.
Ne sont pas pressés les Capitols. L'on ne va pas se plaindre, plein de connaissances à saluer et surtout le temps de zieuter le monument. L'est négligemment couché par terre. Immense et en bois. Vu la vétusté ce doit être des planches recyclées de l'arche de Noé. Le déluge les a sacrément abîmées. Me suis pas trompé de beaucoup, de la dernière guerre. Mondiale. 1939, m'annoncera fièrement son propriétaire. Pas n'importe qui. Pascal. Le bassiste des Capitols. L'ancien lead guitar des Sprites.
Les Sprites ! Un groupe d'importance. Qui remonte à l'antiquité du french rockabilly. Dans les années 80, le premier combo français de qualité qui se soit consacré à reprendre l'oeuvre de Gene Vincent. Possédait une pêche admirable, mais sont arrivés trop tôt. Ne restent d'eux que quelques titres sur des 33 tours anglais. Compilation de groupes en pointe à l'époque. Et aussi quelques CD d'enregistrement d'un concert qui circule chez les fans. Nous avons précédemment rencontré le batteur, Red Dennis, au Rock & Boat qui officiait derrière Al Willis ( voir kr'tnt 176 du 13 / 02 / 14 ). Pascal Guimbard ne se retrouve donc pas là ce soir par hasard. Vient de rentrer en France après seize d'absence passées aux States. L'a croisé et joué avec beaucoup de monde. Ne se vante pas, l'on sent une modestie intrinsèque. Avoue qu'il n'écoute pas que le rockabilly de sa jeunesse. S'intéresse beaucoup au country et à bien d'autres musiques américaines.
PREMIER SET

Les premières notes de Bop Street retentissent... Les Capitols entament leur set. Troisième fois que je vois les Capitols et je m'aperçois qu'avec un répertoire sensiblement similaire, ils ne m'offrent pas le même show. Ne reproduisent pas à l'identique, n'ont pas pris le parti des interprétations figées que l'on réitère à chaque occasion. Vincent serait le premier à apprécier cette manière d'opérer de ré-habiter chaque morceau selon de nouvelles prétentions. Chaque titre originel est un diamant dont on peut varier à volonté les brillances et faire étinceler les éclats selon un nouvel éclairage.

Pascal ne slappe comme un sauvage sur son immense contrebasse. La picore d'un doigt presque distrait. Une caresse coulante qui contourne la tranchante agressivité des morceaux au profit d'un dynamo-swing des plus enlevés. N'oublie pas que Cliff Gallup était un fervent admirateur de Django. A Franky Gumbo de rétablir l'équilibre selon des secousses électriques propulsées à bon escient.

Steff est au chant. Vêtu d'une simple chemise noire, il a délaissé les tricots sweat rayés des Fifties pour une tenue plus classique qui ne rappelle en rien les cuirs funèbres et reptiliens de Gégène. De même, il ne cherche pas à décalquer le timbre si particulier de l'idole absolue que reste le créateur de Be Bop A Lula presque un demi-siècle après sa mort. Pas d'imitation. Essaie seulement de retrouver l'esprit de ces glissandi vocaux, de cette agilité suprême que possédait Vincent, ce qui donnait toujours l'impression qu'il chantait sur le fil d'un rasoir mentholé. Et il se débrouille bien, le Steff. Connaît les morceaux à merveille, ne les décline pas de travers ou à contresens des parti-pris de Gene.

Reçoit de l'aide de par derrière. De Didier le batteur. Pas l'exubérance juvénile de Dickie Harrell mais une maîtrise sans défaut. Pas l'obsession de la caisse claire feulée et feutrée mais la permanence d'un beat assuré, jamais embourbé dans un contre-temps et prêt à tous les démarrages fulgurants. La rigueur sèche de la frappe contrebalance la rondeur moelleuse du jeu de Pascal. L'on pourrait craindre un déséquilibre dans ces deux manières d'entrevoir la ligne d'horizon rythmique, mais au contraire cette divergence se traduit par une assise orchestrale des plus stables.

Ne déroulent pas que le collier des perles de Gene Vincent, entre un Teenage Partner dont on oublie l'écrin des choeurs mis très en avant dans la version la plus connue de Vincent parce que la voix de Steff monopolise la plus grande partie de l'espace sonore et une Race With The Devil dans laquelle Franky Gumbo ne force pas la note, les Capitols intercalent de nouvelles compos. Ce sont les titres du nouveau disque dont on nous annonce enfin – cela fait trois ans que nous l'attendions – la sortie imminente dans une petite quinzaine de jours. Ce sont les morceaux dans lesquels le band entre de plein pot et de plain pied. L'on a même l'impression que Franky donne alors tout son jus dans le gumbo. Remue la soupe avec dextérité, solos plus imaginativement personnels, et stridences plus appuyées. La salle ne ménage pas ses acclamations. Promettent de revenir pour deux autres sets.
DEUXIEME SET

Le retour. Plus dur, plus violent. Franky est davantage en avant, le set en est beaucoup plus électrique. Lignes de fuite et regroupements pour repartir aussitôt. Dans la ligne des Blue Caps. Montées en puissances et brisures éparpillantes. Avec en prime ces cristaux atomiques de retenue que sont des joyaux comme Jezebel ou Cat Man. L'urgence et le fourmillement des chevaux qui se pressent les uns contre les autres avant la charge. Who slapped John ? C'est la grande menace qui plane sur vous avant de se refermer et de vous enserrer dans sa poigne de fer rouge.

Ca survient comme un rêve d'orage. Steff est au summum de sa voix encerclée dans la frappe de la batterie. Ca passe et ça casse comme des poignées de grenades qui retombent en pluie d'acier. Les Capitols offrent encore des titres de leur futur album qui s'intègrent parfaitement avec la play-list spécial Gene. Pas des démarquages, des oeuvres à part entière qui leur définissent un style bien à eux. Des parallélépipèdes de force brute qui donnent envie d'écouter et de posséder le disque au plus vite.
SET TROIS

Les voici de nouveau sur scène. Mais ils vont s'échapper très vite. Steff a repéré les Ol' Bry dans la foule. Les appelle pour qu'ils les rejoignent sur scène. Refile même son Harmony Monterey à Eddie, Franky abandonne carrément sa duo jet 56 à Diego et Tuierry n'a qu'à ramasser la big mama de Pascal, leur laissent les clefs de la maison, sans préavis. N'y a que Didier prisonnier de ses futs qui est condamné à rester. Ce qui n'a pas l'air de l'ennuyer, l'est prêt à collaborer à l'aventure impromptue sans état d'âme.

Deux concerts dans un, nous sommes gâtés. Eddie a compris qu'après le set précédent des Capitols il doit mettre le turbo à fond les manettes pour relever le défi. Pas une seconde à perdre. Les temps morts sont les ennemis des instants magiques. C'est parti un Am I Blue à vous frictionner les oreilles pour le restant de l'année. Un rayon de miel, arrosé au jus de piment. Voudraient redescendre, erreur stratégique, la salle est prête à organiser un défilé de protestation s'ils persévèrent dans cette mauvaise idée. De toutes les manières les Capitols ne sont pas pressés.
Alors on se régale d'une suite Ol Bryenne des mieux venues. Pas un dessert de sucreries Doo Wop, plutôt une entrée teigneuse à la rockab de derrière les fagots qui vous incendie la gorge. Un must.

Enfin les Capitols consentent à revenir, mais il est hors de question qu'ils laissent les Ol' Bry s'échapper dans la nature. Steff et Eddie se décident pour un dernier lingot d'or liquide, un Folsom Prison Blues qu'ils chantent à deux. Font cela si bien que l'on se demande si Johnny Cash ne l'a pas composé pour eux. Je n'aurais pas dû écrire tant de bien sur eux car à la fin du morceau ils nous laissent tomber comme de vulgaires paires de vieilles chaussettes sales. Je me permets de leur rappeler que the great Cash a enregistré un minimum de soixante-dix albums et qu'en cherchant dans leur mémoire ils auraient pu trouver quatre ou cinq autres pépites. Que voulez-vous les rockers sont ainsi, plus vous leur en donnez, plus ils en veulent. Ne se contentent pas du pain des pauvres, vous avaleraient la brioche des riches sans coup férir si on les laissait faire. Merci les Loners pour cette soirée. Un bel exemple de camaraderie rock entre deux combos. Plus l'ombre tutélaire de Gene Vincent. Quand je vous dis qu'il en faut peu pour rendre les rockers heureux !
( Photosde Chris Dixie Straet prises sur le facebook des artistes )
Damie Chad.
106 / ROUEN
28 – 01 – 14 / THE OBITS
LE GROS BEAT DES OBITS
On avait un vague souvenir. Rick Froberg ? Bon dieu ! Mais c’est bien sûr ! Le concert des Hots Snakes au Nouveau Casino, par une chaude soirée de mai 2005 ! Deux guitaristes jouaient dans les Hot Snakes : Rick Froberg et John Reis, le mythique leader de Rocket From The Crypt. Bien sûr, c’est John Reis qu’on venait voir.
Pendant toute la première partie, John Reis se tenait au bar, coiffé comme Eddie Cochran, et il signait quelques pochettes de disques. On avait là un type d’une incroyable gentillesse, aussi facile d’accès et souriant que Phil May. Puis il était monté sur scène pour jouer comme un diable. Il moulinait tellement d’accords sur sa Les Paul blanche décorée de dragons qu’il donnait le vertige. Il n’utilisait aucune pédale d’effet. Il sortait un son direct sur le Marshall. Son son cru vrillait les tympans. Il balançait une incessante purée d’accords extravagants dont l’enchaînement relevait de la plus brutale virtuosité. Il jouait si fort qu’on n’entendait même pas Rick Froberg, planté de l’autre côté de la scène. Comme John Reis jouait à l’extrême droite et Rick Froberg à l’extrême gauche, le centre de la scène restait atrocement vide. Un bassman jouait un peu en retrait. Le pauvre Rick Froberg ne disposait pas du coffre permettant de couvrir un tel ramdam.

John Reis jouait comme un démon. Il remuait la tête en rythme d’avant en arrière, tel un dindon rockab. Il faisait le Cochran avec félinité. Il retombait parfois sur ses pattes, accompagnait ses breaks fulgurants de gestuelles jambaires. Ça tenait du prodige. Il transpirait à grosses gouttes. Même ses mains dégoulinaient. Il était certainement le plus grand rythmique de tous les temps. Il n’y avait pas deux accords qui fussent les mêmes et ses incursions dans les aigus en disaient long sur son abnégation. Il ne semblait n’être sur cette terre que pour le rock’n’roll. On voyait bien la furie pulser dans ses veines. Il grattait ses accords avec une main tordue comme celle d’un poliomyélite. Il turlupinait des moulinets à longueur de morceaux. Son jeu était d’une densité rarissime. Il se situait en dehors du commun des mortels. Avec lui, le rock fumait. Il moulinait industriellement. En pur killer de San Diego, il s’ingéniait à dépasser toutes les bornes.

N’oublions pas que Rocket From The Crypt fut à peu près le seul groupe américain (avec les Screaming Trees) à être encensé par la presse anglaise. Pour «Hot Charity», les Rockets avaient obtenu 10 sur 10 dans le NME, ce qui était exceptionnel, car en la matière les Anglais battent tous les records de chauvinisme. Ce soir-là, les Hot Snakes jouèrent une ribambelle de morceaux nerveux et souvent passionnants tirés de leur troisième album, «Audit In Progress». Ces rockers inaltérables bandaient leurs muscles. Rien ne pouvait leur barrer le chemin. John Reis était la plus grosse locomotive de l’histoire du rail.

Pour retrouver l’ambiance de ce concert édifiant, il suffit d’écouter l’album live des Hot Snakes qui s’appelle «Thunder Down Under». «Braintrust» nous saute à la gorge, c’est un monstre garage-punk hérissé de gimmicks urgents que John Reis joue d’un petit doigt vicieux. Puis on entend clairement les orgues de Staline, il pleut des power-chords dans tous les coins, sous un ciel noir d’apocalypse. On se tape aussi le vrai punk exacerbé de «Think About Carbs», et Rick Froberg chante la glotte en sang d’une voix de kid nourri aux céréales. Il hurle comme un con sur la rythmique haut de gamme du gentil John, le type le plus charismatique d’Amérique. Autre point fort de ce set live, c’est «Plenty For All», bien poundé derrière, riffé sauvagement, mais le pauvre Rick force sa voix, il manque atrocement de coffre. Rick Froberg n’est pas Chris Farlowe, on l’aura bien compris. Mais le gentil John le laisse hurler dans la tempête sonique et joue ses arpèges jusqu’au bout. «Who Died», c’est l’enfer sur la terre, une stoogerie abominable, feu, flammes, fun, le magma coule. Tous ces morceaux sonnent comme des prouesses techniques. «Kreative Kontrol» est un autre morceau hanté par les gimmicks de John Reis. On entend des harmoniques de fond extraordinaires. Rick Froberg sonne comme un martyre hardcore. Il faut pouvoir le supporter.
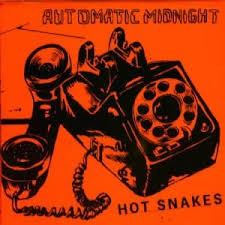
Le premier album studio des Hot Snakes s’appelait «Automatic Midnight». Sur la pochette, comme sur les pochettes des albums suivants, on trouve des dessins de Rick Froberg qui est illustrateur et graphiste à New York. Il avait dessiné un gros téléphone pour le recto et une voiture décapotable pour le verso. À l’époque de sa sortie, ce disque est un peu passé à l’as. À peine un article dans Spin, et bien sûr, on l’achetait parce qu’il s’agissait d’un side-project de John Reis (comme on achetait les disques des side-projects de Mark Lanegan, de J. Mascis, de Kim Salmon ou de Dave Kusworth). Le premier morceau de l’album s’appelle «If Credit’s What That Matters, I’ll Take Credit». On entendra rarement des trucs aussi saturés. Puis c’est bombardé d’accords. Ils sont complètement fous. Ils dépassent les bornes. On croirait entendre la révolution industrielle devenue folle. Seul John Reis pouvait provoquer un tel paroxysme. On retrouve cette énergie démoniaque dans «10th Planet», une belle pièce de garage punk battue comme plâtre. Ces types ont le diable dans le corps. Ils atteignent des niveaux inusités de densité sur-saturée et de grosse excitabilité carabinée. «Our Work Fills The Pews» est monté sur un beat vaudou et ça se met à cavaler. Encore une belle cochonnerie. Rick Frobert hoquette comme un déséquilibré tantrique. C’est l’un des morceaux les plus insidieux de l’histoire insidieuse. C’est la croix et la bannière. Encore une belle accroche mortelle. On retrouve la saturation optimale avec «Past Lives». La basse crache ses poumons. Horrible. Voilà la Dame aux Camélias de la basse dure. C’est d’une sauvagerie à peine croyable. C’est le son de basse dont rêvent tous les psychopathes. Bizarrement, la console n’a rien dit. Voilà encore une pièce d’une violence à peine descriptible. John Reis chante «Mystery Boy» et on sent tout de suite la différence. Il emmène tout à un train d’enfer, de façon puissante et dévastatrice. C’est à la fois éclatant et explosif. On retrouve le grain riche et total de la voix de John Reis. C’est une véritable orgie sonique digne des grandes heures de Rocket From The Crypt. Et puis l’album s’achève avec «Let it Come». On sent qu’il existe des forces souterraines dans le flux des Hot Snakes.

Leur second album s’appelait «Suicide Invoice». Ce fut un disque pour le moins aride, très bousculé, tourmenté et qu’on rangeait avec les disques garage, pour simplifier les choses. Car ce n’était pas que du garage, au sens où l’entendaient les concessionnaires. Les chansons des Hot Snakes étaient beaucoup plus tarabiscotées. On pourrait même dire torturées, mais cette impression était essentiellement due à la voix de Rick Froberg, qui est celle de l’hérétique brûlé vif en place de Grève. John Reis joue dans ce disque à pochette jaune son rôle de locomotive et il emmène un morceau comme «Gar Forgets The Insuline» à fond de train vers le néant. «XOX» est une belle pièce douloureuse et si on aime bien les belles pièces douloureuses, alors on se régale. Rick travaille ça au hurlement. Il crie vraiment comme s’il était ligoté au poteau du bûcher au moment où les flammes commencent à lui lécher le dessous des pieds. Dans «Who Died», on retrouve les bonnes dynamiques des Rockets. Le son est plein comme un œuf de ptérodactyle. Et puis, vers la fin du disque, on va trouver deux pépites garage, «Bye Nancy Boy» et surtout «Why Does It Hurt» qui est tout simplement défenestrateur, car enfoncé à coups de riffs et digne des gros bash-blasts du grand garage intercontinental. Mais ce n’est pas un disque évident, globalement. On l’écoute par curiosité, et peut-être aussi par sympathie pour John Reis.
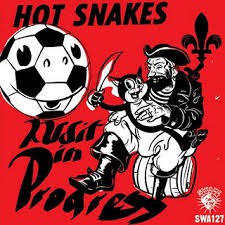
Le suivant, «Audit In Progress», était un gros baboum d’album. On retrouvait sur ce disque tout le percutant du concert au Nouveau Casino, toute la pétaudière rythmique qui n’avait de sens que par rapport à elle-même, car il n’était absolument pas possible de mémoriser le moindre refrain, la moindre fibre mélodique. Ils jouaient la pétaudière de la dérobade de San Diego de façon fulminante et dans une extrême tension pour le simple plaisir de la pulsion pulsative.

Ces dingues battent le fer sans arrêt, «Braintrust» et «Hi Lites» vont tout droit et Rick hurle à travers les flammes de son bûcher. Quand on l’entend chanter, on pense immédiatement à Oliver Reed dans «Les Possédés de Loudun». Les Américains adorent ce genre de disque. Ils qualifient ce rock de ‘edgy’, celui qui va danser la carmagnole au bord du gouffre. Pas de fioritures. Un peu de tarabiscotage, c’est vrai, mais dans les limites de l’acceptable. Le morceau titre de l’album est un garage typique du middlewest, celui qu’on joue à la fourche des deux rivières, là où le ciel se noie dans l’océan de verdure. John Reis rebâtit un monde dans l’espace délétère de la méthode imbue et le pauvre Rick se racle la glotte au sang pour emmener le morceau à l’assaut du néant. On finit par succomber à ce drôle de charme. Avec «Hatchet Job», ils foncent droit dans l’irrationnel rythmique et bâtissent un mur du son totémique gratté à la dure. On assiste au riffage le plus dingue de l’histoire du riffage. Il se dégage de ce morceau une énergie à couper le souffle. Ils épaississent l’atmosphère jusqu’à un taux jusque là ignoré des physiciens. Il coule de ce morceau un jus étrange et bienvenu. Ils nous refont le coup du riffage des fous de l’asile dans «The Mystic Decade», on s’épate de tant d’exactions. C’est épais et violent. On goûte de belles tranches d’apocalypse. Voilà du plombé de très grande envergure. Sur la pochette, Rick a dessiné un nazi qui shoote dans un ballon de foot tout en sifflant sa bière et un chat allongé sur les genoux du pirate va tenter de sabrer le ballon. Tout est dans l’écroulement des civilisations, dans la négation des visages, dans l’oubli de la raison. Avec «Lovebirds», ils forent des voies dans le gruyère de Giger à la recherche de passages inutiles. «Reflex» est un morceau pulsé jusqu’à la nausée. On connaît ce genre de pulsation extrême et on sait où ça mène. Les Californiens adorent rôtir dans les flammes du fameux Californian Hell. Sur ce disque tout est si dense qu’il paraît bien dérisoire de vouloir épiloguer. Tout est si poussé dans le dos qu’il paraît bien dérisoire de vouloir ergoter. Ce que font les Hot Snakes, c’est de la pure suprématie. Ils brisent les flux comme des brindilles et ils effarent l’infidèle.

Aujourd’hui, les Hot Snakes n’existent plus, mais il court une rumeur de reformation. Rick Froberg n’est pas resté assis à se tourner les pouces. Il a remonté les Obits et décroché un contrat avec Sub Pop, qui reste un label de référence, aux États-Unis. Les Obits qui ne chôment pas ont déjà enregistré trois albums et comme ils passaient par Rouen pour jouer au 106, on a profité de l’occasion pour aller les applaudir.
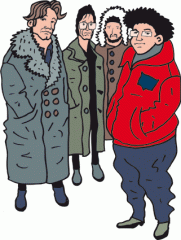
Sur scène, ça se passe exactement comme sur les disques. Pendant un bon moment, il ne se passe rien, on pense à autre chose, à tout et à rien et puis, clic, comme ça, sans qu’on sache pourquoi, ça se met à fonctionner. On sent bien qu’ils s’investissement dans leur musique et que leurs compos reflètent un gros travail en amont. Ça se voit. Presque trop. Ils sont extrêmement sages et concentrés. Ils travaillent des gros grooves et font parfois jaillir des purs moments d’émotion et on se rassure en se disant qu’au fond ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais à part Rick Froberg, aucun Obit n’a la dégaine d’un rocker. Le bassiste Greg Simpson joue posément sur sa basse Rickenbacker. Le petit Sohrab Habibion tisse sur sa guitare des trames qui viennent s’entrelacer avec le jeu un peu libre de Rick et derrière le batteur bat son beurre comme tous les autres. Il faut vraiment se pencher sur leur cas si on veut espérer en tirer quelque chose. Je veux dire par là que leurs morceaux ne sont pas d’une grande évidence.

«I Blame You» fait partie de ces albums qu’on ne réécoute pas souvent, bien qu’ils sachent se montrer par certains côtés très sympathiques. «Widow Of My Dreams» semble être leur hit. Dans «Pine On» on tombe sur de bonnes idées de riffs et ça sent bon la poignée des gaz. Ils recherchent l’admirabilité des choses. En écoutant «Fake Kinkade» on sent que les anciens dieux de la puissance se sont penchés sur le berceau de cet album. Rick et ses amis sont vraiment décidés à en découdre avec l’adversité. Le beat des Obits se dresse fièrement. C’est le troisième morceau de l’album et jusque là, c’est un sans faute. L’oreille du vieux pingouin désarçonné se redresse. Dans «Two Headed Coin», on voit la voix de Rick errer comme une hyène sur un beat tendu et bien dru. On sent leur allant sous l’étoffe. Ils sortent un beat exotique pour «I Blame You», instro court et ambitieux. Le cocktail surprend par la verdeur de son ingéniosité. Les morceaux qui filent dans la nuit comme «Lilies On The Street» font beaucoup de bien aux équipes de la veille technologique avancée. Le bassman joue son motif avec une régularité édifiante. C’est un vrai mètre étalon. «Sud» est un morceau droit, très droit. Il ne s’arrête jamais et c’est très bien. Ils balancent une version grungy de «Milk Cow Blues» et terminent sur un garage de surboum, «Back And Forth», comme s’ils avaient décidé de réveiller nos plus bas instincts.
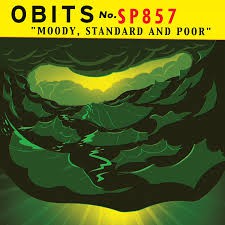
L’album «Moody Standard And Poor» intrigue aussi au plus haut point. Rick Froberg n’a pas vraiment de voix, alors il doit crier. Lui et ses amis semblent se jeter dans des grooves cavalants qui ressemblent à des combats perdus d’avance, comme avec «I Want Results». Il tapent dans le mille fois déjà fait, dans l’excellence du sert à rien, ils sont appliqués et convaincus, ce qui fait leur force. Pendant que Sohrab et Rick croisent leurs chorus, Greg le bassiste joue calmement. «Everything Looks Better Than The Sun» sonne comme un beat mille fois éculé. Pourquoi choisissent-ils de rester les deux pieds dans le même sabot ? Ils ne sortent pas de la routine du college rock cuit et recuit, et pourtant ils parviennent à lancer de petits éclairs intéressants. Ils travaillent les ambiances au corps, ils cherchent des passages dans les récifs. Il faudra fournir des efforts considérables pour comprendre leur démarche. C’est de part et d’autre un travail de fourmi. Avec «Killer», ils n’en finissent plus de poppiser dans la sub-popperie, et le mixeur complique encore les choses en sous-estimant la voix d’hérétique supplicié de Rick Froberg. «Shift Operator» sort enfin des caves de l’ordinaire. Voilà le lapin blanc qu’on attendait, plein de belles atonalités chromatiques et de déviations bienvenues. Dommage qu’ils n’aillent pas dérailler plus souvent. Les gros trucs sont sur la face B, et notamment «Naked To The World», grosse pièce garage inespérée et fièrement interprétée. «New August» est monté sur un beat drôlement rebondi. Ils font un tour à vide. Voilà leur truc : le groove. Le traitement avoiné des espaces intermédiaires. Ils ne s’embarrassent pas avec les sentiments. Ils automatisent leurs pulsions fictionnelles et bloquent le cap sur le cœur du ventricule. Très belle pièce, cisaillée à l’acide, roulée dans la basse, pétrie de mad psyché. Tout s’éclaire, le monde des Obits s’ouvre comme la vulve de Draculette et on fonce vers les profondeurs humides du monde sidéral.

«Bed And Bugs», leur troisième album, grouille de petites bêtes. Tous ceux qui ont chopé des morpions savent de quoi il s’agit. Rick le graphiste a encore fait des siennes en perçant la pochette du vinyle et en la décorant ce motifs géométriques. On se retrouve confronté au même problème : démarrage problématique, et puis, clic, ça accroche. Rick chante hurlé son «Taste The Diff» et son «Spun Out» et on tombe sur l’insidieusement rampant «It’s Sick», qui a la structure d’un gros hit garage-pop. Rick pousse son refrain dans les orties comme une grand-mère. Franchement, ce sacré coquin se plaît à cultiver le malsain. «This Must Be Done» gagne la sympathie. C’est un étrange morceau dont le fond grouille de petites guitares insidieuses. On sent chez ces gens-là une nette volonté de nuire aux oreilles d’autrui. Il cultivent le mystère et semblent ricaner comme des sorcières de Walt Disney. Rick chante très haut dès l’intro son «Pet Trust». Il nous vinaigre les oreilles. Il passe son temps à se racler la gorge. Le morceau reste terriblement ambitieux et fait partie de ceux qui nécessitent plusieurs écoutes. Et puis on tombe sur une petite perle qu’il faut bien qualifier de Dada : «Besetchet», un instro passionnant qui colle au palais comme un loukoum de Michel Tournier. C’est avec une ardeur renouvelée qu’on saute sur la face B et là on tombe sur «Operation Bikini», morceau pressé, au parfum post-punk et on se demande où ils vont chercher des idées pareilles. «Malpractice» se voit monté sur une ligne de basse rapide. Ils jouent là au jeu du calme avant la tempête, l’ancienne spécialité des Pixies. C’est très accrocheur et ça rétablit leur honneur. «This Girl’s Opinion» se caractérise par une bonne ambiance classique et une grosse tension d’accords pantelants. C’est en cocotant qu’ils cherchent leur passage à travers les récifs. On finit par tomber sur de vraies perles, comme «I’m Closin’ In», pur garage digne des géants des sixties. Voilà un morceau solide, bon et cuivré comme le guerrier Apache déterminé à poursuivre le combat jusqu’au bout. On se délectera de «Machines», morceau mystérieux qui aurait beaucoup intéressé Jules Verne et Rick nous dit adieu avec «Double Jeopardy», un instro mystique qui serpente dans la nuit étoilée comme un Arsène Lupin en rut.

On finit par se faire avoir avec les Obits, même s’ils ne sont pas d’un accès facile. Mais leur manque total de prétention les rend infiniment sympathiques. Leur vraie force est certainement leur singularité. Ils défendent l’idée d’un rock ambitieux qui risque de les couper d’un monde devenu impitoyable et affamé de médiocrité.
Signé : Cazengler, sur l’orbite des Obits
The Obits. 28 janvier 2014. Au 106 à Rouen.
Hot Snakes. Automatic Midnight. Swami Records 2000
Hot Snakes. Suicide Invoice. Swami Records 2002
Hot Snakes. Audit In Progress. Swami Records 2004
Hot Snakes. Thunder Down Under. Swami Records 2006
The Obits. I Blame You. Sub Pop Records 2009
The Obits. Moody Standard And Poor. Sub Pop Records 2011
The Obits. Bed And Bugs. Sub Pop Records 2011
De gauche à droite sur l’illustration : Greg Simpson, Rick Froberg, Alexis Fleisig et Sohrab Habibion
SEX PISTOLS
ROTTEN PAR LYDON
Keith & Kent Zimmerman
( Camion Blanc / 2005 )
Les Sex Pistols auront fait couler davantage d'encre que de sperme. Alors autant donner la parole à leur porte-drapeau qu'à un quelconque chroniqueur. Johnny Lydon se raconte. Pas tout seul, ses propos sont coupés d'interventions plutôt courtes d'une vingtaine de témoins de l'apocalypse Pistols qui dans leur grande majorité ne font que confirmer – à quelques nuances près – les dires du principal narrateur. A de rares moments l'on donne la parole à quelques privilégiés dont les dires sont alors secondés de brèves interventions de Johnny.

Le livre original est paru – voici longtemps déjà – en 1994 aux Etats-Unis. A une époque où le personnage était encore une figure mythique et avant-gardiste du rock'n'roll. Ces vingt dernières années, le chantre du punk a été rattrapé par une télévision qui cherche davantage les parts de marché publicitaires que le progrès intellectuel des masses. Malgré quelques gros mots judicieusement placés en direct la figure du leader charismatique a pâti de ses trop fréquentes apparitions. L'image publique de Johnny Lydon n'a pas la force décapante de la gueule vindicative du jeune Johnny Rotten. Il est toujours difficile de se survivre quand le meilleur de votre existence vous a été distribué à l'orée de votre jeunesse.
CLASSE
Consacre cent pages sur 460 à nous parler de ses années de pré-pistoléros. Johnny Rotten n'oublie pas d'où il est sorti. Pas uniquement du ventre de sa maman. Avant tout de la classe ouvrière. N'est pas un militant, ni un révolutionnaire, mais il tient à sa revendication. Fils de prolétaire. Un père qui ne fait pas de cadeau pour mieux enseigner la dureté de la vie à ses quatre garçons, une mère aimante et un taudis insalubre dont il retirera à l'âge de sept ans une méningite qui ne partira pas sans laisser quelques séquelles épileptiques et une étrange fixité du regard.

L'aurait pu en devenir idiot, mais l'année d'immobilité sur un lit d'hôpital lui permettra plutôt d'activer ses neurones. Ne faudra pas le lui faire. Acuité intellectuelle aiguisée. Ne sera plus jamais dupe de sa condition sociale. Sera un rebelle dans l'âme. Qui ne se berce d'aucune illusion. En développera un refus prononcé des conventions sociales. Ne dira jamais zut quand il pense merde. Les chockin' réactions de ses congénères et un sentiment d'auto-dérision prononcé lui permettront de développer un cynisme jusqu'au boutiste ravageur qui ne sera pas étranger à la glorieuse explosion des Sex Pistols.

N'est pas seul. Ses amis ne valent guère mieux que lui. Surtout le jeune Simon Ritchie, plus tard connu sous le sobriquet de Sid Vicious, une espèce de taré congénital qui transcende son vécu familial dévastateur par une auto-suffisance narcissique des plus stupides. Une bande d'ados qui essaient de se faire remarquer comme ils peuvent. Le manque d'argent peut être un parfait aiguillon. Johnny déchire ses habits, les découpe et les raccommode avec des épingles de sûreté... Pour les distractions, l'on danse en boîte au mieux sur de la soul dégénérée au pire sur de la disco robotisée. A dix-sept ans il gagne sa vie en tant qu'animateur auprès de jeunes enfants. Leur enseigne le dessin. L'idée de former un groupe de rock ne lui serait jamais venue à la tête, s'il ne s'était mis à fréquenter la boutique de fringues d'un certain McLaren.
JUSTE UN HIC

N'y va pas pour la musique mais pour les habits à découper. Malcolm McLaren rêve de monter un groupe de rock. L'a déjà recruté trois musicos, Glen Matlock, Steve Jones, Paul Cook. Manque juste le chanteur. McLaren se garde le meilleur poste : sera le pygmalion du rock'n'roll, le manager producteur qui décide de tout. L'a des idées plein la tête. Dans le jargon de Johnny Lydon, cela se traduit par sale petit-bourgeois prétentieux à la con. Le courant ne passera jamais entre les deux hommes.
Faut attendre les dernières lignes du bouquin pour que Lydon révèle un geste de complicité entre lui et McLaren. Sinon il le critique tout du long, sans pitié. Tout ce qui vient de McLaren est frappé selon John d'une tare irrémédiable. L'accuse de tout et de rien, et même d'avoir fait foirer la réussite du groupe. De toutes les manières, Johnny Rotten a toujours raison, une autobiographie est de bien entendu un plaidoyer pro domo, mais avec Johnny ce sont sempiternellement les autres qui ont tort. Peut tout se permettre, mais ne laisse aucune excuse aux malheureux qui croisent son chemin.

McLaren a défini sa feuille de route. Elle ne peut que plaire à Rotten, les Sex Pistols seront le groupe par qui le scandale arrive. Malcolm McLaren sera le grand Manipulateur. Fera faire et dire au combo, tout ce qui ne se dit pas et ne se fait pas selon les us et coutumes des sociétés policées. Les médias et l'opinion publique vont avoir droit à un traitement de faveur accéléré. Lydon endossera à la perfection le rôle du crieur public chargé d' ânonner l'interminable liste des calamités imminentes...
MAESTRO
Faut tordre le cou aux légendes. Au début avec les Sex Pistols, à part Glen Matlock, nous n'avons pas affaire à des virtuoses. Mais au fil des répétitions les progrès seront constants. Lydon qui ne sait pas chanter découvrira tout seul, comme un grand, comment il lui faut placer sa voix. Finira par trouver son style personnel si particulier. Les Sex Pistols se démarquent de tous les groupes : jouent plus vite et plus fort. Pas de finesse. Les grosses ficelles. Celles qui tiennent le mieux.

Le secret des Sex Pistols est tout simple. Alcool et speed pour accélérer les dissensions et surtout pas d'hypocrisie de façade. Les trois musicos n'aiment pas Johnny, Rotten ne supporte ni Matlock, ni McLaren. Et guère mieux les deux autres. Aucune estime entre ces individus. La haine est un ciment plus solide que l'amour. Aucune recherche d'harmonie inter-individuelle. L'on ne ne joue pas avec l'autre, mais contre. Les spectateurs ne sont pas mieux lotis. Rotten les supporte de moins en moins. Il déteste leur attitude de fans transis. Ne se réjouit pas de voir ses propres tenues de scènes adoptées et imitées par le public. Leur reproche leur manque de personnalité et leur uniformisation. Les traite de clones, il les insulte et les provoque. Les concerts deviennent de plus en plus violents. Les bagarres éclatent. Johnny ne s'en prive pas, il se jette dans la salle sans se préoccuper de ceux qui le réceptionneront. Les sinus bouchés il a pris l'habitude de cracher par terre pour dégager sa gorge. Sans le savoir il vient de lancer une mode. Les groupes seront désormais copieusement arrosés de glaviots admiratifs et vindicatifs, habits, visages et instruments dégoulinent de mollards visqueux.
PRECURSEURS
En quelques mois les Sex Pistols ont créé l'évènement. Le bouche à oreille a fonctionné. Toute une jeunesse se reconnaît en ce quatuor de choc. Le punk est né. Des dizaines de groupes leur emboîtent le pas. Lydon assure que le punk est bien né en Angleterre et pas chez les intellos de New York. L'a déchiré ses T-shirts bien avant Richard Hell. Patti Smith est une grand-mère entichée de poésie et les Ramones des gamins sans envergure. Minimise le rôle des New York Dolls et d'Iggy and the Stooges.... Seuls Johnny Thunders et les Heartbreakers trouvent quelques grâce à ses yeux. Encore que Thunders emmène en Angleterre deux fléaux mortels, Nancy Spungen et l'héroïne...

McLaren est aux anges. La mayonnaise prend encore plus vite qu'il ne l'espérait. L'est temps d'embraser le deuxième étage de la fusée afin de la mettre sur orbite médiatique. Quelques insultes proférées en direct à la TV aux heures de grande écoute et le tour est joué. Quelques vomissements en public et l'horreur est à son comble... Les journalistes suivent le groupe en cortège. Tout ce remue-ménage inquiète les autorités qui envoient ses policiers surveiller cette bande de gaziers par trop remuante et nauséabonde.
DIEU SAUVE LA REINE !

Un groupe ne peut pas vivre que sur des reprises. Ecrire des morceaux demandent quelques connaissances. Matlock veut bien se charger du fond musical mais pour les lyrics apparemment il manie mieux le médiator que la plume. Johnny s'en chargera. Pond coup sur coup deux bombes nucléaires, Anarchy In The UK et God Save The Queen, qui font sauter le jackpot et mettent le feu aux poudres. Le premier titre est une déclaration de guerre, mais le second est une intervention militaire. Lydon nous prend pour des imbécile. Est tout étonné des réactions du pouvoir et des foules. Notre but n'était pas politique, assure-t-il, nous étions à mille lieues de cela. A le suivre dans ses raisonnements, les gens se sont affolés pour un pet de lapin, beaucoup de bruit pour rien comme disait Shakespeare.

Les portes se ferment devant eux. Les municipalités annulent les concerts les unes après les autres. Sont obligés de tourner sous des noms d'emprunts mais le plus inquiétant n'est pas là. Une haine anti-pistols se développe parmi les beaufs de service qui hantent les rues de la capitale. D'autrepart les groupes de teddies voient d'un très mauvais oeil le mouv ement punk grandir un peu trop vite... Bref beaucoup trouvent en la défense de la Reine un formidable prétexte pour organiser la chasse à l'homme. Inutile de se plaindre auprès de la police, elle refuse d'accorder sa protection à de tels renégats de la monarchie. Violemment pris à partie Rotten recevra un coup de couteau dans la cuisse et une blessure à la main l'empêchera désormais de pratiquer la guitare. Les punks rasent les murs en espérant éviter toute malencontreuse rencontre assurée de se terminer par un passage à tabac.
Ambivalence de l'idéologie qui balance entre la remise en question radicale du système et le je m'en foutisme généralisé. C'est au nom de la premiere que Rotten obtient de McLaren la mise hors-circuit de Matlock. L'est viré du groupe pas tant parce que pour ne pas faire de peine à sa maman il descend de scène quand le groupe entame l'hymne royal mais pour sa gentillesse naturelle, son caractère de base trop conciliant qui préfère discuter, parlementer, temporiser et négocier que tout de suite s'opposer et agresser l'interlocuteur qui possède un point de vue différent.
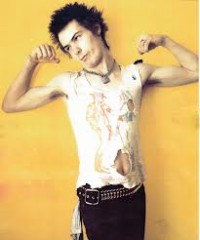
Sera remplacé par Sid Vicious. Rotten rétablit l'équilibre des forces. Ce ne sera plus un tout seul contre trois soudés mais deux contre deux. Le rapport des forces s'équilibre en sa faveur, surtout qu'il possède au plus haut degré l'art de parler. Une chance inespérée pour Sid, Rotten lui offre une très belle preuve d'amitié. Vicious ne saura pas s'en montrer digne. Au début il s'efforce de bien faire et apprend à jouer de la basse. Ne se débrouille pas trop mal. Y met tout son coeur. Qu'il va très vite tourner d'un autre côté. Se prend pour une rock and roll star, en aura tous les caprices, mais n'ira pas plus loin que la première groupie qui lui jette le grappin dessus. Nancy Spungen entre dans la vie de Sid, s'y installe pour toujours. A la vie, à la mort. En fait pas très longtemps mais elle n'en ressortira que les pieds devant. Nancy n'est pas une égérie romantique. Grossière, intéressée, une pute au petit coeur, elle subjugue le pauvre Sid en quelques heures. Sans doute le déniaise-t-elle côté sexe, mais elle l'initie à l'enfer de l'héroïne. Vicious deviendra une loque humaine incapable de tirer une ligne de basse. Le premier fâché sera Rotten qui comprend trop tard son erreur. Imputera la fin des Pistols en partie à la présence hébétée de Sid dans le groupe.

RECORD

En attendant la chronique d'une mort annoncée, les Sex s'enferment en studio pour enregistrer leur album. L'aide de Sid est tellement peu opérative qu'ils se voient obligés de louer les services d'un bassiste de session. Ravaleront leur orgueil puisqu'ils jetteront leur dévolu dur un un certain... Glen Matlock qui accepte de revenir le temps des sessions sans se faire prier. Rotten regrette qu'il ne les ait pas envoyés chier. Le geste aurait été pistolien en diable. Mais Matlock est décidément prêt à toutes les concessions, il accepte le deal sans rechigner. Preuve qu'il n'a pas été renvoyé pour rien.
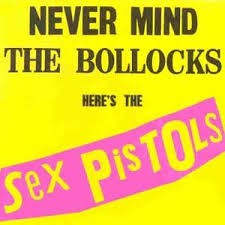
Le disque sera le chef d'oeuvre que l'on sait. Clouera le bec de tous ceux qui les ont devancés. Rien à jeter, surtout pas la pochette d'une crudité rudimentaire. Ca sort chez Virgin mais elle embaume le Do it yourself à plein nez. Découpage et bricolage de génie. Du grand art. Musicalement, c'est du rock. Only rock'n'roll. Du bruit et de la fureur. Et rien d'autre. N'ont pas commis l'erreur de l'arrière-fond ska-reggae qui gît au fond des silons des disques du Clash. Même si plus loin Lydon se vante d'avoir été le premier de la génération punk à apprécier le reggae de Jamaïque. Jah nous aurait donc préservés de la grande contamination !
THE END
De toutes les manières ce sont bien les Sex Pistols qui feront le clash final. Aux USA, McLaren les y a envoyés puisqu'il est impossible de tourner in the old England. L'est comme les journalistes attachés aux basques du groupes, il attend la moindre bévue qui tournera en scandale international. Mais les Pistols se méfient de tout, surtout de Sid dont ils appréhendent la moindre gaffe... Les concerts se passent plus ou moins bien. Ce n'est plus de la musique, c'est du spectacle. Rotten jettera l'éponge à la fin de la tournée.
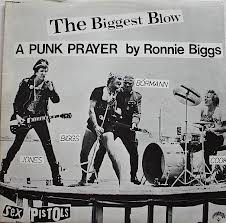
Vicious imprévisible, McLaren - qui projette un film avec Ronald Biggs, le héros du vol du train postal - inaccessible, Jones et Cook peu regardants sur la signification symbolique de la trajectoire du groupe, Rotten préfère partir. Pile à temps pour monter Pil, Public Image Limited...

LA GRANDE ESCROQUERIE

La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll, sortira en 1981. Entre temps Sid Vicious est mort d'overdose. L'on se demande encore si c'est lui qui quelques mois auparavant aura poignardé Nancy Spungen... Rotten crache sur the great swindle. L'accuse d'être un film sur McLaren et pas un film sur les Sex Pistols. L'a raison à cent pour cent. Mais il faut encore savoir ce qu'ont été les Pistolets du sexe. Un groupe de rock un peu en avance sur son temps, appelé à devenir culte auprès des générations futures, ou une opération de marketing d'un genre un peu spécial issue du cerveau embrumé de son concepteur Malcolm McLaren ?
Ce qui est sûr, c'est que contrairement à leur slogan, les Sex Pistols ont bénéficié d'un futur bien rempli. Je ne parle pas des reformations ( juste pour l'argent ) des années 1996, 2003, 2005, 2008... L'on sent que la question a turlupiné Johnny Lydon. Y répond en élargissant la problématique. Les Sex Pistols comme le groupe référentiel du mouvement punk. Le punk comme une révolution culturelle. En avance sur son temps et récupéré par la mode capitalistique, les mèches rouges de jeunes bourgeoises et leur jeans troués de marque... L'écume de la bêtise. Les crottes qui suivent le sillage du bateau d'où elles proviennent. Beaucoup plus important l'affirmation des individualités, notamment les femmes, premier mouvement où les filles furent traités comme les garçons... une coupure avec les vieilles lunes du romantisme réduites en miettes et remplacées par la toute puissance du désir de sexe aussi bien chez les cohortes masculines que féminines.

Avec tout de suite rétropédalage prophétique. Le No Future n'était qu'une annonciation. De 1975 à 1978, le punk n'était qu'une prévision. Le no future étaient pour les lendemains qui ne chanteraient pas. Pour aujourd'hui. Les temps étaient destinés à se durcir. Pas pour tout le monde. Pour la classe ouvrière, les pauvres, les rejetés du système... Le punk ne nous a pas menti. La réalité de notre monde présent qui n'est que le futur du punk est angoissante. La guerre de classe a été perdue. Assez pitoyablement. Faute de combattants. Les ilotes ont mis le masque des maîtres et ont déserté leur camp naturel. Préfèrent consommer que se révolter. Ca leur coûte cher, mais la vie n'a pas de prix.
ROCK ANGLAIS
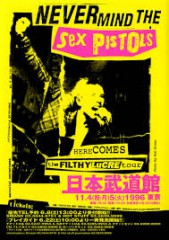
Vous pouvez préférer le groupe de votre choix. Mais quant au rock anglais, je n'en vois que deux qui se détachent. Ni les Animals, ni les Yardbirds. Trop refermés sur eux-mêmes et sur l'histoire du rock. Mais les Stones et les Sex Pistols. Pas parce qu'ils chantent mieux ou jouent mieux de la guitare que tous les autres, mais parce qu'ils sont les deux seuls dont la politique de déploiement a impacté le déploiement de la grande politique. Celle qui s'immisce et transforme la vie des gens. Les Stones par leur école de cynisme et les Sex Pistols pour la turbulence anarchisante des heures de récréation. Qui sont à prendre.
Sex Pistols, une leçon brouillonne d'énergie accumulée et déflagrative.
Merci Monsieur, petite gouape, Lydon.
Damie Chad.
23:49 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.