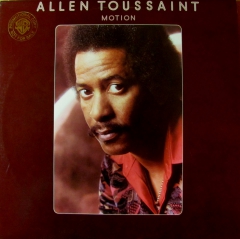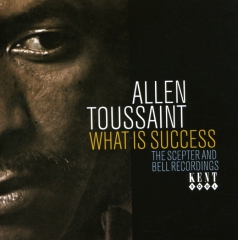30/03/2016
KR'TNT ! ¤ 275 : STEVIE WRIGHT / DISTANCE / ACCIDENT / JUNIOR RODRIGUEZ / JANINE / SAN FRANCISCO
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 275
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
31 / 03 / 2016
STEVIE WRIGHT + EASYBEATS
THE DISTANCE / THE ACCIDENT
JUNIOR RODRIGUEZ & THE EVIL THINGS
JANINE + WC 3 / SAN FRANCISCO
IT' S ALL WRIGHT !

Little Stevie Wright a cassé sa pipe avec une admirable discrétion. Pas de numéro spécial dans les kiosques, pas d’émissions à la télé, la classe totale ! Il est certain que les Easybeats appartenaient depuis longtemps au passé, et qui allait encore s’intéresser au chanteur d’un groupe préhistorique ?
Eh oui, il y a de cela 50 ans, les Easybeats arrivaient d’Australie pour rejoindre peloton de tête des prétendants au trône. Ils disposaient d’un potentiel qui leur permettait de rivaliser directement avec les Beatles.
On commettait tous la même erreur à l’époque en pensant que les Easybeats étaient australiens. En réalité, Stevie Wright était né à Leeds, Harry Vanda aux Pays-bas et George Young en Écosse. Leurs familles avaient émigré en Australie lorsqu’ils étaient jeunes et le groupe s’était formé down under.
Les Easybeats durent leur popularité au tandem Vanda & Young qu’on surnomma l’usine à tubes, mais avant que cette usine ne ponde des tubes planétaires comme «Friday On My Mind», «Pretty Girl» ou encore «Who’ll Be The One», George Young composait tous les hits du groupe avec Stevie Wright.

Fantastique album que ce «Easy» paru en 1965 ! Dès «I’m A Madman», on est frappé par la hargne de Stevie. Il chante comme Van Morrison et pose sa voix sur un tempo de valse à trois temps. C’est sacrément bien descendu à la cave avec du solo très étiolé. Plus loin, «I’m Gonna Tell Everybody» sonne plus poppy, très Hollies dans l’esprit, mais l’époque veut ça. Stevie revient au garage pur et dur avec l’excellent «Hey Girl» et se montre exceptionnel. On reste dans une certaine forme de sauvagerie avec «She’s So Fine» bien dégringolé à coups de basslines transversales. En B, on tombe aussitôt sur un «You Got It Off Me» solide, de belle allure, chanté à l’unisson, avec une certaine prestance de la constance. Il maîtrisaient déjà l’art du hit. On trouve plus loin «You’ll Come Back Again» monté sur un beat survolté et joué avec une sorte de sauvagerie bon enfant. Ils bouclent avec une dernière giclée de pur garage, «You Can’t Do That» : Stevie y chante le meilleur garage du monde.

Tout aussi frais et rose, voici «It’s 2 Easy» paru un an plus tard. Et là on tombe sur l’un des plus gros hits de l’époque, «Women (You Make Me Feel Alright)», la pop idéale zébrée par un beau solo d’Harry. C’est à ce moment-là que l’énergie des Easybeats entre dans la légende. Et tous les cuts qui suivent nous embarquent pour Cythère. Avec «Come And See Her», on a une belle pièce de pop évolutive et même extrêmement ambitieuse. On s’effare de l’incroyable vitalité des Easybeats. Encore de la jolie pop d’attaque frontale avec «I’ll Find Somebody To Take Your Place». On a sur cet album un mélange de genres tellement original qu’on pense bien sûr à l’Album Blanc des Beatles qui allait sortir un peu plus tard. Les Easybeats allaient absolument partout, dans toutes sortes de directions. S’ensuivait un «Some Way Somewhere» une extraordinaire pièce de pop têtue bien montée aux guitares et chantée par Harry. Retour à l’ambition faramineuse avec «Easy As Can Be». On continue de s’alarmer de ce foisonnement d’idées, au fil de morceaux qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. De l’autre côté, il tapent dans les Who pour «I Can See», chant perçant et beat nerveux, très moddish. Ils auraient pu ajouter for miles. Ils prennent plus loin «Something Wrong» au petit beat de circonstance. On pense là aux Pretties de SF Sorrow. Les Easybeats sont un groupe tout aussi magique, avec un chanteur doté d’un timbre distinct et dont le niveau composital renvoie directement à celui de Phil May. On croit rêver en entendant l’harmo et les chœurs. Ils nous font même le coup du Mersey beat avec «What About Our Love». On se croirait sur la rive du Mersey en 1963 ! Et voilà une petite compo de Vanda & Young : «Then I’ll Tell You Goodbye». Ça décolle dans la seconde, on sent le déclic du progrès harmonique, et le cut s’oriente directement sur l’avenir, avec une petite mélodie sous-jacente. Stevie referme la marche avec un «Wedding Ring» dévastateur, incroyablement agressif, écœurant d’énergie et de classe.

Le troisième album de cette trilogie légendaire s’appelle «Volume 3». On retrouve leur fantastique énergie avec «Sorry» joué à la cocotte sourde et de toute évidence pompé par Jethro Tull pour «Locomotive Breath». C’est exactement le même riff. Ils reviennent à l’énergie du Mersey beat avec «You Said That». Encore un cut délicieux qui fond dans la bouche, une power pop de rêve pointue et intemporelle. Tout est parfait dans ce cut, le riff récurrent, les chœurs et la bassline traversière. Ils re-sonnent comme les Pretties avec «Goin’ Out Of My Mind», Stevie chante avec l’esprit du fauve de cave qui guette sa proie, le rat, et on assiste à des montées de fièvre extraordinaires. On ne sent que ça, d’énormes possibilités. Le délire continue avec «Not In Love With You», un pulsatif de beat tendu et goinfré de chœurs superbes. De l’autre côté, ça s’essouffle un peu. Ils se tapent une Scottish lament avec «The Last Day Of May». Roy Wood aurait ajouté des cornemuses, c’est sûr. Et ils reviennent une dernière fois sur la rive du Mersey pour «What Do You Want Babe».
Grâce à ces trois albums, les Easybeats connurent la gloire en Australie. Ce fut la fameuse Easymania, un véritable fléau biblique. Les hordes de fans s’abattaient sur les hôtels et les salles de spectacle comme des nuées de sauterelles et rasaient tout. Obligés de vivre clandestinement pour protéger leurs biens et leurs proches, les Easybeats décidèrent de quitter l’Australie en 1967 pour aller s’installer en Angleterre. Et c’est là où, malgré les hits pré-cités, le groupe entama son déclin. À Londres, ils n’étaient plus qu’un groupe parmi tant d’autres. Et comme ceux qui jouaient du r&b et du garage, ils durent évoluer rapidement vers un son plus ambitieux. Vanda et Young se mirent à écouter des albums de soul et à composer des choses nettement plus ambitieuses, ce qui mit les trois autres très mal à l’aise : Dick Diamonde en bavait sur sa basse. Little Stevie était un excellent showman, mais les vocalises n’étaient pas son fort et Snowy s’épuisait à anticiper les relances de batterie. Petite cerise sur le gâteau, George Young et Harry Vanda demandèrent à Shel Talmy de les produire.

C’est sur «Good Friday» paru en 1967 qu’on retrouve «Friday On My Mind», l’hymne des mods working-class des hot nights du Swingin’ London. Sucré, rapide et juteux à souhait, c’était le hit idéal - I’ll lose my head tonite - En ce temps là, il est vrai qu’on sortait uniquement pour se défoncer. Stevie ne pense plus qu’à ça, il attend le vendredi to have fun in the city. Bowie avait bien compris la magie de ce cut. Avec cet album, les Easybeats prennent un tournant décisif : toutes les compos sont signées Vanda & Young. Sauf «River Deep Mountain High» dont ils lâchent une version redoutable, menée au trot par Stevie le râblé. Ils jettent tout leur génie de rockers dans la balance. Le seul qui parviendra à dépasser ça sera Chris Bailey avec les Saints. Et les voilà qui enchaînent les hits pop bardés de na-na-na-na et de aïe-aïe-aïe-aïe, «Saturday Night», hit ambitieux comme pas deux, suivi d’un paradis pop intitulé «You Me We Love», où ils font monter la sauce avec des chœurs ouvragés dignes des coupoles en or massif de Byzance. Encore un pur hit d’élan vital avec «Pretty Girl» et de l’autre côté on replonge aussi sec dans l’excellence «Happy Is The Man», une pop entrepreneuriale d’effervescence évidente, orienté vers la lumière comme le fameux tournesol du champ d’Auvers. Encore un hit absolu avec «Make You Feel Alright (Women)» annoncé par un riff d’intro et le mnnnn de Stevie. Mené à la baguette et descendu au refrain poppy des saperlipopettes, le tout doté d’un joli tatapoum de Snowy et d’un solo aigrelet d’Harry - Mnnn woman come along with me ! - Alors attention, car on passe à la magie pure avec «Who’ll Be The One». Tout éclate dans des boisseaux d’harmonies vocales et de chutes de refrains lancés au chat perché. On assiste là à de spectaculaires ascensions vers la lumière. Niveau harmonies vocales, ils sont aussi puissants que les Beatles, ça ne fait pas de doute. On revient à la belle pop acidulée avec «Remember Sam», joué à la guitare claire et dopé par un fil mélodique qui dans tous les cas ne laisse pas indifférent. Ils bouclent avec le fantastique «See Line Woman» joué aux percus du Gainsbarre de «Couleur Café». Les Easybeats y créent une fabuleuse ambiance négroïde de sorcellerie tribale. On y danse avec les esprits de la forêt profonde.

Les Easybeats enregistrèrent encore deux albums, avant la fin des haricots, «Vigil» et «Friends». Tout est signé Vanda & Young sur «Vigil». On ne trouve sur cet album que deux énormités, tout juste de quoi satisfaire les appétits. À commencer par «Good Times», avec sa fantastique dynamique de la cloche, un hit fondamental dans lequel on entend Stevie screamer au coin du bois et Nicky Hopkins faire couler des rivières de diamants. Mais les morceaux qui suivent semblent le plus souvent laborieux, très anglais dans l’approche. On se croirait chez les Hollies ou les Beatles, période cuivres fantaisistes, c’est-à-dire Sergent Pepper’s. Il est évident que ça ne pouvait pas plaire à Stevie. De l’autre côté, ils tapent une belle version groovy du «Hit The Road Jack» de Percy Mayfield, et Nicky Hopkins y refait des siennes. Stevie sauve l’album avec un «I Can’t Stand It» énorme, aussi énorme que les grands hits du Spencer Davis Group.

«Friends» est leur dernier album avant le split, en 1969. Il semble qu’avec ce disque ils soient arrivés au sommet de leur art, car le morceau titre qui ouvre le bal montre une ambition démesurée, par la qualité de chœurs qu’on dirait conçus pour des cérémonies religieuses, des chœurs tellement perchés qu’on s’en étonne, un côté épique qui fait bien sûr penser à l’opéra, mais pop. On retrouve l’éclat surnaturel des Easybeats dans «Watching The World (Go By)», un éclat dont on ne se lassera jamais. On se régale ensuite du «Can’t Find Love» craquant de gratte de guitare comme un gratin dauphinois et le chant entre tardivement dans ce pur jus de Vanda & Young. On sent qu’ils testent un nouveau rayon d’action avec tous ces morceaux et notamment «Holding On», un morceau qui s’emballe au prodigieux du propre et à l’élan du figuré. On se régale une fois de plus car c’est gorgé de dynamiques internes et pulsé par une bassline démente. Et là, surprise, voilà qu’ils envoient un «I Love Marie» digne des plus grands hits produits par Phil Spector. Quel spectaculaire rebondissement ! Stevie chante avec la hargne d’un Tom Jones. On retrouve une bassline fabuleuse dans «The Train Song», un cut qui sonne comme du Three Dog Night avec ses petits grattés de gratte funky et sa grosse bassline bien fournie. Ils finissent cette carrière météorique avec un véritable coup de Jarnac : «Woman You’re On My Mind». Stevie donne tout ce qu’il a, c’est un sacré bigorneau. Il va partout où il peut aller. Quelle atmosphère envoûtante ! On aura adoré les Easybeats pour ça. Ils auront su créer des espaces où il faisait bon s’installer pour danser jusqu’à l’aube.

Les fans des Easybeats sont tous aller fourrer leur museau dans une compile d’inédits intitulée «The Shame Just Drained» qui en plus flattait l’œil avec sa belle photo de pochette en fish-eye, dans la tradition des grandes pochettes anglaises des sixties («Have Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow» et la pochette anglaise d’«Are You Experienced ?»). On tombe très vite sur l’incroyable «Baby I’m A Comin’», garage pop que Stevie embarque à fière et même très fière allure. On trouve sur cet album des cuts produits par Shel Talmy et qui étaient restés sur le carreau. Incroyable mais vrai ! On retrouve plus loin dans «Peter» tout le foisonnement musicologique qui faisait la grandeur des Easybeats, cette fantastique propension à l’élévation harmonique. Encore de la puissance indiscutable avec «Me & My Machine» que George emmène au bal, un cut effarant d’aisance et vraiment lumineux. De l’autre côté se niche le morceau qui donne son titre à la compile et c’est encore une fois mélodiquement très ambitieux. Nos amis les Easybeats n’en finissent plus d’aller chercher le très haut de gamme des combinaisons harmoniques et forcément, on se prosterne. Stevie chauffe un peu plus loin cette grosse machine qu’est «Johnny No One». On sent chez lui une belle appétence pour la viande de shuffle. Puis l’aventure des Easybeats s’arrêta. Il ne nous restait plus que nos yeux pour pleurer.

Alors que Vanda & Young filaient vers le succès en tant que compositeurs de renom, Stevie chercha a monter des groupes pour redémarrer. Ses albums solo sont extrêmement difficiles à dénicher, mais ils valent largement le détour. On savait qu’il était l’un des grands chanteurs des Sixties, et l’écoute de ses disques solo ne fait que confirmer tout le bien qu’on pensait de lui. Il suffit par exemple de poser «Hard Road» (même titre que sa bio) sur la platine et on comprend immédiatement ce qui se passe. Stevie prend son boogie rock avec la niaque d’un Rod The Mod, et ça frôle parfois le Highway to Hell. Quelle énergie ! On est en plein dans le haut de gamme de ce qu’on appelle le boogie-rock anglais des seventies. C’est solide et gorgé d’énergie brute, pris à la tripe de chant. Il enfile les petits cuts comme des perles. Il adore le boogie et les trucs teigneux à la Steve Marriott. Il boucle sa face avec un «Didn’t I Take You Higher» admirablement mené au chant et on se régale d’un gros passage de percus, comme sur l’album d’Art (post-VIP’s et pré-Spooky Tooth). On sent que Stevie cherche encore le hit intemporel. La merveille des merveilles se trouve de l’autre côté : «Elvie». Voilà un cut en deux parties, véritable chef-d’œuvre composé par Vanda & Young. Stevie part un peu à la hurlette comme dans AC/DC, et on a même du gros solo gras, mais le cut évolue et semble filer comme un train à travers des pays imaginaires. On a là une belle suite progressive qui tourne à l’équipée passionnante, avec une succession de climats intensifs. Belle évolution captative ! On a une zone en balladif enchanté et la surprise se niche dans le lard de la deuxième partie d’Elvie. Stevie vire soul et même pounding de soul, sur un beat vainqueur. Édifiant ! C’est un hit fantastique ! On s’effare de tant de classe de la part de Vanda & Young. On a là l’une des meilleures combinaisons de l’histoire du rock, un équivalent de Bacharach/Warwick, de Greenwich/Spector, de Hayes/Sam & Dave, du très haut de gamme capable de faire des miracles. Et ça repart à la conquête du monde dans des gerbes d’excellence. On trouve une autre merveille sur cet album, «Didn’t I Take You Higher», un joli rock de tension permanente, bien serré dans ses sangles et on le voit monter doucement en puissance, une véritable merveille de grosse compo évolutive.
La règle d’or : quand on dispose d’un beau chanteur comme Stevie Wright, on se doit de lui composer de belles chansons.

Il existe un autre album solo de Stevie qui vaut le détour : «Black Eyed Bruiser». Le morceau titre reste très AC/DC dans l’esprit, car Stevie chante perché et derrière ça riffe sans vergogne. Il répète qu’il ne veut pas être le black-eyed bruiser. On le comprend. Autre gros cut, «The Loser», chanté au glam des faubourgs. Stevie s’y montre le rampant de service, digne des Heavy Metal Kids et de Gary Holton. Encore un joli cut avec «My Kind Of Music», joué au shuffle d’orgue et sous-tendu par un joli riff de basse joué en sourdine - I like to play all kinds of music - Il ajoute qu’il aime bien le devil’s corner. C’est dingue comme les gens savaient faire de bons albums en ce temps-là.
Mais Stevie va rencontrer l’héro et entamer une belle carrière de loser. Il va même faire les frais d’un traitement médical à base de sommeil intensif et un peu louche qui va lui démolir la cervelle. Stevie va en ressortir vivant, mais dans un état comparable à ceux de Syd Barrett, de Brian Wilson et de Roky Erickson, les trois autres éclopés de la légende du rock. Stevie passa de l’état de très beau mec à celui d’épave aux dents jaunes.
Signé : Cazengler, le Stevie Wrong de service
Stevie Wright. Disparu le 27 décembre 2015
Easybeats. Easy. Parlophone 1965
Easybeats. It’s 2 Easy. Parlophone 1966
Easybeats. Volume 3. Parlophone 1966
Easybeats. Good Friday. United Artist Records 1967
Easybeats. Vigil. United Artist Records 1968
Easybeats. Friends. Polydor 1969
Easybeats. The Shame Just Drained. Albert Productions 1977
Stevie Wright. Hard Road. Albert Productions 1974
Stevie Wright. Black-Eyed Bruiser. Albert Productions 1975
26 / 03 / 2016 – ROISSY-EN-BRIE
PUB ADK
THE DISTANCE / THE ACCIDENT
JUNIOR RODRIGUEZ
AND THE EVIL THINGS
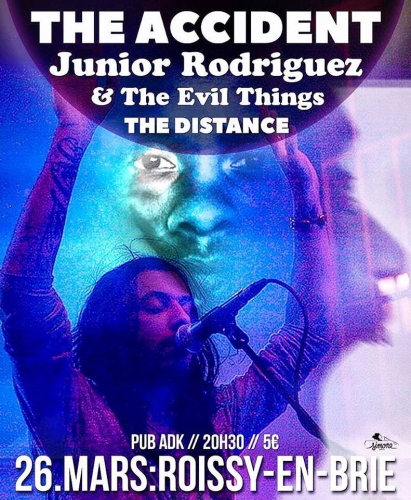
Faut suivre son instinct de rocker. Remarquez parfois le choix n'est pas cornélien. Ne se pose même pas. Junior Rodriguez à soixante-dix kilomètres avec annonce de pluie diluvienne pour le retour, ou alors, à dix neuf heures tapantes des invités avec petits gâteaux fourrés à la crème et rosbeef au four qui embaume la maison. L'est moins cinq, le temps de sauter dans la teuf-teuf et de s'arracher.
Bizarre, le parking est vide, les dernières fois que je suis venu l'était plein comme un oeuf... de Pâques. Doit y avoir du monde qui n'a pas pu s'évader. Les traditions familiales c'est comme le lichen, ça s'incruste partout. Perdu dans mes hautes pensées philosophiques, me trompe de porte et atterris... en Afrique. Des gosses qui s'amusent sagement, une centaine d'adultes qui discutent paisiblement autour de tables encore encombrées d'assiettes. Non ce ne sont pas des réfugiés arrivés par le dernier radeau qui prend l'eau ( vous savez ces gens qui souillent les plages du littoral grec avec les cadavres de leurs gamins ), mais une structure d'accueil, un havre de secours ( payant ) pour des familles qui ont du mal à trouver un logement. Comme par hasard tous des noirs ( comme dirait Donald Trump, doivent être génétiquement programmés pour le blues ). L'est désolant de voir comment la France anciennement Mère des Arts et Terre d'Asile se transforme aujourd'hui en territoire d'instabilité sociale et de précarité honteuse. Suis reçu avec sourire, gentillesse et dignité. L'on pousse même l'amabilité jusqu'à me raccompagner de l'autre côté du bâtiment, dans la cour de la Ferme d'Ayau qui abrite le Pub ADK.
Fermé ! Mon coeur arrête de battre. N'ayez crainte, l'en faut beaucoup plus pour tuer un rocker. Une dizaine de jeunes gens qui battent la semelle devant la porte me détrompent. Ouverture dans quelques minutes, l'on en profite pour évoquer Led Zeppelin, Elvin me parle du groupe The Accident, des amis à lui, qui assurent lourd. Genre de promesse qui me met en appétit. Me vend des craques, The Accident n'assure pas lourd, ils assurent très lourd. Mais procédons avec ordre et méthode.
THE DISTANCE
Surprise, surprise. Ce n'est pas la face A de Parachute Woman des Stones, c'est The Distance – pas stone mais plutôt stoner - le groupe qui était annoncé en tant que surprise guest sur le flyer Facebook du concert. Une bonne et même une des meilleures. Dagulard est relégué tout au fond derrière sa batterie. Sans cesse présent, cartonne ample sur ses drums et ne peut s'empêcher de reprendre les lyrics en sourdine... appuyée très fort, dans son micro. Peau de miel dorée et voix de bourdon. L'a intérêt à marquer sa place car devant les deux guitares fricotisent à bout de bras. Deux grands gaillards, Sylvain cheveux blonds viking et guitare drakkar qui fend les flots, Mike, anneau de pirate à l'oreille, guitare brise-glace et maître du micro. Duff est à la basse, s'en va souvent jouer, dos au public, face à Dagulard, manière de faire déborder la mayonnaise.
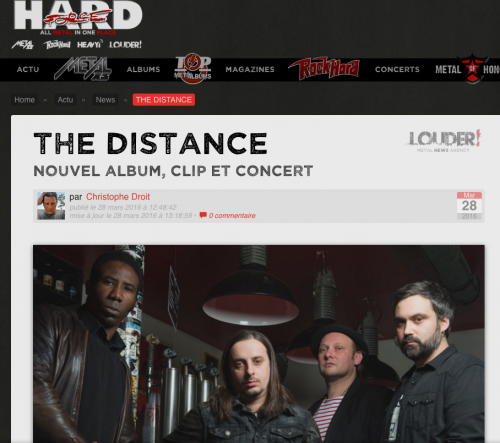
Jouent serrés, faut le temps que l'oreille s'habitue pour savoir qui fait quoi, le groupe est merveilleusement en place, totalement imbriqué, total instrumental, met en place un mur sonore qui s'avance sans cesse vers vous, implacable. Imsomnia ( sûr que l'on ne va pas s'endormir ! ) la fièvre des cauchemars vous étreint, Radio Bat, How Long Before, pas le temps de réaliser que c'est méchamment bon qu'avec Mesmerise et Unconscious Smile, l'on change d'étage, le son prend une autre dimension, plus appuyé, plus dense, jamais stérilement agressif, mais dans une urgence d'autant plus affolante que froidement contrôlée. Belles parties vocales de Mike, timbre écrasé comme du verre pilé quand il fait monter la pression et puis, plus haut c'est l'éclaircie après la folie, le rayon de soleil sur les champs de désastre.
Séparation des sexes dans le public, les garçons immobiles, scotchés, sérieux et attentifs et les filles, grand sourire extatique, qui dansent, l'une d'elles bras levé virant sur elle-même, gracieuse comme un cygne dans l'onde pure d'un poème de Stéphane Mallarmé. Doivent être insensibles à la poésie, car voici qu'ils en rajoutent une couche. Don't Try This – non, on n'essaiera pas, le réussissent trop bien – The Calling, aussi wild que le roman de London, mais brûlant, une flamme dévastatrice qui vous assèche les neurones. Définitivement. Trouble End, presque la fin, et c'est vrai que c'est la lutte finale, la musique qui flotte comme un étendard et Mike qui nous pulvérise avec ses lyrics à vous défenestrer de joie.

C'est la fin. Vous ne comprenez pas. Vous avez envie de rembobiner la cassette et de faire défiler de nouveau. Soudés comme pas un, compacts et tranchants. Ce n'est pas un concert, c'est une démonstration. Rien à reprocher. Faut entendre les clameurs d'approbation. Et puis quand ils commencent à ranger le matériel, les félicitations et les remerciements qui pleuvent. Des invités surprise comme cela à la maison, je ne pars pas.
THE ACCIDENT

Ne connaissais rien d'eux sauf les trois premières lignes du texte qui les annonçait sur FB : le groupe aurait été formé à la suite d'un accident de vélo – ce qui n'est guère courant, moi-même enfant étant passé sous une voiture avec ma bicyclette n'ai jamais éprouvé un tel désir – et Accident serait l'acronyme de Apte À Contre Carrer Idées Débiles Et Nazes Tonton. En plus ce serait du hip-hop. Je ne suis pas réticent ( mais à quatre-vingt dix neuf, oui ). Elvin m'a promis monts et merveilles, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Une première consolation, sur la scène s'agite le grand noir qui tout à l'heure s'est proposé pour annoncer la soirée et présenter The Distance. Aisance, décontraction et énergie en quelques mots.

Sont en place. Démarrent fort : deux constatations dans les quinze premières secondes : c'est du hip hop nitroglycériné, pouvez coller l'étiquette hard rock and roll sur le flacon, vous ne serez pas embêté par la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Chantent en français. Soyons sérieux, ils ont des choses à dire. Les minettes tringlées sur le siège arrière des décapotables, c'est résolument rock, mais quand on y réfléchit, notre société a aussi besoin d'autres lubrifiants. The Accident ne chante pas pour passer le temps. D'où les racines rap.

Patrick Biyick est au micro et à la guitare qu'il quitte souvent pour, tel un scalde, scander ses textes et laisser le sens du slam slalomer dans les bruits de colère des tambours. Ne quittera pas son K-Way rouge flamboyant, capuche sur la tête de toute la soirée. Nous crache pas au visage, partage nos frustrations. Nos vies en cage, nos quotidiens aseptisés, nos désirs normés, ce fachisme libéral douceâtre qui devient de plus coercitif ces dernières années, dédiera sous les applaudissements un morceau aux jeunes du Lycée Bergson qui sont allés caillasser un commisariat, n'a pas dit que la veille ils se sont faits brutaliser par la police, car les temps ne sont plus à l'apitoiement, mais à la riposte.
Musique violente et de rage. Et de jouissance. Les titres parlent d'eux même : Maintenant, Horrifice, Cri de Guerre, Pussy is good, Jusqu'ici tout va bien... les décline façon hardcore, façon rap slam avec derrière le combo qui booste comme des galériens sous les fouets de la chiourme. Un batteur fou au fond, un organiste présenté comme le guitariste de Linkin Park, un bassiste traité d'Egytien et un guitariste avec casquette et capuche sur la tête, un ensemble à première vue hétéroclite mais qui rocke à mort ou qui funke à fond. Se foutent des genres et des classifications. Sont musiciens pour renverser les barrières musicales. Mentales et physiques aussi. Sans céder à la facilité. Pas d'esquive, l'énergie en premier, des mots pour faire éclater les consciences et des notes pour que les corps se pâment.
Applaudissements nourris. Font l'unanimité. Elvin avait mille fois raison. Sont superbe. Une véritable découverte.
JUNIOR RODRIGUEZ
& THE EVIL THINGS

Les Choses Mauvaises. Laissez-moi rire. Ne vous laissez pas avoir. C'est le Mal en entier qui s'est installé sur la scène. Vous savez ce côté obscur de la force, cette chatoyance sans fin, ce miroitement infini qui vous fascine et vous attire irrésistiblement à lui. Junior Rodriguez and The Evil Things squattent la beauté du monde. Donnez-lui une guitare et votre vie s'agrandit. Nous en apportera la preuve lorsqu'au deuxième morceau, une corde cassera. S'emparera de celle que lui tend Accident, et continuera comme si de rien n'était. C'est bien le guitariste qui fait la guitare et pas le contraire. Question d'influx. La musique est avant tout une chose instinctivement mentale.
Les deux groupes précédents ont préparé la piste d'envol. C'est l'heure de se surpasser et de nous emmener en voyage. Beaucoup sont venus pour cela et l'on sent les frémissements du public. Même pas d'impatience. Embarquement immédiat. Dommage qu'il ne soit pas sans retour. Rêves et ouragances, musique d'oubli et sensitive, synesthésie de toutes les perceptions, des grésils de lumières flashantes vous enveloppent dans des linceuls de pourpre tyrienne et des splendeurs ultraviolettes. Il y a un guitariste fou qui s'avance sur le bord de la scène et qui lance des orages d'acier, Junior est derrière, en retrait au centre du plateau, magicien de la six-cordes, la voix qui se perd dans les haubans de la tempête et navigue sur les eaux tels les alcyons d'André Chénier qui pleurent le blues de la mort et l'éclat incandescent des fragrances idéelles.

A la fin du concert, chichiteront sans mélodramatiser sur le son qui à tel moment n'était pas, sur la guitare qui n'était pas, sur tout ce qui n'était pas... au top, nous n'y avons vu que du feu, brûlant volcanique, éruptif. Des perfectionnistes d'une humilité quasi-incompréhensible. Termineront sur Heaven Lips, tous ceux qui se demandent depuis trois décennies ce que la Lady qui ne croyait pas que tout ce qui brille soit en or allait faire en haut de son fameux Stairway to Heaven, la réponse est enfin donnée. Si vous redoutez les ambiances paradisiaques? Bite Me Now and Cactus Seed vous ménagent des descentes vertigineuses dans les escaliers des fournaises infernales. Junior et ses sbires vous offrent les anneaux de la volupté et la morsure du serpent. Plus les visions oniriques qui vont avec – méfiez vous Dali was a Liar, et les Chants d'innocence d'un William Blake sont aussi ceux des expériences les plus extrêmes. Turn on the Light et Sweet Demon pour synthétiser l'alliance des contraires.
Ne sont que quatre – batteur et bassiste qui fourbissent et fournissent l'appareillage audacieux de structures rythmiques, brisures et contre-brisures, élévations soudaines et dégringolade de dénivellements les plus abrupts. Et les guitares, l'on ne peut même pas parler de guitaristes car ils ne sont que des focales irradiantes d'ondes tour à tour maléfiques et apaisantes.

La voix de Junior qui ne rappelle en rien celle d'un Robert Plant, plus suavement épicée, emporte ailleurs, qu'elle morde ou caresse, elle infléchit la musique vers un noyau gravitationnel, originel, caravelle en partance vers les particules électriques de lointains tropiques mystérieux et emplis de périls. Les lèvres du paradis entrouvertes se referment. La technique fait signe qu'il se fait tard. Immense ovation.
RETOUR
Difficile de se quitter. Trois prestations de toute magnificence. Duff exprime la pensée commune – celle du public, de l'organisation, et du public – un triple concert tellement beautiful où chaque groupe s'est porté à son meilleur qu'il est dommage qu'ils ne puissent tout de go partir en tournée...
Me reste deux bricoles à rajouter : la route transformée en patinoire jusqu'à la maison ce qui est peu intéressant, et cette exclamation qui fuse « C'est un honneur ! » lorsque Junior remercie pour la guitare que le guitariste d'Accident vient de lui passer, ce fut aussi un honneur pour nous d'assister à un tel concert.
Damie Chad.
P.S. 1 : récupéré deux CD ( Distance et Evil Things ) que je chronique la semaine prochaine.
P.S. 2 : les photos des deux derniers groupes sont prises sur le FB de Fustin Do de la Nébuleuse d'Hima que nous retrouverons bientôt en spectacle.
JANINE
OLIVIER HODASAVA
( INCULTE / Janvier 2016 )

Etrange livre. Glauque à souhait. Sur la couverture ils ont ajouté la mention roman. L'on ne sait jamais. Peut-être ont-ils espéré que ça passerait mieux en tant qu'œuvre d'imagination. Mais le livre s'inscrirait davantage dans la section des documentaires. Et même si l'on veut être plus précis dans la série des enquêtes. Encore que le lecteur ne découvre rien de plus que ce qu'il savait déjà, ou que ce que la quatrième de couve lui aura révélé. Il est des murs qu'il est difficile de franchir. Celui du futur et celui de la mort, pour ne citer que deux culs-de-sac de la pensée. Vous vous en doutez, mes deux exemples ne sont pas pris au hasard. Nous avons pourtant droit à un témoin de première main. Un fan absolu. Nous pouvons lui faire confiance.

Au départ il s'agit de l'histoire d'un groupe de rock français. L'un des plus célèbres de cette génération que l'on surnomma les Jeunes Gens Modernes. Expression malheureuse. Rien ne se démode davantage que la modernité. A Trois dans les WC, un groupe, pour vous les situer, un peu dans la mouvance de Taxi Girl ( que j'abomine, mais là n'est pas la question ), mais provincial, du grand nord, pas la toundra boréale mais Saint-Quentin. Z'auraient pu rester des inconnus, mais leur appellation non contrôlée a dû soulever bien des phantasmes puisque très vite ils furent signé par CBS. Good deal, une major. L'a tout de même fallu qu'ils changeassent leur nom en WC 3 – moins graveleux pour les programmateurs frileux de nos radios nationales... Le succès ne fut pas au-rendez-vous, et CBS s'apprêtait à ne pas renouveler leur contrat après deux disques lorsque le groupe arrêta de lui-même les festivités. S'étaient formés à cinq, très vite ne furent plus que quatre, puis se retrouvèrent à trois, lorsque Janine, au sortir d'un concert décida de mettre fin à son existence en avalant volontairement une surdose de médicaments, le jeu à deux n'en valait plus la chandelle... Pour la musique, je vous laisse juge, vous trouverez sur You Tube une cinquantaine de titres à écouter, pour ceux qui voudraient creuser plus profond, ces dernières années ont vu quelques rééditions...

Olivier Hodasava fut un fan de la première heure. L'assista au dernier concert. Celui à la suite duquel Janine décida de franchir la frontière interdite... De quoi vous glacer le sang et l'âme. Ce n'est que trente ans plus tard, suite à la mort de son père, qu'il se sent capable de revenir sur l'énigmatique tragédie de la disparition volontaire de Janine. Remonte la pente. Explore toutes les cavités. Interroge les survivants. Essaie de circonscrire au plus près les circonstances du drame, amasse les documents... et finit par ne pas trouver grand chose...
Françoise n'est pas une beauté. Un peu boulotte. Elevée dans une famille de cathos coincée du cul, enfant sérieuse qui trouve son évasion dans la musique. Piano, orgue, premier prix du conservatoire, une voie royale se dessine, l'on imagine le rêve des parents. Patatras, l'enfant modèle se laisse séduire par la musique du diable. Si ce n'est pas l'amour du rock and roll qui la guide, nous diagnostiquerons le désir d'un joli pied de nez à Papa et Maman et leur vie trop étriquée pour une adolescente... Mal dans sa peau et silencieuse. C'est ainsi qu'aux premières semaines on la ressent dans le groupe. Mais les garçons ne font pas les difficiles, elle s'y entend trop en musique pour lui tenir rigueur de son air un peu rébarbatif... Surtout que les mois passant, elle finit non pas par s'amadouer mais par trouver sa place. Regards commisératifs de grande fille sur ces gamins insupportables mais attachants. Leur apprend le respect, la distance, petit sourire et légère dose d'ironie, elle ne s'en laisse point compter. Mine de rien, elle préserve son intimité et son mystère. Le papillon s'extrait de sa chrysalide. Janine est belle et attirante.
Le groupe est soudé, partage espoirs et galères. Sans doute y trouve-t-elle cette chaleur affective qui lui a été refusée pendant l'enfance. Finira même par sortir avec Jean-François. L'idylle durera quelques mois, mais les relations s'espaceront peu à peu. Pas de fâcherie. Une incompatibilité existentielle. Trop de silence de sa part qui excède l'empressement du garçon dérouté...
Le groupe possède sa base de repli : Saint-Quentin. Mais il arrive un jour où nécessité fait loi. C'est à Paris que se forge les grands destins. A la capitale, WC 3 ne se retrouve que pour les séances de répétition et de studio. Chacun assure sa survie économique dans son coin comme il peut. Janine ne peut pas grand chose. L'est remarquée dans le milieu pour ses compétences musicales, mais elle ne parviendra jamais à participer à un projet qui ferait décoller sa carrière professionnelle. Le groupe enregistre son ultime disque et décide de le défendre en tournée, vous connaissez la fin.
Le mystère reste entier. Mal-être qui remonte à l'enfance ? Dépendance à l'héroïne ? Déception, errance amoureuses ? Déviances ( nous sommes en 1984 ) homosexuelles ? Troubles bipolaires héréditaires ? Janine ne s'est jamais livrée, peut-être aussi l'auteur préfère-t-il taire, par respect envers la discrétion existentielle dont elle fit preuve, des éléments qui expliqueraient la trajectoire de la musicienne.
Ironie de la vie, Janine repose dans la sépulture familiale. Elle n'est plus qu'un nom, un surnom, un souvenir dont la présence en ce monde se dilue doucement... Le livre ne nous apprend rien. Il est le reflet exact de notre angoisse devant l'effacement progressif dont tout ce que nous aimons et nous-mêmes deviendront l'objet. La trame de nos jours n'appartient qu'à nous. L'histoire de WC 3, parfaitement racontée, ne saurait rendre compte de la vie d'un de ses membres. Pas très joyeux. Ni très optimiste. Olivier Hodasava a écrit un très beau livre, que les futurs lecteurs s'attendent davantage aux grandes orgues funèbres des sermons de Bossuet sur la mort, plutôt qu'à une monographie sur l'histoire du rock and roll. Même si c'est Janine qui tient les claviers. Marche funèbre.
Damie Chad.
SAN FRANCISCO
1965 – 1970. LES ANNEES PSYCHEDELIQUES
BARNEY HOSKYNS
( Castor Astral / 2006 )
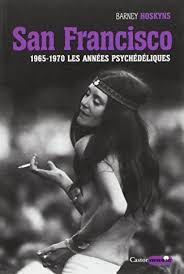
Le titre original Beaneath The Diamond Sky / Haight-Ashbury est beaucoup plus classe et plus précis. Pas question d'en faire une omelette aux regrets, c'est un cadeau – j'aurais choisi quelque chose de plus virulent dans la collection, mais je ne regrette pas ma lecture. A peine cent cinquante pages si vous enlevez la bibliographie et l'index, mais un topo d'une clarté et d'une limpidité absolues.
Barney Hoskyns est surtout connu de par chez nous pour son énorme livre sur Led Zeppelin paru chez Rivage Rouge en mai 2014, sous le titre de Gloire et Décadence du plus Grand Groupe du Monde, qui se présente comme un montage chronologique de plus de cinq cents pages de propos oraux tenus par les acteurs – qu'ils soient du premier ou du dernier cercle de l'aventure du Dirigeable. Fut aussi rédacteur à Mojo et au New Musical Express. Sa bibliographie est aussi longue que le pédigrée de la famille royale d'Angleterre. L'a apposé sa signature dans tous les grands titres de la presse anglo-saxonne mais depuis l'an de grâce 2000, il dirige le site en ligne Rock's Backpages qui archive plus de vingt-huit mille documents écrits sur la musique que l'on aime. A ma connaissance, ils n'ont pas encore archivé KR'TNT ! une erreur impardonnable, une tâche honteuse et indélébile dont leur réputation ne se relèvera pas.
SAN FRANCISCO
Si vous allez à San Francisco
Vous y verrez des gens que j'aime bien
Tous les hippies de San Francisco
Vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien
Une petite intro pour vous faire bondir de vos chaises. Non nous ne sommes pas en France, en 1967, avec Johnny Hallyday, mais à San Francisco, aux States en 1964. Pas très loin des pionniers quand on y pense, mais sur l'autre versant. Le rock and roll à la Elvis, c'est celui des pouilleux et des ignares. L'existe une autre musique, parallèle, serait-on tenté de dire, qui ne se mélange pas avec les torchons graisseux. Le folk. Ce n'est pas très différent du country, mais ça s'inscrit dans une autre tradition, celle du prolétariat en lutte. L'est écouté par les étudiants, des intellos qui commencent à lire Sur La Route de Kerouac paru en 1957, une jeunesse quelque peu contestataire qui se sent étouffée par le futur que leur réserve leurs parents...
Fallut une conjonction de plusieurs éléments pour que l'explosion eut lieu. Une ville : ce sera San Francisco : le soleil, les loyers modérés - notamment dans les quartiers de New Rose puis de Haight-Ashbury qui ont attiré au début des années soixante la première vague contestataire, la génération Beat, littérature, jazz, marginalité... Début soixante, toute une jeunesse issue de la petite-bourgeoisie se regroupe menant une indolente et innocente vie de bohème et de fumette... C'est alors que survient l'élément catalyseur qui va chambouler les esprits, au propre comme au figuré.
THE MERRY SPRANKERS
La bestiole délirante descend du bus. Celui des Merry Sprankers. Les joyeux drilles. Cornaqués par Ken Kesey. Un écrivain, l'auteur d' Vol au-dessus d'un Nid de Coucous, un aficionado de cette nouvelle substance communément appelé LSD. Pas une vulgaire drogue. Un additif spirituel qui vous débouche à la dynamite les portes de la perception de votre cerveau. L'expérience psychédélique par excellence. Une nouvelle philosophie de la vie. Accessible à tous. Suffit d'ouvrir la bouche et de recevoir l'hostie salvatrice.

Dans son bus ultra-colorié Ken Kesey parcourt les USA. Organise de mémorables soirées : avec musique et dégustation gratuite. Les Merry Sprankers hallucinent leur folk originel, de blues et puis de rock. Tout est bon pour faire monter la mayonnaise. C'est à San Francisco qu'ils recevront le meilleur accueil : toute une frange de jeunes oisifs qui ne demandent qu'à être convertis à la nouvelle religion lysergique. Autour de Ken Kesey gravitent bien des personnalités locales destinées à devenir célèbres : Jerry Garcia, John Cipollina, George Hunter, Paul Kanter... vous avez reconnu dans l'ordre d'apparition les premiers éléments appelés à fonder Gratefuu Dead, Quick Silver Messenger Service, Charlatans et Jefferson Air Plane...
1965
Toutes ces formations sont encore instables, les changements de personnel – fâcheries, divergences – seront fréquents, mais l'on peut parler d'une communauté musicale au sens large. L'important ce n'est ni la musique, ni le succès. Le plaisir d'être ensemble est primordial : ne donnent pas des concerts mais participent à des rencontres acidulées. Pas de coupures entre les musiciens et l'assistance. Une espèce d'expérience sensitive généralisée. Des moments de vie plus intense, les corps et les esprits s'ouvrent et s'interpénètrent. L'utopie réalisée. Mieux qu'en rêve. Eros et psychos !
1966

Un joyeux bordel organisé. Mais la nature a horreur du vide. Toute société humaine éprouve le besoin de perdurer. Et cette noble tâche de la survie collective débouche sur un problème d'institutionnalisation. Nos doux hippies ne cherchent pas à élaborer un code civil, ils ont seulement besoin de pérenniser l'organisation de leurs fêtes... Deux logiques vont s'affronter : celle de la rationalité froide portée par Bill Graham et ses fameux concerts au Filmore Auditorium, et celle générée par la seule lancée du mouvement lui-même qui sous l'égide de l'association Family Dog et de Chet Helms le petit copain de Janis Joplin réunissait à l'Avalon Ball les jusqu'au-boutistes des expérimentations lysergiques.

Une lutte sourde opposa les deux salles. Ce fut Bill Graham qui l'emporta. Sa victoire est de l'ordre du symbole : peu porté sur la consommations des produits, l'était frais comme un gardon dès le petit matin. Quand Chet Helms enfin remis de ses frasques de la veille se réveillait en début d'après midi, Graham avait déjà passé les coups de téléphone nécessaires à l'organisation de ses futurs concerts. Graham ne travaillait pas pour l'amour de l'art ou de la cause, mais pour gagner de l'argent. Ses ennemis reconnaissaient toutefois qu'il offrait au public des plateaux de qualité.
A l'opposé du pragmatisme grahamiste, les Diggers ( voir in KR'TNT ! 116 du 01 / 11 / 2012 notre recension de Ringolevio l'autobiographie d'Emmett Grogan ) organisaient des concerts gratuits et distribuaient de la bouffe gratuitement et essayaient de mettre sur pied des magasins libres...
1967

L'été de l'amour fut celui de la résolution de toutes les contradictions. Si les Charlatans ratèrent leur coup, Gratefull, Jefferson et Messenger Service, avaient pris de l'importance. Le mouvement prenait de l'ampleur et se mesurait au reste du monde. Y eut une première cassure idéologique suscitée par les mouvements des étudiants de Berkeley. Hippies et rads ( entendez radicaux politisés ) ne vibraient pas sur les mêmes longueurs d'ondes. Les seconds manifestaient pour abattre la société fachisante, et les premiers se contentaient de vivre dans leurs espaces de liberté conquise... Les milliers de jeunes adolescents fugueurs qui alertés par les médias se ruèrent vers l'Eldorado de San Francisco, ne furent pas les seuls à s'intéresser à cette nouvelle poule aux oeufs d'or. Le danger vint de la soeur ennemie. La ville de Los Angeles, bardée d'hommes d'affaire et de représentants du show-bizz. Le piège fut parfaitement tendu. Très agréable. L'organisation d'un festival hippie avec les Who, Jimmy Hendrix et Otis Redding. Bien entendu la scène de Monterey était ouverte pour les têtes d'affiche de Frisco. Difficile de résister aux sirènes lorsque l'on s'appelle Jefferson Airplane ou Janis Joplin and the Holding Compagny, Country Joe and the Fish, Steve Miller Band, Moby Grape, Quick Messenger Service... La pomme s'était précipitée vers les vers. Dans les majors l'on sortait déjà les carnets de chèques...
1968
Les groupes maison de Frisco tournaient désormais dans tous les States. Les anciens camarades se sont transformés en rock and roll stars. Mais la réalité rattrapait maintenant nos utopistes sans lendemain. Engluée au Vietnam, l'armée avait besoin de chair fraîche, plus question de gober son acide pépère dans son coin, fallait se mobiliser et organiser les filières d'expatriation au Canada pour les réfractaires à cette conscription de plus en plus entreprenante... Nos hippies eurent de surcroît à subir les critiques de la communauté noire qui leur reprochait leur absence dans la lutte pour les droits civiques... Le rêve se lézardait de partout...
1969
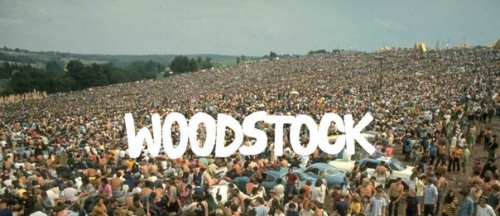
Le pire était à venir. Coup double. Face claire et face sombre. Pluie et sang. Woodstock fut le chant du cygne. Cinq cent mille jeunes vautrés dans la boue, hébétés par toute sortes de produits, un beau film, une catastrophe moutonnière. La mode hippie. La pré-industrialisation galopante. La victoire du renoncement. Mais ce n'était que la brise qui annonce la tempête. Partaient d'un bon sentiment. Les Rolling offraient un concert gratuit. Le Gratefull Dead leur indiqut un service d'ordre dont ils n'ont jamais eu à se plaindre, les Hell Angels d'Oakland. Pas plus gentils que ces bikers ! Barney Hoskyns ne jette la stone à personne, nous explique que les différents clans des Angels étaient en guerre quant au contrôle des ventes de stupéfiants sur la Californie, réglèrent-ils leur différent en s'en prenant aux innocents spectateurs ? La boue et la pluie à Woodstock, la mort et le sang à Atlamont... Le rêve agonise.
1970
The end. Les fugueurs qui ne sont pas retournés chez leurs parents s'adonnent aux drogues et à la prostitution. L'acide n'est plus ce qu'il était. Le monde change. L'on a trouvé mieux. L'héroïne. L'acide vous déglinguait les neurones, l'héro vous chavire le sang. Dureté des temps. Il pousse de plus en plus de tombes dans les cimetières. Le rock est devenue une industrie. La musique ne libère plus. Elle vous endort. Elle vous assomme. Votre existence s'azombie, vous êtes l'addict de votre propre consommation. Rock ou héroïne, quelle différence ?
Un livre qui fait réfléchir. Qui remue le couteau dans l'espoir d'une vie vouée au rock and roll.
Des dizaines de noms, de nombreuses pistes de recherche. Une époque foisonnante, plus audacieuse que la nôtre. A lire pour tous ceux qui n'étaient pas nés et qui ont du mal à se représenter une si folle effulgence.
Damie Chad.
23/03/2016
KR'TNT ! ¤ 274 : JOHNNY LYDON / AMNASTY / FALLEN EIGHT / FROM A BROKEN STEREO / CASEY / ACRES / BURNING DOWN ALASKA / 45 T / LANGSTON HUGHES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 274
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
24 / 03 / 2016
PUBLIC IMAGE LIMITED
AMNASTY / FALLEN EIGHT
FROM A BROKEN STEREO
CASEY / ACRES
BURNING DOWN ALASKA
LANGSTON HUGHES
PRESSE ROCK
Ce rapide encart pour vous signaler la présence de deux groupes que nous aimons bien chez KR'TNT ! dans la presse rock nationale distribuée en kiosque.
BLUES MAGAZINE N° 80

Ce petit ( nous évoquons le format ) trimestriel, consacre quatre pages à interviewer Mathieu le contrebassiste de SWINGING DICE dont nous avons relaté un concert toulousain dans notre livraison 200 du 11 septembre 2014.
ROCK & FOLK N° 584

Vous ne raterez pas la chronique ( p 86 ) de LOVE-O-RAMA de LES ENNUIS COMMENCENT que nous vous présentions dès le 25 février 2016 dans notre livraison 270.
Le Trianon. Paris XVIIIe. 6 octobre 2015
Public Image Limited.
PUBLIC IMAGE ILLIMITED

Vous serez frappé par la stature de John Lydon. Il arrive sur scène enveloppé dans un immense costume gris foncé, un vrai sac à patates sans autre forme que celle d’une stricte verticalité : même tour de torse que de chevilles. Il porte des chaussures multicolores qui font de lui une sorte de clown grotesque digne d’un conte macabre de Tim Burton. On aurait presque tendance à vouloir se moquer du vieux punk. Mais attention, en deux minutes, il impose un respect total et ce d’une manière radicale. Toute la force du personnage se concentre dans la figure et dans la voix qui sont l’une et l’autre d’une incomparable expressivité.

Comme si John Lydon avait réinventé l’expressionnisme. Il met en route ce qu’il faut bien appeler un tour de chant, comme le firent avant lui des gens comme Jacques Brel ou Nina Simone, Barbara ou Dusty Springfield. Sa légende de punk-rocker le sert et le dessert à la fois. Mais oui, John Lydon fut au temps des Pistols le plus grand shouter d’Angleterre, mais aujourd’hui, il ne doit son prestige qu’à son seul génie de chanteur, comme s’il échappait définitivement à l’histoire du rock, au temps, aux tendances et surtout aux clichés. John Lydon crée son monde sur scène avec une assurance et un impact qui sont ceux d’un géant. Lorsque vous allez voir chanter de très grands interprètes, vous oubliez rapidement leur apparence physique et l’environnement pour vous centrer sur le visage, car c’est là que tout se passe. Le visage et les mains - et donc la voix - deviennent le temps d’un set le centre du monde, une source de fascination dont on ne décroche qu’à la fin, lorsque le public ovationne.

Tout ce qui dans les albums de Public Image pouvait déplaire - le côté talkative de certaines chansons - passe bien sur scène, car John Lydon chante d’une voix forte et image ses propos d’expressions et d’intonations merveilleusement justes. Comme s’il redonnait du son au son, de la même façon dont Michel Serres ou Pierre Bourdieu redonnent du temps au temps dans les pages de leurs livres respectifs. L’idéal serait presque de ne pas connaître ses disques, car on sent chez John Lydon une volonté certaine d’emmener son public avec lui dans le monde qu’il bâtit au fil des chansons.

C’est un monde incroyablement ressemblant à celui qu’on connaît, un monde de vrais gens et d’injustice, un monde de faux amis (You cheat easily like all charity - Disappointed), un monde d’argent (I’m changing my way where money applies - This Is Not A Love Song), un monde d’arnaques religieuses (This is religion/ A liar on the altar - Religion), un monde de colère (Anger is an energy - Rise) et un monde de gens courageux (I’ll never surrender/ I’m a Warrior - Warrior). John Lydon pose son regard sur le public avec une sorte d’intentionnalité, comme s’il s’adressait à des gens venus pour entendre des messages. Il offre un curieux mélange d’artiste et de tribun. Et comme les grands artistes pré-cités, il donne TOUT. On n’en finira plus de gloser sur la générosité de cet homme. C’est probablement le trait de son caractère qui frappe le plus. Parfois, on découvre que pour donner - à ce niveau - il faut savoir se montrer extrêmement puissant. John Lydon donne TOUT ce qu’il a. Tu veux mon monde ? Tiens le voilà ! Je te le donne ! Il est à toi ! Prend-le.

Suivez les grands artistes. Jamais vous ne serez déçu.
En rappel, il se paiera le luxe de jouer un hit planétaire, le fameux «Public Image» datant de sa résurrection après la fin tragique des Pistols. Quelle fantastique ampleur ! Lu Edmonds retrouve sans mal le chemin du son de Keith Levene et le pauvre Scott Firth cavale péniblement après le fantôme de Jah Wooble. Mais John Lydon entre dans la danse et tout reprend du sens. Le vieux Trianon se remet à tanguer sur ses fondations. Il finit bien sûr avec «Rise» et beugle «Heart Heart Heart !» en guise d’ultime message à un public tétanisé.
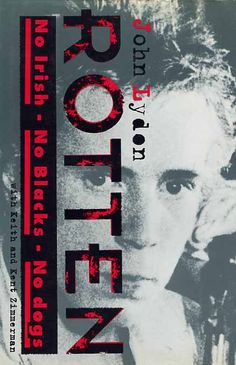
L’autre façon d’approcher - autant que faire se peut - John Lydon, c’est de lire ses deux volumes autobiographiques parus à vingt ans d’intervalle, «Rotten» et « Anger Is An Energy». Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il s’y livre sans détour, principalement dans le second. Il y parle longuement de Nora, de son choix de vivre en Californie (John se lève tôt pour profiter du soleil - it really is all about getting up early and enjoying sunrise and sunset), des soins dentaires qui lui ont changé la vie (fin des problèmes de santé), il avoue admirer Duran Duran et Boy George, les Status Quo et Captain Beefheart (in a big way), il explique que Sid adorait Bowie et que lui préférait Mick Ronson (just seemed like a lad). Il ne supportait pas le Grateful Dead (the dullest band I’ve ever known), mais il adorait Oscar Wilde (Oscar Wilde I found outrageously funny), les Pink Fairies (fantastic!) et Edgar Broughton Band (filthiest beards and hair). Mais aussi les Dolls (I thought they were great) et Chrissie Hynde (we were very attuned to each other). Mais le chapitre démolition est lui aussi bien fourni. Avec Liam Gallagher et William Reid, John Lydon est certainement le meilleur entrepreneur de démolition d’Angleterre. Il navigue quasiment au niveau des grands polémistes français de l’Avant Siècle, des gens comme Octave Mirbeau et Léon Bloy qu’on craignait pour leur férocité. Les deux cibles favorites de Lydon sont bien sûr Vivienne Westwood et McLaren dont il brosse d’horribles portraits - Westwood was basically a born-and-bred shopkeeper, of the Margaret Tatcher kind - Allez traduire ça, c’est impossible. On perdrait tout le fantastique mépris qui graisse la formule. La langue de John Lydon est unique, comme l’est celle de Dylan que je considère depuis quarante ans comme intraduisible - sa langue est un souffle poétique, au sens pouchkinien du terme. Quand John Lydon parle de McLaren, il évoque le souvenir d’un manipulateur pitoyable qui n’arrivait même pas à gérer sa propre vie (A bit of a disaster. Poor sod). Les Clash (poor old Joe Strummer), Nick Kent, Jon Savage (Who the fuck are you Jon Savage ? You were not a Sex Pistol) et l’Angleterre (The teduim of council flat existence - it’s an incredibly unfair universe, Britain) passent aussi à la casserole. On s’enivre littéralement du souffle de John Lydon. Quand il épingle la pingrerie des Thénardiers McLaren/Westwood, il assène ceci : «Any of the gear we wore from the SEX shop we absolutely had to pay for». Et puis il y a l’épisode hilarant des dents - By the time I was joining the Pistols, the second I smiled it was like, ‘Oh my God, look at these teeth of him’ - D’où le surnom Rotten. John raconte qu’il a grandi dans un milieu social où on ne se lavait pas les dents et dès qu’on le pouvait, on se faisait tout arracher pour mettre un dentier payé par la sécu anglaise. Seulement, les produits fixants n’étaient pas fiables et quand les adultes rigolaient ou qu’ils dansaient dans les petites fêtes, ils perdaient leurs dentiers. John raconte que gamin, son père lui confiait la mission de ramasser les dentiers qui tombaient lors les fêtes de famille, mais il peinait à identifier les propriétaires.
Pages fantastiques consacrées aux Pistols, bien sûr - We came on and we came in very strong and very quick. We became, I think, the world’s most powerful band - et il a diablement raison de dire ça, qui oserait prétendre le contraire ? Mais en même temps, il reste assez amer, car il rêvait d’une complicité au sein du groupe qui n’a jamais existé, même lors des deux reformations - So eat shit and die, you cunts. That’s my polite way of saying, we could’ve been good - Le paragraphe consacré à la première reformation est certainement l’un des passages clés d’Anger. John retrouve Steve Jones et Glen Matlock à la marina de Venice Beach, en Californie - So it was a good meeting and we were as usual very open with each other. There’s not much subterfuge going on with us lot - Puis ils durent affronter les journalistes dans les conférences de presse, l’horreur - Oh come on, isn’t it all about the money ? - Excédé, John répond - I’m fat, forty and back. Deal with it. Next ! - Retour sur les chansons - My songs were echoes of rebellion and empathy for people - Puis il règle ses comptes avec le mouvement punk - I’m sorry but I never did this for the narrow-minded - Il appréciait surtout les Buzzxocks, X-Ray Spex, les Adverts et les Raincoats, plus les Slits, bien sûr, à cause d’Ari Up, la fille de Nora. Il finit le chapitre sur la reformation des Pistols avec l’évocation d’un concert exceptionnel au Chili, et bien sûr, que se passe-t-il le lendemain matin ? Steve, Paul et Glen se font la cerise sans même dire au revoir - What can I say ?
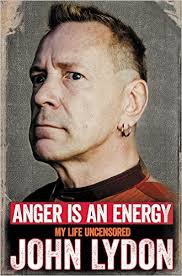
On note un détail qui diffère d’un livre à l’autre : John se teignait les cheveux en vert à une époque et son père le mit à la porte. Dans Anger, son père dit : «Get out of the house, you look like a Brussels sprout !» - c’est-à-dire un chou de Bruxelles, et il ajoute plus loin - which I now realize was somewhat of a compliment - Dans Rotten, son père dit : «Get The fuck out of my house and take that fucking cabbage on your head with ya !» - Mais dans les deux cas, John se dit fier de son père. Rotten est un ouvrage beaucoup plus expéditif et truffé de témoignages de gens comme Billy Idol ou Chrissie Hynde. Les souvenirs des Pistols sont plus frais et John donne le détail des attaques à l’arme blanche dont il a été victime dans la rue. Toute la genèse des Pistols s’y trouve, traitée dans une langue directe. Glen qui n’aimait pas les paroles de «God Save The Queen», Glen qui était fan d’Abba (And funny enough so was Sid), poor Glen (He wanted everyone to like him and have a good time. So boring), la haine des Anglais (There will always be hate in the English because they’re a hateful nation), Vivienne Westwood (Vivienne Westwood always made me laugh and it annoyed her no end) (She’s deeply silly. Wacky shit), la supériorité écrasante des Pistols (Avec ou sans le Grundy show, l’explosion était inévitable. After all the Pistols were so good. There’s no other way of describing them), Sid, justement (Sidney was basically stupid), Sid qui n’avait pas de copine, avant Nancy (Sid never had girlfriend. He loved himself too much), et on tombe sur des passages hilarants, comme par exemple cette soirée au Wedgies où il sont invités (Sid wore something approaching a leather jacket, but there was a sleeve missing). Autre grand moment de rigolade : McLaren force l’entrée chez CBS pour obtenir un contrat, mais la secrétaire lui dit de dégager. Humilié, McLaren lance : ‘How dare they ! I’ll call the police !’ et la secrétaire ajoute : ‘No need. They’re on their way !’ N’oublions jamais que John Lydon est aussi un mec infiniment drôle. Il sort une autre anecdote hilarante. La scène se déroule à San Francisco, John vient de se faire virer du groupe et il n’a pas un rond. Il ne sait pas comment faire pour rentrer en Angleterre. Alors il appelle Warner Brothers à Los Angeles (le label qui représente les Pistols aux États-Unis). Une secrétaire décroche et il se présente, Johnny Rotten. La secrétaire explose de rire : «Oh yeah sure. Johnny Rotten’s on the phone. Wouahhhh ! Ha ha ha ! As if he can use a phone !» Vous verrez aussi Steve Jones raconter qu’il se réveillait le matin dans le studio de Denmark Street, qu’il avalait un black beauty et qu’il apprenait à jouer de la guitare sur un album d’Iggy Pop et le premier album des New York Dolls, un Steve Jones qui, comme le rappelle Paul Cook, était complètement obsédé par le sexe. John raconte que Steve Jones prenait une demi-baguette de pain, enlevait la mie, y versait de l’eau chaude et y fourrait un morceau de foie de porc puis sa bite, pour se masturber. Il revient aussi sur l’effarante pingrerie de McLaren (You could never sit at a bar with Malcolm, because he would’nt buy his rounds). À la fin du livre, John l’accuse tout simplement d’avoir détruit les Pistols (Santa Claus turned into Stalin overnight). On trouve aussi dans ce livre percutant un bel hommage aux Pretty Things (Everybody remembers that the Prettty Things were better than the Stones, but they didn’t get the records out there).

Tous les fans des Pistols sont allés voir les deux films de Julien Temple, «The Filth And The Fury» et «There’ll Always Be An England - Live From The Brixton Academy». Dans Filth, assis à côté d’un ampli avec sa Les Paul, Steve Jones montre les accords de tous les hits des Pistols - «Bodies», my favorite. La part belle revient évidemment à John Lydon dont on retrouve le style tranchant. Après l’épisode Grundy, il évoque l’attitude de McLaren : «Malcolm panicked beyond belief». Pour commenter l’éviction de Glen, il a cette formule lydonienne : «It was a Bay City Rollers situation. I wanted it more hardcore». Ce qu’on ne comprenait pas bien à l’époque, c’est que Johnny Rotten ne proposait pas qu’une totale réinvention du rock. Il parlait aussi comme un écrivain. Chacune de ses formules sonnait comme un aphorisme. Il fait peser sur la moindre de ses syllabes le poids d’une intelligence hors norme, un peu à la manière de William Burroughs dans «Amarican Prayer». Il est avec Keith Richards et Mick Farren l’un des seuls qui aient des choses capitales à dire sur le rock. C’est sans doute la raison pour laquelle on s’est tellement attaché à lui. Quand God Save arrive, on agresse Johnny dans les rues. «I was attacked on sight», dit-il d’une voix admirablement timbrée. Il se ramasse un coup de machette dans la rotule, un coup de couteau dans le poignet et une bouteille cassée dans l’œil. Johnny décrit l’arrivée de Nancy à Londres - I fucking hated her ! - Elle branlait les mecs pour ten bucks. Le plus atroce des paradoxes, c’est que les Pistols font la une des journaux et qu’ils n’ont pas un rond car McLaren tourne un film avec leur blé. Puis on arrive à la fameuse tournée américaine. A l’aéroport, ils subissent les fouilles à corps. Les douaniers commencent par Sid, mais il arrêtent vite fait, à cause de l’état de son slibard. La tournée entraîne dans son sillage le FBI, la CIA et une cinquantaine de journalistes anglais venus pour provoquer du scandale. Au Longhorn, Sid traite les cowboys de pédés. Il prend une canette pleine dans la gueule. Bong ! Lèvre éclatée. Un mec leur balance une tête de porc. Fin de l’histoire bien connue à San Francisco et John qui lâche : «Je savais que ça allait se terminer mais je ne pensais pas qu’ils se conduiraient comme des branleurs et des lâches. It’s fucking fucked off !» Et ça se termine par un épisode extrêmement bouleversant. John est filmé à contre-jour. Il évoque la mort de Sid et tient Malcolm et le management des Pistols pour les responsables de cette fin tragique - I’ll hate them for evar for doin’ that - Et il se met à chialer - You can’t be more evil, can you really Julien ? - Vicious, poor sod. No fun.

L’autre film indispensable à une bonne compréhension des Pistols et de John Lydon, c’est le concert filmé à la Brixton Academy par Julien Temple. On y voit jouer un groupe PARFAIT. Ils sont aussi impopulaires en 1977 - Lydon : «S’ils avaient pu nous pendre, ils s’y seraient mis à 36 millions !» - qu’ils sont populaires en 2008 - You ain’t so special - C’est le public qui chante - You’re a liar - C’est l’Angleterre de Brixton qui reprend God Save et du coup ça devient véritablement un hymne populaire. On voit dans la télé ce fantastique showman qu’est John Lydon et on comprend que sans lui, tout ça n’aurait jamais pu exister. On a l’impression que c’est l’Angleterre toute entière qui chante «Bodies».
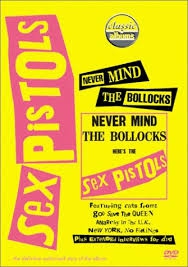
Il existe un troisième film qui donne de bons éclairages sur les Pistols, le «Never Mind The Bollocks» d’Eagle Vision. On y voit MacLaren raconter sa version de l’histoire. Il rappelle qu’il n’a donné qu’un seul conseil aux Pistols : do whatever you want, but make it chaotic. Mais sa morgue le rend profondément antipathique. Il est mille fois moins caustique que Johnny Rotten et cependant, il fut le chef. L’anti-manager, comme il aime à le rappeler. McLaren a l’air de donner une leçon d’histoire du rock à tous les petits cons que nous sommes. On voit aussi deux témoins capitaux de cette histoire : Bill Price et Chris Thomas qui ont enregistré l’ALBUM. Bill Price se montre ébahi par le niveau des Pistols. Il parle de high quality lyrics et il affirme qu’il n’a jamais vu depuis un si fantastic guitar player. C’est émouvant de voir ces magnifiques techniciens du son, accomplis et doux, se mettre au service de la subversion. Après «God Save», le National Front s’en prend aux Pistols et les attaque sur un parking. Ils sont onze. Chris Thomas est poignardé. Bill Price qui intervient pour le défendre est mis en pièces, pif paf. Personne ne leur vient en aide, ni le pub en face, ni les flics, ni l’hosto où ils débarquent en sang. Johnny Rotten rend aussi un hommage appuyé à Chris Spedding qui a aidé les Pistols en leur donnant accès aux studios. C’est à Steve Jones que revient l’honneur de conclure ce poignant documentaire en racontant la fin du groupe - It was ugly in San Francisco. I’d just had enough. Regrets.
Après ce que John qualifie d’utter disaster, on imagine qu’il faut un certain courage pour se relever, remonter un groupe et revenir dans l’actualité avec un son entièrement nouveau. C’est pourtant ce qu’il a réussi à faire avec Public Image. On attendait tout de lui, de la même façon qu’on attendait tout de Johnny Thunders ou d’Iggy Pop.

«First Issue» paraît en 1978, au lendemain de la première vague punk. Dès «Theme», on tombe dans le dub de Jah. C’est lui qu’on entend. Que lui. Keith Levene est en retrait. «Theme» sonne comme un assaut sonique. Quelque chose d’inédit en Angleterre pour l’époque. John geint au fond du studio. On sent qu’il ne va pas bien. Comment peut-on l’aider ? On retrouve dans «Theme» l’hypno de Can que John dig tant. Avec «Religion» 1 & 2, John fait de l’anti-cléricalisme primaire. C’est sur «Annalisa» que Jim Walker montre le bout de son beat. John monte aussi au créneau, mais c’est Jim qui joue le jeu. C’est aussi le retour du Rotten. Il fait son énorme têtu totémique. Il règne sur cet album une tension jusque-là inédite. Même les grands spécialistes du mal-être comme van Der Graff Generator n’étaient pas allés aussi loin dans les profondeurs du tourment psychologique. Keith Levene reprend la vedette en face B avec «Public Image». Il joue ses gros paquets d’accords vinaigrés et John jumppe au sommet de sa gloire éternelle, pendant que derrière, Jah jive son drive. «Low Life» était destiné à McLaren. John chante ça avec une parfaite méconnaissance des lois de la gravité du chant. On le sent privé d’inspiration. Ça sonne terriblement post-punk, un brin arrogant. C’est probablement le but de l’opération. Ils attaquent «Attack» aux accords stoogiens. Ce power-chordage de mauvais aloi masque un manque total de vertu. Par chance, Jah revient dubber la baraque avec «Foodertompf» et un vrai boost de sound-system, du pur jus de Notting Hill Gate Carnaval. Jah mène la danse et blaste l’ambiance. Avec le son bien rond et un peu élastique, il sort un son de basse idéal. Ça groove le vibe dans les chaumières. Salué par la critique, ce disque fut qualifié de «as edgy as the wildest punk singles» et la section rythmique Wobble-Walker de «Sly & Robbie of the blank generation».
Mais à l’époque, le ver était dans le fruit. Wobble et Keith Levene ne pouvaient pas se sentir - Wobble just wanted to kill him. Just kill him. Murder him. Tear him apart - et comme Levene se shootait à l’héro - He was poisoned by chemicals, or a chemichal imbalance in the brain, but it made that rat-arsed, snarly, contemptuous cunt unbearable to put up with...

Il existe un petit livre très intéressant sur l’histoire de Public Image : «Metal Box. Stories From John Lydon’s Public Image Limited». Phil Strongman y jette un éclairage fascinant sur les racines et la formation de PiL. Pour commencer, pas de manager. Puis John cherche des musiciens - I remembered Wobble, A-ha he can play bass a bit - vaguely ! Let’s give him a call ! - Puis Wobble rappelle que Keith Levene was the best musician on that scene by a country mile. He has a beautiful harmonic sensibility - John voulait au départ répartir l’argent à parts égales dans le groupe - There’s no Rod Stewarts in this band ! - S’ensuivent des pages assez capiteuses sur Gunter Grove et sur les gens que John y hébergeait, notamment les membres de PiL : Jim Walker qui arrivait du Canada et Keith Levene. Pas mal de drogues, rappelle Don Letts - heroin, weed and speed - Party every night - an undertone of evil, rappelle Jim Walker. Wobble parle d’energy vampires out there - Et puis John a installé une incredibly loud sound station, et petite cerise sur le gâteau, les descentes de police se multiplient. Un matin à l’aube, John accueille les flics en brandissant un sabre de cérémonie japonais. Pour Alan McGee, «Lydon was charismatic. Wobble couldn’t really play but he was a genius, doing this jazz-rock free-forming thing. Levene was a Yes guitarist in a punk band.» Mais le principal ingrédient du PiL system, ce fut le chaos. Wobble garde le souvenir d’un concert au Rainbow - the most violent gig I’d ever been to - Ailleurs, John reçoit un boule de billard en plein tête, et à Vienne une bouteille de deux litres de vin heurte John McGeoch en pleine tête, le scalpant. À Athènes, des anarchistes foutent le feu au quartier.
Jim Walker ne va rester qu’un an dans PiL, le temps d’enregistrer ce fabuleux premier album, puis fatigué d’attendre des sous qui ne venaient pas, et fatigué par le manque d’organisation du groupe, il mit les voiles. L’éclairage sur Keith Levene est plus diffus. Strongman brosse le portait d’un brillant musicien devenu junkie notoire. Il était donc hors jeu pendant de longues périodes. Le personnage le plus intéressant du lot est sans aucun doute Jah Wobble, l’architecte du son et de la violence - I ended up kicking the head of security in the face - À Paris, il reçoit une tête de cochon en pleine figure - It knocked me out ! A fucking pig’s head ! - Strongman évoque aussi le son d’un Jah qui jouait tellement fort qu’on croyait entendre un tremblement de terre. Lors d’une première tournée américaine, PiL fut invité à jouer dans la fameuse émission American Bandstand. Le célèbre Dick Clark vint saluer les Anglais dans leur loge: «Hello I’m Dick Clark !». Jah lui répondit aussi sec : «Good, well fuck off then !» - Et puis Jah n’en pouvait plus de voir ce pauvre Keith Levene se traîner avec ses problèmes de junkie pendant les tournées. Il en eut tellement marre qu’il finit par quitter le groupe. Ce petit livre regorge aussi d’anecdotes croustillantes sur John Lydon. Quand un journaliste lui dit que les Gun’sN’Roses sont des fans des Pistols, il réagit violemment : That band has really misundestood us. It was all about opening things up, not closing things down !» Mais il revient toujours régler ses comptes : «Pendant des années, j’ai subi des descentes de police à Gunter Grove et aucun de vous, bande de bâtards, ne m’a soutenu !»
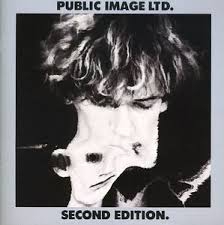
On attendait forcément des merveilles de «Metal Box»/«Second Edition» paru un an après le premier album. Ils attaquent «Albatross» d’une façon assez spécieuse, c’est-à-dire qu’on a le temps d’y réfléchir. La viande arrive avec «Swan Lake». Jah sort pour l’occasion un rude groove offensif. Pour les autres, c’est du gâteau. Sacré Jah, il embarque bien son monde. Jim Walker dit que tous les cuts sont construits comme ça : lui et Jah jouent un groove et les autres entrent dedans. Ici, Keith Levene ramène un beau thème de guitare. Il règne dans ce cut un énorme parfum de modernité. Voilà bien le groove des temps modernes. Avec «Pop Jones», John entre dans les corridors déserts de sa folie. Personne ne peut plus rien pour lui. On le voit errer à la surface du groove bien sourd et bien malsain de «Carerring». C’est encore Jah qui dubbe «Graveyard». Les autres comptaient vraiment sur son sens aigu du boost. Il repart sur les traces de Keith Hudson pour «The Suit». Jah s’en donne à cœur joie. C’est son album. Les autres n’ont rien dans le crâne. Jah sort un groove de dub et le tour est joué. C’est encore Jah qui soutient John a bout de drive dans «Bad Body». Le pauvre John bat sa coulpe au fond du studio. Il erre comme une âme en peine. Il erre toujours dans sa désolation pour «No Birds». Il chante tout à l’envers, en dépit du bon sens. Pauvre John.

On retrouve tous ces puissants cuts sur «Paris Au Printemps», un live enregistré à Paris en 1980 : «Theme», toujours lamentatif et mal dans sa peau - And I wish I could die - Puis «Chant», bien Dada, loin du confort du studio, puis «Careering», sauvé par le drive de basse, joué à l’Anglaise, typical brit street sound. On retrouve là l’esprit du grand PiL, avec ce chant de rengaine et le dubbing de Jah. Puis John fait son Pistol dans «Low Life», il renoue avec les flamboyances d’«EMI», il mouille ses syllabes de bouts de phrases et redevient le grand imprécateur, fantastiquement soutenu par le drive de dub. Sur «Attack», Keith Levene refait son petit festival. Ces mecs avaient tout de même une sacrée allure. Ils avaient trouvé un vrai son qui dépassait largement le cadre étriqué du post-punk. Puis John chante «Pop Jones» dans l’écho du temps et Keith Levene tricote ses chaussettes d’arpèges.

Jah a quitté le navire quand paraît «The Flowers Of Romance» en 1981, année de l’élection de François Miterrand. C’est Jeanette Lee qu’on voit sur la pochette. Ça démarre plutôt mal avec un «Four Enclosed Walls» joué au tambour seul et un John qui semble psalmodier dans le désert. Ce que confirme «Track 8» : John ne va pas bien. Il repart dans les corridors du contre-chant, comme s’il errait dans les corridors d’un vieil asile désaffecté. Ou bien il joue la carte de l’étrangeté, ou bien il renégocie l’équilibre de sa santé mentale. Sur «Phenagen», il joue des cloches thibétaines et donne beaucoup d’inquiétude à ses proches. C’est Martin Atkins qui joue le morceau titre au tambour arythmique. Il fait du togolais, oui mais du togolais de Sainte-Anne, le togolais qui ne sert plus à rien , du togolais dont même les Togolais ne voudraient pas, un togolais qui se perd dans les interstices de la raison. Avec «Banging The Door», John cherche des noises à la noise. Il chante à l’envers, pareil au dingue qui nargue son reflet dans un miroir. Il a décidé d’échapper définitivement à toutes les lois de la raison. John avoue dans Anger qu’il joue tous les instruments sur l’album. Interrogé par un journaliste, Jah Wooble n’y va pas par quatre chemins : «To be brutally honest, we all know that the name PiL after Metal Box meant shite !»

On retrouve deux belles bêtes sur «Live In Tokyo» : l’hypnotic «Annalisa» et le pistolérien «Low Life». C’est Martin Atkins qui bat le beurre sur «Annalisa». On peut lui faire confiance. Dommage que le bassiste Bernard n’ait pas de son. John refait son Rotten avec «Low Life» - Bourgeois antechrist - On retrouve les morrrron et des anarchists de l’ancien temps. L’avantage de cet album est qu’on retrouve des cuts qui ne figurent pas sur les albums, comme par exemple «This Is Not A Love Song», plaidoyer d’incantation monté au beat discö. Ou encore le fameux «Death Disco», monté lui aussi au beat discö sec, mais cette fois sans le dub de Jah, alors ça retombe comme un soufflet. Et John ne va pas bien. Le voilà reparti dans les corridors déserts de sa folie. On entend sa voix de harpie mal considérée se perdre dans l’écho du temps. Il tente de regagner l’estime des gens avec «Bad Life». Il y sort sa meilleure voix plaintive, mais c’est fatiguant. Martin Atkins revient battre le beurre du beat de «Banging The Door» et John fait son Max la menace. Keith levene joue dans l’arrière-boutique. Imprécation et lancinance sont bien les deux mamelles du pauvre John.
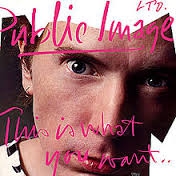
Nouveau départ en 1984 pour PiL avec «This Is What You Want. This Is What You Get» et une nouvelle équipe autour de John et de Martin Atkins. Keith Levene a quitté le groupe. Sur la pochette, John joue les plaboys. Il est admirablement bien coiffé et porte un blazer pied de poule. Il prend «Bad Life» à la petite hurlette. Cette fois, l’atroce bass-drum des années 80 prend les devants. Monté sur son discö beat, «This Is Not A Love Song» est hélas le cut de PiL le plus connu. S’ensuit un «Solitaire» enchâssé sur un beat post-punk. John monte au créneau et miaule dans les limbes du Pacifique. On tombe en face B sur «Where Are You» que John chante d’une voix de Castafiore énamourée. Il se laisse dériver au long des corridors déserts de sa déchéance septentrionale. L’ambiance semble vouloir cultiver the strangeness of sorts. John fait du bon Dada sans même s’en rendre compte. Ils terminent cet album mi-figue mi-raisin avec «The Order Of Death» joliment ambiancé à la guitare, avec un son qui rappelle celui de Keith Levene, ce qui semble logique puisqu’il a co-écrit le cut avec John. Mais on sent bien que tout ce qui faisait la force de PiL a disparu. Sans Jah, PiL is shite.

Ce que vient contredire «Album», paru l’année suivante. Là-dessus jouent Ginger Baker, - Ginger, I loved. What a nutter -Tony Williams et Steve Vai. On sent dès «FFF» un parti-pris plus rocky. Steve Vai cocote sur sa guitare. C’est soutenu au beat solide par Tony Williams. Il frappe même très dur. Avec «Rise», John prône l’énergie. Sacré John. Il en aura passé du temps à prôner - I’m gonna rise an energy ! - Sacrément bien battu par Ginger Baker, voilà «Fishing». John semble s’épanouir sur le stomp, pendant que Steve Vai fait des siennes par derrière. On retrouve le même son sur «Round», et John roule ses syllabes dans la farine. Et comme sur les cuts précédents, c’est battu bien dru et Steve Vai fait son guitariste émérite. Le hit du disque, c’est «Bags» qui ouvre le bal de la B. On y retrouve ce curieux alliage de gros beat dur prééminent et d’incursions de guitares incisives - Black rubber bags ! - Voilà un vrai stomp de brute. Sur «Home», John devient fantastique d’imprécation. Il ne quitte pas d’une semelle son vieux style pistolérien d’exaction patriarcale. Par sa densité, cet album renoue avec «Metal Box», minus le dub de Jah. «Ease» se fait encore plus élégiaque. On suivrait John jusqu’en enfer, de toute façon. Steve Vai joue les virtuoses dans une atmosphère crépusculaire de fin de disque. Quelle audacieuse mixture ! C’est terriblement déroutant. On imagine que John a pris des risques en laissant s’exprimer ce virtuose bavard. Pour la petite histoire, John et Ginger ne se sont jamais rencontrés - It absolutely shocked me that people of their status had respect for me.

Trois ans plus tard paraît «Happy». John reconstitue un PiL avec John McGeoch, Lu Edmonds, Allen Dias et Bruce Smith. Ça commence mal avec «Seattle», un groove privé du dub de Jah. John semble souffrir d’une sacrée panne d’inspiration. Alors il décide de re-rouler ses r, comme au temps des Pistols et il tape «Rules And Regulations», histoire de rappeler qu’il fut un temps le plus grand chanteur d’Angleterre. Il fut même complimenté par Miles Davis qui comparait le chant de John au son de sa trompette. Avec «The Body», on reste dans l’imperturbable vieux son des familles limited. John semble bel et bien limited, pour le coup - We want your body - C’est monté au vieux beat cousu de fil blanc comme neige. Avec «Hard Times», John fait comme Jaz, il dénonce les pollueurs - Spies everywhere/ You put the poison in the air - Et comme Lemmy il dit son dégoût du kaki - I don’t like khaki/ I won’t wear your uniform - John rejette tout en bloc. Il prend «Open And Revolving» au chant de harangue déboîtée - Like some silly soliloquy - Et puis il termine en s’ennuyant sur le beau riff de «Fat Chance Hotel» - I get bored in the brain - Il meurt d’ennui pendant ses vacances - Some useless holiday.

Il parvient à conserver miraculeusement la même équipe pour «9», sauf Lu Edmunds qui souffre d’acouphènes. Dès «Disappointed», John revient à ses élans d’imprécation cavalante. Mais c’est très muselé au niveau des orchestrations. On note l’absence criante du dub de Jah. Dias n’est pas Jah. Alors John cherche la voie de la rédemption dans le poppy «Warrior». Next to ridiculous. «Sand Castles In The Snow» vire post-punk et John se plaint dans «Worry» - The fruit of life gave me dysentery - Voilà «Like That», monté au joli beat tocky, et des chœurs de filles poppisent atrocement la chose. Le pauvre John hulule - Just like a woman - Et ça finit par friser le discö beat. S’ensuit un «Same Old Song» monté au beat entreprenant. On sent bien cette fois encore que John cherche sa voie. Il continue d’errer au long des vieux corridors déserts de sa destinée.
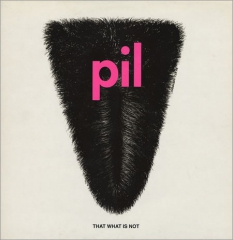
Joli système pileux sur la pochette de «That What Is Not». C’est une sorte de clin d’œil irrévérencieux. John McGeoch gratte sa gratte sur cet album. L’«Acid Dream» qui ouvre le bal a ce petit côté incantatoire pileux mais forcément, avec John dans les parages, ça prend vite des proportions extravagantes. Par contre, McGeoch riffe «Luck’s Up» à l’anglaise et même à l’anglaise colérique, mais ça finit par tarabiscoter, c’est peu concis, ça brouillonne. Et le pauvre John s’enfonce dans «Cruel» à la recherche du temps perdu et d’effets de promontoires ridiculous. Il va même virer pop dans «God» et le groove de basse ne vaut pas le dub de Jah. Dommage, tout est dommage sur cet album. McGreoch envoie de bons riffs, John roule bien des r dans son pigeonnier, et ce «Covered» est joué au tambour de guerre africain. Ça tourne à la teignerie et un sorcier africain vient reprendre John au chant. C’est un disque très agité, comme on le voit avec «Love Hope» qui finit dans la folie pure. John ne ménage pas sa peine. Il sait mettre son esprit au service de la déraison. «Unfairground» vaut aussi le détour, car John ressort ses vieilles recettes de Sex Pistol. Dans «Emperor», McGeoch part en solo et joue les fous dangereux. John adore ça. Il revient en imprécateur et se couronne à la cathédrale de Reims. Mais le pauvre John finit par nous fatiguer avec ses crises de grandiloquence. À l’entendre, on croirait qu’il beugle des ordres. Heureusement le fringuant McGeoch part en vrille, dans la meilleure des traditions ashetoniennes. C’est un sauveur d’album. Dans «Good Things», John fait le fou, alors ça tourne au mambo drive de shuffle bizarre et des filles font les contre-feux. John joue la carte de la contrescarpe cavaleuse et on entend les filles hurler dans les collines d’Emily Brontë ou d’ailleurs, on s’en fout de toute façon, car il n’y a aucun espoir.

Sur «Alife 2009», on retrouve tous les vieux coucous, du genre «Disappointed» (John cherche l’hymne à coups de plaintes geignardes), «Bags» (vieux fonds de commerce de PiL, mais hélas sans Ginger Baker), «Memories» (traité au plan incantatoire anti-jubilatoire), «Annalisa» (on les sent déterminés à vaincre, mais il leur manque le dub de Jah), «Religion» (bien rampant, avec un peu plus de basse dans le son), «Rise» (à peu près le seul cut de PiL qui soit mélodique, on le suit avec un intérêt non feint - I’m gonna rise an energy or anarchy) et «Open Up» (monté au beat entreprenant, ouf, ils finissent quand même par ramener un peu de viande).
En 2012, John Lydon songe à reformer PiL. Wobble se montre gourmand et John lui dit goodbye. Quand à keith Levene ? - I simply didn’t want Keith in my life again. It’s completely clear: he’s a cunt.

C’est en gros la même équipe qu’on trouve sur «This Is PIL» : Lu et John, Bruce Smith au beurre et Scott Firth à la basse. John prend le morceau titre à l’agonie de Sainte-Anne. Il prêche dans le désert. On trouve cette fois un gros son d’infra-basse qui semble vouloir renouer avec le son du premier album - Welcome to PiL ! We are PiL ! - Ils annoncent la couleur : nous voilà avec un album de dub. Mais les morceaux défilent et il ne se passe hélas pas grand chose. On a la petite jérémiade convenue dans «Human» et le vieux coup de pilisme patenté dans «I Must Be Dreaming». Il se dégage des deux premières faces de ce double album un léger parfum d’ennui. Avec «The Room I Am In», John erre dans sa room. La room où il est. Retour au dub extra pur avec «Lollipop Opera» un cut bourré d’infra-basse de sound system. John remonte sur ses grands chevaux pour «Reggie Song», mais il cavale au long des corridors glacés de son univers branlant - I am from Finsbury Park - Et on tombe enfin sur le hit du disk, «Out Of The Woods», monté au riff de basse hypnotique de big sound system, un fantastique clin d’œil à Can.

«What The World Needs Now», nouvel album de PiL, sort tout juste du four. Dès «Trouble Double», John retrouve sa vieille niaque d’antan. La tendance se confirme avec «Know How». Il y retrouve ses vieux accents pistoliens et Lu Edmunds nous gave de jolis passages de guitare. Puis John lance une attaque en règle contre l’hypocrisie américaine - le fameux censorship - avec «Betty Page» - God bless America - Il y cherche la dimension grandiose du dénonciatif, une sorte de vieux cheval de bataille, isn’t it ? En face B, on tombe sur un «Spice Of Choice» qui semble pompé sur «Love Is The Drug» de Roxy. On assiste en face C au retour en force du dub sature-man avec «Big Blue Sky» et John profite de l’espace qui s’offre pour lancer au ciel une ouverture symphonique exceptionnelle. On ne l’aurait jamais cru capable d’un tel exploit atmosphérique. Mais c’est vrai qu’il fait aussi partie des gens qui n’ont plus rien à prouver, et ce depuis 1977. L’autre grand cut de l’album se niche en face D : «Corporate», un dub expressionniste à la Bertolt Bretch, pur jus de dénonciatif - Corporate murderer - qui n’est pas sans rappeler le «Blood On Your Hands» des mighty Killing Joke - Welcome to your icloud head - Il finit avec une pure pistolerie du XXIe siècle, «Shoom» - Fuck you ! Fuck off ! Fuck sex ! It’s bollocks ! All sex is bollocks ! Et voilà le travail.
Signé Cazengler qui remPiL
Public Image Limited. Le Trianon. Paris XVIIIe. 6 octobre 2015
Public Image Limited. First Issue. Virgin 1978
Public Image Limited. Second Edition. Virgin 1979
Public Image Limited. Paris Au Printemps. Virgin 1980
Public Image Limited. The Flowers Of Romance. Virgin 1981
Public Image Limited. Live In Tokyo. Virgin 1983
Public Image Limited. This Is What You Want. This Is What You Get. Virgin 1984
Public Image Limited. Album. Virgin 1985
Public Image Limited. Happy. Virgin 1987
Public Image Limited. 9. Virgin 1989
Public Image Limited. That Was Is Not. Virgin 1992
Public Image Limited. Alife 2009. Concert Live 2009
Public Image Limited. This Is PiL. PiL Official 2012
Public Image Limited. What The World Needs Now. PiL Official 2015
Phil Strongman. Metal Box. Stories From John Lydon’s Public Image Limited. Helter Skelter 2007
John Lydon. Anger Is an Energy - My Life Uncensored. Dey Street Books 2015
John Lydon. Rotten - No Irish, No Blacks, No Dogs. St Martins 1994
The Filth And The Fury. Julien Temple. DVD 1999
Sex Pistols. Never Mind The Bollocks. DVD Eagle Vision 2002
Sex Pistols. There’ll Always Be An England. Live From The Brixton Academy. Julien Temple. DVD 2007

18 / 03 / 2016
GIBUS CAFE / PARIS
AMNASTY / FALLEN EIGHT
FROM A BROKEN STEREO
CASEY / ACRES
BURNING DOWN ALASKA
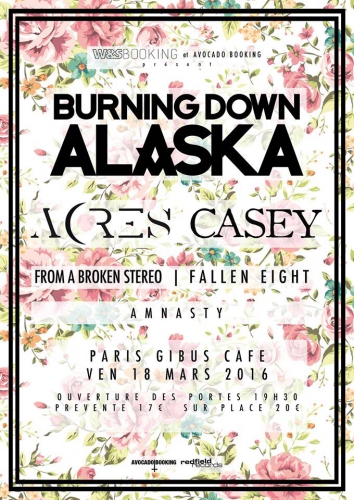
Waouh ! Six groupes en une seule soirée, au Gibus Café, commence à 19 h 30 et se termine à minuit. Question espace-temps comme disait Einstein tous les risques que ce soit aussi comprimé qu'un tube d'aspirine effervescent. Je ne connais pas les têtes d'affiche mais depuis la Release Party de Fallen Eight ( KR'TNT ! 269 du 18 / 02 / 2016, tout juste un mois, ô combien le temps passe vite comme disait Héraclite ), j'ai envie de voir From a Broken Stereo. Puis faisons profil bas, le Gibus café, je connais l'endroit où le haut-de-forme est accroché, ne renouvelons pas l'erreur du samedi précédent où après avoir parcouru soixante-dix kilomètres, me suis aperçu que j'avais laissé l'adresse notée rapidement en début de semaine à la maison, mémoire défaillante et coin de la planète perdue puisque non cartographié selon le GPS peu performant...
AMNASTY

Suis arrivé avec dix minutes de retard. Retenu par une charmante cliente à la librairie juste en face. J'ai raté les deux premiers morceaux. Pratiquement la moitié du set, car l'orga ne leur en a pas donné davantage. Quatre grands gaillards de front. Vous ne verrez pas le batteur, l'est caché par le rideau impénétrable des trois guitares et du chanteur, rangés comme des livres sur l'étagère, en prenant soin de ne pas se gêner.
Heureusement qu'ils ne se laissent pas intimider par la situation limite. Possèdent une arme pas secrète du tout, un bataillon de fans qui se pressent sur le devant de la scène et qui profitent de l'énergie qu'ils dégagent pour se dépenser follement. Sur leur facebook, ils se sont attribués l'étiquette métalcore mélodique. Ne les contrarions pas, mais la mélodie ils ont dû la laisser au local. C'est du gros son, explosif et jouissif. Le bouchon du champagne qui fuse et qui troue le plafond, pour les gentilles bubulles qui sautillent vous repasserez. Ou alors dans la salle des fans déchaînés, un véritable bombardement de neutrons qui ricochent sur les murs. Idéal pour une première partie. L'on sent qu'ils mettent toute la gomme pour qu'on ne les oublie pas. Guère possible, avec toutes les filles qui les prennent en photo. Trois titres et s'en vont. Pas de rappel malgré les applaudissements nourris. Faudra les revoir, en de meilleures conditions. Avec surface de réparation et set in extenso plus distances, temporelles non aumôniales. Amnasty, le nom a été choisi pour ses sonorités. Justement, ils savent se faire entendre.
FALLEN EIGHT

Dure épreuve. Pas pour nous qui avons bénéficié d'un set de toute beauté. Vous savez ces instants lamartiniens où le temps suspend son vol. Pour le groupe, j'imaginons. Pressé par l'orga alors qu'ils sont en train d'installer leur matériel. Je ne vous parle pas de l'encombrement dans cet espace réduit. Mais aussi en plein milieu du tour de chant... A croire que leurs morceaux seraient interminables. Les américains ont réussi à résumer sur cassette audio La Recherche du Temps Perdu du divin Marcel en une minute, mais il ne faut pas non plus exagérer. Vous nous ferez plaisir de ne pas confondre rocker avec listener's digest.
La scène ne s'est pas agrandie mais Clem trouve la parade : micro en main il saute avec l'agilité d'un cabri par-dessus les retours dans le public et fera ainsi d'incessantes allées et venues entre les deux niveaux ce qui libère plus d'espace pour ces compagnons. Sauf pour JP enfermé avec sa batterie dans une tour d'ivoire de plastique transparent ce qui ne le rend pas plus visible à nos yeux. Le Gibus Café prend soin de nos oreilles, vous avez même un cadran lumineux qui indique en gros chiffres rouges les décibels. Comme sur les routes à automobiles, interdit de dépasser le 110. C'est gentil toutes ces précautions, mais nous sommes dans un concert de rock and roll et non dans une maison de retraite.
C'est en ces occasions qu'un groupe prouve sa maturité et son savoir faire. Fallen Eight prend le minotaure des petites adversités par les cornes et nous offre vingt-cinq minutes de félicité. Pas évident, leur musique nécessite de longs moments où la pression s'accumule lentement pour éclater en de puissants orages tumultuesques infinis. Trouvent la parade, moins de longueur mais davantage d'intensité. Nous offrent un condensé d'énergie irradiante. Les amateurs de rondes guerrières arrêtent leur tourbillon et prennent le temps d'écouter, de se laisser submerger par cette marée musicale qui monte, monte et nous recouvre d'un groove majestueux. Cité d'Ys noyée par les eaux et la cloche de l'église qui bat le glas des morsures envenimées. Fallen Eight nous engloutit dans son monde. Retour au liquide amniotique pour mieux renaître aux forces titanesques du monde qui s'ouvre comme un fruit trop mûr.
Une superbe prestation, la voix de Clem qui se rit des tempêtes des guitares comme l'albatros de Baudelaire des nuées. Un grand moment.
FROM A BROKEN STEREO

Les Broken n'ont pas brisé notre état de béatitude. Pour la stéréo, ils l'ont définitivement atomisée. Mieux vaut être totalement soi que singer les autres. Après le drapé moiré des Fallen Eight, les five FABS nous ont offert le froissé déchiqueté. De tous les groupes de la soirée, ce sont eux qui ont le mieux utilisé leur mini-plage horaire. Peu de morceaux mais expédiés comme des trailers infernaux. Des particules sonores qui vous poussent à en voir, à en entendre plus. Vous filent des crocs voraces et vous donnent envie de déchiqueter de la chair fraîche. C'est sûr que leur hardcore sans concession était idéal pour se plier au mini-format qui leur était imparti. Antoine – comme tous les batteurs de la soirée isolée dans sa cloche de plongeur plastifiée, est estompé par ses acolytes. Debout tous les quatre sur le devant de la scène. Vous avez l'impression du gang des frères Jesse James, sur l'affiche du cinéma, juste avant de foncer dans la banque qu'ils vont attaquer dans la seconde qui suit. Les hold up comme on les aime, avec les caissiers qui se font exploser le cervelet à la winchester et les chevaux fous dans la rue qui écrasent les passants innocents.
Arthur mène la danse. Chant robuste et d'une redoutable efficacité qui vous arrache la viande des os. Pas un hasard si nous avions remarqué sa très courte apparition à la Rise & Grow Realease Party des Fallen Eight en février dernier. ( voir KR'TNT ! 269 ). Le chahut recommence dans la salle, difficile de rester de marbre devant une telle avalanche de speed. Silence ! Arthur annonce un nouveau morceau avec un son particulier. Et hop, comme par miracle apparaît un râtelier de nouvelles guitares qui vitissimo rejoint les coulisses porteur des anciennes. Un son plus clair, plus léger, mais tout aussi grisant que le premier, cela ressemble à une masse visqueuse qui rampe sur le plancher, une présence menaçante qui vient d'en bas, mais tout aussi chargée de danger que le début du set. Faudrait en entendre davantage pour analyser plus finement. Mais évidemment c'est déjà trop tard. Fin de la partie. Amputé par le gong. En tout cas s'en sont tirés comme des chefs sioux sur le sentier de la guerre. Volée de flèches sur le chariot de nos cerveaux qui flambent. Nous laissent pantois. Belle démonstration de force. A revoir d'urgence dans un concert non équeuté.
CASEY

Exunt les formations nationales. Bienvenue aux groupes étrangers. N'auront pas droit aux portions congrues. Adieu les sets riquiqui. Carrément roudoudoubles. Z'ont ne les pressera même pas quand le matériel s'accumulera devant la scène. Un véritable déménagement, d'autant plus qu'il faut démonter la batterie des froggies – ce qui libère un quart de scène – et faire coulisser le plexiglass étouffe-son – aussi rébarbatif que les murs anti-bruit du périphérique - jusqu'au kit-drum marqué du logo des Burning Down Alaska qui occupe le second quart. Les anglais tentent de démonter l'objet séparatif peu transactionnel en douce et de le transvaser clandestinement panneau par panneau vers les coulisses. Sont vite arrêtés par la régie-son qui tient à son artefact comme à la prunelle de ses yeux, comme au tympan de son oreille. Mais l'on s'en fout, on a un guitariste.
Pas bêtes les englishes, plantent un micro devant la scène pendant que derrière l'on trimballe les planches à magic box. Normal, il y a un guitariste. N'est pas tout seul. Sont cinq en tout. Je n'ose pas dire que les quatre autres ne comptent pas. Non, ce ne sont pas des demi-portions de Vaches Qui Rit. Une fois qu'ils seront tous casés, Casey dévoilera ses canons à particules oniriques. Vous emportent au pays d'Alice et du lapin blanc en trois coups de cuillère à pudding. Crème anglaise premier choix. Doux comme le vent dans les roseaux des poèmes de Yeats, mais épicé au parfum d'orange amère. Vous caressent la peau en même temps qu'ils vous labourent la chair à vif. Et en plus ils ont un guitariste.
Payait pas de mine, pendant les préparatifs, je me demandais s'il faisait partie du groupe ou si c'était un jeune frère qui venait donner un coup de main. L'a attendu longtemps avant d'ouvrir son étui. Puis s'en est allé branché sa guitare, l'on avait envie de l'aider, de lui montrer l'orifice où brancher le jack. N'était pas encore tout à fait prêt quand les autres ont démarré la machine. Et plaf ! Transformation. C'était un guitariste. Au début, on n'y croyait pas. L'a pris le train en marche, l'a suivi le mouvement. L'on avait même l'impression d'un rythmique qui se la coulait douce, du genre doucement le matin et pas trop vite le soir. Mais c'était un guitariste.
Une dégaine incroyable. Une espèce de banane choucroute qui lui écrasait la tête – exactement la description de Moby Dick la baleine blanche qui s'apprête à foncer sur le malheureux Péquod, les harpons plantés dans son flanc et le cadavre du capitaine Achab entortillé dans les filins d'acier – bref une coiffure so tipycally british, et une veste toute simple qui lui donnait l'allure des guitaristes – anglais – des années soixante. Ce qui tombait très bien, parce que figurez-vous que c'était justement un guitariste.
Plongé dans son jeu jusqu'au rêve. Pas le genre de briscard à vous envoyer des riffs qui vous découpent en tranches de mortadelle avec le tranchant d'un sabre de cavalerie. C'est simple, chaque fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant, c'était lui. Les deux petites notes, à première ouïe subsidiaires, mais qui vous emportent dans les hauteurs stratosphériques, c'était lui. Au bout de dix minutes, l'on avait oublié le restant de l'équipe. Que vous pouvez ranger dans les cadors. Car Casey ça casse les manivelles. Pas exactement le rock que j'aime, un peu trop doux pour moi. Oui, mais quand Toby vous disperse un collier de perles précieuses dans les esgourdes, vous vous sentez mieux. Vous pond des notes comme des gouttelettes de rosée opalescentes, un jeu arachnéen, d'une finesse incroyable.
Quand j'ai voulu lui parler à la dernière seconde de l'ultime morceau, l'était déjà entouré des Fallen Eight, qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur l'art de ce magicien. Normal, c'est un guitariste.
ACRES

Etrange cette programmation. Deux groupes qui se ressemblent trop. Acres joue plus fort, plus lourd que Casey. Quand vous comparez, et vous ne pouvez y échapper tellement les deux univers sont semblables, la balance du destin penche toujours en faveur d'Acres. Oui, mais eux ils n'ont pas de guitariste. Enfin sont comme tout le monde. Des guitares comme s'il en pleuvait, un drummer pas plus visible que tous les autres qui l'ont précédé, du métier, de l'expérience, de la conviction. Vous emmènent loin. Une musique aussi belle que du Swinburne. En plus, s'ils n'ont pas de guitariste, ils ont un chanteur.
Le gars qui s'y croit si fort que vous finissez par croire en lui. Ne faut pas être pressé. Les camarades lui brodent de fils d'or un long tapis d'arpèges, et lui il reste appuyé sur le micro, la tête penchée comme un poète romantique attendant la visitation du souffle divin et apollinien. Ne vous regarde pas, l'est tourné vers le mur latéral, immobile et silencieux. Ce n'est qu'au bout de presque dix minutes qu'il s'éveille et entonne le premier couplet.
Acres vous entraîne au pays des fées et des magiciens, vous emmène par la main dans les tableaux des préraphaélites, les femmes y sont belles comme des sorcières aux cheveux rouges de sang et vénéneuses comme des plantes carnivores. Dans l'assistance assise, quasi-religieuse, de fins sourires mystérieux errent sur les lèvres des jeunes filles. Elles s'éclipseront durant l'interlude qui précèdera le dernier groupe.
Sidération et subjugation. Les yeux du serpent qui vous fascinent. Sagesse immémoriale des contes symbolistes. Rien de âcre dans Acres. Vous refile le baiser de la belle au bois dormant pour vous réveiller de la laideur du monde et vous entraîner dans la léthargie contemplative des mangeurs d'opium...
BURNING DOWN ALASKA

Avec l'apocalyptique promesse du nom je m'attendais à une impitoyable fournaise. Une atmosphère martienne de 3417 degrés celsius minimum. Un groupe torride. Erreur culturelle. Burning Down Alaska nous vient d'Allemagne, les peuplades d'outre-Rhin sont animées d'une fervente foi en la sainte écologie. Peut-être leur nom est-il simplement une mise en garde sur le réchauffement climatique, je ne sais pas, mais enfin je vous apporte une bonne nouvelle, la musique de Burning Down Alaska n'est en rien responsable de l'extinction programmée de la banquise. Nos amis les pingouins peuvent continuer à les écouter sereinement sur leur électrophone sans craindre pour leur habitat de glace fondante, le danger vient d'ailleurs.
Ce n'est pas qu'ils soient mauvais. Même qu'ils sont bons. Ne manque même pas un boulon de huit à leur guitare. Sont au point. Comme des pros. C'est là le gros hic. Peuvent tout faire, s'énerver méchant de temps en temps, mais juste ce qu'il faut, et puis revenir aux ambiances emphatiques de base, lourdes et lentes – comme les amantes d'André Hardelet – dont le public semble se régaler. Connaissent leur affaire. Pas moyen de s'ennuyer avec eux. Allez tout le monde lève la main, allez maintenant tout le monde baisse la main, allez tout le monde tape dans les mains et tout le monde tape dans ses menottes proprottes, allez tout le monde se baisse, et allez quand j'aurai dit trois tout le monde se lèvera, one, two, three, jumping sur place s'il vous plaît, cela me rappelle mes cours de gymnastique à l'école primaire. Sont un peu fatigants. Je ne voudrais pas tomber dans les poncifs, mais cette méthode d'occupation comportementale coïncide si bien avec la fameuse discipline germanique, que cela en devient gênant.
Je dois avoir mauvais esprit car l'assistance – celle qui est restée - connaît leurs morceaux par coeur et les faces s'illuminent de sourires jouissifs. Perso j'éprouve comme un malaise, le hardcore d'entertainment ne me séduit guère. Pense que c'est même juste le contraire de l'esprit du rock and roll. Alaska a tous les codes et toutes les clefs mais ils n'ouvrent aucune porte. Surtout pas celle du cabinet secret des horreurs de Barbe-bleue. Restez groupés autour de nous, ici l'on vous cocoone-rock. Burning Down Alaska me laisse froid. Tout à l'heure en partant, je m'attarderai devant un café, sont cinq pas très géniaux à jouer un rock ni très futé, ni très incisif, mais au moins ils y croient, et je préfère.
Alaska est antinomique. La formation classique – basse, batterie, deux guitares – qui sur le haut de la scène se charge des lignes mélodiques plus les accélérations nécessaires pour ne pas s'endormir. Et en bas, devant, le micro sur pied, et un autre portatif, deux chanteurs. Deux hurleurs qui vomissent leurs tripes sur le devant. Quand l'un est au cromi, l'autre chante pour lui, le corps haché dans une transe frénétique. Ce sont eux qui soufflent le show et le froid. Voix craquelée pour l'un et plus swinguante pour l'autre. Du sur mesure. Mais il manque un grain de folie. Le groupe ne se met jamais en danger. Evite la route des icebergs. Du moins ceux qui font couler les Titanic.
Ce hardcore teuton, ne me titille pas les tétons.
RETOUR
Pas à la maison. Réflexif. Une belle soirée. Ce soir le hardcore avait davantage de coeur que de dureté... Et puis six groupes en cinq heures, sans plateau tournant, c'est un peu beaucoup. Le plus est l'ennemi du bien. Cette constatation : chaque groupe rameute son propre public, qui se volatilise en partie après son passage... La moitié de l'assistance ayant disparu lors du passage d'Alaska. Un public de jeunes gens avec une grande proportion de gent féminine. Le rock serait-il en train de grignoter le terrain perdu ?
Damie Chad.
( Photos prises sur le FB des artistes, ne correspondent pas obligatoirement au concert )
45 TOURS
SOUVENIRS, SOUVENIRS
PHILIPPE AMELOT
( Le Castor Astral / 2000 )

Pas plus épais que quatre 45 Tours empilés, longueur pratiquement similaire – dépasse même de cinq millimètres – par contre question surface l'en manque à vue de nez au moins trente pour cent. Au Castor Astral, ils ont une bonne collection rock assez étendue ce qui est un indice positif et puis l'argument décisif du bouquiniste, trois euros. Adjugé, vendu. A ce prix l'on ne boude pas, serait-il frelaté, son hypothétique plaisir.
Philippe Amelot est né en 1964, n'a pas choisi la meilleure période, a fêté ses vingt ans dans le milieu des années 80, son choix de disques a statistiquement peu de chance d'être mirifique. Laisse à désirer : Maxime Le Forestier, Renaud, Mano Negra, Neil Young, Lili Drop, Antoine, Michel Fugain. Sûr je choisis les pires – il y a tout de même un Roy Orbison les Byrds et Les Pogues mais enfin nous n'habitons point sur la même planète. L'est passé à côté. Ses parent avaient écouté Elvis Presley et Bill Haley, l'est vrai qu'ils n'en étaient pas devenus des rockers pour autant, l'on sent les fragrances moisies de la petite-bourgeoisie, de toutes les manières le phénomène de la dégénérescence des générations est un peut-être une course à l'abîme inéluctable.
Quoi qu'il en soit, cela commence mal. Premier disque écouté : Cuando Calienta el sol, accordons-lui le bénéfice de l'âge, moins de dix ans, mais vous conviendrez que ça pue le blaireau. L'est des personnes qui sont maudites avant d'avoir commencé à vivre. Franchement si vous étiez une fille accepteriez-vous de sortir avec un gars qui tout petit écoutait une telle horreur ? Et si vous étiez patron, vous viendrait-il à l'idée de l'embaucher dans votre entreprise à profits ? Et si vous étiez son père, ne l'auriez-vous pas déposer fissa à la Dass, rouge de honte ? Je pourrais continuer mon questionnaire sur des pages et des pages, mais je vous en fais grâce. D'autant plus que la musique Philippe Amelot, il s'en fout un peu. Vous pose le titre en haut du chapitre – bingo, comment avez-vous deviné qu'il y en avait pile quarante-cinq ? - vous rédige deux ou trois pages à la suite et c'est à peine s'il se souvient du hit, souvent il ne lui consacre pas plus de quatre ou cinq lignes, et parfois l'a tellement oublié qu'il le cite in-extremis avant le point final. Pour l'analyse musicale, c'est râpé comme le gruyère à trous.
Et tout de même, il y a une petite musique qui se dégage de ce mince bouquin. Certes pas très joyeuse, première moitié : le occasions ratées, deuxième hémisphère : les regrets. Résumé d'une vie. Un truc pas vraiment marrant à se farcir. D'ailleurs le frère du narrateur s'en est allé avant la fin. Suicide mode d'emploi. L'a mis un dernier disque et a fait sa révérence. Merci du cadeau, frérot. Le genre d'anecdote qui vous plombe une vie. Surtout qu'en plus, l'avait fait le mauvais choix. Amelot remplace le scud par un autre de Nick Drake. Retour à l'expéditeur, lui change la bande-son de la scène ultime.
Pour Amelot la vie est une camelote qui s'effiloche. Nous parle d'Elsa Brezner, qui forma Tanit avec Pascal Humbert – aujourd'hui avec Bertrand Cantat dans Detroit – qui sortit deux disques chez New Rose. L'évoque d'une manière impressionniste. Perdue dans ses rêves. Comme lui en son passé. A peine plus loin, évoque la figure de Marc Seberg. Pas à son avantage. Une attitude pro ou post traumatique. L'aime vraiment cette génération. La sienne. Celle qui s'est fadée l'après-punk. Arrivée sur les débris de la grande désillusion. Perdue avant d'avoir même pensé qu'ils pourraient tenter de miser une misère d'espoir sur la balance de leur destin ébréché.
Décroché de la vie réelle. L' appétence rimbaldienne n'est pas son fort. Au mieux elle est derrière lui. Entassée dans des cartons. Qui ne contiennent pas grand-chose. Mais enfin c'est déjà ça. A appris à survivre en se contentant de peu. Pour le présent, n'y croit pas. Fait semblant de. L'important est de participer. Lui, il a tout perdu. Si nous étions psychiatre nous parlerions de dépression. La grande. Pas celle de 29, celle du 45. Un trauma avec antécédents familiaux. Bien écrit. N'empêche qu'il n'a pas écouté les bons disques. Oui je sais, je suis un peu sectaire. Mais je ne me soigne pas.
Damie Chad.
LANGSTON HUGHES
POETE JAZZ, POETE BLUES
FREDERIC SYLVANISE
( ENS Editions / 2009 )

Un livre d'universitaire avec tous les défauts de la langue de bois pédagogique. Ce genre d'individu ne peut voir un poème un poème sans y poser par dessus un étron phatique. C'est ce que l'on appelle un commentaire littéraire. Pas autre chose qu'une vulgaire paraphrase qui consiste à répéter en moins bien ce que l'auteur a exprimé en beaucoup mieux. Contrairement à ce que les lignes précédentes le laisseraient accroire c'est un art difficile. Ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Inutile de se fâcher avec les pontes de votre domaine d'étude : ce sont eux qui possèdent le terrible pouvoir des fourches caudines de la nomination dite par cooptation. Certes l'art du cirage des pompes possède ses titres de noblesse depuis qu'il fut exercé par James Brown, mais il ne faut pas confondre les dures lois de la survie économique avec la prostitution de la pensée.
Frédéric Sylvanise n'échappe pas à cette règle d'airain de la redite obligatoire. L'a encore une chance dans son malheur, c'est que depuis le Seghers de la collection Poète d'Aujourd'hui qui date de 1964, il existe très peu d'ouvrages d'ensemble sur Langston Hughes, il peut donc apporter bien des éléments neufs à un lecteur français. Néanmoins, son ouvrage ne comporte pas moins d'une centaine de pages redondantes et oiseuses. Notamment une introduction à répétition qui est une véritable invitation au suicide.
C'est d'autant plus dommage qu'il se livre à un travail de présentation passionnant. S'intéresse à quatre recueils de l'oeuvre de Hughes, les plus intéressants, les deux premiers et les deux derniers. Dans l'ordre The Weary Blues ( 1926 ), Fine Clothes to the Jew ( 1927 ), Montage of a Dream Deferred ( 1951 ) et Ask your Mama : 12 Moods for Jazz ( 1961). L'en a écrit d'autres, mais Mister Sylvanise privilégie ceux-là, car ils correspondent parfaitement à l'objet de son étude : le rapport de la poésie de Langston Hughes avec la musique. Dans l'intervalle l'œuvre du poète aurait pris une tonalité militante beaucoup plus accentuée. Nous voulons bien le croire, mais le ton très politique des deux dernières ouvrages ne nous paraît guère traduire une inflexion très prononcée de sa trajectoire.
Dommage que Frédéric Sylvanise ait cru bon de gaspiller des années à pondre une thèse pour ensuite travailler à l'adapter en un livre pour public intéressé mais non spécialisé. C'est que son travail est précieux : l'a introduit dans son volume un nombre conséquent de traduction de poèmes de Langston. Avec le texte original à côté. Quand on pense que ces recueils n'ont pas encore été traduits en français, l'on regrette qu'au lieu de ses commentaires par trop inutiles, il ne se soit donné pour but de rendre la poésie de Langston Hughes enfin accessible en notre bel idiome. Surtout qu'il se débrouille bien, qu'il arrive à rendre d'une manière assez fine les altérations argotiques du langage des populations noires.
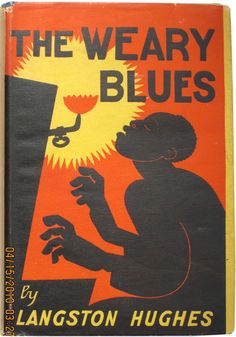
The Weary Blues ( le blues du désespoir ) porte mal son nom, sans être persona non grata, le blues cède la place au jazz, un jazz que nous qualifierons de rythmique, ce pianotement incessant dont le poète s'est servi pour désarticuler la syntaxe anglo-saxonne. N'emploie pas pas le bulldozer, lui préfère les altérations synchroniques du ragtime et du boogie woogie.
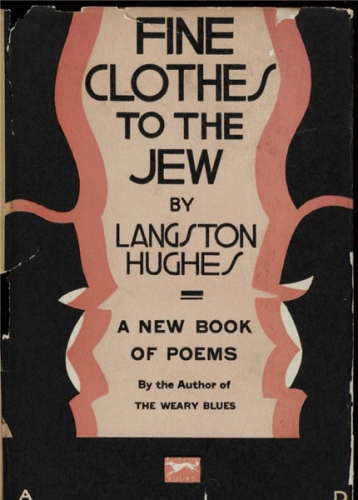
C'est dans le recueil suivant Fine Clothes to the Jews ( que nous transposerions en Beaux Habits de chez ma Tante, afin d'éviter toute attribution d'appétence antisémite à l'auteur, the Jew ne désignant que le Mont-de-Piété ) que le blues foisonne. Sylvanise explique que dans The Weary Blues Hughes évoque le blues issu du Vaudeville – c'est cette altération quelque peu variétalement contaminée qui permit aux chanteuses comme Bessie Smith d'accéder à une large reconnaissance - mais que dans l'oeuvre suivante, il essaie de calquer la structure de ses poèmes sur celle des paroles du blues primitif, folk blues et commando delta. Se perd dans de savantes démonstrations pour établir que tel poème respecte la structure des blues à huit mesures, et tel autre celle des vers à douze mesures. Rien à voir avec le nombre de pieds mais avec la reprise de tel ou tel vers dans les strophes suivantes. Quand on connaît les multiples variations parolières qui existent pour un même morceau de blues... ne contrarions pas notre professeur qui s'accroche si fort à sa théorie.
Le jazz, le blues, tout est parfait, c'est alors que Sylvanise agonise, l'a oublié le troisième couffin. Bordel de Dieu et le gospel, et le negro-spiritual, et les cantiques et les chants au Seigneur, qu'en faire dans tout cette musique profane de mécréants ? Le problème c'est que Langston n'était pas un esprit religieux, alors notre chercheur nous bricole un chapitre intermédiaire dans lequel il essaie de prouver que telle strophe de tel poème correspond au couplet de tel hymne préféré des chapelles noires que notre poète ne pouvait pas ne pas connaître. Perso, je passerai bien un peu de désinfectant Bakounine sur cette partie-là...
Pour les deux recueils suivants, va falloir vous enquiller le concept de modernisme. L'est un peu globuleux, pas bête le Sylvanise prend soin de ne pas le définir. Circonscrivons-le sous une acception rudimentaire de modernisme poétique en le définissant comme toutes les nouvelles formes d'écriture de la poésie après que le dix-neuvième siècle ait cassé en mille morceaux notre bel alexandrin...
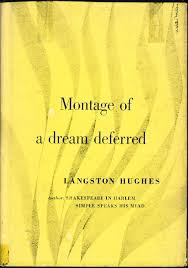
Pour Montage of a Dream Deferred, Langston partage sa page en deux colonnes, la plus grande sur votre gauche, la plus étroite sur votre droite. La première est dévolue au poème proprement dit, la deuxième à son commentaire musical. Sous forme de mots, notations de sons produits par tel ou tel instrument avec force de métaphores filées. C'est un recueil, mais ce n'est qu'un seul et unique poème qui court sur plusieurs pages, avec des thèmes qui s'entrecroisent, qui s'en vont, qui reviennent, le texte fonctionne comme un morceau de Charlie Parker. Un savant montage de points et contrepoints pour expliquer le premier mot du titre.
Pour le Dream Deferred, c'est le fameux rêve americain, l'ameri( yes you )can dream. Mais vu du côté des noirs. C'est pour cela qu'il est différé. Le mot revient avec la constance du leitmotiv wagnérien de l'Or dans la tétralogie. A part que les nègres, l'or ils n'en voient pas la couleur, la reconnaissance, l'égalité, la fin de la misère, l'amélioration des conditions, c'est toujours promis et jamais tenu. Always deferred. L'on sent poindre comme une certaine lassitude.
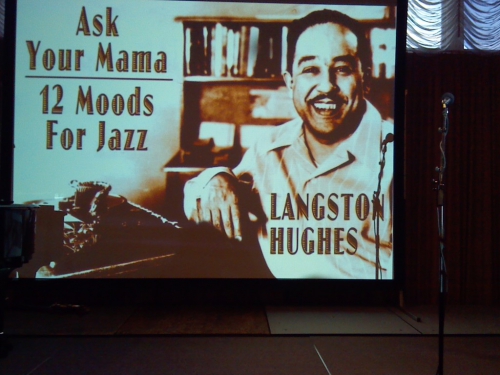
Ask your Mama : 12 Moods for Jazz. Ce n'est pas vingt ans plus tard. Mais dix ans après. Le futur s'accélère. Pour la disposition, c'est la même. C'est la musique qui a changé. Le Be-Bop est passé de mode. La première fois que j'ai lu le titre, j'avais compris douze manières de jouer le jazz. Pour le loto, j'avais les douze bons numéros. J'avais la douzaine, mais pas the dozens. Ce qui change tout. Dozen, c'est le distique que l'on se crache à la gueule lorsque l'on s'invective avec un tiers : du genre petit cul quand tu pètes on ne te vois plus, fais pas le malin – passe ton chemin, mais en beaucoup plus fort, demande à ta mère pourquoi tu ne ressembles pas à ton père. Ask your Mama, c'est un peu l'équivalent de notre Nique ta Mère national... La colère est là. Les temps sont discordants. Comme les accords du free-jazz d'un Ornette Coleman. C'est en ces mêmes années que la notion de Black Power devient opératoire. Plus de rêve, plus de poème, plutôt une coagulation, une coulée de textes qui racontent la naissance de la rage noire partout, en Amérique, en Afrique, avant, maintenant, violence radicale et politique en gestation...
Nous sommes en 1961, le pan-africanisme n'est pas encore la baudruche crevée qu'il deviendra, les temps semblent chauds pour une explication finale. Pour les minorité actives noires Langston Hughes ( qui mourra en 1967 ) est déjà dépassé. Les futurs black panthers en germination misent davantage sur les fusils que sur la poésie... Aujourd'hui après l'échec patent de tous ces mouvements de révolte tiers-mondiste, la figure du poète commence à être réévaluée. Il apparaît de plus en plus qu'il fut le premier à opérer une prise – une cassure - de conscience dans les pans les plus démunis des communautés noires, grâce, très tôt, dès ses premiers poèmes, à ce travail de retrempe de la conscience noire dans l'énergie du blues du désespoir.
Damie Chad.
16:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pil, johnny lydon, amnasty, fallen eight, from a broken stereo, casey, acres, burning down alaska, philippe amelot, langston hughes, frédéric sylvanise
16/03/2016
KR'TNT ! ¤ 273 : ALLEN TOUSSAINT / JEAN-FRANCOIS JACQ / ELVIS CADILLAC / CRASBIRDS / ZINES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 273
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
17 / 03 / 2016
ALLEN TOUSSAINT
JEAN-FRANCOIS JACQ
ELVIS CADILLAC / CRASHBIRDS
ZINES
CACHEZ CE TOUSSAINT QUE
JE NE SAURAIS VOIR
Qui mieux qu’Etta James peut présenter Allen Toussaint, l’un des artistes clés de l’histoire de la musique américaine ?
Etta sortait à peine des pattes de Jerry Wexler avec lequel elle avait enregistré l’énorme «Deep In The Night» quand MCA lui proposa un contrat. Elle fut d’autant plus ravie qu’Allen proposait de produire son prochain album à la Nouvelle Orleans. Ravie, oui, car elle avait une sorte de béguin pour lui. Elle s’installa dans un petit hôtel rococo du Quartier Français et attendit le coup de fil d’Allen. Rien, pas de nouvelles ni dans la soirée ni le lendemain matin. Le lendemain après-midi on lui remit un pli avec une cassette. Dans le petit mot qui accompagnait la cassette, Allen lui disait qu’il allait vite la contacter. Elle connaissait Allen depuis longtemps et elle savait qu’il était à la fois très spirituel, très sexy, même funky, et qu’il avait un goût très fin en matière de vêtements. Elle le savait riche. Il vivait comme un prince - Well if I can be a prima donna, Allen can be Mr Cool - Elle poireauta toute la semaine et commençait à perdre patience - Getting madder by the minute.
Au bar de l’hôtel, elle entendait des rumeurs à propose de soirées, mais les soirées d’Allen étaient toujours privées - Everything about Toussaint was private - Pour la consoler, Allen lui faisait porter de fleurs, des bonbons et des petits mots d’excuse. Son chauffeur venait même la chercher en limousine pour l’emmener dans un restaurant chic où on lui servait les spécialités de la Nouvelle Orleans. Mais au bout de deux semaines, Etta sentit qu’elle commençait à devenir dingue - I was going a little nuts. I still hadn’t laid eyes on Mr. Cool - Puis un soir elle entendit le barman dire qu’Allen était arrivé dans une fête, juste en face de l’hôtel. Au moment où elle arriva, elle vit partir la Rolls d’Allen. Elle sauta dans un taxi et demanda au chauffeur de suivre la Rolls. Ils arrivèrent devant la propriété d’Allen et entrèrent dans le parc à la suite de la Rolls. Allen sortit de sa Rolls et lança : «Etta ! Quel bonheur de te voir !». Mais elle n’était pas d’humeur à badiner : «Arrête ton char, Benhur, faut qu’on cause !». Il la fit entrer chez lui et la conduisit dans son studio. Il y trônait un grand piano à queue. Elle vit qu’il portait des sandales comme Jésus et que ses orteils étaient particulièrement bien soignés. Quand il enleva son veston, elle vit qu’il portait une chemise sur mesure. Il alla au bar et servit deux verres de cognac Louis XIV. Il parla un peu de Jésus, mais Etta n’était pas d’humeur à badiner. Alors Allen s’inquiéta. Il lui demanda la raison de sa colère. C’est là qu’elle explosa - Goddamnit Allen ! - Elle lui reprocha de l’avoir fait poireauter deux semaines dans un hôtel - Who the hell do you think you are ? - Elle l’accusa de ne s’intéresser qu’à son nombril, elle annonça qu’elle avait autre chose à faire et qu’elle en avait marre de ses conneries. Allen qui commençait à chercher des notes au piano l’encouragea à continuer de s’énerver - That’s great ! - Etta devint blanche - What’s great ? - Il lui demanda de continuer à s’énerver toute seule - Don’t stop ! - Mais cette fois il chantait la phrase, et il enchaîna - Don’t stop your teasing - Il composait une chanson sur le tas ! Etta n’en revint pas - The boy wrote a song. A beautiful song - C’est ainsi que Mr Cool prit Miss Prima Donna en main. Elle voyait ses mains courir sur le clavier et elle était bouleversée - I like that groove. I like it a lot. Don’t stop !

Ce cut allait se retrouver sur l’un des plus beaux albums d’Etta James, l’imbattable «Changes» produit par Allen Toussaint.
L’histoire artistique d’Allen Toussaint remonte au tout début des sixties. Joe Banashak cherchait un directeur artistique pour son label Minit. Il fit appel à Harold Battiste qui déclina l’offre mais qui proposa à sa place Allen Toussaint, un jeune pianiste virtuose, timide et réservé, qui avait été découvert par Dave Bartholomew et qui avait déjà joué pour Fats Domino. Allen composait alors à tours de bras et avec la bénédiction de Banashak, il signa sur Minit Irma Thomas et Ernie K-Doe. Bientôt les hits commencèrent à pulluler dans les charts, à commencer par «Ooh Poo Pah Doo» de Jessie Hill, enregistré au studio de Cosimo Matassa. Puis le fameux «Mother-in-law» interprété par Ernie K-Doe - Ernie was very theatrical character - Allen raconte qu’il était jaloux de James Brown. Allen composa aussi des hits fabuleux pour Irma Thomas - Her voice inspired me to write songs. It still does - et Aaron Neville. Puis Minit fut avalé par Imperial, qui fut à son tour avalé par Liberty.

Allen se souvient aussi du bon temps qu’il passa avec Lee Dorsey au Sugar Bowl de Thibodaux, en Louisiane - We would go to clubs, we rode Harley-Davidsons together and we raced Cadillacs. We had a good time - Lee aimait bien chanter des paroles comiques - You could never write ‘Working In The Coal Mine’ for Luther Vandross or Teddy Pendergrass - Allen composait pour Lee Dorsey.
En 1970, il produisit trois albums majeurs : «Yes We Can» de Lee Dorsey, l’album d’Ernie K-Doe et «Toussaint», son premier album solo. En plus, Allen fricotait avec Dr John, Paul Simon et Patti LaBelle.
En 1973, Allen monta le label Sansu avec Marshall Sehorn et en créant le fameux Sea-Saint studio, il prit la suite de Cosimo Matassa et devint le point de mire du New Orleans sound - When Cosimo had to close his studio, we opened Sea-Saint - Comme house band, Allen avait les Meters, un groupe monté par Art Neville - He always had magic - Pour Allen, les Meters n’étaient pas un groupe ordinaire - They were making history - Ils accompagnent d’ailleurs Dr John sur «The Right Place» et «Desitively Boonaroo». Sur Sansu, Allen signa Betty Harris, Benny Spellman et Diamond Joe. Des tas d’Anglais commencèrent à traverser l’Atlantique pour venir enregistrer au Sea-Saint : Robert Palmer, Jess Roden, Frankie Miller - Frankie Miller, I could write forever for him. And he’s not an imitator.
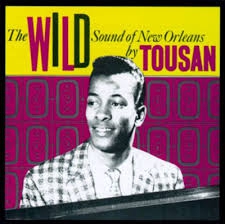
Ses débuts discographiques remontent à 1958, avec «The Wild Sound Of New Orleans». Il se faisait alors appeler Tousan. Il ne jouait que des instros et quelques uns comme «Whirlaway» étaient particulièrement endiablés. Sa virtuosité éclatait à tous les coins de rue.
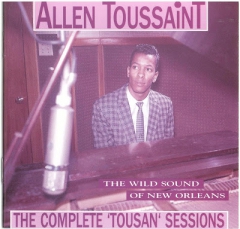
En 1992, Bear Family fit paraître l’intégrale des Tousan Sessions et on retrouvait cette ambiance typique des brass bands de la Nouvelle Orleans, funéraires et joyeux à la fois. S’il fallait en retenir quelques uns, alors ce serait «Nashua», extrêmement emballant, ou «Moo Moo» joué sur un beau thème d’orgue, ou même «A Lazy Day», étrange et doux, joué au petit piano et soufflé au doux du sax. On sentait alors une patte indéniable.

L’affaire se corse avec la parution en 1970 de son premier album «Toussaint», sur Scepter, le label des Shirelles. C’est avec cet album qu’il installe sa légende, car «From A Whisper To A Scream» est ce qu’on appelle une mélodie immédiate. On sent dès l’intro que son groove s’inscrit dans le marbre du temps. Ce n’est pas un groove ordinaire, il s’agit au contraire d’un groove diabolique qui flatte les fusibles, qui va là où aucun doigt ne va, c’est une science de l’intrinsèque qui n’appartient qu’à lui. Avec «Chokin’ Kind», on reste dans le meilleur groove de nonchalance qui soit et on comprend à ce moment-là qu’on a dans les pattes un énorme album. Ce cut est mélodique en diable, visité par des notes de basse de bas de manche, et dans les cœurs on retrouve Venetta Fields qui fut l’une des prestigieuses Ikettes, ainsi que Merry Clayton. Ces deux reines font des merveilles. En bout de face, on tombe sur un «Everything I Do Gonna Be Funky» digne du grand Pops. De l’autre côté, Allen ne propose que des instros, mais c’est du très haut de gamme, comme ce «Cast Your Fate To The Wind» qui est connu comme le loup blanc des steppes ou encore «Number Nine», une merveille universelle.

Au dos de la pochette de «Life Love And Faith» paru en 1972, on nous rappelle qu’Allen adore bricoler sur le 8 pistes de Cosimo et rouler en Harley. Les Meters accompagnent Allen sur ce disque qui sonne forcément très funk. Zig et George sortent le grand jeu. Rappelons qu’il s’agit là de l’une des sections rythmiques les plus légendaires de l’histoire du rock. Et ça swingue dès «Victims of Darkness». On passe à la pure funky motion avec «Am I Expecting Too Much». Si vous voulez danser le jerk du crabe des cocotiers, alors il faut écouter «Goin’ Down», un heavy groove de rock au son mordant, doo doo whap, riffé à la sauce New Orleans, avec un piquant effroyable. Allen semble darder ses rayons jusqu’à l’horizon de tous les mythes. D’autres énormités guettent l’amateur de booty en B, par exemple cet effarant «Soul Sister» - Hey you with the curly bush on your head baby - et les filles qui font Thank you brothah thank you baby - On se régale aussi d’«I’ve Got To Convince Myself» plus poppy, admirablement rythmé à l’épisodique, les instruments interviennent par petites phases successives dans le respect du swing. On pense à Pops, bien sûr. Oh et puis ce «Gone Too Far» et sa belle partie de guitare ! Allen termine ce fantastique album avec «Electricity». Il branche sa mélodie sur le groove et ça prend des allures de hit interplanétaire. C’est joué au pouet de George Porter, et derrière ça gicle à coups de demi-mesures et de Hey qui rappellent les Four Tops.
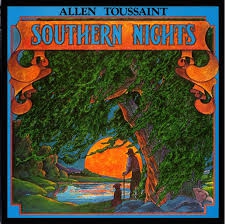
«Southern Nights» est un album clé pour deux raisons. Pour sa pochette d’abord qui évoque cette paix à laquelle Allen enfant fut habitué. Grâce à ses parents, il put goûter aux bienfaits du paradis et c’est précisément ce qu’il raconte dans le morceau titre qui est de la magie pure. C’est presque exotique, au sens où Jean Gabin parle de la Chine dans «Un Singe En Hiver». Il semble que la mélodie s’inspire involontairement du «Honey Pie» des Beatles. Bizarrement, le cut suivant qui s’appelle «You Will Not Lose» sonne comme un cut des Beatles. On retrouve bien évidemment les Meters sur ce bel album. De vieux relents de Congo Square remontent dans «Worldwide» et cette incroyable pièce de funk qu’est «Country John» est emmenée en balade par l’autre fou, George Porter. On sent ces corrélations nouvelles et affreusement modernistes. On se régalera aussi de «Basic Lady», un r’n’b bien senti et alerte, avec, serti dans la fin de cut, le thème mélodique de «Southern Nights». Mais tout est irrésistible sur ce disque. Un cut comme «When The Party’s Over» n’a l’air de rien comme ça avec son émincé de groove de bonne guerre, mais quand on a des musiciens d’exception au cul du beat, ça change la mise, Arthémise.
Dernier album de l’âge d’or, voilà «Motion» paru en 1978 et produit par Jerry Wexler. Allen attaque avec le «Night People» qu’il avait composé pour Lee Dorsey, un funky strut effectif. On retrouve Etta james et Bonnie Raitt dans les backing ! Elles font des hanging out extraordinaires ! Avec «Lover Of Love», Allen fait de la pop de soul et chante avec une finesse de ton sucré. Il laisse planer le doute sur ses syllabes. Si on apprécie le groove de satin jaune, alors il faut écouter «To Be With You» - You are the beauty that catches every eye yeah yeah - C’est violonné comme dans un rêve. En B, il revient à la funky motion avec «Viva La Money», bien épaulé par Etta et Bonnie, alors attention, c’est le cut des rêves les plus fous. Allen joue les charmeurs avec «Declaration of Love», revient à la pop de soul cuivrée avec «Happiness», où il frôle de Stevie Wonder et termine avec un chef-d’œuvre de good time music intitulé «The Optimism Blues», accompagné par l’immense Venetta Fields.
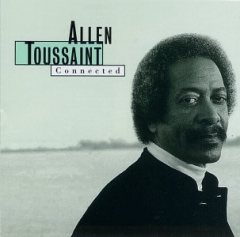
«Connected» paru en 1996 reste un album solide, qu’il démarre avec de la good time music d’élégance suprême, «Pure Uncut Love». Le hit de l’album est probablement «Funky Bars», un instro digne des Meters. Il tape dans ses compos célèbres comme «Get Out Of My Life Woman», dont Lee Doesey avait fait un hit. Le morceau titre est lui aussi très pimpant. Allen s’amuse bien avec son histoire de connection. Son «Aign Nyee» est assez africain dans l’esprit. Il fait de la cosmic Africana, comme Taj Mahal. Il chante «In Your Love» à l’extrême délicatesse du bonheur de vivre à la Nouvelle Orleans. Il chinoise son effet mélodique dans un souci de raffinement complaisant de bonne guerre mais aussi de bonne augure. S’ensuit un nouvel instro, «All Of It», solide comme le phare du bout du monde et on tombe ensuite sur une merveille absolue, «Wrong Number» - Everytime my telephone rings/ I’m scared to death - C’est un slowah de charme extrême qu’il chante d’une voix luisante de mille promesses. Les filles qui l’appellent sont des filles qui se trompent de numéro, alors Allen répond «wrong number, sorry goodbye». Il fait les Drifters à lui tout seul. Imparable.
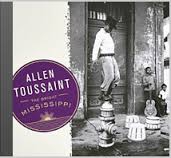
«The Bright Mississippi» paru en 2009 est un album étrangement calme. Comme par hasard, le morceau titre est une compo de Monk. Allen revient aux sources du jazz New Orleans («Egyptian Fantasy», «Singing The Blues») et à St James («Dear Old Southland»). Avec «West End Blues», on est dans un autre monde, le retour aux sources du jazz américain, mais le jazz de blues. C’est toute la mélancolie d’une autre époque, une musique à la fois languide et funéraire. C’est terrible. On sent le Quartier français dans «Blue Drag», c’est sacrément velouté et joué dans un esprit de mystère complet, pas loin de ce que fait David Lynch quand il touche à la Nouvelle Orleans. Il faut aussi entendre «Just A Closer Walk With Thee», qui sent la nostalgie, grâce à la clarinette magique. Oh, il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Avec le morceau titre, il va au tatapoum du rempart, c’est du gumbo de fanfare ! Incroyable, c’est chatoyant et plein comme un œuf. C’est joué à l’ancienne dans le foutraque de beat de grosse caisse. Tout simplement incroyable ! On retrouve le jazz de trompette bouchée à l’émeri dans «Day Dream» et on tombe plus loin sur un «Solitude» gratté aux notes millésimées. Il laisse le jeu se faire dans la lumière du soir, comme au temps béni des Southern Nights. C’est une sorte de magie qui n’existe nulle pat ailleurs. Allen pianote dans l’atmosphère délibérée d’un gratté d’éparpillement. C’est unique dans l’histoire de l’éparpillement. Il redit à travers ça qu’il a tout son temps, même si la mort approche, mais au fond ce n’est pas si grave, car de toute façon les notes coulent comme des gouttes d’or dans le groove des dieux du paradis. Allen le saint joue avec un certain Marc Ribot qui gratte sa gratte au paradis de la flibuste, loin, là-bas au large de tout, dans l’univers des rivières de diamant. On peut seulement rêver, car ce monde n’est pas le nôtre.
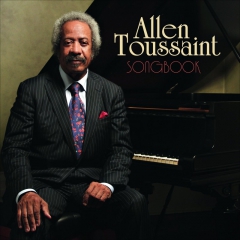
«Songbook» fait nécessairement partie des disques de l’île déserte. On y entend Allen créer les conditions de l’intimisme avec des chansons intemporelles, comme ce «It’s Raining» qu’il composa pour Irma Thomas en 1962. On retrouve des traces de Coal Mine dans l’excellent «Who’s Gonna Help Brother Get Further» et la fameuse soft shoe approach dans «Holy Cow». Belle expression, tant il est vrai qu’on peut marcher sur des œufs élégamment. On retrouve aussi le fantastique balladif «Freedom For The Stallion» que tout le monde a repris, de Lee Dorsey à Boz Scaggs en passant par Three Dog Night. Avec «St James Infirmary», on retombe dans le funéraire joyeux qui colle si bien à la Nouvelle Orleans et l’admirable petit groove de «Soul Sister». Tout aussi magnifique, voilà «Old Records» chanté en duo avec Irma. Il fait un festival de cajun avec «I Could Eat Crawfish Everyday» - laissez bon temps rouler, I could eat crawfish everey day - Pure magie de la Nouvelle Orleans, telle que la décrit aussi Dr John dans son album «Gumbo». Il rend ensuite un hommage vibrant à New York avec «There’s No Place Like New York». Notons au passage que sur la pochette, Allen est sapé comme un prince, et sur une autre photo, à l’intérieur de la pochette, il pose le pied sur le pare-choc de sa Rolls pour bien nous montrer qu’il porte toujours des sandales, comme au temps béni de l’épisode Etta James, dans le Quartier français. Et là on arrive à une sorte de chef-d’œuvre qui franchement dépasse tout ce qu’on peut imaginer : une version longue de «Southern Nights», où il relate dans le détail son idyllic childhood spent in the Louisiana country side. Il parle plusieurs langues, il évoque sa mère Noami Neville, my father Clarence, et il revient sur the spirit of the song. - It’s like a movie for me, a story of what happened when I was 6 or 7 - C’est hallucinant - Hank you - Good Lord, écoutez cette version car comme Marvin dans «What’s Going On» ou Monk dans «Crepuscule With Nellie», Allen Toussaint y sonne comme Dieu.

Attention, il faut prendre les compiles qui le concernent très au sérieux, à commencer par l’indispensable «A Bit Of New Orleans» paru sur NYNO Records en 1998. Allen y fait deux brèves apparitions, et il laisse le champ libre à d’incroyables artistes. On se croirait revenu au temps de la pétaudière de Cosimo Matassa. On tombe rapidement sur un nommé James Andrews et son «Got Me A New Love Thing». C’est du gras de la Nouvelle Orleans, un fabuleux chanteur et des chœurs de mecs à la traîne. Voilà un cut pris à la meilleure décontracte du monde et le solo de trompette vient encore repousser les frontières de l’admirabilité des choses ! Wow, les chœurs sont une véritable bénédiction. Ce qui suit est encore pire : Raymond Myles avec «Jesus Is The Baddest Man In Town». Voilà le gospel des enfers, la pure démence de la latence. C’est certainement le plus gros coup de gospel batch qu’on ait entendu ici bas, c’est équivalent à l’énergie d’une armée qui monte à l’assaut des remparts ennemis, oui, car le gospel de Raymond explose la nef et la voûte et tout le saint-frusquin. Et voilà Raymond qui entre dans le groove comme un empereur sur son char, et il chante à la perfe démoniaque. Au dessus ? Rien ! Il incarne le firmament ! On assiste là à l’écrasante victoire de la beauté pure et soudain une folle arrive pour chanter à l’arrache, alors ça explose de plus belle dans l’église, comme chez Aretha. Il n’existe rien de plus spectaculaire que le gospel batch. Raymond chante au feeling pur comme Marvin. Il remonte le flux à contre-courant et fulgure pour l’éternité. On tombe plus loin sur un fabuleux coup de r’n’b, Larry Hamilton avec «Black Hub». Il chante ça sous le boisseau et ça tourne aussitôt à l’énormité, dans les règles de l’art avec des filles qui font a-ahhh, ah-ahhh et des ohh qui en disent long sur l’élasticité groovitale. C’est à se damner. On entend plus loin un certain Wallace Johnson jouer comme Albert Collins, et le New Birth Brass Band tape «Smoke That Fire» au cha-cha-cha africain. Encore une perle de r’n’b avec Oliver Morgan et son «It’s All About You», un cut digne des hits de Rufus Thomas, mais en plus énorme, et chanté à la vraie voix, comme si c’était possible. Accompagné par Tricia Boutté, Allen Toussaint referme la marche avec «Sweet Dreams», pure merveille romantique montée sur l’une de ces mélodies dont il a le secret. Il va toujours chercher des grooves incroyablement purs.
En 2007, Ace/Kent a publié une belle compile intitulée «What Is Success (The Scepter And Bell Recordings)». On y retrouve le premier album d’Allen paru sur Scepter et tous ces singles qu’on ne peut plus acheter dans les Monoprix comme avant. On le sait, Allen vise systématiquement l’élongation maximale du groove et pas mal de morceaux sonnent comme ceux de Leon Russell qu’on entendait à l’époque. On retrouve même des petits échos du Midnight Rambler de Stones dans «From A Whisper To A Scream». On retrouve aussi le fabuleux «Number Nine», un instro de rêve, mélodique et enjoué. Et plus loin une version chaude de «Working In The Coal Mine» où Venetta Fields et Merry Clayon font des ravages. Encore un groove de rêve avec «I’ve Got That Feeling Now» et trouve vers la fin une version dynamique de «Tequila» jouée aux congas et au piano.
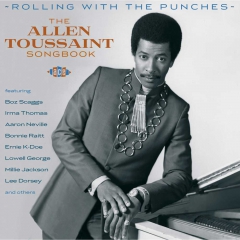
Fantastique compile aussi que ce «Rolling With The Punches. The Allen Toussaint Songbook» paru chez Ace récemment. On y entend chanter la crème de la crème de la Nouvelle Orleans. À commencer par Ernie K Doe avec «Here Come The Girls» qui sonne comme l’une des pires pépites de juke qu’il soit donné d’entendre ici bas. C’est battu au tambour militaire et Ernie chante avec tout le pathos des Temptations. Sacré Ernie, c’est un cadeau. Et puis voilà Boz Scaggs qui chante lui aussi comme les Temptations. Quel sacré groover ! Avec «Hercules», on voit bien qu’il raffole de cette soul magique. Notre bonne Bonnie s’y met aussi. Avec «What Is Succcess», elle groove comme tous les saints du paradis. Lee Dorsey est bien entendu celui qu’il faut suivre en priorité. C’est lui la bête. La preuve ? «Occapella». Aaron Neville chante toujours comme un ange et on retrouve le génie interprétatif de Don Covay avec «Everything I Do Gonh Be Funky». Il sait indéniablement booster le booty, c’est un prince et il s’appuie sur l’un des plus beaux beats de tous les temps. On reste chez les géants de cette scène avec les Meters et «Ride Your Poney», pur génie, Zingaboo bat comme un diable et George Porter suit au strutting. Allen Toussaint prend «Soul Sister» à la bonne franquette du groove symbolique. C’est véritablement énorme et chargé de tout le feeeling de la terre. Voilà qu’arrive ensuite un autre géant, Solomon Burke, avec «Get Out Of My Life Woman». C’est suivi à coups de trombone. Encore une pure énormité. De toute façon, cette compile est atrocement dense. Tout est bon, là-dessus. D’autres immenses interprètes comme Irma Thomas, Frankie Miller et les Pointer Sisters suivent. Et puis on tombe sur une pure pépite de juke : «Fortune Teller» par Benny Spellman. Un merveilleux groove de mambo joué au plus profond du pathos des Caraïbes et complètement secoué au sableur. Bill Medley des Righteous Brothers prend «Freedom For The Stallion» au plus profond de son baryton et Robert Palmer secoue les cocotiers avec «Sneakin Sally Thru The Alley», accompagné bien sûr par les Meters. Maria Muldaur fait un carton avec «Brickyard Blues». Elle dispose d’une vraie voix et elle prend tout de suite le cut à la bonne hauteur. Elle chante avec un chien épouvantable. Elle est sans aucun doute la Honky Tonk woman de rêve. Lowell George chante lui aussi d’une belle voix d’écorché vif. Quand on entend «What Do You Want The Girl To Do», il sonnerait presque comme un smooth black dandy. Ça donne une pure merveille de luminosité et d’incitation au rêve de groove. Finalement, ces trois blancs (Lowell, Boz et Frankie) s’en sortent avec les honneurs, mais des trois, c’est Lowell le meilleur. Il embarque son truc très haut dans les contreforts épidermiques. Dans son interview de 2014 pour Uncut, Allen rend un vibrant hommage à Lowell George - Lowell George was one of the hippest guys I met in my life - Allen dit qu’il était encore jeune et qu’il avait la philosophie et la maturité d’un vieil homme. Allen adorait sa fréquentation. S’ensuit «I’ll Be Rolling» par Millie Jackon. On sent la présence d’une voix prégnante et on retrouve la suprématie de la grandeur millique. Quelle immense chanteuse ! Lee Dorsey revient faire un tour de «Holy Cow» et Glen Campbell ferme la marche avec une version de «Southern Nights». Il en fait de la good time music et ce sera l’un de ses seuls hits en 50 ans de carrière. Ça sonne comme un cut de l’Album Blanc des Beatles. L’ombre de «Honey Pie» repasse. C’est la même chose.
Signé : Cazengler Toussaint glin-glin..
Tousan. The Wild Sound Of New Orleans. RCA 1958
Allen Toussaint. Toussaint. Scepter Records 1970
Allen Toussaint. Life Love And Faith. WEA 1972
Allen Toussaint. Southern Nights. Reprise Records 1975
Allen Toussaint. Motion. Warner Bros. Records 1978
Allen Toussaint. Connected. NYNO Records 1996
Allen Toussaint & Friends. A Bit Of New Orleans. NYNO Records 1998
Allen Toussaint. The Bright Mississippi. Nonesuch 2009
Allen Toussaint. Songbook. Rounder Records 2013
Allen Toussaint. What Is Success (The Scepter And Bell Recordings). Kent Records 2007
Allen Toussaint. The Complete Tousan Sessions. Bear Family Records 1992
Rolling With The Punches. The Allen Toussaint Songbook. Ace Records 2012

The Blues Magazine #11. January 2014. In The Right Place by Alice Clark

Uncut #214. July 2014. Allen Toussaint by Richard Williams
FRAGMENTS D'UN AMOUR SUPRÊME
JEAN-FRANCOIS JACQ
( Editions Unicité / 1° Trimestre 2016 )

Déchiré. Déchirant. Un livre dont on ne sort pas intact. De Jean-François Jacq nous avons déjà chroniqué Bijou : Vie et Mort d'un Groupe Passion et deux écrits biographiques intitulés Heurt Limite et Hémorragie à l'Errance, ( in KR'TNT 252 du 22 / 10 / 15 ) deux livres pas particulièrement musicaux mais il est des existences bien plus rock que de nombreux morceaux dûment enregistrés sur disque... Certains naissent avec une cuiller en bois de rose dans la bouche. Poétique manière de dire que de la vie ils ne connaîtront que les épines. Les plus acérées. Faut un sacré courage quand on est mal parti. Désamour des parents et très tôt, la rue, la faim, le froid, le mépris... Très beau quand c'est raconté dans un roman de Dickens, très dérangeant quand c'est un de nos contemporains qui témoigne. A part que ce n'est pas un témoignage. En des conditions sordides Jean-François Jacq a réalisé la grande opération alchimique, il a transformé le plomb de de la souffrance humaine en or poétique. L'emploie des mots qui ne ronronnent pas en de beaux alexandrins alanguis sur les coussins du canapé, sont des chats efflanqués l'échine couverte d'ulcères et de pustules, qui bavent et griffent avant de s'enfoncer dans les ténèbres des nuits les plus noires. Des textes borderline, des pèse-nerfs à la Antonin Artaud, une écriture du corps, écorché et supplicié. Littérature limite.
Fragments d'un Amour Suprême, le troisième tome de la trilogie maudite. L'Amour Suprême, la musique de Coltrane ce souffle divin continu, ce trait de feu qui vous brûle toujours plus profondément et le fantôme de Villiers de L'Isle-Adam, l'auteur des Contes Cruels – tout un programme - qui dormait dans les maisons en construction et faisait office de punching ball vivant dans un cours de boxe... il est des patronages qui ne pardonnent pas. C'est pour cela que certains les méritent.
Le livre se résume en trois lignes. Jean-François Jacq rencontre Daniel, l'amour de sa vie – c'est fou comme, présenté ainsi, cela fait tarte. Vivront un peu moins de six mois ensemble. La récidive du cancer de Daniel mettra un point final à cette histoire. A cette relation. A cette embellie. Pas vraiment joyeux. L'on a envie de passer à autre chose. Triste, mais tout compte-fait, on n'y peut rien. Les arrangements de la lâcheté...
Mais le problème n'est pas là. Réside dans la plaie béante. Celle de la vie. Celle de l'écriture. Attention parfois les mots sont des fils de fer barbelés. Posons le décor : une petite ville de province, peuplée d'ignorance et de bêtise. Crasse intellectuelle et rognures pourrissantes d'affectivités tronquées. Pour les personnages vous connaissez déjà : Daniel et Jean-François. Deux destins parallèles. Deux lignes brisées. Deux miroirs. Daniel n'est qu'un gamin amoché par la vie. Jean-François tout aussi cabossé mais qui possède sa niche écologique de survie aléatoire. Difficile de faire avec moins.
Manque une ombre au tableau. La misère. Ce n'est pas une abstraction. Considérez-la comme une matière fécale qui emplit et empuante le monde de nos héros. Très fatigués. Peu fringants. Ne se battent pas pour les beaux yeux des grands principes. Se collètent avec les réalités sordides. Le manque d'argent, le manque d'entregent, le manque de tout. Le manque de rien aussi. N'ont qu'une arme pour se défendre : leur solitude. Le couple primordial reconstitué se suffit à lui-même. N'ont besoin de personne d'autre. L'œuf cosmique originel terminera en omelette tragique.
Descente aux Enfers. Dantesque. La pauvreté ne réside pas uniquement dans le bas de laine percé de nos économies. L'a ses quartiers dans la tête des gens. Que ce soit celle du lumpen-prolétariat, ou celle de l'élite de la nation. Dans les deux cas, c'est à hurler. L'envie de s'emparer d'un fusil et de tirer dans le tas. Mais en faisant attention à ne pas rater la cible. Cela ne règle pas les problèmes mais vous aurez l'excuse d'avoir été emporté par vos impressions de lecture. La suffisance est partout, que ce soit dans le quart-monde ou dans le staff supérieur des services hospitaliers. L'est généreux, notre auteur, ne le dit jamais explicitement, ne tombe pas dans le piège de la dénonciation sociologique. Reste au plus près de l'os de l'amour. la misère attire les vautours voraces qui se nourrissent de votre chair sanguinolente. Les aigles royaux aussi, qui vous conchient sur la gueule uniquement parce que vous faites partie des misérables.
Pauvres amants, il ne leur reste que quelques parcelles de bonheur volées au temps qui fuit, à la mort inexorable qui s'avance. Rares fragmences, dans ce torrent de boue qui coule et emporte tout au fond de la tombe. Fermez les yeux, écarquillez-les, cela ne changera rien à l'affaire.
Deux individus emportés comme des fétus de paille, pris dans une logique existentielle qui les dépasse. Une histoire individuelle, personnelle qui ne regarde qu'eux. L'écriture de Jean-François Jacq agit comme un révélateur. C'est la cruauté de notre société qui est mise en exergue. Dans toutes ses strates. Dans son fonctionnement intime. Effet de loupe grossissante sur la laideur du monde. Ces Fragments d'un Amour Suprême sont destructifs. Ne laissent qu'un champ de ruines. Après leur lecture vous ne pouvez plus croire en l'opérativité efficiente de la rédemption amoureuse. Quant au réconfort que pourrait vous apporter la collectivité, vous comprenez vite que ce n'est qu'un leurre, un mythe, une consolation pour les esprits calibrés des midinettes. L'innocent, le faible, le fragile sont condamnés. Sont étouffés par le nœud de serpents qui leur sert de matrice. C'est ce qui vous a enfanté qui vous tue. Lentement, mais sûrement.
Une romance avec paroles de colère en sourdine, vieille d'un tiers de siècle. Jean-François Jacq a survécu. Sans mélo. Avec fierté et dignité. Car ce qui vous tue, vous rend aussi plus fort. L'urne funéraire de Daniel repose dans son colombarium. Mais le mélange est hybride, des deux côtés de la pierre tombale. Un peu de l'un et un peu de l'autre. Daniel se promène encore dans notre monde porté comme un fœtus de vie palpitante dans la tête de Jean-François Jacq, et ce dernier possède un fragment de lui, entièrement mort, en résidence perpétuelle dans les cendres du néant. Ces Fragments d'un Amour Suprême, sont et d'outre-tombe, et d'outre-vie. Ne sont pas un simple livre mais un objet auréolé de néant posé comme un bibelot animé sur les crédences de nos existences. Transmutation métaphysique de la physique des corps. Réalisation orphique.
Âmes insensibles s'abstenir, vous y perdriez votre sérénité.
Un grand livre.
Damie Chad.
ELVIS CADILLAC
KING FROM CHARLEROI
NADINE MONFILS
( Editions fleuve / Mars 2016 )
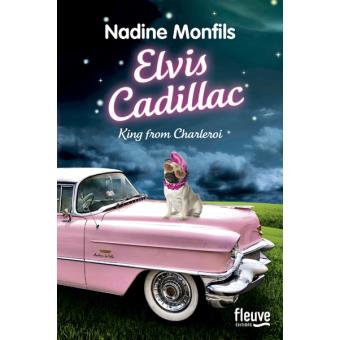
Elle a la frite et elle est belge. Nadine Monfils a déjà publié une trentaine de romans. Sa bibliographie fait rêver : un Nickel Blues en 2013, Contes pour Petites Filles Perverses en 2005 aux éditions de La Musardine – signe de qualité puisqu'ils publient les textes érotiques de Pierre Louÿs – et sa série aux titres désopilants Mémé Cornemuse. Rien qu'à ce court énoncé, vous l'avez compris elle n'écrit pas des bouquins dans lesquels on s'ennuie. Et puis les rockers c'est comme les chiens de Pavlov, vous mettez Elvis dans le titre et une cadillac rose sur la couverture, ils sortent leur porte monnaie sans réfléchir une nano seconde. Tout juste s'ils ne lèvent pas la patte sur les jantes de la berline pour marquer d'un pis appropriateur leur contentement.
Ne peux pas vous résumer l'intrigue, ce serait gâcher votre plaisir. Ne vous donne que le strict minimum : l'anniversaire d'Olivia octogénaire, la réunion d'un panier de crabes, pardon je voulais dire d'une famille, en fait comme ils sont friqués ce serait plutôt des langoustes - qui tourne mal. Pour la parenté, car pour le lecteur c'est la franche rigolade. Je vous rassure le récit est très moral, les bons se récompensent eux-mêmes et les méchants sont punis par là où ils pêchent. Ne vous réjouissez pas trop vite, une fois le bouquin refermé vous vous dites que Nadine Monfils ne partage pas une vision très optimiste quant à l'état de notre société. Ne répondez pas que vous aussi, vous pensez que blablabla, blablabla... Ce n'est que le premier étage de la fusée. La communauté humaine n'est que les ramassis de la totalité des individualités. Et si le niveau ne s'élève pas bien haut selon notre auteur c'est que les unités qui la composent ne pèsent pas lourd. Développe une vision de l'individu plutôt noire, le truc à faire passer Le Monde comme Volonté et Représentation de Schopenhauer pour le prospectus de vos prochaines vacances sur une île paradisiaque du Club Méditerranée.
Vous vous en moquez, ce qui vous intéresse, c'est la Cadillac. Elle n'est pas à vendre. Son propriétaire y tient comme à la prunelle de ses yeux. Normal, c'est un rocker. Un vrai. Un pur. Tout petit il a été traumatisé. Pas parce que sa mère l'a abandonné dans un restaurant. Une petite misère de la vie, le genre d'évènement qui ne vous empêche pas un jour d'entendre un bon disque d'Elvis Presley. N'en faut pas plus pour orienter une vie. Le petit Elvis, réalisera son rêve, deviendra le King de Charleroi. Le Presley local, le Pelvis du pauvre. Fait partie de ces personnages que l'on n'aime guère. Au mieux, on les plaint, l'on s'apitoie sur leur déficit de personnalité. On explique leur regrettable travers avec les fumeuses théories de Tonton Sigmund... Au final l'on préfère en rire, s'en moquer, s'en gausser. Une façon d'évacuer la gêne que le fan ressent devant ces caricatures, non pas de ses idole, mais de lui-même. Le sosie n'est peut-être pas un misérable clone, une grossière décalcomanie d'un rêve inatteignable. Pourquoi ne serait-il pas une suprême forme d'appropriation, une incarnation christique faite homme ? Si le ridicule – entendez par ce mot le rire jaune des imbéciles qui ont peur de ne plus être leur propre nullité - ne tuait pas, le monde serait vraisemblablement peuplé de millions d'Elvis.
En tout cas, l'Elvis de Nadine Monfils ne se prend pas pour Presley. Connaît ses limites. N'est pas Elvis, n'est pas sa réincarnation, n'est pas son imitation, l'est simplement un gars qui vit sa vie selon son idole. Point à la ligne. Chacun son rôle, certains sont électriciens, d'autres docteurs en physique nucléaire, ou gardienne d'immeuble, lui l'est un gars qui n'a rien trouvé de mieux que d'être l'Elvis de Charleroi. Ne se prend pas pour dieu le père. N'en a ni la voix, ni le physique. Anime les mariages, les communions et les enterrements. N'en veut pas davantage. Son appart, sa chienne, sa Cadillac, bouffer et croûter tous les jours, que voulez-vous de plus ? Se contente de peu, mais possède l'essentiel. Et peut-être même l'absolu.
Si Nadine Monfils avait voulu écrire une thèse, sans doute l'aurait-elle intitulée : Défense et Illustration du Sosie, et se serait-elle enfoncée dans de sordides développements psycho-sociologiques que personne n'aurait jamais lus – surtout pas les membres avachis de son jury de thèse qui lui auraient attribué son titre de docteur... car connaissant la vie universitaire elle n'aurait pas oublié de leur faire à chacun une petite pipe en bois de bite molle avant la remise du prix. Mais c'eût été moins désopilant pour nous pauvres lecteurs privés de gâterie. Je parle du roman, bande de saguoins aux idées mal / bien ( rayez la mention inutile ) placées. De toutes les manières Elvis a suscité dans la littérature mondiale nombre de romans phantasmatiques. Vous pouvez poser celui-ci sur la dessus de la pile.
Damie Chad.
LIVE IN DEAD CITY
CRASHBIRDS
BLACK THURSDAY / STEAMROLLER / NO LEFT NO RIGHT / DEAD CITY / I WANT TO KILL YOU / NO FUN FOR PUNKS / HARD JOB / A PERFECT WORLD / THE LIONS / NEON BAR / SOMEONE TO HATE / MONEY / SPANISH BLUES.
Vocals & Rhythm Guitar : DELPHINE VIANE / Lead Guitar & Crashbox : PIERRE LEHOULIER.
Production : Crash Association. Enregistré live en mars 2015.
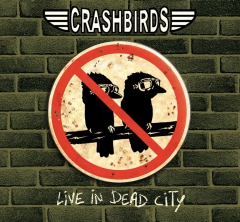
Magnifique pochette. Deux pauvres corbeaux sur leur branche, interdits de villégiature dans la Cité Morte. Mur de briques impitoyable à l'arrière. Votre âme apitoyée compose déjà le numéro de la SPA ornithologique que vous remarquez les grosses lunettes de motard qu' arborent nos corbacks perchés. La donne change. Les deux petits malheureux zoziaux transis de froid que personne n'aime se parent du farouche statut des asociaux, des guerriers urbains, des résistants de l'ultime heure qui s'obstinent à squatter les espaces interdits de la civilisation occidentale agonisante. Une belle métaphore de la survie du rock and roll en nos sociétés déchiquetées par le profit.
Tout cela révélé par le seul logo du groupe. Moins célèbre que la langue des Stones mais tout aussi efficace. Les Crashbirds le déclinent aussi sur leurs affiches et flyers de concerts. Une parfaite réussite : rien qu'en voyant le logo vous entendez le groupe. Un totem.
Black Thursday : guitares grondantes qui bousculent le son, la voix de Delphine Viane qui plane comme un écho menaçant au-dessus du désastre. Une intro comme on les aime sonnante et trébuchante. C'est nous qui tombons. Steamroller : Delphine allume le feu, un binaire appuyé qui martèle la cadence, elle chante comme on jette du sel sur les épaules de suppliciés, et sur la fin la guitare de Pierre Lehoulier se taille de vaste espaces cisaillés de ferrailles cadencées. No Left No Right : la guitare qui sonne comme une charge de cavalerie, la crash box qui martèle le pas des chevaux, Delphine crie d'exaltation et d'exultation, séquences rythmiques qui se suivent et s'emmêlent comme une couronne d'épines. Dead City : morceau titre, balancé à outrance, saturé de guitares et la voix de Delphine mène et accentue la transe. Solitude des grandes cités lovecraftiennes abandonnées au milieu des déserts interdits, la menace qui rampe partout, qu'il faut combattre quand elle vous saute à la gorge. Infâmes gargouillis de guitares. Parfois la vie est une erreur. Abominable délectation. I Want to Kill You : une chanson d'amour qui tue, un blues de mort, réveil au petit matin blême, cette envie de sang qui vous prend, faut l'étancher dans les flaques d'hémoglobine du premier venu, comme du dernier arrivé, votre vie est un hall de gare, envie folle de délivrer un billet pour l'au-delà... Pierre pave le chemin de toutes les bonnes raisons de vos mauvaises intentions et Delphine s'introduit en vous comme la lame transperçante du couteau. Si ma guitare était un fusil chantaient autrefois les folkleux, ne croyaient pas si bien dire. No Fun For Punk : pas de pitié. Le titre précédent le laissait présager. Pierre abat les riffs comme des coups de hache. Delphine s'est muée en l'essaim d'abeilles tueuses qui obscurcit votre esprit et vous poursuit dans vos derniers retranchements. Delphine au volant, hystérique qui hurle par la fenêtre ouverte et Pierre qui klaxonne pour vous avertir qu'ils vont vous écraser. Hard Job : dur travail, les guitares furieuses s'en donnent à cœur joie, parfois elles se taisent et puis reviennent en trombe bientôt épaulées par Delphine qui vous assène ses lyrics comme l'on maudit la vie dans les rituels vaudous. Le cri du coq qu'on égorge, et le tam-tam de la guitare de Pierre qui massacre à la tronçonneuse tout ce qui dépasse autour. C'est ça le rock and roll. A Perfect World : un velouté de guitare juste pour le début, Delphine pose trop de questions pour que le jour se termine aussi bien que le titre l'annonce. La beauté féline du tigre n'a jamais bridé sa cruauté. Ici tout n'est que crime, lucre et volupté. Pierre déroule des arpèges ensorceleurs. L'idée du paradis est une histoire qui a mal fini. Ne soyez pas dupes. Neon Bar : encore une sombre histoire. Fiez-vous à la voix de la prêtresse delphique pour vous y retrouver. Vous montre le chemin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or mais c'est ainsi que l'on apprend la vie, à grands coups de guitares sur la gueule. The Lions : sont lâchés dans l'arène. Spectacle flamboyant et néronien. Delphine reprend la main. De fer. Balaie tout devant elle. Chante comme une déesse et les méchantes bestioles soumises et subjuguées lui lèchent les santiags. Someone to Hate : du solide dans ce monde de brutes, une branche à laquelle se raccrocher, tant que vous avez quelque chose à haïr vous savez que votre vie a enfin un but. Comme par hasard le rythme s'accélère, tout le monde est pressé de trouver son destin et de le coincer dans la ruelle la plus sombre des désirs inavouables. Money : l'argent, Delphine miaule après le manque et Pierre écrase ses frustrations à grands coups de guitares, un peu comme quand vous brisez les devantures de banque pour vous servir. Z'ont dû ouvrir un coffre aux pépites d'or car la suite est un joyeux charivari. Aux petits oiseaux les mains pleines. Musique amorale. Spanish Blues : il y a bien comme un air de fandango qui traîne par le fond, mais l'on est bien plus près de guitares qui pleurent le rock and roll et qui déferlent le blues. A elle toute seule Delphine se charge des chœurs rupestres, lamentations sauvages et hurlements psalmodiés, du scat-rock de belle facture. Vous laissent exsangues.
Un disque rempli à ras bord de bruit et de fureur. Direct live. Débordant d'énergie et de violence crûe. Des guitares à manger les murs, et une voix à scalper les voisins. Rien à jeter. Pas un morceau au-dessous du niveau de l'océan en furie. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'aimez pas le rock and roll.
Damie Chad.
ZINES / TU VERRAS
( Trailer et vidéo sur YouTube / Février 2016 )
Certains l'affirment, le rap ne serait que l'ultime métamorphose du blues. Cela se défend. Surtout vu de l'Amérique. Le Delta finissant par se jeter dans la mer du ghetto. Oui mais par ici, nous sommes loin de Chicago ou de New York. N'empêche que depuis plus de vingt ans le rap s'est installé dans nos banlieues. Puis un peu partout. Sur les ondes, dans la mode, par la danse. L'est apparu comme un cri de rage et de révolte, puis l'a été doucement grignoté par le milieu ambiant. Douce France au climat tempéré. S'est assagi, s'est adouci, s'est acclimaté. Pas la peine de hennir de rire, suffit de voir la distance idéologique qui sépare les groupes de danse country de la génération américaine des Outlaws pour se dire que personne n'est à l'abri de telles mésaventures. Ce n'est qu'un exemple, nous pourrions en citer d'autres plus dérangeants pour un public rock. Doit rester quelques irréductibles dans les caves mais en règle générale sur les média l'on est passé des apels aux meurtres – calqués sur les gangs amerloques – aux désirs d'insertion par le biais de la réussite sociale et musicale... Pris par une soudaine curiosité, m'en suis allé sur YouTube voir et écouter ce qu'y déposent les adolescents d'aujourd'hui. Tout un continent, suffit d'un peu de curiosité. Ne vais pas tout vous raconter parce que je préfère, et de loin, le rock and roll, parce que j'ai choisi Zines.

Zines ( prononcez zainès ), premier morceau, tout chaud, de deux minots de quinze ans. Totalisent près de trois mille écoutes en quelques jours. Enregistré au studio Blackvoice de Sartrouville. D'abord vous saute aux yeux l'objet-vidéo. Beau montage. Suites entrecoupées d'images. Couleur + noir et blanc. Deux décors entremêlés. Lac automnal de banlieue ocre et fond de murs bétonnés tagués de blanc. Deux silhouettes de gamins qui gesticulent. Côte à côte, décalés, en opposition, superposés, ballets d'images virevoltantes. Etrangement c'est le découpage visuel qui rythme le morceau.
Z'ont aussi soigné la bande-son. La musique en arrière, comme un rideau de fond. Ne s'appuient pas sur elle pour déployer leurs lyrics. L'est un peu comme le générique d'un film. Ont simplement essayé de mettre en scène toutes ces heures passées dans les chambres ou les garages à répéter mille fois les gestes vus à la télé et sur le net. C'est cette recherche instinctive de simplicité, ce refus de faire comme les idoles confirmées, de se cantonner à leur seule expérience si jeune, si immature qu'elle soit, qui donne au clip cet aspect de fraîcheur et d'authenticité qui retient l'attention.
Du chant, mais aussi de la danse. Jeux de mains ( mais pas de vilains ) très étudiés. Un véritable ballet d'attitudes et de gestes symboliques. De très courtes séquences qui s'enchaînent et qui se bousculent, les yeux des visionneurs partent en vrille à tenter de se retrouver dans le labyrinthe de cette étonnante scénographie. Utilisent l'alphabet réécrit d'une tectonic extrêmement stylisée dont la fluidité contraste avec les brisures des prises de vue. Ce léger hiatus entre la gestuelle et sa transmission visuelle n'est pas étranger au charme de l'ensemble.
Mais c'est au tournant du flow et aux virages des lyrics que l'on attend le rappeur. Musique qui en a sous le code, qui impose la délimitation d'un ring mental et intellectuel dont il ne faut pas dépasser les cordes. Deux voix encore jeunes, mais qui ne se débrouillent pas mal du tout. Qui surtout évitent de se manger l'une l'autre. Ensemble, seules, ou côte-à-côte, chacune garde son tempo sans chercher à se cannibaliser. Frères mais pas ennemis. Interventions vocales mais pas punitives.
Pour les paroles, l'on est loin des messages de haine et de rébellion. Des rêves d'ados qui ont envie de devenir connus. De s'évader de leur quotidien morose de lycéen et de collégien. Auprès de leurs pairs et plus si affinités. Avec un arrière-fond, de mauvaise conscience, une interrogation sur l'efficience du rap actuel. Essaient de se situer par rapport aux cadors du moment. Existentiellement, entre Justin Bieber et Mesrine, la route est large. Même s'ils n'entrevoient pas vers où elle mène.
Faudra suivre ce qu'ils feront par la suite. Leur trajet risque d'être symbolique de toute une génération.
Damie Chad.