29/05/2014
KR'TNT ! ¤ 191 : MARTHA REEVES / JALLIES / LOREANN' / CAPTAIN BEEFHEART
KR'TNT ! ¤ 191
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
30 / 05 / 2014
|
MARTHA REEVES ( + VANDELLAS ) / JALLIES / LOREANN' / CAPTAIN BEEFHEART |
NEW MORNING / O7 - 05 - 14
MARTHA REEVES & THE VANDELLAS
MARTHA MY DEAR

Il fut un temps béni où Berry Gordy régnait sur cette planète sans partage. Martha Reeves et les autres reines de la soul dégageaient le passage et les petits blancs dégénérés n’avaient qu’à bien se tenir. Au temps de leur splendeur, Martha Reeves, Rosalind Ashford et Betty Kelley (rapatriée des Velvelettes en 1964 pour remplacer Annette Beard devenue mère de famille) enfilaient les hits comme des perles. L’usine à tubes Tamla Motown tournait à plein régime. Berry Gordy sortait des tubes planétaires à la chaîne. Motor City rumble, baby ! Il inondait littéralement le marché.
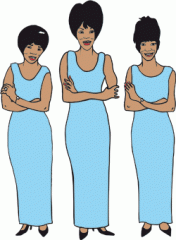
«Dancing In The Street» et «Heat Wave» font partie des plus gros hits de l’histoire du rock. Quand ça démarre, c’est comme «1969» des Stooges, «Gloria» des Them, «Chain Of Fools» d’Aretha, «One Hand Loose» de Charlie Feathers, «Summertime Blues» d’Eddie Cochran ou «The Last Time» des Stones : on se lève et on bouge son cul, parce que c’est impossible de faire autrement. Il faut situer Martha Reeves exactement au même niveau que Jerry Lee : monstres sacrés tous les deux, encore en vie après cinquante ans de bons et loyaux services dans l’une des industries les plus mortifères qui soient, capable de lever un ouragan d’un seul claquement de doigt, et puis on retrouve chez elle comme chez lui cette classe effarante, cette animalité électrique et cette façon de plonger un regard noir dans le vôtre. Martha Reeves était au New Morning par ce beau soir de mai, serrée dans une robe pailletée, et elle plongeait son regard dans celui des petits culs blancs agglutinés à ses pieds. On avait sous les yeux une mémère de 72 ans abîmée par le temps, mais cette femme de haute stature redevint comme par magie la superstar Martha Reeves en attaquant «Ready For Love», le premier morceau d’un set pour le moins dément. Et c’est là où les grands artistes noirs font toute la différence.

Ils dégagent une énergie considérable, plus que n’en dégageront jamais tous les groupes garage réunis. Dès le second morceau, «Come And Get Those Memories», Martha s’essoufflait et transpirait abondamment. Elle secouait un vieux tambourin et s’épongeait le front avec un grand mouchoir de dentelle noire. Entre chaque morceau, elle cuisinait le public et lui racontait des anecdotes. Elle parlait de ses peines de cœur et puis bam, elle attaqua «Nowhere To Run» comme au bon vieux temps, au temps où elle régnait avec ses deux copines Rosalind et Betty sur Detroit, Michigan, et qu’on la filmait sur une chaîne de montage, assise dans un coupé Mustang en cours d’assemblage. Motor City, baby ! Et Martha rallumait l’incendie. Derrière elle, les mercenaires envoyaient la purée Motown. Elle tapait ensuite dans l’un des plus grands hits de tous les temps, «Jimmy Mack», un Jimmy Mack en chair et en os - «Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack/ When are you comin’ back ?/ Oh, Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack» - une leçon de swing épouvantable et Martha semblait légère, elle retrouvait le secret de ses vieux pas de danse. Non seulement elle se révélait l’égale de Jerry Lee, de Marlene Dietrich, de Sister Rosetta Tharpe ou de Nina Simone, mais elle incarnait aussi la magie de la meilleure soul du monde, le Motown Sound - Oh, Jimmy Mack, Jimmy/ Oh, Jimmy Mack - et les petits culs blancs entassés à ses pieds dansaient le jerk comme ils pouvaient. Il n’y avait qu’une seule femme noire, dans le premier rang et quand elle s’est mise à frapper des mains et à se déhancher, elle semblait possédée. Juste derrière nous se trouvait la petite batteuse des Protokids, elle aussi complètement possédée par le démon de la soul. Curieusement, la seule fois où j’ai senti une ambiance comparable d’hystérie collective dans un premier rang, c’était au concert de reformation des Stooges de Ron Asheton au Zénith de la porte de Pantin. Les filles d’un certain âge qui se trouvaient là collées aux rambardes étaient dingues d’Iggy. Elles chantaient toutes les chansons en chœur avec lui. Iggy Pop ? Un autre produit de Detroit, Michigan, comme par hasard.

Et bam, elle ressortait «Honey Chile» des oubliettes, mais sans les violons, et miracle, ça fonctionnait, elle rallumait tous ces vieux brasiers qu’on croyait avalés par Chronos, mais pas du tout, ce r’n’b restait, incarné par elle, d’une mordante actualité. Et un peu plus tard, elle annonçait «Heat Wave» en s’épongeant le visage, et on repartait aussi sec vers le jardin magique de notre adolescence. Les chœurs manquaient cruellement, et Martha le savait, alors elle palliait à ce manque du mieux qu’elle pouvait et faisait grimper ses yeah-yeah-yeah-yeah au firmament de la plus grande soul-music de tous les temps. Ne cherchez pas d’équivalent, ça n’existe pas. On profitait des morceaux plus lents pour l’observer, pour s’abreuver d’images d’elle, et puis - on l’attendait - elle annonça «Dancing In The Street», le hit que tous les groupes du monde ont rêvé d’avoir écrit, mais c’est elle Martha Reeves qui l’a eu dans les pattes et qui en a fait un hit planétaire - «They’re dancing in Chicago/ Down in New Orleans/ Up in New York City/ All we need is music, sweet music/ There’ll be music everywhere/ There’ll be swinging swaying records playing/ Dancing in the street» - et là tout a basculé dans la folie, les dimensions se sont mélangées, Martha Reeves nous a tous emmenés dans la lune, le New Morning a explosé, cette façon qu’elle avait d’appuyer sur le a de Chicago, puis de swinguer son down in New Orleans-up in New York City, et de pousser l’emphase sur le all de all we need, tout ça dépassait et de loin ce qu’on avait l’habitude de voir et d’entendre. On était frappé par l’éclat du génie de cette vieille lionne. Chaque fois qu’on voyait Jerry Lee sur scène, on croyait avoir une révélation du genre mystique et là, c’était à peu près la même chose. Martha Reeves sortait le grand jeu, le plus naturellement du monde.

Il faut désormais s’habituer à l’idée que ces géants et ces géantes de l’âge d’or vont disparaître et qu’il n’y aura malheureusement pas grand monde pour les remplacer. Amen. Et que le diable emporte les wannabees.

Un premier album de Martha & The Vandellas sortit en 1963. «Come And Get These Memories» proposait des belles compos signées Holland Dozier Holland. C’est l’époque de la pop joyeuse. Berry Gordy cherchait à pénétrer le marché des blancs. Rosalind Ashford et Annette Beard accompagnent Martha dans cette aventure. On voit que «Can’t Get Used To Losing You» est de la pop de blancs puisque c’est signé Doc Pomus et Mort Shuman, deux piliers du Brill. Puis on passe au niveau supérieur avec un groove bien balancé de Richard Berry, «Moments». Mais le reste de l’album est un peu mou du genou. L’époque voulait ça.

«Heatwave» est le second album de Martha & the Vandellas. Il s’ouvre évidemment avec le titre phare, la démence dans la tendance, pas de prudence dans l’excellence. En 1963, elle nous rivait déjà le clou, avec son énergie explosive. Les ouh-ouh-ouh sont expédiés au firmament à coups de clap-hands. Martha et ses copines vont chercher tout ça très haut. Elles piaillent comme des moineaux. Encore un coup fumant : «Then He Kissed Me», un fleuron de kitscherie de la pire espèce - I didn’t know just what to do/ So I whispered I love you/ And he said that he loved me too/ And then he kissed me, ce qui veut dire en gros, qu’elle ne savait pas trop quoi faire, alors elle lui a dit qu’elle l’aimait, et il lui a répondu qu’il l’aimait aussi et donc il l’a embrassée. «If I Had A Hammer» est l’une des chansons les plus galvaudées - en France par Cloclo, et ailleurs par Trini Lopez - mais Martha Reeves en fait un vrai truc, de sa voix grasse et pointue. Version fantastique. Ces filles là ne rigolaient pas. Elles se comportaient un peu mieux que les malheureuses petites connes qui osaient chanter devant les caméras françaises. Puis Martha Reeves nous fait le coup du r’n’b joyeux de la providence avec «Wait Till My Bobby Gets Home», orchestré par un big band des enfers. Martha Reeves nous fera danser jusqu’à la mort.
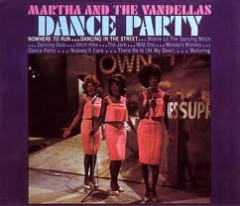
Ça commence vraiment à chauffer avec l’album «Dance Party», paru en 1964. «Wild One» est le prototype du hit Tamla parfait, avec une cymbale devant dans le mix. Alors ça percute et les Vandellas montent comme la marée. Ça pulse des reins avec «Nowhere To Run». La puissance dévastatrice de la ligne de basse restera dans les annales. Ça ne peut être que James Jammerson. D’autres monstruosités en face B : «Mobile Lil The Dancing Witch» (incroyablement funky pour l’époque, modèle du genre, animé de mauvaises intentions), «Dance Party» (un jerk très beau qui ne veut pas dire son nom et on patauge dans l’extrême qualité compositale, c’est orchestré avec un tact surhumain et chanté il faut voir comme), «Motoring» (gros r’n’b à l’ancienne qui roule tout seul, sérieusement gonflé comme un moteur, rythmique adroite et huilée, c’est pianoté dans le fouillis et la basse bat comme un cœur, the heart of soul, la machine Tamla ronfle pour l’éternité), «The Jerk» (embarqué à la bassline et soutenu aux cuivres - c’mon - solo claqué sobrement) et «Hitch Hike» (just perfect).

«Watch Out !» sort en 1966, en plein cœur de l’âge d’or. C’est le trio de choc composé de Martha Reeves, de Rosalind Ashford et de Betty Kelly. Le hit magique de l’album, c’est «I’m Ready For Love», doté d’une pulsation experte à la Supremes et d’une féérie vocale appareillée. Nocturne et excitant. Ce genre de cut nous rend encore plus nostalgiques de cette époque merveilleuse que furent les années soixante. La version de «Jimmy Mack» qui se trouve sur l’album est malheureusement lissée. Pas de basse devant. Rien ! Il faut absolument écouter la version remastérisée si on veut entendre le travail fabuleux de James Jammerson. On se régalera de «Let This Day Be», une pop song de haut rang montée sur une mélodie hollywoodienne. Encore une merveille de r’n’b sophistiqué avec «Happiness Is Guaranteed», pièce gantée de soie noire et finement dansante. On se croirait dans une ambiance de salle immense, comme dans certains hits des Supremes. C’est effarant de qualité chant et les arrangements font baver le profane. Mais l’album reste plutôt pop, avec des morceaux comme «What Am I Going To Do Without Your Love», chanson progressiste et ambitieuse qui fournit une nouvelle preuve de l’écrasante supériorité de Tamla sur l’ensemble de la pop américaine. Même chose avec «Tell Me I’ll Never Be Alone», petite perle de pop suprême du Michigan hantée par des voix d’anges à la peau noire. Un véritable pied de nez au Vatican.
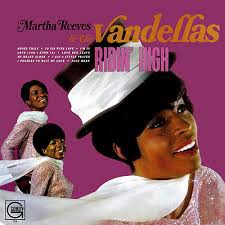
Magnifique pochette rose et blanche pour l’album «Ridin’ High». Betty Kelly a été virée et Lois, la sœur de Martha, a pris sa place. C’est un album gorgé de pur jus Motown, avec des classiques imparables comme «I Promise To Wait My Love» (petite perle de r’n’b sacrément secouée à la basse), «Honey Chile» (le r’n’b de rêve monté sur une rythmique mélodique, l’un des hits sixties les plus hanteurs de consciences), «(There’s) Always Something That Remind Me» (du Burt repris en France par Schmoll - Il y a toujours un coin qui me rappelleuh - oh wohoho - mais Martha crève l’écran, elle va si haut qu’on ne la voit plus, on savait qu’elle était une géante, mais quand on l’entend chanter ça, on se prosterne jusqu’à terre), «(We’ve Got) Honey Love» (jolie pièce de r’n’b ordinaire typique des Vandellas et c’est ce qui fait la force des Vandellas : chez elles, le morceau ordinaire prend l’allure d’un classique, comme chez les Supremes), «I Say A Little Prayer» (la voix de Martha est tellement colorée qu’elle peut transformer une platitude en chef d’œuvre impressionniste) et «Without You» (pas loin du très grand music-hall, c’est dire si).

«Suagar N’ Spice» est sans doute le meilleur album de Martha Reeves & The Vandellas. Sa sœur Lois et Sandra Tilley qui est très claire de peau accompagnent Martha (Sandra vient aussi des Velvelettes et elle remplace Rosalind). Elles ouvrent le bal avec un beau groove orchestré à l’ancienne, «Taking My Love (And Leaving Me)». Absolument énorme. Pure magie Tamla. Ambiance miraculeuse. «Shoe Leather Expressway» est aussi du grand art Tamla monté sur une ligne de basse extravagante. On est au royaume de la bassline. Celle-là danse et glougloute derrière le groove. Encore du groove doux et serein comme pas deux avec «You’re The Loser Now» et on passe ensuite au winner avec «I’m A Winner». Une fois de plus, on est confronté à la classe mortelle de Martha Reeves. C’est du niveau des grands hits d’Aretha et ça grimpe très vite dans les étages. Absolument fabuleux de r’n’bisme. Elles tapent ensuite dans un vieux hit de Gilbert Bécaud, «What Now My Love», et Martha n’a aucun problème pour grimper au firmament, elle a cette voix de rêve qui rend possible tous les décollages. Elle explose sans aucun effort. C’est d’ailleurs ce qu’on avait remarqué en la voyant chanter sur scène. Elle dispose de cette incroyable facilité à grimper dans les octaves. La face B reste d’une rare densité. «Loneliness Is A Lonely Feeling» est une nouvelle pièce de pop r’n’bique digne des Supremes. On trempe dans le même genre de complot. C’est puissant, chanté, orchestré et choristé. Tout y est. Appelons ça le vieux son des victoires. Toujours de la belle pop vandellique avec «I Love The Man». On reste évidemment dans le très haut de gamme, c’est swingué à la hanche, ça prend l’occiput et ça ne le lâche pas. Quand un cut comme «I Can’t Get Along With You» se met lentement en route, il faut s’attendre au pire, c’est-à-dire à un petit chef-d’œuvre ambivalent. On a même un prototype du r’n’b rentre-dedans avec «Heatless». Pur jus Tamla, voilà le fameux hit secret qui faisait danser les jukeboxes. Just lovely. Impossible de reste de marbre.

On arrive dans les années 70 et Tamla Motown entame son déclin. Le son se blanchit de plus en plus et Berry Gordy s’est réinstallé à Los Angeles. On fit tout de même un dernier test avec l’album «Black Magic» paru en 1972, et on était persuadé que c’était foutu d’avance. D’autant que la plupart des artistes soul viraient disco, de la même façon que les rockabs qui avaient en leur temps viré country. Ils avaient tout simplement joué la sécurité matérielle, ce qui est de bonne guerre. On trouve quand même quelques morceaux solides sur cet album tardif des Vandellas et notamment «Your Love Makes It All Worthwhile», monté sur un bon beat et finement discoïde. On voit cependant que le Motown sound reste en bonne santé. Elle retapissent un hit de George Harrison, «Something». Ça devient un groove orchestré relativement inspiré. Et puis, une bombe nous guette au coin du bois : «Tear It On Down», une énormité avec une basse poussée devant, dans une pure ambiance sixties. Voilà un vrai romper black. Le génie du Tamla sound se niche dans ces merveilles organiques bien ficelées. Une vraie carne de r’n’b, bien lestée, avec une belle assise rythmique. Les filles ont une classe folle. On les sent parfaitement à l’aise sur ce genre de stomp pulsé à l’extrême. On retrouve du beau r’n’b classique en face B avec «Bless You», plénitude Tamla et orchestrations seventies. R’n’b supérieur avec «In And Out Of My Life», emmené par un walkin beat. Merveilleuse pièce, groove somptueux. On reste en bonne compagnie. Il semble que Martha et ses amies aient réussi à sauver l’honneur du label. Elles retapent dans Burt avec «Anyone Who Had A Heart» et elles en font une merveille absolue qui scintille sous les lampions de la discothèque. Quand on voit les coiffures frisées de Martha et de ses amies sur la pochette, on les soupçonne d’avoir cédé aux sirènes de la mode. Retour au solide groove de basse avec «Hope I Don’t Get My Heart Broken». Voilà un exemple d’intégration groovy réussie. Très révélateur.

L’idéal pour tout amateur c’est un bon Best Of anthologique des enfers comme «The Definitive Collection», parue en 2008, avec un son remastérisé. Avec ça, on se fait sauter le caisson : «Nowhere To Run» (le hit absolu, le r’n’b dans toute sa splendeur, d’une élégante brutalité tribale avec des chœur yeah-yeaherques terriblement sexy), «In My Lonely Room» (la musique des jours heureux, on claque de mains avec Martha, hit monumental, c’est la vraie musique, celle des gens doués qui vont bien), «Dancing In The Street» (l’insurrection, on descend dans les rues, partout, à New Orleans, New York City, Chicago et Motor City, les villes brûlent. Pure dementia diabolica. Music everywhere, c’est stompé aux maracas, Martha et ses copines dansent dans leurs petites robes de taffetas, elles foutent le feu dans toutes les cervelles. Vous en connaissez beaucoup des mecs qui provoquent ça ?), «Quicksand» (personne ne peut survivre à une telle avalanche de hits planétaires. C’est clappé des hands, chanté perché, du Tamla à se damner, on explose de plein fouet, au paradis de la soul), «I’m Ready For Love» (vraie pépite de sexe torride, elles tirent le truc vers les cimes, Martha met sa voix sucrée en avant, festin pour l’amateur, elle relance avec candeur, d’une voix pointue comme pincée), «Wild One» (battu par derrière, machine Tamla, un truc unique au monde, l’éclat d’un pounding énorme, on a l’impression d’être sous une voûte avec elles, c’est grandiose et inspiré et ça colle des frissons un peu partout), «You’ve Been In Love Too Long» (à tomber, encore une horreur apocalyptique, les filles secouent les colonnes du temple, elles chantent le r’n’b le plus puissant de tous les temps, Martha fait la loco avec son chien habituel), «Jimmy Mack» (monté sur un délire de basse, deux notes viennent saturer au refrain sur Jimmy Oh Jimmy, voilà la bombe, on entre dans ce morceau comme dans un rêve, la voix de Martha se durcit lorsqu’elle attaque le pont, la basse de Jammerson passe devant et vrille, Hey Jimmy) et «Bless You» (plus funky, elles retournent directement au jardin magique, c’est d’un miraculeux qui dépasse la mécanique quantique, fraîcheur de peau et satin blanc, parfum des jours si profondément heureux, elles élèvent leur truc au sommet de ce qui est humainement acceptable en termes de plénitude, Martha my dear, tu nous rends si profondément heureux, nous autres petites brebis trottant dans les jardins enchantés des paradis artificiels, sous la douce emprise de l’opium de la soul et sous le regard bienveillant du dieu Berry).

On ne pourrait pas imaginer un monde sans Jerry Lee. C’est pareil avec Martha Reeves. Un monde sans Martha Reeves, ce serait comme un jour sans rhum à bord de la frégate de Bartholomew Roberts. Impensable.
Signé : Cazengler le Vandale.
Martha Reeves & The Vandellas. New Morning. Paris Xe. 7 mai 2014
Martha & The Vandellas. Come And Get These Memories. Gordy 1963
Martha & The Vandellas. Heat Wave. Gordy 1963
Martha & The Vandellas. Dance Party. Gordy 1964
Martha & The Vandellas. Watch Out ! Gordy 1966
Martha Reeves & The Vandellas. Ridin’ High. Gordy 1968
Martha Reeves & The Vandellas. Sugar’n’Spice. Tamla Motown 1969
Martha Reeves & The Vandellas. Black Magic. Gordy 1972
Martha Reeves & The Vandellas. The Definitive Collection. Motown 2008
De gauche à droite sur l’illustration : Rosalind Ashford, Martha Reeves et Betty Kelly.
MONTEREAU – FAULT – YONNE
23 – 05 – 2014 / L'ANTIDOTE
THE JALLIES
Comme souvent quand je vais voir les Jallies – allez savoir pourquoi – la teuf-teuf se remplit de présence féminine – comme si je n'étais pas capable de me débrouiller tout seul. Une véritable escort girls, même que la copine a filé rencart à une amie du coin, deux gardes du corps pour moi tout seul, c'est beaucoup – un véritable barrage filtrant de protection autour de mon auguste personne, je me demande si cette attention ne serait pas intéressée.
Un temps de chien, même que la Salsa est restée dans sa panière. L'on arrive tout dégoulinant d'eau, facile de repérer l'Antidote sur la place du Marché au Blé, une vingtaine de personnes se collent, le col relevé, la clope au bec, contre la façade. Fumer et se mouiller, les deux à la fois, l'alternative est interdite. Fait meilleur dedans, surtout que la Vaness se précipite dans mes bras... pour me vanter le croque-monsieur au maroilles, personnellement c'est plutôt de croquer les demoiselles qui me remonte le moral, mais faute de grive je passe une commande de toasts grillés au fromage chaud.
L'Antidote se remplit. Toute la jeunesse monteauroise semble s'y être donnée rendez-vous. Heureusement le local est assez grand, long et large. Le bar est tout au fond, le matos des Jallies est dans un renfoncement latéral accessible aux yeux de tous. Ambiance joyeuse de fin de semaine, tandis que les verres se vident la fièvre monte doucement, lorsque le groupe rejoint ses instruments, l'on pressent que la soirée sera chaude.
PARTY 1

Ca démarre sur les chapeaux de roue. Pas le temps de faire ouf qu'ils sont déjà sur la route, les trois meufs qui font la teuf à fond sur le titre éponyme. Les soutes devant, les soutiers derrière. Turbinent sec. En fait ne vous y trompez pas ce sont eux qui poussent à la roue. D'abord Thomas qui se calfeutre sous son chapeau feutre, ne va pas en rater une, sans cesse un break de guitare à pousser au coeur des braises. L'a adapté son style, joue plus serré, plus concis, mais avec des attaques ultra-violentes et always on the speed. Pas le temps de voir venir, avec lui il faut que ça dégringole - les minauderies des filles, tiens si moi je prenais la guitare maintenant à moins que peut-être que je garde mon tambourin parce que - elles ont intérêt à ne pas y passer trop de temps, car au bout de trois secondes il vous grille une intro à faire sauter les fusibles du quartier. De son côté Julios en rajoute, il tient enfin sa vengeance – brûlante – après des mois de martyre, qui devrait en toute équité lui valoir la canonisation le jour même de sa mort. Mais là, il est encore vivant. C'est pour sa contrebasse que vous pouvez vous faire de la bile. Fini l'époque où il en jouait. Désormais il lui arrache les cordes – à les entendre miauler on croirait qu'il est en train d'éviscérer un chat, mais non, c'est un tendre, un ami des bêtes, mais quand il slappe on dirait Bruce Lee dans la Fureur du Dragon. En plus il se retient. Après le set, je l'entendrai déclarer : « Non j'ai fait doucement, on a un concert demain, je ne voudrais pas m'arracher la peau des doigts ! ».

Remarquez devant, ce n'est guère mieux. Céline, la douce Céline, la tendre Céline, s'est métamorphosée en lionne. Incapable de rester en place, l'on ne voit que sa robe rouge qui zig-zague entre les instruments, difficile de la suivre des yeux, elle bouscule les tempos comme les déménageurs les armoires à glace d'une seule main, elle rugit et vous pousse la chansonnette comme d'autres vous plantent la baïonnette dans le coeur. Nous dévoile un aspect inconnu de sa personnalité, et vu les réactions du public l'on ne peut pas dire que ce soit déplaisant. Mais combien de facettes cachées possède-t-elle encore ?
Tiens un garçon de plus sur scène. Non je n'ai pas bu et je n'ai pas la berlue, c'est même une tête connue, Jérôme toujours présent lorsque les Jallies officient en leur fief, ouvre sans ménagement un étui posé au bord de la scène et en exhibe une trompette rutilante. Une place devant un micro, vous voulez rire, nul besoin, se cale sur le morceau suivant et vous le transforme en fanfare mexicaine, un peu comme la scène centrale du bal des villageois sous les arbres centenaires de La Horde Sauvage. Mais en plus sauvage. Sourire d'extase sur les visages autour de moi. Et cris de joie sur les dernières notes.

Je sens que les lecteurs s'impatientent, dans leur âme je lis qu'ils veulent Leslie. Des nouvelles de la nouvelle. Sont bonnes, très bonnes. Ses sourires chavirent les choeurs, s'amuse comme une gamine à renchérir sur les wap-doo-wap. A l'aise comme si c'était son cinquantième concert. Avec en plus un sourire à faire fondre un croquemort. N'y a pas que l'alcool qui fait briller les yeux des garçons autour de moi. Par contre quand elle chante ça fait mal. Très mal. Encore une mignonnette qui ne prend pas les pincettes pour vous asséner des atemis meurtriers. Coup sur coup elle enchaîne Johnny's Got A Boom Boom de la divine Imelda ( l'est vrai que nous sommes au mois de May ) et Train Kept A Rollin de Johnny Burnette. On a eu de la chance qu'aucune patrouille de pandores ne se soit aventurée sur la place, l'on était tous bon pour la garde à vue et le cabanon. Le café transformé en lunatic asylum. Hystérie collective prolongée. Comme aurait dit Balzac, c'était Leslie dans la vallée de la mort. L'a gagné ses galons, Leslie.
L'on enchaînera sur un boogie d'anniversaire, et le set culminera sur un Whole Lotta Shakin Goin' Home à faire jerker le vieux Jerry Lou comme au temps de sa jeunesse tumultueuse. Pour une fois dans sa vie, Vanessa sut faire preuve de sagesse en décrétant qu'il était temps d'arrêter le charivari avant que tout ne chavire définitivement et de reprendre ses esprits devant un verre ( un grand ) au bar.
PARTY 2

Euphorie à ras les amphores. Quatorze titres débités comme elles viennent de le faire, vous avez votre dose de rockab-swing-rollant pour le trimestre. Mais non, c'est reparti pour un tour. Replay. Same players shoot again. Niveau d'intensité garanti. En trente secondes tout le monde a oublié les trois quart d'heures de coupure. C'est ça l'effet Jallies. Suffit qu'elles ouvrent la bouche pour que l'univers prenne des couleurs. Elles repeignent votre vie en rose bonbon au poivre.
Les filles sont sur le devant de la scène et les garçons marnent derrière. Normal nous sommes en Seine et Marne. Les triplettes sont déchaînées, parfois il est difficile de savoir laquelle des trois chante en soliste, elles ne se volent pas les morceaux, elles les survolent, en repoussent les limites et les refrains, interchangeant à plaisir les rôles. Parfois les deux mecs les poussent un peu des épaules et imposent de ces petits soli de basse ou de guitare qui vous décoifferaient une armée de chauves. En plus ils reçoivent du renfort, un batteur fou qui s'adjuge la caisse claire de Vanessa – l'on se demande pourquoi puisqu'il tape aussi bien sur les murs – et qui mène une sarabande d'enfer. Est acclamé comme Cassius Clay lors de ses mémorables combats.

Quatre garçons pour trois filles, pour une fois ces demoiselles ont du souci à se faire. Vous voulez rire ? Ce n'est pas parce que je n'en ai pas encore parlé qu'elle est restée sur le banc de touche. Vanessa a encore travaillé son KO technique. Tout sourire et toute blondinette. Un mirage, un miracle. Mais vous n'avez pas intérêt à laisser traîner un standard ou un rockab de derrière les fagots aux alentours. Elle s'y jette dessus et vous le malmène sans plus de cérémonie. Vous le secoue dans tous les sens, vous l'essore et vous le transperce en moins de deux. Elle ne griffe pas mais elle mord à plein gosier. Vous ne savez pas où elle va chercher ça, mais sa voix est un sabre de samouraï qui dépiaute à la vitesse d'un rotor d'hélicoptère, peut aussi bien vous tisser un napperon de dentelle, mais la demoiselle a de l'appétit pour les chevauchées sauvages, frisson garanti, dans le filigrane de son grain de voix, vous percevez la démence du loup qui hurle à la nuit, les claquements secs des mâchoires de caïmans qui se referment sur une proie innocente, tout un monde de violence primitive et animale qui gît au fond de l'être humain. Des lèvres chatoyantes, des yeux qui pétillent de malice, et ce tréfonds de folie et de brutalité barbares au plus profond de nos gènes et que l'on se garde bien de réveiller, par peur. Mais elle, la Vaness, l'Artiste, la magicienne à l'ensorceleuse raucité, elle n'éprouve aucune crainte, elle a domestiqué la bête visqueuse qui dort, et elle vient lui manger dans la main, dès qu'elle le veut. Pour notre plus grand plaisir. La voix de Vanessa nous réconcilie avec cette part maudite de nous-mêmes qui nous effraie tant. Joyeuses Jallies, soyeuses Jallies, à profusion. Tant que vous le désirez. Mais n'occultez pas la face cachée et hécatienne du blues qui transite en sourdine sous tout cela.
PARTIR
Le concert finit en apothéose, cris, danses, émerveillements, et j'en passe. Jamais vu un public si jeune et aussi réceptif dans un concert de rockab. Plein de nouveaux morceaux au répertoire comme cet I Love The Bug ou Fishnet Stockings, mais je laisserai le mot de la fin à Julios sortant de scène la chemise dévastée de sueur : « Je ne sais pas si c'était rockab, mais à coup sûr c'était sacrément rock'n'roll ». Et je lui donne sacrément raison.
Damie Chad.
PROVINS / LE CESAR / 17 & 24 – 05 – 14
LOREANN'
17 / 05 / 2014
Suis un peu embêté pour écrire cet article. C'est Loreann' elle-même qui me l'a dit : « Ne dis rien, j'ai trop mal à la gorge, ce n'est pas génial aujourd'hui. » C'est sûr que malgré son col roulé elle est en plein courant d'air et qu'il souffle en permanence un petit vent glacé pas du tout agréable. Mais c'est une règle intangible : l'on ne peut être à la fois juge et partie. La preuve c'est que malgré la fraîcheur ambiante l'on est serré comme des harengs en caque sur cette terrasse et que personne ne manifeste l'envie de s'en aller. Les rares chaises qui se libèrent sont aussitôt réoccupées sans faillir. A croire que ce petit filet de voix dont elle médit si allègrement doit quelque peu réchauffer les coeurs et raffermir l'âme des impétrants.
Jacquie la Gratte est de retour, Loreann' lui laisse volontiers sa guitare le temps de siroter un thé bien chaud, l'en profite pour un intermède musical qui ne nous rajeunit pas, un pot-pourri des années soixante avec Da Dou Ron Ron de Johnny Hallyday, et Twist à St Tropez des Chats Sauvages. Plus tard ce sera un accordéoniste qui viendra de son propre chef l'accompagner sur un morceau de... que mon cerveau atrophié a oublié... Pas génial, c'est elle qui le dit, mais toujours le même intérêt de la part des auditeurs et ces musiciens de hasard qui s'en viennent témoigner leur sympathie. A la réflexion, ce ne devait pas être tout à fait comme elle l'a déclaré. Mais puisqu'elle ne veut pas que j'en parle, je me tais.
24 / 05 / 2014
Enfin presque. Parce que je vais vous parler de la semaine précédente. Submergé par des obligations je n'ai pas eu le temps d'écrire l'article. Alors je résume. Faisait beau temps. Les parkings étaient pleins mais sur le marché les vendeurs faisaient grise mine. Personne, pas de clients, les allées désertes. A peine trois ou quatre pèlerins. Le César est aux trois-quarts vides et la terrasse désertée. Ne me demandez pas où la population provinoise avait disparu, c'est un mystère.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu tort. Car Loreann' était là, fidèle au poste, et en pleine forme. L'a même fini par rameuter assez de monde pour remplir la terrasse, vraisemblablement au grand désespoir des marchands qui ont dû se voir, à grands regrets, arracher leur maigre clientèle... Un coup dur pour l'économie mercuriale de l'ancienne cité comtale, mais comme nous sommes de ceux qui pensons que les activités artistiques priment sur toutes les autres, nous n'en fûmes point désappointés.
Et Loreann', dans la blondeur de ses cheveux soulignée par un rayon de soleil venu tout exprès pour s'excuser de son manquement de la semaine précédente, déborde de vitalité. Du coup elle en a oublié un peu cette tristesse automnale de mélancolie qui embrume si délicieusement les harmonies de sa voix pour se mettre au diapason de cette atmosphère matinale printanière. Davantage de vigueur dans l'attaque des morceaux, nous avait jusques à lors celé cet aspect primesautier de son interprétation. Dans la rue vidée de son flot quasi ininterrompu de voitures sa voix s'élève et ricoche sur les façades. Idem pour la guitare, la fait résonner méchamment plus fort que d'habitude. Un ton plus haut mais toujours se dégage cette mystérieuse aura qui enchaîne le spectateur à rester encore une fois pour tenter d'en percer par une nouvelle écoute l'énigme irrésolue de cette attirance qui s'en dégage.

Violemment applaudie. En concert la veille, attendue ce soir-là en un autre lieu, Loreann' commence à agrandir le cercle des interventions. Comme j'ai posé sur la table friandises et cerises les copain s s'y jettent dessus comme poignée de moineaux affamés, mais Loreann' en rajoute une sur les gâteaux : s'est mise à composer. Excellente nouvelle. Plus qu'à attendre avec impatience.
Damie Chad.
CAPTAIN BEAFHEART / La Biographie
mike barnes
Traduction : PATRICK CAZENGLER
( Camion Blanc / Avril 2012 )
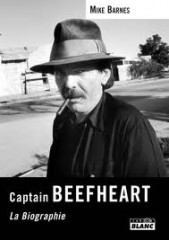
Captain Beefheart, Capitaine coeur de boeuf, ce n'est pas que je sois végétarien – j'aime plutôt le rock saignant – mais le Capitaine Beefheart j'avoue que je n'ai jamais trop adoré naviguer sous son pavillon, un pirate un peu trop arty selon mes goûts mais attention c'est notre Cat Cinglé national qui a mis la patte ( mais pas la trique ) à la traduction. Une véritable caution morale dirais-je car le Cat Zengler vous avez dû vous en apercevoir en lisant – non, je corrige : en apprenant par coeur ( de boeuf ) - ses chroniques consacrées aux émeutiers du rock qu'il n'apprécie pas trop les mous du genou droit. Ceux du gauche non plus.
Mike Barnes est un journaliste rock, la preuve il écrit dans Mojo, mais il participe régulièrement à The Wire le magazine de la musique différente, jazz, new thing, improvisation libre, contemporaine, électronique, expérimentale... quand on veut se rassurer, l'on dit post-punk, on a ainsi l'impression d'être encore en terre connue mais quand on y regarde de près, c'est un continent à la dérive qui a rompu toutes ses amarres avec nos roots chéries.
Généralement les rockers se bouchent les oreilles dès qu'ils entendent de lointain échos de cette pseudo-musique dégénérée. Sont plein de mépris et de hargne envers ses sous-civilisés qui produisent des horreurs sans nom et inaudibles. Attitude compréhensible mais qui ressemble trop à celle adoptée par tous ces individus collet-montés qui détestent cette musique de sauvages qu'est le rock'n'roll. A chacun ses barbares. Une identité – même de rocker - se bâtit autant par des conduites d'amicales ressemblances que par des refus affirmés et proclamés haut et fort. L'homme est un animal : en guise de territoire il se construit des frontières mentales infranchissables. S'y sent bien et au chaud, aussi à l'aise qu'un cadavre dans son cercueil capitonné. L'est comme la larve entortillée dans son cocon. Mais trop souvent il oublie de se métamorphoser en papillon.
Si Gene Vincent est selon les rockers une icône parfaite de la rébellion, Luigi Russolo en est une autre. Ne procèdent pas des mêmes racines, le premier était un gamin américain qui avait reçu en partage la musique populaire des USA, le second fut un italien, engagé dans les mouvements artistiques d'avant-garde du début du vingtième siècle, un héritier de la culture européenne savante et élitiste. En ce temps-là le Futurisme tentait de se mettre à l'heure de la fureur du siècle qui allait naître en 1914. C'est en 1913 qu'il publie L'Art des Bruits, le manifeste qui ouvrit la porte à toutes les cacophonies musicales qui s'en suivirent. Gene Vincent est né en 1935, Luigi Russolo est mort en 1947 et Captain Beefheart naquit en 1941. La chronologie permet de mettre en perspective des évènements qui en apparence n'ont rien à voir entre eux.
UN ENFANT GÂTE
Mais pas pourri dans l'oeuf. Tout petit l'était déjà en avance sur les proximales générations de baby boomers, ces insipides marmots américains à qui l'on passe tout sous prétexte qu'il ne faudrait point les traumatiser. Fils unique, le chéri de sa maman qui est à ses ordres. Aucune autorité parentale, il l'appelle par son prénom et se sert d'elle comme d'une servante obéissante et fidèle. Pas le genre à lui rappeler qu'il est l'heure de partir à l'école, lui il préfère rester à la maison. Facile à garder, ne fait pas de bruit, passe son temps à dessiner et à sculpter des animaux dans tous les morceaux de bois qu'il peut se procurer. Une forte personnalité.
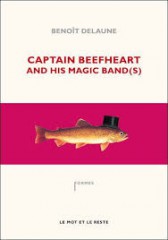
Bison buté qui n'en fait qu'à sa tête, mais il se fracassera sur le premier écueil : à seize ans ses parents s'opposent à ce qu'il aille en Europe dans une école d'art. Vocation contrariée. Pédalera quelques années dans la choucroute informe de l'adolescence et de la prime jeunesse avant de tirer les définitives leçons qui présideront à la manière dont désormais il guidera sa vie. Des préceptes simples qu'il appliquera avec une fermeté exemplaire : article 1 : toujours faire ce que je veux faire, article 2 : ne jamais écouter les autres mais agir en sorte que ce soit les autres qui m'obéissent, article 3 : ne jamais transiger sur les deux précédents commandements impératifs et absolus. Pouvez détester le Capitaine et le tenir en piètre estime, mais vous serez obligés de convenir que jusqu'à sa mort il ne dérogera pas une seule fois à ses propres principes éthiques. Une véritable personnalité de rocker !
ENVIRONNEMENT MUSICAL ( 1 )
Suffit d'un mauvais voisin qui donne le mauvais exemple pour que votre gosse tourne mal. Quoique pour le dénommé Van Vliet – l'autre nom du Captain Beefheart – l'on ne sait lequel influença l'autre. Se rencontreront à l'université d'Antelope, dans le Comté de Los Angeles. Beefheart + Zappa, les deux grands déjantés du rock sixties commencent à traîner ensemble. Très vite dans les clubs de blues et de rhythm and blues.
ZAPPA
Deux personnalités distinctes et surtout deux parcours différents. Zappa possède une solide formation de musique classique, s'intéresse à Stravinsky , Varèse le dodécaphonisme et tout ce qui suit. Mais Zappa bifurque, s'entiche de musique populaire et de guitare électrique. N'en abandonne pas pour autant ses bases classiques. Se servira du rock comme d'un cheval de Troie, autant pour le libérer de sa naïve simplicité que pour bousculer la musique contemporaine. C'est un compositeur, il écrit ses partitions, ses musiciens doivent les jouer à la note près, ce qui n'empêche pas que de temps en temps il ménage des plages soigneusement circonscrites d'improvisation. Il adore bousculer, mais avec ordre et méthode. Aimerait être reconnu comme un grand musicien, un grand compositeur. Que son nom devienne aussi célèbre que celui de Debussy.
Sûr de lui et plein de commisération pour l'ensemble des rockers qui pour la plupart jouent d'oreille et ont du mal à lire une portée en clef de sol... Voudrait les écraser tous, aimerait être la rock star suprême, le magnifique bordellisateur du siècle. Après moi, vous pouvez tirer la chasse sur tout ce qui m'aura précédé. Dans les années 70, une chambre d'étudiant sur deux offrait le célèbre poster de Zappa entièrement nu trônant sur ses chiottes. Tout un symbole. L'anar chie. Sur le monde qui l'entoure.
VAN VLIET

Aussi convaincu que le précédent d'être le génie du siècle. Pas le même bagage musical. Ne sait ni lire, ni écrire la musique. Ne sait jouer d'aucun instrument. Monstrueux déficit en faveur de Zappa. Pas étonnant que tous les deux se retrouvent dans les bars miteux à écouter du blues. L'on imagine mal les deux compères assister au Requiem de Fauré tout en dissertant doctement sur l'art du contrepoint. Van Vliet ne possédait pas la culture nécessaire pour prétendre partager de tels échanges de vue. Quant à penser qu'il aurait pu se taire et écouter religieusement le savoir de maître Zappa, c'est bien mal le connaître. Se sent beaucoup plus à l'aise avec la rusticité des structures du blues. Le blues c'est avant tout une question de feeling. Suffit de se laisser porter et de nager dans le sens du courant. Van Vliet trouve la solution. S'aperçoit qu'il possède une grosse voix, ne sait pas trop quoi en faire, alors il apprend à hurler et à hululer, chez lui il passe et repasse les disques de Howlin' Wolf et est très vite capable de l'imiter parfaitement. Bientôt il adjoindra à son talent de blues shouter le porte-voix naturel du blues : l'harmonica, qui n'est que la continuation instrumentale des cordes vocales et du soufflet des poumons.
ENVIRONNEMENT MUSICAL ( 2 )
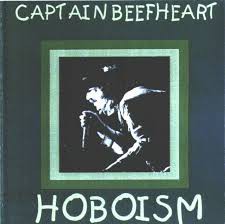
Tout le monde est OK avec le British Blues. De Cyril Davies à Eric Clapton, de John Mayal à Led Zeppelin, en passant par l'American Folk Blues Festival aux Animals, n'importe qui peut réciter la leçon. La même phénomène se produisit aux USA. Mais d'une façon un peu différente. Aux Etats-Unis tout est plus rapide. A tel point que le blues se confondit avec le rock. Aux Etats-Unis l'on a les moyens. Les adolescents commencent à entreposer du matériel dans le garage des parents, de mois en mois, les amplis se multiplient, en 1968 Blue Cheer déclare la guerre. Parient sur la force de frappe sonore. Contrairement aux anglais, à des groupes comme Cream, qui créent les bases du hard rock en jouant sur la perfection musicale des riffs découpés et articulés à outrances, Blue Cheer invente la charge éléphantesque qui écrase tout sur son passage. Point de subtilité et pas de quartier.
A Detroit City, Stooges et MC 5, sont eux aussi des adeptes des grandes vitesses, mais ce n'est pas seulement l'aiguille du compteur poussé au maximum qui les intéresse, c'est la suite, lorsque l'on a dépassé la zone rouge et que l'on continue à foncer, l'on arrive alors en des atmosphères de grandes turbulences, ce n'est plus le rythme qui compte mais la pâte sonore où l'on débouche, un no man's land chaotique, explosif, où rien ne ressemble à rien, où l'on ne sait plus si l'on produit du son ou du bruit. Maximum de décibels et plénitude des jouissances. La musique devient une expérience charnelle, une approche fulgurante de la modernité. A Love Suprême comme dirait John Coltrane. Born to Be Wild, en déclinaison rock.
Etrange musique qui prend son essor dans les gémissements hypnotiques du blues rural pour terminer dans les sphères les plus extrémistes du jazz non orchestral en empruntant the rock'n'roll highway. Le chemin est tracé. Suffit de l'emprunter. Par contre personne ne sait sur quoi il débouche...
L'ORCHESTRE MAGIQUE

De 1965 à 1968, Captain Beefheart brûle les étapes. Possède son groupe, le Magic Band, avec lequel il enregistre deux simples dont une reprise de Bo Diddley – a déjà l'intuition que tout son doit ressembler à une jungle luxuriante - Diddy Wah Diddy qui lui octroie un statut de groupe régional. Pas mal pour un début, mais A & M refuse les premières prises du premier 33, Safe As Milk. Trop violent, trop désordonné. L'on aime bien le Milk Cow Blues chez A & M, mais il ne faut pas que la vache soit trop folle. Captain comprend la leçon, veut bien mettre un peu d'eau dans son lait. L'embauche une jeune guitariste, Ry Cooder qu'il a déjà remarqué lors de différents concerts.

Ry Cooder c'est le roi de la slide, avec lui tout glisse comme sur du verre, vous ferait avaler un sabre d'abordage sans que vous vous en aperceviez. Quant au Captain, il se met à l'unisson, un coeur de boeuf tendre comme l'agneau qui vient de naître, s'en faudrait d'un millimètre pour que sa voix ne vienne pleurnicher dans votre mouchoir. Bon, de temps en temps ça se gâte, l'ensemble s'engouffre dans des rythmiques à la Doors et Le Ry vous tire de ses cordes de si étranges mélopées que l'ambiance devient carrément tordue. Mais l'amateur y retrouve ses petits assez facilement, d'autant que la guitare qui miaule vous permet de ne pas leur marcher dessus. C'est du binaire, du binaire tordu-bossu, psychédélique certes, avec des paroles un peu bizarres, mais enfin l'époque est à l'outrance. Le rock est en crise d'adolescence et les groupes ne savent pas quoi faire pour se démarquer. Parfois, ca tombe un peu à côté, certains passages ne dépareraient point dans un disque de Santana, cela pour vous faire comprendre que c'est un joyeux foutoir. Et quand on commence à se perdre l'on retombe sur un vieux riff de blues des familles qui vous rassure.
Le disque sort chez Buddah Records mais le pacha est déçu, le succès espéré se révèlera être un bide. Est surtout convaincu que la maison de disques ne lui a pas donné l'entière liberté, s'est senti brimé dans ses désirs. En retrait sur ses possibilités. Peut faire beaucoup mieux. Le deuxième album ne lui apportera pas plus de satisfaction, les bandes de Strictly Personnal seront trafiquées en son absence pour être mieux accueillies par le public... Beefheart s''en ouvre à Zappa qui se propose de l'enregistrer sur son propre label Straight Records en lui promettant tout le temps nécessaire.
TROUT MASK REPLICA
Ry Cooder fait un somptueux cadeau au Capitaine, il quitte le Magic Band dès les enregistrements terminé. S'éloigne pour d'autres aventures. A visualisé l'iceberg qui se profile à l'horizon, veut créer sa propre musique pas celle de Van Vliet, c'est qu'une fois que Zappa lui a donné carte blanche le Capitaine révèle sa véritable nature. Le leader charismatique se révèle tel qu'en lui-même l'auto-proclamation de son génie le dévoile. Un tyran. Mais un tyran bien-aimé de son peuple.
Commence par enfermer les musicos chez lui et les fait bosser comme des dromadaires. Les transforme en ses instruments. Doivent développer ses idées à lui. Leur donne des indications oiseuses et peu signifiantes, à eux de se débrouiller et de trouver. Bon prince, il les laisse travailler tout le reste de la journée et pour ne pas les déranger pendant ce temps il va s'amuser avec les filles et les grosses voitures. Pour les royalties c'est réglé comme sur du papier à musique, se créditera de l'intégralité des morceaux. En attendant il veille à la santé physique de ses musicos aimés, l'est sûr qu'au régime qu'il leur impose ils ne prendront pas de poids. Quant à lui le malheureux qui ne sait pas résister à ses mauvais penchants il emmène sa copine au restaurant.

Le résultat dépassera toutes les espérances, au début l'on n'entend que la voix du Capitaine qui écrase l'orchestration, comme vous ne comprenez pas l'anglais vous êtes dispensé de toute interprétation. Ensuite votre oreille est accaparée par un saxophone omniprésent. Non, ce n'est pas Jerry Rafferty, c'est le Capitaine, il ne sait pas en jouer, mais que cela ne vous empêche jamais de vous servir d'un instrument. D'ailleurs les musiciens qui derrière lui sont des cadors se voient imposer des tempos déstabilisateurs, rien ne tient debout, la rythmique boîte et se casse la figure à tous les pas. Le bon vieux tempo du blues est totalement dévasté, jeté à la poubelle, s'agit pas de chanter mais de dramatiser des effets de voix, parfois de temps en temps vous saisissez un riff mais dans la seconde qui suit, tout le monde s'emploie à le frapper par terre, à l'écraser à coups de bottes, à le hacher tout menu pour que désormais vous soyez convaincu que c'était une illusion musicale. Le Capitaine intervient souvent, il ne chante pas, il commente, il imite les voix off des films d'horreur, il vous raconte une histoire comme si vous étiez un petit enfant. La narration vous passe par dessus les neurones mais vous ne voulez pas vous endormir sur de si inquiétantes atmosphères, alors vous en redemandez encore et encore, à tel point que vous commencez par en devenir addict. Si vous survivez à la première écoute, si vous avez le courage de traverser la fosse aux serpents, il vous faudra l'écouter in extenso trente-cinq fois avant de vous rendre compte qu'une cohérence musicale gît au fond du marécage. Trout Mask Replica c'est une curieuse alliance de ménagerie du cirque Bouglionne, de recette de camembert frit et de rock'n'roll déjanté. Avec en fond des rengaines de vieux blues aussi venimeux que des aspics qui nichent dans les arbres fruitiers.
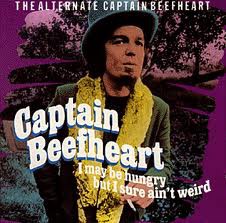
Le disque sortit en 1969, en avance de quinze ans sur son temps. Peu de succès, il faudra attendre l'explosion punk et plus tard la généalogie – bruitisme – dada - lettrisme – situationnisme - surréalisme - qu'en dressera Greil Marcus dans Lipstick Traces ( voir KR'TNT ! 1 136 du 21 – 03 – 2013 ) pour en évaluer la portée. Grâce à lui le rock s'est approprié toute une partie de la musique contemporaine. A ramené l'art de l'élite dans la rue. A détruit les tours d'ivoire compassées des musiques évoluantes.
COMMENT CONTINUER ?

Après un tel chef d'oeuvre, Le Capitaine aurait dû saborder son navire et se perdre corps et bien avec lui. Difficile de faire mieux. D'ailleurs il n'y parvint pas. Continua à enregistrer ses disques, mais aucun n'atteignit une si folle magnificence. Certains se vendirent beaucoup mieux que sa truite vagabonde, pas du tout chopinesque, mais musicalement ils se tiennent en retrait. Commercial. Diront les mauvaises langues. Les fans n'ont pas manqué de le lui reprocher. Un peu plus préhensibles par des oreilles habituées à des harmonies fluidifiées, modulerons-nous. Certains n'hésiteront pas à qualifier certains albums de soupe à l'eau sans sel. Le Magic Band changera souvent de musiciens, travailler trois années de suite dans l'équipage du maudit rafiot était usant. Le capitaine toujours aussi insupportable, usant de son ascendant naturel pour imposer ses vues et ses idées. Beaucoup partent fâchés, mais aucun ne regrettera son passage sur la nef des fous.

Toutefois les évènements finirent par se retourner contre le Capitaine. Une grande gueule qui promettait beaucoup et signait n'importe quoi sur un coup de Trafalgar. Se fâche avec Zappa qui question caractère lui ressemble beaucoup et qui finit par perdre le contrôle et la propriété de son propre label... Au début des années 80, il est difficile de se procurer les disques du Capitaine, trop de procès en cours... L'équipage des matelots excédés est de moins en moins chaud pour se lancer en d'épuisantes tournées qui ne leur ramènent que très peu d'argent...
DERNIER PORTRAIT

En 1982, le Captain n'a plus le beefheart à la tâche. Il abandonne la musique. N'y reviendra plus. Retourne à ses premières amours, la peinture. Avait souvent illustré ses pochettes de ses dessins mais là il a définitivement changé de cap. Finira par devenir un artiste connu, coté et respecté. Mais ses apparitions se font rares. L'aventurier se calfeutre chez lui, se débat contre la sclérose en plaques. Qui le maintient sur un fauteuil roulant et qui finit par triompher de ses entêtements magistraux en décembre 2010.

Captain Beefheart a été un pionnier en son genre, tout une partie de la musique d'aujourd'hui, Post-Punk, No Wawe, Indus, Noise, se réclame de son oeuvre... Loin de nos racines sacrées, mais seules survivent les espèces qui engendrent assez d'individualités déviantes pour pouvoir s'adapter à de nouvelles conditions imposées par les circonstances d'un univers en perpétuelle mutation. Ce n'est pas le monde qui a grandi, vous diront les lézards, ce sont les dinosaures qui ont rétréci.
Tirez-en les conclusions que vous voulez.
Damie Chad.
PS : si vous n'aimez pas le Capitaine, lisez quand même surtout si vous appréciez la belle prose françoise, Le Cat Zengler s'est surpassé.
22:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
23/05/2014
KR'TNT ! ¤ 190 : LISA AND THE LIPS / CHARLIE WEST / ORVILLE NASH / SUBWAY COWBOYS / OL' BRY / MARC SASTRE/
KR'TNT ! ¤ 190
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
23 / 05 / 2014
|
LISA AND THE LIPS + BELLRAYs / CHARLIE WEST / ORVILLE NASH / SUBWAY COWBOYS / OL' BRY / / MARC SASTRE / |
|
ERRATA Suite à ma chronique de la semaine dernière sur le concert des Ghost Highway, Zio me fait remarquer qu'il n'accompagne pas à la contrebasse Miss Regina Crown mais MISS VICTORIA CROWN. Donc acte, mes excuses à la jeune reine que j'espère avoir le plaisir de revoir en concert bientôt. ( DC) |
LE BATOLUNE / HONFLEUR ( 76 ) ) / 30 -04-14
LISA AND THE LIPS
Mona Lisa

Lisa Kekaula pourrait très bien prétendre à un trône africain. Elle a le port d’une reine et une voix d’airain. Elle pourrait très bien revêtir un boubou de soie tissée d’or et alourdir ses bras de bijoux antiques, mais non, elle se présente à nous coiffée d’un chignon dressé en gerbe et serrée dans un pantalon de cuir noir. Lisa Kekaula entre sur la scène du Batolune comme si elle entrait dans la salle du trône de l’empire Dogon du XVe siècle : elle se fait d’abord entendre puis elle se manifeste physiquement, imposant à tous et à toutes sa puissante prestance animale. Elle détient aujourd’hui le big soul power que détenait Aretha en 1968.

Autour d’elle se dressent les Lips, une formation composée de musiciens espagnols relativement jeunes et de Bob Vennum, son vieux compagnon d’aventure. Lisa et Bob ont semble-t-il jeté l’ancre en Espagne pour se réinventer. Ces activistes du blast soul-punk qu’on connaissait sous le nom des BellRays se sont transmutés en Lisa & The Lips, une fière équipe de funksters dévastateurs. La high-energy est toujours au rendrez-vous mais désormais, Mona Lisa shout-balamalatte la meilleure soul du monde.

Très grosse équipe, en vérité : trompette, sax, claviers, batterie, basse, deux guitares et Lisa embarque tout ça dans une bacchanale entêtante, cette espèce de pulsation hypnotique à laquelle les grands shouters noirs de r’n’b nous ont habitués. Écoutez n’importe quel album live de Wilson Pickett ou de Ike & Tina Turner, et vous retrouverez cette animalité de peau humide et de all night long. C’est toute la différence avec le garage qui s’arrête au bout de deux minutes, pour reprendre et s’arrêter encore deux minutes plus tard. Les géants de la soul traversent la nuit dans la fournaise des pulsions animales. Leur distance n’est pas la même. Lisa règne sur l’immense chaos de la sensualité avec une sorte de parfait mystère africain : pas de regard, la voix, rien que la chaleur de la voix, comme si les dieux primitifs s’exprimaient à travers elle.

Et comme pour contrebalancer ce pathos, elle se livre à quelques pitreries en se roulant par terre. Bob place ici et là quelques solos de guitare dignes de ceux de Wayne Kramer, totalement incendiaires, et sur les morceaux plus funk, Pablo Rodas, un petit bassiste qui n’a l’air de rien avec ses cheveux longs bien peignés joue des lignes de basses stupéfiantes et dignes de celles de Bootsy Collins. Un drummer nommé Max Resnikosky bat un beurre technique très haut de gamme et joue à merveille le rôle clé du pulsateur. Avec une section rythmique aussi rutilante, Lisa et Bob jouent sur du velours.

L’album de Lisa & The Lips ravira tous les amateurs de hot soul. Les vieux fans des BellRays y retrouveront aussi leur compte de bombes, avec par exemple «Come Back To Me», un mid-tempo fin et racé, gorgé de la meilleure soupe de soul, où on entend Bob prendre un solo rissolé aux flammes de l’enfer. Et puis on trouve aussi cette pataterie râblée, «You Might Say». Lisa monte à l’assaut, en puissante shouteuse. Voilà un rock-blast monté sur un groove seventies, craquant et bon comme le pain frais. Franchement, on ne peut pas espérer mieux. Puis Lisa prend «Trouble Mind» à la Esther Phillips, softy-sweety à la petite vitesse du beat bien doux. On la sent dans son élément - ease my trouble mind - on ne peut que vibrer, à condition bien sûr de considérer le genre comme supérieur. Et puis voilà ce «Stop The DJ» avec lequel ils ont bouclé leur deuxième rappel, monté sur un funky beat à la Bootsy. C’est un funk digne des nuits rouges de Harlem, finement shafty. On suit à la trace cette belle ligne de basse insistante et bien groovy, toujours affiliée au meilleur funk des ghettos d’antan. Pablo bombarde sa basse et part en vrille sur des coups de bas de manche affriolants. C’est un traverseur de manche en quinconce, il va chercher le tagada de gamme pulsatif. On retrouve un mid-tempo infernal - leur meilleure vitesse - avec «The Pick-Up», mélodique en diable - heaven goes around me yeah - une pièce de soul inspirée. Et on revient au funky strut avec «Push». Ils trottent dans les traces du push - you’re gonna have to push to make it all the way - Lisa grogne et Pablo se balade à longueur de manche. Il fait le grand jeu traversier du funkster impavide - push wouahhh - fabuleux et coulant. Ils terminent l’album avec une pièce mortellement ralentie et funkstée à la racine du poil, «The Player», exemplaire, précis et régulier comme un mercenaire bien payé - funky booty baby, pièce de rêve. Tout ceci pour dire que l’album vaut l’emplette.

C’est vrai qu’on ne sortait jamais indemne d’un album des BellRays. Lisa et Bob ont monté le groupe en Californie en 1992. À l’époque, Tony Fate produisait et Bob jouait de la guitare. Leur premier album s’appelait «In The Light Of The Sun». Sacrée entrée en matière. Pour un premier album, c’était un véritable coup de maître. Dans «Crazy Water», on les sentait déjà très obsédés par le Tamla sound. Tony Bramel sonnait comme James Jammerson, le légendaire bassman des Funk Brothers, l’orchestre maison de Tamla. On ajoutait là-dedans une trompette à la Miles Davis et on se retrouvait avec un hit. On en trouvait un autre avec «Footprints On Water» que Lisa amenait d’une voix grave pour aller ensuite chercher une mélodie imparable. Pour «Same Ground», ils nous servaient sur un plateau un riff seventies et un shuffle hot et bien pushy. On retrouvait nos belles nuits rouges de Harlem, une musique puissante des reins, et tendue comme la peau d’un tambour africain. Il semblait que les BellRays avaient percé le secret du beat sourd d’Harlem Shuffle. Nouvelle horreur stupéfiante avec «You’d Better Find A Way» allumé au power-chord. Annonciateur d’incendies à venir. Ils donnaient leur vision du rock, celle d’un rock qui décollait avec un vent mélodique brûlé par une fournaise rythmique. On avait là de quoi se régaler - Inspiration ! You’d better find a way - modèle d’intégrité compositale, Lisa éclatait au firmament et Bob lui donnait la réplique. Encore plus somptueux : «In The Light Of The Sun», avec une belle entrée en matière de voix diffuses et embarqué très vite au plus haut niveau mélodique. Et ça grimpait dans l’éclat, soutenu par des cœurs. La force des BellRays, c’est que leurs grands hits sonnent comme des classiques intemporels. C’est encore ici le cas. Avec leur premier album, ils révélaient leur génie.

«Let It Blast» est sorti six ans plus tard. C’est là que la presse a commencé à s’intéresser à eux. Pour décrire le phénomène, les journalistes avaient inventé cette formule : Aretha accompagnée par le MC5. Les BellRays se voulaient révolutionnaires, dans la veine du MC5, mais ils utilisaient un nouveau langage, le soul-punk. Petit à petit, les BellRays se sont élevés dans l’échelle sociale du rock. De petit combo exotique revendiquant l’héritage du MC5, ils sont passés au rang de maîtres suprêmes du blast-garage américain. Ils commencèrent à régner sans partage sur un immense territoire hérissé de petites oreilles de lutins.
Une chose est certaine : les BellRays sont essentiellement un groupe de scène. Ils furent pendant un temps la meilleure équipe de rockers californiens. Tony Fate ne se refusait rien, ni la riffalama à la Tony Iommi - ou pire encore, à la AC/DC - ni les incursions incendiaires à la Wayne Kramer. Ils avaient le drummer approprié, on s’en doute. L’articulation centrale de cette machine de guerre que furent les BellRays, c’était Bob Vennum. On l’a dit et répété à chaque fois, Bob Vennum était le meilleur bassiste de rock sur cette terre. Il dépassait en intensité ses vieux pairs, Tim Bogert et Jack Cassady. Bob Vennum avait un jeu de basse impulsif complètement exacerbé. Il pouvait bombarder comme dix Lemmy et jouer le jazz comme Charlie Mingus. Il fallait donc voir les BellRays sur scène. Bob Vennum faisait quasiment le spectacle à lui tout seul. Il jouait vraiment comme un dieu. Il sautait, il suait, il carambolait ses notes, comme Tim Bogert le faisait aux grandes heures de Cactus. Comme certains joueurs de tennis, il avait le bras droit beaucoup plus volumineux, à cause sans doute de la tension musculaire due au jeu de médiator. Pas de prisonniers. Bob Vennum fut un monstrueux showman doublé d’un technicien hors-pair. Et quand on aura compris que la dynamique d’un groupe repose sur le bassman, on aura tout compris.

Puisqu’on patauge dans les certitudes, en voici une autre : «Let It Blast» nettoie bien les oreilles. Lisa met son chien au service de l’un des plus effrayants carnages soniques de la fin du XXe siècle. Tony Fate fait subir les derniers outrages à sa bête à cornes. Il joue sur une SG Gibson bordeaux. Il peut jouer les machines à riffer quand ça lui chante et il fait parfois passer Tony Iommi pour une belette. Le maillon fort de cette fine équipe, c’est l’immense Bob Bass Boss Vennum. Il ne peut pas rester tranquille plus de cinq secondes. «Changing Colors», c’est un peu l’enfer sur la terre. Lisa arrive là-dedans en hurlant. On ne peut vraiment parler que de fournaise, avec une basse qui ronfle comme ça. Horrible. Le son est très peu soigné. Ils ont enregistré ça sur un radio-cassette. La basse sonne comme un battement de cœur. Chez Fate, ça tire les notes. Elles se baladent comme des serpents dans les fougères. C’est à tomber. Ça cafouille dans la farfouille. Voilà une entrée en matière qui ne pardonne pas. Encore du beau foutage de garage avec «Cold Man Night». Toujours plus motivé. La basse qui est sourde comme un pot passe devant, dans le mix. Lisa porte tout l’édifice à bouts de bras. Elle ne mégote pas. Bob fait tout le ramdam à lui tout seul. Il martèle et il pilonne. Tony Fate est au fond du studio, on l’entend à peine. C’est un cut explosé dans l’oignon, basse de Bob devant toute. Il gratte trop de notes. À l’époque, quand on le voyait sur scène, il jouait des milliards de notes, il sautait en l’air et faisait les chœurs, tout ça en même temps. «Today Was» reste dans la même lignée de titres volontaires et indomptables, fougueux comme des poneys indiens. Lisa tente de calmer le jeu. Avec des démons comme Tony Fate et Bob dans les parages, c’est impossible. Rien de plus infernal que «Kill The Messenger», monté sur un tempo dévasté type Motörhead. Trop de puissance. Lisa parvient à régner sur cette extravagance. C’est le chaos total, l’empire du trash, on entend les forces du mal nous rattraper à la course. «Blue Cirque» sonne la charge de la brigade légère. Les BellRays ont l’air de foncer dans la plaine sous le feu de l’artillerie russe. Ils ont cette capacité de susciter des images très fortes. C’est emmené à la batterie. Le pounding mène la danse. Il y a des petites zones de néant, mais le morceau repart toujours. Les BellRays développent de réelles capacités lysergiques en relation directe avec les tourments cosmiques des dieux antiques. Ils jazzifient «Testify» jusqu’à l’os du sternum. C’est un prêche de type Airplane ou MC5 - brothers and sister everywhere - retour en force du garage porté par une basse diabolique. Ce «Testify» évoque aussi les Flaming Sideburns. Les BellRays en font un morceau assez lourd, au moins aussi lourd qu’un heavy-blues de Nebula ou de Pentagram. Bob joue des lignes de jazz bass. Il est absolument spectaculaire. Il joue ces petites gammes rapides qui ont fait la gloire des grands contre-bassistes du XXe siècle. Bob et Tony sont capables de lever de grandes tempêtes jazzy. Peu de bassistes sont capables de jouer de tels boléros. L’équation du groupe est parfaite : une chanteuse colorée, un guitariste virtuose et une section rythmique d’avant-garde. Il n’y a pas de recette miracle. Et si on est pas encore tombé de sa chaise, alors on tombe avec «Black Honey», plaqué d’accords déments, gratté menu, emmené, intuitif, chanté à la vie à la mort. Les BellRays, le grand groupe américain du XXe siècle ? Allez savoir. Ce «Black Honey» vaut tout l’or du monde. Cerise sur le gâteau : un solo d’antho signé Tony Fate qui rappelle ceux de Victor Unitt dans l’album «Parachute» des Pretty Things. Le drive de basse emmène toute la bande au firmament. La basse ronfle comme un gros buveur assoupi. «Black Honey» est une nouvelle preuve de la supériorité des BellRays sur tous leurs concurrents. C’est un garage qui tombe avec un jeu de questions-réponses - Black honey ! Black honey ! Voilà l’archétype du vrai hit garage. Placide, Bob répond : Black Honey ! Il joue l’un de ces riffs de basse qui font frémir. «Black Honey» n’est pas seulement le hit de ce disque des BellRays. Il est aussi l’un des hits majeurs du XXe siècle.

Leur troisième album «Grand Fury» paraît en l’an 2000. L’apocalypse, c’est eux, évidemment. Nostradamus ne l’avait pas prévu. «Too Many Houses In Here» est une explosion collatérale. Pas d’équivalent nulle part ailleurs, inutile de chercher. C’est brûlé de l’intérieur, ils vont bien plus loin que les Stooges, on ne sait pas comment c’est possible, mais on l’entend, on sent une forte odeur de brûlé sonique. Lisa se prélasse dans une braise héritée directement de «Motor City’s Burning» du MC5. Pur génie. Et Bob pilonne tout ça comme un malade. Avec «Fire On The Moon», ça continue. Tony cocote sa mortelle randonnée. Ces gens-là sont des fous. Ils riffent dans la viande et Lisa règne sur ce carnage. Aucun groupe américain n’a jamais sonné comme ça et ne pourra jamais sonner comme ça. Lisa allume le feu sur la lune. Suite de l’aventure riffique avec «Snake City», la machine de guerre s’ébranle et Lisa est aux commandes. Ils explosent tout. Absolument tout. C’est comme des Stooges gonflés à l’hydrogène. Puis on se prend «Screwdriver» en pleine poire. Lisa nous envoie rissoler dans la Rôtisserie de la Reine Pédauque. Le duo Bob/Fate dépasse l’entendement rythmique. Ils ne jouent pas, ils blastent en permanence. «Heat Cage» n’a aucune chance d’en réchapper. Il vaut mieux avoir les oreilles solides pour écouter ça. On a là ce qui se fait de mieux dans le rock américain : la fournaise du Detroit sound explosée jusqu’au vertige et la voix d’une reine de la soul. Une véritable tornade d’embrasement. «Evil Morning» arrive et aucun répit n’est possible. Ces gens-là surjouent le destin du rock atomique. Rien ne saurait calmer leurs ardeurs sémantiques. Ils cherchent des voies nouvelles, comme le ver dans la pomme. Dès l’intro, «Stupid Fuckin’ People» est bombardé par les deux riffeurs fous. Rien ne peut les arrêter. Ils dépassent toutes les bornes, ils transcendent l’axe Blue Cheer-Motörhead-Stooges-MC5, ils vont encore plus loin, et Lisa hurle, elle s’empare des éclairs jaillis du ciel. On assiste au plus gros pilonnage sonique de tous les temps. Bob sort «Monkey House» à la note de bas de manche, puis c’est traité façon MC5. Nouvelle démence sonique à l’état pur. On a encore droit à un coup de génie avec les chœurs de «Under The Mountain» et on resssort de cet album à quatre pattes.
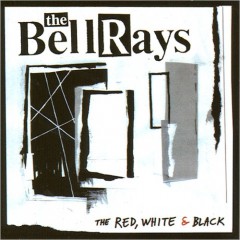
Nouvelle monstruosité en 2003 avec «The Red White And Black». Comme ils l’indiquent sur la pochette, la soul est le professeur et le punk est le prêcheur (Soul is the teacher and punk is the preacher). Folie pure avec le cut d’ouverture, «Remember», un truc de dingue qui perd ses roues, ils foncent de travers, comme s’ils roulaient avec des pneus crevés. Léger parfum de free. Puis on retrouve le riffage du Destin mortel dans «Street Corner» et «Sister Disaster». Fate hache tout ça menu. Voilà l’équation magique du rock moderne : voix + riffage + inspiration. «You’re Sorry Now» est une belle compo de Bob. C’est même un hit planétaire. Ambiance dramatique, accords descendants, foggy motion de riffs terribles. Voilà un hit fabuleux et gargantuesque. C’est un heavy-rock rendu mélodique par les descentes d’accords et le chant perçant de la reine Lisa. On revient au MC5 avec «Revolution Get Down». Bob fait grimper les ponts sur des lignes de basse effarantes. Il faut l’entendre traverser la fournaise révolutionnaire. Le cut est farci de breaks terribles. Bob croise au large comme un requin à lunettes. Faramineux. Pop explosive avec «Find Someone To Believe In». C’est l’une de leurs spécialités. Ils savent faire du mélodif explosif. «Some Confusion City» est un magnifique morceau de batteur. C’est Eric Algood qui bat le beurre. Bob fait hey-hey et il gratte sa basse comme un con. Quelle magnifique équipe, franchement ! Les relances sont impitoyables. Les BellRays nous emmènent en enfer et on adore ça. Punk in the flesh avec «Black Is The Colour». Lisa bat tous les records - bein’ shot down on the blue side of town. Quand on entend «Stone Rain», on se dit : mais ce sont des malades ! La basse devient folle. Il faut entendre Bob perdre les pédale - I feel so lonely I could die - il va dans tous les sens. Il multiplie les descentes de manche. C’est lui le bassman le plus dingue de l’univers, il va là, et là, et il remonte ensuite par des ponts insalubres, quelle brute. On l’entend faire d’autres prodiges dans «Rude Awakening» et ils finissent avec un punk-rock qui envoie au tapis, «Voodoo Train». Inutile d’ajouter que cet album compte parmi les grands albums classiques du rock.

«Have A Little Faith» sort en 2006. On démarre sur un gros groove joué à la manière des Temptations, «Tell The Lie». Tony Fate fait son funky wha wha king. Par derrière, Bob coud sa toile avec un doigté caoutchouteux qui en dit long sur sa culture groovy. Tony Fate a donc écrit le nouveau hit des Temptations. Ils renouent avec la grande sauce funky des eighties. Un saxophone vient sopraner dans l’air torride. Lisa rassemble tout l’air de ses poumons pour honorer la mémoire des divas de la soul. C’est réussi. «Time Is Gone» est un gros groove salace. Le tempo est bizarre, un peu mambique, comme mal embouché. Tony Fate fait monter la petite pression. Il rentre dans le trou du track en jouant un extravagant chorus jazzy. Ce mec a des ressources. Il joue un solo à la Zappa. Il semble que les BellRays mettent un peu d’eau dans leur vin. C’est Tony Fate qui écrit les morceaux. Il devient un compositeur ambitieux. «Chainsong» cumule les fonctions. Dans le cours du couplet, on passe du hardcore à la jazzitude béate. On sent une quête de sophistication. Ça ne peut pas leur faire de mal. Ils cassent bien l’ambiance, avec des zones éthérées à la John McLaughin. Et puis voilà «Pay The Cobra», une remontée en température typique des BellRays de la première heure. Le problème, c’est que tous leurs morceaux musclés se ressemblent. Et puis voilà un couplet en apesanteur. Tony Fate le relève immédiatement avec sa rythmique à la Tony Iommi. Il adore gratter sa bête à cornes. Ça le réconcilie avec la vie. «Snotgun» est aussi une speederie bien fuselée. C’est une revendication de la liberté. Cette chanson est très politisée. «Everybody look at my snotgun/ Tune your guitar to the snotgun/ The alphabet ends with the snotgun/ And all I wanna do is to be free. All I wanna.» «Change The World» est une chanson de Bob. On change de registre. Les BellRays font claquer l’étendard sanglant de la révolte. C’est riffé à mort - I don’t think I can kill myself - éclat du génie bellrique. Et voilà «Detroit Breakdown» qui est le gros cut du disque. Pur Motor City sound - «No more Iggy or the MC5/ Wayne’s been doin’ it in LA now, so you’re just livin’ a lie.» Les BellRays remettent les pendules à l’heure. Effectivement, il ne reste rien du Detroit shakedown. «Maniac Blues» sonne comme une grosse affaire. Effarant de maîtrise. Lisa tire sur ses syllabes et Tony mitraille, bien soutenu par Bob l’inéluctable. Il faut que la gloire des BellRays resplendisse sur la terre comme au ciel. Ils terminent avec une bravado suprême - ah-la-la palabalalah - une reprise des Cornichons de Nino Ferrer. Lisa la swingue à mort. Elle envoie les cornichons, les tomates et les ouvre-boîtes danser dans la fournaise - ba-la-la-la - elle s’amuse comme une folle et elle embarque le swing sauvage.

«Raw Collection» est une compile des singles parus entre 1995 et 2002. Et là, il est recommandé d’attacher sa petite ceinture. Le un s’appelle «You’re Sorry Now». C’est un son caverneux, ambiance soul sixties, avec une basse rampante qui arrive derrière Lisa. Il s’agit d’une belle compo psyché de Bob, nappée d’accords crépusculaires. C’est absolument magistral et ça peut hanter l’esprit. Lisa dispose de tellement de feeling qu’elle ne sait plus quoi en faire. Attention : ils s’attaquent ensuite à un classique vénéneux : «Nights In Venice» des Saints. L’énergie dévastatrice dans un classique dévastateur, ça donne du dévasté dévastateur. Les deux riffeurs fous s’en donnent à cœur joie. Tony cisaille comme un fou. Il est dans son élément. La voix de Lisa colle parfaitement à ce classique de l’apocalypse. Ils vont même finir dans la collision. Bob tricote ses déflagrations souterraines. Franchement, sans les BellRays, que deviendrions-nous ? Ils nous font le coup de la fausse sortie et reviennent comme des barbares. Bob reste sur une note, Tony se roule par terre et se tortille. Il faut aux barbares des compos terribles, voilà le secret. «Half A Mind» sonne illico comme un classique pop, et même comme un hymne. Tony joue tout en fuzz. La mélodie est là, évidente, montée sur une dynamique de basse décisive. C’est une véritable splendeur. Avec sa mélodie enchantée, «Mind’s Eyes» pourrait aussi sonner comme un classique des sixties. Bob joue une bassline de r’n’b et Lisa rayonne comme un soleil dans le ciel bleu des sixties. Les BellRays tapent dans le très haut de gamme. «Pinball City» est un punk-rock sauvage. Lisa prend le chant par en-dessous. La rythmique est du pur MC5. Ils poussent des Hey ! d’anthologie. Bob se balade. Il a la note facile. On reste dans le pinball avec «Mother Pinball», un shuffle de la Nouvelle Orleans - Come on ! Do the pinball, baby ! «Tie Me Down» bascule dans la frénésie. Ils vont si vite qu’on doit s’accrocher à la rambarde. «Say What You Mean» sonne comme un classique épais et dévastateur. On plonge dans cette heaviness jubilatoire comme dans un bain de jouvence. Les foules reprennent le refrain en chœur. On nage dans l’énormité bardée de clameurs. Ho ! Ho ! Ho ! On lève le poing ! Quelle poigne ils ont ! Ils tiennent leurs hits par les couilles. Tony plonge dans un chorus d’une monstruosité hallucinée. Flip, flop, ils pataugent dans le génie. Lisa est au maximum de ses possibilités. Et le morceau repart, en défonçant tout. Lisa et ses amis reprennent les choses là où le MC5 les avait laissées.

«Hard Sweet And Sticky» sort en 2008 avec une belle pochette gourmande. Ils attaquent ça avec un nouveau hit planétaire, «The Same Way», une pop éclatante envoyée avec tout le chien de sa chienne. Compo de l’immense Bob Vennum. C’est quand même autre chose qu’Aerosmith. Au moins, il y a de la tenue dans ce balladif. «Infection» est heavy comme l’enfer. Bob qui joue désormais de la guitare envoie un solo monstrueux. Avec les BellRays, c’est pas compliqué : si on leur demande de faire un album de rock, alors ils font un album de rock. Leurs albums font partie de ceux qu’on réécoute à intervalles réguliers, car on sait qu’on y trouve de la substance. «Infection» est un morceau incommensurable qui se répand dans l’univers. «Comin’ Down» est un mid-tempo poussé par une rythmique ingrate et brutale. Bob repart en solo liquide. Il compte désormais parmi les solistes les plus brillants d’Amérique. Ils reprennent leur vieux hit «Footprints On Water». L’élégance de leur pop restera dans les annales. Lisa et Bob emportent leur soul pop au firmament, à coups de cris, d’éclats et de prodigieuse élégance. «That’s Not The Way It Should B» est du typical BellRays : Lisa devant et derrière, deux riffeurs fous, avec des relances diaboliques et une dynamique exceptionnelle. C’est un cocktail dont on ne se lasse plus.

Le dernier album paru des BellRays s’appelle «Black Lightning». Il est sorti enveloppé du mystère d’une pochette noire traversée d’un éclair anthracite. Comme on l’imagine, cet album recèle son petit lot de bombes. Et notamment le morceau titre qui fait l’ouverture. Ça reste carré et Bob envoie des solos dignes de ceux de Wayne Kramer. Lisa reste cette fabuleuse shouteuse qu’on suit depuis le début. Le paradoxe, c’est qu’il n’y a pas de surprise. C’est aussi énorme qu’on le supputait. Même chose pour «Hell On Earth», nouvelle pièce fumante de rock incendiaire. On entend moins le double riffage d’antan. Le son est plus fusionnel, dans l’esprit de la lave qui s’écoule des flancs du Krakatoa. «On Top» est un cut extrêmement punchy. Lisa l’expédie au firmament, elle a l’habitude. On note au passage que la puissance des BellRays est intacte. «Power To Burn» est une pièce de belle pop mentalement élevée, montée à coups de mélodie, de power chorus et d’un ramassis disparate d’accords cavaleurs. Bob ne faiblit pas, ce n’est pas dans ses habitudes. Il revient toujours placer un chorus intéressant. Avec «Power To Burn», les BellRays nous offrent un modèle de power pop californienne. «Living A Lie» est du pur BellRays, une énormité rockée à la cantonade, vite troussée et enfilée à sec par un gros solo garage. «Everybody Get Up» est cocoté d’avance. Lisa chauffe la marmite. Et ça part dans l’épaisseur de la clameur. Dans la verdeur de la lourdeur. Dans l’éclat de la puissance. C’est une fois de plus une véritable source de jouvence. Toujours aussi épais et bon, voilà «Close Your Eyes» - c’mon take my hand and close your eyes - et Bob part en vrille, c’est un démon du bonheur séculaire, il laisse filer son solo de feu liquide. Rien d’aussi magistral que les BellRays. Huit albums et pas un seul déchet. Qui dit mieux ?
Signé : Cazengler, amateur de belles raies.
Lisa & the Lips. Le Batolune. Honfleur (76). 30 avril 2014
BellRays. In The Light Of The Sun. In Music We Trust 1992
BellRays. Let It Blast. Vital Gesture Records 1998
BellRays. Grand Fury. Uppercut Records 2000
BellRays. Raw Collection. Uppercut Records 2003
BellRays. The Red White And Black. Poptones 2003
BellRays. Have A Little Faith. Cheap Lullaby Records 2006
BellRays. Hard Sweet And Sticky. Vicious Circles 2008
BellRays. Black Lightning. Fargo Records 2010
Lisa & The Lips. Lisa & The Lips. Vicious Circle 2013
18 / 05 / 2014 / AVON 77
AMERICAN COUNTRY ROCK AVON
CHARLY WEST / ORVILLE NASH

C'est la faute au Cat Zangler, qui ici même dans KR'TNT 148 au doux mois de juin 2013 nous avait dressé un tel dithyrambe d'un concert d'Orville Nash que nous ne nous pouvions pas faire semblant d'ignorer qu'il passait à trente-cinq minutes de la maison. Sur le papier ce n'était pas donné, ouverture à dix heures du matin avec initiation à la danse counry toute la journée. Douze heures western swing sans le swing, c'est un peu craignos, alors prudents comme des séminoles sur le sentier de la guerre qui se préparent à sortir de leurs marécages, Mister B and Aïe ! Avons, à Avon, décidé de nous introduire dans le camp des visages pâles à la tombée de la nuit, juste pour le concert.
Judicieuse décision ! Le soleil rasait la cime des arbres lorsque nous pénétrâmes dans le ranch des envahisseurs, poétiquement nommée La Maison des Vallées. Un centre culturel communal composé d'immenses bâtiments et entouré de vastes parkings ombragés, disposé si délicatement au pied d'un interminable et impressionnant aqueduc ferroviaire que l'on se croirait transporté dans une maquette géante.
L'on arrive à l'heure incertaine entre chiens de prairie et loups du grand nord, les garçons vachers finissent leur repas, les hommes ont gardé leur chapeau sur la tête et les filles leur longue robe volante, des regards surpris se posent sur la tenue fifty de Mister B et mon blouson simili-skaï, manifestement l'on se demande ce que nous sommes venus faire là, nous aussi, mais on se rappelle que l'on est ici pour Orville Nash. Ouf !
Annonce au micro : démonstration de danse country catalane dans la salle de spectacle. Je ne voudrais pas me lancer dans une catalinaire dévastatrice à l'encontre de la sardane catalane mais je me suis toujours demandé pourquoi l'Onu n'avait pas inscrit sur la liste des organisations terroristes tout ce qui a un rapport quelconque avec cette stupide pantomime débilitante qui se pratique du côté de Perpignan. Si vous ne me croyez pas, profitez de vos vacances pour vérifier l'étendue des dégâts.
Je tire Mister B de ce guet-apens génocidaire culturel en l'emmenant finir sa bière à l'extérieur. Silhouette connue à l'horizon, incroyable mais vrai, un troisième rocker, et pas n'importe lequel, Raphaël le guitariste des Atomics, le pistoléro sans reproche à la Gretsch de nacre blanche et d'or ! Mais le concert commence...
CHARLIE WEST

Une salle de concert comme on n'en fait plus depuis un demi-siècle, une scène surélevée aussi vaste qu'un champ de foire, et un plancher de petites lamelles de bois aussi glissant qu'un avon de Marseille, et un plafond si haut que vous oubliez qu'il existe, une véritable cathédrale. Au micro le présentateur s'inquiète de notre santé et pour nous éviter toute fatigue inutile il nous recommande d'aller chercher une chaise au réfectoire, ce qui occasionne une sortie en masse vers le susdit lieu de sustentation alimentaire. Bref au bout de cinq minutes tout le monde est sagement assis le long des murs. N'y a que Mister B et mon immodeste personne, qui tels des rocs immobiles dans la tempête, restons debout, collés contre une issue de secours. Ah, ces rockers ils ne peuvent pas faire comme tout le monde !
Tout est en ordre, Charlie West peut faire son apparition suivi de tous ses musicos. Charlie West n'est pas un bleu de la veille. Un véritable vétéran, dans les années soixante-dix il accompagna Vince Taylor, ce qui tout de suite vaut lettre et patente de noblesse. Longtemps axé vers le blues et le rock, en 1999 il effectue un changement de cap, il se tourne vers la country music. Depuis il écume avec son orchestre les festivals et réunions, country comme il se doit. L'orchestre est en place, petit problème Charlie recherche son jack qu'il finit par trouver sur le pupitre de son violoniste. Un, deux, trois et c'est parti. Pas besoin d'en entendre plus pour comprendre. Merveilleusement en place, de sacrés musicos, aussi précis qu'une montre suisse, de la qualité, de la haute définition. Rien à redire, rien à reprocher.
N'ont pas entamé depuis trente secondes Colorado Girl que la voisine de Mister B assise sur sa chaise lui demande – non pas de lui réserver la dernière danse – mais de se pousser légèrement afin qu'elle voie un peu mieux... Le public country nous réservera toujours des surprises... Tout à l'heure ce sera à Raphaël – venu de rejoindre – que sera réitérée la même demande... n'ont tout de même pas tous le cul vissé sur un poteau de barrière de corral. Beaucoup se lèvent et se mettent à danser. Assez joliment faut l'avouer, pas tous doués mais avec du coeur, certains couples se débrouillent plus que bien, et puis guetter les panties des demoiselles quand la robe tournoie et s'élève vers la voûte céleste est une occupation de rocker des plus émérites. Parfois c'est même western string.

Evidemment nous nous intéressons avant tout à la musique. L'on en prend plein les oreilles pour pas un rond – façon de parler car le ticket d'entrée aurait fait fuir le septième de cavalerie – Claude pédale dur à la Steel Guitar, pas très spectaculaire de rester à table toute la soirée, mais il fait fondre les coeurs. La Pedal Steel Guitar c'est encore pire que la gravure de La Mélancolie d'Albert Dürer, ça vous essore le palpitant comme une machine à broyer, dans les films on vous montre toujours les outlaws de la mort en train de faire feu des deux gachettes, en fait ces killers n'étaient que de gros sentimentaux prêts à fondre en larmes dès qu'une minette capricieuse refusait de leur sourire... ils avaient l'âme bien moins aiguisée que la lame de leurs couteaux... heureusement que de l'autre côté de la scène Pascal tire les crins de son crin-crin à foison. Ne sera pas toujours fidèle à son fiddle car sur plusieurs titres il l'abandonnera pour la guitare, mais quand il s'empare de son archet, qu'il a coutume entre deux titres de tenir entre ses dents, ce n'est pas pour nous tirer des larmes de crocodile, nous entraîne sur son violon violent dans une sarabande effrénée. L'a le physique de l'emploi, blond le visage taillé à coups de serpes, genre Apollon qui a beaucoup souffert, et lorsqu'il descend de scène et qu'il entre dans le cercle des danseurs, il les mène jusqu'au bout du délire avec la ruée finale du rond diabolique qui se referme sur lui...

Je traverse toute la salle pour jeter un oeil sur Styve le batteur. Assure aussi les choeurs, c'est lui la cheville ouvrière, si du groupe émane un si beau son, c'est en grande partie grâce à lui. Une frappe puissante mais aérée, qui n'écrase personne et qui laisse à chacun la possibilité de s'exprimer sans avoir à faire l'effort de pousser les meubles pour s'immiscer dans l'atmosphère architecturale qu'il ordonne.
C'est joli, mais nous les rockers l'on aime les ambiances un peu plus dures. Il y aura de très bons moments comme les reprises de Seminole Wind de John Anderson ou de The Wanderer de Dion & the Belmonts. Mais au bout d'une heure et quart nous nous éclipsons discrètement vers le bar. Ce n'est pas que ce soit mauvais, mais Charlie West – j'ai oublié de dire qu'il se débrouille plutôt bien au chant - a compris qu'il faut donner aux longhorns le fourrage conditionné qu'ils aiment. L'herbe sauvage leur causerait peut-être un peu trop mal aux dents. Je sais c'est un peu vache ce que je dis, mais Mister B est encore plus critique que moi, de la country commerciale marmonne-t-il, et il a l'impression que le public se moque totalement de l'histoire de la musique country... L'ajoute, je me demande comment il réagirait si à la place de Charlie West on leur proposait les Subway Cowboys, mille fois plus authentiques, plus roots et plus honky tonk...
ORVILLE NASH
En chemin – décidément tous n'atterrissent pas obligatoirement à Rome – nous rencontrons Patrick – un habitué des concerts rockabilly - qui lui aussi effectue – quel hasard ! - un repli stratégique vers le saloon. Formule à voix haute la question qui traverse nos cervelles depuis le début de la soirée. Comment un tel public réagira-t-il face à Orville Nash ? Surtout que la veille il a assisté au concert que d'Orville donnait au Saint Vincent à St Maximin, pas tout à fait le même whisky qui coulerait d'un même tonneau. Celui d'Orville c'est du véritable White Ligthning nous confie-t-il.

D'ailleurs sur qui tombons-nous à la première table du café ? Orville Nash en personne qui se lève pour nous saluer. N'est pas tout seul, Raphaël et Francis qui fut le bassiste des Hot Rocks, sont à ses côtés. Ne reste plus qu'à attendre, mais Orville et les Gamblers s'éloignent pour aller revêtir leur tenue de scène, chapeau et foulard bleu savamment noué autour du cou. C'est ainsi que nous les retrouvons tous les trois sur la scène. Divine surprise, toute une partie du public s'est massé devant la scène et y restera durant tout le set. Quant à ceux qui ne se lèvent pas leur siège, ils seront encore là à la fin du show. Comme quoi il ne faut pas désespérer de l'humanité !

La différence tout de suite. Dès les premières notes. L'on change d'étage. Et de musique. Ici pas d'enjolivements pour attirer le touriste. C'est du brut de brut. Guitare, rythmique et contrebasse, le trio dans toute sa rusticité et dans toute sa gloire. Impossible de tricher, tout le monde garde ses deux mains sur les cordes et personne ne va se pendre. Honky Tonk Mood pour donner le la. Nous sommes aux limites, à l'intersection de trois genres qui se suivent et se ressemblent tout en se différenciant, hillbilly, honky tonk, rockabilly. Campagne, bourgade, ville. Ruralité, sociabilité et fureur de vivre. A trop se côtoyer l'on ne supporte plus de se faire marcher sur les pieds. Bientôt chaussés de daim bleu. La musique populaire américaine est une longue marche qui nous conduit des grands territoires perdus aux concentrations citadines. Les musiciens haussent le ton au fur et à mesure que l'espace rétrécit.
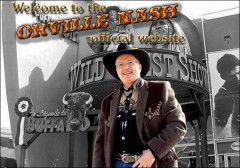
A part que Orville Nash vous fait l'aller-retour en trois minutes. Le temps d'envoyer un Swamp Child aussi gluant de vase verdâtre qu'un alligator qui sort du bayou et le voici déjà dans le poulailler de Charlie Feathers en train de glousser comme une poule qui couve son oeuf alors que le renard se faufile au travers du grillage. Autant vous dire que ça rocke dur et qu'il y a du remue-ménage. Je ne parviens pas à dénicher un adjectif pour qualifier la voix d'Orville, ce qui est certain, c'est que c'est exactement celle qui convient. Vit en France, mais être américain ça vous donne un satané plus pour ce genre de refrains. Vrille ses morceaux comme par chez nous les vieux vous causent en patois. Vous ne reconnaissez rien mais vous comprenez tout. La voix fait image. Vous propose ce que vous voulez voir. Et entendre. L'est terrible à la gratte, lorsqu'il lance ses morceaux ou que les Gamblers le laissent quelques secondes jouer seul, l'on s'aperçoit qu'il balance sans état d'âme. American efficacity. Garantie orvilienne.

Raphaël confirme ce que nous pensions de lui. Un super guitariste. Pourrait nous envoyer des tonnes d'électricité, nous la jouer white rock à outrance, du genre vous n'en voulez plus, en voici encore, mais non il se souvient que l'électrification des campagnes ne s'est pas faite en un clic, alors il s'adapte. Ne bouscule pas le type de musique qu'il est en train de jouer. Ne tient pas être moderne. Se contente d'être en accord avec son sujet. L'est là pour servir mais pas pour se servir et dépasser devant tout le monde avec un plateau préparé. Ne passe pas une clôture sans la refermer car c'est ainsi que l'on respecte les antiques us et coutumes. L'a intégré qu'il joue une musique qui s'évade du country certes, mais qui n'emporte pas moins avec elle des brins de paille et un peu de crottin sous ses semelles.
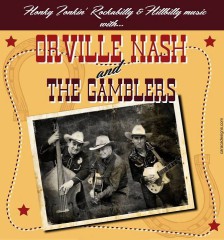
Francis Gomez agit de même. Nous l'avons vu avec sa stature de géant en un autre concert soulever des montagnes et faire dégringoler des tonnes de rockailles sur nos têtes, mais là il sait rester sobre. Déverse tout de même des cruches et des cruches de swing à vous couper le souffle. Même qu'à un moment n'y tenant plus il couchera sa fat mama à terre et s'y vautrera dessus comme pour une sodomie en public – faut dire qu'à ce moment-là Orville rockait comme un roquet en colère, et que Raphael malmenait salement son pickin', bref toutes les conditions étaient réunies pour passer le mur du son. Ce n'était plus du honky Tonk mais du Honky Tank, une division de blindés en train de charger toutes chenilles hurlantes.
Dans le public, ça applaudit de plus en plus frénétiquement à la fin des morceaux, et puis en plein milieu pour souligner tel passage particulièrement bien perçu. Je ne sais pas comment ils font mais lorsque je me retourne je m'aperçois que derrière nous une quarantaine d'amateurs de country dance improvisent un stroll un peu heurté car à la vitesse où Orville débite ses hits si vous avez envie de suivre la cadence vous n'avez guère le temps de compter les pattes des mouches qui volent.
Un rappel et c'est tout. Orville et ses deux condotierres nous laissent sur le bord du ring, sonnés comme les cloches de Notre-Dame, les bras entremêlés dans les cordes, essayant de reprendre notre souffle. Nous a estabouziés. Extase et catharsis. Merci à Raphaël et Francis pour leur vielle de Gamblers, merci à Orville Nash pour ce set impeccable. Ils ont gagné, par K.O technique, par K.O passion.
FIN DE PARTIE
Après un tel round de sorciers, impossible de rester à écouter les disques qui suivent. L'on sort se remettre les idées en place. Excellente idée. Rencontre avec Rudy, Nathalie et son copain qui viennent du Nord. Ne soyez pas surpris mais quand des rockers rencontrent d'autres rockers, de quoi voudriez-vous qu'ils jactent, si ce n'est d'histoires de rockers. L'on se sépare alors que les responsables ferment à clef la Maison des Vallées.
Damie Chad.
( Pour les photos : on a pris ce qu'on a trouvé, ne correspondent pas au concert )
L'ALIMENTATION GENERALE / PARIS / 19 – 05 – 14
SUBWAY COWBOYS / OL' BRY
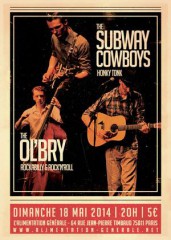
L'est des fois où un sort injuste s'acharne sur les rockers innocents comme l'agneau qui vient de naître. Z'avons pas pu voir les Cowboys du Souterrain qui jouaient dans un bled perdu de l'Oise, et des considérations familiales nous avont empêché d'assister au spectacle des Vieux Briards – peut-être braillards brillants, mais nos traductions sont très approximatives – chez les Loners. De quoi vous dégoûter de vivre. Mais ne voici-ti-pas que les deux groupes suce-nommés passent, non in an another time, neither in an another place comme le chante le diabolique Jerry Lou but en même temps et au même endroit. A Paris. A L'Alimentation Générale. Une occasion unique de faire nos courses.
La course c'est la teuf-teuf mobile qui s'en charge, nous dépose à vingt heures tapantes à moins de cent cinquante mètres de l'épicerie maréchale. Trois jours après je me demande encore comment elle a fait pour dénicher une place de stationnement. Un dimanche soir en plus. Alors que ces têtes de veaux de parigots se sont dépêchés de s'entasser dans leur vingt mètres carrés à mille euros mensuel afin d'être fin prêts le lundi matin à rejoindre au plus tôt leur boulot-métro-dodo. Ce qui explique l'assistance un peu maigriotte. Des amateurs et des connaisseurs, plus une colonie de jolies étudiantes que les rockers émoustillent toujours.

Le patron doit être fatigué, début des hostilités à neuf heures tapantes, fin de partie un peu avant minuit. Ôtez un quart d'heure pour la mi-temps et calculez combien de temps il reste pour chacun des deux groupes.
SUBWAY COWBOYS
Les trois sur scène. De guingois. L'espace est si restreint et si encombré par le matos des Ol' Bry qu'ils ont été obligés de se disposer comme des pions sur un damier sur la seule diagonale libre du carré. Mat au fond, Will au milieu – vous le reconnaissez à son chapeau – et Fab devant, en avant file. Se sentent tellement à l'étroit dans cette minuscule cellule scénique qu'ils entament leur set par un morceau de circonstance, le Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Ne les plaignez pas. A peine s'ils ont la place pour bouger les doigts sur leur cordage, vont donc sublimer leur désir d'espace et de verdure. Ce qu'ils ne peuvent vivre, ce sont leurs instrument qui l'exprimeront.

Echec et mat en faveur de Matt. Apparemment un garçon calme et sérieux, soucieux de bien faire. Se penche avec sollicitude sur sa contrebasse qui a l'air trois fois plus épaisse que lui. L'on dirait qu'il joue au docteur et qu'il l'ausculte une dernière fois avant de décider une intervention chirurgicale, que l'on pressent fatale. Pour un peu on tirerait un mouchoir de sa poche dans le but d'écraser furtivement une larme sur la tristesse de notre joue. Faux-semblant. C'est un ponte, un spécialiste qui vous réveille les morts rien qu'en sortant son bistouri. Ca ruisselle de tous les côtés. A croire qu'il y a une dizaine de contrebassistes éparpillés dans la pièce qui s'amusent établir des effets stéréos et quadriphoniques dans tous les angles du local. Pluie orageuse de triples croches qui virevoltent comme des oiseaux moqueurs dans tous les azimuts. Un trio honky tonk, oui mais qui grâce à Matt résonne comme un quatuor de Bartock. Une batterie, pour quoi faire ? A lui tout seul Matt vous recrée le mur du son de Phil Spector.

Ce serait dommage de ne pas profiter d'une telle architecture sonore. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se targuer d'être digne de vivre dans la Maison Dorée de Néron. Les Subway Cowboys ont de la chance – mais celle-ci ne sourit qu'à ceux qui se donnent la peine de l'attraper – possèdent un prince de la guitare. Deux mois que nous ne l'avions pas vu et il a encore affiné ses licks de tueur. Foudroyants. L'était déjà très bon. S'inscrit désormais dans les meilleurs. L'a acquis l'intelligence et l'instinct du jeu. Ses doigts se posent d'eux-mêmes, n'a plus besoin de les commander, car il agit depuis un espace mental supérieur qui structure toutes ses intuitions. L'est arrivé à une corrélation d'intentions totale, l'esprit ne commande pas plus au corps que celui-ci n'obéit à celui-là. Comme des navires qui voguent de conserve. Comme tout a l'air simple, on le regarde jouer et sa maîtrise est si grande qu'il nous semblerait facile d'en faire autant. Leurre de magicien.

Entre les deux Will. Pas du genre à se cacher pour se faire oublier. Qu'il le voudrait, qu'il ne pourrait pas, avec son organe turgescent, on le repère tout de suite. Ne peut pas ouvrir la bouche sans qu'aussitôt l'attention se focalise dessus. N'aime pas le yaourt, c'est du made in USA, d'importation directe. Mais timbré à son effigie. Tout ce qu'il touche il l'accapare. Sans le martyriser. Tape en plein dans le répertoire de l'americana, mais c'est si bien roulé que l'on n'a jamais l'impression, comme beaucoup d'autres, qu'il traduit avec de gros sabots bien de chez nous. Des godillots parfois sincères mais souvent pathétiques. Non, les versions des Subway Cowboys sont bottées de santiags d'origine ou de texanes d'importation. Mais elles sont comme la pantoufle de Cendrillon. Assez uniques en leurs genres pour exciter la convoitise de presque tous. C'est étrange, ne font que des reprises, avec par exemple ce soir l'accent mis sur Joe Hill, connues de presque tous, mais si bien foutues qu'elles semblent être des compos originales, tant leur interprétation sonne juste.
C'est un régal, on galope à fond de train derrière des bisons qui n'ont aucune envie de finir en boîtes de corn-beefs et le soir on écluse des décalitres de bière brune en pensant à toutes les filles blondes qui nous ont plaquées. Des vachardes, et il y en a un véritable troupeau. Très belle définition du honky tonk man, le mec entre deux vaches celle qu'il poursuit et celle qui s'éloigne... Une véritable postulation baudelairienne entre la réalité qui s'enfuit et le rêve qui s'évanouit. L'air de rien les Subway Cowboys sont en train de construire une phénoménologie du honky tonk.

Mais revenons à la concrétude des choses. Avec sa boucle d'oreille ce garçon tourbillonnant parmi les spectateurs ne pouvaient que se faire remarquer. Tant pis pour lui, Will le rappelle à son destin de batteur des SpunyBoys, Guillaume se fait un peu prier mais il consent tout de même tout en s'excusant à s'asseoir derrière la batterie des Ol' Bry, à l'écouter il n'y arrivera jamais, ce n'est pas tout à fait son style, peut-être mais il y prend du plaisir, et nous avons pour la première fois l'occasion de voir les Subway avec un drummer derrière eux. Court interlude car le trio reprend de plus belle sa course effrénée.
Un dernier morceau et c'est fini. Les métropolitains descendent de leur estrade sous des cris de regret. Encore ! Encore ! One more ! One More ! Mais l'heure c'est l'heure et de toute évidence sur terre comme sous terre le bonheur ne dure pas éternellement !
OL' BRY
Pas évident de passer après les Subway. Alors que chacun de ses acolytes se glisse à sa place Eddie tient à préciser que les Ol' Bry ont un sacré gant à relever. Pas d'inquiétude à se faire, le set sera aussi bon, bien que très différent. Comme quoi il suffit d'être soi-même pour emporter l'assentiment de tous. Et ce soir-là les Ol' Bry furent magnifiquement les Ol' Bry.
Résumé des chapitres précédents. Depuis leur création les Ol' Bry avaient leur particularité, le groupe rockabilly fortement influencé par le do wap. Flirtaient un peu avec les années soixante, les tempos d'enfer et les sirops d'érable au pur jus de betterave. Les mois ont passé et le son a évolué. Le groupe a trouvé la formule idéale. Eddie à la rythmique et au chant au milieu, Rémy le saxo à sa gauche et Diego à la guitare à sa gauche. Un peu comme Odin, le dieu nordique, qui se baladait avec un corbeau sur l'épaule gauche et un autre sur l'épaule droite. Trois grands bavards, le corbac on the left qui racontait le passé, l'emplumé on the right qui prophétisait l'avenir, et le Dieu in person qui livrait ses sentences de vie et de mort. Trois verbiageurs émérites mais qui avaient pigé que quand l'un parlait les deux autres se la bouclaient.

Pas question pour le sax et la guitare de se mettre aux abonnés absents, non mais ils y vont mollo-mollo – mezzo-soprano si vous désirez un terme musical – quand Eddie chante. En plus il ne se contente pas de vocaliser, il tape du pied comme un madurle, et maltraite sa guitare - qu'il tient très haut, à la Elvis des premières photos - tel un forcené qui arrache les barreaux de sa prison. A tel point qu'il fusillera le micro. Merci à l'ingé du son qui en improvisera un autre de fortune tout en assurant une parfaite sonorisation...
Quelques mois que je n'avais pas vu les Ol' Bry. Diego en a profité pour étudier. Pas la guitare, porque la toca muy bien, es un maestro, un matador, et vous auriez du mal à lui enseigner quelques trucs qu'il ne connaîtrait pas. Question mandoline, es un jefe. Un chef. Mais vient d'un pays étranger. Je ne parle pas en géographe. Provient carrément d'une autre planète. Du – tant pis je lâche le gros mot – infierno y damnacion – du jazz. Bref c'est un super musico, en connaît trois mille sept cent trente quatre fois plus que le guitariste moyen de rockab. A la différence près qu'il y a un esprit rockab que l'on n'apprend pas dans les écoles de jazz. Donc toutes ces dernières semaines l'a pointé ses oreilles sur les disques et les concerts rockab et comme c'est un super technicien il a retrouvé la notice de montage. En théorie c'est facile, en pratique c'est plus difficile. Alors que le guitariste de jazz n'en finit pas de nous éblouir, regardez-moi je suis le virtuose du quartier, je vous reprend le thème en la mineur et je vous l'étire durant dix minutes, le gratteux rockab n'occupe le devant de la scène que durant quinze secondes le temps de vous balancer un riff qui vous scalpe le cerveau et puis il passe le bébé à qui veut le prendre. Ne vous inquiétez pas, n'a pas jeté l'eau du bain, plus tard il vous en balance une louche à travers la figure, juste pour vous rappeler que sans lui votre vie deviendrait plus triste. Ne vous alimente pas en continu. Vous plante des injections de vitamine toutes les vingt secondes dans la chair, et vous donne de temps en temps une piqûre de rappel.

Et Diego qui a compris impulse une nouvelle sonorité au groupe. Plus rock, plus rockab. En contrepartie le sax a aussi intuité la leçon. Souvent en sourdine à l'huile, mais quand il intervient c'est d'une manière d'autant plus tonitruante, prend toute la place, mène un remue-ménage de tous les diables, bouche le port de Marseille, et puis retourne se calfeutrer dans sa boîte sans faire plus de bruit qu'une souris. Pour revenir avec des miaulements de chats affamés. Et Eddie au milieu. Concentré sur le chant, il envoie les modulations sans modération, sans se soucier de rien, sûr qu'à la première respiration, ou le sax ou la guitara reprendront le flambeau.
Juste un problème. C'est que comme dans les légions romaines en formation de combat il y a une deuxième ligne derrière. La section rythmique, basse et contrebasse. Avec les jeunes rockers faut se méfier, Thierry qui n'est pas né de la dernière ondée, a trouvé le poste idéal pour surveiller en toute discrétion son gamin. L'a ressorti sa grosse doudoune à manche de son étui et s'est adjugé le poste de contrebassiste depuis lequel il ne lâche pas son rejeton, Eddie, des yeux. En plus comme il lui faut démontrer que les fils ne vaudront jamais les pères il écrit et refile ses compos au groupe. Question cordage rien à lui reprocher. Si les trois zozos de devant peuvent se repasser le témoin à tout bout de champ, c'est bien parce que derrière, Thierry leur bétonne un tapis rouge d'arrière-fond. Il y a encore un batteur, Marcelo. Me suis déplacé plusieurs fois pour tenter de l'apercevoir, mais en vain. L'espace est si exigu que je n'ai pu apercevoir qu'une fois deux spatules de caoutchouc qui batifolaient en l'air. Par contre je l'ai entendu. N'a pas arrêté une seconde de monter la mayonnaise. La prochaine fois je me cacherai dans la grosse caisse pour lui repiquer la recette. Pour aujourd'hui croyez-moi sur parole. Jamais en défaut, et pas cette fixité rythmique propre aux groupes rockab qui peut devenir vite impardonnable si elle n'est pas associée à une onctuosité lyrique qui donne davantage de volume à chaque battement.
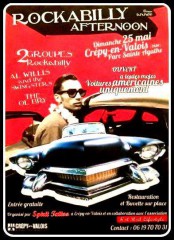
Un set féroce. Un Eddie trépignant, totalement à l'aise sur tout son répertoire. Des morceaux de leur premier CD mais dans des versions fiévreuses – North Side Girl, She Don't Care ou Let me dance – des classiques My Babe, Unchain My Heart, un You're sixteen superbement bien envoyé et j'avoue que je ne suis pas un grand fan de ce titre de Johnny Burnette que je trouve un peu trop midinette - et un I'm Comin' Home dédié à Mister B, très proche de la version de Gene Vincent grâce aux aboiements du saxophone de Rémy, mais aussi en hommage aux Ghost Highway qui ne sont pas là ce soir le somptueux Cause I Forgot écrit par Jull, et enfin, gâteaux à la crème chantilly sur les cerises précédentes, les nouveaux morceaux, enregistrés chez Mister Jull mais pas encore sortis, de véritables tueries qui sonnent plus rockab que tous les rockabs.
END OF THE ROAD
Minuit l'heure du crime. L'on coupe les micros et les rockers rentrent chez eux. Deux superbes concerts, l'on ne regrette pas d'être venus. Quand je pense que certains n'aiment pas les groupes français. Ne savent pas de quoi ils se privent. Subway Cowboys et Ol' Bry ont été magnifiques.
Damie Chad.
BOOKS
MARC SASTRE
L'HOMME PERCE / AUX BÂTARDS LA GRANDE SANTE
Fidèles lecteurs de KR'TNT, ne dites pas : Marc Sastre, inconnu au bataillon, ce serait mentir. L'on vous en a déjà parlé sur ce même blogue. Evidemment vous n'avez retenu que la moitié du fruit empoisonné que l'on vous tendait. Je vous excuse, Jeffrey Lee Pierce, ce n'est pas n'importe qui, les projecteurs des cerveaux humains ont tendance à focaliser sur sa personnalité, alors la bio au sulfure pas du tout biodégradable que nous avions chroniquée ( KR'TNT 160 DU 23 / 10 / 2013 ) vous avez oublié qu'elle était signée de Marc Sastre.

Me définirai personnellement plutôt comme un acrate que comme un anarchiste, mais ce n'est pas par hasard si ce dimanche 11 mai, je batifolais dans les allées du Salon du Livre Anarchiste. Recherchai Les Fondeurs de Briques, la maison d'édition qui fit paraître en version française Le Pays où Naquit Le Blues d'Alan Lomax ( voir KR'TNT 119 du 22 / 11 / 2012 ) et le J'effraie Lee Pierce du susdit Sastre Marc. Avec ces deux titres à leur actif, ces gens-là ne peuvent pas être totalement mauvais. La preuve, ils présentaient même quelques livres de poésie de Marc Sastre, assemblés en d'autres maisons.
Donc deux plaquettes de Marc Sastre parues en 2011et 2013, aux Editions les Cyniques. Un nom qui ne peut que plaire aux rockers, depuis que les Stooges et Iggy Pop nous ont expliqué l'ultimité de la philosophie cynique dans leur titre fondateur I Wanna Be Your Dog.

L'HOMME PERCé / MARC SASTRE
Vous suffit de regarder la couverture pour comprendre le contenu du bouquin. Pour ceux qui ne seraient pas versés en mécanique, vous avez la légende de la photo : engrenages à chevrons. Court d'ailleurs une étrange histoire à Toulouse sur l'inventeur du cardan à chevron, c'est un vieil ouvrier qui me l'a raconté lors de la pause déjeuner, mais je m'éloigne, d'autant plus que je n'ai pas donné le copyright du document : pas de surprise, Citroen Communication.
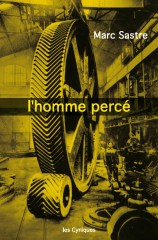
En plein dans la matière du poème. L'usine, l'atelier, le chantier, les différentes déclinaisons de ce que l'on appelle communément le travail. Pas celui qui rend libre. L'aliénation, l'exploitation, la servitude, les synonymes sont légion. L'homme percé, c'est l'homme usiné comme les pièces qu'il produit. Le travail est une lèpre qui manufacture le travailleur. Vous transformez la matière par votre travail, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, la grande métamorphose c'est l'homme qui la subit. N'oublions jamais que la transformation de l'homme équivaut à une déshumanisation. Le travail ne vous grandit pas, il n'est pas le chemin nietzschéen qui mène au Surhomme, il est amoindrissement et usure sans possibilité de retour à l'état neuf.
Tout cela Marc Sastre ne le théorise pas, il le dit, l'énonce et l'annonce, sans complaisance. La poésie comme témoignage de la désanthropologisation de l'individu. Point de salut, point de fierté. Ne mange pas les médailles en chocolat du bon travailleur qui s'est échiné et esquinté durant un demi-siècle à perdre sa vie pour gagner le droit de survivre économiquement.
AUX BÂTARDS LA GRANDE SANTE / MARC SASTRE
Les non-lecteurs se contenteront encore une fois de la couverture. Dessin d'Anne Martel – comme toutes les autres illustrations. L'en existe un autre semblable, cher aux rockers, le doigt dressé que Johnny Cash pointe sur vous. Le rebelle métaphysique vous ordonne d'aller vous faire foutre.

Ce recueil est plus tonique que le précédent qui ne vous laissait aucune échappatoire, fils de prolo tu es, fils d'esclave tu resteras. Forment tous les deux un diptyque. Ne vous faites pas d'illusion. Ce n'est pas : un, le mal ; deux, le bien. Même si ça commence bien. La révolte et l'éros. Deux bonnes addictions. Les nerfs opimes du bonheur et du bien-être. L'homme en marche vers sa liberté.
Un peu comme la nouvelle formation de Little Bob, les Little Blues Bastards. Pas dingue, le Little Bob, a assez bossé et vécu pour savoir qu'un bâtard heureux comme un chat de gouttière en liberté attrape aussi parfois le blues. Idem chez Marc Sastre, au début on relève la tête et l'on se croit assez fort pour conquérir le monde. Mais ce n'est pas si facile qu'il n'y paraîtrait. Ce n'est pas l'ennemi d'en face qui vous fait peur. La confrontation est prévue. Sera sanglante et l'on a toutes les chances de perdre. Mais le jeu en vaut la chandelle ( verte du père Ubu ).
Non, l'ennemi est en nous. Pire et mieux que cela. Nous sommes nous-mêmes notre ennemi. Le travail nous a façonnés à son image. Nous sommes, des bêtes de somme. Notre chair, notre peau, notre corps, notre pensée, sont altérés et édulcorés. La grande santé nietzschéenne nous la poursuivons, mais elle ne se laisse pas attraper. Ce qui s'installe en nous, c'est la maladie chronique de notre impuissance à changer le monde. Notre bâtardise rime avec vantardise. Nous sommes des guerriers vaincus, avant même d'avoir combattu.
Faudra tout de même faire avec nous-même puisque nous n'avons rien d'autre sous la main que nous-même. Les autres me ressemblant trop pour que je puisse en faire quelque chose. L'individu est un roi sans couronne. Mais un roi tout de même. J'ai intérêt à sortir de toutes mes contradictions et de moi-même. Si je veux me libérer de l'antique chaîne de l'esclavage, ne plus un être un chien d'élevage mais un bâtard au-delà de toute appartenance.
Deux recueils pour ne plus être dupe, ni de sa condition, ni de soi-même. Attitude rock par excellence.
Damie Chad.
00:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lisa & the lips, charlie west, orville nash, subway cowboys, ol' bry, marc sastre
15/05/2014
KR'TNT ! ¤ 189 : BUUTSHAKERS / ROCKIN JEP'S / BLACK PRINTS / GHOST HIGHWAY / LOREANN' / BIJOU
KR'TNT ! ¤ 189
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
15 / 05 / 2014
|
CIARA THOMPSON + BUTTSHAKERS / ROCKIN'JEPS / BLACK PRINTS / GHOST HIGHWAY / LOREANN' / BIJOU / |
LE HAVRE ( 76 ) / LE TETRIS / 20 - 03 - 14
THE BUTTSHAKERS
NOTHING BUT THE BUTTSHAKERS

Très courageux de leur part ! Les Buttshakers, apprentis sorciers basés à Lyon, jouent en première partie de Jim Jones. On est au Havre, terre de rock et visiblement, le public ne s’est déplacé que pour Jim Jones et son rock incendiaire à la Little Richard. Les Buttshakers s’installent sur la grande scène du Tétris, le nouveau «pôle de création» bâti sur les hauteurs du Havre, dans l’ancien fort de Tourneville. L’endroit flambant neuf en impose. L’architecte a vu grand et a taillé des portes étroites et très hautes dans les murailles, ce qui donne au lieu une allure de temple antique. Pour un groupe encore vert, jouer dans un tel endroit devant un public spécial, c’est une sorte de baptême du feu. On ne miserait pas un peso sur eux. D’autant qu’ils proposent un set de rhythm & blues, ce qui nous éloigne de Little Richard. Enfin, pas tant que ça.

Les musiciens du groupe paraissent très jeunes. Deux joueurs de cuivres, un bassiste, un guitariste et un batteur attaquent le premier morceau. La petite chanteuse black arrive dans la foulée et commence à haranguer la foule. Elle essaie de chauffer un public inerte et elle déploie une énergie considérable pour y parvenir, mais sans résultat. Tant pis. Elle enchaîne les morceaux, elle danse, elle shoute, elle gueule, elle miaule, elle fait tout le cirque habituel des grandes shouteuses de r’n’b à l’ancienne et elle s’en sort admirablement. Elle porte le cheveu crépu et une petite robe légère en tissu jungle. Elle danse bien et chante admirablement. Les musiciens qui l’accompagnent sont assez brillants mais désastreusement inertes. On songe aux pas de danse des musiciens de Vigon et à l’incroyable efficacité de leur numéro, lorsqu’ils sont alignés en rang d’oignons et qu’ils balancent ensemble une jambe en l’air d’un côté, puis de l’autre. Là, rien. Les mecs sont assez jeunes et ils restent concentrés sur leurs instruments. On dirait des fonctionnaires du r’n’b. Le bassiste joue au doigt avec le feeling adéquat. Le guitariste reste discret, comme il se doit. Il se contente de petites interventions sulfureuses. Leur set tient sacrément bien la route. La petite black fait le spectacle à elle toute seule. Elle tire tout le set à l’énergie et elle finit par mettre le public dans sa poche. Mais la fosse est loin d’être devenue une piste de danse. On assiste à une sorte de petit miracle, car le set dure assez longtemps, sans aucun passage à vide.

Impossible de résister à l’envie d’aller échanger quelques mots avec cette petite tigresse métisse. Elle signe ses disques à l’entracte. Vue de près, elle paraît encore plus jeune que sur scène. On lui donnerait quinze ou seize ans. Elle a des cernes brunes sous les yeux. On sent un petit personnage délicat et fragile. Elle s’appelle Ciara Thompson. Elle est originaire de Saint-Louis, dans le Missouri, et son français est parfait. Elle vit à Lyon depuis quelques années. Évidemment, on parle de Chuck Berry, originaire de Saint-Louis, mais on tombe vite en panne de références. Saint-Louis n’est pas Memphis. Elle vante les mérites de sa ville natale et avoue une grande admiration pour Jerry Lee Lewis. Wow ! Mais la conversation est difficile, car il faut sauter un fossé de deux générations, en matière de goûts musicaux, et il n’est pas certain du tout qu’on écoute le même genre de r’n’b. Je tends une perche avec Sister Rosetta Tharpe, mais elle ne sait pas qui c’est, ce qui peut sembler normal. Elle parle de gens que je ne connais pas. Elle appartient à la génération FaceBook et s’intéresse à des artistes plus contemporains et sans doute pas très connus. Et donc nos cultures respectives ne se recoupent pas, ce qui achève d’éteindre l’enthousiasme conversationnel. Heureusement, Jim Jones arrive sur scène. Good luck baby !

Les Buttshakers ont déjà enregistré deux albums. Au moins, ils ne perdent pas de temps. C’est l’occasion de revenir sur la plupart des morceaux du set qui étaient excellents. Ciara dispose d’une vraie voix et d’un sacré caractère, alors on peut écouter ces deux disques en toute sécurité.

La première chose qu’on note, c’est que line-up du groupe a changé entre les deux albums. Les gens qui jouent sur «Headaches and Heartaches» paru en 2010 ne sont pas ceux qu’on a vu sur scène au Tétris. Mais on ne trouvera aucune information sur la pochette de «Wicked Woman», le mini-LP qui vient de sortir et sur lequel on retrouve quelques morceaux joués sur scène.
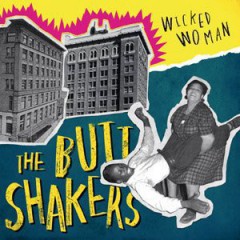
Le mini-LP se joue en 45 tours. Ça accroche dès le premier morceau. «Man’s World» est judicieusement tatapoumé. Pas le temps de souffler. Ciara fonce directement dans le lard du cut avec un chien considérable. Elle sait shaker le soul d’un cut, pas de problème. Elle connaît la ficelle de la hot soul et elle va chercher des accents dignes de Lisa Kekaula. Elle mâche bien ses attaques. Elle sait faire sa féroce. Les breaks d’orchestre sont parfois un peu prétentieux. En gros, c’est de l’excellente soul qui ne repose que sur Ciara. Le solo de guitare est un peu en retrait, la basse en avant, sèche mais pas aussi swingante que celle de James Jammerson. Globalement, elle s’en sort bien. «Nothing To Hold» est le slow-jerk entreprenant auquel les sixties nous avaient habitués. Le morceau manque singulièrement d’éclat, c’est cuivré à la lyonnaise, sans allant, mais elle tient bon, elle ne lâchera pas. C’est un peu comme si elle engageait son honneur dans cette histoire. Elle y met tout son héritage génétique et toute sa classe. Elle sait mettre sa glotte au carré. Elle gueule quand il faut. Ciara sait s’imposer. Pas question pour elle de jouer les incomprises ni les inhibées. Elle se débrouille toute seule, comme on le lui a appris quand elle était petite. Le dernier morceau de la face A s’appelle «A Way To Get By». Il s’agit d’un slow blues vaguement inutile.

Avec la face B, on passe aux choses sérieuses. «Wicked Woman» est une perle à la James Brown, montée sur un riff de basse astucieux. Ciara se sent chez elle. Elle navigue en eaux claires. Elle peut arracher. Elle peut même pulser le beat. Derrière, ils sont bien. Le guitariste joue avec les petits accents funky auxquels les Blue Flames nous avaient habitués. Étonnant, car elle n’a pas la voix de son âge. Pour une gamine, elle dispose d’un coffre relativement imposant. Elle sait écraser le champignon quand il faut. On sent qu’elle marche à l’instinct. Chez elle, le shout est inné. Elle fait partie des meilleures Soul Queens contemporaines. Ses accents sont bien rauques. Elle l’emporte à chaque instant. Tout amateur éclairé de soul sera surpris par la verdeur de sa hargne. Elle est d’une crédibilité stupéfiante. Et voilà la grosse reprise, le «Tell Mama» de Clarence Carter, bouffé tout cru, jadis, par Etta James pour Chess. Ciara chevauche la bête sans problème. Elle entre résolument dans l’âge d’or. C’est du pur Stax sound Chessisé. L’excellence incarnée. Ça réchauffe le cœur. On replonge dans la magie des temps bénis, avec l’éclat et l’énergie d’alors, même si la basse sonne un peu pépère, mais ce n’est pas si dramatique. Ciara sait allumer son «Tell Mama», joli coup. Il lui faudrait les Memphis Horns derrière et Andre Williams comme producteur. Ah, on verrait la différence ! Dernier morceau de ce mini-LP : «The Start». Digne d’Aretha. Ciara mène bien le jeu avec sa poigne de fer. Elle embarque son monde à la seule force de sa rage soul. Le morceau est un peu biscornu, quant aux ponts, mais elle s’en sort bien. Solo dans le fond du studio. On n’est pas chez les BellRays. Il ne faudrait pas confondre.

C’est sur le premier album que se trouvent les choses vraiment sérieuses. «Headaches And Heartaches» est sorti en 2010 et les Buttshakers ont pas mal roulé leur bosse depuis. Pas de reprises sur cet album, mais en gros, on se retrouve avec dix hits de garage soul vraiment très impressionnants. Son énorme sur «You Talk Too Much». Ciara donne une sacrée ampleur au cut et derrière elle, les cuivres sont excités. Elle va chercher le guttural pour livrer une pièce de soul torride. C’est monstrueux et battu à la diable. Digne des géants. Elle chante avec une maturité sidérante. C’est du Aretha en colère. Elle a même encore plus de chien enragé, c’est une véritable battante de la soul. Avec «I’ve Been Abused», on entre dans la soul par la grande porte, avec un jeu de guitare killer. Ciara dépote sa soul. Elle tue les mouches au scortch. Backing idéal, salement bon. Elle fait régner sa loi, pas de pitié pour les canards boiteux. Ciara Thompson est tout simplement énorme de génie soul. On entend le bassman emmener un couplet. Évidemment, ce n’est pas celui qu’on a vu au Havre. Celui-si s’appelle Fabien Giamina. Il est redoutable. Puis ils nous trashent un slow à la guitare. Ce guitariste s’appelle Julien Masson et il co-écrit quasiment tous les morceaux avec Ciara. Retour à la monstruosité avec «Hey Hey», encore plus garage-soul que le garage-soul des BellRays. On admire une fois de plus la haute teneur du cran de la petite Ciara. Ce blast a l’allure d’un hit. Dingue et dur. Bien poundé, bonnes guitares et cette voix de reine de la soul qui hante les épidermes. Elle s’accroche, elle a le culot d’une diva, elle a le poids d’Aretha et la puissance d’Etta James, mais avec encore un truc en plus, un côté teigne qui évoque celui de Lisa Kekaula. Elle nous sonne véritablement les cloches. Dès l’intro de «Losin’ It», elle percute de plus belle. Elle n’est pas aussi ronde que Lisa Kekaula, mais elle a exactement le même genre de chien de sa chienne et le même genre de classe, celle d’une vraie shouteuse. «(On The Verge Of) Falling In Love» reste dans le même esprit, celui de la puissance effarante. Il ne faudrait pas prendre Ciara Thompson pour une débutante. Elle claque le beignet de la soul quand elle veut. Elle peut même rivaliser avec Wilson Pickett. «Headaches & Heartaches» arrive comme une nouvelle énormité, avec des chœurs à la Motown et une section de cuivres à la hauteur du mythe. Si on est pas encore tombé de sa chaise, c’est le moment ou jamais. Voix de rêve, chœurs insistants à la revoyure, tout est là. C’est un hit qui a rendez-vous avec l’histoire, c’est indescriptible de soul-shaking, elle nous sert tout ça sur un plateau d’argent. Cette folle est bourrée d’un génie qui sort d’elle par tous les pores. Pour finir, ils envoient un boulet nommé «You Got Me Movin’» qui nous démâte. Sacrée Ciara, elle se bat jusqu’à sa dernière goutte de sang. C’est elle la grande battante du XXIe siècle. D’ailleurs, elle s’est fait tatouer deux grenades sur le haut de la poitrine, un peu en aval des épaules. Cette pièce de soul est une fois de plus une sorte d’énormité déterminante. Elle est superbe et conquérante. Il arrive que la pure magie et l’incroyabilité des choses se croisent sur certains disques. Si par chance on surprend ce phénomène irrationnel, il faut savoir en profiter, comme on profite d’une belle matinée de printemps.
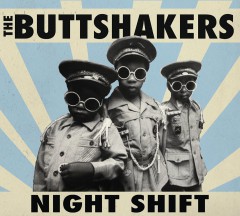
Et pouf, en passant l’autre jour devant le mur des nouveautés chez Gibert, je vois le nouvel album des Buttshakers qui me tend les bras et qui me crie : «Prends-moi, s’il te plaît, prends-moi !» Bon alors attention : ce disque est une bombe atomique. «Night Shift» s’ouvre sur le morceau du même nom et on découvre un groupe encore plus agressif que les BellRays. Ciara est déchaînée. Elle fait éclore le bouquet de soul-garage le plus sauvage de l’histoire du rock. On a même droit à de la guitare fuzz. Ciara chevauche ce monstre sans selle à travers l’histoire et le temps, comme la reine des steppes de la soul en feu. S’ensuit «I Wanna Know», plus funk. Comme ils n’ont pas d’histoire véritable - pas de rencontre avec Sam Phillips ou de carrière californienne, par exemple - les Buttshakers dépendent essentiellement de la qualité de leurs compos. Et ça ne tient que grâce au soul power de Ciara Thompson. Elle a le punch de Cassius Clay. Nouveau punk blast avec «Your Love Is Amazing». Ciara la lionne ravage les contrées, c’est renversant et dynamité au scream. Pur génie. En écoutant «Satisfied», on cherche à qui on pourrait comparer Ciara chez Stax, mais aucune des géantes de Stax n’a ce type de punch extrême. Elle arrache au chant avec une force indescriptible. L’autre coup de génie de cet album s’appelle «Get Your Blues». C’est stompé d’avance. Ça part en swing sur une ligne de basse infernale et athlétique - gimme a rhythm while I can stick with you - elle va chercher le rythme avec une force terrible. C’est une superbe pièce d’aventure musicale reprise à la trompette, arrosée au groove de basse, emmenée dans la démence de la fragrance. Elle met tellement de vie dans les morceaux qu’elle finit par fasciner, comme nous fascinent les très grands artistes du genre.
Signé : Cazengler, le buttshaké du bulbe
Buttshakers. Le Tétris. Le Havre (76). 20 mars 2014
Buttshakers. Headaches and Heartaches. BackToMono Records 2010
Buttshakers. Wicked Woman. Copase Disques 2013
Buttshakers. Night Shift. Youz Production 2014
ROCK IN GOMETZ LE CHÂTEL
10-05-2014 / Espace Culturel Barbara
ROCKIN JEP'S / BLACK PRINTS
GHOST HIGHWAY

Je maugrée, tout pour être heureux, le grand Phil à coudre au volant de sa toto-ride, un GPS encore plus performant que l'ordinateur de 2001 Odyssée de l'Espace, la copine derrière, et un concert en prévision droit devant à cent kilomètres. Mais un orage de grêle me force à rentrer mes jambes que je laissais benoîtement pendre à l'extérieur de la portière par la vitre grand-ouverte. Je ne voudrais pas me fâcher avec le syndicat d'initiative de Gometz Le Château mais aucun panneau indicateur n'arbore le nom du châtel à la gomme, toutefois après avoir tourné quelque peu en bourrique dans les ronds-points, l'on tombe enfin dans le patelin. Des malins, ils ont fourré le centre culturel en plein centre commercial – qui a dit que la culture n'était pas une marchandise ? - au moyen-âge ce devait être entouré de douves profondes, ils les ont remplacées par des parkings à perte de vue. Moins poissonneux, mais idéal pour se garer. Je fais semblant de pas entendre ma meufette qui remercie Phil qui n'a pas, lui, une conduite heurtée, comme sur du velours qu'elle dit. Ne perd rien pour attendre mon gant de fer. Barbelé.
Entrée en douceur dans la salle d'accueil, avec marchand de disques et de babioles rock – tiens, un pin's de Vince Taylor et de Gene Vincent que je n'avais pas – ils ont les mêmes en magnet, pour ceux qui veulent tagger leur frigidaire aux profils de leur passion. Plateau sandwich à six euros, avec volet détachable pour le café – mais où s'arrêtera le progrès humain – une orga à vos petits soins, beaucoup de têtes connues, une bonne proportion de jeunes. La fête peut commencer.
THE ROCKIN JEP'S

Je rentre dans la salle juste comme ils démarrent. Rockin' Nicolas me saute aux yeux. Je savais qu'il était porteur de guitare dans le trio de Jamy, et tout dernièrement dans le groupe de Miss Victoria Crown en compagnie de Zio, et le voici maintenant lead guitar parmi les Rockin Jep's. Les aiglons ont tendance à prendre leur envol. Lui reste encore un peu de timidité, mais elle est en train de mettre les voiles, il va assurer sans problème, je ne lui donne pas six mois pour parvenir à atteindre une certaine autorité. C'est que les autres ne sont plus des perdreaux de l'année. Pointent à la génération précédente, mais le vin qui a mûri n'est pas du tout désagréable à boire.

Le set sera très court. Viennent tout juste de se former et pour le rappel on les obligera à rejouer un morceau. Trop modestes, étaient prêts à s'éclipser, mais les rockers c'est comme les enfants, quand vous leur donnez des gâteries, ils n'en ont jamais assez. Et il faut reconnaître que c'était si bien mis en forme que l'on y a pris goût très vite.

Eric Ozenda est à la caisse claire. Son jeu se fond dans dans la contrebasse de Patrick Millet. Celui-là tout petit il a dû tomber dans l'instrument, peut-être même que ses parents se sont servis d'une vielle carcasse de double-bass comme berceau. L'astique méchamment. L'on a l'impression qu'il est partout à la fois. Pas besoin de chercher l'intrus, présent sur tous les plans, les trois s'en sont aperçus, et ont donc développé une stratégie idoine. Aucune envie d'être aux abonnés absents. Lui laissent toute la place qu'il veut mais hors de question de le laisser bargouiner tout seul. Sont sans cesse là, Ozenda à rendre coup pour coup, un battement de corde immédiatement suivi d'un claquement rebondissant de peau, Rockin Nico n'arrête pas de planter les banderilles électriques, à la n'oublie pas que c'est moi qui ponctue l'histoire et qui souligne la fin des phrases. Ne s'en laisse pas compter. Quant à Jacques Marin, il se sert de ses deux armes à la fois, la voix et la guitare rythmique, faut entendre comme ça mouline quand il lance l'attaque et soutient la charge aussi longtemps que nécessaire. Combo à tombeau ouvert.

Je m'amuse à regarder le jeu de Patrick, la main droite qui vibrionne au niveau du ventre de sa chérie bobonne, jusque là, tout est normal, c'est à gauche que le spectacle est fascinant. Pendant que de l'autre côté il mène la chasse à courre avec la meute des chiens de l'enfer à ses côtés, il pince le haut du manche, et doucement, avec une lenteur de reptile qui s'approche de sa proie sans éveiller son attention, il descend son doigt, sur la corde extérieure, qui glisse comme une menace insidieuse... Pratiquement immobile mais imperturbablement en mouvement, à l'image d'un insupportable suspense apocalyptique. Les Rockin Jep's rockent à merveille. Un début plus que prometteur.
BLACK PRINTS

Intermède court. There's Rock'n'Roll On The Radio. Gros mensonge. C'est sur scène que ça se passe. Accrochez-vous car ça décoiffe. Yann détonne. Dans tous les sens. Une chevelure sur le mode toison d'ours hirsute – la moins gominée de tous les groupes du circuit rockab de l'hémisphère nord, mais j'adore les individus libres qui ne rentrent pas dans le moule – et une frappe lourde comme un paquebot. A côté, tout ce que vous pouvez trouver de plus classique, Thierry Clément – son sempiternel chapeau de cow-boy – attention, de ces pistoléros qui ont traîné leurs santiags dans tous les sanglants corrals de l'Ouest - tambourin au poignet ou washboard à hauteur de poitrine, c'est au choix mais quand on entendra son solo sur la planche à laver, ce sera de quoi faire frémir toutes les ravaudeuses de l'ancien temps dans leurs tombes... question dés – de ceux qui n'abolissent pas le hasard mallarméen - quand il pousse ce n'est pas au 421 qu'il joue, plutôt à la puissance mille. Etrange ces Black Prints qui allient la frappe canonnière la plus lourde à la cavalcade des chevau-légers de la Maison du Roi. L'obusier et le lance-pierre. Un heureux mariage, une grêle de cailloux après le coup de masse sur la tête, tout compte fait ça réveille.

Pas de contrebasse. Une simple basse électrique – les Black Prints ne sont pas des orthodoxes – confiée à Jean-François Marinello, en joue de tout son corps, pas une note qu'il n'en extraie sans une participation de tous ses muscles qui tour à tour se plient et se détendent. Va la chercher très loin, au plus profond de sa chair et l'expulse comme s'il envoyait une partie de son être en exil. De loin vous penseriez que c'est le guitariste soliste dans les affres labyrinthiques de la création de son plus beau solo. Mais non, ce n'est qu'un bassiste qui arrache chaque note de son coeur comme si sa vie en dépendait. Soucieux de se dépasser à chaque instant.

Et puis il y a Olivier Clément. L'arbre dans la tempête. Avec les trois autres forcenés, tous les naufrages seraient possibles. Il est si facile de dérégler l'horloge du rock'n'roll ! Mais Olivier est là, debout, droit dans ses bottes et dans son futal de cuir noir qui grandit encore plus sa silhouette élancée. Satanée prestance. La classe, qui impose. A la guitare et au chant. A la rythmique et à la lead. Assure les deux. Le métronome et l'explosion. La braise et la flamme. Sans effort apparent. Bouge à peine ses doigts. L'on se demande comment il fait pour être aussi précis. Remue imperceptiblement son index et son annulaire et il vous assène un solo à la Buddy Holly, quand tout se met à balancer autour de vous et que ça tangue méchamment d'un bord sur l'autre. En anglais, c'est beaucoup plus vite dit, ça s'écrit en trois mots – et encore on supprime des lettres – c'est : rock'n'roll. Nous y sommes en plein. Dans le coeur noir le plus profond du rock'n'roll. Baby Let's Pay House, Jeanie Jeanie, les classiques défilent, un à un, méthodiquement, ne vous pressez pas, il y en aura pour tout le monde, mais aussi les morceaux originaux comme Two Tones Shoes et l'ensemble de leur album en fin de parcours.

Inexorables. Les Black Prints c'est toute l'histoire du rock'n'roll qui défile, le passé et la toute récente, rien ne peut les arrêter. Je suis une force qui va, disait Victor Hugo. Le roc qui dégringole de la colline et qui emporte tout sur son passage. Vous emmènent avec eux. Et ils en rigolent. Echangent des regards malicieux, tiens une intro de guitare un peu étirée pour que tu ne saches pas où je veux en venir, et cette ouverture fractale sur les deux toms, tu t'en souviens, retombent toujours sur leurs pattes comme le Stray Cat Strut qui longe les gouttières.

Une version de Brand New Cadillac à vous faire courir chez le concessionnaire pour vous commander exactement la même – merci Vince Taylor, mais ce n'est que le début. Olivier invite Thierry Credaro à les rejoindre sur scène, vont nous offrir la plus splendide interprétation de Shakin' All Over que j'ai jamais entendue, de Johnny Kidd annoncera Olivier, je serais tenté de préciser de Joe Moreti, le guitariste qui officiait déjà sur la Cadillac de Vince – pas étonnant que ce dernier ait repris ce bijou avec ses Play-Boys – Thierry et Olivier se complètent merveilleusement à la guitare, aucune opposition, chacun essayant d'amplifier les effets obtenus par son coéquipier. L'on aimerait que ça ne se termine jamais, qu'ils reprennent indéfiniment le solo et le pont jusqu'à ce que le jour ne se lève plus. Le public est en transe. Sans doute le moment le plus fort de la soirée qui n'en manqua pas.

Thierry redescend sous une salve d'applaudissements et les Black Prints enchaînent sans coup férir. Manière de parler, car sur sa batterie Yan est un meurtrier fou, a killer on the road. Plus l'heure avance plus il se permet des breaks zarathoustriens, des ponctuations démesurées aussi meurtrières que des icebergs ballotés par une tempête de force 10. Et Olivier, le chêne qu'aucun aquilon ne détrônera, réengage à chaque fois les hostilités avec un nouveau titre encore plus venimeux que les précédents. Train Kept A Rollin et Rock'n'Bop Blues pour clore les festivités. Un set historial.
Vous n'y étiez pas. Vous le regrettez. Méritez-vous de vivre ?
GHOST HIGHWAY

Plusieurs mois que nous n'avons pas vu les Ghost. La vie d'un groupe n'est pas un long fleuve tranquille. Zio est parti – accompagne maintenant Miss Regina Crown. Nous ne nous faisons guère de souci pour lui, depuis les TeenKats, il s'est toujours débrouillé pour être là où ça se passe. Nous sommes prêts à le suivre dans ses nouvelles aventures. Mais ce soir, ce sont les Ghost Highway qui monopolisent notre attention. N'ont pas choisi une demi-pointure pour remplacer Zio, ni plus, ni moins que Thibaut Chopin. On ne le présente plus, l'a participé à tant de groupes, de concerts et de rencontres qu'il faudrait y passer la nuit pour tout raconter.

A première vue, c'est la même chose, démarre par les titres habituels, mais à deuxième oreille, plus rien n'est pareil. D'abord se rabattre sur Phil, car c'est lui le continuateur sonique du groupe. C'est bien sa frappe qui est à la base des Ghost. Et ici à Gometz le Chatel nous nous en rendons compte pour une raison évidente, le son de base est plus ample, plus fort qu'avant. Ce n'est pas une question de potentiomètre qui virerait dans l'écarlate. Mais un parti-pris de jouer davantage en rentre dedans, en libérant encore plus d'énergie.

Confirmation, dès que Mister Jull lance ses premiers accords. Beaucoup plus électrique. Dans ses interventions, car selon son habitude il envoie le riff comme on lâche les chiens, et puis on les rappelle aux pieds du maître pour qu'ils se calment un tantinet et laissent un peu de place pour la compagnie. Mais cette fois ça cingle et ça gicle avec beaucoup plus de brutalité. Un peu comme si Jull avait dépassé sa hantise de l'authenticité originelle pour une immédiateté beaucoup plus efficace.

Du coup Arno ne tient plus en place, encore plus d'humour pince-sans-rire au troisième degré que d'habitude et une façon de chanter, moins vieux sud profond, et quand il tire son harmonica, c'est davantage western italien que hillbilly primitif, ou avec des inflexions bluezy plus appuyées.

Mais c'est Thibaut que vous voulez voir. Le voici dans son costume marron clair, Arno en a enfilé un marron crème brûlée et Jull est engoncé dans une veste d'un jaune automnal. A franchement parler, ce n'est pas trop rock'n'roll, mais heureusement nous ne sommes pas à un défilé de mode. Il est indéniable que Thibaut est un pro. Joue sans avoir l'air d'y penser comme si son seul souci était de coller aux Ghost sans chercher à se montrer. Abandonnera sa réserve peu à peu. Finira par emporter les coeurs sur un solo avec tourniquet de ses deux avant-bras autour du manche. Le truc apparemment très simple, facile à décomposer, mais qui demande une aisance et une expérience que l'on devine durement acquises au fil des années.

Question apport au groupe, je parlerai d'un contact plus swingant et plus rythmique, très loin du ce bruit de fond qu'instillait Zio, un peu comme cette rosée sonore tombée des étoiles qui serait selon certains rêveurs la rumeur anonyme de notre univers qui se meurt. Peut-être est-ce pour cela, pour pallier le bourdonnement ondoyant de Zio que les Ghost ont dû en quelque sorte hausser le son. Mais ce n'est pas sûr. Les prochains concerts auxquels nous assisterons nous aiderons à mieux comprendre. Car il est certain que les avancées de Mister Jull à la guitare sont si évidents que le reste du combo se doit se mettre à l'unisson de cette montée en puissance des riffs qui exigent pour être mieux entendus et déployés ce que nous appellerons une surconsommation d'électricité.

Set un peu court mais tout de suite suivi du final habituel. Going up to the country couplé avec Johnny Law, tandis que Thibaut vient s'assoir sur le bord de la scène bientôt rejoint par Jull et Arno. Avec reprise à fond les manettes pour finir en beauté. Sortent sous les applaudissements de la foule. Les Ghost Highway ont convaincu. Ont fait preuve d'une redoutable efficacité. Le groupe a encore progressé. Vraisemblablement en phase intermédiaire. Le public sur le pied de guerre pour la conquête de nouveaux territoires.
FEU D'ARTIFICE

Plus de dix personnes sur scène, Jull, Arno, Thibaut, Olivier, Thierry, Rockin Nico, Thierry, Eric, Patrick et les autres. Le miracle c'est que très facilement tout le monde trouve ses marques et la formation quasi symphonique se lance pour un boeuf pas un poil cacophonique mais musqué et géant. Martchbox, sur lequel Thibaut pose des vocaux très appréciés, My Babe que Willie Dixon a volé à Sir Rosetta Thorpe, et un dernier petit Cochran, juste pour la route... Que personne n'a envie de reprendre, trop belle soirée, rock'n'roll jusqu'au bout des ongles.
Ne reste plus qu'à attendre l'année prochaine, car l'orga boostée par ce premier succès parlait déjà de Rockin in Gometz le Châtel 2.
Damie Chad.
( Photos prises sur les facebook des artistes / Merci à Martine F. )
10 – 05 – 2014 / PROVINS
LE CESAR / LOREANN'

Le 26 avril on a fait la tête, les tauliers du César étaient partis en vacances, mais le 03 mai, on a failli faire un esclandre, le café était ouvert, la terrasse exposée au soleil, mais Loreann n'était pas là. Elle a osé nous faire cela à nous, Phil, Richard, Damie, nous priver de notre apéro-folk du samedi matin, et nous laisser le bec dans l'eau du pastis, ah ! La drôlesse ! Mais ce matin, elle est revenue se faire pardonner. Nous avons été magnanimes – nous n'aurions pas pu faire autrement tellement sa voix nous enchante, mais ne le lui dites pas – toutefois la punition divine ne s'est pas faite attendre : pluie continuelle toute la matinée. L'on a poussé les étuis à guitare sous l'auvent et emballé la sono dans de grand sac poubelles.
Et puis nous l'avons lâchement abandonnée à son triste sort de chanteuse de rue, réfugiés à l'intérieur du troquet autour d'une boisson fumante, béatement bercés par la douceur de cette voix susurrante, la salle toute en longueur se révélant être une magnifique chambre d'écho... C'est alors qu'à la table juste derrière j'ai aperçu Dominique. Fille d'une famille éclectique, la soeur chante du rhythm'n'blues à plein gosier, le frère de la trompette jazz ( nul n'est parfait ) la nièce du slam, mais Dominique, elle c'est le country et le folk. J'ai vite remarqué – c'est parce que je suis très intelligent – que la voix de Loreann' ne la laissait pas indifférente, même qu'elle commençait à citer les titres et à fredonner les morceaux. Bref un quart d'heure plus tard sans trop user d'une douce violence je l'ai traînée jusqu'au micro de Loreann'. Petits papotages entre filles, et bientôt elles attaquaient Neil Young.

Très intéressant à écouter, elles ont un peu le même répertoire mais ne l'abordent pas de la même manière, Dominique partisane d'une attaque un peu plus franche, un peu plus enlevée – que ce soit sur les cordes de la guitare ou vocales – et Loreann' se restreignant dans une certaine moiteur du chant et de l'orchestration, davantage intimiste et beaucoup moins intempestive. Très proche de cette ambiance étouffante des chaleurs du vieux sud, cette pesante atmosphère que l'on retrouve dans les romans américains de Julien Green. Dominique, plutôt fille des fraîcheurs matinales de l'eau du Mississipi.
Dominique se sauve à l'intérieur du café, mais au bout d'un moment on la retrouve au bord du micro, à chantonner et discuter avec Loreann'... C'est cela Loreann', une voix qui s'immisce et qui vient vous chercher, et qui ne vous lâche plus... Longtemps que Dominique n'avait chanté, mais Loreann' réveille les mélancolies et ravive les regrets. Malgré la pluie, des passants hâtifs s'arrêtent et restent quelques minutes figés en eux-mêmes, puis s'ébrouent comme pour s'affranchir de leur rêve et reprendre le chemin de leur existence anonyme...
Vous pouvez désormais retrouver Loreann' sur www.loreann-music.com ou sur son facebook, loreann Torn . Nous sommes trop gentils avec vous !
Damie Chad.
BIJOU
VIE, MORT ET RESURRECTION
D'UN GROUPE PASSION
JEAN-FRANCOIS JACQ
( L'ECARLATE / Avril 2014 )
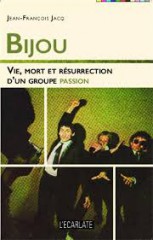
Beau cadeau dans les nouveautés de la semaine. Un livre sur Bijou. Je passe commande sans réfléchir. Sur la photo, le livre ne paraît pas très épais. Enfin mieux vaut une petite monographie que rien du tout. Juste une illusion, une fois dans la main, il pèse son pesant d'or. Logique, Bijou ce n'est pas de la pacotille, et le bouquin avoisine les trois cents pages, c'est rempli de textes à ras-bord, un cahier photos inédites au milieu, et une belle préface de Laurent Chalumeau.
Bijou a brillé de mille feux, mais le coffret refermé, le diadème s'est terni, et on l'a un peu oublié. Et pourtant, Bijou fut en quelque sorte le premier groupe français. Entendons-nous, chronologiquement l'a été précédé d'une myriade d'autres, question ventes il n'a pas vraiment cassé trois pattes à un canard. Non, Bijou a été le premier groupe français à faire jeu égal avec les anglais. Les âmes chagrines et les esprits requins jetteront Magma et Little Bob Story aux deux premières places. Pour Magma la question sera vite réglée, un orchestre kolossal, mais qui officiait dans une sphère musicale très éloignée du rock'n'roll, quelque part entre Stockhausen et le jazz d'avant-garde. On peut les laisser en orbite sur la planète Kobaïa, ils y sont très bien et à leur place. Little Bob est un concurrent plus sérieux. Jean-François Jacq ne peut s'empêcher de lui jeter quelques piques, l'est vrai que le prétendant à la couronne du rock français n'est pas sans quartier de noblesse, mais sans vouloir rallumer la guerre de cent ans, il faut se rappeler que Little Bob a choisi de s'exprimer, le traître, en anglais. Qui est la langue naturelle du rock'n'roll, mais enfin nous parlons de rock'n'roll français !

Le rock'n'roll français doit-il être chanté en français ou en anglais ? Question sans intérêt, que ce soit en langue shakespearienne ou rabelaisienne, débrouillez-vous pour que ça sonne bien. Faites comme vous le sentez. Oui Bijou s'est exprimé en français, naturellement serait-on tenté de dire, mais s'il s'est imposé à son époque si facilement aux groupes anglais, cela tenait beaucoup plus à ses qualités intrinsèques qu'au fol langage de François Villon.
UN GROUPE FRANCAIS

Le bon vieux terroir national. Rien à voir avec la France agricole et paysanne. La banlieue Sud, Savigny-sur-Orge, Juvisy, Longjumeau, à la fin des années cinquante et au début des sixties on y plante des HLM, et on récolte toute une génération de rockers. Des rockers français, bien de chez nous, qui écoutent Gene Vincent et Johnny Hallyday, tous petits ils s'accrochent à leurs transistors comme à une bouée de sauvetage, le monde peut changer, eux ils resteront rock jusqu'à la fin de leur vie, et même s'ils se marient et se rangent, car ils ont transmis le flambeau aux petits frères... Blousons noirs et Golf-Drouot, le rock n'a pas dix ans d'âge qu'il possède déjà ses mythes et ses légendes.

C'est en ces lieux que grandissent les futurs mousquetaires de Bijou. Sont encore des cailloux mal dégrossis, mais ils vont persévérer. L'on n'atteint pas à la brillance souhaitée, sans rouler quelque peu sa bosse dans le lit torrentiel du rock'n'roll, de groupe en groupe, d'expérience en expérience, des mois et des mois de galère, de répétitions, de concerts improbables avant de maîtriser son instrument, et d'intégrer tout l'héritage de la culture rock, des Chaussettes Noires aux Pub Rock, des pionniers au prog, les tsunamis se succèdent, rock instrumental des rosbeef, British Blues, révolution hendrixienne... un groupe phare tous les trois mois, sans oublier les cuivres de chez Stax, le glam, la décadence et la naissance du hard, et n'en jetez plus. Plus qu'il n'en faut pour une oreille humaine. Heureusement nous possédons un cerveau qui permet de prendre du recul, d'analyser, de rejeter de choisir...

Au final ils se retrouvent à quatre. Comme les mousquetaires. Trois plus un. Dynamite à la batterie, Vincent Palmer à la guitare, Philippe Dauga à la basse. Formule minimale. Ils avaient un chanteur. S'en sépareront quand la mayonnaise commencera à prendre. Pas par méchanceté. Par nécessité. L'alcool l'a rendu trop instable... C'est un plus, le groupe se ressoudera d'autant plus sur lui-même. Sont trop peu nombreux pour ne pas faire bloc. Si en 1975 le groupe percutera si fort c'est avant tout grâce à cette cohésion orchestrale durement acquise, engoncés sur eux-mêmes comme un poing fermé qui vous désarçonne au premier coup. C'est un moins, le chant restera la grande faiblesse de Bijou, pas que Palmer et Dauga qui s'y collent aient démérité, mais à la base ce ne sont pas des chanteurs.

L'en reste un, Jean-William Thoury, l'homme à tout faire ( ce qui laisserait supposer que les autres ne feraient rien ) chauffeur, parolier, un oeil sur les projos, une oreille sur la sono... De visu pour un peu on le prendrait pour le larbin de service. Mais c'est la tête pensante, pas celui qui réfléchit à tout pour ne rien oublier, non le stratège. Celui qui a tout compris, que dans un groupe de rock, les musiciens ne sont que la cinquième roue de la charrette, s'ils avancent au petit bonheur la chance, saisissant les occasions quand elles se présentent. Alors que l'on se doit de savoir à l'avance ce que l'on veut. On ne profite pas de l'opportunité des circonstances, on la crée de toutes pièces. Le rock est une question de maîtrise. L'on calcule la musique, on définit l'image, on n'avance jamais à l'aveuglette. On pourrait le comparer pour la partie d'échec qu'il entreprend avec le monde du showbizz à Malcolm McLaren, le prodigieux metteur en scène des Sex Pistols.
INTEGRITE ROCK

A part que Jean-William Thoury – en parfait accord avec les trois autres – ne désire aucunement monter l'arnaque rock'n'roll du siècle. Refusent d'être des escrocks. Entendent simplement être et devenir ce qu'ils sont. Au grand jeu du poker menteur de la vie, ils posent tout sur la table : chantent en français parce que yaourter en anglais est peut-être plus difficile et moins évident, et quelque part une manière de se singulariser tout en restant fidèle à soi-même par rapport à tous ces french group qui scandent in english. L'idiome comme une ligne de démarcation, et comme affirmation non négociable.

Normalement les maisons de disques devraient se précipiter, elles qui s'obstinent à ce que leurs artistes soient accessibles à la plus large portion du public. Il n'en fut rien. L'on n'apprend pas à un voleur à se faire prendre. Les majors ont du flair, ces quatre zozos ont bien d'autres idées derrière la tête, vont vouloir tout diriger, le contrôle total sur leur production. Le Thoury n'est pas un touriste qui se laissera manoeuvrer facilement. Elles se méfient.
Mais Jean-William s'entête, il veut une major. Ou rien d'autre. Pas de minuscule label qui n'offrirait pas un studio digne de ce nom, même pas Skydog de Zermati, le label rock par excellence, car trop connoté pour un public de spécialistes et aux garanties de distribution improbables... Veut être présent sur l'ensemble du territoire. Les musicos le méritent.

Et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne. Bijou n'a pas enregistré un seul disque que déjà son nom circule dans toute la province – j'en peux témoigner pour la ville rose de Toulouse – sur la foi de rares témoins qui ont eu la chance d'assister aux premiers concerts. C'est que les amateurs de rock bouillonnent. L'on sent que quelque chose est en train de monter, que les New York Dolls et Dr Feelgood ne sont que des signes avant-coureurs. Londres est en pleine effervescence. C'est pourtant en France que l'étincelle rock va mettre le feu à toute la plaine punk. A Mont-de-Marsan au beau mois d'août 1976... Bijou tirera les marrons de l'incendie, une prestation remarquable, répétée l'année suivante, qui mettra le feu aux poudres.
BIJOU PUNK

Les évènements se précipitent si rapidement, ils sont si difficiles à cerner que durant plusieurs mois on mêlera Bijou à la nomenclatura punk. Tant que les Pistols n'auront pas défini à leur avantage les canons du punk, tout ce qui apparaît un peu trop rentre-dedans sera catalogué comme pure punk. Mais Bijou reste avant tout un groupe de rock. N'ont pas la banane, mais ils soignent leur mise – il n'existe pas de photo d'Eddie Cochran en tenue négligée ont-ils l'habitude de dire – rock, mais trop mods pour être rockers, le look mais pas les loques, les épingles à nourrice et le débraillé punk, ils rejettent en bloc...
Musicalement c'est un mix entre les Chaussettes Noires et les Flamin' Groovies – Bijou a fini par trouver un groupe à son image, les Flamin' qui envoient la purée tout en restant classe, le grand style, la fureur et l'élégance. Destroy mais en costume trois pièces. Sont trois mais Bijou repose sur Vincent Palmer. Le guitariste, la guitare, le son. La discographie de Bijou est parsemée d'instrumentaux. Bijou n'a jamais renié ses origines. L'ombre des Shadows les poursuit. La revendiquent, mais la guitare claire de Marvin est un peu customisée, parfois elle gronde comme celle de Keith Richards sur Have You Seen Your Mother Baky Standing In The Shadows, mais Palmer ne se laisse jamais déborder par l'amplification du son, joue serré, très serré, cherche avant tout la maîtrise, change de plan comme de lunettes noires. Aujourd'hui Bijou tourne encore, sous le nom de Bijou SVP, acronyme de Sans Vincent Palmer, mais c'est comme une bouteille de whisky sans whisky...

Sur scène Palmer n'est guère statique, avec Philppe Dauga à la basse ils ont un jeu d'avancées et de reculades qui n'est pas s'en rappeler celui du premier Feelgood avec Wilko Johnson. Nerveux, incisif et jamais en difficulté, rapide et jamais en défaut, Palmer est un plaisir à voir ( vidéo sur You Tube ) et à écouter. Inventif mais sans une note de trop, vise à l'efficacité, jeu sans esbroufe, mais percutant.
BIJOU DISCOG
Parviendront enfin à décrocher une signature chez Phonogram, via Philips. Auront ce qu'ils auront voulu. C'est à dire qu'ils se font avoir. On leur concèdera leur liberté de création puisqu'ils y tiennent. Mais la liberté a un prix pour lequel Philips refusera de s'engager. On distribuera les trente-trois dans les bacs à disquaires mais pour la promotion radio et le battage médiatique, inutile de repasser. Le retour sur investissement sera très bon pour Philips puisqu'ils n'investissent rien, pour Bijou, ce sera la grosse déception.

Pathe-Marconi ne lésinera pas sur les moyens pour imposer Téléphone, le concurrent direct de Bijou. Pas musicalement, car Téléphone est beaucoup plus Stone que Bijou, qui sonne beaucoup plus pub-rock. Mais un pub-rock qui aurait gommé ses racines noires. Bijou ne sera jamais un groupe grand public, sera le combo pour aficionados. Au bout de quatre trente-trois tours, l'unité idéologique de Bijou se lézardera. Dauga pensant qu'il serait plus rentable de céder les titres à un éditeur qui aurait intérêt à les commercialiser à outrance. L'expérience ne lui donnera pas raison.
Les titres des cinq premiers albums de Bijou suffisent à cerner l'univers du groupe : Danse Avec Moi, OK Carole, Pas Dormir, En Public, Jamais Domptés, plaisir des filles, la scène comme champ de bataille, orgueil rock attitude, un programme qui ne tranche en rien avec les paroles des grands rockers nationaux : Hallyday, Rivers, Ronnie Bird, Noël Deschamps... Jean-Williams Thoury s'inscrit dans une tradition populaire qu'il continue. Il est dommage que ses textes n'aient pu bénéficier d'un chanteur qui les aurait davantage théâtralisés par le seul grain de sa voix. Le LP Pas Dormir enregistré sous la houlette des frères Mael du groupe Spark qui ont malheureusement gommé les aspects les plus durs des morceaux est le seul qui rende quelque peu justice aux voix de Dauga et Palmer mises en avant puisque les parties instrumentales ont été édulcorées.
N'ai jamais été grand fan de Gainsbourg. Pas assez rock à mon goût. Trop chanson française. Gainsbourg aura vampirisé Bijou. La collaboration des deux artistes aura plutôt brouillé l'image du groupe patiemment mise au point par Jean-Williams Thoury. Cet épisode aura précipité la perversion des goûts d'un public qui au début des années quatre-vingt commence à abandonner le gros rock qui tâche pour de doucereuses sucrettes : reggae, world music...
THE END

C'est le reflux. Le rock recule, les salles ferment... Bijou ne survivra pas à la crise : le groupe s'effiloche, pire Bijou n'est plus à la pointe du rock français, le renouveau rockabilly qui s'installe doucement mais sûrement capte à lui toute une partie du public rock qui était la base des fans de Bijou. Qui suit le mouvement : le groupe enregistre Bijou Bop, ce n'est pas un retour aux sources, plutôt le serpent qui se mord la queue... La boucle se referme. Bijou explose. Tout le reste de l'histoire ne sont que les débris que la comète entraîne dans sa révolution.

Bijou a disparu des consciences. Jean-François Jack ressuscite la légende. Un travail de titan qui fourmille d'anecdotes et de détails, mais surtout une admirable reconstitution d'une époque révolue. Un superbe cadeau pour les générations futures qui voudront se pencher sur la naissance du phénomène rock en France, avec en prime la relation du parcours exemplaire d'un groupe appelé à devenir encore plus culte grâce à ce livre.
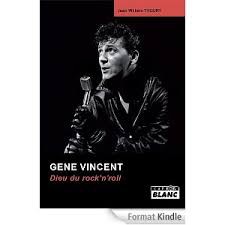
Quarante ans se sont écoulés depuis la naissance de Bijou, Nous croisons de temps en temps Jean-Williams Thoury dans les concerts rockabilly. Toujours aussi attentif à cette musique qu'il aime et qui a orienté sa vie. Nous avons déjà présenté dans KR'TNT deux de ses ouvrages, l'irremplaçable somme sur Gene Vincent Dieu du rock'n'roll paru au Camion Blanc ( voir livraison N° 18 du 27 / 09 / 10 )et son dictionnaires des films de moto, Bikers ( N° 165 du 28 / 11 / 13 ). Vincent Palmer a renoncé à s'auto-parodier, Bijou a vraisemblablement été une expérience trop forte et trop intime, pour qu'il ait envie de continuer... La courte notule biographiquee sur Jean-François Jacq, due à la plume de Christian Eudeline, sur la quatrième de couverture, nous incite à nous procurer ses autres livres.

Damie Chad.
21:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : loreann', rockin jep's, black prints, ghost highway, buttshakers, bijou


