10/02/2021
KR'TNT ! 497 : CHARLIE WATTS / DOWN IN NEW ORLEANS / ACROSS THE DIVIDE / MARC SASTRE / ANIMALS / ROCKAMBOLESQUES XX
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 497
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR'TNT KR'TNT
11 / 02 / 2021
|
CHARLIE WATTS / DOWN IN NEW ORLEANS ACROSS THE DIVIDE / MARC SASTRE ANIMALS / ROCKAMBOLESQUES 20 |
TEXTES + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
J’ai la Watts qui s’dilate - Part Two
Les Stones ? On en fait tout un plat, alors que ça ne représente que trente albums. Que sont trente albums comparés à l’univers ? Rien.
Grâce à ce type de raisonnement, on peut se livrer à l’expérience d’une réécoute des trente albums, ce qu’a dû faire Mike Edison pour écrire Sympathy For The Drummer - Why Charlie Watts Matters. Mais ce ne sont pas les Stones qu’on écoute, c’est Charlie Watts. Diable, comme Edison a raison : l’énergie des Stones vient de Charlie Watts. Fantastique éclairage ! Celui qu’on prenait jusqu’alors pour un personnage de second plan devient une sorte de maître d’œuvre de la Stonesy.
C’est ce qui frappe le plus lorsqu’on ressort de l’étagère le premier album des Stones paru en 1964, England’s Newest Hitmakers. Charlie est partout, et même mieux que partout : il pulse, notamment dans «Carol» qu’il bat à la diable. Ce n’est pas un batteur qu’on entend, mais une machine de takatak. Leur «Route 66» est incroyablement bien emmené, on peut même parler de proto-punk. Voilà une occasion en or de saluer le génie de Brian Jones, composante punk des Stones. L’«I’m A King Bee» qui ouvre le bal de la B est sans doute le cut qui situe le mieux Brian Jones dans les Stones : heavy groove et glissé de note dans l’alternance du va et vient, et bien sûr, Jag pose bien son King bee baby. Personne ne peut battre les Stones à ce petit jeu. Ils traînent aussi leur «Little By Little» dans la boue, ils font littéralement du heavy punk avec un beau départ en solo d’épate latérale. Avec «Can I Get A Witness», les Stones semblent nous dire : «Bienvenue dans le swinging London motownisé !». Charlie fait une fois de plus tout le boulot, il bat ça tout droit avec un épouvantable gusto. Ils terminent avec un autre chef-d’œuvre proto-punk, l’infernal «Walking The Dog» de Rufus, c’est du punk in the flesh, avec des coups de sifflet, numéro complet avec l’I’ll show you how to wok the dog et le killer solo flash on the run. Fa-bu-leux, complètement saqué du shook et le beat de Charlie sonne comme des clap-hands.
La même année paraît 12 x 5, un album un peu raté car la moitié des cuts sont mous du genou. Dommage car la pochette est magnifique. On ne voit que Brian Jones dans le coin de droite. Ils ouvrent le bal avec la meilleure version d’«Around & Around» jamais enregistrée. Charlie la swingue à la perfe et les guitares se fondent bien dans l’overwhelming. Avec son tapatap, Charlie n’en finit plus de ramener du jus au jeu. On tombe plus loin sur l’«Empty Heart» qui fit bondir Roky Erickson. Il se peut que tout le son du 13th Floor vienne de là, de cette ferveur cathartique d’harmo et de guitare. Ils rockent aussi le Womack d’«It’s All Over Now» avec toute leur niaque de punksters et glissent dans la course un killer solo flash d’antho à Toto. Quelle section rythmique ! Charlie sauve la B avec «Grown Up Wrong» : il joue ça tout droit avec un petit takaktak de recalage ici et là, pendant que Brian Jones le claque au bottleneck. Ils bouclent avec un «Susie Q» joué punk aux clap-hands. Les Stones comme on les aime.
Trois albums paraissent en 1965, à commencer par The Rolling Stones Now ! Si on voulait faire simple, on pourrait dire que c’est un album de batteur. Eh oui, il faut voir Charlie shaker le vieux hit de Solomon Burke, «Everybody Needs Somebody To Love». Il nous shake ça au tambourin de charley derrière le need you you you. Sur «You Can’t Catch Me», il fait du rockabilly. Tout repose sur l’élégance de son beat. On entend même Bill voyager dans le son, c’est dire si les autres se régalent. Et quand on tombe sur le «Down The Road Apiece» qui ouvre le bal de la B, l’évidence saute une nouvelle fois au paf : tout repose sur le swing de la section rythmique et les solos arrivent comme des bonus mirifiques. Le British beat n’est pas une vue de l’esprit. Brian Jones se tape la part du lion avec ce «Little Red Rooster» monté sur une dentelle de takatak provided by Charlie Watts. Il bat ça fin à la folie et Brian Jones joue au long cours. L’album s’achève avec «Surprise Surprise» que Charlie bat rockab avec des relances d’une incroyable finesse. Il soutient le beat avec un tambourin posé sur la charley et l’auréole d’accointances de cymbales qu’il claquouille à la volée mesurée.
Aux yeux des fans, Out Of Our Heads reste l’un des sommets de la Stonesy, car c’est là que se nichent ces coups de génie inexorables que sont «The Last Time» et «Satisfaction». Ils enregistrent ces deux hits à Hollywood et sont au sommet de leur art. Charlie sort un beat infernal sur «The Last Time» et il ramène du jus d’entrée de jeu dans «Satisfaction», qui reste l’hymne de l’éternelle adolescence. La messe est dite depuis 1965. Charlie amène aussi «The Under Assistant West Coast Promotion Man» d’un simple roulement. Belle leçon de swing. Mais le reste de l’album n’est pas aussi convaincu : ils tapent dans Sam Cooke avec «Good Times», dans Solomon avec «Cry To Me» et dans Marvin avec «Hitch Hike». Ils sont complètement fous ! Par contre leur version du «Mercy Mercy» de Don Covay enregistrée à Chicago est bien envenimée.
Le troisième album enregistré en 1965 s’appelle December’s Children (And Everybody’s). Il laisse un goût amer car on s’y ennuie au peu, malgré les clins d’yeux à Muddy Waters, à Arthur Alexander et à Hank Snow. L’hommage rendu au vieux délinquant de Saint-Louis avec «Talkin’ Bout You» sauve l’A, car elle est heavily insidieuse. Et «Get Off My Cloud» sauve la B. On a là l’un des emblèmes du swinging London. Pas de plus beaux accords de guitare, pas de plus belle profusion de chant, de clap-hands, de Charlie et de Brian. Edison a bien raison d’écouter les takatak de Charlie : c’est de l’art moderne.
En fait, les Stones auront un mal fou à égaler la splendeur punkoïde de leur premier album. Ils auront enregistré cinq albums en deux ans et c’est semble-t-il avec le sixième, Aftermath, que Brian Jones atteint son apogée. Charlie bat «Stupid Girl» sec et net et il donne toute sa mesure avec «Under My Thumb» : il envoie son takatak secouer le doh doh doh de Bill. Si la Stonesy est une science, en voilà l’équation de base : Charlie + Bill = la Stonesy. La perfection du son s’accompagne d’une progression du groove, avec un plus un mélange insolent de marimba et de fuzz, c’est-à-dire Brian + Keef. C’est plombé du beat, down to me. Si Aftermath reste l’album le plus discret des Stones, c’est à cause de «Goin’ Home», véritable apanage du groove de Stonesy. Ils jouent véritablement à l’apogée d’un style. L’autre sommet de l’album est le «Flight Five O Five» qui ouvre le bal de la B, l’un des cuts les plus punky des Stones - Get me on the flight five o five - Jag s’y fracasse la part du lion. Il faut noter l’extraordinaire qualité de la prod hollywoodienne de Dave Hassinger. On note aussi une belle fuzz noyée dans le son d’«It’s Not Easy» et le génie marimbique de Brian Jones dans «Out Of Time».
Brian Jones vole encore la vedette sur la pochette de Got Live If You Want It paru aussi en 1966. Cet album live propose une belle collection d’énormités, à commencer par «Under My Thumb» que Charlie s’empresse de basher aux cymbales. Bill rôde divinement dans le son. The bass on the beat ! C’est le son de la sauvagerie. À ce petit jeu, ils sont imbattables. Bill dévore ensuite «Get Off Of My Cloud», l’hymne des sixties par excellence. Il faudrait que quelqu’un se dévoue pour écrire un book sur Bill. La section rythmique fait encore des ravages dans «Not Fade Away» : carrée et sauvage, pleine de jus, le modèle absolu. En B, ils cassent la baraque avec l’enchaînement fatal de «The Last Time» et «19th Nervous Breakdown». Toute l’énergie vient du team Charlie/Bill et le riff vient incendier la plaine. Il faut voir Charlie entrer dans le beat du Nervous Breakdown ! Here it comes ! C’est là très précisément qu’on entre en religion. Arrive plus loin l’un des plus beaux hits des Stones, «Have You Seen Your Mother Baby Standing In The Shadow». Quelle purée royale ! Charlie bat le beurre des dieux. C’est joué aux chimes de guitare et battu à la diaboulette. À cet instant précis, les Stones sont le plus grand groupe de rock du monde.
Malgré sa pochette qui compte parmi les plus réussies de l’époque, Between The Buttons n’est pas l’album culte qu’on voudrait qu’il soit. Seuls deux cuts retiennent l’attention, «My Obsession» et «Miss Amanda Jones». Le premier est plutôt weird, monté sur un mish-mash de disto. Pour l’époque, c’est très aventureux et un brillant pianotis soutient les ooh baby du Jag. Il faut aller en B déterrer «Miss Amanda Jones», un cut qui préfigure Exile, c’est-à-dire l’esprit boogie foutraque. Les autres cuts peinent tragiquement à convaincre. Charlie et Bill devaient s’ennuyer à jouer «She Smiled Away». «Cool Calm & Collected», c’est vraiment n’importe quoi. Malgré les coups d’harmo, «Who’s Been Sleeping Here» refuse obstinément de décoller. Par contre la basse de Bill monte bien dans le mix.
Quand la conversation arrivait sur Their Satanic Majesties Request, on parlait d’un album raté. Les fans les plus exacerbés parlaient même de haute trahison. On en voyait se rouler par terre dans la cour du lycée, en proie à de violentes crises de dépit. C’est vrai que le son est beaucoup trop psychédélique pour les Stones. On vit des cars entiers de fans aller se plaindre au mur des lamentations. Keef parvient tout de même à caler un riff de Stonesy dans «Citadel» et Charlie réussit l’exploit de le swinguer. Il faut entendre ses relances titanesques ! Sinon, en s’ennuie pendant tout le reste de l’A, même si Brian Jones s’amuse avec son clavecin et sa flûte. En entendant ça, on criait à l’arnaque. Et tout reprenait du sens en B avec l’arrivée de «She’s A Rainbow», le hit parfait des Stones. Drumming impeccable, puissant et swingué à la fois. C’est ce qui frappe le plus dans ce hit magique : la qualité du drumming. Par contre, «Gomper» bat tous les records de nullité crasse. Cette volonté de psychedelia est une vaste fumisterie. Les Stones sauvent les meubles avec «2000 Light Years From Home» : belle entrée en matière, riff de basse et tatapoum de Charlie, back to the real deal de la Stonesy mais dans les étoiles, smooooth & soooo cool - It’s so very lovely/ 2000 light years from home.
L’un des sommets de la Stonesy s’appelle «Sympathy For The Devil» et se trouve sur Beggars Banquet. C’est l’histoire du man of wealth and taste. Tout repose sur le mix percus/drumbeat, la hargne de Jag, aw yeah, la bassline voyageuse et ces ooh-ooh qui vont marquer l’histoire du rock. Il ne faut pas oublier le solo exacerbé de Keef, assez novateur pour l’époque. La photo déployée dans le gatefold ténébreux illustre parfaitement ce chef-d’œuvre qu’est Sympathy. Encore de la Stonesy à son sommet avec «Parachute Woman», land on me tonite, et ces deux guitares qui se fondent dans le melting pot. Son très Chess dans l’esprit. Puis Jag chante son «Jig Saw Puzzle» au nez pincé à la Dylan, même esprit qu’«All Along The Watchtower», oh the singer he looks so angry. Charlie se tape un coup de génie en B avec «Street Fighting Man». Son tap tap déclenche la furia del sol. Le cut est gorgé de son, de descentes de basse, de rumeurs de sitar. Les Stones remontent à leur apogée. C’est aussi là qu’on trouve la vraie version du «Stray Cat Blues», bien vitriolée aux guitares, rien à voir avec la version à la mormoille que va jouer Mick Taylor par la suite. Et Brian Jones sort son dulcimer pour «Factory Girl».
La deuxième moitié de l’apogée du règne des Stones s’appelle Let It Bleed. Trois coups de génie s’y nichent, à commencer par «Gimme Shelter», if I don’t get somme sheltah, et cette folle de Merry Clayton gueule tout ce qu’elle peut. Les Stones se font tout petits dans le storm de Jag et de Merry, et quand ils chantent ensemble, Charlie pointe bien le beat. C’est un cut dont on ne se lassera jamais. On peut dire la même chose de «Live With Me». Keef & Charlie, voilà le secret des Stones, avec un punk de Jag et ses water rats par dessus. Ah quelle blague ! C’est l’un des pires coups fourrés jamais imaginés. On y entend même un solo de sax, alors t’as qu’à voir ! C’est «Monkey Man» qui illumine la B. Encore un coup du punk Jag, qui aménage une petite accalmie avant la tempête et le freakout savamment orchestré. On a toujours eu un petit faible pour le cut d’adieu, «You Can’t Always Get What You Want». Tout y est : les coups d’acou, les congas de Congo Square, le gospel batch, les pianotis et l’extrême richesse de la musicalité. On y voit le Jag jeter tous ses try sometimes dans la balance, et puis on a aussi les prescriptions filled et les gimmicks de relances très Southern, et bien sûr Mister Jimi. Sans oublier la montée au ciel du gospel batch et le basculement dans l’éternité, avec un décalage du beat imaginé par Charlie Watts. On croise peu de cuts aussi spectaculairement parfaits.
À ce stade des opérations, il est bon de remettre le nez dans le Mojo Interview qu’accorda Charlie en 2015. Mark Paytress y cite Keef : «No Charlie, no Stones.» Un Keef qui rappelle aussi que Charlie était un batteur de jazz peu concerné par la révolution culturelle à laquelle il participait. Charlie aime à rappeler qu’il préférait Charlie Parker à tout le reste, y compris Jimi Hendrix. Il rend aussi hommage à Ginger Baker - He’s a white African - et donc à Phil Seamen, le mentor de Ginger. Charlie se souvient aussi de sa première révélation : Chico Hamilton - You must remember, jazz was very big in those days - Et Charlie cite des noms de jazzmen anglais que personne ne connaît, sauf les spécialistes : Eddie taylor, Brian Broklehurst, John Picard, Danny Moos, people nobody knows now. Puis Charlie remonte dans le temps jusqu’à Fred Below, chez Chess, et DJ Fontana chez Sun - Il ne joue pas comme jouent les batteurs aujourd’hui, he plays shuffle, swing. he’s playing country and western like a big band drummer, a 4/4 swing time swing - Il en arrive fatalement aux Stones et rappelle qu’il suivait Keef - Keef is the rythm and I would follow him. It’s very much a Chuck Berry type mentality - Il a aussi un regard très clair sur le succès des Stones aux États-Unis : à la différence des Beatles qui ramenaient leurs chanson, les Stones se basaient sur des reprises américaines et forcément ça étonne Charlie qu’ils aient pu avoir autant de succès auprès des kids américains - These white kids actually bought it. Amazing ! - Et il ajoute : «On jouait du Jimmy Reed dans des dance shows, ce qui est plutôt ridicule, quand on y pense. Mais les kids aimaient ça. On jouait à Chicago et si tu descendais un peu plus bas dans la rue jusqu’à Smitty’s Corner, tu pouvais voir the real thing. Mais ils n’allaient pas chez Smitty’s.»
En 1970, il a fallu se débrouiller avec un seul album des Stones, ce Get Yer Ya-Ya’s Out qu’on a beaucoup trop écouté. Mick Taylor n’y amène rien. Que dalle. À la limite, on préfère le «Jumping Jack Flash» des Groovies. Si on écoute «Midnight Rambler», c’est uniquement pour Charlie. Pareil pour le Sympathy qui ouvre le bal de la B : tout le jus vient du battage en règle de Charlie. Ça ne tient que par lui. Mick Taylor en fait trop. Très belle version de «Little Queenie», aw took a look at cha, c’est l’un des sommets du boogie boogah, bien allumé au coin du bois. On les voit ensuite ramener toute la musicalité du rock dans «Street Fighting Man». Les descentes de guitares croisent l’impeccabilité du drive de basse, ça claironne très haut dans le ciel du Madison, les Stones jouent à la clameur and Charlie is good tonite, hesn’t he ?
Sticky Fingers est un album à double tranchant. Impossible de s’habituer au son de Mick Taylor. Son solo dans «Sway», ce n’est plus de la Stonesy. Par contre, «Can’t You Hear Me Knocking», si, c’est la Stonesy comme on l’aime, avec une basse bien ronde dans le son et un Jag bien punk au chant - Help me baby/ Ain’t no stranger - Voilà la Stonesy mal peignée, percutée de la culasse, impavide et Bobby Keys rive le clou du cut avec son shoot de sax. Mais ce fut peut-être un peu trop groovy pour les fans des Stones à l’époque. En B, Charlie fait un carton avec «Bitch» et c’est là qu’on entend le fameux my heart’s beating louder than a big bass drum.
Il faut bien dire qu’Exile On Main St sent le remplissage. L’album qui est double ne tient que par la présence de deux merveilles, «Rocks Off» et «Happy». Charlie bat sec l’up-tempo de «Rocks Off» et Keef chante son «Happy» d’une belle voix de fausset. Le voilà à son plus frénétique. Fabuleux travail de riffing. Mais pour le reste, c’est compliqué. On les voit tenter le diable avec «Rip This Joint», jolie tentative de jump cuivré de frais et joué à la stand-up. C’est Charlie qui rafle la mise avec un jive de jump. «Casino Boogie» est l’archétype de la Stonesy qui ne sert à rien. Avec «Tumbling Dice», les Stones inventent les Black Crowes. C’est là que Chris Robinson et les autres vont venir s’abreuver. Il faut dire que la musicalité de Dice est un modèle éternel. La B est la face la plus faible d’Exile. Tous les cuts sont mous du genou et privé d’éclat, comme d’autres sont privés de dessert. Zéro idée aussi en C, à part «Happy». C’est le problème global d’Exile. Pas d’idées. Cet album est infesté de filler. Pas de quoi faire un plat non plus avec la D. Ils recyclent le riff de «Monkey Man» pour essayer de sauver «Soul Survivor», mais on ne l’écoute même pas.
Tous les fans des Stones se sont arrêtés à l’époque avec Goats Head Soup. Le vieux groove de «Dancing With Mister D» rendait l’album tolérable. On éprouvait une immense pitié pour les Stones qu’on sentait en panne d’inspiration. On écoute ce Dancing en sachant bien qu’il ne s’y passera rien de plus que ce qui s’y passe déjà. Exile nous a heureusement habitué aux faces pitoyables, et donc l’A ne choque pas plus que ça. «Doo Doo Doo Doo (Heatbreaker)» se noie dans cette A pitoyable, presque sauvé par des chœurs déshinibés et des nappes de cuivres. On retrouve deux shoots de Stonesy en B, «Silver Train» et «Star Star». Chaque fois, le Silver Train rejaillit du passé. C’est le cut oublié par excellence. Johnny Winter en fit une reprise superbe. «Star Star» est typiquement le genre de cut qu’on attend d’eux : voilà de la Stonesy pure et dure, fuck a star ! Quatre bons titres sur un album, ce n’est pourtant pas si mal. Le problème est qu’à cette époque, on attendait encore des miracles des Stones.
Dans le Mojo Interview, Charlie rappelle à quel point il a détesté le succès - Je n’ai jamais aimé ça. Oh, j’adorais jouer dans un groupe qui marchait bien, et j’adorais la scène. Mais une fois le rideau tombé, laisse tomber. Je détestais ça - Comme il détestait le flower power.
On a tout de suite détesté la pochette d’It’s Only Rock’n’Roll, même si Guy Peellaert la signe. Pochette trop arty pour les Stones ? Allez savoir ! C’est là sur cet album paru en 1974 qu’on trouve le «Luxury» que reprenait Jesse Hector. Joli coup de working so hard to keep in your luxury, monté sur le riff de Keef. Sinon, l’album propose un joli tas de Stonesy bien pépère, du style «If You Can’t Rock Me» ou «Short And Curlies», et même des cuts qui ne servent à rien comme «Ain’t Too Proud To Beg» ou le morceau titre. Voilà où mène la célébrité. On voit même Mick Taylor faire son Santana sur «Time Waits For No One», un cut qui étrangement se laisse écouter. Ils finissent cet album mi-figue mi-raisin avec une belle tentative de retour aux affaires, «Fingerprint File». Ces vieux démons de Jag & Keef savent encore touiller un dirty bag.
Paru en 1976, Black And Blue est peut-être l’album des Stones le plus détesté et donc le moins connu, sans doute à cause de ce «Hot Stuff» qu’on entendait partout à la radio et qui était leur vision du funk blanc. C’est vrai que l’A est catastrophique. Ils se prennent pour Peter Tosh avec un «Cherry O Baby» inepte et pour Rickie Lee Jones en B avec un «Melody» encore plus inepte. Et pire encore, pour Roy Orbison avec «Feel To Cry». Alors que fait Charlie ? Il frappe «Hey Negrita» sec et net. Keef sauve l’album avec «Crazy Mama» et son phrasé distinctif. On y admire une fois encore la cohésion du son. Les Stones, ce n’est pas une vue de l’esprit, c’est une réalité, l’un des symboles du British sound. Keef est un guitariste qui joue avec une précision exceptionnelle, son petit riff est une véritable merveille d’intentionnalité. C’est aussi sur Black And Blue que Ron Wood fait son entrée dans les Stones. Il joue sur quelques cuts et figure au dos de la pochette.
Le Love You Live paru en 1977 est un document intéressant, quasi ethnologique. Keef y sort une fantastique version de «Happy» qui justifie à elle seule l’écoute de ce double album. C’est un peu comme si tout le dandysme des Stones s’y incarnait. Tout ce qu’on peut aimer dans le rock anglais est là, dans cette version embarquée au heavy beat de Charlie. Et curieusement, le «Hot Stuff» qu’on y trouve est bien meilleur que la version studio de l’album précédent. En B, Keef chante son vieux «Tumbling Dice» à la force du poignet et Woody se fend d’un beau solo entreprenant dans «You Can’t Always Get What You Want», mais quand même, il vaut mieux écouter la version studio pour récupérer le gospel batch. Les Stones rendent hommage aux blackos avec la C : du blues avec «Mannish Boy» et «Little Red Rooster» et du Chuck avec «Around & Around». Ils terminent avec le bouquet fatal «Brown Sugar»/Jumpin’/Sympathy. C’est vrai qu’avec ça, ils sont dans l’universalisme. Voilà trois hits puissants qui ont façonné leur époque. Le Sympathy est assez long mais ultra joué. On en a pour son argent. Les Stones ont des hits, ils s’amusent bien et ils ont raison.
Tiens, voilà l’album du grand retour : Some Girls. En 1978, tout le monde croyait les Stones finis. Les Stones ? Ces vieux has-been ? Ha ha ha ha ! C’est vrai qu’ils commencent l’album en se prenant les pieds dans le tapis avec «Miss You». Sacrilège ! De la diskö ! Mais aussitôt après, Jag fait claquer le fouet de «When The Whip Comes Down». Cut sans peur et sans reproche. Et puis de fil en aiguille, ce bal d’A va nous réconcilier avec les Stones. Si on en pince pour la Stonesy, c’est même l’album idéal. On retrouve le joli mingling de guitares dans «Just My Imagination». Serait-ce le retour de the Ancient Art of Weaving dont parle Mike Edison ? Le morceau titre est lui aussi très bardé de son. Les deux guitares jouent le jeu de la musicalité à gogo. Il semble que les Stones se réinventent avec ce retour aux sources, dans l’insatiabilité de l’Ancient Art of Weaving. Encore trois belles surprises en B, à commencer par un «Respectable» gorgé de guitares et des meilleures. Charlie mène la danse à la force de son énergie. C’est Keef qui chante «Before They Make Me Run», avec son accent biaisé et les guitares en biseau derrière. Fantastique allure de bastringue ! Il relance inlassablement son relentless, penché en avant, comme s’il chantait par en-dessous. Woody passe à la basse pour un «Shattered» tapé à l’insidieuse. Voilà ce qu’on appelle une vraie fin de non-recevoir.
Puisque Some Girls marque le retour à la confiance, alors on peut s’octroyer une écoute d’Emotional Rescue. Force est de constater que les Stones des années 80 savent encore se montrer impressionnants. Il se peut que Woody ait amené du sang neuf. C’est Charlie qui tire l’épingle du jeu en B avec son numéro de drummer dans «When The Boys Go». Il bat ça sec et en force. Il vaut largement tous les batteurs du punk anglais, il pulse à merveille. Les chœurs de filles participent aussi à la grandeur des Stones. Le hit de l’album s’appelle «Let Me Go». Merveilleux shoot de Stonesy - I tried giving you the velvet gloves/ I tried giving you the knock-out punch - Keef joint ses chœurs de fausset à ceux du Jag. On note que Bill est toujours là et on l’entend bien mener la danse de «Dance», alors que Charlie joue au fouetté de peau des fesses avec un tact qui encore une fois en bouche un coin. C’est un plaisir que d’écouter ça, rien que pour le fouetté de Charlie. Cet album ne laisse pas indifférent, on s’effare assez rapidement du son, notamment dans «Summer Romance». Le son est plein comme un œuf. Ils jouent leur vieille carlingue de Stonesy en fer blanc et Charlie bat ça comme s’il avait vingt ans. C’est aussi sur cet album que se niche l’infâme putasserie qui donne son titre à l’album et Keef vole au secours des fans avec «All About You». Il est faux dès qu’il monte son ouuhhh, mais c’est ce qui fait le charme discret de sa bourgeoisie.
Attention, le Tattoo You date de 1981, donc il ne date pas d’hier. Ce Tattoo-là est un faux album puisque les Stones y proposent les restes de sessions précédentes, comme par exemple ce «Slave» qui date des sessions de Black And Blue. On peut donc parler d’un cut sauvé des eaux. Il y a du son, quoi qu’on puisse dire des Stones d’après les Stones. C’est même assez balèze, avec ces coups de sax et ces chœurs de rêve - Don’t wanna be your slave - Mais si on écoute tous les tardifs des Stones, ce n’est pas seulement à cause du big book de Sharky, c’est aussi pour Keef, et là, il nous ressort un «Little T&A» qui date des sessions d’Emotional Rescue. Il faut le voir lancer ses She’s my little rock’n’roll. Il n’y a que lui qui puisse réussir ce sortilège. Il lance des yah keefy, il niaque son chant avec génie et derrière le son fonce comme une diligence. Puissant Keef ! Rescapé des sessions de Some Girls, voici «Black Limousine» que Jag chante comme un punk. Les Stones renouent avec le pâté de boogie. L’autre merveille de ce ramassis de rescapés est «Waiting On A Friend» qui date du temps de Goat Heads Soup. Voilà les Stones dans une espèce de pop-rock à parfum paradisiaque, ambiance Southern, good time music de rêve, pur moment de magie. Sonny Rollins blows the sax et Nicky Hopkins égrène ses rivières de diamant. C’est le cut parfait, avec des accents dylanesques et sa musicalité maximaliste. C’est aussi sur cet album qu’on trouve le heavy keefy «Start Me Up» que Charlie bat à la bravado. Comme si les Stones montraient qu’ils voulaient encore frapper un coup. Et quel coup ! Ce sont les vieux Stones, mais God, comme ils savent tenir un beat. C’est dirons-nous leur façon de chasser le doute parmi les fidèles de la vieille paroisse. Quant au reste, on peut le foutre à la poubelle. Ce sale petit voyou de Jag ruine pas mal d’efforts.
Malgré sa pochette d’une incroyable vulgarité, Undercover est un bel album de Stonesy. On note la frappe sèche et déterminée de Charlie dans «She Was Hot» et «Tie You Up» sonne comme un vieux rockalama net et sans bavures. Keef monte aux chœurs sur les ponts, et comme c’est chanté à la ramasse, ça redevient du grand art. «Wanna Hold You» est le cut de Keef. Il adore chanter ses cuts de Keef. C’est dingue comme il sait faire la différence. Charlie veille au bon grain de l’ivraie, car il cavale bien le beat. On trouve aussi des cuts de diskö-funk bizarres sur l’album («Undercover Of The Night» et «Too Much Blood») et les Stones retrouvent leur éclat avec «Too Tough», un cut qui repose une fois de plus sur le beat de Charlie. Bon d’accord, Jag chante et Keef ramène du riff de fer blanc, mais la classe du cut vient du beat. Curieusement, «All The Way Down» est encore un énorme cut de Stonesy chanté à pleine gueule. Ils continuent de produire cet excellent mix de riffs, de beat et de voix. Ils n’ont rien perdu de leur superbe.
Pochette années 80 pour Dirty Work avec des Stones déguisés en coiffeurs. L’époque veut ça. Il semblerait que ce soit l’album de Charlie car le beat est monté au devant du mix. Du coup, «Fight» devient un cut de batteur. Et comme le montre «Hold Back», Charlie n’a jamais battu aussi sec. Il joue dans la devanture du mix et ça donne du jus à ces cuts qui n’ont pas de cou. Et comme le dit si justement Edison, «Had It With You», c’est le son de Jag et de Keef qui se battent. C’est gratté à l’os et l’harmo ramène les Stones aux sources. Le cut de Keef s’appelle «Sleep Tonight». Au fond, Keef est un vieux requin mélancolique.
On trouve une belle énormité sur Steel Wheels : «Hold On To Your Hat». Les Stones sont encore capables de beaux blasts, il faut s’en féliciter. Keef introduit «Sad Sad Sad» au riff vainqueur et Charlie le bat à la dure. Voilà encore un cut de batteur avec un fort relent de Stonesy. La prod est une merveille absolue. Keef doit aimer le hard funk car voilà qu’arrive «Terrifying». Comme il a des idées de riffs en tête, il faut que ça sorte. Le «Rock And A Hard Place» qui ouvre le bal de la B est plus classique. On entend les Stones de l’époque. Charlie y bat un big break de bass drum. Edison a raison d’insister sur l’importance de Charlie Watts. Pas de Stonesy possible sans cette force de frappe. Et puis voilà le cut de Keef, «Can’t Be Seen». Quand il prend le micro, on sent nettement la différence. Il chante à perdre haleine, embarqué une fois encore ventre à terre par le beat cavaleur de son poto Charlie.
Énorme album que ce Voodoo Lounge paru en 1994. Inespéré ! Charlie casse la baraque avec «You Got Me Rocking». Charlie on the beat, yeah ! Si les Stones, n’ont pas le heavy drum beat de Charlie, ils n’ont rien. Charlie bat comme un galérien. C’est une leçon dont l’histoire se souviendra. Il fait encore des siennes dans «Sparks Will Fly». Une bombe. Tout le chant de Jag repose sur Charlie. C’est bardé de son, avec Darryl Jones on bass. Terrific ! Charlie réveille encore les bas instincts dans «Moon Is Up». Il bat tout ce qu’il peut battre. Alors Jag peut faire son cirque. C’est soutenu au concert d’orgue cajun. Encore une fois, tout repose sur les épaules de Charlie et les autres ramènent du gratté de poux sur leurs guitares. Résultat plutôt fascinant. On entend Keef charger la chaudière d’«I Go Wild». C’est le cut révélatoire de l’album, rien d’aussi explosif. Et les keefy cuts ? On en trouve deux, ici, «Thru & Thru» et «The Worst». Keef ne chante pas très bien son Thru, mais c’est Keef, il est encore capable de coups de Jarnac, d’autant qu’il part en sucette à la fin du cut. Beautiful Keef !
Avec Stripped, les Stones radotent leurs vieux tubes. Charlie bat «Street Fighting Man» comme plâtre, mais on perd toute la magie de la version originale. Puis ils flinguent «Like A Rolling Stone», «Not Fade Away» et battent tous les records d’infamie avec «Shine A Light». Jag s’y prend pour un Soul Brother, c’est comme si on voyait palpiter son anus. Rien à tirer non plus de «The Spider & The Fly» et d’«Im Free». Pareil pour «Wild Horses» : allez plutôt écouter la version originale. Ici, le Jag est insupportable. En fait on ne supporte plus le vieux Jag, on ne supporte plus de le voir ruiner ces hits magiques que sont «Let It Bleed» et «Dead Flowers». Keef sauve le set avec «Slipping Away».
Heureusement, Bridges To Babylon vole au secours des Stones. Quel album ! Démarrage en trombe avec «Flip & Switch», fracassé par Charlie le punk. Wow, on peut dire que Charlie bat ça wild. Alors Jag peut ramener sa fraise mordorée. On entend rarement des beats aussi ramassés. Tous ceux qui s’imaginent que Charlie sucre les fraises se mettent le doigt dans l’œil. Il n’a jamais aussi bien battu. C’est un batteur infernal. Il bat à la folie Méricourt. Il bat dans l’aura du no way out. Keef est juste derrière. Avec «Low Down», on sent que les Stones font l’impossible pour rester les Stones. Ils ressortent toutes leurs vieilles ficelles de caleçon, mais ça ne marche pas. «Gunface» non plus. Keef sauve les meubles avec «You Don’t Have To Hear It», un reggae de pirate, whisper in my ear, Keef nous emmène dans la cabane, il sait le faire, avec les chœurs et les cuivres. Admirable. Retour en force des Stones avec «Out Of Control» et son refrain explosif, comme à la grande époque. C’est le genre de cut qui ne prévient pas, comme un coup de boule. Retour aussi du power dans «Saint Of Me» - You’ll never make a saint of me - ce démon de Charlie bat ça wild encore une fois et Jag tire bien son épingle du jeu. Charlie bat «Might As Well Get Juiced» au hip-hop beat et on entend une belle mélasse de guitares dans le fond du beat et une fois encore, Jag se prend pour le diable. Belle démonstration de heavyness. Encore un cut de batteur avec «Too Tight», violente décharge de Stonesy, Charlie tend le beat. Puis Keef se tape la part du lion avec «Thief In The Night» et «How Can I Stop». Magie pure, on est bien obligé de l’avouer.
Faut-il écouter A Bigger Bang ? Oui, mille fois oui, ne serait-ce que pour «This Place Is Empty», cut de Keef, c’mon baby. Il est effarant de classe. Il chante sa vieille rengaine aux dents branlantes de junkie dude. Du coup, les Stones reprennent du sens, loin des putasseries de Jag. Keef et Charlie veillent au grain. Et puis on voit aussi les Stones devenir fous avec «Rough Justice». Surtout Keef et Charlie. C’est une horreur, une cavalcade infernale, une Stonesy punkoïde qui t’embarque pour Cythère, un ouragan raseur de mottes, ça déloge les bunkers, ça siphonne Tournesol, Charlie frappe comme un frappadingue. Précision capitale : Don Was produit l’album, d’où le son. «It Won’t Take Long» n’est pas de la Stonesy, mais du big heavy sound. Ça reste une aventure de rock électrique intéressante. Il faut dire aussi qu’on croise pas mal de cuts qui ne servent à rien. Il faut attendre «Oh No Not You Again» pour retrouver la terre ferme et la grosse riffalama. C’est assez violent, on assiste à un beau développé de Stonesy et c’est à Charlie que revient l’honneur de finir en beauté avec «Look What The Cat Dragged On». Charlie power ! Imbattable.
Le dernier album des Stones paraît en 2016 et s’appelle Blue & Lonesome. C’est un album conçu en hommage au blues et ils tentent de renouer avec le son de leurs premiers albums, mais sans Brian Jones, ce qui est une grave erreur. Sans Brian Jones, les Stones ne sont pas très doués pour le blues. Les problèmes commencent avec le «Just A Fool» de Little Walter. Jag y sonne comme une vieille tante de la Nouvelle Orleans. Derrière ça joue et ça bat sec et net. Quoi qu’on en pense, il faut avoir écouté ça. Et pas sur un smartphone. Il faut un minimum de son pour se faire une idée. Avec «Commit A Crime», Jag se prend pour Wolf, donc ça pose un problème. Ça ne marche pas, malgré tout l’harmo du monde. On les voit jouer aussi le morceau titre à l’extrême sincérité, mais justement, c’est là où le bât blesse : trop de sincérité tue la sincérité. Jag tente de faire illusion avec l’antique «All Of Your Love» de Magic Sam, mais encore une fois, on décroche. Il faut attendre «I Gotta Go» pour voir les Stones s’aligner sur la folie de Little Walter. Saluons leur courage. C’est gonflé de leur part. Charlie stompe le beat et sauve les Stones du naufrage. Et comme on le voit avec le heavy blues d’«Everybody Knows About My Good Thing», Keef ne fait jamais n’importe quoi. Même s’il choisit Johnnie Taylor, les Stones manquent de crédibilité sur ce coup-là. N’est pas Stax qui veut. Et si c’est Keef qui le prend au chant, on l’accepte, mais jamais Jag. No way. Retour à Little Walter avec «Hate To See You Go» tapé au heavy beat de garage blues. C’est bardé de son et d’énergie, c’mon baby/ baby please don’t go - Ils noient ensuite «Hoodoo Blues» d’harmo, et Jag chante comme à l’aube des Stones. Alors forcément, ça pince le cœur. D’autant que les Stones rendent un bel hommage au génie de Lightning Slim.
Au moment de l’interview, Charlie a 73 balais. Il pense pouvoir jouer avec le Stones jusqu’à 85 ans - C’est facile, tu t’arranges pour que le public soit heureux à la fin de la soirée - L’interview a lieu au moment où les Stones prévoient de partir en tournée pour jouer Sticky Fingers. Mais sans Mick Taylor. En même temps, Charlie avoue qu’il en a un peu marre des tournées - I want to do other than sit in a hotel in Ohio. Je veux dire que j’ai fait ça toute ma vie. Si Keef était là, il dirait : ‘Que veux-tu faire d’autre ?’ - Charlie reconnaît pour finir que les Stones sont plutôt bien conservés. Paytress lui fait d’ailleurs remarquer qu’il a toujours ses cheveux. We’ve kept a lot of it together, lui répond Charlie, surtout Mick. Mais aussi Roger Daltrey, et Ringo. Il rappelle ensuite que passé les 40 ou 50 ans, il y a des choses à faire pour pouvoir encore durer 20 ans. Paytress demande quelles choses et Charlie lui répond faire de l’exercice. Mais pas trop. Il dit détester les muscles. «Si tu as des muscles, tu ne peux plus porter un costume.» Alors Paytress lui rappelle que Ginger avait fait du vélo de course. Charlie conclut là-dessus : comme Keef, Ginger était une force de la nature. Ginger n’avait pas l’air bien ces derniers temps, mais il jouait encore comme un démon après avoir mené la vie qu’il a mené. Now that’s amazing.
Signé : Cazengler Charlie Ouaf (va chercher la baballe)
Rolling Stones. England’s Newest Hitmakers. London Records 1964
Rolling Stones. 12 x 5. London Records 1964
Rolling Stones. The Rolling Stones Now ! London Records 1965
Rolling Stones. Out Of Our Heads. London Records 1965
Rolling Stones. December’s Children. London Records 1965
Rolling Stones. Aftermath. London Records 1966
Rolling Stones. Got Live If You Want It. London Records 1966
Rolling Stones. Between The Buttons. Decca Records 1967
Rolling Stones. Their Satanic Majesties Request. Decca Records 1967
Rolling Stones. Beggars Banquet. Decca Records 1968
Rolling Stones. Let It Bleed. Decca Records 1969
Rolling Stones. Get Yer Ya-Ya’s Out. Decca Records 1970
Rolling Stones. Sticky Fingers. Rolling Stones Records 1971
Rolling Stones. Exile On Main St. Rolling Stones Records 1972
Rolling Stones. Goats Head Soup. Rolling Stones Records 1973
Rolling Stones. It’s Only Rock’n’Roll. Rolling Stones Records 1974
Rolling Stones. Black And Blue. Rolling Stones Records 1976
Rolling Stones. Love You Live. Rolling Stones Records 1977
Rolling Stones. Some Girls. Rolling Stones Records 1978
Rolling Stones. Emotional Rescue. Rolling Stones Records 1980
Rolling Stones. Tattoo You. Rolling Stones Records 1982
Rolling Stones. Undercover. Rolling Stones Records 1983
Rolling Stones. Dirty Work. Rolling Stones Records 1986
Rolling Stones. Steel Wheels. Rolling Stones Records 1989
Rolling Stones. Voodoo Lounge. Virgin Records 1994
Rolling Stones. Stripped. Virgin Records 1995
Rolling Stones. Bridges To Babylon. Virgin Records 1997
Rolling Stones. A Bigger Bang. Virgin Records 2005
Rolling Stones. Blue & Lonesome. Polydor 2016
Mark Paytress. The Mojo interview : Charlie Watts. Mojo # 261 - August 2015
Down in New Orleans
Avec Stuart Baker (New Orleans Funk/Soul Jazz), l’autre grand spécialiste du New Orleans Sound s’appelle John Broven. Rhythm And Blues In New Orleans est très certainement l’ouvrage de référence en la matière. Comme le dit si bien Charles Aznavour, ils sont venus, ils sont tous là. Broven brosse dans son livre le portrait de chacun des acteurs d’une scène incroyablement riche, à commencer bien sûr par Cosimo Matassa, le Sam Phillips local, auquel Fatsy, Little Richard, Lloyd Price et tant d’autres doivent tout. Passionné de son, ce petit épicier italien développa ce que Mac Rebennack appelle the Cosimo sound - strong drums, heavy bass, light piano, heavy guitar, light horn and strong vocal lead (gros son de batterie, de basse et de guitare, piano et cuivres légers et chant puissant) - Alors bien sûr, vous allez dire que c’est facile pour lui quand on a des mecs aussi brillants que Fatsy et Little Richard dans le studio, mais non, pas du tout, il faut raisonner à l’inverse, c’est parce que ces mecs sont brillants qu’il faut se montrer à la hauteur. Mac ajoute que Cosimo demandait au guitariste de doubler la bassline et aux cuivres de la renforcer. Mais ce n’est pas tout. Cosimo : «The New Orleans Sound wasn’t only based on horns and rhythm. There’s a kind of attitude to lyrics too.» (Le son New Orleans n’est pas seulement basé sur les cuivres et la rythmique. Les textes jouent aussi un rôle capital). Il cite l’exemple des Cajun guys de la Louisiane du Sud qui avaient la même kind of attitude to lyrics, oui des mecs qui savaient soigner leurs textes. D’ailleurs Huey P. Meaux travailla énormément avec Cosimo. Notons qu’en 1956, Cosimo avait déjà enregistré «Lawdy Miss Clawdy», «Tutti Frutti» et «Ain’t That A Shame». Pas mal pour un petit épicier rital, non ?
Red Tyler parle du studio de Cosimo comme d’un endroit très primitif - Si tu vas y jouer en été, tu vas avoir de sacrés problèmes, car il n’y a pas d’air conditionné - et Bert Frilot qui travailla pour Cosimo de 1961 à 1964 ajoute : «Anytime we had a recording session, that morning we’d call the French Market Ice Company and we would order two tons of crushed ice.» (Chaque fois qu’on allait enregistrer, on appelait la French Market Ice Company pour se faire livrer deux tonnes de glace pilée). Le nom de Cosimo restera donc attaché à des anecdotes aussi poilantes que celle des deux tonnes de glace pilée. Par contre, l’aspect business est beaucoup moins drôle. Le pauvre Cosimo tenta l’aventure en montant Dover Records. Il croyait réussir là où Harold Battiste avait échoué avec A.F.O. Records, mais il allait y laisser toutes ses plumes. Les sous rentraient moins vite qu’ils ne sortaient - I didn’t know anything about the record business - Pourtant il avait des hits («Tell It Like It Is» d’Aaron Neville ou encore «Barefootin’» de Robert Parker), mais ça ne suffisait pas. Les distributeurs jouaient sur les délais de paiement et Cosimo fut confronté au même problème qu’Uncle Sam à Memphis : plus de tréso. Le pauvre Cosimo n’avait pas d’Elvis à vendre pour se remettre à flot et il perdit tout ce qu’il possédait, y compris l’épicerie.
C’est Roy Brown qu’on voit en couverture de l’ouvrage de John Broven. Pour le situer, Broven dit qu’il fut le premier chanteur de Soul et que ses héritiers sont les géants du popular urban-blues, B.B. King, Bobby Blue Bland et Little Milton, auxquels il faut ajouter the early rhythm and blues output de Little Richard, de Clyde McPhatter et de Jackie Wilson. Avec «Good Rockin’ Tonight», Roy Brown started it all in New Orleans : enregistré en 1947 chez Cosimo, soit quatre ans avant que Jackie Brenston et Ike Turner n’enregistrent «Rocket 88» chez Uncle Sam à Memphis, un Rocket qu’on considère à tort comme le first rock’n’roll record. Mais dans les deux cas, on se fourre le doigt dans l’œil jusqu’au coude : la première à hot-rocker dans ses godasses fut Sister Rosetta Tharpe en 1944 avec «Strange Things Happening Every Day». Elle y passait un petit solo hardi qui fit bander plus d’un guitariste.
New Orleans devient vite le nouvel El Dorado et le premier à en profiter, c’est Lew Chudd, le boss d’Imperial Records, label indépendant californien. C’est avec Chudd que commence la merveilleuse aventure de Fatsy, l’un des artistes les plus attachants et les plus brillants du XXe siècle. Cosimo rappelle que Fatsy était très créatif. Il savait s’approprier un air traditionnel. Broven : «Somehow Fats was rock’n’roll’s safety valve, and all he was putting down was good-time New Orleans music.» (D’une certaine façon, Fats servait de soupape de sécurité au rock’n’roll, il proposait de la good time music de la Nouvelle Orleans). Et il ajoute : «Relaxed good humour permeated his records and everything was simple and danceable.» Oui Broven a raison, sa musique respirait la joie et la bonne humeur et tout le monde dansait. Fatsy était aussi très populaire chez les Cajuns. Earl King se souvient d’avoir vu dans le bayou des juke-box bourrés de singles du grand Fats Domino. Parmi les gens qui doivent tout à Fatsy, on trouve bien sûr Clarence Frogman Henry, Joe Barry, Warren Storm, Chubby Checker, Bobby Darin et Little Milton à ses débuts. Broven dit mieux que personne la puissance de Fatsy sur scène : «Fats drove the band from the front, with immaculate drummer Smokey Johnson by his side setting up an irresistible street beat.» (Fats jouait devant sur scène et installé à côté de lui, Smokey Johnson battait l’irrésistible street beurre). Allen Toussaint qualifiait Fatsy de master of simplicity, mais il ajoute que la racine de sa légende reposait sur the studio magic created by Fats and Dave Bartholomew, with Cosimo Matassa at the control board. Toussaint a raison d’insister sur ce point : un artiste n’est jamais seul pour créer de la magie. C’est dans tous les cas une combinaison. Ici, ils sont trois : Fatsy, Dave Batholomew ET Cosimo. Dans le cas d’Elvis, ils seront quatre pour créer la magie de «That’s All Right» en 1954 : Elvis, Scotty Moore, Bill Black ET Uncle Sam.
Avec Lew Chudd, l’autre grand exploitant du New Orleans Sound s’appelle Art Rupe, boss de Specialty Records, un autre label indépendant californien. Il voyait Lloyd Price comme un équivalent de Fatsy et «Lawdy Miss Clawdy» parut en 1952. Quand Lloyd Price est appelé sous les drapeaux, il ramène Little Richard chez Specialty, et du coup, il perd sa couronne. Rien ne pouvait arrêter the wild and frantic Little Richard. Tous ses hits furent enregistrés en 13 mois, de septembre 1955 à octobre 1956, chez Cosimo, on North Rampart. Selon Mac Rebennack, Little Richard avait du talent, mais il n’eut de succès que lorsque Lee Allen and Red Tyler put that sound on him and put that hard rock feel on him. C’est le New Orleans Sound that got Little Richard across, and since he’s left that sound behind, he’s never been susscessful. Little Richard devait tout, absolument tout, au barrelhouse power de New Orleans et il commit une erreur fatale en allant ensuite enregistrer ailleurs. Pas de wild and frantic Little Richard sans New Orleans Sound, sans Earl Parmer ni Lee Allen. Il arriva la même mésaventure à Guitar Slim : tant qu’il enregistrait chez Cosimo, ça restait passionnant et tout s’écroula dès qu’Art Rupe l’envoya enregistrer ailleurs - New Orleans music does not travel (c’est un son qui ne s’exporte pas) - Guitar Slim n’enregistra que quatre cuts chez Cosimo, dont le fameux «The Things That I Used To Do», lors d’une session supervisée par Jerry Wexler, pour ATCO. Mais Art Rupe voulait Slim et il l’envoya enregistrer ailleurs, ce qui ruina sa carrière. Guitar Slim mourut alcoolique à New York. Il n’avait que 33 ans. Il était pourtant devenu légendaire : quand il jouait dans un club, il lui arrivait de sortir dans la rue avec sa guitare. Il portait des costards très voyants, rouges, blancs ou verts (the loudest green). Al Reed : «Jimi Hendrix was a latecomer with this electric sound. The man who had a hell of a lot to do with the electric sound was Guitar Slim, because his was the finest and his was about the first. No one else had done it before.» (Jimi Hendrix est arrivé longtemps après Guitar Slim qui fut le premier à jouer aussi électrique et il était le meilleur. Avant lui, personne n’avait jamais sorti un son pareil). Et Mac ajoute que lorsqu’on entend jouer Earl King, on entend Guitar Slim - But Earl was never the insane entertainer that Slim was.
John Broven évoque aussi le proto-punk de la Nouvelle Orleans, avec Jerry Byrne et Ronnie Barron. C’est Byrne qu’on retrouve dans l’ultra-mythique «Morgus The Magnificient» de Morgus and The 3 Ghouls, mystérieuse formation dans laquelle officient Mac et Frankie Ford. Pour Mac, Jerry Byrne et Joe Barry étaient «the two problem kids that I had.» Il faut préciser que tout ce petit monde tournait à l’héro. Broven évoque aussi le souvenir du grand Bobby Charles, un kid blanc qui s’imposa dans la black scene, avec ce mélange de New Orleans r’n’b et de Cajun feel qu’on appelle swamp pop et dont Ace remplit aujourd’hui de délicieuses compiles.
L’autre grand héros de Broven, c’est Johnny Vincent, d’origine italienne comme Cosimo et qui après avoir bossé pour Art Rupe chez Specialty fonda le label Ace à Jackson, Mississippi (un nom qu’allaient reprendre Ted Carroll et Roger Armstrong à Londres, en hommage à Johnny Vincent). Sur Ace, on trouvait Frankie Ford, Huey Piano Smith, Earl King, Joe Tex et... Morgus and The 3 Ghouls. Tout le catalogue Ace est réédité sur Ace en cinq volumes. On peut parler de passage obligatoire.
L’ouvrage de Broven épuise autant qu’une marche en forêt équatoriale. Il n’en finit plus de ramener des figures de légende. Tiens, Earl King, fils spirituel de Guitar Slim. Broven dit qu’avec lui, on est au cœur du South Louisiana swamp-pop style. Cosimo le considère comme un grand producteur, un homme à idées - He would be coming up with little figures that fit (Il sortait des petits gimmicks qui convenaient parfaitement) - Earl King enregistrait pour des tas de labels locaux. Broven évoque aussi les sessions organisées par Berry Gordy en 1963 avec un pack d’artistes de la Nouvelle Orleans, Eskew Reeder (Esquerita), Earl King, Joe Jones et Reggie Hall. Reeder indique que ces sessions changèrent le son de Motown qui était alors cha-cha («Shop Around») et qui se transforma pour devenir le full sound des Vandellas («Nowhere To Run»), that funky boomin’ stuff we brought up from New Orleans. Ne les cherchez pas, ces sessions pour Motown sont restées inédites.
Earl King n’eut pas le temps d’écrire son autobio, Huey Piano Smith non plus, mais par chance, John Wirt lui consacre un ouvrage, Huey Piano Smith And The Rocking Pneumonia Blues. Smith avait commencé dans les années 50 à tourner dans les clubs avec Guitar Slim, puis après avec Earl King. Comme Dave Bartholomew trouvait Smith trop parfait au piano, il lui conseilla de jouer quelques fausses notes, ‘like Little Richard’. Smith tournait avec un groupe à géométrie variable nommé the Clowns dans lequel passèrent des gens comme Bobby Marchan et Gerri Hall. Huey Smith ne jurait que par la good time music, comme Fatsy. Cosimo le traitait de driving force. Huey was hot et ses albums sortaient sur Ace.
Puisqu’on parle des labels locaux, voilà Minit monté par Joe Banashak. Mac : «Banashak was the fortunate cat to fall upon Toussaint’s services.» (Banashak eut la chance de tomber sur un mec aussi doué qu’Allen Toussaint). Banashak embauche en effet Allen Toussaint comme producteur maison et Minit devient légendaire, avec un roster composé de gens comme Bobby Womack, Ernie K-Doe et Chris Kenner qui est selon Mac, l’un des heaviest songwriters down here - I don’t think there was anybody writing better songs, from ‘Sick And tired’ to ‘Something You Got’ in the gospel tradition, and his writing influenced Allen Toussaint - Son vieux complice Marshall Sehorn dit de Toussaint qu’il fut the most talented man I’ve ever known.
Dans ce livre, Mac est à la fête bien sûr, surtout quand Harold Battiste décrit le son de Dr. John the Night Tripper : «African-New Orleans-Congo Square type of spiritual thing.» Eh oui, ça devient intéressant quand le rock se fait spirituel. Battiste sait de quoi il parle puisqu’il produisit le premier album de Dr John à Los Angeles. Personnage clé lui aussi, Harold Battiste, qui fut le boss du label A.F.O., l’un des berceaux du pur New Orleans Sound, et qui comme Cosimo, bouffa la grenouille. Battiste connaîtra des heures meilleures à Los Angeles en lançant Dr John et en produisant «I Got You Babe» de Sonny & Cher. Il va aussi co-produire Doctor John’s Gumbo avec Jerry Wexler, un album clé de la mythologie de Big Easy puisque Mac y rend hommage à tous ses héros, Huey Smith, Archibald, Earl King et Fess, aidé en cela par une ribambelle de légendes locales : Lee Allen, Ronnie Barron, Shirley Goodman, Tami Lynn et Alvin Robinson.
Restons au rayon des producteurs de génie. Voici Dave Bartholomew, qui vient tout juste de casser sa vieille pipe en bois à l’âge de 100 ans. Bert Frilot le situe ainsi : «Dave Batholomew was another one of those guys that was smarter than he knew he was.» (Il était encore plus classe qu’il ne croyait l’être, pas mal comme compliment, non ?) Frilot ajoute que Bartho pouvait diriger un big band et qu’au premier abord il pouvait avoir quelque chose d’intimidant.
Broven termine son parcours du combattant avec les Meters et leur organized freedom qui fit tant baver Keith Richards. En 2015, Broven se félicitait de voir que ses deux grands héros Fatsy et Bartho étaient encore en vie. Fatsy monta sur scène pour la dernière fois en 2007 au Tipitina, un set qu’on retrouve dans le film Walking Back To New Orleans.
Marshall Sehorn : «You can go anywhere you want to: there’s no music like New Orleans music. There’s no other singers like New Orleans singers. There’s no other people like New Orleans people. Nobody else has as good a time as we do. Nobody else shakes their ass as we do, and that’s everybody, everybody from old to young, black and white, Indians, jumpin’, dancin’, carryin’ on and having a good time. And that’s what it’s all about. That’s what this city is all about.» (Tu peux aller où tu veux : il n’existe rien de comparable au son de la Nouvelle Orleans, rien de comparable aux chanteurs d’ici, rien de comparable aux gens d’ici. Ici, on prend du bon temps, personne ne danse comme on danse ici, les jeunes comme les vieux, les bancs, les noirs et les Indiens, tout le monde danse et prend du bon temps, et ça dit tout ce qu’il faut savoir de la Nouvelle Orleans).
La meilleure illustration de cette déclaration prophétique est sans doute le Mardi Gras de la Nouvelle Orleans. Le roi du Mardi Gras s’appelle Theodore Eugene Bo Dollis. Il chante dans un Indian Tribe nommé the Wild Magnolias, et leur premier album, The Wild Magnolias With The New Orleans Project parut en 1974. Aaron Neville : «The Wild Magnolias record was the first of its kind.» C’est ce qu’on appelle en langage tonitruant a smokin’ beast, un véritable chef-d’œuvre de funk primitif. Art Neville : «You heard everything in that music, Sly Stone, James Brown, Parliament, Funkadelic, even the Meters.» Rien qu’avec «Handa Wanda», c’est dans la poche. Wow, quel shuffle de funk ! C’est wahté d’entrée de jeu, chanté à l’Africaine et monté sur une extraordinaire assise rythmique, avec bien sûr des filles qui déraillent. Bo Dollis mène le bal des vampires. Même jus avec «Smoke My Peace Pipe», afro-cubain en diable, jazz de Soul de butt. On est dans l’excellence du beat, dans la moiteur des jazz-roots, dans l’orgie des influences - Sly, War, Isleys, JB’s, MG’s, Hendrix & Coltrane - Bo : «No pop, but that Otis Redding and Little Willie John, they were alright !». Pour Bo qui adore Otis et Little Willie John, le rêve absolu est de voir les Indian Tribes from Brazil, Trinitad, Haïti and the Wild West hanging out and having fun, Willie Tee est survolté, pas besoin d’expliquer, just listen ! On reste dans l’énormité avec «(Somebody Got) Soul Soul Soul», énorme cut de Soul System, têtu comme une mule, joué à l’excellence des percus et ramoné par le bassmatic. Sans doute avons-nous là le meilleur funk d’Amérique. Les Wild Magnolias terminent ce festin de son avec une triplette insurpassable : «Golden Crown», «Shoo Fly» et «Iko Iko». Back to Congo Square, sous tension maximaliste, avec tout le génie du carnaval et de ses coups de sifflets. Ils tapent «Shoo Fly» au funk têtu comme une mule, avec toute l’énergie du gospel batch puis Bo éclate l’Iko du Congo. Les filles sont magnifiques. Cyril Neville : «It came from New Orleans, and it also came from a deeper place, a place of alienation, double alienation, for being black and for being Indian.» (Ça vient de la Nouvelle Orleans, bien sûr, mais aussi de quelque chose de plus profond, d’une double aliénation, celle d’être nègre et celle d’être indien). Cyril parle bien sûr de marginalisation.
Sur la pochette de They Call Us Wild, les Wild Magnolias posent en grande tenue de carnaval. Au dos de la pochette, on trouve les portraits des musiciens qui les accompagnent. Black is black. Tout l’univers musical des Wild Magnolias tourne autour du carnaval. Ils tapent «New Suit» au funk de Soul très pro. Soul brother à la voix très généreuse, Bo Dollis mène bien sa barque. Le hit du disk s’appelle «Fire Water». Groove de forêt profonde et humide, ultra joué aux percus, un vrai modèle de funk africain et attention, car les Injuns arrivent avec «Injuns Here We Come» ! Bo shake bien son shit secoué de percus. Le bassman Erving Charles fait décoller le groove. Bo mâche sa niaque. Ça repart de plus belle en B avec «New Kinda Groove». Bo joue la carte du heavy groove. Il fait danser les esprits. Bo ne lâche jamais prise. La classe du groove de funk qui suit : «Jumalaka Boom Boom» ! Erving Charles joue comme un dieu. Il drive sa basse en queue de poisson. Il récidive avec «We’re Gonna Party». Ce démon d’Erving Charles crée la magie chez les Magnolias. Groove profond et luxuriant comme la forêt du Douanier Rousseau - Do you wanna party/ That’ what I say/ Party all nite long - Huitième merveille du monde.
Grand retour de Bo Dollis & The Wild Magnolias en 1990, soit quinze après, avec I’m Back At Carnaval Time. Casting de rêve : George Porter on bass et Snooks Eaglin on guitar. Bo attaque avec cet extraordinaire shoot de good time music qui s’intitule «Carnival Time» - Everybody’s happy - organique ! On a même un solo de trompette dixieland. S’ensuit un «Bon Ton Roulet» magnifique, véritable street rumble, il bong tong roulette, Bo chante au timbre fêlé. Belle version d’«Iko Iko» cuite dans son jus d’Africanité. Bo chante ses gênes de Brazzaville et de fuckin’ Servognan et tout l’album remonte ainsi dans le temps, comme une pirogue sur un fleuve inexploré. Tiens voilà «Shallow Water Oh Mama», fantastique exercice de style, soufflé à la Satchmo, c’est-à-dire aux trompettes de la renommée, mais ça joue dans la matière d’un groove, plus sophistiqué, pas loin de Miles Davis. On tombe plus loin sur l’imparable «Tipitina», ils fessent le Fess, à la trompette de tromblon, ce sacré Bo roule Tipi dans sa vieille diction salivaire. On s’effare de tant de classe, tous ces mecs du carni font un carnage et Bo chauffe à blanc le cul du cut. Encore une merveille avec «Coconut Milk». On suivrait Bo Dollis jusqu’en enfer. Si on recherche de l’organique, c’est là. George Porter fait le con sur sa basse pouet-pouet. Tout bascule dans la démesure, dans une orgie de beat et Bo is back, inlassable, mouvant, il groove tout à l’édentée patentée.
Bo Dollis & The Wild Magnolias remettent leur business en route en 1996 avec 1313 Hoodoo Street. Bo tape dans le Cuban beat avec «Run Joe». Ça se danse avec une poule dans les bras et un grand verre de rhum à la main. Ce Bo-là chante divinement, au chicot branlant. Il sonne comme le roi de la fête au village. C’est tellement plein de son que ça frise chaque fois l’énormité. On tombe beaucoup plus facilement accro de Bo Dollis que d’un disque de garage classique. Pourquoi ? Parce qu’ils s’y passe des trucs extraordinaires. Bo est un diable. «Angola Bound» pourrait bien être l’hymne à la liberté des esclaves. Bo le prend à la petite voix, accompagné par les fantômes des congas de Congo Square. Fuck, tous ces pauvres blacks n’avaient pas demandé à voyager, et encore moins à devenir les esclaves des blancs ! Mais Bo décide de prendre la chose du bon côté et fait battre les tambours. Ça donne Bo Diddley à la Nouvelle Orleans. On passe au funk avec l’excellent «Might Mighty Chief», Bo part en guerre - I’ve got a dance - mais il part en guerre sous le boisseau, en pur groover épidermique. Il tape aussi une reprise de «Walk On Gilded Splinters». C’est joué au boogaloo du lac Pontchartrain, avec le spectre de Marie Laveau en toile de fond. Bo sait réveiller les zombies. Il en fait une version bien plus authentique que celle de Steve Marriott. Les morts sont là ! Il n’existe pas de pire version. Son «Voodoo» est trop funk pour le boogaloo, mais comme Bo est un mec bien, alors on le suit. Il sabre son funk à merveille - Voodoo women ! - Les chœurs effarent au plus haut degré. Bo est dans le bain. Ça baigne pour Bo. Encore une belle rasade de funk New Orleans avec un «Injuns Here They Come» très africain, bien ramené au devant de la scène, pure africana, le son a survécu aux horreurs de l’esclavage, c’est dire si la nature humaine a bon dos. Bo salue les Injuns, c’est-à-dire les Indiens, eux aussi victimes de la cruauté des blancs dégénérés. Il termine cet album faramineux avec un «Indian Red» encore plus primitif. C’est leur façon de dire «Foutez-nous la paix !».
Quel fantastique délire carnavalesque que ce Life Is A Carnival ! Cet album peut rendre dingue, surtout si on commence à écouter «Pock-A-Nae» en regardant le Tribe danser la nuit sous le grand chêne. C’est de l’African beat funk, cette Africana qui traversa l’océan bien malgré elle, mais elle resplendit désormais de tout son éclat magique. Rien d’aussi définitif que ce funk de la Nouvelle Orleans, beat têtu et sensuel - All nite long - Pur genius, esprit vengeur du peuple noir qui mangera les petits culs blancs. «Pock-A-Nae» vous hantera. Toute la mythologie se met en route avec «Who Knows», groove Pontchartrain, digne de Dr John et mené par Big Chief Bo Dollis qui n’en finit plus de rallumer des brasiers dans «Party» - We are the Wild Magnolias/ Keen to sing you a song - C’mon, c’est digne de Sly - We’re on a party - C’est à se damner, le Tribe nous balance l’un des meilleurs rafts de funk de l’univers. Raw to the bone ! On vendrait son père et sa mère pour un cut aussi beau qu’«All On A Mardi Gras Day», joué au duveteux de la Nouvelle Orleans, avec un coup de tuba dans le cul du cut. Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? Et voilà le Zulu King, c’est le carnaval, tout le monde danse. «Shanda Handa» sonne assez Dr John, c’est même envoûté de frais, on mesure l’emprise du hoodoo sur le rock blanc. Tout Dr John vient de là, du monde des esprits. Oui, l’Afrique a vraiment débarqué sur le continent. Avec «Cowboys & Indians», on retrouve l’esprit de Splinters, fabuleux groove de cimetière à la nuit tombée joué aux percus. On parlait du loup, le voilà : Dr John joue sur «Blackhawk», nouveau cut d’ambiance subliminale, monté sur un sale groove de mousse de cimetière abandonné - When I come down to New Orleans - Ils racontent leurs routes et leurs déroutes. Tout cet album vibre de hoodoo motion, de pulsion carnavalesque, d’all nite long, on entend jouer un guitar king du coin de la rue dans «Battlefield» et Marva Wright vient débaucher le funk-monster «Hang Tough», elle s’y arrache les ovaires, Bo Dollis l’allume et elle répond du tac au tac. Encore un chef-d’œuvre violent et dangereux avec «Tootie Ma», digne de David Lynch et des exécutions sommaires auxquelles on assiste furtivement dans Wild At Heart.
Un autre Indian Tribe vaut largement le détour : The Wild Tchoupitoulas, avec un album du même nom paru en 1976. Même genre d’extravagance, ces mecs posent en costume d’Injuns de carnaval, mais cette fois, Allen Toussaint les produit et les Meters les accompagnent. Leon, George, Zigaboo, ils sont tous là. Le boss s’appelle Big Chief Jolly et il mène le bal du gospel carnavalesque. Personnage clé dans l’histoire des Neville Brothers puisque George Landry, aka Big Chief Jolly, n’est autre que leur oncle. Ce junkie notoire et dealer local passe ses nuits en ville et rentre au petit matin en sifflotant. Charles Neville : «Always sharp. Hats for days.» Toujours sur son trente-et-un et coiffé d’un chapeau. Aaron raconte qu’Uncle Jolly s’asseyait au piano pour jouer (to bang out) ‘Junkie Blues’. Et bien sûr, Uncle Jolly porte une arme. Un jour, la police l’accuse d’avoir accosté une blanche. Les poulets commencent par le mettre en cage pendant 72 heures. La question n’était plus de savoir si l’histoire était vraie, si Jolly connaissait cette femme, s’il l’avait même déjà vue. La blanche est catégorique, même si pour elle tous les nègres se ressemblent. Alors les poulets mettent la pression sur Jolly. Tu vas avouer, niggah ? Impossible. Pourquoi ? Parce que Jolly ne peut pas avouer un truc qu’il n’a pas commis. Les coups commencent à pleuvoir. Bim bam ! Jolly tient tête. Mais non, j’ai rien fait ! Alors les flicards lui disent : «Baisse ton froc» et le placent face à un bureau. Un poulet ouvre un tiroir, dit à Jolly d’y mettre ses couilles et claque le tiroir. Cyril Neville : «They nearly beat him to death. Ils l’ont tellement rué de coups qu’il n’entend plus d’une oreille. Mais il a réussi à garder sa dignité et ils ont été obligés de le relâcher.»
Ce héros de la famille Neville dit un jour à ses neveux qu’il voudrait bien enregistrer un disque comme celui des Wild Magnolias. Son idée est simple : il veut une musique qui puisse exprimer l’esprit et l’âme de son Uptown tribe. Comme il revendique le sang indien qui coule dans ses veines, ses neveux lui proposent «Indians Here We Come», un groove à la Dr John. Fantastique décontraction de groove - I’m sending my gang down two by two - Ils tapent ensuite dans un hit des Meters, «Hey Pocky A-Way». George Porter entre dans le lard du funk à la syncope. Zingaboo souligne ça finement. On est dans l’archétype du New Orleans Sound, joué à l’épisodique miraculeux. Les voix éclatent dans le blossom de la légende. L’«Indiand Red» qui ouvre le bal de la B est un hymne à la révolte - We are the Indians of the nation/ The wide wild creation/ We won’t kneel down/ Not on the ground - Fantastique déclaration d’indépendance, les Tchoupi gèrent ça au gospel batch. S’ensuit un fantastique «Big Chief Got A Golden Crown» avec de paroles mythiques - Mardi Gras morning when the sun comes up/ Big Chief gets a golden crown/ Drink fire water from a silver cup - Joli groove vermoulu, idéal pour danser dans la rue avec Martha. Encore un joli slab de funkitude avec ce «Hey Mama» joué aux congas de Congo Square - Hoon don day - C’est rythmé au don day ! Pour Cyril Neville, voir son oncle chanter, c’était comme de voir un roi : «It was royalty, funky royalty. The gooves were dance grooves, parade grooves, party grooves. It was a music of motion, a music that moved us to change our lives.» Aaron Neville pense que cet album enregistré avec Uncle Jolly est un disque saint. Uncle Jolly veut enregistrer un deuxième album, mais quand il voit si peu de blé arriver, il décide d’arrêter les frais : «Screw ‘em. I ain’t recording for those guys again.» Jolly propose de partir en tournée et ils déboulent en Californie avec Fess.
Wardell Quezergue est l’une des légendes du New Orleans Sound des années soixante et soixante-dix. Mais il est beaucoup moins connu qu’Allen Toussaint. Pourtant, dès qu’on met le grappin sur l’une de ses production, on tombe de la chaise et ça fait mal au cul. La preuve ? Cette compile inespérée qui s’appelle Sixteen Smokin’ Soul Senders Vol. 1 et qui sonne comme un Best of Stax, mais avec un petit quelque chose de particulier : les artistes qui s’y trouvent sont notoirement inconnus, à commencer par l’immense Lydia Marcelle et son «Everybody Dance». Une pure énormité sortie des Districts - C’mon baby do the jerk - Elle chante comme une sale petite carne des bas fonds, elle ramène tout le scum des streets, ça clap du hand et ça stomp du feet. Révélation suprême et timbre unique. Un peu comme Earl-Jean McCrea. L’autre grosse poissecaille de cette compile miraculeuse s’appelle Senator Jones. Il est là avec deux smokin’ monsters, «Let Yourself Go» et «Boston Feel». Il y est soutenu par des chœurs de filles complètement délurées. Vous n’aurez ça qu’à la Nouvelle Orleans. Senator Jones chante avec une vraie voix d’arrache. Il a ce petit quelque chose que n’ont pas les autres. Si vous aimez bien le raw r’n’b, c’est là que ça se passe - Do the Boston feel ! - Tiens, voilà encore une incroyable merveille d’Ali Baba : the Jades avec «Lucky Fellow», un fabuleux hit de groove de Soul. C’est même la part du rêve, le hit absolu des jours heureux. Idéal pour les petits cœurs serrés. Et ça repart de plus belle avec the Fabuletts et «Can’t Stay Away», encore une belle lampée de r’n’b. Tout y soigné, le son, les chœurs, les cuivres, c’est du hot raw de rêve. Et les Bates Sisters s’amusent à sonner comme les Ronettes. Yeah baby, on se croirait chez Phil. Elles y croient dur comme fer. Et puis voilà Guitar Ray qui radine sa fraise avec «Patty Cake Shake», un hit roulé dans la farine d’une basse bien ronde. C’est d’une classe indécente. Vous ne trouverez pas un seul déchet sur cette compile. Tout est nickel chez Wardell. Il visait de toute évidence le public Stax, mais comme les labels locaux n’avaient personne pour les distribuer, c’est resté lettre morte. On y entend aussi l’immensément immense Earl King avec «Feeling My Way Around». Quelle brochette de surdoués !
Autre légende du New Orleans Sound, Eddie Bo. Un conseil, chopez Baby I’m Wise. The Complete Ric Singles 1956-1962, une compile Ace plutôt récente. Ne serait-ce que pour entendre «Hey There Baby», un cut digne des Beatles mais avec un batteur dément. Un vrai dingue du beat et le petit solo de sax n’y changera rien. Bo the beat fait le show. Il faut aussi entendre ce coup de génie intitulé «Check Mr Popeye», ce funk bien vermoulu qu’il l’emmène au paradis - Oh do the papah - Eddie Bo est aussi le grand spécialiste du slowah super-frotteur. On en trouve une série sublime dans cette compile, à commencer par «I Need Someone». Eddie chante comme un crocodile, les mâchoires en cœur. On note son incroyable prestance et la qualité plastique du chant l’élève au plus haut rang du kitsch. Même chose avec «Nobody Without You», slowah effarant de présence décadente et de fleurs fanées - Please/ Please come back - Ou encore «Everybody Everything Needs Love», vieux slowah gluant qu’il chante au-delà de ses capacités. Eddie est un démon, il faut le savoir, un extraordinaire artiste, il pousse les choses aux max du mix. On le voit aussi taper dans le r’n’b rudimentaire avec «Every Dog Got His Day». Eddie est une génie du chachapoum de balloche louisianaise, et il se paye même le luxe d’un killer solo de sax. Alors il tombe et remonte, affolant de petite énergie. Il tape aussi dans le heavy blues avec «You Got Your Mojo Working». Ah comme c’est bon ! On est dans le Ric d’époque, c’est-à-dire dans l’underground louisianais de l’excellence. Avec «It Must Be Love», Bo se plonge dans le heavy groove romantico - I wonder - Il se demande pourquoi il est si stupide. Il passe au rock de petite bite avec «Ain’t It The Truth Now» et attention à «What A Fool I’ve Been», c’est à tomber. Il tape là dans l’excellence du kitsch, c’est battu aux congas et nappé de violons. Extraordinaire ! Voilà encore une raison de ne pas perdre Eddie Bo de vue. On le voit danser «Dinky Doo» au coin du juke, il y va à coups de ya ya ya. Il adore aussi le jump comme on le constate à l’écoute de «Ain’t You Ashamed», il chante ça à la fritaille, avec du guitar gimmick de luxe. Ah le veinard ! Eddie Bo ne se refuse rien. C’mon Bo ! Il termine avec le morceau titre, qui est un hit du grand Lee Dorsey - Baby you’d better be movin’ on !
Autre passage obligé pour tout amateur de New Orleans Sound : Clarence Frogman Henry. Grâce à Ace, on peut se goinfrer en écoutant Baby Ain’t That Love. Texas & Tennessee Sessions 1964-1974. Comme Eddie Bo, Forgman Henry est un artiste complet et assez fascinant, il faut le voir attaquer «Ain’t Got No Home», ce typical jive de juke monté au oh wooh wooh. Il chante ça d’une voix de gonzesse et ça bascule dans le hot kitsch et puis cet enfoiré redescend chercher son meilleur baryton pour créer de l’expressionnisme. On ne trouve pas ce genre d’artiste sous le sabot d’un cheval. Cette compile pullule de petits hits de juke, à commencer par «Cajun Honey», fantastique coup de mon cher ami, aw quel punch, encore une histoire de fille qui rend fou - You’re driving me wild - Tout aussi excitant, voilà «That’s When I Guessed». Il passe au groove de boogaloo avec «Shake Your Money Maker». Frogman sait jiver sa petite affaire. Il nous propose les meilleures conditions du groove. C’est là qu’on danse avec les loops. Avec «Saving My Love For You», il se montre tout simplement extraordinaire de prestance. Un patron blanc dirait de lui : «C’est un bon esclave !». Il tape dans Meaux avec «Think It Over». C’est noyé d’orgue et Frogman sort des grosses mains balladeuses pour tripoter le cul du cut. Effarant ! «Baby Ain’t That Love» semble gravé dans le marbre de l’underground louisianais. Il sait aussi faire du Fatsy. La preuve ? «Cheatin’ Traces». Il tape aussi une cover du «Sea Cruise» de Frankie Ford, mais il la prend trop reggae et ça ne marche pas. On note au fil des cuts l’extraordinaire santé de cette compile. On passe en effet de genre en genre et Frogman suit le mouvement. Quand il tape dans le heavy blues avec «I Can’t Take Another Heartache», ça devient passionnant, car il sait titiller son blues d’un doigt expert. Il traite «Hummin’ A Heartache» à la maturité de bon aloi. C’est un vieux pro. Il sait jiver un jive et chanter du nez. Lorsqu’arrive «It Went To Your Head», le son se modernise considérablement. Attention, c’est encore du Meaux. C’est ultra-joué à la guitare. Joli coup de Tex-mex avec cette reprise de Doug Sahm, «We’ll Take Our Last Walk Tonight». C’est bardé de coups d’harmo et Frogman en fait une merveille élégiaque. Et quand on écoute «You Can Have Her», on se dit qu’on est bien dans ce coup d’Ace. Eh oui, Ace sait tisonner les vieux braseros et créer les conditions de la légende. Une chose est bien certaine, Frogman Henry en est une. Encore du Meaux avec «Mathilda». Huey P. Meaux s’y connaît en rock motion, aucun doute là-dessus. Frogman tape dans la country avec «In The Jailhouse Now», il gère la chose au mieux des possibilités. Chez Meaux, on ne fait pas n’importe quoi. Quel son ! Voilà ce qui s’appelle une production ! Le heavy groove d’«A Certain Girl» se montre digne de Slim Harpo et cette compile se termine avec «Shock-A-Dilly Alabam» - I was born/ Just across the river/ In a little town - On se trouve une fois plus noyé dans le meilleur groove d’Amérique et il loue les musiciens qui l’accompagnent - Come on Jojo !
Puisqu’on dans les passages obligés, en voici un autre : The Dave Barholomew Songbook. The Big Beat. Toujours Ace. On n’imagine pas à quel point Dave Bartholomew fut sollicité en tant qu’auteur. Bien sûr, ça commence par Fatsy, mais tous les grands artistes américains ont tapé dans ses chansons, à commencer par Elvis avec «Witchcraft» (Il jive ça comme un king), Jerry Lee Lewis avec «Hello Josephine» - Hello Josephine/ How doo/ Youuu/ Doooo - Brenda Lee avec «Walking To New Orleans» (Fantastique et juvénile, c’est presque aussi beau que la version de Fatsy) et bien sûr Dave Edmunds avec «I Hear You Knocking» (pur génie, ce Gallois sorti de nulle part qui nous Slim Haponise Bartho). On profite aussi de l’occasion pour réécouter «The Fat Man», vieux coup de ramdam de piano drive. On peut même parler de beat des origines. Là mon gars, tu es aux sources du rock avec ce petit gros qui pianote comme un dingue. Il ventricule son beat à l’orée du bois. Laisse tomber les autres, c’est Fatsy qu’il te faut. Shirley & Lee, c’est du même acabeat. Avec «I’m Gone», on a le duo le plus sexy de toute l’histoire du rock. C’est elle, la reine du groove juvénile, elle dégouline de génie purulent. Dans cet enfer, le pauvre Lee tente de faire surface, mais c’est elle la coche qui ouuuh-ouuuhte le babïïï. Elle est perçante, elle chante du ventre, elle est la source du rock, la pure source de tout le sexe du rock. Prodigieux ! Tiens, encore une folle de la Nouvelle Orleans : Annie Laure, avec «3x7=21». Elle tape ça au gospel batch, elle jazze son dam doo leum dah bam bam et là tu as Ella, tu as aussi Miles qui vient schtroumpher du solo de wah dans l’ombilic des limbes. Ces gens sont sublimes. Tout aussi dévastateur, voilà Smiley Lewis avec «Down The Road». Ah t’as voulu voir Vesoul ? Alors voilà Smiley. Il joue comme une brute. Il chante au gras du yes I’m gone et le solo de sax sonne comme une pétaudière. On a là un extraordinaire drive de New Orleans Sound. Smiley chante comme un démon, yes I’m gone, il défonce la rondelle des annales. Tout aussi explosif, voilà «Ain’t Gonna Do It» des Pelicans. Ils jouent ça à l’énergie concomitante, c’est un délire de good time music. Mais qui ira écouter les Pelicans ? On ne connaît même pas leur existence. Par contre on connaît celle du Johnny Burnette Trio qui tape une belle cover d’«All By Myself». Évidemment, ils claquent ça au jive de rockab de fière allure. On trouve aussi l’un des tout premiers rockers d’Amérique sur cette compile : Roy Brown, qui explose «Let The Four Winds Blow» - Have you heard the news - Quelle énergie ! C’est battu à la diable. Ce shuffle énergétique n’existe nulle part ailleurs. Encore un autre roi du shuffle : Bobby Mitchell avec «I’m Gonna Be A Wheel Someday». C’est joué à l’extrême des possibilités. Rien d’aussi jivé de la ciboulette que ce truc-là. D’autres merveilles impitoyables guettent l’imprudent voyageur : «Everynight About This Time» par les Fabulous Upsetters, ou encore l’implacable «Blue Moday» repris par Georgie Fame. Et combien d’autres encore ? Il faudrait s’étendre sur Keith Powell, Tami Lynn ou encore Bobby Charles. C’est vrai qu’on n’en finirait plus.
Le mot de la fin revient à Dr. Ike Padnos, cité par John Broven dans sa bible : «New Orleans rhythm and blues, by mixing in the influence of the territory bands, Louis Jordan, and boogie-woogie piano, kicked off with Roy Brown’s ‘Good Rocking Tonight’ in 1948. Then a year later Fats Domino’s ‘The Fat Man’ helped usher in the birth of rock’n’roll with Earl Palmer laying down a subtle backbeat and Dave Bartholomew’s arrangements of the horns doubling up on top of the rhythm section.»
Signé : Cazengler, new orléon de Bruxelles
Wild Magnolias With The New Orleans Project. Polydor 1974
Wild Magnolias. They Call Us Wild. Barclay 1975
Bo Dollis & The Wild Magnolias. I’m Back At Carnaval Time. Zensor 1990
Bo Dollis & The Wild Magnolias. 1313 Hoodoo Street. Aim 1996
Wild Magnolias. Life Is A Carnival. Metro Blue 1999
Wild Tchoupitoulas. ST. Antilles 1976
Wardell Quezergue. Sixteen Smokin’ Soul Senders Vol. 1. Night Train International 2002
Eddie Bo. Baby I’m Wise. The Complete Ric Singles 1956-1962. Ace Records 2015
Clarence Frogman Henry. Baby Ain’t That Love. Texas & Tennessee Sessions 1964-1974. Ace Records 2015
The Dave Barholomew Songbook. The Big Beat. Ace Records 2011
John Broven. Rhythm And Blues In New Orleans. Pelican Publishing 2016
DISARRAY
ACROSS THE DIVIDE
( Digital Album - 02 / 12 / 2020 )
Les ai vus trois fois en concert. Ce n'est pas un mythe, il fut un temps où l'on pouvait voir des concerts, je vous assure que cela a existé, j'avais chroniqué leur album Encounters, j'ai souvent jeté un œil sur leur FB, ne se passait pas grand-chose, je me doutais que dans leur coin ils devaient trimer et tramer quelque plan secret, et au deuxième jour de décembre ils ont sorti un nouvel album, précédé de quelques clips sur You Tube, un acte de courage, mais ils ont raison c'est au petit matin du deux décembre que les canons ont brisé la glace d'Austerlitz, et fissurer la chape de plomb qui est tombé sur le rock est une louable initiative.
La pochette mérite d'être vue. Au début vous souriez, quel besoin d'écrire le nom du groupe en si gros sur la pochette, seraient-ils en pleine crise mégalomaniaque. A croire qu'il n'existe qu'eux dans ce bas-monde. Faut scruter l'ocre-orangé pour visualiser la vestale en ses voiles blancs qui va de l'avant les yeux bandés. Son pied-nu frôle la pierre usée d'un porche, serait-ce l'entrée d'un temple abandonné. Derrière elle l'orée d'une forêt embrumée, peut-être simplement un parc déserté, en tout cas, un sentiment de solitude, ambiance romantique, l'on songe aux somptueuses et mélancoliques proses de Chateaubriand et l'on se dit que si le nom du groupe voile la photo de la couverture, ce n'est pas du tout une naïve manifestation de fierté mal-placée mais une mise en situation de l'auditeur, ne sommes-nous pas des aveugles qui marchons dans la vie sans rien savoir de très précis de là où l'on va, même si l'on associe l'idée de mort à la plus néfaste et angoissante noirceur... D'ailleurs le premier titre n'est guère encourageant...
Black hole : étrange il y a de la musique mais la voix d'Alexandre est si prenante qu'il vous capte et que vous n'entendez qu'elle, s'il y a un trou noir c'est elle dans laquelle vous vous engloutissez, rassurez-vous nous ne sommes ni dans l'espace ni dans la guerre des étoiles, la cavité ombreuse qui vous emporte est à l'intérieur, maintenant vous pouvez entendre le ruissellement du métal, une pluie qui claque et qui lave, vous enferme dans un cocon, car si la désolation est au-dedans de vous, la lumière aussi, il suffit d'oser le voyage de ne pas se perdre dans les mers de noire solitude, juste un passage, un étroit et immense boyau, un tunnel sans fin dont vous finirez par joindre le bout. Superbe intro, une espèce de récitatif sauvage, un rugissement sans fin de lion. Burried memories : harmonieuses glissades, les guitares ont l'air de s'enfuir, comme un relent de fête, mais cela ne dure pas, l'épreuve ne fait que commencer, une espèce de jeu-vidéo, une partie que vous n'avez pas le droit de perdre, l'ennemi est le plus terrible qui soit, vous n'en rencontrerez jamais de pire, vous le connaissez bien, est-ce pour cette raison que cette piste est une épilepsie joyeuse, renforcée par le chœur des voix, hachée par Alexandre, l'alien est en vous, vous êtes l'alien de vous-même, une bête sombre qui vous hante et qui surgit la nuit pour vous attaquer. Une course-poursuite, une chute sans fin à l'intérieur de vous-même, le morceau s'arrête brusquement, avez-vous touché le fond, allez-vous être enseveli sous des morceaux de vous qui tombent sur vous... Invincible : tambourinades, bruits de forges titanesques, je suis un peu comme ces martiens de la guerre des mondes d'H. G. Wells qui se réparaient eux-mêmes après avoir été touchés par les obus et les torpilles, la plus grande violence est en moi, morceau tornade, morceau limite, de mes défaites je construirai mes victoires, ma vie sera une tour érigée pour détruire l'univers, ce qui m'a tué m'a rendu plus fort que la mort, plus fort que la trahison. Un vent de haine et d'allégresse souffle dans les voiles de la vengeance. Oblivion : tout va trop vite, kaos dans la tête, sont-ce des rêves ou des claquements de metal qui s'échappent, la voix d'Alexandre déchire les certitudes, des chœurs venus d'ailleurs creusent des espaces immenses comme des cathédrales stellaires, l'on ne sait plus si l'on est dans un film de science-fiction ou dans soi-même, la vitesse exponentielle du déluge musical ne vous aide pas à garder vos idées claires. Gold : Axel ouvre le vocal mais Alexandre l'éventre, l'or scintille et corrompt, ne reste qu'à le rejeter, qu'à le maudire, et à abandonner ceux qui l'utilisent comme monnaie d'échange, un cri de colère et de dégoût, le groupe devient fracas hurlant, une hystérie musicale, ne s'agit-il pas de détruire la société. (S)Hell : la musique ronronne, ce n'est pas un chat mais une bête hideuse qui s'éveille dans la gorge d'Alexandre, c'est le démon du bien, celui qui promet de tout recommencer, générique de film à gros budget et multitudes de figurants, grandiloquence des grands sentiments, les promesses n'engagent-elles que ceux qui les croient, l'œuf dans le nid que l'oiseau couve n'est-il pas celui d'un serpent. Brisez la coquille, vous entendrez l'enfer. To the bone : très rock, un cri de haine, l'envie de cracher sur sa gueule, les chœurs comme des oiseaux moqueurs et le vocal tel un procureur qui condamne et maudit, tu ne fais plus partie du clan, les mots claquent comme les lanières d'un fouet. Damnation, retranchement définitif de la communauté humaine. Lost : il existe sur YT une magnifique vidéo verticale oppressante à souhait. Pas d'attente, musique concassée un peu à la manière de Linkin Park . Sans appel. Sans rappel. Le constat froid et glacé de l'échec de la civilisation humaine. Quelques survivants qui errent sans but. Danny Louzon de Nakht est venu en renfort pour bazooker le vocal sans rémission. Des éclats de haine retournée envers soi-même. Un monde et une musique sans résilience. Même pas le no future, juste le no tout court. Un non-avenir qui fait froid dans le dos. Une explosion désatomisée. By any means : très belle vidéo verticale à regarder en vis-à-vis de la précédente, elles forment un véritable diptyque. Après la perdition, l'apaisement, la possibilité d'un recommencement, musique plus douce, un orage bienfaisant qui redonne vie. Serait-ce la fin du cauchemar. Etrange comme les éraillements d'Alexandre paraissent dans l'immense vacarme de l'album une berceuse douce et tendre. Addiction : encore un pas en soi-même, un chant de rouille pour avouer la vérité, un bien grand mot pour nommer un souvenir inoubliable, juste un chagrin de rencontre, qui vous a emmené dans les ténèbres intérieures, parfois l'on a l'impression que le metal se fait violon, l'a beau se reprendre tout casser et concasser, rien n'y fait l'addiction est un poison, en eaux troubles, l'addiction est un plaisir. Between You & Me : des cordes comme des perles de rosée. Tout dire, tout vomir, faire le point et le poing, ce que l'on garde et ce que l'on chasse, Alexandre dégueule le vocal, bile noire et bile sanglante, les guitares deviennent les clairons de la victoire, les voix s'éloignent dans le lointain. Fastueuse emphase finale de l'orchestration. Le rideau tombe.
Unité rythmique et sonore. Le vocal d'Alexandre est le fil noir qui traverse l'œuvre de part en part. La batterie de Maxime Weber gronde et galope telle une nuée menaçante et dévastatrice. Elle ne faiblit jamais. Il est important d'entrevoir la guitare d'Axel Biodore et la basse de Regan MacGonam en tant que chants lyriques de grande amplitude. Ecouter ce disque c'est entrer dans une immense symphonie vocale qui ne faiblit jamais. Un grand vent qui vous emporte et vous ravage.
Damie Chad.
LA FIN DU ROCK
MARC SASTRE
( Les fondeurs de briques / Janvier 2021 )
Rock is dead, titre posthume des Doors publié en 1997, mais enregistré en 1969. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Plus d'un demi-siècle... Et voici que Marc Sastre nous propose ces quatre mots qui tuent, la fin du rock, comme disent les bluesmen, il n'y va pas avec le dos de la spoonfull. Marc Sastre n'est pas un inconnu pour les kr'tntreaders, nous avions chroniqué son Jeffrey Lee Pierce. Aux sources du Gun Club in Kr'tnt 160 du 23 / 10 / 2013. L'on avait beaucoup aimé à tel point que l'on s'était intéressé à deux de ses recueils de poèmes, L'homme percé et Aux bâtards de la grande santé dans notre livraison Kr'tnt 190 du 22 / 05 / 2014.
Avis aux amateurs, ceci n'est pas une histoire du rock'n'roll qui se terminerait par de vagues considérations sur l'essoufflement du genre et conclurait sur sa prochaine et rapide extinction. Le livre serait plutôt à ranger parmi les essais éthiopathiques. La disparition du rock n'est pas une fin en soi. Si vous désirez savoir pourquoi le rock est mortel, il est d'abord nécessaire de savoir pourquoi le rock existe. Tout phénomène nécessite la cause qui l'a engendré dixit Aristote, le rock'n'roll n'est pas l'exception qui confirme la règle. Encore faut-il s'interroger sur la notion du pourquoi dont émane un parfum trop eschatologique, qui tendrait à faire accroire que le rock'n'roll est apparu pour sauver le monde. Très prudemment Marc Sastre se contente de réfléchir sur les circonstances qui ont permis au rock'n'roll de se déployer, restons terre à terre, remplaçons l'élucidation du pourquoi par l'interrogation du comment.
Question de méthode. Tout de suite l'on se heurte à un grave problème. Même si l'on part du pire, du principe que le rock est à deux pas de sa tombe, qu'il est moribond, qu'il n'en a plus pour très longtemps, il n'en empêche pas moins que le rock n'étant pas encore tout à fait mort, il est encore vivant, étudier un phénomène dont on fait partie, dont on est encore partie prenante, et en dresser son certificat de décès est chose impossible, celui qui dit en ses derniers instants je meurs sur son lit d'hôpital au milieu de multiples perfusions est encore en vie même si l'annonce s'avèrera très vite avoir été prophétique... Marc Sastre réussit à contourner – et c'est en cela que réside la force de son livre qui n'excède pas cent pages – cet obstacle épistémologique. Pour annoncer la mort du rock, vous pouvez garder un pied à l'intérieur du rock si cela vous chante – en fait parce que vous êtes incapable de faire autrement - mais il faut avant tout s'en extraire, s'en libérer.
Le rock n'est pas né de la Sainte Vierge, il est le fils utérin de la domination marchande du monde. Ce n'est pas un hasard si l'opuscule débute non pas dans un champ de coton mais à la Renaissance, à ce moment conceptuel précis où la technique permet à l'homme occidental de se rendre maître de sa planète, encore moins si ce premier chapitre a pour titre : à la croisée des chemins le diable conduisait une Ford T, laissez le Diable se dépatouiller avec Robert Johnson, concentrez-vous davantage sur la voiture, un instrument de libération clamera-t-on dans les années soixante, car l'on est toujours séduit par les riches couleurs du serpent dont vous êtes mordu. Heidegger vous énonce la même chose mais il ne parle pas de l'encombrant reptile, il laisse le dangereux ouroboros à Nietzsche, mais ceci est une autre histoire. Enfin si l'on veut car l'histoire de la fin de la philosophie ressemble étrangement à celle de la fin du rock'n'roll, celui qui l'annonce y est encore empêtré en plein dedans.
Chacun a son anecdote croustillante à raconter, pour Marc Sastre il met en scène The Clash, un groupe qui pour moi ne vaut pas tripette mais chacun de nous possède ses propres histoires d'amour-haine bien plus véridiques que celles de tous les autres... Arrachons-nous les paillettes exaltantes de nos yeux exaltés, le rock'n'roll a partie liée avec quelque chose qui nous dépasse tous, la domination économique du capitalisme productiviste – comme par hasard c'est en ces années-là que le rock'n'roll est le plus imaginatif, le plus créatif - et puis libéral, la finance coupe les vivres à la production – le rock s'étiole, s'éparpille, le serpent se mord la queue – c'est le moment idéal de sortir le couplet idéal que tout le monde attend.
Le rock est une musique de révoltés. De laissés pour compte. De ceux qui ont refusé de pactiser avec le Capital – à moins que ce ne soit cette hydre tentaculaire qui ait négligé de leur glisser le minimum vital – le pire c'est que c'est vrai et totalement faux. Certes, le blues, le rock, le rap sont à l'origine des musiques mises au point par des couches délaissées de la population. Ces premiers de corvées – et encore souvent ils se contentent de claquer du bec la bouche ouverte car il n'y a pas de travail pour tout le monde, car le travail est la seule richesse des pauvres et il n'est pas bon qu'elle soit partagée entre tous – sont les véritables héros du rock'n'roll.
Tu parles Charles. Tu n'as jamais entendu parler du grand retournement. Ah ! mes cocos vous aimez le rock, souriez vous êtes filmés ( soyez modernes faites des selfies ) vous voulez du rock, l'on va vous en vendre du rock, du beau, du bon, du gras, tous les styles, tout ce que vous voulez – cela s'appelle diviser pour mieux régner – nous aussi on a lu Marx, la marchandise on va vous la fétichiser à outrance, vous allez connaître non pas la malédiction mais l'addiction ( ce qui est beaucoup plus diabolique ). La porte des élus sera étroite, pour des milliardaires comme des Stones combien de crève-la-faim, non ne les plaignez pas, ils possèdent quelque chose de bien plus précieux que les grosses liasses de bank-notes, ils ont le rêve dans leur tête dont ils ne veulent pas se défaire, dont ils refuseront de se départir d'une seule miette. Etrangement cette musique de laissés-pour-compte aide à les maintenir dans leur dépendance, le rock'n'roll participe d'une démarche oppressive, réactionnaire, conservatrice, anti-révolutionnaire. Tout ce que vous inventez, tous vos crans d'arrêt, on vous les rend, on vous les vend, en plaqué-or, armes émoussées que vous brandissez fièrement et retournez contre vous.
O. K man Sastre, tu parles d'or et tu causes de toc, mais le rock dans tout ça ? Je vous rassure, le rock ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il en jacte en mec qui en a fait la colonne vertébrale de son implantation dans le monde. Et le livre regorge de magnifiques évocations, ce mec sent le rock, il est son propre sang, il l'a fait sien, ou plutôt c'est le contraire c'est le rock'n'roll qui a donné un sens à son existence et permis d'accéder à une vie plus pleine, plus riche, plus enthousiaste. D'où cette inquiétude devant ce recul du rock dans la culture contemporaine. Sans doute un jour qualifierons-t-on le moment historique que nous vivons comme celui de la recul-ture, un truc encore pire que le no future des punks car il n'y a pas que le rock qui recule, de nouveaux âges d'obscurité se mettent doucement en place.
N'est pas vraiment optimiste le Sastre. Le sastrisme est encore plus décourageant que le sartrisme. S'en tire par la consolation du pauvre. Certes le rock est mort, certes nous n'y pouvons rien, certes c'est foutu, mais au moins nous avons eu la chance d'être une génération à qui le rock a permis de partager la table des Olympiens, le beggar's banquet nous y avons accédé et cela personne ne nous l'enlèvera. Il suffisait de tendre l'oreille et de se servir. Que ceux qui n'y ont pas pensé ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Quant à nous, nous ressemblons un peu à ces soldats d'Alexandre qui l'aventure finie rentrèrent chez eux la tête pleine d'un rêve qu'ils avaient eux-mêmes forgé mais qui maintenant leur échappait et qui était bel et bien terminé. Ils ont pu le raconter à leurs petits-enfants mais qui aujourd'hui se souvient de leurs récits à part les livres d'histoire... dont tout le monde se fout...
Et pourtant quelques pages avant ses derniers mots Marc Sastre nous parle du futur du rock. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il se contente d'en relater les derniers soubresauts, les derniers obsédés du rock qui montent des labels, forment des groupes, qui organisent des tournées qui ouvrent leurs bars pour les concerts, qui écrivent des livres et des blogues, bref tous ceux qui se démènent pour entretenir la flamme avant qu'elle ne s'éteigne... le dernier carré à Waterloo qui meurt et ne se rend pas.
Z'oui il y a des malchances que ça se termine ainsi, mais il y a une autre manière d'entrevoir le feu qui couve. La situation est-elle désespérée ? Oui mais pas plus et même moins qu'elle ne l'était lorsque les premiers bluesmen tendaient des cordes sur les planches de leur baraque pour produire la bourrasque des sons qui exprimeraient leur mal-être et leur révolte. Le monstre qu'ils ont produit leur a échappé, d'autres s'en sont gavés, l'ont retenu prisonnier à l'aide de chaînes d'or, et ont fini par l'abattre, mais ses bâtards et son esprit courent encore. La mauvaise herbe repousse toujours.
Un spectre hante le monde. Il se nomme rock'n'roll.
Un beau bouquin qui parle de la mort du rock pour l'aider à vivre et à revivre.
Damie Chad.
ANIMALS / 1964 ( I )
L'année 1964 sera faste pour les Animals, une rencontre déterminante, celle de Mickie Most, pour rester dans l'étroit périmètre de Kr'tnt relisez dans la kronic 495 ( du 28 / 01 / 2021 ) du Cat Zengler consacrée à Ron Wood tout le bien qu'il dit sur Truth et Beck Ola du Jeff Beck Group, apprenez-le par cœur pour plus tard le réciter à vos petits-enfants et concluez pour chaque album par la formule : produit par Mickie Most. Cela servira à leur élévation morale. Brjeff, suffit pas d'avoir des musiciens doués, si c'est un glandu qui s'agite derrière la console, il vous manquera le son, et sans son que ferait Delilah ! Pour ceux qui veulent tout savoir sur Mickie Most, le Cat Zengler vous a préparé exprès pour vous un topo au top à lire sur Kr'tnt ! 434 du 17 / 10 / 2018.
MARS 64
Baby let me you take home : ce n'est pas une vieille reprise de blues, je pense que Most a dû suggérer ce morceau écrit par Bert Russel Berns – lui aussi producteur qui forma Bang Record avec Jerry Wexler – et Wess Farrell qui travailla avec Russel. C'est quoi au juste : une chansonnette de rien du tout, fleur bleue et tout ce que l'on déteste, mais gravée dans le marbre. Rien à enlever et rien à ajouter. Les plans se succèdent à une vitesse diabolique, un clavier gentillet qui joue le rôle de l'orgue de barbarie dans les chansons sentimentales, Price a compris que point trop n'en faut, se faire voir et se faire désirer sont les deux mamelles du rock, ce qui signifie qu'il est urgent de se faire oublier de temps en temps, le morceau n'excédant pas les trois minutes notre organiste n'est pas tout à fait en cellule d'isolement, Burdon se charge de tous les rôles, du garçon qui presse, de la fille qui attend qu'il se taise enfin pour dire oui, et du mec romantique qui tire sa tirade ( parlée ) de ( fausse ) passion racinienne, et les trois autres que leur reste-t-il à faire, les jolis chœurs, moqueurs qui tiennent la chandelle pendant que le copain décharge. Une véritable comédie de mœurs juvéniles. Gonna send you to the Walker : un de ces vieux traditionnels arrangés et trafiqués par beaucoup de monde. Vous changez les titres et un peu les paroles et vous créditez de votre nom, ici elle est aussi signée des deux précédents. Ce qui est certain c'est qu'elle ne se retrouve pas tout à fait par hasard chez les Animals après que Dylan l'ait enregistré sur son premier disque. Influence Chuck Berry certaine dans le traitement du morceau. Même départ, mais deux fusées intergalactiques peuvent avoir été tirées du même pas de tir sans que les espaces qu'elles visiteront soient les mêmes. C'est sûr que vous avez deux petits soli de guitare de Valentine mais le premier s'amourache de l'orgue de Price et cela change la donne, Burdon vous dégobille le vocal à la torpille, si vous aimez les albums Où est Charlie ? je vous propose une nouvelle version Où est Chas ? pour ma part j'ai envie de répondre que je comprends pourquoi les Doors se sont passés de bassiste, doit quand même contribuer à la noirceur du son des Animals, je me demande si parfois sa piste n'est pas overdubée par l'orgue ce qui contribue à sa prééminence... Walker où le guy renvoie sa poupée qui ne s'habitue pas à la grande ville étant tout près de Newcastle l'on peut se demander si le morceau n'est pas une parodie des vieux south blues...
JUIN 64
The house of the rising sun : la première fois que je l'ai entendue c'était par Johnny Hallyday, paroles d'Huges Aufray, Alan Price à l'orgue, et les Animals quand et par qui l'ont-ils écouté la première fois... sur l'origine de la chanson jeu concours : cherchez la chronique dans Kr'tnt !, il est logique de penser que Burdon grand connaisseur de blues devait connaître certains des premiers enregistrements, toutefois il à remarquer que si Baby let me to take you at home est en piste 2 de la face B de l'Album Bob Dylan en tant que Baby let me follow down il est immédiatement suivi, en piste 3, sur ce même 33 T de The house of the rising sun, d'après moi c'est ce que l'on appelle un hasard significatif... C'est bien l'arrangement de Dylan et de Dave Van Ronk à qui le Bob l'avait '' emprunté'' que reprennent les Animals. Ce morceau hissa les Animals au pinacle du rock'n'roll, il fit leur gloire, il les expédia directly dans le heartbeat des fans de l'époque au même niveau que les Rolling Stones et les Beatles. Il fut aussi la première fêlure qui brisa l'unité du combo. J'étais jeune et pas trop bête, je me disais, l'est attribué à Price ce ne peut pas être Alan Price, l'est bien sympathique mais il n'a pas la carrure pour écrire cela ( le fameux flair du rocker ), j'ai cherché, me suis creusé la tête pour finir par l'attribuer à Lloyd Price, résultat j'ai cherché vainement durant des années The house of the rising sun par Lloyd Price sans jamais la trouver... mauvaise piste. Une erreur fatale que ne commit pas Alan Price, crédita le traditionnel à son nom. Il oublia bêtement de rajouter les quatre autres copains... qui ne le lui pardonnèrent jamais. Le ver était dans le fruit mais Price a dû penser que le fruit était autour du ver... on ne commente pas un tel morceau, c'est sur celui-ci que l'on entend Chas un max... la voix de Burdon est magnifique, quant à l'orgue de Price il puise dans les racines du gospel... D'ailleurs le premier morceau de la face B de Bob Dylan, s'intitule Gospel Plow ( voir la version de Chance McCoy And the Apallachian String Band )... Talkin' 'bout you : ne pas confondre avec le Talking about you de Chuck Berry, l'adaptation provient de Ray(on de soleil noir ) Charles quand on sait d'où procède Ray Charles l'on ne s'étonne pas que le morceau sonne méchamment gospel, sans surprise quand on a le début l'on sait comment cela se terminera sept minutes plus tard, l'orgue court comme l'aiguille des secondes au cadran de la montre pas du tout arrêtée, l'on pourrait s'ennuyer mais Burdon est si imaginatif qu'il vous entraîne dans un tourbillon sans fin, et les chœurs derrière miaulent comme des chats amoureux sur les toits les nuits de pleine lune.
SEPTEMBRE 64
I'm crying : enfin un original, Price et Burdon ont mouillé la chemise, résultat un must, Hilton hausse le ton de sa guitare et ça défile à la vitesse d'un troupeau de mustangs qui galopent pour échapper à un feu de prairie, un superbe morceau refermé sur lui-même comme une sphère parménidienne, Burdon s'impose comme l'un des plus grands vocalistes rock, mais le plus terrible ce sont ces chœurs masculins échappés d'une représentation de l'Agamemnon d'Eschyle qui ont la même force dramatique que les trois coups du destin dans la symphonie du destin brisé de Beethoven... Eddy Mitchell en a donné une version qui n'est pas à dédaigner, même les lyrics sont moins passe-partout que ceux de Burdon. Take it easy : encore écrit par le duo Price-Burdon, je n'appelle pas cela une création, plutôt une imitation de ce qui existait avant eux, une espèce de décalcomanie de leurs inspirations, vous avez le droit de penser que je cherche des poils sur les œufs pondus par les Animals surtout que c'est méchamment mis en boîte, le Mickie Most il devait être horloger suisse dans une autre vie. Nos deux compositeurs ne se sont pas oubliés, occupent toute la place, mais Mickie Most a su faire sonner l'heure à la batterie de Steel et vous a ménagé pour Hilton le quart de minute dont chaque soliste a besoin pour être célèbre. L'ensemble souffre de sa juxtaposition avec I'm cryin'
Nous les avons écoutés, regardons-les :
The house of the rising sun :
Décor de studio, des espèces d'éléments de croix blanches de pierres tombales appuyées sur une cloison que la lumière des projecteurs rend jaunâtre, la caméra se déplace de droite à gauche, voici Alan Price assis devant son orgue, mince comme une table à repasser, l'on se demande comment il peut tirer de cet étui à mitraillette un telle amplitude sonore, sous les manches des guitares l'on aperçoit au fond et au faux centre de l'image le haut de la batterie de John Steel légèrement positionné de guingois, impressionnante la carrure de Chas Chandler bouche le fond du décor, devant lui Hilton Valentine avec son air sage et sa Fender et devant Hilton Eric Burdon – pas vraiment beau, ne rallumons pas la Guerre de Cent Ans, disons une beauté anglaise – sont rangés tous les trois en escalier, portent tous un complet marron-gris qui ne laisse dépasser que le col jaune de leur chemise. Sont affublés d'une cravate noire. Le décorateur aurait-il compris que The house of the rising sun désignait la dernière demeure des cimetières ? C'était la vue d'ensemble. Attention une chorégraphie, les trois ostrogoths debout défilent devant nous, dévoilant pleine vue l'entier attirail de John Steet et Alan et son joujou. Voici à l'extrême droite la tête de Burdon, peau acnéique, qui d'un lugubre appel met en garde toutes les mothers du monde, il baisse la tête et ses beuglements vous filent le frisson filandreux, la caméra tourne et l'on se rend compte que les planches blanches symbolisent les barreaux d'une cage dans laquelle ils sont prisonniers, preuve que décorateur avait intuité juste, et que nos trois zigotos ne se livrent pas à une chorégraphie de centre aéré mais qu'ils tournent en rond dans leur cellule, Steel bat le beurre en mâchant un chewing gum de façon peu ragoûtante, Burdon vous ouvre la bouche avant que le dentiste ne lui arrache ses dents de sagesse, mains de Price avec la gourmette en argent au poignet droit, Hilton vous adresse son meilleur sourire hypocrite, l'est manifestement content que ça se termine ( on achève bien les Animals ), s'inclinent tous respectueusement.
I'm cryin'
Dans le temps traînait sur le net une espèce de réplique de la précédente. Nos Animals y interprétaient en playback I' m cryin, restaient sagement alignés comme des I jaunes ( Rimbaud affirma en un poème célèbre que le I était rouge mais les historiens ont prouvé qu'il n'avait jamais vu cette vidéo ). Etaient revêtus d'un magnifique costume bouton d'or éblouissant, pourquoi les Animals ne seraient-ils pas des canaris après tout, je ne l'ai pas retrouvée, hélas. Il existe tout un tas de versions plus ou moins live de ce morceau, question ethnologique privilégiez leur premier passage au
Sullivan Show, le 18 octobre 1964
Le décor est un peu chiche, un fond de baraque de loterie de fête foraine agrémentée d'un arc d'ampoules électriques colorées – rappelons que l'image est en noir et blanc, enfin en grisâtres inexpressifs – mais l'on entend la foule invisible qui crie et surtout l'on voit : John Steel surélevé sur son podium, Alan au niveau de la médaille d'argent sur sa gauche et devant plantés comme des piquets de tomates les trois autres. Le morceau n'est pas commencé que déjà ils ouvrent leurs râteliers aussi larges que des bouches d'égout et l'ouragan vocal vous surprend en pleine campagne, vous expédient le choral comme un tapis de bombes sur un village innocent, z'ont les yeux qui pétillent de joie, Steel est un peu inquiétant ne se préoccupe que de sa cymbale, un gosse autiste qui joue pendant des heures avec l'emballage du cadeau que sa grand-mère lui a offert, Chas est à la fête, il balance tout heureux sa stature de géant, l'est sûr que les filles ne peuvent pas ignorer sa présence virile, le plus rigolo c'est Eric, il a une façon d'allonger le cou comme une girafe chaque fois qu'il s'approche du micro, et puis sur la fin il roule les épaules avec ce regard en biais de boxeur qui va vous décrocher le knock out dans la seconde qui suit, tiens il se tient l'épigastre gauche d'une manière luxurieuse, l'Alan a l'air pour une fois plus préoccupé par sa participation à la chorale démoniaque que par sa machine à touches, n'y a que l'Hilton qui semble se souvenir qu'il est là pour jouer de la musique encore qu'il n'oublie pas d'ouvrir sa bouche aussi large que l'entonnoir d'un mégaphone. Normalement ils devraient être tristes puisque la chanson veut qu' ils pleurent, mais l'on devrait conseiller cette bobine à tous les dépressifs. Z'ont l'air tellement heureux que c'est plus que jouissif, réjouissif.
Damie Chad. A suivre.
XX
ROCKAMBOLESQUES
LES DOSSIERS SECRETS DU SSR
( Services secrets du rock 'n' rOll )
L'AFFAIRE DU CORONADO-VIRUS
Cette nouvelle est dédiée à Vince Rogers.
Lecteurs, ne posez pas de questions,
Voici quelques précisions
91
Sont tous à la poursuite de Molossa et de Molossito, Charline et Charlotte en leur maillot rose, l'adjudant qui les suit de près, soldat Pierre, soldat Marc qui comme tout soldat du rang qui se respecte sont prêts à suivre leur chef jusqu'à la mort, et une dizaine de fusiliers-marins qui gardaient le poste de garde de l'entrée qui ont suivi le mouvement par réflexe, commettant une première erreur, celle de laisser la grande porte d'entrée du palais ouverte, et une deuxième qui pourrait leur valoir le conseil de guerre, le portail de la cour d'honneur béant aux quatre vents, ceci est juste une expression parce que pas un souffle d'air ne trouble l'atmosphère du petit matin.
-
Droit dedans !
Je n'ai pas attendu l'ordre du Chef pour commencer la manœuvre, avec la sureté et l'élégance d'un pilote professionnel, je pose l'appareil et coupe les gaz.
-
Nous ne pouvions trouver circonstances plus favorables, déclare le Chef en retirant de sous son siège une mallette de fer-blanc, les filles et les chiens ont été formidables, j'avais escompté entrer en force, mais la voie est ouverte !
-
Attention hurle Vince, une grosse bagnole passe le portail, suivie d'une autre!
En six secondes c'est une dizaine de voitures qui entourent notre appareil, elles ne sont pas totalement arrêtées qu'en surgissent une quarantaine d'individus ( mâles et femelles )passablement excités qui se ruent sur nous en criant et en nous tendant un carton à bout de bras. Les logos sur les voitures, les caméras et les micros sont explicites, BFM TV, Europe 1, France Inter, Antenne 2, Match... des journalistes !
-
Mesdames, Messieurs – la voix onctueuse du Chef s'élève et comme par miracle le silence s'installe – service de Sécurité de L'Elysée, que puis-je pour vous, s'il vous plaît si un seul d'entre vous pouvait formuler votre requête, cela nous permettrait d'avancer plus vite !
-
C'est très simple, une jolie petite brunette a pris la parole, nous avons reçu une convocation de la Présidence de la République pour participer au point presse, qui suivra la réunion secrète sur la pandémie Coronado-virus que tient actuellement le Haut Conseil de Surveillance en présence du Président de la République. Il est vrai que nous sommes un peu en avance, mais le portail était ouvert et nous avons cru...
-
Vous avez eu raison. Je vous demande de patienter une petite vingtaine de minutes en compagnie de l'agent de sécurité Vince, je me précipite aux nouvelles avec l'agent Chad, à tout à l'heure.
Un soupir de satisfaction s'élève de la foule...
92
Molossa et Molossito galopent dans les couloirs, ils ont bien une minute d'avance sur leurs poursuivants, tous deux se cachent sous les tentures de doubles-rideaux qui encadrent une vaste fenêtre face à une large porte capitonnée. Charlotte, Charline, l'adjudant, soldat Pierre, soldat Marc et la douzaine de fusiliers-marins passent devant eux en trombe sans les voir.
-
Crois-en mon flair, Molossito, c'est là-dedans que ça se passe !
-
Oui Molossa, ce serait bien que l'agent Chad soit là, il trouverait le moyen d'entrer lui, il est si intelligent !
-
Tiens le voilà, avec le Chef en plus !
93
Ambiance studieuse. Le Président de la République parle. Tout le monde l'écoute, certains prennent des notes.
-
La situation est grave, des milliers de morts chaque jour, nous avons réussi à détourner la colère de la population en accusant à tort le Service Secret du Rock'n'roll d'avoir répandu le virus en distribuant gratuitement des Coronado sous la Tour Eiffel, le temps que nous arrêtions les deux responsables de cette organisation terroriste et nous...
-
Troudemerdededieu, ouvrez vite, nous les tenons !
La porte vient de s'ouvrir brutalement, l'Adjudant entre suivi du soldat Pierre qui tient fermement par le bras Charlotte qui porte Molossa, puis du soldat Marc qui tient fermement par le bras Charline qui porte Molossito, suivi du Chef solidement encadré par une dizaine de fusiliers-marins et qui porte précautionneusement sa mallette de fer blanc contre sa poitrine...
-
Clitotrouédelasaintevierge, mon Président, nous avons le Chef, les chiens et deux jeunes innocentes qui se font faites avoir par les paroles doucereuses de ces aigrefins, pour l'agent Chad, d'après moi, il ne doit pas être très loin !
-
Adjudant, vous méritez de la France, et vous le dénommé Chef, l'ignoble empoisonneur du pays, quelles piteuses excuses allez-vous imaginer pour votre défense !
94
Lorsque j'apparais sur le perron je m'attends à entendre des exclamations de soulagement et d'impatience, mais non tous les journalistes sont assis sur les marches et semblent porter une très grande attention aux paroles de Vince.
-
Excusez-moi, mesdames, messieurs le Président vous recevra dans une vingtaine de minutes !
-
Chut ! Taisez-vous ! Laissez-nous donc tranquilles ! Dites au Président que ce n'est pas pressé, qu'il prenne tout son temps ! Il y a tout de même des choses plus graves que les milliers de morts du Coronado-Virus sur cette terre ! Ecoutez plutôt ce que nous raconte l'agent Vince, c'est prodigieux, insensé, incroyable !
-
Oui Messieurs-dames, je vous ai pour le moment évoqué la vie de mon ami Eddie Crescendo, j'en viens maintenant à raconter les derniers jours de sa mystérieuse disparition...
Je m'éclipse discrètement...
95
Je suis revenu une demi-heure plus tard. L'assistance est atterrée. La petite brunette est en pleurs. Certains appellent nerveusement leur rédacteur en chef sur leur portable. Il y en a même deux qui retiennent une chambre d'hôtel à Nice...
-
Le Président de la République vous fait savoir qu'il a l'honneur de vous recevoir, je vous demanderais le plus grand calme et la plus grande dignité. Nous avons à traverser de longs couloirs, je compte sur vous pour ne pas crier et courir pour arriver les premiers.
Vince et moi marchons en tête. Tout le monde se déplace avec gravité et componction. L'adjudant nous attend devant la porte
-
Enculédetaracededieu, le Président a dit que les caméras et les appareils photos sont autorisés, en rang par deux, un dernier coup de peigne pour les dames, messieurs rajustez vos nœuds de cravates, et que personne ne moufte sans autorisation, facederatsdedieu !
Et d'un geste auguste il poussa les deux vantaux matelassés...
A suivre...
09:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie watts, down in new orleans, across the divide, marc sastre, animals, rockambolesques ( 20 )
23/05/2014
KR'TNT ! ¤ 190 : LISA AND THE LIPS / CHARLIE WEST / ORVILLE NASH / SUBWAY COWBOYS / OL' BRY / MARC SASTRE/
KR'TNT ! ¤ 190
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
23 / 05 / 2014
|
LISA AND THE LIPS + BELLRAYs / CHARLIE WEST / ORVILLE NASH / SUBWAY COWBOYS / OL' BRY / / MARC SASTRE / |
|
ERRATA Suite à ma chronique de la semaine dernière sur le concert des Ghost Highway, Zio me fait remarquer qu'il n'accompagne pas à la contrebasse Miss Regina Crown mais MISS VICTORIA CROWN. Donc acte, mes excuses à la jeune reine que j'espère avoir le plaisir de revoir en concert bientôt. ( DC) |
LE BATOLUNE / HONFLEUR ( 76 ) ) / 30 -04-14
LISA AND THE LIPS
Mona Lisa

Lisa Kekaula pourrait très bien prétendre à un trône africain. Elle a le port d’une reine et une voix d’airain. Elle pourrait très bien revêtir un boubou de soie tissée d’or et alourdir ses bras de bijoux antiques, mais non, elle se présente à nous coiffée d’un chignon dressé en gerbe et serrée dans un pantalon de cuir noir. Lisa Kekaula entre sur la scène du Batolune comme si elle entrait dans la salle du trône de l’empire Dogon du XVe siècle : elle se fait d’abord entendre puis elle se manifeste physiquement, imposant à tous et à toutes sa puissante prestance animale. Elle détient aujourd’hui le big soul power que détenait Aretha en 1968.

Autour d’elle se dressent les Lips, une formation composée de musiciens espagnols relativement jeunes et de Bob Vennum, son vieux compagnon d’aventure. Lisa et Bob ont semble-t-il jeté l’ancre en Espagne pour se réinventer. Ces activistes du blast soul-punk qu’on connaissait sous le nom des BellRays se sont transmutés en Lisa & The Lips, une fière équipe de funksters dévastateurs. La high-energy est toujours au rendrez-vous mais désormais, Mona Lisa shout-balamalatte la meilleure soul du monde.

Très grosse équipe, en vérité : trompette, sax, claviers, batterie, basse, deux guitares et Lisa embarque tout ça dans une bacchanale entêtante, cette espèce de pulsation hypnotique à laquelle les grands shouters noirs de r’n’b nous ont habitués. Écoutez n’importe quel album live de Wilson Pickett ou de Ike & Tina Turner, et vous retrouverez cette animalité de peau humide et de all night long. C’est toute la différence avec le garage qui s’arrête au bout de deux minutes, pour reprendre et s’arrêter encore deux minutes plus tard. Les géants de la soul traversent la nuit dans la fournaise des pulsions animales. Leur distance n’est pas la même. Lisa règne sur l’immense chaos de la sensualité avec une sorte de parfait mystère africain : pas de regard, la voix, rien que la chaleur de la voix, comme si les dieux primitifs s’exprimaient à travers elle.

Et comme pour contrebalancer ce pathos, elle se livre à quelques pitreries en se roulant par terre. Bob place ici et là quelques solos de guitare dignes de ceux de Wayne Kramer, totalement incendiaires, et sur les morceaux plus funk, Pablo Rodas, un petit bassiste qui n’a l’air de rien avec ses cheveux longs bien peignés joue des lignes de basses stupéfiantes et dignes de celles de Bootsy Collins. Un drummer nommé Max Resnikosky bat un beurre technique très haut de gamme et joue à merveille le rôle clé du pulsateur. Avec une section rythmique aussi rutilante, Lisa et Bob jouent sur du velours.

L’album de Lisa & The Lips ravira tous les amateurs de hot soul. Les vieux fans des BellRays y retrouveront aussi leur compte de bombes, avec par exemple «Come Back To Me», un mid-tempo fin et racé, gorgé de la meilleure soupe de soul, où on entend Bob prendre un solo rissolé aux flammes de l’enfer. Et puis on trouve aussi cette pataterie râblée, «You Might Say». Lisa monte à l’assaut, en puissante shouteuse. Voilà un rock-blast monté sur un groove seventies, craquant et bon comme le pain frais. Franchement, on ne peut pas espérer mieux. Puis Lisa prend «Trouble Mind» à la Esther Phillips, softy-sweety à la petite vitesse du beat bien doux. On la sent dans son élément - ease my trouble mind - on ne peut que vibrer, à condition bien sûr de considérer le genre comme supérieur. Et puis voilà ce «Stop The DJ» avec lequel ils ont bouclé leur deuxième rappel, monté sur un funky beat à la Bootsy. C’est un funk digne des nuits rouges de Harlem, finement shafty. On suit à la trace cette belle ligne de basse insistante et bien groovy, toujours affiliée au meilleur funk des ghettos d’antan. Pablo bombarde sa basse et part en vrille sur des coups de bas de manche affriolants. C’est un traverseur de manche en quinconce, il va chercher le tagada de gamme pulsatif. On retrouve un mid-tempo infernal - leur meilleure vitesse - avec «The Pick-Up», mélodique en diable - heaven goes around me yeah - une pièce de soul inspirée. Et on revient au funky strut avec «Push». Ils trottent dans les traces du push - you’re gonna have to push to make it all the way - Lisa grogne et Pablo se balade à longueur de manche. Il fait le grand jeu traversier du funkster impavide - push wouahhh - fabuleux et coulant. Ils terminent l’album avec une pièce mortellement ralentie et funkstée à la racine du poil, «The Player», exemplaire, précis et régulier comme un mercenaire bien payé - funky booty baby, pièce de rêve. Tout ceci pour dire que l’album vaut l’emplette.

C’est vrai qu’on ne sortait jamais indemne d’un album des BellRays. Lisa et Bob ont monté le groupe en Californie en 1992. À l’époque, Tony Fate produisait et Bob jouait de la guitare. Leur premier album s’appelait «In The Light Of The Sun». Sacrée entrée en matière. Pour un premier album, c’était un véritable coup de maître. Dans «Crazy Water», on les sentait déjà très obsédés par le Tamla sound. Tony Bramel sonnait comme James Jammerson, le légendaire bassman des Funk Brothers, l’orchestre maison de Tamla. On ajoutait là-dedans une trompette à la Miles Davis et on se retrouvait avec un hit. On en trouvait un autre avec «Footprints On Water» que Lisa amenait d’une voix grave pour aller ensuite chercher une mélodie imparable. Pour «Same Ground», ils nous servaient sur un plateau un riff seventies et un shuffle hot et bien pushy. On retrouvait nos belles nuits rouges de Harlem, une musique puissante des reins, et tendue comme la peau d’un tambour africain. Il semblait que les BellRays avaient percé le secret du beat sourd d’Harlem Shuffle. Nouvelle horreur stupéfiante avec «You’d Better Find A Way» allumé au power-chord. Annonciateur d’incendies à venir. Ils donnaient leur vision du rock, celle d’un rock qui décollait avec un vent mélodique brûlé par une fournaise rythmique. On avait là de quoi se régaler - Inspiration ! You’d better find a way - modèle d’intégrité compositale, Lisa éclatait au firmament et Bob lui donnait la réplique. Encore plus somptueux : «In The Light Of The Sun», avec une belle entrée en matière de voix diffuses et embarqué très vite au plus haut niveau mélodique. Et ça grimpait dans l’éclat, soutenu par des cœurs. La force des BellRays, c’est que leurs grands hits sonnent comme des classiques intemporels. C’est encore ici le cas. Avec leur premier album, ils révélaient leur génie.

«Let It Blast» est sorti six ans plus tard. C’est là que la presse a commencé à s’intéresser à eux. Pour décrire le phénomène, les journalistes avaient inventé cette formule : Aretha accompagnée par le MC5. Les BellRays se voulaient révolutionnaires, dans la veine du MC5, mais ils utilisaient un nouveau langage, le soul-punk. Petit à petit, les BellRays se sont élevés dans l’échelle sociale du rock. De petit combo exotique revendiquant l’héritage du MC5, ils sont passés au rang de maîtres suprêmes du blast-garage américain. Ils commencèrent à régner sans partage sur un immense territoire hérissé de petites oreilles de lutins.
Une chose est certaine : les BellRays sont essentiellement un groupe de scène. Ils furent pendant un temps la meilleure équipe de rockers californiens. Tony Fate ne se refusait rien, ni la riffalama à la Tony Iommi - ou pire encore, à la AC/DC - ni les incursions incendiaires à la Wayne Kramer. Ils avaient le drummer approprié, on s’en doute. L’articulation centrale de cette machine de guerre que furent les BellRays, c’était Bob Vennum. On l’a dit et répété à chaque fois, Bob Vennum était le meilleur bassiste de rock sur cette terre. Il dépassait en intensité ses vieux pairs, Tim Bogert et Jack Cassady. Bob Vennum avait un jeu de basse impulsif complètement exacerbé. Il pouvait bombarder comme dix Lemmy et jouer le jazz comme Charlie Mingus. Il fallait donc voir les BellRays sur scène. Bob Vennum faisait quasiment le spectacle à lui tout seul. Il jouait vraiment comme un dieu. Il sautait, il suait, il carambolait ses notes, comme Tim Bogert le faisait aux grandes heures de Cactus. Comme certains joueurs de tennis, il avait le bras droit beaucoup plus volumineux, à cause sans doute de la tension musculaire due au jeu de médiator. Pas de prisonniers. Bob Vennum fut un monstrueux showman doublé d’un technicien hors-pair. Et quand on aura compris que la dynamique d’un groupe repose sur le bassman, on aura tout compris.

Puisqu’on patauge dans les certitudes, en voici une autre : «Let It Blast» nettoie bien les oreilles. Lisa met son chien au service de l’un des plus effrayants carnages soniques de la fin du XXe siècle. Tony Fate fait subir les derniers outrages à sa bête à cornes. Il joue sur une SG Gibson bordeaux. Il peut jouer les machines à riffer quand ça lui chante et il fait parfois passer Tony Iommi pour une belette. Le maillon fort de cette fine équipe, c’est l’immense Bob Bass Boss Vennum. Il ne peut pas rester tranquille plus de cinq secondes. «Changing Colors», c’est un peu l’enfer sur la terre. Lisa arrive là-dedans en hurlant. On ne peut vraiment parler que de fournaise, avec une basse qui ronfle comme ça. Horrible. Le son est très peu soigné. Ils ont enregistré ça sur un radio-cassette. La basse sonne comme un battement de cœur. Chez Fate, ça tire les notes. Elles se baladent comme des serpents dans les fougères. C’est à tomber. Ça cafouille dans la farfouille. Voilà une entrée en matière qui ne pardonne pas. Encore du beau foutage de garage avec «Cold Man Night». Toujours plus motivé. La basse qui est sourde comme un pot passe devant, dans le mix. Lisa porte tout l’édifice à bouts de bras. Elle ne mégote pas. Bob fait tout le ramdam à lui tout seul. Il martèle et il pilonne. Tony Fate est au fond du studio, on l’entend à peine. C’est un cut explosé dans l’oignon, basse de Bob devant toute. Il gratte trop de notes. À l’époque, quand on le voyait sur scène, il jouait des milliards de notes, il sautait en l’air et faisait les chœurs, tout ça en même temps. «Today Was» reste dans la même lignée de titres volontaires et indomptables, fougueux comme des poneys indiens. Lisa tente de calmer le jeu. Avec des démons comme Tony Fate et Bob dans les parages, c’est impossible. Rien de plus infernal que «Kill The Messenger», monté sur un tempo dévasté type Motörhead. Trop de puissance. Lisa parvient à régner sur cette extravagance. C’est le chaos total, l’empire du trash, on entend les forces du mal nous rattraper à la course. «Blue Cirque» sonne la charge de la brigade légère. Les BellRays ont l’air de foncer dans la plaine sous le feu de l’artillerie russe. Ils ont cette capacité de susciter des images très fortes. C’est emmené à la batterie. Le pounding mène la danse. Il y a des petites zones de néant, mais le morceau repart toujours. Les BellRays développent de réelles capacités lysergiques en relation directe avec les tourments cosmiques des dieux antiques. Ils jazzifient «Testify» jusqu’à l’os du sternum. C’est un prêche de type Airplane ou MC5 - brothers and sister everywhere - retour en force du garage porté par une basse diabolique. Ce «Testify» évoque aussi les Flaming Sideburns. Les BellRays en font un morceau assez lourd, au moins aussi lourd qu’un heavy-blues de Nebula ou de Pentagram. Bob joue des lignes de jazz bass. Il est absolument spectaculaire. Il joue ces petites gammes rapides qui ont fait la gloire des grands contre-bassistes du XXe siècle. Bob et Tony sont capables de lever de grandes tempêtes jazzy. Peu de bassistes sont capables de jouer de tels boléros. L’équation du groupe est parfaite : une chanteuse colorée, un guitariste virtuose et une section rythmique d’avant-garde. Il n’y a pas de recette miracle. Et si on est pas encore tombé de sa chaise, alors on tombe avec «Black Honey», plaqué d’accords déments, gratté menu, emmené, intuitif, chanté à la vie à la mort. Les BellRays, le grand groupe américain du XXe siècle ? Allez savoir. Ce «Black Honey» vaut tout l’or du monde. Cerise sur le gâteau : un solo d’antho signé Tony Fate qui rappelle ceux de Victor Unitt dans l’album «Parachute» des Pretty Things. Le drive de basse emmène toute la bande au firmament. La basse ronfle comme un gros buveur assoupi. «Black Honey» est une nouvelle preuve de la supériorité des BellRays sur tous leurs concurrents. C’est un garage qui tombe avec un jeu de questions-réponses - Black honey ! Black honey ! Voilà l’archétype du vrai hit garage. Placide, Bob répond : Black Honey ! Il joue l’un de ces riffs de basse qui font frémir. «Black Honey» n’est pas seulement le hit de ce disque des BellRays. Il est aussi l’un des hits majeurs du XXe siècle.

Leur troisième album «Grand Fury» paraît en l’an 2000. L’apocalypse, c’est eux, évidemment. Nostradamus ne l’avait pas prévu. «Too Many Houses In Here» est une explosion collatérale. Pas d’équivalent nulle part ailleurs, inutile de chercher. C’est brûlé de l’intérieur, ils vont bien plus loin que les Stooges, on ne sait pas comment c’est possible, mais on l’entend, on sent une forte odeur de brûlé sonique. Lisa se prélasse dans une braise héritée directement de «Motor City’s Burning» du MC5. Pur génie. Et Bob pilonne tout ça comme un malade. Avec «Fire On The Moon», ça continue. Tony cocote sa mortelle randonnée. Ces gens-là sont des fous. Ils riffent dans la viande et Lisa règne sur ce carnage. Aucun groupe américain n’a jamais sonné comme ça et ne pourra jamais sonner comme ça. Lisa allume le feu sur la lune. Suite de l’aventure riffique avec «Snake City», la machine de guerre s’ébranle et Lisa est aux commandes. Ils explosent tout. Absolument tout. C’est comme des Stooges gonflés à l’hydrogène. Puis on se prend «Screwdriver» en pleine poire. Lisa nous envoie rissoler dans la Rôtisserie de la Reine Pédauque. Le duo Bob/Fate dépasse l’entendement rythmique. Ils ne jouent pas, ils blastent en permanence. «Heat Cage» n’a aucune chance d’en réchapper. Il vaut mieux avoir les oreilles solides pour écouter ça. On a là ce qui se fait de mieux dans le rock américain : la fournaise du Detroit sound explosée jusqu’au vertige et la voix d’une reine de la soul. Une véritable tornade d’embrasement. «Evil Morning» arrive et aucun répit n’est possible. Ces gens-là surjouent le destin du rock atomique. Rien ne saurait calmer leurs ardeurs sémantiques. Ils cherchent des voies nouvelles, comme le ver dans la pomme. Dès l’intro, «Stupid Fuckin’ People» est bombardé par les deux riffeurs fous. Rien ne peut les arrêter. Ils dépassent toutes les bornes, ils transcendent l’axe Blue Cheer-Motörhead-Stooges-MC5, ils vont encore plus loin, et Lisa hurle, elle s’empare des éclairs jaillis du ciel. On assiste au plus gros pilonnage sonique de tous les temps. Bob sort «Monkey House» à la note de bas de manche, puis c’est traité façon MC5. Nouvelle démence sonique à l’état pur. On a encore droit à un coup de génie avec les chœurs de «Under The Mountain» et on resssort de cet album à quatre pattes.
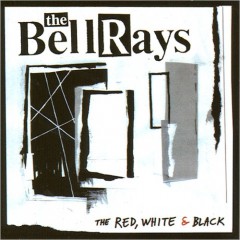
Nouvelle monstruosité en 2003 avec «The Red White And Black». Comme ils l’indiquent sur la pochette, la soul est le professeur et le punk est le prêcheur (Soul is the teacher and punk is the preacher). Folie pure avec le cut d’ouverture, «Remember», un truc de dingue qui perd ses roues, ils foncent de travers, comme s’ils roulaient avec des pneus crevés. Léger parfum de free. Puis on retrouve le riffage du Destin mortel dans «Street Corner» et «Sister Disaster». Fate hache tout ça menu. Voilà l’équation magique du rock moderne : voix + riffage + inspiration. «You’re Sorry Now» est une belle compo de Bob. C’est même un hit planétaire. Ambiance dramatique, accords descendants, foggy motion de riffs terribles. Voilà un hit fabuleux et gargantuesque. C’est un heavy-rock rendu mélodique par les descentes d’accords et le chant perçant de la reine Lisa. On revient au MC5 avec «Revolution Get Down». Bob fait grimper les ponts sur des lignes de basse effarantes. Il faut l’entendre traverser la fournaise révolutionnaire. Le cut est farci de breaks terribles. Bob croise au large comme un requin à lunettes. Faramineux. Pop explosive avec «Find Someone To Believe In». C’est l’une de leurs spécialités. Ils savent faire du mélodif explosif. «Some Confusion City» est un magnifique morceau de batteur. C’est Eric Algood qui bat le beurre. Bob fait hey-hey et il gratte sa basse comme un con. Quelle magnifique équipe, franchement ! Les relances sont impitoyables. Les BellRays nous emmènent en enfer et on adore ça. Punk in the flesh avec «Black Is The Colour». Lisa bat tous les records - bein’ shot down on the blue side of town. Quand on entend «Stone Rain», on se dit : mais ce sont des malades ! La basse devient folle. Il faut entendre Bob perdre les pédale - I feel so lonely I could die - il va dans tous les sens. Il multiplie les descentes de manche. C’est lui le bassman le plus dingue de l’univers, il va là, et là, et il remonte ensuite par des ponts insalubres, quelle brute. On l’entend faire d’autres prodiges dans «Rude Awakening» et ils finissent avec un punk-rock qui envoie au tapis, «Voodoo Train». Inutile d’ajouter que cet album compte parmi les grands albums classiques du rock.

«Have A Little Faith» sort en 2006. On démarre sur un gros groove joué à la manière des Temptations, «Tell The Lie». Tony Fate fait son funky wha wha king. Par derrière, Bob coud sa toile avec un doigté caoutchouteux qui en dit long sur sa culture groovy. Tony Fate a donc écrit le nouveau hit des Temptations. Ils renouent avec la grande sauce funky des eighties. Un saxophone vient sopraner dans l’air torride. Lisa rassemble tout l’air de ses poumons pour honorer la mémoire des divas de la soul. C’est réussi. «Time Is Gone» est un gros groove salace. Le tempo est bizarre, un peu mambique, comme mal embouché. Tony Fate fait monter la petite pression. Il rentre dans le trou du track en jouant un extravagant chorus jazzy. Ce mec a des ressources. Il joue un solo à la Zappa. Il semble que les BellRays mettent un peu d’eau dans leur vin. C’est Tony Fate qui écrit les morceaux. Il devient un compositeur ambitieux. «Chainsong» cumule les fonctions. Dans le cours du couplet, on passe du hardcore à la jazzitude béate. On sent une quête de sophistication. Ça ne peut pas leur faire de mal. Ils cassent bien l’ambiance, avec des zones éthérées à la John McLaughin. Et puis voilà «Pay The Cobra», une remontée en température typique des BellRays de la première heure. Le problème, c’est que tous leurs morceaux musclés se ressemblent. Et puis voilà un couplet en apesanteur. Tony Fate le relève immédiatement avec sa rythmique à la Tony Iommi. Il adore gratter sa bête à cornes. Ça le réconcilie avec la vie. «Snotgun» est aussi une speederie bien fuselée. C’est une revendication de la liberté. Cette chanson est très politisée. «Everybody look at my snotgun/ Tune your guitar to the snotgun/ The alphabet ends with the snotgun/ And all I wanna do is to be free. All I wanna.» «Change The World» est une chanson de Bob. On change de registre. Les BellRays font claquer l’étendard sanglant de la révolte. C’est riffé à mort - I don’t think I can kill myself - éclat du génie bellrique. Et voilà «Detroit Breakdown» qui est le gros cut du disque. Pur Motor City sound - «No more Iggy or the MC5/ Wayne’s been doin’ it in LA now, so you’re just livin’ a lie.» Les BellRays remettent les pendules à l’heure. Effectivement, il ne reste rien du Detroit shakedown. «Maniac Blues» sonne comme une grosse affaire. Effarant de maîtrise. Lisa tire sur ses syllabes et Tony mitraille, bien soutenu par Bob l’inéluctable. Il faut que la gloire des BellRays resplendisse sur la terre comme au ciel. Ils terminent avec une bravado suprême - ah-la-la palabalalah - une reprise des Cornichons de Nino Ferrer. Lisa la swingue à mort. Elle envoie les cornichons, les tomates et les ouvre-boîtes danser dans la fournaise - ba-la-la-la - elle s’amuse comme une folle et elle embarque le swing sauvage.

«Raw Collection» est une compile des singles parus entre 1995 et 2002. Et là, il est recommandé d’attacher sa petite ceinture. Le un s’appelle «You’re Sorry Now». C’est un son caverneux, ambiance soul sixties, avec une basse rampante qui arrive derrière Lisa. Il s’agit d’une belle compo psyché de Bob, nappée d’accords crépusculaires. C’est absolument magistral et ça peut hanter l’esprit. Lisa dispose de tellement de feeling qu’elle ne sait plus quoi en faire. Attention : ils s’attaquent ensuite à un classique vénéneux : «Nights In Venice» des Saints. L’énergie dévastatrice dans un classique dévastateur, ça donne du dévasté dévastateur. Les deux riffeurs fous s’en donnent à cœur joie. Tony cisaille comme un fou. Il est dans son élément. La voix de Lisa colle parfaitement à ce classique de l’apocalypse. Ils vont même finir dans la collision. Bob tricote ses déflagrations souterraines. Franchement, sans les BellRays, que deviendrions-nous ? Ils nous font le coup de la fausse sortie et reviennent comme des barbares. Bob reste sur une note, Tony se roule par terre et se tortille. Il faut aux barbares des compos terribles, voilà le secret. «Half A Mind» sonne illico comme un classique pop, et même comme un hymne. Tony joue tout en fuzz. La mélodie est là, évidente, montée sur une dynamique de basse décisive. C’est une véritable splendeur. Avec sa mélodie enchantée, «Mind’s Eyes» pourrait aussi sonner comme un classique des sixties. Bob joue une bassline de r’n’b et Lisa rayonne comme un soleil dans le ciel bleu des sixties. Les BellRays tapent dans le très haut de gamme. «Pinball City» est un punk-rock sauvage. Lisa prend le chant par en-dessous. La rythmique est du pur MC5. Ils poussent des Hey ! d’anthologie. Bob se balade. Il a la note facile. On reste dans le pinball avec «Mother Pinball», un shuffle de la Nouvelle Orleans - Come on ! Do the pinball, baby ! «Tie Me Down» bascule dans la frénésie. Ils vont si vite qu’on doit s’accrocher à la rambarde. «Say What You Mean» sonne comme un classique épais et dévastateur. On plonge dans cette heaviness jubilatoire comme dans un bain de jouvence. Les foules reprennent le refrain en chœur. On nage dans l’énormité bardée de clameurs. Ho ! Ho ! Ho ! On lève le poing ! Quelle poigne ils ont ! Ils tiennent leurs hits par les couilles. Tony plonge dans un chorus d’une monstruosité hallucinée. Flip, flop, ils pataugent dans le génie. Lisa est au maximum de ses possibilités. Et le morceau repart, en défonçant tout. Lisa et ses amis reprennent les choses là où le MC5 les avait laissées.

«Hard Sweet And Sticky» sort en 2008 avec une belle pochette gourmande. Ils attaquent ça avec un nouveau hit planétaire, «The Same Way», une pop éclatante envoyée avec tout le chien de sa chienne. Compo de l’immense Bob Vennum. C’est quand même autre chose qu’Aerosmith. Au moins, il y a de la tenue dans ce balladif. «Infection» est heavy comme l’enfer. Bob qui joue désormais de la guitare envoie un solo monstrueux. Avec les BellRays, c’est pas compliqué : si on leur demande de faire un album de rock, alors ils font un album de rock. Leurs albums font partie de ceux qu’on réécoute à intervalles réguliers, car on sait qu’on y trouve de la substance. «Infection» est un morceau incommensurable qui se répand dans l’univers. «Comin’ Down» est un mid-tempo poussé par une rythmique ingrate et brutale. Bob repart en solo liquide. Il compte désormais parmi les solistes les plus brillants d’Amérique. Ils reprennent leur vieux hit «Footprints On Water». L’élégance de leur pop restera dans les annales. Lisa et Bob emportent leur soul pop au firmament, à coups de cris, d’éclats et de prodigieuse élégance. «That’s Not The Way It Should B» est du typical BellRays : Lisa devant et derrière, deux riffeurs fous, avec des relances diaboliques et une dynamique exceptionnelle. C’est un cocktail dont on ne se lasse plus.

Le dernier album paru des BellRays s’appelle «Black Lightning». Il est sorti enveloppé du mystère d’une pochette noire traversée d’un éclair anthracite. Comme on l’imagine, cet album recèle son petit lot de bombes. Et notamment le morceau titre qui fait l’ouverture. Ça reste carré et Bob envoie des solos dignes de ceux de Wayne Kramer. Lisa reste cette fabuleuse shouteuse qu’on suit depuis le début. Le paradoxe, c’est qu’il n’y a pas de surprise. C’est aussi énorme qu’on le supputait. Même chose pour «Hell On Earth», nouvelle pièce fumante de rock incendiaire. On entend moins le double riffage d’antan. Le son est plus fusionnel, dans l’esprit de la lave qui s’écoule des flancs du Krakatoa. «On Top» est un cut extrêmement punchy. Lisa l’expédie au firmament, elle a l’habitude. On note au passage que la puissance des BellRays est intacte. «Power To Burn» est une pièce de belle pop mentalement élevée, montée à coups de mélodie, de power chorus et d’un ramassis disparate d’accords cavaleurs. Bob ne faiblit pas, ce n’est pas dans ses habitudes. Il revient toujours placer un chorus intéressant. Avec «Power To Burn», les BellRays nous offrent un modèle de power pop californienne. «Living A Lie» est du pur BellRays, une énormité rockée à la cantonade, vite troussée et enfilée à sec par un gros solo garage. «Everybody Get Up» est cocoté d’avance. Lisa chauffe la marmite. Et ça part dans l’épaisseur de la clameur. Dans la verdeur de la lourdeur. Dans l’éclat de la puissance. C’est une fois de plus une véritable source de jouvence. Toujours aussi épais et bon, voilà «Close Your Eyes» - c’mon take my hand and close your eyes - et Bob part en vrille, c’est un démon du bonheur séculaire, il laisse filer son solo de feu liquide. Rien d’aussi magistral que les BellRays. Huit albums et pas un seul déchet. Qui dit mieux ?
Signé : Cazengler, amateur de belles raies.
Lisa & the Lips. Le Batolune. Honfleur (76). 30 avril 2014
BellRays. In The Light Of The Sun. In Music We Trust 1992
BellRays. Let It Blast. Vital Gesture Records 1998
BellRays. Grand Fury. Uppercut Records 2000
BellRays. Raw Collection. Uppercut Records 2003
BellRays. The Red White And Black. Poptones 2003
BellRays. Have A Little Faith. Cheap Lullaby Records 2006
BellRays. Hard Sweet And Sticky. Vicious Circles 2008
BellRays. Black Lightning. Fargo Records 2010
Lisa & The Lips. Lisa & The Lips. Vicious Circle 2013
18 / 05 / 2014 / AVON 77
AMERICAN COUNTRY ROCK AVON
CHARLY WEST / ORVILLE NASH

C'est la faute au Cat Zangler, qui ici même dans KR'TNT 148 au doux mois de juin 2013 nous avait dressé un tel dithyrambe d'un concert d'Orville Nash que nous ne nous pouvions pas faire semblant d'ignorer qu'il passait à trente-cinq minutes de la maison. Sur le papier ce n'était pas donné, ouverture à dix heures du matin avec initiation à la danse counry toute la journée. Douze heures western swing sans le swing, c'est un peu craignos, alors prudents comme des séminoles sur le sentier de la guerre qui se préparent à sortir de leurs marécages, Mister B and Aïe ! Avons, à Avon, décidé de nous introduire dans le camp des visages pâles à la tombée de la nuit, juste pour le concert.
Judicieuse décision ! Le soleil rasait la cime des arbres lorsque nous pénétrâmes dans le ranch des envahisseurs, poétiquement nommée La Maison des Vallées. Un centre culturel communal composé d'immenses bâtiments et entouré de vastes parkings ombragés, disposé si délicatement au pied d'un interminable et impressionnant aqueduc ferroviaire que l'on se croirait transporté dans une maquette géante.
L'on arrive à l'heure incertaine entre chiens de prairie et loups du grand nord, les garçons vachers finissent leur repas, les hommes ont gardé leur chapeau sur la tête et les filles leur longue robe volante, des regards surpris se posent sur la tenue fifty de Mister B et mon blouson simili-skaï, manifestement l'on se demande ce que nous sommes venus faire là, nous aussi, mais on se rappelle que l'on est ici pour Orville Nash. Ouf !
Annonce au micro : démonstration de danse country catalane dans la salle de spectacle. Je ne voudrais pas me lancer dans une catalinaire dévastatrice à l'encontre de la sardane catalane mais je me suis toujours demandé pourquoi l'Onu n'avait pas inscrit sur la liste des organisations terroristes tout ce qui a un rapport quelconque avec cette stupide pantomime débilitante qui se pratique du côté de Perpignan. Si vous ne me croyez pas, profitez de vos vacances pour vérifier l'étendue des dégâts.
Je tire Mister B de ce guet-apens génocidaire culturel en l'emmenant finir sa bière à l'extérieur. Silhouette connue à l'horizon, incroyable mais vrai, un troisième rocker, et pas n'importe lequel, Raphaël le guitariste des Atomics, le pistoléro sans reproche à la Gretsch de nacre blanche et d'or ! Mais le concert commence...
CHARLIE WEST

Une salle de concert comme on n'en fait plus depuis un demi-siècle, une scène surélevée aussi vaste qu'un champ de foire, et un plancher de petites lamelles de bois aussi glissant qu'un avon de Marseille, et un plafond si haut que vous oubliez qu'il existe, une véritable cathédrale. Au micro le présentateur s'inquiète de notre santé et pour nous éviter toute fatigue inutile il nous recommande d'aller chercher une chaise au réfectoire, ce qui occasionne une sortie en masse vers le susdit lieu de sustentation alimentaire. Bref au bout de cinq minutes tout le monde est sagement assis le long des murs. N'y a que Mister B et mon immodeste personne, qui tels des rocs immobiles dans la tempête, restons debout, collés contre une issue de secours. Ah, ces rockers ils ne peuvent pas faire comme tout le monde !
Tout est en ordre, Charlie West peut faire son apparition suivi de tous ses musicos. Charlie West n'est pas un bleu de la veille. Un véritable vétéran, dans les années soixante-dix il accompagna Vince Taylor, ce qui tout de suite vaut lettre et patente de noblesse. Longtemps axé vers le blues et le rock, en 1999 il effectue un changement de cap, il se tourne vers la country music. Depuis il écume avec son orchestre les festivals et réunions, country comme il se doit. L'orchestre est en place, petit problème Charlie recherche son jack qu'il finit par trouver sur le pupitre de son violoniste. Un, deux, trois et c'est parti. Pas besoin d'en entendre plus pour comprendre. Merveilleusement en place, de sacrés musicos, aussi précis qu'une montre suisse, de la qualité, de la haute définition. Rien à redire, rien à reprocher.
N'ont pas entamé depuis trente secondes Colorado Girl que la voisine de Mister B assise sur sa chaise lui demande – non pas de lui réserver la dernière danse – mais de se pousser légèrement afin qu'elle voie un peu mieux... Le public country nous réservera toujours des surprises... Tout à l'heure ce sera à Raphaël – venu de rejoindre – que sera réitérée la même demande... n'ont tout de même pas tous le cul vissé sur un poteau de barrière de corral. Beaucoup se lèvent et se mettent à danser. Assez joliment faut l'avouer, pas tous doués mais avec du coeur, certains couples se débrouillent plus que bien, et puis guetter les panties des demoiselles quand la robe tournoie et s'élève vers la voûte céleste est une occupation de rocker des plus émérites. Parfois c'est même western string.

Evidemment nous nous intéressons avant tout à la musique. L'on en prend plein les oreilles pour pas un rond – façon de parler car le ticket d'entrée aurait fait fuir le septième de cavalerie – Claude pédale dur à la Steel Guitar, pas très spectaculaire de rester à table toute la soirée, mais il fait fondre les coeurs. La Pedal Steel Guitar c'est encore pire que la gravure de La Mélancolie d'Albert Dürer, ça vous essore le palpitant comme une machine à broyer, dans les films on vous montre toujours les outlaws de la mort en train de faire feu des deux gachettes, en fait ces killers n'étaient que de gros sentimentaux prêts à fondre en larmes dès qu'une minette capricieuse refusait de leur sourire... ils avaient l'âme bien moins aiguisée que la lame de leurs couteaux... heureusement que de l'autre côté de la scène Pascal tire les crins de son crin-crin à foison. Ne sera pas toujours fidèle à son fiddle car sur plusieurs titres il l'abandonnera pour la guitare, mais quand il s'empare de son archet, qu'il a coutume entre deux titres de tenir entre ses dents, ce n'est pas pour nous tirer des larmes de crocodile, nous entraîne sur son violon violent dans une sarabande effrénée. L'a le physique de l'emploi, blond le visage taillé à coups de serpes, genre Apollon qui a beaucoup souffert, et lorsqu'il descend de scène et qu'il entre dans le cercle des danseurs, il les mène jusqu'au bout du délire avec la ruée finale du rond diabolique qui se referme sur lui...

Je traverse toute la salle pour jeter un oeil sur Styve le batteur. Assure aussi les choeurs, c'est lui la cheville ouvrière, si du groupe émane un si beau son, c'est en grande partie grâce à lui. Une frappe puissante mais aérée, qui n'écrase personne et qui laisse à chacun la possibilité de s'exprimer sans avoir à faire l'effort de pousser les meubles pour s'immiscer dans l'atmosphère architecturale qu'il ordonne.
C'est joli, mais nous les rockers l'on aime les ambiances un peu plus dures. Il y aura de très bons moments comme les reprises de Seminole Wind de John Anderson ou de The Wanderer de Dion & the Belmonts. Mais au bout d'une heure et quart nous nous éclipsons discrètement vers le bar. Ce n'est pas que ce soit mauvais, mais Charlie West – j'ai oublié de dire qu'il se débrouille plutôt bien au chant - a compris qu'il faut donner aux longhorns le fourrage conditionné qu'ils aiment. L'herbe sauvage leur causerait peut-être un peu trop mal aux dents. Je sais c'est un peu vache ce que je dis, mais Mister B est encore plus critique que moi, de la country commerciale marmonne-t-il, et il a l'impression que le public se moque totalement de l'histoire de la musique country... L'ajoute, je me demande comment il réagirait si à la place de Charlie West on leur proposait les Subway Cowboys, mille fois plus authentiques, plus roots et plus honky tonk...
ORVILLE NASH
En chemin – décidément tous n'atterrissent pas obligatoirement à Rome – nous rencontrons Patrick – un habitué des concerts rockabilly - qui lui aussi effectue – quel hasard ! - un repli stratégique vers le saloon. Formule à voix haute la question qui traverse nos cervelles depuis le début de la soirée. Comment un tel public réagira-t-il face à Orville Nash ? Surtout que la veille il a assisté au concert que d'Orville donnait au Saint Vincent à St Maximin, pas tout à fait le même whisky qui coulerait d'un même tonneau. Celui d'Orville c'est du véritable White Ligthning nous confie-t-il.

D'ailleurs sur qui tombons-nous à la première table du café ? Orville Nash en personne qui se lève pour nous saluer. N'est pas tout seul, Raphaël et Francis qui fut le bassiste des Hot Rocks, sont à ses côtés. Ne reste plus qu'à attendre, mais Orville et les Gamblers s'éloignent pour aller revêtir leur tenue de scène, chapeau et foulard bleu savamment noué autour du cou. C'est ainsi que nous les retrouvons tous les trois sur la scène. Divine surprise, toute une partie du public s'est massé devant la scène et y restera durant tout le set. Quant à ceux qui ne se lèvent pas leur siège, ils seront encore là à la fin du show. Comme quoi il ne faut pas désespérer de l'humanité !

La différence tout de suite. Dès les premières notes. L'on change d'étage. Et de musique. Ici pas d'enjolivements pour attirer le touriste. C'est du brut de brut. Guitare, rythmique et contrebasse, le trio dans toute sa rusticité et dans toute sa gloire. Impossible de tricher, tout le monde garde ses deux mains sur les cordes et personne ne va se pendre. Honky Tonk Mood pour donner le la. Nous sommes aux limites, à l'intersection de trois genres qui se suivent et se ressemblent tout en se différenciant, hillbilly, honky tonk, rockabilly. Campagne, bourgade, ville. Ruralité, sociabilité et fureur de vivre. A trop se côtoyer l'on ne supporte plus de se faire marcher sur les pieds. Bientôt chaussés de daim bleu. La musique populaire américaine est une longue marche qui nous conduit des grands territoires perdus aux concentrations citadines. Les musiciens haussent le ton au fur et à mesure que l'espace rétrécit.
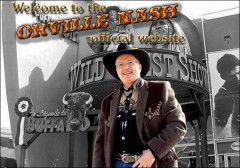
A part que Orville Nash vous fait l'aller-retour en trois minutes. Le temps d'envoyer un Swamp Child aussi gluant de vase verdâtre qu'un alligator qui sort du bayou et le voici déjà dans le poulailler de Charlie Feathers en train de glousser comme une poule qui couve son oeuf alors que le renard se faufile au travers du grillage. Autant vous dire que ça rocke dur et qu'il y a du remue-ménage. Je ne parviens pas à dénicher un adjectif pour qualifier la voix d'Orville, ce qui est certain, c'est que c'est exactement celle qui convient. Vit en France, mais être américain ça vous donne un satané plus pour ce genre de refrains. Vrille ses morceaux comme par chez nous les vieux vous causent en patois. Vous ne reconnaissez rien mais vous comprenez tout. La voix fait image. Vous propose ce que vous voulez voir. Et entendre. L'est terrible à la gratte, lorsqu'il lance ses morceaux ou que les Gamblers le laissent quelques secondes jouer seul, l'on s'aperçoit qu'il balance sans état d'âme. American efficacity. Garantie orvilienne.

Raphaël confirme ce que nous pensions de lui. Un super guitariste. Pourrait nous envoyer des tonnes d'électricité, nous la jouer white rock à outrance, du genre vous n'en voulez plus, en voici encore, mais non il se souvient que l'électrification des campagnes ne s'est pas faite en un clic, alors il s'adapte. Ne bouscule pas le type de musique qu'il est en train de jouer. Ne tient pas être moderne. Se contente d'être en accord avec son sujet. L'est là pour servir mais pas pour se servir et dépasser devant tout le monde avec un plateau préparé. Ne passe pas une clôture sans la refermer car c'est ainsi que l'on respecte les antiques us et coutumes. L'a intégré qu'il joue une musique qui s'évade du country certes, mais qui n'emporte pas moins avec elle des brins de paille et un peu de crottin sous ses semelles.
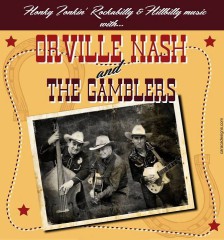
Francis Gomez agit de même. Nous l'avons vu avec sa stature de géant en un autre concert soulever des montagnes et faire dégringoler des tonnes de rockailles sur nos têtes, mais là il sait rester sobre. Déverse tout de même des cruches et des cruches de swing à vous couper le souffle. Même qu'à un moment n'y tenant plus il couchera sa fat mama à terre et s'y vautrera dessus comme pour une sodomie en public – faut dire qu'à ce moment-là Orville rockait comme un roquet en colère, et que Raphael malmenait salement son pickin', bref toutes les conditions étaient réunies pour passer le mur du son. Ce n'était plus du honky Tonk mais du Honky Tank, une division de blindés en train de charger toutes chenilles hurlantes.
Dans le public, ça applaudit de plus en plus frénétiquement à la fin des morceaux, et puis en plein milieu pour souligner tel passage particulièrement bien perçu. Je ne sais pas comment ils font mais lorsque je me retourne je m'aperçois que derrière nous une quarantaine d'amateurs de country dance improvisent un stroll un peu heurté car à la vitesse où Orville débite ses hits si vous avez envie de suivre la cadence vous n'avez guère le temps de compter les pattes des mouches qui volent.
Un rappel et c'est tout. Orville et ses deux condotierres nous laissent sur le bord du ring, sonnés comme les cloches de Notre-Dame, les bras entremêlés dans les cordes, essayant de reprendre notre souffle. Nous a estabouziés. Extase et catharsis. Merci à Raphaël et Francis pour leur vielle de Gamblers, merci à Orville Nash pour ce set impeccable. Ils ont gagné, par K.O technique, par K.O passion.
FIN DE PARTIE
Après un tel round de sorciers, impossible de rester à écouter les disques qui suivent. L'on sort se remettre les idées en place. Excellente idée. Rencontre avec Rudy, Nathalie et son copain qui viennent du Nord. Ne soyez pas surpris mais quand des rockers rencontrent d'autres rockers, de quoi voudriez-vous qu'ils jactent, si ce n'est d'histoires de rockers. L'on se sépare alors que les responsables ferment à clef la Maison des Vallées.
Damie Chad.
( Pour les photos : on a pris ce qu'on a trouvé, ne correspondent pas au concert )
L'ALIMENTATION GENERALE / PARIS / 19 – 05 – 14
SUBWAY COWBOYS / OL' BRY
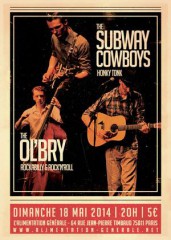
L'est des fois où un sort injuste s'acharne sur les rockers innocents comme l'agneau qui vient de naître. Z'avons pas pu voir les Cowboys du Souterrain qui jouaient dans un bled perdu de l'Oise, et des considérations familiales nous avont empêché d'assister au spectacle des Vieux Briards – peut-être braillards brillants, mais nos traductions sont très approximatives – chez les Loners. De quoi vous dégoûter de vivre. Mais ne voici-ti-pas que les deux groupes suce-nommés passent, non in an another time, neither in an another place comme le chante le diabolique Jerry Lou but en même temps et au même endroit. A Paris. A L'Alimentation Générale. Une occasion unique de faire nos courses.
La course c'est la teuf-teuf mobile qui s'en charge, nous dépose à vingt heures tapantes à moins de cent cinquante mètres de l'épicerie maréchale. Trois jours après je me demande encore comment elle a fait pour dénicher une place de stationnement. Un dimanche soir en plus. Alors que ces têtes de veaux de parigots se sont dépêchés de s'entasser dans leur vingt mètres carrés à mille euros mensuel afin d'être fin prêts le lundi matin à rejoindre au plus tôt leur boulot-métro-dodo. Ce qui explique l'assistance un peu maigriotte. Des amateurs et des connaisseurs, plus une colonie de jolies étudiantes que les rockers émoustillent toujours.

Le patron doit être fatigué, début des hostilités à neuf heures tapantes, fin de partie un peu avant minuit. Ôtez un quart d'heure pour la mi-temps et calculez combien de temps il reste pour chacun des deux groupes.
SUBWAY COWBOYS
Les trois sur scène. De guingois. L'espace est si restreint et si encombré par le matos des Ol' Bry qu'ils ont été obligés de se disposer comme des pions sur un damier sur la seule diagonale libre du carré. Mat au fond, Will au milieu – vous le reconnaissez à son chapeau – et Fab devant, en avant file. Se sentent tellement à l'étroit dans cette minuscule cellule scénique qu'ils entament leur set par un morceau de circonstance, le Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Ne les plaignez pas. A peine s'ils ont la place pour bouger les doigts sur leur cordage, vont donc sublimer leur désir d'espace et de verdure. Ce qu'ils ne peuvent vivre, ce sont leurs instrument qui l'exprimeront.

Echec et mat en faveur de Matt. Apparemment un garçon calme et sérieux, soucieux de bien faire. Se penche avec sollicitude sur sa contrebasse qui a l'air trois fois plus épaisse que lui. L'on dirait qu'il joue au docteur et qu'il l'ausculte une dernière fois avant de décider une intervention chirurgicale, que l'on pressent fatale. Pour un peu on tirerait un mouchoir de sa poche dans le but d'écraser furtivement une larme sur la tristesse de notre joue. Faux-semblant. C'est un ponte, un spécialiste qui vous réveille les morts rien qu'en sortant son bistouri. Ca ruisselle de tous les côtés. A croire qu'il y a une dizaine de contrebassistes éparpillés dans la pièce qui s'amusent établir des effets stéréos et quadriphoniques dans tous les angles du local. Pluie orageuse de triples croches qui virevoltent comme des oiseaux moqueurs dans tous les azimuts. Un trio honky tonk, oui mais qui grâce à Matt résonne comme un quatuor de Bartock. Une batterie, pour quoi faire ? A lui tout seul Matt vous recrée le mur du son de Phil Spector.

Ce serait dommage de ne pas profiter d'une telle architecture sonore. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se targuer d'être digne de vivre dans la Maison Dorée de Néron. Les Subway Cowboys ont de la chance – mais celle-ci ne sourit qu'à ceux qui se donnent la peine de l'attraper – possèdent un prince de la guitare. Deux mois que nous ne l'avions pas vu et il a encore affiné ses licks de tueur. Foudroyants. L'était déjà très bon. S'inscrit désormais dans les meilleurs. L'a acquis l'intelligence et l'instinct du jeu. Ses doigts se posent d'eux-mêmes, n'a plus besoin de les commander, car il agit depuis un espace mental supérieur qui structure toutes ses intuitions. L'est arrivé à une corrélation d'intentions totale, l'esprit ne commande pas plus au corps que celui-ci n'obéit à celui-là. Comme des navires qui voguent de conserve. Comme tout a l'air simple, on le regarde jouer et sa maîtrise est si grande qu'il nous semblerait facile d'en faire autant. Leurre de magicien.

Entre les deux Will. Pas du genre à se cacher pour se faire oublier. Qu'il le voudrait, qu'il ne pourrait pas, avec son organe turgescent, on le repère tout de suite. Ne peut pas ouvrir la bouche sans qu'aussitôt l'attention se focalise dessus. N'aime pas le yaourt, c'est du made in USA, d'importation directe. Mais timbré à son effigie. Tout ce qu'il touche il l'accapare. Sans le martyriser. Tape en plein dans le répertoire de l'americana, mais c'est si bien roulé que l'on n'a jamais l'impression, comme beaucoup d'autres, qu'il traduit avec de gros sabots bien de chez nous. Des godillots parfois sincères mais souvent pathétiques. Non, les versions des Subway Cowboys sont bottées de santiags d'origine ou de texanes d'importation. Mais elles sont comme la pantoufle de Cendrillon. Assez uniques en leurs genres pour exciter la convoitise de presque tous. C'est étrange, ne font que des reprises, avec par exemple ce soir l'accent mis sur Joe Hill, connues de presque tous, mais si bien foutues qu'elles semblent être des compos originales, tant leur interprétation sonne juste.
C'est un régal, on galope à fond de train derrière des bisons qui n'ont aucune envie de finir en boîtes de corn-beefs et le soir on écluse des décalitres de bière brune en pensant à toutes les filles blondes qui nous ont plaquées. Des vachardes, et il y en a un véritable troupeau. Très belle définition du honky tonk man, le mec entre deux vaches celle qu'il poursuit et celle qui s'éloigne... Une véritable postulation baudelairienne entre la réalité qui s'enfuit et le rêve qui s'évanouit. L'air de rien les Subway Cowboys sont en train de construire une phénoménologie du honky tonk.

Mais revenons à la concrétude des choses. Avec sa boucle d'oreille ce garçon tourbillonnant parmi les spectateurs ne pouvaient que se faire remarquer. Tant pis pour lui, Will le rappelle à son destin de batteur des SpunyBoys, Guillaume se fait un peu prier mais il consent tout de même tout en s'excusant à s'asseoir derrière la batterie des Ol' Bry, à l'écouter il n'y arrivera jamais, ce n'est pas tout à fait son style, peut-être mais il y prend du plaisir, et nous avons pour la première fois l'occasion de voir les Subway avec un drummer derrière eux. Court interlude car le trio reprend de plus belle sa course effrénée.
Un dernier morceau et c'est fini. Les métropolitains descendent de leur estrade sous des cris de regret. Encore ! Encore ! One more ! One More ! Mais l'heure c'est l'heure et de toute évidence sur terre comme sous terre le bonheur ne dure pas éternellement !
OL' BRY
Pas évident de passer après les Subway. Alors que chacun de ses acolytes se glisse à sa place Eddie tient à préciser que les Ol' Bry ont un sacré gant à relever. Pas d'inquiétude à se faire, le set sera aussi bon, bien que très différent. Comme quoi il suffit d'être soi-même pour emporter l'assentiment de tous. Et ce soir-là les Ol' Bry furent magnifiquement les Ol' Bry.
Résumé des chapitres précédents. Depuis leur création les Ol' Bry avaient leur particularité, le groupe rockabilly fortement influencé par le do wap. Flirtaient un peu avec les années soixante, les tempos d'enfer et les sirops d'érable au pur jus de betterave. Les mois ont passé et le son a évolué. Le groupe a trouvé la formule idéale. Eddie à la rythmique et au chant au milieu, Rémy le saxo à sa gauche et Diego à la guitare à sa gauche. Un peu comme Odin, le dieu nordique, qui se baladait avec un corbeau sur l'épaule gauche et un autre sur l'épaule droite. Trois grands bavards, le corbac on the left qui racontait le passé, l'emplumé on the right qui prophétisait l'avenir, et le Dieu in person qui livrait ses sentences de vie et de mort. Trois verbiageurs émérites mais qui avaient pigé que quand l'un parlait les deux autres se la bouclaient.

Pas question pour le sax et la guitare de se mettre aux abonnés absents, non mais ils y vont mollo-mollo – mezzo-soprano si vous désirez un terme musical – quand Eddie chante. En plus il ne se contente pas de vocaliser, il tape du pied comme un madurle, et maltraite sa guitare - qu'il tient très haut, à la Elvis des premières photos - tel un forcené qui arrache les barreaux de sa prison. A tel point qu'il fusillera le micro. Merci à l'ingé du son qui en improvisera un autre de fortune tout en assurant une parfaite sonorisation...
Quelques mois que je n'avais pas vu les Ol' Bry. Diego en a profité pour étudier. Pas la guitare, porque la toca muy bien, es un maestro, un matador, et vous auriez du mal à lui enseigner quelques trucs qu'il ne connaîtrait pas. Question mandoline, es un jefe. Un chef. Mais vient d'un pays étranger. Je ne parle pas en géographe. Provient carrément d'une autre planète. Du – tant pis je lâche le gros mot – infierno y damnacion – du jazz. Bref c'est un super musico, en connaît trois mille sept cent trente quatre fois plus que le guitariste moyen de rockab. A la différence près qu'il y a un esprit rockab que l'on n'apprend pas dans les écoles de jazz. Donc toutes ces dernières semaines l'a pointé ses oreilles sur les disques et les concerts rockab et comme c'est un super technicien il a retrouvé la notice de montage. En théorie c'est facile, en pratique c'est plus difficile. Alors que le guitariste de jazz n'en finit pas de nous éblouir, regardez-moi je suis le virtuose du quartier, je vous reprend le thème en la mineur et je vous l'étire durant dix minutes, le gratteux rockab n'occupe le devant de la scène que durant quinze secondes le temps de vous balancer un riff qui vous scalpe le cerveau et puis il passe le bébé à qui veut le prendre. Ne vous inquiétez pas, n'a pas jeté l'eau du bain, plus tard il vous en balance une louche à travers la figure, juste pour vous rappeler que sans lui votre vie deviendrait plus triste. Ne vous alimente pas en continu. Vous plante des injections de vitamine toutes les vingt secondes dans la chair, et vous donne de temps en temps une piqûre de rappel.

Et Diego qui a compris impulse une nouvelle sonorité au groupe. Plus rock, plus rockab. En contrepartie le sax a aussi intuité la leçon. Souvent en sourdine à l'huile, mais quand il intervient c'est d'une manière d'autant plus tonitruante, prend toute la place, mène un remue-ménage de tous les diables, bouche le port de Marseille, et puis retourne se calfeutrer dans sa boîte sans faire plus de bruit qu'une souris. Pour revenir avec des miaulements de chats affamés. Et Eddie au milieu. Concentré sur le chant, il envoie les modulations sans modération, sans se soucier de rien, sûr qu'à la première respiration, ou le sax ou la guitara reprendront le flambeau.
Juste un problème. C'est que comme dans les légions romaines en formation de combat il y a une deuxième ligne derrière. La section rythmique, basse et contrebasse. Avec les jeunes rockers faut se méfier, Thierry qui n'est pas né de la dernière ondée, a trouvé le poste idéal pour surveiller en toute discrétion son gamin. L'a ressorti sa grosse doudoune à manche de son étui et s'est adjugé le poste de contrebassiste depuis lequel il ne lâche pas son rejeton, Eddie, des yeux. En plus comme il lui faut démontrer que les fils ne vaudront jamais les pères il écrit et refile ses compos au groupe. Question cordage rien à lui reprocher. Si les trois zozos de devant peuvent se repasser le témoin à tout bout de champ, c'est bien parce que derrière, Thierry leur bétonne un tapis rouge d'arrière-fond. Il y a encore un batteur, Marcelo. Me suis déplacé plusieurs fois pour tenter de l'apercevoir, mais en vain. L'espace est si exigu que je n'ai pu apercevoir qu'une fois deux spatules de caoutchouc qui batifolaient en l'air. Par contre je l'ai entendu. N'a pas arrêté une seconde de monter la mayonnaise. La prochaine fois je me cacherai dans la grosse caisse pour lui repiquer la recette. Pour aujourd'hui croyez-moi sur parole. Jamais en défaut, et pas cette fixité rythmique propre aux groupes rockab qui peut devenir vite impardonnable si elle n'est pas associée à une onctuosité lyrique qui donne davantage de volume à chaque battement.
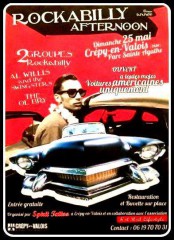
Un set féroce. Un Eddie trépignant, totalement à l'aise sur tout son répertoire. Des morceaux de leur premier CD mais dans des versions fiévreuses – North Side Girl, She Don't Care ou Let me dance – des classiques My Babe, Unchain My Heart, un You're sixteen superbement bien envoyé et j'avoue que je ne suis pas un grand fan de ce titre de Johnny Burnette que je trouve un peu trop midinette - et un I'm Comin' Home dédié à Mister B, très proche de la version de Gene Vincent grâce aux aboiements du saxophone de Rémy, mais aussi en hommage aux Ghost Highway qui ne sont pas là ce soir le somptueux Cause I Forgot écrit par Jull, et enfin, gâteaux à la crème chantilly sur les cerises précédentes, les nouveaux morceaux, enregistrés chez Mister Jull mais pas encore sortis, de véritables tueries qui sonnent plus rockab que tous les rockabs.
END OF THE ROAD
Minuit l'heure du crime. L'on coupe les micros et les rockers rentrent chez eux. Deux superbes concerts, l'on ne regrette pas d'être venus. Quand je pense que certains n'aiment pas les groupes français. Ne savent pas de quoi ils se privent. Subway Cowboys et Ol' Bry ont été magnifiques.
Damie Chad.
BOOKS
MARC SASTRE
L'HOMME PERCE / AUX BÂTARDS LA GRANDE SANTE
Fidèles lecteurs de KR'TNT, ne dites pas : Marc Sastre, inconnu au bataillon, ce serait mentir. L'on vous en a déjà parlé sur ce même blogue. Evidemment vous n'avez retenu que la moitié du fruit empoisonné que l'on vous tendait. Je vous excuse, Jeffrey Lee Pierce, ce n'est pas n'importe qui, les projecteurs des cerveaux humains ont tendance à focaliser sur sa personnalité, alors la bio au sulfure pas du tout biodégradable que nous avions chroniquée ( KR'TNT 160 DU 23 / 10 / 2013 ) vous avez oublié qu'elle était signée de Marc Sastre.

Me définirai personnellement plutôt comme un acrate que comme un anarchiste, mais ce n'est pas par hasard si ce dimanche 11 mai, je batifolais dans les allées du Salon du Livre Anarchiste. Recherchai Les Fondeurs de Briques, la maison d'édition qui fit paraître en version française Le Pays où Naquit Le Blues d'Alan Lomax ( voir KR'TNT 119 du 22 / 11 / 2012 ) et le J'effraie Lee Pierce du susdit Sastre Marc. Avec ces deux titres à leur actif, ces gens-là ne peuvent pas être totalement mauvais. La preuve, ils présentaient même quelques livres de poésie de Marc Sastre, assemblés en d'autres maisons.
Donc deux plaquettes de Marc Sastre parues en 2011et 2013, aux Editions les Cyniques. Un nom qui ne peut que plaire aux rockers, depuis que les Stooges et Iggy Pop nous ont expliqué l'ultimité de la philosophie cynique dans leur titre fondateur I Wanna Be Your Dog.

L'HOMME PERCé / MARC SASTRE
Vous suffit de regarder la couverture pour comprendre le contenu du bouquin. Pour ceux qui ne seraient pas versés en mécanique, vous avez la légende de la photo : engrenages à chevrons. Court d'ailleurs une étrange histoire à Toulouse sur l'inventeur du cardan à chevron, c'est un vieil ouvrier qui me l'a raconté lors de la pause déjeuner, mais je m'éloigne, d'autant plus que je n'ai pas donné le copyright du document : pas de surprise, Citroen Communication.
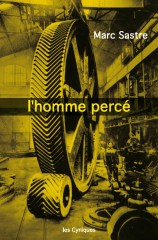
En plein dans la matière du poème. L'usine, l'atelier, le chantier, les différentes déclinaisons de ce que l'on appelle communément le travail. Pas celui qui rend libre. L'aliénation, l'exploitation, la servitude, les synonymes sont légion. L'homme percé, c'est l'homme usiné comme les pièces qu'il produit. Le travail est une lèpre qui manufacture le travailleur. Vous transformez la matière par votre travail, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, la grande métamorphose c'est l'homme qui la subit. N'oublions jamais que la transformation de l'homme équivaut à une déshumanisation. Le travail ne vous grandit pas, il n'est pas le chemin nietzschéen qui mène au Surhomme, il est amoindrissement et usure sans possibilité de retour à l'état neuf.
Tout cela Marc Sastre ne le théorise pas, il le dit, l'énonce et l'annonce, sans complaisance. La poésie comme témoignage de la désanthropologisation de l'individu. Point de salut, point de fierté. Ne mange pas les médailles en chocolat du bon travailleur qui s'est échiné et esquinté durant un demi-siècle à perdre sa vie pour gagner le droit de survivre économiquement.
AUX BÂTARDS LA GRANDE SANTE / MARC SASTRE
Les non-lecteurs se contenteront encore une fois de la couverture. Dessin d'Anne Martel – comme toutes les autres illustrations. L'en existe un autre semblable, cher aux rockers, le doigt dressé que Johnny Cash pointe sur vous. Le rebelle métaphysique vous ordonne d'aller vous faire foutre.

Ce recueil est plus tonique que le précédent qui ne vous laissait aucune échappatoire, fils de prolo tu es, fils d'esclave tu resteras. Forment tous les deux un diptyque. Ne vous faites pas d'illusion. Ce n'est pas : un, le mal ; deux, le bien. Même si ça commence bien. La révolte et l'éros. Deux bonnes addictions. Les nerfs opimes du bonheur et du bien-être. L'homme en marche vers sa liberté.
Un peu comme la nouvelle formation de Little Bob, les Little Blues Bastards. Pas dingue, le Little Bob, a assez bossé et vécu pour savoir qu'un bâtard heureux comme un chat de gouttière en liberté attrape aussi parfois le blues. Idem chez Marc Sastre, au début on relève la tête et l'on se croit assez fort pour conquérir le monde. Mais ce n'est pas si facile qu'il n'y paraîtrait. Ce n'est pas l'ennemi d'en face qui vous fait peur. La confrontation est prévue. Sera sanglante et l'on a toutes les chances de perdre. Mais le jeu en vaut la chandelle ( verte du père Ubu ).
Non, l'ennemi est en nous. Pire et mieux que cela. Nous sommes nous-mêmes notre ennemi. Le travail nous a façonnés à son image. Nous sommes, des bêtes de somme. Notre chair, notre peau, notre corps, notre pensée, sont altérés et édulcorés. La grande santé nietzschéenne nous la poursuivons, mais elle ne se laisse pas attraper. Ce qui s'installe en nous, c'est la maladie chronique de notre impuissance à changer le monde. Notre bâtardise rime avec vantardise. Nous sommes des guerriers vaincus, avant même d'avoir combattu.
Faudra tout de même faire avec nous-même puisque nous n'avons rien d'autre sous la main que nous-même. Les autres me ressemblant trop pour que je puisse en faire quelque chose. L'individu est un roi sans couronne. Mais un roi tout de même. J'ai intérêt à sortir de toutes mes contradictions et de moi-même. Si je veux me libérer de l'antique chaîne de l'esclavage, ne plus un être un chien d'élevage mais un bâtard au-delà de toute appartenance.
Deux recueils pour ne plus être dupe, ni de sa condition, ni de soi-même. Attitude rock par excellence.
Damie Chad.
00:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lisa & the lips, charlie west, orville nash, subway cowboys, ol' bry, marc sastre


