10/05/2017
KR'TNT ! ¤ 328 : JERRY RAGOVOY / HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE /HEADCHARGER / FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE / NAKHT / CLAUDE BOLLING
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 328
A ROCKLIT PRODUCTION
11 / 05 / 2017
|
JERRY RAGOVOY HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE / HEACHARGER / FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE / NAKHT CLAUDE BOLLING |
TEXTE + PHOTOS SUR :
http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Les ragots de Ragovoy
Les ragots de Jerry Ragovoy valent leur pesant d’or. Dans son numéro d’avril, Record Collector publie une interview inédite de ce géant du Brill qui eut la chance de travailler avec Bert Berns, en tant que co-auteur et co-producteur. Voilà bien ce qu’il faut appeler un duo de choc. Oui, car avec Jerry et Bert, nous nous trouvons au cœur du mythe de la grande pop américaine, ou pour être plus précis, aux racines du cœur de mythe. Comme le rappelle Al Kooper, Jerry and Bert were known as white kings of soul music. Oui, les rois blancs de la Soul music, ni plus ni moins.
Le premier hit qu’ils composent ensemble est le fameux «Cry Baby» popularisé par Garnet Mimms & the Enchanters, un quatuor black new-yorkais. Mais Garnet chante d’une voix trop puissante. On sent en lui le vétéran des gospels choirs, il explore les cimes et redescend avec un timbre terreux de boogaloo qui frise le Howlin’ Wolf. Malgré toute la puissance de ce hit obscur, ça ne pouvait pas marcher. Apparemment, Jerry misait lourd sur Garnet car il enregistra d’autres obscurités frénétiques, comme cet «As Long As I Love You» qu’on trouve sur la belle compile qu’Ace consacre à Jerry. Garnet chante à la poigne de fer, il sort du pur jus de r’n’b new-yorkais des early sixties, on sent une incroyable présence et on se pose la question habituelle : pourquoi diable est-il tombé dans l’oubli ? Son «Thinkin’» relève du pur jus de raw r’n’b, celui que nous affectionnons particulièrement.
Bert avait un sens «commercial» beaucoup plus développé que celui de Jerry. Il savait flairer les très gros coups. Il signa Erma, la grande sœur d’Aretha, sur son label Shout et co-écrivit le fameux «Piece Of My Heart» avec Jerry. Ce fut le smash que l’on sait, popularisé plus tard par Janis Joplin, comme chacun sait. Il est important de préciser ici que Janis raffolait des chansons de Jerry. Après «Piece Of My Heart» (qu’on trouve sur Cheap Thrills), elle tapa dans «Try (Just A Little Bit Harder)» pour Kosmic Blues. Jerry fut tellement touché par ces brûlants hommages qu’il composa «I’m Gonna Rock My Way To Heaven» pour elle, mais la pauvre Janis cassa sa pipe avant de pouvoir l’enregistrer. On trouve trois autres hits de Jerry sur Pearl, l’album posthume de Janis : «Cry Baby», «My Baby» et le Tatien «Get It While You Can». C’est dire si Janis avait bon goût !
Quand Dan Nooger qui mène l’interview demande à Jerry si Bert n’était pas un peu trop directif en studio, Jerry rigole. Bien sûr que si ! Phil Spector, Shadow Morton, Leiber & Stoller, c’est-à-dire tous le grands producteurs de l’époque, étaient des gens intraitables. Ils donnaient des indications très précises aux interprètes, ils voulaient que les chansons qu’ils avaient composées soient chantées d’une façon extrêmement précise. Ils répétaient énormément avant d’enregistrer. L’interprète n’avait qu’une seule marge de manœuvre, son feeling.
Howard Tate était aussi l’un des chouchous de Jerry. Ancien collègue de Garnet Mimms dans les Belairs, Howard adorait travailler avec Jerry - We were too good a team - C’est vrai, mais Jerry rappelle aussi qu’Howard était un homme perturbé - a troubled person - Et quand Howard refit surface en 2003 après vingt-sept ans d’absence, qui fut son producteur ? Mais Jerry, bien sûr. Il faut situer le team Ragovoy/Tate au même niveau que le team Bacharach/Warwick, ou encore Berns/Franklin. Voilà ce que les habitués du PMU de la rue Saint-Hilaire appellent des doublets gagnants. Jerry rappelle que l’album Get It While You Can est devenu culte. Il faut entendre l’archange Tate swinguer «You’re Looking Good» d’une voix délicate et partir en piqué vrillé. Tate tâte bien le terrain et des trompettes arrosent ses chutes grandioses. Par contre, il oublie toute forme de sophistication pour chanter «Get It While You Can». Jerry rappelle aussi que tous ces hits étaient enregistrés live, avec l’orchestre au grand complet - no overdubs.
Et puis il rend hommage à Lorraine Ellison, qui figure parmi les plus brillantes Soul Sisters d’Amérique. En Europe, on connaît «Stay With Me» grâce à Sharon Tandy, mais la version originale vaut son pesant d’or. Lorraine cœur d’acier percute son hit du petit doigt et l’envoie valdinguer au noooow d’exaction maximaliste. Elle grimpe son can’t believe si haut qu’on le perd de vue. Cette folle atteint les zones érogènes d’un feeling atrocement pur - Remember ! Remember ! - Elle ouh-ouhte sa spectaculaire percée stratosphérique. L’histoire de cette session est assez marrante : un jour, le patron de Warner appelle Jerry et lui demande s’il connaît quelqu’un qui saurait chanter avec un orchestre. Quel orchestre ? Le boss lui explique qu’il a sur les bras un orchestre de 46 personnes payé pour une session de trois jours que vient d’annuler Frank Sinatra. Jerry saute sur l’occasion et dit qu’il connaît quelqu’un. Ça se passe un lundi, et la session débute le mercredi soir. Il contacte Lorraine aussitôt, lui compose un hit vite fait, écrit les arrangements pour les 46 musiciens, deux nuits sans sommeil, et pouf ! C’est «Stay With Me» ! Lorraine chante en direct avec tout l’orchestre ! La version qu’on entend sur le disque est la version stéréo de l’époque, enregistrée en une seule prise, même pas mixée - I didn’t even have to mix - Jerry rend hommage à Phil Ramone, l’ingénieur du son qui enregistra ce monster hit sur un huit pistes. Magie pure de la Soul. Mais il y eut à la suite un léger problème, car de la même manière qu’Aretha, Lorraine refusait de monter dans un avion, pas question de quitter Philadelphie, ce qui coula sa carrière et fâcha Jerry qui voulait faire de la promo. À l’époque, c’était la règle. Pour promouvoir un hit, il fallait tourner.
L’un des hits les plus célèbres de Jerry est certainement «Time Is On My Side», popularisé par Irma Thomas, puis les Stones. Jerry l’enregistra en 1963 avec un tromboniste de jazz danois nommé Kai Winding, soutenu par un trio de backing girls de choc : Cissy Houston, Dionne Warwick et sa frangine Dee Dee. Il faut entendre cette énorme version jouée aux trompettes de la renommée et chauffée à blanc par les clameurs des filles devenues folles. Pure démence de la partance ! Irma reprit le hit à Hollywood en 1964 et les Stones un peu plus tard la même année. Tiens justement, puisqu’on parle d’Irma : après le succès de «Time Is On My Side», elle voulut absolument enregistrer une session avec Jerry et vint à New York pour enregistrer quatre titres dont «The Hurt’s All Gone» qu’on trouve sur la compile Ace et qui n’est pas si bon, car elle tente de passer en force. Dommage. Jerry tenta aussi de faire décoller Estelle Brown, l’un des choristes new-yorkaises les plus demandées avec les trois pré-citées et d’autres encore comme Doris Troy et Myrna Smith. Mais son «You Just Get What You Asked For» à la fois captivant, si maladroit et sur-produit refuse de décoller. Estelle voit une girl dans un looking glass who is crying - And this girl is me - On retrouvera Estelle dans les mighty Sweet Inspirations avec Cissy Houston, Sylvia Shemwell et Myrna Smith.
L’une des grandes révélations de la compile Ace, c’est Pat Thomas qui chante «I Can’t Wait Until I See My Baby’s Face». C’est emmené d’une voix mûre d’Africana à la revoyure, sur fond de groove magique. Jerry crée pour Pat les conditions de l’excellence. Le cut est si bon que Dionne Warwick le reprendra dix ans plus tard sur son album Then Came You, dont la pochette s’orne de son portrait peint. Jerry produisit cet album en 1975, mais il avoue pleurer chaque fois qu’il le réécoute, car il le dit over-orchestrated. Il dit même avoir voulu péter plus haut que son cul - je me prenais pour Burt Bacharach qui, ajoute-t-il, ne sur-produit jamais. Jerry pense que c’est son plus grave échec et confie dans la foulée qu’il aimerait bien pouvoir s’excuser auprès de Dionne. Et pourtant quand on écoute «Move Me No Mountain», on frémit, car Dionne explose ce groove digne de nos rêves les plus humides. C’est atrocement bon. Bizarrement, Then Came You compte parmi les meilleurs albums de Dionne. Jerry pêche sûrement par excès de modestie.
On retrouve aussi le fameux «Good Lovin’» des Olympics sur cette belle compile Ace, un hit sixties qui sera popularisé un peu plus tard par les Young Rascals. C’est un pur hit de juke, irréprochable et idéal pour jerker au coin du chrome. L’autre hit universaliste que composa Jerry fut bien sûr «Pata Pata» pour Miriam Makeba. Quand Jerry la reçoit dans son bureau, Miriam lui dit : «What I wanna do Jerry is American ballads !». Wow ! Jerry s’enthousiasme immédiatement. Facile, des American ballads, il en a plein ses tiroirs. Mais comme il est très pro et qu’il ne la connaît pas, il va la voir chanter dans un club et paf, il tombe carrément de sa chaise ! Eh oui, il découvre une reine africaine, un univers musical qui lui est inconnu et qui le fascine. Alors, il laisse tomber les American ballads et demande à Miriam de revenir dans son bureau et de lui chanter des chansons africaines. Miriam est ravie de ce revirement. Elle chante a capella et Jerry l’enregistre. Il écoute la cassette chez lui et Jerry flashe comme un dingue sur «Pata Pata». Il demande à Miriam de l’aider à transcrire le texte en Anglais. «Pata Pata» devient le hit que l’on sait. Miriam chante comme une géante et ne la ramène pas. C’est toute la différence avec Stong. On monte encore d’un cran avec Dusty chérie. Comme Irma, Dusty chérie voulait absolument travailler avec Jerry car il bénéficiait d’une aura de rêve - A r’n’b icon - Pour elle, Jerry co-écrit «What’s It Gonna Be» avec Morty Shuman. Dusty est une bonne, elle ramène là-dedans tout le foncier d’Angleterre et tout le chien de sa chienne - I can’t face it - Encore un pur hit de juke, Jack.
Carl Hall est l’autre grande révélation de cette compile. Jerry n’enregistra que quatre singles avec Carl dont l’effarant «What About You». C’est lui la véritable star du Jerry Sound System. Jerry lui fournit le background orchestral de la légende. Carl combine le meilleur groove du monde avec le scream impénitent - What about you mister - Il chante à l’énergétique pur et dur. Tiens, encore un fabuleux coup de Jarnac avec «You Don’t Know Nothing About Love», un softah sirupeux qu’il traite à l’égosillée purulente, il s’y monte impitoyable - One day my friend it’s gonna be your turn - et il développe une fascinante ambiance perfide. Selon, Jerry, Carl Hall est un géant - One of the most mind-blowing vocalists who ever lived - un artiste capable de chanter du gospel, de la Soul et du Broadway, et qu’on retrouve dans les chœurs derrière Bonnie Raitt sur l’album Streetlights.
Jerry monta son label Rags Records pour promouvoir les disques de Lou Courtney, un mec qu’il aimait bien - I think Lou Courney was a great talent - En effet, quand on écoute «What Do You Want Me To Do», on entend un séducteur croasser dans son micro. Cette fois, Jerry va sur un son plus funky, mais ça reste extrêmement produit. Il connaît bien ses artistes. Il les produit avec les mains d’un cordonnier, comme dirait Léo. Jerry veille aussi sur le destin de Major Harris, un vétéran de la Soul qui fit partie des Delfonics. Avec «Pretty Red Lips», ce bon Major nous croone un groove d’une classe infiniment supérieure, c’est indubitable, et la question de savoir si ce groover est humain ne se pose même pas, puisqu’il groove comme un dieu de l’Olympe. D’où cette réputation non usurpée de divin groover.
Signé : Cazengler, Jerry rat d’égout
Roll With The Punches. Interview Jerry Ragovoy par Dan Nooger. Record Collector #465/April 2017
The Jerry Ragovoy Story. Love Is On My Side 1953-2003. Ace Records 2008
PETIT-BAIN / PARIS / 04 – 05 – 2017
HOWLIN' MACHINES / THE DISTANCE
HEADCHARGER
Retour au Petit-Bain. Brrrr ! Le frisson dans le dos quand me revient le froid de loup qui sévissait fin janvier sur Paris, heureusement que Pogo Car Trash Control avait salement relevé la température. Ce soir c'est mieux, seulement la pluie – remarquez de l'eau au Petit-Bain ce n'est pas étonnant – sont sympas nous ouvrent les portes un peu avant l'heure. Pour le voyage pas de problème, la teuf-teuf a tenu la distance en un temps record. A croire qu'ils avaient vidé Champigny de sa population pour nous laisser passer. Bref nous voici au chaud, dans les flancs du navire, le temps de discuter avec un photographe en mission commandé fan de métal à mort.
HOWLIN' MACHINES
Sont trois tout jeunes. N'ont pas de beaucoup dépassé la vingtaine. Basse, guitare et batterie. Et un chanteur. Seulement besoin d'ouvrir la bouche pour que l'on se rende à l'évidence. Une voix. Une vraie. De celles qui s'imposent sans forcer. Noire à souhait. Du moins au début du set trop court. Car elle passera sans effort de la pulsion rhythm 'n' bluesy au phrasé rock'n'rollien avec de temps en temps ce léger décalage qui claque en écho non sans faire penser aux décrochements répétitifs de Robert Plant. Tient entre ses mains une basse Rickenbaker . De Lemmy à Metallica, cette bébête monstrueuse au sustain inimitable, suffit de la mettre au galop pour qu'elle vous garde sans faillir la même allure, pouvez jouer du cimeterre sans souci et éparpiller les têtes sur votre passage en toute tranquillité, genre d'engin de chantier idéal pour un chanteur occupé aux vocales manœuvres. C'est qu'à ses côtés ses deux acolytes ne chôment pas. Tambour battant pour l'un et riff hifi pour l'autre sur les cordes. Les machines hurlantes ne connaissent pas l'immobilité, une fois démarrées rien ne saurait les ralentir. Ne prennent même pas le temps de finir les morceaux. Leur tronçonnent la queue sans préavis d'un coup de hachoir définitif. Un peu comme quand vous terminez votre livre trente pages avant la fin, d'un claquement sec et rédhibitoire, afin de vous emparer au plus vite du tome 2. Sont des adeptes du stoner de Brest, une frégate de soixante canons qui vous court dessus à l'abordage toutes voiles dehors portée par un vent arrière de soixante nœuds. Nous sortent tout de même un blues au milieu de set, The Lies About, mais tellement surchargé d'impédance énergétique qu'il vous roborative les neurones davantage qu'il ne vous éreinte l'âme. Se livrent à une OPA sans défaut sur l'assistance qui se laisse subjuguer et maltraiter avec un plaisir évident.
Dernier morceau. Les cris de déception fusent. Cette fusée étincelante nous l'aurions bien gardée encore un bon moment. Ils emporteront nos regrets. Une trajectoire éblouissante. Courbe harmonieuse et élégante. Du bas vers le haut. Missile sol-air. Ces jeunes gens sont partis pour atteindre des régions situées dans les stratosphères interdites aux vaches molles du rock'n'roll. Down 'n' Higher proclament-ils, mais définitivement higher.
THE DISTANCE
Se touchent du poing, tous les quatre, tel un rituel vaudique, avant d'égorger le blue red rooster du rock'n'roll. Et tout de suite après c'est la montée en puissance de la fournaise. Le son est là, vous saisit de son ampleur, la lave de Pompéi débordant du cratère assassin et refermant sa gangue mortuaire sur les habitants englués dans un fleuve de feu. Avec un avantage, c'est que vous ne mourrez pas, au contraire c'est une force sonique qui s'insinue en vous, vous porte et vous transcende.
Trois devant et Hervé tout seul derrière. N'est pas abandonné. Duff lui rend souvent visite, un pied sur l'estrade où repose la batterie. C'est qu'Hervé est attelé à ce que Roger Gilbert Lecomte appelait un horrible travail révélatif. Du tramage forgique de poésie. L'enclume et le marteau. Casser la carapace des rêves pour en extraire l'élixir souverain de la réalité agissante. Œuvre alchimique par excellence. Une large cadence – en ses débuts comme le ressac incessant et millénaire de la mer qui s'écrase sur le rivage – qui peu à peu, insensiblement, s'accélère tout en montant en mouvance sonore. Tout à l'heure finira en fou épileptique, en possédé du démon rythmique, les cent bras de Shiva parcourant les toms sans une seconde d'interruption - un personnage de dessin animé passé à la chaise électrique, vous ne voyez plus, vous n'entendez plus que cette frappe qui passe et repasse, ces bras levés qui s'abattent sans fin, un tambour de machine à laver directement branchée sur une ligne à haute tension - qui tournent et retournent comme les ailes rouges de la guerre des poèmes de Verhaeren.
Et les trois devant qui insidieusement alimentent le foyer. Duff à la base, les cheveux qui coulent sur ses épaules dissimulent son visage, se plante au bord de la scène pour lâcher sur vous les chiens de chasse de ses lignes de basse. N'est plus qu'un émetteur phonique, un dispensateur de noirceur ondulante, qui induit les transes intérieures les plus meurtrières, doit parvenir à certains points d'acmé énergétique indépassables, des chakras d'intensité opératifs, car parfois il se redresse, regarde le public et un rapide sourire énigmatique éclaire ses lèvres.
Mike est au micro. Utilise sa voix comme un second instrument. Ne domine pas les autres mais la module comme un cinquième élément éthérique dont l'apport se révèle indispensable à la cohésion du groupe. Joue de la guitare. Non pas tout comme Sylvain mais avec Sylvain. Certes ils n'en ont pas une pour deux mais c'est tout comme. Pour sûr il y a des moments où chacun tricote de son côté, mais si j'ose dire cela ne compte pas. Sont comme des jumeaux. Des géants siamois. Plus le set avancera, plus on les verra se rapprocher, corps contre corps, et guitares face à face, emportées dans un tunnel infini d'égrenage grêle de notes fuyantes, l'impression de deux cavaliers galopant de conserve mais perdant leur sang jusqu'à l'évanouissement final, en ces moments la batterie n'en accélère pas moins le tempo, mais moteur coupé, une voiture dévalant un col de montagne sans frein, Duff qui met sa basse en brasse coulée, en apnée, et brutalement alors que l'on croit que le feu va s'éteindre et mourir d'asphyxie l'incendie embrase la forêt, ah ! Ces coups de reins brutaux et fastueux du quatuor qui repart comme un seul homme ! Répétitifs en plus. Car le rock'n'roll est avant tout un art de l'excès, il est strictement recommandé de dépasser la dose prescrite. Et d'en reprendre à foison tout en ayant soin de cambrioler la pharmacie. Pas question de demander poliment et de payer son dû.
Alors ils nous font la distribution gratuite. Vous en aurez plus que vous ne voulez. Sur les trois derniers morceaux, ils sont devenus fous. Mike et Sylvain ne sont plus que des marionnettes saccadées hantées par de mauvais génies vipérins. Sont cambrés, des automates en délire, opèrent une espèce de parade de paralytiques tétanisés qui marchent en tous sens, la bave du rock'n'roll aux lèvres et leurs guitares atteintes d'une fureur de berserker. Duff ne tarde pas à subir lui aussi les effets de cette transe hypnotique et tous trois se croisent comme des trains fantômes échappés de leur rail. Exultation dans la salle. Sylvain projette sa guitare sur le sol – la fureur de la destruction n'est que l'autre versant de la démesure des dieux - et sur une dernière razzia drumique le combat cessa faute de combattants. Pas de rappel. C'est la stricte application de la réglementation de la salle. Les lumières se rallument. Les meilleures choses ont une fin. Même les sets de The Distance.
HEACHARGER
Distribué à l'entrée du concert, Flyer-Zine Musikoeye N° 33, papier glacé, quatre pages, révélant interview sur l'enregistrement d'Hexagram, leur sixième album, et les voici maintenant sur scène. Sûrs d'eux, l'on sent les vieux routiers rompus – formés en 2004 – qui ne s'en laissent pas compter et qui escomptent bien satisfaire le public manifestement acquis à l'avance. Nous livrent un show impeccable, millimétré, j'aurais toutefois aimé que fût un tantinet plus forte la tonalité du micro sur lequel Sébastien Pierre bondit alors qu'un mur de guitares déferle sur nous. Ne s'économise pas, agite sa grande silhouette dans tous les sens, visière de casquette en avant et bras sémaphoriques qui moulinent l'espace.
Headcharger charge, un régiment de blindés qui écrase tout sur son passage, juste le temps de ré-accorder entre deux morceaux, l'offensive ne s'arrête jamais. David Rocka et Antony Josse sont aux guitares, ne laissent subsister aucun interstice sonique, aucun répit, aucun essoufflement, aucune fêlure, au taquet, toujours là au moment où il faut y être, les doigts qui filent et l'attitude attendue. Cheveux hirsutes, barbes et visages dégoulinent de sueur, ils donnent plus qu'ils ne prennent. Amassent et dispensent le son, mais c'est Sébastien qui établit la communication avec le public qui s'agite à sa demande, manifestement ravi de s'entrechoquer même si l'étroitesse du lieu canalise quelque peu son exubérance.
Les guitares filent loin devant, et à la batterie Rudy Lecocq pousse tout près derrière, ne nous dispense pas de simples rudiments, les coups pleuvent sur ses peaux comme giboulées de Mars et grésils de tempête, heavy-stoner-sound, tambours de sable et ronds de feu. Un son qui cherche le point de fuite mais ne s'y engouffre pas sans emmener tout l'orchestre avec lui. Pas question de batifoler en chemin pour compter les pétales des coquelicots, l'on attrape le loup par la queue et on ne le lâche pas d'une seconde. Romain Neveu à la basse doit avoir un sacré boulot, n'aimerais pas être à sa place, c'est à lui qu'échoit le sale boulot, de maintenir la cohérence du groupe et de l'empêcher d'éclater en mille directions et de se disjoindre dans une course éperdue.
Headcharger garde le contrôle, de Land of Sunshine qui ouvre le set à Wanna Dance qui le clôt, ils vous tondent la pelouse sans jamais oublier le moindre brin d'herbe, tout en préservant les fragiles corolles des pâquerettes, déboulent sans frémir au cœur de taillis de ronces à la All Night Long ou à la Dirty Like Your Memorie et vous en ressortent sans une égratignure. Vous déchiquettent bien de leurs lames acérées quelques grasses couleuvres alanguies qui dormaient dans les hautes herbes mais personne ne s'en inquiète. Surtout pas le public si j'en crois les regards extatiques de mes voisines qui ne quittent pas des yeux les garçons sauvages magnifiés en pose héroïques de guitar-héros, jambes écartés, corps penchés en avant, statures iconiques du rock'n'roll.
Une heure, pendule accrochée au mur faisant fois de l'exactitude de ce décompte temporel, l'on ne sait trop pourquoi, tout s'arrête, n'est même pas onze heures, faut pourtant boire le fameux bouillon, qui coupe court à toutes les effulgences de la vie. Headcharger quitte la scène sans rémission. De la belle ouvrage.
RETOUR
La teuf-teuf trottine, de vastes pensées s'amassent sous mon front, une découverte : Howlin'Machines, une tuerie : The Distance, et Headcharger de bons combattants mais perso leur trouve un petit côté un peu trop chevalier blanc sans peur ni reproche. Gimme Danger comme dit Iggy. L'auto-radio se bloque sur Ouï FM et diffuse les douces romances de Bring The Noise, arrivé à Provins – hertzienne zone maudite - les ondes décrochent. Tant pis, j'ai eu le temps d'entendre Paroles M'assomment de Pogo Car Crash Control. La boucle est bouclée.
Damie Chad.
06 / 05 / 2017 / LE MEE-SUR-SEINE
LE CHAUDRON
RELEASE PARTY NEW EP CHAKRA
NAKHT
FRCTRD / ACROSS THE DIVIDE
Savigny-le-Temple. La teuf-teuf longe l'Empreinte. Etrange, parvis désert à quinze minutes de l'ouverture officielle des portes. Y aurait-il un lézard dans l'horloge ou un homard dans la cuvette WC ? Nécessité absolue d'improviser et d'appliquer un plan B. Inutile de me reprocher d'avoir mal lu le flyer. A vue de nez, Le Mée-sur-Seine n'est pas loin. Essayons Le Chaudron. Presto & bingo ! N'ont même pas commencé. Ça papote à loisir devant l'ustensile à popote.
FRCTRD
Noir. Lumière infranchissable pourriture disait Joë Bousquet. FRCTRD va s'adonner à son jeu favori de dissociation de nos photons mentaux. Sample d'entrée, et dès les primes notes ils vous présentent la fracture avec la TVA adjacente du Tout Voulu Atomisé. Musique brutale, happée par elle-même, qui à chaque pas en avant s'écroule dans la fosse commune des pseudo-illusions qu'elle n'arrête pas de creuser. Une tranchée rectiligne qui s'engouffre dans la brisure de sa propre rectitude.
Cinq guerriers du néant illuminatif. Anneaux de caraque aux oreilles, zigomatiques saillants, et une voix d'onagre en rut, Vincent Hanulak annule tout, cavale crache et cravache le carnage du grain moulu de sa voix. Remarquez que derrière sa guitare d'une sombreur luisante de lampadophobe, avec ses yeux de braise et sa barbe de prédicateur fou d'évangéliste atterré, Filip Stanic n'a rien à lui à envier... impossible d'apercevoir le visage interdit de Clément Treligieuse, le dissimule avec une obstination derrière le rideau d'une blonde touffeur, à croire qu'il s'agit d'une attentatoire terreur religieuse qui lui interdit de quitter l'absence de toute présence, Maxime Rodrigues penché sur sa basse, une patience d'insecte, de ceux qui savent que leur race immonde finira par supplanter l'espèce humaine, et Gregory Louzon concentré sur ses fûts à la recherche de l'impossible formule de la dilution finale.
Tout juste quelques titres. Une poignée de grenades entrouvertes jetées à la face de l'intermittence du monde. Mais assez pour signifier le clignotement du néant dévorateur que tout un chacun feint de ne pas apercevoir. Par sa musique, épurée jusqu'à l'os, qui se dévore elle-même, qui se phagocyte de sa propre viduité, FRCTRD vous plonge le nez dans la vacuité absolue de votre existence, ce filet entrecroisé de cordes emmêlées, ce réseau arachnéen de toutes vos fragilités qu'un coup de vent glacial projettera un jour ou l'autre au fond du gouffre.
L'on ne peut exprimer le silence que par des bruits implosifs nous rappelle FRCTRD, des pétarades mouillées, des eaux suintantes de la morbidité malfaisante de nos petitesses humaines. Des hachis de guitare et des purées parmentières de batterie qui crapaude en batracien que l'on fait fumer et qui explose en nuage artificiel de fumée létale. Le combo ne nous ménage pas, fait le ménage, passe le délabré plumeau poesque aux plumes de corbeau plutonien sur la toile de nos démissionnaires exigences.
Un set magnifique. D'amer constat des dégâts occasionnés par l'erreur de vivre. Musique métaphysique. Fractured but no captured.
ACROSS THE DIVIDE
Encore des partisans cumulatifs des fissions nucléatiques. Musique à trous taillés à pic dans l'intumescence lyrique des samples omniprésents. Across the Divide découpe au plus court. Sont les adeptes de la fragmentation fractale. Un riff ne saurait aller plus loin que lui-même. Même répété, compressé coup sur coup une dizaine de fois, asséné comme des fureurs de fouets, cinglé comme comme des salves de sangles sur les épaules d'un supplicié, très vite tout se déstructure. Effondrement final. La musique d'Acroos The Divide est une suite dramatique interrompue de points de suspension. Mais le silence ne s'intercale pas entre les abruptifs sonores. Sont remplis par les grandes orgues des samples de toute pompeuse noirceur, un peu comme ces musiques d'enterrement que l'on passe pour cacher en vain le gouffre vital enfermé dans le tabernacle du cercueil.
Axel Biodore est à la guitare. Un beau jeu mais pas du tout bio. Martyrise ses cordes à la manière de ces épandages d'insecticides meurtriers qui vous pulvérisent la végétation en quinze secondes et vous provoquent des mues géantes chez les coléoptères venimeux dispensateur de pustules purulentes. Alexandre Lhéritier n'en a guère besoin, sa voix d'écorcheur de chats faméliques se suffit elle-même, vous agonise de ces chuintements boueux de lamentin échoué, pourtant Axel ne peut résister à agrémenter les reptations gosierâles de son chanteur d'une espèce de beuglement caverneux qui diffracte encore plus cette sensation de vertigineux malaise qui s'exsude des découpes rampantes opérées par Maxime Weber sur ses cymbales atonisées. Parfois Jonathan Lefeuvre aussitôt imité par Axel, arrête de jouer de sa guitare, vous donnent l'impression de chuinter les interstices qui séparent les cordes, de glisser leurs doigts comme des chirurgiens qui hantent de leurs assassines phalanges les entrailles d'un patient opéré à vif sans anesthésie, et la basse de Régis Sainte Rose adopte alors la douceur funèbre d'une rapsodie maladive. Et tout cela vole aussitôt en éclats, en tôles de coques d'obus dispersées au moment le plus meurtrier de son impact.
Auront droit au set le plus long. Se livreront à un concassage sonique méthodiquement chaotique, l'on sent qu'ils cherchent la fissure ultime, leur musique achoppe la réalité du monde tel un trépan mû par un infatigable et monstrueux balancier qui cherche à s'immiscer dans la matière la plus noire de l'univers.
NAKHT
Les rois de la fête mortelle. Qui pousseront l'élégance jusqu'à se contenter d'un set à notre goût un peu trop court. Nous savons bien qu'indénombrables sont les anneaux d'Apophis, L'assistance aurait bien voulu que l'on en déroulât trois ou quatre de plus...
Lourdeurs sonores. Trois projecteurs tournoient leurs trois pinceaux de lumière blanche qui n'ont d'autre but que d'aviver la pénombre. Chacun des musiciens, encore invisibles, regagne sa place. L'on entend Danny Louzon qui depuis les coulisses poussent un hurlement rauque de bête traquée. Embrasement de lueurs d'hémoglobine, son sursaturé des guitares qui déchirent les tympans, les têtes des guerriers guitaristes tournent sans fin telles des ailes de libellules rilkéennes folles tandis qu'à la batterie Damien Homet broie le noir des espérances diluées, Danny, déjà si grand, se juche sur le piédestal de fer central, sa tête touche presque les tubulures centrales qui soutiennent les projecteurs, se courbe, s'incline vers nous, brasse l'air de ses bras comme s'il nous faisait signe de s'approcher pour mieux entendre les grognements caverneux qui émanent des profondeurs de ses poumons. Gestes impérieux et déluge sonore. Ronde des guitares qui changent de place, marche des ombres, le temps de recevoir la commotion en pleine figure que Danny nous prédit Our Destiny qui se s'annonce que sous les pires auspices du bruit et de la fureur, faut le voir saisir son micro à deux mains, ponctuer d'un bras impérieux les segments monstrueux de la prophétie, tandis qu'aux guitares, Alexis Marquet et Christopher Maigret sabotent les règles de la sainte harmonie de leur kaotiques giclées cordiques, Clément Bogaert reste perdu dans la transe enivrée d'une danse barbare inachevable. La musique gronde et emplit l'univers pour fêter le réveil d'Apophis le maudit. La musique de Nakht prolifère comme l'infinie reproduction protozoairique de brontosaures géants qui accoupleraient leurs fétides corpulences en des noces de tonnerre et de foudre, sans cesser de piétiner les géantes forêts ante-préhistoriales... La scène est déchirée d'éclairs de lumières blanches plus pâles que des aubes blafardes de fin du monde sur choral de requiems noirs engoncés dans une pachydermique rythmique, une espèce d'halètements syncopés dont on ne perçoit que les brisures mais pas le souffle nauséabond qui pourtant pulvérise les rochers. Béance mortifère, symbolisée par le falzar noir de Danny aux deux jambes soigneusement lacérées d'une large entaille dont on voit s'ouvrir et se refermer les lèvres mouvantes, jumelles bouches muettes d'une pythie delphique qui révèlerait par ce bâillement de batracien inaudible les ultimes malédictions de la future désintégration de la race humaine. Grouillements d'égosillements, martelages titanesques, points d'ogres en ouverture de précipitations nocturnes, Nakht bouscule les montagnes et patauge dans les failles océaniques. Les cités flambent sous les pas des conquérants et la musique brûle, Nakht est un dragon engendré par nos phantasmes les plus masochistes qui n'ayant plus rien à dire finit par s'incendier lui-même pour ne pas être victime de la froideur impie du silence qui corrompt et gangrène l'univers. Grondements antédiluviens pour conjurer nos faiblesses. Nakht dépose la rosée mortifère de sa musique comme un feu atomique, il est la nacre préservatrice qui se forme à la surface des roches et le chancre purpural de nos âmes. Cette ambroisie mortelle détient le secret de l'immortalité. C'est pour cela que nous l'écoutons. Epoustouflant.
RETOUR
Après une telle soirée il est difficile de rejoindre le monde vide de nos contemporains. Trois groupes réunis en une seule unité tonale. Toutefois distincts et dissemblables. Nakht a méchamment réussi sa Realease Party. Nakht a rouvert nos chakras encrassés. Evidemment si vous n'aimez pas, vous pouvez vous inscrire à un centre de méditation zen. Ce serait même préférable pour vos fragilités. Ce qui vous tue ne vous rend pas plus fort.
Damie Chad.
CHAKRA / NAKHT
INTRO / WALKING SHADES / THE MESSENGERS / HALL OF DESIRE / LXXVII / MIND'S JAIL /
DANNY LOUZON : vocal / DAMIEN HOMET : drums / Clément BOGAERT : bass / ALEXIS MARQUES : guitar / CHRISTOPHER MAIGRET : guitar.
On avait beaucoup aimé la brutalité d'Artefact le premier EP de Nakht, autant dire que l'on attendait le deuxième avec intérêt.
Intro : grondements annonciateurs de fureur, chants védiques venus d'ailleurs, des gouttes d'eau lourde clapotent, des serpents venimeux rampent dans les canalisations. Frottent leur ventres écailleux sur le plomb saturnien. Arrosages dulcimériques et cymbales qui s'affaissent. Walking Shades : sons sursaturés, instrumentaux phrasés cithariques, la voix de Danny qui s'amplifie et domine le tout, une radio mal réglée qui diffuse des guitares d'orage et la batterie qui compresse les tympans des temples détruits. The Messengers : générique musical, guitares grondantes presque sixties entremêlées de mélopées orientalisantes, oasis d'optimisme vite balayée par le vent froid et mordant des nappées nakhtiques, et le grondement rhinocérique de Danny qui bouscule les palmiers du désir, grandiloquences orchestratives et Danny qui hache le persil des illusions d'un timbre implacable. Les Messengers ne semblent pas apporter de bonnes nouvelles, malgré la danse des guitares à laquelle se mêlent les soubassements saccadés d'une batterie embrochée. Lyrisme concassé. Très fort. Parviennent à rendre le rut de l'inaudible audible. Apophys : poussée de batterie. Corruption de guitares et montée in abrupto de tout l'ensemble, des cordes qui sonnent comme les trompettes du jugement dernier, Danny semble en bégayer comme s'il avait trop de sons à déglutir, Nakht écrase tout. Le serpent Apophys gît désormais dans votre hypophyse. Hall of Desire : des notes de piano trop fortes pour être vraies, reviendront de temps en temps comme des ponctuations ensoleillées pour mieux approfondir le noir de la nuit définitive, les guitares barrissent, la batterie se trémousse en une indécente orgie sonore, et Danny rajoute du gros sel sur les blessures comme l'on passe un rouleau compresseur sur des cadavres putréfiés. Délirium trémens instrumental final. LXXVII : le vent se lève sur les sables du désert et balaie les bribes de votre entendement. Ritournelle du pire annoncé. Mind's Jail : trop tard, vous n'échapperez au courroux des Dieux qui s'offrent une fricassée de cervelles humaines pendant que Cléopâtre essaie de charmer les aspics de la mort afin que leur venin soit encore plus efficace. Elle y réussit parfaitement. Nakht vous assassine à coups de marteaux. Dites merci. Vous n'en avez jamais espéré autant.
Nakht a réussi l'impossible : se métamorphoser sans se trahir. Changer pour accentuer son idiosyncrasie primale. Continuer sur sa lancée sans se répéter. Se renouveler sans se trahir. Être encore plus violent. Plus insidieux. Le scorpion maléfique à deux dards. Le cobra à deux têtes qui rampe sur le dos. L'horreur cent noms.
Une démarche qui n'est pas sans rappeler celle du Zeppelin qui cherchait du nouveau dans les sonorités de l'Orient, mais ici il s'agit d'une autre filiation, d'une autre djentry, davantage métallique. Se tiennent du côté obscur de la force. Foudroyant.
Damie Chad.
MIND'S JAIL / NAKHT
( vidéoclip réalisé par : )
ALEK GARBOWSKI / YANN GUENOT
PICTURES & NOISED ABROAD PRODUCTION
Figure imposée, combo métal dans un studio, filmez et servez brûlant. Des vidéos de cet acabit l'en existe des milliers, la difficulté consiste à sortir du lot. Sûr qu'il vaut mieux partir avec un groupe et un morceau qui percutent les oreilles, mais une fois ce premier obstacle franchi, faut mettre en scène, intuiter la chorégraphie, et diriger la valse des séquences. En plus, il y a une petite clause, non écrite, en bas du cahier des charges que chaque réalisateur porte en sa tête, éviter à tout prix le piège de l'illustration musicale, fuir comme la peste les images redondantes, la paraphrase cinématographique qui ne sera qu'une redite sans intérêt. Construire un scénario graphique, qui apporte un sens, qui donne davantage de force et d'expressivité à la musique, tel est le but.
Plongée dans le sombre bleutée d'une nuit spectrale. D'incertaines silhouettes se dessinent dans le vide. Que votre oeil soit aussi rapide que la flèche qui court vers la cible dans les éclats d'un soleil noir. Travelling sur Danny, pose de taureau, corps courbé vers le sol, vous vomit littéralement le chant dessus, entrecoupé des images virevoltantes de la chevelure blonde que Clément agite en tous sens comme s'il exhibait à la terre entière son propre scalp. Des fragments de guitaristes tournoient dans les images. A chaque fois plan serré, corps à corps des représentations avec leurs propres négations, ne jamais montrer l'intégralité d'une attitude, seulement en exposer des nano-secondes de tronçons iconiques, apparition-disparition, la caméra ne se fixe pas, elle enregistre des pièces d'un puzzle qui vous sont présentés une à une mais en un tel écartèlement d'espaces temporels si brefs qu'il vous est impossible d'en reconstituer une image mentale satisfaisante, happé que vous êtes par ce morcellement incessant. La batterie fracassée, pourtant dominée par le grondement de la voix de Danny, un grognement de bête empêtrée dans un combat mortel. Nous conte en d'affreux borborygmes les images cachées dans les tanières de l'inconscient humain. Visions d'horreurs sans nom et de désirs sans frein libérés de leurs gouffres qui remontent comme du fond des mers intérieures, de grosses bulles de suint qui éclatent à la surface et nous éclaboussent de leurs viscosités gluantes. Avec cette apparition d'une silhouette féminine qui s'en vient au travers des champs d'angoisse de la folie. Crispation de flashs fugitifs. Rencontre finale. La parole se fait chair et se retrouve en face de son cauchemar. Rêve et ramdam reconstitués. Androgynie du son et de l'image.
Magnifique. Original. Figure imposée renouvelée. Réussite totale due à Alek Garbowski et Yann Guenot.
Damie Chad.
BOLLING STORY
CLAUDE BOLLING
+ JEAN-PIERRE DAUBRESSE
Ce n'est pas que j'apprécie Claude Bolling, et j'avoue même que je me suis pas mal ennuyé durant au moins les trois-quarts du bouquin que je ne vous conseille pas de lire. A moins que vous ne soyez comme moi, turlupiné par une insidieuse question. Et je dois avouer que je n'ai pas trouvé la réponse dans ces trois-cents vingt pages – réjouissons-nous, près de soixante sont dévolues à la discographie de notre impétrant – et que je n'en suis pas plus avancé... Mais peut-être vaut-il mieux commencer par les faits eux-mêmes. D'autant plus que ceux-ci sont nombreux. Bolling se raconte, dans un ordre à peu près chronologique, l'on sent que le rôle de Jean-Pierre Daubresse a dû se réduire à celui de poseur de questions et vraisemblablement de transcripteur d'entretiens oraux. Un genre d'exercice peu propice à la réflexion, qui privilégie les dates, les anecdotes et les circonstances et qui se refuse à toute introspection historiale.
Bolling est né en 1930, suis surpris par le fait que ce patronyme n'est en rien un pseudonyme, son père était un véritable américain dont sa mère divorça relativement vite. Pas un drame. Nous sommes en milieu aisé et Claude aura droit à une enfance choyée et protégée. Entre Paris et la Côte d'Azur. Dessin et aquarelle seront ses premiers hobbies mais il se met comme les jeunes filles de bonne famille au piano, dans lequel il se révèle très vite assez doué. Evoluera de piano en piano, de professeur en professeur, apprendra à déchiffrer, à lire et à écrire la musique. L'on est chez des gens sérieux, pas question de se contenter d'une éducation à l'oreille, travaillera ses partitions de Debussy comme tout élève bien élevé qui se respecte. N'empêche qu'il n'est pas sourd, et qu'il laisse entrer dans ses pavillons largement ouverts les bruits musicaux qui traînent aux terrasses des cafés et à la radio. Le jazz est là, s'insinue en lui en contre-bande et finira par être élu roi... Il a tout juste douze ans lorsque son oncle lui refile un disque de Fats Waller. Illumination ! Il existe donc une autre manière de jouer du piano que l'académique !
C'est ici que les questions me poussent dans le cerveau comme des bubons dans le pli de l'aine des pestiférés. Voici une génération favorisée des dieux. Ce n'est pas la première qui arrive dans le monde du jazz. Il existe déjà dans notre pays un milieu jazz non négligeable, l'a débarqué chez nous dans les fourgons de l'armée américaine en 1917, le Hot Club de France naît en 1932 et bientôt apparaît Django Reinhardt un musicien exceptionnel de classe internationale, un deuxième étage de la fusée américaine sera mis à feu avec la libération de Paris en 1944, le jazz est étiqueté musique de la liberté retrouvée...
Mais ce n'est pas tout. Se produit un miracle auquel le rock'n'roll national n'a pas eu droit. Les musiciens noirs débarquent à Paris. Des mythes vivants, l'occasion de les voir, de les entendre, de les écouter. Mieux, de les approcher, de discuter avec eux, de jouer avec eux... et beaucoup plus si affinités qui s'établissent rapidement. Faut lire le récit de la rencontre avec Earl Hines au cours de laquelle le pianiste lui apprend tous ses trucs et la manière d'étirer ses doigts sur l'empan du clavier alors que l'on possède de petites mains. Mais il y aura plus, Bolling entretiendra une véritable amitié avec Duke Ellington in person et même Louis Armstrong. Le Duke l'invite sur scène à ses côtés et se sert de son savoir musical pour la transcription de nouveaux arrangements. Dans le même ordre d'idée l'on pensera à Sidney Bechet s'adjoignant l'orchestre de Claude Luter...
Certes l'on me rétorquera que faute de grives l'on se contente de merles ( en l'occurrence ici blancs )... Ou alors on insistera sur le ravissement de ces musiciens noirs considérés et fêtés en France comme des génies, une attitude qui devait les changer des continuelles rebuffades subies en leur pays. Là n'est pas mon propos. Lorsque l'on regarde la suite de la carrière de Claude Bolling, l'on reste surpris. On s'imagine que boosté par une telle reconnaissance de figures mythiques du jazz, notre héros allait se propulser en une démarche musicale de haut niveau. Or il n'en fut rien. Ses activités se déployèrent selon deux directions, rémunératrice pour la première et fort honorifiquement agréable pour la deuxième. Bolling écrivit près de quatre-vingt musiques de film, de quoi faire bouillir la marmite, l'est particulièrement fier de Borsalino, cela se peut comprendre. Mais il possède aussi son grand orchestre. L'occasion de donner de multiples concerts en France et dans le monde entier. Et Bolling tout en portant l'accent sur ses talents de compositeur et d'arrangeur de haut-niveau, de son éclectisme qui court de la musique classique à la variétoche la plus franchouillarde, en passant par le jazz le plus pur, tire sur la grosse ficelle du respect que l'on se doit de porter à la musique populaire... Sa contribution jazzistique se réduit à des adaptations grand-public des grandes figures tutélaires du jazz, quand il les aura toutes passées en revue il s'attaquera aux sous-genres ragtime, boogie-woogie, blues...
Une clef peut-être pour comprendre un tel cheminement. Se livre davantage dans les quinze dernières pages, d'abord sa passion pour le modélisme ferroviaire, et nous sert enfin sa vision du jazz. N'est guère éloigné de la rétrograde position d'Hugues Panassié resté bloqué et crispé en une attitude des plus puristes sur le New Orleans, Bolling regrette que cette musique de danse se soit fourvoyée à partir de la naissance du Bebop dans l'intellectualisme... Le livre s'arrête brutalement sur l'évocation de sa prescience écologique... Très symptomatique de ces gens qui courent après l'histoire et qui restent enfermés dans le bon temps de leur jeunesse. Par contre son témoignage sur le recul de la musique vivante nous agrée, il évoque avec regret cette lointaine époque où la duplication sonore était interdite en tous lieux publics, sur les plateaux radio et à la télévision, cette loi que l'on pourrait juger de draconienne avait pour corollaire la multiplication des formations de tous genres...
Le livre est entrecoupé de témoignages de divers compagnons de route de Claude Bolling comme Jean-Christophe Averty ou Jacques Deray, la plupart d'entre eux sonnent un peu nostalgeo-ringards, difficile d'avoir été et de n'être plus, le temps dévore tout, l'oubli triomphe des gloires passées, l'acrimonie de la célébrité enfuie ronge les caractères...
Enfin les rockers seront heureux de savoir que Claude Bolling évite soigneusement de prononcer le mot rock'n'roll, ne le lâche que par trois fois du bout des lèvres, parce que les situations rapportées l'obligent, mais l'on sent le mépris sous-jacent sous l'ignorance affectée.
Damie Chad.
11:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jerry ragovoy, howlin' machines, the distance, headcharger, frctrd, across the divide, nakht, claude bolling
22/02/2016
KR'TNT ! ¤ 270 : KEITH RICHARDS OVERDOSE / HOWLIN' JAWS / NELSON CARRERA + SCOUNDRELS / YANN THE CORRUP TED / JAKE CALYPSO / LES ENNUIS COMMENCENT / NAKHT / FALLEN EIGHT
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 270
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
25 / 02 / 2016
KEITH RICHARDS OVERDOSE
NELSON CARRERA & THE SCOUDRELS
YANN THE CORRUP TED / JAKE CALYPSO
LES ENNUIS COMMENCENT / NAKHT
FALLEN EIGHT / HOWLIN' JAWS
04 / 12 / 2015
L'ESCALE / LE HAVRE ( 76 )
KEITH RICHARDS OVERDOSE

UNE BONNE DOSE DE KEITH
RICHARDS OVERDOSE
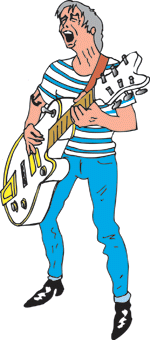
Ça remonte au temps où Born Bad se trouvait encore rue Keller. Deux choses vous mettaient en transe : le mur des nouveautés et bien sûr les bacs à thèmes : garage, surf, soul, punk, blues et rockabilly. On y piochait un mélange de nouveautés pointues et d’occases de rêve à 13 euros. Born Bad était pour ceux qui avaient fréquenté Rock On à Londres la suite logique. Et pendant qu’on farfouillait dans les bacs, Iwan passait des disques. Il passait bien sûr des trucs intéressants et les oreilles des lapins blancs se dressaient. Franchement, il régnait dans cette boutique une ambiance idéale. Pour les petits rockers de banlieue, c’était tout simplement la caverne d’Ali-Baba.
Un jour, alors que je sortais des bacs des beaux pressages américains de Dick Dale et toute une série d’occases des Chesterfield Kings, j’entendis un truc encore plus terrible que ce qu’on entendait habituellement, du garage-punk, mais avec un son sourd auquel nous n’étions pas habitués. Direction le comptoir.
— C’est qui qu’on entend ?
Il montre la pochette, avec la photo en noir et blanc. Je n’en reviens pas !
— Keith Richards Overdose ? Ça alors ! Le vieux Keef il a de l’humour !
— Mais non, c’est pas Keef, c’est des Marseillais !
— Quoi ? Des Français avec un son pareil ?
— Oui des anciens Hatepinks !
— Fantastique ! Il est à vendre ?
— T’as de la chance, il en reste un...

L’album est solide, c’est le moins qu’on puisse dire ! Les Marseillais naviguent au même niveau que leurs compatriotes les Cowboys, dans les couches de son plein et dans le bon bal des influences. Ils nous happent dès «Rocking At The House Of Blue Lights» avec un punk-rock sourd et torride, bombasté à la vieille mode. On retrouve ce sourdisme de son dans «Chain Reaction Honey», et ça vire crampsy sans prévenir, avec une basse qui mène le binz par le bout du nez. C’est un excellent disque d’attaque frontale, comme le confirme «Hot Blood». On pense à l’album des Loyalties, perdu dans le fog de l’underground anglais - Hot blood I love you so ! - On reste dans la belle attaque avec «Skinny Jeans», torché à la belle énergie des ouh et des ah ! Le rock des KRO est d’une incroyable solidité. On retrouve chez eux toute la belle niaque des Cowboys From Outerspace. Cet album est vraiment excitant, bardé de gros climats pathogènes et d’excès d’oh yeah ! «Never Been Good With Math» est joué à l’excès de jus Gun Club/Gallon Drunk et noyé au plus profond des pires torpeurs atmosphériques. De l’autre côté, on trouve une reprise bien enlevée de «Hippy Hippy Shake» puis un stupéfiant «Walking The Frog», punkoïde au possible - Oh c’mon ! - C’est une vraie fournaise ! Les Overdoses pataugent dans l’excellence de la démence et ils font monter la mayo des c’mon jusqu’à l’apothéose. Avec «Try This», on se croirait chez les Who de «Live At Leeds» ! Ils nous plaquent carrément les accords de «Substitute» ! Encore une fameuse pétaudière avec «Scatman» et ils referment la marche avec un faramineux «1234 & Again» chanté au bon boogaloo et terrible de présence indigène.

Les années passent et voilà que se produit un petit événement. Oh, ça ne fera pas la une des journaux, mais c’est un petit événement quand même. D’autant plus important qu’il est double. On apprend en effet la réouverture de l’Escale, un bon bar rock du Havre avec au programme nos amis marseillais. Il n’en faut pas davantage pour renouer avec ce vieux sentiment d’excitation qu’on éprouve chaque fois qu’un bon concert est annoncé. Le boss de l’Escale a refait sa salle à neuf et c’est presque devenu luxueux. Endroit idéal pour un groupe garage comme Keith Richards Overdose. Et petite cerise sur le gâteau, la salle est pleine.

Sur scène, les Marseillais offrent un surprenant mélange de stonesy et de garage-punk, le tout bien soutenu au beat. Avec son maillot rayé et son ancre de marine tatouée sur le bras, le chanteur renvoie à l’univers visuel des Dolls, d’autant qu’il joue sur une grosse White Falcon, comme jadis Sylvain Sylvain. Le parallèle avec les Dolls est flagrant, et on repense à cette assurance qu’affichaient Sylvain et Johnny Thunders, lorsqu’ils plaquaient leurs accords en tordant leurs bouches, eh oui, ils savaient au plus profond d’eux-mêmes (deep inside their hearts) qu’ils jouaient dans le meilleur groupe de rock du monde, à l’époque. On retrouve la trace de cette assurance chez le Marseillais, car il semble véritablement possédé lorsqu’il claque ses accords en hurlant ses refrains. Ce mec est un pur rock’n’roll animal, un porteur de flambeau, l’héritier d’une lignée de puristes qui remonte aux Dolls et aux early Stones.

Ce mec sait ruisseler comme Little Richard et montrer son cul comme Iggy Stooge. Il peut faire le con sur scène, sauter dans le public, il a derrière lui une section rythmique infaillible et un transfuge des mighty Holy Curse en support guitaristique. Leur objectif semble se limiter à offrir un bon set de rock aux Havrais, ce qui est en soi le plus louable des objectifs. C’est aussi l’occasion de vérifier une fois de plus que l’avenir du rock se trouve dans les bars, plutôt que dans les stades.

Le deuxième album des Marseillais vient de paraître sur Closer, avec une pochette ornée du Jolly Rodger des junkies : un crâne et deux seringues croisées en guise de tibias. Joli titre : «Kryptonite Is Alright». Ils attaquent avec «If I Was You», ce slow super frotteur qui fit des ravages pendant le set du Havre. On pense bien sûr au slow super-frotteur des Oblivians. L’ensemble de l’album est très rock’n’roll. La plupart des cuts sont montés sur des structures classiques, mais si on ne retrouve pas le son du premier album, on croise au coin du bois la belle tension qui faisait son charme. Ils ornent «Ton Punk Rock De Vieille» d’un beau solo suspensif et bouclent la face avec «Fifteen Sixteen», amené au parti-pris de stonesy et doté d’un beau background dollsy. Ce cut inspiré vaut pour le hit du disque, d’autant qu’on sent battre sous la peau le pouls des Dolls. De l’autre côté se niche un fantastique balladif intitulé «So You Say You Lost Your Baby» et on tombe plus loin sur l’excellent «Hold Me Tony», nerveux et bien goulu. On voit bien qu’ils cherchent leur voie sans trop se casser la tête. Ils bouclent avec un «Worse Things I Could Do To You» servi sur un plateau par l’intro de basse du grand Nasser. Ce cut fit lui aussi quelques ravages lors du set, car il fonctionne à l’insidieuse.
Signé : Cazengler, aux verres dose
Keith Richards Overdose. L’Escale. Le Havre (76). 4 décembre 2015

Keith Richards Overdose. ST. Scanner Records 2011
Keith Richards Overdose. Krytonite Is Alright. Closer Records 2015
19 – 02 – 2016
ROCK'N'BOAT
LA PATACHE / PONT DE L'ALMA
HOWLIN' JAWS /
NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS
YANN THE CORRUPTED
JAKE CALYPSO

Finissons de faire les zouaves, dare-dare au Pont de l'Alma, pour prendre à l'abordage La Patache à l'attache le long du quai. D'abord franchir la muraille de Chine des touristes made in Hong Kong qui rejoignent leur car, ensuite s'engouffrer au galop dans le navire amiral du rockabilly. Pas le temps de le parcourir jusqu'à la poupe pour saluer amis et connaissances que Bernard Soufflet l'organisateur de l'évènement présente déjà les Howlin' Jaws. Comme un rocker normalement constitué ne rate jamais un gig des Howlin' je me faufile au premier rang. Non sans difficulté, car il y a du monde.
HOWLIN'JAWS

Même si vous ne les connaissez pas, je vous donne le truc pour les reconnaître. Sont le seul groupe du monde à arborer fièrement une casquette à hélice – allusion hélicoïdale à la structure de l'ADN, ou apparition du complexe de l'hélicoptère à ajouter aux analyses freudiennes ? : les savants n'ont pas encore résolu le problème – sur la tête. Le grand sur votre droite, incliné sur sa contrebasse c'est Djivan, he's the one in his red blue-jean, au fond au milieu, baguette à la main, non ce n'est pas le chef d'orchestre, c'est la batteur Mathieu qui ne croit qu'en ce sur quoi il cogne ( dur ). Enfin the last but not the least, c'est Lucas (grave) penché sur son instrument, l'esquire exquis de la squier guitar. Avant de lâcher les fauves, je vous explique le comportement de ces félins. Comptez dix minutes de déchaînement absolu. Vous êtes en train de sortir votre portable de la poche pour alerter les autorités, lorsque tout se calme, comme par magie. Silence absolu. Apparemment nos lascars ont quelque chose de plus important à faire. C'est au choix. Ou Djivan, ou Lucas. Il tire son peigne de sa poche arrière et entreprend de lisser ses cheveux en arrière. Ne poussent pas le vice jusqu'à se regarder dans une glace, et c'est brusquement reparti pour un quart d'heure de pur bonheur. Pour ceux qui aiment le grabuge au mètre cube.
Quatre groupes, alors autant mettre la barre au plus haut tout de suite. Les Howlin' détestent les gradations lentes. Appliquent un principe des plus simples, en dix secondes vous devez être au maximum. Ensuite, toujours en rajouter. Ne jamais baisser en intensité. Pour bien montrer qui ils sont, ils tapent en majorité dans leur répertoire original. Ils sont les Howlin, aux dents longues, et le public ne manque pas de mordre à l'hameçon.

Djivan est au chant et Mathieu au tambour. Lucas est partout. Les deux acolytes lui fournissent la toile, écrue, épaisse, une véritable voile de clipper taillée pour les vents d'orage, et c'est Lucas qui dessine dessus les têtes de mort et les sabres d'abordage. Pirate au long cours qui ne fait pas de prisonnier. N'est à l'aise que dans les combats rapprochés. Bondit sur le devant de la scène et vous tire quelques boulets juste dans la soute à munitions pour vous faire sauter le caisson. C'est un retors, vous a toujours l'intervention de trop, celle qui vous fait chavirer de joie, la lame du poignard qui pénètre droit dans votre coeur sans crier gare. Et Djivan qui ricane des chants de matelots à vous glacer d'horreur l'âme de Baudelaire. Derrière Mathieu crashe boume et hue comme un forcené. Impulse le rythme, droit à la lame, ne pas faiblir, ne pas mollir, lorsque l'on a déchaîné la tempête faut assumer. Et il assomme à tour de bras. Djivan déchire the big mamamita – elle va mourir mais il s'en soucie comme de son premier radeau.
Revoilà Lucas, on ne l'avait pas oublié avec ces notes qui nous déchirent le cerveau sans pitié, ce gars il est dangereux, il vous trépane jusqu'au bulbe rachidien et vous l'applaudissez des deux mains comme un zombie stupide. Les Howlin n'ont pas cassé la baraque, ils ont réduit les planches en poudre. Et plus ils vous dézinguent plus la masse des spectateurs s'appesantit sur le devant de la scène.

Difficile de rêver mieux comme entrée en matière. C'est comme pour Le Vaisseau Fantôme de Wagner l'on risque de ne se souvenir que du prélude. Les Jaws nous ont pulvérisés. Un set d'une intensité incroyable. Sans bla-bla, sans chiquet, trois musiciens et leur musique. Le problème pour les hypothétiques lecteurs qui n'aimeraient pas, c'est qu'ils ne jouent que du rock and roll. Vous n'êtes pas obligés d'apprécier. Ni d'être parfaits. Evidemment les Howlin' Jaws, eux ils sont parfaits. Tant pis pour vous, tant mieux pour eux.
Quand ils ont quitté la scène il y avait de quoi écrire un livre rien qu'à décrire les yeux brillants d'adrénaline de l'assistance stupéfaite et ravie.
NELSON CARRERA
AND THE SCOUNDRELS

Pas évident de passer après une telle tornade. Les Howlin' c'est du rockag électrifié à mort comme une chaise dans un pénitencier américain, Nelson Carrera c'est le hillbilly des collines, agreste et rural. Faut être un sorcier pour de telles transitions. Pas le genre de défi qui peut apeurer Nelson. Mais ce n'est pas aux renards que vous apprenez à voler les poules. Les Scoundrels ne sont pas des demi-sels. Des pros : Jorge le Taiseux qui ne regarde que sa contrebasse, faut entendre comme il l'a fait chanter, Pascal l'Efficace aux drums et à la barbichette, inutile de se retourner vers lui, vous suivrait jusqu'en enfer, et Raphaël à la gâchette facile. Un coup d'oeil de Nelson et c'est parti pour la chevauchée sans pitié. Vous vouliez savoir ce que c'est qu'une guitare électrique, Raph vous fait la démonstration. N'allez pas vous plaindre à votre mère après. Il sera trop tard. D'autant plus que Nelson sur sa rythmique il vous mène les frères Jesse James à l'attaque de la banque sans état d'âme.

En plus Nelson, il a une arme même pas secrète, une voix d'or. C'est presque trop facile. Enrageant, vous pouvez toujours essayer devant le lavabo. S'en sert comme un brigand pour fracturer la porte de votre sensibilité. Cinq titres à tout berzingue pour montrer ce dont les Scoundrels sont capables et puis l'on part vers la campagne country, les contreforts des Appalaches, le rock d'avant le rock. Un enchantement. Nous tient sous le charme, Nelson, ne nous lâchera plus. Les titres défilent sous les acclamations, un hommage à Carl des Rhythm All Stars, qui nous manque. Charlie Feathers, Johnny Horton, les grands noms, la discographie idéale, interprétée par un combo de rêve. Ne savez plus où donner de la tête, Jorge qui résonne, Pascal qui façonne, Raph qui cisèle et Nelson qui module tout en expédiant le tout sur une rythmique d'enfer. C'est en cela que réside le mystère, une pêche d'enfer et une voix qui explore les moindres sinuosités de la nostalgie. Nelson sous sa couronne de cheveux blancs est le barde du hillbilly, nous administre une leçon de bel canto rockab. Après lui pouvez aller vous rhabiller. C'est du cousu d'or fin. De la belle ouvrage rehaussée de la pourpre incendiaire de la guitare de Raph.
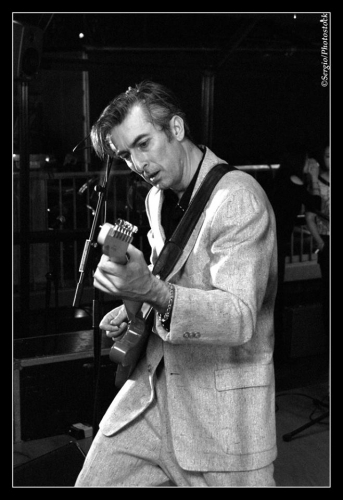
Chante longtemps sous les vivats du public. On s'y laisserait prendre, l'on passerait toute la soirée avec. Mais Bernard Soufflet regarde sa montre. C'en est fini de cette oasis de fraîcheur dans ce monde de brute. Nelson et son band de malandrins ont une fois de plus réussi leur coup. Une douceur enlevée, une tendresse enfiévrée, et hop, ils sont déjà repartis. Mais ils emportent tout ce que vous avez de meilleur en vous. Un rêve d'Amérique que vous ne referez jamais tout seul avec une même intensité. Faudra attendre que Nelson Carrera et ses boys repassent près de chez vous.
YANN THE CORRUP TED

Attention l'on change de scène. L'on est dans le gang des outlaws. Chevauchée dans les rangs des rebelles. Le devant de la scène est squatté par un bataillon de teds. Texas est à la basse, placide, l'en a vu d'autres, le fiston a intérêt à assurer à la guitare. Jacky Lee et son incroyable dégaine – c'est fou comme ses favoris en lames de faux qui se rapprochent de ses lèvres lui confèrent une terrible dignité - attend les dernières accordailles de la balance, ne sera jamais parfaitement établie, la voix de Yann étant trop souvent reculée par rapport à sa guitare. Dommage car le set fut infernal.
Du début à la fin. Facile à résumer, une rythmique de fer. Intangible. Avec un crescendo irrésistible. Morceau après morceau. Ce n'est pas que l'on joue obligatoirement plus fort, c'est que l'on confère davantage d'intensité à chaque fois. Musique très physique avec une terrible implication personnelle. A la moitié du set, les fans n'y tiennent plus et montent danser sur scène. Chacun s'approprie le morceau, le mime, de la voix et du corps, d'une guitare imaginaire.
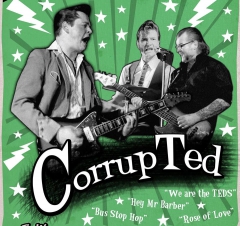
Yann a cherché l'efficacité. Maximum de classiques beaucoup de Flyin' Saucers et de Charlie Feathers. Tout le monde connaît les titres et se laisse dériver et hypnotiser par le tempo d'acier. Trois infatigables. Sont pour le développement durable mais pas pour économiser l'énergie. Texas file les lignes de basse comme s'il pêchait au gros. Pas des truites vagabondes. Du cachalot bagarreur. Mes yeux sont rivés sur les doigts de Yan qui scandent le rythme sur des cordes fines et coupantes comme des noeuds coulants. Jacky Lee est fascinant. En mouvement perpétuel. L'abat des coups tranchants comme des cognées de bûcheron sur l'entaille des arbres. Pas d'écho, pas de rebond, pas de volume ouaté, sec comme une branche d'arbre qui casse d'un bruit net sous votre pied. Ou le déclic d'un piège à loup sur votre jambe. A la fin du set, l'est un signe qui ne trompe pas, fait jouer ses poignets pour en chasser la rigidité robotique. Une frappe d'une vigueur étonnante. Chaque coup retentissant dans sa propre solitude sonore sans jamais mordre sur le suivant ou le précédent. Un mouvement d'horlogerie pour une cadence inexorable.

Auront droit à un rappel, exigé par le public. On ne pouvait pas les laisser comme cela. Nous aurons droit à un Train Kept A Rollin démentiel. Perso j'ai une préférence pour leur interprétation de Born To Be A Rolling Stone de Gene Vincent, un titre rarement choisi dont ils ont bousculé avec bonheur l'orchestration. Finissent dans un charivari festif des plus agréables. Ont réussi à corrompre le public. L'est vrai que les rochers, quand on leur propose du rock qui dévaste le périmètre de leur entendement, ont l'âme vénale. Drapés dans leur enthousiasme les Teds sont toujours les Teds. Egaux à eux-mêmes. Ne déçoivent pas. Sont vivants.
JAKE CALYPSO

L'est attendu comme le messie. Pas celui qui marche sur l'eau, celui qui bondit de rock en rock sur les rochers qui affleurent. Thierry révèle sa nature méticuleuse, range son boîtier à lunettes dans son sac, vérifie sa monnaie dans la poche du pantalon, vous le regardez et vous vous dites, on en a encore pour une demi-heure. Guillaume ramasse sa contrebasse, Christophe passe sa bandoulière, Hervé trifouille sa guitare. Prend subitement deux décisions lourdes de conséquence. D'abord il enlève sa veste jaune pour arborer une chemise d'un rouge-orangé à faire hurler de joie les photographes, puis d'un geste large il jette au fond de la scène le fil et le scotch qui relie sa guitare à l'ampli. Prend la parole et résume la situation d'une phrase lapidaire à la Jules César dans La Guerre des Gaules. « Pas de jack, pas de répétition, pas de balance ! ».

Retenez-les. Trop tard c'est parti. Christophe Gillet plante les premières banderilles, se propulse en avant à chaque riff, le pied catapulté en hauteur comme à la savate. Sous sa casquette plate Guillaume maltraite son encombrant, et Loison à qui il ne faut pas en promettre se met à glousser au micro comme une pintade quand le goupil se faufile dans le poulailler. La salle chavire et caquette comme la fameuse poule d'Henri IV que l'on viendrait chercher pour la glisser dans le pot idoine. Thierry bat la démesure du fou tranquillou dans un mouchoir de poche. Le mec qui ne s'affole jamais. Dans le tintamarre qui va suivre, se contentera d'esquisser de temps en temps un sourire sardonique. Il est l'oeil de l'ouragan. Le moteur immobile de la roue folle du karma humain qui tourne à toute vitesse. Loison se mue en Shiva, le dieu aux mille bras. S'est débarrassé de sa bandoulière, tient sa cithare acoustique coincée comme une oiselle sous son aisselle, ce qui lui donne une belle prestance à la Elvis. Ce qui tombe à pic, puisqu'il est en train de revisiter son dernier CD, downtown à Memphis qu'il a enregistré avec son band dans les studios Sun. Un truc que je ne comprendrai jamais, comment fait-il ce diable d'homme, cet agité du bocal, pour vous restituer le son dans sa pureté absolue ! Bien sûr, l'a son gilet de sauvetage, le Chris qui vous turlupine tout ce que vous voulez sur sa guitare. Tout en étant atteint d'une tarentulite aigüe. Avec Guillaume plié de rire en deux, tel un Ganesh facétieux, sur son engin – sans pour autant pédaler dans la choucroute d'un quart de ton – moi j'aurais comme un doute. Mais non Loison, c'est en même temps la pureté foncière du rockab et l'Actor's Studio. Vous en donne le maximum pour le prix minimum. Eloge de la gratuité de la folie. Romantisme débridé et échevelé. Grogne, ronce, babatise et attise sans cesse le public. Ne sont plus seulement quatre mousquetaires sur scène, le régiment du public les suit et les précède. Deux cents gosiers chantent en choeur avec Loison. A chacun son petit délire, perso je suis en train de jouer des tablas sur la contrebasse de Guillaume quand ma voisine me tire par la manche pour me passer un demi-verre de bière éventée. What is it ? Je ne suis pas celui pour qui vous me prenez ! Mais non, elle vient de déboucher une bouteille de Sky et je suis désigné pour passer à Jake sans jack un graal de Jack, ce nectar suprême des Dieux. C'est que Loison, il faut le ravitailler en plein vol, l'est d'ailleurs en train de voler au travers de la salle sur le bout de nos bras. D'autres se vautrent sur la scène, certains caressent le visage d'Hervé maintenant gisant sur le dos, ça hurle de tous les côtés, des excités inventent de nouvelles danses, Loison refait un petit tour à vol d'oiseau, revient en courant, glisse sur une flaque de bière et emporte au sol une danseuse, un flip flap arrière à vous briser la colonne vertébrale dont Noureev n'a jamais osé rêver. Au sourire ravi de cette cavalière si rapidement jetée à terre, l'on pourrait parler de choc amoureux.

Mais Hervé est déjà sur scène – au-dessus des eaux de la Seine – chante le désespoir du blues – un blues de peaux rouges criards et ravagés à l'eau de feu - en faisant le poirier sur la batterie de Thierry qui n'est pas ému pour une demi-cacahouète par cette pirouette. Jette sa chemise dans la foule, s'enfuit en coulisses. Mais on ne stoppe un pandémonium aussi facilement qu'un go-fast sur une autoroute. Il se fait tard. Bernard Soufflet octroie un rappel, tout de suite transformé en trois morceaux par Mister Loison. Je préfère ne pas vous raconter, vous m'en voudriez toute la vie de n'avoir pas été là. Bref, un set de folie. Merci à nos quatre héros.

RETOUR
L'on s'éclipse à toute vitesse. Comment l'on a regagné la Teuf-teuf à l'autre bout de Paris, sans métro, je vous le conterai un autre jour. Mais la journée a été tellement bonne que l'on n'a pas ressenti cela comme une galère. En plus j'ai ramené, un petit vingt-cinq centimètres inédit de Gene Vincent qui vient juste de sortir; tra-la-la-la-lère !
Damie Chad.
( Photos fb des artistes : Sergio Photostock / Rey Fonzareli / Olvier Navet )
LES ENNUIS COMMENCENT
LOVE-O-RAMA
FLIGHT OF THE TAIKONAUTS GUITAR / THE FRENCH PLAYBOYS MOTORCYCLE BOYS / DON'T TELL ME YOUR TROUBLES / MARWINE TAGADA / JOHNNY'S DEAD / WHEN ELVIS WAS THE KING / 2000 YEARS FROM HOME / I ATE MY BURGER ( TWO DAYS LATER ) / THE GODSPELL ACCORDING TO A. A. NEWCOMBE / TEENAGE QUEEN / OFF THE BUNCH / SOLLACARO 2:45 PM
Atomic Ben : Vocal, guitar / Gus Psycho Picasso : double bass / HUGO SLIM KIDD : Drums / Arno Cole Hicks : guitars /
Benislav Bridgen : organ piano / Jezebel Rock : Arrangements
Methanol Production / Buzz Buzz Records

Fly of The Taikonauts Guitar fanfares de guitares, apachien ou appalachien ? Un rumble des familles dirions-nous pour mettre tout le monde d'accord, oui ça sonne plus américain qu'anglais, mais voyez-vous c'est la poule aux oeufs d'or française qui nous a pondu cette petite merveille. The French Playboys Motorcycle Boys après la poulette made in France ceux qui portent un aigle sur le dos, cavalerie de chevaux d'acier, c'est Ben qui chevauche en tête, super girl sur le porte-bagage, bagarres et cavalcades à foison, c'est chromé comme un aileron de Triumph, la route des légendes, l'autoroute de la mythologie rock, Don't Tell Me Your Trouble conseil d'un ami à l'ami, ne dépose pas tes valises de problèmes dans mon living-room, j'en ai des malles pleines, les nanas deviennent merveilleuses dès qu'elles se sont enfuies, alors écoute ce camaïeu musical, cet entremêlement de batterie ponctuée de guitares et la voix de Ben qui sautille sur les obstacles, y a trop de bon rock and roll dans le monde pour s'ennuyer dans la vie. Marwine tagada elle est sucrée comme une fraise tagada arrosée de sucre candy, la petite Marwine, avec ses sourires de crocodile vous la croqueriez sans rémission. Les Ennuis vous présentent la poussinette idéale, le rêve dont on dreame toutes les nuits et dont vous vous interdisez la cueillette, avec des chœurs féminins à vous conduire tout droit en enfer. Ne craigniez rien, à peine avalée vous en dégustez dix autres aussi sweetest dans le paquet de la vie, suffit de remettre dix fois de suite la piste 4. Attention terriblement addictif. Johnny's Dead changement de climat, l'est des êtres plus inquiétants que Marwine, le rythme obsédant du morceau, vous incite à la plus grande des prudences, attention l'Amitié est encore plus dangereux que l'Amour. Johnny le zombie n'est pas le copain idéal, mais l'est irrésistible comme tous les bad boys. Une version des Bras en Croix de Johnny mis au goût du jour dans le retour des morts-vivants. Le malheur c'est tout comme pour Marwine, vous allez y revenir au moins vingt fois de suite pour en goûter tout l'humour noir. Attention le noir prédomine. Et ces notes éthérées de strato comme un avion qui se perd dans le brouillard... When Elvis Was The King quand Elvis s'insinue dans votre âme et friture tout votre feedback. Le rock est une drogue destructrice, façonne votre pensée et dicte vos déviances. Jeune et jolie, mais déjà en mode survivance. Parce qu'Elvis est le roi. Et que personne ne peut rien y faire. L'est des cauchemars dont on refuse de sortir, l'on y est trop bien. Chant phantomatique de Ben qui vous atomise. 2000 Years From Home quand la réalité est trop lourde à porter vaut mieux sauter dans le fuselage de l'orgue et s'enfuir à l'autre bout de l'univers. Avec les Stones en trip dans le cockpit, l'on est sûr de ne pas s'ennuyer. I Ate My Burger ( Two Days Later ) retour sur terre, attention c'est encore plus terrible qu'un voyage dans l'espace, les fins de soirée sont parfois dures à achever, surtout au petit matin, quand on a sniffé filles, rock and roll et cocaïne dans les intraveineuses de la rage de vivre. Difficile de retrouver son assiette. Et même de retrouver son burger dans son assiette. The Godspell according to A. A. Newcombe le même sujet que le précédent, mais en plus sombre. Un massacre. Ne plus survivre dans la mythologie mais dans la réalité de la vie. Pouvez prier Jésus et tous les diables de l'enfer, les filles s'éloignent... Teenage Queen le réel perdu, vous revivez votre vie en kaléidoscope avec les titres de Gene Vincent en bande son. Une fois ouvert le livre de la nostalgie rock ne se referme jamais. Rêve de vampire qui éprouve une folle envie de fraises tagadas. Off The Bunch reprise de la course en tête. Soyons clair, dans la tête du perdant. Magnifique si vous voulez, mais ne vaut mieux pas donner un titre au tableau en peau de chagrin. Portrait de Dorian très gris sombre. Spellacaro 2: 45 PM instrumental sous-titré Death in the afternoon. Tout un programme. Tout le programme. Quand vous abattez l'as de pique au poker menteur de la vie, faites attention que ce ne soit pas le Johnny Ace.
Waouh ! C'est des français qui ont fait un truc de ce calibre ? Se foutent de notre gueule : chantent en anglais mais prennent soin de glisser le mot french dans les lyrics. De tous les disques rock parus en France, c'est vraisemblablement celui qui s'inscrit le mieux dans l'imaginaire rock national. Lisez les notes de la pochette si vous voulez confirmation.
A se procurer d'urgence si vous êtes fan de rock an roll. Même si en fait c'est un disque de blues, le disque de blues, le plus déchirant éclos sur le terreau national. Bourré d'humour dynamite, une production des plus soignées, des musicos au summum de leur art et un chanteur époustouflant. Tout en finesse. Mais en prime, tout ce que l'on ne dit pas, tout ce que l'on tait par pudeur, pour ne pas ennuyer les voisins, ce désespoir qui vous saisit à la gorge lorsque vous passez la frontière du mi-temps de la vie, la pente du déclin. La pochette annonce la couleur : couleur bleu-gris du soir qui descend. Le renard de l'existence vous subtilise toujours le fromage de la vie, à vous le corbeau déplumé même si vous possédez le plus beau love-O-ramage du pays...
Musicalement c'est une merveille. Un groupe de mambo-rockabilly qui ne court plus après les vieilles lunes de l'adoration perpétuelle, mais qui tient par-dessus tout à se démarquer du troupeau de la meute suiveuse par son aspect créateur. Les seuls vrais loups encore sauvages sont les solitaires.
Citez-moi cinq disques français qui atteignent à ce niveau, et je vous remercierai. Perso, je n'en connais que trois. Commencez par quérir et chérir celui-ci.
Damie Chad.
NAKHT / ARTEFACT
INTERLUDE / ARTEFACT / OUR DESTINY / NEW BREATH / FALLEN LIFE
Danny : Vocals / Chris : guitar / Alexis : Guitar / Clément : bass / Damien : drums

Désolée la terre. Astre mort. Ecrasée par l'immensité spatiale des nues. Avec au centre d'un anneau saturnien trop parfait pour ne pas être inquiétant, l'apparition de l'oeuf germinatif planétaire culminant selon les contreforts d'une mastaba pyramidale rudimentaire. Presque un visage en croissant de lune renversé en filigrane. Taisez-vous, une oreille runique nous écoute. Avons-nous jamais été seuls depuis l'extinction génocidaires des terribles lézards. Très belle pochette du premier EP de Nakht.
Interlude destruction finale. Juste le commencement d'un autre cycle. Des voix éparses agonisantes dans la poussière du bruit. Et une autre qui émerge de sa toute férocité barbare. La musique comme une fin de règne, le bruit comme la fureur d'un monde nouveau émergeant. L'on ne brise pas la coquille du magma stellaire sans tuer les derniers hommelettes que nous sommes. Juste un interlude. Artefact la suite de l'histoire de la bête qui nage dans le fétus humain. Mais c'est nous qui sommes le produit de cette gestation germinative. Nous croyions être de êtres vivants, nous ne sommes que des constructions aléatoires du vivant cellulaire. La coupure du triangle et les grognements du cochon qui nous dévore de l'intérieur. Nous sommes la crotte du cosmos. La merde puante des dieux. Enfoncez-vous cela dans le crâne à coups de pelles avant de creuser la tombe de vos illusions. Crash final. Our Destiny s'annonce mal, l'oracle n'est pas très optimiste nous promet tous les malheurs de l'univers cosmique. Nous sommes les résidus du bidet intergalactique. Assomption finale dans les vertiges de la brutalité. New Breath une respiration brontausaurique. Hosannah sur les cistres et les encensoirs comme disait Mallarmé. Je vous apporte la bonne nouvelle. Tout va mal et rien n'ira pour le mieux. L'horizon s'éclaircit. Pas la peine non plus d'entreprendre la danse votive du feu primordial. Le soleil n'est pas mort. Il n'a jamais existé. C'est ce que l'on appelle l'espoir. Fallen Life la vie nous est tombée dessus comme la nielle dans un champ de blé, comme la mort sur un cimetière. Les voix se sont tues à jamais. Plus de plaintes, plus de de menaces. Nous avons triomphé. Nous sommes devenus un oubli objectal. Tous les objectifs sont atteints.
Musique de cataclysme. Crépuscule des hommes. Nakht frappe fort. Lot de consolation sur le disque : Le scarabée hexagrammique de l'immortalité, le triomphe des insectes. Quinze minutes pour apprendre à survivre en devenant insectivore. Le secret des Dieux en barres chaucolocaustées empoisonnées. Prémonition de la catastrophe à venir. Guerre du feu nucléaire posthistorique. Oreilles fragiles s'abstenir.
N'a qu'à acheter. Nakht.
Damie Chad.
FALLEN EIGHT / RISE & GROW
REBORN / COME FROM THE SKY / FINAL SHOT / BREATH OF THE AGE / LIGHT / WORST NIGHTMARE
Clem : vocals / Medy : lead guitar / Joffrey : bass / Florian : guitar / JP : drum

Pochette comme une main tendue au néant. Parmi le chaos des étoiles la rosée se dépose sur la fleur miraculeuse. Poussez et croissez. Ainsi parle Fallen Eight. Sur le volet intérieur, l'effigie des apôtres de la bonne nouvelle. Celle de la germination aristotélicienne qui assure les mystères de l'advenue de l'Être. Taisent l'autre côté du décor, la corruption de toute rose en son déclin.
Reborn cri primal de l'enfant qui vient de naître. Rassurez-vous si l'avenir s'annonce radieux, l'accouchement s'est mal passé. L'enfant en porte les stigmates de la plus grande des violences. Parfois l'amour engendre des monstres. Fallen Eight c'est un peu wagnérien, la voix qui hurle que tout est beau et les leitmotives des orages désirés qui hantent la musique. Come From The Sky tout ce qui tombe du ciel n'est pas obligatoirement bon. L'est des bébés dragons qui deviennent insupportables dès qu'ils grandissent. Tout est dans la façon d'entrevoir les choses. L'explosion atomique à moitié réussie ou à moitié ratée. Dans les deux cas, c'est volontairement catastrophique. Final Shot parfois il ne faut pas hésiter. Faut tuer le chien avant que sa morsure ne vous enrage. Une seule balle suffit. Mais débat de conscience en votre âme corrodée par les illusions des prophéties ambigües. Musique pressante et oppressante. Dialogue partitif de guitares. Les voix se sont tues. Mélodies du bonheur empoisonnées. Breath Of The Ages déferlement des âges anciens dans votre âme vous aboyez comme un chien sous la lune louvienne et solitaire. Sans doute y a-t-il quelque chose à dire, mais encore faut-il savoir quoi. Crier ne suffirait-il pas ? Fallen Eight s'emballe. Hurlements et tambours de la colère. Restez seul avec votre solitude. Vous ne pourrez jamais être en plus mauvaise compagnie. Light La lumière est au bout du chemin comme la terreur au bout de la nuit. La clarté n'est que l'envers de l'obscurité. La distance entre les deux est millimétrique. Un pas sur le côté et la lumière vous aveugle, la nuit reposera votre vue. C'est ainsi que les aveugles deviennent voyant. Inversion des valeurs ? Worst Nightmare le pire est toujours certain. Mais c'est sur le fumier de la décomposition qu'éclosent les plus belles fleurs. Un monde pétri de brutalité décompositoire engendre le plus doux des parfums. Fallen Eight emprunte la voie sèche, celle qui allie la plus véloce des rapidités à la plus grande efficacité. La grande déferlante du limon régénérateur.
Une voix magnifique, les orgues de la tendresse et la philharmonique de la rébellion. Théâtralité extrême du choc émotionnel. Servie sur le coussin rugueux d'une orchestration sans défaut. Beauté parfaite. Roses carnivores aux épines acérées et cancéreuses. A cueillir sans retenue.
Damie Chad.
15/10/2014
KR'TNT ! ¤ 204. SUICIDE / NEXTFLOOR / NAKHT / NATURAL RESPECT / KLAUSTROPHOBIA / BILL HALEY / MONT DE MARSAN
KR'TNT ! ¤ 205
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
16 / 10 / 2014
|
SUICIDE + ALAN VEGA / NATURAL RESPECT / NAKHT / NEXTFLOOR / KLAUSTROPHOBIA BILL HALEY / FESTIVAL MONT DE MARSAN |
LA GAÎTE LYRIQUE / PARIS 03
08 – 07 – 14 / SUICIDE
ROCK'N'ROLL SUICIDE
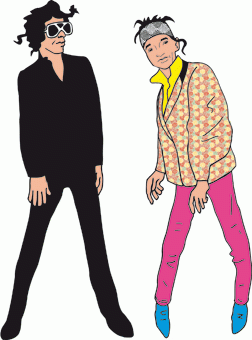
Ce concert de Suicide à la Gaîté Lyrique avait un petit air de dernier rendez-vous. Martin Rev semblait en grande forme, mais Alan Vega - 76 ans - ressemblait à un mort-vivant. Ils paraissaient tous les deux à la fois perdus dans l’immense volume de cette salle et en même temps terriblement présents, car foncièrement légendaires. Ces deux petits vétérans de la grande époque se dressaient face à une salle pleine à craquer. On sentait que le public était un public de fans et de connaisseurs. Cinquante ans de légende électro, ce n’est pas rien. Même si on ne raffole pas des albums et de la musique de Suicide, il faut bien avouer que leur set - et ce qu’ils dégagent tous les deux par leur simple présence - sort de l’ordinaire. On peut parler de souffle et du fruit d’une incroyable ténacité. Si on admire tant Alan Vega et Martin Rev aujourd’hui, c’est tout simplement parce qu’ils ont su défendre pendant cinquante ans une vision unique du rock. Et pour eux, ce fut extrêmement difficile, car leur style les marginalisait radicalement. Ils étaient beaucoup trop en avance sur leur temps. On encensait Patti Smith à l’époque, mais la seule présence de Suicide dans les parages du CBGB la ringardisait systématiquement. La pauvre Patti Smith travaillait à l’ancienne et la modernité Suicide dépassait ses facultés de compréhension.

C’est en les voyant sur scène qu’on réalise à quel point ils sont dans le vrai. Pas dans le vrai, c’est vrai, mais dans leur vrai. Leur univers est réel, il fonctionne. Pendant une heure, on ne s’ennuie pas un seul instant. Au contraire. Ils exercent une étrange fascination, du genre de celle que pouvait exercer dans l’antiquité un personnage charismatique rencontré au détour d’un chemin perdu de Palestine. See what I mean ?

Affublé d’une casquette marquée Brooklyn, de lunettes à montures fluo et d’un ensemble moulant en vinyle noir, Martin Rev fit un joli numéro de cirque. Il martyrisa ses machines et pulsa un son énorme gorgé d’électro synthétique. Il mit tout le monde sous tension et insuffla dans les esprits une belle dose d’adrénaline. Il sortait un son qui n’était pas du rock, mais son pounding valait cent fois celui d’un garage-band. Ce son qu’il a inventé voici cinquante ans est le heartbeat urbain de New York, et les machines diront la pulsion urbaine d’une ville comme New York mieux qu’aucun groupe de rock ne le fera, ni même le Velvet et encore moins Grand Mal. Et là-dessus se pose la voix forte d’Alan Vega, chantre de la décrépitude urbaine et des bas-fonds de la mégapole. Alan Vega appartient à la caste des très grands chanteurs américains, il ne faut pas l’oublier. Niveau Elvis, Iggy et George Jones. Il disposait autrefois d’un timbre unique, d’une prestance comparable à celle de Lou Reed et d’un sens aigu du swing rockab. Mais ce soir de juillet à la Gaîté Lyrique, il semblait avoir perdu sa voix ainsi que sa vitalité. Il errait comme une âme en peine, revenait au micro et brandissait sa canne à pommeau. Il semblait pourtant heureux de se retrouver sur scène à Paris car il n’en finissait plus de saluer le public. Il chantait par intermittences, pendant que Marty faisait trembler les colonnes du temple. Ces deux personnages donnaient l’impression de maîtriser le chaos. Mais dans l’immensité de cette salle, le chaos semblait démesuré et rendait leurs silhouettes bleuies par le light-show encore plus frêles. Peu de groupes osent ainsi se mesurer aux éléments, surtout lorsque ces éléments ont été créés de toutes pièces. Quand on voit Martin Rev, on pense aussitôt à une sorte de Docteur Frankenstein farfelu. L’étonnant est qu’ils atteignent tous les deux leur fin de cycle de vie alors que leur chaos sonique semble entamer le sien.

L’histoire de Suicide ne date pas d’hier. Alan rencontra Marty en 1969. L’ami Marty sculptait et jouait déjà dans un groupe de jazz expérimental, typique de la bohème new-yorkaise des années soixante (voir les mémoires de John Cale et l’histoire de Sun Ra). Ce groupe de jazz expérimental jouait toute la nuit. Marty et Alan cliquèrent bien et montèrent Suicide. Leur premier show eut lieu dans un musée, comme par hasard. Suicide s’est toujours considéré comme un projet d’art expérimental. Leur première prestation, baptisée «Punk Rock by Suicide», eut lieu au New York City Museum en 1970, et tant mieux pour ceux qui purent y assister. Ils avaient déjà cinq ans d’avance sur la scène «punk» new-yorkaise. Mais comme le précisait Marty, les vrais punks n’étaient pas ceux qui arrivèrent dans le rond du projecteur en 1975, mais ceux qui étaient là depuis le début : Elvis, Chuck Berry et Little Richard, c’est-à-dire un chauffeur de camion, un taulard et un trave.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la formule de Suicide fut élaborée comme un concept. Marty et Alan voulaient explorer les possibilités du minimalisme : vocals, drums & machines. Ils affinèrent le projet en virant la batteuse Mari - qui était aussi la femme de Marty - en 1975, pour la remplacer par une boîte à rythme et se rapprocher encore plus de leur idée du minimalisme : deux personnes, un seul micro et des claviers. Rien d’autre. Personne n’aurait misé un centime sur eux. Leur show s’appelait alors «Punk, Funk and Sewer Music by Suicide». Ils se produisaient dans les clubs new-yorkais à la même époque que les Dolls alors à leur apogée. Peu de temps avant de mourir, Arthur Kane expliquait que les Dolls avaient la trouille de Suicide, car Alan Vega sortait tout le temps son cran d’arrêt et se donnait des coups de poing dans la figure. Il montait aussi sur scène avec une chaîne de moto et frappait le plancher à coups redoublés, ce qui terrorisait le public. Mais en 73, les Dolls et Suicide sympathisèrent et David Johansen jouait parfois des claviers avec les deux compères. Johansen avait fini par apprécier leur modernité.

Suicide sortait un son unique, que les Anglais qualifiaient de thunderous proto-punk electronica. Aucun groupe n’avait jamais sonné comme ça aux États-Unis. Chaque chanson était conçue comme un film. Alan Vega racontait une histoire. Il faisait de la poésie urbaine, comme Lou Reed, d’ailleurs. L’histoire de «Frankie Teardrop» raconte l’histoire d’un pauvre type qui ne s’en sort pas - «He’s working from seven to five/He’s just trying to survive» - et qui descend toute sa famille avant de se tirer une balle dans la tête - «Frankie put the gun to his head/ Frankie’s dead». La mort rôdait dans les chansons d’Alan. Les sets du groupe étaient d’une rare violence et dépassaient rarement les 30 minutes. L’un des épisodes les plus retentissants de leur «carrière» fut la fameuse tournée anglaise de 1978 en première partie des Clash, et notamment le concert de Glasgow. Alan Vega et Marty cultivaient un goût prononcé pour le chaos et Glasgow était l’endroit rêvé. Henry Scott-Irvine raconte l’épisode : «Le chaos semblait inévitable avec un tel rassemblement : 4.000 punks et skinheads de Glasgow ! Alan Vega arriva sur scène sans être annoncé. Il portait un blouson doré avec une seule manche. L’autre avait été arrachée. Il plongea le public dans un silence consterné. Un mec brailla : ‘Qui c’est celui-là ?’ Un autre gueula : ‘Hé toi, prends une guitare !’ Le public avait ‘I’m So Bored With The USA’ des Clash en tête et les gens commencèrent à claquer des mains. Pour mieux provoquer les Écossais, Alan Vega claqua des mains en rythme avec eux. Mon pote me glissa à l’oreille : ‘Il ne faut jamais provoquer un mec de Glasgow !’ Dans les secondes qui suivirent, les Écossais arrachèrent toutes les rangées de sièges de la salle.» Évidemment, Alan Vega continua de les provoquer. Il ramassa une boîte de bière qu’il but à la santé du public, puis une hache vint se planter à ses pieds. Il y eut une bagarre générale dans la salle, et après le concert, les flics embarquèrent Joe Strummer au ballon. L’autre heure de gloire de Suicide fut la première partie d’un concert d’Elvis Costello à Bruxelles en 1978. Une fois de plus, le public n’était pas préparé à supporter l’assaut de la fameuse thunderous proto-punk electronica. Les Belges étaient là pour Costello et sa petite pop bien propre sur elle. Alors les Belges laissèrent Suicide jouer un morceau pour voir à quoi ça ressemblait puis ils commencèrent à huer pendant «Rocket USA», le second morceau. Au troisième morceau, ils gueulaient : «Elvis ! Elvis !» On est en Belgique, ne l’oublions pas. Ils n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin. Un Belge sauta sur scène pour piquer le micro d’Alan. Hey ! Trop tard ! Alan ne s’est pas découragé. Il s’est mis à chanter «Frankie Teardrop» a capella. Mais ça huait de plus belle. Alors Alan s’est énervé : «Shut the fuck up ! This is about Frankie !» Il fut obligé de quitter la scène et bien sûr les Belges se mirent à applaudir son départ.

Dans l’histoire du rock, peu de gens ont su manier le chaos avec brio. Avec les Pistols et les Stones, Alan et Marty furent les meilleurs. Si les concerts tournaient mal, ça leur semblait normal. Ils étaient tous les deux des petits durs new-yorkais et rien ne pouvait les effrayer. Ils ne bronchaient pas quand ça dégénérait. La réaction du public les décevait souvent. Too square to appreciate their genius. Beaucoup d’artistes d’avant-garde ont vécu ça avant eux. Édouard Manet fit scandale avec son Déjeuner Sur l’Herbe. Idem pour Malevitch avec le Carré Blanc sur Fond Blanc et plus récemment pour Wim Delvoye avec sa fameuse machine à caca. L’histoire de l’art grouille d’histoires de ce genre. Il n’était pas surprenant de voir Alan Vega et Marty Rev confrontés à l’obscurantisme rock de leur époque. Il faut tout de même se rappeler que le monde des «enfants du rock» est surtout un monde extrêmement cloisonné où règne un sectarisme encore plus virulent que dans le monde syndical. Quand on n’aime pas un groupe, il est d’usage de dire que c’est de la merde. Dans le monde syndical, quand on n’apprécie pas les idées des autres, il est d’usage de dire qu’ils ne sont pas dans la ligne.

Leur premier album n’était pas à la hauteur de leur réputation. C’est le principal reproche qu’on pouvait leur adresser. Beaucoup trop pop pour des gens qui se vendaient comme les apôtres du chaos. L’album ne tenait que par la voix d’Alan Vega et la qualité de ses textes, qu’on taxait de sambas morbides - «Speeding on down the skyway/ 100 miles per hour/ Gonna crash/ Gonna die/ And I don’t care» - C’est vrai que «Rocket USA» puait l’angoisse. Même chose pour «Frankie Teardrop», monté comme une mascarade cauchemardesque avec la mort comme délivrance, le beat ultime du non-regard et du déni de vie qui s’affirmait dans un hurlement. En écoutant «Ghost Rider», on avait l’impression de voir une petite assemblée de robots déniaisés jerker dans un habitacle caoutchouté, avec des hochements de tête d’avant en arrière, des roulements d’épaules et des ploiements de genoux sporadiques. On avait l’impression d’écouter un disque fantôme traversé par des vents glacés. Certaines pièces comme «I Remember» étaient même trop pop, alors que sur scène Alan Vega provoquait les skins écossais, les pires. Mais avec ce premier album, les deux compères posaient les conditions de leur légende. Et ils inventaient un genre qui n’existait pas encore : l’électro.
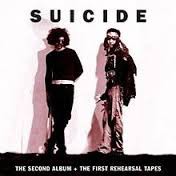
Leur second album «Suicide : Alan Vega and Martin Rev» était beaucoup plus solide. «Mr Ray» était dédié à Ray Gange, le mec qu’on voit dans le film «Rude Boy» consacré aux Clash. «Fast Money Music» sonnait comme un hit étrange, avec un brin de folie monté sur un groove de flûte des Andes, le push des fantômes et Alan s’énervait, il poussait des petits cris de bête et ça devenait excitant. Alan ramenait sa fraise rockab dans «Be Bop Kid», il prenait ça à la décontracte et groovait sur les machines automatiques. On réalisait à la lumière de ce numéro de charme à quel point Alan Vega était brillant. Il chantait ensuite «Las Vegas Man» du menton. Il savait créer des ambiances et nous embarquer dans ses grooves malades et latents. Il chantait ça bizarrement et Marty samplait dans son coin. «Shadazz» était une sorte de mambo admirablement séduisant - Sweet lady she dies oh shadazz - et «Dance» ressemblait à un groove en mauvaise santé, un groove plombé et une fille chantait derrière. On avait là un truc parfaitement malsain qui évoquait les ambiances glauquissimes de David Lynch, du genre aw t’es mort dans l’orgasme purulent d’un délire à la Burroughs. Alan et Marty connaissaient toute cette logique de la putréfaction des idées par cœur. Leur groove était celui d’une mort par overdose. Mais pour pouvoir entrer sérieusement dans l’univers de Suicide, il fallait être complètement défoncé. C’est là que se trouvait la clé de l’énigme. «Super Subway Comedian» le matin au petit déjeuner, en même temps que la tartine beurrée, ça ne marche pas. Par contre, si on l’écoutait dans de bonnes conditions, alors on voyait le petit joueur de flûte des Andes sur le radeau d’Aguirre parti à la dérive sur l’Amazone, c’était Alan qui portait le bonnet et qui dansait d’un pied sur l’autre parce qu’Aguirre avait sorti son épée et lui avait ordonné de danser. On voyait les singes et on voyait les flèches. On voyait le radeau dériver vers l’enfer. Ce deuxième album était bourré d’ambiances délétères. On avait là le fameux dérèglement de tous les sens dont parlait le trafiquant d’armes Rimbaud qui d’ailleurs aurait adoré ces killer flavors. Suicide se montrait maladif, contagieux, malsain et crapuleux. «Dream Baby Dream» était du pur jus suicidaire avec une mélodie à la ramasse de la rascasse et «Radiations» émettait de sacrées concoctions d’art moderne à la fois énormes et lointaines.
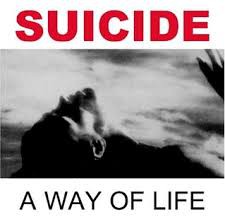
Avec leur troisième album, «A Way Of Life», les deux compères ont trouvé leur vitesse de croisière. Retour au groove ténébreux avec «Wild In Blue», qu’Alan chante d’une voix rugueuse à la Bukoswki. Il va chercher ses accents assez loin au fond de son gosier, dans une belle ambiance d’écho mortifère. On retrouve l’excellence de la pression avec «Rain Of Ruin», monté sur un beat voodoo électronique. Alan débite son voyage d’une voix mûre. S’il est une musique qui se prête à la littérature, c’est bien celle d’Alan Vega. Il est littéraire, au sens américain du terme. Comme le furent Malcolm Lowry, Mezzrow et William Burroughs. Ils expérimentaient en direct. «Sufferin’ In Vain» sonne de manière incongrue, comme un petit roman de Jean Paulhan. Il faut aimer prendre les chemins de traverse, et si on s’y plait, alors on se délecte de tant de grâce impromptue. «Domino Christ» est une pièce exemplaire d’hypnotisme carabiné. Alan et Marty tapent dans l’excellence de la démesure. Ils se veulent à la fois expansifs et envoûtants. C’est magnifique d’alarmisme tempéral. Encore une belle merveille suicidaire avec «Heart Beat» qui s’inscrit dans le cutané du son et les interjections d’Alan allument des lampions dans les rues désertes. C’est le fameux beat des ténèbres, celui qui terrorise les admirateurs de Jean-Jacques Rousseau. Parce qu’il avance dans la nuit comme une machine de guerre, semblable à un énorme vacherin technologique qui se profile dans l’embrasure des brisures de rêve, là où l’esprit n’ose plus guère traîner, au lendemain de certains traumatismes viscéraux. Mais Alan s’y fourvoie. C’est un démon vert de l’au-delà des genres. Il fait son rock, que ça plaise ou pas.

Avec son léger parfum discoïdal, «Why Be Blue» semblait subir les ravages de la mode. On était en 1992, et donc en plein dedans. Le morceau titre est très dansant. «Cheat Cheat» se veut plus rocky-road, mais le beat reste dans le trapèze horizontal. Dans «Universe», Alan Vega sonne comme un prêtre Inca priant l’astre solaire sur la haute terrasse d’un temple. Il faut attendre «Last Time» pour retrouver la stature suicidaire et les petites ossatures translucides. Retour des poissons mécaniques argentés qui circulent entre les nappes de mambo synthétique - Yah - La musique de Suicide est une formidable plate-forme d’expérimentations imaginaires. Ou bien on avale un grand verre de rhum de Guyane, ou bien on fume un gros joint d’herbe, et en voiture les enfants. Magie du propulsif. Les sons colorent l’espace et des formes apparaissent. On se sent apaisé par la seule présence d’Alan Vega. Sa voix chaude nous met en confiance. Avec quelqu’un d’autre, ça ne marcherait pas. Nouveau hit exemplaire avec «Pump It» qu’Alan chante avec de la délinquance plein la bouche. Il fait swinguer ses voyelles sur fond de transe électro concoctée par l’ami Marty. Avec cette pièce maîtresse d’hypnotisme - Hot hash - il règne sur son univers. C’est à ça qu’on reconnaît les géants visionnaires. Autre merveille : «Mujo», énorme et suicidaire, dotée d’un beat qui ne pardonne pas. Alan se vautre dedans comme dans un canapé rose. Il chante avec une affectation perverse, glousse un peu et le beat fuira vers l’horizon, jusqu’à la fin des temps. Voilà ce qu’il faut bien appeler une fin de non-recevoir.

Le dernier album de Suicide est sorti en 2002. On trouvait sur «American Supreme» l’une de ces énormités dont est capable Alan Vega : «Beggin’ For Miracles». Un hit planétaire bourré de sens, monté sur un gros beat industriel - dancing on the graves - Il ravale sa salive - Oh yeah ! So spectacular ! And you’re gonna beg ! And you’re gonna beg ! - un point de non-retour. Il retrouvait son accent de la rue pour attaquer «Swearing To The Flag» et chantait un hymne à la décadence de l’Amérique avec «American Mean» - Hey bank-robber, stay away ! - On avait même des trompettes dans le groove de «Wrong Decisions» et de la violence à l’état pur dans «Death Machine», pure électro de transe, énorme et bien pulsée, même si on n’aime pas l’électro. Il balance un nouvel hymne à la grandeur de l’Amérique avec «Power Au Gogo» - Thank you America/ Everything is crime/ Everything is racist/ Au gogo - Magnifique. Tout est dans le swing de sa diction. Il échappe au format de la chanson. C’est un géant du rock des rues. Et il finit avec «Child It’s A New World», alors on retrouve l’excellence de ses mises en garde et l’autorité de ses injonctions.
Tous les fans de Suicide possèdent les disques live, et notamment «Ghost Rider» qui propose les fameuses ROIR Sessions de 1986. C’est le seul moyen de se réconcilier avec le premier album studio qui paraissait un peu raté. Ils attaquaient «Rocket USA» à la corne de brume et Alan partait aussitôt en vrille pour faire son punk des bas-fonds new-yorkais. Il conjurait les démons de l’acier noirâtre et travaillait l’énervement chamanique. Il organisait son petit chaos et échappait à toutes les règles d’or. Il trépignait ensuite «Rock N Roll» dans la friture d’huile de vidange des machines secouées par les court-circuits - schcccchhh ! - Il conjurait - babybabybaby - il attirait les ennuis comme un gros aimant et se comportait comme le parfait nosférateur. Dans «Ghost Rider», on entendait les klaxons et ils envoyaient «Harlem» valser sur un jungle beat incantatoire évadé d’une salle de torture américaine. Ils lâchaient une version noire, dans l’esprit du non-esprit. On sentait une persévérance maléfique. Puis ils passaient le vieux hit de Question Mark à la moulinette de Jean-Christophe Averty - Oh cry cry cry - ils re-frissonnaient un «96 Tears» qui n’en avait pas besoin, et le traitaient à la nappe déviante et fine d’alu dans l’étain de l’éteignoir. Et dans le profond de l’oreille, ça dansait comme la main molle et blanche d’une Carmélite de Clovis Trouille.

On vit apparaître dans les années 80 les premiers albums solo d’Alan Vega. Sur le premier, un guitariste nommé Phil Hawk l’accompagnait. Alan allumait les lampions dès le premier titre, «Jukebox Baby», une sorte de rockab futuriste qu’il haletait merveilleusement. Et on allait de surprise en surprise, avec «Fireball» et sa belle progression cavaleuse - babe babibaberen - bien montée sur son petit dadada et surtout «Bye Bye Bayou», pièce de pur génie cavaleur montée sur une jolie mécanique rythmique, un paradis hypnotique pour les moustiques et les amateurs de frissons. Alan en profitait pour faire le con et imiter toutes les bêtes du marais.

«Collision Drive» sortait un an plus tard. Il jouait avec un vrai groupe et continuait d’explorer la magie rockab avec «Magdalena 82» et «Magdalena 83». On trouvait même sur ce disque une reprise un peu trop bizarre de «Blue Suede Shoes». Il fallait attendre «Outlaw» pour retrouver notre cher géant visionnaire. Il y était suivi par une guitare offensive et bien grasse. Il s’agissait là du hit que tous les fans d’Alan attendaient de pied ferme. On tombait ensuite sur un autre chef-d’œuvre absolu, un «Ghost Rider» monté sur un rif bourdon. Terrible riff qui s’insinuait dans la cervelle. Cette vraie cochonnerie tendancieuse entrait dans le conduit auditif comme le scarabée qui était entré dans l’oreille de Speke, au temps où il explorait avec Richard Burton les hauts plateaux d’Afrique de l’Est à la recherche des sources du Nil. On avait là une vraie merveille hypnotique. Ce Ghost interdisait le pékin perdu dans la Cité et emportait tous les Riders in the Storm. Vega végatait à fond de Mystery Train et régnait sans partage sur un monde idéal caractérisé par l’absence de médiocrité. Il posait le haut registre de sa voix sur de vertigineux autels de parti-pris catégoriques.

Et hop, il revenait deux ans plus tard avec «Saturn Trip». Il profitait de «Saturn Drive» pour lancer le frelon des machines. Ça bourdonnait bien à l’oreille, d’autant mieux qu’Al Jourgensen et Ric Ocasek étaient de la partie. Alan redevenait l’espace d’un morceau le roi des tensions suburbaines. Puis il claquait «American Dream» au groove byzantin d’Ocasek et il végaïait nonchalamment au fil d’une belle élongation du beat. On pourrait croire que «Kid Congo» est un clin d’œil aux Cramps, mais non, c’est juste un exercice de style alerte - Oh ouango-bango ! On trouve un hit pop de bas de gorge en face B, le fameux «Wipeout Beat», ce pur jus déclamatoire qui va faire sa grandeur - We want a radio/ We want a TV/ We want the movies/ We want it now wouahhh ! - Le hit de l’album, c’est «Angel». On y retrouve la transe de Question Mark & The Mysterians. Alan sait manier le vrai drive sixties - She’s so sensational/ I love her so/ I love her so - et derrière Mark Kuch joue du gros garage d’évacuation. Tout tient par la voix.

Si on achète «Just A Million Dreams», c’est uniquement pour la pochette. Alan y est beau comme un page florentin. L’album est littéralement massacré par la prod des années 80. Alan a beau s’énerver - Cumon, I’m dangerous - ça ne marche pas. Le son synthétique le ridiculise. Tout est atrocement poppy sur ce disque et Ocasek fait le fanfaron par derrière. Le seul morceau sauvable est «Wildheart», monté sur un beat furtif et hanté par des TV Ghosts. Alan navigue en solitaire dans cet univers de pacotille, au fil d’images qui défilent sans laisser de souvenirs.
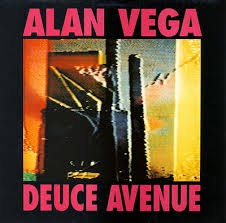
Sur «Deuce Avenue» paru en 1990, il chante avec Liz Lamere. Dès «Body Trip Jive», on retrouve la merveilleuse pulsation pulsative des temps bénis. Avec «Sneaker Gun Fight», Alan teste le beat. Il le toise d’un œil expérimental. Il va chercher des accents durs. All the power ! Il se confronte avec le son. Il heurte le beat de plein fouet. Avec «Jab Gee», il cherche ses mots sur fond de beat électronique, pendant que des nappes de violons synthétiques s’éloignent. Alan Vega est au rock ce qu’Henri Michaux est aux lettres : il expérimente savamment. Il teste une fois de plus l’étrangeté du beat avec «La La Lola» et se contrefout de la latitude. Il bricole un mambo technoïde fascinant. Il se situe aux antipodes de TOUT. Alors on le suit de près. Dans «Deuce Avenue», il shoote un riff de la planète Uranus. Il cherche une sorte de réconciliation avec la mélodie humaine et bascule inexplicablement dans le weird extraordinaire. Dans «Sweet Sweet Money», on l’entend cultiver la désespérance sur un beat de fin du monde. Puis il revient au weird par pur hasard avec «Love On», épaulé par des chœurs de petites fourmis et des frelons qui zonent. On se croirait chez Tamla-Gallimard. Avec «No Tomorrow», il nous entraîne à nouveau dans une atmosphère fabuleusement littéraire. On croirait entendre des bruitages de voix intérieure à la Joyce. Avec Alan Vega, on évolue dans un autre monde, qui serait celui d’une certaine évolution.
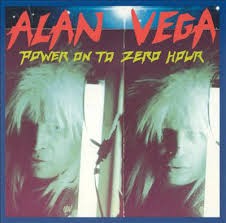
Il revient en 1991 avec «Power On To Zero Hour», nouveau manifeste techno-littéraire. «Bring In The Year 2000» est le groove urbain idéal. Alan Vega est au son ce que William Burroughs est aux lettres : une force tellurique, un vif-argent, un pape de l’insolite, une intelligence dépareillée. Avec «Sucker», Alan reprend son bâton de pèlerin suicidaire. Il pulse le beat et crache son ressentiment. Il s’en prend au genre humain et au dévoiement de la race blanche. La richesse des ambiances sonores le rend invincible. Il sait driver les machines noires et froides - Watch out brother ! - Il provoque un agacement neuronique intense et touille le foutraque - Sucker ! - Avec «Fear», il titube dans les couloirs du palais sur de faux airs décadents auxquels se mêlent des échos de voix droguées et il chante ses rêves de trips. Il récupère un groove nubien pour «Automatic Terror». Sous la lune de Balaluma, il attise un groove adroit et juteux. Chaque disque d’Alan Vega est une aventure passionnante qui nous fait oublier la platitude des contingences. Alan Vega invente avec ses disques une espèce de nébuleuse nubile qui luit comme l’or pâle dans l’ombre d’une minuscule scène tendue de velours bleu nuit. Attention à «Believe It» : on tombe sous le charme hypnotique du White Zombie de Victor Halperin. Alan serre les poings - Forget all the promises/ Forget all the news - On retrouve l’incandescence de «Beggin’ For Miracles». Le génie technoïde d’Alan Vega donne le vertige.

«New Raceon» est un album du même niveau que le précédent. Alan attaque avec «The Pleaser» et il pose sa voix de King techno sur un beat métronomique. «Christ Dice» est furieusement fouillé aux guitares. Il fonctionne par grosses giclées d’interjections electroïdes. Hey ! C’est un meneur de rondes infernales. Hey give my Christ dice ! «Gamma Pop» est un hit dégingandé et fantastique d’allant. Il stimule un squelette rythmique trouvé dans le bric et le broc du Bronx. Pur hypnotic blast. Avis aux amateurs. Encore une équipée sauvage avec «Viva The Legs». Alan est le seul mec capable de virées à la Brando. Il crée les moods de la mort du petit cheval fabuleusement fouillés au beat. Dans «Do The Job», Ocasek joue le guitar man vaudou. Une fois de plus, Alan fascine. Il n’a plus rien à prouver - No more soul ! - Alors, il susurre des vers modernes dans la chaleur blanche d’une fournaise technoïde. Ça ronfle dans «Keep It Alive», comme dans Sleep, le film en plan fixe d’Andy Warhol qui nous montre pendant trois heures un mec en train de dormir - Don’t take your shit - On a là une véritable bête de soul techno à la Vega, il pousse des cris. On le suivrait jusqu’en enfer. Ça ronfle et derrière ça fouette des guitares dans les couches du son. On entend crier une belette dans une cave.

Alan Vega, c’est la même chose que Sun Ra : il conçoit des espaces nouveaux. Et donc, il ne peut pas plaire à tout le monde. Avec «Dujang Prang», il cure la plaie du vieux cauchemar américain du Sud-Est asiatique. «Hammered» ? Comme son nom l’indique, Alan martèle comme Charles Martel, sauf qu’il ne martèle pas des crânes de Sarrazins mais le crâne du néant. Il erre dans les tin cans et dans les aléas d’un groove de boîtes en fer. C’est du grand Vega, du paradis artificiel en vrac de havoc. Et voilà «Cheenanoka», l’immense groove organique du Vega galvanique. Il est accompagné de chœurs de cathédrale et de glouglous de labo interdit. C’est une atteinte à la morale, un beau désordre panaméen. Il taille ses instruments dans la jungle de bambous technoïdes et sollicite les âmes des guerriers perdus. Alan Vega est la réincarnation du Fantôme du Bengale. Il groove sur la mort et les chœurs des guerriers morts hantent son cut. S’ensuit une petite virée dans l’espace avec «Saturn Drive 2». Il suce des molécules et gronde de plaisir. Il libère des énergies inconnues. Son vaisseau réagit bizarrement, mais c’est bien. Il chuchote ses confidences, perdu dans le néant. Personne ne l’écoute. Avec «Jaxson Gnome» on réalise encore plus nettement l’originalité d’Alan Vega. Son univers est l’un des plus imagés de l’univers du rock. Peu de gens sont capables de tripper autant à jeun, c’est à dire sans rien avaler. Son rock monte toujours directement au cerveau. Il s’adresse essentiellement à l’intellect. Avec «Life Ain’t Life», il recrée une ambiance de flaques noirâtres dans un immense hangar gelé. On se demande d’ailleurs ce qu’on fait là. «Flowers Candles Crucifixes» se présente comme un cliché mais Sahib Vega pas cliché. Il aspire sa bave. Il lance ses pulsions dans le groove le plus poisseux de l’univers. Il hurle dans la surenchère du rut. On entend griller des notes de guitare. C’est atrocement beau. On entend couler un filet d’eau au plus profond de la jungle. Avec Alan, on est dans l’esprit de survie, on est dans l’éclat du mythe. Certains échos renvoient aux scènes de cauchemar tournées par David Lynch à la Nouvelle Orleans (Wild At heart). Puis il fait sonner les tambours de guerre guinéens dans «Big Daddy Stat Livin’ On Tron» et provoque à nouveau le grand dérèglement de tous les sens.
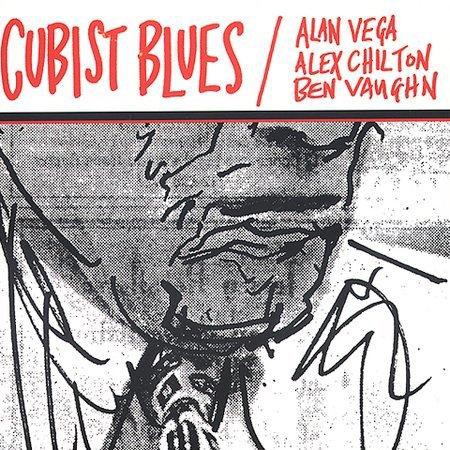
Alan Vega, Alex Chilton et Ben Vaughn enregistrèrent «Cubist Blues» en 1996. C’est un album exceptionnel. On voit rarement des triplettes de cet acabit. «Fat City» est du pur autobahn. Vega tire l’overdrive et chante d’une voix de stentor mythologique. «Freedom» est une pièce plus mélodieuse qui sonne comme un vieux hit parabolique. Alan en fait un slow super-frotteur. Emmené par un chant à la ramasse, «Candyman» est un vrai cut d’anticipation. Alan procède par interjections et jette des coups de menton. Derrière, Chilton gratte comme un dingue. «Lover Of Love», c’est à tomber. C’est la rumba des junkies de Brooklyn sortis tout droit de Ringolevio. Pur Grogan groove. On retrouve l’élégance suprême du groove new-yorkais dans «Do Not Do Not». Et puis avec «The Werewolf», Alan rappelle à toutes fins utiles qu’il est l’un des plus grands chanteurs américains.

La même année sortait «Getchertiktz», un nouvel album de triplette. Cette fois, il s’est acoquiné avec Ric Ocasek et Gillian McCain. Ils chantaient leurs trucs à tour de rôle. Le génie d’Alan Vega éclate une fois de plus au grand jour avec des cuts comme «Tell Me» (fabuleux groove urbain - sweet sweet jealousy), «Smell War» (il entre sur le sentier de la guerre - mutilate ! mutilate !), et surtout «Train», qui est un absolu chef-d’œuvre de trash-rock - No brain no brain/ Insane/ Born on death row/ You gotta crawl - tout est là, dans la façon de fabriquer le cauchemar américain. Pas besoin d’accords garage ni de fuzz. Il suffit d’un peu de classe - In the train/ Wants my ass/ Hey hey no way/ Get the fuck of here - On retrouve dans ce cut exceptionnel toute la puissance sonique des Stooges et du Velvet. C’est une cavalcade insensée. Alan est tout seul avec son attirail - They say hey ! - Voilà une énormité qui n’a pas de prix.
L’album intitulé «2007» est sorti en 1999. On y entend le prêtre défroqué Vega hurler dans la tourmente technoïde des années de déficit antérieur. Il hurlera comme ça jusqu’à la fin des temps et personne n’entendra ses plaintes inutiles. Dans «Meth 13 Psychodreem», la meth se fait mess, il chante le bonheur du trip, c’est un enfant de la balle et même du speedball. Les bruitages sont ceux des os de crâne qu’on entend bouger en plein trip. Dans «Hunger Wonders», il rappelle que les carottes sont cuites - You’ve run out of miracles, mais ça, on le sait depuis longtemps - Hey creators - et une flèche frappe l’écho en plein cœur. Horrifié par le spectacle du néant, Alan hurle democracy dies dans «Jajeemba». Avec «Blessing Fa Ta Broke», il nous baigne dans l’ambiance démoniaque du trip aux grillons sur les genoux de Rosemary. Alan agonise et le beat s’éteint. Encore des surprises de taille avec «King» (claquement d’échos mortifères) et «Trinity 2007» (on y entend un hurlement de cloporte saturnien - toujours le trip de meth). Puis dans «Doctor Death», Alan s’adresse à la mort. Alors elle vient, avec un bruitage particulier.

«Station» date de 2007. Dès «Freedom’s Smashed», on retrouve la grosse atmo à la gaga, la friture électro. Alan crie I see it dans l’enfer du beat urbain. On adore le gospel des machines selon Vega. Lui et Jourgensen sont les seuls qu’on tolère ici bas. Il enchaîne avec le groove des catacombes, «Station Station» et revient au punk psychotique avec «Psychopatha», monstrueux de provok amerlok dans une ambiance malsaine. Il grille sa voix dans l’enfer du mythe. Avec «Crime Street Cree», on poursuit la traversée de l’immense continent tordu d’Alan Vega. Toute la pulsion du monde malade est dans ce cut qui suinte d’une bile atroce. Dans «Traceman», on sent le prophète perdu dans le désert. Alan Vega est une sorte de Jeffrey Lee Pierce errant au milieu de gros beats africains sur-dimensionnés. Il sait lui aussi aller dans l’abattage et nous défoncer le crâne avec des coups mécaniques. «Gun Gone Gam» est un fabuleux ferraillage. Alan Vega ne s’arrête jamais d’innover. Il fait gicler les énergies urbaines de l’électro. Il est à la fois obsédant et fracassant. «13 Crosses 16 Blazin Skulls» nous plonge une fois de plus dans un univers en écho. Alan Vega construit un cut comme Godard construit un film : avec des champs et des contre-champs, des cadres sublimes et des fragments littéraires. Voilà comment on pourrait définir le génie d’Alan Vega. Avec «SS Eyes», il swingue le beat comme s’il avait 20 ans. Comme Raymond Radiguet, ce mec a le diable au corps et rien de ce qu’il entreprend n’est gratuit. Son beat vaut tout l’or du monde. «Warrior Fight For Ya Life» renoue avec l’énergie fondamentale excédentaire du produit extérieur brut de la brutalité concomitante. Comme le beat fait du sur-place, il finit par terrifier. Dans «Devastated», Alan Vega appelle à l’aide - ah-aaaah - il est devastated, alors le beat l’enfonce dans la défonce, il n’en sortira pas vivant, mais il s’en moque éperdument, puisqu’il n’est rien d’autre qu’un génie déjà purulent. Il survivra planqué dans les interstices jusqu’à la fin des temps. Ah-aaaah !
Signé : Cazengler, le végâteux
Suicide. La Gaîté Lyrique. Paris IIIe. 8 juillet 2013
Suicide. Suicide. Red Star Records 1977
Suicide. Alan Vega And Martin Rev. Mute/ZE 1980
Suicide. A Way Of Life. Wax Trax! 1988
Suicide. Why Be Blue. Brake Out Records 1992
Suicide. American Supreme. Mute 2002
Alan Vega. Alan Vega. Celluloid 1980
Alan Vega. Collision Drive. Celluloid 1981
Alan Vega. Saturn Trip. Elektra 1983
Alan Vega. Just A Million Dreams. Elektra 1985
Alan Vega. Deuce Avenue. Musidisc 1990
Alan Vega. Power On To Zero Hour. Musidisc 1991
Alan Vega. New Raceon. Musidisc 1993
Alan Vega. Dujang Prang. Musidisc 1995
Alan Vega, Alex Chilton & Ben Vaughn. Cubist Blues. Thirsty Ear 1996
Alan Vega. Getchertiktz. Sooj Records 1996
Alan Vega. 2007. Saturn Strip 1999
Alan Vega. Station. Blast First 2007
TOUS EN SEINE
CHARTRETTES / 11 – 10 – 2014
NATURAL RESPECT / NAHKT
NEXT FLOOR / KLAUSTROPHOBIA
L'on ne peut jamais être tranquille dans cette vie. Toujours des questions insidieuses qui vous turlupinent et qui ne vous laissent aucun repos tant que vous n'avez pas trouvé la réponse. Exemple : mais à quelles étranges activités se livre Ady quand elle ne vient pas interpréter Queen of Rock And Roll au Glasgow, à Fontainebleau ( voir KR'TNT ! 201 du 19 – 09 – 2014 ) avec les Jallies ? La réponse est facile : elle organise le Tremplin Des Musiques Actuelles « Tous en Seine » à Chartrettes. Oui, mais comment fait-on pour arriver à Chartrettes ? Très difficile. Comptez sur le hasard, la chance et un coup de pouce du destin et des anciens Dieux de l'Olympe qui vous prennent en pitié. Sans quoi vous n'y parviendrez jamais.
La teuf-teuf mobile et moi avons traversé des contrées désertiques, d'interminables rues étroites de plusieurs kilomètres de long bordées de maisons aux fenêtres desquelles ne brille aucune lumière. Nous sommes bien en Seine & Marne, mais l'on éprouve la sensation d'être en route transylvanienne vers le château maudit du Comte Dracula. Pas âme qui vive, j'ai l'impression d'être le dernier survivant de l'humanité. Situation critique, mais pas déplaisante au fond, je suis désormais sans rival, et maître incontesté du monde. Et paf ! Mon rêve s'écroule au dernier tournant, brutalement le village fantomatique se peuple de juvéniles silhouettes rassurantes, toute une jeunesse qui se presse vers les marches d'escalier qui donnent accès L'Espace Multiculturel de Chartrettes. Deux cents jeunes gens miraculeusement sortis de je sais où.
Attention, l'on ne rentre pas comme dans un moulin, c'est gratuit mais chacun des futurs spectateurs se voit remettre un ticket extrêmement important. C'est un tremplin et le public est ainsi muni de son prochain bulletin de vote. Un véritable sésame démocratique. Avec effet immédiat. L'on nous demande souvent notre avis dans notre société, pour n'en tenir jamais compte, mais là apparemment il en serait autrement. Y a tout de même un jury de quatre personnes, une musicienne, un conseiller municipal de la commune, une représentant de la jeunesse et un membre du service culturel organisateur. Z'ont intérêt à avoir une bonne paire d'oreilles !
La salle est toute belle, vaste, haute, avec poutres modernes apparentes – gigantesques porte-manteaux de bois clair - et une véritable scène avec coulisses et régie son... La fête peut commencer dès la fin du speech d'introduction d'Ady, qui s'en tire comme une chef.
THE NEXTFLOOR

N'ont pas la partie la plus facile. Débutent à froid. Intérêt à être dedans dès la première note. Cueillir le public avant de laisser le doute l'effeuiller. Faut le captiver en une seconde et le garder prisonnier durant le temps réglementaire. Pas de montre en main, mais pas plus d'une demi-heure. Superbement mis en place. Yvan bondit et s'empare du micro, alors que les trois autres ouvrent les écluses du déluge sonore. N'a pas dit un mot que déjà tout est dit. Rock and roll attitude. Ne se positionne pas face au public. Mais s'accroupit de profil au pied du podium de la batterie. Pratiquement pas un geste. Immobilité du chant. Quelques secondes, et puis change de place, comme s'il était maintenant le reflet d'un miroir qui n'existe pas. Des plans fixes qui suivent les saccades musicales. Chorégraphie pour un seul danseur. Ballet d'unicité. Peu de choses, mais qui contiennent tout un monde. Nous tendent une image. Changeante. Que l'on n'a pas le temps de décrypter. Comme ces petites mèches de cheveux si pointues qu'elles semblent être nées du hasard d'un coup de peigne mais qui induisent l'idée d'une dimension diabolique. Chez Nextfloor l'on préfère suggérer qu'annoncer.

Un léger défaut tout de même. Ces poses deviennent trop répétitives. Heureusement que derrière la musique emporte l'adhésion, car les nettes icônes du début du set trop souvent répétées finissent par perdre leur impact quasi onirique. L'est sûr que cette espèce de théâtralisation ne doit pas être abandonnée, mais il faut l'empêcher de dégénérer en gimmick. L'est nécessaire de renvoyer sans arrêt l'ascenseur au palier supérieur.
Ca marque les esprits car toute une partie des spectateurs quittent le devant de la scène... pour glisser rapidement leur bulletin dans l'urne transparente disposée sur une table au fond de la salle. Reviennent au plus vite, leur devoir électoral accompli. En attendant Nextfloor n'est pas resté coincé entre deux étages. Sur sa batterie Quentin se démultiplie. Frappe de tous côtés afin que la guitare grondante de Guillaume n'apparaisse point trop survitaminée. Passe pas ses riffs en douce, ni vu, ni connu. Plutôt salut à bon entendu. Du rock qui clique et qui vous requinque. Galvanisé métal mais avec rythmique encore typiquement rock and roll. Luisant et appétissant. Beaucoup de cohérence, dans la structuration des morceaux et la manière de les déployer sur scène. Savent soigner les articulations. Très rapide et en même temps très syncopé. Un très bon groupe. Sont les premiers à passer mais pour le moment je leur accorde mon intention de vote. Aux suivants de me faire changer d'avis.
( photos de répétition )
NAHKT

Ne venez pas faire assaut d'ignorance pendant qu'ils s'installent. Tout le monde sait depuis les découvertes de Champollion que Nakht signifie « Puissance » selon l'ancienne écriture hiéroglyphique. Est-ce pour cela qu'ils posent deux énormes piédestal de bois sur le devant de la scène comme pierres symboliques de la pyramide musicale qu'ils veulent gravir ? Bref avec un nom aussi présomptueux, faut assurer. Tâche d'autant plus redoutable qu'il s'agit de leur première apparition publique.
Six sur scène mais l'on n'en voit que deux. Les deux chanteurs debout et impassibles devant leurs boîtes noires. Les autres sont autour, en position un peu satellitaire. N'envisagez pas des comparses de deuxième zone. Basse, guitares, batterie. Se chargent de la musique. Denrée relativement importante dans un groupe de rock. Si vous pensez que les guitares vont empiler les riffs les uns sur les autres et que la batterie va les aligner à grands coups de massue pour que chacun reste sagement à sa place et ne relève pas trop la tête qui risquerait de dépasser, vous êtes dans le rouge. Erreur absolue. Veux bien être conciliant, peut-être en fut-il ainsi les deux premières minutes, mais après c'est devenu beaucoup plus angoissant. Le son s'est vite transmué en une étrange purée. Ni d'avoine, ni de pommes de terre. Non, de l'orichalque pur, cet étrange métal dont d'après Luc-Olivier d'Algange étaient constitués les remparts de l'Atlantis mythique. Une espèce d'alliage sonore inconnu, d'une flexibilité à toute épreuve, qui s'insinue dans vos oreilles sans que vous y preniez gare – je vous jure que pourtant ils jouent très fort, ou du moins aussi fort que le permet la sono locale – et qui s'empare de vos centres nerveux sans que vous puissiez vous y opposer. Le résultat ne se fait pas attendre. La moitié de la salle se met à pogoter comme des derviches tourneurs piqués pae la plus effroyable des tarentules. Une ambiance de fous en liberté, échappés pour toujours de l'asile.

Voudrais pas vous effrayer. Reste les deux chanteurs Thug et Danny. Ne chantent pas. Ils déglutissent, ils expectorent, ils éjaculent, hors de leurs infects et infâmes gosier, d'immondes serpents venimeux qui s'enroulent autour de vos synapses cervicales et les déroutent de leurs trajectoires mentales habituelles. Des aliens qui s'en viennent élire domicile dans cette matière blanche censée contenir votre intelligence qui désormais ne répond plus à vos injonctions. La puissance de Nakht n'est pas un vain mot, mais un talisman de grande opérativité maléfique. Le rock comme on l'aime. Qui vous transforme en zombie rythmique secoué de tremblements parkinsonniens des plus aberrants. Ne vous laissent pas une seconde de répit. A peine l'un se mue-t-il en un silence époustouflant que l'autre reprend l'antienne terrifiante. Ou alors pendant que le plus grand aux bras tatoués d'incisifs symboles vous invective, le second meugle d'obscures litanies dont il vaut mieux ne pas saisir le sens.
Du métal. Du hardcore metal. Du death hardcore metal. Toutes les étiquettes que vous voulez. Mais un grand groupe. Allaité aux sombres mamelles des fils du kaos fractal, ce qui en français courant se traduit par adeptes du bordel généralisé. Immenses ovations. J'ai oublié que j'étais prêt à voter pour le groupe précédent.
NATURAL RESPECT

Je préviens tout de suite. Je n'aime ni le reggae ni le rap. Autant dire que j'ai quelques préventions contre cette sorte de groupe. Avec tout le respect naturel que je leur dois, cela s'entend. A priori, je serais même plutôt en phase avec les mots d'ordre qu'ils ont écrit au feutre sur une grande feuille de papier : Ni Dieu, Ni Maître, un slogan qui fleure bon l'anarchie, et leur Pas de Futur sans Culture me semble une reviviscence anti-nihiliste et intelligente du No Future punk, quant à la dénonciation de l'éducation scolaire sclérosante dont est victime la jeunesse d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas être d'accord.
Côté entrée en matière, le guitariste tout seul qui se plaint des absents qui entrent peu à peu et un par un, c'est un peu raté. Se débrouille pas mal d'ailleurs sur sa guitare, un jeu très funk, haché menu qui impose le rythme de base au son du groupe. Tristan à la batterie et Clément à la batterie ne font que suivre le mouvement. La loi du groove. Ce pourrait être monotone, mais Nail intervient souvent à la trompette. Ca ne remplace pas une section de cuivres mais ça pigmente et ça pimente le hachis bio végétal. Alex est au chant, et partout à la fois. Farandole micro en main et les dreads au vent entre les musiciens. Sa voix est en première ligne, à mi chemin entre des inflexions rap et des lignes mélodiques typiquement reggae.

N'empêche que malgré leurs inspirations post-modernes, ressemblent un peu à ces groupes hippies des fumeuses années soixante-dix, un petit côté prêche militant d'un autre âge, et goût underground de la revendication festive. Même leur camionnette antédiluvienne, peinturlurée à leur nom, stationnée devant l'entrée semble sortir de ce passé post-préhistorique du rock français. Subjuguent le public, puisque dans son immense majorité il consent à la première demande à venir s'asseoir devant la scène. Devant tant d'engouement je me demande s'ils ne vont pas récolter une marée de bulletins à leur nom. Je le crains.
Ne cachent pas leur drapeau dans leur poche, chanson sans concession contre le Front National qui passe comme une lettre à la poste. L'existe donc encore des rebelles qui ne mordent point à pleines dents dans les doucereuses et nocives tartines empoisonnées du populisme. Le fachisme d'obédience nationale n'est que le miroir aux alouettes que le capitalisme apatride tend aux pauvres – d'argent et d'esprit - pour mieux les engluer dans leurs colères vouées à leurs propres impasses. Applaudissements. S'en tirent avec les honneurs de la guerre. Je ne voterai pas pour eux. Vous vous en doutiez. Pas assez rock and roll. A mon humble avis. Le seul que j'écoute.
KLAUSTROPHOBIA

S'installent doucement. Quatre garçons qui s'empressent autour de leurs instruments et une jeune fille qui erre sur le plateau, toute mince dans son T-shirt à tête de mort. L'a l'air de mourir de trac. L'on aurait envie de la consoler et de lui dire que ce n'est qu'un bon moment à passer. Mais ce n'est pas la peine. Les boys n'ont pas lancé la machine depuis trente secondes que subitement elle se transforme en bête de scène. L'on ne voit plus qu'elle. Attire tous les regards. Pourtant les guys font tout ce qu'il faut pour qu'on les remarque. Jouent fort, si fort que le chant de Yuki est parfois mangé par la pâte sonore qu'ils nous servent à grande pelletée. Sur leur facebook, ils se définissent comme un metal band. N'en sont pas loin, mais logent encore plus près des racines très rock. Genre, j'envoie l'électricité puis je vous électrocute. Sans discute. Ni rémission. Ne vous laissent pas moisir dans votre coin. Bougent pas mal. Le guitariste n'en finit pas de se percher sur la plateforme de la batterie sur laquelle Thomas se défonce à mort. Dernier concert pour lui. La vie l'appelle ailleurs. C'est l'inconvénient d'être jeune.

L'avantage aussi. Car vous êtes muni d'une incroyable énergie. Tout comme Yuki, ce petit bout de fille. Un peu maigrelette selon les canons de la beauté de la Renaissance, mais si bien dans sa peau et son corps qu'elle vous subjugue et que vous ne pouvez quitter des yeux ses ardences de feu follet. Quelques secondes de danse lascive auprès d'un des guitaristes et c'est l'envolée, plane littéralement à trente centimètres au-dessus de la scène, emportée dans son propre tourbillon. Vous paraît enlevée dans un délire personnel, une transe égotiste indépendante, mais non elle s'arrête à la fraction de seconde près, à chaque brisure de rythme initiée par l'orchestre. Maîtrise beaucoup plus que l'on pourrait croire. Ne perd pas le nord musical. L'a de ces façons péremptoires de lever le bras qui sont autant d'appel à émettre encore plus de rage et l'orchestre se dépêche de rajouter une couche de speed.
Danse et chante. N'arrête pas de donner de la voix. Lyrics sans fins. Vient de pousser à fond, on lui accorderait quelques secondes de répit, le temps de reprendre souffle, mais elle est déjà engagée en un autre couplet. Plus vite et plus fort. Sans effort, avec aisance. Elle est la flamme vive qui vole sur le bûcher incandescent. Malgré son nom Klaustrophobia ne rabat pas sur vous le couvercle de vos impuissances. Vous communique une force à briser toutes les clôtures psychologiques qui limitent dangereusement votre existence. Je leur accorderais bien mon vote. Mais je suis homme à savoir résister au chant voluptueux et siréen de la gent femelle.
( photos concert Flèche d'or )
INSTANT DECISIF
Faut attendre le dépouillement. L'orga a prévu, un précieux passe-temps. Le groupe de Seine & Marne qui monte. Ne vous emballez pas. Ce n'est pas du rock. Même pas du reggae à funk les manettes. Non Minuit 6 Heures donne dans la chanson française. Un peu revisitée. Certes. Un bon chanteur, un noir à la belle voix dans un costume de pirate, et trois petits blancs par derrière qui accompagnent. Après le déchaînement des quatre groupes précédents, entendre le batteur pépère tapoter son rythme de valse relève de l'incongruité. Toute une frange du public ne partage pas mon avis. Moi j'aurais préféré que l'on passe une bande d'un groupe de rock connu à la place. J'endure stoïquement toute une longue demi-heure jusqu'à ce que Ady reprenne le micro.
Sait faire durer le suspense ! Sont tous montés sur scène derrière elle. Que de monde ! Sont beaux et jeunes mais on les sent tendus et impatients de connaître le résultat. Nous aussi. Le prix est intéressant pour un jeune groupe : ou un enregistrement de quatre morceaux, ou une résidence dans un studio d'enregistrement et structure de spectacle de Melun. Ady débite la litanie des remerciements usuels. En vient enfin au coeur du sujet. Joué dans un mouchoir de poche. Veux bien le croire. Je n'ai pas hésité pour inscrire mon choix, mais je reconnais qu'au moins trois des quatre combos se sont mieux que bien battus.
NAHKT !!!
Sort enfin le nom des vainqueurs. NAHKT !!! Pour une fois que mes contemporains s'alignent sur mes positions, je ne boude pas mon plaisir. Pour une première apparition publique, c'est un signe de grande classe. Faut voir comme les Nahkt sont contents. Recueillent les acclamations du public et de leurs malheureux concurrents avec joie mais sans ostentation.
C'est fini. Ady redonne le micro à Minuit 6 Heures pour un dernier quart d'heure de prestation. Félicite Nahkt et distribue les bises avant de m'éloigner alors que Minuit Six Heures entonnent Vesoul de Jacques Brel. Courage, fuyons !
Sûr que l'on va garder un oeil sur Nahkt, le groupe qui a la niaque.
Damie Chad.
JUKEBOX N° 335
NOVEMBRE 2014

Suffit parfois de quelques pages pour sauver le numéro d'un magazine. Après plus de trente ans de bons et loyaux services à l'encyclopédisme rock Jukebox s'essouffle quelque peu. La rubrique Ces Disques Ont Une Histoire... sent un peu le remplissage. Beatles, Sylvie Vartan et Trini Lopez en couverture, beaucoup de monde pour se remémorer le passage des Fab Four à l'Olympia, sujet un peu rebattu. La surprise vient d'ailleurs : de Tony Marlow qui nous offre un article fouillé sur les guitaristes de Bill Haley.

DANNY CEDRONE & FRANNY BEECHER
Tony continue donc sa série sur les grands guitaristes du rock. Bill Haley, le pionnier à la mauvaise cote. L'a été remplacé dans le coeur des fans par Carl Perkins et Johnny Burnette qui à l'époque étaient – à tort – considérés comme des seconds couteaux. Il y a quarante ans à peine avait-on prononcé le mot rock and roll que le nom de Bill Haley revenait systématiquement sur le tapis. Rouge. Qui s'est bien fané depuis. Ce n'est pas un hasard, certes la musique de Bill Haley est beaucoup plus proche du swing et beaucoup moins électrifiée que celle de ses pairs, mais elle n'en reste pas moins du pur rock'n'roll. C'est aussi vrai que les studios Sun sont entretemps devenus la Mecque fondatrice du rock'n'roll, grâce à une documentation de plus en plus accessible. Cette mise en première ligne de Sam Phillips n'est pas non plus étrangère à un gommage idéologique de toute une partie du milieu rock qui a privilégié les origines blanches du old rock pour mieux faire oublier le sang noir qui irrigue ses veines. Mais par chez nous, dès l'apparition de Bill Haley on en a rajouté une couche spéciale franchouillarde due à la ringardise des milieux musicaux qui ont accueilli à sa naissance l'oeuvre du leader des Comets. Tony Marlow ne mâche pas ses mots à l'encontre de Boris Vian qui a oeuvré tout au long de sa vie pour ridiculiser cette nouvelle musique qui venait bouleverser son plan de carrière. L'a rejetée du côté du burlesque agissant à son encontre comme les artistes de music-hall blancs d'Amérique avaient fait face à l'intrusion des musiciens et des chanteurs noirs au début du siècle précédent en instituant le genre parodique des Black Faces. Que les noirs surent s'approprier en une sorte de surenchère au second degré. Mais cela nous entraînerait trop loin.

Danny Cedrone fut le créateur du solo de guitare de Rock Around The Clock dont les notes acidulées et imparables mirent le feu au monde entier. Pour l'anecdote il se contenta de replacer, d'une manière un peu plus fluide, le solo qu'il avait créé pour Rock The Joint. L'avenir s'ouvrait à lui. Ce que Charlie Christian avait réalisé pour la guitare électrique jazz, et T-Bone Walker pour la guitare électrique blues, Dany Cedrone le concrétisait pour la guitare rock. Rock Aroud The Clock est enregistré le sept juin 1954, dix jours plus tard, le dix-sept juin, la pendule du rock and roll sonne la mauvaise heure, Cedrone se tue stupidement en descendant un escalier. Sic transit gloria mundi.

Pas le temps de s'attarder. Bill Haley est à la porte du succès, lui faut recruter en vitesse un guitariste capable de remplacer le malheureux Danny Cedrone. Ce sera Franny Beecher, joue du country mais provient du jazz. Travailla avec Benny Goodman et se laissa influencer par Django Reinhardt. Ses doigts agiles n'auront pas de mal à marcher sur les traces de Danny Cedrone. On ne change pas un riff qui gagne. Dans les mois qui suivent Franny qui a compris ce que veut exactement le gros Bill l'aidera à mettre en boîte quelques uns des classiques du rock tels Birth Of The Boogie ou Razzle Dazzle. Concerts, enregistrements, Franny est de tous les plans, mais sa femme ( tout comme celle de Cliff Gallup ) le désire plus souvent à la maison. Au début des années 60, il décroche de son statut de pro à plein temps. Jouera très vite en semi-pro autour de chez lui avant de participer à la reformation des Comets en 1987 jusqu'en 2008.
Nous a quittés en ce début d'année 2014. Sa disparition aura fait de moins bruit que sa guitare. Merci à Tony Marlow pour ce magnifique hommage à ses trois grands pionniers. Un bel article fourmillant de renseignements et toujours ce beau style d'une précision absolu. Rien ne vaut un guitariste pour parler de guitaristes.

Tony Marlow sera en concert ce vendredi 17 octobre 2014 à Lagny-Sur-Marne au local des Loners. A ne pas manquer.
Damie Chad.
PUNK SUR LA VILLE !
LE PREMIER FESTIVAL PUNK DE L'HISTOIRE
MONT DE MARSAN 1976 / 1977
ALAIN GARDINIER
( ATLANTICA 2014 / Mai 2014 )

Z'ont calculé le format au centimètre près. Celui d'un vinyl, trente-trois ( je vous fais grâce du dernier tiers ) tours. Comme un vieux disque des Sex Pistols ou des Damned, et pourquoi pas de Bijou et de Little Bob, après tout nous sommes en France et pour une fois que le rock français a devancé les grands-frères ricains et rosbeefs, l'on ne va pas s'en priver. Un bel objet, à la couverture un peu trop souple et difficile à ranger dans la bibliothèque. Les esprits chagrins diront qu'il fait un peu double emploi avec Le Massacre des Bébés Skaï / Punk Rock Festival Mont de Marsan 1976 / 1977 de Thierry Saltet publié chez Julie Editions en novembre 2013 ( voir KR'TNT ! 177 du 20 – 02 – 2014 ) et qui vient d'être réédité cette semaine ! Toutefois nous noterons qu'abondance de biens ne nuit pas. Oui, c'est exactement la même histoire mais les rockers sont comme les petits enfants, z'aiment bien entendre répéter et encore répéter les hauts faits glorieux qui ont marqué le déploiement de leur musique.

Alain Gardinier – un homme crédité pour la pochette d'un disque de Screamin' Jay Hawkins ne saurait être tout à fait mauvais, aurait même tendance à attirer le respect – n'est pas un nouveau venu dans le paysage rock. A refilé des photos à la moitié des magazines intéressants du pays, a chroniqué une foultitude d'évènements rock, a bossé sur Canal +, est devenu le spécialiste incontesté du surf, a monté une maison de production de films, bref un curriculum qui vous vide une cartouche d'imprimante à lui tout seul... L'a tout de même raté un truc important dans sa vie : n'était pas présent au premier Festival Punk de Mont de Marsan. Moi aussi. Mais lui, il s'est rattrapé, l'était au second. Pas moi. Bref un mec passionné toujours pendu aux basques de l'actualité rock, ce qui est normal puisqu'il est basque. D'où cette publication chez Atlantica, maison d'éditions régionale à l'affût des traditions locales, perdues, retrouvées, nouvelles ( surf, tauromachie, chasse à la baleine, pelote, pottocks ) de ce Sud-Ouest appuyé sur les Pyrénées et bordé par le littoral atlantique.
IMPRO
Un groupe de copains qui n'ont même pas vingt ans dans une petite ville de province que la plupart de nos concitoyens seraient bien embêtés de localiser sur une carte qui décident sur un coup de tête de préparer un festival. Z'étaient au café, auraient pu demander une troisième tournée de bières, mais non, ce sera un festival rock. Tant qu'à se faire mousser autant viser haut. Ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils ont déjà organisé quelques concerts qui ont bien marché, mais subitement sans s'en rendre compte ils viennent de changer d'échelle. Comme l'un d'eux monte quelquefois à Paris s'approvisionner en disques à Paris dans la boutique de disques L'Open Market, il en cause deux mots au patron, Marc Zermati, aussi fondateur de Skydog... C'était la bonne porte et le bon deal. Connaît du monde à Londres et est à l'affût et à la pointe de ce qui se fait de neuf en rock.

De neuf peut-être pas. Mais de ce qui bouge. Le rock s'est endormi. Les grands groupes ronronnent. Se reposent sur le tiroir caisse. Aussi ennuyeux à regarder qu'un troupeau de brontosaures occupés à ingurgiter leurs quinze tonnes de graminées journalières. Pour Zermati, les mots d'ordre sont simples, retour à l'énergie primitive ! Rock'n'roll toute ! L'a même une idée de génie. L'invente un truc encore pire que le rock. Le mot existe depuis toujours, on l'emploie de plus en plus souvent à New York et in London, mais parmi d'autres, l'aurait pu passer à la trappe, mais Zermati a du pif. Plus de rock – plus ou moins rentré, sinon dans les moeurs, du moins dans le vocabulaire - désormais ce sera le punk ! Difficile de trouver plus crétinisant. La revendication au degré zéro du moins disant culturel. Les rockers étaient des voyous, cela fait peur, les punks fleurent mauvais comme une promesse d' analphabétisme. Cela vous déstabilise. L'esprit positiviste bourgeois en vacille sur lui-même. Miné de l'intérieur.
Ce n'était pas le moment idoine. L'esprit gauchiste mis à mort par l'élection de Giscard à la présidence de la République survivait encore. Se focalisait sur un dernier point de résistance. Un seul, mais très rock and roll. Concerts gratuits, passages en force, jolis grabuges. Les préfets s'affolaient et jetaient de l'huile sur le feu en envoyant les CRS. Cela dégénérait systématiquement en affrontements violents si bien que tous les festivals de l'été 1976 furent, les uns après les autres, interdits. Partout.
MONT DE MARSAN I
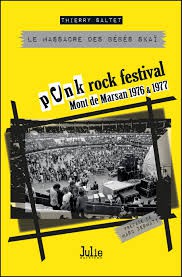
Sauf à Mont de Marsan. Petite ville de province où tout le monde se connaît. Faut savoir ruser. Dans les tractations avec la mairie l'on parle de festival de jazz et de pop. Et avec les flics, l'on sort le grand jeu. Rangez vos soldats de plomb, notre propre service d'ordre s'occupera de tout. Pari gagné. Par chance il n'y aura pas des milliers de participants. Point d'habits bleutés dans le proche horizon, tout se déroulera à merveille. Pour le programme vous vous reportez à notre livraison 177, ou alors vous achetez le bouquin, c'est rempli de photos et l'on vous explique tout en long et en large, avec photocopies des courriers officiels et petits topos sur les groupes.
MONT DE MARSAN II

Celui-là Gardinier y assiste. S'implique davantage dans le compte-rendu. Ce coup-ci, l'on avance à visages découverts. En 1976, le punk était un futur en marche, en 1977, c'est une présence indiscutable. Pour parodier Cavafy, on peut dire que l'on n'attend plus les barbares. Campent désormais sur la place centrale de l'actualité. A Mont de Marsan, l'on est bien embêtés, tout s'est si bien passé l'année dernière qu'il est difficile de promulguer un droit de veto. Des chevelus, des crêtus ( très rares ) qui ont écouté de la mauvaise musique très fort, mais dans l'ensemble, le petit commerce a fait son beurre. Donnée économique de poids. Alors comme l'on attend beaucoup plus de spectateurs et davantage de groupes, chacun fait ses comptes.

La police n'a pas dit son dernier mot. Lui reste son as de pique à jouer. Une belle facture pour les policiers de l'année précédente qui ont été affectés à la surveillance du festival. Beau coup de vice. D'abord ils n'étaient pas là, ensuite c'est à régler tout de suite, sinon la fête n'aura pas lieu. Faudra passer sous les fourches caudines de l'injustice. Quand l'Etat se prend pour Léviathan vous avez intérêt à payer tous les pots que vous n'avez pas cassés. Apporteront la moitié de la somme en promettant de faire l'appoint avec les bénéfices...

Qu'importe, Mont de Marsan II sera une aussi belle réussite que le premier. Pour la programmation vous vous reportez à notre livraison 177, ou alors vous volez le bouquin. Ce serait un très beau geste d'une exquise punkitude. Pour le Mont de Marsan III, il est inutile de prendre les billets. A l'impossible nul n'est tenu. Ne faut pas non plus prendre les autorités pour ce qu'elles sont. Jurèrent très tôt que désormais on ne les y reprendrait plus. Et elles tinrent parole.
PLUS TARD

Un changement de majorité présidentielle et municipale plus tard le festival renaquit de ses cendres en 1984, en 1985, en 1986. Et puis plus rien. Le punk n'a pas survécu à sa naissance. En 1978, il n'existe plus. On vous vend la New Vague, mais sur les rayonnages le punk est dans les boîtes en soldes. On n'aura plus l'énergie pour remettre le couvert à ce qui est en train de devenir un événement mondain. Organisateurs, groupes et spectateurs ont poursuivi leur chemin. Pas toujours facile de rester fidèles à ses idéaux. Le seul qui vous trahisse vraiment, c'est vous-même. Pour une fois le poison punk n'a pas pourri par la tête. C'est surtout le public qui s'est amoindri et dilué. Le livre se termine sur l'évocation des principaux protagonistes de cette aventure incroyable. N'ont pas fondamentalement divergé de leurs choix initiaux et énergies premières. Reste à écrire le post scriptum. Que l'on ajoute en bas de page pour signaler que l'on n'a pas oublié le plus important.
L'ARMEE DES OMBRES
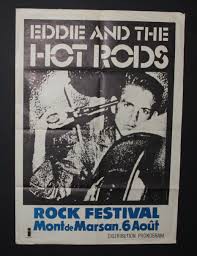
Celle des anonymes. Qui ont fourni le gros des bataillons du mouvement. Qui ne se sont pas vendus. Peut-être parce qu'ils n'avaient rien à vendre. Ou peut-être encore pire, parce que personne n'a voulu les acheter. Et les punkers ont fait comme les rockers. Ont subsisté. Par petits groupes. Sans cesse renouvelés. Ne sont plus qu'une minorité. Mais active. On les dénigre toujours et encore. On ne les appelle plus que par l'infamante dénomination de punks à chiens. Pas tout à fait des SDF, mais des nomades urbains, qui vivent dans les marges, qui squattent les sorties de secours d'une société en train de s'engluer dans ses propres immondices. La comète punk remue encore la queue mais tout le monde détourne le regard. Punk Sur La Ville est un beau livre. Mais il se termine trop tôt. L'urgence n'est pas à la remémoration des années fastes. L'étude des écorces mortes du passé n'est intéressante que si elle permet d'agir sur la présence du monde. Les punks comme les sentinelles du désastre qui vient. Peuvent hurler tant qu'ils veulent dans leur micros ou dans leurs mains en porte-voix. Personne ne veut les entendre. La caravane passe, file droit vers le précipice, les punks à chiens aboient.
Damie Chad.
14:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suicide, nextfloor, nakht, natural respect, klaustrophobia, bill haley, mont de marsan


