05/02/2020
KR'TNT ! 450 : GENE VINCENT / SLEEPY LABEEF / LEE FIELDS / CARIBOU BÂTARD / DYE CRAP / JOHNNY MAFIA / NOT SCIENTISTS / A CONTRA BLUES / POP MUSIQUES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 450
A ROCKLIT PRODUCTION
06 / 02 / 2020
|
GENE VINCENT / SLEEPY LABEEF / LEE FIELDS CARIBOU BÂTARD / DYE CRAP / JOHNNY MAFIA NOT SCIENTISTS / A CONTRA BLUES / POP MUSIQUES |
TEXTES + PHOTOS : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Il Gene en hiver
Vous avez déjà entendu parler de Luke Haines, plus connu sous le nom de Luke la Main Froide. Il fit jadis la une de l’actualité avec une tripotée d’albums dont ceux des Auteurs et deux romans que tout fan de rock anglais doit se faire un devoir de lire, Bad Vibes/Britpop And My Part In Its Downfall et Post Everything/Outsider Rock And Roll.
Mais nous sommes là aujourd’hui pour une autre raison : ses chroniques dans Record Collector qui, chaque mois, lui accorde généreusement une page. Oh, ce n’est pas grand chose, mais c’est souvent très intéressant. On lui doit de brillantes chroniques consacrées aux Pink Fairies, à Robert Calvert, ou encore à Steve Peregrin Took. Ce mois-ci, il consacre sa chronique à Gene Vincent et plus précisément à un petit film documentaire réalisé en 1970 qu’on peut aller voir sur YouTube, The Rock And Roll Singer. Quatre jours de tournage. Gene était alors de retour en Angleterre pour la promo de son album I’m Back And I’m Proud. Il avait 34 ans. Attention, ce film sans prétention est extrêmement émouvant. On y voit une ancienne star du rock nommée Gene Vincent qui tente de faire son retour.
Luke la Main Froide n’y va pas de main morte : «Si vous êtes une rock star et qu’une équipe de télé vous a suivi pendant quelques jours, ça veut dire que votre carrière a été balancée au vide-ordures. Soit on va vous sortir du trash, soit vous êtes carrément le trash. Le docu rock n’est pas fait pour sauver une carrière.» Il fait ensuite la distinction entre deux genres de docus rock : ceux consacrés aux gens qui vont bien et qui n’intéressent personne, et ceux consacrés à ceux qui vont mal et qui vont mourir, et là bingo, coco !
Quand il débarque à l’aéroport, Gene est content : des Teds viennent l’accueillir et lui demander des autographes. Mais on sent tout de suite qu’il y a un problème, déjà en 1969 : Gene est passé de mode. Luke Haines : «Eugene Craddock was too much for rock». Ça, tous les fans de Gene Vincent le savent. Mais Haines va encore plus loin quand il suggère que le rock aurait pu s’arrêter à «Be-Bop-A-Lula». Car c’est après Be-Bop que commence son déclin. Haines rappelle brièvement l’accident de Chippeham où Eddie Cochran perdit la vie : «By now, Gene Vincent was a dead man barely walking and an almost living legend». C’est ce mec-là, un mort vivant et en même temps une légende vivante qu’on voit débarquer à Heathrow et aller répéter avec les Wild Angels dans une cave de Croydon.
Lucky Luke rappelle que Gene est complètement fauché quand il décide de repartir en tournée en Angleterre. Il doit du blé aux impôts. Il est accro aux anti-douleurs et siffle trois bouteilles de Martini par jour. Selon Luke la Main Froide, The Rock And Roll Singer is the greatest rock documentary ever made. Oui, le plus grand docu rock jamais réalisé, simplement parce que, dit-il, on y voit the greatest rock singer who ever lived, et que c’est du cinéma vérité, filmé dans l’instant. Gene, nous rappelle Haines, ne vivait que dans l’instant.
On le voit boiter et s’arrêter pour répondre à des questions :
— Pourquoi ce retour en Angleterre ?
— I’ve got a new album out.
Il est affable et il est rincé. Haines le décrit comme «un Ratso Rizzo qui a grossi, une icône brisée qui boitille dans les couloirs et qui disparaît, avalé par les portes de l’oubli, en trimballant un pauvre étui à guitare». On retrouve Gene plus loin dans l’un des pires endroits d’Angleterre, nous dit Haines, le Dukes B&B. Une fois de plus, Gene se fait enculer par le promoteur, mais ce n’est pas si grave, vu qu’il s’est fait enculer toute sa vie : par des promoteurs, par son ex-femme et par sa rotten luck, c’est-à-dire la poisse. Il réclame son blé, mais le mec lui dit que le blé est dans un bureau fermé jusqu’à lundi. Gene est le roi des poissards, c’est l’une des raisons pour lesquelles on s’attache à lui depuis plus de cinquante ans - Our rock’n’roll hero is somewhat melancholic - Disant cela, Haines semble se marrer, mais pas tant que ça. Il aurait plutôt envie de chialer. La poisse continue : comme il arrive en retard au studio de télé, l’émission est annulée. Alors Gene prévient qu’il va aller se soûler la gueule, puisque ces cons ont annulé le show télé. Le film s’enfonce dans une insondable tristesse.
Un journaliste lui demande :
— What are your loves and hates ?
— My loves are my wife and my dog, and my hates are the French groups. ‘Cause they never turn up.
Oui, il se plaint des groupes français qu’on attend pour des prunes avant les concerts. Ces branleurs ne viennent même pas. La caméra le filme assis à l’avant d’une bagnole qui roule dans Londres. Fantastiques images. Gene explique au chauffeur que la CIA a pris le pouvoir aux États-Unis. Le lendemain, l’émission est re-programmée. No alcohol, lui dit un responsable de Thames TV. Dans la loge, une dame lui lave les cheveux et les sèche au casque. Gene monte enfin sur scène avec les Wild Angels. Un mec annonce :
— Tonite with the Wild Angels he gives you Be-Bop-A-Lula !
Alors on voit Gene penché sur son micro, la patte folle en arrière, all dressed in black. Les gens dansent dans le studio, ça fait partie du show, comme le veut la coutume de l’époque. Gene prend sa petite voix d’hermine frelatée et susurre my baby doll/ My baby doll. Il porte un gilet de cuir noir et médaillon pendouille au bout d’une grosse chaîne passée autour de son cou. À la fin, il est content. Un vrai gamin.
Retour en loge et aux sempiternels problèmes de fric. Gene réclame son blé. Que dalle.
— Tell’ em I want my money caus’ ther’s gonna be trouble.
Il est gentil, il prévient que si on ne lui file pas son blé, ça va mal très tourner. Il va quand même jouer sur l’île de Wight. On le voit poireauter sur le ferry et poireauter encore. Il se plaint du poireau :
— This is the hard part. Waiting to rehearse, waiting to get on.
Sur scène, Gene dégringole son vieux «Say Mama». Puis «My Baby Left Me».
En fin de chronique, Haines nous rassure. Le film pourrait être très pénible, mais il ne l’est pas tant que ça, à cause dit-il du charisme de Gene Vincent (other-wordly magnetic charisma). C’est avec les extraits du set de l’île de Wight que tout finit par se remettre en place, avec un Gene singing like an angel from heaven. Après Be-Bop, les gens en veulent encore. One more ! One more ! Alors il revient EXPLOSER «Long Tall Sally». Le mot de la fin revient à cet aimable franc-tireur qu’est Luke la Main Froide :
— Commencez par visionner The Rock And Roll Singer puis écoutez sa version d’«Over The Rainbow». Et quand vous aurez séché les larmes de vos yeux, vous maudirez Dieu d’avoir autant maltraité le plus authentique de tous les chanteurs de rock’n’roll.»
Signé : Cazengler, Gene vin rouge
Gene Vincent. The Rock and Roll Singer. 1969
Luke Haines. Sweet Gene Vincent. Record Collector # 501 - January 2020
Hang on Sleepy
Peter Guralnick rencontra Sleepy LaBeef pour la première fois en 1977. Sleepy se produisait chez Alan’s Fifth Wheel Lounge, l’équivalent d’un resto routier situé à une heure de route au Nord de Boston. Ce truckstop est le genre d’endroit que les Américains appellent un honky tonk. Michael Bane : «Vous pouvez appeler ce genre d’endroit honky tonk si vous voulez. Mais dans ce genre de bar éclairé aux néons qui vend de la bière pas chère, les habitués du samedi soir se sentent chez eux. Le honky tonk est aussi américain que peut l’être la tarte aux pommes. Il est aussi profondément ancré dans notre inconscient collectif que peut l’être la pute au cœur d’or. C’est un repaire prisé par la classe ouvrière qui pourrait se situer quelque part entre le passé et l’avenir, une zone tampon entre le trash alcoolique et le désespoir. Lumières tamisées et hard country music : un bon honky tonk, c’est tout ça et même beaucoup plus encore. C’est un endroit magique où toutes les règles sont temporairement suspendues. C’est vrai, vous pouvez danser dans un honky tonk, mais c’est beaucoup plus qu’une salle de bal, vous pouvez écouter de la musique, mais c’est beaucoup plus qu’une salle de concert, vous pouvez boire au point de sombrer dans un coma éthylique, mais c’est beaucoup plus qu’un bar où on va se soûler la gueule. Un bon honky tonk, c’est l’American dream limité à de la bière, des gonzesses et de la loud music.»
Si Guralnick cite Bane, c’est pour bien situer les choses : Sleepy LaBeef se produisait à longueur d’année dans des honky tonks un peu partout aux États-Unis : au Texas, puis autour d’Atlanta, près de Boston, ou alors au Kansas ou dans le Michigan. Il vivait de ses concerts. S’il a fini par s’installer dans le Massachusetts, c’est simplement parce que son bus de tournée avait pris feu sur la route et qu’il avait perdu tout ce qu’il possédait : fringues, disques, souvenirs, tout. Alors il s’est installé dans le motel derrière l’Alan’s Fifth Wheel Lounge et devint pour trois mois le house-band du truckstop. Depuis lors, il est resté basé dans la région.
Sleepy connaissait 6 000 chansons, il lui suffisait d’en entendre une dans un jukebox et si elle lui plaisait, il la retenait dès la deuxième écoute. Aux yeux de Guralnick, Sleepy LaBeef est un artiste considérable : «En une soirée, Sleepy LaBeef pouvait donner un cours d’histoire du rock’n’roll, en allant de Jimmie Rodgers à Jimmy Reed, en passant par Woodie Guthrie, Chuck Berry, Joe Tex et Willie Nelson. Ce multi-instrumentiste pouvait jouer de la guitare avec la niaque d’Albert King. En plus de sa connaissance encyclopédique de la musique, Sleepy avait du flair, de l’originalité et de la conviction.» Sleepy cultivait une autre particularité : il ne jouait jamais deux fois le même set.
Guralnick insiste beaucoup sur le côté «force de la nature» de Sleepy qui ne mesurait pas moins de deux mètres pour 120 kilos et qui fut the only rockabilly baritone, car oui, c’est ce qui frappe le plus à l’écoute de ses disques : la puissante gravité de sa voix. Guralnick va même jusqu’à comparer Sleepy à Wolf, tant par la présence que par la stature musicale. Mais tout ceci n’était rien comparé aux moments où, nous dit Guralnick, Sleepy prenait feu sur scène, tapant dans «Worried Man Blues» ou «You Can Have Her» avec une rare violence. Il entrait paraît-il en transe.
En référence, Sleepy cite principalement Sister Rosetta Tharpe, qui fut aussi la muse de Cash et de Carl Perkins. Il cite aussi les noms de Lefty Frizzell, de Big Joe Turner et de Floyd Tillman. Mais il y en a d’autres. Quand on lui pose la question des autres, il demande de combien de temps il dispose, car la liste est longue. Et quand il entendit Elvis chanter «Blue Moon Of Kentucky» à la radio, il éprouva un choc, car il savait exactement d’où venait Elvis : de l’église. Car Sleepy avait chanté comme ça à l’église pendant des années.
Ce n’est qu’en 1968 qu’il rencontre Shelby Singleton, l’acquéreur de Sun Records et qu’il devient the last Sun recording artist. Mais c’est dix ans trop tard, même si Colin Escott voit en Sleepy le gardien de la flamme. Bad timing, disent les Anglais. Au lieu d’aller à Memphis comme le firent Jerry Lee, Roy Orbison et tous les autres, Sleepy préféra aller à Houston. Fatale erreur. Ça explique en partie qu’il ne soit jamais devenu une star, alors qu’il en avait la carrure, notamment grâce à son ‘basso profundo’. Le fait qu’il ne soit pas devenu une star tient aussi au fait qu’il n’ait pas bénéficié de l’aide d’un producteur du calibre d’Uncle Sam, ou, comme le suggère Guralnick, du calibre d’Art Rupe, le boss de Specialty, qui avait l’oreille pour le r’n’b et le gospel.
Selon Guralnick, Sleepy n’aurait jamais gagné un rond avec ses disques. Pour vivre et élever ses enfants, Sleepy fut obligé de tourner en permanence. Mais bon, pas de problème. Il le dit d’ailleurs très bien lui-même : «I never sold out. Nobody owns me. I know I’m good. I wouldn’t be honest if I didn’t tell you that.» (Je n’ai jamais vendu mon cul. Je n’appartiens à personne. Je sais que je suis bon. Je ne serais pas honnête avec toi si je ne te disais pas tout ça) (...) «Well quand j’ai débuté dans le business, je ne savais même pas qu’on pouvait y faire du blé. Et je pense que demain, je continuerai de monter sur scène, même si je ne fais pas de blé. Voilà comment je vois les choses.» Guralnick est en tous les cas convaincu que Sleepy était l’un des douze artistes les plus brillants qu’on pouvait voir sur scène aux États-Unis. Il lui consacre d’ailleurs dans Lost Highway un chapitre aussi important que ceux qu’il consacre à Elvis et Charlie Feathers. Et l’une des premières images du livre, c’est Sleepy en train de gratter sa gratte.
Les fans de Sleepy se sont tous jetés sur la belle box éditée par Bear Family, Larger Than Life. Cette box est une véritable caverne d’Ali Baba. On y trouve cinq CDs et un livret grand format aussi écœurant qu’un gros gâteau au chocolat : ça dégouline d’une crème de détails. Chacun sait que les Allemands ne font jamais les choses à moitié. Le disk 1 est sans doute le plus précieux car il rassemble tous les singles enregistrés par Sleepy entre 1955 et 1965 à Houston, Texas. On vendrait son âme au diable pour ce «Baby Let’s Play House» enregistré en 1956. Sleepy s’y montre digne de Charlie Feathers : même sens aigu du hiccup, jolis guitares claironnantes, slap in the face (Wendall Clayton), admirable déboulade - Bbbabe/ babebabe/ bum bum bum - Sacré Sleepy ! La B-side de ce premier single est un balladif atrocement efficace, «Don’t Make Me Go» : Sleepy impose sa présence aussi nettement qu’Elvis période Sun. Il enregistre aussi «I’m Through» en 1956. C’est admirable de vraie voix. L’accompagnement est un modèle de discrétion. Du biz à la Cash. On se régale à écouter chanter ce mec, même ses heavy balladifs texans passent comme des lettres à la poste. Toujours en 1956, il enregistre «All The Time» sur fond de barouf d’accords. Sleepy est le winner of the game, il allume comme un cake du ring, c’est énorme et fabuleusement hot, let’s get it now et solo de Charlie Busby, un mec qu’on peut voir en photo dans le livret, avec sa vilaine trogne et sa chemise à carreaux. Et crac, en 1957, il enregistre «I Ain’t Gonna Take It», ça slappe sous le menton, toujours Wendall Clayton, un môme de 13 ans. Sleepy amène «Little Bit More» à la folie Méricourt, il en veut encore - I’m gonna kiss you a little bit more/ Weeeehhh/ All nite long - Zyva Mouloud Labeef ! En 1958, Sleepy enregistre «The Ways Of A Woman In Love» sur un takatak à la Cash, mais il détient le power véritable. Il reprend d’ailleurs le «Home Of The Blues» de Cash. Durant la même session, il enregistre le «Guess Things Happen That Way» de Jack Clement, fabuleux popopoh de Deep sounding popopoh. Le single suivant s’appelle «Can’t Get You Off My Mind». On sent le rockab qui règne sur son empire. Fantastique cavalcade. Sleepy est un mec idéal pour Bernadette Soubirou. Ce big heavy shuffle texan est si bon qu’on hoche la tête en suçant le beat. Il fait aussi un «Turn Me Loose» digne de Buddy Holly. Ah ça sent bon le Texas ! En 1959, il reprend le «Tore Up» d’Hank Ballard et le racle bien au guttural. Il se prend d’ailleurs pour Billy Lee Riley. Il rend aussi un superbe hommage à Bo Diddley avec une reprise de «Ride On Josephine». Comment tu veux résister à ça ? Impossible.
Le disk 2 démarre avec sa reprise du big «Goodnight Irene» de Leadbelly. Wendall Clayton la slappe derrière les oreilles ! Sleepy est un weird outcast, il chevauche en marge de la société, il fait comme Jerr, il swingue son Leadbelly avec un max de gusto, good nite Iriiiiiine, tout ça sur fond des wild guitars de Red Robinson et Toby Torrey. Il faut voir aussi Sleepy bouffer la heavy country de «Oh So Many Years». C’est un vrai gator ! Il croutche tout ce qui traîne. Powerus maximalus, comme dirait Cicéron. Encore un fabuleux coup de heavy downhome baryton dans «Somebody’s Been Beatin’ My Time». En 1965, Sleepy enregistre pour Columbia à Nashville et ça s’entend. Il chante au creux de son baryton et son «Completely Destroyed» se révèle d’une puissance inexorable. Il adore ces vieux shoots de rengaines tagada. Il passe aux choses sérieuses avec une reprise de Chucky Chuckah, «You Can’t Catch Me». Véritable shoot de rockabollah, suivi d’une mise en coupe réglée du «Shame Shame Shame» de Jimmy Reed. Et voilà qu’il plonge dans le New Orleans Sound avec l’«Ain’t Got No Home» de Clarence Frogman Henry, ouh-woo-woo-woo, il le fait pour rire, il passe par tous les tons, même le cro-magnon. Sleppy éclate tout. Rien ne lui résiste. C’est sans doute là, dans sa première époque, qu’il montre à quel point il domine la situation. Il faut le voir attaquer «A Man In My Position», Goodbye Mary/ Goodbye Suzi, il fonce vers d’autres crémeries, d’autres chattes bien poisseuses. Sa voix transperce les murailles. De cut en cut, on s’effare de la qualité du stuff, comme par exemple ce «Sure Beats The Heck Outta Settlin’ Down», solide merveille pleine d’allant et de punch, country festive à la bonne franquette, un vrai joyau de good time music. On pourrait dire la même chose de «Too Young To Die» et de «Two Hundred Pounds Of Hurt», joués au fantastique swagger. Ce sacré Sleepy accroche bien son audimat. On le voit ressasser la vieille country d’«Everyday» à la poigne de fer. Powerful country dude ! Il termine sa période Columbia avec un sidérant «Man Alone». Ce mec sait chanter son bout de gras. Avec son Stetson noir et son blazer blanc, il fait figure d’aristo. Alors attention, en 1970, il enregistre chez Shelby Singleton. Il entre dans sa période Sun avec «Too Much Monkey Business» qu’il prend à la voix de heavy dude. Avec le «Sixteen Tons» de Merle Travis, il passe au ringing de wild rockab. Il sait de quoi il parle. Et puis voilà qu’on tombe sur un coup de génie : «Asphalt Cowboy». Fantastique résurgence de la source ! Il sonne comme Elvis dans le Polk Salad schtoumphing, Sleepy tape son Cowboy au dur du Deep South et le tempère à la pire aménité. Il en fait du big beat à ras la motte, typique d’un Tony Joe sous amphètes, sur fond de slidin’ du diable. L’un de quatre guitaristes présents dans le studio joue au picking demented. Sleepy ?
Le disk 3 démarre sur la suite de la période Sun et ça chauffe très vite avec «Buying A Book» que Sleepy chante du haut de la tour de Babylone puis il explose le vieux «Me And Bobby McGee» de Kris Kristofferson. Il l’emmène avec l’autorité d’un King. C’est la version qu’il faut écouter, car montée sur un heavy drive de slap. C’est plein de jus et gratté sec, lalala lalala ! En plein dans le mille. Sleepy laisse bien son Bobby en suspension - Good enough for me and/ ...Bobby McGee - Il rend ensuite hommage à Hooky avec «Boom Boom Boom» qu’il chante d’une voix de gator, croack croack, au right out of my feet du marais. Hooky devait bien se marrer en écoutant ça. S’ensuit un hommage torride à Joe Tex avec «It Ain’t Sanitary». Comme Elvis, Sleepy ne travaille qu’au feeling pur. Et bham, voilà l’«Honey Hush» de Big Joe Turner. Sleepy le yakety-yake d’entrée de jeu, il fonce dans le tas. Just perfect. Avec «A Hundred Pounds Of Hurt», il renoue avec le country power. En tant que Southern dude, Sleepy vaut mille fois Cash. On le voit ensuite monter sur le coup d’«I’m Ragged But I’m Right» comme on monte sur un braco. Sleepy monte sur tous les coups, comme Jerr. Il n’a pas froid aux yeux. Il va même exploser le cul de la pauvre country. Nouvel hommage, cette fois à T Bone Walker avec «Stormy Monday Blues». Ça pianote au fond du saloon. Sleepy honore ce géant du blues et l’hommage prend une sacrée tournure, c’est vraiment le moins qu’on puisse dire. Il faut voir ce chanteur passionnant monter dans ses gammes. Il ne fait qu’une seule bouchée de «Streets of Laredo» et va loin au fond de son baryton pour interpréter «Bury Me Not On The Lone Prairie». Il chante aussi «Tumbling Tumbleweeds» à la carafe implicite et barytonne de plus en plus. En 1974, il se tourne résolument vers la country, mais il est si bon qu’on l’écoute attentivement, même quand on n’est pas fan de country. Il reprend aussi le «Good Rocking Boogie» de Roy Brown qui est en fait le «Good Rockin’ Tonight» - Well I heard the news/ We’re gonna boogie tonite - Énorme swagger.
Suite de la période Sun sur le disk 4. Avec «Mathilda», il enfonce son clou cajun à coups de poing. Même niveau qu’Elvis question prestance et ça violonne à perdre haleine. Sleepy reste dans le cajun avec «Faded Love» - I miss you darling more & more - Très haut niveau d’instrumentation avec un Sleepy qui solote au glouglou dans le flow. Toute la session de mai 1977 est cajun, même la reprise de «You Can’t Judge A Book By Its Cover». C’est très spécial, rien à voir avec Cactus. Sleepy opte pour le mode cavalier léger, c’mon, can’t you see. S’ensuit un «Young Fashioned Ways» bien slappé derrière les oreilles décollées. Sleepy et ses amis n’en finissent plus d’allumer les vieux coucous : c’est le tour du «Sittin’ On Top Of The World» des Mississippi Sheiks, un heavy blues popularisé par Wolf et plus tard Cream. Sleepy does it right. Facile quand on est monté comme un âne. Ah qui dira la violence du country beat, avec la petite incision qui ne fait pas mal, cette guitare scalpel qui entre dans le cul du beat. Ces mecs y vont de bon cœur. Plus rien à voir avec Cream. Sleepy fait aussi une version royale de «Matchbox». Puis il rend hommage à Lowell Fulson avec une version superbe de «Reconsider Baby». Il en fait un carnage, même si la bite blanche est moins exposée aux aléas sentimentaux que la bite noire - I hate to see you go - Mais au fond, Sleepy ne manquerait-il pas un peu de crédibilité, si on compare sa version avec celle du géant Lowel Fulson ? Et la valse des covers de choix reprend avec «Polk Salad Annie», c’est une version ultra-musculeuse, Sleepy et ses copains ont décidé de fracasser la Salad, ils jouent au big Southern brawl. Fantastique énergie ! Ça bat sec et net, sur un beat bien tendu vers l’avenir. Sleepy crée l’événement en permanence. Il brame son «Queen Of The Silver Dollar» au fond du saloon et tape son «Stay All Night Stay A Little Longer» au Diddley beat, avec des chœurs. Wow, ils sont en plein dans Bo ! C’est un véritable coup de génie : Sleepy fond l’énergie country dans le cœur de Bo ! Du coup, ils retapent un coup de «Baby Let’s Play House» - Babbb/ I’ll play house for you - Sleepy tape aussi dans l’extraordinaire «Tall Oak Tree» de Dorsey Burnette, joli shoot de black country rock. Quelle autorité et quel son ! Ces sessions Sun rangées chronologiquement dans la box sont de vraies merveilles. Sleepy eut la chance de ne pas tomber dans les pattes du Colonel Parker et de RCA. Il put ainsi préserver son intégrité.
On continue avec le disk 5 qui propose ses chansons de gospel et notamment une reprise de son tout premier single, enregistré en 1955 et resté inédit, «I Won’t Have To Cross The Jordan Alone»/«Just A Closer Walk With Thee» : vieux gospel country demented. Il explose sa ‘old time religion’. Il prend aussi «Ezekiel’s Boneyard» en mode jumpy et occipute «I Saw The Light». Il chante tout ça d’autorité avec une insolente profondeur de ton. Sleepy ravage les églises en bois. Il joue tout son gospel batch à la country effervescente, avec une incroyable énergie du beat. On tombe plus loin sur les sessions d’un album plus rock, avec notamment des reprises musclées de «Rock’n’Roll Ruby» et de «Big Boss Man». Il les groove sous la carpette du boisseau, il leur fouette la croupe au mieux des possibilités du fouettage, et ça donne un vrai swing d’American craze. Sleepy y va toujours de bon cœur, il faut le savoir. Il claque aussi l’«I’m Coming Home» de Johnny Horton au country power et riffe en sourdine à l’huile. Tout est alarmant de power et de classe. Sleepy is all over. Il prend son «Boogie Woogie Country Girl» ventre à terre et devient violent avec son killer solo flash. On ne parle même pas de la version demented de «Mystery Train». Il va droit sur Elvis 56. Encore plus demented, voici «Jack & Jill Boogie» avec un Cliff Parker qui a le diable au corps. Hommage à Lee Hazlewood avec «Honly Tonk Hardwood Floor», beau brin de son of a gun, pas de problème, ça reste du Grand Jeu. Il gratte aussi son «Tore Up» au sec de Nashville et termine avec la doublette infernale de Billy Boy, «Flying Saucer Rock’n’Roll» et «Red Hot».
Quant au disk 6, il propose l’album enregistré à Londres avec l’excellent Dave Travis Bad River band. Cet album est un véritable festival de rythmique et de sawgger rockab. On ne saurait rêver mieux dans le genre. Pour les Anglais, ça devait être un rêve que d’accompagner un mec aussi brillant que Sleepy LaBeef. Sur cet album, tout est bon, il n’y a rien à jeter, ils tapent «Ride Ride Ride» au fouette cocher et envoient un fabuleux shoot de virtuosité avec «LaBœuf’s Cajun Boogie» : figures de style bien carrées et somptueuses descentes de gammes cajunes. Sleepy joue ça au gratté sauvage. Il faut dire que le mix de Bear ravive encore la fraîcheur enivrante de l’album. Avec «Go Ahead On Baby», Sleepy prend les choses au débotté et embarque «Mind Your Own Business» au heavy drive. Sleepy travaille ça en profondeur et passe une espèce de killer solo flash qui laisse rêveur. Cet album est une vraie bombe atomique. Sleepy saute sur le râble de tous ses solos, il joue tout à l’ouverture d’esprit. Il embarque son «Shame Shame Shame» au rumble rockab et se paye une belle dégringolade de bass drive avec «Cigarettes And Coffee Blues». Sleepy est dans son délire de swing et bat absolument tous les records de désinvolture.
On retrouve toutes les merveilles Sun sur les deux premiers albums de Sleepy, The Bull’s Night Out et Western Gold. Le plus diabolique des deux albums Sun est le premier qui s’ouvre sur la version nerveuse de «Too Much Monkey Business». On sent le cat accompli. Mais c’est en B qu’ils chauffent la marmite avec cette fantastique version de «Me And Bobby McGee» que Sleepy prend d’une voix de big guy. C’est gratté à l’efflanquée d’acou tutélaire. Sleepy fait son stentor terminator, il bat même Elvis à la course. Il charge ensuite la barque de la B avec «Boom Boom Boom», puis l’«It Ain’t Sanitary» de Joe Tex qu’il fait sonner comme du Tony Joe White avec le même sens du come along, puis «Honey Hush» qu’il prend à la cosaque d’une voix d’Ivan Rebroff. Cette B fulminante se termine avec l’excellent «Asphalt Cowboy» monté sur l’attaque de takatak Telecasté et on voit Sleepy naviguer à la surface du beat, fier comme un amiral de la Royal Navy. Le Western Gold est plus country, avec un «Mule Train» bien cavalé et un «Cool Water» bien monté dans les gammes de chant. Sleepy fait là de la country de cornac. Il fait sa barrique avec «Tumbling Tumbleweeds» et retombe dans la vieille country de poids avec «Strawberry Roan». Il sort son meilleur baryton, celui de la prairie, pour «Wagon Wheels» - Carry me over the hills - et sombre dans un océan de nostalgie avec «Home On The Range». Et tout cela se termine avec «Ghost Riders In The Sky» qui sonne comme une cavalcade de cowboys à la mormoille. Avec cet album, on a disons l’équivalent des grands albums country de Jerr parus sur Smash.
Encore du Sun en 1979 avec Downhome Rockabilly et une série de reprises assez magistrales de «Rock’n’Roll Ruby» et surtout de «Big Boss Man» qu’il fait sonner comme une bombarde. Sleepy chante comme Hulk, du haut du ventre et ça swingue fabuleusement. Autre belle surprise : «Boogie Woogie Country Girls», un hit de Doc Pomus que Sleepy taille au swagger et ça slappe dur derrière lui. Belle version de «Mystery Train». Sleepy se positionne sur celle d’Elvis et il en a la carrure. Sa version lèche bien les orteils de l’original signé Junior Parker. En B, il salue Lee Hazlewood avec une cover d’«Honky Tonk Hardwood Floor» puis Hank Ballard avec un «Tore Up» hautement énergétique. S’ensuivent deux clins d’yeux à Billy Boy avec «Flying Saucer Rock & Roll» et «Red Hot». Ces mecs ont le diable chevillé au corps. Puis Sleepy va exploser le vieux «I’m Coming Home» de Johnny Horton. Il tape ça au fouette cocher. On se régale de l’incroyable carapatage de Sleepy LaBeef. Ça joue au meilleur country jive de derrière les fagots. Et cet album qu’il faut bien qualifier de miraculeux se termine sur le «Shot Gun Boogie» de Tennessee Ernie Ford. Wow shot gun boogie !
Charly s’est aussi jeté sur les sessions de Sleepy pour remplir deux albums, Beefy Rockabilly et Rockabilly Heavyweight, parus en 1978 et 79. Comme à son habitude, Charly tape dans le tas pour vendre. On retrouve sur Beefy Rockabilly toute la ribambelle : «Good Rockin’ Boogie», «Blue Moon Of Kentucky», «Corine Corina» qu’il chante dans les règles du meilleur art, «Matchbox», joué sec et net et sans bavure, «Party Doll» monté sur un solide drive de Nashville et l’irremplaçable «Baby Let’s Play House». Franchement, cette A vaut le détour et ça continue en B avec un «Too Much Monkey Business» chanté à la poigne d’acier, un «Roll Over Beethoven» irréprochable et un «Boom Boom Boom» transformé en big drive nashvillais. C’est joué à la frénétique, bien fouetté de la croupe, au vrai tagada. Charly charge bien la barque en ajoutant «Honey Hush» et «Polk Salad Annie», ce qui donne au final un album hélas beaucoup trop parfait. Sleepy ne vit que pour allumer les vieux cigares. Notez bien que les liners notes au dos de la pochette sont signées Guralnick. Il insiste : «Écoutez bien cet album. Avec ces morceaux qui s’inspirent du blues, du cajun, du swing, de la country et de la pure church-rocking Soul, on a une idée parfaite de ce que sont les racines du rockabilly, et comme dans le cas des géants du rockab original, Sleepy marie tout ça grâce à un incroyable style personnel.» Il s’enfièvre et compare le style vocal de Sleepy à ceux d’Elvis, de Big Joe Turner et de Wolf.
Et puis revoilà l’excellent Rockabilly Heavyweight enregistré à Londres avec le Dave Travis Bad River Band, repris dans la Bear Box en son intégralité. On y trouve des versions fringantes de «Shame Shame Shame» ou «Milk Cow Blues» que Sleepy arrose de killer solos flash. Au dos de la pochette, Max Needham nous raconte dans le détail ce concert donné au Regent Street studio, sur Denmark Street. Alors âgé de 44 ans, Sleepy ouvre le bal : «Come on bopcats, let’s rock !» et il attaque avec «Sick & Tired». La perle de l’album est sans doute «LaBœuf’s Cajun Boogie», un instro qui swingue de manière fantastique. Joli shoot de swing aussi dans «Mind Your Own Business», monté sur un drumming rockab de coin de caisse et des chœurs de mecs frivoles. Ah comme c’est fin et rusé ! Les Anglais se révèlent excellents, ils swinguent aussi «Lonesome For A Letter» et nous envoient au tapis avec un «Smoking Cigarettes & Drinking Coffee Blues» monté sur un drive infernal. Sleepy a bien raison de travailler avec Dave Travis. Ils font bien la paire. Sleepy prend plus loin «I’m Feeling Sorry» au gras d’attaque à la Jerr. C’est un album réjouissant bardé d’ol’ rock’n’roll furia del sol. Sleepy rafle la mise sans jamais forcer. Le festin se poursuit en B avec «Honky Tonk Man» et sa belle aisance swinguy - Hey hey mama/ Don’t you dare to come home - Sleepy n’en finit plus de jouer comme un dieu, surtout dans «My Sweet Love Ain’t Around».
En 1981, Sleepy entame sa période Rounder Records avec It Ain’t What You Eat It’s The Way You Chew It. C’est encore Guralnick qui signe le texte au dos de la pochette. Il décrit dans le détail toute la session d’enregistrement qui eut lieu au Shook’s Shack de Nashville. Il rappelle dans ce texte qu’il a fréquenté Sleepy pendant trois ou quatre ans et qu’il fut charmé à la fois par sa dimension musicale et sa dimension intellectuelle. Sleepy est un homme qui lit énormément. Une fois de plus Guralnick sort les noms d’obscurs contemporains de Sleepy, Frenchy D et Johnny Spain. Le reproche qu’on pourrait faire à cet album, c’est son côté trop Nashville. Sleepy perd son edge, même si Guralnick prétend le contraire. Même si «I Got It» (chanté aussi par Little Richard) sonne comme le rock’n’roll du diable. Il rocke bien son «I’m Ready», c’est fouetté et cravaché en toute connaissance de cause, mais sans surprise. Il tente en B le coup du heavy boogie avec «Shake A Hand» et reprend l’«If I Ever Had A Good Thing» de Tony Joe. Il fait aussi une belle version de «Let’s talk About Us», mais le «Walking Slowly» d’Earl King retombe à plat. Notons aussi qu’avec cet album, on sort de la période couverte par la Bear box.
Toujours sur Rounder, voici Electricity, paru en 1982. Steve Morse signe le texte au dos de la pochette. Il rappelle que Sleepy peut reproduite n’importe quel roots style : blues, country, cajun ou gospel. Mais s’empresse-t-il d’ajouter, c’est quand il rocke que ça devient intéressant - You’re under the spell of the real thing - À quoi Sleepy ajoute : «La seule musique qui m’intéresse est celle qui donne la chair de poule.» Alors en voiture Simone pour un album plein d’edgy boogie-woogie, de wild rockabilly et de pure overdrive rock’n’roll, nous dit Morse. Il ajoute que le soir d’un concert au Mudd Club à New York, Lux Interior vint trouver Sleepy pour lui demander un autographe. Première bonne surprise avec «Low Down Dog» repris jadis par Smiley Lewis et Big Joe Turner. Le beat rebondit aussi bien qu’une balle en caoutchouc dans la chaleur de la nuit et Sleepy transperce son Low Down en plein cœur d’un sale petit killer solo flash. C’est avec «Alabam» qu’il rafle la mise - I’m going back/ To Alabam - C’est cavalé ventre à terre, Sleepy fonce à la cravacharde. Morse précise que Sleppy reprend la version de Cowboy Copas. Puis il s’en va swinguer son vieux «I’m Through» qui date du temps où il chantait avec Hal harris et George Jones au Houston Jamboree, dans le milieu des années cinquante - Cause I’m blue/ I’m through with you - Il attaque sa B avec une cover de «These Boots Are Made For Walking» - The perfect rockabilly song, dit Sleepy - et il s’endort sur ses lauriers avec «You’re Humbuggin’ Me’» de Lefty Frizzell. Réveil en sursaut avec «Cut It Out» de Joe Tex, mais la prod ne met pas assez le cut en valeur. On a un problème avec cet album qui sonne comme le point bas d’une carrière.
Guralnick est de retour au dos de la pochette de Nothin’ But The Truth, paru en 1986. Attention c’est un big album ! Guralnick dit même qu’on l’attendait depuis longtemps, car c’est l’album live tant espéré. Guralnick est tellement fasciné par Sleepy qu’il le range dans son panthéon à côté de James Brown, Jerr et Wolf, in his pure ability to tear up a stage. Il veut dire que Sleepy explose une scène aussi bien que James Brown, Jerr le Killer et Wolf. Sleepy : «I’ll garantee you something’ll be going on !» Eh oui, Sleepy nous fout la chair de poule avec son «Tore Up Over You», real rockab madness. Sleepy a le diable au corps et il tore up dans les brancards. Il enchaîne avec un extraordinaire shake de Beefy Beef nommé «Boogie At The Wayside Lounge». Il drive ça à la voix d’homme, comme son copain Jerr le Killer. Même jus. Il nous embarque dans un interminable drive de boogie blast. Il annonce a little bit of bluegrass & rhtyhm & blues pour présenter «Boogie Woogie Country Man» et emmène son «Milk Cow Blues» à la force du poignet. En B, il prévient les gens qu’il adore cette chanson et pouf, voilà «Let’s Talk About Us». Il l’embarque aussi à la poigne de fer. Ce mec rolls on the rock et pique une crise comme son copain Jerr le Killer. S’ensuit un magnifique hommage à Bo Diddley avec «Gunslinger». Il jette dans la balance toute sa sincérité d’homme blanc et les chœurs font «Hey Bo Diddley !». Alors on monte directement au paradis. Il annonce : «Got a little boogie for ya» et boom, «Ring Of Fire» qu’il prend en mode boogie blast. Ah il faut avoir vu ce cirque si on ne veut pas mourir idiot. Et c’est avec le medley final qu’il va s’inscrire dans la légende des siècles. Fantastique tenue de route ! Les mecs y vont franco de port en démarrant avec le «Jambalaya» d’Hank Williams. Ils restent sur le même beat pour «Whole Lotta Shaking Goin’ On» que Sleepy chante au sommet de son art, sans jamais céder un pouce à la faiblesse. Toujours le même beat pour «Let’s Turn Back The Years» et «Hey Good Looking», pas de variante, avec Sleepy, tout coule non pas de source mais de muddy water et il termine sur un vieux shoot de Folsom. Le seul mot qu’on puisse ajouter au sortir de cet album, c’est wow. Alors wow ! Et même mille fois wow !
Ce sont les frères Guralnick qui produisent l’excellent Strange Things Happening paru sur Rounder en 1994. Sleepy rafle la mise dès «Sittin’ On Top Of The World» qu’il attaque au takatak. Il faut voir ce roi du monde parader dans son groove en toute impunité. Il est le grand vainqueur du rock américain. S’il est un mec qui inspire confiance sur cette terre, c’est bien Sleepy. Tu peux entrer dans la danse, tu ne seras pas déçu, c’est du big American sound claqué aux mille guitares et chanté au meilleur basso profundo. Sleepy récidive plus loin avec «I’ll Be There». On croit que la messe est dite depuis belle lurette, en matière de heavy boogie, et pourtant Sleepy claque ça sec. Il développe un extraordinaire swing de jive qui n’appartient qu’à lui. C’est encore un hit de juke comme on n’ose plus en rêver, chargé de wild guitars. What a swagger ! Il finit au guttural. Avec «Trying To Get To You», il sonne comme Elvis. Pur Memphis jive. Idéal pour un ‘gator comme Sleepy. Le titre de l’album est bien sûr un clin d’œil à Sister Rosetta Tharpe. Il embarque le morceau titre au heavy beat pianoté. Le géant s’adresse à une géante et le beat est au rendez-vous. Oh every day ! Clameurs de gospel ! Every day, là mon gars tu en as pour ton argent. Solo à la coule. Merveilleux Sleepy LaBeef. Son «Playboy» sonne comme un boogie classique, mais Sleepy en rajoute des couches. Il rend aussi un bel hommage à Muddy avec «Young Fashoned Ways» et à Ernest Tubb avec «Waltz Across Texas». Il finit avec une version live de «Stagger Lee» - ‘This is Stagger Lee now ! - Cette façon d’embarquer un cut n’appartient qu’à lui. Il fait sa loco et embarque Stagger Lee sur les rails à travers l’Amérique.
On pourrait voir I’ll Never Lay My Guitar Down comme un album de plus. Simplement, il s’y passe des choses, du genre «Treat Me Like A Dog», vrai shuffle de rockab moderne. Sleepy l’embarque au train train d’enfer de Mystery Train et donne une belle leçon de heavy shuffle. Il finit son cut à la folie Méricourt, à la Jerr, stay away from you, il explose son final au guttural, il shoute le train du try to try comme s’il se trouvait au Star Club de Hambourg ! Wow ! Il fait aussi sur cet album une nouvelle version d’«I’m Coming Home». Ah il aime bien Johnny Horton. Ça tombe bien, nous aussi. Il le claque au heavy claqué de boisseau, il le joue en mode bluegrass avec une gratte qui sonne comme un crapaud buffle du bayou, c’est fin et racé, digne des trains en bois du bayou et des grenouilles de Monsieur Quintron. Spectaculaire ! Il nous remet une couche de magnifique aisance avec «Little Old Wine Drinker Me» qui sent bon le «Route 66». Tiens puisqu’on parlait du bayou, Sleepy reprend l’excellent «Roosevelt & Ira Lee» de Tony Joe. Même race d’aventuriers du son et du swamp. Violent shoot de hot boogie down avec «Hillbilly Guitar Boogie». Sleepy adore le hot hillbilly blast, il en fait ses choux gras. Et il prend prétexte d’un «You Know I Love You» pour soloter à bras raccourcis.
Tomorrow Never Comes pourrait bien être l’un des meilleurs albums de Sleepy. Le morceau titre est une reprise d’Ernest Tubb, l’une de ses idoles parmi tant d’autres. «I grew up listening to Hank Williasm, Howlin’ Wolf, Bill Monroe, Tommy Dorsey, Muddy Waters, Bob Wills, Roy Acuff and Big Joe Turner». Sa version de Tomorrow est un vrai slab de rockab arraché à l’oubli. Une merveille de power, slappé par ce démon de Jeff McKinley. Autre reprise de choc : «The Blues Come Around» d’Hank Williams. Fantastique drive de heavy junk, Sleepy joue ça à la main froide, et ça pulse au beat rockab, avec un killer solo à la fin. Le «Detour» d’ouverture de bal est aussi un sacré romp de rockab. Sleepy sait prendre le taureau rockab par les cornes. Il joue ça au country power blast. Nashville romp, baby. Cette session nashvillaise de l’an 2000 compte parmi les sommets de l’art, avec des mecs aussi brillants que Jeff McKinley et David Hughes. Il fait aussi une version incroyablement rockab de «Too Much Monkey Business». Là-dessus, Sleepy est imbattable. Il faut voir comme il sait driver son Monkey Business. C’est assez fascinant. Il transforme le plomb du Monkey Business en or rockab. Mais ce diable de Sleepy est bien trop américain pour l’alchimie. On note la belle ferveur de David Hughes au slap. Maria Muldaur vient duetter avec Sleepy sur «Will The Circle Be Unbroken». Elle se fond dans l’exégèse. Elle sait shaker un couplet de gospel batch, pas de problème. Elle sait comment il faut la ramener. Sleepy rend plus loin hommage à Tony Joe avec «Poke (sic) Salad Annie». Belle tension, Sleepy adore Tony Joe et ses racines rurales, parce qu’il a les mêmes. Il descend au fond de sa cave pour y chercher le meilleur baryton. Il revient à ses premières amours avec un vieux coup d’«Honey Hush». Il connaît le Yakety Yack par cœur, mais on se régale du beau slap de Nashville. Jeff McKinley fait même un beau numéro de slap à vide. C’est une version de rêve, avec des chœurs de potos derrière et un solo de wild guitar. Il termine avec un fantastique shoot de «Low Down Dog». McKinley slaps it all over. Sleepy LaBeef serait-il the last of the great original rockabillies on earth ? En tous les cas, il slappe son shit, oooh oui, ooh oui. Si tu veux du vrai rockab, mon gars, vas voir Sleepy. Ou Jake Calypso.
Paru en 2001, Rockabilly Blues est une compile concoctée par Rounder à partir de cuts de blues restés inédits et enregistrés lors des sessions antérieures, comme par exemple celles de Nashville avec D.J. Fontana et Cliff Parker. Sleepy rend un bel hommage à Jimmy Reed avec une cover de «Bright Lights Big City» et ramène du violon cajun dans un «Fool About You» qu’il finit au yodell, comme Jerr. Sleepy tape aussi dans Muddy avec une reprise de «Mannish Boy», mais sa version manque tragiquement de heavyness. Elle n’est ni assez grasse ni assez spongieuse. Trop plastique. Pareil, il se vautre avec «Rooster Blues». On croirait entendre un gamin de 15 ans dans une surprise-party. Il sauve l’album avec «Night Train To Memphis», oh yeah, hallelujah ! Duke Levine y fait pas mal de ravages sur sa guitare. Sleepy tape une joli coup de gospel avec «This Train», mais se vautre lamentablement avec «Long Tall Sally» et «Rip It Up». Comme quoi, il faut parfois laisser les outtakes dormir au fond de leur tiroir.
Sur Roots paru en 2008, Sleepy a pris un coup de vieux. Il porte des lunettes et sa main droite qu’on voit posée sur la guitare est celle d’un vieux bonhomme. Mais quand il swingue son «Cotton Fields», il le fait d’une voix qui fait rêver tous les chanteurs. Il ramène même du violon derrière. Il en fait une version diabolique et chante au mieux de son basso profundo. Ah comme ce mec peut être génial ! Il fait encore du swagger protectionniste avec «Baby To Cry» et atteint des summums d’artistry. Il claque ensuite ce vieux balladif de «What Am I Worth» avec une ferveur qui en bouche un coin. Il chante l’Americana au deepy rap. Ce démon de Sleepy lègue ses cuts à la postérité avec la générosité d’un seigneur déchu. L’autre sommet de l’album, c’est «Miller’s Grave» qu’il chante comme Cash au soir de sa vie. Même intensité que le vieux Cash tombé dans les pattes de l’horrible Rick Rubin. Même délire de fantastique présence. Sleepy revient à son cher heavy blues avec «Completely Destroyed» - I’m just a shell of a man - et tape son «Foggy River» au meilleur baryton de l’univers. Il gratte son «Dust On The Bible» à coup d’acou. Véritable shoot de country jive ! C’est énorme d’American fever et de die for it. Sleepy est encore pire que Cash à l’article de la mort. Il se veut immanquable. Il reprend aussi «Detroit City», comme l’a fait Jerr à une époque, et étend l’empire de sa nostalgie des cotton fields at home - I wanna go home - Puis il embellit «In The Pines» de Leadbelly à l’embellie - And you shiver when the cold wind blows - Il faut aussi le voir se plonger dans la Bible avec «Matthieu 24» - I believe the time has come for the Lord to come again - Il y croit dur comme fer et se livre avec «Have I Told You Lately» à un sacré ramage en son plumage. C’est encore une fois digne du Cash de la fin des haricots. Avec «Amazing Grace», il ne pouvait pas trouver meilleure fin de non recevoir.
Alors voilà son dernier album, Sleepy LaBeef Rides Again, paru en 2012 et doublé d’un DVD, l’excellent Live At Douglas Corner Café. L’idée de doubler la séance d’enregistrement de Rides Again au fameux RCA Studio B de Nashville est jaillie du cerveau de Dave Pomeroy, le bassman de Sleepy. Eh oui, il fallait y penser : on a donc la version studio ET la version live du même set. Sleepy sort le Grand Jeu puisqu’il tape dans ses vieux coucous, à commencer par «Honey Hush» - Umm honey hush - Il lui sonne bien les cloches et enchaîne avec un «Lost Highway» en père peinard sur la grand mare des canards. Look out ! Fantastique ramshakle ! Les points forts de l’album se trouvent vers la fin, à commencer par un medley explosif, «Tore Up Over You/ I Ain’t No Home/ Ring Of Fire» - Tore up ah ha ! - Il ne faut pas lui confier ce genre de truc, il va l’exploser ! Il embroche son Ain’t no home sur le même beat, Sleepy est un spécialiste du glissé de cut en cut sur le même beat, il sait aussi faire monter la température et pouf, voilà Ring of Fire qu’il explose. Sleepy est le roi des medleys. Juste derrière se trouve l’excellent «Willie & The Hand Jive», un vieux boogie de Johnny Otis. Sleepy lui fait honneur - Do the hand jive one more time ! - On retrouve aussi sur cet album de vaillantes versions de «Red Hot» et d’«Hello Josephine». Infernal ! How doo yoo dooo ! Sleepy sait pincer les fesses de Josephine, doo yoo remember me baby ? Il nous claque à la clé un sacré solo de belle gueule à la Clémenti - How doo yoo dooo - Il ressort tous ses vieux classiques, «Young Fashioned Ways», «Blues Stay Away From Me» et «Boogie Woogie Country Man» - I like a little rock, I like a little roll - Et pouf ! Il part bille en tête. On le voit gratter «Wolveron Mountain» avec un appétit de géant qui en dit long sur son admiration pour Rabelais. Il termine cet album qu’il faut bien qualifier de classique avec «Let’s Turn Back The Years». La fête continue. Il faut en profiter. Dans le film du concert au Douglas Corner Café, c’est Dave Pomeroy qui présente Sleepy, the one and only Sleepy LeBeef, oui, prononce le a de la le et cette grande baraque de Sleepy attaque son «Honey Hush» en vieux pro. Des témoins viennent dire la grandeur de Sleepy entre deux cuts, notamment Peter Guralnick : «Sleepy is the greatest performer I have ever seen.» On voit Kenny Vaughan soloter en alternance avec Sleepy. Tout est extrêmement carré, articulé sur ces trois musiciens exceptionnels que sont Sleepy, Kenny Vaughan et Gene Dunlap au piano. Sleepy : «I recorded it en 1959, a Hank Ballard twist.» Pouf, «Tore Up» ! Les témoins n’en finissent plus de saluer la grandeur de Sleepy : «It became a Sleepy trademark : he plays all nite long and never stops it !» Ils font de «Willie And The Hand Jive» un fantastique groove climatique, bien drivé par cet excellent batteur rockab qu’est Rick Lonow - Do the hand jive one more time - Tout le monde descend sauf Sleepy qui va continuer de gratter sa gratte jusqu’à la fin des temps.
Signé : Cazengler, Sleepy LaBave
Sleepy LaBeef. Disparu le 26 décembre 2019
Sleepy LaBeef. The Bull’s Night Out. Sun 1974
Sleepy LaBeef. Beefy Rockabilly. Charly Records 1978
Sleepy LaBeef. Downhome Rockabilly. Sun 1979
Sleepy LaBeef. Rockabilly Heavyweight. Charly Records 1979
Sleepy LaBeef. It Ain’t What You Eat It’s The Way You Chew It. Rounder Records 1981
Sleepy LaBeef. Electricity. Rounder Records 1982
Sleepy LaBeef. Nothin’ But The Truth. Rounder Records 1986
Sleepy LaBeef. Strange Things Happening. Rounder Records 1994
Sleepy LaBeef. I’ll Never Lay My Guitar Down. Rounder Records 1996
Sleepy LaBeef. Tomorrow Never Comes. M.C. Records 2000
Sleepy LaBeef. Rockabilly Blues. Bullseye Blues & Jazz 2001
Sleepy LaBeef. Roots. Ponk Media 2008
Sleepy LaBeef. Rides Again. Earwave Records 2012
Sleepy LaBeef. Larger Than Life. Bear Family Box 1996
Peter Guralnick. Lost Highway. Back Bay Books 1999
Seth Pomeroy. Sleepy Labeef Rides Again. Live At Douglas Corner Café. Earwave DVD 2012
Battle Fields - Part Two
Si on aime la Soul à en brûler bien qu’ayant tout brûlé, alors il faut écouter Lee Fields. Comme Brel, Lee Fields cherche l’inaccessible étoile. Telle est sa quête. Quand il vient chanter «Honey Dove» en rappel, il brûle du même feu que Brel, c’est en tous les cas ce que ressentent tous ceux qui eurent l’immense privilège de voir l’Homme de la Mancha au Théâtre des Champs Élysées. Lee Fields atteint lui aussi les niveaux supérieurs de l’interprétation dans ce qu’elle peut avoir de mercurial et d’implosif à la fois. Jacques Brel reste le modèle absolu de l’intensité interprétative, et Lee Fields dispose à la fois du talent et de «Honey Dove» pour le rejoindre dans ce lointain firmament. On pourrait aussi citer James Brown, bien sûr. Même genre de volcan, même genre de professionnalisme exacerbé, avec cette façon spectaculairement élégante de rappeler que la Soul et le funk sont avant toute chose une affaire de black power.
Bien sûr, si on veut prendre un coup de black power en pleine gueule, il faut faire l’effort d’aller voir Lee Field sur scène. Les mauvais clips mis en ligne font insulte à sa grandeur. Comme s’ils le ratatinaient.
À l’âge de 69, ce petit bonhomme rondouillard tournoie sur scène comme une toupie et shoute la meilleure Soul des temps modernes. Il est le spectacle, le monstre sacré, dans sa veste de smoking brodée de fil d’or, son pantalon noir à baguettes et ses boots argentées. Lee Fields vient d’une autre époque, celle des grandes revues de la Soul américaine d’antan, lorsque que les blackos prenaient leur revanche sur la société des blancs en conquérant le monde sans la moindre violence, avec un art qu’on appelle la Soul Music. C’est un point qui mérite d’être sérieusement médité. Les fils d’esclaves n’eurent pas besoin de B52 ni de fucking snipers pour conquérir le monde occidental et faire danser les petits culs blancs. Rien ne pouvait résister au rouleau-compresseur de cette Soul dont les figures de proue étaient Stax, Tamla et James Brown. Lee Fields perpétue la tradition avec en plus le punch de Cassius Clay. Il met le monde moderne KO en dix manches, et franchement, le monde moderne est ravi d’avoir été mis au tapis par un petit nègre aussi brillant que Lee Fields. Si on osait, on dirait même que c’est un honneur.
Oui, Lee Fields nous met KO. C’est une réalité. Il attaque son «Work To Do» au chaud d’intonation à la Otis, il perpétue cette vieille tradition d’émotion contenue qui fait la force de la Soul, il chante au chaud-bouillant de son âme. En cours de set on sent sa mâchoire se décrocher à plusieurs reprises, surtout quand Lee pique sa crise de hurlette de Hurlevent au terme d’un «Love Prisoner» lancinant et harassé par des brisures de rythme, set me free, implore-t-il, mais la Soul est un long parcours, c’est du all nite long, le nègre a l’endurance qu’un blanc n’a pas, même sous coke. Deux siècles d’esclavage, ce n’est pas rien. Set me free ! Il prend le prétexte d’un drame sentimental pour hurler son set me free/ I’m your love prisoner/ Set me free. Well done, Lee !
Il sait aussi enflammer les imaginaires avec du funk politicard - We can make the world better/ If we come together - Comme Mavis, il y croit encore. D’ailleurs il fait pas mal de participatif dans le show, il sollicite énormément le public, lui demande de chanter avec lui, de taper dans les mains, de remuer les bras en l’air ou d’embrasser sa voisine. Sacré Lee, il sait chauffer une salle. C’est son job, il le fait merveilleusement bien et son orchestre de petits blancs tient sacrément bien la route. À noter qu’on y trouve deux Jay Vons, le guitariste et le keyboardist - It’s time for me to sing that song called a Faithful Man and it goes like this - Il renoue avec le déchirement suprême, il rallume la chaudière de la Soul la plus hot de l’histoire, celle de James Brown. «Faithful Man» est l’un de ses tubes les plus convaincus d’avance. Il l’arrose de screams terribles et tire sa sauce à n’en plus finir. Typiquement le genre de cut qu’on aimerait voir continuer. Tank you ! Thank you ! Lee se montre éperdu de gratitude, il revient hurler comme James Brown dans son micro, please don’t baby ! Il faut pourtant se résoudre à le voir partir. Oh mais il va revenir !
Il faut écouter le nouvel album du dernier des grands Soul Brothers. Il ouvre le bal d’It Rains Love avec le morceau titre. Il n’a aucun problème de puissance. Il y va de bon cœur, porté par un bassmatic de rêve. On se retrouve dans une prod épaisse et bien cogitée, une prod à grumeaux, finement parfumée d’excellence de la pertinence. Cette Soul cabossée ressemble à l’étain blanc qui a vécu. Lee Fields sort un «Two Faces» aussi âpre et dense qu’un hit de James Brown. Il fait de la Soul à crampons qui accroche bien. Il finit son cut au beat défenestrateur. Il fait ensuite du Bobby Womack avec «You’re What’s Needed In My Life». Cet admirable Soul Brother avance dans le son à pas mesurés et en chaloupant des hanches, soutenu par des chœurs de filles saturnales. Ça sonne comme un hit des temps modernes. Tu as ça dans l’oreille et tu vas au paradis du Soul System. Quel aplomb ! Il envoie une nouvelle giclée de heavy Soul avec «Will I Get Off Easy». Il chante au ciel, c’est un perçant, un puissant seigneur, il n’a pas besoin de scream. Sur la pochette, il a l’air d’un pharaon serré dans une veste d’écaille. Il chante son «Love Prisoner» à l’avenant, dans les règles de l’art du set me free. Il fait du pur James Brown à coups de Please have mercy on me. Il reste dans cette Soul de pleine voix avec «A Promise Is A Promise», il la télescope en plein vol et revient à la profondeur avec «God Is Real». Il chante à outrance et nous laisse un bel album. Il termine avec «Don’t Give Up» et ne lâche pas la rampe. Il souffle la poussière des volcans et les nappes de violons. Ce petit black possède une voix qui nous dépasse.
My baby love/ My honey dove. Que ne donnerait-on pas pour le voir chanter cette merveille une fois encore. Lee Fields y atteint les niveaux jadis atteints par James Brown («It’s A Man’s Man’s World) ou Marvin Gaye («What’s Going On»), avec en plus un sens de l’extase combinatoire unique dans l’histoire de la Soul. Il finit en mode apocalyptique comme sut si bien le faire Otis en son temps dans «Try A Little Tendreness». À la fin, ce héros titube, comme vidé, mais il revient shooter get up ! Yeah yeah !
Signé : Cazengler, Lee Fiel
Lee Fields. Le 106. Rouen (76). 21 janvier 2020
Lee Fields & The Expressions. It Rains Love. Big Crown 2019
30 / 01 / 2020 – PARIS
SUPERSONIC
CARIBOU BÂTARD / DYE CRAP
JOHNNY MAFIA
Rendez-vous au Supersonic. Qui fête ses quatre ans d'existence et lance son magasin de disques. Longtemps que je voulais voir Johnny Mafia, depuis qu'ils ont tourné avec Pogo Car Crash Control. Genre d'accointances prometteuses que j'aime bien. En plus deux groupes inconnus mais qui viennent du pays du Cat Zengler. De Rouen, une ville qui chauffe dur depuis au moins la sainte année 1431, le bûcher de Jeanne d'Arc. Pour ceux qui n'étaient pas présents le jour de ce funeste événement, la lecture de Le ravin du loup ( et autres histoires mystérieuses des Ardennes ) de Jean-Pierre Deloux s'impose.
CARIBOU BÂTARD
L'on n'a jamais su qui était le caribou et qui était le bâtard, mais vu qu'ils ne sont que deux sur scène nous n'avions qu'une chance sur deux pour nous tromper. Batterie + guitare, le binôme rock par excellence, peut-être économique. Sûrement pratique. C'est fou ce que l'on rencontre de caribous dans les romans d'aventures canadiens, se font systématiquement et bêtement abattre par des chasseurs émérites. Notre Caribou Bâtard a compris la leçon, la meilleure façon de ne pas mourir c'est de vivre et pour cela de se battre. Donc sur la droite vous avez un batteur fou. Vite, fort et bien. Peut faire mieux : très vite, très fort, très bien. Pas une seconde d'arrêt. Enchaîne les titres comme un forcené. En plus il chante, paroles sommaires et répétitives. A la cadence avec laquelle il frappe, vous comprenez qu'il ne lui reste plus assez de cerveau disponible pour se lancer dans la haute littérature. Un registre de voix plutôt étrange comme s'il la montait au plus haut de son octave naturel afin de se frayer un chemin dans le délicieux tintamarre qu'il déverse sur le public. Douche de décibels indélébiles dans vos oreilles. En plus il réussit ce tour de force de ne jamais vous ennuyer, à fond de train, à une cadence infernale, mais il sait varier les rythmes et les factures ( véritables coups de bambous ) architecturales de chacun des morceaux.
Mais que serait le rock sans guitare ? Le n'ai pas le temps de répondre à cette angoissante question métaphysique. Ce n'est pas que je ne connais pas la réponse, c'est que le guitariste m'en empêche. Vous voulez de la guitare, et vlan il vous file le grondement assourdissant qui accompagnera la fin du monde et dont Jean aurait dû noter la présence dans son Apocalypse. En tout cas chez Caribou Bâtard ils n'ont pas oublié son indispensable tonitruance. Cette machine tue les fascistes avaient noté Woodie Guthrie sur sa guitare, celle de Caribou elle ne se perd pas dans de subtiles et arachnéennes distinctions, elle tue tout le monde, c'est beaucoup plus efficace. Au moins ils sont sûrs de n'oublier personne. Je me risquerai à oser le concept de sonorité submergeante pour qualifier cette monstruosité sonore. Si vous êtes sonophobe, sortez fumer une clope, pas devant la porte, de l'autre côté de la rue, si vous êtes sonophile tentez de rester, si vous êtes mégasonophile ce set est pour vous. Les amateurs apprécieront cette guitare qui pétarade divinement dans votre cerveau, à la manière du générique de L'Equipée Sauvage, certes il ne vous restera plus beaucoup de neurones par la suite, mais au moins une fois dans votre vie, vous aurez vécu quelque chose, c'est si rare de nos jours que je pense que bientôt que tout le monde voudra un Rangifer Tarandus comme animal de compagnie. Précisez bien la sous-espèce, le caribou toundrique possède cette mauvaise habitude de bouffer la moquette, mais avec le Caribou Bâtard, il éliminera vos voisins indélicats avec une célérité ahurissante. Sont épuisés à la fin du set, alors pour les récompenser le public leur offre un bruit d'enfer.
DYE CRAP
Quatre sur scène. Non ils ne sont pas là pour faire de la surenchère sonore. Même que pendant qu'ils attendent le batteur parti on ne sait où, l'on patiente à écouter les caresses cordiques bienfaisantes de la guitare Vox, la forme d'une mandoline ou d'une larme, mais de crocodile, car si elle peut vous émouvoir grâce à sa parfaite musicalité, elle sait devenir sans préavis aussi tranchante que l'ivoire de ces amphibiens somme toute peu sympathiques.
Les voici au complet. Démarrent sans plus attendre. Ils ont le son, ils ont l'énergie, ils ont le savoir-faire, vont vous dérouler le show comme un tapis rouge devant les grands hôtels parisiens de luxe. Ce n'est pas ce que j'appelle du rock, mais de la pop. La différence entre les deux peut sembler hasardeuse. Mais dans la pop même si le tapage nocturne a empêché le client de dormir, on lui offrira au petit matin une séance sauna-relaxation-épilation intégrale gratuite pour le dédommager. Que voulez-vous le caca coloré aux senteurs de rose ça fleure plus bon que bon. Alors Dye Crap ils ne ménagent pas leur peine, il y a des batteurs sur lesquels les groupes se reposent comme ces familles qui piquent-niquent sur la pierre tombale de leur cher défunt, et d'autres qui emportent les copains en un tourbillon de feu. Celui de Dye Crap est un escalator volant, fend l'air à la vitesse d'une fusée et comme les deux guitares lui emboîtent les réacteurs au quart de tour vous n'avez pas le temps de regarder votre montre. Bassiste et chanteur, le guy se défend bien, l'a une voix qui porte et qui accroche, lorsque le machine est lancé, Dye Crap est une belle machine de guerre. Mais ils vous ménagent aussi des instants d'autoroute, des aires pique-nique avec toboggans pour les enfants et des sous-bois pour promener le chien, c'est là où je m'ennuie un peu, mais autour de moi, l'on apprécie les jeunes filles ferment les yeux et se laissent bercer par cette houle de bon aloi, qui vous porte et vous balance sans brutalité. Mais au bout de cinq minutes, c'est encore une fois la séquence speed, qui vous fait traverser la moitié de l'Atlantique en moins d'un jour, et alors que vous croyiez toucher au but, retour au clapotis rassurant dans les moiteurs tropicales. Si vous avez rêvé de naufrage et d'un radeau de survie poursuivi par un cachalot affamé, c'est raté. Faut reconnaître qu'ils savent alterner le bien et le mal. Vous plongent en enfer mais vous renvoient au paradis. La salle adore, elle hurle dès que les flammes comminatoires s'approchent et ronronne de plaisir dès que les heaven gates s'entrouvrent. Un bon moment. Mais je préfère les mauvais. L'utile et agréable c'est bien mais l'inutile et le désagréable, c'est mieux.
Dans l'inter-set, sur ma gauche mon voisin opine, oui ça ressemble un peu à Muse ce qui m'amuse, mais sur ma droite une de mes voisines se rebelle contre cette comparaison qu'elle trouve profondément déplacée et injuste. Ô ma muse, je suis désolé !
JOHNNY MAFIA
La faute à leur réputation. M'attendais à des visages burinés de durs à cuire échappés du bagne, poursuivis en hélicoptères par des tueurs à gage, pactisant avec des tribus anthropophages, traversant les pieds nus sans sourciller des jungles luxuriantes infestées de serpents, mais non, Théo, Fabio, William, et Enzo, n'ont même pas l'insolence hautaine de la jeunesse, sont souriants, amènes, des looks de lycéens, pour certains d'entre eux un peu abruptement tignassés mais sans plus, par contre ils sont très mal entourés.
De jeunes gens très mal élevés. Les filles comme les garçons, vous savez ma bonne dame tout se perd en ce bas-monde. Ils ne savent pas se tenir. Et encore moins se retenir. Un signe qui ne trompe point. Très vite les photographes ont arrêté de photographier les artistes. Une photo par-ci, une autre par-là, parce que tout compte-fait ils étaient venus pour eux, mais ils ont préféré braquer leurs appareils reproducteurs sur cette masse d'agités. Les éditorialistes alarmistes ont raison, la mafia est partout et gangrène tout. Ce soir par exemple elle était aussi bien sur scène que dans le public.
'' Ce soir, exceptionnellement nous allons commencer par un solo de batterie'' nous ont-ils prévenus. Ultra-mensonger. Ils n'ont pas du tout débuté par un solo de batterie, ou alors z'ont juste fait un solo qui a duré tout le set. D'un bout à l'autre sans arrêt. Dans les tempêtes les plus dévastatrices, faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue pour garder la barre. Chez Johnny Mafia, c'est le batteur. L'a mouliné grave et sec, de toutes ses forces, tant pis si parfois il a même recouvert basse et guitares. Le genre d'incidents totalement anodins. Pas de quoi en faire des gorges chaudes, de toutes les manières le spectacle n'était pas sur la scène quoique tous les yeux étaient braqués sur eux. Alors ils ont fait comme tout le monde. Non ils ne sont pas descendus dans le public. Mission impossible. Ça criait, ça hurlait, ça tanguait, ça s'écroulait, ça se relevait, ça tourneboulait, ça réclamait des titres, ça interpellait, l'on a même vu un soutient-gorge atterrir sur le manche de la basse, de temps en temps ça s'affaissait dangereusement d'un côté puis de l'autre, il y avait des poussées subites de fans pliés sur les retours, eux ils continuaient leur cirque, des morceaux courts méchamment jerkés, entre Ramones et Wampas, cent pour cent Johnny Mafia, puis il y a eu des gars qui se sont faits promener sur les mains des copains, des jambes en l'air désespérées, des têtes qui ont évité des poutrelles de fer par miracle, peut-être certaines se sont-elles entrouvertes en touchant le sol à la manière de ces coquilles d'œufs que vous fractionnez sur le rebord du saladier, des gens qui vous tombaient dans les bras, d'autres qui vous poussaient dans le gouffre, le public n'était plus qu'une masse gélatineuse mouvante se ruant tantôt dans un sens, refluant vers un autre au mépris de toutes les lois de la gravité. Preuve que c'était très grave. Alors comme ils ne pouvaient pas descendre parmi nous – je reprends le fil du récit – le chanteur est monté sur nous, il a refilé son micro à un quidam compressé dans le pudding humain, il a tout de même gardé sa guitare, et là il a été splendide, l'a joué à King Kong sur l'Empire State Building, certes il n'est pas allé plus haut que le premier étage, mais aucun avion de chasse n'est intervenu, s'est accroché comme il a pu et est parvenu à enjamber la rambarde du balcon. N'y avait plus qu'à attendre qu'il revienne, on l'a suivi à la trace auditive pendant qu'il descendait les escaliers.
Si vous croyez que cet exploit à calmé le public, vous avez tort. La horde de fans gesticulait tellement que nos johnnymen ont essayé la technique du bateau pirate qui se sert des pièces d'or de leurs sanglantes rapines pour mitrailler à bout portant le gros vaisseau de ligne qui fonce sur eux. Z'ont refilé leur guitare à l'assistance, tenez c'est pour vous faites-en ce que vous voulez, elle a voyagé de main en main, mais chacun s'est trouvé dans le cas du molosse meurtrier à qui vous avez jeté un os à moelle en peluche et qui ne sait comment se dépatouiller du cadeau trop mou pour ses canines, alors la guitare leur est revenue sagement. Ne sont pas restés sur cet échec, sont des pédagogues, ils savent que la répétition est la base d'une saine pratique éducative, en ont tendu une autre à un grand gaillard en lui désignant les retours, le gars a hésité deux secondes, allait-il la fracasser tout de go, l'a opté pour la production de larsen, une note délicate dans le remue-ménage collectif. Vous connaissez le principe centenaire des mafieux, tu travailles pour nous, nous on te couvre. Z'ont intimé à un gars de s'occuper du micro, et à un autre de riffer comme si sa seconde vie en dépendait. Sont malheureusement tombés sur des timides, alors ils se sont vengés sur un téméraire qui était grimpé sur scène, lui ont passé deux guitares autour du cou, le zigoto était ligoté comme Houdini, en mieux car pas enfermé dans une malle, l'on a pu assister à ces efforts maladroits pour retrouver la liberté.
La chienlit aurait dit un célèbre général. Un chahut-bahut-dahut comme l'on n'en fait plus. Musicalement, un peu foutraque, mais chaud, si chaud ! Un dernier conseil si vous voyez une annonce de leur concert dans votre patelin, mafiez-vous de Johnny. Ce sont des tueurs.
Damie Chad.
NOT SCIENTISTS & JOHNNY MAFIA
( 45 Tours / 2019 )
( Kicking Records / 112 )
L'ont annoncé durant le concert, 4 titres, 5 euros, après le concert ce fut la ruée, on se serait cru à l'amap du samedi matin quand on vous prévient que le kilo de topinambour a encore baissé. Chemise cartonnée présentée dans une pochette plastique. Design géométrique qui attire l'œil mais qui ne le retient pas assez longtemps. Le vinyle est d'un beau bleu tendre.
Side A : NOT SCIENTISTS : vous ne confondrez pas avec The Scientists groupe after-punk d'Australie, encore moins avec We-Are-Scientists des USA. Nos Not Scientists viennent de chez nous, sont composés d'Ed Scientist ( guitare, voix ), Jim Jim ( guitare, voix ), Thib Pressure ( basse ), Bizale le Bazile ( batterie ). Tournent en France et en Amérique du nord.
Bleed : entrée quasi-guillerette. Attention parfois la fausse joie est plus acerbe que l'acrimonie la plus violente. Une espèce de rocktournelle adolescente emplie d'énergie et de fierté blessée. D'autant plus dangereuse donc. Poison : Entrée emphatique et puis l'on se dépêche d'avaler la coupe de poison à pleins traits. Une rythmique qui galope et les voix qui explosent comme une caution mélodique. Comediante et tragediante, voici que la musique se met à retentir d'accents mélodramatiques à l'espagnole. Mais l'on revient à quelque chose de plus typiquement rock anglais avec fin échoïfiée.
Side B : JOHNNY MAFIA : On les entend beaucoup mieux qu'en concert. Surtout les guitares. Davantage mélodiques aussi. Voix comme épaissie. De beaux vrillés de guitares. Ressemblent un peu à des groupes anglais de la belle époque. Eyeball : des espèces d'allées et venues de guitares fabuleuses, ça s'en vient et ça s'en va. Au milieu du morceau une espèce de cafouillage mélodique inventif et l'on repart pour ne pas terminer, soyons précis le début du morceau suivant est comme enchâssé dans la fin du dernier. A moins que ce ne soit le contraire. Spirit : comme des tremblés de guitares et puis les voix surviennent, ce sont-elles qui prennent le lead. Qui mènent la mélodie, la batterie en oublie son battement par trop entêtant. Il y a encore une petite surprise dans ce morceau comme dans le précédent. Johnny Mafia quitte l'autoroute sur laquelle ils s'étaient lancés à pleine puissance, comme s'ils avaient un truc de trucker urgent à montrer à leur passager. Qui le changera de l'habitude de vivre.
Deux groupes qui ne se sont pas associés artificiellement. Se ressemblent même presque trop.
Damie Chad.
EN VIVO / A CONTRA BLUES
( Enregistré les 17 et 18 mars 2012
au Conservatoire de Liceo / Barcelone )
Souvenez-vous c'était au mois d'août 2016, je vous racontais l'histoire de cette petite fille écrasée de fatigue et de froid dans son camion, en pleine nuit ariégeoise, j'aurais parié pour sa mort sous hypotension prochaine, quand je l'ai vue installée derrière la batterie d'A Contra Blues, je me demandais si elle aurait la force de soulever une baguette, et tout de suite en trois coups elle a nous a offert Tchernobyl et Hiroshima sans amour, une frappe atomique, et à ses côtés cette espèce de géant issu d'un conte de sorcières, chaque fois qu'il ouvrait la bouche il y avait un building qui s'écroulait à Chicago, un des meilleurs concerts de blues que je n'aie jamais entendu. ( les amateurs se reporteront à la livraison 293 du 08 / 09 / 293. )
Et hier dans la pile de CD's, celui-ci encore enveloppé dans son emballage transparent ! Non ce n'est pas une malheureuse inadvertance, c'est pire qu'un crime contre l'humanité, c'est in crime contre le blues.
Alberto Noël Calvilla Mendiola : guitare / Hector Martin diaz : guitare / Joan Vigo Fajin : contrebasse / Jonathan Herrero Herreria : vocal / Nuria Perich chastang : batterie.
Everyday I have the blues : certains l'ont plus davantage que d'autres, l'on se souvient des versions inoubliables de B.B. King et de Memphis Slim, longues et lentes déclarations d'amour haineux au blues, chez A Contra Blues l'on ne flemmarde au lit au petit matin en se réveillant, pas question de s'apitoyer sur soi-même, ils n'ont pas à proprement parler le blues, mais la fièvre du blues, vous sentez la différence tout de suite, un tempo mid-jazz, mi-funk pour commencer, ensuite c'est la dégringolade, Jonathan vous jette son vocal comme s'il était en train d'invectiver un taureau qui retarde un max le moment de la mise à mort, ensuite une guitare qui s'énerve méchant, mais c'est Nuria qui vous exécute la bête avec le solo de batterie expéditif qui tue. Standing at the crossroad: attention avec un tel titre l'on rentre dans la mythologie blues par excellence, commencent par là où les autres finissent, le solo de guitare qui klaxonne d'habitude en fin de morceau vous arrache ici les oreilles dès le début, et puis shuffle vénéneux toujours parsemé de stridences cordiques et Jonathan qui vous mollarde le vocal comme une lettre d'insultes à votre banquier, ne s'attardent guère au milieu du carrefour, vous expédient le tout en un final définitif au diable vauvert. Yon never can tell : qui dit blues, dit rock, c'est logique, une association d'idées naturelle, et pan un classique, Jonathan nasille encore mieux que Chuck Berry, certes à la fin il n'y tient plus et vous jette les dernières pelletées de mots à la manière des croques-morts pressés de terminer le boulot avant la pause-déjeuner, et l'orchestre derrière, ben il n'oublie pas sa nationalité espagnole, n'ignore pas que le grand Chucky n'a pas fait que du rock, l'avait aussi une prédilection pour le calypso-caribean, alors il s'y colle à merveille, les guitares deviennent langoureuses et Nuria vous bat la marmelade comme si elle accompagnait Compay Segundo à la Havane. Guitar man : l'on connaît l'anecdote Jerry Reed convoqué par Elvis pour jouer de la guitare sur sa reprise de Guitar Man et le pauvre Jerry tellement ému qu'il est obligé de s'isoler dans sa bagnole pour retrouver le riff qu'il n'arrivait pas à sortir devant le King, Jonathan lui rend un bel hommage et puis se jette sur le vocal pour le bouffer tout cru, vous le descend à la vitesse de ces piliers de bistrots marseillais qui vous enfilent un mètre de pastis en moins de trente secondes, derrière guitares et contrebasse sont à la fête, vous expédient le bébé vitesse grand V. 44 : chasse gardée pour Jonathan, un morceau taillée à la démesure de sa voix, les musicos vous font un beau raffut sur les deux ponts, mais Jonathan se la joue un peu à la Tom Jones survitaminé, étale ses octaves comme d'autres le linge sale à la fenêtre. Spoonful : retour au blues le plus pur, le morceau roi du disque, du pain bénit pour la contrebasse de Joan, Un bel hommage à Howlin' Wolf, Jonathan ne tombe pas dans le piège de coller au phrasé enroué du loup du blues, nous la joue à Peggy Lee sur Fever, mais il reste fidèle à l'esprit du blues par deux longs passages de spoken words du meilleur effet, le public se prête au jeu et hulule en douceur pendant que Nuria caresse ses cymbales, les guitares restent discrètes se contentant de claquer en fin de vers comme les rimes des sonnets de José-Maria de Heredia. Wine : du blues alcoolisé au rock'n'roll, le shuffle parce que le corps tangue, mais le vocal explose car dans votre tête tout s'entremêle et les guitares deviennent folles. How blues can you get : dissipation des vapeurs, lendemains d'extase et jours de solitude, à la B. B. King, les guitares qui envoient des notes à l'économie, de temps en temps, mais qui font mouche à chaque fois. Toute la tristesse du monde tombe sur vous. Vous êtes foutus, heureusement qu'Alberto et Hector enfilent des perles sur les cordes de leur guitare et finissent par vous offrir un collier de rutilances qui ne tardent pas à se dissiper dans le néant du désespoir. Tempête en fin de morceau. Night time is the right time : longue présentation des musicos et de la team d'accompagnement en milieu de morceau, avaient commencé en force terminent en beauté accompagné par le public qui s'époumone avec plaisir.
Blues éclectique mais de la meilleure farine dont on fait les biscuits royaux. Un Regal !
Damie Chad.
UN SIECLE DE POP
HUGH GREGORY
( Vade Retro / 1998 )
Pas un livre de plus sur le rock'n'roll. Le titre n'est pas menteur. Pop au sens de musiques populaires. Pluriel non hasardeux. En entrouvrant le livre rapidement vous glanez au hasard quelques noms en grosses lettres, Glenn Miller, Buddy Holly, David Bowie, Rolling Stones... mais ce n'est pas le récapitulatif des grandes vedettes du rock'n'roll et de la pop qui sont chronologiquement épluchées une à une. Le book ne s'intéresse pas aux individus mais aux courants musicaux, exemple vous n'apprendrez pas l'essentiel que vous devez savoir sur Elvis Presley, juste quelques rudiments de base, et la notice ne s'attarde pas uniquement sur la divine personne du King, très vite elle embrasse toute la période et cite quelques pionniers, sans s'attarder outre mesure. En gros un amateur de rock connaît cela par cœur. N'empêche que le bouquin est bien fait.
Cela fonctionne à la manière d'une mosaïque labyrinthique mobile. Un jeu de go à vous rendre fou, à vous faire perdre vos certitudes. C'est qu'aucune tesselle ne possède un emplacement vraiment fixe dans le dessin final. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez la placer n'importe où. Même si en y réfléchissant quelque peu il point en vous le désir anarchisant de décréter que sa place pourrait se nicher en n'importe quel endroit et cette idée absurde n'est pas aussi idiote et illogique qu'il n'y paraîtrait.
Hugh Gregory vous vient en aide. Attardez-vous longuement sur les deux premières double-pages, à la limite vous n'avez plus besoin de lire la suite, la première ne vous sera compréhensible qu'après avoir vu la deuxième, mais prenez toutefois le temps de l'étudier. La tentation de passer très rapidement sera grande, ce n'est que la table des matières ! Première constatation, quel charcutier ce Gregory, ne voilà-t-il pas qu'il vous découpe l'histoire de la musique populaire en tranches égales à la manière d'un salami. La dernière est légèrement moins épaisse ( un dixième ) mais l'on ne peut lui en vouloir, elle s'arrête en 1999 et non en 2000, normal le livre est sorti en 1999 en sa version française. Je ne sais si en Angleterre elle s'arrêtait en 1998 !
Certes nous utilisons très facilement les expressions sixties, seventies... pour désigner les périodes de notre musique, mais ce découpage nous paraît à première vue bien superficiel. Et puis tout de même il y a des trucs qui clochent : pourquoi par exemple ranger les Rolling Stones dans la décennie 1980 – 1990 à côté de la House et du Hip-hop. Et cette fin en queue de poisson, terminer sur la rubrique La musique de films que vous n'attendiez pas obligatoirement, l'on a l'impression que l'auteur abandonne son armée de lecteurs en pleine campagne en ne leur spécifiant même pas qu'ils doivent maintenant se débrouiller par eux-mêmes pour rentrer chez eux. Leur a tout de même laissé quelques indices, les petits filets de couleurs différentes associés à chaque période temporelle.
Il est temps de tourner la page. Le plan s'étale devant vos yeux. Vingt-six rectangles de sept couleurs différentes, sagement alignés comme des petits soldats. Entre eux des flèches qui se dirigent de l'un à un autre et qui dessinent un véritable parcours labyrinthique. Et là tout s'éclaire. Remarquez toutefois que la lumière a peut-être été conçue pour donner plus d'importance à l'obscurité primordiale. Je prends un exemple réduit à l'état squelettique : avez-vous déjà pensé que l'influence des musiques orientales s'est exercée aussi bien sur le bhangra, le funk et le Heavy Metal... Certes vous pensez à Kashmir de Led Zeppelin, par contre si vous n'avez que des notions très floues quant au banghra faire un tour par ce bouquin, il pourrait vous aider. ( Vous le trouvez à moins de trois euros sur le net ) Tout ceci pour vous expliquer pourquoi les deux pages consacrées à Miles Davies se rencontrent dans la dernière décennie du siècle précédent alors que son chef d'œuvre Kind of blues date de 1959, et In a silent way de 1967. Hugh Gregory s'intéresse avant tout aux influences tant historiques ( transfert des populations, migrations ) que technologiques ( électrification de la guitare, apparition de l'appareillage électro-acoustique dans les foyers, apparition de la radio et de la télévision... ).
Reste que la lecture de l'ensemble de l'ouvrage se révèle enrichissante. Une étonnante constatation, les cinq premières décennies sont les plus passionnantes. Ce n'est pas que l'auteur ait bâclé les dernières, c'est que la première moitié du siècle est en quelque sorte quantitativement moins riche. Irremplaçable certes, et vraisemblablement musicalement la plus authentique, mais il n'y a pas la profusion d'artistes qui ira en un galop exponentiel par la suite. Pour le tout début manquent les enregistrements, ce qui est un énorme frein quant à la vision subséquemment parcellaire de ces époques lointaines quelque peu floutées. La synthèse des rares données s'en trouve de ce fait facilitée.
Deuxième constatation : le livre n'est pas partisan. Gregory nous parle de musiques populaires, ce que nous pouvons traduire par qui plaît au peuple, et l'on s'aperçoit que le rock ( en englobant ce que lui dissocie en Rock'n'roll / Rockabilly et Rock en un sens beaucoup plus large quasi-totalitaire ) n'est pas selon nos préférences le vecteur principal des goûts du public. Que votre fierté de rocker n'en prenne pas un coup, au contraire, plus le rock sera minoritaire plus il retrouvera sa pernicieuse faconde. Ce sont les minorités actives qui mènent le monde car elles portent en elles la faculté d'influencer les modes de vie. Même s'il brouille un peu le message en ne différenciant pas ce qui tient de la musique au sens strict et de la culture au sens large et surtout en employant le terme rock par trop générique pour traiter du travail des majors dont Hugh Gregory dénonce l'effet délétère sur sa transformation en musique grand public. Donne tout de même l'impression de plaider pour un affadissement de la production au cours des années. A le lire on se demande comment il envisage la production actuelle des cinq premiers lustres du troisième millénaire...
Remet un peu la hiérarchie des vaches sacrées en place. Par exemple pas de pages génériques consacrées au mouvement hippies, aux bikers, teds et autres '' mauvais garçons''. Entre musique blanche et musique noire, son cœur balance pour la noire, la soul au détriment du rock'n'roll, c'est elle qui mène le bal, plus organique, plus matricielle, plus morcelable, plus fertile, moins figée. La musique européennes dont il discerne les racines les plus profondes, la musique savante '' classique '' religieuse et profane, notamment l'Opéra, et la folklorique plus vivante mais un peu ossifiée par la préservation qu'en effectuèrent les générations venues du continent, une conservation formelle à comprendre comme un signe identitaire de rattachement à leurs origines, aurait par ses charpentes structurelles empêché toute liberté créatrice si ce n'est par une déliquescence des plus mortifères. Des chansonnettes de Tin Pan Alley à l'easy listenin d'aujourd'hui, la pente fatale se serait poursuivie sans anicroche. Pensons à Eno qui jouit d'une réputation de novateur et sa Music for Airports de 1978, comme si l'originalité aboutissait à la revendication de la notion d'insignifiance. Le savoir-faire se métamorphosant en manipulation mentale. Les originelles percussions africaines frappant encore à la porte du paradis pour demander à y entrer. Quand on entend le rap-variétoche que diffusent les stations nationales de par chez nous l'on se demande si elles n'ont pas réussi à s'asseoir à la droite du bon dieu blanc. Cantiques édulcorés pour tout le monde.
Livre qui pousse à réfléchir, pour aider à cela, un index final n'aurait pas été de trop. De même, parfois les photos deviennent envahissantes. Bizarrement la section que j'ai préférée traite de la house. Ce n'est pas que j'éprouve une quelconque satisfaction à l'écouter. Un son trop monotone et trop maigrichon à mon humble avis. Mais quand ce mouvement est apparu en nos vertes contrées je participais à une radio locale et deux jeunes collègues avaient réussi à fédérer autour de leur émission, je ne me souviens plus de son titre ( cinq fois par semaines, horaires en fin d'après-midi ) toute une jeunesse qui habitait dans des patelins perdus dans les fonds désertiques de la Seine & Marne, longtemps depuis les tout premiers disques des Rolling Stones que je n'avais ressenti une telle ferveur chez des ados d'une quinzaine d'années. Rassurez-vous, l'émission fut vite supprimée ! Pour une fois qu'une chronique offre une fin morale vous n'allez pas vous plaindre !
Damie Chad.
11:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gene vincent, sleepy labeef, lee fields, caribou bâtard, dye crap, johnny mafia, not scientists, a contra blues, pop musiques
29/06/2016
KR'TNT ! ¤ 288 : RONNIE SPECTOR / LEE FIELDS / HELLEFTY / CRASHBIRDS / NINA SIMONE / LEROI JONES / ZINES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 288
A ROCKLIT PRODUCTION
30 / 06 / 2016
|
RONNIE SPECTOR / LEE FIELDS HELLLEFTY / CRASHBIRDS NINA SIMONE / LEROY JONES / ZINES |
NEW MORNING / PARIS X / 22 - 06 - 2016
RONNIE SPECTOR
RONNIE BIRD
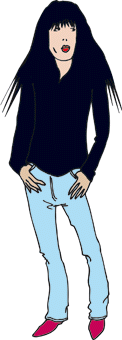
Avant de s’appeler Ronnie Spector, elle s’appelait Veronica Bennett. Elle tenait sa couleur de peau d’un joli métissage : père irlandais et mère métisse d’indien Cherokee et de noir, comme Jim Hendrix. Elle chantait dans les Ronettes avec sa grande sœur Estelle et une cousine nommée Nedra Talley. Elles habitaient toutes les trois Spanish Harlem et adoraient Frankie Lymon. Veronica passait ses journées à la fenêtre de sa chambre à regarder les filles de Spanish Harlem déambuler avec des grosses coiffures et des clopes au bec. « I loved that tough look ». Oui, Veronica aimait beaucoup ce look des filles de la rue. Et puis un beau jour la vie des Ronettes vie bascula dans le rêve : Phil Spector les prit sous son aile pour les transformer en pop stars.
Avec Phil les choses ne traînaient pas. Il lui fallait des tubes, et vite fait. Il voulait aussi des nuées de maçons pour bâtir le plus gros wall of sound du monde. C’mon ! Il savait où trouver des collègues pour l’aider à composer des tubes. Il allait taper aux portes des petits bureaux du Brill Building où besognaient les auteurs compositeurs salariés :
— Salut Cynthia, salut Barry ! Alors, et si on composait un petit hit planétaire pour mes nouvelles protégées ? Ça vous dit ?
— Chouette idée, Philou ! Tiens, regarde, il pleut ! On pourrait faire un truc sympa sur la pluie, pas vrai ?
Et Cynthia Weil se met à pianoter une mélodie effarante.
— Tatata, walking in the rain... Tatata, pas mal, hein, Philou ?
— Ouais, c’est pas mal, Cynthia, mais monte un peu à l’octave, là, pour embarquer ton thème, oui là, tatataaaaaaa, aw fuck, quelle mayotte, ma cocotte ! Fuck shit up, on va encore défoncer la rondelle palpitante du Billboard ! Il finira par marcher comme un cowboy, le Billboard, si on continue comme ça, les enfants, ha ha ha ! Quelle merveille ! Rejoue-le, Cynthia ! Tatataaaaaaa, walking in the rain ! Veronica et les deux autres vont nous chanter ça aux petits oignons, vous allez voir !
Une chose est bien certaine : quand on écoute « Walking In The Rain », on frémit. C’est tout simplement dégoulinant de génie, mais un génie particulier, car attentif au global comme au moindre détail. Quant à ce jerk royal, « (The Best Part) Of Breaking Up », on le danse à l’Égyptienne, avec les poignets cassés. On sent les flux du River Deep. On sent le morceau destiné à traverser les siècles. Dans 2 000 ans, on dansera encore ce jerk royal des Ronettes. Et la fin démente, c’mon baby, fut reprise par Brian Wilson.

Phil file vers un autre bureau :
— Salut Ellie, salut Jeff ! Vous avez un moment ? On pourrait peut-être composer un petit hit pour mes chouchoutes de Spanish Harlem ?
— Oh, toi Philou, on sent que t’es amoureux...
— Hey Ellie, ne vas pas si vite ! Une chose que mon grand-père m’a apprise est qu’il ne faut jamais brûler les étapes, right ? Bon, alors, qu’avons-nous comme idée, chers tourtereaux ?
— I wonder...
— Ah pas mal, Jeff, c’est un titre ?
— Yeah, man !
— Alors, Ellie, pianote-nous l’un de ces petits jives dont tu as le secret....
— Écoute un peu ça, Philou ! Plonk plonk plonk !
— Aw ! Tremedous ! Quelle profondeur ! Vas-y monte-nous ça à l’octave ! I wondeeeeeer ! Pas mal ! Encore un coup de Trafalgar en perspective, hein ? Quelle belle mélodie qualitative ! Ça va leur jerker la paillasse ! T’aurais pas autre chose, Ellie ? Allez, arrête de faire ta mijaurée, tu as bien une idée de riff dynamiteur en tête...
— J’ai ça, Philou, écoute... Dessus, il faudrait des paroles du genre be/ my ba/ by, tu vois, bien ponctuées sur les accords, plonk plonk plonk, tu peux nous écrire des paroles, mon petit Jeff chéri ?
— Ouais ma poulette, attends, be my/ Baby/ Be my little baby/ Say you’ll be my darling/ Be my baby now/ Oh, oh, oh, oh !
— Bon Jeff tu ne t’es pas foulé sur ce coup-là, mais ça suffira. Merci Ellie pour ce nouveau coup de génie. Franchement, je ne sais pas ce qu’on deviendrait sans toi...
« Be My Baby » incarne le génie productiviste de Phil Spector à l’état le plus pur. Et le génie composital d’Ellie Greenwich à l’état le plus torride. Comme résultat de la combinaison des deux, on obtient le démarrage de refrain le plus foudroyant de l’histoire du rock. Fallait-il que Phil et Ellie soient géniaux pour nous servir une telle merveille ! Brian Wilson conduisait sa voiture lorsqu’il l’entendit pour la première fois à la radio. Il fut tellement frappé par la puissance de ce hit qu’il perdit le contrôle de son véhicule.
— Tu vas peut-être penser que j’exagère, Ellie, mais il me semble deviner au pétillement de ton regard que tu as encore une idée en tête.
— On ne peut rien te cacher, Philou. J’ai effectivement un truc qui me gratte l’ovule depuis un moment. Ça donne quelque chose comme ça... Plonk plonk plonk. Là-dessus, il faudrait chanter quelque chose du genre, Ba/ By/ I love/ You... Tu vois, Jeff chéri ?
— Ah oui, je le sens bien, mmmmm... On pourrait essayer ça... Come on baby/ Oh-ee baby/ Baby I love only you !
— Jeff, fais attention, tu pourrais te faire une entorse au cerveau, si tu fais trop d’efforts... Bon, on va mettre nos trois biquettes en studio demain matin et orchestrer ce nouveau hit greenwichien comme il se doit ! Merci de votre collaboration, mes amis !
« Baby I Love You » bénéficie d’une attaque démente. C’est l’archétype du couplet pop secoué aux tambourins. On est sidéré par l’extraordinaire classe de l’inventivité de Phil Spector et d’Ellie Greenwich. Et le refrain vaut aussi pour un archétype surnaturel. Il n’est pas surprenant que Joey Ramone soit devenu FOU de cette chanson.

Quand le premier album des Ronettes est arrivé en Europe, ce fut une déflagration atomique, mais au sens positif de la chose. On trouve aujourd’hui un autre album des Ronettes qui s’appelle « Volume 2 » et qui propose un sacré lot de petites merveilles du même acabit. Phil Spector composait des choses avec Harry Nillson, comme par exemple ce « There I Sit » intrigant car sous le vent et accompagné par des marteaux piqueurs. On trouve aussi une autre merveille signée Phil Spector, Cynthia Weil & Barry Mann, « (I’m A) Woman In Love », qui décolle à un moment, uniquement pour tétaniser les esprits. Retour d’Ellie avec « I Wish I Never Saw The Sunshine », une machine à jerker d’un éclat invraisemblable et qui explose à la face du monde. Aujourd’hui, on ne voit plus des montées comme celle-là dans les hits pop.
Phil et Ronnie se sont mariés, puis Ronnie s’est plainte de Phil. De 1968 à 1972, elle a vécu comme séquestrée dans leur belle villa d’Hollywood : barreaux aux fenêtres, clôture électrifiée, chiens de garde - All he wanted me to do was stay at home and sing Born To Be Together to him every night - Elle s’évada et divorça.
Et là, elle a commencé à en baver. Elle s’asseyait sur une réputation, mais elle n’avait plus que sa voix. Toute la magie d’antan s’était envolée. Pfffff, plus rien. Ce sont des gens comme John Lennon, Joey Ramone et Amy Whinehouse qui imitait son maquillage et sa coiffure qui l’aidèrent à revenir dans l’actualité.

En 1980, elle essaya d’enregistrer un album de rock new-yorkais, le fameux « Siren », mais ce fut douloureux, et pour elle et pour nous. Elle avait pourtant rassemblé une grosse équipe, Cheetah Chrome des Dead Boys à la guitare, Billy « Wrath » des Heartbreakers à la basse et d’autres gens avec un bon curriculum, mais les morceaux restaient d’une affligeante banalité. Elle attaquait pourtant avec « Here Today Gone Tomorrow » des Ramones. Elle enchaînait avec « Darlin’ », une sorte de petit hit bien balancé et solidement interprété, mais on était loin des fastes d’antan. Elle allait même chercher le « Anyway That You Want Me » de Chip Taylor popularisé par les Troggs, mais encore une fois, le jus céleste faisait gravement défaut. Phil en aurait fait un chef-d’œuvre, c’est évident. Elle sortait de cette aventure malheureuse avec « Happy Birthday Rock’n’Roll », l’occasion pour elle de tripatouiller la nostalgie et d’envoyer des extraits de « Be My Baby ».

Quelques années plus tard, elle réapparût avec un album encore plus médiocre, « Unfinished Business ». Elle tentait désespérément de retrouver la veine du Brill, mais ça ne marchait pas, car elle tombait dans tous les pièges de la prod des années 80. C’était carrément de l’abattage. Le disque était tellement mauvais que le disquaire qui le vendait me l’offrit. Le seul morceau sauvable de ce disque était celui qui se nichait en fin de face B, « Good Love Is Hard To Find », une petite pièce de r’n’b aux allures de good time music qui accroche bien car très vivace.
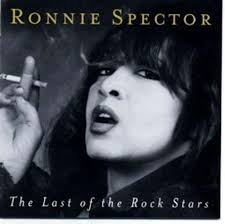
En 2006, Ronnie fit une espèce de come-back avec l’album « The Last Of The Rock Stars » et une palanquée d’invités : Joey Ramone, Keef, Nick Zinner des Yeah Yeah Yeah, les Greenhornes, les Raveonettes, Daniel Rey et quelques autres personnalités. « Work On Fine » sonnait comme un morceau de légende. Dans cette fabuleuse reprise d’Ike Turner, Keef donnait la réplique à Ronnie - yes darling - Ils en faisaient une merveille de groovitude. L’autre grosse pièce de cet album était « Hey Sah Lo Ney », une reprise de Mickey Lee Lane popularisée par les Detroit Cobras sous un autre nom, « Hey Sailor ». Avec sa version, Ronnie s’en sortait avec tous les honneurs. « Ode To LA » était une tentative désespérée de revenir au temps béni du Brill. Sune Rose Wagner des Raveonettes s’était cru autorisé à singer Phil Spector et Ellie Greenwich en proposant une pop-song aventureuse et en la produisant avec les pompes d’antan. Mais ça ne marchait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que Phil Spector est un génie, alors que Sune Rose Wagner n’est qu’un Danois. On retrouvait aussi sur cet album une nouvelle mouture du « Here Today Gone Tomorrow » des Ramones, épaulée par des backings chancelants qui lui donnaient une allure extraordinaire. Ronnie savait que Joey était dingue des Ronettes, alors Ronnie est devenue dingue des Ramones, ce qui semblait logique. Elle soignait tout particulièrement la petite montée de fin de cut. Sur d’autres morceaux, on entendait Daniel Rey jouer de la guitare, et pour tous les amateurs de gros rock new-yorkais, c’était un plaisir que de le retrouver au coin du bois.
Et puis soudain, nous voilà tous rendus en 2016 ! Il s’est écoulé 52 ans depuis l’irruption des Ronettes dans les hit-parades. Ronnie revient dans l’actualité avec un nouvel album et un concert au New Morning. Que peut-on espérer de mieux dans nos misérables existences ?

L’album s’appelle « English Heart », et comme son nom l’indique, c’est un album de reprises de hits anglais. Ronnie explique qu’elle est restée nostalgique de sa première tournée en Angleterre, alors elle tape dans « Because » des Dave Clark Five - Bekos ! Bekos ! - Elle y va avec toute la fougue de sa jeunesse perdue. Elle tape bien sûr dans les Stones qu’elle a bien connus avec « I’d Much Rather Be With The Girls » - une compo d’Andrew & Keef. Elle en fait un racket, transformant les girls en boys. Encore plus gonflé : sa version de « Tired Of Waiting » des Kinks, mais la voix ne colle pas, c’est trop putassier. Et ça continue avec les Zombies (« Tell Her No »), les Beatles (« I’ll Follow The Sun » - ce vieux b-side d’EP qu’on finissait par adorer), Sandie Shaw (« Girls Don’t Come »), et puis cette surprenante reprise d’« How Can You Mend A Broken Heart » des Bee Gees dont elle fait une version incroyablement osée, nappée d’orgue et pulsée au Spanish Harlem beat. Ronnie se prend au jeu et elle enchante sa nostalgie.

Oui, car désormais, tout cela n’est plus qu’une histoire de nostalgie. Voir arriver Ronnie sur scène, c’est voir arriver la fin d’une époque magique. Elle incarne ça aussi bien que les stars de son âge encore en activité. Elle dégage un truc que ne dégageront plus les nouveaux prétendants au trône. Il faut désormais accepter que ce chapitre de l’histoire du rock se referme. Et d’ailleurs, notre propre chapitre, c’est-à-dire celui des gens qui ont grandi avec, va se refermer avec. Voilà, ça se termine, mais au moins ça se termine en beauté.

Un seul concert de Ronnie Spector suffit à recréer cette magie perdue, à laquelle nous fûmes tant attachés et qui d’une certaine façon nous a façonnés, en nous protégeant de la médiocrité. Quand on écoutait les hits de Phil Spector ou de Brian Wilson, on ne pouvait pas s’intéresser à la variété française. Et Ronnie Spector sur scène, ça ne trompe pas. Elle apparaît toute de noir vêtue, silhouette impeccable, rayonnante, d’évidence ravie de l’accueil des Parisiens.

Elle crée aussitôt de l’émotion et paf, elle envoie « Baby I Love You » histoire de nous sonner un peu les cloches. Et tout le set sera placé sous le signe de l’émotion, car encore une fois, Ronnie tape au point le plus sensible de l’histoire du rock. Elle est accompagnée par trois délicieuses choristes et un backing-band irréprochable. Elle commente toutes ses chansons et le public boit ses paroles.

Elle quitte la scène pendant une version torride de « What’d I Say » et revient pour envoyer au firmament un « Walking In The Rain » qui n’a pas pris une ride. Bien sûr, ce n’est pas le wall of sound, mais par sa seule présence et par son charisme, Ronnie se situe bien au-delà de toutes les attentes. Elle incarne tout simplement la grande pop américaine. Elle a exactement le même genre de classe et de stature que Martha Reeves ou Mavis Staples. Et voilà qu’elle balance une version un peu funky de « You Can’t Put Your Arms Round A Memory » et quitte la scène en plein dans l’apothéose de « Be My Baby ». Au premier rang, on voit des mâchoires se décrocher. Rappel ? Pas rappel ? Si, rappel ! Elle fait un retour triomphant pour rendre hommage aux guys - A little dating with John - avec « I’ll Follow The Sun » qui passe mille fois mieux sur scène que sur son dernier album et puis c’est l’explosion atomique avec « I Can Hear Music », l’un des hits pop les plus ravageurs de l’âge d’or.

La petite métisse de Spanish Harlem mérite bien sa place dans l’Olympe des temps modernes, parmi les vivants et les morts, les dieux ailés et les dieux cornus.

Signé : Cazengler, un Spector des travaux finis
Ronnie Spector. Le New Morning. Paris Xe. 22 juin 2016
Ronettes. Presenting The Fabulous Ronettes Featuring Veronica. Phillies Records 1964
Ronettes. Volume 2. Phillies Records 2010
Ronnie Spector. Siren. Polish Records 1980
Ronnie Spector. Unfinished Business. Columbia 1987
Ronnie Spector. The Last Of The Rock Stars. High Coin 2006
Ronnie Spector. English Heart. Caroline Records 2016
Ronnie Spector. Nobody’s Baby. Lois Wilson. Mojo #256. March 2015
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 12 - 05 - 2016
LEE FIELDS

BATTLE FIELDS
— Morris ?
— Yeah Morris Levy speaking !
— James à l’appareil... James Brown...
— Ooooh Mister Dynamiiiite ! Que me vaut l’honneur ?
— Un petit service à te demander... Oh pas grand chose...
— Dis toujours...
— Figure-toi qu’un fucking nabot nommé Lee Fields me fait de l’ombre.
— Quel genre d’ombre ?
— En studio, et puis aussi sur scène. Certains journalistes commencent à insinuer qu’il est bien meilleur que moi...
— T’as vérifié ?
— Ben oui, mec ! Tu me pends pour une bille ou quoi ? Bootsy m’a ramené un disque du nabot. Son truc s’appelle «Dreaming Big Time». Je vis ça comme un affront mortel, Morris.
— Bon, je vois... Tu attends quoi de moi exactement ?
— Ben que tu règles le problème !
— Réglé comment ? Une balle dans chaque rotule ou l’éradication ?
— Même avec des béquilles, il serait encore capable de danser comme un funkster de la planète Mars. Non, il faut l’éradiquer, Morris, c’est plus sûr !
— Okay, James. J’envoie une équipe. Ça tombe bien, ils sont dans mon bureau, et ils se frottent déjà les mains. Mes associés ritals adorent casser du nègre, ha ha ha !
— Merci Morris, que Dieu te garde !
— Attends attends, on a oublié un petit détail...
— Quoi ?
— J’ai des frais, James ! Tu sais bien que je ne travaille jamais à l’œil ! Que penses-tu d’un petit pourcentage de 30 sur tes ventes de disques ?
— Heiiiiiiiiin ? Mais tu veux me mettre sur la paille, fucking jew !
— Fais gaffe à ce que tu dis, James !
— Mais 30% sur mes ventes, c’est des milliards de dollars, Morris !
— Bon alors 25, mais c’est mon dernier prix !
— Mais t’es malade !
— Encore un mot de travers et j’appelle ton copain Lee Fields pour lui faire part de notre conversation...
Il y a un grand blanc au bout du fil. Puis James reprend :
— Dac pour 25, mais je veux que ça soit réglé dans les 24 heures !
— Tu peux compter sur ton pote Momo ! Demain à la même heure, Lee Fields aura disparu sans laisser de traces...
Le lendemain soir, les deux gorilles de Morris Levy rentrent au bercail. Ils affichent tous les deux une mine fermée. Ils s’assoient sans dire un mot dans la banquette. Morris sort une bouteille de scotch du mini-bar et trois verres remplis de glaçons.
— Ça s’est bien passé les gars ?
— ...
— D’habitude vous êtes plus loquaces...
— ...
— Un problème ?
— Vas-y Lucky, raconte ça à Morris...
Le regard de Lucky reste noyé dans l’ombre du petit chapeau à la Sinatra.
— Bon, Morris, faut pas prendre la mouche. Ça s’est pas passé comme prévu...
— Quoi ?
— Attends, t’énerve pas.
— Vous n’avez pas fait le boulot ?
— Laisse-moi t’expliquer...
— Vas-y, je t’écoute...
— Bon, on est arrivés comme prévu, avec la tronçonneuse et les pelles dans le coffre. On est entrés chez lui par derrière. Carmine avait vissé son silencieux. Le fucking nabot était dans son salon. Il dansait devant la télé. Il a dû entendre le parquet craquer. Il s’est retourné, il nous a vus et il s’est mis à faire des pas de danse. Carmine a essayé de le buter, mais ce fucking nabot était vif comme l’éclair ! Il m’a sauté dessus, m’a mis un coup de karaté dans la pomme d’Adam et il a désarmé Carmine d’un coup qui aurait pu lui casser le bras. Ensuite, il nous a attachés tous les deux sur des chaises et il nous a obligés à écouter l’un de ses disques, «It’s Hard To Go Back After Loving You»...
— Et alors, bande d’imbéciles ?
— Le disque est sacrément bon, Morris ! Carmine et moi, on est devenus fans, ahhh mama mia !
— Vous vous foutez de ma gueule, j’espère...
— Sur la Vierge Maria, je te jure que ce disque est bon, Morris !
— Non, les gars, ça suffit, je trouve que votre blague a assez duré...
— Mais Morris, c’est pas une blague...
Une chape de silence tombe sur le bureau. Lucky reprend son monologue d’une voix encore plus grave :
— Tu devrais écouter un cut qui s’appelle «You Got Another Thought», c’est un boogie slow de rêve que tu peux danser avec une petite pépée bien roulée, tu vois ce que je veux dire ? Et puis t’as «A Sacred Man Can’t Gamble», un vieux funk amené à coups d’oh yeah et avec de grands airs ! Derrière Lee, t’as un mec qui fait des yeah quand il faut. Ahhhhh Morris, c’est fantastico ! C’est monté comme un coup de génie, Morris ! C’est pulsé et suivi à la trace par le poto d’oh yeah ! C’est un cut qui va te rendre dingo, Morris, tu peux me croire ! Et ça continue avec «All Up In It» ! Encore du jive de funk comme on n’en voit plus. Ce fucking nabot chante au sommet d’une dégueulade de soul de charme, c’est du James Brown sur-vitaminé ! Et sur ce disque t’as encore un truc de fou qui s’appelle «Freak On The Dance Floor», un cut de dance de rang royal. Là tu peux danser the night away et lever un freak-out dont t’as pas idée...
L’autre gorille demande la parole :
— Sans vouloir t’offenser, Morris, j’ai craqué moi aussi pour le fucking nabot. J’ai payé deux dollars «Let’s Talk It Over», la réédition de son premier album paru en 1979. Tu vois, c’est pas cher... Figure-toi que là-dessus, tu as deux hits de funk planétaires : «Wanna Dance» et «She’s A Lovemaker». Lee shake son booty comme James Brown, il est foutrement sexué - Let me see you move ! - Quant à Lovemaker, quelle pétaudière, mama mia ! Lee pulse comme un piccolo diabolo ! L’élève dépasse le maestro, yeaahhhh ! Dans les bonus, tu tomberas sur «Fought For Survival», fantastique machine de guerre funky et ça continue avec un «Funky Screw» à la Jaaaames Brown qui boote le popotino de cœur de funk. Par la wha-wah et son ample saxitude, «The Bull Is Coming» va te renvoyer au géant Isaac, tellement c’est joué à la classe pépérito.
À moitié en transe, Lucky reprend la parole sans la demander :
— T’as un autre album de dingo, Morris, c’est «Coming To Tear The Roof Down» ! Va directement sur le morceau titre et bham ! Lee te chante ce truc d’une voix verte et ça vire funk énoooorrrrmito, c’est un embrouillage du diabolo, il t’embarque dans l’enfer du funk et t’as aussi «Talk Is Cheap», monté sur des power-chords funky ! Il faut que tu voies comment le fucking nabot s’accroche au beat, ces mecs jouent avec leurs tripes, c’est le cut de la dernière extrémité ! Et t’as encore du funk avec «Nasty Sexy Dance», joué aux percus sèches, ça te saute à la gueule, Morris ! Oh le son ! Et avec «Let Me Be The One», le fucking nabot enfonce son beat à coups de talon dans le cul des annales ! Tu te relèveras la nuit pour écouter ce disque ! Tu as aussi «I Won’t Tell Nobody» joué à la cloche funky. C’est du stomp de funk, on n’a encore jamais vu ça !
Blanc comme un linge, Morris donne un violent coup de poing sur son bureau :
— Bon, ça suffit ! Je vous laisse la vie sauve, je ne mets pas de contrats sur vos têtes, mais vous quittez immédiatement la ville ! Je ne veux plus jamais revoir vos têtes de bibards !
Chaque fois que la situation se complique au-delà du raisonnable, Morris Levy prend conseil auprès de son ami Vito Genovese, expert en matière de résolution d’équations. Ils se retrouvent dans la salle du fond d’un petit restaurant de Little Italy. Morris lui raconte dans le détail l’épisode précédent. Vito pose sa fourchette et plonge un regard humide de compassion dans celui de Morris :
— Ah oui, je comprends, mon petit Morris... Délicat, très délicat... Pour récupérer quelques milliards de dollars, tu commets l’erreur de céder au caprice de James Brown. Maintenant, si tu veux sauver la face, tu vas être obligé de le descendre. Délicat, très délicat...
— Pourquoi dis-tu que c’est délicat ?
— Mais voyons, rompiscatole, tu ne sais donc pas que je suis fan de James Brown ?
— Tu te fous de ma gueule, j’espère...
— Sur la Vierge Maria, je te jure que non, Morris !
— Non, Vito, ça suffit, je trouve que ta blague a assez duré !
— Mais Morris, c’est pas une blague... Si tu touches un seul cheveu de la tête de James Brown, je demanderai à Benny Eggs de t’emmener faire une promenade du côté des docks, tu vois ce que je veux dire ?
— Bon, ça va comme ça, Vito, ne te mets pas en rogne ! Dis-moi plutôt comment je peux sauver la face dans cette putain d’histoire !
— Délicat, très délicat... Tu es baisé, Morris...
— Que veux-tu dire ?
— Ce que je viens de dire. Tu es baisé...
— Ça veut dire quoi en clair ?
— C’est toi qui dois disparaître.
— Tu te fous de ma gueule, j’espère...
Vito s’essuie la bouche avec la grande serviette à carreaux.
— Un chef de famille ne doit pas commettre d’erreur, tu comprends, Morrilito, ça rejaillit sur les autres familles... Nous devons tous veiller à rester immaculés, comme la Vierge Maria...
Et Vito se signe.
Un ange passe. Morris en profite pour sortir son Beretta - Bahmmm ! Une balle entre les deux yeux de son ami Vito ! Les deux hommes qui montaient la garde à la porte de la petite salle entrent en trombe, les armes à la main :
— Ça va chef ? Oh mince, vous avez descendu Don Genovese !
— Mais non, abruti ! Le coup est parti tout seul ! C’est un accident ! Fais courir le bruit immédiatement, sinon, on va encore avoir une guerre des gangs sur les bras. Ce n’est plus de mon âge !
Morris croit avoir réglé le problème, mais il se trompe. Vito avait raison, le problème reste entier. Impossible de sauver la face. Et sans conseiller avisé, un chef de famille perd l’initiative, c’est-à-dire l’avantage.
Morris sait qu’il va devoir se tirer une balle dans la tête. Mais il veut quand même comprendre comment il a pu se faire baiser par un fucking nabot. Le seul moyen de comprendre, c’est d’écouter ses disques. Alors, il envoie un de ses hommes acheter les albums de Lee Fields chez le disquaire du coin de la rue.

Il commence par écouter l’album «Problems». Dès l’intro du morceau titre chauffé à blanc, Morris tombe de sa chaise. Lee Fields fait du pur James Brown, il sonne comme un petit délinquant black et derrière lui, ça rampe dans l’ambiance mortelle de la mortadelle, oh yeah, il est dessus, il est dedans, il sort le meilleur groove rampant du mondo bizarro, il chauffe ça au pas de danse, les mains à plat, all the time ! Et ça continue avec «The Right Thing», pur jus de funk africain, claqué aux percus. Lee entre là-dedans comme un cake, à la chaudarde de yeahhhh de James et c’est fan-tas-tique, claqué aux guitares et tututé à la basse. Il a tout. Lee est un géant du funk business, il sort de terre pour éclater au grand jour, c’est complètement démentoïde - You turn me on ! - Il refait son James Brown dans «Bad Trip» et il passe au funk définitif avec «I Don’t Know When I’m Going». Il gueule comme un Mister Dynamite survolté, c’est un vrai feu d’artifice funk. S’ensuit un cut de clap nommé «Clap Your Hands» qui palpite dans l’effarance de l’excellence. Et puis voilà que tombe du ciel un hit universel : «Honey Dove» - Oh baby love - un mélopif extraordinaire à la Barry White. Lee revient à James Brown avec «I’m The Man» et termine cet album fabuleux avec une pièce de soul somptueuse, «You Made A New Man Out Of Me». Lee ne raisonne qu’en termes de firmament. Morris n’en revient pas. Il est hagard, comme frappé de stupeur.

Il retrouve l’excellent «Honey Dove» sur «My World», un album plus soul, c’est vrai, mais Lee ne fait que de la soul dévastatrice - My baby love - C’est imparable, il chante «Honey Dove» au timbre jaune et ardent. Il est hanté par la soul et visité par les démons du spirit. C’est d’une infernale beauté factuelle. L’autre hit de l’album s’appelle «My World Is Empty», soul dense et pas dense comme l’ouate du paradis et l’étoupe du canon, merveilleuse exaction longitudinale d’accès immédiat. Des alizés portent les chœurs et le son coconute. Et puis il faut entendre la ligne de basse qui traverse «Ladies». Filigrane ensorcelant. Voilà encore un chef-d’œuvre de soul moderne.
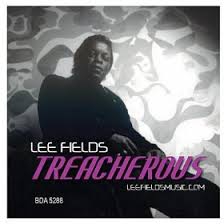
Fébrilement, Morris sort «Treacherous» de sa pochette et pouf, il retombe sur un coup de génie intitulé «We’re Here To Turn It Off», un funk tribal exceptionnel, une pulsion de la forêt profonde. Quel radicalisme ! Morris n’en revient pas. C’est du funk africain, Lee mène le bal des sorciers, il va plus loin que les autres compères et il éclate de rire au cœur du shuffle. Avec «At The End Of The Day», Lee tape dans la groovitude de James et de Marvin. Il est enragé, il ne lâche rien. Morris commence à comprendre. Ce fucking nabot de Lee Fields dispose d’un tempérament exceptionnel. Il fait du funk statique avec «Dance Like You’re Naked» et ça sonne comme le meilleur funk de la planète funk. Morris comprend que James Brown ait pu trembler pour sa couronne. D’autant que Lee embraye sur «I Want You So Bad», une pièce de soul coulante qu’il tartine au plus chaud de l’intimité organique. Lee se fait merveilleusement insistant, il chante ça à la percée fatale, il révèle un côté persuasif exceptionnel, il finit toujours par l’emporter.

Morris ressort la bouteille du mini-bar et boit directement au goulot. Il sent qu’il devient fiévreux. Il sort «Faithfull Man» de sa pochette et écoute le morceau titre, une sorte de plaidoyer soul d’un homme noir fasciné par le James Brown d’«It’s A Man Man’s World». Admirabilis ! Lee prend sa soul au chant ardent, avec une stupéfiante présence, il est dans l’ultra-brownisation des choses. En B, il chante «Wish You Were Here» en vrai screamer de plaintif intrusif. Il force les vulves à la hussarde. Et oh surprise, voilà qu’il tape dans la stonesy en reprenant «Moonlight Mile». C’est quasiment le hit de l’album tellement il chante ça bien. Il enchaîne avec un chef-d’œuvre de deep soul, «It’s All Over (But The Cryin’)» - It’s been three long years/ Since I Lost my mind - Lee est un fantastique installateur de pathos, il pressurise son froti, c’est à pleurer tellement c’est intense. Lee n’enregistre que des disques très denses, qui ne s’écoutent pas comme ça, en cinq minutes. Morris comprend que Lee Fields appartient à la caste des immenses artistes. Ce fucking nabot boucle sa B avec «Walk On Thru That Door». Il travaille tous ses cuts avec plusieurs spécialistes et chante une soul hyper travaillée avec un souci constant d’exploser la légende, il recherche le coin du bois, l’impossible renversement des conjonctions, il re-pétrit la vieille soul avec l’ardeur d’un petit artisan épuisé de ne plus croire en rien et pourtant il pétrit son pétrin, il pète ses ouates et revendique ses bretelles de Soul Brother number ce qu’on veut.

Morris tombe alors sur un autre «Faithfull Man». Oh, ce sont les versions instrumentales des morceaux qu’il vient d’écouter ! Le hit de Lee qui donne son titre à l’album fonctionne très bien en instro, avec sa petite contre-mélodie incisive et sa bassline en quinconce. Du coup, «I Still Got It» instro passe aussi comme une lettre à la poste. C’est amené comme un groove d’anticipation. Les Expressions vont bon train. Pour des petits blancs, ils s’en sortent plutôt bien. Mais tout n’est hélas pas du même niveau. La bassline sauve un cut comme «Still Hanging On» et de l’autre côté, ils tapent le «Moonlight Mile» des Stones à l’instro, ce qui n’est pas forcément une bonne idée. Morris retrouve l’aspect ensorcelant de la soul du fucking nabot dans «It’s All Over (But The Crying)». Ces instros valent pourtant le détour, car tout est soigné, très travaillé et admirablement arrangé.

Morris finit son tour d’horizon avec l’album «Emma Jean». Le fucking nabot attaque «Just Can’t Win» à la voix fêlée. Il tape dans le groove des géants de la terre. Sa voix ne trompe pas. Il chante la meilleure soul qui se puisse concevoir aujourd’hui. Il tape dans l’universalisme, dans un abîme de son qui embrasse l’osmose du cosmos. Morris écoute ensuite «Standing By Your Side», une sorte de r’n’b à l’ancienne orchestré par devant dans le mix. C’est de la démence baveuse pure et dure. Morris assiste à une hallucinante progression du son sous-jacent, une merveille de dosage, c’est pulsé dans la jugulaire du cut, Ce Lee Fields est un vrai démon, se dit Morris, l’écho du beat bat devant et le solo éclate sa grappe. Le beat rebondit et les cuivres l’endorment. Lee Fields allume tous les feux. Il tape aussi dans la soul de winner avec «It Still Gets Me Down» - When I see you around - Lee ne lâche jamais la rampe. Il chante à fond de deep. Il enchaîne avec un «Talk To Somebody» à la James Brown. Il sort à la fois la même attaque et la même voix, en tout seigneur tout honneur. Il tient son groove par les cornes. Il joue le funk de l’abdo. Ce mec a du génie, Morris finit par l’admettre. Ce fucking nabot a une vision claire de son art, ce qui n’est pas le cas de Morris.
Le moment est venu d’en finir. Morris comprend très bien qu’il ne pouvait pas faire le poids face à Lee Fields. Il arme son Beretta et enfonce le canon dans sa bouche. Bhammm !
Morris Levy a commis deux erreurs coup sur coup : sous-estimer un personnage comme Lee Fields et bien pire, rater le concert de Lee au 106.

Pourtant, quand il arrive sur scène, on s’interroge. Lee Fields n’a rien du Soul Brother habituel. Il avance vers le micro en se dandinant, avec une bouille de gamin vissée sur un corps de petit pépère. Comme ses musiciens l’ont annoncé comme au temps des revues, le public l’acclame. Il porte l’une de ces vestes brillantes ornementées comme seuls osent en porter B.B. King et Little Milton.

Il attaque avec un «All I Need» terriblement bien senti. En performer accompli, il chauffe la salle aussitôt. Il alterne les gros raids de deep soul avec les virées funky et il ahurit littéralement un public peu habitué à ce genre d’exactions. Il passe rapidement du statut de petit bonhomme à celui d’immense artiste. Il screame sur des crises de cuivres, il double les délires de guitare de cris d’alarme, il virevolte, mime James Brown pour que les choses soient bien claires, il reste en contact permanent avec son public.

On assiste à l’éclatante victoire d’un grand artiste noir. Lee Fields établit une fois de plus l’immense supériorité funky du peuple noir. Il jette toute sa vie dans la balance.

Il ne fait pas un show, il EST le show, il est le funk à deux pattes et la voix d’un art majeur. Comme les autres Soul Brothers, Lee Fields incarne le black is beautiful hérité des sixties et lui redonne du punch. Il finit avec l’excellentissime «Faithfull Man» et revient vêtu d’un petit gilet rouge à la James Brown pour un knock-out final, l’interplanétaire «Honey Dove». Oh yeah, baby love nous berce le cœur de langueurs monotones, et il tire sans fin sur l’élastique de sa chanson magique.

Signé : Cazengler, Lee Vide

Lee Fields. Le 106. Rouen (76). 12 mai 2016
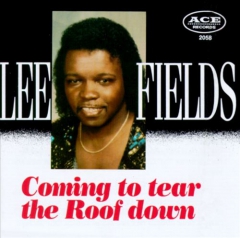
Lee Fields. Coming To Tear The Roof Down. Ace Records 1983
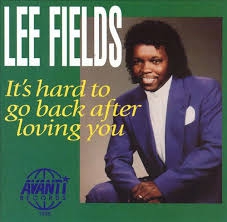
Lee Fields. It’s Hard To Go Back After Loving You. Avanti Records 1997
Lee Fields. Problems. Soul Fire 2002
Lee Fields. My World. Truth & Soul 2009
Lee Fields. Treacherous. BDA Records 2011
Lee Fields. Faithfull Man. Truth & Soul 2012
Lee Fields. Faithfull Man. Instrumentals. Truth & Soul 2012

Lee Fields. Let’s Talk It Over. Truth & Soul 2013
Lee Fields. Emma Jean. Truth & Soul 2014
FÊTE DE LA MUSIQUE
PROVINS / 21 – 06 – 2016
HELLEFTY

Premier concert depuis un mois. Pas question d'arpenter toute la ville, trop fatigant pour mon état encore vacillant. Je scrute le programme avec soin. Je déniche la perle rare. Les autres, je les ai déjà vus, ou alors mon flair de rocker subodore au mieux des groupes de reprises approximatives. Je sais, je suis injuste mais quand on veut privilégier son chien de l'enfer... Bref ce sera Hellefty, métal, ou rien.
Dix heures quarante cinq, je suis pile au rendez-vous. Renaud Bernal et son band entament leur dernier morceau. Se dépêchent de ranger leur matériel. N'ont pas fini que déjà Hellefty extirpe son matos de leurs trois bagnoles garées devant l'Eglise et l'entasse au pied de l'estrade. Musiciens et amis jouent aux roadies, et bientôt l'on entend une espèce de grondement à faire trembler les murs de la maison divine. Non ce n'est pas le diable, c'est le guitariste qui règle son ampli.
C'est à ce même moment que dans la lumière de la lampe qui éclaire le stand de la régie son j'aperçois les premiers moustiques. Aussi petits que des moucherons avec une étrange manière de se laisser tomber mollement vers le sol. Cinq minutes plus tard, faut se rendre à l'évidence, ce sont de minuscules gouttes d'eau qui ne mouillent même pas. Helllefty est en place, batterie, guitare, basse, n'y a plus qu'à jouer. Petit problème, l'espèce de rosée inefficace se transforme tout à coup en drache serrée... La sécurité surgit, on attend cinq minutes et si ça continue, on arrête tout. Because eau et électricité... Pas de bâche protectrice au-dessus des musiciens. Merci la mairie.
Dix minutes plus tard. Le concert est tombé à l'eau. La pluie se fait insistante. Faut démonter et remplir les voitures à toute vitesse. La place se vide. Ne reste plus que Vincent le batteur dégoûté et mon immodeste personne toute aussi dépitée qui taillent le bout de gras durant un quart d'heure. Ironie du sort : la pluie s'arrête de tomber...
Sont du coin, gîtent dans le triangle Provins-Nangis-Melun, donc on les reverra. Un CD quatre titres devrait sortir bientôt. Sur leur FB, l'on peut écouter de belles choses bien en place. Affaire à suivre.
Je rentre à la maison. Ce ne fut pas Hellefty. Ce fut rien.
Damie Chad.
SOGNOLLES EN MONTOIS
SALLE POLYVALENTE - 25 / 06 / 2016
CRASHBIRDS

Les rockers c'est comme les scientifiques fous qui recommencent illico leur expérience alors que le premier essai a rayé de la carte la moitié de l'agglomération. Ma précédente tentative de reprise de concert ayant lamentablement échoué ( voir article ci-dessus ), je réitère quatre jours après.
Sognolles en Montois. C'est sur les hauteurs de la Brie. Comptez douze centimètres au-dessus du niveau de la plaine. Un village perdu. Ce n'est pas plus mal : les ornithologues sont tous d'accord pour affirmer que les piafs de passage aiment à faire étape dans des lieux retirés. D'ailleurs quand vous avez déniché la salle polyvalente vous garez la voiture au plus vite sur le parking car vingt mètres plus loin le goudron s'achève, la route s'arrête dans le pré à quinze mètres du tronc vénérable d'un orme à la ramure imposante.
Les animaux possèdent un sens prémonitoire. Les Crashbirds se sont installés devant la façade de la salle des fêtes. Ne tombera pas une goutte ce soir. Ambiance champêtre, des enfants qui courent partout, des tables et des bancs alignés sur l'herbe, et une chaîne alimentaire qui distribue barquettes de frites et brochettes sur barbecue à des prix défiant toutes les grandes surfaces du département. Toute la population du village est rassemblée pour les festivités.
Situation idyllique. Je tiens toutefois à avertir les lecteurs charmés par cette paisible description. Certes les Crashbirds sont des oiseaux magnifiques, la houppette sous le menton du mâle et la teinte rousse de sa compagne sont ravissants, mais avant d'aménager un abri dans votre jardin, n'oubliez pas que ces passereaux sont d'infatigables jacasseurs. Pire que des cigognes qui claquettent du bec sur la cheminée. Font un bruit inimaginable. Plus question pour vous d'écouter les informations à la télé. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, Charles Darwin dans son bestseller La Sélection des Espèces vous explique comment les gentils petits oisillons volants ont été une tentative désespérée d'adaptation des dinosaures pour échapper à leur disparition. Bref du sang de reptile coule dans le moindre volatile sur son arbre perché comme dans une fable de Jean de La Fontaine. Les Crashbirds sont donc les héritiers de ces sales serpents qui grouillaient dans les eaux boueuses du delta. Old snake dirty blues !
REPTATIONS
Si vous ne me croyez pas, suffit d'écouter l'avant-concert, ces trente secondes durant lesquelles Pierre se cale sur son tabouret. Delphine en profite pour s'éclaircir la voix. Exactement comme si vous aviez marché par mégarde sur la queue d'un crotale. Vous imaginez le mécontentement de la bébête dérangée dans sa sieste. Une traînée mortelle d'écailles qui se dresse vers le ciel. Un bruissement métallique de roquette qui s'amplifie sans trêve, un ruban d'acier étincelant qui vibre de mille résonances, un sabre de cavalerie qui s'élève dans les airs avant de vous trancher la tête. Reprenez vos esprits, ce n'était que quelques innocentes vocalises. Déchirez aussi l'image mentale suscitée par la contemplation de leur superbe logo, ces deux petits zoziaux blottis l'un contre l'autre, on dirait qu'ils ont mis des lunettes d'aviateurs pour se protéger des impitoyables frimas de l'hiver. Les pauvres, ils n'ont que ça pour se couvrir ! En vérité ce sont deux pilotes de guerre aguerris qui étudient leur prochain objectif. C'est vous, attaque imparable en piqué. Vous faites partie, à votre corps consentant, des victimes rocklatérales.

Inutile de fuir. A droite vous avez la guitare électro-acoustique de Delphine. L'en émane comme de flexibles feuilles métalliques qui vous giflent à coups redoublés. N'ai jamais entendu une guitare claquer avec tant de punch, l'on dirait un laminoir. A gauche Pierre, plus classique une Gibson - électrique cela va de soi - mais beaucoup plus perfide. Delphine c'est clair et net, du rentre dedans, Pierre c'est plus traître, vous y mettez l'oreille - celle du connaisseur - et hop vous êtes happé jusqu'aux doigts de pieds. Vous emporte dans un labyrinthe, joue au minotaure, surgit toujours par la galerie où vous ne l'attendiez pas. Tricote salement, une maille à l'endroit et hop une frette à l'envers. Un jeu subtil et inventif. Pourrait s'arrêter là, nous serions contents. Mais non l'est comme le dieu Janus qui regarde des deux côtés. Finesse d'un côté, brutalité de l'autre. Nous assène le coup du bûcheron. Avec le pied. Pas du 36 fillette de ballerine anémique. Qu'il abat impitoyablement sur son caisson électrique. Une boîte à bruit qu'il a concoctée lui-même, juste pour vous prendre la tête. Une rythmique impitoyable. Vous avait prévenu, c'est écrit en grosse lettres sur la toile tendue derrière lui, dirty rock'n'blues. Pour marcher dans les marécages du stomp-bayou l'est nécessaire de chausser de gros godillots. C'est plus prudent pour les morsures d'alligators que vous essayez de hacher à la machette.

Comme vous êtes encore empêtré dans les machistes stéréotypes de la féminité vous tournez votre regard vers Delphine à la recherche d'un peu de douceur réconfortante. L'est belle comme la description de Velléda dans les Martyrs de Chateaubriand, toute élancée, toute droite, toute blanche, drapée dans la rousse auréole de sa chevelure, imparable, qui va son chemin, rayonnante et insensible, elle chante le blues électrique. Un voix d'airain. Claire mais qui ne tire pas vers les aigus, grave mais jamais sombre, infatigable, enchaîne les morceaux sans faillir. A peine une gorgée de bière de temps à autre, le temps que Pierre talque ses mains. Un timbre ensorcelant. Les autochtones qui assistent au spectacle ne sont pas spécialement des amateurs de dirty blues, mais les conversations se sont tues et aux applaudissements nourris et variés l'on sent que les gens ont compris qu'il se passait quelque chose. Certes ce n'est que la vieille fascination reptilienne du blues qui refait surface. Car Crashbird crache le blues comme le serpent son venin. Vous inocule la torpeur mythique du Sud et la violence flamboyante des villes électriques. Une jambe dans la terre arable du blues et l'autre dans la sauvagerie du rock and roll.

Le breuvage est servi avec le sourire de Delphine entrecoupé de l'humour auto-sarcastique de Pierre. Pas de péroraison, mais des réparties hâtives pour très vite repartir dans leur pilonnage intensif. Jouent leurs compositions, plus quelques rares reprises, par exemple un Under My Thumb - comment Pierre s'y prend-il pour assurer à lui tout seul le balancement rythmique si particulier des Pierres Qui Roulent, l'on dirait qu'il y a trois guitares, tandis que Delphine déchaîne un ouragan vocal qui emporte tout.
ENVOL

Se sont arrêtés au bout d'une heure trente. La nuit est tombée. Une fraîcheur piquante vous assaille l'épiderme. Promettent un deuxième set d'une demie-heure, nous administreront le double. Durant le court entracte le public se jette sur les CD et les T-shirts, avec un tel logo, pourraient créer toute une ligne de vêtements et une centaine de magasins franchisés sur tout l'hexagone.

C'est reparti. Comme en quatorze, avec l'attaque des tranchées à la baïonnette. Je ne pensais pas qu'ils pourraient faire mieux que la splendeur du premier set. Je reconnais mon erreur. Repartent sur les chapeaux de roue. Des chansons d'amour et de haine. Une reprise vitriolée de Because The Night et puis de ces duos de guitares infinis et époustouflants. Delphine délaisse le micro et se rapproche de Pierre, et l'on a droit à ces chevauchées fantastiques sans fin jusqu'au bout de l'horizon du rock. Faut entendre l'approbation admirative de l'assistance à la fin de chaque morceau. Un séjour dans le jardin des délices, avec pension complète. Tout ce que vous désirez au plus profond de vous-même vous est donné. Plus les suppléments qui vont avec. Est-ce du blues ? Est-ce du rock ? C'est avant tout de la sale bonne musique. Un régal. Un must. Un déluge bienfaisant d'énergie qui revigore nos âmes de pêcheurs en eaux troubles d'un Mississippi en crue, assoiffées de tumultueuse beauté rock and rollienne. Ce soir Crashbirds a rompu les digues.
Damie Chad.
P.S. 1 : cette fois, ce fut tout.
P.S. 2 : J'oubliais les quatre gendarmes dans leur fourgonnette attirés par le bruit. Police partout, justice nulle part. Sont vite repartis. Apparemment la maréchaussée ne goûte guère le rock and roll. Ce n'est pas grave : personne n'aime la police.
P.S. 3 : ce n'était peut-être pas exactement un orme. Mais je confirme, c'était bien un arbre.
( Photos FB : Fredo la lune )
NINA SIMONE, ROMAN
GILLES LEROY
( Folio 5371)
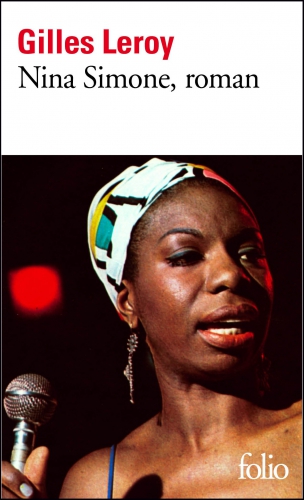
Nous avertit dès le titre, Gilles Leroy. Le sujet c'est bien Nina Simone. Mais un roman. Pas une biographie. Mais l'est difficile de romancer sans biographiser. Certes se contente des dernières années de l'existence de la Diva. La déchéance d'une étoile qui s'effondre sur elle-même, c'est plus vendeur qu'une réussite zénithale. Les lecteurs sont des pleureurs. Compatissent facilement. Peut-être parce que leur cursus à eux se révèle assez pâlichon dans son ensemble. Heureusement il y a les dialogues et les monologues intérieurs qui permettent de remonter le temps et de raconter tout ce qui s'est passé avant.
Pour les dates et les titres des morceaux, prière de vous reporter à la discographie. Tout au plus une dizaine d'entre eux seront évoqués dans le livre. Pour la véracité historiale, à vous de démêler le vrai du faux, une note en fin de volume nous indique que les principaux personnages – hormis ceux relatifs à l'enfance - sont des fictions. Le projet de Gilles Leroy est tout autre que l'atteinte d'une congruence effective avec la réalité. Ce qu'il essaie de retranscrire c'est le portrait intime de son héroïne. Tente de saisir comment ça marchait dans la tête de Nina.

Fut diagnostiquée bipolaire. Un mot médical qui dit tout et n'importe quoi. Les psy sont comme les géologues qui se placent devant la (in)jointure californienne des plaques continento-tectoniques et qui déclarent doctement que vous êtes devant la faille de San Andreas. Nous le savions déjà. Nous, ce qui nous intéresse c'est de savoir si notre espèce présente des similitudes avec l'extinction des dinosaures. Bref, dans une histoire, il faut chercher les lézards. Avez-vous remarqué que dès que l'on s'approche de près ou de loin du blues, les écailleux font leur apparition ?
Premier brontosaure : dans la psyché de la petite Eunice Kathleen Waymon née en 1933. Sait à peine parler que déjà elle sait jouer du piano. Pour ses parent noirs et pieux, c'est un don de Dieu qu'il est interdit de laisser perdre. Et la minette est condamnée au clavier plusieurs heures par jour. L'aimerait jouer à la poupée, la pauvre baby doll, et courir avec ses copines dans le jardin. Boulot. Boulot. Boulot. En plus, de gentilles dames blanches aux porte-feuilles aussi remplis d'or que leur coeur lui offrent de sérieuses leçons de piano hebdomadaires. Puis le pensionnat dans une école avec section de musique. Un rêve. Et un enfer. Ce qui ne vous tue pas, vous blesse tout de même sérieusement.

Deuxième tyranosus rex : met un peu de temps pour l'apercevoir. La prise de conscience n'en sera que plus dure. Vit dans un monde ségrégatif. Oh, à Tryon ( Caroline du Nord ) ce n'est pas le KKK qui règne, les blancs et les noirs se saluent très poliment dans la rue. Pas d'insultes. L'on se côtoie mais l'on ne se mélange pas. Premier coup de couteau. A treize ans lors de son premier concert dans sa ville natale, un couple de blancs arrivés en retard fait un scandale car deux places de devant sont occupées par les deux seuls noirs de l'assistance. Eunice refuse de jouer si ses géniteurs doivent quitter leurs chaises. Désormais un mur de verre transparent isolera ses parents de la communauté blanche dont les membres se détournent sur leur passage.
Troisième Galliminus ( très maximus ) : crise économique. Le père perd ses emplois. En tombe malade. La mère qui ne travaillait pas est obligée d'accepter les ménages, l'était une acharnée de l'Eglise, sera bonne chez les blancs riches. Nina est née après la déconfiture familiale, mais les stigmates s'imprimeront en elle. Etrange, ce constat selon lequel les noirs sont plus durement touchés par la dépression que les blancs.

Quatrième albertosaurus : méchante morsure. Joue mieux que tous les quatre cents concurrents du concours d'entrée de l'Institut Curtis mais elle ne fera pas partie des admissibles. Induit vite pourquoi. L'était la seule postulante de couleur à se présenter.
Cinquième spinosaurus. L'autre soir, je dinais chez une copine. L'avait mis un double CD de succès de Nina en fond de conversation. Genre de crime à ne pas commettre. Trente-six morceaux et pas un seul à jeter. Trente six merveilles. Trente six chandelles ! Vous auriez eu envie de baiser la trace de ses talons aiguilles. De Nina, pas de la copine, suivez un peu, bon dieu ! Jugement erroné. De la gnognotte. Juste bon pour la cagnotte. Pour Nina, ce n'était que de la sous-musique. De la variétoche. Son truc à elle, c'était Chopin, Beethoven, Debussy. Le reste roupie de sansonnet. Pipi de canari. De l'alimentaire. N'aimera jamais qu'on la compare à Billie Holyday. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, elle reprendra plusieurs de ses morceaux. Leurs parcours s'inscrivent dans deux cultures différentes. Billie de la négritude afro-américaine du jazz, et Nina de la musique classique européenne. Choc des origines. Cherchez l'erreur.
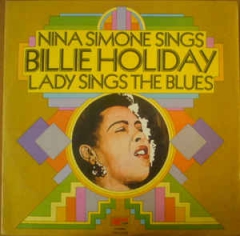
La ménagerie est terminée. Pas facile de vivre avec ces amicales bébêtes qui farfouillent dans votre cerveau. Causent beaucoup de dommages mais elles présentent parfois des avantages. La revanche du pauvre. La vengeance de la négresse. L'argent qui coule à flots, qui permet d'acheter superbes villas et robes de reine. La reconnaissance des fans, l'adulation des foules, les applaudissements, les articles laudateurs, n'est plus noire, n'est même pas blanche, l'est une Artiste fêtée par le monde entier.
Mais la gloire est frivole comme dit Aznavour ( celui-là vous ne l'attendiez pas ) et si vous regardez d'un peu trop près vous ne tarderez pas à voir les craquelures sur la peinture dorée du tableau. S'est faite méchamment arnaquée en signant ses contrats, la jeune Nina. L'ardoise se compte en millions de dollars. Devinez la couleur des patrons de labels ? Vous avez raison, mais il y a eu aussi des noirs n'ont pas toujours été clean, non plus.

Du coup elle deviendra une acharnée des Droits Civiques. Donne des représentations au profit de la lutte. Participe à des meetings et à des marches interdites par la police. Notamment avec Langston Hughes, celui-la on le retrouve toujours du bon côté des barricades et James Baldwin, celui-ci il ne vaut pas mieux que le précédent. Pire que Joan Baez, Nina n'est pas pacifiste, juge la violence nécessaire à l'obtention de la justice. Des positions qui ne vous donnent pas que des amis. N'est plus très bien vue aux Snakes comme elle appelait les States. Ne vous étonnez pas si elle s'en va vivre en Afrique, et en ses dernières dix années de par chez nous.
Courir le monde fatigue. L'âge impose sa loi. Nina boit un peu trop et grossit trop et pas qu'un peu. S'arrête et doit reprendre ses tournées pour assurer les fins de mois. Se bat contre le cancer. Gilles Leroy nous rappelle qu'elle n'est pas toute blanche. Sait être cruelle avec son entourage. L'est rongée par ses défaites et ses remords. Ses maris qui n'ont pas été de tendres roucouleurs – mais elle aimait les armoires à glace plutôt viriles - sa fille qu'elle n'appelle jamais. Se repent de ses faiblesses, se laisse manipuler trop facilement, peut-être même qu'elle aime cela, et qu'elle le désire. Le sado-masochisme se niche avant tout dans vos contradictions les plus secrètes, les plus destructrices, celles sur qui votre personnalité s'est bâtie.

L'en vient à s'auto-culpabiliser. A-t-elle vraiment si bien joué qu'elle l'a pensé au concours Curtis ? N'était-elle pas un peu faiblarde sur son interprétation de Chopin ? Le doute la ronge. Le racisme ce n'est pas seulement les horreurs de l'esclavage ou les humiliations de la ségrégation. Beaucoup plus insidieux. L'Homme Noir en arrive à perdre confiance en lui-même. Peut-être n'est-il pas égal à l'Homme Blanc. A croire que dans ces deux appellations ce n'est pas le dénominateur commun homminal qui prime. Mais la suite adjectivale. L'un plus beau, plus brillant que l'autre. Symptomatiquement, elle aime que ses amants noirs aient la peau plus claire que la sienne. Elle déteste ses lèvres trop lippues.
Vous croyez être capable de juger et d'analyser en toute objectivité, en toute sérénité la profondeur de la faille qui est en vous. Mais vous y êtes déjà dedans. Jusqu'au cou. Comme dans la merde. Et vous glissez sans fin, le long de la paroi. Et lorsque vous aurez enfin atteint le fond, que vous pourriez donner le coup de pied qui vous permettra de remonter... C'est trop tard. C'est que vous êtes déjà mort.

L'on meurt toujours de quelque chose. Mais l'agonie est plus dure à vivre quand l'on n'a pas unifié ses contradictions.
Un beau livre.
Damie Chad.
P.S. : Nina Simone, roman est le dernier tome de la triologie de Gilles Leroy consacrée à trois figures féminines américaines. Le personnade de Zelda Fitzgerald qui apparaît dans ce troisième volet est l'héroïne du premier volume intitulé Alabama Song
LE PEUPLE DU BLUES
LEROI JONES
( Folio 3003 / 2015 )

Beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est un classique de la littérature américaine consacré au blues. Fut édité en 1963. En gros avant la naissance des Rolling Stones. Ce qui signifie pour les jeunes européens des années soixante avant que le blues ne nous fût révélé. Première constatation : où sont nos idoles ? LeRoi Jones ignore le Delta. Charley Patton, Son House, Robert Johnson, et toutes les autres grandes figures fondatrices et mythique du blues ne sont même pas cités. Le Chicago blues est traité avec la même désinvolture, le nom de Muddy Waters apparaît une fois dans une courte énumération un peu comme si je nommais à l'emporte pièce Jean-Claude Annoux dans une histoire du Yé-Yé français. Moi petite frenchie grenouillette très estomaquée ! Apparemment nous ne partageons pas les mêmes idoles.
Deuxième étonnement : s'appelle le peuple du blues, mais devrait être sous-titré le peuple du jazz. Cette réflexion sans animosité. Le parti-pris de LeRoi Jones explique cependant en partie l'étrange découpage opéré par Mike Evans dans son livre Le Blues, un Siècle d'Histoire en Images que nous avons chroniqué dernièrement ( voir KR'TNT ! 286 du 16 / 06 / 2016 ). Nous ne voyons le blues que par le prisme d'un de ses aboutissements, le rock and roll, que nous privilégions au-delà de toute objectivité. Lunettes déformantes. Jones écrit son histoire du blues en la collant de très près à sa branche, pour lui, maîtresse : le jazz.
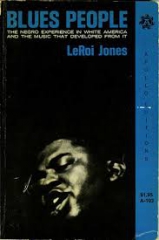
Et pourtant Jones ne parle que du blues. Emploie le mot systématiquement pratiquement à chaque page. Cause de musique - car quel que soit le bout par lequel vous le prenez le sujet vous l'impose – mais ne l'étudie pas sous son aspect purement musical. Emploie le terme sans le définir comme phénomène d'évidence. Le décortique selon un point de vue que nous qualifierons de marxo-sociologique. Un sous-marxisme clandestin jamais appelé par son nom. Chat échaudé craint l'eau froide : LeRoy Jones a été dénoncé comme communiste et rétrogradé de son grade de sergent durant son armée... Donc l'en reste à une analyse des rapports de classes, jamais entrevus en tant que stratégie de lutte de classes révolutionnaire, mais en tant que conséquences sur la psyché de la population noire.
Ne s'attarde guère sur l'esclavage en tant que tel. Cite les hollers comme première affirmation d'une identité personnelle mais préfère se pencher sur les divisions qui très vite s'instaurent dans la communauté. Ceux qui travaillent aux champs et ceux qui servent à la maison. Les domestiques qui vivent dans un contact étroit avec les maîtres abandonneront très vite leurs racines africaines pour adopter celle de l'american way of life. Coupent les ponts avec leurs anciens dieux et adoptent la religion chrétienne. Quelques uns d'entre eux embrasseront l'état de pasteur. Ce sont eux qui évangéliseront leurs frères soumis aux tâches les plus dures. L'embryon d'une bourgeoisie noire est ensemencée dès les primes décennies de la servitude. A cette mince couche de « mieux-nantis » s'agglomèreront les affranchis qui deviennent artisans et qui petit à petit se constituent un pécule – peut-on déjà parler d'un capital ? - qui les pose au-dessus de leurs frères de sang.

De sang, mais pas de peau. C'est notamment à partir de la Nouvelle-Orléans que va s'installer cet étrange camaïeu psycho-social qui va fragmenter le peuple noir. Tous ne sont pas aussi noirs. D'une ethnie à l'autre la mélanine n'est pas la même. La pigmentation est inégalitaire. Certains sont plus foncés que d'autres. Les amours ancillaires des maîtres n'ont pas atténué les différences. Dans le troupeau, les moutons noirs sont les plus nombreux. L'on peut parler d'une sélection raciale qui s'opèrera lentement mais sûrement : les plus noirs resteront les plus pauvres, les plus clairs entreprendront de monter l'échelle de la réussite économique. Jones pousse très loin cette logique : toute une fraction de noirs veulent singer les blancs. De véritables caméléons. Pour eux, l'assimilation totale avec les blancs est la condition sine qua non de l'intégration. Rejettent toutes accointances avec leurs origines, renieront très tôt le blues comme signe et rappel injurieux de leurs anciennes conditions d'esclaves. Il n'est de pire aveugles que ceux qui ne veulent pas voir. Cette façon d'agir se perpétue encore aujourd'hui, souvenons-nous des produits détergents employés par Michael Jackson pour se blanchir l'épiderme, et le peu de souci qu'a manifesté le président Obama envers ses électeurs de couleur... L'argent n'a pas d'odeur mais il lave le plus blanc...

Les premiers bluesmen, furent des blueswomen. Jones indique bien l'origine rurale du blues mais n'en fournit aucune description. Qui ? Quand ? Comment ? Pas un mot. Plus que le blues des villes ces femelles du blues représentent un blues plus policé, qui tire sa culture d'un circuit économique que l'on peut déjà qualifier d'entertainement. Théorie du sandwich, une couche de beurre blanc, une rondelle de boudin noir et l'on recommence. Les blancs ont imité les nègres qui ont imité les blancs qui les imitaient, les blancs ont apporté les capitaux, les noirs les ont imités à leur tour et tutti quanti jusqu'à la création de l'industrie du showbiz...
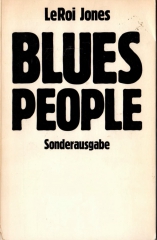
Les noirs détenaient la pulsation primordiale. Les blancs se sont vite aperçus de leur manque. Ne se sont pas découragés. Ont copié. Ce n'est pas un hasard du calendrier qui a fait que le premier enregistrement de jazz soit dû à un groupe de blancs. Les noirs créent. Les blancs récupèrent. Edulcorent aussi. L'art brut ne plaît pas aux masses. N'achètent que des musiques doucereuses. Du rythme, mais pas de folie. Du swing mais pas du rumble. Les nègres peuvent s'agiter tant qu'ils veulent, l'industrie du disque, des spectacles et les médias sont principalement propriétés et priorité des blancs. S'instaure une course sans fin. Les premiers partis sont vite rattrapés. Le jazz est aux mains des blancs : ce sont leurs artistes qui seront avantagés et qui ramasseront le plus de blé. Les uns stompent et marnent dans leur coin, les autres pompent et paradent dans les vitrines de la célébrité. Les grands orchestres sont des concepts européens, un peu de noir rehausse le blanc. Embaucher un ou deux solistes nègres, exécuteront leur numéro comme les enfants font les pitres devant leurs parents attendris.

Il y a des résistants. Des big bands naîtront les blues shouters et puis les combos de rhythm and blues, cette musique de sauvages que la bourgeoisie noire refuse d'écouter. Charlie Parker et quelques camarades saccagent le jazz et inventent le Be-Bop. Tollé général. Très vite lui succèdera le cool. Jazz mentholé pour blancs qui ne supportent pas les brusqueries de ce jazz nouveau un peu trop vert crû. De toutes les manières, que ce soit Be- Bop ou Cool, les blancs en font une mode, et mettent l'accent sur les musiciens de leur race. Du coup LeRoy Jones en vient à considérer le rock and roll – cette musique de petits blancs – comme beaucoup plus subversive que le jazz des années cinquante. Ce rock que l'on traite de bruit nauséabond produit par d'incultes sauvageons ! Les mêmes condamnations qui servirent à qualifier le blues et les novateurs du jazz en leur temps. Ne passe pas sous silence non plus, ces mouvements de revival des formes anciennes qui furent tant décriées en leur époque. Trente ans après, leurs forces subversives et sémentales font partie du paysage culturel. Ont perdu leurs facultés urticantes. Rentrent dans l'ordre normal de l'évolution rassurante des choses qui se sont tant usées qu'elles sont devenues anodines et dignes de toute louange muséographique.
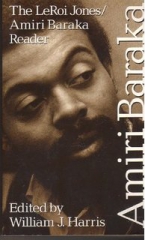
Le livre se termine avec les poussées riffiques de John Coltrane et l'apparition de ce qui deviendra le free jazz. Passe très vite sur ce qui sera un des grands centres d'intérêt de l'existence de l'auteur : la beat Generation. Nous sommes en 1963, ignore totalement les mouvements de contestation de la jeunesse universitaire blanche et les gémissements du renouveau folk, consacre un paragraphe à la compréhension qu'il éprouve pour tout ce mouvement noir qui à l'instar de Malcom X se convertit à l'Islam - lui-même prendra le nom d'Amiri Bakara - comme pour marquer que la conciliation blancs /noirs s'est faite attendre trop longtemps, que les enfants rejetés finissent un jour par couper les ponts, qu'il est temps de marquer une coupure franche et nette, cassante, entre les deux communautés. Le Black Panter Party n'oubliera pas de lire cet ouvrage qui relate avec une très grande précision les stratégies d'asservissement et de domination que les blancs ont élaborées durant trois siècles pour contrer les avancées successives de la cause noire. Récupération culturelle, divisions économiques et manipulations psycho-sociales qui marchent de pair avec des processus d' auto-fragmentations autant dues à une individuation petite-bourgeoise de survie animale qu'à une occultation des conjonctions de classe. Un livre qu'il faut lire en se rappelant que ce n'est pas uniquement le peuple du blues mais les pauvres de tous pays qui furent et qui restent soumis à de tels champs de force. Une analyse que l'on peut qualifier de révolutionnaire. Et d'utilité directe.
Damie Chad.
ZINES - #VFLC // Episode 1

Episode 1. Mais c'est le deuxième morceau ( voir KR'TNT ! 273 du 17 / 03 / 16. ) Pas de vidéo cette fois. Bande son seule. Inutile de mettre de la gaze sur le coup, le poing suffit. Zines, z'ont su passer l'obstacle sans se recopier, voire pire se renier. Le deuxième oxer est le plus dangereux. Trop souvent l'on crache tout son venin à la première morsure, et ne reste plus de poison pour la suite.
Chut ça commence. Du violon. Oui du violon ! Sur du rap ! Larmoyant et déchirant. Générique d'un film sentimental. L'on se croirait dans une boîte avec un crin-crin tsigane qui vient pleurer dans votre oreille. Les notes éparses dignes d'un piano-bar accentuent l'impression. Voix mélodieuse d'une égérie, glapissement de gamin, et braoum ! Vous prenez direct sur la gueule. La paire de claques qui fait mal et vous envoie à terre sans que vous ayez le temps de reprendre vos esprits. Maintenant faut réaliser. La séquence est sur deux plans. Les plaintes du violon langoureux qui reviennent comme les rimes souterraines d'un poème, et les voix marquent la rythmique sans concession. Parfois vous avez comme des écrasements de musique, des effondrements de claviers, qui semblent s'enfoncer dans leurs propres ornières, qui ruissellent et forment comme un contre-chant de bande-son mélodramatique. Le flot n'attend pas. Imperturbable. Sans arrêt. Ni regret. Mais ne vous fiez pas à l'ambiance.
Zines règle ses comptes. Des voix de scalpel. Mettent les pendules du rap à l'heure. La leur. Ne suffit pas d'avancer les aiguilles pour être devant. Y-a tellement de faiseurs et d'envieux qui vous tournent autour. En sens contraire. Deux ados, le dos au mur de la réalité. Le rêve s'effondre comme un décor de carton-pâte qui prend l'eau. Il est temps de clarifier et de poser les limites. Tracent les bandes blanches du terrain de foot, de la terre des fous. Une lame de couteau, un cutter menaçant, qui découpent le contour des faux-frères et des remplaçants du banc de touche. Du banc des souches immobiles. L'on ne peut être fidèle qu'envers sa tribu. Seule manière de ne pas se trahir soi-même. Zines démontre que l'univers loin d'être en constante expansion est en perpétuel rétrécissement.
Crise de croissance. Plus vous grandissez, plus le monde premier des illusions se rapetisse. C'est ainsi que l'on gagne en maturité. Que les voix s'affirment. Ne se cachent plus derrière les images. Crachent sur la laideur des êtres. Point de désespérance. Reste une ultime tour d'attaque. L'orgueil adolescent sûr d'avoir emprunté le bon chemin. Celui qui fonce droit devant. Zines nous sert un rap qui mord. Mais il est des blessures qui vous réveillent de vos torpeurs et qui vous font un bien fou. Elles vous rendent davantage conscients et vous obligent à vous reposer les bonnes questions. Celles d'une certaine honnêteté intellectuelle.
Ce deuxième morceau de Zines est séduisant. Ces deux jeunes garçons ont des idées originales. Parviennent à se renouveler et à nous surprendre tout en restant dans le droit fil d'une démarche artistique dont ils assument tous les enjeux. A suivre.
Damie Chad
21:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lee fields, ronnie spector, crashbirds, hellefty, nina simone, leroi jones, zines rap officiel



