19/01/2022
KR'TNT ! 538 : AHMET ERTEGUN / RONNIE SPECTOR / JUKIN' BONE / SHADRACKS / CYCLONE / GOLEM MECANIQUE / FRANCOIS RICHARD / ROCKAMBOLESQUES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 538
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR'TNT KR'TNT
20 / 01 / 2022
|
AHMET ERTEGUN / RONNIE SPECTOR JUKIN' BONE / SHADRACKS / CYCLONE GOLEM MECANIQUE / FRANCOIS RICHARD ROCKAMBOLESQUES |
TEXTE + PHOTOS : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
Ertegun club - Part One
Voici une dizaine d’années paraissait une biographie d’Ahmet Ertegun, le légendaire boss d’Atlantic, un label qui fut avec Elektra l’un des grands labels indépendants de l’histoire du rock américain. Le biographe en question s’appelle Robert Greenfield, un auteur qu’on connaît surtout pour avoir signé deux ouvrages majeurs sur les Stones, Exile On Main Street - A Season In Hell With The Rolling Stones et l’encore plus fameux STP - A Journey Through America With The Rolling Stones, traduit en Français en 1977 et paru aux Humanos dans l’excellentissime collection Speed 17.
Profitant du fait qu’Ahmet Ertegun soit né en Turquie, Greenfield a titré sa bio The Last Sultan. Il ne s’est pas cassé la tête. Comme tous les bons titres, le sien relève de l’évidence. Greenfield ne cherche d’ailleurs pas à s’installer au panthéon des écrivains, il sait qu’il ne dispose pas du souffle requis, il se contente de construire sa bio comme un gros millefeuilles de 400 pages, en collectant ici et là, comme le ferait un journaliste, des éléments d’information qu’il façonne et polit pour les homogénéiser. Ce book ne peut en aucun cas rivaliser avec le Sam Phillips - The Man Who Invented Rock ‘n’ Roll de Peter Guralnick ou le Respect Yourself - Stax Records And The Soul Explosion de Robert Gordon. L’énergie de Robert Greenfield est plus d’ordre compilatoire que romanesque, dommage, car s’il est un sujet qui se prête au traitement romanesque, au moins autant que Sam Phillips, c’est bien Ahmet Ertegun. Mais l’absence de souffle n’enlève rien à l’efficacité du rythme narratif. Greenfield compense l’absence de style en forçant la marche. Le book s’avale d’un trait, un gros trait, mais d’un trait d’un seul. On ne le lâche pas, même lorsque Greenfield aborde l’aspect ingrat de son personnage qui était d’abord un homme d’affaires, avant d’être ce noctambule hipster que tout le monde décrit, un homme fasciné par les artistes noirs et leur slang. Atlantic n’est pas seulement l’histoire d’une passion pour la musique noire, c’est aussi et surtout un gros business, qui suppose une certaine forme de virtuosité dans l’art de manipuler les très grosses sommes, avec en toile de fond, ce combat permanent pour la survie économique, un combat qui passe par la découverte de nouveaux talents. À l’échelle d’une vie, ça doit finir par devenir éreintant, mais apparemment, Ahmet Ertegun s’en est fort bien accommodé, puisqu’à l’âge de 83 ans, il était encore dans un backstage new-yorkais avec ses amis les Rolling Stones. Il faut souhaiter ce genre de longévité à tous les amateurs de rock.
Greenfield commence par citer Ahmet en exergue - Plus je vieillis et plus je réalise à quel point je suis turc. Je cultive les deux principaux vices turcs : l’indolence et l’excès - Ahmet prend très vite forme sous la plume de Greenfield. On entend d’abord sa voix, «the nasal hipster’s voice teintée des inflexions du slang noir des rues et rythmée sur les syncopes de ce jazz qu’il adorait depuis l’enfance. Ahmet savait toujours groover en parlant. Auréolé d’une fumée d’une cigarette et un verre à la main, c’était un conteur né qui pouvait tenir en haleine n’importe quel type audience, grande comme petite.» Son parcours scolaire passe par une école du nom de St. Albans, dans l’État de Washington, un endroit très conservateur où Ahmet s’ennuie : «Il n’y avait ni cowboys, ni Indiens, ni gangsters, no Negroes, nothing. No Jews. Also no sophistication.» Ahmet est le fils de l’Ambassadeur de la Turquie aux États-Unis. En vertu d’une loi turque, son père Mehmet Munir dut changer de nom et il opta pour Ertegun, «erte» signifiant «prochain» et «gun» signifiant «jour», un nom à connotation religieuse : le jour viendra. À 14 ans, Ahmet traîne dans les clubs noirs de New York. Il était même parfois le seul blanc dans la salle - Les noirs étaient gentils avec les blancs car ils en avaient une trouille bleue - Une nuit, il rencontre Sidney Bechet dans une party à Harlem et Bechet lui demande ce qu’il boit, alors Ahmet dit : «Scotch & soda». Bechet lui retire le verre des mains et lui colle un joint dans le bec. C’est son baptême du feu, avec ce qu’il appellera toute sa vie la ‘ma-ree-wanna’. Une amie voit Ahmet rayonner dans les clubs de jazz : «Il aimait la musique et il comprenait les gens. Il avait un don extraordinaire : il pouvait discuter avec les musiciens et avec les ducs.» Il s’habille comme les jazzmen - I need a pair of alligator shoes ! - Ahmet est particulièrement fasciné par Lester Young que Billie Holiday surnomme «The President», Prez pour les intimes, quite possibly the hippest dude who ever lived, l’inventeur d’un slang de jazz («bread» pour le blé, «that’s cool» et «You dig?». Il portait un crushed black porkpie hat et buvait tellement qu’il mourut alcoolique à l’âge de 49 ans. On croise aussi Mezz Mezzrow, aussi hip que Prez, qui fume et qui deale de la ma-ree-wanna, qui joue de la clarinette et qui écrit la bible des hipsters, Really The Blues. On est avec Ahmet dans l’entre-deux mondes, au cœur du mythe, Ahmet est l’hipster par excellence, il est au jazz ce que Duchamp est à l’art, un électron libre fabuleusement affamé. En 1939, George Frazier qui est éditorialiste au Boston Globe rencontre Ahmet dans une small cocktail party à Washington et le qualifie de ‘bizarre’ : «Le peu de cheveux qu’il avait était coiffé avec une raie au milieu et plaqué de chaque côté d’un crâne plutôt plat. Il avait le regard humide et à travers ses verres sans montures, il m’inspirait une certaine compassion. Au dessus de sa lèvre supérieure, une très fine moustache me faisait penser au dessin d’une ligne de chemin de fer sur une carte scolaire.»
Puis Ahmet entre au St. John’s College d’Annapolis, dans le Maryland. Jac Holzman y séjournera lui aussi un peu plus tard. Jac dit qu’on y apprend le Grec et les maths, «l’algèbre pendant la deuxième année, Cartesian math, et la théorie des parallèles de Nikolai Lobarchevsky pendant la quatrième année. On participait à des débats philosophiques autour des maths. L’idée était de nous initier aux rigueurs de la réflexion sans être rigide. Je pense que les débats socratiques et le principe d’égalité entre les tuteurs et les élèves stimulaient Ahmet.»
C’est en 1949 qu’il monte Atlantic avec Herb Abramson. À cette époque, nous dit Greenfield, le music biz indépendant démarrait doucement : Herman Lubinsky avec Savoy Records, Syd Nathan à Cincinnati avec King Records, Art Rupe à Los Angeles avec Specialty Records, Jules, Saul, Joe et Lester Bihari avec Modern Records, Eddie et Leo Mesmer avec Aladdin, les frères Chess à Chicago avec Aristocrat puis Chess Records. C’est l’époque des pionniers. Pourquoi Atlantic ? Parce que les noms auxquels pensait Ahmet était déjà pris, Horizon, Blue Mood - J’avais entendu parler d’un label qui s’appelait Pacific Jazz à l’époque. Aussi, en désespoir de cause, j’ai dit : ‘Look, ils s’appellent Pacific ? Alors on va s’appeler Atlantic !’ - Ahmet démarre donc avec Herb et Myriam Abramson au 234 West 56th Street, au 5e étage. Le soir, quand ils enregistrent, il poussent le bureaux pour faire de la place aux musiciens. Il y a une petite salle de bains où Ray Charles va se shooter. Juste à côté se trouve le fameux Patsy’s restaurant où viennent dîner Sinatra et les gens de la mafia.
Et puis il y a les fameuses virées dans le Deep South, à la recherche de nouveaux talents. Ahmet et Herb descendent une première fois dans le Sud en 1949, parce qu’à New York, nous dit Ahmet on ne trouvait pas de funky blues singers. Et là il embraye sur ce qu’il appelle «l’histoire la plus incredible de sa vie». Il marche dans les rues d’un quartier noir d’Atlanta et il tombe soudain sur un aveugle qui chante du gospel, playing incredible slide guitar. Les passants lui donnent la pièce. Ahmet met des billets dans le chapeau et demande à l’aveugle : «Have you ever heard of Blind Willie McTell ?» Et à la grande stupéfaction d’Ahmet, l’aveugle répond : «Man, I am Blind Willie McTell.» Voilà la magie du personnage, l’Ahmet magique. On doit à Blind Willie McTell l’excellent «Statesboro Blues» repris par Taj Mahal sur son premier album et des tas d’autres luminaries, et pour Dylan, Blind Willie McTell signifie the beginning of it all.
Ahmet et Herb décident alors de descendre à la Nouvelle Orleans car on leur a parlé d’un «musical magician who played in a style all his own». Ils sont obligés de prendre un ferry jusqu’à Algiers, puis un taxi. Mais aucun chauffeur blanc ne veut les déposer à Algiers - I ain’t going to that nigger town - Alors Ahmet et Herb partent à pieds à travers des champs marécageux et quand ils arrivent au nightclub - rather a shack - Ahmet s’extasie : «Ça ressemblait à un dessin animé qui grandissait et se rétractait to the pulsing beat.» Ils assistent à un show de Professor Longhair, Fez pour les intimes, «playing his own idiosyncratic rhythms on piano against the beat». Incredible ! La sidération d’Ahmet bat tous les records : «Fez was creating these weird, wide harmonies while singing in the open-throated style of the blues shouters of old.» On ne saurait imaginer meilleure description. Ahmet flirte avec le génie descriptif, il fait swinguer sa langue (in the open-throated style/ of the blues shouters of old). Chacune de ses phrases semble sortir un couplet de Cole Porter. Il ajoute que Fez sonnait comme un «cross between Jelly Roll Morton et Jimmy Yancey», qu’il mixait le blues avec le jazz, le ragtime et la musique Cajun. «My God !» dit Ahmet à Herb, «We’ve discovered a primitive genius !». Mais Fez vient de signer avec Mercury. Voyant les deux blancs déçus, Fez dit qu’il a signé sous le de Roeland Byrd et ajoute : «With you I can be Professor Longhair.»
Ahmet fréquente les frères Chess. À l’époque, Chess est l’autre grand label indépendant spécialisé dans la musique noire. Quand Ahmet vient visiter les locaux de Chess à Chicago, Leonard lui fait faire le tour du propriétaire. Une gonzesse est à la réception avec une machine à écrire. Puis Leonard lui présente la balayeur, Muddy Waters. «Il bosse à mi-temps pour nettoyer les bureaux», dit Leonard le renard. «Il enregistre aussi des disques.» Quand Ahmet demande où se trouve se service comptable, Leonard le renard s’interloque : «Quel service comptable ?». Pour rassurer Ahmet, il explique que la fille à la réception s’occupe aussi des comptes. Puis Ahmet lui demande de quelle manière il gère les royalties. Leonard le renard s’interloque à nouveau : «Quelles royalties ?». Bon, Ahmet préfère couper court. Il apprendra un peu plus tard de la bouche de Marshall, fils de Phil Chess, que son oncle Leonard avait passé un étrange accord avec Muddy : si ses ventes de disques venaient à chuter, Muddy pouvait venir se faire un billet en s’occupant du jardin de Leonard. Alors Ahmet lui répond qu’il a passé un autre genre d’accord avec Big Joe Turner : si ses ventes d’albums venaient à chuter, alors Ahmet se mettrait à son service comme chauffeur.
C’est Herb Abramson qui apprend les bases du métier de label boss à Ahmet : les contrats, les séances d’enregistrement, les relations avec les fabricants de disques et la distribution. Et pourtant leur relation va s’arrêter brutalement : Herb est envoyé en Europe pour servir dans l’armée en tant que dentiste. C’est là que Jerry Wexler entre dans la danse et c’est avec lui qu’Ahmet va faire ses prochaines virées de le Deep South. Wexler est très différent d’Ahmet. Wexler est un homme colérique et suspicieux, il surveille tout, principalement les factures, il parle mal au personnel d’Atlantic, met constamment en doute leurs compétences, il s’inquiète pour rien et un rien le met en pétard. Wexler est hanté par la peur de manquer, car il a grandi dans l’extrême pauvreté des quartiers juifs new-yorkais, alors qu’Ahmet est fils d’ambassadeur et qu’il n’a jamais manqué de rien. Malgré toutes ces différences, Ahmet et Wexler fonctionnent comme les deux doigts de la main, the record business equivalent nous dit Greenfield de Mr. Inside and Mr. Outside.
Leur premier gros coup, c’est Big Joe Turner. Ahmet le signe en 1951, après l’avoir vu jouer à l’Apollo de Harlem accompagné par le big band de Count Basie. Et pourtant, le show tourne au désastre, car Big Joe et le big band ne jouent pas ensemble. Quand le big band s’arrête, Big Joe joue encore. Le public le hue et Big Joe s’enfuit. Ahmet parvient à le retrouver dans un bas voisin et le console, lui disant qu’il veut faire de lui une big star. Alors Big Joe qui est un vétéran de toutes les guerres lui répond : «Okay if you pay me money.» Ahmet lui propose 500 $ et Big Joe lui répond «Yeah that’s good». Ahmet dit que c’est pour four sides (deux singles) et Big Joe qui appelle Ahmet «Cuz» lui dit «All right Cuz.» Ils vont enregistrer «Shake Rattle And Roll» avec Mickey Baker on guitar, et aux chœurs, Jesse Stone, Ahmet et Wexler. En 1954, «Shake Rattle & Roll» est le premier rock’n’roll single qui se vend à un million d’exemplaires. Avec l’«I Got A Woman» de Ray Charles, Atlantic redéfinit le futur du record business en Amérique. «Shake Rattle & Roll» lance le rock’n’roll et «I Got A Woman» la Soul. Greenfield : «Ce que les deux hits ont en commun, c’est Ahmet et Wexler.» Ils vont ajoute Greenfield devenir the greatest team in the history of the record business.
Mais Ahmet et Wexler n’ont pas exactement la même vision des choses. Quand Paul Marshall vient trouver Wexler pour lui proposer la distribution des Beatles en Amérique, Wexler lui répond que ça ne l’intéresse pas. Alors Marshall donne la distribution des Beatles à Vee-Jay. Quand Ahmet l’apprend, il est furieux. Bien sûr Wexler ne parle pas de ça dans son autobio. Il s’en explique ailleurs, disant «qu’il n’y avait pas de blues dans les Beatles» et donc ça ne pouvait pas l’intéresser - That’s why I didn’t care about the Beatles and I did like the Rolling Stones - Aux yeux de Greenfield, la décision de Wexler fait partie des grandes erreurs de l’histoire du record business. Ahmet ne lui pardonnera jamais cette «trahison». Mais ça ne s’arrête pas là. Lors d’un meeting avec Leiber, Stoller, George Goldner et Wexler, Ahmet découvre le pot-aux-roses : Wexler veut racheter Atlantic. Quoi ? Ahmet met fin à la mutinerie en disant : «Il n’y a qu’un seul problème. Atlantic m’appartient.» Aux yeux d’Ahmet, il n’existe rien de pire que la trahison. Quand il découvre que Wexler a ourdi le complot dans son dos, il est furieux. Leur relation de confiance en prend un sacré coup. Pour Ahmet, c’est foutu. Et pourtant, ils vont continuer de bosser ensemble.
Et pourtant, Ahmet est conscient des limites de ce qu’on appelle the Atlantic sound : «Ce que l’industrie appelle the Atlantic sound fut remplacé par le Motown sound, qui était fabuleux. J’ai tout de suite adoré ça, je ne savais pas comment le reproduire et ça me paniquait. On ne savait pas comment le composer, comment le jouer, comment le chanter. Motown était plus moderne et plus hip que ce qu’on faisait, le public a suivi et c’est devenu la pop music.»
Ahmet s’entend bien avec Phil Spector. Totor voit en Ahmet un mentor et un père de substitution. De son côté Ahmet est subjugué par l’intelligence de Totor : «I’ve never seen anybody like Phil before and I’m sure I won’t see anybody like him again.» Il ajoute ce qu’on sait déjà : «Phil était complètement cinglé, mais charmant, extrêmement intelligent et très talentueux.» Ils passent leurs soirées ensemble dans les clubs à jiver le slang comme Mezz Mezzrow. Ahmet lui offre vite un job chez Atlantic. Mais les autres pontes d’Atlantic ne peuvent pas schmocker Totor qui le leur rend bien. Soit on le traite d’asshole, soit d’insane. L’amitié d’Ahmet et de Totor dure jusqu’en 1961.
Ahmet et Wexler bossent aussi avec deux autres génies des early sixties, Leiber & Stoller. Greenfield nous ressert la fameuse anecdote du «There Goes My Baby» des Drifters que Wexler ne supporte pas. Quand il entend cet enregistrement financé par Atlantic, il pique une crise de colère et jette dans le mur son sandwich au thon qui, nous dit Stoller, y reste collé. Par contre, Ahmet trouve l’enregistrement excellent. Il est tellement excellent qu’il grimpe en tête des charts. Greenfield : «Que quatre hommes avec des personnalités aussi fortes puissent s’entendre sur un point relevait du miracle. En 1961, après que Totor soit devenu producteur superstar, Leiber & Stoller demandent à ce qu’on les crédite comme producteurs sur les albums. D’abord outragé par cette requête, Wexler finit par céder.»
Nouveau coup de cœur d’Ahmet : the Budffalo Springfield qu’il trouve «very special in so many ways» : ils écrivent des chansons qui ne ressemblent à rien de ce qui existe, ils ont trois lead singers qui sont aussi des grands guitaristes, Neil Young, Stephen Stills et Richie Furray - Je veux dire qu’un groupe a de la chance quand il arrive à avoir ne serait-ce qu’un seul bon chanteur et un seul bon guitariste - Aux yeux d’Ahmet, Buffalo Springfield est l’un des «greatest rock’n’roll bands I’ve heard in my life». Et pourtant, Stills et Young n’avaient rien en commun. Stills était encore plus déterminé et ambitieux que Neil Young. Selon Neil Young, «Stills crevait d’envie d’aller à Londres traîner avec les Beatles aussitôt que possible.» Le Buffalo commence à tourner aux États-Unis, mais ça se passe mal, la tension monte dans le groupe, Stills frappe Bruce Palmer sur scène à New York parce qu’il joue trop fort et pour le remercier, Palmer colle un tas dans la gueule de Stills qui s’écroule dans la batterie. Comme l’a fait Totor, Stills prend Ahmet comme modèle et comme mentor. Greenfield : «En vieillissant, il commença à s’habiller comme Ahmet et il portait un bouc. Il commença aussi à s’acheter des pompes à 5 000 $.»
Malgré les succès, Wexler reste hanté par le fantôme de la faillite - Depuis le début, nous n’avons pas le choix : c’est grossir ou disparaître. Et qui peut prédire l’avenir ? Tous les autres labels indépendants ont disparu - C’est lui qui pousse à la roue pour revendre Atlantic et aller en Floride mener une vie de rentier. Ahmet finit par céder et il revend Atlantic à Warner pour 17,5 millions de $. Bon prince, Warner propose à Ahmet et Wexler de continuer à gérer leur boutique et à choisir les artistes. Même traitement de faveur pour Jac Holzman qui a vendu Elektra à Warner. Le nouveau conglomérat s’appelle WEA.
Avec Buffalo Springfield, Ahmet entre dans sa phase ‘rock blanc’ : Crosby Stills & Nash, Cream et les Stones. Il apparaît que le véritable rock’n’roll animal dans cette histoire est Stephen Stills. Greenfield nous raconte que Crosby, Stills & Nash passent neuf heures à travailleur l’excellent «Long Time Coming» de Croz, et quand les autres qui en ont marre partent se coucher, Stills reste dans le studio à peaufiner les arrangements jusqu’à l’aube, pour que Croz soit à l’aise au chant. Les autres surnomment Stills ‘Captain Many Hands’. C’est lui qui joue tous les instruments sur le premier album, excepté les drums. Un peu plus tard, lorsque Stills tourne à la coke, il devient insupportable et Geffen qui s’occupe de lui en tant qu’agent le raye de la liste de ses clients. Greenfield consacre pas mal de place à Geffen qui à cette époque s’occupe aussi de Laura Nyro. Geffen rencontre Clive Davis qui est alors le boss de Columbia et lui promet de lui amener Stills qui est alors signé sur Atlantic. Geffen commet l’erreur de sa vie en allant voir Jerry Wexler chez Atlantic, au 1841 Broadway. Il y a en effet deux gros problèmes : un, Wexler n’est pas un grand fan des rockoids à cheveux longs, contrairement à Ahmet, et deux, il supporte encore moins les agents. Comme Geffen lui demande de casser le contrat de Stills, Wexler pique l’une de ses crises légendaires, il hurle ‘Get the fuck out of there’, chope Geffen par le colbac et le jette dans le couloir. Geffen revient chez Stills qui attend la bonne nouvelle, mais Geffen lui dit : «My God, ce sont des animaux là-bas !».
Plus tard, Steve Ross, le big boss de WEA réunit ses directeurs pour une journée de travail chez lui à Beverly Hills : autour de la table se trouvent les deux frères Ertegeun (Ahmet et Nesuhi), Mo Ostin, Jerry Wexler, Jac Holzman et David Geffen. Geffen dit en aparté à Wexler qu’il vient de signer Dylan. Bon, Wexler encaisse sans rien dire. Un peu plus tard, il profite d’un point de détail pour rentrer dans la gueule à Geffen qui et assis à côté de lui : «You stole an artist that we had !». Geffen fait pffff, et ajoute : «You’re an old washed-up record man, what the fuck do you know ?». L’injure suprême. Alors Wexler devient tout rouge, les veines de son cou gonflent et ses yeux sortent des trous. Il perd complètement le contrôle de lui-même et repique l’une de ces crises qui font sa légende. Il hurle à Geffen : «You agent ! You’d jump in a pool uf pus to come up with a nickel between your teeth !», ce qui peut vouloir dire que même au fond une mare de pus, il ramasserait une pièce de monnaie avec les dents. Alors les autres sautent sur Wexler juste avant qu’il ait le temps de frapper Geffen et ce conclave qui réunit les hommes les plus puissants du record biz se transforme en partie de catch. Steve Ross est outré, «Ce n’est pas possible !», Mo Ostin se lève, dit qu’il ne peut pas tolérer ça et s’en va. Et Wexler hurle at the top of his lungs.
Ahmet aime bien Geffen, mais avec parcimonie. Un jour, George Trow, Geffen et Ahmet sont au Beverly Hills Hotel et Geffen prend un appel. C’est Joni Mitchell. Pendant que Geffen papote, Ahmet dit à Trow : «Il doit être en train de parler à un artiste. Il prend son air inspiré. Pour ça, il doit essayer de se débarrasser momentanément de sa cupidité.» Lors d’un vol à bord d’un avion, Ahmet est assis en face de Geffen et lui jette sur la tête sa cendre de cigarette. Geffen lui annonce que s’il n’arrête pas immédiatement, il va lui jeter un verre d’eau à la figure. Comme Ahmet n’arrête pas, Geffen passe à l’acte. Pendant des années, ils ne vont plus s’adresser la parole. Avant de se réconcilier.
Quand Cream enregistre Disraeli Gears à New York, Ahmet tente de mettre Clapton en avant, mais il finit par découvrir que le vrai leader de Cream, c’est Jack Bruce. Mais le groupe va très vite se disloquer. Lors de la troisième tournée américaine, ils se battent tous les soirs. Ginger voulait buter Jack. Jack voulait se suicider. Et Clapton disait : «Sortez moi de là, je ne peux plus les supporter, ni l’un ni l’autre.» Puis Ahmet voit les Stones comme le couronnement de sa carrière. Il les considère comme «the most desirable act in business». Avec les Stones, Atlantic devient le premier label du monde. Pour les Stones, Atlantic est symbolique. Comme ils ont grandi avec Chuck Berry, ils ont fini par embaucher le fils Chess pour diriger leur label et choisi Atlantic pour la distribution américaine, parce qu’ils écoutaient aussi Ruth Brown et Ray Charles quand ils étaient jeunes. Une façon de boucler la boucle, alter all. Ils signent l’accord chez Jagger à Londres, un Jagger qui raconte la scène : «Ahmet avait tellement bu de bourbon qu’au moment de se serrer la main, sa chaise se renversa et il tomba à la renverse.» Comme le dit si bien Greenfield, the honeymoon was about to begin.
Côté rigolade, Greenfield épingle deux ou trois anecdotes hilarantes. Wilson Pickett se trouve chez Stax à Memphis et Wexler lui propose d’enregistrer «Hey Jude». Pickett l’envoie chier, pas question d’enregistrer «Hey Jew» ! Pire encore. Otis Redding appelle Nesuhi Ertegun ‘Nescafe’ et Ahmet ne reprend pas Otis quand il l’entend l’appeler ‘Omelet’. Un Otis qui un jour est tellement bourré qu’en faisant une révérence, il se pète la gueule. Ça, il faut savoir le faire.
Ahmet se marie une première fois avec une certaine Jan Holm dont il n’est pas vraiment amoureux - C’était une very nice girl mais je n’étais pas follement amoureux d’elle et je ne pense pas qu’elle fût amoureuse de moi. Pourtant je l’ai demandée en mariage et elle a accepté car il semblait que c’était la seule chose qu’elle pût faire - Évidemment, le mariage tourne court, Ahmet accepte le divorce, lui donne tout ce qu’il possède et retrouve sa chère liberté : chaque nuit, il est en ville, dans les clubs, usually with a stunning young model on his arm.
Geffen nous rapporte un épisode comique. Ça se passe dans le bureau d’Ahmet. Geffen lui demande : «Comment faites-vous pour gagner autant d’argent dans le music biz ?» Ahmet se lève et traverse la pièce en courant. Il dit à Geffen : «Voilà comment je gagne beaucoup d’argent.» Geffen ne comprend pas. Alors Ahmet refait exactement le même cirque. Il court et s’arrête. Geffen dit qu’il ne comprend toujours pas. Ahmet s’impatiente : «Regarde schmuck, je le fais encore une fois. Prends des notes.» Il court à travers la pièce. Geffen avoue qu’il ne comprend toujours pas. Alors Ahmet lui dit qu’avec un peu de chance, on court et on se cogne dans un génie qui va vous rendre riche. Les Anglais appellent ça bumping into geniuses. Et Ahmet en a bumpé pas mal : Phil Spector, Wexler, Ray Charles, Leiber & Stoller, Jagger & Richards.
Pour fêter le 25e anniversaire d’Atlantic en 1973, Ahmet emmène 200 personnes à bord d’un Boing 747 pour aller faire la fête à Paris. À bord de l’avion, tout le monde boit, fume des joints et sniffe de la coke. Party ! Quand Wexler s’endort, Ahmet lui pique son passeport et remplace la photo par celle d’une femme qui se fait enfiler par un âne. Quand Wexler présente son passeport à Orly, le douanier regarde la photo, puis Wexler. Voulant se rendre utile, Wexler dit qu’à l’époque il portait une barbe. À côté de lui, Ahmet s’écroule de rire. En fait, ce mec aura passé sa vie à rigoler et à s’amuser. Il possédait une Bentley, une Rolls, une Sunbeam et deux Cadillac Fleetwood, l’une bleue, l’autre verte. Il collectionnait les toiles de Jasper Johns, Rauschenberg et un Matisse, son artiste préféré. Quand il voit Wexler démissionner, Ahmet devient philosophe : «Il est triste parce que la musique qu’il aimait tombe en désuétude. C’est une erreur que d’accorder trop d’importance à la musique qu’on enregistrait. Ce n’est pas de la musique classique. On ne peut pas la voir de la même façon. C’est comme les vieux films de Fred Astaire. Ils sont marrants, mais ce n’est pas du grand art. Il ne faut pas les voir comme du grand art.» Dans un paragraphe en exergue, Dave Marsh déclare : «J’ai connu John Hammond, Jerry Wexler et Sam Phillips, et laissez-moi vous dire qu’Ahmet fut the greatest record executive who ever lived. Il était plus créatif, il avait plus de goût, il a duré plus longtemps, il avait les meilleures relations avec les artistes, et il n’a jamais cessé d’ouvrir des marchés et de les maintenir en activité.» Dans les années 90, il signe des groupes comme Foreigner, AC/DC, Twisted Sister, Yes, INXS, Genesis, et du coup, Atlantic n’a plus rien à voir avec ce qui fit sa spécificité. Ahmet raisonnait un homme d’affaires, il avait besoin de continuer à générer d’énormes profits. Mais il nous rassure aussitôt : «J’écoute beaucoup de musiques actuelles, mais j’écoute surtout Pee Wee Russell et Bud Freeman, et toujours le «Shreveport Stomp» de Jelly Roll Morton, that’s the hottest record ever made.» Ahmet fréquente aussi Cher qui est devenue une superstar, il aime bien lui peloter les seins en public, alors Cher s’indigne tendrement : «Oh Ahmet !». Il adore aussi pincer les fesses des artistes qu’il signe, mais ça ne plaît pas à toutes. Alors Ahmet rigole. En plus il est marié avec Mica, et Mica sait qu’Ahmet vient d’une culture où les hommes ont plusieurs femmes, aussi comprend-elle parfaitement qu’Ahmet puisse continuer de vivre sa vie d’homme en se tapant une copine de temps en temps. Comme la femme de Muddy, elle a cette grande intelligence.
Signé : Cazengler, Ertegouine
Robert Greenfield. The Last Sultan. Simon & Schuster 2011
Ronnie Bird
Avant de s’appeler Ronnie Spector, elle s’appelait Veronica Bennett. Elle tenait sa couleur de peau d’un joli métissage : père irlandais et mère métisse d’indien Cherokee et de noir, comme Jimi Hendrix. Elle chantait dans les Ronettes avec sa grande sœur Estelle et une cousine nommée Nedra Talley. Elles habitaient toutes les trois Spanish Harlem et adoraient Frankie Lymon. Veronica passait ses journées à la fenêtre de sa chambre à regarder les filles de Spanish Harlem déambuler avec des grosses coiffures et des clopes au bec - I loved that tough look - Oui, Veronica aimait beaucoup le look des street bitches. Et puis un beau jour, la vie des Ronettes bascula dans le rêve : Phil Spector les prit sous son aile pour les transformer en super stars.
Avec Totor, ça ne traînaient pas. Il lui fallait des hits galactiques ! Quickly ! C’mon ! Il savait où trouver des cocos pour l’aider à les composer. Il tapait aux portes des petits bureaux du Brill. Toc toc toc !
— Hi Cynthia ! Hi Barry ! Et si on composait un petit hit galactique pour mes nouvelles pouliches ? Ça vous branche, les cocos ?
— Chouette idée, Totor ! Tiens, regarde, il pleut ! On pourrait faire un truc sympa sur la pluie, pas vrai ?
Et Cynthia Weil se met à pianoter une mélodie galactique.
— Tatata, walking in the rain... Tatata, pas mal, hein, Totor ?
— Ouais, c’est pas mal, Cynthia, mais monte un peu à l’octave, là, pour embarquer ton thème, oui là, tatataaaaaaa, aw fuck, quelle mayotte, ma cocotte ! Fuck shit up, on va encore défoncer la rondelle du Billboard ! Il finira par marcher comme un cowboy, le Billboard, si on continue à le défoncer comme ça, les cocos, ha ha ha ! Quelle merveille ! Play it again, Cynthia ! Tatataaaaaaa, walking in the rain ! Veronica et les deux autres bécasses vont te chanter ça aux petits oignons, tu vas voir !
Une chose est bien certaine : « Walking In The Rain » fait frémir. C’est un hit dégoulinant de génie, mais un génie particulier, car attentif au global comme au moindre détail. Quant à ce jerk royal, « (The Best Part) Of Breaking Up », on le danse à l’Égyptienne, avec les poignets cassés. On y sent les effluves du River Deep. On le sent destiné à traverser les siècles. Dans 2 000 ans, on dansera encore ce jerk royal des Ronettes.
Totor fonce vers un autre bureau. Toc toc toc !
— Hi Ellie ! Hi Jeff ! Vous avez un moment ? On pourrait peut-être composer un petit hit galactique pour mes chouchoutes de Spanish Harlem ?
— Oh, toi Totor, on voit bien que t’es amoureux...
— Hey Ellie, pas si vite ! Une chose que mon grand-père m’a apprise est qu’il ne faut jamais brûler les étapes, right ? Bon, alors, qu’avons-nous comme idée, mes cocos ?
— I wonder...
— Ah pas mal, Jeff, c’est un titre ?
— Yeah, man !
— Alors, Ellie, pianote-nous l’un de ces petits jives dont tu as le secret....
— Écoute un peu ça, Totor ! Plonk plonk plonk !
— Aw ! Terrific ! What a profondeur ! Vas-y monte-moi ça à l’octave ! I wondeeeeeer ! So gooood ! Encore un coup de Trafalgar galactique en perspective, hein ? What a mélodie ! Ça va leur jerker la paillasse ! T’aurais pas autre chose, Ellie ? Allez, arrête de faire ta mijaurée, tu as bien une idée de riff dynamiteur en magasin...
— J’ai ça, Totor, écoute... Dessus, il faudrait des paroles du genre be/ my ba/ by, tu vois, bien ponctuées sur les accords, plonk plonk plonk, tu peux nous écrire des paroles, mon petit Jeff chéri ?
— Ouais ma Lilie, attends, be my/ Baby/ Be my little baby/ Say you’ll be my darling/ Be my baby now/ Oh, oh, oh, oh !
— Bon Jeff tu ne t’es pas foulé sur ce coup-là, mais ça suffira. Merci Ellie pour ce nouveau coup de génie. Franchement, je ne sais pas ce qu’on deviendrait sans toi...
« Be My Baby » incarne le génie productiviste de Totor à l’état le plus pur. Et le génie composital d’Ellie Greenwich à l’état le plus torride. Comme résultat de la combinaison des deux, on obtient le démarrage de refrain le plus foudroyant de l’histoire du rock. Fallait-il que Totor et Ellie soient géniaux pour nous servir une telle tambouille ! Brian Wilson était au volant lorsqu’il entendit « Be My Baby » pour la première fois à la radio. Il fut tellement frappé par la puissance du hit qu’il en perdit le contrôle de sa bagnole.
— Tu vas peut-être penser que j’exagère, Ellie, mais il me semble deviner au pétillement de ton regard que tu as encore une idée en tête.
— On ne peut vraiment rien te cacher, Totor. J’ai effectivement un truc qui me gratte l’ovule depuis un moment. It goes like this... Plonk plonk plonk. Là-dessus, il faudrait chanter quelque chose du genre, Ba/ By/ I love/ You... Tu vois, Jeff chéri ?
— Ah oui, je le sens bien, mmmmm... On pourrait essayer ça... Come on baby/ Oh-ee baby/ Baby I love only you !
Ça fait marrer Totor :
— Jeff, fais gaffe, tu pourrais te faire une entorse au cerveau, si tu fais trop d’efforts... Bon, on va mettre nos trois biquettes en studio demain matin et orchestrer ce nouveau hit greenwichien comme il se doit ! Merci de votre collaboration, mes cocos !
« Baby I Love You » bénéficie d’une attaque démente. C’est l’archétype du couplet pop secoué aux tambourins. L’extraordinaire classe de l’inventivité de Totor et d’Ellie Greenwich sidère encore la terre entière. Le refrain relève du phénomène surnaturel. Il n’est pas surprenant que Joey Ramone soit devenu FOU de cette chanson.
Quand le premier album des Ronettes est arrivé en Europe, ce fut une déflagration atomique, mais au sens positif de la chose. On trouve aujourd’hui un autre album des Ronettes qui s’appelle Volume 2 et qui propose des petites merveilles du même acabit. Totor composait des choses avec Harry Nilsson, comme par exemple ce « There I Sit » intrigant car sous le vent et accompagné par des marteaux piqueurs. On trouve aussi une autre merveille signée Totor, Cynthia Weil & Barry Mann, « (I’m A) Woman In Love » : si elle décolle à un moment, c’est uniquement pour tétaniser les esprits. Retour d’Ellie avec « I Wish I Never Saw The Sunshine », une machine à jerker d’un éclat invraisemblable et qui explose à la face du monde. Aujourd’hui, les hits pop ont perdu toutes ces dynamiques.
Totor et Ronnie se sont mariés, puis Ronnie s’est plainte de Totor. De 1968 à 1972, elle a vécu comme séquestrée dans leur belle villa d’Hollywood : barreaux aux fenêtres, clôture électrifiée, chiens de garde - All he wanted me to do was stay at home and sing Born To Be Together to him every night - Elle s’évada et divorça.
C’est là qu’elle a commencé à en baver. Elle s’asseyait sur une réputation, mais elle n’avait plus que sa voix. Toute la magie d’antan s’était envolée. Pfffff, plus rien. Des gens comme John Lennon, Joey Ramone et Amy Whinehouse qui imitait son maquillage et sa coiffure l’aidèrent à revenir dans l’actualité. En 1980, elle essaya d’enregistrer un album de rock new-yorkais, le fameux Siren, mais ce fut douloureux, pour elle comme pour nous. Elle avait pourtant rassemblé une grosse équipe, Cheetah Chrome des Dead Boys à la guitare, Billy « Wrath » des Heartbreakers à la basse et d’autres gens réputés, mais les cuts restaient d’une affligeante banalité. Elle attaquait pourtant avec l’« Here Today Gone Tomorrow » des Ramones. Elle enchaînait avec « Darlin’ », une sorte de petit hit bien balancé et solidement interprété, mais on était loin des fastes d’antan. Elle allait même chercher l’« Anyway That You Want Me » de Chip Taylor popularisé par les Troggs, mais encore une fois, la magie faisait gravement défaut. Totor en aurait fait un chef-d’œuvre, c’est évident. Elle sortait de cette aventure malheureuse avec « Happy Birthday Rock’n’Roll », l’occasion pour elle d’utiliser la nostalgie pour recycler des extraits de « Be My Baby ».
Quelques années plus tard, elle réapparût avec un album encore plus médiocre, Unfinished Business. Elle tentait désespérément de retrouver la veine du Brill, mais ça ne marchait pas, car elle tombait dans tous les pièges de la prod des années 80. C’était carrément de l’abattage. Le disque était tellement mauvais que le disquaire qui le vendait me l’offrit. Le seul morceau sauvable de ce disque était celui qui se nichait en fin de B, « Good Love Is Hard To Find », une petite pièce de r’n’b aux allures de good time music qui accroche bien.
En 2006, Ronnie fit une espèce de come-back avec l’album The Last Of The Rock Stars et un gros tas d’invités : Joey Ramone, Keef, Nick Zinner des Yeah Yeah Yeah, les Greenhornes, les Raveonettes, Daniel Rey et quelques autres luminaries. « Work On Fine » sonnait comme un cut légendaire. Dans cette fabuleuse reprise d’Ike Turner, Keef donnait la réplique à Ronnie - yes darling - Ils en faisaient un chef-d’œuvre de groovitude. L’autre grosse pièce de cet album était « Hey Sah Lo Ney », une cover de Mickey Lee Lane popularisée par les Detroit Cobras sous un autre nom, « Hey Sailor ». Ronnie s’en sortait avec tous les honneurs. « Ode To LA » était une tentative désespérée de revenir au temps béni du Brill. Sune Rose Wagner des Raveonettes s’était cru autorisé à singer Totor et Ellie Greenwich en proposant une pop-song aventureuse et en la produisant avec les pompes d’antan. Mais ça ne marchait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que Totor est un génie, alors que Sune Rose Wagner n’est qu’un Danois. On retrouvait aussi sur cet album une nouvelle mouture de l’« Here Today Gone Tomorrow » des Ramones. Des backings chancelants lui donnaient une allure extraordinaire. Ronnie savait que Joey était dingue des Ronettes, alors Ronnie est devenue dingue des Ramones, ce qui semblait logique. Elle soignait tout particulièrement la petite montée de fin de cut. Sur d’autres morceaux, on entendait Daniel Rey jouer de la guitare, et pour tous les amateurs de big sound new-yorkais, c’était un plaisir que de le retrouver.
Et puis soudain, nous voilà tous rendus en 2016 ! 52 ans se sont écoulés sous le Pont Mirabeau depuis l’irruption des Ronettes dans les charts du monde entier. Ronnie revient dans l’actualité avec un nouvel album et un concert au New Morning.
L’album s’appelle English Heart, et comme son nom l’indique, c’est un album de reprises de hits anglais. Ronnie explique qu’elle est restée nostalgique de sa première tournée en Angleterre, alors elle tape dans le « Because » du Dave Clark Five - Bekos ! Bekos ! - Elle y va avec toute la fougue de sa jeunesse perdue. Elle tape bien sûr dans les Stones qu’elle a bien connus avec « I’d Much Rather Be With The Girls » - une compo d’Andrew & Keef. Elle en fait un racket, transformant les girls en boys. Encore plus gonflé : sa version de « Tired Of Waiting » des Kinks, mais la voix ne colle pas, c’est trop putassier. Et ça continue avec les Zombies (« Tell Her No »), les Beatles (« I’ll Follow The Sun » - ce vieux b-side d’EP qu’on finissait par adorer), Sandie Shaw (« Girls Don’t Come »), et puis cette surprenante reprise de l’« How Can You Mend A Broken Heart » des Bee Gees dont elle fait une version incroyablement osée, nappée d’orgue et pulsée au beat de Spanish Harlem. Ronnie se prend au jeu et ça tourne à l’enchantement.
Oui, car désormais, tout cela n’est plus qu’une histoire de nostalgie. Voir arriver Ronnie sur scène, c’est voir arriver la fin d’une époque magique. Elle dégage un truc que ne dégageront plus les nouveaux prétendants au trône. Il faut désormais accepter l’idée que ce chapitre de l’histoire du rock se referme. Un chapitre qui est aussi le nôtre, celui des gens qui ont grandi avec, et qui va se refermer avec nous. Ça se termine, mais au moins ça se termine en beauté.
Un seul concert de Ronnie Spector suffit à recréer cette magie perdue, à laquelle nous fûmes tant attachés et qui d’une certaine façon nous a tous façonnés, en nous protégeant de la médiocrité du monde moderne. Quand on écoutait les hits de Totor ou de Brian Wilson, on ne pouvait pas s’intéresser à la variété française. Et Ronnie Spector sur scène, ça ne trompe pas. Elle apparaît toute de noir vêtue, silhouette impeccable, rayonnante, d’évidence ravie de l’accueil des Parisiens. Elle crée aussitôt de l’émotion et paf, elle envoie « Baby I Love You » histoire de nous sonner un peu les cloches. Et tout le set sera placé sous le signe de l’émotion, car encore une fois, Ronnie tape au point le plus sensible de l’histoire du rock. Elle est accompagnée par trois délicieuses choristes et un backing-band irréprochable. Elle commente toutes ses chansons et le public boit ses paroles. Elle quitte la scène pendant une version torride de « What’d I Say » et revient pour envoyer au firmament un « Walking In The Rain » qui n’a pas pris une ride. Bien sûr, ce n’est pas le wall of sound, mais par sa seule présence et par son charisme, Ronnie se situe bien au-delà de toutes les attentes. Elle incarne tout simplement la grande pop américaine. Elle a exactement le même genre de classe et de stature que Martha Reeves ou Mavis Staples. Et voilà qu’elle balance une version un peu funky de « You Can’t Put Your Arms Round A Memory » et quitte la scène en plein dans l’apothéose de « Be My Baby ». Au premier rang, on voit des mâchoires se décrocher. Rappel ? Pas rappel ? Si, rappel ! Elle fait un retour triomphant pour rendre hommage aux guys - A little dating with John - avec « I’ll Follow The Sun » qui passe mille fois mieux sur scène que sur son dernier album et puis c’est l’explosion atomique avec « I Can Hear Music », l’un des hits pop les plus ravageurs de l’âge d’or.
La petite métisse de Spanish Harlem qui vient de casser sa pipe en bois mérite bien sa place dans l’Olympe des temps modernes, parmi les vivants et les morts, les dieux ailés et les dieux cornus.
Signé : Cazengler, un Spector des travaux finis
Ronnie Spector. Disparue le 12 janvier 2022
Ronnie Spector. Le New Morning. Paris Xe. 22 juin 2016
Ronettes. Presenting The Fabulous Ronettes Featuring Veronica. Phillies Records 1964
Ronettes. Volume 2. Phillies Records 2010
Ronnie Spector. Siren. Polish Records 1980
Ronnie Spector. Unfinished Business. Columbia 1987
Ronnie Spector. The Last Of The Rock Stars. High Coin 2006
Ronnie Spector. English Heart. Caroline Records 2016
Ronnie Spector. Nobody’s Baby. Lois Wilson. Mojo #256. March 2015
Inside the goldmine - Rocking Bone
Il en avait bavé dans la côte, ce putain de Solex était encore tombé en panne à cause de cet abruti de Lionel qui pour soit-disant gonfler le moteur avait agrandi les admissions à la lime, et forcément le Solex n’avait pas supporté l’opération, pleurt pleurt pleurt en pleine côte de Saint-Hubert, ah la vache, obligé de pédaler comme un forçat pour arriver jusqu’en haut avec tous ces abrutis qui klaxonnaient derrière parce qu’ils ne pouvaient pas doubler à cause des camions qui descendaient en sens inverse, un vrai cauchemar cette affaire-là et c’était sûrement pas le moment, parce qu’à la maison, le glauque régnait sans partage, il battait tous les records, Hitchcock n’aurait jamais pu imaginer un plan pareil, avec cette belle-mère, la troisième du nom, qui picolait en cachette et qui insultait tout le monde à table, la garce, c’était facile pour elle car on avait ordre de fermer nos gueules, pas question d’ouvrir le bec sauf pour avaler cette saloperie de chou-fleur à la béchamel qu’elle nous servait tous les soirs sans exception, elle servait cette merdasse à la louche, alors il fallait avaler ça aussi vite que possible pour sortir de table et aller se réfugier dans nos chambres, car c’était le seul endroit peinard de la baraque, on pouvait y écouter des disques mais pas trop fort et se plonger dans la lecture de Creem & Châtiment, ce vaillant petit canard américain qui grouillait d’infos sur tous ces groupes mythologiques qui nous faisaient baver, comme par exemple les Jukin’ Bone qu’on a longtemps appelé les Junkin’ Bone parce qu’on avait mal lu les pochettes de ces deux albums RCA qu’on était allé un jour acheter à Paris en ayant pris ce choo choo train de give me just a little more acceleration et il fallait voir comme on était content de ramener ces deux albums dans le terrier glauque, de véritables trophées, on les ressortait du sac toutes les cinq minutes pour les admirer encore et encore, on s’en émerveillait à s’en arrondir le dessin des yeux.
C’est vrai qu’à l’époque on adorait ces petits albums de groupes américains pas très connus, on leur attribuait une valeur on va dire affective car il ne s’agissait pas non plus de grands albums. Les deux albums de Jukin’ Bone sont sortis la même année, en 1972. Évidemment, il n’existe aucune information sur ce groupe avalé depuis longtemps par l’oubli. En creusant un peu, on découvre qu’ils sont originaires d’Upstate New York et que 44 ans après leur split, ils se sont reformés pour enregistrer un nouvel album. Bon bref. Le fait de savoir que Jukin’ Bone a survécu donne du baume au cœur, mais c’est en 1972 que se jouait le destin de ces deux albums irrémédiablement classiques. Ils jouaient leur boogie rock en pères peinards sur la grand-mare des canards. On les voit tous les six sur la pochette de Way Down East, avec leurs petits cheveux longs, leurs vestes en velours, leurs pattes d’eph et leurs boots. Tout le monde portait des boots en 1972. Tous les mecs qui écoutaient du rock portaient les cheveux longs. On devait écouter plusieurs fois Way Down East pour essayer de se convaincre qu’il s’agissait d’un bon album, mais il y avait dix mille fois plus de viande chez les Pink Fairies et le Vanilla Fudge que chez les Bone. Alors on persévérait, tiens, «Nightcrawler», c’est pas mal, c’est plus corsé et même sacrément corsé, ajoutait-on, on stompait ça des boots et on les voyait aller chercher le petit raunch. Mais leur boogie rock restait globalement bon enfant. On se demandait d’ailleurs comment ils avaient réussi à signer sur RCA qui était quand même le label d’Elvis et de David Bowie. Ils terminaient leur bal d’A avec un «Mojo Conqueroo» copié sur le thème des Gilded Splinters, ce qui avait le don de nous enthousiasmer. Et puis en B, ils nous resservaient une belle resucée de «See See Rider» qui tombait bien au pli, Joe Whiting chantait au sommet de son petit lard, on les sentait bien inspirés par les trous de nez, mais bon, on préférait nettement la version d’Eric Burdon. Sur scène, les Bone devaient impressionner, car si on retourne la pochette, on tombe sur une photo qui met l’eau à la bouche. Early seventies aux USA, ça faisait rêver tous les petits branleurs de province.
Leur deuxième album s’appelait Whiskey Woman. Pochette illustrée, ambiance urbaine, la nuit tombe sur la ville et comme pour le premier album, photo de scène au dos. Ils démarraient avec un «Jungle Fever» qui n’avait de fever que le nom, mais ils s’amusaient bien, ce qui était le principal, il ne fallait surtout pas les embêter. Tout était bien joué sur cet album, bien structuré, gratté au riff de gras double, incroyablement cousu de fil blanc, mais globalement c’était bien senti. On tombait enfin sur une énormité : «Spirit In The Dark», joué aux fantastiques accords de clameur groovy, c’était plein d’écho, élégant et conquérant. Il s’agissait du hit des Bone, joué dans un fantastique élan suprématiste, au cœur du cut se nichait un démarrage aux accords de groove, un merveille intersidérale qu’on voyait s’envoler. Et là les Bone devenaient des héros, sur la foi d’un seul cut, «Spirit In The Dark». Alors forcément, on retournait la galette et on dressait l’oreille, car on attendait des miracles. Ils démarraient leur bal de B avec le morceau titre, un boogie rock bien cossu. Ils connaissaient toutes les ficelles de caleçon, ils n’étaient pas nés de la dernière pluie et ils enchaînaient avec une resucée du vieux «Going Down» de Don Nix, mais pour le miracle, tintin. S’ensuivait une autre cover, «The Hunter», version bien musclée, mais le pauvre Joe Whiting n’avait pas la voix de Paul Rogers. Et l’album s’achevait dans une sorte de banalité. Il n’y avait pas de quoi se prosterner, mais bon, ça avait le mérite d’exister.
Signé : Cazengler, Jukin’ Bore
Jukin’ Bone. Way Down East. RCA Victor 1972
Jukin’ Bone. Whiskey Woman. RCA Victor 1972
L’avenir du rock - Shadracks & roll
L’avenir du rock se doutait bien qu’ils finiraient par lui poser la question :
— Que pensez-vous de la transmission génétique, avenir du rock ?
— Pas grand chose...
— La transmission génétique fait pourtant théoriquement partie du diagramme de vos thématiques... Vous évoquez les héritages mais curieusement vous n’abordez jamais la question de la transmission génétique...
— Pffffff... Que voulez-vous que je vous dise ?
— Vous pourriez expliquer aux auditeurs de Franche Culture que le rock, au même titre que l’intelligence ou la schizophrénie, peut être considéré comme un gène transmissible...
— Vous devriez plutôt interroger un généticien...
— Ne soyez pas cynique, avenir du rock, l’histoire du rock grouille d’exemples de transmissions génétiques, et vous les connaissez très bien. Quel est le premier exemple de gène rock qui vous vient à l’esprit ?
— Gene Vincent !
— Ah ah ah ! Ce que vous pouvez être spirituel ! Ah ah ah ! Vous en avez certainement une autre ?
— Starkey et Hutch !
— Ah ah ah, quel sens de la répartie ! Allez, avenir du rock, faite encore rigoler l’auditoire de Franche Culture qui en a bien besoin...
— Me casse pas les Burnettes, Billy !
— Ah ah ah ! Vous ne faites pas semblant ! Vous n’êtes pas dans la gêne, côté gènes, n’est-ce pas ? Ah ah ah ! Excusez-moi j’en ai les larmes aux yeux ! Une petite dernière, peut-être ?
— Les chiens ne font pas des Shadracks.
Il est fort probable que les auditeurs de Franche Culture n’aient rien compris à la dernière vanne de l’avenir du rock. Sauf ceux qui écoutaient jadis le Dig It! Radio Show. Gildas programmait les Shadracks parce que leur premier album grouillait de classiques gaga. Logique car Huddie Shadrack est en fait le fils de Wild Billy Childish. Comme les chiens ne font pas des Shadracks, Huddie sonne comme son père. Ça tombe sous le sens.
Le meilleur exemple de gaga génétique s’appelle «Corinna», au bout de la B de ce premier album, un cook me down claqué aux accords de basse avec de forts relents de Louie Louie. Huddie n’en peut plus, Corinna in my arms ! L’album grouille aussi d’échos de proggy pop. Huggie a de toute évidence écouté des tas de très bons albums. Le «Splitting In Two» de fin de B se termine en apothéose d’accords stoogiens, mais anglicisés. Le coup de génie de l’album est la cover de «Boredom» qui ouvre la bal de la B : cover explosive d’un hit explosif, méchant clin d’œil aux Buzzcocks, c’est vite expédié en enfer. Bor’dom Bor’dom ! C’est d’autant plus méritoire que «Boredom» fait partie des intouchables. Ils font aussi un petit coup de Mersey Beat avec «Things I Hear». Les coups d’harmo rappellent ceux de Brian Jones dans les early Stones. Huddie a donc formé un trio avec deux petites gonzesses, Elisa et Elle. Au dos de la pochette, Councillor Duxburry qualifie leur son de punk inspired rhythm & noise. Bien vu Councillor, c’est exactement ça. «She Sailed The Sea» sonne comme du gaga minimaliste avec de belles flambées de noise. Huddie Shadrack développe en réalité une approche du gaga très novatrice. Il utilise les limites du power-trio pré-pubère pour créer des ambiances judicieusement aléatoires. C’est Elle qui lance «Plastic Lives» au one two three four de l’ancien temps du punk-rock de l’âge d’or. Ils réussissent à conserver ce son très désabusé. Avec «Locust Flies Again», on voit qu’Huddie a hérité de tout le bataclan, ça joue à la ferraille avec une belle disto de pâté de foi. L’avenir est assuré.
Dans un numéro récent, Vive Le Rock leur consacre une petite page, notant qu’après un démarrage en mode punk attitude, they morphed into the artistic and serious band they are today. Huddie écoutait les Damned au temps de son premier album. Il dit maintenant viser un son «raw, but also quite honest and melancholic, a bit arty, even though I don’t like the term.» Pour lui, le son du deuxième album n’est ni du gaga-rock, ni du punk, ni de l’indie. Il veut juste que ça sonne interesting. Il souhaite être pris au sérieux, rappelant qu’il n’avait que 17 balais quand il a composé les cuts du premier album - It’s just been a natural progression from there. I’m just poking around in the dark for ideas.
Leur deuxième album vient de paraître et s’appelle From Human Like Forms. Un mec nommé Rhys a remplacé Elle. Bon le son n’est plus du tout le même. Le seul cut gaga est le «Wet Cake» qui ouvre le bal de la B, monté sur les accords de Louis Louie. Pour le reste, Huddie cherche sa voie et il nous fait partager son ambition. Il faut donc faire un petit effort et se montrer digne de sa confiance. Derrière lui, Elisa fait de très beaux chœurs. Ils sonnent parfois comme les Pixies («Pray»), mais passent généralement par le vieux chemin des groupes anglais. Certaines harmonies vocales renvoient au premier Soft Machine. Huddie débroussaille sa petite pop bien tempérée, il vise le climatique, l’ambiance supérieure. Il a une bonne voix, bien ferme, un peu grave, étonnante pour un kid de son âge. On entend même parfois des échos de Bowie dans ses accents chantants («It’s All Undoing»). Il y a quelque chose d’héroïque chez lui, donc d’intéressant, et même de foutrement intéressant. Il ne lui manque plus que les grosses compos. Il chante aussi un peu comme Stephen Malkmus dans le morceau titre, il développe un même sens de la pop sophistiquée. Il redouble d’ambition avec «Delicate Touch», un cut monté sur un riff de basse hypno, il rentre dans le lard de la pop avec une voix d’Américain anglicisé, il chante au grain conquérant. Et c’est avec «No Time (Slight Return)» qu’il rive son clou. On se croirait chez les punks de Manchester, c’est extrêmement bien foutu, gratté au don’t give a fuck. Belle façon de boucler un album dévoré d’ambition.
Signé : Cazengler, Shadrat d’égoût
Shadracks. The Shadracks. Damaged Goods 2018
Shadracks. From Human Like Forms. Damaged Goods 2021
Introducing The Shadracks. Vive Le Rock # 85 - 2021
*
Ecoute c'est du Belge ! Encore qu'il y a belge et belge. Si vous prisez les suavités poétiques de Charles Van Lerberghe ou les fragiles dentelles de Max Elskamp, passez à la rubrique suivante, par contre si vous adorez le bruit et la fureur à faire péter la sous-ventrière de vos chevaux de guerre qui cavalcadent dans vos neurones, restez ici. Les prévisions météo sont sûres à cent pour cent : Cyclone force 10 en route vers vos oreilles.
BRUTAL DESTRUCTION
CYCLONE
( Roadrunner Records / 1986 )
Donc des Belges, basés sur Bruxelles, c'était il y a longtemps. N'ont commis que deux albums, nous n'ouïrons que le premier, le second Inferior to none ( ne se prennent pas pour les derniers de la classe ) ne conserve que deux de cinq membres initiaux. Se sont reformés en 2019 et ont donné quelques concerts.
Johnny Kerbush : guitare / Pascal Van Lit : guitar / Guido Geveis : vocal / Stefan Daamen : bass, guitar / Nicolas Lairin : drum.
Au cas où le titre ne vous suffit pas, admirez la pochette de Nicolas Verin. Sans doute un long développement serait-il nécessaire ici pour étudier l'influence de la peinture du dix-septième siècle sur l'imagerie métal, nous nous contenterons d'utiliser la notion de perversion des genres, les vanités de l'ancien temps figurant un crâne humain, généralement sis en un décor luxueux, rappelaient aux pauvres humains qu'ils étaient voués à la mort ( et entre parenthèses, que seul Dieu est grand ), Cyclone et une kyrielle d'autres groupes, se servent de la tête de mort pour manifester leur orgueilleuse puissance, la mort ils la réservent à leurs ennemis, pour eux ils se réservent la victoire et le triomphe. A ses débuts le groupe ne se nommait-il pas Centurion.
Prelude to the end : c'est l'équivalent de Prélude et Mort d'Yseult, mais en plus rapide, un cauchemar qui passe, à peine deux minutes, le temps de se réveiller et de l'interpréter en sinistre avertissement quant à la journée qui s'ouvre, une horde de Sleipnirs odiniques qui déboule sur vous et ne manquera pas de vous piétiner. Devez être un peu maso, vous remettez illico l'intro, cette walkyrienne chevauchée fantastique est carrément dantesque. Ah ! quel plaisir ces pincées riffiques à croire que l'on projette du sel gemme sur vos plaies purulentes, délicieux ! Long to hell : je ne peux lire le mot hell dans un titre de metal sans penser au Highway to hell du Blue Öyster Cult, mais c'est indéniablement le nom de Metallica qui vous saute au cerveau ( tous les lecteurs de Kr'tnt en ont un ), derrière ça remue salement mais le pire c'est le Guido, chante comme il glaviote - j'interromps il y a une guitare qui hennit bien fort, espérons que son palefrenier soit encore vivant, j'en doute – il vous perce la figure de mollards pointus comme des vrilles – tiens le destrier a dû en ratatiner un autre contre la paroi de son box – elles vous vérolent la gueule fort joliment, ce n'est pas Mirabeau mais Miralaid, nous avons de la chance, ça s'arrête sur une dernière expectoration gluante. Fall under is command : un tempo plus lent ( juste le début ) et un morceau plus long ( pas trop cinq minutes, les dernières ), sont inhumains chaque fois que l'on arrache une dent au chanteur on devrait l'endormir au lieu de lui baratter la tête à coup de baguettes de batterie, pas le te temps de vous ennuyer, toutes les dix secondes ils inventent une horreur, les égoïnes ont l'égo aigu, Nicolas Lairin ravage ses caisses à la manière d'un varan des Galapagos qui galope après son gosse pour l'avaler tout cru. Appetite for the destruction comme disait l'autre. S'ensuit des éclats de rire particulièrement maltraitants. Le morceau se termine sur les cris agoniques du gamin, son père lui arrache les membres un à un.The call of steel : tambourinade de guerre, deviennent lyriques, trottent au carnage gaillardement, du mal à se faire à cette voix de chouette clouée sur une porte de grange en feu, étrange sérénade Guido martèle des paroles comme un soudard aviné et de temps en temps vous pousse des cris d'aigle dont une flèche empoisonnée stoppe l'élan en plein vol, mêlée instrumentale, des cordes exaltées miaulent comme des orgues de Staline, et ce givré de Geveis youpiise comme des danseuses de french cancan. Fighting the fatal : cymbales emballées et section rythmique au taquet, à la basse Damon se comporte en démon, se colle à la batterie et la pousse au crime, ces cris de gamins qui tombent sans le faire exprès dans un puits profond de cinquante mètres avec la batterie qui jette des lourdes pierres par-dessus pour être sûr qu'il ne remonte pas, en prime un cuveau d'acide guitarique et l'affaire est en passe d'être réglée, sont pressés de terminer, pour passer à plus cruel, ils accélèrent le rythme, à coup sûr the trashy kings de Belgique ce sont eux ! In the grip of evil : nous envoient le riff par colis postal en intro, tapent la belote sur le coin du comptoir et vous refourguent le sbeul dans les synapses, vous enfilent des hallebardes dans le ventre et le chanteur fou explose la banquise, chante plus vite que sa voix même que derrière ils ont du mal à suivre, alors ils envoient la vapeur pour l'ébouillanter à coups de jets d'eau chaude, y réussissent puisque l'on ne l'entend plus, erreur il revient en forme olympique et vous assène trois piaillements de castrats pour vous couper les roubignoles dans la cour de l'école. Vous avais avertis, evil signifie que ça fait mal ! Vous écoutez à vos risques et péril. Take thy breath : vous font un peu attendre sur l'intro, style boucher sympa qui désosse votre chien devant vous, le Guido a envie de parler, vous n'écoutez pas ses paroles vous attendez qu'il se rue dans le contre-ut au troisième acte, il existe une autre version de ce disque, z'ont refait le mixage, préférez celui-ci, ce n'est pas bien de couper les ongles d'un tigre, employons une métaphore plus précise, de scier la corne d'un rhinocéros vu la manière dont le frappadingue assène ses coups sur ses tambours, repartent à fond de train et hop ils accélèrent dans les tournants, pas de souci dans les lignes droites aussi, hurlement final, pas tout à fait encore un bruit étrange, d'après moi, mais je n'en suis pas sûr, le triple rôt de satisfaction d'un lion qui vient d'engloutir un chrétien dans l'arène tandis que Néron dépose une couronne de rose sur sa crinière sanglante. Incest love : tiens une chanson d'amour pour terminer, tout est relatif, il est manifeste que ce qu'ils préfèrent chez Einstein ce n'est pas la théorie mais la bombe atomique, alors ils vous la font exploser pour de bon, les guitaristes vous scient les spectatrices du cirque tout du long en deux parties égales pendant que Guido pousse de petits cris tout mignounitous comme les gouttes de sang qui sautent de ses malheureuses. Basse et batterie passent la serpillère pour nettoyer. Nickel chrome, plus rien à voir. Ni à entendre. Les meilleures choses ont une fin. Avez-vous remarqué que Guido chante en belge.
Une monstruosité. Ne vous vantez pas que vous l'écoutez tous les matins au petit déjeuner. Vous perdriez vos amis. Mais sont-ce de véritables amis ?
Damie Chad.
*
Dans la cinq cent trente et unième livraison de KR'TNT ! du 25 / 11 / 2021 nous avions promis de revenir sur Golem Mécanique, il est plus que temps de tenir notre promesse. Voici trois nouvelles chroniques sur trois opus que vous retrouverez avec plaisir sur Bandcamp. Le site en présente à ce jour dix-huit. Une mine d'or dont je vous conseille de vous lancer dans l'exploration de ces galeries secrètes scintillantes d'obscurité.
Rappelons que chaque production ne bénéficie que d'un très petit tirage ( de prix modique ), réalisé sous forme d'une cassette souvent augmentée d'un court livret et / ou différentes glanes. Nous employons ce dernier vocable pour orienter l'auditeur vers les premiers travaux de Mallarmé encore lycéen, qu'il objectivera bien plus tard par l'envoi de divers objets poétiques à quelques correspondants choisis. Certains objecteront que ces artefacts mallarméens appartiennent à une veine fantaisiste, nous nous contenterons de leur conseiller de relire ses traductions des Poésies d'Edgar Poe et Igitur conte métaphysique dans lequel les objets symboliques jouent un grand rôle...
ORACLE
GOLEM MECANIQUE
( Février 2021 )
Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi en premier lieu cette pochette. Les colonnes m'ont attiré. Tout ce qui de près et de loin évoque les Anciens Dieux de l'Hellade et de la Rome antique, je suis un sectateur absolu de ces concepts opératifs que l'on nomme les Dieux. Golem Mécanique s'inscrit dans une autre tradition, celle de la revisitation de la gnose, savoir enté aussi bien sur la dernière philosophie païenne que sur l'héritage chrétien et donc biblique, mais ne vaudrait-il pas mieux remplacer ce mot par caïnique. Les deux morceaux qui suivent sont inspirés par les poèmes de William Blake lui même admirateur de John Milton qui dans son épopée Lost Paradise donne longuement la parole à Lucifer, qui prononce notamment le célèbre vers : '' Mieux vaut régner en Enfer que servir au Paradis'', nous sommes-là aux sources occultes du romantisme, du mouvement Gothique, et de bien étranges musiques...
Daughters of Albion : douces voix ennuagées comme un appel, répété, à chaque fois légèrement plus fort, silence, un bruit assourdi et indistinct semblable à ces bouchons dans les oreilles lorsque l'on monte en montagne, les murmures plus forts, un appel, oui c'est bien un appel des filles d'Albion, se plaignent-elles ou nous hèlent-elles, sirènes enjôleuses dans la brume, de si loin des premiers temps, silence, comme un vent lointain de cornemuse qui s'étend sans fin, s'amplifie lentement, avec au fond la palpitation d'un cœur machinique qui impulse une plus grande lenteur précipitante, parfois des étincellements de musique, comme des éclats d'épée touchées par le soleil, gradation incessante, et puis se met en branle tel un retirement, comme un voilement qui n'en reste pas moins fort, l'on avance tout en reculant, c'est maintenant que l'on comprend que la chose ne bouge pas, qu'elle reste immobile, car elle est inaccessible, l'on a entendu, l'on n'a rien vu, les filles d'Albion procèdent d'une nouvelle légende, contée et illustrée par le poëte William Blake, ami de Mary Wollstonecraft dont la fille Mary créatrice de Frankenstein fut la femme de Percy Bysshe Shelley... ce morceau est à écouter comme une approche, de tout un monde, qui possédait des idées bien moins étriquées et beaucoup plus révolutionnaires que notre siècle... Urizen : une voix infinie sur un fond d'orgue majestueux, s'élève un chant doux en l'honneur d'Erizen, cette créature moitié-dieu, moitié-homme, moitié-terre, fils d'Albion, les filles de celui-ci pourraient être les siennes, imaginées et rêvées par William Blake dont Le livre d'Urizen, relate une vision fragmentale de l'homme partagé entre l'attrait paradisiaque et la tentation luciférienne, pluie diluvienne d'orgue, nous sommes dans un monde de grandeur qui nous dépasse mais la voix humaine passe par-dessus. L'histoire d'Erizen est celle d'une dégradation incessante qui descend les escaliers du Divin qui aboutissent à l'Homme, personne ne lui interdit de les remonter, long silence, la voix seule, qui se tait lorsque la musique revient, et qui se mêle maintenant à elle, sinuosités de serpent caducique, long silence, la voix seule survit. Divine.
NONA, DECIMA ET MORTA
GOLEM MECANIQUE
( Ideologic Organ Label / Mars 2020 )
La pochette nous offre une vision – préférons ce terme à celui de photo ( prise par Ida Sofar ) – de Karen Jebane autre entité nominative de Golem Mécanique. Cette fois-ci nous n'avons pas affaire avec une cassette mais à un disque, paru aux éditions Mego ( SOMA 31 ), ce qui explique peut-être le pourquoi cette couverture de présentation vinylique traditionnelle.
Karen Jebane : voix, drone-box, organ / Marion Cousin : Voix, Harmonium.
Face A : une voix si pure en ses harmoniques, pourtant à peine balbutiée, chaque mot cerné de silence, lorsque l'on s'aperçoit qu'elle n'est accompagnée d'aucun instrument, il est trop tard, une sonnerie retentit. Aussi agaçante qu'un téléphone qui vous rappelle à la sinistre réalité quotidienne alors que vous étiez ailleurs propulsé sur les cimes d'Engadine. Elle ne dure pas, le morceau approche les vingt minutes, elle persiste, un signal, une alerte, sur laquelle vient se rajouter une frange de fugue organique de Bach mais qui resterait bloquée sur quelques notes. L'impression que l'on s'enfonce dans le son et que le son interpénètre en vous, une espèce de transsexualité musicale, alors que surviennent des voix féminines aussi souveraines que des laudes chantées en grégorien par des moines, sur lesquelles se superpose un bourdon de basse intenable, une force qui avance en votre cerveau pour le purger de toutes les nocives expériences de votre existence, les voix se taisent et cela devient insupportable, un moteur d'avion qui prend de l'altitude, au loin des bribes lointaines de chant, elles ne sont pas une imagination, elles sont là de plus en plus présentes, vous cherchez le sens de ces paroles qui tombent du ciel ou qui surgissent du néant, la nuit nous entoure, nous enveloppe d'une cape protectrice, nous ne le savons pas et en même temps nous ne l'ignorons pas, pire qu'un son implacable, qui vous pousse et vous accule contre les murs de votre prison intérieure, la violence s'accroît-elle ou est-ce seulement une illusion qui n'est que le voile épais de votre conscience, une mer immense écume à l'infini, une roue de vielle mécanique tourne selon le modèle de l'éternel retour, tout en persistant à n'être que dans sa propre présence, maintenant vous comprenez que cette sempiternélité cosmique n'est pas une déchéance, votre esprit s'ouvre à une plus grande amplitude, à une immense magnitude, vous vous retrouvez en vous tels que l'immortalité des dieux vous change, le volume devient processionnaire, l'homme peut mourir d'être immortel a dit Nietzsche, mais c'est encore la plus sûre garantie de votre immortalité. La voix seule encore une fois, une fragilité du silence qui confine à l'absolu. Face B : une note, seule, longue, la voix survient, sans surprise, selon le modèle du morceau précédent, lentement, mot à mot, lâchés, espacés, les uns après les autres, des oiseaux de proie qui s'envolent un à un, de la dextre qui les laisse s'enfuir dans le vaste monde. Maintenant ils semblent sourire, plus joyeux presque, c'est qu'ils évoquent trois jeunes, du moins les imagine-t-on ainsi, filles, l'on s'attendrait à une ronde toute gentillette, mais nous sommes sur l'avers de la face B, l'autre côté, le premier évoquait la divinité oubliée et reconquise de l'homme, ici nous avançons sans bruit dans un paysage tout plat, nous suivons un sentier de cendre sonore, comme s'il ne fallait pas faire de bruit, musique en mineur, un bruissement tout doux, infini, la voix reprend son antienne, elle a le charme des Douze Chansons de Maeterlinck, celles qui parlent de princesses, celles de la fin surtout, aussi obsédantes que Les aveugles sa pièce-poème, la voix psalmodie de temps en temps, derrière la sonnerie essaie de klaxonner pour nous faire marcher plus vite d'un pas lourd et triste, mais qui serait pressé d'arriver au terme de ce paysage dévasté qui semble être le miroir des âmes en peine, des frissons sonores s'agitent comme des voiles de songe, est-il nécessaire de s'éveiller, de savoir où nous sommes, qui nous sommes, qui sont-elles ces trois sœurs, nous étions tranquille mais la sonnerie sans fin s'amplifie, pour un peu elle deviendrait angoissante, aurions-nous le temps de compter jusqu'à dix, et si la treizième, si nervalienne, ne revenait pas, si le comput n'atteignait jamais le chiffre 11 bouillonnant, composé du seul chiffre 1 qui se regarde en lui-même, ces chœurs de nonnes deviennent oppressants, s'ils pouvaient ne jamais s'arrêter, si la troisième était l'ultime, pourquoi cette voix désolée, douée d'une pureté angélique, serait-ce celle de l'ange de la mort, regardez la pochette, cette photographie, cet œil qui vous regarde par-dessous et qui sourit, des trois Parques Nona qui file, Decima qui fuse, Morta que l'on fuit, quelle est-elle... L'artiste est-elle celle qui tresse les plus belles couronnes de laurier, elles exaltent notre grandeur, pour mieux nous chuchoter Memento Mori...
LUCIFERIS
GOLEM MECANIQUE
( Ideologic organ / Février 2021 )
La pochette est une illustration de Gustave Doré. L'on a dit que Victor Hugo n'a jamais terminé son poème La fin de Satan parce que la fatigue et la vieillesse l'en ont empêché. Son entourage lui chantait la douce chanson : tu en as assez fait durant toute ta vie, repose-toi. Même Dieu s'est arrêté de travailler au bout de sept jours... ces conseils venaient de l'extérieur, mais au dedans de lui-même, pourquoi cet infatigable travailleur n'a-t-il pas fourni un dernier, voire suprême, effort... quelles forces surgies de l'intérieur du poëte l'ont-elles amené à surseoir au couronnement de son œuvre poétique... L'interprétation que Karen Jebane donne de la gravure de Gustave Doré, celle d'une chute de Lucifer chutant, n'arrêtant jamais de chuter, car tant que le terme de sa course n'est pas échu, il n'est pas encore condamné, il n'est pas puni, il reste libre d'être encore ce qu'il est dans sa chute-libre... Hugo a-t-il pensé que la fin de Satan serait aussi la fin de la liberté humaine...
Karen Jebane présente ce disque comme un double de Nona, Decima et morta, pour rester dans le romantisme français, ces trois moires correspondraient à l'Eloa d'Alfred de Vigny, et son Lucifer de lumière, et ce Luciferis notre propre part d'ombre que nous portons au-dedans de nous.
Golem Mécanique : Drone Box / Philippe Bell : guitare.
Cadere : ( tomber ) : un point noir sur l'horizon du ciel le plus haut qui tombe sans fin, à une vitesse folle, rien ne le freinera, une horreur si démesurée qu'elle en devient splendide, il y a une terrible obstination à vouloir tomber ainsi, sans rémission, et sur ce vertige organique survient le souffle rauque de la bête qui tombe, un bruit de guitare méphistophélesque qui fout la frousse, qui vous force à regarder sans agir, car tenter de le freiner s'avèrerait impossible, une pierre, un rocher qui fonce dans l'espace, qui gronde tel un objet interstellaire, un mystère qui passe, qui ne vous voit pas, qui vous oublie tellement concentré dans sa chute dans l'espace illimité qui ne semble pas avoir de fond pour l'arrêter, vous l'avez perdu du regard, était-ce une étoile filante de braise ardente, elle est si loin qu'elle semble invisible, mais le sifflement occasionné par sa chute vous cisaille les oreilles, ce n'est pas une chose, c'est un drame qui bascule en lui-même, un entonnoir métaphysique dans lequel s'engouffrent l'espoir et le désespoir du monde, quand est-ce que ce cri musical inhumain cessera, vous n'en pouvez plus, vous êtes happé par un gigantesque vortex qui s'enfonce dans des profondeurs que vous ne pouviez imaginer, ô cette chute continue si abjecte qu'elle n'en est point monotone, qu'elle focalise encore plus votre attention, les stridences se font plus tranchantes, elles vous assaillent, elles vous écrasent, la chose qui tombe remporte une victoire, elle vous entraîne avec elle, vous perdez l'équilibre et vous tombez à votre tour, vous n'êtes plus qu'un point noir au plus profond du ciel, et d'autres vous suivent, vous voici vol d'hirondelles funèbres sans printemps en partance pour un infini qui recule sans fin, sans fin, sans fin... Déjà nous ne sommes plus qu'un chuintement illimité. Magnifique, merveilleux. Musique rebelle. Une écoute difficile à supporter. Luceat : ( qu'il brille ! ) : comme un point de lumière que l'on ne voit pas, que l'on pressent, onde divine que l'on devine, que l'on cherche, que l'on aperçoit, flamme tremblotante d'une bougie, mais si vous tombez dans l'illimité pourquoi le fait de tomber serait-il une chute, par rapport à quoi tombez-vous, pourquoi ne seriez-vous pas en train de vous élever, tout ne dépend-il pas de la place de l'observateur, ne suffit-il pas de changer la focale de son regard pour transformer le vil plomb qui tombe en or qui rougeoie, et qui bientôt se transforme en brillance aurorale, n'est-ce pas que cette musique palpite et étincelle, elle se darde de rayons matutinaux, elle se déplie, ses ailes qui la portent, ne s'agitent-elles pas comme deux longues flammes, deux étendards victorieux qui boutent le feu aux poudrières du chaos, le noir devient gris, le gris s' éclaire de blanc, encore sale, encore douteux, bientôt éblouissant, quelqu'un a-t-il allumé la lumière, le monde change de couleur, les moindres recoins de l'univers s'illuminent, celui qui tombait irradie de tous côtés, l'univers s'embrase d'un feu prométhéen, des boules de feu se détachent et s'enfuient au-delà des horizons cosmiques, tout rayonne d'une splendeur inégalée, l'espace s'apaise, il se détend, il se délasse, il semble sourire, ce qui était en bas est maintenant partout, la bête triomphe, elle est dragon de feu, elle crache des flammes bienfaisantes qui désormais réchauffent et réconfortent la chétive humanité, des ondes de bonheur parcourent les étendues sans fin, l'on croirait entendre les trompettes victorieuses de mille millions d'anges énamourés qui annoncent la bonne nouvelle, une ferveur universelle s'unit au porteur de lumière et tout s'envole, telle une roue ocellée de paon en une ronde folle. Cette deuxième piste est à la hauteur de la première. Grandiose.
Damie Chad.
*
Un curieux livre. Un titre un peu passe-partout et pas très visible sur la couverture rougeoyante, le nom de l'auteur est à rechercher au dos du volume, et quand vous l'ouvrez vous tombez sur une succession de pages blanches, à tel point que le premier réflexe est de penser que le livre débute à la japonaise par ce que nous appelons la quatrième de couverture, comme un manga. Le premier paragraphe du faire-part est assez intriguant pour que résonne en nous le célèbre adage de Mallarmé, ''Un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant.'' D'autant plus qu'il nous est annoncé comme le premier acte d'un pentaptyque, dont les quatre suivants seront publiés d'ici 2025. Une bonne raison pour se donner à vivre au moins jusqu'à cette année-là.
V I E
Livre I – L'asquatation
FRANCOIS RICHARD
( Novembre 2021 )
Une question taraudante, pourquoi ces huit pages blanches au début. Remarquez que l'interrogation surgit à la lecture des premières pages. Tellement déroutantes et bouleversantes que votre esprit cherche à se raccrocher au moindre indice qui s'avèrerait signifiant. Ne parlons pas de la photographie grise et floue qui les suit et qui ne figure rien sinon sa propre présence. Encore une page blanche, grand flash, une feuille noire. Plus de cent cinquante pages plus loin, grand flash, une autre feuille noire. Intuitivement vous comprenez qu'elles encadrent, qu'elles cadrent le récit. Blanc et noir, ombre et lumière, intuitivement vous pensez à Goethe. A sa théorie des couleurs. Et de là à Faust. Qui est un livre sur les pouvoirs de l'esprit humain. Et vous commencez à comprendre.
Toutefois il convient d'aborder cet opus encore par l'extérieur pour mieux définir son objet. Nous avons employé deux mots : récit et acte.
Commençons par l'évidence. Le livre est une suite de séquences plus ou moins longues, elles rapportent divers épisodes d'une histoire racontée dans l'ordre chronologique, constituée de phrases regroupées en paragraphes, rien de bien déroutant à première vue. Nous venons de décrire l'intérieur du livre. Le mot acte nous permet d'envisager son extérieur. Malgré Faust, écartons toute idée de théâtre. Pensons plutôt à cette idée que le fait en soi-même d'écrire un livre est un acte de portée métaphysique, c'est-à-dire un geste capable d'exercer une influence sur le monde. Nous n'évoquons par ces mots ni le succès, ni le nombre de lecteurs que peut avoir un bouquin dans l'entregent qui le voit éclore. Si le texte est encagé de feuilles noires, ce n'est point pour faire joli, mais pour le séparer du monde, l'isoler pour qu'il apparaisse comme une volonté ( celle de François Richard ) qui ne s'inscrit pas dans la sordide réalité indistinctive en tant que bibelot anodin. Nous savons maintenant que quelque chose se joue, là et maintenant à toujours, dans cet espace clos.
Lecture abîmale. Le lecteur n'est pas convié à écouter béatement, lui échoit le rôle de faire le travail. Non pas de lire. Trop facile. La tâche même à laquelle s'astreignent les personnages du livre. Quelques renseignements utiles : question : Où ? En France. Cette précision est importante, elle ne relève évidemment d'aucun chauvinisme ou nationalisme. Question : Quand ? difficile de dater, après une grande catastrophe, laquelle, je vous laisse l'imaginer, climatique, épidémique, atomique, barbarique, encore plus terrible que les quatre réunies peut-être.
Rentrons dans le vif des sujets. Les personnages, vous aurez du mal à les identifier, ils sont nombreux, une bonne douzaine. Ce n'est pas pour cela que vous peinerez à les reconnaître. Le problème ne vient pas de vous. Mais de la douzaine d'eux. N'y mettent pas de mauvaise volonté. Ils voudraient. Ils aimeraient. Le problème c'est qu'ils n'en savent pas plus que vous. N'ont plus de mémoire. Ne se souviennent de rien. Les pages blanches du début correspondent à ce vide initial. Ce ne sont pas les souvenirs qui leur reviennent, plutôt des choses informelles qui leur posent souvent beaucoup plus de questions qu'elles n'apportent de réponse. A vous lecteurs d'interpréter ces fragmences venues d'ailleurs inconnus qui ne sont que des bribes incompréhensibles de leur passé. Une colonie d'adolescents et d'enfants réunis. Habitent un bâtiment délabré nommé le squat de Ribardy. Etrange robinsonnade ! Nous les voyons s'ébattre, oiseaux englués tentant de s'arracher à la gangue de leur mazout amnésique. Sans doute progressent-ils en eux-mêmes, mais le lecteur aura du mal à déchiffrer les runes incompréhensibles de leurs paroles, de leurs pensées, de leurs actes. Le comportement de ces gamins monopolise le premier mouvement – terme musical – du livre.
Le deuxième mouvement conte leur navigation vers l'île d'Avalon. Ce nom ne saurait être dû au hasard. Si l'on y rajoute un ermite qui a l'air de connaître le passé et l'espèce de Mentor nommé Thiam sans mort, sans s'éclaircir notre horizon de lecture semble s'ouvrir sur un récit épique. Serions-nous dans une épopée avec, question subsidiaire, ne serions-nous pas dans un poème. Troisième mouvement : nous voici sur le continent au milieu de nulle part, dans une fête, dans une clairière. Le mot clairière n'est pas sans évoquer Heidegger et sa réflexion sur l'oubli de l'oubli. Au lieu d'Heidegger nous avons une allusion au Journey through the past de Neil Young.
Il est sûr qu'à la fin du livre le mystère reste entier. Que cet état de fait ne soit pas un prétexte pour ne pas en entreprendre la lecture. L'histoire a-t-elle d'ailleurs un quelconque intérêt. Suivre les aventures de nos héros, si palpitantes ou angoissantes seraient-elles, ne serait-ce pas rester en surface du livre. Ne vaudrait-il pas mieux tenter une lecture qui essaie de percer la peau de son écriture. Regardez les moindres mots de ce récit, ils sont comme dans tous les autres livres formés du noir de leur encre et du blanc de la page. Que signifie cette alternance, que toute connaissance repose sur du vide, sur du néant. Pourquoi les mémoires trouées de ces gamins ne seraient-elles pas l'image du vertige de l'écriture et pourquoi l'écriture ne serait-elle pas un acte qui s'inscrirait entre prose et poésie. La prose qui dit et la poésie qui mystérise.
Un des gamins énonce un jour le mot Odyssée, peu après ils prendront la mer vers Avalon. L'on ne peut lire V I E sans évoquer l'Ulysse de Joyce, roman qui s'étend en vingt-quatre chants, et raconte une journée de la vie ( peu héroïque ) de Leopold Bloom, Une existence terne, considérée à l'aune de l'intérêt romanesque, mais d'une richesse fabuleuse, car la pensée de mister Bloom vogue sans cesse sur les représentations imaginatives de toute pensée en action. Traverse gouffres, mythifications et touche aux notions les plus élémentales de la réalité humaine, la mort, le désir, la peur, la connaissance... Au fond Bloom n'est guère différent de l'Ulysse d'Homère. Toute l'analyse de Joyce passe par la mise en langage de son roman. Notons que Finnegans wake dernier roman de Joyce, écartèle la graphie des mots anglais pour leur faire dire ce que le blanc sur lequel se dessine le noir des lettres ajoute ( ou retranche ) au sens des mots.
François Richard s'est embarqué dans une tentative d'écriture du même genre. Joyce était irlandais. François le français s'inscrit dans une démarche culturelle française. En fin de volume, sont publiées deux notules de l'éditeur au reçu du manuscrit. Qui en tente une première interprétation arquée sur les démarches d'Arthur Rimbaud et de Stéphane Mallarmé. Il n'épilogue pas sur l'intrigue du roman, il tente de comprendre et de mettre à jour la signification de cette œuvre qu'il définit comme un travail poétique sur la langue ( française puisque écrit en français ) et avant tout comme une aventure poétique, pour ne pas dire une percée en poésie.
Pour mieux comprendre, sans doute faut-il replacer ce premier tableau du pentaptyque V I E ( Joyce parlait de work in progress ) dans l'histoire du déploiement de la prose française depuis un demi-siècle, depuis cette réflexion sur l'écriture de la poésie des années soixante-dix qui déboucha sur la pensée déconstructiviste qui elle-même accoucha d'une prose des plus plates qui inonde le roman moderne. V I E délaisse cette morne plaine littéraire et essaie par son écriture de renouer avec ce que, faute de mieux, nous nommerions l'essence de la poésie.
Ouvrir V I E cinq ou six fois au hasard est une fête intellectuelle. Certes c'est la même histoire qui se déroule, mais les paragraphes dans lesquels on se plonge révèlent à chaque fois un monde différent, une vision du monde en quelque sorte annexe, vous donnent l'impression de voyager d'île en île, chacune dévoilant une autre facette de toute vision. Pourtant à chaque fois malgré la profuse diversité des univers apparus, le lecteur reçoit l'impression qu'il est en présence d'un des points géodésiques de l'essentiel.
Gageons que V I E terminé apparaîtra à beaucoup comme un livre somme et de refondation.
Damie Chad.
ROCKAMBOLESQUES
LES DOSSIERS SECRETS DU SSR
( Services secrets du rock 'n' rOll )
Episode 15
VIVE LA POLICE
Le brigadier s'avéra très sympathique. En plus du café il ouvrit une boîte de biscuits secs, enrobés de chocolat.
_ Heureusement que vous avez eu la bonne idée de mettre un terme à la vie de votre bonne femme, je commençais à m'ennuyer !
Il est vrai que le commissariat est bien calme. Je lui jette un regard étonné, je ne m'attendais pas à une foule énorme, tout au moins trois ou quatre plantons ensommeillés, deux voitures de cowboys de la BAC venus jouer les cakes, une kyrielle d'ivrognes exigeant à boire, non, silence complet. Devant mon regard étonné il enchaîne :
_ Tous partis, une réunion urgente, tout le monde, m'ont laissé seul avec le prisonnier et la consigne de n'ouvrir qu'au cas de grande urgence. Je suis sûr que le patron me le reprochera, je l'entends déjà, '' une pauvre conne zigouillée, vous croyez que je n'ai que ça à foutre, le pauvre gars aurait dû revenir dans deux ou trois jours !'' L'est comme cela le patron depuis la semaine dernière, depuis qu'il a été convoqué à l'Elysée, trois fois déjà, et tout à l'heure encore !
_ Le prisonnier ?
_ Pas bavard le gars, refuse de parler depuis qu'on lui a confisqué sa guitare ! Bon je cause, je cause, j'vais vous fourrer avec lui dans sa cellule, mais je vous préviens l'est muet comme une tombe. Étonnant pour un mec pour qui passait son temps tous les soirs à hurler sous la Tour Eiffel, je vous le dis moi, le monde est maboul !
_ Brigadier, je ne veux pas abuser de votre accueil, mais passez-moi la guitare du gazier, il chantera, ce sera plus gai, cela mettra de l'ambiance
_ Pas bête votre idée, tenez prenez son instrument, je vous suis avec la clef.
NEIL YOUNG
Dès que la grille de cellule s'est refermée Neil Young me sourit. Il se jette sur la boîte de petits gâteaux que le brigadier compatissant m'a offert et y puise dedans à pleines mains. Comme je suis un grand psychologue je ne dis rien, c'est écrit dans tous les manuels : N'hésitez pas à sacrifier vos biens les plus précieux pour parvenir à vos fins. Lui, enfin parvenu au bout de sa faim, se penche vers moi et me glisse à l'oreille :
_ Vous en avez mis du temps à arriver, dépêchez-vous de me filer votre plan d'évasion !
_ Le voilà ! Je lui tends la guitare !
FOCALISATION EXTERNE
Le brigadier est content. Les deux prisonniers ont l'air de bien s'entendre et le gars au T-shirt de Neil Young s'est mis à jouer et à chanter très fort, une musique un peu bizarre, bon, il préfère l'accordéon, mais l'ambiance vous a pris un petit tour festif pas du tout désagréable, du coup il s'ouvre un paquet de galettes bretonnes. Durant vingt minutes les pieds sur la table, il est aux anges, mais son ravissement est coupé net par un ineffable couac, suivi de râles monstrueux. Le meurtrier de sa femme serait-il un tueur en série, aurait-il commis une monumentale erreur fatale à son avancement !
La voix rassurante de l'assassin l'appelle au secours :
_ Brigadier venez vite ! Je vous en prie, c'est urgent ! Ses cordes vocales se sont rompues !
La clef dans la main il entre dans la cellule. Le spectacle est atroce. Le musicien est dans les bras de l'assassin qui essaie tant bien que mal de le soutenir, l'autre est en train de vomir du sang et des morceaux de chair, c'est dégoûtant, le brigadier n'a rien vu venir. Ses collègues le retrouveront évanoui assommé par une guitare qui a traversé sa tête. A moins que ce ne soit le contraire.
TOUT LE MONDE DETESTE LA POLICE
Je referme à clef la cellule, Neil Young fauche le paquet de galettes bretonnes abandonné sur la table du brigadier, ne reste plus qu'à sortir et à nous évanouir dans la nuit. Opération réussie Cinq sur Cinq ! Aucune perte, si ce n'est ces deux steaks hachés bien saignants que j'avais gardés dans ma poche pour Molossa et Molossito. Tant pis, à la guerre comme à la guerre ! Justement la voici. Nous sortions du commissariat lorsque du bout de la rue débouche une file d'une dizaine de voitures gyrophares en action. Neil Young détale comme un lévrier et je le suis sans épiloguer sur la conjoncture qui tourne au vinaigre !
Un coup de chance, un carrefour dont la rue que nous empruntons est en sens interdit et bloquée par un gros camion-livreur. Derrière nous les portières claquent, sont une trentaine à nos trousses. Le Neil m'étonne, avec son estomac plombé de galettes bretonnes il galope comme un dératé, je le suis sans peine – n'oubliez pas que suis un agent secret – le Neil m'épate '' au prochain croisement on se sépare'' me crie-t-il, et hop il fonce à droite tandis que je tourne à gauche. Je n'en crois pas mes oreilles, personne derrière moi, sont tous après le Neil, étrange, je reviens sur mes pas, je comprends, l'artère qu'a empruntée Neil est une impasse, je ne peux rien pour lui, des voitures de police barrent la rue, des coups de feu retentissent, tapi dans l'obscure et bienvenue encoignure biscornue d'une entrée de magasin, j'aperçois les policiers refluer et s'entasser dans les voitures qui démarrent et s'éloignent en trombe. Je me glisse dans le cul-de-sac, Neil a donc trouvé une sortie providentielle. Non ! Je ne tarde pas à trébucher sur son cadavre, sur le trottoir criblé de balles. La lueur blafarde du petit jour éclaire la scène, le sang coule encore de ses blessures, et se coagule dans la rigole. Près de sa main droite, j'aperçois deux taches d'un drôle d'aspect. Une espèce de gribouillis sanglant, je me recule un peu, je comprends, ce sont deux lettres toutes tordues, il m'est toutefois facile de les déchiffrer, cette barre torsadée ne peut être qu'un I, et ce serpent mal foutu, un S. Le dernier message de Neil !
RETOUR A L'ABRI
Les chiens me font la fête et les filles m'embrassent, le temps n'est pas aux effusions, le Chef me laisse juste le temps de changer de chemise et de pantalon.
_ Agent Chad au rapport, ordonne le Chef en allumant un Coronado, le plan Alpha n'attend pas !
Les filles ne quittent pas mes lèvres, elles me lancent des regards admiratifs, surtout lorsque je me présente comme l'assassin de ma femme, elles éclatent de rire lorsque je rappelle Neil engouffrant les galettes bretonnes, et pleurent lorsque je conte la fin prématurée du chanteur.
_ Il est inutile de pleurnicher, déclare le Chef, un agent du SSR ne pleure jamais, que cela vous serve de leçon, est-ce vraiment tout agent Chad ? Si je comprends bien, le seul indice à retenir ce sont ces deux lettres maladroitement tracées, veulent-elles vraiment signifier quelque chose de précis ?
_ Un dernier message, peut-être à sa fiancée qui se prénomme Isabelle, suggère Framboise, et peut-être même ISIS, en écrivant seulement deux lettres il l'a nommée toute entière !
Ses paroles sont accueillies par un murmure flatteur
_ Ou alors, je sais que c'est nettement moins romantique, hasarde Joël, au moment de mourir il a pensé à mettre ses affaires en ordre, IS comme Impôts sur les Sociétés !
Sa proposition ne convainc personne, un guitariste fauché qui consacre ses ultimes instants à payer ses impôts !
_ Il aimait Neil Young, connaissez-vous une de mes chansons préférées de cet artiste, IS a dream ? moi Noémie je m'imagine à mes derniers moments me demandant si la vie ne serait pas un songe.
Le Chef ne nous laisse pas rêver :
_ Non, apprenez à réfléchir dans le droit fil de l'affaire qui nous préoccupe : quel intérêt aurait la police à abattre un chanteur de rue ? Aucun. Quelle est la nationalité de Charlie Watts ?
_ Anglais !
Le Chef tira une longue bouffée de Coronado !
_ Anglais, bien sûr et vous n'avez jamais entendu parler de l'Intelligence Service !
Nous devions avoir tous l'air ahuri :
_ Vous voyez les bienfaits du plan Alpha. Nous prenions notre Neil Young pour un comparse anodin, de fait c'était un agent Secret de sa très gracieuse majesté qui tentait de nous faire passer un message, si la police l'a abattu ce n'est certainement pas parce qu'il chantait mal !
A suivre...
10:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ahmet ertegun, ronnie spector, jukin' bone, shadrack, cyclone, golem mécanique, françois richard, rockambolesques ep 15
29/06/2016
KR'TNT ! ¤ 288 : RONNIE SPECTOR / LEE FIELDS / HELLEFTY / CRASHBIRDS / NINA SIMONE / LEROI JONES / ZINES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 288
A ROCKLIT PRODUCTION
30 / 06 / 2016
|
RONNIE SPECTOR / LEE FIELDS HELLLEFTY / CRASHBIRDS NINA SIMONE / LEROY JONES / ZINES |
NEW MORNING / PARIS X / 22 - 06 - 2016
RONNIE SPECTOR
RONNIE BIRD
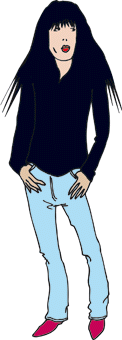
Avant de s’appeler Ronnie Spector, elle s’appelait Veronica Bennett. Elle tenait sa couleur de peau d’un joli métissage : père irlandais et mère métisse d’indien Cherokee et de noir, comme Jim Hendrix. Elle chantait dans les Ronettes avec sa grande sœur Estelle et une cousine nommée Nedra Talley. Elles habitaient toutes les trois Spanish Harlem et adoraient Frankie Lymon. Veronica passait ses journées à la fenêtre de sa chambre à regarder les filles de Spanish Harlem déambuler avec des grosses coiffures et des clopes au bec. « I loved that tough look ». Oui, Veronica aimait beaucoup ce look des filles de la rue. Et puis un beau jour la vie des Ronettes vie bascula dans le rêve : Phil Spector les prit sous son aile pour les transformer en pop stars.
Avec Phil les choses ne traînaient pas. Il lui fallait des tubes, et vite fait. Il voulait aussi des nuées de maçons pour bâtir le plus gros wall of sound du monde. C’mon ! Il savait où trouver des collègues pour l’aider à composer des tubes. Il allait taper aux portes des petits bureaux du Brill Building où besognaient les auteurs compositeurs salariés :
— Salut Cynthia, salut Barry ! Alors, et si on composait un petit hit planétaire pour mes nouvelles protégées ? Ça vous dit ?
— Chouette idée, Philou ! Tiens, regarde, il pleut ! On pourrait faire un truc sympa sur la pluie, pas vrai ?
Et Cynthia Weil se met à pianoter une mélodie effarante.
— Tatata, walking in the rain... Tatata, pas mal, hein, Philou ?
— Ouais, c’est pas mal, Cynthia, mais monte un peu à l’octave, là, pour embarquer ton thème, oui là, tatataaaaaaa, aw fuck, quelle mayotte, ma cocotte ! Fuck shit up, on va encore défoncer la rondelle palpitante du Billboard ! Il finira par marcher comme un cowboy, le Billboard, si on continue comme ça, les enfants, ha ha ha ! Quelle merveille ! Rejoue-le, Cynthia ! Tatataaaaaaa, walking in the rain ! Veronica et les deux autres vont nous chanter ça aux petits oignons, vous allez voir !
Une chose est bien certaine : quand on écoute « Walking In The Rain », on frémit. C’est tout simplement dégoulinant de génie, mais un génie particulier, car attentif au global comme au moindre détail. Quant à ce jerk royal, « (The Best Part) Of Breaking Up », on le danse à l’Égyptienne, avec les poignets cassés. On sent les flux du River Deep. On sent le morceau destiné à traverser les siècles. Dans 2 000 ans, on dansera encore ce jerk royal des Ronettes. Et la fin démente, c’mon baby, fut reprise par Brian Wilson.

Phil file vers un autre bureau :
— Salut Ellie, salut Jeff ! Vous avez un moment ? On pourrait peut-être composer un petit hit pour mes chouchoutes de Spanish Harlem ?
— Oh, toi Philou, on sent que t’es amoureux...
— Hey Ellie, ne vas pas si vite ! Une chose que mon grand-père m’a apprise est qu’il ne faut jamais brûler les étapes, right ? Bon, alors, qu’avons-nous comme idée, chers tourtereaux ?
— I wonder...
— Ah pas mal, Jeff, c’est un titre ?
— Yeah, man !
— Alors, Ellie, pianote-nous l’un de ces petits jives dont tu as le secret....
— Écoute un peu ça, Philou ! Plonk plonk plonk !
— Aw ! Tremedous ! Quelle profondeur ! Vas-y monte-nous ça à l’octave ! I wondeeeeeer ! Pas mal ! Encore un coup de Trafalgar en perspective, hein ? Quelle belle mélodie qualitative ! Ça va leur jerker la paillasse ! T’aurais pas autre chose, Ellie ? Allez, arrête de faire ta mijaurée, tu as bien une idée de riff dynamiteur en tête...
— J’ai ça, Philou, écoute... Dessus, il faudrait des paroles du genre be/ my ba/ by, tu vois, bien ponctuées sur les accords, plonk plonk plonk, tu peux nous écrire des paroles, mon petit Jeff chéri ?
— Ouais ma poulette, attends, be my/ Baby/ Be my little baby/ Say you’ll be my darling/ Be my baby now/ Oh, oh, oh, oh !
— Bon Jeff tu ne t’es pas foulé sur ce coup-là, mais ça suffira. Merci Ellie pour ce nouveau coup de génie. Franchement, je ne sais pas ce qu’on deviendrait sans toi...
« Be My Baby » incarne le génie productiviste de Phil Spector à l’état le plus pur. Et le génie composital d’Ellie Greenwich à l’état le plus torride. Comme résultat de la combinaison des deux, on obtient le démarrage de refrain le plus foudroyant de l’histoire du rock. Fallait-il que Phil et Ellie soient géniaux pour nous servir une telle merveille ! Brian Wilson conduisait sa voiture lorsqu’il l’entendit pour la première fois à la radio. Il fut tellement frappé par la puissance de ce hit qu’il perdit le contrôle de son véhicule.
— Tu vas peut-être penser que j’exagère, Ellie, mais il me semble deviner au pétillement de ton regard que tu as encore une idée en tête.
— On ne peut rien te cacher, Philou. J’ai effectivement un truc qui me gratte l’ovule depuis un moment. Ça donne quelque chose comme ça... Plonk plonk plonk. Là-dessus, il faudrait chanter quelque chose du genre, Ba/ By/ I love/ You... Tu vois, Jeff chéri ?
— Ah oui, je le sens bien, mmmmm... On pourrait essayer ça... Come on baby/ Oh-ee baby/ Baby I love only you !
— Jeff, fais attention, tu pourrais te faire une entorse au cerveau, si tu fais trop d’efforts... Bon, on va mettre nos trois biquettes en studio demain matin et orchestrer ce nouveau hit greenwichien comme il se doit ! Merci de votre collaboration, mes amis !
« Baby I Love You » bénéficie d’une attaque démente. C’est l’archétype du couplet pop secoué aux tambourins. On est sidéré par l’extraordinaire classe de l’inventivité de Phil Spector et d’Ellie Greenwich. Et le refrain vaut aussi pour un archétype surnaturel. Il n’est pas surprenant que Joey Ramone soit devenu FOU de cette chanson.

Quand le premier album des Ronettes est arrivé en Europe, ce fut une déflagration atomique, mais au sens positif de la chose. On trouve aujourd’hui un autre album des Ronettes qui s’appelle « Volume 2 » et qui propose un sacré lot de petites merveilles du même acabit. Phil Spector composait des choses avec Harry Nillson, comme par exemple ce « There I Sit » intrigant car sous le vent et accompagné par des marteaux piqueurs. On trouve aussi une autre merveille signée Phil Spector, Cynthia Weil & Barry Mann, « (I’m A) Woman In Love », qui décolle à un moment, uniquement pour tétaniser les esprits. Retour d’Ellie avec « I Wish I Never Saw The Sunshine », une machine à jerker d’un éclat invraisemblable et qui explose à la face du monde. Aujourd’hui, on ne voit plus des montées comme celle-là dans les hits pop.
Phil et Ronnie se sont mariés, puis Ronnie s’est plainte de Phil. De 1968 à 1972, elle a vécu comme séquestrée dans leur belle villa d’Hollywood : barreaux aux fenêtres, clôture électrifiée, chiens de garde - All he wanted me to do was stay at home and sing Born To Be Together to him every night - Elle s’évada et divorça.
Et là, elle a commencé à en baver. Elle s’asseyait sur une réputation, mais elle n’avait plus que sa voix. Toute la magie d’antan s’était envolée. Pfffff, plus rien. Ce sont des gens comme John Lennon, Joey Ramone et Amy Whinehouse qui imitait son maquillage et sa coiffure qui l’aidèrent à revenir dans l’actualité.

En 1980, elle essaya d’enregistrer un album de rock new-yorkais, le fameux « Siren », mais ce fut douloureux, et pour elle et pour nous. Elle avait pourtant rassemblé une grosse équipe, Cheetah Chrome des Dead Boys à la guitare, Billy « Wrath » des Heartbreakers à la basse et d’autres gens avec un bon curriculum, mais les morceaux restaient d’une affligeante banalité. Elle attaquait pourtant avec « Here Today Gone Tomorrow » des Ramones. Elle enchaînait avec « Darlin’ », une sorte de petit hit bien balancé et solidement interprété, mais on était loin des fastes d’antan. Elle allait même chercher le « Anyway That You Want Me » de Chip Taylor popularisé par les Troggs, mais encore une fois, le jus céleste faisait gravement défaut. Phil en aurait fait un chef-d’œuvre, c’est évident. Elle sortait de cette aventure malheureuse avec « Happy Birthday Rock’n’Roll », l’occasion pour elle de tripatouiller la nostalgie et d’envoyer des extraits de « Be My Baby ».

Quelques années plus tard, elle réapparût avec un album encore plus médiocre, « Unfinished Business ». Elle tentait désespérément de retrouver la veine du Brill, mais ça ne marchait pas, car elle tombait dans tous les pièges de la prod des années 80. C’était carrément de l’abattage. Le disque était tellement mauvais que le disquaire qui le vendait me l’offrit. Le seul morceau sauvable de ce disque était celui qui se nichait en fin de face B, « Good Love Is Hard To Find », une petite pièce de r’n’b aux allures de good time music qui accroche bien car très vivace.
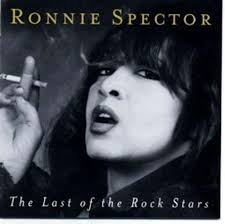
En 2006, Ronnie fit une espèce de come-back avec l’album « The Last Of The Rock Stars » et une palanquée d’invités : Joey Ramone, Keef, Nick Zinner des Yeah Yeah Yeah, les Greenhornes, les Raveonettes, Daniel Rey et quelques autres personnalités. « Work On Fine » sonnait comme un morceau de légende. Dans cette fabuleuse reprise d’Ike Turner, Keef donnait la réplique à Ronnie - yes darling - Ils en faisaient une merveille de groovitude. L’autre grosse pièce de cet album était « Hey Sah Lo Ney », une reprise de Mickey Lee Lane popularisée par les Detroit Cobras sous un autre nom, « Hey Sailor ». Avec sa version, Ronnie s’en sortait avec tous les honneurs. « Ode To LA » était une tentative désespérée de revenir au temps béni du Brill. Sune Rose Wagner des Raveonettes s’était cru autorisé à singer Phil Spector et Ellie Greenwich en proposant une pop-song aventureuse et en la produisant avec les pompes d’antan. Mais ça ne marchait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que Phil Spector est un génie, alors que Sune Rose Wagner n’est qu’un Danois. On retrouvait aussi sur cet album une nouvelle mouture du « Here Today Gone Tomorrow » des Ramones, épaulée par des backings chancelants qui lui donnaient une allure extraordinaire. Ronnie savait que Joey était dingue des Ronettes, alors Ronnie est devenue dingue des Ramones, ce qui semblait logique. Elle soignait tout particulièrement la petite montée de fin de cut. Sur d’autres morceaux, on entendait Daniel Rey jouer de la guitare, et pour tous les amateurs de gros rock new-yorkais, c’était un plaisir que de le retrouver au coin du bois.
Et puis soudain, nous voilà tous rendus en 2016 ! Il s’est écoulé 52 ans depuis l’irruption des Ronettes dans les hit-parades. Ronnie revient dans l’actualité avec un nouvel album et un concert au New Morning. Que peut-on espérer de mieux dans nos misérables existences ?

L’album s’appelle « English Heart », et comme son nom l’indique, c’est un album de reprises de hits anglais. Ronnie explique qu’elle est restée nostalgique de sa première tournée en Angleterre, alors elle tape dans « Because » des Dave Clark Five - Bekos ! Bekos ! - Elle y va avec toute la fougue de sa jeunesse perdue. Elle tape bien sûr dans les Stones qu’elle a bien connus avec « I’d Much Rather Be With The Girls » - une compo d’Andrew & Keef. Elle en fait un racket, transformant les girls en boys. Encore plus gonflé : sa version de « Tired Of Waiting » des Kinks, mais la voix ne colle pas, c’est trop putassier. Et ça continue avec les Zombies (« Tell Her No »), les Beatles (« I’ll Follow The Sun » - ce vieux b-side d’EP qu’on finissait par adorer), Sandie Shaw (« Girls Don’t Come »), et puis cette surprenante reprise d’« How Can You Mend A Broken Heart » des Bee Gees dont elle fait une version incroyablement osée, nappée d’orgue et pulsée au Spanish Harlem beat. Ronnie se prend au jeu et elle enchante sa nostalgie.

Oui, car désormais, tout cela n’est plus qu’une histoire de nostalgie. Voir arriver Ronnie sur scène, c’est voir arriver la fin d’une époque magique. Elle incarne ça aussi bien que les stars de son âge encore en activité. Elle dégage un truc que ne dégageront plus les nouveaux prétendants au trône. Il faut désormais accepter que ce chapitre de l’histoire du rock se referme. Et d’ailleurs, notre propre chapitre, c’est-à-dire celui des gens qui ont grandi avec, va se refermer avec. Voilà, ça se termine, mais au moins ça se termine en beauté.

Un seul concert de Ronnie Spector suffit à recréer cette magie perdue, à laquelle nous fûmes tant attachés et qui d’une certaine façon nous a façonnés, en nous protégeant de la médiocrité. Quand on écoutait les hits de Phil Spector ou de Brian Wilson, on ne pouvait pas s’intéresser à la variété française. Et Ronnie Spector sur scène, ça ne trompe pas. Elle apparaît toute de noir vêtue, silhouette impeccable, rayonnante, d’évidence ravie de l’accueil des Parisiens.

Elle crée aussitôt de l’émotion et paf, elle envoie « Baby I Love You » histoire de nous sonner un peu les cloches. Et tout le set sera placé sous le signe de l’émotion, car encore une fois, Ronnie tape au point le plus sensible de l’histoire du rock. Elle est accompagnée par trois délicieuses choristes et un backing-band irréprochable. Elle commente toutes ses chansons et le public boit ses paroles.

Elle quitte la scène pendant une version torride de « What’d I Say » et revient pour envoyer au firmament un « Walking In The Rain » qui n’a pas pris une ride. Bien sûr, ce n’est pas le wall of sound, mais par sa seule présence et par son charisme, Ronnie se situe bien au-delà de toutes les attentes. Elle incarne tout simplement la grande pop américaine. Elle a exactement le même genre de classe et de stature que Martha Reeves ou Mavis Staples. Et voilà qu’elle balance une version un peu funky de « You Can’t Put Your Arms Round A Memory » et quitte la scène en plein dans l’apothéose de « Be My Baby ». Au premier rang, on voit des mâchoires se décrocher. Rappel ? Pas rappel ? Si, rappel ! Elle fait un retour triomphant pour rendre hommage aux guys - A little dating with John - avec « I’ll Follow The Sun » qui passe mille fois mieux sur scène que sur son dernier album et puis c’est l’explosion atomique avec « I Can Hear Music », l’un des hits pop les plus ravageurs de l’âge d’or.

La petite métisse de Spanish Harlem mérite bien sa place dans l’Olympe des temps modernes, parmi les vivants et les morts, les dieux ailés et les dieux cornus.

Signé : Cazengler, un Spector des travaux finis
Ronnie Spector. Le New Morning. Paris Xe. 22 juin 2016
Ronettes. Presenting The Fabulous Ronettes Featuring Veronica. Phillies Records 1964
Ronettes. Volume 2. Phillies Records 2010
Ronnie Spector. Siren. Polish Records 1980
Ronnie Spector. Unfinished Business. Columbia 1987
Ronnie Spector. The Last Of The Rock Stars. High Coin 2006
Ronnie Spector. English Heart. Caroline Records 2016
Ronnie Spector. Nobody’s Baby. Lois Wilson. Mojo #256. March 2015
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 12 - 05 - 2016
LEE FIELDS

BATTLE FIELDS
— Morris ?
— Yeah Morris Levy speaking !
— James à l’appareil... James Brown...
— Ooooh Mister Dynamiiiite ! Que me vaut l’honneur ?
— Un petit service à te demander... Oh pas grand chose...
— Dis toujours...
— Figure-toi qu’un fucking nabot nommé Lee Fields me fait de l’ombre.
— Quel genre d’ombre ?
— En studio, et puis aussi sur scène. Certains journalistes commencent à insinuer qu’il est bien meilleur que moi...
— T’as vérifié ?
— Ben oui, mec ! Tu me pends pour une bille ou quoi ? Bootsy m’a ramené un disque du nabot. Son truc s’appelle «Dreaming Big Time». Je vis ça comme un affront mortel, Morris.
— Bon, je vois... Tu attends quoi de moi exactement ?
— Ben que tu règles le problème !
— Réglé comment ? Une balle dans chaque rotule ou l’éradication ?
— Même avec des béquilles, il serait encore capable de danser comme un funkster de la planète Mars. Non, il faut l’éradiquer, Morris, c’est plus sûr !
— Okay, James. J’envoie une équipe. Ça tombe bien, ils sont dans mon bureau, et ils se frottent déjà les mains. Mes associés ritals adorent casser du nègre, ha ha ha !
— Merci Morris, que Dieu te garde !
— Attends attends, on a oublié un petit détail...
— Quoi ?
— J’ai des frais, James ! Tu sais bien que je ne travaille jamais à l’œil ! Que penses-tu d’un petit pourcentage de 30 sur tes ventes de disques ?
— Heiiiiiiiiin ? Mais tu veux me mettre sur la paille, fucking jew !
— Fais gaffe à ce que tu dis, James !
— Mais 30% sur mes ventes, c’est des milliards de dollars, Morris !
— Bon alors 25, mais c’est mon dernier prix !
— Mais t’es malade !
— Encore un mot de travers et j’appelle ton copain Lee Fields pour lui faire part de notre conversation...
Il y a un grand blanc au bout du fil. Puis James reprend :
— Dac pour 25, mais je veux que ça soit réglé dans les 24 heures !
— Tu peux compter sur ton pote Momo ! Demain à la même heure, Lee Fields aura disparu sans laisser de traces...
Le lendemain soir, les deux gorilles de Morris Levy rentrent au bercail. Ils affichent tous les deux une mine fermée. Ils s’assoient sans dire un mot dans la banquette. Morris sort une bouteille de scotch du mini-bar et trois verres remplis de glaçons.
— Ça s’est bien passé les gars ?
— ...
— D’habitude vous êtes plus loquaces...
— ...
— Un problème ?
— Vas-y Lucky, raconte ça à Morris...
Le regard de Lucky reste noyé dans l’ombre du petit chapeau à la Sinatra.
— Bon, Morris, faut pas prendre la mouche. Ça s’est pas passé comme prévu...
— Quoi ?
— Attends, t’énerve pas.
— Vous n’avez pas fait le boulot ?
— Laisse-moi t’expliquer...
— Vas-y, je t’écoute...
— Bon, on est arrivés comme prévu, avec la tronçonneuse et les pelles dans le coffre. On est entrés chez lui par derrière. Carmine avait vissé son silencieux. Le fucking nabot était dans son salon. Il dansait devant la télé. Il a dû entendre le parquet craquer. Il s’est retourné, il nous a vus et il s’est mis à faire des pas de danse. Carmine a essayé de le buter, mais ce fucking nabot était vif comme l’éclair ! Il m’a sauté dessus, m’a mis un coup de karaté dans la pomme d’Adam et il a désarmé Carmine d’un coup qui aurait pu lui casser le bras. Ensuite, il nous a attachés tous les deux sur des chaises et il nous a obligés à écouter l’un de ses disques, «It’s Hard To Go Back After Loving You»...
— Et alors, bande d’imbéciles ?
— Le disque est sacrément bon, Morris ! Carmine et moi, on est devenus fans, ahhh mama mia !
— Vous vous foutez de ma gueule, j’espère...
— Sur la Vierge Maria, je te jure que ce disque est bon, Morris !
— Non, les gars, ça suffit, je trouve que votre blague a assez duré...
— Mais Morris, c’est pas une blague...
Une chape de silence tombe sur le bureau. Lucky reprend son monologue d’une voix encore plus grave :
— Tu devrais écouter un cut qui s’appelle «You Got Another Thought», c’est un boogie slow de rêve que tu peux danser avec une petite pépée bien roulée, tu vois ce que je veux dire ? Et puis t’as «A Sacred Man Can’t Gamble», un vieux funk amené à coups d’oh yeah et avec de grands airs ! Derrière Lee, t’as un mec qui fait des yeah quand il faut. Ahhhhh Morris, c’est fantastico ! C’est monté comme un coup de génie, Morris ! C’est pulsé et suivi à la trace par le poto d’oh yeah ! C’est un cut qui va te rendre dingo, Morris, tu peux me croire ! Et ça continue avec «All Up In It» ! Encore du jive de funk comme on n’en voit plus. Ce fucking nabot chante au sommet d’une dégueulade de soul de charme, c’est du James Brown sur-vitaminé ! Et sur ce disque t’as encore un truc de fou qui s’appelle «Freak On The Dance Floor», un cut de dance de rang royal. Là tu peux danser the night away et lever un freak-out dont t’as pas idée...
L’autre gorille demande la parole :
— Sans vouloir t’offenser, Morris, j’ai craqué moi aussi pour le fucking nabot. J’ai payé deux dollars «Let’s Talk It Over», la réédition de son premier album paru en 1979. Tu vois, c’est pas cher... Figure-toi que là-dessus, tu as deux hits de funk planétaires : «Wanna Dance» et «She’s A Lovemaker». Lee shake son booty comme James Brown, il est foutrement sexué - Let me see you move ! - Quant à Lovemaker, quelle pétaudière, mama mia ! Lee pulse comme un piccolo diabolo ! L’élève dépasse le maestro, yeaahhhh ! Dans les bonus, tu tomberas sur «Fought For Survival», fantastique machine de guerre funky et ça continue avec un «Funky Screw» à la Jaaaames Brown qui boote le popotino de cœur de funk. Par la wha-wah et son ample saxitude, «The Bull Is Coming» va te renvoyer au géant Isaac, tellement c’est joué à la classe pépérito.
À moitié en transe, Lucky reprend la parole sans la demander :
— T’as un autre album de dingo, Morris, c’est «Coming To Tear The Roof Down» ! Va directement sur le morceau titre et bham ! Lee te chante ce truc d’une voix verte et ça vire funk énoooorrrrmito, c’est un embrouillage du diabolo, il t’embarque dans l’enfer du funk et t’as aussi «Talk Is Cheap», monté sur des power-chords funky ! Il faut que tu voies comment le fucking nabot s’accroche au beat, ces mecs jouent avec leurs tripes, c’est le cut de la dernière extrémité ! Et t’as encore du funk avec «Nasty Sexy Dance», joué aux percus sèches, ça te saute à la gueule, Morris ! Oh le son ! Et avec «Let Me Be The One», le fucking nabot enfonce son beat à coups de talon dans le cul des annales ! Tu te relèveras la nuit pour écouter ce disque ! Tu as aussi «I Won’t Tell Nobody» joué à la cloche funky. C’est du stomp de funk, on n’a encore jamais vu ça !
Blanc comme un linge, Morris donne un violent coup de poing sur son bureau :
— Bon, ça suffit ! Je vous laisse la vie sauve, je ne mets pas de contrats sur vos têtes, mais vous quittez immédiatement la ville ! Je ne veux plus jamais revoir vos têtes de bibards !
Chaque fois que la situation se complique au-delà du raisonnable, Morris Levy prend conseil auprès de son ami Vito Genovese, expert en matière de résolution d’équations. Ils se retrouvent dans la salle du fond d’un petit restaurant de Little Italy. Morris lui raconte dans le détail l’épisode précédent. Vito pose sa fourchette et plonge un regard humide de compassion dans celui de Morris :
— Ah oui, je comprends, mon petit Morris... Délicat, très délicat... Pour récupérer quelques milliards de dollars, tu commets l’erreur de céder au caprice de James Brown. Maintenant, si tu veux sauver la face, tu vas être obligé de le descendre. Délicat, très délicat...
— Pourquoi dis-tu que c’est délicat ?
— Mais voyons, rompiscatole, tu ne sais donc pas que je suis fan de James Brown ?
— Tu te fous de ma gueule, j’espère...
— Sur la Vierge Maria, je te jure que non, Morris !
— Non, Vito, ça suffit, je trouve que ta blague a assez duré !
— Mais Morris, c’est pas une blague... Si tu touches un seul cheveu de la tête de James Brown, je demanderai à Benny Eggs de t’emmener faire une promenade du côté des docks, tu vois ce que je veux dire ?
— Bon, ça va comme ça, Vito, ne te mets pas en rogne ! Dis-moi plutôt comment je peux sauver la face dans cette putain d’histoire !
— Délicat, très délicat... Tu es baisé, Morris...
— Que veux-tu dire ?
— Ce que je viens de dire. Tu es baisé...
— Ça veut dire quoi en clair ?
— C’est toi qui dois disparaître.
— Tu te fous de ma gueule, j’espère...
Vito s’essuie la bouche avec la grande serviette à carreaux.
— Un chef de famille ne doit pas commettre d’erreur, tu comprends, Morrilito, ça rejaillit sur les autres familles... Nous devons tous veiller à rester immaculés, comme la Vierge Maria...
Et Vito se signe.
Un ange passe. Morris en profite pour sortir son Beretta - Bahmmm ! Une balle entre les deux yeux de son ami Vito ! Les deux hommes qui montaient la garde à la porte de la petite salle entrent en trombe, les armes à la main :
— Ça va chef ? Oh mince, vous avez descendu Don Genovese !
— Mais non, abruti ! Le coup est parti tout seul ! C’est un accident ! Fais courir le bruit immédiatement, sinon, on va encore avoir une guerre des gangs sur les bras. Ce n’est plus de mon âge !
Morris croit avoir réglé le problème, mais il se trompe. Vito avait raison, le problème reste entier. Impossible de sauver la face. Et sans conseiller avisé, un chef de famille perd l’initiative, c’est-à-dire l’avantage.
Morris sait qu’il va devoir se tirer une balle dans la tête. Mais il veut quand même comprendre comment il a pu se faire baiser par un fucking nabot. Le seul moyen de comprendre, c’est d’écouter ses disques. Alors, il envoie un de ses hommes acheter les albums de Lee Fields chez le disquaire du coin de la rue.

Il commence par écouter l’album «Problems». Dès l’intro du morceau titre chauffé à blanc, Morris tombe de sa chaise. Lee Fields fait du pur James Brown, il sonne comme un petit délinquant black et derrière lui, ça rampe dans l’ambiance mortelle de la mortadelle, oh yeah, il est dessus, il est dedans, il sort le meilleur groove rampant du mondo bizarro, il chauffe ça au pas de danse, les mains à plat, all the time ! Et ça continue avec «The Right Thing», pur jus de funk africain, claqué aux percus. Lee entre là-dedans comme un cake, à la chaudarde de yeahhhh de James et c’est fan-tas-tique, claqué aux guitares et tututé à la basse. Il a tout. Lee est un géant du funk business, il sort de terre pour éclater au grand jour, c’est complètement démentoïde - You turn me on ! - Il refait son James Brown dans «Bad Trip» et il passe au funk définitif avec «I Don’t Know When I’m Going». Il gueule comme un Mister Dynamite survolté, c’est un vrai feu d’artifice funk. S’ensuit un cut de clap nommé «Clap Your Hands» qui palpite dans l’effarance de l’excellence. Et puis voilà que tombe du ciel un hit universel : «Honey Dove» - Oh baby love - un mélopif extraordinaire à la Barry White. Lee revient à James Brown avec «I’m The Man» et termine cet album fabuleux avec une pièce de soul somptueuse, «You Made A New Man Out Of Me». Lee ne raisonne qu’en termes de firmament. Morris n’en revient pas. Il est hagard, comme frappé de stupeur.

Il retrouve l’excellent «Honey Dove» sur «My World», un album plus soul, c’est vrai, mais Lee ne fait que de la soul dévastatrice - My baby love - C’est imparable, il chante «Honey Dove» au timbre jaune et ardent. Il est hanté par la soul et visité par les démons du spirit. C’est d’une infernale beauté factuelle. L’autre hit de l’album s’appelle «My World Is Empty», soul dense et pas dense comme l’ouate du paradis et l’étoupe du canon, merveilleuse exaction longitudinale d’accès immédiat. Des alizés portent les chœurs et le son coconute. Et puis il faut entendre la ligne de basse qui traverse «Ladies». Filigrane ensorcelant. Voilà encore un chef-d’œuvre de soul moderne.
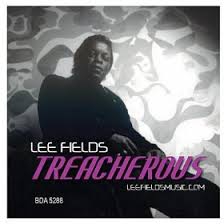
Fébrilement, Morris sort «Treacherous» de sa pochette et pouf, il retombe sur un coup de génie intitulé «We’re Here To Turn It Off», un funk tribal exceptionnel, une pulsion de la forêt profonde. Quel radicalisme ! Morris n’en revient pas. C’est du funk africain, Lee mène le bal des sorciers, il va plus loin que les autres compères et il éclate de rire au cœur du shuffle. Avec «At The End Of The Day», Lee tape dans la groovitude de James et de Marvin. Il est enragé, il ne lâche rien. Morris commence à comprendre. Ce fucking nabot de Lee Fields dispose d’un tempérament exceptionnel. Il fait du funk statique avec «Dance Like You’re Naked» et ça sonne comme le meilleur funk de la planète funk. Morris comprend que James Brown ait pu trembler pour sa couronne. D’autant que Lee embraye sur «I Want You So Bad», une pièce de soul coulante qu’il tartine au plus chaud de l’intimité organique. Lee se fait merveilleusement insistant, il chante ça à la percée fatale, il révèle un côté persuasif exceptionnel, il finit toujours par l’emporter.

Morris ressort la bouteille du mini-bar et boit directement au goulot. Il sent qu’il devient fiévreux. Il sort «Faithfull Man» de sa pochette et écoute le morceau titre, une sorte de plaidoyer soul d’un homme noir fasciné par le James Brown d’«It’s A Man Man’s World». Admirabilis ! Lee prend sa soul au chant ardent, avec une stupéfiante présence, il est dans l’ultra-brownisation des choses. En B, il chante «Wish You Were Here» en vrai screamer de plaintif intrusif. Il force les vulves à la hussarde. Et oh surprise, voilà qu’il tape dans la stonesy en reprenant «Moonlight Mile». C’est quasiment le hit de l’album tellement il chante ça bien. Il enchaîne avec un chef-d’œuvre de deep soul, «It’s All Over (But The Cryin’)» - It’s been three long years/ Since I Lost my mind - Lee est un fantastique installateur de pathos, il pressurise son froti, c’est à pleurer tellement c’est intense. Lee n’enregistre que des disques très denses, qui ne s’écoutent pas comme ça, en cinq minutes. Morris comprend que Lee Fields appartient à la caste des immenses artistes. Ce fucking nabot boucle sa B avec «Walk On Thru That Door». Il travaille tous ses cuts avec plusieurs spécialistes et chante une soul hyper travaillée avec un souci constant d’exploser la légende, il recherche le coin du bois, l’impossible renversement des conjonctions, il re-pétrit la vieille soul avec l’ardeur d’un petit artisan épuisé de ne plus croire en rien et pourtant il pétrit son pétrin, il pète ses ouates et revendique ses bretelles de Soul Brother number ce qu’on veut.

Morris tombe alors sur un autre «Faithfull Man». Oh, ce sont les versions instrumentales des morceaux qu’il vient d’écouter ! Le hit de Lee qui donne son titre à l’album fonctionne très bien en instro, avec sa petite contre-mélodie incisive et sa bassline en quinconce. Du coup, «I Still Got It» instro passe aussi comme une lettre à la poste. C’est amené comme un groove d’anticipation. Les Expressions vont bon train. Pour des petits blancs, ils s’en sortent plutôt bien. Mais tout n’est hélas pas du même niveau. La bassline sauve un cut comme «Still Hanging On» et de l’autre côté, ils tapent le «Moonlight Mile» des Stones à l’instro, ce qui n’est pas forcément une bonne idée. Morris retrouve l’aspect ensorcelant de la soul du fucking nabot dans «It’s All Over (But The Crying)». Ces instros valent pourtant le détour, car tout est soigné, très travaillé et admirablement arrangé.

Morris finit son tour d’horizon avec l’album «Emma Jean». Le fucking nabot attaque «Just Can’t Win» à la voix fêlée. Il tape dans le groove des géants de la terre. Sa voix ne trompe pas. Il chante la meilleure soul qui se puisse concevoir aujourd’hui. Il tape dans l’universalisme, dans un abîme de son qui embrasse l’osmose du cosmos. Morris écoute ensuite «Standing By Your Side», une sorte de r’n’b à l’ancienne orchestré par devant dans le mix. C’est de la démence baveuse pure et dure. Morris assiste à une hallucinante progression du son sous-jacent, une merveille de dosage, c’est pulsé dans la jugulaire du cut, Ce Lee Fields est un vrai démon, se dit Morris, l’écho du beat bat devant et le solo éclate sa grappe. Le beat rebondit et les cuivres l’endorment. Lee Fields allume tous les feux. Il tape aussi dans la soul de winner avec «It Still Gets Me Down» - When I see you around - Lee ne lâche jamais la rampe. Il chante à fond de deep. Il enchaîne avec un «Talk To Somebody» à la James Brown. Il sort à la fois la même attaque et la même voix, en tout seigneur tout honneur. Il tient son groove par les cornes. Il joue le funk de l’abdo. Ce mec a du génie, Morris finit par l’admettre. Ce fucking nabot a une vision claire de son art, ce qui n’est pas le cas de Morris.
Le moment est venu d’en finir. Morris comprend très bien qu’il ne pouvait pas faire le poids face à Lee Fields. Il arme son Beretta et enfonce le canon dans sa bouche. Bhammm !
Morris Levy a commis deux erreurs coup sur coup : sous-estimer un personnage comme Lee Fields et bien pire, rater le concert de Lee au 106.

Pourtant, quand il arrive sur scène, on s’interroge. Lee Fields n’a rien du Soul Brother habituel. Il avance vers le micro en se dandinant, avec une bouille de gamin vissée sur un corps de petit pépère. Comme ses musiciens l’ont annoncé comme au temps des revues, le public l’acclame. Il porte l’une de ces vestes brillantes ornementées comme seuls osent en porter B.B. King et Little Milton.

Il attaque avec un «All I Need» terriblement bien senti. En performer accompli, il chauffe la salle aussitôt. Il alterne les gros raids de deep soul avec les virées funky et il ahurit littéralement un public peu habitué à ce genre d’exactions. Il passe rapidement du statut de petit bonhomme à celui d’immense artiste. Il screame sur des crises de cuivres, il double les délires de guitare de cris d’alarme, il virevolte, mime James Brown pour que les choses soient bien claires, il reste en contact permanent avec son public.

On assiste à l’éclatante victoire d’un grand artiste noir. Lee Fields établit une fois de plus l’immense supériorité funky du peuple noir. Il jette toute sa vie dans la balance.

Il ne fait pas un show, il EST le show, il est le funk à deux pattes et la voix d’un art majeur. Comme les autres Soul Brothers, Lee Fields incarne le black is beautiful hérité des sixties et lui redonne du punch. Il finit avec l’excellentissime «Faithfull Man» et revient vêtu d’un petit gilet rouge à la James Brown pour un knock-out final, l’interplanétaire «Honey Dove». Oh yeah, baby love nous berce le cœur de langueurs monotones, et il tire sans fin sur l’élastique de sa chanson magique.

Signé : Cazengler, Lee Vide

Lee Fields. Le 106. Rouen (76). 12 mai 2016
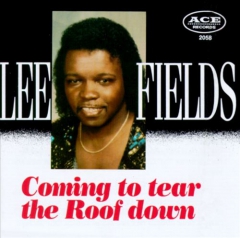
Lee Fields. Coming To Tear The Roof Down. Ace Records 1983
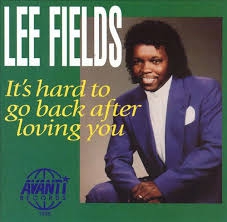
Lee Fields. It’s Hard To Go Back After Loving You. Avanti Records 1997
Lee Fields. Problems. Soul Fire 2002
Lee Fields. My World. Truth & Soul 2009
Lee Fields. Treacherous. BDA Records 2011
Lee Fields. Faithfull Man. Truth & Soul 2012
Lee Fields. Faithfull Man. Instrumentals. Truth & Soul 2012

Lee Fields. Let’s Talk It Over. Truth & Soul 2013
Lee Fields. Emma Jean. Truth & Soul 2014
FÊTE DE LA MUSIQUE
PROVINS / 21 – 06 – 2016
HELLEFTY

Premier concert depuis un mois. Pas question d'arpenter toute la ville, trop fatigant pour mon état encore vacillant. Je scrute le programme avec soin. Je déniche la perle rare. Les autres, je les ai déjà vus, ou alors mon flair de rocker subodore au mieux des groupes de reprises approximatives. Je sais, je suis injuste mais quand on veut privilégier son chien de l'enfer... Bref ce sera Hellefty, métal, ou rien.
Dix heures quarante cinq, je suis pile au rendez-vous. Renaud Bernal et son band entament leur dernier morceau. Se dépêchent de ranger leur matériel. N'ont pas fini que déjà Hellefty extirpe son matos de leurs trois bagnoles garées devant l'Eglise et l'entasse au pied de l'estrade. Musiciens et amis jouent aux roadies, et bientôt l'on entend une espèce de grondement à faire trembler les murs de la maison divine. Non ce n'est pas le diable, c'est le guitariste qui règle son ampli.
C'est à ce même moment que dans la lumière de la lampe qui éclaire le stand de la régie son j'aperçois les premiers moustiques. Aussi petits que des moucherons avec une étrange manière de se laisser tomber mollement vers le sol. Cinq minutes plus tard, faut se rendre à l'évidence, ce sont de minuscules gouttes d'eau qui ne mouillent même pas. Helllefty est en place, batterie, guitare, basse, n'y a plus qu'à jouer. Petit problème, l'espèce de rosée inefficace se transforme tout à coup en drache serrée... La sécurité surgit, on attend cinq minutes et si ça continue, on arrête tout. Because eau et électricité... Pas de bâche protectrice au-dessus des musiciens. Merci la mairie.
Dix minutes plus tard. Le concert est tombé à l'eau. La pluie se fait insistante. Faut démonter et remplir les voitures à toute vitesse. La place se vide. Ne reste plus que Vincent le batteur dégoûté et mon immodeste personne toute aussi dépitée qui taillent le bout de gras durant un quart d'heure. Ironie du sort : la pluie s'arrête de tomber...
Sont du coin, gîtent dans le triangle Provins-Nangis-Melun, donc on les reverra. Un CD quatre titres devrait sortir bientôt. Sur leur FB, l'on peut écouter de belles choses bien en place. Affaire à suivre.
Je rentre à la maison. Ce ne fut pas Hellefty. Ce fut rien.
Damie Chad.
SOGNOLLES EN MONTOIS
SALLE POLYVALENTE - 25 / 06 / 2016
CRASHBIRDS

Les rockers c'est comme les scientifiques fous qui recommencent illico leur expérience alors que le premier essai a rayé de la carte la moitié de l'agglomération. Ma précédente tentative de reprise de concert ayant lamentablement échoué ( voir article ci-dessus ), je réitère quatre jours après.
Sognolles en Montois. C'est sur les hauteurs de la Brie. Comptez douze centimètres au-dessus du niveau de la plaine. Un village perdu. Ce n'est pas plus mal : les ornithologues sont tous d'accord pour affirmer que les piafs de passage aiment à faire étape dans des lieux retirés. D'ailleurs quand vous avez déniché la salle polyvalente vous garez la voiture au plus vite sur le parking car vingt mètres plus loin le goudron s'achève, la route s'arrête dans le pré à quinze mètres du tronc vénérable d'un orme à la ramure imposante.
Les animaux possèdent un sens prémonitoire. Les Crashbirds se sont installés devant la façade de la salle des fêtes. Ne tombera pas une goutte ce soir. Ambiance champêtre, des enfants qui courent partout, des tables et des bancs alignés sur l'herbe, et une chaîne alimentaire qui distribue barquettes de frites et brochettes sur barbecue à des prix défiant toutes les grandes surfaces du département. Toute la population du village est rassemblée pour les festivités.
Situation idyllique. Je tiens toutefois à avertir les lecteurs charmés par cette paisible description. Certes les Crashbirds sont des oiseaux magnifiques, la houppette sous le menton du mâle et la teinte rousse de sa compagne sont ravissants, mais avant d'aménager un abri dans votre jardin, n'oubliez pas que ces passereaux sont d'infatigables jacasseurs. Pire que des cigognes qui claquettent du bec sur la cheminée. Font un bruit inimaginable. Plus question pour vous d'écouter les informations à la télé. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, Charles Darwin dans son bestseller La Sélection des Espèces vous explique comment les gentils petits oisillons volants ont été une tentative désespérée d'adaptation des dinosaures pour échapper à leur disparition. Bref du sang de reptile coule dans le moindre volatile sur son arbre perché comme dans une fable de Jean de La Fontaine. Les Crashbirds sont donc les héritiers de ces sales serpents qui grouillaient dans les eaux boueuses du delta. Old snake dirty blues !
REPTATIONS
Si vous ne me croyez pas, suffit d'écouter l'avant-concert, ces trente secondes durant lesquelles Pierre se cale sur son tabouret. Delphine en profite pour s'éclaircir la voix. Exactement comme si vous aviez marché par mégarde sur la queue d'un crotale. Vous imaginez le mécontentement de la bébête dérangée dans sa sieste. Une traînée mortelle d'écailles qui se dresse vers le ciel. Un bruissement métallique de roquette qui s'amplifie sans trêve, un ruban d'acier étincelant qui vibre de mille résonances, un sabre de cavalerie qui s'élève dans les airs avant de vous trancher la tête. Reprenez vos esprits, ce n'était que quelques innocentes vocalises. Déchirez aussi l'image mentale suscitée par la contemplation de leur superbe logo, ces deux petits zoziaux blottis l'un contre l'autre, on dirait qu'ils ont mis des lunettes d'aviateurs pour se protéger des impitoyables frimas de l'hiver. Les pauvres, ils n'ont que ça pour se couvrir ! En vérité ce sont deux pilotes de guerre aguerris qui étudient leur prochain objectif. C'est vous, attaque imparable en piqué. Vous faites partie, à votre corps consentant, des victimes rocklatérales.

Inutile de fuir. A droite vous avez la guitare électro-acoustique de Delphine. L'en émane comme de flexibles feuilles métalliques qui vous giflent à coups redoublés. N'ai jamais entendu une guitare claquer avec tant de punch, l'on dirait un laminoir. A gauche Pierre, plus classique une Gibson - électrique cela va de soi - mais beaucoup plus perfide. Delphine c'est clair et net, du rentre dedans, Pierre c'est plus traître, vous y mettez l'oreille - celle du connaisseur - et hop vous êtes happé jusqu'aux doigts de pieds. Vous emporte dans un labyrinthe, joue au minotaure, surgit toujours par la galerie où vous ne l'attendiez pas. Tricote salement, une maille à l'endroit et hop une frette à l'envers. Un jeu subtil et inventif. Pourrait s'arrêter là, nous serions contents. Mais non l'est comme le dieu Janus qui regarde des deux côtés. Finesse d'un côté, brutalité de l'autre. Nous assène le coup du bûcheron. Avec le pied. Pas du 36 fillette de ballerine anémique. Qu'il abat impitoyablement sur son caisson électrique. Une boîte à bruit qu'il a concoctée lui-même, juste pour vous prendre la tête. Une rythmique impitoyable. Vous avait prévenu, c'est écrit en grosse lettres sur la toile tendue derrière lui, dirty rock'n'blues. Pour marcher dans les marécages du stomp-bayou l'est nécessaire de chausser de gros godillots. C'est plus prudent pour les morsures d'alligators que vous essayez de hacher à la machette.

Comme vous êtes encore empêtré dans les machistes stéréotypes de la féminité vous tournez votre regard vers Delphine à la recherche d'un peu de douceur réconfortante. L'est belle comme la description de Velléda dans les Martyrs de Chateaubriand, toute élancée, toute droite, toute blanche, drapée dans la rousse auréole de sa chevelure, imparable, qui va son chemin, rayonnante et insensible, elle chante le blues électrique. Un voix d'airain. Claire mais qui ne tire pas vers les aigus, grave mais jamais sombre, infatigable, enchaîne les morceaux sans faillir. A peine une gorgée de bière de temps à autre, le temps que Pierre talque ses mains. Un timbre ensorcelant. Les autochtones qui assistent au spectacle ne sont pas spécialement des amateurs de dirty blues, mais les conversations se sont tues et aux applaudissements nourris et variés l'on sent que les gens ont compris qu'il se passait quelque chose. Certes ce n'est que la vieille fascination reptilienne du blues qui refait surface. Car Crashbird crache le blues comme le serpent son venin. Vous inocule la torpeur mythique du Sud et la violence flamboyante des villes électriques. Une jambe dans la terre arable du blues et l'autre dans la sauvagerie du rock and roll.

Le breuvage est servi avec le sourire de Delphine entrecoupé de l'humour auto-sarcastique de Pierre. Pas de péroraison, mais des réparties hâtives pour très vite repartir dans leur pilonnage intensif. Jouent leurs compositions, plus quelques rares reprises, par exemple un Under My Thumb - comment Pierre s'y prend-il pour assurer à lui tout seul le balancement rythmique si particulier des Pierres Qui Roulent, l'on dirait qu'il y a trois guitares, tandis que Delphine déchaîne un ouragan vocal qui emporte tout.
ENVOL

Se sont arrêtés au bout d'une heure trente. La nuit est tombée. Une fraîcheur piquante vous assaille l'épiderme. Promettent un deuxième set d'une demie-heure, nous administreront le double. Durant le court entracte le public se jette sur les CD et les T-shirts, avec un tel logo, pourraient créer toute une ligne de vêtements et une centaine de magasins franchisés sur tout l'hexagone.

C'est reparti. Comme en quatorze, avec l'attaque des tranchées à la baïonnette. Je ne pensais pas qu'ils pourraient faire mieux que la splendeur du premier set. Je reconnais mon erreur. Repartent sur les chapeaux de roue. Des chansons d'amour et de haine. Une reprise vitriolée de Because The Night et puis de ces duos de guitares infinis et époustouflants. Delphine délaisse le micro et se rapproche de Pierre, et l'on a droit à ces chevauchées fantastiques sans fin jusqu'au bout de l'horizon du rock. Faut entendre l'approbation admirative de l'assistance à la fin de chaque morceau. Un séjour dans le jardin des délices, avec pension complète. Tout ce que vous désirez au plus profond de vous-même vous est donné. Plus les suppléments qui vont avec. Est-ce du blues ? Est-ce du rock ? C'est avant tout de la sale bonne musique. Un régal. Un must. Un déluge bienfaisant d'énergie qui revigore nos âmes de pêcheurs en eaux troubles d'un Mississippi en crue, assoiffées de tumultueuse beauté rock and rollienne. Ce soir Crashbirds a rompu les digues.
Damie Chad.
P.S. 1 : cette fois, ce fut tout.
P.S. 2 : J'oubliais les quatre gendarmes dans leur fourgonnette attirés par le bruit. Police partout, justice nulle part. Sont vite repartis. Apparemment la maréchaussée ne goûte guère le rock and roll. Ce n'est pas grave : personne n'aime la police.
P.S. 3 : ce n'était peut-être pas exactement un orme. Mais je confirme, c'était bien un arbre.
( Photos FB : Fredo la lune )
NINA SIMONE, ROMAN
GILLES LEROY
( Folio 5371)
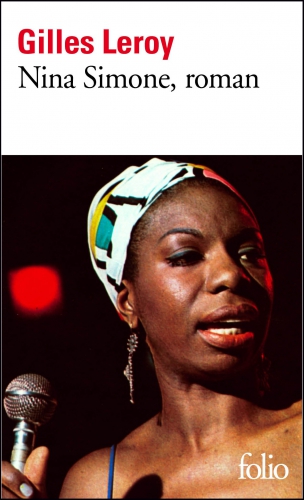
Nous avertit dès le titre, Gilles Leroy. Le sujet c'est bien Nina Simone. Mais un roman. Pas une biographie. Mais l'est difficile de romancer sans biographiser. Certes se contente des dernières années de l'existence de la Diva. La déchéance d'une étoile qui s'effondre sur elle-même, c'est plus vendeur qu'une réussite zénithale. Les lecteurs sont des pleureurs. Compatissent facilement. Peut-être parce que leur cursus à eux se révèle assez pâlichon dans son ensemble. Heureusement il y a les dialogues et les monologues intérieurs qui permettent de remonter le temps et de raconter tout ce qui s'est passé avant.
Pour les dates et les titres des morceaux, prière de vous reporter à la discographie. Tout au plus une dizaine d'entre eux seront évoqués dans le livre. Pour la véracité historiale, à vous de démêler le vrai du faux, une note en fin de volume nous indique que les principaux personnages – hormis ceux relatifs à l'enfance - sont des fictions. Le projet de Gilles Leroy est tout autre que l'atteinte d'une congruence effective avec la réalité. Ce qu'il essaie de retranscrire c'est le portrait intime de son héroïne. Tente de saisir comment ça marchait dans la tête de Nina.

Fut diagnostiquée bipolaire. Un mot médical qui dit tout et n'importe quoi. Les psy sont comme les géologues qui se placent devant la (in)jointure californienne des plaques continento-tectoniques et qui déclarent doctement que vous êtes devant la faille de San Andreas. Nous le savions déjà. Nous, ce qui nous intéresse c'est de savoir si notre espèce présente des similitudes avec l'extinction des dinosaures. Bref, dans une histoire, il faut chercher les lézards. Avez-vous remarqué que dès que l'on s'approche de près ou de loin du blues, les écailleux font leur apparition ?
Premier brontosaure : dans la psyché de la petite Eunice Kathleen Waymon née en 1933. Sait à peine parler que déjà elle sait jouer du piano. Pour ses parent noirs et pieux, c'est un don de Dieu qu'il est interdit de laisser perdre. Et la minette est condamnée au clavier plusieurs heures par jour. L'aimerait jouer à la poupée, la pauvre baby doll, et courir avec ses copines dans le jardin. Boulot. Boulot. Boulot. En plus, de gentilles dames blanches aux porte-feuilles aussi remplis d'or que leur coeur lui offrent de sérieuses leçons de piano hebdomadaires. Puis le pensionnat dans une école avec section de musique. Un rêve. Et un enfer. Ce qui ne vous tue pas, vous blesse tout de même sérieusement.

Deuxième tyranosus rex : met un peu de temps pour l'apercevoir. La prise de conscience n'en sera que plus dure. Vit dans un monde ségrégatif. Oh, à Tryon ( Caroline du Nord ) ce n'est pas le KKK qui règne, les blancs et les noirs se saluent très poliment dans la rue. Pas d'insultes. L'on se côtoie mais l'on ne se mélange pas. Premier coup de couteau. A treize ans lors de son premier concert dans sa ville natale, un couple de blancs arrivés en retard fait un scandale car deux places de devant sont occupées par les deux seuls noirs de l'assistance. Eunice refuse de jouer si ses géniteurs doivent quitter leurs chaises. Désormais un mur de verre transparent isolera ses parents de la communauté blanche dont les membres se détournent sur leur passage.
Troisième Galliminus ( très maximus ) : crise économique. Le père perd ses emplois. En tombe malade. La mère qui ne travaillait pas est obligée d'accepter les ménages, l'était une acharnée de l'Eglise, sera bonne chez les blancs riches. Nina est née après la déconfiture familiale, mais les stigmates s'imprimeront en elle. Etrange, ce constat selon lequel les noirs sont plus durement touchés par la dépression que les blancs.

Quatrième albertosaurus : méchante morsure. Joue mieux que tous les quatre cents concurrents du concours d'entrée de l'Institut Curtis mais elle ne fera pas partie des admissibles. Induit vite pourquoi. L'était la seule postulante de couleur à se présenter.
Cinquième spinosaurus. L'autre soir, je dinais chez une copine. L'avait mis un double CD de succès de Nina en fond de conversation. Genre de crime à ne pas commettre. Trente-six morceaux et pas un seul à jeter. Trente six merveilles. Trente six chandelles ! Vous auriez eu envie de baiser la trace de ses talons aiguilles. De Nina, pas de la copine, suivez un peu, bon dieu ! Jugement erroné. De la gnognotte. Juste bon pour la cagnotte. Pour Nina, ce n'était que de la sous-musique. De la variétoche. Son truc à elle, c'était Chopin, Beethoven, Debussy. Le reste roupie de sansonnet. Pipi de canari. De l'alimentaire. N'aimera jamais qu'on la compare à Billie Holyday. Ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, elle reprendra plusieurs de ses morceaux. Leurs parcours s'inscrivent dans deux cultures différentes. Billie de la négritude afro-américaine du jazz, et Nina de la musique classique européenne. Choc des origines. Cherchez l'erreur.
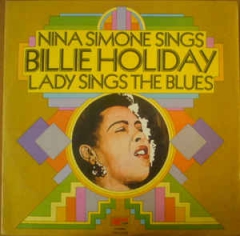
La ménagerie est terminée. Pas facile de vivre avec ces amicales bébêtes qui farfouillent dans votre cerveau. Causent beaucoup de dommages mais elles présentent parfois des avantages. La revanche du pauvre. La vengeance de la négresse. L'argent qui coule à flots, qui permet d'acheter superbes villas et robes de reine. La reconnaissance des fans, l'adulation des foules, les applaudissements, les articles laudateurs, n'est plus noire, n'est même pas blanche, l'est une Artiste fêtée par le monde entier.
Mais la gloire est frivole comme dit Aznavour ( celui-là vous ne l'attendiez pas ) et si vous regardez d'un peu trop près vous ne tarderez pas à voir les craquelures sur la peinture dorée du tableau. S'est faite méchamment arnaquée en signant ses contrats, la jeune Nina. L'ardoise se compte en millions de dollars. Devinez la couleur des patrons de labels ? Vous avez raison, mais il y a eu aussi des noirs n'ont pas toujours été clean, non plus.

Du coup elle deviendra une acharnée des Droits Civiques. Donne des représentations au profit de la lutte. Participe à des meetings et à des marches interdites par la police. Notamment avec Langston Hughes, celui-la on le retrouve toujours du bon côté des barricades et James Baldwin, celui-ci il ne vaut pas mieux que le précédent. Pire que Joan Baez, Nina n'est pas pacifiste, juge la violence nécessaire à l'obtention de la justice. Des positions qui ne vous donnent pas que des amis. N'est plus très bien vue aux Snakes comme elle appelait les States. Ne vous étonnez pas si elle s'en va vivre en Afrique, et en ses dernières dix années de par chez nous.
Courir le monde fatigue. L'âge impose sa loi. Nina boit un peu trop et grossit trop et pas qu'un peu. S'arrête et doit reprendre ses tournées pour assurer les fins de mois. Se bat contre le cancer. Gilles Leroy nous rappelle qu'elle n'est pas toute blanche. Sait être cruelle avec son entourage. L'est rongée par ses défaites et ses remords. Ses maris qui n'ont pas été de tendres roucouleurs – mais elle aimait les armoires à glace plutôt viriles - sa fille qu'elle n'appelle jamais. Se repent de ses faiblesses, se laisse manipuler trop facilement, peut-être même qu'elle aime cela, et qu'elle le désire. Le sado-masochisme se niche avant tout dans vos contradictions les plus secrètes, les plus destructrices, celles sur qui votre personnalité s'est bâtie.

L'en vient à s'auto-culpabiliser. A-t-elle vraiment si bien joué qu'elle l'a pensé au concours Curtis ? N'était-elle pas un peu faiblarde sur son interprétation de Chopin ? Le doute la ronge. Le racisme ce n'est pas seulement les horreurs de l'esclavage ou les humiliations de la ségrégation. Beaucoup plus insidieux. L'Homme Noir en arrive à perdre confiance en lui-même. Peut-être n'est-il pas égal à l'Homme Blanc. A croire que dans ces deux appellations ce n'est pas le dénominateur commun homminal qui prime. Mais la suite adjectivale. L'un plus beau, plus brillant que l'autre. Symptomatiquement, elle aime que ses amants noirs aient la peau plus claire que la sienne. Elle déteste ses lèvres trop lippues.
Vous croyez être capable de juger et d'analyser en toute objectivité, en toute sérénité la profondeur de la faille qui est en vous. Mais vous y êtes déjà dedans. Jusqu'au cou. Comme dans la merde. Et vous glissez sans fin, le long de la paroi. Et lorsque vous aurez enfin atteint le fond, que vous pourriez donner le coup de pied qui vous permettra de remonter... C'est trop tard. C'est que vous êtes déjà mort.

L'on meurt toujours de quelque chose. Mais l'agonie est plus dure à vivre quand l'on n'a pas unifié ses contradictions.
Un beau livre.
Damie Chad.
P.S. : Nina Simone, roman est le dernier tome de la triologie de Gilles Leroy consacrée à trois figures féminines américaines. Le personnade de Zelda Fitzgerald qui apparaît dans ce troisième volet est l'héroïne du premier volume intitulé Alabama Song
LE PEUPLE DU BLUES
LEROI JONES
( Folio 3003 / 2015 )

Beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est un classique de la littérature américaine consacré au blues. Fut édité en 1963. En gros avant la naissance des Rolling Stones. Ce qui signifie pour les jeunes européens des années soixante avant que le blues ne nous fût révélé. Première constatation : où sont nos idoles ? LeRoi Jones ignore le Delta. Charley Patton, Son House, Robert Johnson, et toutes les autres grandes figures fondatrices et mythique du blues ne sont même pas cités. Le Chicago blues est traité avec la même désinvolture, le nom de Muddy Waters apparaît une fois dans une courte énumération un peu comme si je nommais à l'emporte pièce Jean-Claude Annoux dans une histoire du Yé-Yé français. Moi petite frenchie grenouillette très estomaquée ! Apparemment nous ne partageons pas les mêmes idoles.
Deuxième étonnement : s'appelle le peuple du blues, mais devrait être sous-titré le peuple du jazz. Cette réflexion sans animosité. Le parti-pris de LeRoi Jones explique cependant en partie l'étrange découpage opéré par Mike Evans dans son livre Le Blues, un Siècle d'Histoire en Images que nous avons chroniqué dernièrement ( voir KR'TNT ! 286 du 16 / 06 / 2016 ). Nous ne voyons le blues que par le prisme d'un de ses aboutissements, le rock and roll, que nous privilégions au-delà de toute objectivité. Lunettes déformantes. Jones écrit son histoire du blues en la collant de très près à sa branche, pour lui, maîtresse : le jazz.
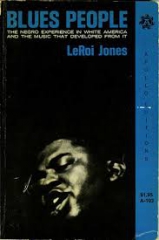
Et pourtant Jones ne parle que du blues. Emploie le mot systématiquement pratiquement à chaque page. Cause de musique - car quel que soit le bout par lequel vous le prenez le sujet vous l'impose – mais ne l'étudie pas sous son aspect purement musical. Emploie le terme sans le définir comme phénomène d'évidence. Le décortique selon un point de vue que nous qualifierons de marxo-sociologique. Un sous-marxisme clandestin jamais appelé par son nom. Chat échaudé craint l'eau froide : LeRoy Jones a été dénoncé comme communiste et rétrogradé de son grade de sergent durant son armée... Donc l'en reste à une analyse des rapports de classes, jamais entrevus en tant que stratégie de lutte de classes révolutionnaire, mais en tant que conséquences sur la psyché de la population noire.
Ne s'attarde guère sur l'esclavage en tant que tel. Cite les hollers comme première affirmation d'une identité personnelle mais préfère se pencher sur les divisions qui très vite s'instaurent dans la communauté. Ceux qui travaillent aux champs et ceux qui servent à la maison. Les domestiques qui vivent dans un contact étroit avec les maîtres abandonneront très vite leurs racines africaines pour adopter celle de l'american way of life. Coupent les ponts avec leurs anciens dieux et adoptent la religion chrétienne. Quelques uns d'entre eux embrasseront l'état de pasteur. Ce sont eux qui évangéliseront leurs frères soumis aux tâches les plus dures. L'embryon d'une bourgeoisie noire est ensemencée dès les primes décennies de la servitude. A cette mince couche de « mieux-nantis » s'agglomèreront les affranchis qui deviennent artisans et qui petit à petit se constituent un pécule – peut-on déjà parler d'un capital ? - qui les pose au-dessus de leurs frères de sang.

De sang, mais pas de peau. C'est notamment à partir de la Nouvelle-Orléans que va s'installer cet étrange camaïeu psycho-social qui va fragmenter le peuple noir. Tous ne sont pas aussi noirs. D'une ethnie à l'autre la mélanine n'est pas la même. La pigmentation est inégalitaire. Certains sont plus foncés que d'autres. Les amours ancillaires des maîtres n'ont pas atténué les différences. Dans le troupeau, les moutons noirs sont les plus nombreux. L'on peut parler d'une sélection raciale qui s'opèrera lentement mais sûrement : les plus noirs resteront les plus pauvres, les plus clairs entreprendront de monter l'échelle de la réussite économique. Jones pousse très loin cette logique : toute une fraction de noirs veulent singer les blancs. De véritables caméléons. Pour eux, l'assimilation totale avec les blancs est la condition sine qua non de l'intégration. Rejettent toutes accointances avec leurs origines, renieront très tôt le blues comme signe et rappel injurieux de leurs anciennes conditions d'esclaves. Il n'est de pire aveugles que ceux qui ne veulent pas voir. Cette façon d'agir se perpétue encore aujourd'hui, souvenons-nous des produits détergents employés par Michael Jackson pour se blanchir l'épiderme, et le peu de souci qu'a manifesté le président Obama envers ses électeurs de couleur... L'argent n'a pas d'odeur mais il lave le plus blanc...

Les premiers bluesmen, furent des blueswomen. Jones indique bien l'origine rurale du blues mais n'en fournit aucune description. Qui ? Quand ? Comment ? Pas un mot. Plus que le blues des villes ces femelles du blues représentent un blues plus policé, qui tire sa culture d'un circuit économique que l'on peut déjà qualifier d'entertainement. Théorie du sandwich, une couche de beurre blanc, une rondelle de boudin noir et l'on recommence. Les blancs ont imité les nègres qui ont imité les blancs qui les imitaient, les blancs ont apporté les capitaux, les noirs les ont imités à leur tour et tutti quanti jusqu'à la création de l'industrie du showbiz...
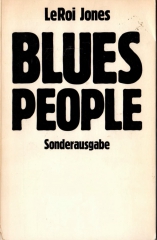
Les noirs détenaient la pulsation primordiale. Les blancs se sont vite aperçus de leur manque. Ne se sont pas découragés. Ont copié. Ce n'est pas un hasard du calendrier qui a fait que le premier enregistrement de jazz soit dû à un groupe de blancs. Les noirs créent. Les blancs récupèrent. Edulcorent aussi. L'art brut ne plaît pas aux masses. N'achètent que des musiques doucereuses. Du rythme, mais pas de folie. Du swing mais pas du rumble. Les nègres peuvent s'agiter tant qu'ils veulent, l'industrie du disque, des spectacles et les médias sont principalement propriétés et priorité des blancs. S'instaure une course sans fin. Les premiers partis sont vite rattrapés. Le jazz est aux mains des blancs : ce sont leurs artistes qui seront avantagés et qui ramasseront le plus de blé. Les uns stompent et marnent dans leur coin, les autres pompent et paradent dans les vitrines de la célébrité. Les grands orchestres sont des concepts européens, un peu de noir rehausse le blanc. Embaucher un ou deux solistes nègres, exécuteront leur numéro comme les enfants font les pitres devant leurs parents attendris.

Il y a des résistants. Des big bands naîtront les blues shouters et puis les combos de rhythm and blues, cette musique de sauvages que la bourgeoisie noire refuse d'écouter. Charlie Parker et quelques camarades saccagent le jazz et inventent le Be-Bop. Tollé général. Très vite lui succèdera le cool. Jazz mentholé pour blancs qui ne supportent pas les brusqueries de ce jazz nouveau un peu trop vert crû. De toutes les manières, que ce soit Be- Bop ou Cool, les blancs en font une mode, et mettent l'accent sur les musiciens de leur race. Du coup LeRoy Jones en vient à considérer le rock and roll – cette musique de petits blancs – comme beaucoup plus subversive que le jazz des années cinquante. Ce rock que l'on traite de bruit nauséabond produit par d'incultes sauvageons ! Les mêmes condamnations qui servirent à qualifier le blues et les novateurs du jazz en leur temps. Ne passe pas sous silence non plus, ces mouvements de revival des formes anciennes qui furent tant décriées en leur époque. Trente ans après, leurs forces subversives et sémentales font partie du paysage culturel. Ont perdu leurs facultés urticantes. Rentrent dans l'ordre normal de l'évolution rassurante des choses qui se sont tant usées qu'elles sont devenues anodines et dignes de toute louange muséographique.
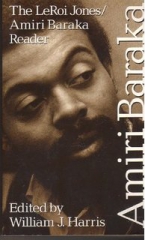
Le livre se termine avec les poussées riffiques de John Coltrane et l'apparition de ce qui deviendra le free jazz. Passe très vite sur ce qui sera un des grands centres d'intérêt de l'existence de l'auteur : la beat Generation. Nous sommes en 1963, ignore totalement les mouvements de contestation de la jeunesse universitaire blanche et les gémissements du renouveau folk, consacre un paragraphe à la compréhension qu'il éprouve pour tout ce mouvement noir qui à l'instar de Malcom X se convertit à l'Islam - lui-même prendra le nom d'Amiri Bakara - comme pour marquer que la conciliation blancs /noirs s'est faite attendre trop longtemps, que les enfants rejetés finissent un jour par couper les ponts, qu'il est temps de marquer une coupure franche et nette, cassante, entre les deux communautés. Le Black Panter Party n'oubliera pas de lire cet ouvrage qui relate avec une très grande précision les stratégies d'asservissement et de domination que les blancs ont élaborées durant trois siècles pour contrer les avancées successives de la cause noire. Récupération culturelle, divisions économiques et manipulations psycho-sociales qui marchent de pair avec des processus d' auto-fragmentations autant dues à une individuation petite-bourgeoise de survie animale qu'à une occultation des conjonctions de classe. Un livre qu'il faut lire en se rappelant que ce n'est pas uniquement le peuple du blues mais les pauvres de tous pays qui furent et qui restent soumis à de tels champs de force. Une analyse que l'on peut qualifier de révolutionnaire. Et d'utilité directe.
Damie Chad.
ZINES - #VFLC // Episode 1

Episode 1. Mais c'est le deuxième morceau ( voir KR'TNT ! 273 du 17 / 03 / 16. ) Pas de vidéo cette fois. Bande son seule. Inutile de mettre de la gaze sur le coup, le poing suffit. Zines, z'ont su passer l'obstacle sans se recopier, voire pire se renier. Le deuxième oxer est le plus dangereux. Trop souvent l'on crache tout son venin à la première morsure, et ne reste plus de poison pour la suite.
Chut ça commence. Du violon. Oui du violon ! Sur du rap ! Larmoyant et déchirant. Générique d'un film sentimental. L'on se croirait dans une boîte avec un crin-crin tsigane qui vient pleurer dans votre oreille. Les notes éparses dignes d'un piano-bar accentuent l'impression. Voix mélodieuse d'une égérie, glapissement de gamin, et braoum ! Vous prenez direct sur la gueule. La paire de claques qui fait mal et vous envoie à terre sans que vous ayez le temps de reprendre vos esprits. Maintenant faut réaliser. La séquence est sur deux plans. Les plaintes du violon langoureux qui reviennent comme les rimes souterraines d'un poème, et les voix marquent la rythmique sans concession. Parfois vous avez comme des écrasements de musique, des effondrements de claviers, qui semblent s'enfoncer dans leurs propres ornières, qui ruissellent et forment comme un contre-chant de bande-son mélodramatique. Le flot n'attend pas. Imperturbable. Sans arrêt. Ni regret. Mais ne vous fiez pas à l'ambiance.
Zines règle ses comptes. Des voix de scalpel. Mettent les pendules du rap à l'heure. La leur. Ne suffit pas d'avancer les aiguilles pour être devant. Y-a tellement de faiseurs et d'envieux qui vous tournent autour. En sens contraire. Deux ados, le dos au mur de la réalité. Le rêve s'effondre comme un décor de carton-pâte qui prend l'eau. Il est temps de clarifier et de poser les limites. Tracent les bandes blanches du terrain de foot, de la terre des fous. Une lame de couteau, un cutter menaçant, qui découpent le contour des faux-frères et des remplaçants du banc de touche. Du banc des souches immobiles. L'on ne peut être fidèle qu'envers sa tribu. Seule manière de ne pas se trahir soi-même. Zines démontre que l'univers loin d'être en constante expansion est en perpétuel rétrécissement.
Crise de croissance. Plus vous grandissez, plus le monde premier des illusions se rapetisse. C'est ainsi que l'on gagne en maturité. Que les voix s'affirment. Ne se cachent plus derrière les images. Crachent sur la laideur des êtres. Point de désespérance. Reste une ultime tour d'attaque. L'orgueil adolescent sûr d'avoir emprunté le bon chemin. Celui qui fonce droit devant. Zines nous sert un rap qui mord. Mais il est des blessures qui vous réveillent de vos torpeurs et qui vous font un bien fou. Elles vous rendent davantage conscients et vous obligent à vous reposer les bonnes questions. Celles d'une certaine honnêteté intellectuelle.
Ce deuxième morceau de Zines est séduisant. Ces deux jeunes garçons ont des idées originales. Parviennent à se renouveler et à nous surprendre tout en restant dans le droit fil d'une démarche artistique dont ils assument tous les enjeux. A suivre.
Damie Chad
21:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lee fields, ronnie spector, crashbirds, hellefty, nina simone, leroi jones, zines rap officiel



