19/12/2015
KR'TNT ! ¤ 261: HAYSEED DIXIE / BLUE TEARS TRIO / LANGSTON HUGHES
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 260
A ROCK LIT PRODUCTION
24 / 12 / 2015
|
HAYSEED DIXIE / LANGSTON HUGHES |
Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015
HAYSEED DIXIE

L'ACIDE DIXIT DES HAYSEED DIXIE

Gag ou pas gag ? Chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois, au temps où sonnaient les cloches de Jouahandeau. Pour un amateur de blind dates, ce groupe américain est une bénédiction. Les Hayseed Dixie ne jouent que des reprises qu’ils entraînent le plus souvent dans la ronde infernale du plus beau hillbilly des Appalaches. Sur scène, ils font absolument tout ce qu’il faut pour qu’on ne les prenne pas au sérieux, mais en contrepartie ils jouent comme des diables. Il n’est pas besoin d’être musicien pour comprendre que ces quatre mecs sont de très grosses pointures, comme on dit chez les cordonniers.

À une autre époque, on avait découvert Th’ Legendary Shack Shakers à la Boule Noire, et ce soir-là, nous n’étions qu’une petite vingtaine de personnes rassemblées au pied de la scène pour admirer le numéro de cirque de JD Wilkes et de ses copains du Kentucky. Leur numéro consistait à slapper le fameux southern gothic dont on trouve les racines dans les romans de William Faulkner et d’Erskine Caldwell. Les Shakers allaient beaucoup plus loin que les groupes de country-punk, car ils dynamitaient leur son à coups d’harmo et de banjo. Ils dégageaient un souffle extraordinaire qui pouvait ressembler à celui de la liberté absolue, telle que l’ont vécue leurs ancêtres les pionniers. Ces gens qui s’installèrent dans des terres inconnues échappèrent définitivement aux lois de la société et purent inventer les leurs. Ils ne le savaient pas, mais leur objectif qui était de cultiver quelques arpents de terre et de vivre libre cousinait sérieusement avec ce que les piratologues appellent l’utopie.

Les quatre pitres d’Hayseed Dixie vivent à Jackson, dans le Tennessee. Le nom du groupe est une déformation phonétique d’AC/DC, un groupe qu’ils semblent priser puisqu’ils ont déjà enregistré un tribute à AC/DC. Ils terminaient d’ailleurs leur set du 106 avec «Highway To Hell», ce qui n’était pas forcément une bonne idée, car dans leur tas de reprises, ils avaient des choses plus intéressantes, comme par exemple une reprise du Rapsody de Queen assez extraordinaire. On s’imagine que Queen reste intouchable à cause du chant de Freddy Mercury, mais ces gens-là sont suffisamment doués pour en proposer une version spectaculaire. On reconnaissait au passage des cuts célèbres, comme «Ace Of Spades», ou «Watching The Detectives» de l’endivaire Costello. Au moins, l’avantage du blind date, c’est que ça amuse les gens. Comme ces jeux télévisés auxquels on participe sans le vouloir quand il faut composer des mots avec des lettres. Pendant ce temps, on ne fait pas de conneries.

Hayseed Dixie était au 106 dans le cadre des Nuits de l’Alligator, pris en sandwich entre le grand Bloodshot Bill et les vaillants Heavy Trash. Ils surent tirer leur épingle du jeu car ils faillirent voler la vedette à Heavy Trash, grâce à une reprise du thème de Délivrance. Et là on ne rigole plus, car on entre de plain pied dans cette mythologie réactivée jadis par Martin Boorman, celle d’un Deep South sauvage et désertique où rôdent encore des trappeurs édentés. Ces fantômes ne portent plus la fameuse coiffe en fourrure de Davy Crockett, mais des casquettes. Tout l’univers malade jadis décrit par Faulkner rejaillit de façon spectaculaire dans ce film et tous ceux et celles qui l’ont vu en ont été marqué à jamais. Pas uniquement par les quelques scènes de violence, mais peut-être plus sûrement par cette rencontre dans une cabane au bord du fleuve entre un gosse dégénéré et un type civilisé qui voyant un banjo dans les mains du gosse tente de nouer un dialogue en jouant un thème sur sa guitare. Le gosse l’entend et le rejoue à l’oreille sur son banjo. Alors le civilisé joue une variante et le gosse la reprend immédiatement. C’est là que la magie se produit. Les deux instrumentistes accélèrent le tempo et ça donne «Banjo Duelling». Avec cette séquence, Boorman fait de l’universalisme, la science de tous les rêves impossibles de connexion entre les êtres. Il semble que la musique soit le seul moyen d’établir cette connexion. Et quand les Hayseed Dixie attaquent ce thème devenu mythique, on ne peut que se prosterner. D’autant qu’ils sont quatre à pouvoir le jouer. Mais c’est Johnny Butten qui mène forcément le bal sur son banjo. Ça pourrait tourner au cliché, mais non, car c’est joué dans les règles de l’art. Et à part eux, qui est capable de jouer le thème de Délivrance ?

Même dans ses rêves les plus fous, Gram Parsons n’aurait jamais imaginé qu’une telle équipe puisse un jour incarner l’Americana. Le chanteur John Wheeler ressemble à un prof d’histoire-géo en vacances en club Med, Jake Byers qui joue sur une grosse basse acoustique se déguise en clown trash-metaller, Joe Hymas qui gratte une mandoline fait le hippie dans sa salopette et le seul qui ne semble pas faire le clown en se déguisant, c’est Johnny Butten avec son banjo et sa casquette de trappeur édenté. Leur set est un mélange assez explosif d’auto-dérision, de talent, d’énergie, de virtuosité et de wild americana.
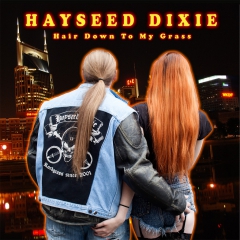
Ils profitaient de cette tournée pour faire la promo de leur nouvel album, «Hair Down To My Grass». Ils proposent une série de reprises pas toujours du meilleur goût, mais on les écoute pour se régaler des parties de banjo de l’ami Butten. Tout est emmené à l’énergie des Appalaches. Le problème est qu’ils reprennent des morceaux de groupes qu’on ne connaît pas forcément, comme Journey, Survivor, les Scorpions ou Pink Floyd. Mais partout règne une sorte d’excellence d’allant et ces quatre mecs astiquent leur beat avec une incroyable frénésie. On tombe sur un vieux coucou comme «The Final Countdown» qui incarne tout ce qu’on a pu détester dans les années 80, mais ils en font un truc nouveau, joué au violon gras de Stephane Grapelli et monté à la pompe manouche, alors ça devient intéressant, d’autant que l’ami Butten vient gratter son banjo du diable. Il joue terriblement vite et reste miraculeusement dans les clous d’une énergie dévoyée. On trouve aussi sur cet album une reprise salée de «We Are The Road Crew» de Motörhead. Banjo man y entreprend une cavalcade hallucinée. Le banjo, lorsqu’il est bien joué, donne toujours une image de la virtuosité excessive. Quand on demande à Johnny Butten d’où il sort sa virtuosité, il répond tout simplement qu’il a appris à jouer du banjo at the age of nine. Pour le «Comfortably Numb» du Pink Floyd, Banjo man refait un véritable festival et semble même crever le mur du son avec un indicible smash énergétique. Il sort le son de la vie, le banjo éclate dans le supersonic rocket-shout. Aucune guitare électrique ne peut rivaliser avec cette frénésie extravagante. Ils bouclent cet album avec «Don’t Fear The Reaper» du Blue Oyster Cult. C’est une fois de plus joué au violon gras et vrillé par un wild drive de banjo sauvage des Appalaches. Banjo man reprend le thème de l’huître qui se prenait pour les Byrds et l’emmène cavaler à travers les plaines du Wyoming et du Dakota tagada, au vent d’allure chargé de parfums sauvages, narines dilatées, énergie de la vie primitive, cavalcade insensée à travers les collines couvertes d’herbes hautes à perte de vue, yaooohh, le banjo bouillonne comme le sang dans les veines d’un homme libre.
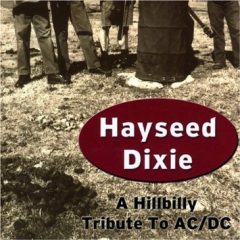
Cet album n’est que la partie visible de l’iceberg. Les Hayseed Dixie ont déjà enregistré une belle série d’albums et Banjo man vient tout juste de remplacer de frère de Joe Hymas, qui jouait bien, mais pas aussi vite que lui. On dit de Banjo man qu’il figure dans le livre Guinesss des records en tant que joueur de banjo le plus rapide du monde. Leur premier album fut un Tribute à AC/DC et même quand on n’apprécie pas vraiment le rock hurlé des Australiens, on écoute l’album des Hayseed avec un réel plaisir. John Wheeler s’impose comme un chanteur extraordinaire dès la première reprise qui est celle de «Highway To Hell». Ils transforment ensuite «You Shook Me All Night Long» en hit de cabane du Midwest. On se croirait dans «Les Portes du Paradis» de Cimino. Encore une belle mainmise avec «Dirty Deads Down Dirt Cheap». Wheeler chante comme un stentor avec un humour à fleur de peau, au milieu d’un véritable bombast d’instruments à cordes, le tout monté sur le tic tac de fond de la grosse basse acou. Il se peut que ce premier album reste leur meilleur album. Wheeler chante aussi «Hells Bells» à la force de la glotte, mais sans hurler, comme c’est le cas dans la version originale. Ils embarquent «Money Talks» au tourbillon des hillbillys. Ces mecs circulent dans les collines à train d’enfer et les solos d’acou sont d’une rare violence. John Wheeler va où le vent le porte. Nouvelle merveille avec «Have A Drink On Me», une petite aventure de bluegrass à la tabasse du beat. Ces mecs repartent inlassablement en patrouille. Ils ne craignent ni le diable, ni l’indien, ni les fauves, ni la mort. Voilà encore un cut fabuleusement fouillé aux violons et bardé de coups d’acou. Franchement on s’épate de tant d’énergie. Tous les groupes de rock devraient écouter cet album, car il renvoie une bonne image de ce que peut signifier le rock lorsqu’il est de bonne humeur. La version de «TNT» fera hennir les goths du coin de la rue, mais tant pis. Et ils repartent ventre à terre à coups d’acou. Avec «Back In Black», John Wheeler fait un vrai numéro de cirque - Yes I’m back, well I’m back/ You know I’m back/ I’m back in black - Ce mec fait ce qu’il veut au chant. Il monte où il veut. Il aménage ses propres paliers et soudain, il emprunte un pont jazzé au slap étrangement fantastique et il revient en envoyant des coups d’acou terribles. Leur énergie nous soûle. Avec «Big Balls», John Wheeler fait l’éloge de ses big balls - I got big balls, she got big balls - et sa voix puissante porte jusqu’à l’horizon.
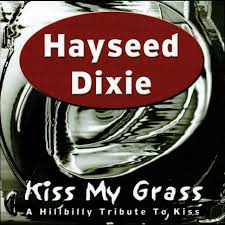
Après le Tribute à AC/DC, ils passent au Tribute à Kiss. Eh oui, ce sont des Américains, et le goût des Américains en matière de musique fait souvent l’objet de bien des moqueries. Quand on écoute «Calling Dr Love», on ne reconnaît pas forcément les clowns de Kiss, car banjo et mandoline mènent la danse. Le truc des Hayseed marche à tous les coups, quelque soit le navet choisi. Ils jouent avec une telle énergie qu’on en redemande. Ils vont même réussir à mettre de la pompe manouche dans «Let’s Put The X In Sex» et la Banjo man d’alors part en vrille. Il transforment aussi «Lick It Up» en rock gitan. On assiste à une belle étude de croisement avec le banjo de Délivrance et soudain, ça part. Banjo man devient fou. S’ensuit un «I Love It Loud» que John Wheeler chante à l’admirabilité des choses. Cet album est particulièrement amusant, car les Hayseed transforment les cuts de Kiss en belles bourrées auvergnates. C’est de bonne guerre.
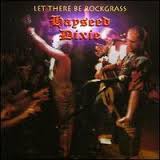
Leur fantastique reprise de «Ace Of Spades» se trouve sur l’album «Let There Be Rockgrass». Lemmy a dû jubiler en entendant ça. Banjo man joue à toute blinde. C’est le banjo du diable - The ace of spades ! The ace of spades ! - On y entend un effarant duel d’effarence entre le banjo et la mando. Ils sortent aussi une reprise de «Walk This Way» d’Aérosmith. Ils traitent le passage rap à la jew harp. Ils traquent le riff dans un coin et ils l’Appalachent sans pitié. Leur truc est sacrément bien ficelé. Autre reprise fumante, celle de «Centerfold» du J. Geils Band. Ce genre de groove leur va comme un gant. John Wheeler le bouffe tout cru, évidemment. L’autre grosse pièce de l’album est «Corn Liquor», emmené par une attaque de banjo démente. On sent la puissance du beat des Appalaches. Musicalement, le banjo reste aussi excitant qu’un bon drive de slap joué sur une stand-up.

Leur version des «Duelling Banjos» se trouve sur l’album «A Hot Piece of Grass». Pure magie. Quand ça part, ça part en vrille. Ils jouent ce classique imparable comme des démons. Tout est emmené à la vitesse de l’éclair. Attention, ce n’est pas tout. Ils sortent aussi une fantastique version du «Black Dog» de Led Zep. John Wheeler fait son Robert Plant superbement et le banjo illumine le vieux souvenir de Led Zep. Autre bonne surprise : la reprise du «War Pigs» de Black Sabbath. Ils passent Sab à la casserole bluegrass. Il y a chez les Hayseed une énergie autrement plus diabolique que celle d’Ozzy et de ses comparses. Banjo man plante au cœur de «War Pigs» un solo de banjo terrible. Ils proposent aussi une version insidieuse de «Whole Lotta Love». Au chant, John Wheeler est dessus, pas de problème. Quand on dispose d’une vraie voix, on peut taper dans ce genre de vieux coucou sans risque. On trouve aussi dans «Roses» une merveilleuse échappée de banjo exacerbée. Voilà encore un cut larger than life. Les amateurs de bluegrass se régaleront de «Blind Beggar Breakdown», entièrement cavalé au banjo ventre à terre et doté de tous les apanages de l’ardente vélocité.
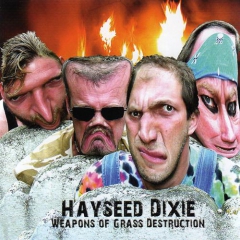
Ah il faut le voir pour le croire : une version du «Holiday In The Sun» des Pistols se niche sur l’album «Weapons Of Grass Destruction». Mais ils la ralentissent pour la rendre méconnaissable. Autre chef-d’œuvre iconoclaste : la reprise du «Strawberry Fields Forever» des Beatles. Décidément, ils ne reculent devant aucune expérience spirituelle. Ils prennent un tempo soutenu et ils utilisent des coups de banjo pour recréer les tons mauves de la vision psychédélique originelle. Leurs soudaines montées en température passent plutôt bien. En fait, ils adorent exploser les lieux communs du rock. Ils finissent d’allumer ce vieux coucou à coups de violon des Appalaches. Comme quoi, rien ne se perd, ni les choses, ni les âmes. L’autre gros coup de cet album est la reprise de «Down Down» des Status Quo. Ils renouent avec le boogie des seventies britanniques. Ils nagent dans l’eau glacée du temps comme des saumons d’Écosse. Et comme d’habitude, leur reprise se veut splendide d’énergie spécifique. Vu qu’ils tapaient dans les Beatles, ils se sentaient obligés de taper dans les Stones. Alors voilà qu’ils reprennent «Paint It Black». Oh, ils sont dessus, comme des sangsues sur les jambes du Capitaine Wyatt. Mais on se régalera surtout de «Hangover Breakdown», joué à la culbute de banjo et pulsé au crash-boum du double carburateur.

Histoire de dérouter encore plus les curieux, ils firent paraître en 2008 un album SANS reprises intitulé «No Covers». Curieusement, quand ils ne jouent plus de reprises, ça marche beaucoup moins bien. John Wheeler et ses amis composent des petits boogies insignifiants et tout rentre dans l’ordre. Avec «Born To Die In France», Wheeler raconte l’histoire de grand grand-daddy from the First World War. Et lorsqu’ils attaquent «You’ve Got Me All Wrong Baby», ils se prennent carrément pour un gang de power rock. Le pire c’est que ça marche. À force d’écouter les poids lourds du rock FM, ils se prennent eux-mêmes pour des poids lourds. Phénomène purement américain. Ils s’amusent comme des gosses, ne l’oublions jamais.

La belle version de «Bohemian Rhapsody» qu’ils jouent en concert se trouve sur l’album «Killer Grass» paru en 2010. John Wheeler lui shoote un énorme boost de rift dans le cul. Ils reviennent à Black Sabbath avec une fastueuse reprise de «Sabbath Bloody Sabbath» embarquée au banjo. Ça vaut tout l’or du monde. On y retrouve l’esprit enlevé, ce goût pour les cavalcades infernales au pied des Rocheuses, au temps où les amortisseurs n’existaient pas encore. Ils enchaînent avec une reprise de «Won’t Get Fooled Again». Le banjo imite l’intro de synthé et ça part sur un beat de basse acou. John Wheeler fait un véritable festival, il bouffe Daltrey tout cru. Comme le duc de Guise, il mène le combat à sa guise. Quand on entend le solo de banjo, on réalise soudain que ces gens-là ne sont pas du genre à s’embarrasser avec les détails. Mais la bonne surprise se trouve sur le deuxième disque de l’album qui est un DVD. On les voit faire le cons dans quelques clips rigolos, et le clou du spectacle, c’est la leçon dans banjo filmée dans le jardin. On y voit les deux frères Hymas jouer sur un banjo : l’un gratte les cordes et l’autre les pince. Puis, Jake Byers vient donner un cours de basse acou. On le voit jouer ses mesures de pompe à sec et c’est assez fascinant. Ce mec joue admirablement bien. John Wheeler vient ensuite pincer les cordes que gratte Byers. Et ils finissent à quatre, offrant le spectacle d’un hallucinant groupe de surdoués. On voit aussi Byers filmé dans la forêt pour un Tutorial : comment enterrer un body dans la forêt. On se croirait chez John Waters. Puis on revient à la magie pure avec un autre Tutorial : comment jouer «Duelling Banjos» avec un joueur de bongo africain. On se prosterne, comme devant l’apparition du prophète.
Signé : Cazengler, AC KC
Hayseed Dixie. Au 106, Rouen. 26 février 2015
Hayseed Dixie. A Hillbilly Tribute To AC/DC. Dualtone Records 2001
Hayseed Dixie. Kiss My Grass. A Hillbilly Tribute To Kiss.
Hayseed Dixie. Let There Be Rockgrass. Cooking Vinyl 2004
Hayseed Dixie. A Hot Piece Of Grass. Cooking Vinyl 2005
Hayseed Dixie. Weapons Of Grass Destruction. Cooking Vinyl 2007
Hayseed Dixie. No Covers. Cooking Vinyl 2008
Hayseed Dixie. Killer Grass. Cooking Vinyl 2010
Hayseed Dixie. Hair Down To My Grass. Hayseed Dixie Records 2015
De gauche à droite sur l’illustration : Joe Hymas, John Wheeler, Jake Byers et Johnny Butten.
BLUE TEARS TRIO
MILLION TEARS
SHADOW MY BABY / LOVE ME / MILLION TEARS / THE WOMAN I LOVE / ROCKERS GANG / YOU TWO-TIMED ME ONE TIME TOO OFTEN / RIGHT STRING BABY / ONE HAND LOOSE.
Didier : guitar & vocals / Aimé : upright bass & vocal / Franck : drum & vocals.
Enregistré : Batolune / Honfleur
Contact : 06 61 54 55 25 / bluetearstrio@hotmail.fr

Shadow my baby, du rudimentaire authentique, la batterie qui bat, la basse qui slappe et la guitare qui fait le ménage, juste le telmps de jeter la vaisselle à terre, on n'aura même pas l'occasion de passer le balai que c'est déjà fini. Belle dispute vocale ponctuée d'éclats de guitare. Interventions musclées comme l'on dit.
Love me, z'ont un cantaor qui mène la danse, du coup tous les instrus se mettent à valser, mais rien à dire c'est le chanteur qui fait tout le boulot. Pourtant la rythmique pédale dur. C'est un décor, le lead vocal vous raconte l'action, rien que par ses inflexions. Du grand art. L'amour c'est toujours urgent, vous en mordrez les rideaux.
Millions Tears, des millions de larmes, un véritable drame, l'on est dans la ballade pré-sixtie, tempo chevauchée western, arrière-fond country. Le cowboy solitaire n'a pas laissé son énergie au paddock, l'a tout perdu, mais il s'en remettra. Nous aussi, d'ailleurs on le remet tout de suite rien que pour la guitare qui pétille comme un feu de bois. Attention, les étincelles volent et ça brûle. Ce que l'on appelle verser de chaudes ( mais alors very hot ) larmes . En tout cas, nous on ne pleure pas, on ne se sent au mieux. La vie nous sourit. Pas grise du tout.
The woman I love, tout heureux, Le blues Tear fait sonner la guitare pour claironner la nouvelle aux alentours, et les copains viennent lui donner un coup de voix pour que le monde entier soit au courant. L'est tout fou, et communique son ardeur. A faire fondre la banquise.
Rockers gang, tout de suite on roule les mécaniques, l'ambiance se tend, le rockabilly descend des collines et vient squatter l'asphalte. Un peu plus de lyrisme, romantisme appuyé, un solo baston, une contrebasse à répétition et le drummin à percussion. L'on a rincé une pincée de kilomètres entre le Studio Sun et nous, mais pas question de courir trop loin, l'on tourne autour de Memphis en prenant soin de ne pas prendre la tangente. Un original.
You two-time me one time too often, retour au classicisme. un vieux fond de tiroir - autant dire un antique reste d'alambic – du tord-boyaux de Johnny Carrol, le trio lui a enlevé ce goût d'écorce sauvage prononcé, idem pour le piano, mais ils ont mis la pédale forte sur le chant. Un petit bijou. Rubis sur ongle.
Right string baby, ne pouvait pas ne pas être cité, le matou aux pompes de daim bleu celui qui marcha si longtemps dans l'ombre de Johnny Cash quand ses miaulements sont passés de mode. Plus pur que lui dans la légende rockabilly, vous ne trouverez pas. Le Trio s'en donne à coeur joie. Ne vous laissez embobiner par les choeurs, soyez toute ouïe sur les parties instrumentales qui sont une véritable fête de l'esprit.
One hand loose, l'on finit chez un outlaw. Un gars de la tribu qui n'en fit qu'à sa tête. Pas question de lui voler dans les plumes. Par contre les Larmes Bleues vous rentrent dedans sans ménagement. Swinguent comme au temps de la prohibition, quand l'alcool de contrebande coulait à flot. Estomac fatigués s'abstenir.

Un disque pour connaisseurs. Le néophyte n'y verra que du feu. Prendra son pied nikelé au tungstène mais pas davantage. Mais ceux qui se réveillent en pleine nuit pour réécouter la partie de piano sue la two-time me one time too often carrollingien ont de quoi méditer. Sûr que l'on est en face de véritables artistes. Pas des rigolos qui font de la reprise comme l'on joue à la roulette russe. En étant sûr d'y laisser sa cervelle éclatée contre le mur dès la troisième mesure. Ici l'on est dans l'infinitésimal. S'agit pas de recopier. Mission impossible. Mais de s'en approcher au mieux. Tout est une question d'options, être au plus près, tout en étant assez pertinent pour montrer que l'on assume ses propres directions. Pour le Blue Tears Trio, la démarche fut assez simple, taper dans les meilleurs crus, en exprimer toutes les subtilités, mais en opérant une refonte de fond. Font main basse sur la cargaison homologuée, mais la repeigne à leur effigie en bleu as de pique. Respect et fidélité d'une main, réappropriation triumvirique de l'autre. Un vingt-cinq centimètres qui n'aligne pas les morceaux à saute-moutons. Unité de son et de jeu. Même les deux compos, malgré leur intrinsèque écriture ne jurent pas avec l'ensemble. Du rockabilly comme l'on n'en fait plus. Une référence pour le futur de cette musique. Beau Blue Tears groupé.
Damie Chad.
LES GRANDES PROFONDEURS
LANGSTON HUGHES
( Pierre Seghers / 1947 )
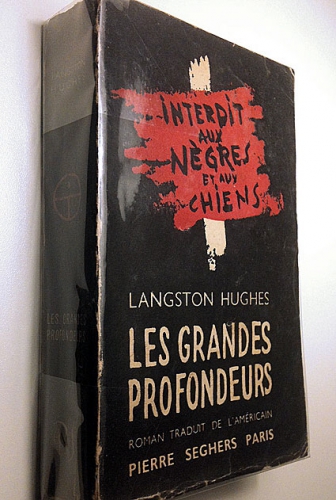
Le bouquin commence mal. Pour un écrivain. Le jeune Langston Hughes se débarrasse de ses livres en les jetant à la mer. Vient d’avoir vingt et un an, n’y voyez ni tardive révolte d’adolescence, ni crise intellectuelle créatrice, ce ne sont pas de simples volumes qu’il offre aux profondeurs de l’eau amère, mais tout un pan de sa vie dont symboliquement il se sépare. L’est désormais en partance sur la grosse mer ( The Big Sea est le titre américain de cette autobiographie ) et il se prépare à affronter les plus vives tempêtes de son existence qui débute vraiment. Quitte définitivement les longs marécages des années de faux apprentissage et de véritable soumission.
Le souvenir de Langston Hughes s’estompe dans nos mémoires, difficile de trouver un seul de ses bouquins dans les rayons de nos librairies. Connut pourtant son heure de gloire de par chez nous d’après guerre et jusqu’à sa mort en 1967. Rappelons que son premier recueils de poèmes The Weary Blues, paru en 1927 marqua la naissance de la fierté noire aux Etats Unis. Pour une fois un écrivain nègre s’écartait du principe de la sainte imitation des patterns dominants, refusait de singer les modèles de la littérature blanche et inscrivait son écriture dans l’expression la plus originelle du cœur palpitant et populaire de l’âme noire, le blues. Longtemps celui-ci fut comme un double obscur du Mississippi, un jumeau d’ombre diabolique, coulait en sourdine, rampait comme en cachette dans l’esprit dévasté d’un peuple anéanti. C’est avec Langston Hughes qu’il brisa ses digues et commença à inonder et fertiliser le reste du monde.
Né en 1902. Un petit noir comme les autres. Pas tout à fait. La peau bronzée mais pas d’ébène. Mais tout se passe dans la tête. Dans sa famille l’on se transmet le souvenir d’un ancêtre qui fut compagnon de John Brown. Le premier nègre qui prit les armes contre les maîtres esclavagistes en 1859, fut pendu mais son exemple survécut malgré cette mort que les maîtres blancs voulurent ignominieuse. Bon sang ne saurait mentir. En double héritage Langston Hughes reçut aussi par sa grand-mère une ascendance indienne. Possède même deux arrière grand-pères blancs, dont un juif, mais aux Etats-Unis une seule goutte de sang noir suffit à vous classer dans la catégorie des moricauds (terme choisi par le traducteur pour exprimer la connotation insultante du mot nigger ).
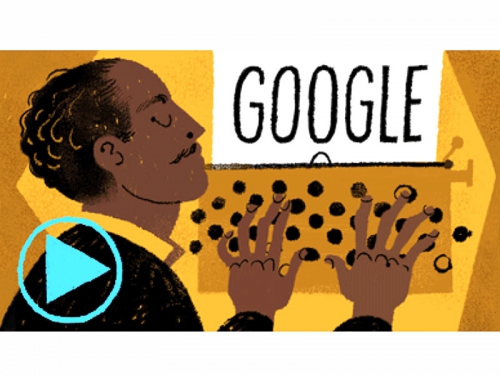
Famille pauvre qui partagera de Cleveland à Chicago le lot de misère commun à tous. Recherche incessante de travaux mieux rémunérés, de loyers moins chers. La vie est dure et sans pitié. Instabilités familiales, enfant confié à des tantes de la parentèle proche ou éloignée. Langston Hughes connaîtra pourtant une enfance démunie de tout superflu mais non misérable. Sa mère qui possède assez d’instruction fréquente l’église et les bibliothèques. Le petit Langston fait preuve de flair, perdra devant les simagrées exaltées des assemblées évangéliques la foi qu’il n’aura jamais vraiment eue. N’a pas dix ans qu’il s’est déjà débarrassé d’une partie des chaînes de l’esclavage mental dans lesquelles la population noire s’ést engluée.
Bon élève depuis tout petit. Aime lire. Nous sommes en des temps d’apartheid, les blancs et les noirs ne se mélangent pas, ni dans les églises, ni dans les bars, ni dans les salles de spectacle, ni dans les écoles, ni partout ailleurs. Peut y avoir quelques exceptions, quelques blancs dans un collège noir ou vice-versa, mais de fait elles ne font que confirmer les lois d’airain de l’exploitation des noirs. Mais la communauté n’est pas formée que de misérables. Possède ses intellectuels qui oeuvrent à une amélioration de la condition de leur peuple. Fondent des journaux, publient des ouvrages historiques, forment des instituteurs et des professeurs, luttent à leur manière en essayant d’élever le niveau culturel de la population, sont des progressistes qui ne croient pas à une réforme radicale de la société, mènent un combat résigné. Misent sur le long terme… Les sans-grades ont les yeux fixés sur l’actualité la plus proche, sont intéressés par… la Russie, la prise du pouvoir par les communistes et Lénine leur paraît une expérience prometteuse… Mais en attendant des jours meilleurs, le jeune Langston recherche les petits boulots pour aider sa mère à préparer des repas un plus consistants…
Le père s’est enfui, depuis longtemps. Au Mexique. Refuse la misère. En a rapporté la cause sur la bêtise des nègres. N’est pas un Oncle Tom, l’est pire, a assimilé l’idéologie raciste, droitière et réactionnaire des maîtres blancs. Les pauvres sont des fainéants ou des incapables. Tant pis pour eux. Lui il gagne de l’argent, a une maison, un ranch et fait des affaires. Hait autant les mexicains pauvres que les nègres sans argent. Aimerait que son fils acquière les diplômes d’ingénieur qui lui permettraient de faire prospérer sa ferme, est prêt pour cela à lui payer l’Université. Cause toujours, et perdue. Le courant ne passe pas entre le père et le fils qu‘il a fait venir au Mexique. Langston a la fibre littéraire, Crisis une revue noire commence à publier ses premiers poèmes… Donne des cours d’anglais dans des collèges mexicains pour payer ses inscriptions. N’a qu’une idée en tête : l’université Columbia et… Harlem, la plus grande ville noire du monde. Au plus près de son peuple.
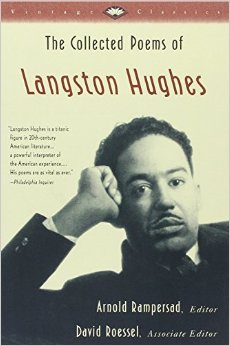
Année charnière et d’initiation. Heureux à Harlem et mal à l’aise à Columbia. Partagé entre son désir d’acquisitions culturelles et son dépit du monde intellectuel qu’il aperçoit. Redoute de se confronter à cette intelligentzia noire, très éloignée des préoccupations des plus misérable, qui lui semble bien moutonnière même s’il ne se sentait pas capable de s’opposer et de discuter avec ses plus dignes représentants, se juge trop jeune et trop inexpérimenté. Finira par s’embarquer sur un vapeur, direction l’Afrique. Berceau de la race et cercueil des illusions perdues. Nouveau Rimbaud à peine éclos à la recherche de la vraie vie. Traversée de l’océan Atlantique picaresque, le travail n’est guère pénible et la camaraderie de bonne compagnie. De l’Afrique il ne connaîtra que les ports, assez pour comprendre la spoliation du continent par les compagnies américaines, anglaises et françaises, les populations réduites à une misère encore plus pathétique que ses frères d’Amérique.

Finit par se retrouver en France. A Paris. Sans argent, en un pays en crise. Finira par travailler dans une boîte de nuit à Montmartre. Rejoint la cohorte noire venue de Broadway, cuisiniers, portiers, danseurs, chanteurs et musiciens. Toute cette génération qui précéda de peu la venue de Joséphine Baker, des noms aujourd’hui connus des seuls amateurs : Florence Embry, Bricktop Ada Smith qui furent durant quelques courtes années les reines du Paris de la nuit. Artistes, noceurs, aristocrates déclinants viennent danser le charleston, mais tard dans la nuit et jusqu’au petit matin Cricket Smith et sa trompette, Louis Jones et son violon, Palmer Jones au piano, Franck Withers et sa clarinette, et Buddy Gilmore à la grosse caisse tapent le bœuf, le jazz et le blues. La musique nègre s’installe à Paris et Langston Hughes renoue avec le blues mémorial.
Le blues, il connaît, le transcrit en poèmes et durant toute sa saga européenne il continue à envoyer des textes à Crisis qui les publie. Des amateurs viendront même lui rendre visite en notre capitale. Lorsqu’il revient aux USA, un singe sur l’épaule et soixante quinze cents en poche. La donne a changé.
FUREUR NOIRE

En apparence rien de bien neuf à Harlem. Travaille dur dans une blanchisserie. Mais le noir est devenu à la mode. Tout a commencé avec la comédie musicale Harlem Shuffle en 1921, et en quelques mois la culture noire devient furieusement branchée. Débute alors ce mouvement que l’on nommera la Renaissance Noire ( ou Renaissance de Harlem ) centrée autour d’Harlem. Cela durera de 1921 à 1931, la célébrité de Langston Hughes est indissociable de cette vague, de cette vogue. N’en fut jamais dupe. N’y a jamais cru, même si les circonstances lui furent extrêmement bénéfiques.
Ce sont évidemment les blancs qui firent monter la sauce. Pas les rednecks de base, non ! La frange cultivée de la haute-bourgeoisie fortunée. Du jour au lendemain tout ce qui était d’origine noire devint sacré. Pas de semaine sans réception mondaine ! Harlem bruisse de fêtes perpétuelles. Chaque soir des milliers de blancs s’en viennent squatter les boîtes, les bars, les restaurants, les salles de spectacle, bouffent de la nourriture noire, écoutent de la musique noire, s’attroupent autour du moindre noir qui passe comme les français sur le passage de la girafe en 1826. Dans les milieux plus huppés l’on donne des réceptions avec champagne et lecture de poèmes. Hughes est souvent invité. Des revues même blanches lui demandent des textes. Publie son premier recueil le fameux Weary Blues.
Fraîchement salué dans le milieu littéraire noir. Les livres suivants encore plus. On lui reproche de montrer les noirs tels qu’ils sont, avec leur langage maladroit, leurs qualités et leurs défauts. Faut profiter de l’occasion pour faire avancer la cause noire dans les consciences : ne faut présenter que des spécimen de nègres parfaits, polis, gentils, respectueux… Le nègre à courbettes qui s’adapte en tous points aux modèles idylliques des représentations prisonnières des visions colonisatrices et esclavagistes du nègre qu’il n’est pas besoin de tuer pour qu’il soit bon. Hughes ressent toutes les contradictions inhérentes à cette mode nègre. Ne possède pas encore tous les concepts nécessaires à sa transcription, mais dans sa tête les idées s’entrechoquent.
UNE BIENFAITRICE
Profite des opportunités pour s’inscrire à l’Université Lincoln et acquérir sa licence. Voyage aussi dans le Sud des Etats Unis, entend Bessie Smith et assiste aux secours portés aux populations qui ont vu leurs demeures emportées par la crue de 1927 du Mississippi, témoigne de la différence des secours portés aux blancs et aux noirs. Faut lire ces pages de la légende noire rapportée une fois n’est pas coutume par un témoin privilégié, et noir.
Une riche héritière blanche le reçoit chez elle ( aucune aventure sentimentale ) et lui verse une pension afin qu’il poursuive son œuvre avec la tranquillité d’esprit nécessaire. Tout baigne dans l’huile. Rance. Ne suffit pas d’être gentil pour changer le monde. La charité philanthropique ne résout que quelques cas individuels. La mauvaise conscience des blancs évolués possède ses propres limites. Ses nouveaux écrits ne plaisent pas à sa bienfaitrice. Met trop en évidence cette notion de classes ( possédantes et exploitées ) beaucoup plus pertinente que le combat pour l’égalité raciale qui n’est qu’une coquille vide si elle n’est pas complétée par la mise en pratique de l’égalité économique. La biographie se termine là : Langston Hughes coupe les ponts, devient un individu libre. A conquis son indépendance. Les années d’apprentissage sont finies, pour lui la vie peut commencer.
POESIE BLUES
Le livre est d’une richesse prodigieuse, ne s’attarde guère, cite des dizaines de noms qui doivent évoquer de façon plus ou moins précise des personnages plus ou moins célèbres pour un lecteur américain moyen. Pour nous européens d’outre-Atlantique n’y a qu’à souhaiter une improbable réédition avec notes à l’appui dans les années futures…
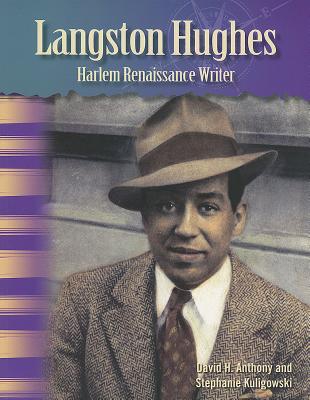
Langston Hughes nous raconte sa vie, mais parle aussi de sa poésie. Nous dit qu’il ne peut écrire de poèmes dans les périodes fastes et heureuses de son existence. Faut qu’il soit mal, saisi d’un malaise existentiel pour que l’alchimie poétique ait lieu. Jamais la poésie américaine ne sera aussi proche du blues que dans son œuvre. Un livre indispensable pour toux ceux qui aiment le blues. Et son damné bâtard de rock and roll.
Damie Chad.
P. S. : pour ceux qui veulent en savoir plus sur The Weary Blues : voir KR’TNT ! 21 du 07 / 10 / 2010. L’essentiel de l’œuvre poétique de Langston Hughes est accessible sur Google Books. En version originale. Malheur à ceux qui ne lisent pas la langue de Walt Whitman !
HISTOIRES DE BLANCS
LANGSTON HUGHES
( Traduction Hélène Bokanowdki )
( Les Editions de Minuit / 1946 )
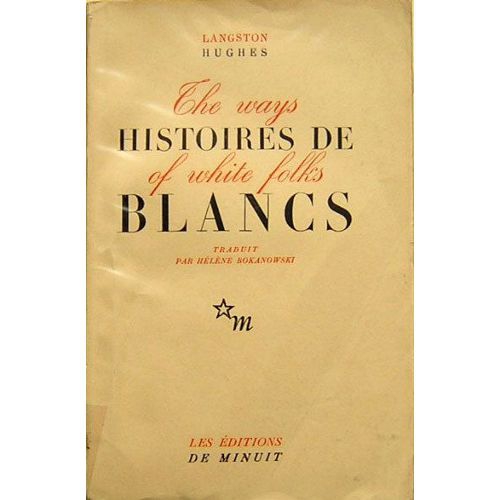
Quatorze nouvelles rouge sang. Le premier livre en prose de Langston Hughes. Indispensables pour tout amateur de blues music. D’ailleurs l’une d’entre elles s’intitule Le Blues que je joue. L’on pourrait trouver étonnant qu’un auteur noir consacre un de ses premiers livres à des Histoires de Blancs, comme s’il n’avait rien à raconter sur son propre peuple. Mais l’intitulé est en trompe l’œil - au beurre noir - Hughes parle bien des Blancs, mais dans leurs rapports avec les noirs. N’emploie pas la grosse caisse de la condamnation de l’esclavage, préfère les notes maintenues à la B. B. King qui s’insinuent en votre peau comme des lames de poignards ultra-fines qui traversent vos organes vitaux sans que vous vous en aperceviez.
Peuple blanc d’un côté et peuple noir de l’autre. Séparés par les eaux tumultueuses d’un Mississippi de bêtises et d’ignorances. Sûr, il y a les grosses brutes stupides qui ne rêvent que de lynchages - le livre se termine par un de ceux-ci - mais ce n’est pas le plus important, contre ceux-là il n’y a rien à faire, ils sont l’amère réalité d’une vie en demi-teintes dont il ne faut jamais s’écarter sous peine de cruelles punitions. L’analyse de Langston Hughes est beaucoup plus aigüe que ce théâtre d‘ombres claires et obscures, recherche et expose la racine du mal dans ses contradictions les plus intimes. Ce ne sont pas les blancs et les noirs, mœurs et coutumes dissociées à laquelle il se livre, mais à la mise à nu des dessous civilisationnels de deux manières d’appréhender la vie. Les noirs vivent leur vie, en toute simplicité, sans le besoin de filtres moraux ou intellectuels, proche de la nature animale et festive de l’être humain à qui la chair fut donnée en premier. Les blancs ont un rapport morbide avec leur existence, ne la saisissent jamais directement à bras-le-corps, ont besoin d’outils conceptuels pour se situer dans le monde et vis-à-vis de leurs semblables. La plupart se contentent de préjugés, les noirs sont de grands enfants naïfs qui ont de temps en temps besoin de corrections exemplaires pour ne pas commettre l’irréparable. Ce sévère paternalisme n’est que la fausse façade d’une réalité économique les plus abjectes : les noirs sont les victimes désignées et reconnaissables par la couleur de leur peau d’une exploitation économique sans borne. Au dix-neuvième siècle, les patrons et les intellectuels européens parlaient de la loi d’airain du capitalisme contre laquelle il était impossible de lutter affirmaient-ils et dont ils se disaient autant victimes que les populations ouvrières soumises à des conditions de travail et de misère intolérables. A les écouter fallait les plaindre d’être les profiteurs du système ! Ah ! Quel Homère moderne chantera la douleur d’être riche et puissant !

Evidemment quand vous y pensez un peu trop, l’injustice sociale dont vous profitez peut causer mauvaise conscience. Surtout si vous revendiquez de l’amour du Christ pour les humbles et les faibles. Pour se défendre de cet œil de Caïn cérébral, il est nécessaire de s’imposer des barrières mentales strictes. Qui malheureusement ne correspondent pas à la réalité. Il est des blancs qui couchent avec leurs domestiques, ce qui est dommageable comme par exemple dans Père et Fils. Le contraire éminemment scandaleux et très rare, je vous rassure, existe aussi : une femme blanche qui fornique avec un nègre est une calamité qui remet en cause les fondements de la société d’apartheid… Dans les deux cas le problème est le même : naissance d’êtres hybrides que la société blanche rejette dans le camp des nègres. Il ne faut point se laisser apitoyer par ses affects. D’autant plus que ces mulâtres incertains, ces métis méprisables, de par leurs aspects physiques peuvent s’introduire dans la bonne société blanche et se livrer à des manipulations honteuses. Méfiez-vous des emballages, les peaux les plus blanches peuvent être des outres de sang noirs. Plusieurs nouvelles d’une cruauté sans faille traitent ces problèmes de frontières humaines incertaines. Rajeunissement par la Joie se double par-dessus le marché d’une critique au vitriol de la recherche d’une plus grande spiritualité de la haute bourgeoisie blanche.
L’on est toujours trahi par les siens. Les noirs apeurés qui refusent de se révolter par exemple. Mais qu’attendre d’un nègre - comme d’un chien - hormis soumission et obéissance. Ces cas ne sont pas graves, s’inscrivent dans l’ordre naturel de la supériorité de la race blanche. C’est la Bible qui le dit. Vous n’allez pas remettre dieu en question tout de même. Non, il y a des blancs qui se laissent stupidement apitoyer et qui malgré leur bon cœur courent au-devant de graves désagréments. Vous n’empêcherez pas l’eau d’un fleuve de rejoindre la pente fatale de son écoulement. Adoptez le bébé de vos fidèles domestiques noirs qui ont la mauvaise idée de mourir jeunes et vous verrez les problèmes auxquels vous serez confrontés. C’est comme ces parisiens qui s’entichent d’un husky dans leur studio. Au bout d’un moment l’animal dépérit. Un négrillon, rien de plus ravissant, mais quoi qu’en faire lorsqu’il arrive à l’adolescence, z’êtes obligés de l’inscrire dans une école noire. Bientôt il vous reprochera de l’avoir aimé comme une peluche que l’on a honte de montrer aux amis. Retournera à sa communauté originelle, sexe, danse et musique…

Mais il n’y a pas que les sentiments chrétiens qui vous poussent à de mauvaises bonnes actions. L’art aussi est une religion de la beauté. Et certains noirs touchés par une grâce apollinienne sont de véritables artistes. Sont capables de jouer du Rachmaninoff bien mieux que des milliers d’adolescents blancs abreuvés de leçons de pianos depuis leurs plus tendre enfance. Ne faut pas laisser pourrir cette fleur sur le fumier où elle a miraculeusement éclos. Faut la transplanter à Paris, lui payer professeurs de renom et lui offrir une pension mensuelle pour qu’elle accède enfin au nirvana de l’idéal blanc éthéré... mais mauvais sang ne saurait mentir, la négresse est davantage inspirée par le blues et la concupiscence charnelle de son amant. Pas besoin d’avoir lu les œuvres complètes de Freud pour comprendre pourquoi ces mécènes blancs au portefeuille charitable ne franchissent jamais le Rubicon du désir qui les pousse vers ces corps noirs d’où émane une splendeur charnelle bien trop coruscante pour leurs velléités vitales corsetées par des siècles de christianisme pudibond. Totem de l’art et tabou de la chair. Les blancs sont des êtres auto-limités, bien moins libres de leurs actes que les noirs enchaînés par les règles coercitives de la ségrégation.

Langston Hughes est le premier pervertisseur littéraire de l’écriture noire. The backdoor man, celui qui est entré par la porte de derrière pour vous faire un petit dans le dos. Ses nouvelles n’ont rien à envier à un Villiers de l’Isle Adam, à un Jean Lorrain, à un un Barbey d’Aurevilly. Ne dit pas, suggère. Ironie froide et cruauté glaciale, les deux seins d’une poitrine généreuse. Jamais un mot de trop, jamais un cri d’indignation cauteleuse, ne joue pas la comédie des bons sentiments, n’essaie pas de nous apitoyer, ne nous prend pas par la main, nous tend un miroir, ce n’est pas qu’il nous assimilerait aux blancs américains, nous rappelle que les conduites humaines, si généreuses soient-elles, reposent souvent sur des réalités dont-elles ne sont que les vaniteux et inconsistants paravents qui nous permettent de nous regarder dans une glace chaque matin. Met à nu cette bonne conscience derrière laquelle nous cachons nos lâchetés. Suffit de faire attention aux chaînes de précarité et d’indigences sociales que nos élites politiques sont en train de nous forger - pour notre plus grand bien économique et notre si précieuse sécurité - pour comprendre que ces Histoires de Blancs sont d’une actualité brûlante. Si nous avons la peau blanche, nous risquons, à très courts terme et plus vite que nous le croyons, de devenir marron… et marris cocus de nos libertés.
Damie Chad. ( été 2015 )
23:22 | Lien permanent | Commentaires (0)
15/12/2015
KR'TNT ! ¤ 260 : STIFF LITTLE FINGERS / JAKE CALYPSO AND HIS RED HOT / GUENDALINA FLAMINI / MARY BEACH / CLAUDE PELIEU / NEW YORK 1978
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 260
A ROCK LIT PRODUCTION
16 / 12 / 2015
|
STIFF LITTLE FINGERS JAKE CALYPSO & HIS RED HOT GUENDALINA FLAMINI CLAUDE PELIEU / MARY BEACH 1978, NEW YORK IN COLOR |
|
ADIEU A THIERRY CREDARO C'était un rocker et c'était un homme. Un magicien de la guitare, attentionné aux autres et au monde. L'est désormais sur l'autre rive, en un autre rêve. Son âme continue de vivre dans des ailes de corbeau... |
|
AMIS ROCKERS ! Attention, le jeudi 24 au soir sans doute aurez-vous autre chose à faire qu'à reluquer la 261 ° livraison de KR'TNT, comme nous sommes gentils nous la mettrons sur le site au plus tard le samedi 19 décembre. De même le jeudi 31 décembre nous ne doutons pas que vos mauvaises habitudes de rockers assoiffés vous dispenseront de jeter ne serait-ce qu'un rapide regard sur la 262° livraison de KR'TNT. Comme nous sommes trop sympas nous la posterons au plus tard le samedi 02 janvier. Pour la 263° comme d'habitude dans la nuit de mercredi à jeudi... KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME ! |
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 05 – 12 – 16
STIFF LITTLE FINGERS
LE STUFF DES STIFF
Dans l’histoire du rock anglais, il n’existe pas de groupes plus radicaux que Stiff Little Fingers et Third World War. En 1970 (TWW), puis en 1979 (SLF), ces deux groupes firent parler la poudre, comme on dit dans les westerns de série B. Ces gens-là évoquaient la violence qui régnait alors dans les rues d’Angleterre et d’Irlande du Nord et mettaient au service de leurs discours respectifs le son adéquat. Chopper guitar et appel à la guérilla urbaine pour Third World War, fournaise cataclysmique pour Stiff Little Fingers. Lorsque John Peel commença à diffuser «Alternative Ulster» dans son radio show, on eut à cette époque le sentiment très net de n’avoir jamais rien entendu d’aussi violent, ni d’aussi politiquement enragé, même chez le MC5 qui appelait aussi à l’insurrection. Simplement, Jake Burns et ses trois amis allaient beaucoup plus loin dans la violence de ton - What we need is an alternative Ulster ! - Jamais un groupe de rock n’avait tapé aussi fort du poing sur la table (Même s’ils faisaient seulement référence au fanzine Alternative Ulster qui les soutenait). On se demande aussi pourquoi les services secrets britanniques ne sont pas intervenus pour les faire taire. Les Stiff sonnaient comme des héros révolutionnaires et ils auraient très bien pu entraîner un peuple déjà engagé dans une lutte sans merci. Jake Burns et ses trois amis disposaient de l’un des pouvoirs les plus redoutables qui soient : le génie pyromaniaque. Ils pouvaient faire brûler Londres et c’était autre chose que le facétieux «London’s Burning» des Clash. Ils carbonisaient les esprits aussi radicalement que le MC5 de «Motor City’s Burning».
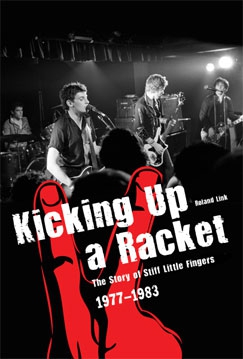
Roland Link a consacré un remarquable ouvrage au groupe : «Kicking Up A Racket. The Story Of Stiff Little Fingers 1977-1983». Si on s’intéresse à ce groupe exceptionnel, il est important de consacrer un peu de temps à ce livre, car il nous débarrasse enfin de toutes les conneries qui ont pu être publiées dans la presse sur les Stiff. Roland Link plante bien le décor : il appelle ça «the troubles», la guerre civile qui avait lieu en Irlande du Nord au moment où Jake Burns, Ali, Henry et Brian Faloon montaient leur groupe, justement pour échapper à cet enfer quotidien. Link rappelle qu’à l’époque, on risquait sa peau quand on rentrait chez soi tard le soir à Belfast et qu’on tombait sur une patrouille anglaise planquée dans un recoin - Oi you. Come over here ! - Il raconte pas mal d’anecdotes qui font froid dans le dos. À part le danger de mort permanent qui régnait dans cette ville, il ne s’y passait rien et les jeunes crevaient d’ennui.
Lors de leur premier séjour à Londres, les Stiff étaient tellement accoutumés aux fouilles à corps qu’ils levaient encore les bras en l’air lorsqu’ils entraient dans des magasins, croyant qu’on allait les fouiller. La paix régnait à Londres, ils n’en revenaient pas - quoi, on peut sortir le soir pour aller boire un verre sans risquer sa peau ? Et le soir, quand ils montaient sur scène, Ali ne supportait pas de voir les punks et les skins s’affronter. Ça le foutait en rogne. Il les traitait de spoiled bastards et ajoutait : «You assholes why are you causing all this trouble ? There’s nothing to cause trouble about !» Ali leur reprochait de se battre sans aucune raison valable. Pour lui, la vraie violence, c’était de se retrouver coursé par les gens des brigades spéciales et des milices protestantes, des brutes qui haïssaient les Irlandais exactement de la même façon que les paras français haïssaient les Algériens, au point de les abattre comme des chiens. Roland Link rappelle que les army patrols et les RUC patrols tabassaient systématiquement tous les gens qu’ils chopaient dans la rue. Ces brutes s’amusaient aussi à fracasser les portes des maisons à quatre heures du matin, puis ils insultaient les gens et réduisaient tout leur mobilier en miettes. «Twenty soldiers and twenty RUC men entered screaming, guns cocked and pointing, pulling your father down the stairs by his head - get down there you Irish bastard !» Rien ne pouvait protéger les Irlandais de cette haine. Link compare les occupants britanniques à des Nazis. Les Irlandais se terraient et vivaient dans la peur. Quand dans un concert des Stiff, le public exaspérait Jake et qu’il voyait des bagarres éclater entre les Teds et les punks, il s’arrêtait de jouer pour présenter «Johnny Was» : «C’est une chanson à propos d’un type qui a été abattu parce qu’il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ça arrive tout le temps à Belfast. J’espère que ça arrivera un jour à certains d’entre vous !»

Jake Burns reçoit son premier choc à l’âge de treize ans : le concert d’adieu de Taste à la télé. Au tapis. À Noël, ses parents lui offrent «On The Boards», second album de Taste. Puis son père lui paye une guitare électrique, mais ni lui ni Jake ne savaient qu’il fallait aussi un ampli. Jake mit un an et demi pour apprendre à accorder sa guitare. Ce fut le commencement d’un rêve commun à des milliers de kids anglais et irlandais. Puis le Jake ado allait craquer tout son pognon en disques. Il ne buvait pas, il ne fumait pas. Il ne vivait que pour les vinyles. Puis il monta son groupe et commença par jouer des reprises de Clash. Le premier cut qu’il composa, ce fut «Suspect Device». Jake s’inspirait des troubles, même s’il s’en défendait. Il ne voulait surtout pas qu’on l’accuse d’en faire un fonds de commerce. Il voulait s’inspirer des faits réels de la vie de tous les jours. Mais son environnement était tout de même un peu spécial. Ce n’était pas baby drive my car, mais haut les mains, écarte les jambes. Il devait faire des chansons avec ce qu’il voyait quotidiennement, les fouilles à l’entrée des magasins, les barrages routiers et les rues désertes le soir à cause du couvre-feu. Ses textes reflétaient bien la suffocation et la paranoïa dont il souffrait, comme la plupart des habitants de Belfast. Pour expliquer l’essence du garage, on évoque la frustration dont souffrent les jeunes dans leurs quartiers de banlieue. Pour expliquer l’essence du punk-rock, on évoque un violent rejet de la mère Thatcher et du prog-rock britannique. Le premier album de Stiff Little Fingers échappe à tout ça. Il sort tout droit d’un contexte hors normes dont nous n’avions même pas idée : une guerre civile à deux heures de Paris. C’est probablement le seul vrai disque punk de cette époque. Les Stiff ne faisaient pas semblant d’être en colère. Et ils n’avaient pas besoin de se déguiser pour être des punk-rockers. Leurs conditions de vie les lavaient de tout soupçon. Et petite cerise sur le gâteau, ils étaient extraordinairement doués.
Jake rappelle qu’il se disait influencé musicalement par les Who et Montrose. C’est John Peel qui mit le feu aux poudres à Londres en découvrant «Suspect Device», qu’il avait reçu sur une cassette. John Peel comparait ce hit à «Whole Lotta Shakin’ Going On» de Jerry Lee, un hit parfait doté «de la plus grande chute de tous les temps : Blow up in your face !»

Leur premier album, «Inflammable Material» fut un classique instantané et presque quarante ans après sa parution, il n’a pas pris une seule ride. L’album est resté aussi virulent et dévastateur qu’il l’était en 1979. Non seulement les compos sont solides, mais les textes sont des petits chefs-d’œuvre de prose insurrectionnelle. Tout est rentre-dedans, violent, juste et imparable sur cet album. Ils démarrent avec «Suspect Device» et mettent une pression terrible - We’re gonna blow up in your face - Quand on joue dans un groupe de reprises et qu’on reprend ce cut, c’est un régal, je vous le garantis. Ça se joue en accélération permanente et ça se hurle à s’en arracher les ovaires. Les Stiff ne faisaient pas semblant, et ce qu’ils jouaient n’était pas le punk-rock du Londres des boutiquiers de King’s Road, mais du straight Irish street-rock. Ils ne faisaient que rappeler une réalité : on risquait sa peau en sortant la nuit à Belfast. «State Of Emergency» qui suit reste dans la même veine : chanté à la fournaise. À beugler comme ça, Jake s’arrache la glotte. Il semble que les Stiff aient décidé à cette époque d’enfiler les brûlots comme des perles et paf, on tombe sur «Wasted Life», l’un des pires pamphlets anti-militaristes qui se puisse concevoir - I won’t be no soldier/ I won’t take orders from no one - Pas plus enragé que Jake Burns. C’est exceptionnel de verdeur révoltée. Avec Terry Stamps, Jake Burns est le rocker le plus inflammable qui soit. Ils ont tous les deux la même énergie de chiens enragés. Ce qui est dingue c’est que tout est bon sur cet album. «White Noise» est un fantastique pulsatif stiffique et mirifique claqué à l’accord cavaleur - Irish bodies don’t count/ Life’s cheaper over there - C’est vrai que la vie ne vaut pas un clou en Irlande du Nord. Ils enchaînent avec un «Breakout» extrêmement mélodique et joué aux beaux accords distanciés, c’est superbe d’élégance énergétique. Et la fête continue en face B avec «Law And Order», prodige d’infra-révolte. La violence rôde à la fois dans le prêche du soulèvement et dans le son. Ils transforment le «Johnny Was» de Bob Marley en énorme psychodrame d’intensité ultraïque. Henry Cluney qui était alors le guitariste du groupe délie un solo absolument infernal et Jake ouvre en hurlant des gouffres abyssaux.
Paul Morley du New Musical Express salua l’album en ces termes : «The classic punk record. Il reflète à la perfection cette époque où tout semblait important et politique. Il s’attaquait aux clichés. Il détruisait l’idée voulant que les chansons ne parlent que de filles et ce voitures. Ce disque attaquait Londres. Ce disque attaquait l’industrie du disque.» Le style des Stiff est en effet unique : «hoarse voice, sharp guitar and fine drumming.»
Mick Middles de Sounds : «The power, the passion, the anxiety, the anger. The perfect cocktail. The perfect gig.»
Parmi les admirateurs des Stiffs, on comptait Mark E Smith : «A hell of a band with power, courage, conviction and skill.»
Il y eut un petit épisode savoureux de guéguerre entre les Undertones et les Stiff. Les Undertones accusaient les Siff de faire du hard rock comme Thin Lizzy et Jake répondait que les Tones faisaient de la petite pop parce que Fergal Sharkey était incapable de chanter autre chose. En fait les deux groupes avaient des différences de style très nettes : les Undertones incarnaient le côté pop du punk-rock et on les assimilait à des Ramones irlandais, et on affublait les Stiff du surnom de Clash irlandais.

On allait trouver d’autres énormités sur «Nobody’s Heroes», leur second album, qui est lui aussi resté un classique fumant, car quasiment tous les titres sonnent comme des hits, «Gotta Getaway», «Fly The Flag», «At The Edge» - Living on the edge of this town/ And I won’t be shot down - et bien sûr le morceau titre qui sonne comme un hymne - Get up out be what you are - Wow quel refrain ! L’autre brûlot anti-militariste des Stiff se trouve en fin de face B : «Tin Soldiers» qui est comme la plupart des autres bombes, assez remonté contre le système. Mais dans la presse anglaise, on allait commencer à dire qu’ils se ramollissaient depuis qu’ils s’étaient installés à Londres et qu’ils engrangeaient les succès, l’argent et les filles.

«Hanx» est leur troisième album, paru en 1980. On est encore dans Belfast et dans les hymnes. Jake le freluquet chante avec une méchante hargne - Be what you are - Il s’arrache même un peu trop la glotte. Les Stiff jouent tout «Fly The Flag» à l’arpège beslfastois. Ce sacré Henry n’en finissait plus d’épater la galerie. C’est avec une joie incommensurable qu’on retrouve «Alternative Ulster», le hit punk définitif. Tout y est : l’entrain, la vélocité, le grain, la bestialité. On sentait bien que ces mômes de Belfast étaient prêts à en découdre - Yeah yeah - Jake crachait ses poumons et Henry caressait le dos du dragon en jouant un beau thème. On retrouve la grandeur belfastoise avec «Wasted Life». Le punk se jouait en Irlande du Nord, et non dans le Londres des boutiquiers. Et bien sûr «Tin Soldier» nous est servi avec toute la tension d’extermination - At the age of seventeen - Ils nous stuffent le stiff et c’est même double ration. Et ils bouclent cet album fumant avec «Suspect Device» qui une fois de plus s’échappe de l’asile.

On trouve deux cuts de génie sur «Go For It» paru un an plus tard : «Kicking Up A Racket» et «Silver Lining». Kicking est monté sur un gratté de basse. On a là du pur punk-rock bien balancé. Jake chante du gras sur le rebondi d’Ali et soudain ça part ! Fantastique élasticité des élastomères. Ces mecs ont une forme de génie, le génie belfastois, l’Irish sponk démentoïde. Ils sont terriblement bons. Ils plongent leur cut dans le chaos. Avec «Silver Lining», ils tapent dans la pop-rock désespérément grandiose. Rien d’aussi prodigieux. C’est monté sur une mélodie énorme. Jake le géant la presse comme un citron. Eh oui, on aurait dû s’en douter : les Stiff sont un groupe extraordinaire et rien qu’avec ces deux cuts, Jake fait partie des héros du rock moderne. On trouve d’autres cuts intéressants sur cet album, comme par exemple «Roots Radical Rockers & Ragga», où ils se prennent pour les Clash. Mais Jake n’a rien perdu de sa hargne et Henry fait des prodiges sur sa guitare. Ah les excellent stiffers ! Ali fait un gros travail en profondeur sur «Just Fade Away». C’mon ! On les suivrait jusqu’en enfer. Quelle santé ! Quel son ! Et surtout quel élan ! Ils semblent jaillir. Encore un cut extrêmement vitaminé : le morceau titre de l’album. À les entendre jouer comme ça, on comprend qu’ils ont vraiment quelque chose dans le ventre. C’est battu à la vie à la mort par Jim Reilly. Ils font pas mal de cuts de reggae, mais ils dégagent tellement d’énergie qu’on les prend au sérieux. «Hits And Misses» sonne aussi comme un hymne. C’est du ramoné de cheminée. Ces mecs savent tirer le meilleur parti d’un morceau. Il faut se souvenir qu’à l’époque, on attendait tout de Jake Burns et il ne décevait jamais. Encore un cut athlétique avec «Gate 49» où Jake sonne comme un rockab californien. Quand il évoque cet album, il parle d’un album de transition : la fin du group punk et l’avènement du groupe pop. Lui et Henry sont d’ailleurs d’accord sur un point : pour eux «Go For It» est le meilleur de leurs quatre premiers albums studio.

Avec «Now Then», ils virent power-pop. On sent toujours le gros travail d’Henry derrière, à la guitare. Il faut attendre «Touch And Go» pour retrouver la terre ferme des steppes d’Irlande du Nord. Au niveau son, c’est bien fouillé. Henry a conservé tous ses bons réflexes. «Bits Of Kids» se veut power-poppien avec des envolées à l’ancienne mode. Ils restent dans la belle pop éclatante avec «Welcome To The Whole Week» traversé par un solo inflammatoire. On retrouve là leur sens du fantastique unisson au refrain et ce diable d’Henry soutient l’ensemble par des arpèges fulminants.
«Now Then» ne marche pas. On approche du split. Jim Reilly quitte le groupe en 1982. Il annonce dans la presse qu’il préfère quitter le groupe alors qu’il est à son sommet. Et puis il ne supportait plus les bagarres avec Henry et Jake. Et puis Jake boit trop et ça fatigue Henry. À son tour, Jake annonce qu’il quitte le groupe. Henry s’écroule. Il ne sait pas ce qu’il va devenir.

En 1988, parut l’album live «No Sleep ‘Til Belfast». Était-ce un clin d’œil au live de Motörhead ? Peut-être, mais le son n’était pas vraiment au rendez-vous. Ils attaquaient avec une version d’«Alternative Ulster» qui manquait un peu de verdeur abrasive. Mais quel bonheur que de réentendre des grands hymnes irlandais comme «Silver Lining» ou «Nobody’s Hero». Ces deux classiques joliment harmoniques réveillent toutes les ardeurs. Ils allument «Nobody’s Hero» dès l’intro et lui donnent une dimension flamboyante. La foule reprend en chœur, comme d’ailleurs dans «Gotta Getaway». C’est là qu’on mesure l’impact de ce groupe sur le peuple irlandais. On trouve d’autres versions spectaculaires sur cet album live, «Just Fade Away» (bardé de relances de batterie), «Wasted Life» (véritablement en flammes), «At The Edge» (fulgurant), «Fly The Flag» (I’m alright ! Union jack !), «Tin Soldiers» (incantatoire), «No Sleep ‘Til Belfast» (énorme clin d’œil au tandem Run DMC/Aerosmith, mais on est en Irlande, alors ça dégueule un peu et même beaucoup) et «Suspect Device» (pur cut de combat). Ils finissent évidemment avec «Johnny Was» car après Jake n’a plus de voix.
C’est en 1987 que le groupe se reforma à l’initiative d’Ali.

Mais Ali ne joue pas sur «Flags And Emblems». Bruce Foxton des Jam le remplace et Dolphin Taylor remplace Jim Reilly. L’album n’est malheureusement pas à la hauteur des attentes. On ne peut pas gagner à tous les coups. Lee Brillaux joue de l’harmo sur «(It’s A) Long Way To Paradise» et Rory Gallagher de la slide sur «Human Shield». Curieux cut que ce «Human Shield», on y retrouve le gargouillis que Joe Perry jouait avec Run DMC. Henry Cluney fait pas mal de miracles sur ce disque, notamment dans «Each Dollar A Bullet» et dans «The Game Of Life», joliment riffé. Deux cuts sortent du lot : «Johnny 7», riffé par Henry le héros, avec un refrain propulsé au drumbeat exacerbé par Dolphin le dauphin. Puis «No Surrender», petit chef-d’œuvre de power-pop, éclaté aux beaux accords et percé en son centre d’un solo d’antho à Toto.

En 1994, Henry est viré du groupe, pendant l’enregistrement de «Get A Life». C’est le manager qui l’appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle. Henry panique car son vieux copain Jake ne veut pas lui répondre au téléphone. Jake dira plus tard à Link qu’Henry n’avait pas travaillé les morceaux de l’album et qu’il s’amusait à jouer en studio des riffs de Metallica. Les Stiff se retrouvent donc à trois pour enregistrer «Get A Life» : Jake, Bruce et Dolphin. Pas de problème. Jake sait jouer de la guitare. Avec le morceau titre qui ouvre le bal, ça commence à chauffer. Bruce fait de gros glissés de manche sur sa basse. La flamme des Stiff crépite de plus belle. Jake sait encore fabriquer des gros cuts virulents. On retrouve la très grand power-pop avec «Can’t Believe In You». Jake pulse le power de la pop par dessus les toits, épaulé par le jeu incroyablement dynamique du bassman Bruce. C’est du très haut de gamme hanté par la basse du Fox. Dans «No Laughing Matter», Jake cocote comme un beau diable. On croirait entendre un vieux cut des Troggs noyé de fuzz et soudain, il part en vrille pour un véritable killer solo. Il renoue avec le génie en prenant le refrain de «Forensic Evidence». Voilà le secret de Jake Burns : éclater au firmament avec un refrain en deux temps. Il continue de nous épuiser les oreilles avec «Baby Blue», cut terriblement batailleur et il revient un peu plus loin au chant policard avec «When The Stars Fall Down From The Sky» où il évoque les exploits de la police française lors de la ratonnade de 1961 qui fit 200 victimes parmi les Algériens - Put the bastard underground/ Buried every black in town/ Who dared to raise his voice - Et Jake arrose ça d’un solo de rêve.

Cinq ans plus tard, ils enregistrent «Tinderbox» à trois : Jake, Bruce et Steve Grantley qui remplace Dolphin. On les sent à l’aise dans ce format. Il faut savoir que sur chaque album des Stiff se niche un hit planétaire. «You Can Move Mountain» sonne même comme un hymne - Don’t give up the fight - Jake adore les hymnes. C’est son péché mignon. Il a cette facilité. Il balance là l’un de ces refrains dont il s’est fait une spécialité et il l’arrose d’un solo superbe. Rien d’aussi beau sur cette terre que ce refrain. Dans «The Message», Jake ressort le gargouillis de Joe Perry/Run DMC. Franchement, c’est excellent, d’autant que Jake contrebalance ça à vieux coups de solos. Il joue comme un démon du Labrador. Depuis qu’Henry est parti, il ne se sent plus. Jake n’éprouve aucune difficulté à régner sur le rock anglais. S’ensuit un cut exceptionnel de qualité mélodique : «Dead Of Night». En voilà encore un qui sonne comme un hit. Avec «A River Flowing», Jake tape son couplet au beat cokney d’Irlande et il tire son train sous le tunnel de la grande démesure. Mais à force de vouloir trop bien faire, il finit par sonner comme les Clash. Il ressort le riff de Joe Perry dans «In Your Hand» et passe à la pop hyper orchestrée avec «Dust In My Eye». Jake s’amuse bien, il touche à tout, y compris à la grosse prod. Voilà un cut stupéfiant d’envergure et bardé de cuivres.

Pour enregistrer «Hope Street», Jake recrute le guitariste Ian McCallum. Qui a dit que les Stiff étaient cuits, à l’époque ? C’est tout le contraire. Ils n’ont jamais été aussi bons. Quatre énormités sur ce disque. Un, «Bulletproof», où le Fox fais son bassman et on n’entend que lui. Le cut vire à l’énormité progressivement et le son accourt au rendez-vous. La structure reste classique mais Jake et ses copains remplissent tout l’espace sonore à ras-bord. Deux, «Tantalise», un cut incroyablement éloigné des préoccupations des Stiff. Jake y fait son Dylan et ça devient vite terrible de galvaudage car Jake a percé le secret des relances qui était celui du grand Bob. Et ça devient hallucinant de morphisme highway-sixty-sixtique. Jake plonge dans les vagues avec la rage d’un gosse des rues qui découvre la mer pour la première fois de sa vie. Jake Burns sait brasser les influences. Trois, «Hope Street», belle pièce de pop-punk chantée à l’angle des rues, bardé d’esprit 77 avec des chœurs de mortadelle. Bruce la brute broute sa basse. Ce Fox sait faire claquer le métal d’une corde de basse. Et du coup, Jake renoue avec la pire ampleur qu’on puisse attendre d’un disque de Stiff. Basse furibarde, mélodie increvable et grandeur du bon Burns. C’est lui l’âme. C’est lui le créateur du mythe. Quatre, «All The Rest» - Shout it out - encore un cut qui tombe du ciel. Ils font le break du garage fermé le lundi et ça vire à la pépite de juke. «Hope Street» était un double album. Le second disque proposait un Best Of de morceaux live sélectionnés par Jake. Tout y est. Chaque fois qu’on réécoute ça, on se dit que la messe est dite depuis longtemps. Amen.
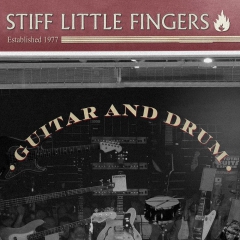
Les Stiff se reforment en 2003 pour enregistrer «Guitar And Drum». La formation n’a pas bougé. On retrouve Jake, Bruce, Ian McCallum et Steve Grantley. Quel album ! Tout est bon sur ce disque. Jake ouvre le bal avec «Guitar & Drum» d’une voix toujours aussi perchée. Dans «Strummerville», il rend hommage à Joe Strummer et derrière lui, un excité gueule «Clash City Rockers !». Ça s’épaissit avec «Can’t Get Away With That». Jake chante ça avec une rage ancienne. Puis il revient à la sauvagerie avec «Still Burning», histoire de rassurer les inquiets. Son activité volcanique est intacte, rassurez-vous. Le son est toujours là et la voix parfaite. Ian McCallum fait un fantastique travail souterrain. Dès l’intro, «Walkin’ Dynamite» sonne comme un hit hymnique. McCallum est un démon, il explose toutes les molécules du cut avec son picking. On a là un véritable inventeur de son - And you were walking dynamite - Ah ! ces éclats de McCallum ! Ce mec allume tout, il joue à l’enroulée dans le clair esprit du vif argent et Jake brûle encore, bien qu’ayant tout brûlé, oui il brûle encore, même trop, même mal. Encore plus énorme : «Dead Man Walking» ! C’est un balladif qui se traîne à la façon du «Groovin’» des Young Rascals, parfaitement indigne des jukes rouillés de Belfast, mais Jake en fait un cut dément, qui sonnerait presque comme le «Have You Ever Seen The Rain» de Creedence. Et la fête continue avec «Empty Sky», punk-rock battu à la brutale, véritable blast d’Irish punk, un vraie giclée dans l’œil. Tous ceux qui imaginaient que Jake s’était ramolli devraient écouter ce cut. Retour au gros son avec «I Waited». Quel son, Sam ! C’est encore McCallum qui fait des prodiges dans son coin. Vous ne verrez pas souvent des prodiges de cet acabit. Belle pièce de jakerie que ce «Achille’s Heart» qui suit. Il sait rester incendiaire, l’animal. Son Achille est violent et bien senti. Ce mec reste un héros. Il a une vraie voix et un vrai son. On assiste à une terrifiante entrée des guitares dans l’écho séculaire des vampires. Retour à la fantastique énergie dévastatrice pour «Who Died And Made You Elvis». C’est encore bardé d’éclats de guitare démoniaques. Cet album est une bombe. Qu’on se le dise.

Ils viennent de réchauffer l’actualité avec «No Going Back», un album tout aussi gesticulant que le précédent. Et là, on comprend subitement que les Stiffs sont des êtres flamboyants. Ils nous souhaitent la bienvenue au club des menteurs avec «Liars’ Club». On retrouve la vraie jakerie un peu plus loin avec «I Just Care About Me», où il dénonce le plus grand fléau des temps modernes : l’individualisme - And don’t forget the mantra/ Me ! Me ! Me !/ I don’t care about nobody else/ I just care about me - Et les choses prennent une sale tournure avec «Throwing It All Away». Ça éclate comme du gros rock américain. On se croirait chez Hold Steady. Leur truc est beaucoup trop épique pour être vrai. Mais comme on vénère Jake, alors ça devient un hymne, car c’est solide comme un hymne stiffien. Encore du gros Jake avec «Good Luck With That», merveilleuse purge de répondant et de ruckus. La guitare sonne comme un lance-flamme. Et voilà le hit idéal : «Since Yesterday Was Here». Pur Stiff politique - Poll tax minor strikes MLK Margaret Thatcher CNA and Watergate Again ! - Ils en font un refrain révolutionnaire qui devrait rameuter les foules. Ils bouclent cet album superbe avec «When We Were Young» un beau cut de distance, gratté à la cocotte. L’immense Jake nous ficelle ça vite fait bien fait et c’est embarqué au grattage supérieur. Ça se termine bien sûr par un final de pure folie.
Alors évidemment, quand les Stiff sont revenus jouer en France, on s’est précipités pour aller les revoir. Impossible de rater un tel événement. Tagada Tagada. Arrivée en avance à Paris et donc petite tournée des disquaires, suivie d’une tentative ridicule de traverser Paris en voiture à une heure où on sait qu’il vaut mieux prendre le métro. Résultat : arrivée en retard au Batofar. En nous voyant arriver avec nos mines consternées, la gamine à l’accueil fut prise d’un fou rire. Écroulée sur son comptoir. On n’a même pas sorti les billets.
— Zont commencé ?
— Ben oui, zont commencé. Pfffff !
Ce n’était pas la peine de poser la question, on les entendait depuis le quai.
— Depuis longtemps ?
— Oh ben non.
Elle ré-éclata de rire et chercha dans son sac un kleenex pour s’essuyer les yeux et se moucher. Comme elle n’en trouvait pas, elle demanda, l’air hagard :
— Zauriez pas un kleenex ?
— Ah ben non.
Je me tournai vers mon compagnon d’infortune :
— T’en as, toi ?
— De quoi ?
— Ben des kleenex !
— Oui, j’en ai un, mais il a déjà servi...
Elle, hilare :
— Arrêtez, je vous en supplie...
L’entrée de la soute où se déroulait le concert se trouvait à quelques mètres. C’était plein à ras-bord, jusqu’en haut des marches. Impossible de se faufiler entre les gens pour descendre. Même un pygmée ne serait pas passé. Au loin, on voyait Jake le ventru jouer «Nobody’s Hero». Il remontait de la soute un violent remugle d’étuve. C’est vrai que pour descendre là-dedans, il faut penser à s’habiller légèrement, car il y fait toujours une chaleur à crever. On vit d’ailleurs de malheureux amateurs s’extraire péniblement du tas de viande en sueur pour aller respirer l’air frais du quai. Au-dessus de la gamine de l’accueil était suspendue une petite télé dans laquelle on voyait Jake le ventru gratter sa guitare blanche. On aurait très bien pu se contenter de voir le concert à la télé, mais non, décision fut prise de monter au bar qui se trouve sur le pont supérieur. Il y régnait une sordide ambiance techno. Bien sûr, le DJ avait mis le volume à fond pour couvrir le raffut qui montait de la soute. Étant donné l’état foireux de la soirée, cette misérable techno tombait vraiment à pic. En pour couronner le tout, les bières n’étaient pas fraîches.

Quand le concert rouennais des Stiff fut annoncé, on se mit à genoux pour remercier Dieu de ce miracle. Et le soir dit, on les vit entrer sur scène un par un, le petit McCallum, le grand Ali, le solide Steve Grantley puis Jake Burns, bien ventru et tout de noir vêtu. Premier coup de pied dans la fourmilière avec «Nobody’s Hero», histoire de bien chauffer la salle et rincette avec «At The Edge». Quand il chante, Jake Burns ne donne jamais l’impression de forcer sa voix. Il va au chat perché naturellement. Et à sa façon de promener les yeux sur les premiers rangs, on sent chez lui une sorte de timidité.

Dans son livre, Link fait parfois référence à un besoin maladif d’être reconnu pour ce qu’il est. Ian McCallum semble être lui aussi un personnage très réservé, car il ne se met jamais en avant. Le fait qu’il porte des espadrilles renforce encore le sentiment de modestie qu’il inspire. Ali reste fidèle à son image de bassman sautillant et merveilleusement volubile. Comme tous les vétérans de la scène anglaise, les Stiff sont capables d’aligner une série de hits imparables. Pour finir, il enchaînent trois belles bombes, «Wasted Life», «Tin Soldiers» et un «Suspect Device» qui fait trembler les colonnes du temps. Comme le public n’est pas encore au tapis, ils reviennent comme Cassius Clay pour balancer un uppercut intitulé «Alternative Ulster».

Signé : Cazengler, Little Finger dans l’œil

Stiff Little Fingers. Le 106. Rouen (76). 5 décembre 2016
Stiff Little Fingers. Inflammable Material. Rough Trade 1979
Stiff Little Fingers. Nobody’s Heroes. Chrysalis 1980
Stiff Little Fingers. Hanx ! Chrysalis 1980
Stiff Little Fingers. Go For It. Chrysalis 1981
Stiff Little Fingers. Now Then. Chrysalis 1982
Stiff Little Fingers. No Sleep Til Belfast. Kaz Records 1988
Stiff Little Fingers. Flags And Emblems. Essential 1991
Stiff Little Fingers. Get A Life. Essential 1994
Stiff Little Fingers. Tinderbox. Spit Fire 1997
Stiff Little Fingers. Hope Street. Oxygen Records 1999
Stiff Little Fingers. Guitar And Drum. EMI 2003
Stiff Little Fingers. No Going Back. Rigid Digits 2014
Roland Link. Kicking Up A Racket. The Story Of Stiff Little Fingers 1977-1983. Appletree Press 2009
Stiff Little Fingers. Still Kicking. DVD Secret Records 2015
De gauche à droite sur l’illustration : Ali McMordie, Jake Burns, Steve Grantley et Ian McCallum.
Addendum.

Vient de paraître sur Secret Records un CD/DVD intitulé «Still Kicking» qui propose un concert filmé à Londres en 2004. Il s’agit de la formation précédente des Stiff, avec Ian McCallum, Steve Grantley et Bruce Foxton à la basse. Idéal pour le fan des Stiff, car on y voit l’immense Jake Burns régner sur un monde qu’il a créé de toutes pièces, grâce à une voix perchée et un peu rauque, un sens inné du refrain hymnique, une solide technique de guitare et une énergie hors du commun. On le voit faire une fantastique prise de solo sur «Taking Dynamite». Il présente quasiment tous ses morceaux. Il dédie «Is This Why You Fought The War For ?» à Tony Blair et balance un peu plus loin en guise de réponse : «For the oil !» Jake saute encore en l’air. Pas très haut, mais il saute. La fin du set est une lente montée vers l’explosion finale - I was only 19 years when I wrote this song. This is called Wasted Life - Il enchaîne avec «Tin Soldier», «Suspect Device», «Guitar & Drum», «Back To Front» et il joue l’intro magique d’«Alternative Ulster».
3 B / TROYES / 11 – 12 - 2015
JAKE CALYPSO AND HIS RED HOT
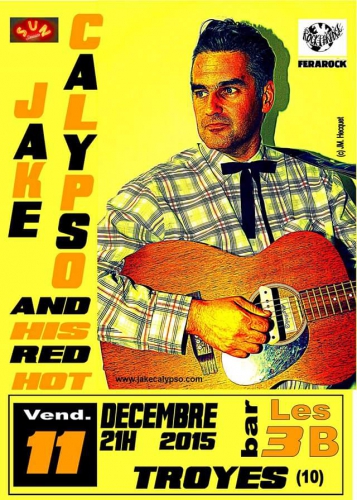
Rarement une journée aura si mal commencé. Des barbares s'en sont pris à un être innocent. Que j'adore. L'amour de ma vie. Celle qui depuis des années, sans cesse à mes côtés, me suit sans rechigner dans les pérégrinations rock and rolliennes les plus hasardeuses. La fidèle d'entre les fidèles. Qui ne dit jamais non. Qui répond toujours oui. Et la voici pantelante, agonisante, sur le trottoir. La teuf-teuf, la teuf-teuf mobile, qui me jette des regards désespérés. La colère me gagne, m'enveloppe d'un voile de sang. Je vois rouge. Les envies de meurtres tournoient dans ma tête. On lui a volé une roue ! Lamentable, elle agonise sur trois pattes, pauvre petite bête. En pleine nuit, devant la maison, alors que je dormais comme un bienheureux, entre les bras de Morphée. J'accuse le monde entier, les services secrets, le libéralisme financier, la ligue anti-rock and roll. Un complot d'envergure planétaire. L'est sûr, certain, et avéré que des puissances occultes veulent m'empêcher de rendre compte du concert de Jake Calypso and his Red Hot, ce soir au 3 B.
Mais on arrête pas un rocker aussi facilement qu'une division blindée à coups d'ogives nucléaires. D'abord j'administre les premiers soins à ma fidèle compagne – je vous rassure, elle survivra. Et le soir-même je fonce à toute allure vers ma destination initiale. Mister B est au volant de son cabriolet grand sport de luxe. Sous ses pneus le bitume s'enfume et l'asphalte s'exalte. Et son coursier pétaradant pénètre en moins d'une heure dans la préfecture de l'Aube. Un véritable cheval de Troyes.
Dans le 3 B, l'on pressent la foule des grands jours, le Hot Red est sur le pied de guerre, Thierry essayant de régler son compte au flipper Elvis Presley. Au fond je note un jeune escogriffe qui tripatouille la contrebasse. Quel est cet inconnu qui se permet de pianoter sur l'instrument de Maître Loison ? Vraiment, la jeunesse ne respecte plus rien, fauche les roues des teuf-teuf mobiles et tripote d'une manière éhontée tout ce qui passe à portée de leurs mains. Je vous le dis... bon mais vous n'êtes pas ici pour entendre des jérémiades sur le déclin de la civilisation européenne. Je passe tout de suite au concert.
PRESENTATION
Enfin ! Mister Loison tapote le micro. Le Red Hot est au complet. Je recompte sur mes doigts. En tout normalement ils sont deux, Christophe Gillet à la guitare, Thierry Sellier on the drums, mais non, après vérification additionnelle, ils sont bien trois, apparemment le grand jeune homme de tout à l'heure, est préposé à la up right bass. Sont beaux comme des sous neufs, brillants comme une pièce de neuf sous. Chemise saumon pour Loison, veste bringée pour Hervé, costume sombre sous casquette plate pour le walkin' new guy, cravate tomate pour le drinkin' new guy – Guillaume pour les intimes, Durieux pour les notaires. Prudents et avisés, Christophe et Thierry se sont affublés d'une chemise légère.

DEEP IN THE SOUTH
Dès la première mesure, l'on est loin de Troyes. A Memphis exactement. Suis à même de localiser, avec la précision d'un GPS sous connexion satellitaire. 706 Union Avenue. En plein studio Sun. Pas la réverb, mais le son est là, magnifique. Y a sans doute eu quelques milliers de combos qui à l'époque étaient capables de reproduire l'apple pie sonique, sans y penser, naturellement, jusqu'à ce qu'Elvis attirât l'attention dessus, et que le monde entier s'aperçût, que bon dieu, c'était bien cela. C'est par la suite que l'on a perdu la recette. C'est comme le Graal, tout le monde le recherche, et personne ne le trouve. L'on y passe à côté sans y prendre garde. Evidemment c'est qu'il y a erreur dans le processus de recréation. L'on essaie d'attraper, de rattraper, de retenir le son, mais Hervé et ses sbires ont compris que ce n'est pas par là que la bête a creusé son terrier. Faut pas se mettre en quête du son. Mais de l'esprit. Et tout de suite tout s'éclaire. Simple comme bonjour, mais faut avoir sacrément turbiné le problème pour le résoudre.

Regardez Thierry Tellier, n'en fait pas des tonnes. D'ailleurs à ses débuts Elvis, n'avait même pas songé à prendre un batteur. Alors Tellier, d'une caisse claire, il en a dix fois trop. Se contente de la portion d'une assiette à dessert. Le reste est superfétatoire. Un coup de cymbale de temps en temps, et un boum de grosse caisse pour agrémenter le plaisir, mais sinon tout réside dans la subtilité de la frappe. Passe le balai, paresseusement. Un technicien de surface pas du tout stakhanoviste. Inutile de vous monter le marlouf et de décréter que vous en faites autant, même par vent d'autan. C'est que la frappe Sun, c'est en même temps la chaude moiteur alanguie d'un après-midi d'été et l'impétuosité de la crue du Mississippi. Ceux qui croient tout savoir urinent juste du Mississippipi de hilbilly cat. Mais ils sont en plein dans le mille à côté. Un balancement moutonnier de taureau de combat. L'impossible alchimie. La lenteur majestueuse des Dieux et le feu brûlant des forges de l'enfer.
C'est sur ce tempo suggestif que Loison accompagne de son acoustique électrifiée. C'est cela le rock and roll, le battement d'un coeur humain et le crin-crin de cordes malmenées. La sauvagerie maximale obtenue avec un minimum de moyen phonique. C'est avec la plus grande retenue d'eau que vous produisez le maximum d'électricité. Heatbeat disait Buddy Holly, et la voix. Tortillarde et nasillarde, mais toujours juste. Quand ils descendent des collines les péquenauds des monticules ont les poings chauds. Question bagarre, faut pas leur en promettre. Hervé qui chante c'est le dindon qui glousse et le cochon qui grogne, plus la voix qui galope avec la nervosité d'un étalon qui n'a pas sailli de juments depuis trois mois. Un autre grand secret du rock and roll, le feu qui couve sous la cendre, le désir qui court dans vos veines, le corps qui bande et le sexe en feu qui brûle.

En théorie, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous pouvez renvoyer les figurants, l'on a les deux acteurs principaux. Oui, mais dans la pratique, l'existe des invités de seconde zone qui s'imposent et qui finissent par décrocher les rôles de première main. Je vous refile les deux méthodes pour réussir en cet emploi. La voix apollinienne, celle de Christophe Gillet. De l'interventionnisme actif. Nécessite la vision d'ensemble. Tout voir, tout entendre, tout comprendre. Et puis parachever. Porter l'incandescence à son ultimité. Vous rajoutez le codicille qui manque à l'absolu. Vous dépassez l'indépassable. Au début vous vous contentez d'accompagner. Vous êtes la doublure. Et lorsque vous devez rentrer sagement dans la boîte à jouer, vous balancez ce que l'on n'attend pas, et juste à ce moment précis vous créez le manque qui ne manquait pas, mais votre action devient l'expression même de son impérieuse nécessité. Christophe Gillet, c'est à tout moment le point d'orgue de la symphonie. Sans lui, elle demeurerait inachevée.

Deuxième méthode. La dionysiaque. Qui exige la foudre et la fougue de la jeunesse. Indispensables attributs de Guillaume. Sans lui, le set serait un film muet. L'apporte la bande sonore. C'est sur l'époussetage de son diplodocus que les trois autres argousins bâtissent leur empire. L'est la toile de la peinture, et le granit de la sculpture. Et le son de la musique. N'apporte pas sa pierre. Impose son menhir. L'a ciré sa big mama comme l'armoire de Tante Ursule. Au début on n'y fait pas gaffe, mais l'on est obligé de s'apercevoir qu'elle dispose d'une infinité de tiroirs. Les ouvre et les referme avec la plus grande rapidité. Les notes se bousculent et ruissellent en torrents impétueux. Z'ont un jeu avec Christophe, c'est Gillet qui ouvre les vannes et c'est Guillaume qui libère les eaux. L'un ébranle le sol avec le trident de Poseidon et l'autre bouscule les cavales de Neptune.
L'ATTAQUE DE LA DILLIGENCE
Le rock and roll c'est comme dans les films. Quand il ne se passe rien, l'on s'ennuie. Mettez une banque, sans hold up la vie de guichetier serait bien terne. Faut du sang, du meurtre et du pillage. Avec Hervé Loison et ses Red Hot, un malheur n'arrive jamais seul. Vous aurez droit à l'intégrale, la révolte des tribus indiennes et l'invasion des zombies qui sortent des marécages. Avant de coucher les enfants laissez-les écouter Lovin' Heart un doux christmas song ( un peu énamourant ) avec le Hot du Père Noël qui gazouille comme des pinsons.
Toute mécanique bien huilée doit casser. C'est la loi du genre. N'ont pas commencé depuis trois morceaux qu'une corde d'Hervé tirebouchonne et finit par pendouiller lamentablement. Pas de panique, encore deux morceaux Downtown to Memphis, et celle du bas se fait la malle à son tour. Signe évident que l'ensemble pulse à toute vapeur. D'ailleurs plus tard nous aurons droit à un Train Kept A Rollin, très vite sorti des rails avec tout l'assistance qui monte dedans et braille la tête hors des portières. Mais en attendant Hervé s'enferme dans la cuisine pour réparer la bécane. Laisse les trois autres soudards nous régaler d'une impro musicale, vicieuse et méchante qui déchaîne l'enthousiasme. Quand il revient, nous fait le coup du grand trémolo, yodellise comme au pays d'Heidi des Montagnes, comme Jimmie Roger n'a jamais osé le faire, pas du Blue Yodel N° 1, du Red Hot Yodel, number 1000. Et puis nous enseigne le B. A. Ba du rock and roll. Ba-Ba-Ba-Ba-Ba répétez cent fois à la suite et tout le monde s'applique et annone la leçon. Ça ressemble un peu à un cours de langue pour allophones atteints de bégaiements prononcés, mais sapristi quel pied ! Magie incantatoire de la répétition. La fièvre monte à El paso. L'on est définitivement sorti de l'Union Avenue, l'on commence à arpenter Beale Street. Loison sort son harmonica et son rock and blues. Se roule un peu par terre. Mais dans les limites d'une stricte décence. Fin du premier set. Laisse l'assistante excitée. Le chien à qui on a proposé le plus bel os à moelle de l'abattoir, avant de le lui retirer A la limite de la frustration.
UN SET DE FOLIE

Deuxième mi-temps. Tout le monde se hâte vers le lieu de la catastrophe prévisible. Thierry lance les tambours. Pas ceux du Bronx, ceux des réserves indiennes sur le sentier de la guerre et de l'explosion. Loison est à la tête de la cavalerie légère. Tour à tour il yodelle comme un cow-boy et hou-houte comme un peau-rouge. En trois minutes, c'est le grand déferlement. Le grand sachem a prononcé les mots magiques, le cri de ralliement des razzia mortelles, Hot Chikens ! Et c'est l'abandon final, les digues cèdent, et la transe collective débute. Dédoublement schizophrénique généralisé. Duduche s'est emparé d'un tambour et tape de toutes ses forces, Dominique s'est accaparé la guitare d'Hervé et se trouve catapulté dans le rêve de sa vie, sur scène avec une foule en liesse qui l'acclame, pour ma part je me fais les griffes sur les cordes de la contrebasse de Guillaume ( plus Durieux, définitivement furieux ) qui joue à fond comme si sa vie en dépendait. D'ailleurs elle en dépend. Jake Calypso est sur tous les fronts, meuglant sur le sol, debout sur les tables, porté en triomphe et allongé sur le comptoir dont il s'échappe pour se lancer dans une nouvelle improvisation rock and roll blues démente, fait le poirier, le pommier, le cerisier et tous les arbres de la création, les racines des pieds qui gesticulent vers le ciel, la tête frondaison plantée dans le sol, ou délicatement posée sur la cymbale que Thierry malmène avec sadisme, Christophe lâche des déferlantes de guitare qui vous knock oute le cerveau, les doigts de Guillaume montent et descendent le long de son manche comme les ascenseurs dans la tour infernale, maintenant debout sur une cloison de séparation Calypso se jette dans le vide, suicide immédiatement arrêté par une bande échevelée de rockers qui l'attrapent en plein vol et lui font visiter l'établissement à la vitesse d'un avion de chasse. L'est immédiatement imité par un fan résolu qui le suit dans l'espace, sans parachute ventral de secours, s'écrase sur le sol comme un fruit trop mûr et se relève en clopinant et en jurant, mais trop tard qu'on ne l'y reprendrait plus. Indescriptible pâmoison. Par trois fois Calypso nous promet trois morceaux avant un dernier pour terminer. Mais arrivé au terme de ses promesses, il est le premier à repiquer dans l'oeil de l'ouragan, obligé de resserrer d'un cran la ceinture de son pantalon qui devant la déviance généralisée aurait tendance à prendre la tangente et les jambes à son cou. C'est la fin. La moitié de l'assistance est couchée par terre et l'autre tient debout par miracle. Un concert dont on se souviendra après notre mort.

POTINS MONDAINS

Gentleman, Duduche félicite Jake Calypso pour la naissance de sa petite-fille. Avec les gènes de son grand-père, sans doute une vedette... Grande chance aux générations futures. Le bar est assailli une dernière fois et la divine Béatrice pourvoyeuse de ces concerts pharamineux ne sait plus où donner de la tête... Dans la voiture je m'aperçois que Mister B est tombé amoureux. Une brune piquante ? Une rousse flamboyante ? Une blonde pétulante? Vous êtes loin de la vérité. De la guitare de Christophe Gillet. Ah, ce son, et il se met à rêver à voix haute...
Bon, gardons la tête froide. D'après moi va falloir mettre ce Guillaume et son groupe The Walkin' and the Drinkin' Guys dans les radars.
Damie Chad.
( photos : FB Béatrice Berlot, featurin' Duduche )
PHOTO-ROCK
Le temps court à sa perte. La nôtre et celle du monde. Et pour le cas très particulier qui nous occupe présentement, les concerts de rock. Sont voués à être stockés et engloutis dans nos capacités mémorielles. Nous avons toutefois élaboré des stratégies de survivance. Je dis nous, car il s'agit d'un problème d'interdépendance universelle. Seul, nous ne pouvons grand chose. Mais nous possédons des béquilles, des appareils enregistreurs, de sons, d'images immobiles ou mouvantes. Plus une culture d'usages et d'usures à laquelle nous empruntons, nos manières de faire, sauce commune des protocoles d'utilisations, sans pour autant oublier de rajouter notre petite pigmentation individuelle, notre minuscule pimentation personnelle. De laquelle nous sommes souvent si fiers, alors que la modestie devrait nous inciter à modérer nos propres jugements.
Voici longtemps que j'ai pris la décision de ne pas prendre de photos des concerts auxquels j'assiste. Outre le fait que je ne possède aucun appareil de duplication de la réalité du monde. Point par manque de moyen financier, plutôt par une désappétence naturelle. D'abord parce que plutôt maladroit de mes gestes je ne me sens guère à l'aise quand il s'agit de me pencher sur le fonctionnement capricieux de tels ustensiles. D'autre part, si je n'éprouve qu'une confiance limitée en mes sens pour me permettre d'accéder à une illusoire objectivité de la préhension du spectacle d'un phénomène qui s'offre à moi, je pense que le fait de le médiatiser au travers d'un artefact technologique aurait davantage tendance à m'en éloigner qu'à m'en rapprocher.
Vision toute égotiste qui n'engage que moi. La preuve pour illustrer mes articles, j'use sans vergogne du FB des artistes, des amis, des connaissances, de la banque de données internet... Les arts graphiques – dessins, peinture, gravure... - m'étant interdits par de graves incompétences congénitales - ne me reste plus que la roue de secours de la pratique d'écriture. Non sans une espèce de fatuité idéologique. Non que je tienne mes textes pour des chef-d'oeuvres de la littérature mondiale ! Mais pour de simples objets mentaux, au même titre qu'une photographie ou une vidéo. Avec toutefois, cette différence, me semble-t-il, de pouvoir agir beaucoup plus directement sur la représentation de la chose représentée. En d'autres termes, l'écriture me permettrait une interprétation beaucoup moins tautologique que la reproduction visuelle.
N'empêche que tout acte d'un sujet pensant est forcément subjectif. Mais beaucoup de photographes s'en tiennent à une simple lecture miroitique et réflexive de la réalité du monde. L'écume de l'apparence leur suffit. Ils apportent ainsi des documents indispensables sur le déroulé de la phénoménisation captée. Mais quant à l'essence de ce qui a eu lieu, ils s'en moquent, ils l'ignorent. Le ressentent parfois, mais ne cherchent pas à le transcrire, à l'expliquer. La photo du criminel enfonçant son couteau dans le corps de sa victime est un témoignage de première main. Mais qui ne nous apporte rien de bien précis quant aux motivations du criminel, ni de celles, peut-être plus surprenantes, de la victime, et encore moins de celles du poignard délictueux, ainsi que le présupposaient les attendus motivés de l'antique droit romain... L'écriture permet de telles approches insidieuses. Si nous la considérons comme une suite téléguidée d'errements généalogiques, qui instinctivement se portent au cœur essentiel et profondément enfoui en sa plus lointaine origénéité de cette fragmence de réalité soumise à question.
L'écriture permet de telles approches. La photographie aussi. Encore faut-il que la photographe s'appelle par exemple Guendalina Flamini.
GUENDALINA FLAMINI
Des photos de concerts de rock and roll, nous en avons tous vu quelques milliers. Je parle ici des amateurs de cette musique. Certaines remontent à des années où nous n'étions pas encore nés. Nous les tenons alors pour de rares et précieux documents. Depuis la généralisation du portable, les clichés du moindre évènement abondent. Dans les stades de la société du spectacle et des barnums communionnels du rock and roll circus, il est plus facile d'entrevoir les stars internationales, reléguées à l'autre bout de la pelouse, sur les écrans géants obligeamment mis à notre disposition, que le groupe inconnu, entassé au fond d'un petit bar, submergé par une forêt de smartphones complaisamment brandis à bout de bras par leurs amis proches.
Nous avons rencontré Guendalina Flamini au concert de Jon and The Vons et des Howlin' Jaws, organisé à La Mécanique Ondulatoire, le 6 novembre dernier ( voir KR'TNT ! 255 ). Facile à remarquer, toute emprise de grâce romaine et de vivacité italienne, avec son appareil de pro en bandoulière. Avons un peu parlé, de rock and roll et de son habitude de suivre les concerts de rock, et par goût personnel, et en free-lance. Photographe et vidéaste. Si vous vouez en savoir plus, ne manquez pas de visiter son FB : Guendalina Flamini Photographer ( et par ricochet son blogue pro ). Vous y retrouverez sans difficulté un choix de photos des deux groupes qui animèrent la soirée. De celles des Howlin' elle nous avait permis d'en prendre quelques unes pour notre chronique, quant à celles de Jon and the Vons elle n'avait pas eu le temps de les tirer. Alors nous cédons au plaisir de les regarder.
GUENDALINA FLAMINI
REGARDE
JON AND THE VONS
Vous avez la kro du concert dans KR'TNT ! 155 du 12 / 11 / 2015, je résume pour ceux qui n'ont aucune envie de flashbacker, quatre garçons et une fille sur une scène exigüe qui délivrent un garage surfin' rock. Un public emporté en un remuement tourbillonnant intempestif et prolongé, le tout selon une montée d'adrénaline contenue. Dans cette étuve bouillonnante, n'y a que Guendalina Flamina qui garde la tête froide. Reporter du combat rock, elle est au premier rang multipliant les angles de vue.
Sont mignons les Vons avec leur tenue rayée, vous rajoutez le joli minois de Sally – merveilleux prénom rock – et vous avez les plus jolies cartes postales du monde, avec un petit côté sourire kitch, rétro-rock comme on en fait plus depuis au moins... demain. Pas de chance pour les amateurs de la réalité sans aspérité du monde, Guendalina Flamini est une photographe-rock.
Pas le genre, du bruit, de la lumière, je rentre, je me fade trois vues d'ensemble and away les voiles, j'aurais toujours cela dans mon port-folio. L'a une une connaissance intuitive du rock, l'apparence flashy, les couleurs criardes, l'ambiance festive, fun, fun, fun, la jeunesse s'amuse au spectacle du rock and roll circus. Z'oui, pour ceux qui ne savent pas gratter le palimpseste du réel. Suffit de retirer la pellicule du vernis véhiculatoire pour retrouver la peau squameuse du reptile rock and roll. Musique borderline, au bord de l'abysse, sur la crête des tsunamis dévastateurs, angoisse, colère et frustration des générations perdues, des enfants qu n'acceptent ni leur avenir, ni leur passé. Encore moins leur présent.
Beaucoup de blanc et de noir dans les photos flaminiennes. Le vide des existences et l'extrême condensation des énergies existentielles. Le rock and roll est sans arrêt au milieu du gué, entre le bord d'ombre et les plages de sable. Pas de couleurs, des teintes, du rose d'innocence fanée au mauve des perles mortuaires. Presque un bistre de transparence boueuse, le fauve cru des crues du Delta tapi dans l'inconscient collectif des adeptes de cette musique qui charrie autant de cadavres d'illusions perdues que de menstruations souveraines.

Photo 1 : Admirez cette sobriété de touche. Cordon ombilical de guitares, micro à terre, plan américain guillotiné, juste le cri munchien au fond qui s'échappe du point focal de la bouche ouverte en un zéro concentrique. Saisissant raccourci du rock and roll, les instruments et le néant. Circulez, il y a tout à voir.

Photo 2 : La gueule ouverte et la profération labiale. Guitares boucliers en avant, l'essentiel est derrière, l'ampli et le micro, car quand il n'y a rien à dire, il faut le crier sur les toits et le moi des mots qui n'ont pas fui. Car ici le silence de la photo est élocutoire. Le rock entre prière soumissive noire et revendication adolescente de la jeunesse fuyante. Sur cette photo d'apparence toute simple, se dévoile l'art de Guendalna Flamina, elle rajoute du sens, ne se contente pas de mettre en cage la réalité, la prolonge, la transforme, la presse pour en extraire le suc essentiel.

Photo 3 : Le cercle de la vie et de la mort. L'arène du rock and roll. Le tambourin et le temps qui bout rien de joyeux. Le rond identificatoire des recherches policières. Le rock and roll est sous caméras de surveillance. Mais les suspects sont aussi des héros. Solitude de celui qui porte la voûte terrestres des fans sur ses épaules, et le fan solitaire qui guette le sourire compatissant qui ne vient pas.

Photo 4 :C'est bien le micro qui bouffe le chanteur. Ne soyez pas naïf. Lui il a compris, l'en a le t-shirt verdâtre de peur. L'on ne tourne pas impunément la langue sept fois dans un noeud de serpents sans dommage. Guendalina Flamini nous rappelle que le rock and roll est un jeu panique. Ce sont les dieux qui vous mordent au visage et pas le contraire.

Photo 5 : L'immobilité de la photo découpe les instants de transe. Vous vivez une grande cavalcade mais Flamini, vous sert le serpent en tranches. L'est toujours un moment de réflexion, de retenue et de silence. Le rock est la musique du diable car si vous croquez la pomme du monde sans réfléchir, cela ne compte pas, cela ne prend de sens que si avant de la réduire à son misérable trognon, vous réfléchissez à la signification de votre acte. Le désir est pétri d'innocence, mais la volonté du désir est criminelle. Le rocker plaide coupable. En toute connaissance de cause. Guendolina nous oblige au saut de la réflexion métaphysique.

Photo 6 :Trois guerriers. Et l'offrande des mains ouvertes tout en bas de la photo. Y avait assez de charivari pour un beau cliché de mouvement de foule. Guendolina a préféré cette terrible solitude du sacrifiant et des sacrifiés. Suffit de l'hésitation d'un battement de main pour que tout disparaisse. Fragilité des présences humaines. Survie miraculeuse de l'instant arraché au fleuve de la vie qui gronde. Pour une fois, l'on peut se baigner deux fois dans la même eau gestatrice de notre destruction.

Photo 13 : La set list comme une aile d'ange qui flotte au vent. Sally visitée par l'annonciation. Le dieu du rock pénètre dans sa chair et elle nous délivre un sourire jouissif de jubilation charnelle et d'introspection divine. Aux racines du rock, les rythmiques païennes d'Afrique et les élévations des églises noires. Le dieu entre en vous, et c'est fuckin' bon.
Reste encore quinze photos à admirer. Je n'ai pas pris les plus belles. Elles sont toutes belles. Mais à la limite cela est secondaire. Ce qui est important c'est qu'au-delà de leur aspect bêtement documentaire ( concert de Jon and the Vons à la Mécanique Odulatoire le 06 octobre 2015 ) elles procèdent d'une esthétique généalogique. Sont des sentiers ouverts, des ouvertures de bouche d'ombre, que tout un chacun peut remonter. Mènent aux sources de la cristallisation originelle du rock and roll, pour mieux nous faire comprendre la survie agonisante du rock and roll en notre propre présence au monde. L'appareil de Guendalina Flamini s'accroche aux écailles de la bête sortie de son milieu naturel. Se tord de douleur et de rire – car pour être prédatrice elle n'est pas dénuée du sens de l'humour noir – l'a du mal à respirer et est une focalisation extrême de souffrances. Mais sa vue est un émerveillement perpétuel. Le python qui serait ressorti de l'invisible fissure des ruines du temple de Delphes. Et Guendalina Flamini sait tout cela d'instinct. Son secret est évident : l'est une fan de rock and roll. L'est vrai que ça aide. Mais ce n'est pas suffisant. L'a encore l'oeil limpide de l'Artiste. Pas une reproductrice. Rien à voir avec les mères porteuses qui accouchent de duplicata qui ne leur ressemblent pas. Celui qui traverse les ombres et trouve le minuscule rai de lumière qui permet de ramener au jour les aspects voilés de la beauté des mondes enfouis dans la noirceur ensorcelante de leurs propres mystères.
Pour une fois que l'on a déniché une véritable photographe rock, l'on va suivre régulièrement son travail sur KR'TNT. Comptez sur nous pour surveiller de près la flamme de Guendalina Flamini.
Damie Chad.
( Photos on FB : Guendalina Flamini )
( La justification des photos sur le blogue est très capricieuse... )
MARY BEACH / CLAUDE PELIEU
COLLAGES
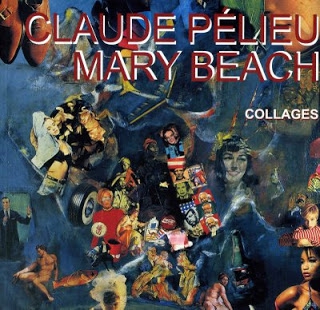
( Catalogue de l'exposition qui s'est déroulée à la galerie Weiller, 5 rue Gît le Coeur
à Paris du 06 / 04 / 1999 au 03 / 05 / 1999 )
C'est qu'il s'agit de ne pas manquer en février 2000 la rétrospective des oeuvres de Mary Beach et de Claude Pélieu, organisée par les services culturels de Lorient et Ploemeur.
Confesser que ces deux artistes ( écrivain, poète, traducteur notamment de Burroghs, Ginsberg, Ferlinghetti... ) m'étaient inconnus me donne la chair de poule. Une grave lacune à combler... Pénétrer dans l'univers de ses plasticiens du collage, s'imprimer dans les déchirures qui plaquent le monde, le démontre et inocule le travers du risque pour mieux appréhender l'écorce de l'invisible donné à l'œil nu sans que jamais la face reconstituée ne puzzle l'interne frigidité, frappe du dire.
Désorganisation de l'image fixant l'uppercut bu à même un regard qui tourne le plan afin de se donner à lire hors du point déplacé. Punctum d'une autre dimension, comme gommée sous le rire sangloté. Hystérie de l'humain macabre se jouant de ses propres signes décalqués de l'humour intransigeant comblé de la cruauté circulatoire. Le mouvement est omniprésent, c'est encore le tempo des effets éclatés qui se charge des pertes sues à même l'éclat des formes...
« Un fameux choc. Les collages de Mary Beach vous giflent le coeur.
Leur histoire ressemble à la vôtre. Ils vous disent : marche les yeux ouverts, sois patient et traverse le feu. Le néant est en toi, vis avec, et sois joyeux. Au jour le jour. »
Bruno Sourdin.
« Dans le genre des villes de Rimbaud et autres illuminations électriques prosopoétiques, voici le Pélieu du temps des assassins ( … ) Je ne pourrais assimiler tous ces froids ciseaux mais leur coupe exacte atteint souvent sa cible ( … ) La poésie peut provoquer des bouleversements dans la société par le mixage des mots et des images ».
Allen Ginsberg.
C'est aussi du mot à l'ouvrage, la combinatoire des vides sanctifiés, les froissures pour ne faire entendre, pour ne plus libérer que l'ombre noire à s'en vêtir de toute urgence.
Eric Morandi.
Texte paru dans le mensuel de
Littérature contemporaine
Alexandre N° 55 ( Septembre 98 )
CLAUDE PELIEU
LEGENDE NOIRE
( Editions du Rocher / 1991 )
Y avait eu les deux bouquins à couverture bleu chez 10 / 18, Jukeboxes ( 1972 ) avec très vite le nom de Gene Vincent, dès les premières pages, à une époque post-morten durant laquelle on n'en parlait peu, et Tatouages Mentholés et Cartouche d'Aube ( 1973 ), l'on en trouvait partout et bientôt des stocks entiers chez les bouquinistes et les revendeurs. Après les deux il y avait eu, même éditeur, même non-couverture, De la Déception Pure. Manifeste Froid. avec Serge Sautreau, André Velter, Jean-Christophe Bailly, et Yves Buin. Bien décevant, surtout si l'on comparait avec Le Manifeste Electrique aux Paupières de Jupe ( paru au Soleil Noir, dès 1971 ) de Michel Bulteau et Mathieu Messagier, plus quelques autres dont Patrick Geoffroy dont je vous reparlerai d'ici quelques jours, ces trois derniers étant aux fondations des éditions Electric Press. En ces temps-là, la jeune poésie française remuait le cocotier et se chauffait salement au tout électrique. Esthétique plutôt chaise fatale que confort douillet quant au krématif traitement de l'écriture. L'était salement aimantée au rock and roll et à la Beat Generation.
Pélieu et sa compagne Mary Beach traduisirent Burroughs, Kérouac, Kaufman, Ginsberg et toute la cut up beat clique... Dès les années 90, la gloire de Claude Pélieu s'estompe. Délaisse quelque peu l'écriture pour la pratique du collage, n'arrête pourtant pas d'écrire. A peut-être payé sa résidence étrangère, très vite dès 1963, il est déjà aux Etats-Unis, l'est devenu un membre à part entière de cette beat generation poétique américaine qu'il a contribuée à révéler en France. L'on trouvera du Pélieu dans les petites revues underground, les gros éditeurs faisant semblant de ne pas savoir qu'il existe...
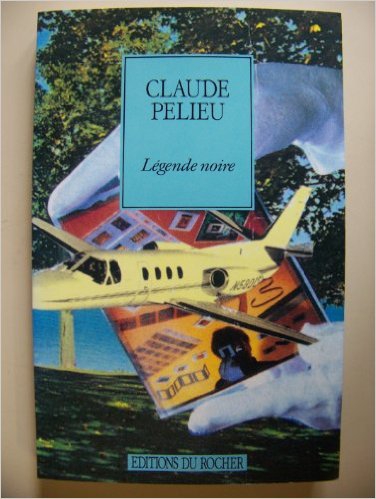
Légende Noire, à première vue un petit roman, avec une jaquette colorée qui attire l'œil. Collage de l'auteur, comme il se doit. De fait une histoire de l'Amérique. Contemporaine. 1963 – 1990. De la guerre du Vietnam à la fin de la Guerre Froide. Rien à voir avec un livre d'histoire. Déréliction des consciences confrontées à une vision métapolitique du monde. Pas étonnant que Pélieu ait été publié – ce qui le rendit célèbre dès 1968 - aux Cahiers de l'Herne, tenus par Dominique de Roux et Jean Parvulesco. S'agissait alors de mettre le feu au vieux monde, et d'en finir une fois pour toutes avec son obsolescente indigence.
Légende Noire nous raconte la fin de ce rêve. Nous démontre que ce ne fut qu'un long cauchemar. Les jeux étaient faits depuis le début. Fallait être naïf pour y croire. Manipulation. Théorie du complot. Les évènements ne sont jamais ce qu'ils paraissent être. Le poëte ne démontre rien. Profère. Une langue de feu. Des images, flammes porteuses de désespoirs incandescents et d'éclairs aveuglants. Rien n'est construit. La bouche d'ombre parle. Ecoutez et taisez-vous. Ce sont des traits de feu qui ourlent et hurlent les lèvres.
Ne laisse rien dans l'ombre et les jours qui restent n'en paraissent que plus noirs. Le monde se précipite dans ses propres sens interdits. Chaperon rouge se jette dans les babines retroussées du loup. Une histoire de sexe. Le seul briquet-kérosène dont dispose encore l'individu pour mettre le feu à toute son existence. Le sexe – de préférence homosexuel - et la drogue. Pour palier cette catastrophe qui vous tombe dessus, vous avez besoin de remontants. Amphétamines et alcools. Tous les produits sont permis à la seule condition qu'ils vous déchirent grave. Vous aident à vous tenir debout. Ce qui ne veut pas dire, droit. Le parallèle est à faire avec L'œil du Lézard de Richard Hell ( voir KR'TNT ! 247 du 18 / 09 / 15 ), ce road-movie punk, qui du coup en paraît quasi-guilleret.
Le monde est sans espoir. Les espions de l'Oncle Sam sont partout. Une seule consolation possible. Le rock and roll. Les souterrains de velours. Walk on the wild side. L'équipée sauvage débouche sur... la fin de la route. This is the end, beautifull Friends. L'autoroute du futur n'est pas achevée. Les travaux ont été stoppés. Inutile d'attendre leur réouverture. Ne reste plus qu'à faire demi-tour. Qu'à repartir en arrière. Amis rockers, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est écrit en toutes lettres sur la première ligne du dernier chapitre : Gonna Back Up, Baby ! De Gene Vincent. Précise l'auteur. Pour les analphabètes du rock. Qui sont légion. Cette présence tutélaire de Gene Vincent, qui reste un point hors-limite de toute l'oeuvre de Claude Pélieu, nous agrée.
Encore un livre désenchanté sur l'Amérique maîtresse of the world déphantasmée. Le monde s'y bouscule, les lecteurs de KR'TNT ! Y retrouveront avec plaisir F. J. Ossang ( voir KR'TNT ! 256 du 19 / 11 / 2015 ) et Daniel Giraud – l'un de nos collaborateurs ( voir KR'TNT ! 257 du 26 / 11 / 2015 ) comme quoi le continent rock est un monde plus petit que l'on pourrait le croire !
Damie Chad
1978, NEW YORK IN COLOR
JEAN-LUC DUBIN
du 04 / 12 / 15 au 07 / 01 / 16
( A.A.R.E.C. 4, rue Garnier Pagès / PROVINS )
Une exposition photos de Jean-Luc Dubin à Provins. L'évènement n'est pas rare. L'habite à côté de la Belle Endormie. Pas vraiment un inconnu Jean-Luc Dubin, a voyagé et exposé un peu partout dans le monde et l'on ne compte plus ses publications. Mais cette fois-ci la thématique nous intéresse très précisément. New York, 1978. Lecteurs de KR'TNT ! ne sursautez pas, Jean-Luc Dubin n'est pas un admirateur patenté de rock and roll. Regarde plutôt les gens et les lieux où ils vivent. Ne va pas chercher les Ramones en studio, mais il déambule dans la grosse pomme comme le ver dans le fruit. Ne vous méprenez pas : c'est la big city qui est pourrie jusqu'au trognon, et l'œil de son objectif qui ne présente aucune difformité décadente.
C'est le Grateful Dead qui avait titré l'un de ses albums, American Beauty, que vous pouviez aussi lire comme American Reality, la médaille et son revers. Ne s'est pas laissé éblouir par la surabondancee des vitrines des beaux quartiers. A entamé ce que les situationnistes appelaient en leur temps une dérive. Facile comme tout. Se laisser porter par les courants ascendants et descendants, inscrire ses pas dans les itinéraires invisibles qui vous attirent et vous emmènent dans les sentes signifiantes. Harlem, Bronx, China Town, l'autre Amérique.
Douceurs des couleurs. Acidités des vues. Les marges et la déglingue. Des individus, des vaincus. Et ceux qui résistent. Apparemment des passants anonymes et interchangeables. C'est l'attitude qui les trahit. Une façon de poser son corps, plus solidement les pieds sur la terre. Pour le sacré vous repasserez. Petits trafics et grosses combines. N'y a que les voitures qui soient vraiment grandes. Mais pas de première main. Des épaves qui sauvent les apparences. Une Amérique que les mythes ont bouffé jusqu'à l'os. Des rues vides, une impression d'abandon et de solitude. Pas envie d'y aller
Prenez plutôt un coffret de six tirages. Objet de luxe réservé aux amateurs d'art, un peu cher pour les bourses de rocker. Je vous l'accorde. I got one hot dollar, comme chantait Gene Vincent.
Damie Chad.
21:23 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/12/2015
KR'TNT ! ¤ 259 : ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS / JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 258
A ROCK LIT PRODUCTION
09 / 12 / 2015
|
ASH / WAVE CHARGERS / HOWLIN' JAWS JIMI HENDRIX / BE BOP A LULA |

LE PETIT BAIN - PARIS XIII - 01 / 12 / 2015
ASH
LE PANACHE D'ASH
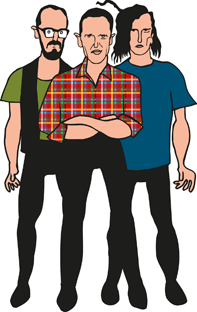
Même dans le cas d’Ash, on peut désormais parler de carrière ! Et même de vingt ans de carrière, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, pourtant, comme dirait le grand Charles, je n’ai-aime que toâ ! Et pourtant, quand Tim Wheeler et ses ceux petits compagnons de bordée déboulent sur scène, on a l’impression qu’ils n’ont pas vieilli. Ils dégagent une sorte de teenage flavour qui nous rappelle que le rock n’est autre que la forme moderne du mythe de la jeunesse éternelle qu’on dit à tort être l’apanage des vampires.

Mais non, il suffit d’aller voir Ash sur scène et de savourer leur ribambelle de hits pop. Ça gicle au plafond de la salle comme des bouquets de feu d’artifice. Ça explose de santé et d’allure. Ces trois Irlandais jouent comme s’ils avaient encore seize ans. Ils jouent, au sens fort du terme. Et le temps a fait d’eux l’un des fleurons du rock anglais. Tim Wheeler est tellement heureux de monter sur scène qu’il sourit à tout bout de champ. Mark Hamilton fait son cirque habituel, jambes écartées, basse en bas et grosse présence, alors que Rick McMurray bat le beurre comme un dieu. Tim Wheeler ne se coiffe plus comme avant. Il plaque ses cheveux vers l’arrière, mais il gratte toujours fièrement sa Flying V, comme au temps où il stoogeait la vieille Angleterre.

Ash peut désormais jouer dans la cour des grands, c’’est-à-dire monter sur scène et aligner une vraie collection de hits, et encore, ils sont gentils, car ils passent pas mal de chansons moins déterminantes. S’ils le voulaient, ils pourraient blower n’importe quel roof. Ils savent créer des moments de pure magie. C’est facile avec un hit comme «Shining Light». Et ils explosent leur fin de set avec «Girl From Mars» que tout le public reprend en chœur. C’est la fête au petit Bain, un bateau qui est en train de devenir, par la qualité de sa programmation, l’endroit de référence, comme le fut un temps la Maroquinerie.

Avec «Trailer/Kung Fu» paru en 1995, les trois gamins d’Irlande allaient devenir les coqueluches de la presse rock anglaise. On était alors encore en pleine Britpop et le son d’Ash arrivait comme un chien dans un jeu de quilles. Dès «Season», on sentait le souffle. Ils prenaient l’Anglais par surprise avec un son de garçons, bien cisaillé à la cisaillade et bardé de bardage. Ils sortaient ensuite l’un de leurs premiers hits, «Jack Names The Planets», balancé aux accords de poids. On sentait en eux une réelle appétence pour le power. Mais il y avait un gros problème avec «Intense Thing» : ce cut était beaucoup trop puissant pour un petit groupe irlandais. Leur truc sentait le charbon actif - She looked so lonely/ Standing on her own - Ils battaient leur final à coups de tempêtes mirifiques et Tim Wheeler hurlait dans les bourrasques.

Avec «Uncle Pat», Ash continuait de s’imposer. Au beau milieu de cette tourmente de distorse outrancière, Tim Wheeler partait en tortille de solo. Comme on le verra par la suite, son vice, c’est le départ en solo. Avec «Petrol», ils typaient un chant qu’on allait appeler le chant pantelant et toutes les puissances du rock étaient au rendez-vous. TimWheeler avait bien compris le mécanisme des explosions mis au point par les Pixies. Plus loin, ils tapaient dans l’insidieux avec «Different Today» et poussaient à l’extrême les logiques de beat et de grondement de basse. Au bout de ce disque se trouvaient les trois titres de «Kung Fu» et notamment «Luther Ingo’s Star Cruiser». Encore un cut beaucoup trop puissant avec lequel ils inventaient un genre qu’on pourrait qualifier de nitro-power pop, celle qui fait vibrer les tympans des pauvres ères qu’on voit traîner non loin des gibets où pourrissent les dépouilles des arsouilleurs.

«1977» est un album dément, l’un des fleurons du rock anglais, tous mots bien pesés. Ce deuxième album est une sorte d’album insurpassable. Ils attaquent avec «Lose Control», une magnifique dégelée de défenestration. Tim lâche ses légions sur les plaines. Quelle fantastique dynamique de guitares ! Et il passe à la heavyness mélodique avec «Goldfinger», l’Absalon Absalon absolu. La tête lui tourne mais il reprend le gouvernail de sa mélodie et ça devient imparablement bon et juteux. Il faut se souvenir de «Goldfinger» comme d’une pierre blanche, celle d’une éminence fondamentale. Le petit Tim sait écrire des hits fondateurs. Et ils tapent dans la stoogerie avec «I’d Give You Anything». Avec ce pilonnage d’accords de fonte brute, ces Irlandais se montrent encore plus stoogiens que les Stooges. Et ils descendent dans les soubassements d’une mélodie désespérée. Le petit Tim passe un solo de whawha et le cut prend feu en fin de partie. C’est plombé, on a là le meilleur sans espoir qui soit. On retrouve «Kung Fu», avec son drive de basse ultra-saturé et l’excellence de la persistance. Le petit Tim explose ça aux oh-oh-oh de power pop. Puis avec «Oh yeah», il replonge dans les profondeurs de sa heavyness. Le petit Tim n’est autre qu’une sorte de Brian Wilson du stoner irlandais. Il crée des ciels glacés et des dérives au septentrion, avec une force de poignet clouté. Il crée un univers unique dans le rock anglais. Ils revient à sa chère power pop avec «Let It Flow», encore une merveille bardée de paliers et d’autorité. On note le port altier du riff et les alarmantes couinades de coins de couplets. «Innocent Smile» se veut puissant comme le tonnerre et indomptable comme l’éclair. Complètement dévastateur ! Wow, quel album ! Chaque cut sonne comme une bombe. Il tombe un son plein comme le déluge d’Ararat explosé au détour de pont. Ce fatidique power trio expatrie le son au fond du blast. On tombe dans l’exceptionnel avec «Angel Interceptor», bardé de coups d’overdrive de son intentionnel et monté sur un énorme fil mélodique - Oooh it’s good to know/ Tomorrow you are coming home/ I feel heaven in you/ Don’t you know - Quelle fantastique énergie ! Il n’y a que Weezer qui puisse s’élever à un tel niveau jubilatoire. Ils tapent dans les puissances des ténèbres irlandaises pour «Darkside Lightside». Leur truc sort du ventre et ça reste dans l’imbattable. C’est même du pur Lovecraft à biscotos qui s’offre un final spectaculaire et terrifiant d’allure.
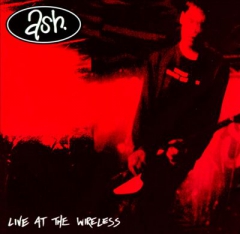
On va retrouver toutes les composantes du génie de «1977» sur un premier album live, le fameux «Live At The Wireless» paru l’année suivante. On retrouve la merveilleuse mélasse d’excellence blasteuse de «Darkside Lightime» que Rick McMurray bat comme plâtre au coin du bois. Ils passent ensuite la belle pop de «Girl From Mars» au foutage foutraque et retombent dans le heavy doom de «Oh yeah». Le petit Tim sait tisser sa toile de fil d’argent dans l’iris d’un soir tombant. Plus loin, ils vont lâcher «I’d Give You Anything», un vrai déluge de magnats du pétrole stoogy. On n’avait encore jamais entendu ça en Angleterre. Le petit Tim cloue la chouette à la porte de l’église maudite. Ils tapent plus loin dans «Goldfinger», l’un des hits d’Irlande les plus puissants qui soient. Quel pachydermisme ! Ils finissant avec une version de «Petrol» explosée à l’harmonie vocale. Ah oui, ils jouent comme des démons pendant que Tim chante comme un ange du paradis. Puis avec «A Clear Invitation To The Dance», Tim devient fou et pousse des hurlements.
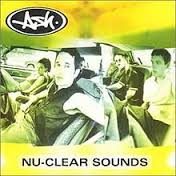
Ils sortent encore un album énorme avec «Nu-Clear Sounds». Dès «Projects», on sent la saturation du son. Ils sortent une mélasse de puissance digne de Monster Magnet. Et voilà une nouvelle bombe avec «Jesus Says», monté sur une fantastique pulsation de chœurs à la Dolls. Voilà une prunerie terrifiante de pataterie, un monstrueux bombardement d’ions soniques bien ronds - Ouh ouhh Ouhhhh - Ces mecs savent briser les murailles. Tout aussi terrific, voilà «Wildsurf», power pop d’ultra puissance, when the Stooges meet Brian Wilson. Encore un coup de génie wheelerien. Il va chercher des contrechants d’excellence explosive et il revient au fil mélodique avec une classe indécente. Quelle merveille ! C’est une sorte d’exaction de sunshine pop ultra débroussailleuse et jouée aux accords des enfers. On n’avait encore jamais entendu une chose pareille. Ils explosent ensuite «Death Trip» au chant de «Maggie’s Farm». Le petit Tim place une diction nitro-active dans l’enfer sonique d’Ash et de cendres. Il œuvre au pur génie iconoclaste et il en a les moyens, le petit bougre ! Et l’infâme Mark Hamilton broie tout ça à coups de basse. Attention à «Numbskull» ! Tim titille ça au gimmick innocent et il revient screamer en armure noire. Il prévient. Et tout s’écroule dans une fracas dévastateur. Il passe du chant à la destruction en règle, de la finesse à la déflagration. Il roule tout dans sa mélasse de farine de distorse et va aux extrêmes définitifs. Il reste encore un énormité sur cet album : «Fortune Teller». Une stoogerie de plus. Tim s’amuse à battre tous les records de garage incendiaire. C’est stoogy dans l’essence du chant. La ville brûle quand joue le groupe et Rick McMurray double la pétaudière en fin de cut.

«Free All Angels» paru en 2001 est le dernier album de l’âge d’or d’Ash. Première énormité : «Shining Light». On a là une pièce de power pop élégante et hautaine, digne des grandes heures de Pimrose Hill. Le petit Tim allie toujours la puissance à l’élégance. Il embarque son monde à l’ingénue libertine des Panzer Divisions. Il enchaîne ça avec «Burn Baby Burn», une puissante dégelée de gelée, encore un cut admirable de puissance de développement, une mainmise sur la marquise. Ces gens-là font ce qu’ils veulent. Il peuvent matraquer jusqu’à plus soif. «Candy» sonne comme un rêve de saturation maximaliste, souligné aux machines infernales de Dante. C’est une véritable mélasse ouatée de psychédélisme irlandais et le festival impitoyable se poursuit avec «Cherry Bomb», pris à l’extrême son d’exaction de power pop ultimate de mate de mythe. Le petit Tim explose tout ça à volonté, comme si Brian Wislon chevauchait les Walkiries. C’est porté au maxi du max de pack. Qui va oser se présenter après ça ? D’autant que Tim dégueule du wha-whatage et il reprend she’s a cherry bomb dans l’enfer d’une fournaise absolue. Il n’existe rien de plus déterminant sur cette terre. Plus loin, il renoue avec le génie en tapant dans «Pacific Palisades». Rick McMurray drumme ça comme une bête. Retour aux Stooges avec «Shark» et ils finissent cet album fumace avec «World Domination», une belle dégelée de gimme gimme more. Le petit Tim adore les dégelées. Il multiplie les occasions et Charlotte fait les chœurs.

Avec «Meltdown», Ash retombe comme un soufflet. Fini la rigolade. Tim nous cocote pourtant «Meltdown» à la pure méchanceté. Il fait bien le coup des couplets à vide sur fond de cocote, mais ça n’explose pas. Par contre, «Orpheus» explose. Tim sort de ses gonds et revient à son chant tordu d’ode d’Irlande. Mais on sent que la niaque d’«Angel Interceptor» a disparu. Avec «Clones», il va faire un tour dans le champs de maïs et on le perd de vue. Est-ce la présence de Charlotte qui plombe le groupe ? Ils semblent avoir abandonné la veine stoogy. Il faut attendre «Vampire Love» pour retrouver la bouillie surpuissante de power pop vampirique à laquelle ils nous avaient habitués. Le petit Tim revient à sa manie de l’explosion, mais sans la fibre d’antan qui se chargeait de mélodies. Il prend un solo furibard et sauve l’album.

«Twilight Of Innocents» est ce qu’on appelle un album foiré. Ils attaquent avec un «Started A Fire» qui sonne comme «I Got You Babe» de Sonny & Cher. Tim balaye ça d’un solo visionnaire. Puis ils nous stompent «You Can’t Have It All» et tapent un refrain lumineux, évidemment. Tim tente de renouer avec la démesure dont il s’était fait le héraut. Mais leur power pop va tomber dans la banalité. Rien ne ressemble plus à la power pop que la power pop. On s’y ennuie à mourir. Aucune étincelle ne veut montrer le bout du nez. Tim et ses amis enchaînent une série de cuts désespérément ordinaires. Tim passe un killer solo dans «Ritual», bien liquide et ravagé de tremblés longs, mais ça ne suffit pas. C’est Mark Hamilton qui mène «Princess Six» par le bout du nez. Il drive tout à la bonne basse - I’m out of my mind/ Cos I need your love - Et ça se termine à la folie garage de yeah yeah yeah oh oh - On voudrait bien qu’Ash fasse encore de gros albums, mais ça doit être difficile de maintenir un tel niveau. C’est évidemment la raison pour laquelle ils ont arrêté d’enregistrer des albums.

«Kablammo» vient de paraître. L’album du retour aux albums ne convainc pas. Avec «Let’s Ride», Tim cherche désespérément à retrouver sa vieille veine, celle des tubes puissants qui éclataient dans l’azur de la pop anglaise. «Let’s Ride» a l’étoffe d’un hit, on sent le retour des grandes eaux d’antan, mais ça reste un amuse-gueule. Il faut attendre «Go Fight Win» pour retrouver un peu de viande. C’est le stomp du retour en grâce d’Ash, l’apanage du power-trio. Ils renouent enfin avec l’art ancien de la belle démonstration de force battue à la diable. La face B bâille aux corneilles et se réveille avec «Shutdown», une power pop pressée qui ne traîne pas en chemin. Hâtons-nous, dit-elle, car le soir tombe !
On retrouve l’essence d’Ash dans les compiles de singles. C’est là que ça grouille. Autant se payer ces compiles, car on y fait le tour du propriétaire.

«Intergalactic Sonic 7’s» devrait monter à bord de la chaloupe en partance pour l’île déserte, car ce double album fonctionne comme un véritable champ de mines. On saute quasiment à chaque cut. Ash groupe imparable ? Allez savoir... Ça démarre avec «Burn Baby Burn», pas de surprise, c’est une dégelée avec un solo à la dentellière des enfers. S’ensuit un «Envy» allumé à coup d’one two three four et on plonge dans l’écume des jours. Tim joue la carte de la niaque maximaliste et il ne rigole pas. Avec «Shining Light», il fait monter la bébête de manière extravagante. C’est explosé de son dans un télescopage de beauté virtuelle à l’horizon. Encore une pétaudière avec «A Life Less Ordinary». Rick McMurray bat comme Vulcain, avec une rage démoniaque. C’est l’occasion idéale pour Tim, alors il emmène ses mélodies exploser au dessus de nos têtes. Pas compliqué : tout est démesuré chez Ash. On retrouve l’effarant «Goldfinger», ils tapent ça du haut des falaises de marbre. Il y a du Phil Spector chez Ash. Quelle clameur et quelle ardeur ! Ils enchaînent avec «Jesus Says» et «Oh Yeah» que Tim amène à la régulière et qui virent à l’énormité. Ici tout n’est que puissance et beauté surnaturelle. On tombe sur un «Candy» pompé dans «Make It Easy On Yourself» et saturé à l’extrême. Oh et puis voilà le retour d’«Angel Interceptor» qui pue le hit planétaire dès la première mesure. Tim amène «Wildsurf» au chant classique et c’est aussitôt explosé en pleine mesure. Ces gens-là ne respectent rien et surtout pas les oreilles. Ils vont à la rencontre de Brian Wilson avec du son plein les poches. On retrouve tous les autres hits à la suite, «Petrol» et «Numbskull», bien sûr. Le disk 2 est aussi éprouvant pour les nerfs. «No Place To Hide» blaste dès l’intro. C’est cisaillé à la base et tous les adjectifs n’y pourront rien. On s’effare de l’insolence de ponts sur-puissants. Quel groupe peut se payer ce luxe, aujourd’hui ? Tim attaque «Where Is Our Love Going» au riff indécis et violent. Puis il passe en mode cavaleur et va chercher des tracasseries d’accords intrinsèques. Ah il tire bien son épingle du jeu, l’animal. Il nous plonge dans le grand maelström de fin du monde démentoïde et c’est battu à la vie à la mort. Encore un cut écrasant de beauté : «Stormy Waters». C’est la power pop la plus heavy de l’histoire du rock, un vrai blasting d’énergie ! Et ils retombent dans la stoogerie de bas étage avec «Melon Farmer». Tim y va comme un Irlandais. C’est chanté à deux voix et ça se perd dans l’outrage fournaisien. Tout est tellement démesuré là-dedans. «Gabriel» est aussi hallucinant d’ampleur. Tim explose la surface du rock. Ils sont terrifiants de démesure et c’est battu comme plâtre. On assiste à l’embolie du beat. «Lose Control» est amené par la pire des menaces - I’m doin’ alright/ Don’t you lose your soul - Ils sont la pire démence qui soit - Out of your mind - le riff plane comme un aréopage de vampires. Et Rick McMurray tape comme un sourd sur «Sneakers». C’est à quatre pattes qu’on sort de cette compile.
Ils décidèrent à une époque de cesser d’enregistrer des albums et de ne faire paraître que des singles. C’est pourquoi on trouve deux volumes de singles parus en 2010, «A-Z Vol. 1» et «A-Z Vol. 2».

Curieusement, on retrouve sur la plupart des singles le son dévastareur, mais sans la démesure qui caractérisait les grands hits ashiens. Il faut attendre «Joy Kicks Darkness» pour vibrer un peu. On a des chœurs de folles dans l’intro et c’est du grand Ash explosé au refrain et des ponts déviants rabattus au beat fatal. Beau single aussi que «The Dead Disciples», joué à la cocote d’expert et monté au chant d’exception. Tim vise les ampleurs considérables - I’m feeling so alive - Il crée un authentique événement d’importance, tant la clameur porte au loin et il chante à l’extrême pourfenderie du chaos - When the show is breeding/ All the ghost are rolling/ When the wall are shaking/ Watch the stars exploding - Pur génie ! Encore une énormité avec «Pripyat» et de la power pop explosive - I listen to the defeaning silence/ In the beautiful lost citadel - On retrouve le grand Tim des envolées. C’est bardé d’images clairvoyantes et plâtré de plâtras de son. Attention à «Command» et à son intro de basse. On a le petit jeu couplet/refrain et les pires jutes d’explosivité. Les refrains coulent comme des fleuves de lave hilare au long des côtes. On tombe plus loin sur «Comin’ Around Again» joué à l’explosivité des descentes. Les couplets clamés sont jetés dans le chaos des refrains et ils nous sortent un final éblouissant. Voilà la puissance du team de Tim. Il balaye tout à la wha-wha et il part en pire vrille qui vaille. S’ensuit une autre dégelée avec «The Creeps». On voit rarement des cuts d’une telle intensité. On sort du commentable. C’est bombardé de Creeps Creeps Creeps.
Ash offre avec le Volume 1 un docu intéressant sur DVD. On suit le groupe en tournée en Angleterre et on voit à quel point Tim et ses deux amis sont décontractés. Sur scène, Tim joue sur une SG blanche. On les voit aussi déclarer la fin des albums. Ils décrètent ne plus vouloir faire que des singles. Et puis à un moment, Tim parle de ses albums favoris, «Abba’s Gold», «Singles Going Steady» des Buzzcocks et «Hot Roks» des Stones. Mais c’est vrai que le singles club est un exercice périlleux. Seuls s’y sont risqués avec eux le Wedding Present et les mighty Wildhearts.

On trouve au moins quatre hits énormes sur le «A-Z Vol.2». À commencer par le wall of sound de «Dare To Dream», gratté en compagnie des anges du paradis. On admire Tim pour ça, justement, pour son goût des apothéoses. Il adore s’installer dans l’enfer d’un mur du son. Il réinvente Spector et le Brill quand il veut. Il développe une puissance qui défie les lois de la nature. Autre hit : «Binary». Tim y retrouve sa belle veine glam. On peut bien parler ici de grandeur suprême du rock anglais - Pumping your heart/ Having your mind delicately blown apart - Énorme ! Toute aussi énorme, voici «Physical World», du vrai Ash sound gratté aux power-chords dévastateurs. Ces trois-là savent blaster un hit avec la même évidence que Slade. «Embers» est aussi du pur jus de power pop explosive. Tim est un entremetteur de power et de pop de premier ordre et en prime, il nous refait le coup de la vrille. Autre monstruosité : «Teenage Wildlife» qui aurait tendance à vouloir sonner comme le «Heroes» de Bowie. Franchement, c’est un hit, mais un hit d’allure planétaire. C’est chanté au meilleur glam d’Irlande et Tim l’orne d’un solo d’encorbellement majeur. C’est terrifiant de grandeur verte. Puisqu’il parle de grandeur verte, justement, voici «Running To The Ocean», encore de la power pop de très haut rang - Coming back to life/ Waking up inside - et il part en solo écarlate dans l’ocean is green, l’ocean is blue. Il faut aussi se gaver d’«Instinct», tendre et dense, avec encore un petit côté Bowie dans le chant. Tim sait naviguer au plus serré, c’est un popster de rang aristocratique.

Le fin du fin, si on aime Ash, c’est de les voir sur scène ou, à défaut, à la télé. Facile si on chope le fameux DVD Tokyo Blitz. On y voit la formation classique avec Charlotte, la perfe de la perfe. Ils sont bien écartés les uns des autres sur scène : Mark Hamilton le bassman fatal, Rick Tape-dur coiffé à l’iroquoise de Travis Bickle, Charlotte en chemisier blanc, Anglaise jusqu’au bout des ongles et au centre Tim la star avec sa Flying V, Tim de hargne et de jambes écartées, Tim d’essence du rock. Il envoie la mélodie de «Life Less Ordinalry» et c’est stupéfiant d’impact. S’ensuit un «Shining Light» qui est le hit absolu. Shining éclate Tokyo qui ovationne Tim la star, le teenage angel du mythe éternel. C’est à pleurer tellement c’est beau sur scène. Tim le sait, il ne joue que des hits, comme les Beatles avant lui. Les profondeurs de «Goldfinger» sont insondables de pur jus. Chaque titre pulvérise tous les hit-parades. «Cherry Bomb» n’a l’air de rien comme ça, mais au refrain, la mélodie nous saute à la gueule. Quand ils jouent «Kung Fu» et «Girl From Mars», ça pogote dans la fosse. «Wild Surf» fait danser Tokyo. Tim rappelle que «Jack Names The Planets» fut leur premier single et «Jesus Says» sonne comme un hit dès l’intro. Ils finissent avec l’effarant «Numbskull».
Et voilà que Tim la star se lance dans une carrière solo avec «Lost Domain». Son père vient de disparaître et il en parle dans «Hospital», une fantastique leçon d’humilité - So I found I was not so strong - Il s’y confesse et c’est poignant - Try to recall the good days gone for evermore/ Try to recall the innocence that I had before - Pour «Do You Ever Think Of Me», il va chercher les très gros effets. Tim est un être en quête d’absolu, ça crève les yeux. Il vise les parapets noyés de brume, au-delà des mondes connus. Il refait son Richard Hawley pour «End Of An Era» et se noie dans un océan d’orchestration. Il explose les limites du Brill et file vers les profondeurs inexplorables de l’univers. Mais il veille à rester indiciblement mélodique. «Medecine» est encore une belle pièce de pop directive et orchestrée à outrance. Tout sur ce disque est ultra-produit, ce qui paraît logique, vu l’étoffe du songwriter. Avec cette chanson fleuve, il va une nouvelle fois très loin. On trouve deux beaux instros sur cet album, dont un «Vapour» joué au sax et au xylo. Tim la star fait de la magie ni noire ni blanche mais lumineuse. Il termine cet album édifiant avec «Lost Domain» et confesse à nouveau ce que chacun ressent lorsque son père jette l’éponge - I think about my father/ And all that I have lost there/ Away away away.
Signé : Cazengler le pot-ash
Ash. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 1er décembre 2015
Ash. Trailer/Kung Fu. Squatt 1995
Ash. 1977. Infectuous Records 1996
Ash. Live At The Wireless. Death Star 1997
Ash. Nu-Clear Sounds. Homegrown 1998
Ash. Free All Angels. Infectuous Records 2001
Ash. Intergalactic Sonic 7’s. Infectuous Records 2002
Ash. Meltdown. Infectuous Records 2004
Ash. Twilight Of Innocents. Infectuous Records 2007
Ash. A-Z Vol. 1. Atomic Heart Records 2010
Ash. A-Z Vol. 2. Atomic Heart Records 2010
Ash. Kablammo. Atomic Heart Records 2015
Ash. Tokyo Blitz. DVD Infectuous Records 2001
04 / 12 / 2015
BUS PALLADIUM / PARIS
THE WAVE CHARGERS
HOWLIN' JAWS
Vendredi soir au coin du feu. Samedi soir à Troyes avec The Twillinger's, a rockabilly band que je n'ai jamais vu. Tout est réglé comme sur du papier à musique. Pardon, sur du papier à rock'n'roll. Mais dans la vie, c'est souvent comme dans le poème d'Edgar Poe, le corbeau noir du désespoir et de la malédiction s'en vient frapper à votre porte. Les plans les mieux préparés s'effondrent, tel un château de cartes emportées par le vent de la terrible Nécessité. Serais-je donc privé de concert cette semaine ? Orage, ô désespoir, ignominique coup du sort qui tombe comme le tranchant de la guillotine sur mes prévisions saturdiennes. Non ! Il n'en sera pas ainsi, sort funeste, je te niquerai jusqu'à la moelle du trognon. Vu l'heure avancée, me reste dix-sept secondes pour fomenter le plan B. That's all right mama, anyway I can do !
La teuf-teuf mobile a compris. Ce soir les feux rouges, les limitations de vitesse, les passants sur les passages cloutés, ça n'existe pas. Des para(kilo)mètres négligeables. Elle a enfin décroché un rôle qui lui convient dans La Highway Impitoyable, celle dont le sang caillé d'innocents piétons forme un pourpre tapis ordalien de goudron rouge du meilleur effet. Résultat : j'arrive pile-poil, à l'heure. Et même avec un peu d'avance.
THE WAVE CHARGERS

Avec un nom comme ça, je ne me faisais pas trop d'illusion. Des attardés de la première mouture des Beach Boys ( ces amerloques qui avaient piqué leur riff à Chuck Berry ), mais comme le pire est toujours certain, les Wave Chargers m'ont séduit. Pas que moi d'ailleurs, vu la salle qui on-, qui ondudu-, qui ondulala, donc qui donc ondula durant tout le set. Quatre sur scène, dont trois avec des lunettes. Depuis Buddy Holly, nous avons appris qu'il faut se méfier de ces looks d'étudiants sages. Ne sont pas les derniers à lancer le chalut du chahut. Le seul qui n'en a pas – je parle des lunettes, demoiselles déjà gémissantes - c'est Francis, la même coupe de cheveux qu'Eddy Mitchel au début des Chaussettes, mais je ne pense pas que cette référence ait été recherchée, et une guitare d'un bleu pâle délavé, enfin pas une guitare, une Fender, et là ce n'est pas un hasard. En plus, va nous montrer qu'il sait s'en servir. Derrière, c'est Claude à la batterie. L'a le sourire facétieux du singe qui du haut de son palmier lance des noix de coco sur le naufragé épuisé que les vagues magnanimes ont roulé sur la plage salvatrice. Sacré coco, il vise juste, et tire des bordées incessantes. Un mauvais destin a voulu que Samy soit préposé à la basse. Ce n'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il a des attitudes innées de lead guitar, le gars qui fait tout le spectacle, debout, couché, à genoux, incapable de rester en place, prend la pose pour les photos souvenirs. Mais Anne ma soeur ne vois-tu rien venir ? Que nenni, ma soeur, je ne vois que le surf qui poudroie et le roll qui verdoie. C'est Anne en personne qui tient et son propre rôle et sa guitare – encore une Fender – qui lui donne la réplique.

Twang ! c'est parti, un petit Wave Chargers Theme, pour annoncer la couleur. Trailer musical, nous voici replongés en pleines années soixante avec ces guitares chantantes et vrombissantes qui affolaient la population. L'on n'avait jamais entendu ça, c'était fuselé et aérien comme un carénage d'avion, et ça vous emportait dans des galops de tribus apaches sur le sentier de la guerre. L'a fallu quatre ans pour s'y habituer, de par chez nous en notre douce France, ce fut un vent de folie, l'on ne comptait plus les groupes qui affutaient leurs guitares, c'étaient les jours heureux de Globule le phoque, les Guitares, les Champions, les Fingers, les Pingouins, les Mustangs, les Fennecks, les Aiglons, les Lionceaux, les Panthères, et toute la ménagerie avec, pour finir au plus proche de nous, en queue d'hirondelle, les Arondes de Montpellier... en arrière-fond bien sûr Dick Dale, Link Wray, Duane Eddie, Hank Marvin, et plus loin encore, plus secret et moins connu à son époque, le travail studio d'Eddie Cochran...

Y avait de tout dans le rock instrumental des années 60, des génies du manche... et des copieurs, et des faiseurs, et des suiveurs. C'est un rock qui s'est un peu dilué en sa propre parodie. De l'exaltation adolescente d'une jouissance sans entraves l'on est passé au médiocre farniente de l'oisiveté petit-bourgeoise, ambiance shaker lounge cocktails des îles avec coca et sans molotov. La vague blues Stones s'est abattue sur cette jeunesse décadente et l'a roulé au loin tel des fétus de chapeau de paille. Chance pour nous, les Wave Changers restent sur la crête de la lame. Ils ont le son et le mur, autant dire que ça décoiffe sec, roulements de Claude et cavalcades de Francis, va chercher les notes brontosaures qui résonnent graves et écrasent tout sur leur passage, et les notules toutes fines à la Woody Wood Peeker qui vous transpercent les tympans sans pitié. L'alterne les basses de basaltes avec la translucidité des cristaux transparents. Anne s'applique, un peu le rôle du second couteau qui ne passe pas dans les premiers plans de guitare, mais elle construit les contreforts nécessaires au soutènement des édifices qu'échafaude Francis. De l'autre côté, contrepoint parfait d'Anne immobile, Samy s'amuse, s'agite, ressemble au discobole de la statuaire grecque avec cet avantage indéniable, celui du mouvement perpétuel. Sale gamin à qui ses parents ont oublié de refiler sa dose de théralène pour qu'il se tienne enfin tranquille.

Nous font des trucs extraordinaires. Douze mesures de Nous les garçons et les filles et plang l'on part dans un tourbillon apocalyptique. Idem pour le Bambino, le must des années soixante, mais pour attardés mentaux, un truc à la sauce Dalida, mais qu'ils nous servent dans une assiette proto punk sixty, qui dégouline de moulinades déjantées. C'est que tout un set instrumental, faut le tenir. Le public est versatile, s'ennuie vite, faut le surprendre à tous les riffs. Faut savoir ménager les surprises, un What'd I say mouture Chat Sauvage chanté avec l'assistance, qui en deuxième partie est chargée de faire les Realets – entre parenthèses autant les Wave turbinent sec, autant nous ne sommes pas merveilleux sur l'affaire. Participation oui, mais les mystères du swing vocal ne sont pas acquis. Par contre question torsion, rien à redire ça twiste dur, à gauche, à droite, au milieu, tout le monde se contorsionne comme si le sort du monde en dépendait. Et pourquoi pas après tout ! Nietzsche n'a-t-il pas écrit beaucoup de bien sur la folie dionysiaque ?

Z'ont un répertoire qui flirte avec le western et les films sur écran panoramique. Un truc comme Attack of The Mexican Food ou La Revanche de Kuromaku, même sans savoir de quoi ça instrumente, vous dessinez les décors grandioses, les chevauchées prestigieuses et les scènes de combat à vous couper le souffle, l'instrumental sixty possède sa dose de carton twang et d'imaginaire kitch, cela peut être sa faiblesse, mais quand les Wave Chargers sont à la réalisation, vous y croyez dur comme du fer brûlant. Palissades Park c'est le grand huit des sensations,une tourmente de guitares qui vous arrachent le palpitant et vous précipitent dans le vide de l'extase.
J'éprouve un regret, j'aurais aimé les entendre sur Apache, oui m'ont offert en échange Shazam et Kasbah – ah ! l'orientalisme de bazar des années soixante, les sortilèges de l'Orient, les cordes qui vous tressent des tapis volants, et les volutes kiffées des narghilés – mais Apache, pour Claude, pour son entrée de batterie, j'aurais voulu le voir drummer, cela n'a l'air de rien, mais il en faut de la subtilité, et avec sa frappe, toute de roulements, pré-Keith Moon – somme toute peu articulée, si ce n'est dans ses accointances rythmiques avec les paragraphes d'arabesques de la Fender de Francis - je suis sûr qu'il s'en serait dépatouillé avec brio.

Rien ne ressemble plus à une giclée de guitares qu'une autre giclée de guitares. Les groupes de l'époque sont allés chercher des sonorités inaccoutumées un peu partout, fandango, flamenco, musiques arabes et d'ailleurs. Tout cela se retrouvera, plus tard magnifié par Led Zeppelin, n'oublions pas qu'à l'époque Jimmy Page était déjà en embuscade et que ces recherches ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, ni dans les mains d'un manchot. Les Wave Chargers sont des jeunes gens modernes que je devine abreuvés de pulp fiction, de manga, et de séries télé, des titres comme Ho Ku Kai et Kuma Beat, nous emportent dans dans un Japon. Exotic mais pas exotoc.
Sont convaincants, les Wave Chargers. Nous ramènent dans le passé du rock, mais ils en redéfinissent les contours. Ravivent les couleurs. Ne se contentent pas de simples décalcomanies. Inventent des teintes nouvelles. Plus flashy. Un set de plaisir. La salle les acclame à tout rompre. L'ont mérité.
HOWLIN' JAWS

Ah ! Les Howlin, rappelez-vous leur passage à La Mécanique Ondulatoire, même pas un mois, ( voir KR'TNT ! 255 du 12 / 11 / 2015 ) et le souvenir marqué au fer rouge d'une apparition apocalyptique. Les revoici donc sur la scène du Bus Palladium. Je ne suis pas tout à fait un idiot, n'ai pas choisi la soirée au hasard. Après le concert de Smooth and the Bully Boys de la semaine dernière, je n'aurais pas pu supporter du rock mélangé d'eau tiède. Me fallait du pur malt au venin de crotale. N'ayez crainte j'ai eu mon médicament. Mais cette fois, sans malt ni additif aquatique, rien que le poison du reptile. Ultra-cobraïque, flacon noir, avec tête de mort en rouge flamboyant. La pourpre agonistique des Dieux.
Avec leur casquette à hélice, n'ont pas l'air sérieux. Arborent un look de collégiens malicieux. Rayon farces et attrapes, l'inénarable trio, Djivan le grand échalas au coin à côté de sa contrebasse, le cancre Mathieu au fond près de la batterie radiateur, et Lucas le beau gosse de la bande qui scrute sa guitare cahier de mathématique d'un air blasé. Evidemment comme ce sont les trois mauvais garçons de la classe, il y a un max de filles qui s'écrasent sur le devant de la scène. Crient pour attirer leur attention. Peine perdue, sont déjà préoccupés par la préparation de leur prochain mauvais coup. Trop tard, vous ne les arrêterez pas, c'est parti.
Cuttin' Out. Tout de suite l'on sent la différence. Ce n'est pas qu'ils jouent mieux. C'est qu'ils s'expriment davantage. La grâce sauvage d'un tigre féroce vous ne saurez l'apercevoir dans une cage carrée de deux mètres sur deux. A la Mécanique Ondulatoire, la scène était minuscule. Z'étaient comme des lingots d'or tassés dans un coffre-fort. Il avaient le droit de respirer, mais pas davantage, ce qui nous avait surtout permis de nous régaler les yeux du jeu de Mathieu en quelque sorte privilégié par la vaste – toute relative - portion d'espace confisquée par ses tambours. Mais ici sur l'estrade du Bus, il y en a deux qui bénéficient d'une large bande de terrain. Pas de football, disons la surface d'un parterre de jardin. Pas le Pérou, mais une zone d'évolution libre. Ce qui change tout. C'est tout de même mieux d'avoir les coudées franches pour jouer de la guitare et emmener la grand-mère au bois et lui montrer comment l'on se chauffe.

Cuttin' Out donc. Facile d'imaginer la musique des Howlin', Djivan et Mathieu s'occupent de la bétonneuse, vous produisent un mortier précontrain, inaltérable et inattaquable. Un pavement aussi solide que les pierres que les Egyptiens ont assemblé pour former les pyramides. De la belle ouvrage. Que Mister Lucas s'emploie aussitôt à découper en morceaux. Vous la sculpte en moins que rien. Même pas au marteau-piqueur, non au burin. Touche trois fois les cordes et vous comprenez que vous êtes en face d'un grand. Dans le rock, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Pouvez acheter toutes les méthodes que vous voulez et vous payer des professeurs, cela ne sert à rien. C'est inné, le moment exact où vous posez la note. Ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop près, ni trop loin. Ce n'est même pas indiqué sur les partoches ( quand elles existent ). Et Lucas, il pique et repique à la nano-seconde près. Fait de la dentelle sur l'ouragan que lui concoctent les deux autres. Solitaire accompagné.

The Urge, By the Tim, Stranger, les morceaux se suivent et se ressemblent, défilent et exhibent leur différence. Magie du rock and roll, tempo de feu et vol du temps suspendu. Tout est dans le silence. Entre les deux notes assénées par Lucas. Une fraction de temps, et une attente interminable, nul ne sait où il veut en venir, mais nous débouchons à l'endroit précis du chemin qu'il a choisi. Ce ne sont pas des notes qui sortent de sa guitare. Mais des cris, incisifs dont l'écho se promène en nous, mais lui il est déjà ailleurs. Plus haut, et le médiator retombe comme un aigle dans le cœur de Nuage Rouge, ou comme la foudre sur nos âmes transformées en paratonnerre.

Ayez le meilleur guitariste que vous voulez mais cela vous sera aussi inutile qu'une cigarette sans allumette. Vous faut aussi le chanteur. Qu'est devenu Cliff Gallup sans Gene Vincent ? Et ce soir Djivan ne chante pas, il est le pétrel dans la tempête, il se joue des vents et des modulations. Ne passe pas en force. N'assène pas les lyrics à coups de barre à mine. Il les pose. Juste l'écume sur le haut de la vague, mais qui en souligne toutes ses inflexions et toute sa puissance dévastatrice. Les chanteurs de rock ne chantent guère. Sont des metteurs en scène, s'apparentent à des réalisateurs de cinéma. Créent un monde. Interprètent tour à tour une comédie désopilante et puis nous engluent dans un drame sanglant. Les paroles s'impriment sur votre rétine, elles ordonnent des images, parce que la voix du chanteur fait office de lanterne magique. Tout est dans l'attaque, la pointe d'ironie, la levée de voix sardonique, l'hésitation complice, l'incitation au crime, et l'invitation à d'obscures copulations. Un sacré manipulateur de marionnettes le vocaliste rock, sa voix est le fil et vous le pantin articulé subjugué hypnotisé et consentant. Une fois que vous avez compris cela, vous n'avez plus de souci à vous faire. Et Djivan a tout pigé.

L'a quand même une double fonction, l'est aussi le contrebassiste du groupe. Y prend un réel plaisir. La penche du côté par où elle ne tombera pas, s'y vautre dessus comme un ruffian énamouré, mais la remet d'aplomb au dernier moment juste avant de céder à la tentation de lui faire subir les derniers outrages. Elle en miaule de rage comme une chatte insatisfaite qui voit le mâle qui se fait la malle et part en cavale avant d'accomplir son devoir procréatif. Elle aimerait s'étendre sur un djivan du salon en vue d'une plus grande coopération, mais non, alors elle feule de désespoir et clame à tous les échos sa profonde déception.

Mais il y a remède à tout, même à une frustration meurtrière. C'est Baptiste qui se charge de faire briller l'espoir. Sur son estrade il annonce à coups de grosse caisse la vente de l'élixir spermatique de remplacement. Possède une appellation suggestive, rock and roll, et il rocke et il rolle à jets discontinus de toutes ses baguettes. La plainte de la Big Mama est englobée dans un magma germinatif, sous le rocky chapiteau tous les miracles sont permis.

Babylone Baby, Oh ! Well, le set atteint à une dimension pharamineuse. Lucas se surpasse. Avec la chair saignante que lui hachent ses deux acolytes, il vous prépare des boulettes de viande empoisonnée qu'il vous lance à la figure comme on jette des graines salvatrices aux passereaux affamés dans les parcs municipaux en hiver. L'on se rue sur cette persillade, en hurlant. Dans la salle c'est le délire. N'y a plus qu'une foule fusionnelle qui ondoie en mesure. Alors Lucas se plante sur le devant de la scène, cinq secondes pas plus, juste le temps de lâcher les cinq plus vicieuses notes de la soirée, celles qui mordent au bas du ventre, et puis il repart en arrière, perdu en lui-même, en une explication sans fin avec sa Squier guitar.
I'm Mad, You got to Loose, Tough Love – un programme de l'attitude quintessencielle rock – ce sont les trois derniers morceaux que les trois chiens enragés des Howlin'Jaws consentent à offrir à la meute hurlante qui assiège la scène. Fini, terminé, Lucas éteint son ampli. Pas de rappel c'est la règle. Mais quelle énergie ! Nous ont transformé en punching ball et n'ont pas arrêté de nous taper dessus. Non seulement on a aimé, mais l'on en aurait redemandé. C'est ça le rock and roll ! Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Nul n'est parfait. Vive les Howlin' Jaws !
( Les photos correspondent au concert de l'American Tours Festival 2015 )
LA MOUCHE

Rien de plus énervant qu'un essaim de mouches qui bourdonnent autour de votre tête. Sont nombreuses Les Mouches, une bonne douzaine. Avec trombone à coulisse, trompette et clarinette, et tout le bataclan. Un côté cirque pagailleux, un côté festif délirium, une ambiance post-hippie, rock alternatif français. Tout ce que je n'aime pas. Me suis enfui dès le deuxième morceau. Je sais c'est lâche, mais c'est ainsi. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être ont-ils donné un show de toute beauté. Ce qui est sûr, c'est que le public acquis d'avance a dû être comblé. Mais je n'ai pas senti. Me suis fié à mon flair. Et puis après les Howlin' je n'avais plus besoin d'autre chose. Tout ce qui suivrait ne pourrait que se situer à un moindre niveau.
Je n'aime guère ceux qui mettent de l'eau hilarante dans leur rock. Le dosage n'est jamais évident. Faut être, soit trop naïf, soit très fort. Le burlesque est un art difficile. Faut d'abord avoir traversé le noir de la nuit le plus désespéré pour en sentir par delà les éclats de rire les facettes les plus lugubres. Et la bande de joyeux godelureaux sur la scène m'ont paru manqué de cette grotesque expérience métaphysique. Trop sûrs d'eux. Leur manquait d'après moi une certaine fragilité existentielle. Tout ces a-priori sans remettre en cause leur dextérité musicale, même que le guitariste n'est pas du tout venant. Se défend mieux que bien. Ce qui me semble manquer à ce genre de groupe, c'est qu'au milieu de leur syncrétisme, ils ont oublié l'importance des racines rock and roll. Je le répète, je ne suis pas sectaire mais je n'aime que le rock.
Damie Chad.
THE HOWLIN' JAWS
TOUGH LOVE / BYE BYE BABY
DJIVAN ABKARIAN : Double basse – Lead vocal / BAPTISTE LEON : Drums – Back vocals / LUCAS HUMBERT : Guitar – Back Vocals
Recorded Live at BLR Studio / Mixage : Mister Jull – Thibaut Chopin /

Dernier 45 tours des Howlin'. Z'avaient le look anglais sur la pochette du premier, tenue plus décontractée pour celle-ci, sales gosses qui se foutent de votre gueule avec leur casquette à hélice de Spitfire sur la tête. A la limite il n'y aurait pas besoin d'écouter. Avec le précédent, sont parvenus à créer une esthétique, des objets de collection. Le vendent à cinq euros l'unité, vu l'épaisseur de carton et la lourdeur du vinyl, c'est donné.
TOUGH LOVE : c'est du brut, d'ailleurs Baptiste commence à taper sur sa batterie comme une brute et Djivan vous a une gosse voix à le faire passer pour un ogre. Après cela, vous vous laissez emporter par la bête. Sauvage. Martèle du sabot, mais Lucas vous y plante de ces banderilles de guitare si acérées dans le dos que vous avez envie de les dénoncer à la SPA. Fermez les yeux ( mais pas les oreilles ) et vous êtes transportés en 63 en Angleterre quand les Animals et les Them commençaient leur expérimentation sur le blues. Oui mais les Howlin', la vivisection ils la pratiquent sur le rock and roll, et faut avouer que ça saigne. Avec ce Tough Love ils ont toughé le gros lot. Ah cette basse qui broute, ce drummin' qui vous empogne et cette salière de guitare à la nitro...
BYE BYE BABY : encore plus colérique, la guitare qui pique, la voix qui résonne, la batterie qui caracole, une face B qui se profile aussi meilleure que la A, les backin'voices qui plagient la lead, un petit solo de Lucas comme on les aime, quinze secondes et circulez, n'y a plus rien à voir, sold out, Djivan qui s'égosille et s'étrangle de fureur, c'est rempli de petites séquences, comme ces tombeaux égyptiens truffés de chambres secrètes, cherchez et vous trouverez toujours quelque chose que vous n'aviez pas visité avant. Du grand art. L'est pas prête de vous débarrasser le plancher la baby, on ne le dira pas, mais c'est vous qui la retiendrez longtemps sur le pick up.
Rien de pire que le vice. Me suis repassé le volume 1, le Sleepwalkin' et le Bumblebee sur le phono. Si vous voulez mon avis philosophique sur la question, si les Howlin' Jaws avaient huit autres titres de l'acabit de ces quatre, et si l'idée leur venait de tous les réunir sur un trente-trois tours, l'on aurait là un album essentiel du rock français d'aujourd'hui. Wait and see !
Damie Chad.
JIMI HENDRIX
RENAUD EGO
( Le Castor Astral / 1996 )
Il y a des jours où je ne peux pas me regarder dans un miroir. Plus de deux cent cinquante livraisons de KR'TNT et pas la plus minuscule notule sur Jimi Hendrix. Un trou de cette grosseur dans le gruyère, c'est un peu exagéré. Je le comprends, je plaide coupable. Je n'ai aucune circonstance atténuante. Ce petit volume déniché dans la bibliothèque tombe à point nommé pour réparer cette omission criminelle. Peut-être que quand je mourrai, à cause de cette impardonnable faute, le bon dieu me refusera le paradis. Je l'aurai mérité. Mais peu me chaut, en vérité je m'en fous d'être avec les fous, tous les rockers sont des grands pêcheurs, sont tous damnés pour avoir joué la musique du diable, sont parqués au fond le plus noir de l'Enfer. N'y sont pas malheureux, une éternité de concerts et de jam-sessions, que voulez-vous de mieux pour des rockers ? D'autant plus qu'il y a des millions de jeunes filles fautives dont il faudra s'occuper activement afin qu'un peu de réconfort moral leur permette d'oublier leurs turpitudes terrestres. Que ces projets d'avenir et de pieuses intentions ne nous détournent de la vie de Jimi, en cette vallée de larmes.

Tout de même une chose me console : faut attendre la cent quinzième page du bouquin pour trouver un résumé de la vie de Jimi. Très bien fait d'ailleurs, dans l'ordre chronologique et agrémenté de brèves citations d'interviews qui éclairent parfaitement la trajectoire du zèbre. Discographie, bibliographie, filmographies à la suite. Rien de pesant, sélectif et rien que l'essentiel. Je vois poindre la question sur vos lèvres : mais que trouve-t-on donc avant ? Mais la biographie de Jimi Hendix, voyons c'est évident mes chers Watson.
Je sens le trouble qui s'installe dans votre cerveau. Soit vous n'avez rien compris, soit vous avez raté un élément important. Ne doutez point de vous, vous n'y êtes pour rien, tout est de la faute de Renaud Ego. Renaud Ego n'est pas un musicologue averti. Est loin d'être un imbécile. A produit des tas d'ouvrages sur des sujets aussi divers que l'architecture ou l'art rupestre africain, mais ce ne sont-là que des cordes adjacentes de son arc. Avant tout Renaud Ego est un poète. N'a donc pas rédigé un livre sur Jimi, tiré au cordeau. Nous offre plutôt ce que l'on pourrait nommer une transcription poétique du guitariste. Pas un recueil de poèmes sur Jimi, non mais le mystère Jimi - commun à tous les individus, car souvent nos actes répondent à des logiques qui nous appartiennent mais que nous ne révélons à personne – tel qu'il fut appréhendé par ceux qui le côtoyèrent. Pas tout le monde, en choisit cinq, Mae, Carol, Harry, Kate et Jim lui-même. Qui ont accompagné son existence, de la naissance à sa mort. D'où sa propre présence à la fin, car l'on est toujours seul lorsque l'on rend l'âme. Des témoins qui se sont plus ou moins épanchés lors et après la disparition de l'idole. Mais ces témoignages n'intéressent guère Renaud Ego. Sont juste des jalons, des balises enregistreuses qui essaient de comprendre le pourquoi du comportement erratique de Jimi.

Jimi ou la difficulté de vivre. Renaud Egonomise, ne nous fait point l'apologie du vaudou psychédélique, les disques sont là et ne demandent qu'à être écoutés. Non, nous conte l'histoire de Jimi le bluesman. Nous connaissons le musicien étincelant, le sorcier de la guitare, l'artiste accompli qui bouscule les traditions et redéfinit les bases de la guitare rock. Le côté glamour de Jimi, les journalistes à sa traîne, les filles à ses trousses, ses tenues vestimentaires colorées, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Le plus important est caché dans les eaux froides d'une vie éteinte. N'est pas né avec une cuillère d'argent dans les molaires. Noir et de sang indien. La dénomination d'Injun Fender serait celle qui lui conviendrait le mieux. L'est un peau-rouge, un Cheval Fou sur le sentier de la guerre, mais après l'extermination, s'est échappé des réserves. N'est qu'un fuyard qui tente de survivre. Né dans la misère, sociale et affective. L'a très vite compris que pour s'en tirer, il doit décamper au plus vite. A tout prix, par n'importe quel moyen, parachutiste - autant dire traître scout qui sert dans l'armée qui opprime son peuple - et puis plus tard avec sa guitare sur le dos, ce qui peut remplacer un bon cheval.

Joue déjà comme un dieu, mais c'est davantage une malédiction. Les Isley Brothers et Little Richard n'ont besoin que d'un accompagnateur, doué mais qui ne la ramène pas avec ses soli incongrus et tonitruants. Ne sait faire que du bruit pour se faire remarquer. Faudra attendre la rencontre avec Muddy Waters qui lui refile le secret du blues en trois minutes. Suffit pas d'ameuter le quartier. Le silence entre les notes est aussi important que les notes. Peut-être davantage même.
L'a tout compris, l'est prêt. Pour toutes les aventures. Ne ratera pas la chance Chandler. Chas des Animals qui cherchaient à devenir producteur... mais qui n'avait personne à produire. C'est l'Angleterre et en quelques mois la gloire. Ne le sait pas encore mais ce n'est qu'une étape. L'a franchira en toute splendeur. Mais c'est le deuxième pallier qu'il ne parviendra pas à surmonter.

Tout nouveau, tout beau. Eric Burdon, Eric Clapton, le Jimi Hendix Experience, Are you Experienced, une flèche qui monte dans l'azur du ciel et qui semble attirée par des hauteurs vertigineuses. Mais l'on n'échappe pas aux lois de la pesanteur terrestre, les filles, les dealers, les pique-assiettes, Jimi ne sait pas dire non. S'empêtre dans sa célébrité. L'a tout ce qu'il veut. Sauf ce qui lui manque le plus. Lui-même. Un peu de solitude pour se retrouver seul en lui-même. L'a de la ressource, suffit qu'il s'enferme dans un studio pour catapulter de nouveaux chef-d'oeuvres. Qui ne sont pour lui que des hors-d'oeuvres. Porte en lui de multiples possibilités. L'est un artiste, un vrai, un créateur. Et la machine s'enraye, la musique est en lui, mais refuse de sortir. Lui faudrait du temps, de la respiration, un manager à visées moins commerciales, un peu moins de dope, un peu moins de fatigue, et stupidement ce soir-là, un peu moins de narcotique...
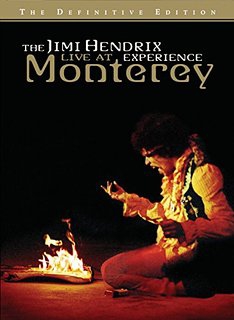
Robert Johnson est mort. On lui a volé sa vie. Toujours à courir devant sa chiennerie de vie qui le rattrape sans cesse. Au tournant, dans les lignes droites et sur le fil rouge de l'arrivée. Jimi Hendrix est mort. S'est fait voler sa vie. N'a pas su la garder pour lui. Difficile quand on ne l'a pas appris dès la naissance. Antonin Artaud dirait : suicidé de la société. Nous, l'on a inventé le mythe du club des 27. Mysticisme de pacotille. Une précaution oratoire en quelque sorte. Je parle pour nous. Nous n'aimons guère les miroirs qui nous ressemblent. Nous aussi, nous nous faisons, nous nous laissons, voler notre existence. Nous aussi sommes des anges exterminateurs, des goules insatiables, qui se repaissent du sang de leur entourage.
L'écriture poétique de Renaud Ego agit comme un scalpel, comme un révélateur. Un très beau livre que je vous engage à lire.
Damie Chad.
04 / 11 / 2015 – FRANCE INTER
TUBES AND CO
REBECCA MANZONI
Ma vie est une souffrance sans cesse renouvelée. Je ne plaisante pas. Je peux même vous donner l'heure. Tous les matins, à sept heures dix-huit minutes exactement. Moi pauvre victime innocente une cruelle torture m'est ainsi infligée à l'instant de mon petit déjeuner. Alors que je trempe généralement ma vingt-septième biscotte dans mon bol de café. Vous livre le nom de ma tortionnaire, Rebecca. Jusqu'à son apparition sur les ondes de France Inter, la seule radio captée sur les ondes du trou géologique provinois, tout va bien dans le monde. Une petite guerre par ci, un attentat par là, les impôts qui augmentent, une épidémie en préparation, des élites qui se remplissent les poches, des dizaines d'usines qui ferment, des sans-logis qui dorment dans la rue, pffft ! des broutilles. Le genre de facéties qui ne vous coupent point l'appétit. Et c'est-là que survient la Manzoni. Ne veut que votre bonheur. Sous prétexte que la musique adoucit les moeurs, elle nous présente selon ses humeurs, un chanteur, une chanson, un style. Ce n'est pas bien long. La plupart du temps, vous avez juste droit à l'intro du morceau, puis elle cause par-dessus. Ce n'est pas bien grave. En règle générale, aux heures de grande écoute les programmateurs de la radio nationale ont des goûts détestables. Ils s'en vantent. Se prévalent d'un label de qualité, une authentique certification NF à les en croire, vous pouvez écouter les esgourdes fermées, l'on vous assure que c'est du bon. Résultats vous avez droit à un, et de préférence une, asthmatique de service qui essaie de couvrir de son maigre filet de voix les éructations funèbres d'une piteuse orchestration électro.
Mais il ne faut jamais désespérer de l'humanité. J'ai évité la mort subite du nourrisson, je ne sais comment. Toute fière, Rebecca Manzoni nous annonce le titre de sa prochaine séquence : Be Bop A Lula !

BE BOP A LULA
De Gene Vincent se hâte-telle d'ajouter. En deux minutes et demie, elle s'en sort plutôt bien, le morceau composé sur son lit d'hôpital, l'accident de moto, parvient même à citer la guitare de Cliff Gallup et les balais de Dickie Harrell, son influence sur le rock européen, notamment anglais et français, et la fin amère dans la solitude et la misère... Crayonne une silhouette, peu, trop peu, à peine esquissée, mais assez toutefois, pour donner au néophyte l'envie de chercher, d'écouter et d'en savoir plus.
Assez rare pour être signalé.
Damie Chad.
00:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ash, the wave chargers, the howlin' jaws, jimi hendrix, be bop a lula


