30/10/2014
KR'TNT ! ¤ 207. WISE GUYZ / STAX STORY / ROCK AND ROLL REVUE / PERMAFROST / PASCAL ULRICH
KR'TNT ! ¤ 207
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
30 / 10 / 2014
|
WISE GUYZ / STAX STORY / ROCK AND ROLL REVUE PERMAFROST / PASCAL ULRICH |
BETHUNE RETRO / 30 & 31 - 08 - 14
LA SAGESSE DES WISE GUIZ

On avait ouvert les paris. Qui veut miser sur les Wise Guyz ?
— Des Ukrainiens ? Bof ! Y vont chanter avec un mauvais accent et ça va nous faire mal aux oreilles !
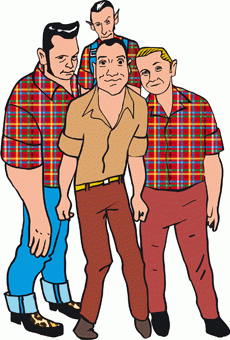
Personne ne voulait parier sur eux. On avait déjà vu jouer les Russes de Diamond Hand et on restait sur notre faim. Ou plutôt sur nos vieux a-priori. Un groupe de rockab, ça venait forcément de Tennessee, ou au pis aller de Californie. Mais pas des pays de l’Est ! Allons soyons sérieux, les gars ! On ne s’était pas tapé le voyage jusqu’à Béthune pour enfiler des perles ni ramasser les copeaux. On était là pour entendre battre le cœur du vieux rockab. Quelques bières par là-dessus pour réhydrater les vieilles convictions et c’était reparti. Jusqu’à la fameuse place du beffroi.

Ils sont arrivés sur la grande scène en plein milieu de l’après-midi. Le chanteur portait un polo rayé, se coiffait comme Eddie Cochran et jouait sur une Gretsch brune. Assis derrière, un gros batteur dominait la scène. À sa droite, une espèce de gravure de mode grattait une sèche au manche pointé vers le sol. Et de l’autre côté, un mec d’apparence banale s’occupait du cas d’une vieille contrebasse. Et dès le premier morceau, ils ont conquis la ville. Ce chanteur qui s’appelle Chris Bird à l’état pas civil bouge et joue comme Eddie Cochran. Il a tout de la superstar : l’aisance scénique, le sourire en coin, le son de guitare, la voix, il a le bop dans le sang et une classe insolente. C’est lui l’héritier de Charlie Feathers, il faut voir comme il percute ses hiccups au coin du bop. Et pendant une heure, ils firent swinguer le vieux beffroi qui n’avait pas connu de tels frissons depuis la grande époque des bourreaux de Béthune. Chris Bird et ses amis reprenaient les choses exactement là où Charlie Feathers les avait laissées. Il y avait quelque chose de fascinant et même de sacré dans leur set. Le rockab redevenait l’évidence même. On sentait que ces mecs avaient travaillé, bien sûr, mais ils avaient en plus le petit quelque chose qui fait toute la différence : la classe, et comme Carl & The Rhythm All Stars, ils savaient mettre toute leur énergie au service des violentes montées en température. Ils jouaient et tout redevenait simple. Si on écoute du rockab, c’est bien pour sentir quelques frissons cavaler sous la peau, pas vrai ? Sinon à quoi ça sert ?

Sur le chemin du retour, on fit un test en écoutant l’un de leurs CD achetés sur place. Car figurez-vous que nos amis ukrainiens sont prolifiques, côté albums.

— Bon d’accord, ils sonnaient bien sur scène, mais en studio, tu vas voir, ça fera comme d’habitude... Ça va retomber comme un soufflet.

Pas du tout. Non seulement ils ont shooté un big hit de bop dans la fesse molle du festival, mais en plus, ils font exploser la métaphore du soufflet et nos derniers a-priori. Ces mecs sont des diables, qu’on se le dise ! Au moyen-âge, ils auraient bouffé tout cru les moines de la sainte Inquisition. Aujourd’hui, ils se contentent de nous bouffer la cervelle.

«Don’t Touch My Greazy Hair» est un album qui date de 2010. Ils attaquent avec le morceau titre et on voit bien qu’ils sont énervés comme des tétards dans une mare. Il faut voir cette cabale de niaque d’Ukraine que nous slappent ces mecs ! Ils gimmickent tout ça à l’alerte rouge et piquent le bop dans la veine bleue du rockab. À la scène comme à la ville ! Ils enchaînent avec un «It’s Not Right» sacrément joué serré. Quelle science du ton ! Quel beau slap bien rond ! Chris Bird chante avec une classe épouvantable, celle d’Eddie, avec le chaloupé et le rictus interne, l’espèce de petite hargne des sales mecs d’Amérique. Il chante avec l’accent qui tranche et la mèche grasse collée à l’arrière. Quand on écoute «Heat», on est effaré par la classe du jive. Il colle au beat comme le sparadrap colle au doigt du capitaine Haddock. Il swingue dans l’épaisseur du groove et derrière ça ronronne au trombone. Il développe une démesure d’aisance ukrainienne. Chris Bird est un swingueur infernal et il nous gratifie d’un décollage de fin de cut effroyable. Tous les morceaux de cet album sont excellents. Il va dans tous les coins et ramène chaque fois un trésor de pirate rockab. «Jukebox Jumpin’» est une swinguerie d’une violence terrible. Ils tapent dans la dépouille du swing des murs de brique de la vieille Ukraine. Brian Setzer devrait aller faire un stage chez eux en Ukraine. Chris Bird hiccupe son «Rock Me Baby» à la Feathers. On voit bien qu’il est le fils spirituel du vieux Charlie. Et ça repart à fond de train avec un «I Wanna Be (With You)» slappé à la vie à la mort par un démon nommé Rebel, celui qu’on a vu sur scène à Béthune. «Moonlight On The Dark» est strummé de façon magnifique et même mirifique, c’est bourré de climats secondaires et chanté comme dans un rêve. Nouvelle tempête avec «Kissin’ Is On My Mind» et le festival se poursuit avec «Really Rocket» qui bascule dans la folie. Chris Bird déclenche l’enfer sur la terre. Il est bel et bien le rockabilly man dont rêvent tous les amateurs. Il rivalise de folie pure avec Jerry Lee et Johnny Burnette. Retour au mid-tempo avec «Girls Babies Chicks And Hunnies», le beat est là, brillant et ardent. Chris Bird fond dessus, comme l’aigle sur sa proie. «Hold Me Baby» ? Vous voulez un avis impartial ? C’est infernal. Les Ukrainiens démontent tout simplement la gueule du mythe. Ce cut est d’une violence hallucinante et il bascule de lui-même dans le swing avec un Chris Bird collé au micro par la bave du commando qui prend le bop d’assaut. Ces mecs sont trop puissants, alors on ne comprend plus rien. Cet album est beaucoup trop explosif, trop bien foutu. Et ce n’est pas fini. «Love Me Or Leave Me», c’est l’hallali du rockabilly. Cette fois, ils explosent comme Little Richard. C’est dire la réalité de leur puissance. Un sax entre dans la purée. Leur truc va bien au-delà de toutes les espérances. Et ils finissent avec «Goodbye Baby», encore un bop énorme. Chris Bird tire l’overdrive d’un coup sec, alors on sent la poussée dans les reins et ça rebascule dans la folie des wild cats. C’est halluciné au strum de stand et au chant de classe qui claque. C’est à tomber. Alors on tombe. Chris Bird est le Real King des temps modernes.

On approche une main tremblante de «Stay Cool» paru à la suite. Va-t-on se risquer à écouter un autre album des Wise Guyz ? Comme toujours, la curiosité l’emporte sur la prudence. C’est l’époque où le batteur Ozzy jouait encore de la rhythm guitar. Ils attaquent avec «Baby Let Me Rock» et on retrouve leur flagrante solidité et ce fabuleux blue boot de jive. Ils ressortent le vieux strumming des sous-bois de l’Arkansas pour «Rude Bad Boy» et secouent ça aux cacahuètes. Chris Bird connaît la bonne patate boppique par cœur. On voit ses jambes gigoter dans le grand pantalon de flanelle fanée. S’ensuit un coup de Jarnac avec «Do The Crab». Montana là-dessus baby et tu verras mon bop. Oh les belles montées de violence rockab ! On se croirait au cinéma. C’est frappé, secoué, énervé et fatidique. Chris Bird est un mec qui sait frapper là où ça fait du bien. Avec «Take A Rest», ils tapent dans l’instro jazzé. Il y a dix mille fois plus de jus dans le jeu de Chris Bird que dans toute ta philosophie, Horatio. Ce mec joue le bop manouche à contre-courant, il va chercher l’excellence dans l’étendue de la principauté et il jazze avec une renversante prodigalité. Encore une pièce hallucinante de véracité swinguy : «Why Don’t You Dance With Me». Il va chercher le son du swing dans l’énormité cavalante de son qualitatif personnel. Ces quatre mecs jouent le swing et le rockab comme des dieux. Ils se baladent. Ils font exactement ce qu’ils veulent. «Jumpin’ Record» reste dans la même veine. Ils ont du jus à ne plus savoir qu’en faire. Chris Bird rentre une fois de plus dans l’exercice de la violence boppée, il conduit son cut comme un pilote de course - yeahhh - c’est puissant, envoyé et fumant. Il est au chant ce que le nuage est au paradis. Il refonde le bop de base. Il faut voir comme il attaque «I’m Not Crazy» ! On a tout ce qu’on désire avec les Wise Guyz : le chant copain et le tranchant du timbre. Les mauvaises langues diront que ce mec est beaucoup trop doué pour être honnête. Encore une belle leçon de mise en place avec «Rock It Baby Rock It». Chris Bird est dessus, dès la première mesure. Pas d’impair, il est le roi du swing. Il le prend par devant et par derrière, sans faire de manières. Encore une merveilleuse pièce de swing avec «Oh Love Me Baby» battue comme plâtre et la fête continue avec «Jukebox Jumpin’». Ils nous achèvent avec un spectaculaire «Stay Cool» d’assise plombée.

On trouve un troisième album chez El Toro, «Let’s Rock The Floor». Les titres des albums sonnent un peu plan-plan, mais les morceaux sont tout sauf plan-plan. «Honky Tonk Boogie» renoue avec la prodigieuse dynamique du rockab supérieur. Les Wise Guyz sortent là une prodigieuse merveille d’équilibre de bop et de chant de timbre mûr. Chris Bird sonne vraiment comme une star. Dans le morceau titre, il prend la suite d’Eddie. Il a la voix qu’il faut pour ça. Son rockab est tout de suite crédible et même digne de la pire teigne de gamme de chauffe. Quel départ en solo ! «Do It Slow» fait partie des cuts qu’ils ont joué à Béthune - do it slow ah-ah - just a little up-up duhh wirrr - Chris Bird manie l’onomatopée avec une virtuosité spectaculaire. Ils passent «Time Is Really Gone» sous le manteau, histoire de faire un point bas sur l’album. Mais Chris Bird captive encore plus dans les petits cuts impassibles. Puis il passe au boogie jive avec «Treat Me Like I Say» et balance un solo dévasté à la note claquée. Il reprend son chant de roi du swing de syllabe écrasée, il arrache les i de boogie avec une classe indécente. On reste dans l’excellence avec «Baby Let Me Rock», merveille absolue, pur génie rockab du niveau de «One Hand Loose». Encore du beau slap de swing dans «Rockin’ New Year». Chris Bird ne peut être que la réincarnation de Charlie Feathers. Il a tout de lui, la classe, les accents, les réflexes. On tombe un peu plus loin sur «What’s Wrong With Me» monté sur un gimmick de dingue. Encore un disque dont on sort hagard.

Autant rester dans l’hébétude pour entrer dans le suivant. «Hot Summer Nights» qui est leur dernier album monte encore d’un cran dans l’explosivité des choses. Ça démarre avec «2 AM Rock» et un chant de coups de menton, de syllabes broyées et un bop du diable. Chris fait son Charlie et joue comme Eddie. Il outche à la cantonade, il écrase ses piétons et déboîte sans clignoter. «Miss Chris» sonne comme un petit bop de l’Oklahoma. Ça swingue du snap de bopping Cadillac et ça gomine dans la grease - yahhh - on frise le rodéo de batmobile vert pistache. Chris pose sa voix comme le ferait un cake de soda shop et on voit ses genoux twister dans la flanelle du grand futal. Il va chercher l’authenticité rockab dans le fond de sa gorge en or. «Bop Disease» est un fabuleux beatin’ de bop. Comme il a chopé la chtouille du bop, il nous la refile par les oreilles. Il râcle ses retours de couplets au sang de la glotte, il crache son mollard magique et réinvente la délinquance juvénile. Encore du bop dément avec «Do It Bop», l’un des temps forts du concert. C’est d’une sauvagerie spectaculaire. Chris hiccupe le chant à la mort du petit cheval, épaulé par une prodigieuse section rythmique. Tous les morceaux des Ukrainiens sonnent incroyablement juste. Ça finit par troubler l’esprit. Encore du catchy en diabolo avec le morceau titre. Pure exotica, cadeau royal du grand Chris Bird et de ses amis Rebel, Ozzy et Gluck. Avec «How Long», ils jouent avec la classe comme d’autres jouent à la roulette russe. Clack ! Oh t’as de la chance ! Vas-y recommence pour voir... Chris Bird et ses amis gagnent à tous les coups. Pour «Catch Your Wave», ils vont chercher du torride à la Jezebel. Chris Bird a le diable dans le corps. C’est un merveilleux contender de la prétendance. Puis il retourne au cœur de la folie rockab avec «Diggin’ The Boogie». Il épouse l’esprit sacré de Charlie Feathers en noces royales. Il se fond dans l’alchimie du bop. Les Wise Guyz font de l’or en barre. Ils reviennent au swing avec «What’s On Your Mind». Chris prend son temps. Il n’est pas pressé. Il est pour l’instant la star de l’underground ukrainien.

Avec son polo rayé, son sourire de Bibi Fricotin, sa classe de môme des rues, sa façon de bouger, sa voix et son jeu de guitare, Chris Bird régnait sans partage sur le festival.
Signé : Cazengler, guyzé dans les tranchées
Wise Guyz. Béthune Rétro. 30 & 31 août 2014
Wise Guyz. Don’t Touch My Greazy Hair. El Toro Records 2011
Wise Guyz. Stay Cool. El Toro Records 2011
Wise Guyz. Let’s Rock The Floor. El Toro Records 2013
Wise Guyz. Hot Summer Nights. Selfmade Records 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Ozzy, Gluck et Chris Bird. Derrière : Rebel
|
C'est pire que les oeuvres croisées d'Aragon et d'Elsa Triolet, mais pour l'article précédent vous pouvez vous reporter à la chronique du concert des Wize Guyz à Parmain ( livraison 205 du 25 / 09 /14 ) de Damie Chad, mais pour l'article suivant nous vous recommandons de relire l'article de Cazengler le staxkhanoviste ( livraison 169 du 26 / 12 / 13 ) sur la saga des enregistrements Stax en Stock. |
SWEET SOUL MUSIC
RHYTHM AND BLUES &
RÊVE SUDISTE DE LIBERTE
PETER GURALNICK
( Editions Allia / 512 pp / 2OO3 )
Dedicated to my Black Beloved Scott Salsa Molossa,

Troisième tome de Peter Guralnick consacré à la musique populaire américaine. Nous avons déjà chroniqué les deux premiers Feel Like Going Home et Lost Highway ( voir KR’TNT 32 & 37 des 23 / 12 / 10 & 27 / 01 / 11 ) qui traitent respectivement du blues et de la country en ses déclinaisons les plus rockabillesques, parus chez Rivage Rouge. Celui-ci fut rédigé durant la première moitié des années 80 à partir d’une centaine d’interviews d’artistes et de protagonistes des plus impliqués dans l’émergence de ce qui s’étiqueta très vite sous l’appellation contrôlée de soul music afin de se démarquer un peu artificiellement du rhythm and blues originel. Rédigé après le sommet de la vague mais assez près de son acmé pour que les différents témoins interrogés soient encore clairement conscients de leurs volitions et de leurs intentions d’alors.

Dans une introduction un peu trop longue à notre goût Guralnick se présente à l’orée de ses travaux comme un jeune américain idéaliste qui pense que le rhythm and blues fut avant tout une musique de révolte et de rébellion de la communauté noire envers l’oppression raciste dont elle était victime. A dû abandonner sa vision romantique du phénomène au fur et à mesure qu’il poursuivait son enquête. Les principaux acteurs ne cachent point que l’argent et le profit furent la plupart du temps à la base de leurs actions. Des noirs aussi voraces que des blancs, voilà qui remet en cause les schémas de gauche bien-pensants. Mais il advient parfois que les conséquences de nos actes nous entraînent beaucoup plus loin que nous ne l’avions envisagé. C’est que nous sommes souvent actés par des logiques qui nous dépassent de beaucoup et qui restent très souvent hors de portée de nos schèmes d’intellectualisation.
SAM COOKE
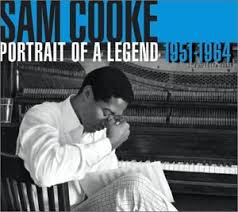
Un chanteur exceptionnel. Mort trop tôt. Assassiné. Les noirs veulent y voir une élimination tordue en bonne et due forme, la voix des ghettos définitivement bâillonnée. La réalité serait beaucoup plus sordide, une rencontre emmenée dans un motel de vingt-cinquième zone qui se fait la malle pendant que la star prend un bain. Sam pète une durite et s’en prend à la tenancière de l’établissement paniquée qui se défend en dernier ressort à coups de revolver. C’est J. W. Alexander l’ami et le complice du chanteur qui relate l’affaire ainsi…
J’ai plusieurs fois tenté d’aimer Sam Cooke. Injection à forte dose quasi-létale de cookeaïne, à ma grande honte j’avoue que je reste des plus réservés. Trop cool, trop crooner pour mes penchants de rocker. Mais c’est moi qui dois avoir tort, tellement d'artistes que j’aime qui s’en réclament que je dois passer à côté. Mais Cooke fut le premier des transgresseurs. C’est lui qui traverse le fleuve de l’enfer qui sépare les Champs-Élysées du gospel du monde infernal des vivants. Presley aura la même démarche mais tout le monde s’en fout. Les blancs n’ont jamais attendu grand-chose du bon Dieu. Pour les noirs il reste le grand dispensateur des consolations. Les aficionados du gospel sont persuadés qu’ils gagnent leur paradis en portant leur lourde croix en ce monde d’injustices et de souffrances. Toute une partie de la communauté noire est adepte du gospel. Sont des croyants sincères - en d’autres termes des imbéciles manipulés - qui assistent à des concerts de musique sacrée. Les chanteurs sont partie prenante de ce christianisme puritano-transique. Ce n’est pas un hasard si la nouvelle forme du rhythm and blues issu du gospel qui se profile à la fin des années cinquante se nommera la soul music.
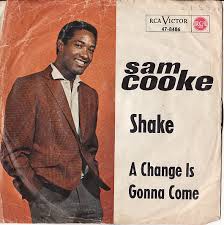
A avoir un bel organe autant le tremper en d’autres endroits que dans de l’eau bénite. Groupies, belles voitures, le diable est un grand tentateur. Sam Cooke succombe à toutes les succubes du monde profane… Meurt donc trop tôt mais il a eu le temps - après avoir entendu le Blowin In The Wind de Bob Dylan - d’enregistrer en 1964 A Change Is Gonna Come qui en fait un champion de la cause noire alors que débute la lutte pour les droits civiques et surtout Bring It On Home To Me un titre porteur d’une fabuleuse incandescence qui deviendra via les Animals un classique repris par nombre de groupes rock…
RAY CHARLES

Chronologiquement il se situe avant Sam Cooke mais ce dernier est si près de l’interprétation du gospel que Ray paraît ne venir qu’après. C’est pourtant bien son I Got A Woman dès 1953 - reprise par Presley en 1956 - qui marque la rupture irrémédiable avec le gospel puisque le morceau n’est que la reprise d’un vieux cantique mais au lieu de rendre hommage à l’amour divin il s’abaisse à dédier sa frénésie endiablée à la charnélité concupiscente d’une pécheresse…
S’est toujours voulu un homme seul. Ne rejette la faute sur personne. Orphelin, aveugle à l’âge de six ans à la suite d’un coma traumatique pour avoir vu se noyer son frère dans le baquet à lessive familial, il assume son destin sans jamais en rejeter la faute sur quiconque ou la société. De même il revendiquera son addiction de vingt ans à l’héroïne en tant que choix personnel en toute conscience des dommages adjacents. N’empêche que de bonnes fées se sont penchées sur son éclosion d’artiste. Bumps Blackwell le patron de Specialty - l’on retrouve son nom sur nombre de standards de Little Richard - et surtout Ahmet Ertegun et Jerry Wexler les deux grands pontes du petit label en train de grandir : Atlantic. Ces deux deniers inaugurent à son encontre une ligne de conduite qui pourrait sembler étrange : lui laisser faire ce qu’il veut, ne pas intervenir jusqu’à ce qu’il trouve la formule explosive qui fera de lui the Genius, le great Ray Charles.

Ray Charles refusera d’endosser toute paternité rock and rollienne, fidèle à sa ligne de conduite il ne veut rien avoir à voir avec cette nouvelle musique dont il laisse l’invention à ses propres créateurs, Little Richard, Bo Diddley, Chuck Berry. Par contre lorsqu’il signe chez RCA, il est en avance de deux générations de rockers : vingt-cinq pour cent de droit, liberté de création, son propre label, et la propriété de ses masters. Beau score pour un noir ! Mieux qu’Elvis !
SOLOMON BURKE
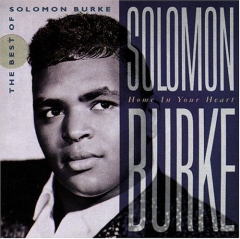
Troisième grand ancêtre de la Soul, Solomon Burke. Décédé en octobre 2010 après avoir enterré toute sa descendance. Certains le placent au niveau voix au-dessus de Sam Cooke. Au-dessus de Roy Hamilton qu’admirait tant Presley. Possède d’ailleurs un organe similaire au roi du rock : toute la gamme du ténor jusqu’aux graves du baryton. Mais son début de carrière fait penser au Colonel Parker. Un obsédé du fric. Profite des interminables trajets des tournées pour vendre de l’eau et des sandwichs à ses acolytes tout en augmentant les prix au fur et à mesure que le soleil tape. Mais il faudrait lui donner le grade de Maréchal tant il dépasse de dix mille coudées l’impresario d’Elvis. Possède ses drugstores et son entreprise de pompes funèbres. N’hésite jamais à mettre la main à la pâte froide. Une Eglise aussi, fondée par sa mère, dont il est prêtre et prêcheur, qui revendique 40 000 paroissiens qu’il visite lors de ses déplacements musicaux. Les grands-mères lui mijotent du chiken fried pendant qu’il saute leurs petites-filles. Un homme très occupé. Parviendra à être deux fois plus gros que Fats Domino et à inspirer le délire mégalomaniaque des mise en scènes de James Brown. Le camelot de la soul, le bonimenteur du rock and soul, mais à l’heure de sa mort, pas une voix ne s’est élevée pour lui retirer sa couronne de roi. L’a traversé le siècle, la foule prosternée à ses pieds, dans un rêve de grandiloquence un peu écorniflée vers la fin, mais comme pour le passage de la Mer Rouge pour Moïse, les flots de la moquerie universelle se sont retirés devant ses pieds. Avec lesquels il a toujours pataugé dans les plats de l’outrancière splendeur de sa bonhommie carnassière.
STAR STAX

La fondation de Stax relève du pur amateurisme. Estelle Axton et Jim Stewart ne sont en rien des fanatiques de rhythm and blues. Jim est l’archétype parfait du petit blanc. Qui prend garde de ne pas frayer avec les noirs. Aucunement par idéologie raciale mais ils ne sont pas de son monde. Gratouille du violon dans des groupes de western swing qui gravitent autour de Memphis. Mentalité de comptable et adepte du do it yourself. Typiquement américain. Comme il adore bidouiller les magnétophones l’idée d’enregistrer un disque lui vient tout naturellement. Ce sera Blue Roses que toutes les radios du coin refuseront de passer. Le bide, mais sans le savoir il vient de mettre en route un maudit engrenage dont il n’a aucune conscience. Nous sommes en 1957, l’année du premier Spoutnik, le label de Jim Stewart portera le nom opportun de Satellite. Nous sommes en 1957. C’est un jeune musicien Chips Moman qui produira le disque de Jim. Tout jeune mais pas tout à fait né de la dernière pluie : à vingt et un ans il a déjà accompagné sur scène Gene Vincent et Johnny Burnette. Une dizaine d'années plus tard il dirigera les fameuses séances d'Elvis lors de son retour sur le devant de l'actualité, en fin de sixties.

C’est alors qu’intervient Estelle, pour que les futurs disques de son frère aient un son moins maigrelet elle s’endette pour acheter du matériel d’enregistrement de qualité. L’aime bien son petit frère… mais encore plus son fils Packy qui a monté avec des copains du lycée un groupe les Royal Spades. Avec déjà Steve Cropper et Charlie Freeman. Des petits blancs qui jouent du rhythm and blues avec section de cuivres, tout comme les noirs. Packy fou de bonne musique ne juge pas les musiciens à la couleur de leur peau… C’est en partie grâce à lui que le cross over des deux communautés s’effectuera sans trop d’anicroches dans ce qui deviendra le chaudron Stax. Les Royal Spades se risquent à jouer dans les clubs exclusivement réservés aux noirs. Et à l’époque ce n’est pas une démarche évidente.

Satellite vivote mais mentalité américaine oblige, yes we can, tout le monde bosse comme des tarés. C’est un transfuge de Sun qui va mettre le feu aux poudres. Rufus Thomas déboule dans les studios avec sa fille Carla. Etrange destinée de ce musicien qui après avoir aidé Sam Philips à mettre au point le fameux son Sun se retrouvera au départ de l’aventure des futurs disques Stax. Le duo qu’il enregistre avec Carla marchera assez fort pour attirer l’attention de Jerry Wexler et des disques Atlantic. Mais c’est avec Gee Whiz de Carla enregistré en novembre 1960 qui cartonne à un million d’exemplaires que le label prend toute son importance.

Local à Memphis dans un ancien cinéma, aujourd’hui transformé en musée, studio d’enregistrement au fond, et vente de disques - toutes marques rhythm and blues - dans la salle de devant, Stax ( ainsi rebaptisée pour éviter un procès avec une compagnie de disques plus ancienne possédant déjà le nom de Satellite )est une petite entreprise qui ne demande qu’à confirmer son premier coup d’éclat. Faudra six mois de travail acharné pour parachever Last Night, un instrumental des Royal Spades rebaptisés Bar Keys sur lequel tout le monde travaille à temps perdu, notamment une section de cuivres composés de musiciens noirs locaux… Last Nigth fondera définitivement la célébrité de Stax . Une méthode de travail. Chacun est une pièce unique mais nul n’est irremplaçable. Suffit d’être là par hasard ou par calcul, lorsque une session se met en place, musiciens, arrangeurs et paroliers se prêtent la main et s’entraident sans arrière pensée. Bien sûr il y aura des révisions déchirantes, des fâcheries peu amènes, des remises en question plus ou moins brutales, mais dans l’ensemble tout se passe pour le moins pire dans le pire des mondes. Enfin presque, les musiciens maisons Booker T and the MG’s enregistrent Green Onions, l’entreprise gagne son premier million de dollars, Chips Momam est mis à la porte par Stewart… Plus facile à renvoyer que l'envahissant Packy qui reste le fils chéri de sa sœur et qui n’en fait qu’à sa tête.
CASTAXPULTE
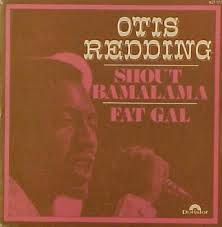
Otis Redding entre chez Stax par la petite porte. En soutien moral au guitariste Johnny Jenkins qui s’en vient au studio directly from Macon pour enregistrer un hit. La séance tourne au désastre, Jenkins, ne parvenant pas à décrocher la tonalité idoine, jette l’éponge au bout de deux heures et demie, quand ça ne veut pas, inutile de s’entêter. Autant profiter de la demi-heure restante avec ce tocard d’Otis qui n’a été jusqu’ici capable que d’enregistrer un copié-collé de Little Richard, l’artiste maconien de référence. Superbe morceau d’ailleurs, mais à l’époque personne ne voulut écouter deux fois de suite son Shout Bamalama. Par contre avec son These arms of mine, mis en boîte illico presto l’unanimité est de mise, la soul music vient de trouver son nouveau maestro.

L’histoire se répète. Les loups sortent du bois dès que le petit chaperon rouge se met en tête de le traverser. Vous le connaissez déjà, c’est Jerry Wexler des disques Atlantic. Un malin, pourquoi se prendre la tête à trouver le son soul dans les locaux d’Atlantic alors qu’on vous l’offre clé en main dans les studios Stax. Cela s’appelle de la sous-traitance. Ne refile pas de gnognote aux studios de Memphis, d’abord Sam and Dave - bientôt Otis refusera qu’ils soient dans les mêmes tournées que lui tellement ils cassent la baraque, et carrément le caïman dans l’aquarium, Wilson Pickett in person, un mauvais sujet ( perso je le préfère à Otis ) de la nitroglycérine en perpétuel état de choc, que l’on s'empressera de renvoyer à Wexler pour incompatibilité d’humeur. C’est la version officielle. Officieusement l’on dit que Jim Stewart ne partage pas équitablement les royalties avec Wexler. Inutile de vous mettre à pleurer, Stax est au faite de sa puissance, l'énergie génitrice du Rhythm and Blues et de la Soul. Le carnet de commande est plein jusqu’à ras bord… quant à Jerry Wexler il tient déjà sa solution de remplacement…
MUSCLE SHOALS

L’histoire recommence. Dans l’état d’Alabama, le plus raciste des Etats Unis. Un groupe de jeunes blancs se met dans la tête de s’enrichir en éditant des chansons, puis comme peu de monde s’intéresse à leur catalogue en les enregistrant eux-mêmes. Faudra plusieurs années pour que la sauce prenne. Des essais, des ratés, des échecs, des rencontres, des découragements, des gagnants et des perdants. Mais lorsque au début des années 60 Rick Hall finit de construire son studio, Fame à Muscle Shoals, il possède autour de lui un vivier de musiciens pour beaucoup destinés à devenir célèbres dans le monde du Rhythm and Blues. C’est évidemment vers Muscle Shoals que se dirigera Jerry Wexler après Stax. N’arrive pas là par hasard. L’a déjà aidé Fame à commercialiser son premier gros succès When A Man Loves A Woman de Percy Sledge… Son flair ne l’a pas trompé, c’est là que diligenté par ses soins Wilson Pickett enregistrera en quelques jours Land Of Thousand Dances. Wexler qui techniquement n’y connaît rien mais qui est un merveilleux entraîneur d’hommes dynamise et dynamite l’équipe qui papillonne autour du studio - car le miel attire les abeilles butineuses - notamment le songwriter Dan Penn, ce blanc qui chante mieux que les noirs, qui leur fabrique des démos insurpassables, et qui s’allie, regardez comme le monde est petit, avec Chips Moman qui profitant de son expérience glanée dans les deux plus grands lieux ryhthm and blues du pays est en train de mettre sur pied son propre embryon de studio à Memphis crânement nommé American… sous les yeux très intéressés de Hall et Wexler, ce dernier toujours prêt à vous aider si vous pouvez lui faire gagner de l’argent.
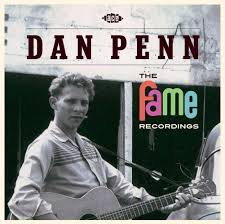
JAMES BROWN
Un de mes amis se plaignait de son sort. N’avait pas eu la chance de se trouver at the right place in the right time. N’était pas parmi les badauds lorsque James Brown courait dans la rue après sa femme en lui tirant dessus au revolver. Ne prenez pas une mine outragée, messieurs, depuis le temps que vous rêvez de faire de même avec votre tendre épouse. Seulement vous, vous n’osez pas. C’est toute la différence entre vous et James Brown.
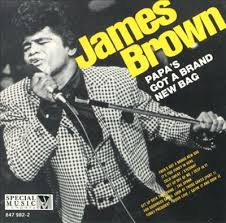
L’on ne peut pas dire que James Brown ait bouffé de la vache enragée, tout petit. Pour la simple raison qu’il n’y avait même pas un vieil os de bœuf à sucer à la bicoque. Cireur de chaussures à dix ans fut peut-être son métier le plus enviable à l’époque. S’est mis à danser pour arracher quelques piécettes aux passants. Le James Brown show vient de loin… Le soul brother numéro 1 s’est fait tout seul. Contrairement à Stax et Fame de Muscle Shoals qui furent des aventures collectives montées sur le modèle des auberges espagnoles, James Brown ne dut son succès qu’à sa persévérance. The american one self made man's man's man's world c’est lui. Tous les autres ne sont que des menteurs. Une fois arrivé il a fièrement revendiqué le titre de capitaliste noir. Un pied dans le système, et l’autre pour lui botter le cul. Ambivalence idéologique. Faut savoir gérer et assumer la dialectique des contradictions.
L’a marné pendant dix ans avant de percer. Ses disques il les enregistrera au forceps, les finançant parfois lui-même, pour forcer la main à ses producteurs qui ne croient pas en lui. Jusqu’au chef d’œuvre ultime, le Live at The Apollo Theater de 1962 qui n’est que le début d’une longue série de surpassements musicaux. Un accomplissement, après des années d’efforts acharnés. S’est inspiré de tout le monde, notamment de Joe Tex pour la mise en place de ses apparitions publiques. James Brown, c’est celui qui prend son âme et celles de ses auditeurs, vous les tord en tous les sens, comme une serpillère, et s’en sert pour s’en frotter le visage couvert de sueur et puis qui s’en essuie les pieds puants d’avoir trop dansé. De la soul au funk. De la flamboyance à l’anéantissement. De la coulée de lave tiède qui emporte tout sur son passage à ses éruptions volcaniques de pierres qui cassent tout sur qui ou quoi elles retombent. James Brown, c’est le christ qui se fait hara-kiri car les légionnaires s’agitent autour de son supplice avec la célérité de fonctionnaires en pré-retraite. Préfère prendre les choses en main, pour que le spectacle soit plus beau, pour qu’il y ait davantage d’hémoglobine et un maximum de feulements de souffrance érotique. Avec en fin, la dernière nique au bon dieu de papa qui l'a lancé et abandonné dans ce pétrin, « même pas mal » et il se relève fier comme Artaban drapé dans sa cape de roi du monde.
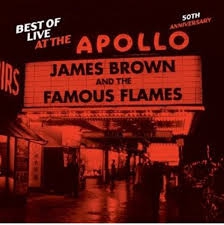
Ne dites jamais de mal de James Brown. L’a enfoncé tout le monde jusqu’au trognon, même les Stones, ces satanés chiens de l’enfer, ont morflé et ont admis leur défaite, la queue entre les jambes. Il fut l’étincelle qui alluma les feux de l’âme noire. I’m black and I’m proud. Et tous les petits blancs qui ne voient pas plus loin que leur cou rouge ont dû en ravaler leur stetson de cowboy d’opérette. C’est que le roi du ghetto, la conscience effulgente de la splendeur nègre, n’a jamais hésité à tirer sur tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Reportez-vous au début de ce paragraphe si vous n’êtes pas convaincu.
SOUL CLAN
Difficile de passer après James Brown. Qui ne se gênait pas pour voler la vedette à quiconque s’y risquait. Alors Peter Guralnick prend la parole. Raconte ses pérégrinations de petit blanc amoureux transi de musique noire. Ne sont pas nombreux à l’époque à se risquer dans les concerts. A l’impression de rendre à César ce qui est à César. L’est déjà un amateur de blues, l’écrit même des articles sur cette musique du diable, mais il ne se leurre pas. Les noirs ont abandonné les dieux du Delta. Le blues leur rappelle trop les fers de l’esclavage qu’ils veulent oublier momentanément pour surmonter tous les désastres psycho-sociologiques engendrés par ces traitements humiliants. L’aura du blues est tombé en déshérence et n’aurait pas survécu si toute une génération d’adolescents blancs ne s’était portée à son chevet. Un peu comme vous recueillez le chien que le voisin a rejeté dans la rue. C’est bien pour le corniaud, mais peut-être y gagnez-vous à vos propres yeux encore plus d’estime de vous-même, la bonne conscience est comme l’enfer pavé d’intentions ambiguës…

Mais avec la soul, c’est un tout autre sentiment, celui de participer à un évènement historial de très grande importance. N’a pas l’impression de s’approprier quelque chose qui ne lui appartient pas. C’est la fête, noire de monde, mais les quelques blancs qui veulent y prendre part sont accueillis avec une indifférence polie et respectueuse. Les choses sont en train de changer. Doucement. Mais Sûrement. Entre 1964 et 1968, les campagnes pour l’égalité des droits civiques, les émeutes de Watts à Los Angeles, la montée en puissance de Black Panthers bousculent la donne traditionnelle des rapports entre les communautés blanches et noire.
Nos soul singers se serrent les coudes. Se soutiennent, font front commun contre toutes avanies et vexations qui arrivent régulièrement en tournée dans le sud profond. L’idée d’une communauté inter-chanteurs matérialisée sous le dénominateur commun de Soul Clan, déjà dans l’appellation un pied de nez au Klu Klux Klan, essaiera de voir le jour. Mais discographiquement cette union aura beaucoup de mal à se matérialiser par le succès attendu.

Guralnick s’attarde sur le cas très symptomatique de Joe Tex. Un chanteur un peu à part. Est entré dans le métier dans l’espoir de gagner assez d’argent pour offrir une maison à sa grand-mère et à sa mère. Le succès venu il abandonnera ses activités musicales pour rejoindre le mouvement des Black Muslim. Superbe voix, mais un jour particulièrement bluesy et de grosse peine de cœur, au milieu d’un morceau il se met à parler en suivant le rythme de la chanson. Cette manière de faire lui apportera ( enfin ) le succès. C’est la vieille reprise du prêche du gospel, ce moment où le pasteur s’adresse directement aux fidèles, mais c’est aussi le signe avant-coureur de ce qui dans les décennies suivantes deviendra le rap… Joe Tex, un artiste au parcours singulier, à redécouvrir et à méditer.
OTIS REDDING
L’artiste numéro 1 de Stax court de succès en succès. La tournée européenne est un triomphe. Otis prend de plus en plus d’assurance. Lorsqu’il retournera aux States il surprend son monde : le nouvel opus qu’il enregistre ne fait pas l’unanimité, Otis a un peu trop écouté le Sergent Pepper des Beatles… Le staff de Stax n’est même pas certain de le sortir un jour. La disparition du chanteur en décembre 67 qui nous refait le coup du crash plane à la Buddy Holly, force la main des décideurs… The Dock Of The Bay sera le dernier succès d’Otis…
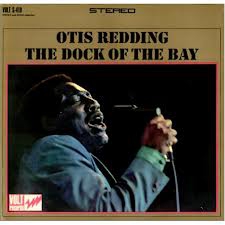
La tournée européenne surprend tous ses participants. Chanteurs et musiciens s’aperçoivent de leur prodigieux succès. Les revues spécialisées n’arrêtent pas de leur tresser des couronnes de laurier. Lorsqu’ils mettent en regard l’indubitable célébrité dont ils jouissent avec la modicité de leurs émoluments et leurs minuscules royalties, ils se disent qu’ils sont beaucoup plus mal payés qu’ils ne le pensaient. C’est une fêlure qui ne pourra aller qu’en s’agrandissant.
ARETHA FRANKLIN
Aretha sera la dernière grande star de Stax. Une artiste hors normes. A la carrière en dents de scie. Elle est la fille d’un des plus grands chanteurs de gospel, le révérend Clarence LaVaughn Franklin. A six ans elle est déjà une enfant étoile du gospel. Une petite fille qui ne veut pas décevoir son papa. Elevée dans le rêve kitch qui habite les roses cerveaux de toutes les petites filles du monde. Vous aurez un destin similaire en teinte psychologique bleue quelques années plus tard avec Mickael Jackson, mais là nous sommes chez les concurrents direct, chez la Motown, trop pop selon l’orthodoxie staxienne. Une petite fille à la peau brune qui n’est pas une oie blanche. A quinze ans elle a déjà beaucoup vu et vécu. Son père qui pense que les dollars accumulés sont la preuve que Dieu déverse sur votre personne tout son amour, la pousse à entamer une carrière profane.

Le parcours d’Aretha n’est pas sans faire penser à Elvis. Le roi du rock provenait du gospel et il y retournera en quelque sorte en fin de course. La reine de la soul oscillera souvent entre morceaux hardcore pêchus et une nostalgie gospellienne souvent déguisée en accents de grande dame trop sophistiquée.
DECHIRURES
Tout à l’air de marcher comme sur des roulettes, mais un évènement inattendu extra-musical va gripper la machine. Le 04 avril 1968 à Memphis le révérend Martin Luther King tombe sous les balles de ses assassins. Le temps de l’innocence est terminée. Pour la première fois une barrière jusqu’à lors invisible et que l’on feignait de ne pas voir se matérialise entre les noirs et les blancs. Le crime met chacun devant sa propre couleur. Des nuages qu’il faut bien appeler noirs s’accumulent dans le ciel serein de Stax.
La convention de Miami organisée en août 68 par la Natra une association des disc jokeys qui diffusent du rhythm and blues, tourne au vinaigre. Officiellement ce n’est qu’une réunion des prestige ( et d’affaires ) qui regroupe tous les responsables - radio, disquaires, édition, labels, compagnies - de la création et de la diffusion de ce style de musique. Officieusement, il s’en passe de belles. Difficile de savoir quoi. L’on parle de menaces, d’armes et de kidnapping. Bien sûr personne n’a rien vu, ni entendu. Mais les évènements qui se déroulent sont à mettre en relation avec la montée de la révolte noire. Un mystérieux groupe de pression venu de New York demande un repartage du gâteau. Les super patrons blancs qui encaissent les bénéfices sont priés de mettre la main à leur portefeuille pour arroser la communauté noire. Ou du moins ses représentants. Aux revolvers chatouilleux… L’on brûle même une effigie de Wexler dans la rue… Black Power in action.

Wexler et Ertegun veulent récupérer leur mise investie dans Atlantic. Affirment qu’ils ont envie de profiter de leur argent. Mais à la lecture du paragraphe précédent l’on peut se demander si c’est vraiment un hasard qu’Atlantic commence à délaisser le rhythm and blues noir pour produire des disques de rock and roll blanc comme les albums de Cream et de Led Zeppelin. Pour quelques millions de dollars Columbia se retrouve propriétaire d'Atlantic et vu les anciens accords de distribution passés avec Stewart des matrices de Stax. Wexler jurera qu’il n’avait pas anticipé de telles conséquences et qu’il en était le premier surpris. Très désagréablement. Terribles moments d’incertitudes pour Stewart prisonnier de signatures imprudentes. Finira par préférer se faire racheter par Warner. A finir mangé par un requin que ce soit au moins celui qui vous aura causé le moins de mal et que - maigre consolation du pauvre - vous aurez choisi. Le plus terrible c’est que Stax ne périclitera pas. Vendra encore davantage de disques que d’habitude à tel point que deux années plus tard elle rachète sa liberté et reconquiert son indépendance.
Stax n’est plus une maison de disques mais une grosse entreprise. Ce qui change tout. D’abord le business, ensuite la musique. L’on investit dans le cinéma. L’on a des projets mirifiques. Les équipes changent. Les vétérans de la première époque sont peu à peu mis au rancart. Les rancœurs s’aiguisent. Les nouveaux cadres dirigeants comme All Bell et Johnny Baylor font tourner la maison et multiplient les bénéfices. Des crocs aiguisés d’entrepreneurs sans état d’âme et des méthodes un peu brutales. Que l’on pourrait qualifier de maffieuses. Jim Stewart ne quitte plus son bureau et inspecte les listings…
THE END

Banal contrôle de police, All Bell a du mal à justifier les cent mille dollars de liquide qu’il porte sur lui en petites coupures. Des juges aux idées mal placées demandent à regarder de près les comptes de Stax. Des sommes de plusieurs centaines de milliers de dollars manquent à l’appel… Jim Stewart est atterré. C’est du moins ce qu’il dit. Il engloutira toute ( ? ) sa fortune personnelle ( gagnée sur les revenus de Stax ) pour éviter le naufrage et boucher les trous, mais en 1976 Stax est condamnée à la faillite et fermée par la justice.
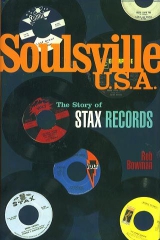
Mais la fin de Stax n’est pas la simple fermeture d’une compagnie de disques. La Soul a vécu. Vous pourrez toujours en écouter, voire en enregistrer, mais Guralnick est formel : la soul est désormais un courant musical suranné. La donne politique et sociologique qui avaient permis la naissance de la Soul, ne sont plus au rendez-vous. La musique a évolué vers d’autres formes.
Pour savoir ce que sont devenus tous nos héros entraperçus en ce bref résumé des cinq cents pages en minuscules caractères de Guralnick, prenez votre courage à deux mains et lancez-vous dans cet océan de connaissance et de savoir. Sweet Soul Music se lit comme un roman noir.

Damie Chad.
ROCK AND ROLL REVUE. N° 70
( Juillet / Août / Septembre 2014 )
( Abonnement : 4 numéros 25 Euros )
( Chèque à l'ordre de Association Rock and Roll Revue )
( chez : François Moussy / Domaine George Washington
42 allée Saint Cucufa / 92 420 Vaucresson )
La seule revue cent pour cent rock and roll du pays. Déjà à son soixante-dixième numéro. Pour ceux qui n'aiment pas lire, vous filez vers les pages centrales admirer les repros couleurs des pochettes rares – comme ce disque suédois de Ricky Nelson – des EP des années cinquante et soixante. Juste pour le régal des yeux et la rage des collectionneurs frustrés. Mais n'y a pas que des belles images.
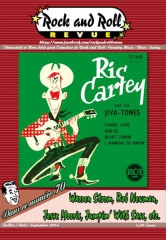
Un petit article sur les légendaires Blue Caps de Gene Vincent qui préférèrent rentrer chez eux au bout de quelques mois de pérégrinations et de tournées incessantes. Etranges décisions. Je veux bien comprendre la femme à la maison qui fait la tête ou pour les plus jeunes les études ou un boulot stable à rechercher mais ce qui m'étonne c'est qu'ils ne semblent pas s'apercevoir qu'ils sont en train de vivre les années légendaires de leur vie. Surtout quand l'on pense que pour la moitié d'entre eux, l'âge de la retraite venu ils devront continuer à travailler pour arrondir les fins de mois. La société américaine ne fait pas de cadeau.
Un article sur Warren Storm, né en Louisianne, batteur doué qui ne connut jamais vraiment le succès. Je résume sèchement la multitude de renseignements apportés par Bernard Boyat, mais le rock and roll est une armée composée essentiellement de seconds couteaux à qui la vie n'a pas offert la chance de percer... Vous passez ensuite à Bob Newman, un peu plus célèbre que Warren Storm mais une gloire toute aussi éphémère.
N'y a pas que les ricains qui sont oubliés en leur pays, par chez nous Jean-Pierre Sasson guitariste swing des années Django et après n'est plus qu'un souvenir pour connaisseurs. Phil Dubois nous permet de le redécouvrir et nous démontre qu'il fut plus que souvent présent sur ces disques de rock des années cinquante qui tentèrent de soulever la chape de plomb que Vian et ses amis avaient posée sur cette musique si dérangeante.
Un article un peu polémique sur les véritables fils du rock and roll. Ne veut point parler de la renaissance rockabilly symbolisées dans les années 80 ( et pour quelques uns avant ) par des groupes comme Whirlwind, les Rockin' Rebels, Jezebel ou les Stray Cats, non pas du tout. Evoque Rolling Stones, Beatles, Animals, Yardbirds, Who, Them, Beach Boys. Un truc à filer une attaque cardiaque à tous les puristes. On ne peut pas dire que chez Rock and Roll Revue l'on caresse le lectorat dans le sens du poil.
Pubien. Juste un mot de trop pour signaler l'existence de la recension ( des plus irréprochables, je vous rassure ) du troisième volet des Hot Boppin' Girls. Mais le pompom boy je le décernerai à l'histoire du disque de Ric Cartey ( EP RCA 75.369 ) paru en 1957 en France. AH ! ces galettes américaines made par chez nous à l'esthétique douteuse qui permirent à un très rare public d'entendre du rock and roll bien avant tout le monde !
Je vous laisse lire les news, les chroniques de disques et les pubs, tout seuls, comme des grands, je vous fais confiance, excusez-moi mais il faut que je remplisse mon bon de réabonnement. Nourriture essentielle pour les rockers.
Damie Chad.
PERMAFROST N° 2
( 1 rue du Progrès / 93100 Montreuil
margaret.chavez@riseup.net )
GAZMASK TERRÖR / IAIN LEVISON / BLACK MIRROR / FREE FESTIVALS IN THE UK / ANARKO PUNK AU CHILI / NY : BLACK OUT 77 & SQUATS 80'S / CLIFFORD HARPER / CINE SEVENTIES / PUNK POUR LES NULS / LUC SANTE / RAP A BUENOS AIRES / LILITH JAYWALKER / ETC...
Ce deuxième numéro de Permafrost porte mal son nom. L'auraient dû l'intituler chaud devant ! Derrière et sur les côtés itou. Sous toutes les latitudes du monde, au Chili, en Argentine, chez sa très malgracieuse majesté, aux States et de par chez nous. Très rock mais sans exclusive. Parfum banane, black music et même shit. Surtout punk. Mais le punk en tant que refus du système d'exploitation capitaliste. Un punk qui fleure de près ou de plus loin avec l'anarchie. Le punk comme moyen de libération individuelle et collective. Ne pas s'arrêter aux images iconiques conçues par la récupération merchandisée. Bakounine disait que les capitalistes étaient assez bêtes pour nous vendre la corde avec laquelle on les pendrait. Très belle prophétie qui s'est réalisée a contrario. Les capitalistes ont été assez malins pour nous revendre sous forme de camisole de force incapacitante les toiles que nous avions tissées pour mettre les voiles et nous enfuir au plus loin de la vie d'esclave qu'il nous impose.

Une grande leçon à retenir : le système vous rattrape toujours : soit en vous envoyant ses flics et faire un petit tour dans ses prisons, soit en se glissant pernicieusement dans vos cerveaux. L'on n'est jamais trahi que par soi-même. L'idéologie du libertarisme anarchisant néo-libéral est une éponge capable d'absorber et d'infléchir en leurs contraires les principes d'une vie libératrice. L'historique des Free Festivals dans l'Angleterre de Thatcher illustre à merveille cet état de fait. Un mouvement de révolte d'abord invisible de chômeurs ou de jeunes n'ayant aucune envie de survivre en une merdouilleuse existence d'ouvriers ou de petits employés sous-payés qui prennent la route et qui qui se mettent à vivoter en une espèce d'autarcie communautaire à base d'idéologie post-hippie, d'entre-aide, de troc, de partage et de campements erratiques sur les routes d'Angleterre. Peu nombreux au début, ils jouent un peu le rôle des fous du roi, d'inoffensifs et sympathiques saltimbanques ultra-minoritaires. Mais le mouvement prend de l'ampleur et les médias se cristallisent sur les festivals de musique qui s'organisent un peu partout en tant que zone libérée avec consommation de drogues et instauration de prix libres et mêmes gratuités sur certains « échanges ». La police interviendra très violemment en 1985 au festival de Stonehenge détruisant systématiquement les véhicules et les effets personnels des adeptes d'une autre forme de régularisation de la vie sociale. Il ne faut pas que les mauvais exemples fassent tache dans le paysage. Après ce coup de force le mouvement s'émiettera. La vie itinérante sera délaissée au profit de squats urbains qui bientôt proposeront des locations de salles ou d'espaces et des spectacles payants. Le serpent de la rébellion finit par se mordre la queue. ( Sur ce sujet voir in KR'TNT ! 170 du 03 / 01 / 2013, la kronic du bouquin de Carol Clerk – traduit par notre cat Zengler préféré – Hawkwind, la saga. )
Mais un incendie n'est pas circonscrit qu'un autre éclate à l'autre bout de la planète. L'internationale punk mérite bien plus son nom que la situationniste. La crise – il vaudrait mieux parler de hold up des banques sur l'argent des particuliers - en Argentine fut un terreau sans précédent pour des expériences de réappropriation et de collectivisation l'expérimentation de multiples pratiques sociales dans les quartiers les plus défavorisés. C'est à lire mais vous commencez à comprendre : Permafrost enquête dans les marges, interviewe penseurs et practiciens politiquement incorrects, note ses lectures récalcitrantes, bande ses dessins acidulés, archive ses bases de données explosives et molotove ses articles en une ronde infernale. Ne cache pas les difficultés car si la révolte est un droit et une nécessité elle est difficile et dangereuse. Ce qui ne peut que la rendre plus attrayante. Permafrost, la revue aux mille causes perdues du passé pour mieux établir notre futur. Bref des leçons d'énergie pour le présent à transformer. Au plus vite.
Damie Chad.
( Rappel au désorde : kronic de Permafrost N° 1 in KR'TNT ! 149 du 20 / 06 / 13 )
PASCAL ULRICH
LE RÊVEUR LUCIDE
( Les Editions Du Contentieux / Robert Roman
7, Rue des Gardénias : 31 100 TOULOUSE
Octobre 2014 / 35 € )

Dans les années 70, on aurait dit Pascal Ulrich ( 1964 – 2009 ) suicidé de la société. Depuis le collectif s'est évanoui. Disparu dans les poubelles de l'Histoire. Comme disait Brother Marx. En ce début de millénaire l'on essaie de rester au plus près du sujet. Pour mieux le cerner. L'on dira donc: Pascal Ulrich suicidé de soi-même. Faut toujours un peu de courage pour ouvrir la fenêtre et passer de l'autre côté. Plus dure sera la chute quand on ne retrouve plus la porte par laquelle on est entré en ce monde.
L'est vrai que l'histoire avait mal commencé. De famille d'accueil en famille d'accueil. De quoi vous blinder le coeur. Ou alors d'aiguiser votre sensibilité. Pour Pascal Ulrich il y eut des bouées de sauvetage. L'envie de surnager. De laisser une trace. Fût-elle sanglante. Lectures et littérature. Celle-ci conçue comme un épanchement. Une plaie qui saigne. Pas très longtemps mais que l'on rouvre à volonté. Mais il vaut mieux rire que pleurer. Même si la girouette de l'âme grince un peu dès que l'on y souffle dessus.
Quelques feuilles volantes, ou agrafées, ronéotypée à l'alcool ( celui d'Apollinaire ), puis les progrès techniques aidant photocopiées, des revues au sommaires efflanqués et aux titres qui fleurent bon les miaulements de détresse comme ce Dada 64, du style je viens après la bataille mais c'est aussi grave qu'en 14 car le carnage métaphysique de l'Homme n'a jamais cessé, ou comme cet Absurde Crépuscule dont l'intitulé n'est pas à proprement parler un vecteur d'optimisme existentiel. Pas la peine de sortir vos mouchoirs pour éponger des larmes de crocodile poétique, Pascal Ulrich ne tirait que sur deux cibles. Le monde et lui-même. Le reste ne l'intéressait guère.

Parfois les mots ne suffisent pas. Ou alors ils en disent trop. L'a commencé à feutrer de toutes les couleurs entre les paragraphes et les strophes puis il a fini par déborder sur les enveloppes de ses envois. Poète et puis peintre. Double postulation. Car l'on n'est jamais soi-même à part entière. Je est un autre nous a déjà prévenu Arthur. Pas le fantôme. L'autre, l'ardennais. Jamais l'un sans l'autre. Et surtout le malaise entre les deux. Jusqu'à vouloir éclater en deux la pomme de la discorde intérieure, cette inaptitude au bonheur post-natal, qui eut raison de lui.
Ce premier livre sur Pascal Ulrich est à lire et à regarder. Robert Roman qui fut un ami proche de Pascal Ulrich n'a pas lésiné sur les moyens : grand format, papier glacé, impression couleur, tout ce luxe était appelé par la peinture de Pascal Ulrich. Cette somme ulrichienne regorge de reproductions de documents rares ou de manuscrits originaux. Elle suit la sente chronologique entrecoupée de témoignages dus aussi bien à des intimes qu'à des confrères écrivains qui firent partie de cette mouvance poétique underground des années 80 qui fut si riche quoiqu'encore superbement ignorée par la large majorité de nos concitoyens.

Pascal Ulrich. Un contemporain à découvrir. Attention, vous ne ressortirez pas indemnes de cette lecture. Alors un conseil, prenez soin de fermer la fenêtre avant de plonger dans le gouffre que vous vous apprêtez à entrouvrir.
Damie Chad.
( Connexions : 1 ° : sur Pascal Ulrich voir aussi kronic sur KR'TNT ! 148 du 13 / 06 / 13; et 2° : sur l'illustration lettre de Pascal Ulrich à Philippe Pissier, pour ce dernier voir in KR'TNT ! 162 la kronic de sa monumentale traduction de Magick d'Aleister Crowley. )
08:55 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/10/2014
KR'TNT ! ¤ 206. LEFT LANE CRUISER / TONY MARLOW / SCANDALE ROCK / GARI 1974
KR'TNT ! ¤ 206
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
23 / 10 / 2014
|
Z'ATTENTION ! Nous mettons z'en lignes cette 206 ° livraison avec deux jours d'avance. Que cette précipitation ne vous empêche pas de jeter un coup d'oeil à la précédente 205 °... si ce n'est déjà fait. Pour La 207 ° rdv le 30/ 10 / 14 ! Keep rockin' til next time ! |
|
LEFT LANE CRUISER / TONY MARLOW / SCANDALE ROCK / GARI ! 1974 |
ROUEN / 31 – 07 – 14
LES TERRASSES DU JEUDI
LEFT LANE CRUISER
CRUISIN' WITH THE CRUISERS

Quoi ? Encore l’un de ces groupes minimalistes qui jouent à deux, comme les Black Keys, les White Stripes, les Winnebago Deals, les Flat Duo Jets, les Magnetix, les Kills et les Trucmuches ? Encore l’un de ces groupes qui frisent le numéro de cirque avec un guitariste qui ne craint pas la mort du haut de sa virtuosité ? Comme on a pu s’ennuyer à voir tous ces duos jouer sur scène ! Les Magnetix, ça allait encore, ils avaient quelque chose de fascinant et une belle animalité, mais les White Stripes, les Kills et les Black Keys, quelle épouvantable corvée !
Par conséquent, il était hors de question d’aller bâiller d’ennui au pied d’une scène où s’exhibaient les Left Lane Cruiser, un duo sorti du Middle West américain - de l’Indiana pour être plus précis - et qui allait ramener sa fraise avec tout le folklore habituel, les chemises à carreaux, les casquettes et le patois américain.
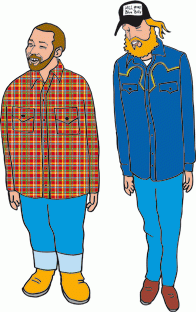
Pire encore, il s’agissait d’un concert gratuit, exactement le genre d’occasion qui se rate, car rien n’est pire qu’un public de concert gratuit. Ça baguenaude, ça vient voir, ça lorgne, ça chouffe, ça mate, ça examine, ça inspecte, ça juge, ça ricane et ça s’en va. Rien à voir avec un public de fans. Et pour comprendre quelque chose à un duo comme Left Lane Cruiser, il vaut mieux avoir quelques éléments d’information sur le trash-blues, car sinon, le profane y perd son latin. C’est pas du blues ? C’est pas du rock ? C’est de l’hébreu ? Ou tout simplement du bruit. D’ailleurs, on voit des gens grimacer ostensiblement et boucher les oreilles des enfants, dès que ça joue un peu fort.

Le problème, c’est qu’on était au cœur de l’été, fin juillet, qu’il faisait beau et qu’une rumeur montait de la ville. Alors, pourquoi pas ? Après tout, les disques du duo ne sont pas si mauvais...

Le début du concert était prévu en début de soirée. La petite scène était installée au pied d’une espèce de cathédrale. On voyait les pigeons se promener dans les dentelles de pierre et se soulager sur les têtes des saints installés dans les hauteurs. La petite place était noire de monde. Les culs terreux de l’Indiana montèrent sur scène à l’heure dite. Mais ils étaient trois au lieu des deux Cruisers habituels, Freddy J IV et Brenn Beck. Ils ramenaient avec eux un copain batteur en marcel noir et aux bras couverts de tatouages. Pour compléter son look d’Ostrogoth du Midwest, il portait une énorme barbe noire en éventail de mountain man et une casquette de base-ball noire. Brenn Beck lui avait cédé son tabouret de batteur pour jouer de la basse. Il portait une casquette noire et un pantacourt noir. Ah la dégaine des musiciens américains ! Il faudra bien que quelqu’un se dévoue un jour pour en faire l’apologie.

Comme à son habitude, Freddy J IV jouait assis. Il s’était fait un look de biker, avec un foulard blanc noué sur le crâne et des lunettes noires à la Ray Charles posées sur le nez. Il aurait très bien pu conduire une Harley dans The Sons Of Anarchy. Il s’assit, brancha sa National et wham bam ! C’était parti pour deux heures de boogie-blues infernal. C’était un vrai bonheur que de voir Freddy J IV jouer et chanter. Il semblait réellement possédé par les démons du boogie, il marquait en permanence le tempo des deux jambes et il allait tout chercher au guttural, histoire d’envoyer ses morceaux rôtir en enfer. Ces trois mecs réussissaient l’exploit d’embarquer un public de bric et de broc. On sentait chez eux une maîtrise des situations compliquées. Ils dégageaient une énergie considérable. Les groupes garage devraient en prendre de la graine. Freddy J IV jouait tout en accords ouverts et grattait ses cordes du bout des doigts de la main droite. Tout son corps était en mouvement, comme celui d’un batteur. Et comme Mike Bloomfield, il enveloppait sa guitare avec son corps. Il se penchait et jouait la plupart du temps la tête baissée et dodelinante. Freddy J IV reprenait les choses là où John Lee Hooker les avait laissées en 1962, juste après «Boom Boom». Il shootait dans le cul de la vielle capitale normande une énorme dose de boogie torride. À un moment, il annonça de la «Detroit Music» et il envoya gicler dans le crépuscule normand une puissante reprise du «Strangehold» de Ted Nugent. Eh oui, c’est à la qualité des reprises qu’on reconnaît les grands groupes. Entre deux morceaux, il sifflait ses verres de bière - «the juice to get loose», titre du morceau qu’il attaquait - et saluait «Louen» ou «la fleiiche», comme il disait.
Ce mec est particulièrement bon, mais ça on le savait depuis un certain temps, car les disques ne trompent pas. D’autant qu’ils sont quasiment tous sortis sur Alive, un label qui reste un sacré gage de qualité. Le boss Boissel est parfaitement incapable de sortir un mauvais disque sur Alive. N’oublions pas que Patrick Boissel et Suzy Shaw étaient des intimes de Mick Farren, du temps où il vivait encore à Los Angeles.
En gros, Left Lane Cruiser a sorti un album par an pendant six ans. Cinq sur Alive et deux sur Hillgrass Bluebilly Records. Ce sont des gens qui ne chôment pas, et qu’on se rassure, cette prolixité ne nuit en rien à la qualité de leur production.
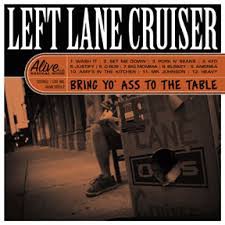
Leur premier album est sorti en 2008. «Bring Yo Ass To The Table» est un titre d’album on ne peut plus raffiné. En français, ça donnerait : Ramène ton cul à table. Sur la pochette, on les voit jouer dans la rue. Si on apprécie bien l’esprit boogie boogah, cet album est un pur régal. Avec «Set Me Down», Freddy J IV et son copain Brenn s’en donnent à cœur joie. Ils dégagent un charme roostsy indéniable. On retrouve dans ce morceau l’infinie profondeur de la bourrée auvergnate de l’Indiana. «Pork And Beans» est un plat d’hiver. Freddy J IV chante avec un bon guttural à la Johnny Winter et lamine quasiment tous ses accords au bottleneck. Belle descente de boogie avec «KFD». C’est une pièce adroite et fine, malgré des apparences mal dégrossies. Freddy J IV est tellement bon qu’on se sent en sécurité. En face B, ils chantent «Bog Moma» à deux voix et ça devient étonnant - oh yeah yeah - et ils éclatent de rire et de fureur apache. Voilà une belle énormité chantée à la revoyure - ah ah ah - et coulée dans un bronze fumant de distorse et d’âpre guttural. «Amy’s In The Kitchen» démarre sur un bon tatapoum et Freddy J IV chante comme un prêcheur fou égaré dans la Vallée de la Mort. Leur truc se met à sonner comme du heavy rock belliqueux - hey come on here - et Freddy J IV ramone tout ça à sec à coups de bottleneck. Wow ! Un vrai hussard en rut ! «Mr Johnson» est encore plus substantiel. Ils font carrément du gros heavy rock classique à deux. Black Sabbath ? Ah ah ah quelle rigolade, en comparaison ! Et ils en resservent une louche avec «Heavy», une vraie purée blanche, l’aligot de rêve des fermes du Cantal, avec un son fouillé à gogo. Le son qui leste comme du plomb. C’est là qu’on commence à prendre Freddy J IV très au sérieux. Mais d’où sort ce dingue ?

«All You Can Eat» sort l’année suivante, avec une pochette ornée d’un coq. Nouveau gage de sérieux : Jim Diamond produit ce très gros disque. Rappelons que Jim Diamond est avec Tim Kerr le producteur garage le plus renommé d’Amérique. Il faut attendre «Hard Workin’ Man» pour retrouver la veine heavy du premier album. On sent chez eux une véritable appétence pour le mal suprême, c’est-à-dire le heavy-rock des cavernes du diable. Ce «Hard Workin’ Man» est magnifique, inspiré et admirablement tendu. Ils restent dans la heavyness des enfers de Dante avec «Black Lung». Freddy J IV y va franco de port. On sent que le heavy très heavy est leur véritable spécialité. On en retrouve de gros spécimens en face B, et notamment «Hard Luck» qui rôde aux frontières du heavy blues. Inutile de dire que ça fume de partout. Leur truc vaut tous les grands classiques de heavy rock des seventies. Encore du heavy blues avec «Broke Ass Blues». On retrouve l’animalité des bois profonds de Bornéo et même quelque chose d’hendrixien. Et ils poursuivent le festival avec «Putain !» qui sonne comme un classique du North Mississipi Hill Country Blues, mais en très musclé. Freddy J IV est un puissant sorcier des collines. Il joue lourd et bien, et il sait secouer le cocotier du blues rock. Attention à «Waynedale» ! C’est une vraie cochonnerie pulsée à la voix. Ils envoient leur heavy blues se rouler dans la fosse du garage. On sent nettement la patte de Jim Diamond, âme sonique des Dirtbombs.

Pas mal de grosses décarcasseries sur «Junkyard Speed Ball». Freddy J IV et Brenn jouent sur le toit d’un vieux pick-up et Jim Diamond produit à nouveau l’album. Ça démarre en trombe avec une excellente pièce de slab, «Lost My Mind». Ils vont assez loin dans l’énervement et Freddy J IV arrose tout ça de grosses rasades de bottleneck. Ils font du fife & drums de névropathes. Avec «Giving Tree», on découvre une autre spécialité du duo : les balladifs somptueux à la Stonesy. Freddy J IV chante ça merveilleusement et enrichit son fourbi de descentes de manche. Un hit ? Allez savoir. Il fait aussi le talking jive sur «Hip Hop» et il risque d’en édifier plus d’un. Il balance en prime un très beau solo liquide. Voilà sans doute le cut inspiré de l’album. Énorme et sec. Ça sonne comme un hit groovy saturé à l’extrême. La face B est un véritable hellfest, mais bon esprit. Freddy J IV chante «Weed Vodka» avec des accents à la Ian Anderson, époque du premier album de Jethro Tull. C’est puissant et fameux. «Cracker Barrel» est encore plus heavy. C’est même plombé et diaboliquement bon. Il joue toute cette heavyness au bottleneck. Jim Diamond joue de la basse sur «Repentant». On l’avait vu jouer de la basse dans les Dirtbombs au Gibus et on peut affirmer que monsieur ne chôme pas. Avec une basse dans les pattes, Jim Diamond devient une sorte de bombardier. Freddy J IV, Jim et Brenn sortent là l’une des plus grosses pièces de heavyness du monde. Freddy J IV chante avec une voix de brute immonde. Il réussit à faire revivre l’esprit des très grands disques de heavy rock des seventies, de type Atomic Rooster, Taste ou Dust.

«Painkillers» est probablement leur meilleur album. C’est un album de reprises et pour corser l’affaire, James Leg et Jim Diamond jouent avec eux. Ce sont essentiellement des reprises de classiques du blues et quels classiques ! Ils démarrent avec «Sad Days And Lonely Nights» de Junior Kimbrough. Ils l’expédient directement au firmament des grosses reprises. Ils en font une sorte de boogie des catacombes qu’ils pulsent avec une énergie digne des orgies du comte d’Orgel. Ils explosent un peu plus tard le «Shake It» de John Lee Hooker en lui donnant une grosse impulsion boogie boogah, une sorte de beat souterrain de la révolution industrielle. Ils jouent ça avec une puissance sourde et extrêmement convaincante. (Attention, sur le vinyle, «Shake It» et «Red Rooster» sont inversés). Puis ils tapent dans l’un des gros classiques de Jimi Hendrix, «If Six Was Nine». Freddy J IV le traite heavy et retrouve le secret alchimique de la fabrication du limon des origines du monde. La face B explose dès «Red Rooster», une version qui plairait beaucoup à Wolf. C’est la reprise la plus heavy de l’histoire du blues. C’est à la fois superbe et démesuré. Freddy J IV et ses compères sont les rois du heavy heavy blues. Ils savent chauffer un classique à blanc. C’est la version ultime de Red Rooster. Rien que pour ça, l’album vaut l’emplette. Et ça continue avec «Ramblin’ On My Mind», un vieux classique de Robert Johnson que Freddy J IV chante à l’extrême possibilité du guttural. Personne n’avait jamais osé chanter comme ça avant lui. Il chante avec une voix de cancéreux atteint de la maladie de Parkinson et de la tuberculose, qu’une vipère apsic viendrait de mordre à la joue et dont la jambe aurait été emportée par un boulet de canon juste avant. En un mot comme en cent, c’est un très gros disque. D’autant qu’ils finissent avec une reprise magistrale du «Sway» des Stones. C’est dire s’ils savent choisir.

«Rock Them Back To Hell» rend hommage aux morts vivants. La pochette nous renvoie à ce bel univers Fuzztones/Cramps/Romero. On s’attend donc au pire, et c’est exactement ce que Freddy J IV nous propose. Dès «Zombie Blocked», on est fixé. Vous vous attendiez à du petit blues joué délicatement au bottleneck au bord du fleuve ? Oh no no no ! Ce sera du heavy doom de zombie bird-dance de guttural ultraïque stompé aux gros oignons gras de l’Indiana. Freddy J IV pulse somme un démon d’acier noir de la SNCF et une fois de plus on se retrouve avec un très gros disque sur les bras. Une vraie malédiction ! Ce n’est pas compliqué : tout l’album patauge dans l’ultra-gadouille de la heavyness. Ils n’arrêtent pas. Ces mecs-là, il faudrait les faire piquer. «Electrify» est bien secoué de gélatine et de ramdam, c’est vraiment dégueulasse. «Neighborhood» sonne comme une extraction de pus de heavyness paranormale portée par un guttural accentué. C’est extrêmement consistant, à condition de savoir apprécier le trash qui pue. Pour écouter ce genre de disque il faut de l’estomac. Quand on les voyait jouer sur la petite place remplie de touristes, on voyait bien que beaucoup de gens faisaient des grimaces de désapprobation. Le son de Left Lane Cruiser pourrait passer pour amical, car on aurait tendance à vouloir les prendre pour un gentil groupe de blues, du type de ceux qu’admirent les vieux pépères collectionneurs. Mais en fait, ils sortent un son extrêmement agressif. C’est tout simplement leur version de la tripe, rien d’autre que l’héritage de cette culture du blues de l’Amérique profonde qui plongeait ses racines dans l’histoire d’un épouvantable cauchemar, celui de l’esclavage. On connaît essentiellement le blues de la plainte et de la douleur, mais le blues de la colère et de la révolte existe aussi. Quand des mecs comme Wolf et Hound Dog Taylor piquaient une crise, on avait intérêt à tendre l’oreille pour ne pas en perdre une miette, car ils devenaient les égaux des dieux. Il semble que Left Lane Cruiser se situe dans la veine de cet héritage, Wolf et Muddy d’un côté, RL Burside de l’autre et au milieu Johnny Winter. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Retour à «Rock Them Back To Hell» avec le fameux «Juice To Get Loose». Freddy J IV embarque ça au combiné de bottleneck et de tatapoum endiablé. Et le festival des énormités se poursuit en face B avec «Be So Fine», un jus de grosse énormité qui coule comme la lave du volcan. «Jukebox» est fantastique d’à-propos et on revient aux super-balladifs avec «Coley», encore un truc digne des Stones, franchement. Freddy J IV leste son balladif de grosse heavyness harmonique. Encore un hit ? Allons allons, ne nous emballons pas. En tous les cas, on sent à l’écoute de ce balladif une fabuleuse inspiration. Freddy J IV est très impressionnant. Il gratte ses accords avec un son graillon qui édifiera tous les amateurs éclairés. C’est d’ailleurs un son qui éveille de vieux souvenirs de bon temps et il place un solo admirable. Il boucle sa petite affaire sans prévenir avec un «Righteous» stompé et embarqué au guttural.
Le dernier album paru s’intitule «Slingshot». Nos deux amis proposent des vieux enregistrements - Early and raw recordings. Si on apprécie les disques qui sautent à la gorge, alors, il faut se procurer celui-là. Ils attaquent avec «Don’t Need Nothing From Me», une grosse bouillie de boogie blues énervé. Ils ont raison de prévenir leurs clients, car ça chauffe terriblement. On retrouve le fucked-up blues des Immortal Lee County Killers avec «Slingshot», purée infâme et capiteuse puis on entend «Sleep Will Mend» rissoler au dessus des flammes de l’enfer. Les coups de slide ravivent les rousseurs sur la peau des couplets suppliciés. Ces deux mecs sont incapables de faire autre chose que de la fournaise. Il faut que ça fulmine, sinon ça ne sert à rien. Le «Right By My Side» qui ouvre le bal des vampires de la face B renverrait plus à une imagerie de labourage moyen-âgeux, quand la terre était épaisse, noire et collante, et les outils rudimentaires. Freddy J IV travaille son blues à l’ancienne, il chante dans sa barbe et gratte ses poux sauvagement. Avec tout ce ramdam, on a beaucoup de mal à croire qu’ils ne sont que deux. «That Ass» est un véritable festival de dynamiques internes, un numéro de trapèze atomique. Ces deux mecs savent tout jouer, le trash-blues, le punk-blues, le fucked-up blues, le bouse-blues, enfin tous les blues.
Catzengler : en pleine cruise.
Left Lane Cruiser. Les Terrasses du jeudi. Rouen. 31 juillet 2014
Left Lane Cruiser. Bring Yo Ass To The Table. Alive Records 2008
Left Lane Cruiser. All You Can Eat. Alive Records 2009
Left Lane Cruiser. Junkyard Speed Ball. Alive Records 2011
Left Lane Cruiser & James Leg. Painkillers. Alive Records 2012
Left Lane Cruiser. Rock Them Back To Hell. Alive Records 2013
Left Lane Cruiser. Slingshot. Hillgrass Bluebilly Records 2014
De gauche à droite sur l’illustration : Brenn Beck et Freddy J IV
17 / 10 / 14 – LAGNY SUR MARNE
LOCAL DES LONERS
TONY MARLOW
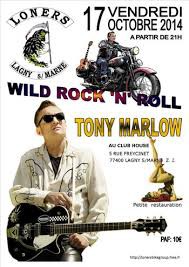
Champion of the world. C'est bien de moi dont je parle. En toute modestie. Sans une hésitation droit au but. Je vous l'accorde jusqu'à Lagny, ce n'est pas difficile. Tot dreit et la direction marquée en gros à chaque rond-point et carrefour. C'est à Lagny que ça se complique. Surtout que ce soir je n'ai pas Mumu qui connaît le moindre patelin de la Seine & Marne comme le fond de sa poche. Sans plan ou GPS, la zone industrielle de Lagny c'est un labyrinthe, mais guidé par l'infaillible sixième sens du rocker en quête d'un concert, je suis tombé pile sur l'aiguille perdue au milieu de la meule de foin. Du coup la teuf-teuf me dit qu'elle est mon Ariane. Se vante un peu trop. Thésée vous, malheureuse quatre roulettes. Si vous continuez à avoir la grosse culasse, je vous abandonne à la première casse-tacot.
Pas trop de monde, ce soir chez les Loners, l'est vrai que le week end est chargé. Ne serait-ce qu'à Couloumiers, pas très loin, c'est Nelson Carrera and the Scoundrels, exactly à la même heure, qui exhibent leurs talents de fripouilles. J'ai opté pour Tony Marlow que je n'ai pas vu sur scène depuis deux ans et l'accueil des Loners toujours aussi sympathique et chaleureux.

PREMIER SET
Trio de choc. Tony sur notre droite, Gilles à bâbord, et Stéphane au centre. Pour une fois que le batteur n'est pas caché par ses camarades, faut le noter. Surtout que ce soir l'on a affaire à trois véritables musiciens. Veux dire par là des gars qui ne sont pas tributaires de leurs instruments, ce sont eux qui mènent le jeu et qui dominent. J'ai maudit ma mère. La sainte femme ne m'a mis au monde qu'avec deux oreilles, et ce soir il m'en manque une. Je ne sais plus où donner de l'esgourde. Je peux bien suivre deux musicos en délatéralisant mon écoute, mais selon les lois d'airain de la mathématique acoustique, il reste un des trois forcenés en dehors de mon champ auditif. M'en faudrait même une quatrième car s'ils fonctionnent chacun dans leur coin en autarcie, le produit final est d'une qualité sans égale. Jouent ensemble, sans jamais se marcher sur les pieds. N'empiètent pas sur le pré carré du voisin, ne s'amusent pas à brouter l'herbe soit-disant plus verte ailleurs que chez soi. Ne s'entraident même pas, n'en ont aucun besoin, les pièces séparées s'ajustent à la perfection. Le local des Loners ce n'est pas l'auditorium de la Cité des Musiques, mais avec un combo mille fois au point, le son est d'une netteté exemplaire.
STEPHANE
L'est des batteurs de rockabilly qui ne touchent jamais leurs cymbales. Me demandent même pourquoi ils en achètent. Sont obnubilés par la caisse claire. Stéphane est plutôt partisan de l'extension du domaine de la lutte. L'a une batterie devant lui, et une idée simple mais lumineuse lui a traversé l'esprit. Celle de s'en servir. Entendez par là de tous ses éléments. S'il était peintre ne serait pas le rapin à utiliser seulement un unique tube de blanc. Palette sonore, tape dans tous les toms. Du coup il dispose d'un étonnant registre d'interventions. Inventif et créatif. Ne vous propose pas le fromage ou le dessert, vous fournit les deux plus la mousse au chocolat et les langues de cat qui vont avec. Vous estourbit par son adresse. Z'avez z'envie de le filmer pour lui piquer tous ses plans. Mais ça ne servirait pas à grand-chose car ce n'est pas un cogneur fou qui ne se fie qu'à l'impulsion de ses bras. Fait aussi marcher son cerveau. Ne sert pas mécaniquement la sauce à ses compagnons, réfléchit avant. Il n'accompagne pas, il joue. Section rythmique, mon oeil ! Refuse le rôle du second couteau qui passe en numéro deux. L'est une entité à part entière. Un orchestre à lui tout seul.
GILLES

Encore un partisan des fractions autonomes. Lui et sa contrebasse. Le monde autour en fond de décor si vous voulez. Mais au premier plan c'est big mama and Gilles. Nous tourne un peu le dos. C'est qu'il la regarde dans les yeux. Sans la lâcher du regard. Parfois à la manière dont il tire sur les cordes l'on croit qu'il va les lui arracher mais la plupart du temps se contente de slaper comme un forcené. Encore un qui ne se considère pas comme un simple accompagnateur. Soliste à part entière. Vous détache ses notes comme un obusier ses shrapnels. Arrivent par flots. Ne poussez pas il y en aura pour tout le monde. Crache des pruneaux qui font mal. Sème à tout vent. Agit par grappes. Quarante notes à la suite qui déboulent d'on ne sait où. Pour un contrebassiste c'est le moment de gloire, l'instant fatidique du solo, regardez comme je suis beau, applaudissez-moi et je m'en retourne pépère sur ma rythmique patapi-patapon ron-ron. Pour Gilles c'est juste un commencement. Une entrée en matière. De ces petites éruptions volcaniques il vous en délivre quarante à la suite, une seconde d'arrêt entre chaque et c'est reparti. Festival et feux d'artifices.
TONY

Avant de l'écouter, faudrait que vous bûchiez un peu. Tous ses articles parus dans la revue Jukebox et consacrés aux grands guitaristes rock. Vous démonte un solo de Chuck Berry avec tant de précision que cela vous en paraît risible de facilité. C'est quand vous essayez d'appliquer la recette que vous vous apercevez que vous avez du mal à suivre la notice. Ce qui est râlant avec Tony c'est qu'il est encore plus fort en pratique qu'en théorie. Commence doucement, trois légères caresses sur les cordes, un peu comme quand vous tapez affectueusement sur le croupion de madame, tout doux comme un battement d'ailes de papillon, mais nous faisons confiance ce n'est qu'un prélude avant la mise en application des Cent vingt jours de Sodome et les reptations du Kamasutra. Idem pour Tony, fait ce qu'il veut de sa guitare, chanter, miauler, vrombir, au choix. Mais toujours cette musicalité dansante qui est la marque de fabrique de ce son qui n'appartient qu'à lui, qui vous enchante l'âme et vous l'aiguise aussi tranchante que la lame d'un couteau.
MUSIC, MAESTROSOS !

Ce premier set fut un délice. Un dessert de gourmets gourmands. Tony est au chant. En anglais et en français. Faut d'ailleurs un petit moment pour que le cerveau réalise qu'il s'exprime en notre idiome natal, tant cela passe bien sans hiatus. Preuve que la stérile polémique de l'anglo-américain en tant que langue naturelle du rock est un faux problème : suffit de le sentir. Tony s'affranchit de toutes les barrières. Dans elle Revient, s'amuse à pousser la voix vers des inflexions méditerranéenne, l'on décèle comme un arrière fond de trémolo flamenco qui se marie très bien avec les clin-d'oeil très sixties du morceau. Impression confirmée par l'instrumental suivant que Tony présentera comme du pasobilly. Ne criez pas au scandale, réfléchissez plutôt aux origines espagnoles du Tex-Mex et toutes les traces que l'on en retrouve chez les plus grands de Buddy Holly à Mink De Ville. L'enchaîne sur un Swing Tennessee davantage orthodoxe, mais s'amuse à flirter avec les genres, le Come On de Chuck Berry même si l'on se souvient surtout de l'interprétation des Stones, tout de suite suivi d'un Runaway Boy parfumé au Born To Be Wild de Steppenwolf, mélange explosif de neorockabilly avec un des titres fondateurs du hard rock. N'oublions pas que Tony Marlow est un biker inconditionnel ( reportez-vous à son 25 centimètres See You At The Race ) et que nous sommes chez les Loners dont quelques belles montures s'alignent devant l'entrée. Le set finit sur un Train Kept A Rollin de Johnny Burnette apocalyptique.

Tony et ses boys nous laissent sur les rotules. Toute l'énergie du rockab alliée aux fièvres rock and roll qui ont suivi.
DEUXIEME SET
Tony a changé de guitare et Gilles débute avec une basse électrique mais très vite il reviendra à sa big Mama favorite. Stéphane reste fidèle à sa batterie, se contente de modifier son style de frappe. C'est que le band ne nous refait pas le coup des Dents de la Mer II. Les crocs toujours aussi acérés mais le son est changé, davantage ramassé, plus anglais en quelque sorte. Ce n'est pas un hasard s'ils nous livrent une version fulgurante de Doctor Feelgood, le vieux morceau de Piano Red brandi comme un drapeau par le groupe éponyme du pub rock qui marqua en Angleterre le retour à l'énergie brute – blanche et noire – du rock and roll. De Doctor Feelgood à Johnny Kidd le pas est allègrement franchi, suffit de passer par son groupe accompagnateur les Pirates dans lequel sévit – pour notre plus grand bien – le guitariste Mick Green. Vont nous remettre Johnny Kidd sans se lasser, Please D'ont Touch, Growl, Please Don't Bring Me Down, Linda Lu par exemple. Marlow expliquera qu'il est en train de préparer un album hommagial au plus célèbre des pirates électriques britanniques, un peu trop oublié ces temps-ci. Le set plonge aussi au plus près des racines bleues du rock and roll avec le I Just Wanna Make Love To You de Willie Dixon popularisé par Chuck Berry, sans se défendre d'explorer le répertoire pure Ted comme le My Little Sister Got A Motorbike de Crazy Cavan. Final démentiel avec un Shakin'All Over époustouflant et un Bip Bop Boom du pianiste Mickey Hawks un pur hit rockabilly aussi percutant et rapide qu'un direct du gauche que vous ne voyez pas venir mais dont vous sentez les effets. Rock Out !
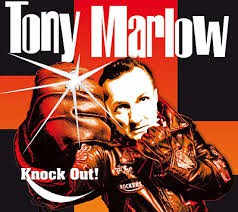
Le trio d'enfer de Tony Marlow nous a sonnés. Tous envoyés au tapis, en deux sets. Ont tout donné et on a tout pris. Exceptionnel. Du rock comme on n'entend plus assez souvent. Du rock ? Non de la musique jouée par des musiciens émérites. Et diaboliques. Un très grand moment de rock and roll.
Damie Chad.
( Les photos ne correspondent pas au concert )
Futurs concerts chez Les Loners :
07 / 11 / 2014 : THE RINGSTONES
23 / 01 / 2015 : FURIOUS ZOO ( avec Renaud Hantson )
( 5 rue Freycinet / Lagny sur Marne / 77 )
LA SCANDALEUSE HISTOIRE DU ROCK
GILLES VERLANT & JEAN - ERIC PERRIN
( GRÜND / Octobre 2012 / 596 pp )
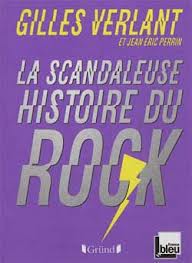
Un truc qui nous faisait salement râler la teuf-teuf et moi. Impossible de faire un long trajet sans que l'auto-radio ne nous déverse, au hasard de nos changements de stations, à peu près tous les cent cinquante kilomètres un épisode de La Scandaleuse Histoire Du Rock. Comme nous adorons le rock et que nous sommes friands de tous les scandales, nous avions dès que retentissait le générique de l'émission ce que l'on pourrait appeler un a-priori favorable. Vite déçu. Vous parlerai de la raison de nos déception tout à l'heure. Je m'attarde d'abord sur l'adverbe, six minutes pour traiter d'un sujet relatif au rock, c'est un peu court. Faut en plus, plutôt en moins, encore décompter le timing des illustrations sonores. Chouette, You Really Got Me des Kinks ! zut z'ont z'enlevé le son au bout de zrente zecondes, idem pour toutes les autres illustrations musicales. Je sais bien que le rock est né des frustrations adolescentes, mais ce n'est tout de même la peine d'en rajouter quatre toutes les six minutes papillons. Aux ailes coupées. Gilles Verlant possède peut-être un bel organe – l'a été chargé durant plus de dix ans des bandes annonces sur Canal + - mais j'avoue qu'il ne m'a jamais fait mouiller le slip – une voix sonore et joyeusement professionnelle, mais un tantinet trop racoleuse pour mes tympans. Question contenu, c'est un peu décevant, exemple : la play-list de l'Ipod du Président Obama, je m'en moque un peu, et vous aussi. Un simple gadget de communication électorale. Un attrape-gogos. Un amuse-peuple. Faut bien jeter un peu de monnaie de singe dans la bouche grand ouverte des manants du roi prêt à gober les restes les plus abjects des poubelles princières. Là est le scandale, mais de celui-là Gilles Verlant se garde bien d'en parler. Les émissions sont diffusées sur les ondes de France Bleu. Retenez bien l'azur démocratique, ne la confondez pas avec le noir anarchie.

Je n'aurais jamais dépensé les 24 euros quatre-vingt quinze centimes nécessaires à l'achat du bouquin, mais c'était mon jour de chance pour moins de cinq euros j'ai ramené tout un lot de bouquins tout neufs dont certains très intéressants encore sertis de leur coque plastique protectrice. C'est ce qu'on appelle un circuit de distribution et d'écoulement parallèle de la production culturelle nationale. Réflexe pavlovien, j'ai été incapable de résister au mot rock'n'roll aussi efficace et meurtrier que la muleta du torero. Idéal pour les temps morts, vous avez cinq minutes à perdre pendant que madame se pomponne dans la salle de bain, et vous vous envoyez tranquille trois ou quatre chroniques, vite fait bien fait, car il ne faut jamais rater l'occasion de s'instruire. Bref, en deux jours, me suis tapé les deux cents quarante items. Question connaissances pures, je n'ai pas appris grand chose. Rien, à part cette information que je m'empresse de vous livrer afin de perfectibiliser vos neurones : avant de sortir avec Mick Jagger, le célèbre mannequin Jerry Hall faisait des galipettes avec Brian Ferry. Preuve indiscutable que la demoiselle avait de la jugeote, délaisser Roxy Music pour les Rolling Stones, est une preuve irrécusable de bon goût. J'avoue que c'est humiliant, moi qui me croyais incollable comme le riz ( celui qui se bouffe tout cru ), suis forcé d'avouer qu'à l'époque j'étais passé à côté du scoop. Je me demande même comment j'ai pu survivre. Un miracle. Que le Vatican ne manquera d'authentifier. Tout de même une chose me console, c'est que parmi les lecteurs de KR'TNT ! doit se trouver deux ou trois malheureux - de stupides irréfléchis en vérité, indignes de venir s'abreuver à foison en nos doctorales pages - à qui avait échappé cette indiscutable réalité : il existe plusieurs morceaux de rock and roll qui affichent le mot « stop » dans leur titre.
Vous en conviendrez le niveau n'est pas de très haut étiage. Le rock étudié à la loupe mais par le petit bout de la lorgnette. Beaucoup d'articles sur les Beatles et quand il n'y a plus rien à dire l'on se penche sur les cas particuliers John, George, Paul et Ringo. Le quatuor d'or du consensus mou du grand public. N'a quand même pas oublié les pionniers, ont pratiquement tous leurs deux pages. Puisque l'on est en train de charger le plateau positif de la balance du jugement de l'âme, précisons que le livre est plus agréable à lire qu'à écouter à la radio. Pour les acharnés du son, un petit encadré vous indique les morceaux que vous pouvez auditionner en parallèle à votre lecture. Mais étrangement le texte dénudé de toute illustration musicale passe mieux. Paraît plus dense et moins primesautier que lu sur les ondes hertziennes. L'est relativement bien écrit et les traits d'humour paraissent plus acérés que lorsqu'ils sont surchargés de la gouaille du présentateur. Certains sont très courts, preuve que Gilles Verlant et ses nègres – aucune allusion aux chanteurs de blues mais aux stagiaires qui ont dû se charger des fastidieuses recherches et de l'écriture de premier jet, ce sont là suppositions totalement gratuites et médisantes de ma part – étaient en panne d'inspiration, à moins que l'inanité de certains sujets fût très vite épuisée... Un citron pressé ne peut donner que le jus qu'il contient comme le roucoule si bien le grand masturbateur Robert Plant in The Lemon Song sur le Led Zeppelin 2. Excusez-moi demoiselles et tourterelles mais le rock est une musique de phacochères en ruts et en manque. Ce qui est totalement scandaleux – je parle du manque, pas du rut - je vous l'accorde.

Sur la jaquette l'on nous promet un second tome. Aux dernières informations, il y aurait eu six cent soixante livraisons radiophoniques sur France Bleu et France Info. Ce qui augure mal du sérieux de cette chaîne d'information quant à la qualité de ses sources. Mais entre temps s'est passé un événement grave. Surtout pour Gilles Verlant. L'a eu la mauvaise idée de mourir. Le vingt septembre 2013. A cinquante six ans. L'est tombé dans un escalier et ne s'en est jamais relevé. Ce qui est triste. Tout compte fait il ne faisait pas grand mal à personne en racontant son sirop rock and roll. A donné l'illusion à tout un large public de se vautrer dans un océan de stupre. Abysses marins rassurants tout de même car pas très profond. L'on n'y risque pas la noyade. Un peu de sexe, un peu de drogue, un peu de rock and roll. Mini doses à chaque fois. Tant pis si ça ne fait pas le maximum. Plus un ton sympathique, un peu critique gauche caviar qui n'engage pas à grand chose mais qui vous donne un vernis de rebelle écorniflant à moindre prix. Le rock and roll en a vu d'autres et n'en est pas mort pour autant. Enfin pas encore.
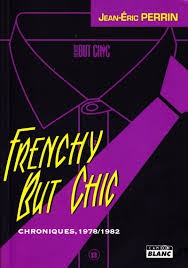
Reste le cas de Jean-Eric Perrin, son nom est écrit en tout petit sur la couverture. Polygraphe rock bien connu, auteur d'une trentaine d'ouvrages de Léo Ferré à Indochine en passant par Le Guide de la Chanson Française. Peut-être s'est-il contenté de souffler des idées. Dans tous les cas, tous les deux ont ratissé large. Très large. Trop large. Pour tout dire l'ensemble n'est pas très scandaleux !
Damie Chad.
GARI ! 1974
Film de NICOLAS REGLAT
( sortie nationale : 15 octobre 2014 )
( http://a-paris-distribution.com/gari/ )

N' y avait pas que des entrées en force dans les concerts à Toulouse dans les années 70. Je vous laisse dix minutes pour que vous alliez illico presto vous replonger sur Riot In Toulouse de Little Bob Story, ça remplacera le coton tige pour nettoyer vos oreilles. Dans Toulouse la Noire, Toulouse la Rouge, se passaient aussi des évènements moins anecdotiques. Le titre du film est suivi d'une citation qui donne le ton :
« Ceux que l'on traite de desperados durant leur vie
deviennent des héros quand tout danger
de s'engager avec eux est écarté »
Nous traitons ici de la face sombre du rock des années soixante-dix. L'on n'en parle généralement qu'à mots couverts. Quelques phrases et hop, l'on revient très vite aux paillettes des supergroupes, tout ce que vous voulez savoir sur les Pink Floyd, ou sur les Rolling Stones, ou sur Led Zeppelin. Ne bousculez pas, il y en a pour tous les goûts. Pour sûr les seventies marquèrent l'apogée du rock dans le grand public. A atteint en cette fabuleuse décennie son étiage le plus haut. Une position hégémonique dans la jeunesse. Du moins dans sa minorité agissante et signifiante. Car les plus gros bataillons de la majorité silencieuse, les rangs dociles de cette chair à patron vouée à l'exploitation libérale, écoutaient la variété la plus moche. Le rock est apparu en ces années mouvementées comme l'expression privilégiée de la révolte juvénile. Face à l'étroitesse de la morale sexuelle héritée de l'idéologie chrétienne, face à la toute puissance des tutelles parentales, face à l'organisation d'une société éminemment castratrice quant à l'effulgence des désirs inassouvis.
« L'expression de la colère », le terme est beau comme le reflet du soleil sur un miroir. Vous éblouit tout en permettant de ne pas voir. Plein les mirettes pour un rond de frite molle dégoulinante de compréhensive attitude. Permet d'évoquer sans s'appesantir. Une fois dit, l'on passe à autre chose. C'est que l'on appelle l'objectivité démocratique. Tout le monde a droit à sa petite phrase récapitulative. Mais en ces générations du baby boom, si certains se sont complus à accentuer le côté « Oooh ! Baby I Need You » d'autres ont préféré explorer le côté « boum ». Ne vous méprenez pas, ce n'est pas la boum acnéique autour du teppaz, mais le boum explosif des bombes qui éclatent un peu partout.
La guerre du Vietnam a mis le feu aux poudres sur les campus universitaires américains. Mais très vite les hippies sans verser du tabac dans leur herbe ont mis un peu trop de fleurs dans le canon de leurs fusils. En France, pour une fois on a dépassé les ricains, l'on s'est offert un petit Mai 68 pas piqué des hannetons, regorgeant de pavés et de gaz lacrymogène. Ca s'est mal fini. La bourgeoisie main dans la main avec les organisations ouvrières réformistes ont enterré les espoirs fous de tout un peuple dans l'urne funéraire des renoncements démocratiques au do it yourself anarchiste. Y a eu des soubresauts, des répliques, qui se sont traduits par l'émergence de groupuscules politiques contestataires.

La bonne ville de Toulouse fut un abcès de fixation de ces rebellions ouvertes qui ne voulaient pas abdiquer. Le mouvement gauchiste y fut très fort et pourvu d'un deuxième pôle anarchiste tout aussi pléthorique et efficace. Simple question géographique, c'est à Toulouse que se replièrent moult des partisans de la révolution espagnole après son écrasement par les troupes franquistes en 1939. Très logiquement la ville soit-disant rose devint la base arrière ( et avancée ) des mouvements qui continuaient la lutte en Espagne même.
Le GARI, anagramme de Groupes d'Action Révolutionnaire Internationale, prit forme en 1973 lorsque des membres du MIL ( Movimiento Iberico de Liberacion ) espagnol furent arrêtés à Barcelone. L'un d'entre eux Puig Antich fut condamné à mort et garroté le deux mars 1974, malgré de multiples manifestations de soutien dans toute l'Europe. Le film relate l'enlèvement à Paris du banquier Baltazar Suarez durant presque trois semaines, sa libération et toutes les actions qui s'ensuivirent. L'est monté à base de quelques images d'archives et donne avant tout la parole à certains des protagonistes de cette action qui monopolisa les médias nationaux durant plusieurs mois. Des gens âgés – l'un d'entre eux est même décédé dans les semaines qui suivirent son témoignage – mais qui n'ont rien renié de leurs engagements. Ce qui est rassurant quand on voit nos hommes politiques prêt à se dédire de la moindre de leurs affirmations politiques dans les minutes qui suivent leurs déclarations dès que la mayonnaise médiatique éclaire d'un peu trop près le sens de leurs paroles.
Je doute que ce film ait droit à une large diffusion. Trop dangereux. Son message est d'une transparence absolue : l'action vaut mieux que l'inaction. Paye toujours mieux. Et pourtant le GARI n'était constitué ni de supermen ni de superwomen. Plusieurs groupes de militants plus ou moins cloisonnés, infiltrés par un agent franquiste en étroite collusion avec la police française, un peu amateurs, mais déterminés et décidés. Assez malins pour prendre la hiérarchie policière à son propre piège et qui échapperont malgré les arrestations et les perquisitions aux lourdes années de prison décidées à titre d'exemple par l'Etat. C'est sûr qu'entre temps ils n'ont ménagé ni la poudre ni la penthrite, mais l'Etat Espagnol devra libérer plus de deux cents militants détenus dans ses geôles. De l'action directe musclée et radicale mais qui reste très loin de la lutte armée.

Un mauvais exemple. A donner des sueurs froides dans le dos de nos dirigeants. L'existe manifestement plusieurs manières de s'indigner. Après l'échec des manifestations pacifiques sur les places publiques, faudrait pas que se constitue un abécédaire des autres manières de lutter. Avec la colère sourde qui s'ancre de plus en plus profondément dans de larges couches de la population excédées de précarité et de misère, il serait très malséant que ce film qui relate des évènements vieux de quarante ans n'engendre une forme aigüe de réflexion sur le déploiement de nouvelles militances, un plus ollé ! ollé ! que la morne résignation de façade d'aujourd'hui.
Un film très rebel rock, en quelque sorte.
Damie Chad.
09:50 | Lien permanent | Commentaires (0)
15/10/2014
KR'TNT ! ¤ 204. SUICIDE / NEXTFLOOR / NAKHT / NATURAL RESPECT / KLAUSTROPHOBIA / BILL HALEY / MONT DE MARSAN
KR'TNT ! ¤ 205
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
16 / 10 / 2014
|
SUICIDE + ALAN VEGA / NATURAL RESPECT / NAKHT / NEXTFLOOR / KLAUSTROPHOBIA BILL HALEY / FESTIVAL MONT DE MARSAN |
LA GAÎTE LYRIQUE / PARIS 03
08 – 07 – 14 / SUICIDE
ROCK'N'ROLL SUICIDE
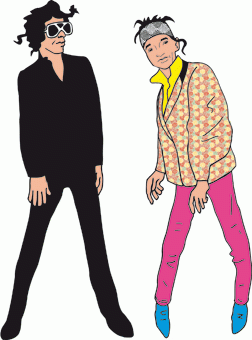
Ce concert de Suicide à la Gaîté Lyrique avait un petit air de dernier rendez-vous. Martin Rev semblait en grande forme, mais Alan Vega - 76 ans - ressemblait à un mort-vivant. Ils paraissaient tous les deux à la fois perdus dans l’immense volume de cette salle et en même temps terriblement présents, car foncièrement légendaires. Ces deux petits vétérans de la grande époque se dressaient face à une salle pleine à craquer. On sentait que le public était un public de fans et de connaisseurs. Cinquante ans de légende électro, ce n’est pas rien. Même si on ne raffole pas des albums et de la musique de Suicide, il faut bien avouer que leur set - et ce qu’ils dégagent tous les deux par leur simple présence - sort de l’ordinaire. On peut parler de souffle et du fruit d’une incroyable ténacité. Si on admire tant Alan Vega et Martin Rev aujourd’hui, c’est tout simplement parce qu’ils ont su défendre pendant cinquante ans une vision unique du rock. Et pour eux, ce fut extrêmement difficile, car leur style les marginalisait radicalement. Ils étaient beaucoup trop en avance sur leur temps. On encensait Patti Smith à l’époque, mais la seule présence de Suicide dans les parages du CBGB la ringardisait systématiquement. La pauvre Patti Smith travaillait à l’ancienne et la modernité Suicide dépassait ses facultés de compréhension.

C’est en les voyant sur scène qu’on réalise à quel point ils sont dans le vrai. Pas dans le vrai, c’est vrai, mais dans leur vrai. Leur univers est réel, il fonctionne. Pendant une heure, on ne s’ennuie pas un seul instant. Au contraire. Ils exercent une étrange fascination, du genre de celle que pouvait exercer dans l’antiquité un personnage charismatique rencontré au détour d’un chemin perdu de Palestine. See what I mean ?

Affublé d’une casquette marquée Brooklyn, de lunettes à montures fluo et d’un ensemble moulant en vinyle noir, Martin Rev fit un joli numéro de cirque. Il martyrisa ses machines et pulsa un son énorme gorgé d’électro synthétique. Il mit tout le monde sous tension et insuffla dans les esprits une belle dose d’adrénaline. Il sortait un son qui n’était pas du rock, mais son pounding valait cent fois celui d’un garage-band. Ce son qu’il a inventé voici cinquante ans est le heartbeat urbain de New York, et les machines diront la pulsion urbaine d’une ville comme New York mieux qu’aucun groupe de rock ne le fera, ni même le Velvet et encore moins Grand Mal. Et là-dessus se pose la voix forte d’Alan Vega, chantre de la décrépitude urbaine et des bas-fonds de la mégapole. Alan Vega appartient à la caste des très grands chanteurs américains, il ne faut pas l’oublier. Niveau Elvis, Iggy et George Jones. Il disposait autrefois d’un timbre unique, d’une prestance comparable à celle de Lou Reed et d’un sens aigu du swing rockab. Mais ce soir de juillet à la Gaîté Lyrique, il semblait avoir perdu sa voix ainsi que sa vitalité. Il errait comme une âme en peine, revenait au micro et brandissait sa canne à pommeau. Il semblait pourtant heureux de se retrouver sur scène à Paris car il n’en finissait plus de saluer le public. Il chantait par intermittences, pendant que Marty faisait trembler les colonnes du temple. Ces deux personnages donnaient l’impression de maîtriser le chaos. Mais dans l’immensité de cette salle, le chaos semblait démesuré et rendait leurs silhouettes bleuies par le light-show encore plus frêles. Peu de groupes osent ainsi se mesurer aux éléments, surtout lorsque ces éléments ont été créés de toutes pièces. Quand on voit Martin Rev, on pense aussitôt à une sorte de Docteur Frankenstein farfelu. L’étonnant est qu’ils atteignent tous les deux leur fin de cycle de vie alors que leur chaos sonique semble entamer le sien.

L’histoire de Suicide ne date pas d’hier. Alan rencontra Marty en 1969. L’ami Marty sculptait et jouait déjà dans un groupe de jazz expérimental, typique de la bohème new-yorkaise des années soixante (voir les mémoires de John Cale et l’histoire de Sun Ra). Ce groupe de jazz expérimental jouait toute la nuit. Marty et Alan cliquèrent bien et montèrent Suicide. Leur premier show eut lieu dans un musée, comme par hasard. Suicide s’est toujours considéré comme un projet d’art expérimental. Leur première prestation, baptisée «Punk Rock by Suicide», eut lieu au New York City Museum en 1970, et tant mieux pour ceux qui purent y assister. Ils avaient déjà cinq ans d’avance sur la scène «punk» new-yorkaise. Mais comme le précisait Marty, les vrais punks n’étaient pas ceux qui arrivèrent dans le rond du projecteur en 1975, mais ceux qui étaient là depuis le début : Elvis, Chuck Berry et Little Richard, c’est-à-dire un chauffeur de camion, un taulard et un trave.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la formule de Suicide fut élaborée comme un concept. Marty et Alan voulaient explorer les possibilités du minimalisme : vocals, drums & machines. Ils affinèrent le projet en virant la batteuse Mari - qui était aussi la femme de Marty - en 1975, pour la remplacer par une boîte à rythme et se rapprocher encore plus de leur idée du minimalisme : deux personnes, un seul micro et des claviers. Rien d’autre. Personne n’aurait misé un centime sur eux. Leur show s’appelait alors «Punk, Funk and Sewer Music by Suicide». Ils se produisaient dans les clubs new-yorkais à la même époque que les Dolls alors à leur apogée. Peu de temps avant de mourir, Arthur Kane expliquait que les Dolls avaient la trouille de Suicide, car Alan Vega sortait tout le temps son cran d’arrêt et se donnait des coups de poing dans la figure. Il montait aussi sur scène avec une chaîne de moto et frappait le plancher à coups redoublés, ce qui terrorisait le public. Mais en 73, les Dolls et Suicide sympathisèrent et David Johansen jouait parfois des claviers avec les deux compères. Johansen avait fini par apprécier leur modernité.

Suicide sortait un son unique, que les Anglais qualifiaient de thunderous proto-punk electronica. Aucun groupe n’avait jamais sonné comme ça aux États-Unis. Chaque chanson était conçue comme un film. Alan Vega racontait une histoire. Il faisait de la poésie urbaine, comme Lou Reed, d’ailleurs. L’histoire de «Frankie Teardrop» raconte l’histoire d’un pauvre type qui ne s’en sort pas - «He’s working from seven to five/He’s just trying to survive» - et qui descend toute sa famille avant de se tirer une balle dans la tête - «Frankie put the gun to his head/ Frankie’s dead». La mort rôdait dans les chansons d’Alan. Les sets du groupe étaient d’une rare violence et dépassaient rarement les 30 minutes. L’un des épisodes les plus retentissants de leur «carrière» fut la fameuse tournée anglaise de 1978 en première partie des Clash, et notamment le concert de Glasgow. Alan Vega et Marty cultivaient un goût prononcé pour le chaos et Glasgow était l’endroit rêvé. Henry Scott-Irvine raconte l’épisode : «Le chaos semblait inévitable avec un tel rassemblement : 4.000 punks et skinheads de Glasgow ! Alan Vega arriva sur scène sans être annoncé. Il portait un blouson doré avec une seule manche. L’autre avait été arrachée. Il plongea le public dans un silence consterné. Un mec brailla : ‘Qui c’est celui-là ?’ Un autre gueula : ‘Hé toi, prends une guitare !’ Le public avait ‘I’m So Bored With The USA’ des Clash en tête et les gens commencèrent à claquer des mains. Pour mieux provoquer les Écossais, Alan Vega claqua des mains en rythme avec eux. Mon pote me glissa à l’oreille : ‘Il ne faut jamais provoquer un mec de Glasgow !’ Dans les secondes qui suivirent, les Écossais arrachèrent toutes les rangées de sièges de la salle.» Évidemment, Alan Vega continua de les provoquer. Il ramassa une boîte de bière qu’il but à la santé du public, puis une hache vint se planter à ses pieds. Il y eut une bagarre générale dans la salle, et après le concert, les flics embarquèrent Joe Strummer au ballon. L’autre heure de gloire de Suicide fut la première partie d’un concert d’Elvis Costello à Bruxelles en 1978. Une fois de plus, le public n’était pas préparé à supporter l’assaut de la fameuse thunderous proto-punk electronica. Les Belges étaient là pour Costello et sa petite pop bien propre sur elle. Alors les Belges laissèrent Suicide jouer un morceau pour voir à quoi ça ressemblait puis ils commencèrent à huer pendant «Rocket USA», le second morceau. Au troisième morceau, ils gueulaient : «Elvis ! Elvis !» On est en Belgique, ne l’oublions pas. Ils n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin. Un Belge sauta sur scène pour piquer le micro d’Alan. Hey ! Trop tard ! Alan ne s’est pas découragé. Il s’est mis à chanter «Frankie Teardrop» a capella. Mais ça huait de plus belle. Alors Alan s’est énervé : «Shut the fuck up ! This is about Frankie !» Il fut obligé de quitter la scène et bien sûr les Belges se mirent à applaudir son départ.

Dans l’histoire du rock, peu de gens ont su manier le chaos avec brio. Avec les Pistols et les Stones, Alan et Marty furent les meilleurs. Si les concerts tournaient mal, ça leur semblait normal. Ils étaient tous les deux des petits durs new-yorkais et rien ne pouvait les effrayer. Ils ne bronchaient pas quand ça dégénérait. La réaction du public les décevait souvent. Too square to appreciate their genius. Beaucoup d’artistes d’avant-garde ont vécu ça avant eux. Édouard Manet fit scandale avec son Déjeuner Sur l’Herbe. Idem pour Malevitch avec le Carré Blanc sur Fond Blanc et plus récemment pour Wim Delvoye avec sa fameuse machine à caca. L’histoire de l’art grouille d’histoires de ce genre. Il n’était pas surprenant de voir Alan Vega et Marty Rev confrontés à l’obscurantisme rock de leur époque. Il faut tout de même se rappeler que le monde des «enfants du rock» est surtout un monde extrêmement cloisonné où règne un sectarisme encore plus virulent que dans le monde syndical. Quand on n’aime pas un groupe, il est d’usage de dire que c’est de la merde. Dans le monde syndical, quand on n’apprécie pas les idées des autres, il est d’usage de dire qu’ils ne sont pas dans la ligne.

Leur premier album n’était pas à la hauteur de leur réputation. C’est le principal reproche qu’on pouvait leur adresser. Beaucoup trop pop pour des gens qui se vendaient comme les apôtres du chaos. L’album ne tenait que par la voix d’Alan Vega et la qualité de ses textes, qu’on taxait de sambas morbides - «Speeding on down the skyway/ 100 miles per hour/ Gonna crash/ Gonna die/ And I don’t care» - C’est vrai que «Rocket USA» puait l’angoisse. Même chose pour «Frankie Teardrop», monté comme une mascarade cauchemardesque avec la mort comme délivrance, le beat ultime du non-regard et du déni de vie qui s’affirmait dans un hurlement. En écoutant «Ghost Rider», on avait l’impression de voir une petite assemblée de robots déniaisés jerker dans un habitacle caoutchouté, avec des hochements de tête d’avant en arrière, des roulements d’épaules et des ploiements de genoux sporadiques. On avait l’impression d’écouter un disque fantôme traversé par des vents glacés. Certaines pièces comme «I Remember» étaient même trop pop, alors que sur scène Alan Vega provoquait les skins écossais, les pires. Mais avec ce premier album, les deux compères posaient les conditions de leur légende. Et ils inventaient un genre qui n’existait pas encore : l’électro.
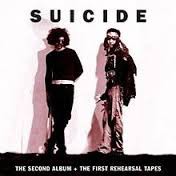
Leur second album «Suicide : Alan Vega and Martin Rev» était beaucoup plus solide. «Mr Ray» était dédié à Ray Gange, le mec qu’on voit dans le film «Rude Boy» consacré aux Clash. «Fast Money Music» sonnait comme un hit étrange, avec un brin de folie monté sur un groove de flûte des Andes, le push des fantômes et Alan s’énervait, il poussait des petits cris de bête et ça devenait excitant. Alan ramenait sa fraise rockab dans «Be Bop Kid», il prenait ça à la décontracte et groovait sur les machines automatiques. On réalisait à la lumière de ce numéro de charme à quel point Alan Vega était brillant. Il chantait ensuite «Las Vegas Man» du menton. Il savait créer des ambiances et nous embarquer dans ses grooves malades et latents. Il chantait ça bizarrement et Marty samplait dans son coin. «Shadazz» était une sorte de mambo admirablement séduisant - Sweet lady she dies oh shadazz - et «Dance» ressemblait à un groove en mauvaise santé, un groove plombé et une fille chantait derrière. On avait là un truc parfaitement malsain qui évoquait les ambiances glauquissimes de David Lynch, du genre aw t’es mort dans l’orgasme purulent d’un délire à la Burroughs. Alan et Marty connaissaient toute cette logique de la putréfaction des idées par cœur. Leur groove était celui d’une mort par overdose. Mais pour pouvoir entrer sérieusement dans l’univers de Suicide, il fallait être complètement défoncé. C’est là que se trouvait la clé de l’énigme. «Super Subway Comedian» le matin au petit déjeuner, en même temps que la tartine beurrée, ça ne marche pas. Par contre, si on l’écoutait dans de bonnes conditions, alors on voyait le petit joueur de flûte des Andes sur le radeau d’Aguirre parti à la dérive sur l’Amazone, c’était Alan qui portait le bonnet et qui dansait d’un pied sur l’autre parce qu’Aguirre avait sorti son épée et lui avait ordonné de danser. On voyait les singes et on voyait les flèches. On voyait le radeau dériver vers l’enfer. Ce deuxième album était bourré d’ambiances délétères. On avait là le fameux dérèglement de tous les sens dont parlait le trafiquant d’armes Rimbaud qui d’ailleurs aurait adoré ces killer flavors. Suicide se montrait maladif, contagieux, malsain et crapuleux. «Dream Baby Dream» était du pur jus suicidaire avec une mélodie à la ramasse de la rascasse et «Radiations» émettait de sacrées concoctions d’art moderne à la fois énormes et lointaines.
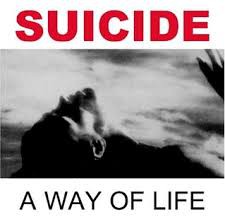
Avec leur troisième album, «A Way Of Life», les deux compères ont trouvé leur vitesse de croisière. Retour au groove ténébreux avec «Wild In Blue», qu’Alan chante d’une voix rugueuse à la Bukoswki. Il va chercher ses accents assez loin au fond de son gosier, dans une belle ambiance d’écho mortifère. On retrouve l’excellence de la pression avec «Rain Of Ruin», monté sur un beat voodoo électronique. Alan débite son voyage d’une voix mûre. S’il est une musique qui se prête à la littérature, c’est bien celle d’Alan Vega. Il est littéraire, au sens américain du terme. Comme le furent Malcolm Lowry, Mezzrow et William Burroughs. Ils expérimentaient en direct. «Sufferin’ In Vain» sonne de manière incongrue, comme un petit roman de Jean Paulhan. Il faut aimer prendre les chemins de traverse, et si on s’y plait, alors on se délecte de tant de grâce impromptue. «Domino Christ» est une pièce exemplaire d’hypnotisme carabiné. Alan et Marty tapent dans l’excellence de la démesure. Ils se veulent à la fois expansifs et envoûtants. C’est magnifique d’alarmisme tempéral. Encore une belle merveille suicidaire avec «Heart Beat» qui s’inscrit dans le cutané du son et les interjections d’Alan allument des lampions dans les rues désertes. C’est le fameux beat des ténèbres, celui qui terrorise les admirateurs de Jean-Jacques Rousseau. Parce qu’il avance dans la nuit comme une machine de guerre, semblable à un énorme vacherin technologique qui se profile dans l’embrasure des brisures de rêve, là où l’esprit n’ose plus guère traîner, au lendemain de certains traumatismes viscéraux. Mais Alan s’y fourvoie. C’est un démon vert de l’au-delà des genres. Il fait son rock, que ça plaise ou pas.

Avec son léger parfum discoïdal, «Why Be Blue» semblait subir les ravages de la mode. On était en 1992, et donc en plein dedans. Le morceau titre est très dansant. «Cheat Cheat» se veut plus rocky-road, mais le beat reste dans le trapèze horizontal. Dans «Universe», Alan Vega sonne comme un prêtre Inca priant l’astre solaire sur la haute terrasse d’un temple. Il faut attendre «Last Time» pour retrouver la stature suicidaire et les petites ossatures translucides. Retour des poissons mécaniques argentés qui circulent entre les nappes de mambo synthétique - Yah - La musique de Suicide est une formidable plate-forme d’expérimentations imaginaires. Ou bien on avale un grand verre de rhum de Guyane, ou bien on fume un gros joint d’herbe, et en voiture les enfants. Magie du propulsif. Les sons colorent l’espace et des formes apparaissent. On se sent apaisé par la seule présence d’Alan Vega. Sa voix chaude nous met en confiance. Avec quelqu’un d’autre, ça ne marcherait pas. Nouveau hit exemplaire avec «Pump It» qu’Alan chante avec de la délinquance plein la bouche. Il fait swinguer ses voyelles sur fond de transe électro concoctée par l’ami Marty. Avec cette pièce maîtresse d’hypnotisme - Hot hash - il règne sur son univers. C’est à ça qu’on reconnaît les géants visionnaires. Autre merveille : «Mujo», énorme et suicidaire, dotée d’un beat qui ne pardonne pas. Alan se vautre dedans comme dans un canapé rose. Il chante avec une affectation perverse, glousse un peu et le beat fuira vers l’horizon, jusqu’à la fin des temps. Voilà ce qu’il faut bien appeler une fin de non-recevoir.

Le dernier album de Suicide est sorti en 2002. On trouvait sur «American Supreme» l’une de ces énormités dont est capable Alan Vega : «Beggin’ For Miracles». Un hit planétaire bourré de sens, monté sur un gros beat industriel - dancing on the graves - Il ravale sa salive - Oh yeah ! So spectacular ! And you’re gonna beg ! And you’re gonna beg ! - un point de non-retour. Il retrouvait son accent de la rue pour attaquer «Swearing To The Flag» et chantait un hymne à la décadence de l’Amérique avec «American Mean» - Hey bank-robber, stay away ! - On avait même des trompettes dans le groove de «Wrong Decisions» et de la violence à l’état pur dans «Death Machine», pure électro de transe, énorme et bien pulsée, même si on n’aime pas l’électro. Il balance un nouvel hymne à la grandeur de l’Amérique avec «Power Au Gogo» - Thank you America/ Everything is crime/ Everything is racist/ Au gogo - Magnifique. Tout est dans le swing de sa diction. Il échappe au format de la chanson. C’est un géant du rock des rues. Et il finit avec «Child It’s A New World», alors on retrouve l’excellence de ses mises en garde et l’autorité de ses injonctions.
Tous les fans de Suicide possèdent les disques live, et notamment «Ghost Rider» qui propose les fameuses ROIR Sessions de 1986. C’est le seul moyen de se réconcilier avec le premier album studio qui paraissait un peu raté. Ils attaquaient «Rocket USA» à la corne de brume et Alan partait aussitôt en vrille pour faire son punk des bas-fonds new-yorkais. Il conjurait les démons de l’acier noirâtre et travaillait l’énervement chamanique. Il organisait son petit chaos et échappait à toutes les règles d’or. Il trépignait ensuite «Rock N Roll» dans la friture d’huile de vidange des machines secouées par les court-circuits - schcccchhh ! - Il conjurait - babybabybaby - il attirait les ennuis comme un gros aimant et se comportait comme le parfait nosférateur. Dans «Ghost Rider», on entendait les klaxons et ils envoyaient «Harlem» valser sur un jungle beat incantatoire évadé d’une salle de torture américaine. Ils lâchaient une version noire, dans l’esprit du non-esprit. On sentait une persévérance maléfique. Puis ils passaient le vieux hit de Question Mark à la moulinette de Jean-Christophe Averty - Oh cry cry cry - ils re-frissonnaient un «96 Tears» qui n’en avait pas besoin, et le traitaient à la nappe déviante et fine d’alu dans l’étain de l’éteignoir. Et dans le profond de l’oreille, ça dansait comme la main molle et blanche d’une Carmélite de Clovis Trouille.

On vit apparaître dans les années 80 les premiers albums solo d’Alan Vega. Sur le premier, un guitariste nommé Phil Hawk l’accompagnait. Alan allumait les lampions dès le premier titre, «Jukebox Baby», une sorte de rockab futuriste qu’il haletait merveilleusement. Et on allait de surprise en surprise, avec «Fireball» et sa belle progression cavaleuse - babe babibaberen - bien montée sur son petit dadada et surtout «Bye Bye Bayou», pièce de pur génie cavaleur montée sur une jolie mécanique rythmique, un paradis hypnotique pour les moustiques et les amateurs de frissons. Alan en profitait pour faire le con et imiter toutes les bêtes du marais.

«Collision Drive» sortait un an plus tard. Il jouait avec un vrai groupe et continuait d’explorer la magie rockab avec «Magdalena 82» et «Magdalena 83». On trouvait même sur ce disque une reprise un peu trop bizarre de «Blue Suede Shoes». Il fallait attendre «Outlaw» pour retrouver notre cher géant visionnaire. Il y était suivi par une guitare offensive et bien grasse. Il s’agissait là du hit que tous les fans d’Alan attendaient de pied ferme. On tombait ensuite sur un autre chef-d’œuvre absolu, un «Ghost Rider» monté sur un rif bourdon. Terrible riff qui s’insinuait dans la cervelle. Cette vraie cochonnerie tendancieuse entrait dans le conduit auditif comme le scarabée qui était entré dans l’oreille de Speke, au temps où il explorait avec Richard Burton les hauts plateaux d’Afrique de l’Est à la recherche des sources du Nil. On avait là une vraie merveille hypnotique. Ce Ghost interdisait le pékin perdu dans la Cité et emportait tous les Riders in the Storm. Vega végatait à fond de Mystery Train et régnait sans partage sur un monde idéal caractérisé par l’absence de médiocrité. Il posait le haut registre de sa voix sur de vertigineux autels de parti-pris catégoriques.

Et hop, il revenait deux ans plus tard avec «Saturn Trip». Il profitait de «Saturn Drive» pour lancer le frelon des machines. Ça bourdonnait bien à l’oreille, d’autant mieux qu’Al Jourgensen et Ric Ocasek étaient de la partie. Alan redevenait l’espace d’un morceau le roi des tensions suburbaines. Puis il claquait «American Dream» au groove byzantin d’Ocasek et il végaïait nonchalamment au fil d’une belle élongation du beat. On pourrait croire que «Kid Congo» est un clin d’œil aux Cramps, mais non, c’est juste un exercice de style alerte - Oh ouango-bango ! On trouve un hit pop de bas de gorge en face B, le fameux «Wipeout Beat», ce pur jus déclamatoire qui va faire sa grandeur - We want a radio/ We want a TV/ We want the movies/ We want it now wouahhh ! - Le hit de l’album, c’est «Angel». On y retrouve la transe de Question Mark & The Mysterians. Alan sait manier le vrai drive sixties - She’s so sensational/ I love her so/ I love her so - et derrière Mark Kuch joue du gros garage d’évacuation. Tout tient par la voix.

Si on achète «Just A Million Dreams», c’est uniquement pour la pochette. Alan y est beau comme un page florentin. L’album est littéralement massacré par la prod des années 80. Alan a beau s’énerver - Cumon, I’m dangerous - ça ne marche pas. Le son synthétique le ridiculise. Tout est atrocement poppy sur ce disque et Ocasek fait le fanfaron par derrière. Le seul morceau sauvable est «Wildheart», monté sur un beat furtif et hanté par des TV Ghosts. Alan navigue en solitaire dans cet univers de pacotille, au fil d’images qui défilent sans laisser de souvenirs.
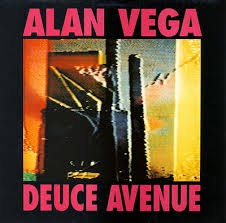
Sur «Deuce Avenue» paru en 1990, il chante avec Liz Lamere. Dès «Body Trip Jive», on retrouve la merveilleuse pulsation pulsative des temps bénis. Avec «Sneaker Gun Fight», Alan teste le beat. Il le toise d’un œil expérimental. Il va chercher des accents durs. All the power ! Il se confronte avec le son. Il heurte le beat de plein fouet. Avec «Jab Gee», il cherche ses mots sur fond de beat électronique, pendant que des nappes de violons synthétiques s’éloignent. Alan Vega est au rock ce qu’Henri Michaux est aux lettres : il expérimente savamment. Il teste une fois de plus l’étrangeté du beat avec «La La Lola» et se contrefout de la latitude. Il bricole un mambo technoïde fascinant. Il se situe aux antipodes de TOUT. Alors on le suit de près. Dans «Deuce Avenue», il shoote un riff de la planète Uranus. Il cherche une sorte de réconciliation avec la mélodie humaine et bascule inexplicablement dans le weird extraordinaire. Dans «Sweet Sweet Money», on l’entend cultiver la désespérance sur un beat de fin du monde. Puis il revient au weird par pur hasard avec «Love On», épaulé par des chœurs de petites fourmis et des frelons qui zonent. On se croirait chez Tamla-Gallimard. Avec «No Tomorrow», il nous entraîne à nouveau dans une atmosphère fabuleusement littéraire. On croirait entendre des bruitages de voix intérieure à la Joyce. Avec Alan Vega, on évolue dans un autre monde, qui serait celui d’une certaine évolution.
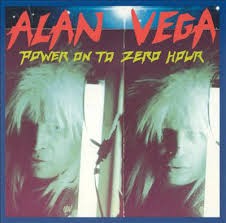
Il revient en 1991 avec «Power On To Zero Hour», nouveau manifeste techno-littéraire. «Bring In The Year 2000» est le groove urbain idéal. Alan Vega est au son ce que William Burroughs est aux lettres : une force tellurique, un vif-argent, un pape de l’insolite, une intelligence dépareillée. Avec «Sucker», Alan reprend son bâton de pèlerin suicidaire. Il pulse le beat et crache son ressentiment. Il s’en prend au genre humain et au dévoiement de la race blanche. La richesse des ambiances sonores le rend invincible. Il sait driver les machines noires et froides - Watch out brother ! - Il provoque un agacement neuronique intense et touille le foutraque - Sucker ! - Avec «Fear», il titube dans les couloirs du palais sur de faux airs décadents auxquels se mêlent des échos de voix droguées et il chante ses rêves de trips. Il récupère un groove nubien pour «Automatic Terror». Sous la lune de Balaluma, il attise un groove adroit et juteux. Chaque disque d’Alan Vega est une aventure passionnante qui nous fait oublier la platitude des contingences. Alan Vega invente avec ses disques une espèce de nébuleuse nubile qui luit comme l’or pâle dans l’ombre d’une minuscule scène tendue de velours bleu nuit. Attention à «Believe It» : on tombe sous le charme hypnotique du White Zombie de Victor Halperin. Alan serre les poings - Forget all the promises/ Forget all the news - On retrouve l’incandescence de «Beggin’ For Miracles». Le génie technoïde d’Alan Vega donne le vertige.

«New Raceon» est un album du même niveau que le précédent. Alan attaque avec «The Pleaser» et il pose sa voix de King techno sur un beat métronomique. «Christ Dice» est furieusement fouillé aux guitares. Il fonctionne par grosses giclées d’interjections electroïdes. Hey ! C’est un meneur de rondes infernales. Hey give my Christ dice ! «Gamma Pop» est un hit dégingandé et fantastique d’allant. Il stimule un squelette rythmique trouvé dans le bric et le broc du Bronx. Pur hypnotic blast. Avis aux amateurs. Encore une équipée sauvage avec «Viva The Legs». Alan est le seul mec capable de virées à la Brando. Il crée les moods de la mort du petit cheval fabuleusement fouillés au beat. Dans «Do The Job», Ocasek joue le guitar man vaudou. Une fois de plus, Alan fascine. Il n’a plus rien à prouver - No more soul ! - Alors, il susurre des vers modernes dans la chaleur blanche d’une fournaise technoïde. Ça ronfle dans «Keep It Alive», comme dans Sleep, le film en plan fixe d’Andy Warhol qui nous montre pendant trois heures un mec en train de dormir - Don’t take your shit - On a là une véritable bête de soul techno à la Vega, il pousse des cris. On le suivrait jusqu’en enfer. Ça ronfle et derrière ça fouette des guitares dans les couches du son. On entend crier une belette dans une cave.

Alan Vega, c’est la même chose que Sun Ra : il conçoit des espaces nouveaux. Et donc, il ne peut pas plaire à tout le monde. Avec «Dujang Prang», il cure la plaie du vieux cauchemar américain du Sud-Est asiatique. «Hammered» ? Comme son nom l’indique, Alan martèle comme Charles Martel, sauf qu’il ne martèle pas des crânes de Sarrazins mais le crâne du néant. Il erre dans les tin cans et dans les aléas d’un groove de boîtes en fer. C’est du grand Vega, du paradis artificiel en vrac de havoc. Et voilà «Cheenanoka», l’immense groove organique du Vega galvanique. Il est accompagné de chœurs de cathédrale et de glouglous de labo interdit. C’est une atteinte à la morale, un beau désordre panaméen. Il taille ses instruments dans la jungle de bambous technoïdes et sollicite les âmes des guerriers perdus. Alan Vega est la réincarnation du Fantôme du Bengale. Il groove sur la mort et les chœurs des guerriers morts hantent son cut. S’ensuit une petite virée dans l’espace avec «Saturn Drive 2». Il suce des molécules et gronde de plaisir. Il libère des énergies inconnues. Son vaisseau réagit bizarrement, mais c’est bien. Il chuchote ses confidences, perdu dans le néant. Personne ne l’écoute. Avec «Jaxson Gnome» on réalise encore plus nettement l’originalité d’Alan Vega. Son univers est l’un des plus imagés de l’univers du rock. Peu de gens sont capables de tripper autant à jeun, c’est à dire sans rien avaler. Son rock monte toujours directement au cerveau. Il s’adresse essentiellement à l’intellect. Avec «Life Ain’t Life», il recrée une ambiance de flaques noirâtres dans un immense hangar gelé. On se demande d’ailleurs ce qu’on fait là. «Flowers Candles Crucifixes» se présente comme un cliché mais Sahib Vega pas cliché. Il aspire sa bave. Il lance ses pulsions dans le groove le plus poisseux de l’univers. Il hurle dans la surenchère du rut. On entend griller des notes de guitare. C’est atrocement beau. On entend couler un filet d’eau au plus profond de la jungle. Avec Alan, on est dans l’esprit de survie, on est dans l’éclat du mythe. Certains échos renvoient aux scènes de cauchemar tournées par David Lynch à la Nouvelle Orleans (Wild At heart). Puis il fait sonner les tambours de guerre guinéens dans «Big Daddy Stat Livin’ On Tron» et provoque à nouveau le grand dérèglement de tous les sens.
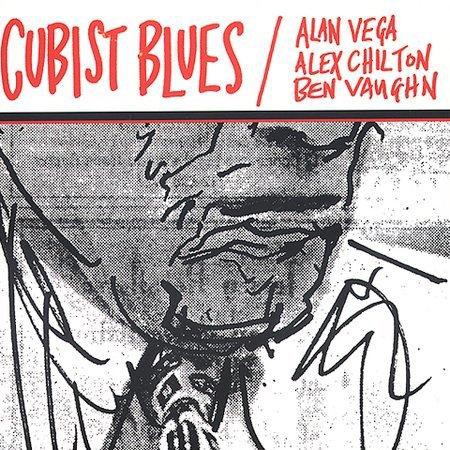
Alan Vega, Alex Chilton et Ben Vaughn enregistrèrent «Cubist Blues» en 1996. C’est un album exceptionnel. On voit rarement des triplettes de cet acabit. «Fat City» est du pur autobahn. Vega tire l’overdrive et chante d’une voix de stentor mythologique. «Freedom» est une pièce plus mélodieuse qui sonne comme un vieux hit parabolique. Alan en fait un slow super-frotteur. Emmené par un chant à la ramasse, «Candyman» est un vrai cut d’anticipation. Alan procède par interjections et jette des coups de menton. Derrière, Chilton gratte comme un dingue. «Lover Of Love», c’est à tomber. C’est la rumba des junkies de Brooklyn sortis tout droit de Ringolevio. Pur Grogan groove. On retrouve l’élégance suprême du groove new-yorkais dans «Do Not Do Not». Et puis avec «The Werewolf», Alan rappelle à toutes fins utiles qu’il est l’un des plus grands chanteurs américains.

La même année sortait «Getchertiktz», un nouvel album de triplette. Cette fois, il s’est acoquiné avec Ric Ocasek et Gillian McCain. Ils chantaient leurs trucs à tour de rôle. Le génie d’Alan Vega éclate une fois de plus au grand jour avec des cuts comme «Tell Me» (fabuleux groove urbain - sweet sweet jealousy), «Smell War» (il entre sur le sentier de la guerre - mutilate ! mutilate !), et surtout «Train», qui est un absolu chef-d’œuvre de trash-rock - No brain no brain/ Insane/ Born on death row/ You gotta crawl - tout est là, dans la façon de fabriquer le cauchemar américain. Pas besoin d’accords garage ni de fuzz. Il suffit d’un peu de classe - In the train/ Wants my ass/ Hey hey no way/ Get the fuck of here - On retrouve dans ce cut exceptionnel toute la puissance sonique des Stooges et du Velvet. C’est une cavalcade insensée. Alan est tout seul avec son attirail - They say hey ! - Voilà une énormité qui n’a pas de prix.
L’album intitulé «2007» est sorti en 1999. On y entend le prêtre défroqué Vega hurler dans la tourmente technoïde des années de déficit antérieur. Il hurlera comme ça jusqu’à la fin des temps et personne n’entendra ses plaintes inutiles. Dans «Meth 13 Psychodreem», la meth se fait mess, il chante le bonheur du trip, c’est un enfant de la balle et même du speedball. Les bruitages sont ceux des os de crâne qu’on entend bouger en plein trip. Dans «Hunger Wonders», il rappelle que les carottes sont cuites - You’ve run out of miracles, mais ça, on le sait depuis longtemps - Hey creators - et une flèche frappe l’écho en plein cœur. Horrifié par le spectacle du néant, Alan hurle democracy dies dans «Jajeemba». Avec «Blessing Fa Ta Broke», il nous baigne dans l’ambiance démoniaque du trip aux grillons sur les genoux de Rosemary. Alan agonise et le beat s’éteint. Encore des surprises de taille avec «King» (claquement d’échos mortifères) et «Trinity 2007» (on y entend un hurlement de cloporte saturnien - toujours le trip de meth). Puis dans «Doctor Death», Alan s’adresse à la mort. Alors elle vient, avec un bruitage particulier.

«Station» date de 2007. Dès «Freedom’s Smashed», on retrouve la grosse atmo à la gaga, la friture électro. Alan crie I see it dans l’enfer du beat urbain. On adore le gospel des machines selon Vega. Lui et Jourgensen sont les seuls qu’on tolère ici bas. Il enchaîne avec le groove des catacombes, «Station Station» et revient au punk psychotique avec «Psychopatha», monstrueux de provok amerlok dans une ambiance malsaine. Il grille sa voix dans l’enfer du mythe. Avec «Crime Street Cree», on poursuit la traversée de l’immense continent tordu d’Alan Vega. Toute la pulsion du monde malade est dans ce cut qui suinte d’une bile atroce. Dans «Traceman», on sent le prophète perdu dans le désert. Alan Vega est une sorte de Jeffrey Lee Pierce errant au milieu de gros beats africains sur-dimensionnés. Il sait lui aussi aller dans l’abattage et nous défoncer le crâne avec des coups mécaniques. «Gun Gone Gam» est un fabuleux ferraillage. Alan Vega ne s’arrête jamais d’innover. Il fait gicler les énergies urbaines de l’électro. Il est à la fois obsédant et fracassant. «13 Crosses 16 Blazin Skulls» nous plonge une fois de plus dans un univers en écho. Alan Vega construit un cut comme Godard construit un film : avec des champs et des contre-champs, des cadres sublimes et des fragments littéraires. Voilà comment on pourrait définir le génie d’Alan Vega. Avec «SS Eyes», il swingue le beat comme s’il avait 20 ans. Comme Raymond Radiguet, ce mec a le diable au corps et rien de ce qu’il entreprend n’est gratuit. Son beat vaut tout l’or du monde. «Warrior Fight For Ya Life» renoue avec l’énergie fondamentale excédentaire du produit extérieur brut de la brutalité concomitante. Comme le beat fait du sur-place, il finit par terrifier. Dans «Devastated», Alan Vega appelle à l’aide - ah-aaaah - il est devastated, alors le beat l’enfonce dans la défonce, il n’en sortira pas vivant, mais il s’en moque éperdument, puisqu’il n’est rien d’autre qu’un génie déjà purulent. Il survivra planqué dans les interstices jusqu’à la fin des temps. Ah-aaaah !
Signé : Cazengler, le végâteux
Suicide. La Gaîté Lyrique. Paris IIIe. 8 juillet 2013
Suicide. Suicide. Red Star Records 1977
Suicide. Alan Vega And Martin Rev. Mute/ZE 1980
Suicide. A Way Of Life. Wax Trax! 1988
Suicide. Why Be Blue. Brake Out Records 1992
Suicide. American Supreme. Mute 2002
Alan Vega. Alan Vega. Celluloid 1980
Alan Vega. Collision Drive. Celluloid 1981
Alan Vega. Saturn Trip. Elektra 1983
Alan Vega. Just A Million Dreams. Elektra 1985
Alan Vega. Deuce Avenue. Musidisc 1990
Alan Vega. Power On To Zero Hour. Musidisc 1991
Alan Vega. New Raceon. Musidisc 1993
Alan Vega. Dujang Prang. Musidisc 1995
Alan Vega, Alex Chilton & Ben Vaughn. Cubist Blues. Thirsty Ear 1996
Alan Vega. Getchertiktz. Sooj Records 1996
Alan Vega. 2007. Saturn Strip 1999
Alan Vega. Station. Blast First 2007
TOUS EN SEINE
CHARTRETTES / 11 – 10 – 2014
NATURAL RESPECT / NAHKT
NEXT FLOOR / KLAUSTROPHOBIA
L'on ne peut jamais être tranquille dans cette vie. Toujours des questions insidieuses qui vous turlupinent et qui ne vous laissent aucun repos tant que vous n'avez pas trouvé la réponse. Exemple : mais à quelles étranges activités se livre Ady quand elle ne vient pas interpréter Queen of Rock And Roll au Glasgow, à Fontainebleau ( voir KR'TNT ! 201 du 19 – 09 – 2014 ) avec les Jallies ? La réponse est facile : elle organise le Tremplin Des Musiques Actuelles « Tous en Seine » à Chartrettes. Oui, mais comment fait-on pour arriver à Chartrettes ? Très difficile. Comptez sur le hasard, la chance et un coup de pouce du destin et des anciens Dieux de l'Olympe qui vous prennent en pitié. Sans quoi vous n'y parviendrez jamais.
La teuf-teuf mobile et moi avons traversé des contrées désertiques, d'interminables rues étroites de plusieurs kilomètres de long bordées de maisons aux fenêtres desquelles ne brille aucune lumière. Nous sommes bien en Seine & Marne, mais l'on éprouve la sensation d'être en route transylvanienne vers le château maudit du Comte Dracula. Pas âme qui vive, j'ai l'impression d'être le dernier survivant de l'humanité. Situation critique, mais pas déplaisante au fond, je suis désormais sans rival, et maître incontesté du monde. Et paf ! Mon rêve s'écroule au dernier tournant, brutalement le village fantomatique se peuple de juvéniles silhouettes rassurantes, toute une jeunesse qui se presse vers les marches d'escalier qui donnent accès L'Espace Multiculturel de Chartrettes. Deux cents jeunes gens miraculeusement sortis de je sais où.
Attention, l'on ne rentre pas comme dans un moulin, c'est gratuit mais chacun des futurs spectateurs se voit remettre un ticket extrêmement important. C'est un tremplin et le public est ainsi muni de son prochain bulletin de vote. Un véritable sésame démocratique. Avec effet immédiat. L'on nous demande souvent notre avis dans notre société, pour n'en tenir jamais compte, mais là apparemment il en serait autrement. Y a tout de même un jury de quatre personnes, une musicienne, un conseiller municipal de la commune, une représentant de la jeunesse et un membre du service culturel organisateur. Z'ont intérêt à avoir une bonne paire d'oreilles !
La salle est toute belle, vaste, haute, avec poutres modernes apparentes – gigantesques porte-manteaux de bois clair - et une véritable scène avec coulisses et régie son... La fête peut commencer dès la fin du speech d'introduction d'Ady, qui s'en tire comme une chef.
THE NEXTFLOOR

N'ont pas la partie la plus facile. Débutent à froid. Intérêt à être dedans dès la première note. Cueillir le public avant de laisser le doute l'effeuiller. Faut le captiver en une seconde et le garder prisonnier durant le temps réglementaire. Pas de montre en main, mais pas plus d'une demi-heure. Superbement mis en place. Yvan bondit et s'empare du micro, alors que les trois autres ouvrent les écluses du déluge sonore. N'a pas dit un mot que déjà tout est dit. Rock and roll attitude. Ne se positionne pas face au public. Mais s'accroupit de profil au pied du podium de la batterie. Pratiquement pas un geste. Immobilité du chant. Quelques secondes, et puis change de place, comme s'il était maintenant le reflet d'un miroir qui n'existe pas. Des plans fixes qui suivent les saccades musicales. Chorégraphie pour un seul danseur. Ballet d'unicité. Peu de choses, mais qui contiennent tout un monde. Nous tendent une image. Changeante. Que l'on n'a pas le temps de décrypter. Comme ces petites mèches de cheveux si pointues qu'elles semblent être nées du hasard d'un coup de peigne mais qui induisent l'idée d'une dimension diabolique. Chez Nextfloor l'on préfère suggérer qu'annoncer.

Un léger défaut tout de même. Ces poses deviennent trop répétitives. Heureusement que derrière la musique emporte l'adhésion, car les nettes icônes du début du set trop souvent répétées finissent par perdre leur impact quasi onirique. L'est sûr que cette espèce de théâtralisation ne doit pas être abandonnée, mais il faut l'empêcher de dégénérer en gimmick. L'est nécessaire de renvoyer sans arrêt l'ascenseur au palier supérieur.
Ca marque les esprits car toute une partie des spectateurs quittent le devant de la scène... pour glisser rapidement leur bulletin dans l'urne transparente disposée sur une table au fond de la salle. Reviennent au plus vite, leur devoir électoral accompli. En attendant Nextfloor n'est pas resté coincé entre deux étages. Sur sa batterie Quentin se démultiplie. Frappe de tous côtés afin que la guitare grondante de Guillaume n'apparaisse point trop survitaminée. Passe pas ses riffs en douce, ni vu, ni connu. Plutôt salut à bon entendu. Du rock qui clique et qui vous requinque. Galvanisé métal mais avec rythmique encore typiquement rock and roll. Luisant et appétissant. Beaucoup de cohérence, dans la structuration des morceaux et la manière de les déployer sur scène. Savent soigner les articulations. Très rapide et en même temps très syncopé. Un très bon groupe. Sont les premiers à passer mais pour le moment je leur accorde mon intention de vote. Aux suivants de me faire changer d'avis.
( photos de répétition )
NAHKT

Ne venez pas faire assaut d'ignorance pendant qu'ils s'installent. Tout le monde sait depuis les découvertes de Champollion que Nakht signifie « Puissance » selon l'ancienne écriture hiéroglyphique. Est-ce pour cela qu'ils posent deux énormes piédestal de bois sur le devant de la scène comme pierres symboliques de la pyramide musicale qu'ils veulent gravir ? Bref avec un nom aussi présomptueux, faut assurer. Tâche d'autant plus redoutable qu'il s'agit de leur première apparition publique.
Six sur scène mais l'on n'en voit que deux. Les deux chanteurs debout et impassibles devant leurs boîtes noires. Les autres sont autour, en position un peu satellitaire. N'envisagez pas des comparses de deuxième zone. Basse, guitares, batterie. Se chargent de la musique. Denrée relativement importante dans un groupe de rock. Si vous pensez que les guitares vont empiler les riffs les uns sur les autres et que la batterie va les aligner à grands coups de massue pour que chacun reste sagement à sa place et ne relève pas trop la tête qui risquerait de dépasser, vous êtes dans le rouge. Erreur absolue. Veux bien être conciliant, peut-être en fut-il ainsi les deux premières minutes, mais après c'est devenu beaucoup plus angoissant. Le son s'est vite transmué en une étrange purée. Ni d'avoine, ni de pommes de terre. Non, de l'orichalque pur, cet étrange métal dont d'après Luc-Olivier d'Algange étaient constitués les remparts de l'Atlantis mythique. Une espèce d'alliage sonore inconnu, d'une flexibilité à toute épreuve, qui s'insinue dans vos oreilles sans que vous y preniez gare – je vous jure que pourtant ils jouent très fort, ou du moins aussi fort que le permet la sono locale – et qui s'empare de vos centres nerveux sans que vous puissiez vous y opposer. Le résultat ne se fait pas attendre. La moitié de la salle se met à pogoter comme des derviches tourneurs piqués pae la plus effroyable des tarentules. Une ambiance de fous en liberté, échappés pour toujours de l'asile.

Voudrais pas vous effrayer. Reste les deux chanteurs Thug et Danny. Ne chantent pas. Ils déglutissent, ils expectorent, ils éjaculent, hors de leurs infects et infâmes gosier, d'immondes serpents venimeux qui s'enroulent autour de vos synapses cervicales et les déroutent de leurs trajectoires mentales habituelles. Des aliens qui s'en viennent élire domicile dans cette matière blanche censée contenir votre intelligence qui désormais ne répond plus à vos injonctions. La puissance de Nakht n'est pas un vain mot, mais un talisman de grande opérativité maléfique. Le rock comme on l'aime. Qui vous transforme en zombie rythmique secoué de tremblements parkinsonniens des plus aberrants. Ne vous laissent pas une seconde de répit. A peine l'un se mue-t-il en un silence époustouflant que l'autre reprend l'antienne terrifiante. Ou alors pendant que le plus grand aux bras tatoués d'incisifs symboles vous invective, le second meugle d'obscures litanies dont il vaut mieux ne pas saisir le sens.
Du métal. Du hardcore metal. Du death hardcore metal. Toutes les étiquettes que vous voulez. Mais un grand groupe. Allaité aux sombres mamelles des fils du kaos fractal, ce qui en français courant se traduit par adeptes du bordel généralisé. Immenses ovations. J'ai oublié que j'étais prêt à voter pour le groupe précédent.
NATURAL RESPECT

Je préviens tout de suite. Je n'aime ni le reggae ni le rap. Autant dire que j'ai quelques préventions contre cette sorte de groupe. Avec tout le respect naturel que je leur dois, cela s'entend. A priori, je serais même plutôt en phase avec les mots d'ordre qu'ils ont écrit au feutre sur une grande feuille de papier : Ni Dieu, Ni Maître, un slogan qui fleure bon l'anarchie, et leur Pas de Futur sans Culture me semble une reviviscence anti-nihiliste et intelligente du No Future punk, quant à la dénonciation de l'éducation scolaire sclérosante dont est victime la jeunesse d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas être d'accord.
Côté entrée en matière, le guitariste tout seul qui se plaint des absents qui entrent peu à peu et un par un, c'est un peu raté. Se débrouille pas mal d'ailleurs sur sa guitare, un jeu très funk, haché menu qui impose le rythme de base au son du groupe. Tristan à la batterie et Clément à la batterie ne font que suivre le mouvement. La loi du groove. Ce pourrait être monotone, mais Nail intervient souvent à la trompette. Ca ne remplace pas une section de cuivres mais ça pigmente et ça pimente le hachis bio végétal. Alex est au chant, et partout à la fois. Farandole micro en main et les dreads au vent entre les musiciens. Sa voix est en première ligne, à mi chemin entre des inflexions rap et des lignes mélodiques typiquement reggae.

N'empêche que malgré leurs inspirations post-modernes, ressemblent un peu à ces groupes hippies des fumeuses années soixante-dix, un petit côté prêche militant d'un autre âge, et goût underground de la revendication festive. Même leur camionnette antédiluvienne, peinturlurée à leur nom, stationnée devant l'entrée semble sortir de ce passé post-préhistorique du rock français. Subjuguent le public, puisque dans son immense majorité il consent à la première demande à venir s'asseoir devant la scène. Devant tant d'engouement je me demande s'ils ne vont pas récolter une marée de bulletins à leur nom. Je le crains.
Ne cachent pas leur drapeau dans leur poche, chanson sans concession contre le Front National qui passe comme une lettre à la poste. L'existe donc encore des rebelles qui ne mordent point à pleines dents dans les doucereuses et nocives tartines empoisonnées du populisme. Le fachisme d'obédience nationale n'est que le miroir aux alouettes que le capitalisme apatride tend aux pauvres – d'argent et d'esprit - pour mieux les engluer dans leurs colères vouées à leurs propres impasses. Applaudissements. S'en tirent avec les honneurs de la guerre. Je ne voterai pas pour eux. Vous vous en doutiez. Pas assez rock and roll. A mon humble avis. Le seul que j'écoute.
KLAUSTROPHOBIA

S'installent doucement. Quatre garçons qui s'empressent autour de leurs instruments et une jeune fille qui erre sur le plateau, toute mince dans son T-shirt à tête de mort. L'a l'air de mourir de trac. L'on aurait envie de la consoler et de lui dire que ce n'est qu'un bon moment à passer. Mais ce n'est pas la peine. Les boys n'ont pas lancé la machine depuis trente secondes que subitement elle se transforme en bête de scène. L'on ne voit plus qu'elle. Attire tous les regards. Pourtant les guys font tout ce qu'il faut pour qu'on les remarque. Jouent fort, si fort que le chant de Yuki est parfois mangé par la pâte sonore qu'ils nous servent à grande pelletée. Sur leur facebook, ils se définissent comme un metal band. N'en sont pas loin, mais logent encore plus près des racines très rock. Genre, j'envoie l'électricité puis je vous électrocute. Sans discute. Ni rémission. Ne vous laissent pas moisir dans votre coin. Bougent pas mal. Le guitariste n'en finit pas de se percher sur la plateforme de la batterie sur laquelle Thomas se défonce à mort. Dernier concert pour lui. La vie l'appelle ailleurs. C'est l'inconvénient d'être jeune.

L'avantage aussi. Car vous êtes muni d'une incroyable énergie. Tout comme Yuki, ce petit bout de fille. Un peu maigrelette selon les canons de la beauté de la Renaissance, mais si bien dans sa peau et son corps qu'elle vous subjugue et que vous ne pouvez quitter des yeux ses ardences de feu follet. Quelques secondes de danse lascive auprès d'un des guitaristes et c'est l'envolée, plane littéralement à trente centimètres au-dessus de la scène, emportée dans son propre tourbillon. Vous paraît enlevée dans un délire personnel, une transe égotiste indépendante, mais non elle s'arrête à la fraction de seconde près, à chaque brisure de rythme initiée par l'orchestre. Maîtrise beaucoup plus que l'on pourrait croire. Ne perd pas le nord musical. L'a de ces façons péremptoires de lever le bras qui sont autant d'appel à émettre encore plus de rage et l'orchestre se dépêche de rajouter une couche de speed.
Danse et chante. N'arrête pas de donner de la voix. Lyrics sans fins. Vient de pousser à fond, on lui accorderait quelques secondes de répit, le temps de reprendre souffle, mais elle est déjà engagée en un autre couplet. Plus vite et plus fort. Sans effort, avec aisance. Elle est la flamme vive qui vole sur le bûcher incandescent. Malgré son nom Klaustrophobia ne rabat pas sur vous le couvercle de vos impuissances. Vous communique une force à briser toutes les clôtures psychologiques qui limitent dangereusement votre existence. Je leur accorderais bien mon vote. Mais je suis homme à savoir résister au chant voluptueux et siréen de la gent femelle.
( photos concert Flèche d'or )
INSTANT DECISIF
Faut attendre le dépouillement. L'orga a prévu, un précieux passe-temps. Le groupe de Seine & Marne qui monte. Ne vous emballez pas. Ce n'est pas du rock. Même pas du reggae à funk les manettes. Non Minuit 6 Heures donne dans la chanson française. Un peu revisitée. Certes. Un bon chanteur, un noir à la belle voix dans un costume de pirate, et trois petits blancs par derrière qui accompagnent. Après le déchaînement des quatre groupes précédents, entendre le batteur pépère tapoter son rythme de valse relève de l'incongruité. Toute une frange du public ne partage pas mon avis. Moi j'aurais préféré que l'on passe une bande d'un groupe de rock connu à la place. J'endure stoïquement toute une longue demi-heure jusqu'à ce que Ady reprenne le micro.
Sait faire durer le suspense ! Sont tous montés sur scène derrière elle. Que de monde ! Sont beaux et jeunes mais on les sent tendus et impatients de connaître le résultat. Nous aussi. Le prix est intéressant pour un jeune groupe : ou un enregistrement de quatre morceaux, ou une résidence dans un studio d'enregistrement et structure de spectacle de Melun. Ady débite la litanie des remerciements usuels. En vient enfin au coeur du sujet. Joué dans un mouchoir de poche. Veux bien le croire. Je n'ai pas hésité pour inscrire mon choix, mais je reconnais qu'au moins trois des quatre combos se sont mieux que bien battus.
NAHKT !!!
Sort enfin le nom des vainqueurs. NAHKT !!! Pour une fois que mes contemporains s'alignent sur mes positions, je ne boude pas mon plaisir. Pour une première apparition publique, c'est un signe de grande classe. Faut voir comme les Nahkt sont contents. Recueillent les acclamations du public et de leurs malheureux concurrents avec joie mais sans ostentation.
C'est fini. Ady redonne le micro à Minuit 6 Heures pour un dernier quart d'heure de prestation. Félicite Nahkt et distribue les bises avant de m'éloigner alors que Minuit Six Heures entonnent Vesoul de Jacques Brel. Courage, fuyons !
Sûr que l'on va garder un oeil sur Nahkt, le groupe qui a la niaque.
Damie Chad.
JUKEBOX N° 335
NOVEMBRE 2014

Suffit parfois de quelques pages pour sauver le numéro d'un magazine. Après plus de trente ans de bons et loyaux services à l'encyclopédisme rock Jukebox s'essouffle quelque peu. La rubrique Ces Disques Ont Une Histoire... sent un peu le remplissage. Beatles, Sylvie Vartan et Trini Lopez en couverture, beaucoup de monde pour se remémorer le passage des Fab Four à l'Olympia, sujet un peu rebattu. La surprise vient d'ailleurs : de Tony Marlow qui nous offre un article fouillé sur les guitaristes de Bill Haley.

DANNY CEDRONE & FRANNY BEECHER
Tony continue donc sa série sur les grands guitaristes du rock. Bill Haley, le pionnier à la mauvaise cote. L'a été remplacé dans le coeur des fans par Carl Perkins et Johnny Burnette qui à l'époque étaient – à tort – considérés comme des seconds couteaux. Il y a quarante ans à peine avait-on prononcé le mot rock and roll que le nom de Bill Haley revenait systématiquement sur le tapis. Rouge. Qui s'est bien fané depuis. Ce n'est pas un hasard, certes la musique de Bill Haley est beaucoup plus proche du swing et beaucoup moins électrifiée que celle de ses pairs, mais elle n'en reste pas moins du pur rock'n'roll. C'est aussi vrai que les studios Sun sont entretemps devenus la Mecque fondatrice du rock'n'roll, grâce à une documentation de plus en plus accessible. Cette mise en première ligne de Sam Phillips n'est pas non plus étrangère à un gommage idéologique de toute une partie du milieu rock qui a privilégié les origines blanches du old rock pour mieux faire oublier le sang noir qui irrigue ses veines. Mais par chez nous, dès l'apparition de Bill Haley on en a rajouté une couche spéciale franchouillarde due à la ringardise des milieux musicaux qui ont accueilli à sa naissance l'oeuvre du leader des Comets. Tony Marlow ne mâche pas ses mots à l'encontre de Boris Vian qui a oeuvré tout au long de sa vie pour ridiculiser cette nouvelle musique qui venait bouleverser son plan de carrière. L'a rejetée du côté du burlesque agissant à son encontre comme les artistes de music-hall blancs d'Amérique avaient fait face à l'intrusion des musiciens et des chanteurs noirs au début du siècle précédent en instituant le genre parodique des Black Faces. Que les noirs surent s'approprier en une sorte de surenchère au second degré. Mais cela nous entraînerait trop loin.

Danny Cedrone fut le créateur du solo de guitare de Rock Around The Clock dont les notes acidulées et imparables mirent le feu au monde entier. Pour l'anecdote il se contenta de replacer, d'une manière un peu plus fluide, le solo qu'il avait créé pour Rock The Joint. L'avenir s'ouvrait à lui. Ce que Charlie Christian avait réalisé pour la guitare électrique jazz, et T-Bone Walker pour la guitare électrique blues, Dany Cedrone le concrétisait pour la guitare rock. Rock Aroud The Clock est enregistré le sept juin 1954, dix jours plus tard, le dix-sept juin, la pendule du rock and roll sonne la mauvaise heure, Cedrone se tue stupidement en descendant un escalier. Sic transit gloria mundi.

Pas le temps de s'attarder. Bill Haley est à la porte du succès, lui faut recruter en vitesse un guitariste capable de remplacer le malheureux Danny Cedrone. Ce sera Franny Beecher, joue du country mais provient du jazz. Travailla avec Benny Goodman et se laissa influencer par Django Reinhardt. Ses doigts agiles n'auront pas de mal à marcher sur les traces de Danny Cedrone. On ne change pas un riff qui gagne. Dans les mois qui suivent Franny qui a compris ce que veut exactement le gros Bill l'aidera à mettre en boîte quelques uns des classiques du rock tels Birth Of The Boogie ou Razzle Dazzle. Concerts, enregistrements, Franny est de tous les plans, mais sa femme ( tout comme celle de Cliff Gallup ) le désire plus souvent à la maison. Au début des années 60, il décroche de son statut de pro à plein temps. Jouera très vite en semi-pro autour de chez lui avant de participer à la reformation des Comets en 1987 jusqu'en 2008.
Nous a quittés en ce début d'année 2014. Sa disparition aura fait de moins bruit que sa guitare. Merci à Tony Marlow pour ce magnifique hommage à ses trois grands pionniers. Un bel article fourmillant de renseignements et toujours ce beau style d'une précision absolu. Rien ne vaut un guitariste pour parler de guitaristes.

Tony Marlow sera en concert ce vendredi 17 octobre 2014 à Lagny-Sur-Marne au local des Loners. A ne pas manquer.
Damie Chad.
PUNK SUR LA VILLE !
LE PREMIER FESTIVAL PUNK DE L'HISTOIRE
MONT DE MARSAN 1976 / 1977
ALAIN GARDINIER
( ATLANTICA 2014 / Mai 2014 )

Z'ont calculé le format au centimètre près. Celui d'un vinyl, trente-trois ( je vous fais grâce du dernier tiers ) tours. Comme un vieux disque des Sex Pistols ou des Damned, et pourquoi pas de Bijou et de Little Bob, après tout nous sommes en France et pour une fois que le rock français a devancé les grands-frères ricains et rosbeefs, l'on ne va pas s'en priver. Un bel objet, à la couverture un peu trop souple et difficile à ranger dans la bibliothèque. Les esprits chagrins diront qu'il fait un peu double emploi avec Le Massacre des Bébés Skaï / Punk Rock Festival Mont de Marsan 1976 / 1977 de Thierry Saltet publié chez Julie Editions en novembre 2013 ( voir KR'TNT ! 177 du 20 – 02 – 2014 ) et qui vient d'être réédité cette semaine ! Toutefois nous noterons qu'abondance de biens ne nuit pas. Oui, c'est exactement la même histoire mais les rockers sont comme les petits enfants, z'aiment bien entendre répéter et encore répéter les hauts faits glorieux qui ont marqué le déploiement de leur musique.

Alain Gardinier – un homme crédité pour la pochette d'un disque de Screamin' Jay Hawkins ne saurait être tout à fait mauvais, aurait même tendance à attirer le respect – n'est pas un nouveau venu dans le paysage rock. A refilé des photos à la moitié des magazines intéressants du pays, a chroniqué une foultitude d'évènements rock, a bossé sur Canal +, est devenu le spécialiste incontesté du surf, a monté une maison de production de films, bref un curriculum qui vous vide une cartouche d'imprimante à lui tout seul... L'a tout de même raté un truc important dans sa vie : n'était pas présent au premier Festival Punk de Mont de Marsan. Moi aussi. Mais lui, il s'est rattrapé, l'était au second. Pas moi. Bref un mec passionné toujours pendu aux basques de l'actualité rock, ce qui est normal puisqu'il est basque. D'où cette publication chez Atlantica, maison d'éditions régionale à l'affût des traditions locales, perdues, retrouvées, nouvelles ( surf, tauromachie, chasse à la baleine, pelote, pottocks ) de ce Sud-Ouest appuyé sur les Pyrénées et bordé par le littoral atlantique.
IMPRO
Un groupe de copains qui n'ont même pas vingt ans dans une petite ville de province que la plupart de nos concitoyens seraient bien embêtés de localiser sur une carte qui décident sur un coup de tête de préparer un festival. Z'étaient au café, auraient pu demander une troisième tournée de bières, mais non, ce sera un festival rock. Tant qu'à se faire mousser autant viser haut. Ne sont pas tombés de la dernière pluie, ils ont déjà organisé quelques concerts qui ont bien marché, mais subitement sans s'en rendre compte ils viennent de changer d'échelle. Comme l'un d'eux monte quelquefois à Paris s'approvisionner en disques à Paris dans la boutique de disques L'Open Market, il en cause deux mots au patron, Marc Zermati, aussi fondateur de Skydog... C'était la bonne porte et le bon deal. Connaît du monde à Londres et est à l'affût et à la pointe de ce qui se fait de neuf en rock.

De neuf peut-être pas. Mais de ce qui bouge. Le rock s'est endormi. Les grands groupes ronronnent. Se reposent sur le tiroir caisse. Aussi ennuyeux à regarder qu'un troupeau de brontosaures occupés à ingurgiter leurs quinze tonnes de graminées journalières. Pour Zermati, les mots d'ordre sont simples, retour à l'énergie primitive ! Rock'n'roll toute ! L'a même une idée de génie. L'invente un truc encore pire que le rock. Le mot existe depuis toujours, on l'emploie de plus en plus souvent à New York et in London, mais parmi d'autres, l'aurait pu passer à la trappe, mais Zermati a du pif. Plus de rock – plus ou moins rentré, sinon dans les moeurs, du moins dans le vocabulaire - désormais ce sera le punk ! Difficile de trouver plus crétinisant. La revendication au degré zéro du moins disant culturel. Les rockers étaient des voyous, cela fait peur, les punks fleurent mauvais comme une promesse d' analphabétisme. Cela vous déstabilise. L'esprit positiviste bourgeois en vacille sur lui-même. Miné de l'intérieur.
Ce n'était pas le moment idoine. L'esprit gauchiste mis à mort par l'élection de Giscard à la présidence de la République survivait encore. Se focalisait sur un dernier point de résistance. Un seul, mais très rock and roll. Concerts gratuits, passages en force, jolis grabuges. Les préfets s'affolaient et jetaient de l'huile sur le feu en envoyant les CRS. Cela dégénérait systématiquement en affrontements violents si bien que tous les festivals de l'été 1976 furent, les uns après les autres, interdits. Partout.
MONT DE MARSAN I
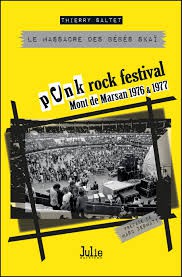
Sauf à Mont de Marsan. Petite ville de province où tout le monde se connaît. Faut savoir ruser. Dans les tractations avec la mairie l'on parle de festival de jazz et de pop. Et avec les flics, l'on sort le grand jeu. Rangez vos soldats de plomb, notre propre service d'ordre s'occupera de tout. Pari gagné. Par chance il n'y aura pas des milliers de participants. Point d'habits bleutés dans le proche horizon, tout se déroulera à merveille. Pour le programme vous vous reportez à notre livraison 177, ou alors vous achetez le bouquin, c'est rempli de photos et l'on vous explique tout en long et en large, avec photocopies des courriers officiels et petits topos sur les groupes.
MONT DE MARSAN II

Celui-là Gardinier y assiste. S'implique davantage dans le compte-rendu. Ce coup-ci, l'on avance à visages découverts. En 1976, le punk était un futur en marche, en 1977, c'est une présence indiscutable. Pour parodier Cavafy, on peut dire que l'on n'attend plus les barbares. Campent désormais sur la place centrale de l'actualité. A Mont de Marsan, l'on est bien embêtés, tout s'est si bien passé l'année dernière qu'il est difficile de promulguer un droit de veto. Des chevelus, des crêtus ( très rares ) qui ont écouté de la mauvaise musique très fort, mais dans l'ensemble, le petit commerce a fait son beurre. Donnée économique de poids. Alors comme l'on attend beaucoup plus de spectateurs et davantage de groupes, chacun fait ses comptes.

La police n'a pas dit son dernier mot. Lui reste son as de pique à jouer. Une belle facture pour les policiers de l'année précédente qui ont été affectés à la surveillance du festival. Beau coup de vice. D'abord ils n'étaient pas là, ensuite c'est à régler tout de suite, sinon la fête n'aura pas lieu. Faudra passer sous les fourches caudines de l'injustice. Quand l'Etat se prend pour Léviathan vous avez intérêt à payer tous les pots que vous n'avez pas cassés. Apporteront la moitié de la somme en promettant de faire l'appoint avec les bénéfices...

Qu'importe, Mont de Marsan II sera une aussi belle réussite que le premier. Pour la programmation vous vous reportez à notre livraison 177, ou alors vous volez le bouquin. Ce serait un très beau geste d'une exquise punkitude. Pour le Mont de Marsan III, il est inutile de prendre les billets. A l'impossible nul n'est tenu. Ne faut pas non plus prendre les autorités pour ce qu'elles sont. Jurèrent très tôt que désormais on ne les y reprendrait plus. Et elles tinrent parole.
PLUS TARD

Un changement de majorité présidentielle et municipale plus tard le festival renaquit de ses cendres en 1984, en 1985, en 1986. Et puis plus rien. Le punk n'a pas survécu à sa naissance. En 1978, il n'existe plus. On vous vend la New Vague, mais sur les rayonnages le punk est dans les boîtes en soldes. On n'aura plus l'énergie pour remettre le couvert à ce qui est en train de devenir un événement mondain. Organisateurs, groupes et spectateurs ont poursuivi leur chemin. Pas toujours facile de rester fidèles à ses idéaux. Le seul qui vous trahisse vraiment, c'est vous-même. Pour une fois le poison punk n'a pas pourri par la tête. C'est surtout le public qui s'est amoindri et dilué. Le livre se termine sur l'évocation des principaux protagonistes de cette aventure incroyable. N'ont pas fondamentalement divergé de leurs choix initiaux et énergies premières. Reste à écrire le post scriptum. Que l'on ajoute en bas de page pour signaler que l'on n'a pas oublié le plus important.
L'ARMEE DES OMBRES
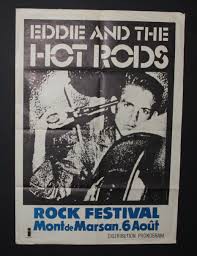
Celle des anonymes. Qui ont fourni le gros des bataillons du mouvement. Qui ne se sont pas vendus. Peut-être parce qu'ils n'avaient rien à vendre. Ou peut-être encore pire, parce que personne n'a voulu les acheter. Et les punkers ont fait comme les rockers. Ont subsisté. Par petits groupes. Sans cesse renouvelés. Ne sont plus qu'une minorité. Mais active. On les dénigre toujours et encore. On ne les appelle plus que par l'infamante dénomination de punks à chiens. Pas tout à fait des SDF, mais des nomades urbains, qui vivent dans les marges, qui squattent les sorties de secours d'une société en train de s'engluer dans ses propres immondices. La comète punk remue encore la queue mais tout le monde détourne le regard. Punk Sur La Ville est un beau livre. Mais il se termine trop tôt. L'urgence n'est pas à la remémoration des années fastes. L'étude des écorces mortes du passé n'est intéressante que si elle permet d'agir sur la présence du monde. Les punks comme les sentinelles du désastre qui vient. Peuvent hurler tant qu'ils veulent dans leur micros ou dans leurs mains en porte-voix. Personne ne veut les entendre. La caravane passe, file droit vers le précipice, les punks à chiens aboient.
Damie Chad.
14:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suicide, nextfloor, nakht, natural respect, klaustrophobia, bill haley, mont de marsan


