25/09/2014
KR'TNT ! ¤ 202. VINCE TAYLOR / BOBBY WOMACK / CAROLINA & HER RHYTHM ROCKETS / JITTERY JACK / WISEGUYZ / ELEANOR HENDERSON
KR'TNT ! ¤ 202
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
25 / 09 / 2014
|
VINCE TAYLOR / BOBBY WOMACK / CAROLINA & HER RHYTHM ROCKETS JITTERY JACK / WISEGUYZ ELEANOR HENDERSON |
VINCE TAYLOR N'EXISTE PAS
MAXIME SCHMITT & GIACOMO NANNI
( SEPTEMBRE 2014 / OLIVIUS )
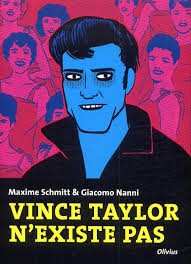
Il est des cadavres qui n'en finissent pas de bouger. Celui de Vince Taylor, plus que tout autre. Rappelons les faits, parution du livre Le Dernier Come-back de Vince Taylor de Jean-Michel Esperet – c'est lui qui lance le feu d'artifice alors qu'aucun éditeur ne voulait prendre le risque - au mois d'avril 2013 ( voir KR'TNT ! 142 du 02 / 05 / 13 ), suivi de Vie et Mort de Vince Taylor de Fabrice Gaignault au mois d'avril 2014 ( voir KR'TNT ! 188 du 08 / 05 / 2014 ), il y a quinze jours nous évoquions la mise en ligne sur le site Roll Call du Numéro Zéro de The Observatory daté du mois de juin 1993 et consacré à Vince Taylor, et voici que sur les comptoirs des librairies en ce premier mois de septembre de la rentrée littéraire de cette année 2014 s'expose ce Vince Taylor N'Existe Pas, de Maxime Schmitt et Giacomo Nanni.
Hasard de calendrier ? Ou prise de conscience d'une génération qui serait en train de s'apercevoir que vu le maigre solde de leur devenir personnel il commencerait, comme le notait Oscar-Venceslas de Lubicz Milosz, à se faire tard dans le jour du monde et qu'il serait temps de livrer leur propre témoignage sur Vince Taylor, figure christo-diabolique, dont ils entendraient écrire la triste nouvelle de son apparition météoritique en le siècle dernier qui s'éloigne à grands pas. A moins que les temps du bilan de la première époque du rock français fussent advenus et que l'on commençât à apurer les comptes en réalisant les colonnes des pertes et profits.

Quoi qu'il en soit, Maxime Schmitt est des plus autorisés à se prévaloir de Vince Taylor. Guitariste du Poing il l'accompagna sur scène durant deux ans et eut le temps de connaître le chanteur, sinon de devenir un ami intime mais du moins de comprendre le mode de fonctionnement, disons erratique, de sa psyché. Pour la grande histoire du rock il convient de rappeler que Maxime Schmitt n'a depuis les fabuleuses sixties jamais quitté le métier, et que de Kraftwer aux Plasticines il a su faire oeuvre de découvreur et de producteur émérite.

Suffit d'ouvrir le livre pour comprendre la présence de Giacomo Nanni. Vince Taylor n'est pas une biographie mais se présente sous la forme d'un roman graphique. Question dessin, notre scripteur a modestement préféré s'en remettre à un auteur de bande dessinée patenté. Je ne sais s'il est à l'origine de ce choix ou s'il lui fut imposé par la maison d'édition. Qui n'en est pas tout à fait une, puisque les éditions de L'Olivier et les éditions Cornélius se sont mises à deux pour créer Olivius, olybrius éditorial vraisemblablement censé limiter les risques financiers. Avec Vince, on ne sait jamais. J'ignore tout autant les raisons qui ont poussé Giacomo Nanni, auteur italien, né en 1971 à s'intéresser à Vince Taylor. Je note seulement qu'il s'est fait connaître dès 1996 par ses Six Dessins Pour Un Voyage En Grande Garbagne, d'après l'oeuvre d'Henri Michaux. La poésie n'est pas très éloignée du monde du rock quand on y réfléchit.

Un peu déçu, dès les premières images. Blanc et noir. Intellectuellement cela tient la route. Combat de l'ange et du démon. Pureté et noirceurs d'une âme déchirée. Mais au résultat beaucoup de gris. Trop de demi-teinte. La couverture avec ses vignettes bleu froid et fuchsia obsédant laissaient présager des a-plats colorés de grande crudités, d'infinies cruauté. Quant au dessin, je déteste ce trait que je qualifierai d'inachevé et par trop schématique. Goût totalement personnel que vous n'êtes pas obligés, chers lecteurs, de partager. Mais la lecture entreprise, je réviserai mon jugement. Les vignettes concourent à l'histoire scénarisée par Maxime Schmitt. Elles n'illustrent pas, mais leur mise en page donne au récit une urgence chaotique qui correspond à l'effet recherché. Celui d'un monde sans réalité objective.

Pas de description. C'est le dessin qui se charge des décors. Nous sommes dans la tête pensante de Vince. Le monde selon Vince Taylor ne ressemble pas au nôtre. Fonctionne d'une autre manière. Vaudrait peut-être mieux parler de cervelle dé-pensante, mais il faut alors ajouter que dans l'univers, rien ne se perd, même pas le bon sens, et que tout se transforme. Les mauvais esprits diront en folie. Les médecins parleront de bouffées délirantes ou de tendances fortement schizophréniques. Mais il s'agit là d'un regard extérieur qui ne perçoit pas la logique comportementale pour la raison toute simple que n'étant point au coeur de cette logique il ne peut en comprendre les agissements. Dans l'oeil de l'ouragan, vous connaîtriez le calme et le repos, mais cela n'empêcherait point ses effets dévastateurs sur l'en-dehors de la bulle germinative et originelle.

Mais la force du livre ne réside pas en cette immersion à l'intérieur du cerveau en ébullition de Vince Taylor. Il est impossible de savoir que l'on est en pleine tempête si quelque part il n'existe point au moins un point extérieur stable, et stable parce qu'extérieur. Idée de génie. Le point d'ancrage dans la réalité est implanté dans l'imaginaire de l'auteur. Il s'agit bien d'un roman. Qui raconte l'histoire vraie de Vince Taylor. Faisons semblant de croire que cet a-priori journalistique de documentaliste de bas-étage qui confond le contenu de ses livres avec l'objectale énumération du monde, soit possible. Mais Maxime Schmitt qui connaît la viduité de toute certitude prend ses aises avec cette vision rassurante de la réalité.

Introduit dans la vie de Vince un personnage qui n'a jamais existé. Un peu comme le troisième oeil dans la tombe de Caïn et le poème de Victor Hugo. Mais ici objectivée en tant que fan dévouée et subjuguée. Qui n'arrête pas de prêter une oreille complaisante et attentive à tout ce que Vince lui confie. Ne lui prête pas que son oreille d'ailleurs. Mais c'est là que le bas blesse. Celui qu'elle enlève pour lui dévoiler sa nudité de petite fille. Très fort, j'entends déjà les cris hystériques que l'invention de cette très jeune amoureuse risque de soulever. Entre ceux qui vont se récrier que Vince Taylor n'était pas un pédophile et ceux qui vont en profiter pour l'accuser d'un crime supplémentaire, l'on risque bientôt d'entendre une forêt d'ânes braire à foison. Vaudra tout de même mieux lire le livre jusqu'au bout avant de crier au feu. Ne vous révèlerai pas pourquoi. M'en voudrai de déflorer, si j'ose dire, la sujette.

Me contenterai plutôt de rappeler que le rock touche au sexe parce qu'il touche à la vie. Et que celle-ci est beaucoup plus séditieuse que les listes d'interdits des bonnes consciences sociétales. Vince Taylor est un personnage christique. Mais descendu de sa croix et qui s'est mis à errer parmi les hommes, parmi les ombres que nous sommes. Contrairement à ce que l'on pourrait espérer, son coeur n'est pas empli d'une douce paix intérieure. L'est plein des affres du ressentiment. Est décidé de se venger et d'abattre un par un tous ceux qui l'ont spolié. Le récit mystique tourne au western. La vengeance sans retour. Le pistoléro sans pitié. Tout se passe dans la tête, car notre desesperado est tombé de son piédestal. Ceux qu'ils recherchent sont hors de sa portée. Ne peut plus croiser que les fantômes de son imagination. Réquisitoire implacable contre tous ceux qui l'ont pillé et qui se sont partagés sa dépouille de cuir noir, son destin de nuit et de charbon. Et tous y passent, l'un après l'autre. C'est l'histoire du rock qui défile sous nos yeux. Gene Vincent, les Beatles, Elvis, Jim Morrison, David Bowie, les plus grands, tous accusés de l'avoir copié et volé. Soyez-en sûrs, le rock ce n'est pas ça, le rock c'est Vince Taylor. Uniquement Vince Taylor.

Vince Taylor n'est plus maintenant que l'autre nom de l'Ange Exterminateur. Ne riez pas. Ne vous sentez pas en sécurité. L'est mort depuis un quart de siècle, oui mais il est des progénitures infâmes qui ne font que semblant de mourir. Têtes de l'hydre qui renaît sans cesse. Les petites filles deviennent grandes, même celles qui ont été biberonnées au pur rock'n'roll.
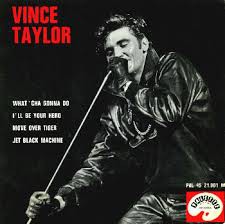
Maxime Schmitt nous livre sa vision de Vince Taylor. L'a beaucoup réfléchi sur cette étrange destinée déployée en mode filmique plus dure sera la chute de l'avion qui se casse la gueule à l'atterrissage. Mais il n'a pas voulu se satisfaire d'un simple reportage post-mortem. Ne s'est pas senti doué pour les notices nécrologiques rédigées à l'encre des précisions biographiques qui ne sont que des bandelettes dont on entoure les cadavres, pour s'en protéger, pour les ligoter au fond de leur cercueil afin qu'ils n'en ressortent jamais. Non l'a fait tout le contraire. A libéré la momie, a ouvert en grand la porte du tombeau pour que le vampire puisse s'échapper et venir hanter nos songes. Boire notre sang et s'infiltrer en notre âme, la figure de Vince Taylor s'affiche comme un ver rongeur qui nous empêchera de connaître un jour le bonheur. Pas tout à fait méchante puisqu'elle laisse sur notre table de chevet les élixirs qui permettent de survivre. La fiole à notice cadavérique des drogues et produits dangereux, la bouteille à la mer du sexe, la fiasque pansue du rock and roll qui nous dispense une énergie aussi noire que le cuir de Vince Taylor.

Esthétiquement c'est aussi mal foutu et brouillon qu'un fanzine punk, donc tout de même de du style, et une fois ouvert on ne lâche plus. Grandeur et décadence de l'Empire du rock and roll. Avec un Vince Taylor Caligula dans le rôle du prince régnant. Immoral et amoral. Outrageant et démesuré. Ce n'est pas un hasard si le souvenir de Vince Taylor remonte à la surface des eaux troubles. Notre époque a besoin de monstres pour oublier l'ennui économique qui nous submerge. Nous pataugeons dans le marécage de nos existences étroitisées par une société de plus en plus prégnante. Vince était trop grand pour son époque. N' pas su s'y adapter. N'a rien trouvé de mieux que de se perdre dans sa tête. Savait au moins que là nul n'arriverait à le retrouver. S'est claquemuré dans la dernière de ses citadelles. L'est mort dans la douleur de ses propres rêves. Si nous lui devons beaucoup, personne ne peut plus rien pour lui.

Foutrement Rock And Roll.
Damie Chad.
WOMACK THE KNIFE
(Part One)
Quand on écoutait Bobby Womack, on avait toujours l’impression de se retrouver à l’Opéra de Quat’sous, ou mieux encore, à la Piste Aux Étoiles, l’émission de télévision primitive qui fit rêver les bambinos du baby-boom. Le grand magicien Bobby transformait tout ce qu’il touchait en soul, c’est-à-dire en or.
On ne trouvera pas un seul déchet dans sa discographie. Il disposait de toutes les inspirations et de tous les talents d’interprétation. Il fait partie de ceux qu’on peut qualifier d’artistes complets. Sa soul n’est jamais sirupeuse. Son funk n’est jamais m’as-tu-vu. Son rock n’est jamais cousu de fil blanc. Son r’n’b ne tombe jamais dans la banalité. Il se dégage de toutes ses chansons un fort parfum de modernité. Personne n’arrivait à la cheville de Bobby, pourtant il sut se montrer assez humble pour confier dans une chanson qu’il admirait Marvin Gaye, et dans une autre qu’il vénérait Eddie Kendricks et David Ruffin des Temptations. Parmi les amis de Bobby, on comptait des géants comme Wilson Pickett (auquel il refilait ses meilleures chansons), Sam Cooke (dont il épousa la veuve Barbara) et Sly Stone, of course, fulgurant compagnon de débauche cocolatérale. Mais si on se penche sur le chapitre des collaborations, c’est le vertige assuré, car Bobby était dans tous les coups fumants. Laissons cela aux obituaristes de la presse anglaise.

Pour l’anecdote : quand Chrissie Hynde débarqua à Londres en 1973, elle voulut aussitôt monter un groupe. Elle fricota avec Johnny Moped et Mick Jones qui n’était pas encore dans les Clash. Mais elle avait une culture musicale que les punks anglais n’avaient pas - «I was a little bit too musical for that punk scene» - De qui leur parlait-elle ? Mais de Bobby Womack, bien sûr, alors que les Anglais écoutaient encore Mott The Hoople. Pas étonnant que Chrissie soit devenue une usine à tubes planétaires et que les autres aient fini par sombrer dans la médiocrité.
Toujours pour l’anecdote : En 1964, Bobby et ses quatre frères formaient un groupe qui s’appelait les Valentinos. Sam Cooke qui les avait à la bonne les signa sur son label SAR. «It’s All Over Now» fut leur tout premier tube. Lors de leur première tournée américaine, les Stones l’entendirent à la radio et voulurent absolument en faire une reprise. Ce fut leur premier numéro un au hit-parade. Merci Bobby.
Très exactement cinquante ans plus tard, Bobby est arrivé au terminus de sa vie. Il n’était pas très costaud et son petit corps l’a lâché. Mais il reste les disques, et pas n’importe quels disques, des disques vampires, condamnés à la vie éternelle. Comme ceux de Johnny Winter qui lui aussi vient de se faire la cerise, ou encore ceux d’Ike Turner ou d’Aretha. Non seulement ces gens-là sont des inventeurs, mais durant toute leur vie d’artiste, ils ont su alimenter une légende et donner la becquée à des nuées de fans voraces.

Son premier album s’appelle «Fly Me To The Moon». Bobby l’enregistre à l’American Studio de Chip Momans, à Memphis, où enregistraient les Box Tops, James Carr, King Curtis, Neil Diamond et Elvis. On est en 1968, au cœur de l’âge d’or. On compte les bons disques par milliers, surtout les bons disques de soul. Mais l’album de Bobby ne passe pas inaperçu, car il contient quatre bombes et notamment le fameux «I’m A Midnight Mover», classique de r’n’b cavaleur screamé à la folie. Avec ce hit pantelant, Bobby et Wilson Pickett vont régner pendant des lustres sur l’Amérique des nuits chaudes. Deuxième bombe : «What Is This», que Bobby roule dans la farine avec un punch hallucinant, et derrière lui ça violonne, alors le r’n’b prend vite des allures grandiloquentes. Il claque sa soul avec une efficacité troublante. On a déjà là ce cocktail extraordinaire de mélodie, de punch, de scream et de classe qui va caractériser tous ses autres albums. Troisième bombe : sa reprise du «California Dreamin’» des Mamas & The Papas. Bobby tape carrément dans l’intapable, dans l’insoutenable légèreté mélodique de l’être Phillipsien. Rien d’aussi fantastique que cette appropriation. Quatrième bombe : «Lillie Mae», âpre, punchy et bien secoué. Bobby fait son festival et rivalise de puissante screamique avec son pote Pickett.
Avec ce premier album, Bobby le magicien donne le La.
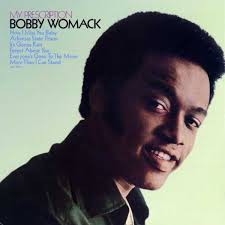
Il sort «My Prescription» deux ans plus tard. Il ouvre la bal avec «Oh How I Miss You baby», un hit pop monté sur une mélodie somptueuse. Son fil mélodique arrive en vol plané. On n’avait encore jamais vu ça. On sent qu’il flirte avec la variété, mais la soul finit toujours par l’emporter. «I Can’t Take It Like A Man» s’anime au fil des secondes, Bobby prend le beat en marche et ça devient incroyablement vivant. On sent une spiritualité de la soul chez ce mec, comme s’il dessinait des horizons pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’en offrir. Le hit de cet album s’appelle «I Left My Heart In San Francisco», merveilleux groove joyeux et fanfaron. Bobby chante la joie de vivre et il perce l’azur de cris déments. Il ne pense qu’à distribuer des frissons, à bonimenter et à swinguer dans l’air chaud. Avec «Don’t Look Back», il semble marcher sur l’eau. Encore un groove idéal monté sur une walking bass. Bobby se met alors à cultiver l’excellence du groove et il se prépare à le porter aux nues.

Sur la pochette de «Communication», il ressemble à un petit garçon. C’est l’époque où il fréquente assidûment Sly Stone qui s’est installé dans l’ancienne maison de John Phillips à Bel Air. Ils travaillent ensemble sur «There’s A Riot Goin’ On» et forcément, «Communication» s’en ressent. Bobby attaque avec un groove rampant et tribal, un groove altier et assoiffé de vengeance, un groove proéminent et altruiste, oh Lord, un groove prégnant et prédisposé. Un groove comateux de génie. Puis il enchaîne avec un autre groove, «Come l’Amore» qui est celui du bonheur parfait, éclatant comme pas deux, qui évoque Charles Trenet et les ouvertures de ciel sur le port de Sète, alors que Paul Valéry et Georges Brassens rigolent de bon cœur à la terrasse du petit bistrot. Comme Bobby est heureux ! Il chante d’une voix légère qui grésille de bien-fondé. Le reste de l’album est moins spectaculaire, mais les chansons restent solides, groovy et sentimentales, toujours montées sur des fils mélodiques impeccables. Avec «Everything Is Beautiful», il fait un groove à la Sam Cooke, histoire de saluer la mémoire de son vieux protecteur.
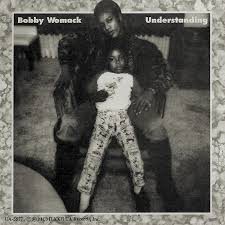
Aussitôt après sort «Understanding», album jumeau sur lequel groovite «I Can Understand», monstrueux d’élégance rythmique, un mélange de beat et de violons qui embarquerait n’importe qui pour Cythère. C’est d’une efficacité redoutable. Et il pousse des cris, histoire de pimenter la volupté. On goûte là à la bienfaisance du beat de base et Bobby part en solo - ooh my guitaaaar ! Sur cet album, Bobby reprend un cut de Neil Diamond, «Sweet Caroline» mais la grosse bête qui se niche dans les buissons s’appelle «Simple Man», une brute de groove saturé, screamée à la folie - gotta-gotta-move - et bariolée de coups de guitare. C’est le groove archétypal de classe princière et d’une puissance cabalistique. Franchement digne des dieux de l’Olympe qui seraient devenus noirs. Bobby y frise la transe de Mr Dynamite. L’autre bombe de l’album, c’est «Harry Hippie», lancé par un Ha ! Everybody claims they want the best things in the life - et Bobby fait danser son groove la main sur la hanche, c’est une pure merveille d’élégance jazzée de soir d’été. Seul le petit Bobby peut accomplir de tels miracles. Il est hallucinant d’essence maligne. Il descend dans le lit de la mélodie en aplatissant ses syllabes. Voilà ce qu’on appelle du grand art.
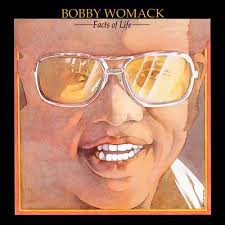
«Facts Of Life» sort dans la foulée, enregistré à Muscle Shoals. Son sourire illustré illumine la pochette. Il attaque avec un groove à la Marvin, «Nobody Wants You When You’re Down And Out». Il sait qu’il règne sur la terre comme au ciel, mais il ne s’en vantera jamais. Il rend un nouvel hommage vibrant à Sam Cooke avec «That’s Heaven To Me» et nous ramène dans le calfeutrage de l’âme. Et puis il continue d’enfiler les hits comme des perles, son medley «Holdin’ On To Baby’s Love/Nobody» est à tomber tellement il est beau, classieux et bien screamé. Bobby, c’est un peu le copain qu’on écoute à longueur de journée sans jamais s’ennuyer. Il fait son groove sur le ton de la confidence et il sait se montrer persuasif. Il sait aussi se montrer victorieux avec «Can’t Stop A Man In Love», et il chante ça en rigolant. Attention, on arrive aux choses sérieuses avec «The Look Of Love», un hit très haut de gamme. La fanfare du studio propulse Bobby dans la stratosphère et il chante d’une voix superbement fêlée. «Natural Man», c’est aussi à se damner pour l’éternité, à cause de la puissance de la mélodie chant. Et il termine son festival avec une reprise de «All Along The Watchtower» - there must be something out of here - il y va franco. Vous ne connaissez pas la version de Bobby ? Rien à voir avec celle de Jimi Hendrix. Il reprend les mots de Dylan et les envoie valser dans le groove de l’Amérique noire. C’est hallucinant, et derrière, ça joue - Outside in the distance - Bobby devient fou, il hurle comme un damné.

En 1973, Bobby était toujours à Muscle Shoals pour enregistrer «Lookin For Love Again». Comme il porte sa guitare acoustique sur l’épaule, on croit que c’est un album de country. Fatale erreur. Ce disque de pur r’n’b est une véritable bombe - une de plus. Quand on écoute «I Don’t Wanna Be Hurt By Ya Love Again», on s’éponge le front. Too much class, baby. La mélodie s’inscrit dans le sang de la soul. Car chez Bobby le séraphique, tout est comme en un ange aussi subtil qu’harmonieux. Bobby porte sa voix au pinacle. On l’entend aussi faire son Wilson Pickett dans «Let It Hang Out». Il utilise la même dynamique que dans «Funky Broadway». Il screame son truc à la folie. Et il faut voir comme c’est riffé. Bobby, c’est un peu la même chose que Clarence Carter, Arthur Conley ou Eddie Floyd : il vaut mieux éviter d’y mettre le nez, car sinon c’est foutu. Sur la face B de cet album faramineux, on trouve «You’re Welcome Step On By», un hit babylonien bardé de dynamiques suprêmes qui sonne comme du Marvin. Imparable. Puis on entend David Hood jouer de la basse comme un dieu dans «Don’t Let Me Down». David est bien sûr le père de Patterson Hood, leader des Drive-By Truckers (Patterson a d’ailleurs invité son père à venir jouer sur le dernier album des Truckers, «English Oceans», un album chaudement recommandé. Un de plus). Retour à Bobby. David Hood fait à nouveau des prodiges sur «There’s One Thing That Beats Failing». Le house-band de Muscle Shoals était probablement l’un des meilleurs du monde, avec les Dixie Flyers de Jim Dickinson et les Funk Brothers de Detroit.

Il attaque «I Don’t Know What The World Is Coming To» avec «I Don’t Know» une espèce de soul discoïde chargée à ras-bord de beat, de rumble, de shuffle et de chant d’éclat majeur. Il l’incante au belvédère des pendus nervaliens et il screame dans le flux de l’âme noire. Quoi qu’il fasse, Bobby dégouline de génie. Encore un groove extraordinaire de puissance avec «If You Want My Love Put Something Down On It», violonné et digne de Marvin, et il rajoute des couches et des couches de fabuleuse mélasse céleste. Il chante «Check It Out» d’une voix fêlée et introduit «Jealous Love» avec un beau son de basse métallique. Alors Bobby bat le beat et crée immédiatement l’excitation. Il chante son truc à contre-courant de la mélodie et finit à la Wilson Pickett, énorme et galvanique. Ce hit est digne du retour du Comte de Monte-Christo, la voix de Bobby se perd dans un tourbillon de jouissance infiniment perfectible, il ré-injecte des voix dans le groove et nous perd dans le péché vaudou. Puis il gratte «It’s All Over Now» à la guitare sèche et recrée le beat de l’Amérique profonde. Version sidérante, digne d’un Joe Cocker de la grande époque. On ne peut pas espérer mieux.

Énorme disque que ce «Safety Zone» qui voit le jour en 1975. On trouve là-dessus au moins trois classiques intemporels. «Everything’s Gonna Be Alright» est le premier. Bobby le shaftise à outrance pendant que Wha Wha Watson fait griller le funk et que Willie Weeks joue de la basse comme le dieu qu’il a toujours été. Alors, Bobby fait basculer son cut dans l’écume des jours de la beauté pure. Il faut vraiment entendre ça au moins une fois dans sa vie. Vous voulez savoir quel est le secret du petit Bobby ? Ce sont les décollages vers des mondes meilleurs. Ce petit bout de black nous ouvre les portes de son monde magique, alors on s’éberlue en visitant la chocolaterie du funk et de la soul. Il enchaîne avec «I Wish It Would Rain», une belle pièce de soul signée Norman Whitfield. On monte là où brillent les étoiles de la soul. Les deux autres classiques intemporels se nichent en face B et pour commencer, le fameux «Love Ain’t Something You Can Get For Free», l’absolu de la classe bobbyque. Ça mord dès l’attaque, avec un chant au râclé d’espolette et un feeling trié sur le volet. Absolument imparable. C’est une pulsion maligne dont personne ne peut réchapper. C’est même l’absolu de la soul. Rien qu’avec ces deux classiques intemporels, on est content d’avoir croisé le chemin de Bobby. Il bricole ensuite un funk canard avec «Something You Got». Il avance au pied palmé. Difficile à réussir si on ne s’appelle pas Bobby Womack. «Daylight» est le troisième classique intemporel de cet album, une pure énormité montée sur les cuivres le plus magiques de l’histoire de la soul. Il nous emmène dans l’interstellaire sur une sorte de beat disco et il chante ça avec le feeling habituel. On pourrait presque parler de pureté toxique. Il termine l’album avec «I Feel A Groove Comin’ On», une cavalcade de soul funk indécente. Bobby chevauche un dragon volant et c’est un spectacle fascinant.

«Home Is Where The Heart Is» est encore un album fantastique, avec notamment le morceau titre, énormité compositale bourrée d’énergie, qui pourrait presque être la bande son des jours heureux. Et Bobby la chante avec tout le chien de sa chienne, il est merveilleux d’élégance scolastique, il accroche au maximum de la possibilité des choses. Avec «Just A Little Bit Sally», il ajoute l’immensité à l’énormité. Il navigue exactement au même niveau que son héros Marvin Gaye. Il laisse planer le doute du beau. Grosse giclée de funk télescopique avec «Standing In The Safety Zone» qu’il chante avec une niaque expéditive et expiatoire. Voilà encore un cut magnifique de prestance épouvantable. On se croirait chez Mandrake le Magicien, lorsque les éléments font semblant de ressembler à des éléments. Encore du funk dévastateur avec «I Could Never Be Satisfied». Cette fois Bobby joue les bulldozers. C’est atroce de puissance et il pousse ses cris d’orfraie. Il oblitère tout, mais de façon coaxiale, ce qui est pire. Avec «Something In My Head», il s’amuse à mélanger James Brown et Marvin. Il se veut stupéfiant d’à-propos et ça marche. Il impose l’allégeance de la prestance.

«Pieces» qui paraît en 1978 tire plus sur le funk. Enfin, c’est une façon de parler. On est aussitôt embarqué par un «It’s Party Time» puissant et screamé. Le retour au groove à la Marvin ne se fait pas attendre, car voici «Twist Your Heart» et un départ automatique pour les stratosphères. Bobby rallume sa petite chaudière funk avec «Wind It Up». Pas de beat plus extravagant sur cette terre. Jamais encore on avait senti une telle énergie dans un disque de musique moderne. «Is This The Thanks I Get» est extraordinaire de puissance soul. On voit Bobby gérer l’espace. Pas de problème. Tu veux de la grandeur ? Tiens en voilà. De la hauteur ? Tiens ! De la qualité intrinsèque ? Pas de problème ! Tiens ! Ce mec est un surdoué. Encore du groove géant avec «Caught Up In the Middle». Il grimpe directement dans les hauteurs. Il reste invariablement bon et d’une vérité crue. Et si on veut danser, alors on peut y aller avec «Never Let Nothing Get The Best On You» et la fanfare des fanfarons. Ça vire aussitôt funk des enfers. Bobby appelle les oh yeah et les autres font des oh yeah. La chose est terrible car bourrée d’énergie. C’est un cross-over de soul dément.
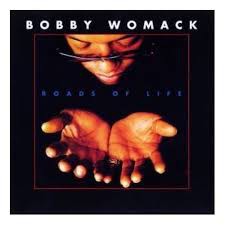
«Roads Of Life» est encore un album magique. Le problème, c’est que tous les albums de Bobby sont magiques. On peut mettre vingt ans à s’habituer à ce genre d’idée. Dans «How Could You Break My Heart», Bobby appelle sa poule en pleine nuit. Elle n’est pas contente - Non mais t’as vu l’heure qu’il est ? Demain je me lève pour aller bosser ! - Et elle l’envoie promener. Alors Bobby transforme l’épisode en chanson funky et ça devient magique, sa chanson prend vite des proportions extravagantes. Et c’est exactement là que se niche le génie de Bobby Womack, dans l’énergie de l’idée et dans la façon dont il en fait une chanson incroyablement originale. Des gens comme Robert Pollard, Dylan ou Chuck Prophet travaillent exactement de la même manière, à partir de l’énergie de l’idée. Bobby est vraiment très fort, car il sait tirer son idée à l’infini, en s’aidant d’arrangements de violons. Et là, on a du grand art. «Honey Dripper Boogie» est une pièce de funk monstrueuse. Bobby est le funkster proéminent, il s’accroche avec des cris d hyène. Son funk est une merveille explosive bourrée d’énergie brute et finie à la trompette. Il attaque le groove de «What Are You Doin’» par en dessous, comme un stratège de génie, alors ça devient une affaire sérieuse. Il embarque son truc à fière, très fière allure. Peu de gens savent cavaler comme ça à travers la plaine. Bobby est une fabuleuse monture en or. Il sait dépasser le stade des louanges - Get it ! - Son groove réchauffe le sang et Bobby le petit héros nous aide à vivre. Bienvenue dans velouté du meilleur groove de l’univers avec «Give It Up». Bobby l’élégiaque fournit le frisson à haute dose. Il reste l’infini protecteur des cœurs sensibles. Puis il teste un petit mélange de Marvin et de funk avec «Mr DJ Don’t Stop The Music», en fait une petite énormité passagère et boucle la boucle avec une romance lente inexorablement bonne, «I Honestly Love You». On l’aura remarqué, Bobby adore le mot Love et tout ce qui tourne autour. Sans ce mot, il est foutu.
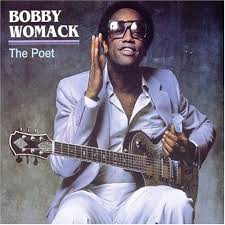
Bobby fut un temps en perte de vitesse, ce qui paraît normal après autant de bons albums. En en 1981, il refit surface avec «The Poet». Attention, «So Many Sides Of You» fend la nuit comme un paquebot de Fellini. Voilà une pièce de soul immense et volontaire, mythique et radieuse. Le groove de Bobby en met plein la vue. Sa soul brille dans la nuit. On n’en finirait plus de vouloir décrire sa grandeur. Il a déjà fait le tour de monde avec ses grooves et personne ne peut égaler ce mélange de raunch et de smooth, de feu et de glace au chocolat. Fucking genius ! Dans «Lay Your Lovin’ On Me», Bobby bat le beat du groove, et derrière une basse funk croasse. C’est d’une fraîcheur et d’un swing qui tuent les mouches. En prime, le cut est animé par une série de breaks miraculeux. Ses frères font des backings monstrueux. Back to the beat avec «Secrets», funksté d’entrée de jeu. Bobby monte immédiatement au créneau. Il a tellement de génie qu’il le distribue à tout le monde. Tenez les gars, c’est pour vous ! Oh ce n’est pas grand chose, juste un petit peu de groove pour passer une bonne soirée. Il tire l’overdrive de la réduction et pose son chant au sommet du feeling. C’est sa botte secrète, alors que rugissent les flammes de l’enfer funkoïde. Encore du funk des bas-fonds avec «Stand Up», monté sur une basse pouet-pouet, monstrueux de puissance pulmonaire et digne de Bootsy Collins. Bobby joue avec le funk comme d’autres avec le feu. Il en fait une œuvre d’art suprême. «If You Think You’re Lonely Now» est digne des grandes heures de Billy Paul. Bobby s’ingénie à supplier les dieux de la soul. Et il revient à Marvin avec «When Do We Go From Here», monté sur une bassline énorme et des violons. La seule chose qui puisse intéresser un mec comme Bobby, c’est l’ampleur.

Il traverse les années 80 sur son petit nuage. Comme tous les funksters, il porte des vêtements excentriques ouverts sur la poitrine et la blancheur de ses dents éclate à la lumière des projecteurs. «The Poet II» arrive trois ans après «The Poet I». Bobby et Patti Labelle font un numéro de haute voltige de charme sur «Love Has Finally Come At Last». D’accord, ça dégouline de siruposité, mais derrière eux, l’ami bassman œuvre avec brio. On retrouve partout cette belle soul vibrante de feeling et Patti Labelle revient faire son numéro de screameuse éperdue dans «It Takes A Lot Of Strength To Say Goodbye». Bobby et Patti tapent dans le romantisme torride et se montrent mélodiquement supérieurs en tout. Leurs jeux d’amour relèvent de la haute voltige du trapèze sans filet. Avec «Through The Eyes Of A Child», Bobby va plus dans le groove de derrière les fagots de la Philly Soul. Il sonne même comme Marvin, et George Benson lâche un solo liquide pourvoyeur d’extase. On se croirait quelque part dans «What’s Going On», très loin au-delà de tout repère. Bobby s’amuse comme un gosse avec son génie. On se sent tellement en sécurité avec lui. On finit par comprendre qu’il est parfaitement incapable d’enregistrer un mauvais disque. C’est au-dessus de ses forces. Il flirte aussi avec la disco, l’époque veut ça, alors il fait de la disco bobbyque. On peut danser sur «Tryin’ To Get Over You», pas de problème, Bobby a tout prévu, le grand orchestre et un bassman nommé David Shields qui roule des triplettes sous ses doigts boudinés. Vous aimez le funk ? Alors écoutez «Tell Me Why» qui ouvre le bal de la face B. Bobby chante le funk au crépuscule des dieux. Il toise le destin avec son sourire en coin. Il est le héros de l’Amérique noire, comme Tintin est le héros du vieux continent. La soul funky de Bobby rayonne dans l’univers, comme celle de Marvin. Il démarre «American Dream» sur un discours de Martin Luther King puis il part en vrille dans le cosmos rejoindre son idole Marvin Gaye. Vous ne trouverez jamais ce genre de chose sur un album de Black Sabbath.
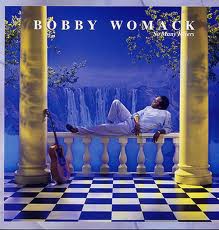
Quand on a «So Many Rivers» dans les mains, on se dit : à quoi bon écouter cet album ? Ce sera la même chose. Pas du tout. Bobby nous emmène au Palace Royal avec «So Baby Don’t Leave Home Without It». Il nous pond un œuf de soul de luxe. Tous les convives portent des redingotes blanches et on trinque au bar avec nos vieux amis de Procol Harum. On passe ensuite à la funky motion avec «So Many Rivers». Bobby reste fidèle à son éthique. Son funk sonne les cloches de la médiocrité. Il peut même faire de la pop, comme dans «Gyspsy Woman», mais avec un arrière-goût groovy et un léger parfum de classe royale à la traîne. Tout aussi distingué, «Let Me Kiss It Where It Hurts», chanté d’une voix plus poivrée que celle de Wilson Pickett. Attention, Bobby salue ses amis disparus dans «Only Survivor» : Janis Joplin, Jimi Hendrix, Otis Redding, Jackie Wilson, Sam Cooke - «just to name a few !» - Il tire un fantastique coup de chapeau - «Sometimes I feel a long way from home...»
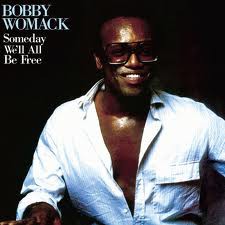
Sur «Someday We’ll All Be Free», on trouvera encore des gros classiques des années de soul et de sel comme «I’m So Proud» ou le morceau titre de l’album, embarqué au sax. Il chante l’espoir perdu des anciens esclaves en fixant les cieux embrasés de Marvin. Fallait-il que les noirs soient crédules pour croire que les blancs allaient leur rendre leur liberté. On écoute «Gifted One» avec un plaisir infini, car on retrouve cette soul de charme qui ne déçoit jamais. Bobby adore partir en groove à travers la nuit, comme il le fait avec «Falling In Love Again», puis il sonne comme Otis dans «Searching For My Love», un petit cut solide, ni trop r’n’b, ni trop rock, dans la bonne balance de l’excellence. Et dans «I Wish I Had Someone To Go Home To», il amène des éléments de punch à la Temptations et du velouté magique.
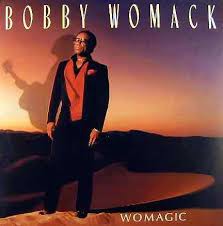
Justement, puisqu’on parle de velouté magique, voici «Womagic», qui sort en 1986. Encore de la soul de haute tenue à la pelle. «When The Weekend Comes» n’est rien d’autre qu’une admirable pièce de r’n’b grattée à la sèche et foutrement bien orchestrée. Il vire un peu dans le groove à la Marvin, comme il est d’usage chez cet admirateur de la beauté formelle. Le hit du disque, c’est «It Ain’t Me», pièce de juke embarquée à la basse et contrebalancée de cassures rythmiques insolites. Encore une jolie preuve de la virtuosité compositale de Bobby. Chez lui, ce qui prime, c’est l’extrême modernité des idées. Son beat est monté et même surmonté. Il incarne le black power dans toute sa grandeur emblématique.
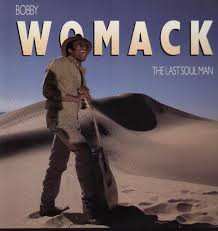
On retrouve «When The Weekend Comes» sur «The Last Soul Man» et cette fois, son ami Sly vient chanter avec lui. Ils s’envolent tous les deux dans un groove à la Marvin, c’est orchestré très funk avec un beat souterrain et des instruments claironnants. Fascinant. Puis Bobby continue d’enfiler ses perles de soul de charme, toutes uniques et bien senties. Avec «A Woman Likes To Hear That», il reste dans la soul en or et chante d’une voix de timbre fêlé à la James Brown, avec une extrême félinité de ton. Et il boucle l’album avec un extraordinaire numéro de charme, «Outside Myself», où, comme le fait si bien Esther Phillips, il va chercher des ambiances dans la nuit urbaine, au hasard des rues désertes. Il dit mieux que tout autre la beauté de l’âme moderne perdue dans un monde peuplé d’yeux lumineux.

«Save The Children» paraît en 1989 avec une pochette à la mode de l’époque. Sur certains morceaux, on le sent tenté par les machines. Avec «Free Love», il va chercher la finesse du funk et il s’y prête avec un vieux réflexe de hanches avantageuses, contrebalancé aux syncopes de violons. Avec «How Can It Be», il part dans son rêve orchestré et nous entraîne une fois de plus dans un monde unique, le sien, qui pourrait ressembler à celui de Smokey. «Tough Job» est du grand Bobby brûleur d’étapes, une horreur pulsée au beat, lancée à fond de train, battue à la revoyure et on l’entend cavaler après son beat en poussant des cris d’orfraie.
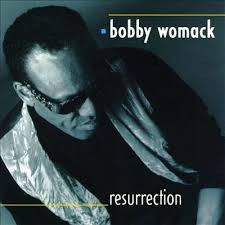
Sur «Resurrection», Bobby fait un duo terrible avec Rod Stewart, «Don’t Break Your Promise (Too Soon)». Rod The Mod s’en sort bien, d’autant qu’il se déclare fan de Sam Cooke. Mais il y a d’autres énormités sur cet album, et notamment «Forever Love» que Bobby dédie à Eddie Kendricks et à David Ruffin des Temptations, «the best singers of all time», ajoute-t-il. On entre dans la légende de la soul de rêve. Bobby nous sort le Grand Jeu. Avec «So High On Your Love», il tape dans le mélodique d’effarence élégiaque. Il charme tous les serpents de la soul. Il lustre le blason de la soul dorée. Quel fantastique ensorceleur ! Avec «Trying Not To Break Down», il propose une soul élaborée. Il crée ses atmosphères à la seule force de la voix, et comme Marvin, il se fait aider par un grand orchestre. Bobby sort une fabuleuse miaulade de soul. Il fait voyager sa voix dans le cosmos. Il reste l’un des personnages les plus attachants de l’histoire de la musique moderne, car il aura passé sa vie à faire rêver les gens de toutes races et de toutes conditions. Il leur aura montré la beauté du ciel. Bobby est imbattable. Il module sa mélodie chant à l’infini et élève la soul au rang d’art majeur. Puis il dédie «Cousin Henry» à tous les vétérans «around the world» et il joue ça au banjo. Quel démon ! Il claque des doigts et un miracle se produit. On ne pourra jamais s’ennuyer en sa compagnie. Il revient à la soul des Mille et Une Nuits avec «Cry Myself To Sleep», qu’il torche d’une voix de timbre fêlé. Il semble encore étendre son emprise sur les âmes. Et il recoiffe sa couronne de roi du r’n’b avec «Color Him Father», qu’il envoie avec toute l’énergie du black power, et derrière, on entend de chœurs déviants. Il nous envoie directement au tapis.

«The Bravest Man In The Universe» est le dernier album du grand Bobby, enregistré à Londres en 2012, avec Damon Albarn, l’ancien Blur, exactement 18 ans après «Resurrection». On est tout de suite surpris par le son : ce sont des machines. Mais il faut faire confiance à Bobby. Il retournerait n’importe quelle situation à son avantage. L’album se révèle spectaculaire, comme le furent les quatre derniers albums de Johnny Cash produit par l’Ostrogoth Rubin. On retrouve les éléments du groove dans le synthétique du son technoïde. «Stupid» est un heavy groove qui sent bon le vieux génie bobbyque. Son vieil art se mêle à la froideur d’une certaine modernité de son. Mélange très spécial mais qui passe assez bien, dès lors que Bobby le gère. «If There Wasn’t Something There» est un vrai hit de complexe technoïde tenu à l’extrême. On note l’excellence du parti-pris. C’est buté au beat. Bobby réussit l’exploit de dégager une énergie extraordinaire. On a ensuite un beau beat africain dans «Love Is Gonna Lift You Up», comme tapé au coin d’un bar en formica quelque part en Angola. Et on retrouve l’éclat du grand Bobby dans «Nothin’ Can Save Ya» monté sur un beat souterrain. Bobby tire sa voix et une petite Africaine nommée Fatoumata vient shooter de la démesure dans le cul du beat. Résultat fascinant. D’autant plus fascinant que c’est doublé de sonorités dérangeantes, on rentre dans une autre dimension du son, comme si Bobby le sorcier magique nous guidait à travers une contrée inconnue, avec la bienveillance des dieux de l’Olympe, qui faut-il le rappeler, seraient devenus noirs. Cet album est d’une modernité effrayante. Il est à la musique moderne ce que «L’Hérésiarque & Compagnie» de Guillaume Apollinaire fut aux lettres. Tous les fans de Bobby ont dû se régaler en écoutant ce chef-d’œuvre d’excentricité qu’est «Love Is Gonna Lift You Up». Avec son vieux beat africain, «Jubilee» sonne comme un retour aux sources, mais avec les machines du non-retour. Bobby s’y sent parfaitement à l’aise. Il est menacé par les maladies de la mort qui tue, mais il continue de danser, la main sur la hanche de la modernité.
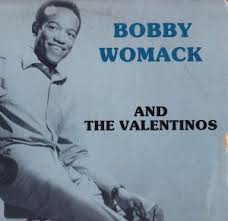
Si on souhaite remonter aux sources, alors il faut écouter «Bobby Womack & the Valentinos», une petite compile Chess qui date de l’époque où Bobby enregistrait avec ses quatre frères. Papa Womack voulait voir ses cinq fils faire carrière dans le gospel. Attention, on trouve pas mal de grosses pièces sur cet album et notamment «I Found A True Love», r’n’b endiablé, véritablement secoué du popotin. Bobby avait déjà une niaque terrible. «Do It Right» est gorgé d’énergie gospel et traversé par un solo de sax invétéré. On sent déjà l’incroyable solidité des compos. «Let’s Get Together» est un hit de soul d’acier, monté sur une très grosse basse qui décaisse. La soul classieuse de «See Me Through» préfigure l’avenir. Bobby façonne déjà les courbes voluptueuses de sa soul. «Sweeter Than The Day Before» est une vraie pétaudière montée sur un beat qui file tout droit. Pas de fioritures, chez les Valentinos. C’est tendu à l’extrême. Ces cinq frangins étaient infernaux.
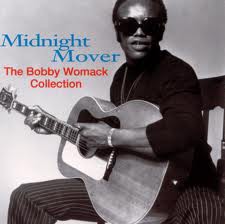
Normalement, avec la rétrospective «Midnight Mover - The Bobby Womack Collection», on devrait avoir de quoi se réchauffer en hiver. Ce double album est forcément une pétaudière, et à défaut de posséder les autres albums de Bobby, on peut très bien se contenter de celui-ci, d’autant que la pochette est superbe. Bobby y joue de la guitare et il porte son pantalon noir à rayures. On y retrouve «I’m A Midnight Mover» (r’n’b teigneux comme pas deux), «What Is This» (r’n’b de grande tenue mélodique), «How I Miss You Baby» (hit planétaire en mid-tempo), «More Than I Can Stand» (hit soul parfait allumé par une petite guitare intrusive), «It’s Gonna Rain» (r’n’b embarqué à la force du poignet), «I Fly My Heart To San Francisco» (stupéfiant de swing et screamé à la Wilson Pickett), «Arkansas State Prison» (heavy blues psyché et descentes de chant à la Bobbie Gentry), «Come l’Amore» (soul du bonheur congénital), «(If You Don’t Want My Love) Give It Back» (Groove monstrueux d’une classe épouvantable, fatal car inspiré), «Communication» (groove infernal digne de Wilson Pickett), «I Can Understand It» (rock torride plongé dans une sauce de soul, digne d’Esther Phillips) et «Woman’s Gotta Have It» (soul mortelle). Et le festival continue sur le disque 2 avec «Nobody Wants You When You’re Down» (pure merveille de groove de voix fêlée), «Across 11th Street» (hit sucré perdu dans l’immensité du groove cosmique de Marvin Gaye), «Holdin’ On To My Baby’s Love» (belle pop soul élancée), «That’s Heaven To Me» (hommage à Sam Cooke), «Looking For A Love» (son classique de Muscle Shoals), «You’re Welcome Step On By» (hit planétaire), «(If You Want My Love) Put Something Down On It» (le groove des rêves inavouables), «Check It Out» (bête de juke), «It’s All Over Now» (rock stonien garni de heavy soul électrique), «Trust In Me» (ce qu’on dit aux filles quand on leur ment), «Everything’s Gonna Be Alright» (funkoïde, pas loin de Shaft) et «Daylight» (la soul des jours heureux montée sur un beat latéral). Si on aime bien sortir d’une compile à quatre pattes, alors il faut absolument se procurer celle-ci.
Signé : Cazengler, alias Bobby Fricotin
Disparu le 27 juin 2014
Bobby Womack. Fly Me To The Moon. Minit 1968
Bobby Womack. My Prescription. Minit 1970
Bobby Womack. Communication. United Artists Records 1971
Bobby Womack. Understanding. United Artists Records 1972
Bobby Womack. Facts Of Life. United Artists Records 1973
Bobby Womack. Lookin For Love Again. United Artists Records 1973
Bobby Womack. I Don’t Know What The World Is Coming To. United Artists Records 1975
Bobby Womack. Safety Zone. United Artists Records 1975
Bobby Womack. Home Is Where The Heart Is. Columbia 1976
Bobby Womack. Pieces. Columbia 1978
Bobby Womack. Roads Of Life. Arista 1979
Bobby Womack. The Poet. Beverley Glen Music 1981
Bobby Womack. The Poet II. Beverley Glen Music 1984
Bobby Womack. So Many Rivers. MCA Records 1985
Bobby Womack. Someday We’ll All Be Free. Beverly Glen Music 1985
Bobby Womack. Womagic. MCA Records 1986
Bobby Womack. The Last Soul Man. MCA Records 1987
Bobby Womack. Save The Children. Solar 1989
Bobby Womack. Resurrection. Continuum Records 1994
Bobby Womack. The Bravest Man In The Universe. XL Recordings 2012
Bobby Womack & the Valentinos. Chess 1984
Bobby Womack. Midnight Mover. The Bobby Womack Collection. EMI Records 1993
20 - 09 – 2014 / PARMAIN ( 95 )
KUSTOM FESTIVAL & TATOO
CAROLINA AND HIS RHYTHM ROCKETS
JITTERY JACK / WISEGUYZ

En chemin vers Parmain, pluie sur le pare-brise et Mister B à l'intérieur qui attend avec impatience de voir les WiseGuyz. La Teuf-teuf se gare en toute discrétion. Pas besoin de se faire toute petite, comparées aux monstres de collection alignées devant le gymnase, elle paraît lilliputienne Même les Chambords ont l'allure de modèles réduits comparées aux porte-avions américains. Pourtant quand on nous soulève le capot avant d'une Ariane, il reste tellement d'espace vide que l'on pourrait installer à côté du bloc moteur une salle de bain avec douche et jacuzzi.
Pour les boutiques, désolé mais elles étaient presque toutes fermées, il était déjà sept heures et demie et à voir le sol détrempé de la pelouse il était facile de deviner que l'après-midi n'avait pas, hélas, été arrosée au bourbon. Fin de journée, à l'intérieur, les tatoueurs sont en train de ranger leurs stands. Pas de tableau de maître sur peau humaine à admirer. L'on en profite pour se poser devant une barquette de frites. Nourriture principale du rocker en expédition.
CAROLINA & HER RHYTHM ROCKETS

Viennent d'Allemagne. Carolina dans sa robe toute noire, cheveux longs tirant vers le roux, tatoos sur les bras, notamment un beau James Dean devant sa voiture, se présente avec la guitare de Jitter Jack en bandoulière, entourées de ses boys, Sébastian à la lead, Marco à la contrebasse, et Stephan à la batterie. Formation classique. Rien de surprenant. Si, l'organe de la belle. Une voix d'airain. De l'acier trempé galvanisé au titane. Ne faiblit jamais. Pas une perte d'un demi-ton par ci par là pour nous rappeler que nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, faillibles et sujets à d'incessantes attaques émotionnelles que nous ne parvenons pas toujours à maîtriser. Avec en prime, aucun effort apparent. Une facilité déconcertante. Pourrait chanter tout aussi bien de la soul, et je la verrais même dans un combo métal, où elle surmonterait avec aisance des murs de guitares sursaturées et ultra speed.

Idem pour ses accompagnateurs qui servent la béchamel au kilomètre sans état d'âme. Perfection industrielle. Qualité sans égale sur tous les produits de la gamme. Du début à la fin. Le band ne débande pas. Z'ont le rythme et le tiennent jusqu'au bout, sans faillir, sans faiblir. Réglo sur le taf. N'y a que dans la salle où l'on ne suit pas. Le premier morceau – on pardonne toujours la première tranche du rôti – promettait, le second aussi, et le troisième itou. Un beau départ mais l'on attendait quelques sprints pour égayer l'atmosphère. Elle est jolie, on est polis, point on ne le dit, mais tout le monde s'ennuie. L'on aimerait que ça fuse. Mais la mise en orbite sera minimale. L'on attendait une aventure intersidérale tous regroupés derrière une guerrière à la chevelure de feu, et l'on tourne paisiblement autour de la planète rockab, sans surprise et sans shoot d'adrénaline.

Le rappel sera tiède. Des jeunes gens qui ont toutes les pièces du mécano mais qui le laissent soigneusement empaqueté dans sa boîte, alors qu'ils pourraient nous bricoler une petite bombe atomique.
JITTERY JACK

Jittery Jack a repris sa guitare. Facile de la reconnaître, son nom est écrit en gros dessus sur fond blanc. En plus petit son lieu d'attache, Boston. Arrive tout droit du Massachusetts. Un truc me suffoque tout d'abord, me semble connaître son orchestre. Sur quelle vidéo les ai-je déjà vus ? Suis-je bête ! Bien sûr, ce sont des petits français, les fameux Rhythm All Stars qui accompagnent Carl ! Vous profiterez de ma stupéfaction pour gommer l'infamante appellation par trop identitaire de « petits français » car ce soir, ils ont montré qu'ils étaient avant tout de grands musicos. Ont brodé un tapis de feu. Incandescent et Jittery Jack s'y est promené dessus, pieds nus sur la terre sacrée de l'ordalie rock'n'roll.

Il y a un problème avec le rockabilly. Ou vous y êtes tombé dedans tout entier, ou vous n'êtes qu'un faiseur. Pour Jittery Jack pas besoin de vous triturer les méninges durant trois mois afin de trouver la bonne réponse. L'a avalé la potion magique. Sans en laisser une goutte. Lorsqu'il arrive sur scène, ne paye pas trop de mine, avec son costume qui rappelle un peu trop Bill Haley, mais dès qu'il aboie What's Buzzin' Cuzzin' dans le micro ce sont les chiens de l'enfer qui s'échappent de sa bouche. L'ai déjà dit et je le répèterai, les stars du Rhythm se chargent du gros travail, mais c'est lui qui fait tout le boulot. Terrible la solitude du chanteur de rockabilly au moment de l'envol. Au premier mot sorti de sa glotte, le monde entier repose sur ses épaules, les uns forgent la foudre mais c'est lui qui la lance.

Et puis il faut tenir. Facile de tirer les marrons du feu sur un morceau mais sur une quinzaine, cela devient de l'art. Faut se surpasser à chaque fois, faire oublier au public tout ce qui a précédé et lui faire miroiter que le meilleur est encore à venir, et tout le show repose sur cette attente, cette tension vers un monde meilleur que l'on n'échangera pas contre de vaines promesses. Le fan de rockab est intraitable, l'en veut toujours plus. Et Jittery Jack est à l'unisson de cette exigence. Rien ne ressemble davantage à un morceau de rockab qu'un autre morceau de rockab, au singer de se débrouiller pour que l'on n'ait jamais l'impression d'avoir déjà vu le film. Suffit d'un détail, une simple intonation de voix, mais une de ces inflexions signifiantes qui révèle un univers, que personne n'attend spécialement à cet instant précis mais dont l'absence serait perçue par tous. Jiterry Jack, ne chante pas, il vit. Pour ce soir, il est le rockabilly à lui tout seul. Son incarnation. Sa façon de reprendre souffle en plein effort, ses mouvements, ses mimiques, ses sourires, ses yeux qui ne quittent pas le public, ses mains en totale frénésie sur sa guitare, il connaît tous les gimmicks, se roule par terre, se jette à genoux aux pieds de son guitariste, le grand jeu, mais qui n'est plus un jeu, plutôt un rite vers la transcendance. Le rockab est une musique platonicienne qui recherche la congruence archétypale, mais il faut des magiciens comme Jittery Jack pour atteindre à cette perfection.

L'orga et le public ne s'y trompent pas. Chaque fois qu'il envoie glisser sa guitare à l'autre bout de la scène pour marquer que c'est la fin, doit se résoudre à revenir pour un rappel. C'est seulement après le cinquième qu'ils pourront enfin s'échapper.

L'on a tout aimé que ce soit, Heartbreaker, Boston Baby ou Something Wicked This Way, et le final démentiel de Boston. Rien à jeter chez Jittery Jack.

WISEGUYZ

Les garçons avisés – pas prétentieux pour deux grivnas - viennent d'Ukraine. Serais incapables de vous dire s'ils sont pro-russes ou pas. Ce qui est certain par contre c'est qu'ils sont pro-rockabilly. A cent pour cent. Quoique...

Les voici tous les quatre sur scène. Changement au programme, pour une fois le rythmique, Gluck, ne chante pas, est à la gauche de Chris Bird le chanteur qui tient la lead guitar, une belle Gretsch noire, les deux autres respectent la tradition, Ozzy derrière à la batterie, et Rebel, aux larges favoris qui descendent presque jusqu'aux commissures des lèvres à la contrebasse acajou qui brille comme un joujou, à la droite de son leader.

Nous azimuthent d'entrée avec un lâcher de grenades dégoupillées, du pur jus néo-rockab hyper électrique, genre plus flashy que moi, tu meurs. L'attention se focalise très vite sur l'oiseau Chris. Pas très grand, mais très habile. Les doigts et la voix en totale interdépendance. En use comme il veut. Chante comme tout un chacun la bouche ouverte, mais pour agiter les phalanges sur les cordes pourrait fermer les yeux que l'on n'y verrait rien. Au bout de trois ou quatre titres, faut se rendre à l'évidence. La tension électrique est retombée, l'on est plus proche d'un rockab classique, mais point puriste à remonter l'arbre généalogique des roots légendaires. D'autant plus qu'il n'y a plus de doute à avoir. Sait jouer rock, mais il possède un délié des phrasés trop élastiques pour ne pas avoir touché au jazz. Nous le confirmera au milieu du set, dans un instrumental à la Reinhardt qui sera fort applaudi. Des bravos pour Django. L'on ne peut s'empêcher à Eddie Cochran et de la manière dont il aurait évolué si la grande faucheuse ne l'avait arrêté de si bonne heure.

La jeunesse de Gluck ne s'endort pas sur les lauriers de Chris Bird. Pourrait se la couler douce puisque le patron est amplement auto-suffisant. A décidé de faire jeu égal. La mobylette qui se prend pour un engin de compète. Impossible de remporter la victoire, mais elle reste dans la roue et dans les descentes à tombeau ouvert elle se livre à de tels vertiges qu'elle suscite l'admiration. Des allures de guitar hero, bras levé et gestes de commandement. Ne laisse pas une seconde de répit à Chris. Celui-ci n'a pas achevé un titre que déjà Gluck lance le suivant. Cavalent tous les deux à fond de train. Jouent avec tant d'impact qu'ils sont sempiternellement obligés de se re-accorder. Mais là encore, pas de temps perdu, ravitaillement en plein vol. Trois bling-bling et c'est reparti au plus vite. Les deux autres acolytes ne sont pas aussi pressants, assurent bien mais ne cherchent pas à faire tomber l'oiseau du nid toutes les trente secondes.

L'a aussi une belle voix notre roucouleur, n'arrive pas à l'érailler comme Cochran mais est capable de la plier à tous les styles. Revisite le rockab en son intégralité, tous les styles et toutes les époques. Avec chorus de guitare idoine à chaque fois. Un répertoire un peu décousu qui manque peut-être d'unité centrale comme nous en discuterons au retour avec Mister B dans la teuf-teuf. Mais un savoir-faire et un feeling indéniables. Plus de dix ans qu'il tourne dans le métier, a su s'adapter à de nombreux changements de musiciens. Transporte une satanée expérience dans ses valises. Ovation pour deux rappels trop courts de la part d'un public en sa grande majorité conquis.

ABSENCES
Mister B and Me avons été sages comme des images, l'on n'a pas regardé les filles ( même pas un quart de seconde ) qui avant, après et entre les groupes s'adonnaient à des shows burlesques, ce n'est pas parce que l'on vieillit mais parce que l'on préférait discuter avec les amis dont Dan Goffreteau l'ancien leader des Burnin'Dust ( voir, entre autres, le tout premier article de KR'TNT ), manager des Ringstones et que vous êtes sûr de retrouver aux quatre coins du monde dès qu'il se passe quelque chose dans l'univers du rockabilly.
Par contre, l'on est repartis un peu tristes certains que le lendemain l'on ne serait pas là pour Silver Moon, Atomic Cats et Jamy And The Rockin' Trio. Quand on vous assure que ce monde n'est pas parfait, croyez-nous sur parole ! Un rayon de soleil toutefois dans cette noirceur environnante, pas mal de jeunes dans l'assistance suspendus aux lèvres des chanteurs.

Damie Chad.
( Photos prises sur le facebook de Edonald Duck )
ALPHABET CITY / ELEANOR HENDERSON
( Sonatine / 2013 / 486 pp )
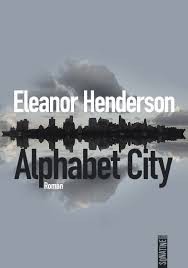
Publient un max d'américains chez sweet little Sonatine. Z'en avons déjà chroniqué pas mal. Dressent petit à petit un portrait de l'Amérique de la mitant du siècle dernier à nos jours. Les States comme les aime, déchirés et rock and roll. Premier roman d'Eleanor Henderson. Sur les photos, elle ressemble à une jeune fille sage. Une carrière d'écrivain toute neuve et sans histoire : étudiante, cours à l'université, remarquée dès la sortie de son premier livre en 2011. L'engageriez sans problème comme baby-sitter pour vos mioches. Leur évitera les cauchemars, avant de les endormir elle saura leur raconter une histoire qui finit bien. Comme Alphabet City. Par contre pour les débuts, ça part un peu mal. Très mal même.

Pouvez réciter l'Alphabet City par les deux bouts. D'un côté l'histoire d'un quartier mal-famé de New York, le fameux Alphabet City, genre une ville se penche sur son passé – car depuis la rénovation est passée par là - et de l'autre une réflexion sur cet âge ingrat et difficile que l'on appelle l'adolescence. Merveilleux sujet d'étude, les gamins ! Parviennent toujours à vous faire craquer. Pouvez les décrire sous leurs plus mauvais aspects, personne n'y croit, le coeur qui bat dans leur poitrine est en or.
En plus les quatre qui sont au coeur de récit ne sont pas bien méchants. Tellement peu que l'un d'entre eux se dépêche de mourir en laissant sa copine en cloque. Bel héritage pour les survivants. C'est ce qui s'appelle être mis aux pieds du mur. Car va falloir faire mieux que les parents. Pire ce sera difficile. Du temps de leur folle jeunesse les vieux n'y sont pas allés de main-morte et de quiquette molle, et je te trompe, et je te quitte, et je te nique et j'abandonne les marmots, ou alors je les emporte et j'en adopte un. Tous les coups sont permis. De Trafalgar et de vice. Circonstances atténuantes, ont vécu les folles années 70, la libération sexuelle, la dope, les grandes idées.
Quinze ans plus tard. Les bébés ont grandi. Veulent voler de leurs propres ailes. Pour tout bagage n'ont que les valises transmises par les ascendants. Sur les trois, il y en une qui est restée sur le quai, oubliée dans la consigne. Celle des grandes idées. Les marmots ont vécu trop près ou trop loin de leurs parents pour être dupes. Une génération qui ne croit plus à rien. Des punks. Mais nous ne sommes plus en 1977, mais aux alentours des années 85.
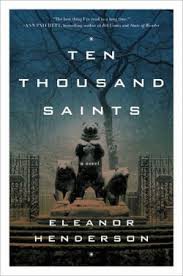
Au début nos chérubins en révolte contre leurs propres malaises existentiels s'adonnent à tous les excès, à toutes les dérives. Mais il est difficile de surpasser Sid Vicious. C'est aussi très dangereux. Le serpent de l'auto-destruction finit par se mordre la queue. Pensait en finir une bonne fois pour toute avec lui-même, mais il n'a tué que le chatoiement des excès. L'on se construit d'abord en imitant les autres, puis en s'opposant à ses prédécesseurs. Le punk jusqu'au boutiste, le punk hardcore, bifurque, il se transforme en Straight Edge. Le grand côté, le bon côté c'est exactement la rive opposée au wild side de Lou Reed. No walkin' in this shit. Pas de drogue, pas d'alcool, même pas une cigarette. Quand les enfants entendent montrer l'exemple aux parents, c'est rarement bien. Surtout que bientôt l'on ajoute un commandement un peu plus pénible que les autres. No sex. Pour la musique, destroy et bourrin. Mais ce dernier terme est discutable.
C'est le parcours de nos trois ados. Et de leurs copains. Sauront s'arrêter à temps. Monteront un groupe de rock, enregistreront un disque ( 1000 exemplaires ), partiront en tournée... mais la vie les rattrape, une clope de temps en temps, une bonne bière pour se rafraîchir, un plan drague par ci par là... chemin glissant vers sympathie for the devil ! Heureusement, car ils étaient prêts à se jeter dans la gueule du loup, à adorer Hare Krishna... S'en est fallu de peu. Auraient pu sombrer dans l'intégrisme le plus réactionnaire. Le straight edge a aussi débouché dans l'horreur, du végétarisme l'on a dégringolé jusqu'à l'homophobie, l'on a cru se libérer de toutes les mauvaises tentations engendrées par la société de consommation pour s'engluer dans une idéologie puritaine des plus retardataires.
Mais nos héros descendront du train en marche. Se sont aperçus que leurs parents malgré toutes leurs faiblesses et leurs erreurs les aimaient ! Snif ! Snif ! Violons ! Comprennent qu'ils ne feront pas mieux qu'eux. Commenceront d'ailleurs par se débarrasser à la Dass de l'héritage encombrant du copain mort... Fini le rock and roll ! Les enfants assagis retournent à l'école. Tout était très mal qui finit très bien. Ne renoncent pas tout à fait. Seront là pour la fermeture du CBGB's, save the last pogo for me !
Tout change. Vingt ans ont passé. Qui se souvient encore des nuits d'émeute du Tompkins Square Park les 6 et 7 aôut 1988, qui vit tous les laissés-pour-compte d'Alphabet City, punks, hippies, dealers, anarchistes, clochards, sans abris et autres nomades urbains s'affronter aux forces de police décidées à nettoyer le quartier avant sa grande réhabilitation ? C'est aussi cela que Eleanor Henderson a tenté de remettre en scène dans son roman moral.
Ecriture simple, personnages attachants, parcours d'une génération très bien documenté, l'ensemble se lit bien et vite. Pas un chef-d'oeuvre mais un remarquable roman sur l'ambiguïté du monde. Le titre original : Ten Thousand Saints ( Dix Mille Saints ) illustre à merveille cette dichotomie du regard que l'auteur porte sur l'être humain.
Damie Chad.
00:04 | Lien permanent | Commentaires (1)
17/09/2014
KR'TNT ! ¤ 201. DENIZ TEK / JALLIES / SCORES / BLOUSONS NOIRS / STEPHEN CRANE / HEWITT
KR'TNT ! ¤ 201
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
19 / 09 / 2014
|
DENIZ TEK / JALLIES / SCORES / BLOUSONS NOIRS / STEPHEN CRANE / HEWITT |
16 – 06 – 2014 / ROUEN
LES TROIS PIECES
DENIZ TEK
TEK C'EST PAS DU TOC
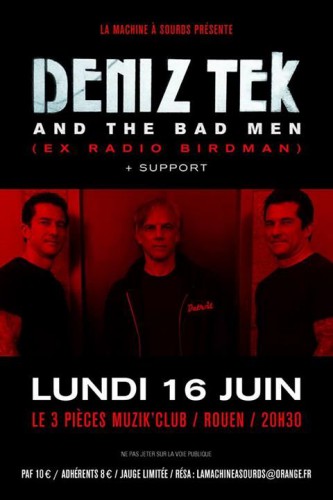
Du toc ou pas du toc ? Pour en avoir le cœur net, le mieux est encore de le voir jouer sur scène. Deniz Tek jouait avec la reformation des Radio Birdman en 2006 à la Maroquinerie. Inutile de dire que ce fut un concert énorme, suivi le lendemain (ou la veille, je ne sais plus) d’un set des New Christs. Et plus récemment, on vit Deniz Tek en solo avec deux frères jumeaux - The Golden Breed, Art et Steve Godoy, anciens champions de skate et tatoueurs célèbres - dans un petit bar rouennais bon esprit, le Trois Pièces. La veille, ils avaient joué devant paraît-il quinze personnes à Honfleur. Soirée fatale car soirée de foot. C’est vrai qu’il faut aussi savoir qui est Deniz Tek et connaître l’histoire de Radio Birdman. Si le nom ne parle pas, c’est foutu.

Quand il ne fait pas le zozo dans une cave avec sa strato, Deniz Tek travaille comme chirurgien. Parce qu’il a joué dans Radio Birdman, certains le croient australien, alors qu’il est américain, originaire d’Ann Arbor, la petite ville universitaire située à proximité de Detroit. Et c’est là où les Athéniens s’atteignirent. Deniz ado eut l’immense privilège de voir les groupes de la fameuse scène de Detroit à l’œuvre, les Stooges, le MC5, Frost, les Rationals et tous les autres barons de l’enfer, et quand il vint s’installer en Australie au début des années soixante-dix, il propagea le plus naturellement du monde la légende du Detroit Sound. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour monter Radio Birdman avec Rob Younger. Leur groupe sonnait comme un mélange de Stooges et de MC5 et reprenait des classiques comme «TV Eye». À l’époque, on adorait ces groupes qui s’efforçaient de rester fidèles à leurs racines.

Aux Trois Pièces, épaulé par une section rythmique explosive (les deux jumeaux), Deniz s’est efforcé de rester dans le même esprit en jouant quelques belles choses tirées de son dernier album solo («Detroit»). Et comme au bon vieux temps de Radio Birdman, il tapait pour finir une impressionnante reprise de «You’re Gonna Miss Me» chauffée à blanc. Curieusement, il démarra avec le «Oh Well» de Peter Green qu’il veilla à raffermir un peu, histoire de donner le ton.

Au début du set, il semblait un peu gêné, car le premier rang se trouvait à un mètre de lui, puis il s’est habitué à cette pression permanente des regards posés sur lui. S’agitait derrière lui un batteur complètement explosif qui se mit torse nu. Son buste couvert de tatouages ruisselait de sueur. Deniz illustra son vieux penchant pour les Stones avec «Fate Not Amenable To Change» et se livra à un riffage qui eût fait loucher Keef s’il s’était trouvé dans le coin. Morceau tiré de «Detroit», comme d’ailleurs «Can Of Soup» qui pourrait passer pour un hit seventies lancinant, monté sur un beat à la Roky Erickson et admirable à tous les égards. Le maigre public réagissait bien. Il amena un autre titre de «Detroit», «Ghost Town», plus balladif, presque traité à l’arpège, un peu cousu de fil blanc, pas loin du pathos, avec des paroles qui ne pardonnaient pas - «We come from Ghost Town/ We’re already dead/ Nothing can’t kill us anymore» - c’était un peu lugubre.

Heureusement, il a rattrapé le coup avec un autre titre de l’album, l’imparable «I’m Alright», belle désaille montée dans une ambiance dollsy. Appelons ça un morceau d’antho vraiment inspiré qui fourmille de breaks salutaires. Sur l’album, ce cut est si bien produit qu’on croirait entendre jouer Johnny Thunders. Deniz sait marteler son stuff et l’harmo de Daddy Long Legs emporte la bouche.

«Detroit» est un bon album de rock. On peut y aller les yeux fermés. Deniz Tek chante avec le timbre voilé des vétérans de la bourlingue, comme on le voit avec «Pine Box», un étrange morceau d’ouverture bien posé sur ses assises. On sent le vieux répondant birdmanien, hanté par des incursions incendiaires. Une chose est certaine : Deniz Tek sait composer. On retrouve un gros son d’accords plombés dans «Twilight Of The Modern Age», encore une fuite typique des Radios d’antan, bien construite et solide comme un châssis de voiture allemande. «Perfect World» sonne comme un hit. C’est encore une fois sacrément bien claqué à l’accord et aménagé de zones d’arpèges très seventies. Puis ça s’emballe avec une belle ampleur et ça se met à sonner comme un hit pop des sixties. Le cut fonctionne comme une sorte de panorama et ça finit dans une ambiance dollsy assez inspirée. Avec «Take That Again», il revient au Birdman sound, à l’authenticité, au rock bien chanté. Il reste bien implanté dans le dessus du panier.

Le plus grand exploit de Deniz Tek restera sans aucun doute son apparition dans le concert donné en 2011 en hommage à Ron Asheton par Iggy et les Stooges. Scott Asheton était alors encore en vie. Pendant toute la première partie du set, c’est Williamson qui joue. Il fait la gueule et il n’a pas de son. La version de «Raw Power» est ca-tas-tro-phique. La riffagerie de Williamson est plate comme la bourse d’un gueusard. Williamson doit bien le sentir, puisque son visage se renfrogne de plus en plus. Il doit même se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère. Il est d’autant plus mal à l’aise qu’on rend hommage au mec qu’il avait réussi à virer du groupe. Ça pue. Avec cet événement, on a vraiment l’impression qu’ils salissent le souvenir de Ron Asheton. Les versions ratées se succèdent pendant une heure, puis il y a un break. Le groupe revient sur scène avec un nouveau guitariste, et là, ça change tout : Deniz Tek attaque le riff de «TV Eye» sur sa Strato blanche avec une telle ferveur qu’on croit entendre les vrais Stooges. Pour «Loose», même chose, now look out ! Alors Iggy renoue avec sa chère délinquance juvénile. Il se jette au sol et rampe comme au bon vieux temps.

Soudain, l’évidence éclate au grand jour. Maigret : «Bon dieu ! Mais c’est bien sûr ! Au moment de la reformation, les Stooges auraient dû engager Deniz Tek et non Williamson, pardi !»

«Radios Appear» est considéré à juste titre comme un classique du rock australien, un genre créé pour l’occasion et donc inauguré par Radio Birdman. Se sont engouffrés là-dedans de nombreux groupes plus ou moins intéressants comme les Celibate Riffles, les Lime Spiders, les Hitmen, les Hoodoo Gurus (plus pop), Died Pretty, les Stems, les Cosmic Psychos, les Powder Monkeys et toute la bande des Scientists/Beats Of Bourbon. On appelait aussi le garage australien le rock high energy, un genre fumeux qui fit pas mal d’émules en Scandinavie. Tous ces gens là s’inspiraient plus ou moins directement du Detroit Sound. D’où l’importance cruciale de l’arrivée à Sydney d’un mec comme Deniz Tek qui fut en quelque sorte le messie. On trouve au moins trois classiques sur le premier album des Birdmen. D’abord «New Race» qui est le morceau stoogy du disque, monté sur les accords de «Gloria» et sur un beat de beast pressée à la Paul Morand. Ce cut est en outre doté d’un superbe final frénétique agité de chœurs sauvages. Ce fut un joli coup de maître. L’autre grosse pièce de l’album, «Aloha Steve & Danno», sonne comme un classique des Dolls. On y retrouve cette merveilleuse dynamique chaloupée et ce beau son perlé de chœurs qui fit la grandeur des Dolls. Ils rendent un bel hommage à Roky Erickson en proposant une resucée de «You’re Gonna Miss Me». S’ensuit «Hands Of Law» qui sonne comme le grand classique du groupe, et c’est sans doute la raison pour laquelle Deniz Tek le reprend aujourd’hui sur scène. C’est un beat qui court la plaine avec de belles ouvertures sur la droite et sur la gauche - Hand of law is coming down/ Hand of law is on us now. Ils finissent ce premier album avec une étrange compo signée Tek/Asheton et montée sur un petit riff orientalisant, mais qui refuse obstinément de décoller.

Quand en 1981 paraît «Living Eyes», le groupe a déjà disparu. Bon album ? Pas bon album ? Les avis sont restés partagés depuis trente ans. Ce n’est évidemment pas l’album du siècle. On y trouve cependant quelques belles pièces de solide garage australien, comme «Hanging On», dans laquelle Robbie chante comme Chris Bailey. Franchement, on croirait entendre les Saints. Morceau intéressant, bien buté du gras du bulbe. Les Birdmen s’en donnaient à cœur joie, surtout Chris Masuak qui tirait un solo à rallonge. Mais on sentait que la plupart des compos de Deniz Tek ne fonctionnaient pas. Trop tarabiscotées, pas d’envolée. «Burn My Eye 78» est certainement l’autre hit du groupe. On apprécie surtout la sauvagerie d’une attaque peu banale. Ça sonne comme un standard des Ramones et ça reste très bon esprit. Quand on écoute le «Smith And Wesson Blues», on pense automatiquement à cette grande interview de Keith Richards jadis parue dans le Melody Maker ou le NME, «You’re never alone with a Smith and Wesson». «Crying Sun» restera aussi l’un des classiques des Birdmen, l’un de leurs morceaux les plus élégants et les mieux balancés. On sentait alors que ces mecs cherchaient leur voie et que ce n’était pas simple, vu qu’ils vivaient loin de tout, là-bas, down under, en Australie. «More Fun» est aussi un beau morceau, vraiment digne de ce qui firent les Dictators à l’époque de «Go Girl Crazy». Ils semblaient plus à l’aise sur le format pop que sur les carcasses tarabiscotées qui ne menaient nulle part.

«Ritualism» sortira quinze ans plus tard. Il s’agissait d’une collection de morceaux live. Ouverture du bal avec l’inévitable «Burn My Eye» et on retrouvait plus loin l’excellent «Hanging On» avec son coup de wha-wha dans les tibias. Une belle reprise de «TV Eye» faisait le cachet de cet album. Le pauvre Robbie essayait de hurler comme Iggy, mais il restait assez loin du compte. Puis il commençait à s’énerver tout seul et là, on peut bien dire que ça devenait très intéressant car ce mec qu’on croyait timide paraissait soudain possédé par le diable : il se mettait à éructer, à baver de la bile verte, comme dans l’Exorciste, sa tête pivotait à 360°, il échappait à la raison, il crachait, moussait, vociférait et arrosait les autres de jets de bile fumante. On regrettait qu’il n’ait pas fait le con comme ça sur les autres morceaux. On sentait le groupe à l’aise car il avait enfin une vraie compo à se mettre sous la dent. Ils fusionnaient TV Eye avec le doin’ alrite doin’ alrite de «Looking At You» du MC5, magistral de pulsion apocalyptique. On sentait en eux les vrais amateurs de Detroit Sound, aucun doute n’était plus permis. Le batteur continuait de battre tout seul dans le vide. «Revelation» sonnait comme du Doctor Feelgood. Ils profilaient cette belle pièce sous le vent et la battaient sec et dru. Autre gros choc référençaire : «Aloha Steve & Danno», tiré du premier album, qu’ils amenaient comme un gros punk-rock d’accords plaqués à l’ancienne, avec des chœurs de filles faits par des hommes, comme chez les Dolls. Et ils bouclaient l’affaire avec «New Race», belle pièce cavalante et solide comme l’enfer tirée aussi du premier album, portée au drumbeat et au riffage 13th Floor Elevators/mi ré la de «Gloria», énormité de fin de disque qui enfonçait bien les clous.

En 1981, Deniz Tek et Rob Younger montèrent un projet audacieux : une tournée australienne avec Ron Asheton. Comme le frangin Scott n’était pas disponible, ils firent appel à Dennis Machine Gun Thompson du MC5. Un album live paru en 1997 illustre cet événement. On y entend une majorité de morceaux des Birdmen, évidemment, mais aussi trois classiques : «Loose» des Stooges, «Looking At You» et «Gotta Keep Movin’» du MC5. C’est très intéressant d’entendre Ron Asheton jouer les solos de Wayne Kramer. Pour Robbie et Deniz, ça devait être le paradis. Dans le petit texte qui accompagne le disque, Deniz évoque le souvenir magique de ce voyage à travers l’Australie. La version de «Loose» est excellente, mais il manque quand même le gros son des Stooges. Ils reprennent «November 22 1963» de Dark Carnival qui raconte l’assassinat de Kennedy - Jackie Kennedy alone in his brains - et gros solo de Ron Asheton. On se régale aussi de «Looking At You», soudain, on a les vraies chansons, les gros hits imparables, et ils pulsent ce bon vieux Looking à l’infini. Ron s’amuse comme un fou, il entre dans le tourbillon incessant et enchaîne les solos vitrioliques. Ils terminent sur une compo circonstancielle, «Columbia», belle pièce insistante reprise aux chœurs - Hey Columbia - mais brisée par un pont débile. Ron le surjoue au gimmickage.

«Zeno Beach» fut l’album de la reformation du groupe, et donc le prétexte à la tournée qui passa par la Maroquinerie en 2006. Bon album ? Pas bon album ? Là-dessus, on trouve au moins trois énormités : «We’ve Come So Far (to be there today)» (Robbie fait sa voix de fantôme geignard derrière, il ne monte pas devant, tout le son est caoutchouté, c’est un cut plutôt stupéfiant), «Die Like April» (petit riff alarmant et à un moment, ils font basculer le morceau dans le heavy goody - you can’t come down - et des gros ponts éclairés par une sorte de génie composital inespéré, ponts déments et le groupe devient sur-puissant, avec des chœurs dollsy - c’est dans ce genre de petit morceau que se niche le génie des Birdmen - la bonne nouvelle c’est que Deniz Tek signe ce spectaculaire chef-d’œuvre) et «Hungry Cannibals» (gros boogaloo insolent de hauteur carnassière, ils deviennent le temps d’un morceau les princes de la nuit, ils déblaient tous les passages, ils sont fatals, classieux, musclés et suivis par des notes d’orgue insolentes, c’est une pure démenterie et ils en rajoutent). Les derniers morceaux de l’album sont aussi très réussis et notamment «Zeno Beach», une power-pop magistrale qui sonne comme une énormité cavalante, supérieure en tout. Mais qui sonne comme ça aujourd’hui, à part les Wildhearts ?

En 2010 est paru un autre album live de Birdmen, «Live In Texas». On est allé voir, par simple curiosité. On y retrouve des morceaux de Zeno, comme «We’ve Come So Far» et une reprise des Who, «Circles». Ils font bien le round and round, mais côté son, ils restent assez loin du compte. Heureusement, ils balancent une grosse version de «Die Like April» qui du coup devient le gros hit des Birdmen, bardé de nappes transversales, c’est lumineux et bien embarqué par Chris Masuak. Dommage que les autres titres ne soient pas aussi bons. L’autre point fort de cet album live, c’est bien sûr le gros son de basse de Jim Dickson qui bat la brousse comme un damné. Ils font une belle reprise du «Til The End Of The Day» des Kinks et reviennent au vieux «Hand Of Law» des Birdmen que Deniz jouait aussi au Trois Pièces pour conclure le set. Cette fois, la version passe bien, car ils la jouent très atmosphérique et la rallongent, ce qui est idéal pour déblatérer.

Et puis les suiveurs de Radio Birdman ont tous récupéré en 1988 le gros boîtier compilatoire intitulé «Under The Ashes». Mais ce n’est pas très bon. On retrouve deux ou trois clins d’yeux aux Stones («Skake» - pompé sur «Let It Bleed», que Robbie chante avec une voix de nez bouché, et «Burn My Eye», avec ses jolis clap-hands de circonstance, mais tellement cousu de fil blanc), une grosse compo («Man With The Golden Helmet», avec ses guitares groovy de Californie, étonnant parti-pris, avec un piano à la «Aladin Sane», curieuse option qui rend le morceau attachant et intéressant) et une cover bien énervée de «You’re Gonna Miss Me». Normal que Deniz connaisse bien les accords. Mais le reste ne convainc pas, loin de là.

Entre les deux époques de Radio Birdman, Deniz Tek a multiplié les projets. En 1994, il sortait l’excellent album «Outside». Dans l’équipe, on retrouvait Jim Dickson et Chris Masuak. Tous les morceaux sont bons, sur ce disque. Ils attaquent avec «Blood From A Stone». On entend bien la basse de Jim Dickson cavaler dans le mix. Belle intensité et richesse de la tambouille, c’est en général ce qu’on attend d’un disque de rock. «Dry To Ride» est un très beau mid-tempo musculeux. Apparemment, c’est le rythme qui convient le mieux à notre héros, comme dirait Houellebecq. On y sent l’excellence d’une belle aisance, la prescience de la rockitude, une essence du développé et une ambivalence de l’impact. Belle pièce hendrixienne avec «Waiting». Ça sonne comme un classique seventies pur jus, comme un vrai hit de série B, ceux que préfèrent les connaisseurs. Jim Dickson sort une grosse bassline à la Noel Redding et le solo de Masuak frise l’hendrixien. On retrouve l’excellent beat sec du mid-tempo sur «Searchning». Deniz Tek sait traiter le problème avec méthode et efficacité. Il est redoutable. «Condition Black» se distingue par un beau drumbeat et un claquage d’accords à l’orée du village. On trempe une fois de plus dans l’excellence réaliste du rock classique, piqué au cœur par un solo d’une rare virulence.

L’autre gros épisode de la traversée en solitaire, c’est bien évidemment Dodge Main, avec Wayne Kramer et Scott Morgan. L’ami Kramer avait joué en première partie d’une tournée australienne des Birdmen et tout naturellement, les deux cocos se sont retrouvés en studio pour pondre quelques cuts en or. Ils démarrent d’ailleurs avec une reprise de «City Slang» du Sonic’s Rendezvous. Scott Morgan lance son attaque frontale et derrière Wayne déverse le diabolo de la mélasse ultime. On se saurait imaginer pire fournaise. Avec «Citizen Of Time», Wayne renoue avec le mythe du guitar hero. Ils tapent ensuite dans «Furure Now» tiré du troisième album du MC5. Fabuleuse reprise énergétique, Scott monte au chat perché de Rob Tyner, il sait le faire, avec toute l’ampleur du feeling de voix fêlée. Et derrière ça riffe et ça raffe, et comme cerise sur la gâteau, on a un atroce solo du grand Wayne Kramer. Il va chercher l’escalade au Vietnam. Bombarder, ça ne lui fait pas peur. Avec ce genre de mec, les choses ne peuvent que se terminer en viande froide. Il tire sur l’élastique jusqu’à l’extrapolation Il joue vraiment comme un dieu furibard. S’il faut emmener un guitariste sur l’île déserte, c’est bien Wayne Kramer. Avec «100 Fools» Deniz essaye de faire les Stooges, mais ça reste très teky. On sent une certaine difficulté au décollage. Puis Wayne Kramer chante cette vieille merveille insurrectionnelle qu’est «The Harder They Come». Et on revient fatalement au Rendezvous avec «Over & Over». Scott Morgan installe son chat perché au dessus des flammes de l’enfer. Cette reprise est exploitée au maximum de ses possibilités. Impossible de pousser davantage le rendement d’une telle chaudière. Ils sont spectaculaires d’allant. Et le festival continue avec «Better Than That» toujours chanté par Scott Morgan, un vrai diable. C’est noyé dans un jus de guitares extraordinaire, on ne sait plus s’il faut parler de radiation du barreau de l’atome, d’explosivité nitroïque, de couche champignonique, toujours est-il qu’on avait encore jamais entendu un tel ramdam. Ils finissent avec la prise d’une forteresse imprenable, le fameux «I Got A Right» des Stooges que Scott prend à la perfection. Il réussit l’exploit de masquer l’absence d’Iggy. Wayne rentre là-dedans comme dans du beurre. Il ne craint pas de se salir les mains. Quelle abomination !
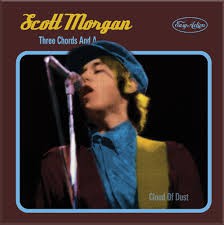
Deniz Tek et Scott Morgan sont des amis de longue date, car le premier concert que vit Deniz ado fut celui des Rationals. Il avait 14 ans. On les retrouve tous les deux dans la reformation du Rendezvous (après la mort de Fred Sonic Smith), dans Powertrane et dans le fameux «Three Assassins», l’album chiricahua. Deniz Tek et Scott Morgan y proposent des morceaux live enregistrés en France et en Italie. On retrouve évidemment tous les vieux coucous circonstanciels, comme «Future Now» (version incendiaire, avec un son exceptionnel), «Electrophonic Tonic» (encore une resucée spectaculairement ronflante du Rendezvous) et puis des morceaux qui sortent d’un album solo de Deniz, «Equinox» («Agua Caliente» et «Shellback»). Ça continue de chauffer avec «Asteroid B-612», garagé jusqu’à l’os du genou, solide et violemment bon. «Love And Learn» est une énormité sans aucune équivalence, pas la peine de chercher. Encore de l’ultra-violence avec «Dangerous» et ils enchaînent avec l’insoutenable trilogie du Detroit Sound : «City Slang», «I Got A Right» et «TV Eye». Aucune oreille ne peut sortir vivante de ce carnage. Inutile d’ajouter qu’après ça, on est calmé pour un bout de temps. Et si on veut goûter au cru le plus violent, c’est-à-dire Powertrane, on en trouve sur un fantastique coffret consacré à Scott Morgan, que vient d’éditer Easy Action : «Three Chords And A Cloud Of Dust». On trouve dans cette rétrospective une version de «1969» des Stooges qui bien sûr ne surpasse pas l’original, mais Scott Morgan en fait une merveille, épaulé par un mur du son et un solo extravagant de Ron Asheton. Avec celle de Joey Ramone, c’est la plus belle reprise qu’on puisse entendre de ce vieux classique increvable. On trouve trois autres monstruosités de Powertrane dans ce coffret, mais sans Deniz : «Beyond The Sound», «You Gotta Come Down» (dans la veine r’n’b avec des chœurs somptueux, du style de ce qu’on trouve sur les albums de The Solution, avec Nicke Andersson des Hellacopters) et «2+2=?» (reprise démente de Bob Seger. On y entend Scott hurler comme Wilson Pickett, c’est atrocement pulsé - Two plus two on my mind - mais le problème avec ce coffret, c’est que tout est bon, et les trois disques sont remplis à ras-bord.)

«Le Bonne Route» paru en 1996 est un album hautement recommandable. Un bon conseil : traquez-le, vous ne serez pas déçus. C’est là qu’on trouve le grand Tek. Ce mec est un peu comme Joan Jett, il a décidé étant môme de consacrer sa vie au riff. Alors rien ne peut l’arrêter et c’est exactement ce qu’on ressent à l’écoute de «Imaginary Man». Deniz riffe envers et contre tout. Il fait de l’abattage. Et il sort un solo qui sonne comme ceux de Ron Asheton. C’est le grand retour inespéré du Detroit Sound. Et tout l’album va sonner comma ça. «Lunatics At The Edge Of The World» tarabiscote un peu mais ça prend vite des allures de MC5 avec des belles poussées de fièvre jaune. C’est même carrément stoogy. On peut aussi parler de hit psyché. «Tubular Dreams» sonne comme un hit descendant digne des Stones. Belle bordée de chords dans le mât de l’Espagnol, capitaine Flint ! Ça joue de l’harmo dans les gréements. Deniz riffe comme une brute. Quel abominable homme des neiges ! Il finit par sidérer. «Clear Itself» est encore une belle pièce de riffage sauvage, au sens de l’étalon. Deniz nous fait le coup du chant dans la pénombre. Il sait bien mener sa barque. Ça gicle dans tous les coins. Encore une énormité avec «Saucer Pilot Blues». Il est bien meilleur dans ses aventures solo qu’avec les Birdmen. Il a trouvé le secret du son explosif et ça devient fascinant. On a enfin l’impression d’avoir entre les mains un vrai disque de rock. Il refait du pur Asheton avec le solo. C’est le son des entrailles grouillantes de la pire fournaise qui ait jamais existé sur cette terre. C’est dingue ce que Deniz Tek peut être bon. Il a vraiment tout pigé. Avec «Ze Good Way», il repart dans l’extrême du son dévasté et coule le bronze de ses solos dans la plaine en feu. Il ne sait plus où il habite, alors il demande au facteur. Mais le facteur, c’est Tati et il ne sait pas non plus. Il répond par des pirouettes et des cacahuètes. Alors adieu les gars et pendant ce temps Jim Dickson et sa basse battent la campagne. Effroyable intro pour «Dave’s Insanity» - digne des Dolls. Deniz a toujours su rendre hommages aux Dolls. On retrouve dans ce cut toute la flamboyance des Dolls. Il est le seul avec Kevin K et les Neckbones à savoir sonner comme ça. Il sort même avec «Dave’s Insanity» le morceau dont les Dolls ont toujours rêvé. Dolls, Stones et Stooges. Voilà de quoi se nourrit Dracula Tek.
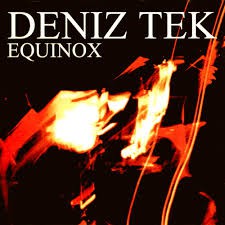
Il sortait en 1998 «Equinox», un autre petit album solo sans prétention. Dans la plupart des morceaux, il recherchait l’envolée. Pour «Seven Is», il tapait dans l’épaisseur du son et observait un étonnant parti-pris de retenue concomitante. Il cherchait l’effet mitoyen en bannissant les risques d’ennui et l’excitation. Sa compo finissait par plaire, car elle ne ressemblait à rien de ce qui existait ici bas. Même effet avec «Agua Caliente». Il tapait à nouveau dans l’expérimentation avantageuse et traitait ses parties de guitare à la manière du MC5. «Christmas Eve» s’inscrivait aussi dans le même processus ambitieux. On sentait chez lui une vraie prise sur la vie. Sa vison rampante se voulait foncièrement originale. On notait quelque chose de médiéval dans l’attaque de «Sideways Motion», quelque chose qui relevait de la puissance organisée. Il proposait une belle sortie en mer de Chine du rock amélioré avec «King Of The Carnival», un talking-rock bien tempéré transpercé d’éclairs et de brillants redémarrages.

Deniz Tek jouait déjà avec les jumeaux en 2003, comme en témoigne l’album «Glass Eye World». Grâce à ce fantastique album, on comprend enfin que Deniz Tek est le roi du solo. Il transperce tous ses morceaux de solos fulgurants. C’est d’autant plus spectaculaire que les morceaux en eux-mêmes ne sont pas spécialement mémorables. Exemple, «Always Out Of Reach», bien passe-partout et soudain, ah c’mon, solo loco ! Même phénomène avec «Let’s Go», un peu poppy, où le solo, incendiaire comme pas deux, s’en sort très bien. «Flight 18» est un mauvais cut déjà entendu mille et mille fois, Deniz joue son rôle favori de marinier des écluses et soudain, il pète la poire d’un solo extraordinaire. C’est son truc, son atout, sa botte mortelle. Il le tire dans la longueur selon des arcanes stoogiennes héritées de son vieil ami Ron Asheton. Même surprise avec la pop pressée de «2 PAM Chloride», et «What It’s For», dont la puissance consommée évoque le MC5. Il entre là-dedans comme dans du beurre et nous livre une belle pièce de Detroit Sound. Encore du rock bien senti et mélodiquement bien foutu avec «Clifford Possum», mené à la trique insidieuse et traversé de solos qui resteront des modèles du genre. Il fait aussi son petit numéro de punk-rocker avec «Wild Caro». Les jumeaux adorent. Ils mettent la gomme. Deniz balance un solo d’excellence suprême. Il l’amène de main de maître et l’écourte brutalement.

Pour éviter de se ruiner la santé à traquer les vieux albums solo, le plus simple est de mettre le grappin sur «The Citadel Years» un double albums qui propose un bon choix de morceaux tirés de tous ses albums solo, «Equinox», «Le Bonne Route», «Glass Eye World» et surtout «Deep Reduction» 1 et 2. On retrouve sur ces deux disques toutes les petites merveilles que sont «Last Cruise On The Owl» (clin d’œil aux Stones), «Tubular Dreams», «Workingman’s Shoes (belle tempête sonique), «Billy Was A Cathar» (bien plombé et un peu heavy), «Lunatics At The Edge Of The World» (pure stoogerie), «Novotel Blues» (bâti dans l’exaction, dans l’esprit Sonic’s Rendezvous/New Race), «What It’s For» (absolument dévastateur) et une reprise à la fois héroïque et spectaculaire du «Meantown Blues» de Johnny Winter. À part Deniz, personne n’aurait osé taper là-dedans. C’est à ce genre de reprise qu’on voit l’homme de goût.
Surtout, si d’aventure vous allez voir Deniz Tek jouer sur scène, prenez soin de visionner le Tribute à Ron Asheton avant le concert. Ça vous permettra de situer le niveau du personnage. Il sera très heureux de vous parler de cet épisode, et vous apprendrez des choses intéressantes. Par exemple, la strato que tient Deniz sur la pochette de «Detroit» est l’ancienne Strato de Ron Asheton. Cadeau des Stooges en guise de remerciement. Et s’il est un mec qui la mérite sur cette terre, c’est bien lui.
Signé : Cazengler, le tekard de service
Deniz Tek. Le Trois Pièces. Rouen. 16 juin 2014
Radio Birdman. Radios Appear. Sire 1978
Radio Birdman. Living Eyes. WEA 1981
Deniz Tek. Outside. Red Eye 1994
Radio Birdman. Ritualism. Crying Sun Records 1996
Deniz Tek. Le Bonne Route. Citadel 1996
Dodge Main. Alive Records 1996
New Race. The First And The Last. Alive/Total Energy 1997
Deniz Tek. Equinox. Citadel 1998
Deniz Tek & Scott Morgan. 3 Assassins. Career Records 2004
Radio Birdman. Zeno Beach. Crying Sun Records 2006
Deniz Tek & The Golden Breed. Glass Eye World. Career Records 2003
Radio Birdman. Live In Texas. Radio Birdman 2010
Deniz Tek. Detroit. Career Records 2013
Radio Birdman. Under The Ashes. Trafalgar Music 1988
Deniz Tek. Citadel Years. Citadel 2011
Scott Morgan. Three Chords And A Cloud Of Dust. Easy Action Recordings ltd 2013
Tribute to Ron Asheton. Iggy & the Stooges + Special Guests. DVD 2013
11 – 09 - 2014 / FONTAINEBLEAU ( 77 )
BAR LE GLASGOW / JALLIES
C'est comme la drogue, vous avez eu votre paquet de dosettes en début de weekend mais dès le jeudi vous êtes en manque. Surtout que le Grand Phil, l'était arrivé à dix-huit heures dix, le samedi à Montereau. Trop tard. Game over. Pas intérêt à manquer la séquence de rattrapage. L'on a vite déchanté. On ne s'était pas glissé dans la teuf-teuf que les copines ont rappliqué, comment vous allez voir les Jallies sans nous, l'a fallu accepter cette escouade de surveillance rapprochée.
Jeudi soir, l'on s'était dit, ce sera désert. Fausses prévisions. La teuf-teuf se jette sur l'ultime place de stationnement libre dans un rayon de mille sept cents vingt-huit mètres et l'on se dirige au pas de course vers le Glasgow. Pas de course, c'est vite dit, car la rue est noire de monde, disons que l'on s'insinue entre les groupes qui papotent un verre à la main au milieu de la chaussée. Tout cela pour s'apercevoir que l'on s'est trompé et que le Glasgow est juste situé dans l'artère parallèle à la notre. Tout aussi encombrée que celle que nous venons de remonter. N'y a qu'à Paris que l'on peut voir les gens musarder ainsi.
L'on s'attendait à ce que le Glasgow soit empli d'Ecossais en kilt, les uns jouant de la cornemuse tandis que les autres liraient d'une voix de stentors de fiévreuses déclarations d'indépendance. Ben non, c'est envahi de teutons tatillons qui boivent leurs chopes de bière avec componction. Tout le staff d'une entreprise qui doit fêter la promotion d'un sous-chef de bureau. Mais en dignes représentants d'un peuple connu pour ses vertus disciplinaires ils vont tous opérer un mouvement de retraite stratégique à huit heures trente précises.
Y a bien le matos en place, mais ces demoiselles se font attendre. Et surprise, quelle est cette jeune fille qui entre et qui nous sourit de sous sa casquette ? C'est Ady. A dire vrai nous a fallu deux secondes et demie avant de réaliser notre plaisir, Ady qui fut à l'origine du groupe et qui revient voir les copines ! Comme par magie les trois oiselles apparaissent et tout ce beau monde s'en va tirer une clope au-dehors, en attendant le début du concert.
CONCERT

Galanterie française : les deux garçons collés contre le mur, les trois filles devant. Tous les cinq agglutinés dans un mouchoir de poche. Pas vraiment de ligne de séparation entre le public et les artistes. C'est plein comme un oeuf de quintuplés. Si vous souffrez d'agoraphobie, ne lisez pas la suite de cette chronique. Céline en est toute émoustillée. Saute partout. Passe de micro en micro et demande aux copines de la laisser chanter. S'amuse comme une gamine, avec son petit bandana noué autour du cou elle nous fait le coup du cowboy charmeur à qui personne ne saurait résister.

Mais c'est de derrière que surgit la surprise. La chiourme se révolte. Episode 2. En ont assez de servir dans l'ombre. Thomas a dû doper sa guitare, car brutalement elle s'impose au premier plan. Le répertoire des Jallies s'en trouve revisité. A Montereau c'était la contrebasse de Julien qui claquait comme les fers d'un régiment de cosaque sur les pavés de Paris en 1871, mais ce soir au Glasgow Thomas nous met à l'heure anglaise, ce sera swing mais avec la touche british-guitar. Tout le temps devant, aux avant-postes, dans les soli bien sûr, mais partout, dans les lignes mélodiques et les passages rythmiques, ne s'interrompt que pour laisser son compère Julien s'envoler sur sa double-bass. Du coup la classe claire en devient presque transparente, faut voir pourtant comme les filles ne la ménagent pas. Oui mais les boys sont à la manoeuvre et ça filoche dans les voiles.

Ca dégage sec. Ne nous sortent que des interprétations d'anthologie. Je ne crois pas qu'il existe sur terre un endroit où la densité de la population au mètre carré soit plus élevée que dans le Glasgow ce soir. Evidemment les filles en rajoutent, déjà qu'elles sont serrées comme des harengs en caque, elles exigent du renfort. Cela fait un petit moment que je ne peux m'empêcher de dévisager cette fille de toute blondeur au visage hilare à deux pas de moi. Je la connais, mais d'où ? Déclic immédiat lorsque Vanessa l'appelle auprès d'elle et lui passe le micro. C'est la meuf à la si belle voix qui avait interprété un morceau lors du passage des Jallies à l'auberge de Thoury ( voir KR'TNT ! 155 du 12 / 09 / 2013 ). Emilie n'est pas seule, voici Jéjé qui surgit et parvient à se faufiler avec sa trompette contre le mur, Leslie préfère émigrer parmi les spectateurs et battre la musique sur son tambourin. Peux même pas vous dire le titre qu'elle chante, je n'ai le souvenir que de sa voix rauque et sensuelle, une traînée de soul brûlante qui trace son chemin dans le feu du volcan rockabilly. Pas n'importe qui, la chanteuse de Soul Sérénade, un combo jazz dans lequel on retrouve les vieux briscards des Haricots Rouges, qui officient encore après presque un demi-siècle. Reviendra dans le deuxième set pour une seconde fontaine de jouvence. A chaque fois elle rentre dans la foule, sourire radieux aux lèvres, de son allure se dégage une incoercible joie de vivre.

Tant qu'on est aux invités, passons-les en revue, Jéjé bien sûr, un vieil habitué, mais ce soir il a soufflé comme jamais, habité par la grâce. Vincent, c'est la première fois. Ce sont les boys qui l'appellent. Ont besoin de renfort parce que les filles pétillent et ne s'en laissent pas conter. A un peu de mal à caser sa grande carcasse. Ca n'y paraît pas mais pour jouer de l'harmonica il faut lever le coude et ici l'espace est millimétré. Rockab blues, ça virevolte comme dans un disque de Little Walter, trilles pesantes et feu follet insatiable. Je suis devant et je saisis toutes les nuances, mais je doute qu'au fond du café ce soit aussi limpide. Le son n'a pas été réglé pour cela. Vincent s'extirpera avec difficulté de la masse mouvante qui grouille sur l'imprécise frontière qui réunit plus qu'elle ne sépare, le groupe et son public. On l'attendait. On l'espérait. L'on ne voulait qu'elle. Et comme les trois mousquetaires les Jallies deviennent quatre. Encore un mystère de la Sainte Trinité ! Qui d'autre qu'Ady pouvait ce soit chanter Rock and Roll Queen. C'est elle qui l'a composé. S'empare du micro et tout de suite c'est royal. A croire qu'elle n'a quitté le groupe que depuis avant hier soir. Version éblouissante. Ady Blue est parmi nous et nous n'en demandons pas plus. Regagnera sa place dans l'assistance dès le morceau achevé. Sous les applaudissements.

Ce n'est pas parce que les garçons sont montés aux rideaux et qu'il y a eu pléthore d'invités que les filles sont restés à la maison. Question ménage, à part les coups de balai sur la caisse claire, elles n'ont pas fait grand-chose. Oui mais pour l'ambiance champagne, elles n'ont pas ménagé leur effort. C'est Vaness qui sauvera la mise lorsque la sécurité entreprend de faire sortir un gars soit disant trop fou-fou ( les filles ça émoustille ) un peu brutalement, en se lançant dans un Jump Giggles And Shout dévastateur qui emporte tout sur son passage et qui permet à la pression de retomber. Céline swing, Leslie rock, Vanessa rockab, le trio infernal. Voix d'airain dans le velours de la beauté. Les oreilles pour tous, mais les yeux que pour elles, les divas. Augustéennes.
Un concert en tout point dissemblable de celui de jeudi. Même les copines n'ont pu s'empêcher de clamer leur admiration. Comme le reste du public qui s'écoule lentement dans le chimérique espoir qu'elles vont remettre cela. Mais non, plus de deux heures de concert dans une atmosphère surchauffée, il ne faut pas demander l'impossible. Même à nos trois déesses.
Damie Chad.
( Les photos prises sur le facebook des Jallies ne correspondent pas au concert )
LE CRI DE LA BETTERAVE
SOISY-BOUY ( 77 ) / 13 - 09 – 14
SCORES

La Brie atomisée, un petit village de huit cents âmes mais qui se paye son festival comme une métropole régionale. Quatrième édition du Cri de la Betterave. C'est ce qui s'appelle revendiquer haut et fort sa culture. Et je vous prie, pas de jeu de mot vaseux, les habitants de Soisy-Bouy, cette charmante bourgade perdue au milieu des champs, ne sont pas des bouseux mais des boyards. Se débrouillent tout de même pour faire venir quelques milliers de personnes dans cette zone perdue de la France abyssale.
Question orga, rien à redire, quatre euros l'entrée, sandwiches et boissons à prix plus qu'abordables, une bonne ambiance, beaucoup de gens des alentours, vous n'arrêtez pas de saluer de vieilles connaissances. N'y a que pour la programmation que je tique, que je tacle. Sont un peu spécialisés dans les blaireaux. Au comité de sélection il ne doit pas y avoir beaucoup de rockers. Bref, il faut séparer le mauvais grain de l'ivresse. Selon moi, il n'y avait pas photo, sans écouter une seule note sur le facebook des artistes, n'y avait que les Scores qui valaient le déplacement. Peut-être Teho, mais programmé hors de mes possibilités horaires personnelles.
Bête rare sur la betterave, un groupe de hard rock à Soizy-Bouy ! Aussi surprenant qu'un diplodocus au zoo de Vincennes. Z'ont quand même pris leurs précautions. Z'ont prévu d'ouvrir la cage du monstre à la bonne heure, lorsque le soleil décline, et que la file devant le stand à frites avoisine les cent cinquante mètres. A dix-neuf heures cinquante, le gros du public familial a regagné ses pénates, et les noctambules ne sont pas encore arrivés. Bref quand il ne reste plus grand monde dans l'arène dévolue aux artistes. Faudrait pas choquer l'honnête laboureur !
SCORES

Qu'importe, les Scores sont à peine sur scène qu'ils ont déjà marqué un point. Les amateurs de rock durs se sont regroupés, et les jeunes filles accourent. C'est qu'ils sont jeunes, et beaux. Se permettent d'avoir entre quinze et dix-huit ans, sans avoir l'apparence de gamins. Ont de la prestance, pantalon à la David Lee Roth pour le premier guitariste, crinière sauvage et torse nu pour le second. Du batteur Nicolas ne dépasse que la tête, terriblement occupé, mouline sec et à tout berzingue, en place et sans a-coups, ce qui est un comble vu la force de ses coups, on ne le voit pas mais on l'entend et l'on ne tarde pas à comprendre qu'il est le coeur battant du groupe. Benjamin est au micro, perfecto et poses à la Gene Vincent qui attirent les regards, un jeu de scène instinctif mais très théâtralisé. Un vocal, pas ce glapissement de renard poignardé que l'on retrouve chez de nombreux hardos, mais un timbre sonore et mélodieux. Cheveux bouclés qui retombent en oreilles d'épagneuls, t-shirt Airbourne, l'est sur scène comme le squale dans l'océan, en accord parfait avec ses acolytes.

Sont au point. Certes il manque un peu de puissance sonore pour une telle musique– l'aurait fallu que l'orga y pense - mais ils montrent qu'ils ont déjà parcouru un bon bout du chemin. Connaissent leurs séquences. Savent composer. Ont compris qu'un morceau de hard se construit comme un film, une énumération de plans, le tout est de savoir les additionner d'une façon originale, s'agit de surprendre l'auditeur. Sont très forts justement sur les changements. Pas de fondu-enchaînés qui sentent l'amateurisme et dans lesquels les instrument se marchent sur les pieds, sont friands de ses coupures franches, aussi irrévocables que des facettes de diamants. Benjamin se charge de les donner à voir par de brutales interruptions de mouvements qui le transforment en statue de pierre alors que les guitares passent en sourdine, et que par-derrière Nicolas se prépare à ouvrir un nouveau chapitre.

Ont lancé la machine et ne sont pas près de l'arrêter, Benjamin n'hésite pas à descendre dans la foule et Simon nous régalera d'un solo après avoir escaladé l'échafaudage dressé à côté de la scène. Avant dernier morceau, Léo Lee Roth à la guitare sursaturée et Nicolas qui se lance dans un solo de batterie. Moment délicat. Dans un roman, c'est l'instant obligé de la longue description où l'auteur doit prouver qu'il a du style. Sa traversée peut se révéler aussi aride que le Sahara. Ce ne sera pas le cas. Pas le temps de s'ennuyer. Ne lésine pas sur la longueur mais il sait varier les plaisirs, se passe toujours quelque chose. Ne piétine pas sur place. Nous emporte avec lui. Brutal et lyrique.
La nuit est tombée et l'ambiance commence à devenir fabuleuse, c'est à ce moment que l'orga intervient pour signaler qu'il est temps de terminer qu'il ne reste plus qu'un titre avant la cinquantième minute fatidique. L'on obtiendra un morceau en rappel. Mais pas un de plus. Moins d'une heure pour un concert de hard c'est comme si l'on demandait à un orchestre classique de jouer la neuvième en un quart d'heure. Le hard est une musique qui a besoin de volume sonore et d'espace chronophage. Sortent sous les acclamations.
SCORES / ON THE ROAD
ON THE ROAD / HAMMER OF LIFE / LOVE IN HELL / COME BACK TO THE GRAVE.
Benjamin Biot-André : chant / Simon Biratelle : guitare et choeurs / Léo Le Roy : guitare et choeurs / Timothée Wawszcyk : basse / Nicolas Marillot : batterie.
Management : Martial Biratelle . Scores.management@gmail.com
Ont déjà sorti un disque, au mois d'avril 2014, enregistré à L'Empreinte ( normal ils sont des alentours de Melun ) par Eric Patey. Quand je suis allé l'acheter me suis retrouvé au stand entouré de jeunes filles impatientes d'avoir leurs dédicaces. Non, le rock n'est pas mort.

Quatre titres, d'aspect moins rugueux que la prestation sur scène. Un peu plus mélodieux et comme ainsi dire posés, l'on peut ainsi à loisir y entendre la basse de Timothée qui n'a pas été favorisée durant le concert. Très agréable à écouter, de la belle ouvrage. Ont eu la sagesse de ne pas brûler les étapes et de ne pas vouloir donner le brûlot du siècle. Rien n'est plus énervant qu'un pétard mouillé. Scores pose ses bases. Il crée pour apprendre. Ne se précipitent pas la tête la première pour se fracasser sur le mur du son. Ils amadouent la technique afin de s'en rendre maître.
On the road, pétarades de moto et clignotements de musique qui font étrangement penser au Young Man Blues des Who, disons que ça ne va pas plus loin, comme s'ils commençaient par le commencement pour apprivoiser la bête. Hammer Of Life, saut en avant d'une génération, malgré le titre l'on est plus près d'AC / DC que du Dirigeable, sacrément bien foutu, ne se plantent jamais. Sur On The Road ils avaient la manière, avec cet Hammer Of Life ils ont acquis l'art de la forge. Love in Hell, l'équilibre des forces. La voix et la musique. L'écrin et le bijou. La puissance et la lenteur. Le charme et le serpent. Avec changement de paradigme au milieu du gué. La voix se tait et la musique survit dans une espèce de solo collectif, et lorsque les vocaux reviennent à l'unisson, l'on sent que l'on est près pour le grand voyage. Come Back To The Grave, premier essai de démesure hard. Chevauchées de guitares en intermèdes, juste pour nous emmener dans la grandeur lyrique des accentuations dangereuses. Tous les chemins mènent à la mort et notre route est bordée de tombeaux. Souviens-toi que tu dois mourir.

Les premiers pas de Scores sur la chaussée des géants sont prometteurs. L'on ne sait pa jusqu'où ils iront. Mais l'on a envie de les accompagner. On tje road.
Damie Chad.
CRI D'APPEL D'UN BLOUSON NOIR
ANONYMES
( Fayard / 1962 )
Un des rares livres d'époque consacré aux blousons noirs. Présenté dès la couverture comme un document authentique. Suis tombé dessus dans une des boutiques de la douzaine des librairies du village du livre de Montolieu. Au coeur de l'Aude sauvage. Entre parenthèse la moisson des livres traitant de la musique du diable et de ses dérivés s'est révélée extrêmement maigre à la fin de la journée.
Eternel combat entre le bien et le mal ? Toujours est-il que dès la première page de ce Cri d'Appel d'Un Blouson Noir, c'est ce cul-béni de Dieu qui pousse la porte. Pas en personne, l'a envoyé un de ses représentants, désolé ce n'est pas son fils, non un simple prêtre. Joue le joli coeur et le cachotier, ne donne pas son nom. Je l'ai épinglé facilement sur le net, puisque le livre se cache dans la longue liste des ouvrages de l'abbé Marc Oraison. Je lui donne du galon, n'était que prêtre et médecin. Faisait partie de cette phalange céleste de curés plus ou moins ouvriers que l'Eglise envoya à la reconquête des masses laborieuses qui à la mitant du siècle commençaient à se détourner ostensiblement du mignon petit Jésus. Bref un de ses insupportables moralinisateurs qui fourraient leur nez un peu partout. Pour Oraison, sa spécialité c'était le cul des homosexuels et le sexe des jeunes gens. L'on connaît le savoir-faire de ces gens-là – ces empêcheurs de tourner en rond dans les parties carrées – au lieu de condamner et de fulminer en brandissant haut et fort le crucifix, prenaient et prônaient la méthode douce. Vous pardonnent avant que vous n'ayez desserré les dents, s'apitoient sur votre sort, vous blanchissent de toutes vos turpitudes pour lesquelles ils parviennent à fomenter de casuistiques excuses irrémissibles, et s'épandent sur vous dans un torrent de larmes. De crocodiles. Car maintenant qu'ils vous tiennent, ne vont plus vous relâcher, et vont vous remettre sur le droit chemin au plus vite. Ce paragraphe pour tracer un juste portrait de Mar Oraison. Funèbre. Né en 1942, rappelé ( peut-être par téléphone, mais pas assez vite à notre goût ) auprès de son dieu en 1979.
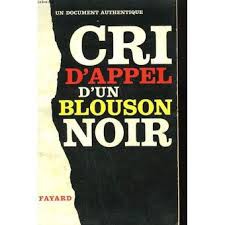
Le livre est à trois voix, chacune affublée d'un pseudonyme. C'est François Dominique – l'on choisit le surnom qui nous idéalise, si Saint François parlait aux petits oiseaux, Saint Dominique mena l'Inquisition contre les Cathares – qui ouvre le bal de charité. Nous parle de l'état de la jeunesse, pas très reluisant, du moins dans les quartiers populaires. N'est pas rare de voir de jeunes désoeuvrés se réunir en bandes dans les squares de Paris. Souvent en jeans et en veste de daim, voire en blousons de cuir, noirs. Ont entre douze et dix-huit ans. Ca crie, ça gesticule, ça se bagarre, ça fuit à l'arrivée des flics. Pas vraiment méchants, mais pas vraiment gentils non plus. Marc Oraison nous demande de ne pas les condamner, ont pour la plupart vécu des enfances déplorables sans amour et sans tendresse. Sont quelques curés à les emmener à la campagne parfois le weekend. Un de ses collègues lui en signale un qui se détache dans le lot, plus renfermé, plus réfléchi et légèrement plus vieux que les autres, qui sera surnommé Moustache.
Un soir Moustache viendra dormir dans le local de Marc Oraison. Reviendra, et petit à petit une confiance s'installera entre les deux hommes. Moustache raconte ses premières années, sa mère, péripapéticienne – comme on dit chez Aristote – au tout petit coeur, qui ne l'aime pas et qui ne se gênera pas pour le lui faire sentir très vite, jusqu'à ce qu'elle se débarrasse de son gamin dans un centre de redressement. N'en ressortira pas brisé, mais plus fort. A dix-huit ans il se retrouvera dans la rue et survivra... Plus tard, Moustache en viendra à coucher ses réflexions sur papier. Ce sont ses feuillets qui constituent le centre du livre, le document authentique, le cri d'appel du blouson noir.
Première déception : Marc sans rime ni oraison, s'invite dans le témoignage. Le texte est constamment coupé par la parole inspirée du prêtre qui développe ses explications à n'en plus finir. Une logorrhée de bons sentiments moralisateurs maquillés sous l'apparente neutralité des analyses sociologiques. Un véritable raseur. De Moustache.
Deuxième déception : notre blouson noir est un intellectuel. Ce qui n'est pas un mal en soi. Mais au lieu d'un poète, un Rimbaud bouleversant qui nous saccagerait l'âme à coups d'images aussi perçantes et tranchantes que la lame d'un cran d'arrêt, nous avons droit à un professeur de fac qui vous pond sa théorie. Ne s'attarde pas sur son cas. Sa chair, son sang, il met tout cela de côté, il traite le sujet en général. Ne confie rien de sa vie, il la justifie. Procédé d'auto-déculpabilisation typiquement christianisé, on ne revendique pas ce que l'on est, on s'en défend en affirmant que l'on n'a pas pu faire autrement. Le blouson noir est une tunique de Nessus qui vous ronge la vie et dont on aimerait tellement se défaire ! Ne me jetez pas la première pierre, auriez-vous fait mieux à ma place !
Faut donc lire entre les lignes pour saisir la substantifique moelle. Décrit bien la bande comme une espèce de tourbillon qui vous attire. En tant que lieu de refuge. C'est un cocon protecteur. Le nombre vous rend plus fort. Et vous redonne confiance en vous. Vous n'êtes plus seul à vous sentir seul. Elle vous donne une identité. Remarquable comme disent les mathématiciens. Désormais vous êtes un blouson noir, une sommité, un hors-la-loi. Mais reconnu par tous. Mais elle vous garde aussi. Le chien errant s'est trouvé une meute. Désormais il répugnera à filer doux, à devenir un mâtin de garde, ou le gardien du troupeau d'un maître. Moustache ne possède pas l'armature de connaissances qui lui permettraient d'assimiler ce refus du travail à une idéologie libertaire et anarchisante. Ne revendique pas le droit à la paresse. N'a aucune conscience claire de l'exploitation. N'aime pas les patrons mais accepte leur existence comme une malheureuse nécessité inamovible. Rétifs mais pas rebelles.
Peu de personnalités. Agissent en groupe. Idem pour le sexe. On passe à chacun son tour sur la même fille. Rien à voir avec une sexualité libératrice et flamboyante. La bande est castratrice et rabote les individualités. Sont incapables de s'affranchir de leur servitude grégaire. Un seul moyen de se distinguer et de se faire reconnaître : la force. C'est elle qui impose la hiérarchie du clan. Avant d'être admis, il faut passer par le baptême de la castagne. L'on ne vous demande pas de gagner, mais de ne pas reculer, et de montrer du cran. De même les bandes se reconnaissent entre elles, de cette façon. On s'affronte, pour se jauger. L'on cherche le respect mutuel. Ces violences apparemment gratuites sont celles qui effraient le plus le bourgeois et les caves. Car elles restent incompréhensibles et peu rationnelles. Pourquoi ces outlaws passent-ils le temps à se casser la figure ? Au lieu de s'en prendre aux nantis. Se contentent de peu, vols de sacs à mains de vieilles dames, petits cambriolages et emprunts de voitures...
Le plus surprenant, c'est le rock. N'en parle pratiquement pas. Dix lignes sur Elvis qui est sévèrement critiqué pour avoir abandonné le rock pur et dur. Et puis c'est tout. Un peu comme si c'était juste la couleur locale, la couche de ripolin sur la façade de la boutique qui vous permet d'attirer le client. Musique adjacente. Le rock n'est pas vécu comme l'ossature primordiale, c'est un bruit de fond. Pas une culture. Pas encore, cela viendra. Dans les années suivantes. Ce n'est pas un hasard si les bandes ne feront plus très vite parler d'elles. En 1964, elles font déjà partie du passé. Un folklore révolu. Le rock dur se replie dans les cités. Dans la marge. Ce sont les fils de la petite-bourgeoisie qui prendront la relève, selon d'autres idoles.
La troisième contribution sera celle de Charles. Un étudiant. En pension chez notre curé. Un jeune venu d'un autre horizon qui se trouve confronté à de bien étranges loulous. On ne peut pas parler d'amitié qui se noue, mais d'une mutuelle compréhension. Moustache sait que Charles possède les clés ( celles de la réussite ) qui ne sont pas accrochées à son trousseau. Charles reste sur son quant-à-soi mais l'on sent poindre en lui une interrogation sur les deux formes de vie qui les attendent. Atterrissage balisé pour lui, une existence déjà sous contrôle. Prend aussi conscience des limites de son futur aseptisé de petit-bourgeois quand il le compare aux zones d'ombres aussi inquiétantes que fascinantes dans lesquelles semble se débattre les jours de son co-locataire. Et même si Moustache possède une expérience de la vie beaucoup plus mature et étendue que la sienne il demeure toutefois un gros point d'interrogation. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. A-t-il réussi à se garer sur les rails du conformisme social, ou a-t-il suivi des sentes apaches, et aventureuses ?
Reste une quatrième section, deux petits textes de Moustache, déjà beaucoup plus personnels dans lesquels il explique son passage à l'acte d'écriture et quatre de ses poèmes parus dans une revue ronéotypée composée et écrite par les jeunes dont s'occupaient la mouvance des prêtres qui tentaient de se rapprocher de ces nouveaux marginaux, éloignés de dieu, mais proches du rock. Moi j'aurais plutôt édité l'ensemble de ses poèmes, c'est beaucoup plus près, beaucoup plus instinctif que sa longue dissertation théorique. Pas Rimbaud bien sûr. Mais déjà le feu de l'adolescence et de la révolte qui couve. Une étincelle. Dans la nuit noire des blousons.
Damie Chad.
BLUE HOTEL / STEPHEN CRANE
( Traduction de Jean-Luc Defromont )
( Editions Liana Levi / 87 pp / 2003 )

Blue Hotel, on a lonely highway,
Blue Hotel, life don't work out my way.
Bigre, un bouquin qui porte le même titre que le célèbre morceau de Chris Isaak, je prends sans réfléchir, sans même l'entrouvrir pour y jeter un coup d'oeil. Vu l'épaisseur je n'y laisserai pas ma fortune et ne perdrai point de temps à le lire. Et puis Stephen Crane, ce n'est pas n'importe qui, l'a eu la bonne idée de naître en 1871 et la mauvaise de mourir de tuberculose en 1900. Bref il a vécu en ces années de formation de la country et du blues. Avant les enregistrements. Un témoin irremplaçable. Question air du temps, peut nous renseigner. La sensibilité ( l'était poète ) aux aguets, les écoutilles de la curiosité ( l'était journaliste ) grand ouvertes.

Le Blue Hotel de Stephen Crane se situe dans le Nebraska, situé au plein centre des Etats-Unis, très loin de l'Est et pas encore l'Ouest. Un entre-deux cher à Bruce Springteen. Mais rien à voir avec l'hôtel du désespoir amoureux de Chris Isaak qui n'est qu'une édulcoration nostalgique de l'hôtel des coeurs brisés d'Elvis. Point de filles en vue. Quatre hommes perdus au milieu de la tempête dans la petite ville de Romper endormie sous la neige. Un étranger un peu bizarre, une partie de cartes sans enjeux financiers qui se termine en pugilat, et c'est tout. Un très grand art de conteur. Impossible de savoir vers où l'auteur veut emmener son récit. L'histoire n'est pas finie. Chacun retourne vaquer à son destin.
Bien sûr l'un d'eux trouvera l'as de pique sur le chemin le plus court. Celui qui mène au cimetière. Mais le drame se passe à l'autre bout de la cité à l'insu des trois autres protagonistes qui n'y sont en rien mêlés. Si ce n'est que par la force des choses chacun des trois s'en sentira en partie responsable. Gros sentiment de culpabilité. Mentalité américaine pétrie de puritanisme. Les hommes ne sont que des marionnettes dans les mains d'un Dieu - que Stephen Crane fils d'un rigoureux pasteur méthodiste se garde bien de nommer - ils interprètent et improvisent un rôle obscur dans une vaste tragi-comédie dont ils ne connaissent ni le sens général, ni la teneur de l'intrigue. La face cachée de l'Amérique. Qui irrigue si bien les mentalités de ses citoyens. Ce vieux fond réactionnaire dont on retrouve l'idéologie rétrograde dans les paroles de nombreux morceaux country.
Damie Chad.
PAVANE POUR UN GROUPE DEFUNT
HEWITT
SACRED HEART

C'est un copain qui m'a refilé l'objet. J'ai essayé, mais je n'y sois pas arrivé. L'est tout neuf. C'est le bassiste qui me l'a offert. Je le connais bien. N'ont fait qu'un seul disque. Mais ils se sont dissous, pas pour dissensions musicales, question de rythme d'emploi du temps. Et il m'a refilé le bébé. Dans la main. J'ai tout de suite eu un sacré coup de coeur pour la pochette. Belle guerrière nordique aux longs cheveux blonds en petite tenue. A l'intérieur c'était encore mieux, les yeux révulsés, en extase comme si plus bas une langue s'affairait sur son clitoris. Mais ce n'était pas ce que je croyais. Pas le chemin de jouissance vers la petite mort, mais le passage vers la possession de la grande. Tout de suite, ça jette un froid.
Pouvez jeter un coup d'oeil sur les lyrics. En anglais, je vous traduis les deux derniers, la sensation de silence, c'est ce que j'ai toujours recherché. Je veux bien, mais tout ce qui précède pourrait être résumer en quelques mots, violence, vitesse, sexe, diable, destruction... Un programme un peu hard. Parfait pour les serial killers. Je comprends le copain, c'est un fan de Depeche Mode ( je ne plaisante pas, ils existent ) Hewitt c'est un peu trop voisin de Evil. Phonétiquement. C'est aussi le nom du héros de Massacre à la tronçonneuse. Avec un patronyme de cet acabit, faut pas vous attendre à un recueil de Nursery Rimes.
91:10 / Heart Lies / Dying Alive / Anthem / Vultures & Crows / Till Death Do Us Part / Fastlane / Taking On Mute I / Taking On Mute II / Melt / What We're Made Of / You'll Never Forget / Voices.
Jay Berast : Vocals / Fabrice Ferry : Bass / Fred Ceraudo : Drums / Brieuc Badin : Guitars / Victor Felletin : Guitars.
Enregistrement : Charles Massabo / Val Gilbert.
La musique est à la hauteur de la pochette. Le groupe s'est formé en 2007 mais le disc est sorti en 2010. Ont pris soin de rôder les morceaux sur scène. Qualité supérieure. Pour l'appréciation les avis divergeront. Des petits froggies qui imitent avec dix ans de retard l'american metal hardcore ou à l'inverse, enfin des français capables de jouer sans qu'on ait à rougir dans la cour des grands. Me rangerai plutôt dans le deuxième camp. Fred Ceraudo fut aussi le batteur de Pleymo, qui se sépara en 2007. Hewitt était un projet ambitieux qui a capoté un peu trop vite. La parution du CD ne fut pas accueilli par des louanges unanimes. En notre pays, l'on n'aime guère les têtes qui prétendent dépasser... Mais le groupe est mort de lui-même. Après avoir accouché d'un enfant bien portant dont à ma connaissance aujourd'hui personne ne se réclame.
Le scud se présente comme un long cri de peur, de haine, de désespoir, peut-être les composantes essentielles de ce que l'on appelle l'amour mais que l'on ferait mieux de nommer la possession de l'autre par le même. Le miroir ne supporte pas que l'image qu'il renvoie soit identique à lui-même. Ce qui explique pourquoi la voix humaine brise le cristal le plus pur. Ne transige jamais sur cette abominable pression de l'intérieur de l'être humain exercée sur la nudité offerte du monde supérieur.
Jay Beral chante comme la panthère noire roucoule, de cette voix de gorge qui fait frissonner, et qu'elle module, lorsqu'elle tourne autour de sa proie, avant de lancer l'attaque et de la saisir à l'encolure. Là où les vertèbres sont les plus fragiles. Guitares et batterie orchestrent le rapt. Sont à l'unisson de cette approche carnassière de la vie. Charles Massado de Los Angeles a su leur donner le son. Rien qui dépasse ou qui fleurerait l'amateurisme. Une véritable production digne de ce nom. Ce qui manque à beaucoup de disques français, une approche en quelque sorte culturelle du traitement du son enté sur une vision intelligente du rock.

Mais la malédiction du roc français a encore frappé. Un coup d'épée dans l'eau, même si celui-ci avait trempé le fil d'un métal le plus dur. Split dès 2011.
Damie Chad.
20:09 | Lien permanent | Commentaires (0)
10/09/2014
KR'TNT ! ¤ 200 WANDA JACKSON / TOM CATS / SHERRY BB / SWINGING DICE / JAKE CALYPSO AND THE RED HOT / MARC AND THE WILD ONES / JALLIES / BOBBIE CLARKE / VINCE TAYLOR
KR'TNT ! ¤ 200
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
11 / 09 / 2014
|
WANDA JACKSON / TOM CATS / SHERRY BB / SWINGING DICE JAKE CALYPSO & THE RED HOT / MARC & THE WILD ONES JALLIES / BOBBIE CLARKE & VINCE TAYLOR |
BETHUNE RETRO / 30 & 31 AOÛT 2014
UN POISON NOMME WANDA

Wanda Jackson a traversé la légende du rockabilly comme une comète, avant de revenir comme tous les autres à la country, par simple réflexe de survie. Mais ce qu’on admire le plus chez Wanda, c’est peut-être sa relation avec l’Elvis de la grande époque. De 1955 à 1957, elle eut l’immense privilège de fréquenter Elvis et de tourner avec lui. Elle allait chez lui, ils s’enfermaient dans sa chambre et Elvis lui montrait sa collection de disques de blues. Ça impressionnait la petite Wanda. Elle voyait bien qu’Elvis s’inspirait de cette musique de nègres. En plus, il roulait des hanches devant elle et ouvrait largement sa chemise pour s’aérer la poitrine. Elle ne savait plus comment dissimuler son embarras. Il faisait une chaleur à crever dans cette chambre. Elvis lui disait de se mettre à l’aise. Mais elle ne comprenait pas. Elle ne savait encore rien de la vie. Quelle chaleur, dear Elvis ! Alors, elle lui demandait des verres d’eau. Il allait remplir le verre au robinet de la salle de bain et revenait en lui faisant des compliments. Il s’approchait d’elle et les murmurait à son oreille. Ça lui donnait le vertige. Quoi, chanter cette musique de nègres ? Mais j’en suis incapable, dear Elvis ! Alors Elvis la saisissait par les épaules et la secouait comme un cocotier pour lui dire : Mais si, honey bee, tu peux chanter le blues et shaker the chicken !

Elvis s’était montré assez persuasif et Wanda décida de tenter le coup. Elle avait un orchestre et à l’occasion de petits concerts dans les salles des fêtes locales, elle testa «Let’s Have A Party». Le pire c’est que les gens adoraient ça. Elle n’en revenait pas. C’était déjà une reprise d’un morceau d’Elvis figurant sur la bande originale du film «Loving You», mais elle poussait le bouchon un peu plus loin, en chantant comme une méchante garce, ce qui était sans précédent aux États-Unis. On peut dire que Wanda fut la première vaurienne de l’histoire du rock. Et les Américains n’étaient pas du tout préparés à ça. Une fille qui chante du rock de voyou ? Les garçons avaient déjà beaucoup de problèmes avec les ligues de moralité, alors une jeune fille non émancipée, on imagine le délire des ligues de mal-baisées.
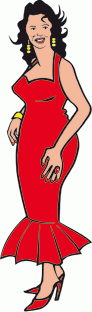
Capitol la prit sous contrat, mais avec des pincettes. Quand elle sortait un single de rockab, on mettait de la country en face B. Lorsqu’elle vint jouer au Grand Ole Opry, on lui demanda de couvrir ses bras nus. Mademoiselle portait une robe sans manches. Vous imaginez le scandale, à Nashville, en 1957, au cœur du pays le plus réactionnaire du monde ?

Mais grâce à un producteur qui l’avait à la bonne chez Capitol, Wanda réussit à enregistrer quelques beaux classiques de rockab et notamment «Fujiyama Mama» qui fit un carton au Japon, un pays qui sortait de la guerre et qui avait pris deux bombes atomiques sur le coin de la gueule. Le plus drôle de cette histoire, c’est que dans les paroles de Fujiyama, Wanda promettait des ravages bien pires que ceux de Nagasaki et d’Hiroshima. Comme les Japonais n’avaient pas le même sens de l’humour, la chanson est passée comme une lettre à la poste. Certains vont même jusqu’à insinuer que les Japonais n’écoutaient même pas les paroles de Fujiyama.

Le premier album de Wanda édité par Capitol est d’un ennui mortel, sauf si apprécie la country bien sirupeuse. Elle tape dans deux ou trois classiques du rock comme «Long Tall Sally» ou «Money Honey», mais on préfère nettement les versions originales. Elle se prend trop pour Elvis et ça coince un peu. «Let’s Have A Party» et «I Wanna Waltz» sont les deux grosses pièces de cet album un peu mou du genou. Dans Waltz, elle casse un rockab bien slappé parce qu’elle préfère danser la valse.

«Right Or Wrong» qui paraît en 1961 est encore pire. Une véritable catastrophe. C’est de la country mielleuse et inepte. Déniché à Londres dans un second-hand shop pour un prix symbolique, l’album fut aussitôt revendu. Aujourd’hui encore, de malheureux collectionneurs vont aller se ruiner pour récupérer une copie propre sur Capitol.

La même année paraît «There’s A Party Goin’ On». Wanda chante du nez et fait sa mauvaise carne, comme si elle voulait semer le désordre dans un quartier résidentiel. Elle manque de crédibilité. On essaie de la faire passer pour un Eddie Cochran au féminin, mais ça ne marche pas. Sa version de «Kansas City» est bien trop pop. Petit conseil, écoutez plutôt la version de Little Richard. La moutarde lui monte au nez avec «Tongue Tied» et elle fait du Walt Disney avec «Tweedle Bee», une pièce de kitsch atroce et tellement ridicule qu’elle finit par capter l’attention. Le seul beau cut de l’album est «Sparkly Brown Eyes» qu’elle chante dans l’Amérique des années 50. Cette fois, elle maîtrise parfaitement sa glotte et livre une chanson inspirée.

S’il faut conserver un album de Wanda, c’est bien «Rockin’ With Wanda», paru en 1962, soit quelques années après la bataille. C’est là que se nichent tous ses gros hits rockab comme «Fujiyama Mama» (vrai bop au féminin, elle glousse comme une dinde et derrière ça slappe dans la profondeur - son de rêve et pulsion rockab bien ronde) et «Honey Bop» (bop à l’état pur, elle tape dans la modernité du bop d’alors, slap fabuleux, elle chante pointu et sort une version énorme). On trouve aussi d’autres belles choses sur cet album, comme par exemple «Cool Love». Roy Clark y balance un killer solo émancipé aux clap-hands. On sent dans ce cut une certaine grandeur intestine. Elle swingue «Hot Dog ! That Made Him Mad» à la vie à la mort. Elle pitche son rockab à point. Encore une pure merveille avec «Baby Loves Him» qu’elle embarque avec une belle ferveur et encore une fois, Roy Clark vient troubler les esprits avec un killer solo. Cut magnifique et ravageur que ce «Mean Mean Man», tellement rauchy dans la démesure qu’elle s’arrache tout.
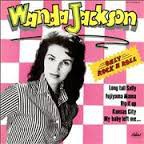
En général, les compiles qui lui sont consacrées sont bien foutues et les pochettes tapent à l’œil. Alors, autant y aller directement. «Only Rock’n’Roll» et «Rockin’ Party» sont sorties longtemps après la bataille, mais elles permettent de retrouver le chanté du nez de «Let’s Have A Party», le petit boogie ravageur de «Mean Mean Man», l’excellent «Fujiyama Mama» farci de hoquets et l’admirable «Honey Bop» boppé jusqu’à l’os du genou, bien senti et joué minimaliste. Elle ose aussi taper dans des classiques intouchables comme «Kansas City», «Honey Don’t», «Whole Lotta Shakin’ Going On» et «Rip It Up», mais elle aurait mieux fait de s’abstenir. Même avec sa voix de nez pincé, ça ne passe pas. On remarque au passage l’excellent travail de Roy Clark dans «Savin’ Me Love», et voilà, on peut dire qu’on a fait le tour.

Wanda retourne ensuite à sa chère country, puis elle se convertit au christianisme pour enregistrer du gospel. Pas facile de rester une légende. C’est probablement le métier le plus difficile de tous. Surtout quand on vit aussi longtemps. Elle atteint aujourd’hui l’âge canonique de 77 ans, mais il n’est pas question pour elle de partir en retraite. Oh no no no !

Elle fit en 2003 un retour rockab fracassant avec «Heart Trouble», un album très intéressant sur lequel s’étaient invités Lux et Ivy des Cramps. Ils firent avec elle des belles versions explosives de «Funnel Of Love» et de «Riot In Cellar Block #9», deux véritables coups de maître. Pour Lux, c’était une façon de rendre hommage à l’une de ses idoles. Dave Alvin des Blasters jouait avec un son énorme sur «Woman Walk At The Door» et «Rockabilly Fever». Wanda tenait bien les rênes de sa monture car ça swinguait furieusement. Par contre, on n’était pas très content de voir l’autre Elvis - le Costello - taper l’incruste pour faire son pauvre petit numéro de m’as-tu-vu opportuniste. Wanda nous refit aussi une belle version de son vieux «Mean Mean Man» avec Larry Taylor de Canned Heat à la basse et Randy Jacobs à la guitare. Un pur régal.

Un autre album du grand retour parut en 2010 : «The Party Ain’t Over». Wanda avait 73 ans. Après Costello, elle se mit à fricoter avec Jack White. Quand on lit les crédits sur la pochette, la première chose qu’on remarque, c’est qu’il met son nom partout : Jack White III. C’est tout juste s’il n’a pas mis sa photo sur la pochette (comme il a osé le faire sur la pochette intérieure d’un album live de Jerry Lee enregistré à Nashville pour son label). Alors on écoute cet album avec la plus extrême méfiance. Et paf, ça commence avec «Rip It Up», il arrive avec sa guitare et gâche tout. Il est incapable de la moindre modestie. À la limite, le seul bon morceau de l’album, c’est «Rhum And Coca Cola» car White n’y est pas. Sur certains morceaux, Wanda chante comme une vieille sorcière de Walt Disney. Sur «Nervous Breakdown», elle se prend carrément pour Eddie Cochran. Elle redevient la délinquante des bas-fonds de l’Oklahoma. La mémé se prend pour la voyoute du coin de la rue et ça devient extraordinaire de concentration vocale. Elle retrouve l’esprit d’Eddie et White qui n’a jamais rien compris à rien vient jouer un solo de guitare seventies qui n’a rien à voir avec l’esprit du morceau. C’est d’une prétention insupportable. Il ruine cette reprise magistrale. L’horreur totale. Le pire de tout, c’est qu’avec ce disque, il a essayé de faire passer Wanda pour une chanteuse à la mode. Et là, on atteint les tréfonds de l’abomination. Car Wanda Jackson n’a pas besoin de White pour être une star.
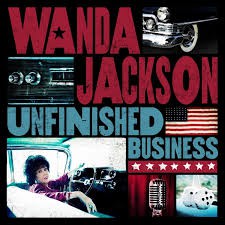
Heureusement, Wanda a choisi en 2012 une autre équipe pour enregistrer «Unfinished Business», et là, on renoue avec le très haut de gamme. Son énorme et beat rentre-dedans sur «Tore Down». On voit bien qu’elle tient son rang de reine du rockab avec «The Graveyard Shift», un cut admirable à bien des égards et elle nous balance ensuite une belle version de «It’s All Over Now». C’est vraiment bien appuyé, tapé au beat, joué à la nashvillaise avec un jeu sobre, purement américain. Avec «Two Hands», elle fait slapper sa country et nous fait cadeau d’une grosse pétite avec «Old Weakness (Coming On Strong)», un fantastique groove de la frontière, claqué à la note de solo. On sent la Telecaster en bois et Wanda la reine du saloon chante pour les trappeurs et les apothicaires itinérants. Elle chante un peu du nez et appuie sa surenchère - Ooooh weakness ! - Véritable pièce de juke d’antho à Toto. Avec «Down Past The Bottom», elle pourrait en remontrer à Jerry Lee. La mémère tient bon la rampe. Et elle finit avec un très beau «California Stars». C’est avec «Rockin’ With Wanda» son meilleur album. Allez-y les yeux fermés.

Alors évidemment, on s’était tous rendus à Béthune pour l’acclamer. Mais les choses ne se déroulèrent pas du tout comme prévu. Pour une fois, le soleil brillait. Une véritable fournaise. Et comme le soleil brillait, la place du beffroi devint très vite impraticable à cause de l’immense foule qui venait assister au défilé des voitures de collection. Wanda devait jouer à 17 heures et une véritable marée humaine rendit très vite toute progression impossible. Nous fûmes repoussés vers la porte d’un restaurant et contraints de nous y installer. Que peut-on faire d’autre que de siffler des bières et du vin, et de tuer le temps en racontant des conneries à table ? Tout espoir de pouvoir regagner la grande scène s’était volatilisé. On voyait des corps entassés sur trois ou quatre mètres de hauteur à travers la vitrine du restaurant qui par miracle résistait encore à la pression de cette marée humaine. En comparaison, Woodstock c’était de la rigolade. On entendait les pétarades des bikers et les vroarrrrrs des dragsters se mêler aux hurlements des badauds piétinés et aux sirènes des voitures de police et des ambulances. Un vieux réflexe aristocratique nous commandait de boire pour ignorer le chaos.
Signé : Cazengler, le Wandale
Wanda Jackson. Béthune Rétro. 30 & 31 août 2014
Wanda Jackson. Wanda Jackson. Capitol Records 1958
Wanda Jackson. Right Or Wrong. Capitol Records 1961
Wanda Jackson. There’s A Party Goin’ On. Capitol Records 1961
Wanda Jackson. Rockin’ With Wanda. Starline 1962
Wanda Jackson. Only Rock’n’Roll. Capitol Records 1978
Wanda Jackson. Rockin’ Party. Combo Records 1993
Wanda Jackson. Heart Trouble CMH Records 2003
Wanda Jackson. The Party Ain’t Over. Third Man Records 2010
Wanda Jackson. Unfinished Business. Sugar Hill Records 2012
TOURNEFEUILLE ( 31 ) / AMERICAN DAYS
LE PHARE / 22 – 23 AOÛT 2014
SHERRY BB / TOM CATS
JAKE CALYPSO AND THE RED HOTS
SWINGING DICE / MARC AND THE WILD ONES

Ne changez pas de page, vous venez de tourner la bonne feuille. La dernière fois que je suis allé à Tournefeuille je me souviens de champs s'étendant à perte de vue. Je n'ai pas une conscience écologique bien élevée mais je dois reconnaître qu'ils ont arraché les brins d'herbes pour les remplacer par d'infinies constructions de ciment... Le charmant village s'est transformé en un indistinct quartier suburbain de la mégalopole toulousaine. Si j'en crois le flyer que me tend ma copine Patou, ils auraient même construit un phare. A cent cinquante kilomètres de la mer cela me semble étrange. Mais tout s'éclaire lorsque nous touchons au but. Le Phare ainsi dénommé est une salle de spectacles des plus parallélépipédiques et des moins turgescentes, ouf merci, avec le crachin fluide qui menace et le petit vent frais qui cingle par intermittence, se retrouver à l'abri ( point côtier ) s'annonce comme un parfait privilège.
Rien que le prix d'entrée nous réchauffe le coeur, trois euros pour deux soirs, c'est à ne pas y croire, mais une fois la voiture stationnée sur le vaste parking, nous mesurons l'ampleur du désastre. La scène est dressée à l'extérieur en plein courant d'air. Toutefois il en faut plus pour abattre un rocker. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, que la collection de voitures vintages se réduit à six véhicules et se termine en maigrichonne queue, pas de poisson vorace, mais d'Aronde bonasse, heureusement la baraque à frites est accueillante, la bière est fraîche, le café brûlant, les stands de disques regorgent de trésors et les filles lorgnent déjà du côté des marabouts à vêtements. Un public différent de celui qui hante les similaires festivités de la région parisienne : moins de cuirs, davantage de jeunes. Un maximum de clubs de danse.
TOM CATS
Depuis le temps que j'aperçois leur nom sur Rockarocky suis enfin heureux de les voir de près. Passent systématiquement dans toutes les villes ou villages situés en-dessous de la Loire. Aussi ai-je décidé que puisque les Tom Cats ne venaient pas à moi, j'irai à eux. Manière d'examiner la portée de ces sudistes matous. Kit minimal de survie : guitare, basse et batterie. Economie des moyens. Plus grande devra être l'énergie déployée. Vont nous faire oublier la pluie. A coups de standards. A coups de pionniers. Rien de surprenant mais de la belle ouvrage. Convaincants et Tomvaincats.
Gretsch ardoise, costume anthracite et chemise blanche, pour la lead guitar et le chanteur. Tête rasée, gilet fauve, pantalon daim, pour Fred contrebassiste, tous deux tapent dans le chic anglais, la britannique impeccabilité, le batteur Pat déjà plus roots avec sa chemise country rouge et noire, ses avant-bras chamarrés de tatoos flamboyants. Enchaînent les tubes les uns après les autres, imperturbables, mais voici qu'ils nous promettent une surprise, et s'écartent l'un de l'autre pour laisser place à...
SHERRY BB

la cerise sur le gâteau, l'effeuilleuse rockabilly, la pin up dévergondée, qui n'hésite pas à nous dévoiler les appâts d'une chair sculpturale. Chacun et chacune n'en pense pas moins mais regarde à qui-mieux-mieux. Hypocrite lecteur comme disait Baudelaire dont la très chère était nue et n'avait gardé que ses bijoux. Les féministes pourront toujours s'élever contre cette consumération sensuelle de la femme considérée comme un des beaux arts, il y aura toujours des voyeurs pour relire les fleurs ( vénéneuses ) du mâle. Se dépouille de ses colifichets, nous aguiche d'un cygne d'ailes d'artificielles plumes, remue un cul charnu comme l'autruche qui l'exhausse en se cachant la tête dans le sol, dévoile en nous souriant la plastique redondante de ses seins globés, agrémentés en leur mignard téton d'un pompon à glands, tel que l'on en trouve dans les lits à baldaquins relégués au fond des secrètes alcôves de nos concupiscences réprimées, rut contenu de femelle emmitouflé dans un corps de femme. Chic et kitch. Choc et toc. Offrande voilée d'un sexe que l'on exhibe sans le montrer. Tout se passe dans la tête. Mens insane in corpore sano. Sherry BB est l'exact reflet que projette le miroir impuissant de notre âme. Arabesque des formes sinuantes, grotesque des efforts désirants. Dé-cul-palbilisez-vous. Le rock et la drogue du sexe ont toujours fait bon ménage. A trois. Sherry BB, le femme-tasme par excellence.
TOM CATS
Dernière note de l'instrumental et Sherry BB s'évanouit dans l'escalier nous laissant seuls avec les Tom Cats. Enchaînent aussitôt en vieux briscards habitués à de telles festives efflorescences. L'en faut plus pour les émouvoir. Nous resservent leur rock marmoréen sculpté aux scuds des classiques ( Vincent, Cochran, Feathers et toute la bande... ). Pat envoie à fond les caisses et Fred use de sa contrebasse comme d'une guitare, en a plein les bras mais n'oublie pas de swinguer avec la précision d'un métronome endiablé. Je n'ai pas le prénom du chanteur mais lui possède un répertoire inépuisable. Voix plastique et infatigable qui se plie à toutes les inflexions exigées, du rififi dans les rifs qui défilent comme à la parade. S'en sort joliment bien. Je rappelle qu'il n'est pas à la rythmique – cette fonction est assurée par Fred - mais à la lead. Un jeu précis qui ne se perd pas en bavardages inutiles. Néo-rockabilly ? Rappelons que les TomCats furent le premier nom des matous efflanqués de Setzer, si vous voulez, mais avec le plateau de la balance qui oscille un tantinet davantage du côté billy que rockab, à mon humble oreille. Z'en tout cas le public en redemande et l'orga enchantée leur proposera de prolonger le rappel. Ce dont personne ne se plaindra. Nous les tom-catalaguerons comme une belle découverte.
JAKE CALYPSO AND THE RED HOTS
Jake Calypso and The Red Hots, ce n'est pas comme dans En Attendant Les Barbares de Constantin Cavafy, l'on est sûr que la horde sauvage va débouler et que même l'on n'aura pas longtemps à attendre. L'on profite des derniers réglages de sono pour zieuter le petit nouveau, Guillaume, tout jeune, tout beau, sous sa casquette plate à la Blue Caps, pour le moment il se tient tranquille à côté de sa contrebasse. Non, c'est déjà parti, Patrick aux drums vient de siffler le coup d'envoi et déjà Christophe envoie un riff - à faire barrir un éléphant de colère – entre les poteaux du camp adverse. Ne cherchez pas Hervé Loison, l'est en train de se faire refiler en douce une timbale de Jack Daniel, qu'il pause précautionneusement sur l'ampli le plus proche de lui avant de s'emparer du micro. Avec sa guitare en bandoulière, sa veste et ses cheveux tirés en arrière, l'a tout l'air d'un gentleman-farmer qui va vous interpréter une doucereuse ballade de folkleux foireux à faire pleurer les grand-mères.
Pas même le temps de raccompagner les mémés à l'hospice, c'est trop tard, le Hot Rod est en flammes, l'étable est en feu, et Jake Calypso totalement inconscient de la gravité de la situation profite de l'occasion pour pousser la tyrolienne, imiter le caquètement des poules affolées et parfaire le grognement du porc monté sur sa truie et au comble de la jouissance. C'est un peu les animaux de la ferme en folie, la grande jakerie de la basse-cour de derrière les fagots. L'en rajoute avec des rasades de tagadas sans tsoin-tsoin qu'il balance dans son micro comme s'il agitait un drapeau pirate. Vous plaque quatre ou cinq morceaux du même acabit et puis décide de jouer le mec sérieux. Un slow, annonce-t-il, sans doute veut-il nous faire comprendre qu'il est un mec hyper cool qui sait moduler les progressions. Autant vous rassurer tout de suite, c'est raté. Totalement, ou alors c'est un slow qui échappe à tout contrôle, un slow de pénétration ardente lorsque votre cavalière, collée à vous, debout et dument embrochée ne peut plus retenir ses frémissements extatiques de son arrière train. Parce qu'au train appuyé où le Hot Rod dégomme ses arpèges, ça coule à fslowt bouillonnant de torrent. Toujours aussi pince sans rire, c'est maintenant la minute d'émotion pure, en quelques mots Jake Calypso évoque sa visite du studio Sun, mais là encore il n'a pas su se tenir. L'a enregistré une reprise du King – l'était pas encore le roi mais l'allait le devenir rapidement – et plank il nous jette une reprise de That's All Right Mama, à vous en faire retourner l'Elvis dans sa tombe. Un peu comme si vous essayez de faire tenir un alligator vivant dans un cercueil.
Mais il est temps de relâcher la bête, pas encore dans le public, car il y a des barrières de protection, mais dans le no man's land encagé par une orga par trop précautionneuse. Par étape. D'abord il s'agenouille sur la scène ( du meurtre ), puis s'y couche, et se penche dangereusement allongeant son torse au-dessus du vide. Une dernière reptation ventrale et le voici affalé sur la grille métallique, le public se rue sur l'idole, l'encourage, le congratule, le touche, le palpe, le caresse, l'exhorte de la voix, plus près de toi mon dieu comme l'orchestre du Titanic, un brouillamini de deux cents personnes hurlantes qui le soutiennent moralement, et physiquement puisque l'on lui glisse une fiasque de whisky entre les lèvres et les filles ne se gênent pas pour l'embrasser.
Mais monsieur Hervé Loison, ne mange pas de ce pain là, remonte sur scène et en homme responsable, en grand prêtre du rock and roll, qui se préoccupe de la santé physique de ses ouailles – je tiens à alerter les âmes sensibles que tout ce qui va suivre risque de choquer certains enfants de plus de soixante-dix ans – il nous invite puisque la pluie recommence à tomber à nous mettre à l'abri et à le rejoindre sur scène. On ne se le fait pas dire deux fois, et une trentaine de personnes – j'en suis – prennent d'assaut la malheureuse tribune.

Diabolique pandémonium ! Le Hot Rod pris d'assaut, plie mais ne rompt pas. Accélèrent le rythme. Folie générale. Ça danse, ça tangue, ça se trémousse, ça crie, ça rocke et ça rolle dans tous les coins, dans tous les sens. Christophe Gillet reçoit du renfort, lunettes à la buddy et cheveux noirs qui dépassent sous son chapeau un nouveau guitariste branche son jack, Vickor Huganet in person, si j'ai bien perçu dans le tumulte la présentation de Jake Calypso ce serait le jour de son anniversaire, mais Jake est reparti en bas dans la foule, il a abandonné le micro – dont je m'empare pour hurler tel un loup fou possédé par le diable des carrefours sous la lune – a droit à une nouvelle et longue goulée de whisky, ce qui lui donne la force de faire le poirier sur la barrière avant d'être enlevé par la foule en délire qui lui fait visiter le pays avant de le ramener à bon port. Un dernier morceau pour la route, mais comme elle promet d'être longue, Calypso nous gâte de quelques phénoménales provendes avant de nous laisser, brisés, moulus, tels des fétus de pailles qu'un tsunami rock n'a pas réussi à disperser. Merci aux Hot Rod qui furent merveilleux et au grand Jake qui nous a entraîné dans un calypso rock démoniaque.
DEUXIEME SOIREE
L'on nous a changé la couleur du bracelet et nous sommes rentrés dans l'arène. L'a fait soleil toute la journée. Samedi soir, la différence saute aux yeux. Beaucoup de monde, des motos de bikers à la pelle – je suis reconnu par deux membres du Club 931 de Chavin ( voir KR'TNT ! 173 du 18 / 01 / 14 pour le compte-rendu de cette soirée mémorable ) - la collection de voitures s'est intensément agrandie, et l'American Days porte désormais bien son nom. Patou qui ne s'est pas toujours remise de la tornade Calypso photographie plein pot. Mais il est temps de retrouver les Swinging Dice, retrouver, car la veille ce fut une agréable surprise de tomber parmi les spectateurs sur Mathieu et Fabien qui officient aussi dans les Subway Cowboys et de les rencontrer à nouveau l'après-midi au centre ville chez un disquaire devant une ruineuse collection de vinyls de blues. Un rêve, en delta plane.
SWINGING DICE
Sont sur scène, Fabien à la guitare sur notre gauche, à droite Pierre assis devant son Roland, Julien au fond à la batterie, et chose rare pour une contrebasse Mathieu au centre. Les dés qui swinguent ne sont pas un groupe rockab mais une formation swing. La meilleure définition du swing – cela peut paraître étonnant – a été donné à Paul Valéry par Albert Einstein lors d'une conversation privée comme le rapporte le poète d'Insinuant 2.
Pour bien faire entendre sa théorie de la relativité le physicien décrivait la nature comme un morceau de caoutchouc sur lequel l'on s'acharnerait à volonté, l'étirant, le compressant, selon tous les azimuts de la boussole, et en plus vers le haut et vers le bas. Qu'importe la forme que vous lui infligeriez, dans toutes les positions imaginables et inimaginables le morceau de caoutchouc malgré tous ses avatars garderait tout de même sa nature de morceau de caoutchouc.
L'en est de même pour le swing. Prenez quatre musiciens et jetez-leur une quelconque phrase – par exemple une intro de Nat King Cole - musicale entre les pattes, le premier qui s'en empare se dépêche de vous l'exposer en long et en large, mais rien ne sert d'être égoïste, pour ne pas ennuyer le spectateur l'on se dépêche de refiler le morceau aux copains – c'est là toute la différence entre le swing et le jazz dans lequel le virtuose essaie de faire joujou le plus longtemps possible avec la bestiole – et très logiquement que de la théorie de la relativité restreinte l'on passe à celle de la patate chaude, elle vous brûle les mains vous déployez des trésors d'ingéniosité pour la garder entre vos paumes mais très vite, vous vous en débarrassez en faveur du premier quidam à votre portée qui entreprend son petit jonglage personnel avant de la refiler à un autre larron... Et ainsi de suite. L'ovale du rugby dont l'équipe fait avancer la ligne mélodique en le ramenant en arrière par une passe rythmique du meilleur aloi.
N'empêche que Valéry qui s'y connaissait en rythmiques syllabiques – si vous ne croyez pas allez chatouiller de près l'horloge atomique d'un simple alexandrin – ne put s'empêcher d'objurguer au grand Kolossal Professor, qu'il fallait tout de même s'inquiéter de la nature du dit morceau de caoutchouc avant de le livrer aux derniers outrages d'une distorsion aléatoire. Ce que vous-mêmes, chers lecteurs n'avez pas manqué de remarquer lorsque je vous donnai la composition des Swingind Dice. Je vois vos sourcils en point d'interrogation. Comment un orchestre de swing sans section de cuivres ? N'est-ce pas une imposture ? Glenn Miller sans trompettes n'est-ce pas une starlette sans maillot de bain ? Et Louis Jordan sans trombones , un baiser sans moustaches ? L'est vrai que depuis Beethoven le piano est capable de remplacer à lui tout seul tout un orchestre, l'existe bien le piano-boogie, le piano-rag, le piano-jazz, et le piano swing, mais imagine-t-on la chevauchée des Walkiries sans la rutilance du pupitre wagnérien des cuivres !
Faudra vous y faire les amis. Car les Swinging Dice ont laissé la fanfare à la maison. Et le pire c'est que l'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Suffit de suivre. C'est aussi rapide et dévastateur que Woody Woodpeker. Les Swinging Dice ça se regarde autant que ça s'écoute. Pierre deux fois plus que les autres car il chante en même temps qu'il malmène son clavier. Attention, les copains appuient souvent de la voix ses effets, tous ensemble ou un par un, car l'un entraîne l'autre. Mécanique de précision, comme ces chaînes de morceaux de sucre dont la chute de l'un entraîne la chute de l'autre et cela à l'infini. Une balle de ping pong qui rebondit dans une partie de deux équipes de double. Mais ici, ça ne tombe jamais à côté et chaque point est marqué conjointement par l'ensemble des joueurs.
Esprit de groupe, ce qui n'empêche pas les mini-challenge, Fab qui répond à l'unisson d'un quart de seconde de retard au dernier battement de Julien sur sa caisse claire, et pendant que les deux autres s'activent, Julien en rajoute toujours un que Fab reprend comme d'un revers de raquette. Genre de musique par excellence où vous ne pouvez pas vous cacher dans le nombre, c'est chacun son tour et l'idée consiste à se surpasser et à pousser l'autre toujours plus loin. Le conduire jusqu'à plus soif, jusqu'au moment crucial où le voici acculé dans le tunnel du solo en même temps obligatoire et libératoire. Se pourrissent la vie pour mieux nous gâter, Pierre debout qui trucide l'ivoire ( plastifiée ) de ses touches, Julien qui balaie ses toms à leur donner une maladie de peau, Mathieu impérial qui nous délivre de ses soli genre charge héroïque au Pont d'Arcole, ses mains rebondissent sur les cordes de la contrebasse qu'il étire comme s'il devait s'adonner au saut à l'élastique, et Fabien qui se joue de sa guitare avec tant d'aisance que l'on se dit que c'est un instrument que l'on doit maîtriser en trois jours, sans beaucoup de peine.
De parfaits musicos. En plus ils sont malins. Parce que en définitive rien n'est plus ennuyant que le swing. La perfection, on finit par s'en lasser. Alors ils ont bien le swing mais ils ont pris garde d'ajouter les six double faces des dés de la chance et du destin. Donc un coup ils zinguent dans le swing pur, mais après ils sont prêts à toutes les compromissions, les voici qui beuglent dans le boogie, qui frôlent le stroll, qui hoquètent dans le rock, qui s'enrôlent dans le roll, qui maçonnent dans le madison, qui dropent dans le bop, qui surprennent à contre-pied la flopée de danseurs qui ravis de l'aubaine essaient de s'adapter à ces incessants changements de tempo. Jouent, des classiques à la Caldonia ou des compos personnelles ( très belles ), à un, à deux, à trois, à quatre, chacun leur tour et le désordre, jamais la même combinaison, avec la voix de Pierre ou en pur instrumental, un récital mosaïque ou chaque petit fragment s'en vient se ranger à l'endroit désigné d'avance dans ce semble-t-il le plus grand désordre.
Des maîtres. Spectateurs sur les rotules, clubs de danses épuisés, nous quittent sous les applaudissements d'un dernier rappel.
MARC AND THE WILD ONES
Nous viennent de Germanie. Ne connaissent que très peu de mots français et l'anglais avec l'accent germanique change un peu de profil. Marc chanteur et guitare rythmique se charge de la communication. Pas facile et un peu longuet. Mais Stephan est impatient de jouer. Sort deux explosives pétarades de sa guitare pour hâter le processus et enfin n'y tenant plus il lance le riff du premier morceau. Heureuse initiative, car en quinze secondes le groupe est à son top niveau. D'emblée dans les limites supérieures. Presque trop bien. Car par la suite, l'on n'assistera à aucune progression. Du premier au dernier morceau l'on aura droit au même calibrage.
Etait-il vraiment impératif de préciser dès la fin du premier titre que les CD sont en vente au bas de la scène ? Intermède inutile et frustrant. Des voix s'élèvent pour demander de la musique. Moments de flottements d'autant plus pénibles que dès qu'ils redémarrent, sans effort apparent, tout baigne dans l'huile. Un rockab puissant, un peu à la Wild Goners, mais à mon goût un peu trop froid et distant. Des pros, qui ne se plantent jamais et qui filent droit sans demander notre reste. Tout est en place, voilure sous le vent et au maximum. Clipper filant grand largue vers le pays du soleil levant et pas le moindre brick pirate menaçant à l'horizon des Sargasses, si vous sentez mes rétentions.
Trois musicos qui assurent, Stepfan aux drums, Andy à la double bass and René à la lead guitar. Quand la guitare de Marc a un petit problème de fixation et qu'il la délaisse au profit de maracas, l'on ne sent pas vraiment la différence. D'autant plus qu'il assure méchant au chant. Incisif et tranchant comme un fer de hallebarde. L'ensemble est plus agréable qu'attachant. On admire mais on ne soupire pas. Vaincus mais pas convaincus. Surtout que le set n'est pas très long et le rappel vite réduit à la portion congrue d'un instrumental. Pour un final de festival, c'est un peu trop brutal. Presque déprimant.
THE END
C'est la fin. Encore un léger chouïa. L'orga appelle sur scène la trentaine de volontaires qui ont collaboré à la préparation et au déroulement de ces deux jours de festivités. Les présente tous nommément et les fait applaudir. Félicitations de penser aux petites mains, indispensables, qui ont permis la cinquième édition de cet American Days. En plus ils promettent de recommencer l'année prochaine.
Va encore falloir squatter l'appart de l'amie Patou et d'Eric !
Damie Chad
( Photos refusées par la machine ! )
JALLIES
06 – 09 – 2014 / MONTEREAU FAULT YONNE

Annoncé pratiquement du jour au lendemain, en plein samedi après-midi, à 16 h 30, l'heure exacte où les rockers ouvrent avec difficulté un oeil brumeux noyé d'alcool et de fatigue, c'est un scandale, oui mais ce sont les Jallies, alors la teuf-teuf file sur Montereau sans demander son reste, et trouve son aire de stationnement à soixante-dix mètres de la Place de la Poste. Suprême récompense des Dieux et divine apparition, la première personne que j'aperçois c'est Vanessa, pas possible, mais elle a grandi pendant les vacances, me ferai tout à l'heure la même remarque pour Céline et Leslie avant de réaliser qu'elles ont toutes les trois glissé leurs mignons petits pétons dans de gros sabots-espadrilles à hauts talons de cordes.
Place rectangulaire, pas très grande, mais plantée de platanes, avec le soleil et l'affluence l'on se croirait dans une petite ville du sud en pleine période estivale. Semaine des Arts de Montereau, tous les peintres du dimanche se sont donné rendez-vous aux quatre coins de la ville pour peindre les endroits les plus pittoresques de la la cité, et la Place de la Poste, envahie de stands d'artistes et de crêpes, est le lieu de convergence de cette manifestation picturale. Et musicale. Une amène chanteuse chargée de l'animation interprète sans trop se prendre au sérieux des airs populaires, large répertoire d'Edith Piaf à Joe Dassin... Ambiance sympathique, se sont même souvenus au dernier moment qu'ils pouvaient eux-aussi support their local rockabilly artists, et ils ont donc au dernier moment pensé à inviter les Jallies...
CONCERT

Concert de rentrée. Le premier depuis deux mois de vacances. Pratiquement improvisé. Sans répétition. A l'arrache. Devant un public qui n'attend pas les larmes aux yeux la dernière réédition de Charlie Feathers, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais dès les premières notes de la balance, réduite au strict minimum, tout le monde se presse devant la scène sans demander son reste. Que voulez-vous trois beaux brins de fille, c'est plus glamour que la mauvaise herbe de rockers en perfectos usés. Formation conventionnelle, les deux garons relégués au fond, Thomas avec sa guitare rouge, Julien avec sa contrebasse, et les trois bimbos bibelots devant qui attirent les regards et les yeux.
En tout cas ce sont les oreilles qui en prennent plein les tympans. Le son est fabuleux, d'une netteté exceptionnelle, sont pratiquement dans un des coins de la place et les façades des maisons font office de parfait mur de réverbération. Un truc me sidère, Vaness n'a pas encore touché à sa caisse claire que l'on entend un claquement sec qui n'en finit pas de marquer le rythme d'une manière souveraine. Evidemment ce ne peut être une boîte à rythmes, incongrue, et qui serait incapable de produire ce bruit net de branche cassée. Cela ne peut être engendré que par la contrebasse de Julien, m'expliquera plus tard qu'il a changé de cordage, sans doute je veux bien l'accroire, mais cette violence et ce feu dévorant proviennent surtout de ses doigts, de sa chair et de son esprit, car la musique n'est que la résultante de nos états d'âme.
Devant les filles gazouillent. Chant de retrouvailles gonflé de joie et d'énergie. Céline exulte, foulard blanc autour du cou, noué à la cow-boy, ce qui conjugué à son jean bleu lui donne une coupe punchy incroyable, en trois secondes elle installe les Jallies au meilleur de leur forme d'où elles ne redescendront plus de tout le set. Leslie – ce n'est pas pour rien que nous sommes chez les peintres, vous ne pouvez pas imaginer l'accord parfait de sa chevelure rousse avec le vert de son T-shirt de dessous, du grand art et en plus je la soupçonne d'avoir réalisé cela sans y réfléchir, d'instinct synesthétique – nous envoie coup sur coup un be Bop A Lula et un These Boots are made for Walkin' de derrière les fagots, à vous couper le souffle, avec Jérôme qui est instamment prié de se saisir de sa trompette pour un aboiement de solo sur Lula qui fit l'unanimité. Quant à Vanessa, touffeur blonde dans ses atours rouges et noirs, elle irradie, son chant rauque et harmonieux à la fois – elle donne l'impression de posséder un double jeu de cordes vocales dont elle se servirait en même temps – vous subjugue.
Ne croyez pas que j'oublie les garçons, la contrebasse de Julien qui crépite comme un incendie de forêt et Thomas, qui joue plus ramassé que d'habitude, moins expansif mais qui fournit le floconné sonore de notes rondes comme des galets et bruissantes comme la mer sur laquelle les trois mouettes rieuses prennent appui pour s'envoler. Avec Jérôme en renfort à la trompette ils vont nous donner une interprétation magistrale de Johnny Got A Boom-Boom d'Imelda May à vous couper le souffle. Un truc à vous impacter le cerveau pour le reste de votre vie. Et Leslie qui caracole là-dessus comme si elle était à la tête d'une charge de cosaques. Le public ne s'y trompera pas qui applaudira à tout rompre. Avec en prime un Train Kept A Rollin dévastateur.
N'y aura pas de rappel parce que le timing de l'après-midi est chargé. Vaness résume l'opinion générale, on en aurait repris sans problème deux heures de plus. Trop court, et trop bon. Un set bourré d'énergie pure, brut de décoffrage, une super barre chocolatée vitaminée au kérosène.. La saison s'annonce chaude.
Les Jallies impérieuses et impériales.
Damie Chad
( Photo sans rapport avec le concert )
BOBBIE CLARKE

A l'origine cette chronique devait être une toute petite notule corrective. Chroniquant le livre Vie et Mort de Vince Taylor de Fabrice Gaignault ( voir KR'TNT ! 188 du 08 – 05 – 2014 ) j'avais rappelé l'existence de l'ouvrage précédemment paru de Jean-Michel Esperet Le Dernier Come-Back de Vince Taylor ( voir KR'TNT ! 142 du 02 / 05 / 2013 ) que dans le feu de l'action j'avais par une stupide homophonie renommé le Dernier Combat de Vince Taylor. Donc acte. J'invite les fans et les admirateurs à se procurer ces deux livres, le plus vite possible.
Faut rajouter le Numéro Zéro de The Observatory du mois de juin 1993 édité par le Vince Taylor Infocentre dont le directeur n'est autre que... Jean-Michel Esperet et que vous pouvez dévorer in extenso sur le site www.rollcallblog.blogspot.com. Vous devriez même vous connecter tous les matins, dès l'aube, avant même le premier café et la première cigarette sur ce site irremplaçable. Documents et archives rares, introuvables ou inédites, dernières nouvelles des artistes de la musique que nous aimons : blues, pionniers, rockabilly, country... Des jours et des jours de lectures passionnantes, plus une foultitude de liens précieux...
Sur ce numéro de The Observatory, la carrière de Vince est analysée avec une très grande précision, étape par étape avec nombreux documents iconographiques et coupures de presses à l'appui. Mais la deuxième partie est encore plus passionnante : les interviewes et les témoignages d'artistes et de musiciens qui ont été amenés à côtoyer de son vivant, ou plus tard fantasmatiquement, cet être humain au destin d'exception et aux multiples facettes que fut Brian Maurice Holden.
Mais dès que l'on parle de Vince Taylor, l'ange du désastre commence à abattre ses cartes d'une manière par trop incroyable. D'abord l'as de coeur sur la couverture du dernier Jukebox ( numéro 333 ) avec Vince Taylor en couverture, la célèbre photo avec les chaînes, et en rouge et noir le titre Bobbie Clarke Raconte. Sa carrière, avant, pendant et après ses apparitions aux côtés de Vince Taylor. Des propos recueillis par Jacques Barsamian. En son temps Bobbie Clarke fut une vedette à part entière, Jeff Beck lui proposa même de faire partie du mythique Jeff Beck Group. Se décida trop tard...

L'as de pique pour Bobby Woodman. Beaucoup plus connu sous le nom de... Bobbie Clarke, le fabuleux batteur de Vince Taylor, celui - le seul – du moins en notre doux pays si peu rockophile, qui était capable au début des années soixante, de se servir de deux grosses caisses en même temps. Le 29 août 2014. Jean-Michel Esperet m'expédie par mail la triste nouvelle alors que je rentre à la maison avec Jukebox sous le bras. Cela s'appelle souffler le chaud et le froid. La fournaise et l'hiémal polaire.
Faudra dans les semaines qui viennent que KR'TNT ! rende hommage à Bobbie Clarke.
Damie Chad
21:52 | Lien permanent | Commentaires (0)


