23/12/2013
KR'TNT ! ¤ 169. DUSTAPHONICS / JALLIES / STAX RECORDS / SOUL & SLY
KR'TNT ! ¤ 169
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
26 / 12 / 2013
|
EDITO Peut-être l'avez-vous remarqué mais l'année se termine et déjà s'avance son cortège d'accaparantes festivités... Comme le jeudi 26 décembre nous vaquerons à diverses saturnales nous mettons en ligne dès ce lundi 24, la cent-soixante neuvième livraison de votre blog rock préféré. Vingt pages d'ardentes kronics rien que pour vous. N'allez pas dire après cela que vous ne croyez pas au Père Noël. Nous reprendrons le combat-rock, dans la soirée du vendredi six janvier. Juste pour la fête des Rois... du rock ! KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME ! |
|
DUSTAPHONICS / JALLIES / STAX INTOX / SOUL & R & B / SLY AND SOUL |
28 - 11 – 13 / OUVRE-BOITE
/ BEAUVAIS / DUSTAPHONICS
LE DESTIN PHONIQUE
DES DUSTAPHONICS

Vroarrrrr ! Varla conduit une Porsche. Cette brune incendiaire bien roulée ne porte que du noir. Belle poitrine et décolleté vertigineux. Varla sait se battre. Elle ne craint personne. Elle peut vaincre les hommes au combat et les tuer d’un coup de karaté. Kill Kill ! Elle fonce. Vroarrrrr ! Surf garage ! Au volant de sa Porsche noire décorée d’une barre blanche, elle est invincible. Elle roule à 240, comme James Dean, mais sans se tuer. Elle est moins conne que lui. Varla est chef de gang. Deux bolides la suivent. Le gang roule à toute blinde dans la Vallée de la Mort. Vroarrrrr ! Au volant de sa Porsche, Rosie lui colle au train. Elle parle avec un fort accent iranien. Brune et sensuelle comme Varla. Elle obéit au doigt et à l’œil. Derrière, la blondasse Billie pilote une Aston Martin décapotée. Elle écrase le champignon et secoue le volant comme une bite. Elle rit à gorge déployée. Ses cheveux blonds flottent dans l’air brûlant.
Bienvenue dans «Faster Pussycat Kill Kill» de Russ Meyer. Bienvenue aussi dans la pétaudière surf-garage des Dustaphonics. Quand elle ne brise pas la nuque d’un gros porc de macho, Varla monte sur scène avec Yvan pour casser la baraque. Tu veux ta dose de frissons, mon gars ? Alors cours chez ton disquaire acheter l’album «Party Girl» des Dustaphonics. Ou encore mieux : vas les voir jouer sur scène. Ça va te jerker la paillasse, mon gars.
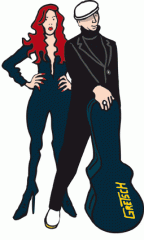
Vroarrrrrr ! Varla, Rosie et Billie jouent au jeu de la mort. Elles se foncent dessus : la première qui s’écarte a perdu. Varla fonce sur les deux autres. Pied au plancher. Évidemment, les deux autres tournent leur volant au dernier moment. Varla ne craint pas la mort. Sacrée Varla, va ! Elles font une pause dans le désert. Billie danse le jerk sur l’auto-radio. Quel cul ! Tiens voilà un mec qui arrive en bagnole ! C’est un fou de vitesse. Il fait du contre-la-montre. Varla se fout de sa gueule : «You’re a good american boy ! A safety first Clyde !» Puis elle le défie : «I never try anything ! I just do it ! I can’t beat clocks ! Just people ! Won’t you try me ?» Tu veux te mesurer à moi ? Ils font la course. Vroarrrrrr ! Varla triche et gagne. Vexé, le mec veut lui en coller une. Quoi ? En coller une à Varla ? Elle lui pète la gorge d’un coup de karaté. Oumff ! Tapis direct. Exceptionnellement, elle le laisse en vie. Mais cet abruti se relève pour la frapper. Quoi ? Elle le retourne sur le ventre, lui tire les deux bras dans le dos, met le pied sur la nuque et tire d’un coup sec. Crack ! Terminé. Pussycat Kill Kill !

Dans le civil, Varla s’appelle Tura Satana. Mais elle est à la ville comme à la scène. Ado, elle est passée à la casserole, alors elle a appris à se battre. Kill Kill ! Russ Meyer n’a rien inventé. Tura Satana est aussi culte que Vampirella. Sur le premier mini-album des Dustaphonics («Burlesque Queen»), Yvan lui rend un hommage fulgurant avec «Tura Satana», pulsé à mort par Aina Westlye, fabuleuse soul sister - hey hey ho ho - et embarqué sur un beat mambo - oh faster pussycat ! Tura shoots mais Aina shouts. C’est un festival extraordinaire, le morceau monte dans les étages, Aina donne tout, comme Mavis et comme Aretha. On renoue avec la soul qu’on aime, celle qui réveille les bas instincts jerkoïdes.
Tura Satana était en contact avec Yvan pendant les dernières années de sa vie. Il a mis en musique «Burlesque Queen», la chanson qu’elle avait écrite et qui raconte son histoire. Et là, on rentre dans le lard du mythe. «Burlesque Queen» sonne comme un classique exotico des Cramps - You’re gonna miss her when she’s gone - heavy blues tropical tout droit sorti d’un bouge de Macao. Bienvenue au voodoo lounge, baby. Les Dustaphonics devaient accompagner Tura sur scène, mais elle s’est fait la cerise en 2011. Alors, Yvan et ses amis ont dû continuer seuls.
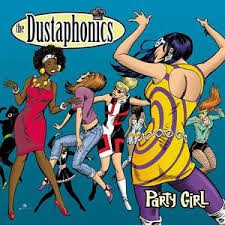
On trouve aussi «Tura Faster Pussycat» sur la face B de l’album «Party Girl». Rythmique en folie. Sur scène Yvan bat le tempo du pied. Ça va extrêmement vite. Il rajoute encore de la folie en battant du pied. Les Dustaphonics foncent dans le désert, comme la Porsche de Varla. Quand ils appuient sur le champignon, ça dégage autant de puissance qu’un gros moulin. Pas étonnant qu’on retrouve une reprise du MC5 sur «Party Girl». Wayne Kramer était dingue de dragsters. Il avait compris que le rock’n’roll était d’abord une histoire de vitesse et de bruit. Le dimanche, Wayne et son copain drummer Denis Tomich allaient au circuit de course pour assister aux compétitions de hot-rods. Ils étaient fascinés par le bruit des gros pots d’échappement et le design des carrossages.
Des dizaines de moteurs tournaient. Vroarrrrrr ! Vroarrrrrr ! Ils devaient hurler pour se parler.
— OH PUTAIN ! DENIS, ÉCOUTE LE BRUIT DU MOULIN... WOW ! T’ENTENDS ÇA ? CONNIE A AU MOINS SIX MILLE CHEVAUX SOUS L’CAPOT ! C’EST SÛREMENT UN VINGT-HUIT CYLINDRES EN W ! WOUAH !
— ON ENTEND LE CLIQUETTEMENT DES SOUPAPES D’ICI ! QUEL MONSTRE!
— CONNIE VA ENCORE GAGNER ! TU PARIES COMBIEN ?
— PAS LA PEINE, TU SAIS BIEN QUE CONNIE GAGNE TOUT L’TEMPS !
La version de «Looking At You» qui se trouve sur «Party Girl» est une bombe. Les Dustaphonics mettent en avant le groove des couplets, ils posent bien les termes de l’insurrection, c’est chanté avec l’insistance explosive des grands soirs et on entend soudain des poussées de guitare au fond du studio. C’est l’une des reprises du MC5 les plus inspirées qu’il vous sera donné d’entendre dans votre vie. Pas de surenchère à la hurlerie, rien que le groove du Detroit sound. Impressionnant.

Les Dustaphonics démarrent leur set et leur album de la même manière : avec un surf instro excitant, «Eat My Dust-a-phonic». Bienvenue dans l’univers killer et funny de ce groupe basé à Londres et qui pourrait bien prendre la place laissée vacante par les Cramps. Leur style fait rêver les amateurs. Leur choix de reprises donne le vertige. Sur l’album, ils tapent dans un vieux classique des Gories, «I Think I Had It» et le traitent à leur sauce, salement riffé et bien vu, groovy et solide avec encore une fois un chorus en forme de festival en cascade au fond du studio. Le son, rien que le son. Yvan place un solo spacio-temporel qui éclate à la cantonade. Du coup, on dresse l’oreille.

D’ailleurs, en concert, on ne fait que ça, dresser l’oreille. Dès l’intro. Ils embrayent très vite avec une monstruosité nichée sur l’album, «Jinx», un garage-cut digne des grandes heures des BellRays. Riffage et soul sister sont au rendez-vous, pas de problème, c’est raw et bien senti. Les Dustaphonics vont vous sonner les cloches, c’est sûr ! Autre petite vacherie survoltée : «When You Gonna Learn». Yvan joue ça de la main, mais aussi du pied. Il est possédé par le rythme. On ne quitte plus son pied des yeux. Il porte des chaussures blanches, comme Ron Asheton. Pas des mocassin, mais des chaussures basses à lacets.
Vous avez déjà entendu du mambo-garage ? Non ? Alors, il faut écouter «Dearest Darling» qui est sur la face 1 de «Party Girl». Ils embarquent le mambo-garage à fond de train, vroarrrrr, Kay Elizabeth, une autre soul sister, le chauffe à blanc. Morceau diabolique et vivace, tenu par un riff mambique digne d’el Señor Coconut. Fantastique ! On pourrait croire que les Dustaphonics se dispersent, mais non, au contraire, ils sont écœurants de cohérence. Ils tirent leur énergie et leur culture du même terreau que les gens de Crypt ou de Norton. C’est un univers composé de rockab, de blues, de garage, de r’n’b, d’exotica, de voodoo, de disques rares, de tout ce qu’on retrouve chez Lux et Ivy et chez tous les collectionneurs éclairés, chez Billy Miller et Miriam Linna, chez Tim Warren et chez Long Gone John, chez Dave Crider et chez Beat-Man, dans les bacs de Born Bad à Paris ou de Rocking Bones à Rennes, chez Roger Armstrong et Ted Carroll, chez Eddie Piller et chez Phil King, chez Paul Major et chez Bobby Gillespie. On reste dans l’énergie lumineuse, celle qui émane des gens qui découvrent et qui sont des passeurs. Ah, tu ne connais pas ce truc qui s’appelle «Just Go Wild Over Rock’n’Roll» de Bobby Dean sur Chess ? Ou le «Cat Talk» de Lew Lewis sur Imperial ? Ou le «Big Deal» des Skee Brothers sur Columbia ? Alors vas sur Bear. Tu les trouveras facilement.

Vroarrrr ! Trois mecs roulent sur des petites motocyclettes. Avec ses lunettes noires, Brahm a un faux air de Peter Fonda. Dante et Slick le suivent. Slick trimballe un petit transistor. Surf garage. On pourrait très bien entendre «Showman Twang Tiki Gods», un instro sauvage des Dustaphonics. Brahm éclate la gueule d’un pêcheur, puis ils sautent tous les trois sur sa poule en bikini rayé. Motorpsycho baby ! Ils reprennent leurs engins et foncent vers le néant. Dans un film de Russ Meyer, le scénario est souvent inexistant. Russ Meyer ne s’intéresse qu’à l’énergie du trash et, bien sûr, aux formes des poulettes qu’il engage pour jouer dans ses films. John Waters va lui aussi travailler sur cette esthétique et bricoler quelques chefs-d’œuvre purement rock’n’roll. The white trash sound.
Surf garage ! Hot shit, baby ! Il y a plus d’énergie dans un hit des Astronauts que dans toutes les compiles garage réunies. Rappelez-vous des Cavaliers le soir du concert des Sonics au Trabendo. Ils étaient tellement bons et tellement surchauffés qu’ils ont bien failli voler la vedette aux Sonics. Sur «Party Girl», les Dustaphonics vous proposent pas moins de trois instros virulents. Et du garage à la pelle. «Party Girl» est un autre morceau digne des BellRays, shouté à l’ancienne, pur motor-city romp, sévèrement riffé, le genre de morceau qui ne plaisante pas. Ne comptez pas trouver du garage à la mormoille sur cet album. Leur «Catwoman’s Strut» pourrait bien être un hommage au Stray Cat Strut, échappé du même nuage de fumée bleue et tout aussi overdosant de feeling. Aina Westlye chante ce morceau. On pense à Lisa Kekaula, une fois de plus. Ils ferment le bal de l’album avec un hommage à Bo Diddley : «Take It From Bo Diddley», un instro fulminant finement teinté de sax, introduit par Bo en personne. Mais non, il n’est pas mort.
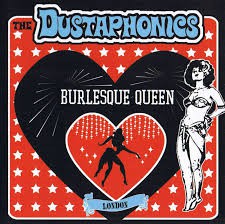
Sur le mini-album «Burlesque Queen», on trouve une autre énormité, «Open Up», embarquée par Aina Westlye. Elle tire ça vers les sommets de la soul garage et on se retrouve une fois de plus avec un hit tentaculaire sur les bras. Il n’existe rien de comparable en Angleterre. Et derrière ça, Yvan balance un solo fabuleux qui éclate dans l’écho du temps. Encore une pièce de soul aux cuisses fermes et pulsée jusqu’au délire.

Les Dustaphonics jouaient à Beauvais dans une salle vraiment idéale pour les concerts de rock : l’Ouvre-Boîte. Ils ont eu plus de chance que les Godfathers, puisqu’ils ont pu jouer en bas, dans la grande salle. Becky Lee assurait la première partie. Elle jouait seule sur scène avec une guitare Burns et une batterie. Son album est sorti sur Voodoo Rhythm, le label du Révérend Beat-Man, notre saint homme vénéré. Becky vient d’Arizona et Beat-Man la protège. Elle a quelques morceaux de garage dignes de Mr Airplane Man, comme «Lies» ou «Man Like You», qu’elle riffe assez salement, ou encore «Mess In Your Mind» qu’elle joue en se coinçant une baguette dans la main droite pour frapper le tom bass entre deux claquages d’accords. C’est dans le temps, pas comme chez Hasil. En prime, son album est vraiment bon.

Quand Yvan attaque l’instro surf d’intro, on croit rêver, car c’est Galloping Cliff Gallup qui joue comme un dingue sous nos yeux. Il sort un son de rêve de sa Gretsch orange. Rythmique de rêve aussi. Un bassman à casquette et un drummer à barbe pulsent comme des bêtes. On voit rarement des sections rythmiques de ce niveau et de cette puissance. Hayley Red, la nouvelle chanteuse des Dustaphonics, arrive. Elle ne porte qu’un petit haut noir et un pantalon de cuir noir très moulant. Forcément, elle allume les plafonniers dans tous les crânes. Elle est très forte, car elle met aussitôt le paquet. C’est une très belle femme, haute et brune. Au début, on la reluque comme on reluque toutes les femmes qui s’offrent en spectacle, mais très vite, elle s’impose par une sorte de candeur de débutante, quelque chose de purement rock’n’roll qu’on ne retrouve que très rarement. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour chauffer le maigre public et elle le fait bien. Ce n’est pas facile de danser devant une cinquantaine de personnes inertes. Son enthousiasme ne faiblit jamais et elle finit par fasciner. Au bout de deux ou trois morceaux, on réalise qu’on assiste à un concert énorme, complètement hors normes. «Jinx», «Tura Satana», «Red Headed Woaman» de Sonny Burgess, puis «Chicago Bird» en rappel, ils passent tout à la moulinette. Sur scène, les Dustaphonics dégagent autant d’énergie que Barrence Whitfield ou que les Dirtbombs, mais dans un genre différent qui est le leur et qui ne ressemble à aucun autre. Le mélange explosif qu’ils proposent fait leur force et leur singularité. On mord au truc et on ne lâche plus. Comme un pit. Grrrrr.

Signé : Cazengler, malade phonique
Dustaphonics. Ouvre-Boîte. Beauvais. 28 novembre 2013
Dustaphonics. Burlesque Queen. Kingaling Records 2010
Dustaphonics. Party Girl. Kingaling Records 2011
Becky Lee & Drunkfoot. Hello Black Halo. Voodoo Rhythm Records 2012
20 – 12 – 2013 / CROSS DINER
MONTREUIL / THE JALLIES
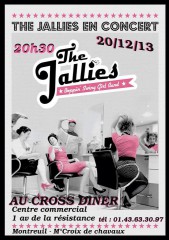
Le géant vert gare la voiture à cent mètres du Centre Commercial de la Croix de Chavaux à Montreuil. N'y a plus qu'à repérer le Cross Diner. Vous indique le truc - car apparemment de nombreux groupes vont être programmés dans les semaines qui viennent – lorsque vous êtes sur l'escalier central, que ce soit en haut ou en bas des marches, inutile de jeter des regards scrutateurs de sioux autour de vous, l'entrée du Cross se cache sous les escaliers. Pour les assoiffés le bar est sur votre droite, mais prenez le temps de jeter un coup d'oeil, rangées de table sur les deux côtés, vaste espace entre, et tout au fond une scène relativement spacieuse. Idéal pour les concerts. Peu de locaux parisiens du même genre peuvent se vanter d'une telle surface.

Décoration sixties sur les murs. L'on nous propose une table près de l'estrade. Le motif du plateau est on ne peu plus américain, stars and barns, je jette un coup d'oeil jaloux sur Jerry et Didier les deux zicos des Megatons installés à côté de nous, bénéficient d'une avenante pin up à la croupe réjouie, c'est vrai qu'ils n'ont pas notre chance, on the other side, les Jallies, Vanessa, Ady, Céline ( et même Julio ) tout contre nous, we are knockin' on the heaven door ! Sont en train de déguster un hamburger maison, elles nous font la bise et en profitent pour nous refiler leurs microbes – le lendemain malade comme un chien ( oui Salsa c'est juste une image et point du tout une image juste ) je ne pourrais même pas me rendre au concert des Howlin' Jaws. Pardon les Jaws, mais contre les armes bactériologiques je suis démuni.

Trois fois les Jallies en trois semaines. C'est que quand on aime, l'on ne compte pas. Apparemment nous ne sommes pas les seuls, la porte s'ouvre sur une cohorte de bikers, les Loners sont venus en force, la prestation de la semaine dernière dans leur local a dû les séduire puisqu'ils en redemandent. Public mélangé, bobos et punks – crête bleue et anneau dans le nez – se côtoient sans problème. L'établissement vient d'ouvrir, le staff est aux petits soins, souhaitons-leur de continuer sur cette voie.
JALLIES ONE
Elles sont en forme les mignonnettes. Est-ce une erreur ou la trêve de Noël qui produit ses effets, elles commencent par présenter Julien et sa contrebasse, le couvrent de compliments et de toutes la soirée elles ne se permettront pas même une moitié de demi-méchanceté à son encontre. Etrange le ménageraient-elles en vue de futurs cadeaux ? Leurs âmes seraient-elles plus noires que la juvénile candeur de leurs visages !
Elles n'ont pas terminé leur morceau de présentation que déjà la salle crépite de bravos. M'a toujours sidéré cette façon qu'elles ont de mettre le public, quel qu'il soit, dans leur poche. Sorcellerie ! Ensuite il n'y a qu'à laisser filer, ça passe comme une lettre recommandée à la poste. Font leur set et surprennent toujours le public là où il ne s'y attend pas. Leurs propres morceaux ou leurs reprises portent toujours le tampon Made in Jallies Land.
Sont elles et pas les autres. Se moquent du qu'en dira-t-on. Swing, rockab, ska, elles passent le tout dans le mixer de leurs voix et vous délivrent à chaque fois la face cachée de l'astre sélénique. Une autre façon de dire, une autre manière de se démarquer des copies conformes ou des imitations paresseuses. Authentiquement Jallies à chaque coup. Elles bousculent les repères mais ne s'écartent jamais de la bonne direction. S'appuient sur la tradition mais n'en restent pas prisonnières.

Nous servent des sucreries à tire-larigot mais derrière c'est Julio qui pose la pâte dans le moule. Tisse le fond, il est le grand réunificateur. Avant même que nos trois subtiles abeilles aient emmené la moindre goutte de nectar. Céline et Vanessa, découpent les parts, à grands coups de caisse claire. Donnent la forme, sculptent le son et le sens, profilent le morceau à leur volonté. Ady dépose les épices et la cannelle à la guitare, elle donne le goût. Et puis elles déposent leur marque de fabrique, la conjugaison fruitée de leurs voix. Au début vous avez l'impression qu'elles chantent à tour de rôle leurs chansons fétiches en solo, ce qui est vrai tout en étant totalement faux. Les deux autres copines se permettent des interventions, elles soutiennent, elles renforcent, elles adoucissent, elles ponctuent, oeuvre collective.
JALLIES TWO
Entracte minimal. Sont pressées de remonter sur scène. Tant que les voix sont encore chaudes.
Ravissement du public. Jusqu'à la serveuse qui se lancera dans un rock déjanté. Les Mégatons n'en reviennent pas de leur reprise de Good-bye Bessy Mae d'Hendrix. Céline qui est à la guitare nous la joue modeste en s'accordant, « Je ne suis pas Hendrix, loin de là. ». Mais les Jallies abordent la grande cime par une voie inexplorée, la fender joue le rôle modeste du sherpa d'accompagnement mais c'est le mariage des trois voix qui escaladent en tête de cordée. Ah ! Ces harmonies, cette palette de nuances, chacune s'irrisant du reflet des autres ! Une merveille. Si prenantes qu'à la réflexion je m'aperçois que je n'ai point, malgré les nombreux concerts auxquels j'ai assisté jusqu'ici, prêté attention aux fioritures de Julien sur sa double bass durant ce morceau, mais j'imagine qu'il ne doit pas garder les deux mains dans les poches.
Une chose est sûre, c'est qu'elles sont en constant progrès. De plus en plus ensemble et de plus en plus inventives. Céline pleine d'allant, de plus en plus volontaire et voix de plus en plus plastique, Ady de plus en plus teigneuse sur les rocks et Vanessa qui pousse son vocal de plus en plus rauque and roll. Blanc, blues, noir, les trois couleurs fondamentales de la musique populaire américaine.
Zutox, c'est déjà la fin. Pas question de les laisser comme cela. Les Megatons aimeraient réentendre Hendrix, mais Ady est trop enrhumée pour se permettre une telle cavalcade. Elles nous offriront une reprise de These boots are made for walkin'. Le plus terrible c'est que toute la salle est prête à marcher comme un seul homme derrière elles.

Prochain concert : le 17 janvier dans le cadre de la présentation du cinquième CD Rockers Kultur au New Morning. Salle mythique, s'il en est. Un bel écrin pour nos perles du rockab swing.
Damie Chad.
STAX EN STOX

Comme il savait que j’étais complètement obsédé par l’histoire des labels et des musiciens de Memphis, my old pal John Ives m’a fait un beau cadeau : l’intégrale des singles Stax, un coffret de 9 CD qui couvre la période 1959-1968. Passeport idéal pour entrer dans cette boutique mythique. Et pour danser le jerk du matin au soir.
Comme les frères Chess à Chicago, deux petits blancs ont eu la bonne idée de créer un label spécialisé et d’accueillir dans leur studio les grands artistes noirs de la région de Memphis. Comment en sont-ils arrivés là ? Bonne question. Le co-fondateur Jim Stewart n’en sait lui-même foutre rien. Il jouait du violon country et bossait dans une banque, et donc il ne s’intéressait pas spécialement à la musique noire. Et puis, pouf, un jour, il a l’idée de monter un studio et d’enregistrer les Veltones, cinq blackos qui font du doo-wop. Sa sœur Estelle Axton vient lui donner un coup de main et ils démarrent le label Satellite Records. Ils doivent vite changer de nom, car Satellite Records existe déjà, alors ils prennent le St de Stewart et le Ax de Axton pour faire Stax, et voilà comment on crée un mythe. Enfantin, non ?

Comme tous les patrons de labels de l’époque, Jim et Estelle embauchent du personnel, et notamment un compositeur maison, David Porter, qui devient le premier pilier du mythe Stax. Isaac Hayes arrive peu de temps après pour travailler avec Porter. Ces deux-là vont se transformer en usine à tubes. C’est eux qui vont signer tous les gros hits de Sam & Dave, la pétaudière à quatre pattes qui débarque chez Stax en 1965 et qui rendra le label célèbre dans le monde entier.

Le second pilier du label, ce sont les Mar-Keys, le «house-band», comme on dit là-bas. Rassemblés autour de l’organiste Booker T Jones, ils sont probablement le premier groupe multi-racial à connaître une certaine popularité dans le Deep South, une contrée où on n’aime pas trop les mélanges. Autour de Booker T, on trouve Steve Cropper et Donald Duck Dunn, deux blancs, Terry Johnson et Wyane Jackson, deux noirs, avec en plus le fils d’Estelle Axton, Charles Packy Axton au ténor sax, et Don Nix au baritone sax. (Le pauvre Packy va mourir d’une petite cirrhose à 32 ans et Don Nix va écumer la région en compagnie des Alabama State Troupers pour prêcher la bonne parole du Memphis Sound). Les Mar-Keys ne jouent que ces instrumentaux qui vont constituer pendant les premières années le fonds de commerce de la maison Stax. Ils font un carton avec «Last Night», puis le groupe se disloque en deux équipes. D’un côté, on retrouve Booker T & the MG’s qui vont connaître la consécration universelle et intemporelle avec cet instro brillant qu’est «Green Onions», et de l’autre les Memphis Horns qui passeront leur vie à souffler dans des instruments à vent pour accompagner la crème de la crème.
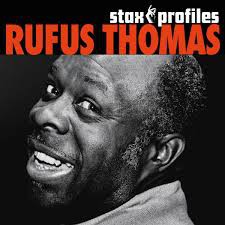
Le troisième pilier du label s’appelle Rufus Thomas, un DJ local qui avait donné à Sun son premier hit en 1953, «Bear Cat». Le père Rufus a déjà du métier quand il entre au studio Stax de McLemore avenue. Pendant des années, il va jouer le rôle de locomotive chez Stax, grâce à son énergie phénoménale et à son sens inné du gros groove funky. Certains iront même jusqu’à insinuer qu’il est le vrai roi de Memphis.
En 1960, ce punk black qu’est Rufus Thomas amène sa fille Carla de 17 ans dans le studio Stax et ils fracassent «Cause I Love You», une sainte horreur bourrée de soul. Ils savent aussi taper dans le registre du blues, comme par exemple avec ce monstrueux «I Didn’t Believe», où ils s’échangent des couplets. Ils ne dégoulinent pas de sueur, mais de classe. À Memphis, Rufus et sa fille vont se taper la part du lion pendant plus de dix ans. Les bougres ont de l’estomac.

Stax propose des instrus groovy de premier choix (Mar-Keys, Booker T, Bar-Keys) mais aussi des mélopées atrocement ennuyeuses qui ne serviront qu’à une seule chose : emballer les filles. C’est l’époque où on dansait des slows super-frotteurs. L’une des grandes pourvoyeuses de slows super-frotteurs sera hélas Carla Thomas. Une vraie plaie. Dès que son père a le dos tourné, on lui fait enregistrer une rengaine à l’eau de rose. Elle attaque sa mièvrerie et on bâille pendant deux minutes trente. Heureusement, Barbara Stephens lui arrache le micro des mains pour attaquer «Wait A Minute», un hit incendiaire qui soigne tous les rhumatismes. C’est du r’n’b chauffé à blanc. On l’a déjà remarqué : dès qu’une grosse black s’en mêle, ça se met à tanguer sévèrement. Barbara charge la barque, elle sait ce qu’elle veut, wait a minute, reviens par ici, foie blanc ! Elle est du Sud, la garce, et là-bas on ne rigole pas avec ces trucs-là ! Elle en a déjà assez bavé avec les patrons blancs, oouuuh ! alors il ne faut pas essayer de la prendre pour une conne, elle ne lâchera pas le morceau. Chez Stax, les artistes ont du tempérament.
Côté hommes, c’est William Bell qui va se charger de la fabrication en série des slows super-frotteurs. On peut dire qu’il en connaît un rayon en matière d’expression des sentiments amoureux et de pommade sentimentale. Otis entre dans la course très tôt et se met lui aussi à pleurnicher dans son micro. Heureusement, Rufus veille au grain et leur tient la dragée haute. Ouah ! Ouah ! Il aboie dans «The Dog», histoire de montrer aux autres comment on fait pour grimper sur une chienne en chaleur. Pas besoin de préliminaires.
Au fil des années et donc des disks du coffret, on reste sur l’impression que ça ronronne doucement chez Stax et soudain, on marche sur un râteau et on prend le manche en pleine poire : «Jelly Bread» de Booket T & The MG’s cause un choc certain, emmené par un drive de basse énorme. Steve Cropper y balance un solo dévoyé avec une arrogance non feinte.

En 1962, le guitariste Eddie Kirkland - légendaire accompagnateur de John Lee Hooker à Detroit - vient s’installer dans le Sud et il enregistre pour Stax une perle noire, «Them Bones». Il chante cette pièce de rumba cathartique digne du Professor Longhair avec des hoquets invraisemblables. C’est l’un des joyaux de la légende Stax.
«Frog Stomp» de Floyd Newman est un jerk de rêve, le modèle parfait de l’instro stompé. En 1963, Newman est un musicien réputé dans la région, il tourne beaucoup et Isaac Hayes joue des claviers dans son orchestre. Il n’existe aucun équivalent de «Frog Stomp» sur le marché. C’est une vraie teigne d’instro à gueule d’empeigne qui vire au délire de clap-hands. Floyd Newman a tout simplement inventé la première machine à jerker. C’est tout de même autre chose que la machine à vapeur du Professeur Artémise qu’a cassée Evariste le gaulois.
D’ailleurs, Floyd Newman met le doigt sur un point capital. C’est exactement là que se situe la spécificité de Stax : dans les coups fumants. Bien sûr, Otis, Rufus et Sam & Dave font figure de valeurs sûres, mais à la limite, leurs hits sont connus comme le loup blanc et finiraient presque par lasser. Par contre, ceux d’Eddie Kirkland, de Floyd Newman ou de Barbara Stephens sont beaucoup moins connus et ils emportent la bouche chaque fois qu’on les réécoute.
Encore deux coup fumants signés Stax : les Van Dells et les Cobras, pour deux instros de malheur. Steve Cropper et Donald Duck Dunn se rebaptisent les Van Dells et enregistrent «Honeydripper», une reprise de Roosevelt Sykes embarquée par une ligne de basse qu’il faut bien qualifier d’historique. Duck Dunn s’est bâti à Memphis une réputation de bassman peu orthodoxe. La chose est pulsée jusqu’à l’os, cuivrée dans l’essence, bousculée dans ses gènes et coiffée d’un solo de sax princier. Ça va vous voler dans les plumes mais aussi dans les méninges. On est chez Stax, au royaume des intros nucléaires. C’est la même équipe - Cropper, Duck Dunn - qui prend le nom de Cobras pour enregistrer cette nouvelle perle noire, «Restless», instro diabolique monté sur un tatapoum jugulaire et on voit la jungle débarquer à Memphis. Les zombies ouvrent un œil et s’exclament : «Enfin un beat qui traîne !» Hoops, la chose est salée, cuivrée, piquée de notes moustiques et on fait un tour d’auto-tamponneuse, cling ! clang ! clong ! fabuleuse partie de shoote. Dans l’esprit, on dirait du surf-garage. Cropper dit qu’il s’est inspiré de Link Wray.

De temps en temps, Rufus ramène sa fille en studio pour lui secouer les puces. Avec lui, inutile de perdre du temps. Il veut que ça bouge et vlan, ils envoient des petits jerks tendus comme «That’s Really Some Good». Carla danse avec son père. Puis, en vrai seigneur, Rufus propose à sa fille de mettre en boîte «The Night Time Is The Right Time», histoire de réserver une place dans la postérité. Rufus fait sonner le heavy blues à la perfection. Au bout de vingt secondes, Carla commence à chauffer. Ils sont fabuleux de véracité réciproque, ou de réciprocité véritable, c’est comme on veut. Le vieux gratte le blues jusqu’à l’os, screetch screetch, c’est un géant, il gueule en haut du volcan, histoire de rappeler qu’il est le dieu du groove de la forêt tropicale.
Avec Oscar Mack, on retrouve le son de la Nouvelle Orléans. Il monte «Dream Girl» sur un gros grattage de guitare et il met le feu aux poudres chez Jim et Estelle. Encore un hit à l’ambiance voilée, incertaine, mais teigneusement moderniste, cueilli au coin du couplet par les trompettes des Cavaliers de l’Apocalypse. Encore un coup fumant.
C’est Estelle qui découvre les Mad Lads, un groupe de doo wop et comme elle adore les disques de Jan & Dean, elle leur propose d’enregistrer «The Sidewalk Surf», un truc qui n’a plus rien à voir avec Stax : Boum ! Voilà encore une cochonnerie chauffée à blanc qui fonce tout droit, à un rythme infernal, embarqué par un drumbeat maniaque de rêve. Avec son «Bar B Q», Wendy Rene fait elle aussi remuer les popotins, pas de problème, ça claque des mains, encore un tube idéal pour la surboum, un trésor que Stax stocke avec style. Franchement, sans Stax, la vie ne serait qu’un steak.

À ce stade des opérations, on pourrait très bien la jouer fine et se demander ce qui fait la différence de style entre Stax et Motown. Motown va plus sur les compos soignées, les harmonies vocales et l’infaillibilité des hits. Berry Gordy voulait une usine à tubes (il avait pris comme modèle une chaîne de montage automobile) et il avait embauché le personnel idoine (Holland-Dozier-Holland, Smokey Robinson, Norman Whitfield et Barrett Strong, entre autres). Stax tape dans un autre registre : Jim et Estelle cultivent une sorte de passion pour le son cru, les voix rauques, les accents lubriques et les arrangements de cuivres un peu hirsutes. Otis et Sam & Dave seront les meilleurs ambassadeurs de cette option.
Personne ne se souvient des Admirals, une groupe de blacks qui enregistra «Get You On My Mind», un hit splendide bourré de toute l’énergie du gospel et chanté d’une voix d’ange écarlate, pas très éloigné de l’esprit Smokey Robinson. Yiouh Yiouh Yiouh ! Fantastique pièce de r’n’b swinguée à ravir. Un mec arrive et place un couplet d’une voix énuclée qui prend au ventre. En fin de couplet, on voit sa voix éclater au firmament. On se pince. Non, ce n’est pas un rêve.
Parmi les personnages truculents de l’écurie Stax se trouve Gorgeous George qui travailla comme valet chez Hank Ballard. Il avait pour particularité de coudre ses propres vêtements. Gorgeous George jouait les dandies. Malheureusement, son «Biggest Fool In Town» pue l’ennui.
Atlantic déniche Sam & Dave à Miami et les rapatrie à Memphis. Ces forcenés enchaînent hit sur hit, des gros tas de r’n’b dégringolés comme «I Take What I Want» ou «A Place Nobody Can’t Find». Le seul qui peut rivaliser avec ce monstre à deux têtes, c’est le vieux Rufus qui sort encore des grooves infectueux comme «When You Move You Lose».

David Porter et Isaac Hayes se sont bien amusés à composer «Hold On I’m Coming» pour Sam & Dave. Porter est aux gogues et Isaac arrive avec une envie pressante - «Get a move on !» - magne-toi le cul ! - alors Porter lui répond «Hold On I’m Coming» en claquant des doigts. Ils ne sont pas allés aussi loin que Screaming Jay Hawkins dans «Constipation Blues», dommage.
Le duo d’enfer Porter-Hayes composait aussi pour les Astors, et notamment «In The Twilight Zone», une fantastique merveille, monstrueuse de jerkitude, montée sur le drumbeat le plus hypnotique de l’histoire des drumbeats, et le diable sait si cette histoire est bien fournie...
Autre personnage clé de l’histoire Stax, Al Bell, qui devient co-directeur du label en 1965 et qui amène un petit nouveau : Eddie Floyd, un black plutôt doué qui a chanté dans les Falcons avec Wilson Pickett et Mack Rice. Et en 1966, Stax prend feu, à cause de tous les hits qui sortent. Les Mad Lads remettent le couvert avec «Sugar Sugar», un beau jerk tarabusté à la sauce sudiste, bien désossé, ruisselant et repris aux cuivres, battu tout droit et admirable de précarité. Eddie Floyd sort son ultra-célèbre «Knock On Wood» repris en France par l’affreux Jojo. Carla s’y met elle aussi, avec «BABY», un jerk infernal secoué par de soudaines accélérations. Et voilà qu’entre en lice le gros Albert King, analphabète et bête guitaristique qui chante avec de la purée de pois plein la bouche. Son «Oh Pretty Woman» est un monument d’anthologie, incroyablement gras, cuivré à outrance, comme si le son Stax se transcendait. Sam & Dave montent «Said I Wasn’t Gonna Tell Somebody» en épi et William Bell qui habituellement nous fait bâiller d’ennui nous pond un jerk des catacombes avec «Never Like This Before», farci de parties de guitare démentes et de chœurs luisants comme des intentions lubriques. So good, baby, le vieux Bell roule des hanches et derrière, des folles en chaleur piaillent Never ! Never ! Et si on veut vraiment goûter le grand cru Stax, alors, c’est «You Got Me Hummin’» de Sam & Dave, que les spécialistes de l’université de Prague qualifient de jerk du diable. En effet, Sam et son copain Dave gémissent comme des soudards en rut. Et comme le groove est extrêmement lent, on imagine les reptations gluantes au fond du pantalon. La touche Stax est unique au monde. Chaude et organique.
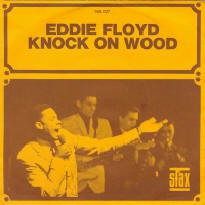
Eddie Floyd a une sacrée classe. Il suffit d’écouter «Raise Your Hand» pour le voir entrer dans le lard d’un groove ralenti. Il prend son temps, ah yeah, et derrière, dans les chœurs, on retrouve la dynamique du gospel. Le tout bien farci de cuivres, dans une ambiance bordélique et décousue. Cette fabuleuse machine recrache une chair à saucisse fumante et odorante.
Voilà que Sir Mack Rice (compositeur de génie - on lui doit notamment «Mustang Sally») quitte Detroit et débarque à Memphis. Il démarre chez Stax avec «Mini-Skirt Minnie», une belle pièce de jerk qui se danse à l’Egyptienne. Il va devenir la seconde patate chaude Stax, juste après Rufus. Il suffit d’écouter «Love Sickness» pour se faire une idée du génie groovy de ce modeste artisan. Tav Falco reprendra pas mal de tubes signés Sir Mack Rice, ne l’oublions pas. Et comme le veut l’usage, les patates chaudes se font des petits cadeaux : Sir Mack Rice compose «Sophisticated Sissy» pour son collègue Rufus.
Autre merveille imparable du vivier Stax, «The Spoiler», composé par Duck Dunn et interprété par Eddie Purrell. Une bombe. Noyée d’orgue dès l’intro, cueillie aux cuivres et balancée dans la stratosphère. Un jerk mortel, comme on en voit peu. Eddie y va, I’m a spoiler, ouuh ! Monstrueux ! Do the spoil ! Eddie joue son va-tout. C’mon C’mon. Bizarrement, après la parution du disque, Eddie va disparaître. Personne n’entendra plus jamais parler de lui.

Johnny Daye disparaîtra lui aussi corps et biens après avoir pondu un hit Stax, «What’ll I Do For Satisfaction». Non seulement il est l’un des punks de Stax, mais en plus il est blanc. Otis l’a déniché à Pittsburgh. Il chante d’une voix crevée, et il parle de satisfaction, ce qui n’est pas très bien vu dans le Sud. La chose est grattée à l’os de l’accord.
Porter et son ami Hayes composent «How Can You Mistreat The One You Love», et Jeanne & the Darlings l’expédient directement au paradis des jerkeurs. Voilà ce qu’il faut bien appeler un jerk de choc claqué de mains et swingué à outrance. Chez Stax, on sait claquer des mains sur un gros beat cuivré. Au détour du disk 8, on tombe sur cette pièce de r’n’b en liberté, fabuleusement sauvage, au sens de l’étalon. Aussi sauvage, le «Wait Your Day» de Mable John. Elle y va, elle danse le menton en avant, les dents serrées, les coudes près du corps, elle balance le groove de tous ses muscles relativement fermes, c’est une tigresse, elle en impose, elle en veut, elle pèse de tout son poids et elle indique la direction de la piste de danse aux petits blancs : allez bouger vos culs de poulets.
L’une des pièces les plus spectaculaires de cette galerie, c’est la reprise de «Knock On Wood» par Carla et Otis. Un chef-d’œuvre absolu. La Carla, elle tire la langue. L’Otis, lui, il sautille dans son pantalon de tergal trop serré. Évidemment, il a mal à la bite. Quelle fournaise ! Après le passage des trompettes, ils remettent ça. Ils frétillent comme des gardons du Delta. Derrière eux, les cavaliers de l’Apocalypse soufflent comme des bêtes et un bassman joue tout en bas du manche. Il faut avoir entendu ce frichti staxien une fois dans sa vie pour ne pas mourir idiot. Voilà la timorée et l’Otis en pleine sauterie. Ga-ga-ga ! Ga-ga-ga ! Admirable prestation.
Comme Booker T s’est calmé, ce sont les Bar-Keys qui reprennent le flambeau des instrus dévastateurs, avec des énormités comme «Soul Finger» ou «Give Everybody Some».

Et puis, on arrive en 1968. Albert King devient la nouvelle patate chaude du label avec son gros son sous-tendu par des grooves de basse éléphantesques, comme dans «Cold Feet» ou encore mieux, dans «I Love Lucy», cette pure giclée de génie qu’on reçoit entre les deux yeux, et le gros Albert, toujours avec sa purée plein la bouche, nous avoue que la Lucie dont il parle, c’est sa guitare. Eddie Floyd signe l’autre coup de génie de Stax en 68 avec «Big Bird». Véritable monstruosité staxique, l’un des singles les plus déments de l’histoire du rock. Aucun groupe de blancs ne pourra jamais rivaliser avec ce groove de guitare/basse vénéneux, Open up the sky, c’est un peu comme si les Stooges débarquaient à Memphis. Rufus ne reste pas les bras croisés, oh non, il casse la baraque en jouant les chefs de gare dans «Memphis Train». Et on retrouve cette année-là le couple chaud de Stax, Otis et Carla. L’Otis y sautille encore plus qu’avant dans «Lovey Dovey» et la Carla, elle tire encore plus la langue. Ils ahanent ensemble, ce qui plonge forcément l’auditeur dans la confusion. La Carla elle couine comme un petit animal, histoire d’allumer l’Otis qui n’a vraiment pas besoin de ça, vu l’état dans lequel il se trouve. Alors, il y va de ses accents mâles et la Carla, elle feule. Si elle continue, elle va provoquer une catastrophe, cette bourrique, euh-euh, elle est infernale, avec son timbre voilé de chatte en chaleur. Franchement, depuis cette chaude journée de printemps 1968, on n’a jamais fait mieux, dans le style soul-shaking allumeur.
1968 ? Oh non, ce n’est pas la fin de Stax, mais seulement la fin de la période magique. Isaac Hayes et les Staple Singers vont enregistrer d’énormes albums et donner à Stax une plus grande audience. Et puis les temps vont commencer à changer. La disco délogera la soul des hit-parades et les boîtes de nuit remplaceront les surboums. Pas grave, puisque Jim Stewart et sa frangine Estelle occupent le premier rang, au panthéon des géants de l’histoire du rock. On les retrouve assis juste à côté de Leonard Chess et de Sam Phillips.
Signé : Cazengler le staxkhanoviste
The Complete Stax Singles 1959-1968. Coffret 9 CD Atlantic 1991
L’illustration : Miss Axton (Estelle pour les intimes) et ce sacré bon vieux Jim Stewart
SOUL & SLY
L'ODYSSEE DE LA SOUL
ET DU R'N'B
FLORENT MAZZOLENI
( HORS COLLECTION / 2010 )

Le côté obscur de la force. La face cachée du rock'n'roll. Si vous voulez. En réalité les surgeons blancs et noirs de la musique populaire américaine se sont depuis le commencement entremêlés. N'y a que ceux que ça dérange qui ne veulent pas voir. Dans certains milieux rock, notamment rockabilly et hard-rock, heureusement minoritaires, l'on a épousé l'idéologie sudiste la plus réactionnaire. Se croient ainsi plus près des soi-disant racines ultra-brite du rock'n'roll.
Les petits blancs du Sud incapables de s'emparer, par une égalitaire redistribution confiscatoire, de la richesse des propriétaires des grandes plantations ont adopté le point de vue rétrograde mais très intéressé des exploitants de manoeuvres serviles. Faute de grives l'on mange des merles noirs. C'est ainsi que les pauvres white trash people scient la branche du magnolia sur laquelle ils ne sont autorisés à s'asseoir et que les jours de fête, pour s'incliner respectueusement devant la fortune des maîtres.
Comme le monde est très bien fait vous avez à peu près le même type de comportement borné de l'autre côté du plateau de la balance, celui qui penche à gauche. Toute une partie de la petite-bourgeoisie socialisante qui pousse des cris d'orfraie au premier accord de rockabilly qui parviendrait à leurs oreilles. Sautent tout de suite sur les grands mots et vous traitent de national-country.
Ce sont les mêmes qui ont applaudi à l'élection puis à la réélection – ces gens-là ont de la suite dans les idées - de Barack Obama. Indéniable progrès de l'humanité, un noir à la maison blanche ! Que le président soit comme les précédents un homme-lige des multinationales capitalistes et un représentant du complexe militaro-industriel ne semble pas les gêner, qu'il n'ait pas levé le petit doigt pour remettre dans leurs maisons les familles qui en furent chassées par la crise programmée des subprimes, ils préfèrent éluder prudemment sur le sujet.
Maintenant ne travestissez pas ma pensée. N'avais pas moins de prévention envers le concurrent d'Obama. Blanc bonnet ou et bonnet noir, c'est toujours un bonnet. Le jour où les gens cesseront de voter pour les maîtres qui malgré leurs mirifiques promesses leur passent la chaîne au cou et qu'ils décideront de s'occuper eux-mêmes de leur propres affaires, suis sûr que l'on sera sur un meilleur chemin. Rien à voir avec la démocratie directe à la Ségolène Royal. Je suis pour la mondialisation anarchisante. Le vieux slogan des Pistols étendu à toute la planète : Anarchy in the World !
L'ODYSSEE DE LA SOUL
Maintenant l'Odyssée de la Soul de Florent Mazzoleni est le livre parfait pour nous rappeler que le monde n'est ni blanc ni noir. Mais ne nous précipitons pas. Vous conseillerai plutôt de prendre le temps de feuilleter les autres bouquins de notre spécialiste. Son Motown, Soul et Glamour paru en 2009 au Serpent à plumes – saluons au passage le grand Quetzacoalt du roman d'Herbet Lawrence – d'une documentation sans faille est l'oeuvre d'un connaisseur émérite. L'a aussi commis un James Brown, l'Amérique Noire, la Soul et le Funk que je vous présenterai un de ces jours.
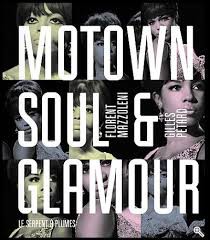
Cette Odyssée de la Soul vise un plus grand public. Point de chapitre préambulatoire qui remettrait la soul dans la continuité de l'histoire de la musique noire de l'Amérique. L'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Année 1960 avec Sam Cooke. Ensuite l'on décline millésime après millésime jusqu'en 2010. Cinquante ans en 335 pages. Le néophyte qui déboule et qui de temps en temps croisera le mot blues se débrouillera par lui-même pour savoir ce que ce vocable recouvre au juste. Vous me direz que c'est en amont de son sujet, et puisqu'il commence en 1960, va pas débuter en 1920.
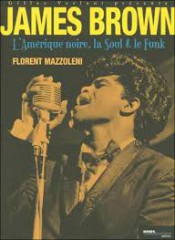
Objection retenue, vos honneurs. Mais en aval, notre auteur persévère. Heureusement que James Brown a posé les bases du funk, au moins on comprend de quoi il s'agit, mais le hip-hop et le rap ils débarquent sans se présenter dans les notules sans que nous ayons droit à une courte introduction. De même lorsque le New Jack Swing se radine, à vous de deviner... Quant à la couverture il aurait été plus juste de titrer et de la R'n'B que « et du R & B », car si le vieux Rhythm And Blues des familles affirme sa présence au travers de l'écurie Stax, il ne faut pas se faire d'illusion, le terme désigne avant tout cette musique de danse fort prisée de toute cette partie de notre jeunesse insoucieuse de son destin social, chair à patrons malléable à merci pour le bien-être de nos bien-aimés gouvernants...
Tant que nous sommes dans les récriminations, plaignons-nous de ce que les notes marginales éparpillent la lecture. Toutes ces récapitulations de disques qui ont marqué l'année épluchée auraient mérité d'être regroupés sur une pleine page sur laquelle elles auraient pu être agrémentées de la reproduction – ne serait-ce qu'au format timbre-poste – de leurs pochettes.
R 'N' B
Question illustration vous allez en prendre plein les mirettes, plein les minettes. Surtout vers la fin, avec ces portraits pleine-page des reine du R 'n' B, chantent peut-être pas très bien, mais elles sont mignonnes à croquer nos panthères noires. Le problème c'est que l'on ne peut traduire l'expression en anglais. L'expression Black Panthers est trop connotée du côté de la révolte pour s'appliquer à leurs adorables minois. Trop lisses, trop propres sur elles. Sont des objets de consommation jetables. Font juste quatre ou cinq millions de petits quarante-cinq tours et puis s'effacent du paysage. Sont vite remplacées. L'industrie du disque n'est pas prêt de casser le moule. Les reproduit à la chaîne.
Un protocole d'une efficience absolue, un : on repère l'objet que l'on va façonner pour toutes les convoitises, deux : on s'arrange pour qu'elle interprète la chanson générique d'un film à gros succès, un blockbuster dans le jargon des branchés sur l'électricité à basse fréquence, trois : on lui distribue deux ou trois Grammy Awards, quatre : l'on presse le citron les deux ou trois années qui suivent, et à la suivante !
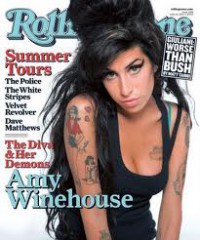
De temps en temps la machine se grippe. Le genre est devenue si codé que même des petites blanchottes parviennent à s'insérer dans la série. Les compagnies de production ne sont pas racistes pour deux sous, pardon pour deux millions de dollars. Le pire qui peut arriver c'est quand l'on déniche la perle rare mais totalement incontrôlable. Amy Winehouse, par exemple. Rien que ses invraisemblables manières de se coiffer vous montrent que ce n'était qu'une sale gamine, pas fiable du tout. Alors sa manière de chanter, vaudrait mieux se boucher les oreilles. Des sangs, du larme et de la sueur. Toute la différence entre la suavité érotique et le porno hard. Elle gueule et elle feule. Totalement soule, impeccablement soul. En deux disques elle a soufflé sur le château de cartes des apparences. Et puis cette rage éclatante, ces paroles déchirées, et cette addiction revendiquée aux drugs, malédiction ne se prendrait-elle pas pour une idole du rock'n'roll ? Ouf, la chipie n'était pas aussi mauvaise qu'on le pensait, elle avait bon coeur, elle a eu la bonne idée de crever à temps. Avant que l'image de toutes les autres ne pâlissent un peu trop...
LA FAUTE A QUI ?

Vous ne vous en sortirez pas en accusant le Système. Ca ne mange pas de pain, ni le blanc, ni le noir. Tant pis je crache le nom. Vous le connaissez mais d'habitude on le prononce avec respect. Et c'est vrai qu'elle le mérite. Mais elle est tombée dans son propre piège. Motown, la Motown, un mythe. Tout le monde connaît l'histoire de Berry Gordy, le petit noir courageux qui monte sa compagnie et qui s'en va courageusement à l'assaut des hit-parades noirs. Car au début, l'on préfère rester entre soi.
Et ça lui réussit plutôt bien. Des noirs qui chantent diablement bien, il y a en plein les Eglises. Les familiales assemblées dominicales de Gospel sont un vivier inépuisable. Au début l'on montre ce que l'on a de plus présentable, des groupes de jeunes filles pures. Ce sont les paroliers qui insinuent les freudiques pulsions du désir dans les textes. Elles sont si mignonnettes que vous ouvrirez tout grand leur portes et leur offrirez le bon dieu sans confession ( et autre chose aussi ). La preuve que même dans les foyers blancs l'on préfère que les ados écoutent ça à des voyous blancs comme Gene Vincent ou Eddie Cochran.

Se fera doubler sur sa gauche la Motown, dans les mix-sixties ils tirent des numéros 1 à en veux-tu en voilà avec les Temptations et les Four Tops. Pas vraiment des bègues, et un accompagnement hyper-soigné, de la belle ouvrage. De la marque. Motown sound. Pas de chance les rockers de tous les pays se focalisent sur Otis Redding, Wilson Pickett, Eddie Floyd, Joe Tex, Sam and Dave, rajoutons Rufus Thomas, sa fille Carla, Ike et sa tigresse Tina, Aretha Franklin qui attire la foudre sur ses enregistrements comme le paratonnerre de Benjamin, c'est une musique encore plus cuivrée que les mines du Chili, et cette montée en puissance correspond à la colère de Malcom X, de Stockely Carmikael, de Huey P. Newton, de Bobby Seale, bref de tous les théoriciens et de tous les meneurs de Black Panthers Party. Les gethos flambent et la musique s'est embrasée.
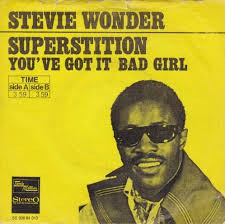
Mais le vent de la colère se crashera comme l'avion d'Otis Redding. En voici un qui aura su mourir comme Buddy Holly. La Motown a tenu bon pendant la bourrasque. Rajoute en vitesse du sucre dans ses produits. Dès 1970 l'on vise le jeune public, Pépé Gordy se charge des Jackson Five. Pour les plus grands on a Stevie Wonder en réserve. De la pop orchestrale tellement bien faite qu'il n'y a rien à lui reprocher. Si ce n'est que c'est... de la pop. Le grand public qui est en train de s'équiper en stéréo et qui se régale d'entendre la voix du chanteur sur la baffle de droite alors que les violons dégoulinent de la voix de gauche. Il y a des baffes qui se perdent.

Motown est en tête des hit-parades et doit agrandir ses coffre-forts. Ca suscite des vocations, un peu partout l'on imite la recette Motown. De Philadelphie jusqu'à Los Angeles les studios et les majors se remplissent les poches. Le problème c'est que quand vous vous habituez à engranger des billets verts en quantité astronomiques, vous prenez de mauvaises habitudes et chaque mois vous devez réussir votre coup pour maintenir votre standing. Vous étiez un aspirateur à fric et vous vous transformez en machine à dupliquer de la fausse monnaie musicale. Vous ne précédez plus le public, vous le suivez. Vous tentez de récupérer tout ce qui se fait de neuf dans les labels ou dans la rue – disco, hip-hop, rap - pour en donner une version aseptisée, présentable et rapidement assimilable par l'oreille moyenne des auditeurs. Musique de danse pour le vendredi, des slows sexuellement très chauds et explicites pour la nuit du samedi, et de la variétoche pleurnicharde pour le dimanche après-midi. Ca ne casse pas trois pattes à un canard à l'orange mais ça vous aide à reprendre le boulot tout le reste de la semaine...
FIN DE L'ODYSSEE
La soul a perdu son âme, elle est devenue une musique de mode, de hype, de dancefloor, et de consommation. Entertainment et Tin Pan Alley ont triomphé. Blues, Rhythm'n'blues et jazz font grise mine. Ironie du sort ces musiques typiquement noires et américaines ne survivent parfois que grâce à un public de petits blancs européens.
La lecture de Mazzoleni est imparable. Il ne prend pas parti. Se contente d'exposer les faits dans leur chronologie. Mais au fil des pages l'insidieuse décadence s'installe. Peut-être le seul genre musical qui s'est auto-suicidé. Une histoire très morale en fin de compte. Ce ne sont ni la blancheur ni la noirceur de la peau qui font la différence. C'est la logique d'accumulation capitalistique du profit qui corrompt tout. Que les rockers de tous les pays – noirs et blancs, ( les jaunes et les rouges aussi ) – en prennent de la graine. Do it yourself, ne laissez pas les grosses maisons de prod vendre votre musique. Car c'est vous qu'elles achètent. Et vous y perdrez votre liberté de création. Comme l'esclave dans son champ de coton. Mais pour les chants de révolte vous risquez de manquer de crédibilité.
Damie Chad.
SLY STONE / GREIL MARCUS
( in Mystery Train de GREIL Marcus )

La précédente chronique reposait dans mes fichiers depuis quelques jours lorsque j'entamais la lecture de Mystery Train de Greil Marcus. Surprise, surprise, - le lecteur se rapportera à notre livraison 145 du 28 / 05 / 13 consacrée à cet ouvrage – près de quatre-vingt pages, je ne m'y attendais point, du livre centré sur Elvis sont dévolues à Sly Stone artiste de San Francisco que l'on n'a guère l'habitude d'évoquer lorsque l'on traite de rockabilly.
Faut remonter loin dans les souvenirs. En France l'on entendit Sly and the family Stone sur les ondes en 1968. Un titre, Dance to the music, un joyeux bordel psycko-funk – on ne le dénommait pas ainsi – l'on aurait plutôt employé l'expression rythm'n'blues déjanté – un truc plutôt sympa qui ne s'inscrivait pas dans la lignée préférée des fans de rock. En ces temps reculés les amateurs se branchaient sur les Doors, Steppenwolf, MC 5, Stooges... Les radios ne suivaient pas les groupes sur le long terme, tout nouveau morceau qui n'accrochait pas immédiatement l'oreille des auditeurs était délaissé. Beaucoup d'artistes anglais et américains n'eurent ainsi en notre douce France qu'un unique succès, matraqué à mort durant deux mois, et puis plus rien. A vous de vous débrouiller comme vous pouviez pour suivre la suite des aventures. Bientôt il ne restait plus dans votre esprit surchargé qu'un nom évanescent... Faut dire qu'à l'époque il naissait un groupe intéressant toutes les heures...
SLY STONE AND THE FAMILY

Sly and the Family Stone était un groupe mixte composée de membres masculins et féminins – phénomène tout naturel dans une famille – de frères et de soeurs de sang et d'amis de hasard et de rencontre, mais aussi de noirs et de blancs. Ce qui à l'époque sentait un peu le soufre. Nous sommes en pleine lutte des droits civiques et les idées qui marchent très vite ont souvent beaucoup plus de mal à s'appliquer dans la vie pratique... Les premiers enregistrements de Sly and the Family Stones sont porteurs de l'immense espoir de la communauté noire qui pressentait que le bouchon du racisme institutionnel qui la maintenait dans la catégorie des citoyens de seconde classe ne tarderait pas à sauter.
Sly and the family Stone était en avance sur son temps. Ce qui n'est pas un bien soi. Le monde ne se dirige pas vers un plus grand progrès en suivant une course d'amélioration exponentielle. En ces mêmes années James Brown jetait les bases rythmiques du funk, lui aussi revendiquait la fierté noire, Say Loud, I'm Black and I'm Proud. Sly participait à la même course, mais il était en tête. James Brown, c'était un peu marche au pas et file tout droit. Le premier musicos qui s'autorisait un pain sur scène écopait d'une amende. Sly ne jouait pas le père fouettard. L'exubérance régnait en maître. L'on s'habillait comme les Beautiful People de la précédente année de l'amour, l'on fumait et l'on avalait des pilules comme l'on respirait, l'on portait beau, de Sly il émanait un charisme psychédélique à la Hendrix. Quant à la musique elle éclatait dans tous les sens, des fricassées de guitares sursaturées rehaussées de cuivres étincelants. Rien à voir avec les lourdes sections carrées de chez Stax, ça montait haut, très haut sans souci de redescendre. Sly se permettait tous les mélanges, il était un sorcier du multipiste. La hype et le funk. Toute la musique noire d'aujourd'hui descend du cortège oriflammesque de la Family Stone.

Et puis inexplicablement la machine s'enraya. En 1970 tout le monde est dans l'expectative, mais quand est-ce donc que le nouveau trente-trois tours sortira ? Il arrive en retard, fin 1971, l'Amérique se précipite, numéro un des ventes, mais même si l'on n'ose pas le dire tout haut, l'on est déçu. La joie irrémissible qui faisait la marque de fabrique de Sly s'est envolée. Que se passait-il ? Le titre, There's a riot goin'on, trimballait tout de même un orage de promesses euphoriques. A la même époque pour donner un aperçu similaire en France les organisations gauchistes prophétisaient que le fond de l'air était rouge.
Aujourd'hui l'on sait que la réalité était porteuse d'un rose très pâle... Sly fit le même constat mais en employant les couleurs de l'Amérique. Sly tire le bilan de la lutte pour les droits civiques. L'orgueil noir a viré au gris. Greil Marcus pousse l'analyse un peu plus loin que d'habitude. La mort de Luther King n'est qu'un prélude. Ce qui est dans la ligne de mire ce n'est pas un prêcheur pacifiste, mais derrière lui le mouvement des Black Panthers que les autorités ont pris la décision de casser. En abattant les militants, en jetant en prison les survivants et les principaux leaders.
Le titre There a riot goin' on signifie exactement le contraire de ce qu'il annonce. L'émeute ne viendra pas de sitôt. Une lecture plus radicale nous dirait qu'il vaudrait mieux se préparer à la lutte armée. Mais Sly n'y croit plus, petit à petit il se retirera de la course au succès.
Greil Marcus est moins sévère que moi dans la condamnation de Motown et des compagnies épigones. Leur laisse quelques mois de grâce. Dès le deuxième semestre de 1972 fleurissent des titres de Curtis Mayfield, des Staple Singers, des O'Jays, des Temptations, de Stevie Wonder qui prennent fait et cause pour la colère des ghettos, et ce mouvement de dénonciation du racisme économique dont sont victimes les populations noires sera repris par une floraison de films, financés par des sociétés de production noires, qui ne cachent plus la violence dont elles sont victimes.
Mais cela sera de courte durée. Une fois que les premières places du billboard sont squattées, l'on va les conserver coûte que coûte... Le feu des dénonciations et des revendications sera vite noyé sous le sirop des violons... à la paupérisation l'on opposera la popérisation. Pour la suite de l'histoire, vous relisez la chronique précédente.
Mais Marcus aime bien insister. Repose les questions simplettes un tantinet gênantes : comment et pourquoi ? Ne donne pas la réponse tout de suite. Prends ses aises et voici qu'il nous entraîne sur une piste qui de prime abord n'a rien à voir avec le sujet, celle de Stagger Lee !
STAGGER LEE

Pour nous ce n'est qu'un titre de Lloyd Price. Longtemps l'on prêta à Price la paternité de The House Of The Rising Sun. Déplorable erreur. Son titre de gloire reste Lawdy Miss Claudy, repris par Presley. L'on savait bien que de Stagger Lee ou de Stag 'O' Lee, il y en avait de multiples versions, un peu comme Frankie and Jonny. Mais l'on ne cherchait pas plus loin. Greil Marcus et quelques autres se lancèrent sur la piste.
Débute à la Nouvelle Orleans avec le rejeton de la famille Stack propriétaire de bateaux à aubes sur le Mississipi. Blouson doré, à l'argent et au colt faciles. Mais ce n'est pas cela. Une histoire banale qui se déroule à Memphis, dans un bar. Stagger Lee joue aux cartes avec un certain Bill Lyons. La mise est dérisoire : chacun met son stetson en jeu. Comme à son habitude Stagger a des as plein les poches, il triche sans vergogne. Lorsque Lyons le remarque, Stagger sort son pistolet et malgré les supplications de Billy qui lui rappelle qu'il a une femme et deux enfants, notre tricheur refroidit son partenaire de poker sans regret.
Billy est mort. Stagger Lee survivra jusqu'à nous grâce à de nombreuses chansons qui sanctifient la déplorable anecdote. Devient le grand méchant loup, celui dont les mamas menacent leurs négrillons : si tu ne manges pas ta soupe... Rien de tel pour ensemencer les imaginations enfantines. Désormais à chaque méfait, bagarre, hold up, vol, viol, meurtre, un seul responsable, Stager Lee... qui se transforme en super héros positif du ghetto, car l'on ne vole pas ses frères, la victime ne peut-être que le blanc. Quand on ne gagne pas dans la réalité, le rêve et le mythe prennent la relève.
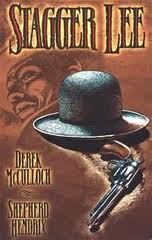
Mais Greil Marcus refuse la bienséance des légendes roses. La vie est toujours plus noire que ce que l'on imagine. N'ayez pas pitié de Billy qui laisse deux lionceaux orphelins. N'était pas un enfant de coeur. Ni plus ni moins qu'une crapule. Ne vaut pas plus que son assassin. S'il avait tiré le premier, il s'en serait mieux sorti. Honneur aux forts, honte aux faibles. L'histoire de Stagger Lee est facile à résumer : c'est celle d'un noir qui tue un autre noir. Ce n'est pas si ancien que l'on désirerait le croire. Ca se passe tous les jours dans les cités. Les dealers s'entretuent pour quelques dollars, les gangs se déclarent la guerre pour agrandir leur territoire... L'argent noir de la pègre noire est aussi sale que celui de la maffia blanche. Comme son alter ego il atterrit en bout de course dans la poche des banquiers noirs qui le recyclent et l'investissent dans les affaires. Notamment dans la musique... La boucle se referme... L'on ne cherche pas à redistribuer aux pauvres mais le profit à court terme. L'artiste politiquement engagé a intérêt à la mettre en veilleuse. Inutile d'attirer l'attention des autorités en tenant des discours séditieux.
La coupure ne passe pas obligatoirement entre les gentils noirs et les méchants blancs. Plutôt entre les dominés et les dominants, les pauvres et les riches. Lutte de classe, plus que de couleur. L'en est de la soul et du rhythm & blues comme du rock'n'roll, lorsque les gros capitaux lui mettent le grappin dessus ils commencent leur oeuvre de castration. En fait ça a beaucoup avoir avec les mésaventures du rockabilly.
Damie Chad.
22:34 | Lien permanent | Commentaires (0)
20/12/2013
KR'TNT ! ¤ 153. JALLIES / FRED NEIL / LITTLE BOB / PAUL PECHENART/ CHRISTIAN LAURELLA
KR'TNT ! ¤ 168
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
19 / 12 / 2013
|
JALLIES / FRED NEIL / LITTLE BOB / PAUL PECHENART / CHRISTIAN LAURELLA |
LOCAL DES LONERS / LAGNY SUR MARNE
13-12-12 / THE JALLIES
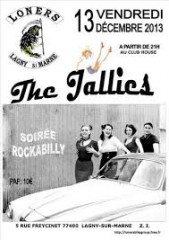
Vous croyiez en avoir fini avec ces demoiselles, et bien non ! Voici qu'elles investissent le local des Loners. Pas tout à fait au hasard, puisque le groupe s'est formé lors d'une fête chez nos bikers voici près de deux ans. Une idée soulevée par Ady qui se concrétisa très vite... Nous on aime bien le local des Loners – pas l'architecture, l'accueil chaleureux que l'on y reçoit – et l'on adore les Jallies, deux raisons plus que nécessaires et suffisantes pour passer prendre Mumu et Billy dans la boutique de fringues ( sur-mesure rock ) de Billy et de foncer comme des cabourgs sur la route de Lagny-sur-Marne. En plus on commence à connaître, une seule petite erreur – léger détour de cinq minutes autour d'un pâté de maisons – et la teuf-teuf mobile se gare comme une fleur au 5, rue Freycinet. Plus tard dans la soirée, l'on compatira avec ces malheureux qui ont tournoyé durant deux heures avant de s'arrêter par un de coup de chance inespérée devant les tonneaux en feu allumés par les loners pour signaler les festivités.
Comme l'Histoire aime bien bégayer ( voir la livraison 167 ), la première personne sur qui l'on tombe sera Julio qui tire flegmatiquement sur un mégot devant l'entrée. Vous l'avez deviné, les galinettes sont dans les coulisses en train d'enfiler leur tenue de bal... A l'intérieur l'on retrouve Celia, amie des Jallies, qui nous raconte ses trois mois passés en Irlande, à errer de pub en pub, de concert en concert. N'a qu'une envie, d'y retourner le plus tôt possible. Beaucoup plus de pluie que dans la Brie, mais de la musique partout. Un pays de rêve. De la bonne bière, en plus. Du mauvais chômage, aussi. Note ô combien discordante !
WE ARE THE JALLIES

Annoncent fièrement le premier morceau. Ce sont bien elles. Vaness a emprunté une des robes bleues d'Ady, ressemblent toutes les deux, avec leurs yeux pétillants de malice, à deux jeunes lycéennes échappées d'un pensionnat en folie afin de commettre les mille bêtises de la vie, l'une après l'autre, méthodiquement, à vider jusqu'à la dernière goutte la coupe de la joie de vivre. Ne comptez pas sur Céline pour donner un semblant de sérieux à la formation, en grande forme Céline, chante à gorge déployée et fait de grands gestes comme Avalokitesvara la déesse aux mille bras. Pendant que les miss pérorent, Julio discute avec sa contrebasse, la seule nana du groupe qui condescend à lui adresser la parole sans lui sortir une méchanceté. Notons que ce soir, elles lui feront l'aumône de lui tendre le micro pour qu'il puisse pousser la tyrolienne ( pas plus de neuf secondes, il ne faut pas exagérer ) sur le final du Whole Lotta.
Hound Dog, tiens l'on dirait un disque avec une erreur de curseur, le 45 tours en 33, ça patine ramollo dans la choucroute, et vroum ! le chien méchant arrache la chaîne qui le retenait au mur de la maison, et se lance à votre poursuite, gare à vos fesses la meute des chiennes hurlantes est après vous, et vous allez sentir si c'est du play back ! Ca se termine sous une pluie d'applaudissement, les Jallies savent mener la chasse. Un peu de Charleston Swing pour rappeler qu'elles sont aussi un groupe de swing. Rockabilettes, certes mais avec cette touche de bop-swing qui n'appartient qu'à elles.

Money Honey, une version que je qualifierais plus noire que d'habitude, plus proche des Drifters que de Presley. C'est que l'air de rien, elles travaillent leurs morceaux à la maison. Des filles sérieuses, qui modifient et améliorent leurs devoirs. Les mêmes plats, mais en changeant la sauce elles initient d'autres saveurs. Elles peaufinent, elles rééquilibrent, elles transmuent. Le même récital qu'au Be Bop, la semaine précédente, mais coloré autrement. Ne nous lassent pas.
Johnny's Got a Boom Boom. Julio nous donne une leçon de contrebasse. Tout à l'heure, lors du deuxième set discrètement il entourera un de ses doigts de sparadrap. Ne m'étonne guère vu la fureur avec laquelle il étripe les cordes, et relâchées, au lieu de geindre elles explosent en grosses cloques sonores qui structurent toute l'armature du morceau. Au chant, Ady nous offre une splendide version du titre d'Imelda May. Justesse de la voix, et appropriation personnelle par cette manière d'écraser la texture des lyrics en cris de rage. Ne s'arrête pas en si bon chemin elle enchaîne sur A Train Kept A Rollin, pas dans l'esprit de la version swing originale de Tiny Bradshaw mais en suivant les rails de la furia dévastatrice de Johnny Burnette.

Un boogie et un remue-ménage-méninge à la Jerry Lou pour nous faire regretter l'interlude qui sépare les deux parties et les Jallies descendent de scène. Ady a si bien su imiter les camelots des anciens temps pour annoncer le disque – une véritable medecine woman - qu'elles passeront leur temps à autographier leur petite merveille.
CRACKER JACK

Gourmandise caramélisée pour ouvrir le deuxième set. Très vite Vaness passe les balais à Céline - qui en époussette un peu violemment la caisse claire - et s'empare du micro. Un Fujiyama Mama à vous enlever le pyjama et un Crazy Legs à vous couper les jambes. Voix de tigresse, altérée de sang. L'a délaissé la batterie, mais ça marche à la baguette, que dis-je à la trique. Et pendant qu'elle feule les deux copines font les innocentes, voix suave des choeurs, piège diabolique de sirènes odysséennes qui vous tentent de vous amadouer pour mieux vous croquer par la suite.
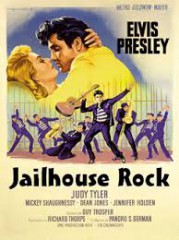
Jailhouse rock et Movin on, deux classiques du rock ne peuvent vous faire de mal. A prendre entre les dents servis chaud et à toute vitesse. L'on reprend souffle, nous le public, parce que le Good Bye Bessie Mae, ce doit-être une pétaudière à chanter, toutes ces voix qui s'entremêlent à n'en plus finir, doit pas falloir mélanger les pelotes. Elles ressortent du labyrinthe, toutes souriantes. Elles ont vaincu le minotaure, mais le corps à corps avec le monstre a dû leur donner des idées.
Des désirs aussi. L'on descend d'un cran. Je ne parle pas de la qualité musicale, mais de la localisation géographique. L'on se dirige vers les membres inférieurs. Un Swing des Hanches parce qu'en son temps Elvis fut baptisé the pelvis, mais l'on ne s'attarde pas, il est temps de passer à la chose sérieuse. Cours d'anglais, c'est Ady qui se charge des explications et de la traduction en langue gauloise – Shave Your Pussy, dédié aux garçons tourbillonnants que sont les Spuny boys – toutes les filles connaissent ce conseil de beauté, d'une manière très euphonique signifie Rase ta chatte. No shockin ! Personnellement j'adore les animaux. Aux approbations qui fusent de la salle, doit y avoir un congrès de la SPA dans le secteur de Lagny-sur-Marne. Une véritable pussy riot émeute. N'en déplaise à tous les Poutine de la terre.

Nos trois minettes sont sur un toit brûlant. Straycats Strut qui suit n'arrange pas la situation. A tour de rôle elles miaulent avec désespoir, elles appellent le matou à rayures en rut, elles nous pondent une de ces abominations rock qui plus tard, le jour funèbre du jugement dernier, leur vaudra les flammes de l'enfer. Mais pourquoi Dieu a-t-il placé le sex si près du rock'n'roll ? Sans aucun doute pour que l'on s'amuse davantage.
Et l'assistance exulte. Ce soir elles sont vraiment The Queen(s) of Rock'n'roll. La soirée s'achève sur un Jump, Giggles and Shouts d'anthologie.
AFTER SHAVE

Encore des autographes à apposer sur les disques. Sont crevées et flapies nos gélinettes, mais Billy décide de leur apprendre à danser le rock, préfèreraient écluser quelques verres de rouge ou de bière en toute tranquillité, mais non, faut qu'elles s'y mettent. Reconnaissent qu'il a de sacrés talents de professeur le Billy. Avec lui tout est facile. Durant le set, s'est chargé de toutes les demoiselles timides qui n'osaient pas. Sont reparties enchantées, les guide si bien qu'elles ont l'impression de savoir danser depuis toujours. Bil l'yllusionniste !
La soirée s'achève. Céline joue au roadie. Elle range son matos. Pluie au-dehors. Elle a enlevé son bandana de corsaire et relâché ses cheveux sous un bonnet de laine blanche. Qu'est-ce qu'elle est belle ainsi, parmi la corolle ondulée de sa chevelure auburn ! Bises à tout le monde. Les routes dégoulinantes d'eau froide et la nuit ouatée de brouillard nous attendent.
Damie Chad.
AUX SOURCES DU NEIL

Oui, Fred Neil tient du fleuve. Par le côté majestueux et intemporel de sa musique. On aurait tort de vouloir l’enfermer dans la fameuse catégorie des folkeux. Il est hors cadre. Il s’accompagne d’une guitare, c’est vrai, comme Nick Drake, Roy Harper, Jimi Hendrix ou Marc Bolan. S’il fallait le situer en quelques mots, on pourrait dire de lui qu’il a une voix à la Johnny Cash et qu’il chante des mélodies ensorcelantes.
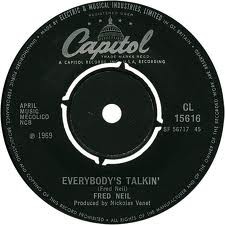
Il est surtout connu pour trois chansons, reprises par des grosses stars des sixties : Nilsson fit une reprise de «Everybody’s Talkin’» pour la bande originale de «Midnight Cowboy», le Jefferson Airplane reprenait «Other Side Of This Life» sur scène et Tim Buckley fit une reprise inspirée d’un morceau qui l’était déjà énormément, «The Dolphins», ces fameux dauphins pour lesquels Fred Neil avouait une passion. Des gens comme David Crosby, Gram Parsons, Stephen Stills et John Sebastian le vénéraient. Stills et Crosby le considéraient comme un immense chanteur - oh man could he sing ! Le futur Lovin’ Spoonful John Sebastian jouait de l’harmo sur «Bleeker And MacDougal», l’album phare de Fred Neil paru sur Elektra en 1965. On trouve aussi sur cet album un certain Felix Pappalardi à la basse mexicaine. Que de beau monde autour du petit Fred...

En s’électrifiant encore davantage, Fred Neil aurait pu faire un malheur aux États-Unis, mais ça ne l’intéressait pas. Il laissait ça aux Byrds et à Dylan. Il fuyait les feux de la rampe. Il ne s’intéressait qu’au blues, «the real blues» - celui de Josh White et de Leadbelly - et accessoirement à l’héro. Il fut l’un des chanteurs phares de la scène new-yorkaise du début des sixties, celle qu’on appelait la scène de Greenwich Village. Une photo le montre sur scène avec Karen Dalton et un jeune Bob Dylan fraîchement arrivé du Minnesota. Fred Neil jouait dans les clubs de Greenwich Village pour quelques dollars. Il s’accompagnait d’une douze cordes et embarquait son public dans un univers de balades magiques. Sur «Bleeker And MacDougal», on en trouve une douzaine, pas moins. Il attaque avec le Bleeker qui donne son titre à l’album, un gros groove débraillé et il installe immédiatement une notion de profondeur et de chaleur, une réelle proximité. Fred chante qu’il veut rentrer à la maison - «I wanna go home». «Blues On The Ceiling» tient du miracle : c’est encore un groove au parfum indiciblement jazzy. Une filet de fumée opiacée effleure la peau - «I’ll never get off this blues alive». Avec «Little Bit Of Rain» on monte encore d’un cran dans le vertige sensoriel. La pureté de cette mélodie frappe tant qu’on pense immédiatement à «Pale Blue Eyes» du Velvet. On y surprend des accents similaires, des profondeurs émotionnelles d’une rare beauté. Fred Neil laisse flotter sa mélodie - timbre flotté à l’excès chaud. La parenté avec Johnny Cash apparaît clairement dans «Other Side Of This Life». Il nous refait Folsom. C’est quasiment le même son - mais sans le tagadac - la même ampleur et la même pente. «Mississipi Train» est une petite merveille d’americana bluesy bardée d’harmo. Fred Neil nous bourre ça de classe hargneuse. Pareil pour «Travellin’ Shoes», tapé à la Dylan, sur une fabuleuse mélodie descendante, et John Sebastian souffle comme un fou dans son harmo. C’est absolument exaltant, embarqué comme pas deux, gratté à l’os, mélodiquement parfait - «My travellin’ shoes !» C’est le morceau de folk-rock idéal, bourré d’énergie et de classe vocale. Puis on ira de grosse surprise en grosse surprise jusqu’à la fin de cet album hors compétition. «The Water Is Wide» est une belle bluette diantrement inspirée, chaude, embarquante, et comme l’indique le titre, vaste comme un océan. Profondeur et vibrato restent les deux constantes de Fred Neil, bercing blues boy de rêve. Et si on aime le blues joué en picking, alors on se régalera avec «Yonder Comes The Blues». Fred Neil écrivit «Candy Man» pour Roy Orbison et ça devint un tube. C’est une belle pièce montée sur des accords à la Bobbie Gentry - «C’mon babe let me take you by the hand.» C’est une fois de plus gratté sec et dévoyé à l’harmo. Fred pousse des coups de baryton comme Ike Turner. «Gone Again» frappe par l’ampleur du ton - «Can you hear the whistle - on on on - on that lonesome train !» Retour au shuffle mythique du lonesome train des blues de base - «I’d loved to stick around/ But you know I’ve got to go again.» Et ça tourne à l’hypnotisme avec l’harmo qui file dans le fond - «I love you baby/ But you’ve got to understand right now !»

Avant d’arriver à New York avec sa guitare, Fred Neil traînait dans le Deep South avec son père qui vendait des juke-box. Au Texas, il fréquentait Roy Orbison et Buddy Holly. Il chantait dans une troupe de gospel et il a ensuite bricolé quelques trucs avec Bobby Darin. À Greenwich Village, il s’est vite taillé une grosse réputation de star underground et de junkie. Crosby, Stills & Nash envisagèrent d’appeler leur groupe The Sons Of Neil. Jac Holzman - patron d’Elektra - ne renouvellera pas le contrat de Fred Neil après «Bleeker And MacDougal» parce qu’en tant que junkie, Fred était parfaitement ingérable. Mais c’est à Paul Rothchild, producteur attitré d’Elektra que revient la palme de la dent dure : «J’ai eu le malheur de produire Fred Neil. C’était un auteur-compositeur brillant mais aussi une véritable ordure. Il fut un précurseur chez les artistes camés, la première épave rock. On planifiait des séances d’enregistrement, et il ne venait pas. C’est pourtant le mec qui a composé ‘Candy Man’, un tube de Roy Orbison. Le jour où il a composé ce hit, il est allé au Brill Building le vendre à vingt producteurs différents et chaque fois il empochait cinquante dollars. Ce n’est pas quelqu’un de bien. Il allait chez Izzy Young - qui dirigeait le Folk Center à Greenwich Village - et lui disait : ‘Izzy, j’ai un concert ce soir et je n’ai pas de guitare.’ Et Izzy lui répondait : ‘Freddie, tu m’as déjà emprunté une vingtaine de guitares, mais je t’aime bien, voilà une autre douze cordes.’ Et Freddie allait au club complètement défoncé - il était tout le temps complètement défoncé - j’ai pu le constater à bien des occasions - il n’arrivait pas à accorder sa guitare, alors il la fracassait sur scène. Cette guitare ne lui appartenait pas.»
Ironie du sort, ce n’est pas Fred Neil qui ira au ballon pour possession de drogue, mais Paul Rothchild qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. Il aura même une veine de pendu, parce que son boss Jac Holzman lui redonnera son poste de producteur à sa sortie du ballon.

Viré d’Elektra ? Fred Neil s’en bat les coquillettes. On lui déroule le tapis rouge chez Capitol. Il enregistre neuf chansons vite fait pour un premier album, mais le producteur lui en réclame une dixième. Fred rechigne. Le producteur l’enferme dans les toilettes : «Tu sortiras quand tu auras fini ta chanson». Fred se marre. Il se fait probablement un shoot vite fait et dix minutes plus tard, il ressort avec «Everybody’s Talkin’». Le producteur est subjugué par la qualité du morceau. On passe au studio. Fred enregistre ça en une seule prise. Le producteur lui dit que ce serait mieux si on musclait le tempo. Fred refuse et se casse. Il en a marre. Tout ce cirque ne l’intéresse pas. C’est Nilsson qui musclera le tempo et qui tirera les marrons du feu avec ce hit planétaire et qui par la même occasion deviendra une star.

Le premier album de Fred Neil sur Capitol s’intitule «Fred Neil». Pochette noire avec un portait en noir et blanc, très sobre. Comme Bleeker, ce disque hante les oreilles. Fred démarre avec «The Dolphins», du gros balladif doux et tendu, visité par la grâce d’un solo de guitare sibyllin. Il va chercher ses intonations au plus profond d’un gosier parcheminé, comme le fait Johnny Cash. Fascinante entrée en matière. Tout Tim Buckley vient de là. Rebelote avec «I’ve Got A Secret», balladif doucement visité par des accents country. Fred Neil va chercher sa mélodie très loin dans l’espace d’une vision unique. C’est la bande-son idéale pour traverser des pays étrangers en voiture. Les paysages défilent admirablement bien. Il fait monter son shake sugaree très haut et redescend doucement dans le velouté. La chose est littéralement pourrie de feeling. Al Wilson - Canned Heat - joue de l’harmo sur «That’s The Bag I’m In», un groove bluesy très imposant. Peter Childs claque un solo tordu et imparable à l’acoustique. On retrouve le timbre mûr de Fred Neil sur «Badi Da». Beauté pure, chaleur et mélodie ensorcelante. On revient au groove océanique avec «Faretheewell». La mélodie se déroule sous nos yeux ronds et lance mille petites langues de beauté orientale. Fred Neil fait geindre ses syllabes argentées et le son vibre au creux d’une paume d’ouate qui s’évapore aussitôt. C’est une poursuite insensée du frisson, parmi les notes de guitare en suspension et la chaleur d’une haleine. On se heurte une fois de plus à la suprématie de la mélodie. «Everybody’s Talkin’», c’est tout simplement un coup de génie. On trouve encore une autre merveille sur cet album. Il s’agit de «Green Rocky Road», un country-rock élégant, bardé de gimmicks fouillés. Derrière, on s’active sur les manches des guitares sèches, ça grouille de son, et c’est le meilleur son d’Amérique. On entend ces guitares pluridisciplinaires en avance sur leur temps. Ils grattent comme des malades et Fred fait la loco.

Un autre album de Fred Neil vaut le détour : «Other Side Of This Life», sorti aussi sur Capitol, avec une face enregistrée live et l’autre face bourrée de fonds de tiroirs. Dès le premier morceau, on réalise que Fred live, c’est encore mieux que Fred en studio. Il attaque au feeling pur et bat sa puissante mélodie seigneuriale sur le manche de sa guitare. Il est tellement bon qu’il éclate de rire à la fin du morceau. Pour lui, c’est un jeu d’enfant que d’être un petit génie. Quand on écoute «Roll On Rosie», on voit tout de suite que tout Ritchie Heavens vient de là. En direct. Le côté salubre et incantatoire. Il nous balance ensuite une version de «The Dolphins» qui est en réalité une véritable bénédiction mélodique. Fred et son collègue Monte Dunn font scintiller les notes de guitare. Comme Dennis Wilson, Fred recherche le groove océanique à l’état le plus pur. Versions somptueuses et plus soft de «That’s The Bag I’m In» et de «Sweet Cocaine». Il faut voir comme ça balance. Et derrière ça joue en solo en continu, comme dans certains morceaux de Sister Rosetta Tharpe ou de Mighty Baby. On retrouve avec plaisir «Everybody’s Talkin’», l’archétype de la mélodie parfaite, véritable machine à remonter le temps, retour à l’enchantement du film et au monde mythique des deux paumés de Brooklyn, Rico Rizzo et Joe Buck. Sur l’autre face, Fred se retrouve accompagné d’un orchestre. «Come Back Baby» vire carrément jazz et tout le monde semble rivaliser de feeling dans le studio. Et on retrouve une version de «Badi Da» étirée au soleil d’Orient. La version croche et on s’émerveille. Puis Gram Parsons chante «Ya Don’t Miss You Water» avec Neil et ça vire carrément country. Impossible de faire autrement, avec Gram Parsons.

Fred Neil n’eut jamais l’intention de faire carrière. Il finit par se lasser de Greenwich Village et des chausse-trappes de la vie de bohème et il mit les voiles, comme voulait tant le faire Rico Rizzo. Il alla s’installer au soleil, loin des manipulateurs du show-business et des mauvaises langues comme ce persifleur de Paul Rothchild. Direction Coconut Grove et Key West, en Floride - terre d’adoption d’Iggy, de Kevin K et de bien d’autres héros. Des gens comme Ben Vaughn ont essayé de faire revenir Fred en studio, mais ça ne l’intéressait pas. Fred proposait qu’on enregistre Karen Dalton à sa place. C’est à David Crosby que revient l’insigne honneur d’enfoncer le clou : «C’était un mec incroyablement doué qui n’avait rien à voir avec l’industrie du disque. Plus ça devenait commercial et moins ça intéressait Freddie. Alors, il a fini par disparaître.»

Bleeker fait partie de la série des cadeaux royaux. Du pur John Ives - my old mate. Ce disque fait désormais partie des hanteurs du château. Nous en discutions, l’autre soir au téléphone. Nous épluchions les morceaux un par un, confrontant nos point de vue de possédés éméchés et John Ives déclara : «C’est un disque que tu peux me faire écouter vingt fois de suite, hic, je ne te demanderai jamais de le changer !»
Signé : Cazengler, vi-Neil junkie
Fred Neil. Bleeker & MacDougal. Sundazed Records 2001
Fred Neil. Fred Neil. Capitol Records 1967
Fred Neil. Other Side Of This Life. Capitol Records 1970
Mick Houghton. Becoming Elektra. Jawbone Books 2010
STORIES OF LITTLE BOB
HISTOIRES POUR ROBERTO
( Krakoën / Avril 2013 )
PREFACE DE LITTLE BOB.
LUC BARANGER. MARION CHEMIN. THIERRY CRIFO. DOMINIQUE DELAHAYE. JEANNE DESAUBRY. SERGUEI DOUNOVETZ. ALAIN FEYDRI. DENIS FLAGEUL. PASCAL JAHOUET. LAURENT JEZEQUEL. STEPHANE LE CARRE. JEAN-NOËL LEVAVASSEUR. JEAN-LUC MANET. OLIVIER MARTINELLI. PIERRE MIKAÏLOFF. MATHIAS MOREAU. MAX OBIONE. STEPHANE PAJOT. GILLES POUSSIN. JEAN-BERNARD POUY. FREDERIC PRILLEUX. SYLVIE ROUCH. VANESSA SIMON CATELIN. BRUNO SOURDIN.
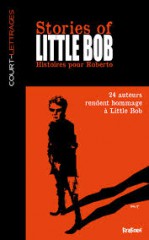
On ne change pas une formule qui gagne. La nouvelle mouture des Editions Krakoën ne s’est pas contentée de ressortir Stories of The Dogs ( voir KR'TNT 155 du 12-09- 13 ), lui ont donné un petit frère jumeau, Stories of Little Bob ( les rockers apprécieront le jeu de mots ), maquette de couverture similaire, même principe de composition, un panel d’auteurs offrant une nouvelle censée être en phase avec l’univers de l’artiste. On n’a pas repris les mêmes mais presque, l’on a pris la peine de multiplier par quatre la participation de la gent féminine, et cette fois-ci les textes ne sont pas classés par l’ordre alphabétique du patronyme des écrivains mais placés selon la chronologie de sortie de chacun des albums de Little Bob que l’histoire racontée est censée évoquer.
A mon humble avis ce recueil est mieux réussi que le précédent. Davantage axé sur la personnalité de Little Bob que ne fut celui dédié à Dominique Laboubée. Peut-être est-ce dû au personnage de Roberto Piazza tout aussi authentique que le guitariste des Dogs mais d’un abord moins lointain, plus sympathiquement proche de vous. Et puis les auteurs ont aussi fait l’effort de coller un peu plus aux thèmes évoqués par les morceaux de notre rocker national.
Vous les laisse découvrir. Noir et sang, mais on varie les plaisirs, de la serial killeresse à la science-fiction style blade runner, de la dénonciation sociale aux rebelles festoyances des jeunesses modernes, c’est notre monde qui passe en ces vingt quatre courts récits, de la préhistoire robertienne à notre no future programmé. Etrange comme en sept ans d'écart entre la composition des deux recueils l’on s’est écarté des poncifs mythiques rock and rolliens pour rentrer dans la peau de notre présent éclaté. Comme s’il était devenu plus difficile de vire dans la dimension de ses propres rêves.
C’est un peu ce que Little Bob nous dit à sa manière dans sa brève préface. Trace sa route de plus en plus loin des autoroutes du show biz. S’enfonce dans les tunnels de l’Underground. Auto-production, pour mieux survivre sans avoir à se renier. Leçon d’un guerrier du rock and roll à méditer.
Damie Chad.
PAUL PECHENART
UNE GROSSE BOULE DE FEU
( Camion Blanc / Octobre 2013 )
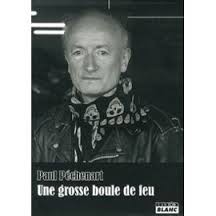
Great Balls Of Fire ! Avec un titre de cet acabit, sûr que ça va déménager sec. J'ai pris le bouquin les yeux fermés ( pas tout à fait, la caissière avait un de ces sourires ! ). Et puis Paul Péchenart, ce n'est pas n'importe qui. Fut le guitariste des Dogs. L'était là au tout début, les deux premières années, de ce que l'on pourrait appeler la formation initiale, bien avant l'enregistrement du premier disque. Et tout ce qui suivit, une vie consacrée à la musique... Doit en avoir des anecdotes truculentes à raconter, me voyais déjà entraîné dans les coulisses du rock and roll...
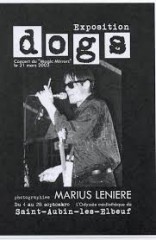
Erreur sur toutes les lignes. Les Dogs ne lèvent pas une seule fois la patte de tout le bouquin. Aucun autre groupe non plus. Heureusement que de temps en temps l'auteur nous parle de la présence rassurante de sa guitare, sans quoi vous pourriez penser qu'il exerce les nobles professions de garçon coiffeur, de courtier en assurance, voire de plombier. Mais sans Watergate, car Paul Péchenart, ne se fait pas mousser, ne se cache pas sous la légende dorée du rebelle adoré, ne se planque pas derrière la mythologie des oripeaux rock. Ne tire pas la couverture. Se met à nu.
Je comprends votre incompréhension. Quoi ! un livre écrit par un rocker, publié dans une maison d'éditions qui a publié près de trois cents ouvrages qui explorent avec méthodicité et sérieux les continents engloutis du rock depuis presque vingt ans et qui ne parle pas de rock 'n'roll ! Aurait-on donné le feu vert du bon à tirer à l'impression, en toute confiance sans avoir jeté un seul regard sur le texte ? Se moque-t-on du monde ? Quel est donc cet ovni qui s'est ne s'est pas posé sur la bonne planète ?

Pas d'affolement. La rock machine fonctionne comme le fameux moteur d'Aristote. Fout tout en branle, propulse le mouvement, mais si vous soulevez le capot, vous hoquetez de surprise, vous vous attendez à trouver le super carburateur en train de trépigner, mais non, il ne fonctionne pas, il ne marche pas, n'est même pas alimenté en essence. Le coeur du moteur, ne bouge pas d'une soupape, ce qui produit le mouvement est d'une immobilité absolue. C'est difficile d'imaginer une Harley qui filoche sur la Highway sans que ne ronronne à plein régime la mécanique sacrée, mais c'est ainsi. Aristote dixit. Si vous n'avez pas envie de vous replonger dans La Métaphysique du maître d'Alexandre le Grand ( un sacré rocker Hellène ) pensez à la formation d'un ouragan. Dévaste tout sur son passage, balaie les maisons comme de vulgaires miettes de pains, arrache les arbres comme des fétus de paille, mais si vous avez la chance de pénétrer en son centre, vous êtes surpris, silence absolu, pouvez vous poser sur une chaise longue et siroter un petit sky tout en fumant un des merveilleux cigares de Jerry Lou. Tout ça à l'oeil.
Paul Péchenart ne raconte ni les concerts incandescents, ni les longues tournées harassantes, ni les beuveries avec les copains. No fun. No drugs. No sex. No rock'n'roll. Ne fait pas visiter la devanture. Les paillettes, le glam et tout le bataclan, faudra vous en passer. L'enlève le perfecto, et le foulard à tête de mort. Directement à l'essentiel. Ce n'est plus le rocker qui fait étalage de ses frasques. Mais l'animal humain qui se dévoile. Attention, aucun strip tease déplacé. Effeuille les mots, mais ne dénude qu'une nudité intérieure. Pas de révélations fracassantes, pas de posture m'as-tu vu, pas de populisme psychanalytique.
Doucement mais sûrement. Faut attendre le dernier mot de la dernière page du dernier chapitre, pour avoir la clef de l'énigme. A part qu'il n'y a aucun mystère, et que la serrure n'était pas verrouillée. Le tout est d'oser pousser la porte. Même pas peur, le méchant loup n'est pas derrière, il y a longtemps qu'il vous a dévoré le coeur, mais ce n'est pas parce qu'il s'est enfui de sa cellule que le prisonnier est libre. La prison vous suit partout. Paul Péchenart n'a pas ménagé sa peine. Un demi-siècle à s'attaquer à l'huisserie avec le chalumeau de sa guitare rock. Sans succès. Inutile de passe en force. L'on peut exploser les gongs à la dynamite punk, vous ne ferez qu'écailler la peinture.
D'où Elvis Presley, d'où Gene Vincent, d'où Jerry Lee Lewis – je cite ces trois-là mais la liste est longue – tiraient-ils leur force ? De leur voix, de leurs virtuosité, de leur art ? Non tout cela n'est que le résultat, la conséquence de quelque chose de beaucoup plus intérieur. Les optimistes affirmeront qu'ils n'ont fait que transcender leur joie de vivre, l'insolente vigueur de leur jeunesse. Just for fun. Serai davantage pessimiste. De leur solitude, avancerai-je. Inhérente à la condition humaine. Chacun se débat avec ses propres spectres. Histoire intime. Partagée par tous, mais vécue individuellement. Certains s'en sortent plus ou moins bien. Les fantômes sont plus ou moins consistants.

Paul Péchenart a dû se battre contre de drôles de monstres. L'ont agressé, lui ont sauté dessus alors qu'il ne s'y attendait pas. Les avait pris pour des êtres inoffensifs. Peut-être en fait étaient-ils déjà en lui depuis le jour de sa naissance, voire de sa conception. Peut-être appelons-nous agression tout ce qui nous arrive. Les bonnes choses comme les plus mauvaises. N'accusons pas les autres. Un seul coupable, nous. Si la lame s'enfonce en nous, c'est que nous sommes trop mous, trop faibles. Nous ne sommes pas assez fort, et nous transmuons cela, en auto-culpabilisation. Pire, c'est armé de ce seul bouclier que nous marchons à la rencontre du monde. Piètre protection, il est facile de se jouer de nous. Contre nous, à tous les coups l'on gagne.
Avec nous aussi. Le bonheur se rit de nous. Nous accompagne un bout de chemin, s'enfuit au milieu du gué, là où les pierres sont glissantes, nous laisse en plan sans préavis. Paul Péchenart ne collectionne pas les groupies croustillantes. Du mal à établir le contact. N'est pas le mâle conquérant qui n'a qu'à claquer les doigts pour que la poulette se glisse dans ses draps. Lui échoit le rôle du chevalier servant. Fidèle mais mal récompensé. L'en souffre, ce qui ne les empêche pas de sulfater grave.
Mais il faut vivre. Paul Péchenart tient le compte de ses stratégies de survie, de ses chemins de traverse qui ne le mènent jamais exactement où il voudrait se rendre mais qui le rapprochent du but fixé. Mais quand il avance de deux pas, l'horizon recule de trois. Ne se décourage pas. S'obstiner ou périr en route, sur le bord du chemin. Etroit, très étroit. Symboliquement, il est incapable d'écrire son journal, sur son ordinateur ou sur une page blanche, se contente du petit format de l'écran de son portable. Comme s'il envoyait des SMS amicaux à des connaissances. Mais en fait il ne s'adresse qu'à lui-même et ne tient pas à jauger du regard l'ampleur du désastre. Goutte à goutte. Le poison passe mieux.
Agit au final aussi comme un antidote. La publication en est une preuve. Peu de monde est capable d'une telle intégrité. Je ne parle pas des rockers qui se doivent d'assurer un minimum d'image afin de ne pas décevoir leur fan. Mais de ceux qui font profession d'écriture. Le roman moderne est embourbé dans un narcissisme déplaisant. L'on y met en scène, ses défauts, ses travers, ses échecs. C'est devenu la norme. Les bobos racontent leurs bobos. Les mêmes que les vôtres, du moins ce que vous consentez à avouer. Paul Péchenart ne triche pas. Ne se contente pas de souligner ses imperfections trop humaines. Ne se met pas à votre niveau. Ne vous tend pas un miroir qui reflète une image acceptable de votre personnalité. L'enlève toutes ses écailles protectrices, déchausse ses crocs pointus et abandonne ses griffes acérées. Le crocodile rock ne se présente pas comme un cruel saurien. L'avoue qu'il ne vaut rien. Que tout cela n'est que de l'apparence. Une baudruche qu'il vide consciencieusement de son air. Vide l'enveloppe du poupon gonflable auquel nous essayons de ressembler. Paul Péchenart préfère s'approcher de sa réalité.
Et au final, il finit par s'accepter, par se retrouver. Tel qu'en lui-même, sa faiblesse se mue en son intégrité. Le livre se clôt sur la reconnaissance de soi-même. Le soleil se lève et illumine toutes les blessures.
Nombre d'amateurs de rock risquent d'être surpris et même déçus par cet ouvrage. Ne retrouveront pas ce qu'ils cherchent. L'imagerie rock'n'roll n'est pas au rendez-vous. N'incruste pas la carapace de la tortue de diamants ou de pierres précieuses multicolores. Paul Péchenart nous parle d'une gosse boule de feu. Mais intérieure, qui ne brille pas comme un feu d'artifice. Lumière froide qui glace l'esprit et brûle l'âme comme des radiations atomiques. Le mal des ardents. Réservé à ceux qui n'hésitent pas à entrer dans la chambre froide de la pulsation vitale de la vie.
Un beau livre.
Damie Chad.
TOURNEE GENERALE
CHRISTIAN LAURELLA
( Editions du Layeur / 2006 )
Vous ne connaissez pas Christian Laurella, bandes d'ignares. Rassurez-vous, moi non plus. C'est un batteur et un percu de jazz. Ne me demandez pas s'il tape bien, je n'en sais fichtre rien. Un mec modeste, en tout cas. Dans son livre il ne parle pas de lui, même si tout repose sur ses épaules. Parle de ses expériences, vingt ans à occuper le poste de tour manager. D'artistes de jazz en tournée en France et en Europe. De grosses pointures. Des cadors, pas du menu fretin.

Le boulot n'est pas facile, grèves d'avions, bus en retard, voitures en pannes, chambres d'hôtels non retenues. Le genre de galère qui arrive à tout le monde, mais quand vous êtes responsables d'un groupe d'hôtes choisis, c'est plus embêtant. Surtout que vous risquez d'en être de votre poche. Alors vous croisez les doigts et vous essayez de naviguer au mieux. Le client possède son carré d'as magique dans sa poche. Le contrat qui stipule ceci ou cela. Avec le couperet du refus de jouer si vous n'honorez pas vos engagements. Plus l'obligation de payer le cachet si vous êtes en votre tort.
Mais il y a encore plus dur que les clauses écrites noir sur blanc. Ce sont les artistes. De grands musiciens, des pros, ils assurent la musique mais question relations humaines, ce n'est pas toujours le top. Donnez du pouvoir à un individu, il y a de fortes chances pour qu'il en profite. Caprices et colères sans cause se succèdent sans trêve. Tout le monde n'est pas ainsi, mais l'ensemble du bouquin sonne un peu triste.
Nos jazzmen ne sont pas des rockers. Pas de groupies hurlantes dans les couloirs, pas de de fêtes, pas d'élans. Ce ne sont pas des groupes, mais des musiciens réunis pour une tournée. Après qui, bye bye au revoir et à la prochaine. Tout semble aseptisé, trop propre comme ces chambres d'hôtel quatre étoiles sans âme. Le confort et la frime. Et puis rien.
Les deux meilleures séquences du bouquin sont celles réservées à Chet Baker et Jaco Pastorius. La détresse et la folie les humanise. Baker qui fixe un cachet unique pour ses concerts, pas très élevé alors que selon les festivals ou selon les organisateurs il pourrait souvent demander davantage. Veut bien gagner sa vie, mais une fois, le gîte, le couvert et la dope assurés, il n'en exige pas plus. Fixe lui-même le rapport marchand de son existence, ne monte pas dans les surenchères, ne laisse à personne d'autre le droit de coter son prix d'achat. Une manière de court-circuiter le système en l'empêchant de faire trop d'argent sur son dos. Même si l'on vous laisse négocier un pourcentage avantageux. Une démarche à méditer.

Chet finira mal. Par la fenêtre de son hôtel. Mais sans doute a-t-il choisi. Pastorius réduit à l'état de sans-abri sera battu à mort. Les clubs de jazz new-yorkais refusent de le laisser entrer. Sa vie et sa musique plongent dans le chaos. Il s'est rendu-compte de l'inanité des conventions humaines. Lorsque Christian Laurella gère sa tournée, il en est encore au stade du refus et du scandale. Il refuse de jouer tant que le grand patron ne sera pas descendu de Paris car il a une discussion extrêmement importante à avoir avec lui. Quand le taulier se radine, il baisse son pantalon et déclare qu'il avait besoin de lui montrer son cul. Bouffonnerie métaphysique, l'avait nécessité de tenir un langage de vérité à tout le cirque de la hiérarchie sociale. La folie ou la mort comme ultime porte de sortie de notre monde. L'artiste endosse le clownesque costume déchiré du pitoyable Auguste. Le jazz vécu comme une traversée des apparences. Ce qui importe c'est de tuer la marionnette humaine. Le pantin de chair et d'os gonflé de suffisance que nous sommes. Rien à voir avec la dignité dont fait preuve un Ahmad Jamal. Certains recherchent la tranquillité d'esprit, la clarté, l'adéquation totale entre la musique, leur intériorité et l'extériorité du monde. Parviennent à l'extase apollinienne. Ahmad Jamal se rapproche de dieu et de la musique classique. D'autres comme Pastorius préfèrent la voix de la main gauche, celle du blues de Robert Johnson, diabolique et dionysiaque. Plus près du rock nd roll.
Damie Chad.
00:23 | Lien permanent | Commentaires (0)
12/12/2013
KR'TNT ! ¤ 167. KEVIN K / JALLIES / ROCK RECUP / JOHNNY HALLYDAY
KR'TNT ! ¤ 167
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
12 / 12 / 2013
|
KEVIN K / JALLIES / RECUP ROCK / JOHNNY HALLYDAY |
L'ESCALE / LE HAVRE / 07 - 11 – 2013
kevin k
LA KLASSE DE KEVIN K

It was raining cats and dogs ! C’est la formule qu’emploient les Britanniques pour dire qu’il pleuvait à verse. All day. Toute la journée. Un déluge sans fin. La nuit tombait et il pleuvait toujours autant. «Apocalyptique !», aurait décrété Nostradamus, s’il s’était trouvé assis à l’arrière de la voiture. On prenait la route du Havre. Un chaos. Les rafales d’eau fouettaient des milliers de véhicules qui roulaient au pas. Comme dans certaines circonstances un peu extrêmes, on sentait d’instinct qu’on n’allait pas s’en sortir. Je ne veux pas dire par là que les carottes étaient cuites, n’exagérons pas, mais il n’y avait aucune raison pour que ça s’arrange. On se serait crus dans les premières pages de «SOS Météores», l’album de Blake et Mortimer : la pluie tombe sans arrêt depuis des jours et des jours, elle génère le chaos dans le pays et elle affole les autorités.
Il pleuvait tellement que l’eau suintait à travers le pare-brise. On avait les pieds qui baignaient dans quelques centimètres d’eau, à l’avant. L’eau entrait partout. Le voyage nous parut interminable. On distinguait à peine les structures du pont de Tancarville dans la tempête. Des fous pressés doublaient par la droite et par la gauche, propulsant dans leur sillage des paquets de mer qui achevaient de noyer le pare-brise et qui emportaient notre dernier espoir d’y voir clair.
En arrivant au Havre, nous allâmes nous ravitailler. Comme nous ne savions pas où se trouvait le bar que nous cherchions, nous posâmes la question à des speed-freaks locaux qui nous déconseillèrent vivement d’aller traîner dans ce quartier. «Là-bas, y’a des gens qu’ont disparu. Aucune trace. À vot’ place , j’y foutrais pas les pieds !». Mais nous étions décidés. Nous suivîmes donc les vagues indications qu’on avait pu recueillir. Nous longeâmes les quais déserts jusqu’au vieux toboggan et entrâmes dans une zone industrielle par une grande avenue. Le coin semblait bel et bien abandonné des dieux. Au loin brillait une enseigne. Ça ne pouvait être que celle de l’Escale, le bar où jouait Kevin K.

Ce bar tabac devait être le seul commerce des environs. Ce n’était pas la foule des grands soirs. Nous allâmes directement dans une petite pièce attenante transformée avec les moyens du bord en salle de concert, et nous fûmes accueillis par un gros accord de guitare. Alrite ? Kevin K et ses deux amis se trouvaient déjà sur la petite scène. Ils attaquèrent leur set sans plus de formalités et ils commencèrent à nous gaver d’un gros rock baveux de type Heartbreakers admirablement bien ficelé, bien dosé et bien direct. Dès le premier morceau, on retrouvait ce qui chez un groupe fait toute la différence : l’authenticité. Aucune prétention, aucune frime, aucune faute de goût : Kevin K jouait le rock électrique, tel que le concevait Eve Sweet Punk Adrien, prophète de l’ancien temps. Kevin K tirait tout son art et toute sa prestance d’une admiration indéfectible pour Johnny Thunders et les Heartbreakers. Et trente-cinq ans après, ça fonctionnait encore. Il n’y avait pas grand monde dans la mini-salle, mais ceux qui se trouvaient là n’en perdaient pas une miette. Le trio imposait une espèce de prestance underground. Pour ceux qui ont vénéré les Heartbreakers, c’était le concert idéal. Petite salle, gros son et hommage à un héros disparu.

Kevin K est un vétéran de la scène américaine. Ça se voit et ça s’entend. Il joue sur une Gibson Melody Maker jaune sans pédale d’effet. Distorse directe à l’ampli. Sur sa guitare, on retrouve le fameux L.A.M.F des Heartbreakers. Quand Kevin K enlève sa veste de treillis, on voit qu’il n’est pas bien épais. Ses bras nus sont couverts de tatouages. Le trio pulse bien : Laur Bomb, parfait drummer dollsy, remplit bien l’espace avec une frappe lourde et métronomique à la Jerry Nolan. Ritchie Buzz, bassman au crâne rasé, cogne avec une rage authentique sur les cordes de son Epiphone. Leur set est un solide mélange de belles compos et de reprises triées sur le volet, comme «Russian Roulette» des Lords Of The New Church, «The Passenger» d’Iggy, «These Boots Are Made For Walking» de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood, et deux classiques des Heartbreakers, of course, «One Track Mind» et «Chinese Rocks». Pas un seul déchet.

Comme Kevin K n’apparaît jamais au sommet des hit-parades, ses disques sortent sur des labels improbables. Le jeu consiste à les trouver. Un fan averti de Kevin K croisé à l’Escale expliquait qu’on les trouvait tous sur e-bay, ce bon vieux e-bay qui a remplacé la Samaritaine. Mais il existe une sorte d’incompatibilité entre l’univers de Kevin K et celui de la vente en ligne. Ce genre de disque doit pouvoir s’acheter chez les vrais disquaires ou lors des concerts. Au moins, on peut échanger quelques mots avec les musiciens et si on est vraiment fan, faire dédicacer un vinyle. C’est tout de même plus sexy que de taper un numéro de carte bleue sur un clavier d’ordinateur, non ? Bien sûr, il faut avoir le choix. Parfois, on ne l’a pas, et il faut aller sur le site d’un groupe ou d’un label pour choper le disque qu’on veut écouter. Alors on ravale sa fierté et on tape le numéro sur ce bon vieux clavier d’ordinateur.

Dans la mesure du possible, je continue de faire les choses à l’ancienne : acheter les disques au concert quand il y en a, et écumer les deux ou trois disquaire parisiens qui ont encore du répondant en matière de bons disques à des prix convenables. C’est comme ça qu’on rapatrie la pincée d’albums nécessaires si on veut explorer plus sérieusement l’excellent univers musical de l’ami Kevin K.
Une chose frappe à l’écoute de ses albums : l’uniformité du son. Les mauvaises langues diront que c’est toujours le même disque et qu’on croit toujours entendre la même chanson pompée sur le «Pirate Love» des Heartbreakers. Les mauvaises langues disaient exactement la même chose des Cramps, de Motörhead et des Ramones : «Oh ben c’est toujours la même chose !» C’est justement ce qui fait la force - et même la supériorité - de ces groupes : ils restent fidèles à un son et à l’intérieur de ce son, ils engendrent une cosmogonie complète. Et puis quand on y réfléchit plus sérieusement, on s’aperçoit qu’en règle générale les groupes ont le même son, album après album. S’ils s’amusent à changer, ça peut mal tourner. Quand Bowie s’est risqué à changer de son pour faire de la disco à la mormoille, les trois quarts des fans de la première heure se sont enfuis en poussant des hurlements d’horreur. Même chose pour Roxy Music, Blondie ou Patti Smith : quand ces messieurs dames se sont mises et mis à taper dans le fucking hit commercial pour se payer des résidences secondaires et bâtir des rentes pour leurs vieux jours, les fans de la première heure se sont sauvés comme des lapins. Lou Reed, Iggy, Lemmy et John Lydon n’ont JAMAIS trahi leurs admirateurs pour un gros chèque. Dit autrement : ils n’auraient jamais osé prendre les gens pour des cons. Une chose pareille eût été impensable de la part de Lux Interior ou de Joey Ramone. Et si on remonte plus haut dans l’histoire, Charlie Feathers brille au firmament des modèles de cohérence artistique absolue.
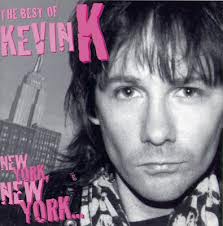
Le mieux est encore de commencer par un Best Of de Kevin K, comme ce «New York New York» excellent de bout en bout, à condition qu’on soit fan de Johnny Thunders. Kevin K est un enfant des Dolls, au sens où on dit enfant de la balle. Il a parfaitement saisi l’esprit de l’urgence, tout au moins est-ce ainsi qu’on pourrait définir cette manière si particulière qu’avait Johnny Thunders de farcir de notes le lard d’un morceau. Kevin K joue classique. Il modélise à l’infini le chorus thundérien et ça reste toujours inspiré et excitant, puisqu’au départ, c’est inspiré et excitant. L’autre grand modèle guitaristique de l’histoire du rock fut Jimi Hendrix. Ses meilleurs héritiers n’ont fait que des bons disques, puisque le modèle était irréprochable. Les albums de Mahogany Rush ou de Robin Trower sont pour la plupart excellents. Ils ne reproduisent pas le son hendrixien à la lettre, ils en proposent de nouvelles variations, tout en respectant l’esprit de celui qu’ils considèrent encore aujourd’hui comme leur mentor.
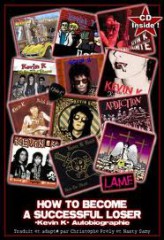
Sur «New York New York», on n’entend que des morceaux de rock classiques et bien sentis, sans surprise quant au qu’en-dira-t-on. Kevin K balance ses textes par dessus ses gros accords saccadés avec une belle aisance. On ne se demande plus pourquoi ce mec refait les Dolls quarante plus tard, mais on se dit : heureusement qu’il y a encore des mecs comme lui. Son «Losing Hurts» cocoté est une petite merveille de considération thundérienne, jouée fast and loud, comme il le dit si bien dans son recueil de mémoires («How To Become A Beatutiful Loser»). Appelons ça le régal du chef. Kevin K a une sorte de génie du son. Il reste bien à l’intérieur de l’archétype. Il lui redonne vie. Mine de rien, c’est un bon archétype. Johnny Thunders, guitariste de la modernité, la Marque Jaune du rock. Kevin K a joué «13th Street» à l’Escale, jolie tranche de power pop nostalgique bien enlevée - where have all the good times gone ? - pop pressée à la Paul Morand, nostalgie poussée dans le dos de l’homme pressé sous le tonnerre thunderien. Absolument supérieur à la moyenne, qu’on se le dise. Équation parfaite : gros son et minauderie. «Deadboy Running Scared» est un morceau salement riffé, c’est sûr, mais terriblement bien intentionné. On retrouve une fois de plus l’incroyable vitalité d’un adorateur de Johnny Thunders et ça nous va. L’ami K ne bouge pas d’un centimètre, il suit sa voie. Pas question d’amener un synthé. Encore une sacrée belle pièce sauvage avec «A Little Taste» et son effarant riffage. Une fois de plus, il courtise le dragon des guitares de feu. I’m in love and she don’t care - ce ne sont pas les textes qui prédominent, on est bien d’accord. Dans chaque morceau, on retrouve l’innocence typique des enfants des Dolls : ingénuité, talent et grâce. Ils sont experts dans le sauvetage du son, plus précisément d’un son. Dans chaque morceau, Kevin K avance avec le museau pointé, il décoche ses chorus avec une pureté fureteuse et il cultive jusqu’au délire l’authenticité thundérienne. «Gang War» est drummé à la vie à la mort, il met le turbo avec «Melody» qu’il riffe à la revoyure. Kevin K ne renonce jamais. Il revient inlassablement au heavy riffage et il multiplie les variations à l’infini. Il finit par susciter une véritable admiration.

L’album «Deutschland» est sorti en 2009. Il démarre sur du rock cocoté bien supérieur à la moyenne. Si on aime bien la power-pop de haut rang, alors on se régalera avec «How Many Times». Encore un morceau qui donne une idée de l’excellence du K. Le bougre sait power-popper. Il chante d’une voix de fausset admirablement juste (alors que celle de Johnny Thunders ne l’était pas vraiment). «She Is No Fun» n’a l’air de rien comme ça au premier abord, mais c’est un morceau qui accroche salement. On peut reprocher à «She Is No Fun» d’être trop classique, c’est vrai, mais Kevin K vient de New York et il sait ce qui est bon pour nos oreilles. C’est un expert, il a joué 48 fois au CBGB, il fréquentait Johnny, David, Jerry, Killer Kane et Syl, alors il n’a aucun problème de crédibilité. Quand on fréquente les Dolls, on est infiniment plus crédible que tous les Stong à la cong et que tous les mords-moi-le-nœud qui téléramatent entre deux portraits de philosophes médiatiques. L’ami K va même chercher la stoogerie avec «Poland», monté sur une ligne de basse dévastatrice. Il fut pendant trois ans le voisin d’Iggy à New York et il évoque la fermeté de sa poignée de main. Detroit shake-hand ! Et comme dans la plupart de ses autres titres, Kevin balance par là-dessus son chorus vitriolique habituel. Avec son côté sélectif et ravigotant, «The Red Haired Girl» aurait très bien pu se trouver sur l’album des Heartbreakers. Encore un morceau fabuleux avec «The Walls Are Tumbling Down», élégant et fuselé en diable, bardé d’accords de rêve. Power-pop pure et dure, bien cadencée, à la fois énergétique et fine, puissante et bien sentie, un rêve pour les gens qui vénèrent la mélodie. Il reprend le thème mélodique à la guitare et l’envoie exploser dans le ciel. Au détour d’un couplet, il laisse tomber sa voix comme une larme, alors on le soutient de toutes nos forces. Il fait partie des héros inconnus du rock, tels que les définissait Nick Tosches.

Son dernier album s’appelle «Allies» et y on retrouve le son classique des Heartbreakers. On croit même parfois entendre la plainte fantomatique de «Leave Me Alone». Kevin K sait faire péter les bouquets thundériens, par exemple dans «Lost My Marbles» qui du coup prend des proportions énormes et vise à la cultissimmité cavalante. Il n’en finit plus de porter le flambeau. Dans «Red White and Blue», on retrouve la frappe métronomique de Laur Bomb, le fantastique batteur dollsy de l’Escale. On trouve aussi sur cet album des merveilles power-pop comme «Give Me Back My Girl», irréprochable et largement graissé aux chorus et on tombe un peu plus loin sur l’excellent «That’s Madrid», basé semble-t-il sur du vécu - Madrid I need you - emmené par de grosses vagues successives, bien battu et incroyablement bon. Encore une fois, Kevin K ne réinvente pas le fil à couper le beurre, mais on sent une telle jubilation dans son disque qu’on finit par éprouver ce qu’il faut bien appeler un profond respect.

Sur la pochette de «Tramp Stamp», Kevin qui est coiffé d’une casquette à la Donovan ressemble à Cyril Jordan. Très bonne augure. «Doin’ All Right» est un pur classique de power-pop. On croirait entendre la voix de Sice, des Boo Radleys de Liverpool, avec ce côté infaillible, plein de vie et d’énergie. The perfect pop song, comme dirait l’autre. «Damage Control» est un cut lent et long, cocoté de main de maître, richement nourri. Kevin K est évidemment le roi du riff des temps modernes. Dans «City Kill», il revient au sempiternel thème du back to the city with nothing to do. Il sait de quoi il parle. Dans «Dreaming Again», il riffe comme les Buzzcocks. Encore une fois, on est bien obligé d’admettre que le morceau est épouvantablement bon, savant et bien dru. On voit parfois nos rêves arrêtés sur le bas-côté, mais lui, il continue, alors il faut le suivre, parce qu’il sait où il va. Il est le roi du pétrole. Tous les groupes de rock ne sonnent pas aussi bien que le sien, loin de là. Il pose sa voix de fausset affreusement juste sur de beaux accords rock’n’roll et il reste dans le vrai, autant que pouvaient l’être Marc Bolan, Eric Carmen ou Robin Zander, et c’est peu dire.

La discographie de Kevin K s’étend jusqu’à l’horizon, mais on peut se livrer à un petit jeu qui consiste à chercher LE mauvais album. Chez Kevin K, ça n’existe pas. On pioche au hasard. Tiens, par exemple «Firestorm» paru en 2010 sur le petit label de Rennes qui monte, Beast Records : une face Texas Terri, une face Kevin K. Les quatre morceaux de l’ami Kevin sont resplendissants. Il emmène son «Graceland To Neverland» ventre à terre, tout droit, et il pose là-dessus sa petite voix sucrée. Plus loin, reprise majestueuse du «London Boys» de Johnny Thunders. Kevin y règne sans partage. Même chose avec l’album «Mr Bones» qui s’ouvre avec une sacrée bombe sur-produite. Kevin K n’en finit plus de porter le feu sacré. «White Trash» sonne comme un classique, éclaté de chorus brillants. C’est de la power-pop extrêmement musclée - I’m white trash ! - il a raison, il fait son auto-bio - mamy’s on pills, and daddy’s been down for years - il balance ça avec une candeur confondante. L’album «Hollywood» paru en 2007 est encore un disque fabuleux, c’est dur de dire les choses comme ça, mais c’est hélas vrai. Vous trouverez la meilleure power-pop du monde chez Kevin K, sur des morceaux comme «Story Of A Girl», «Life In LA» ou «Jennifer Love Song», qu’il fait monter à coups de wow wow et de yeah yeah. Le groove de «Single Girls» vous fera l’effet d’un oasis dans le désert. On s’y abreuve. En écoutant ce disque, on réalise un peu mieux que ce mec n’a absolument aucune prétention. Il fait ses disques, comme un gosse. Il poursuit le jeu et rien ne l’arrêtera. Une autre bombe sexuelle avec «Way Out West» : mauvais départ, le riff n’est pas bien calé sur le beat et soudain, ça se met en route. On n’avait encore jamais entendu un truc pareil. Ça vire très vite à la monstruosité, solo de malade dans la mélasse, fabuleux coup de rein de saumon, et le voilà lancé à l’assaut des cimes, killer solo hallucinant d’élévation et il va chercher sa folie sonique en bas du manche. Arghhh ! Il jaillit hors de l’eau et replonge le morceau dans le tourbillon. Voilà tout le portrait de Kevin K : un génie du son dans l’anonymat. Il plombe «Another Pretty Face» dans un enfer riffé et nous montre comment on joue le garage. C’est à tomber, tellement c’est gras, vicieux et bon, au sens épidermique. Il assaisonne ça d’un solo dollsy. Kevin est un démon. «No Ice In Paradise» est tout simplement digne des Dolls. Il noie ça directement dans les vapeurs de l’enfer. On trouve d’autres monstruosités sur cet album, comme «Hollywood», c’est du délire, mais on n’en finirait plus.
«Cool Ways» ? Encore pire. «She’s Got The Look» et «Cool Ways» sont des modèles de power-pop américaine, effarants de good-looking-bratty-blast et de sunshining-kicking-romp. «Make Up And Break Up» aurait très bien pu figurer sur l’album mythique des Heartbreakers - Oh baby I don’t care ! - solo dément, attaqué à la note, éclair, loud and fast. On n’aurait jamais cru ça possible. Mais si, Kevin K peut le faire. Faut-il que ce mec soit possédé pour s’élever à un tel niveau. Dans «Night Of The Living Dolls», il rend un hommage fulgurant aux Dolls. Un de plus. Kevin K s’arrange pour rester dans le vrai en permanence. Essayez et vous verrez, ce n’est pas facile de rester dans le vrai en permanence. Avec «Rehab», il fait du pur Johnny T, il arrive dans le morceau comme un cartoon cat. C’est une bénédiction d’entendre chanter un mec aussi dévoué. Voilà enfin quelqu’un qui a tout compris. Ouf.

Tous ceux qui aiment les animaux devraient écouter l’album «Joey And Me». L’ami Kevin l’a dédié à son chat Joey. Il lance le morceau qui donne son titre à l’album à l’harmonica et met en scène le Dylan sound pour raconter l’histoire du chat Joey - «Quinze ans de bonne vie sous le soleil du Sud/ Il écoutait mes chansons» - Belle balade. Kevin refuse de laisser partir le chat Joey - «I refuse to let it be the end/ On a rocket with you to the stars/ We have eternel life and it’s ours» - Tous ceux qui ont vu mourir leur ami chien ou leur ami chat écraseront une larme en écoutant «Joey The Cat». Avec «Smack + Swasticas», l’ami K passe aux Stones avec du heavy riffage et des Dancing with Mister D, des Living in Exile with a habit or two, des singing Happy with you et les chœurs de Sympathy For The Devil, youhhh-youhhh ! Fantastique hommage aux Stones, in the South of France, humidity in my pants, c’est incroyablement bien vu - the sound of Tumblind Dice youhhh-youhhh ! - Franchement, ce mec est très fort. On passe ensuite aux Dolls avec «Cried Over You», battu à la Nolan, percé d’un killer solo à la Thunders - I’m done - Il y va. C’est indécent tellement c’est bon.
Un petit dernier pour la route ? Alors ce sera «Addiction» enregistré avec les Real Kool Kats, probablement l’un de ses meilleurs albums, rempli de squelettes et de diables. On prend tout de suite «Addiction», le premier morceau, en pleine poire. C’est du heavy rock forgé dans les flammes de l’enfer, un son qui évoque le grand soir de la fin du monde. On ne peut s’empêcher de penser que si Johnny Thunders vivait encore, il sonnerait exactement comme ça. L’ami Kevin place un pur solo dollsy dans «The Lost Boy» qui suit. Il remet l’art des Dolls en perspective et c’est bien ce qui le rend fascinant. «Whores From Babylon» raconte l’histoire du super-groupe que Stiv Bators, Dee Dee Ramone et Johnny Thunders tentaient de monter à Paris - «Son of a bitch/ I should be rich» - et bien entendu, fabuleux solo dollsy à la clé - «They’re gone, They’re all gone» - C’est hélas vrai : Steve, Dee Dee et Johnny sont tous morts. «Happy Days» ravira les amateurs de power-pop éclairée, car voilà encore un morceau inspiré jusqu’à l’os. L’ami Kevin emporte tout, avec sa candeur d’ado de Buffalo. Il fait encore une fois un disque de fan pour les fans. Kevin K est un frère de la côte, ne l’oublions pas. «Living Fast» pourrait très bien être un morceau de Johnny Thunders. Comme Johnny, Kevin fait péter ses paquets de notes au sommet du couplet, puis il revient à ses accords de cristal. Imparable et furibard. Sur «Rock’n’Roll Dope», il sonne comme Steve Jones, il nous cocote ça à rebrousse-poil. Ce n’est pas compliqué : sur ce disque, tout est bon. Il y a même une reprise judicieuse et fatale de «One Track Mind».

En 2010, paraissait un double DVD, «Successful Loser». Quand on s’intéresse au personnage, le DVD est forcément un document précieux. Le disk 1 est bourré d’archives. On y voit l’ami K, encore jeune à New-York, jouer en trio avec son frère Alan et un bassman dans ses groupes successifs, les Lone Cowboys et les Road Vultures. Ils avaient déjà de l’étoffe à l’époque et on les voit même faire un malheur à l’Irving Plaza avec «Dreaming Again», un hit pop passé à l’as, qu’ils bardent d’harmonies vocales sublimes. Alan chante et Kevin bat le beurre derrière. Mais ce qui fait la force de ce disk 1, ce sont les plans tournés sur la terrasse de l’immeuble où ils vivaient, sur la 13e Rue : Alan et Kevin chantent quelques chansons en s’accompagnant avec des guitares acoustiques. Et ils sont brillants. Ils descendent ensuite dans la rue jouer «Too Much Monkey Business». Ces plans jettent un bel éclairage sur ce qu’on verra à l’Escale, trente ans plus tard.
Sur le disk 2, on suit Kevin K et les Real Kool Kats en tournée en Allemagne, en Espagne et en France. Pour les fans de Kevin, c’est un pur régal, car on voit jouer le groupe dans un grand nombre de petites salles. Ça démarre très fort, avec Nikki Sudden qui accompagne le groupe sur scène pour une reprise de «Pills». On voit aussi Ricky Rat prendre des solos dollsy, Ritchie Buzz bombarder son Epiphone et Kevin échanger quelques phrasés sublimes avec son ami Ricky. Chaque fois, on retrouve la même absence totale de prétention et le même professionnalisme.
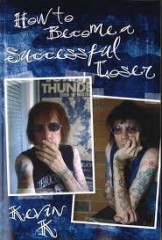
Kevin K fit paraître en 2010 un petit livre intitulé «How To Become A Successful Loser». Il y raconte les principales étapes de sa vie : d’abord Buffalo (ville dont il est originaire), puis New York, puis ses tournées dans le monde entier. Il évoque pas mal de rencontres intéressantes. Aucune trace de prétention dans ce petit livre. Un rocker américain raconte l’histoire de sa vie et c’est admirable de modestie. Il rend des hommages spectaculaires à trois légendes du blues : T-Model Ford, R.L Burnside et Junior Kimbrough qu’il n’est pas allé saluer après le concert («I was afraid to talk to him»). Quand il travaillait comme vendeur de disques à New York, l’ami K voyait entrer dans la boutique des clients comme Jon Spencer, Lou Reed ou Rob Zombie. Il profite de ce passage pour faire le point : «Tous ces gens ont réussi. Je me demande si je ne suis pas un martien. Je n’ai pas réussi à m’en sortir. Tous ces gens sont à l’abri du besoin. Moi, je continue à ramer. Et ça reste compliqué. Je pense que je finirai comme ces vieux noirs qui vivent dans le Mississipi. Dans une vieille cabane, sans eau courante, avec un ventilateur près de la fenêtre et trois chiens dans le jardin, avec les dents pourries et sans sécurité sociale. Peut-être que notre nouveau président Monsieur Obama va réussir à changer les choses pour les pauvres Américains comme moi.» D’où le titre de son livre. Il repense ailleurs à tous ces gens : «Les Spin Doctors, Living Color, Joan Osbourne, Suzanne Vega, les Waldos et les Smithereens. On a joué avec tous ces gens-là. Ça me fait drôle. Ils sont tous devenus riches et célèbres et je continue de jouer dans les mêmes petites salles depuis vingt ans. Quel magnifique loser je fais !» Kevin évoque quelques-uns des meilleurs groupes new-yorkais comme D-Generation ou Sour Jazz («J’aime bien ces mecs parce qu’ils haïssent tout le monde, même moi.») Hommages vibrants à ses amis les Ramones, à Cheetah Chrome et aux Dolls. Puis on tombe sur des passages macabres, à la suite des disparitions respectives de son frère Alan, de Johnny Thunders et de Jerry Nolan («Avec la mort de John et celle de Jerry un an après, la scène new-yorkaise n’avait plus aucun intérêt à mes yeux. Le moment était venu de quitter la ville.») Et ses hommages les plus spectaculaires vont à ses compagnons de route actuels : le guitariste Ricky Rat («Je me sens toujours en sécurité quand il est sur scène avec moi. Je sais que s’il y a un problème, Ricky va le régler. C’est un mec de Detroit, un vrai dur, et avec lui, ça part vite») et Ritchie Buzz («J’ai rencontré beaucoup de musiciens, mais je n’en ai jamais vu un qui travaillait autant que Ritchie. Ce mec est TOUJOURS de bonne humeur. C’est mon confident musical. Il comprend vraiment bien mes chansons.»)

Pages aussi sur ses tatouages, sa guitare, la nourriture qu’on se fait servir en tournée, les drogues (mais sans tomber dans le fucking m’as-tu-vu), les Japonais, les Français (il s’étonne de les voir rester aussi longtemps à table), la Floride, dont il dit qu’il fait bon y vivre, Berlin où il aimerait s’installer un jour et la Pologne, le pays d’où sont originaires son père et sa mère. Tout est vraiment intéressant. Il écrit sur le ton de la confidence et on croit par moments entendre un filet de voix très doux.
À la fin d’une émouvante double page consacrée à Johnny Thunders, Kevin écrit ceci : «En repensant à cette époque, je crois que tous ces mecs, John, Jerry Nolan et Stiv Bator savaient que leur temps était révolu. Je veux dire par là qu’il est impensable de voir Johnny Thunders ouvrir une messagerie pour checker ses mails. Ou Stiv Bator avec un smartphone. Ou Jerry Nolan aller sur son Myspace. Enfin, je ne pense pas. Je suis vraiment content de les avoir connus quand il le fallait.»
Signé : Kat zengler, Kon-vaincu
Kevin K. L’Escale. Le Havre. 7 novembre 2013
Kevin K. The Best Of Kevin K. ICB 2004
Kevin K & The Real Kool Kats. Addiction. Lollipop Records 2004
Kevin K. Mr Bones. Realkat Records 2005
Kevin K & The Hollywood Stars. Cool Ways. Rankoutsider Records 2007
Kevin K. Hollywood. Full Breach Kicks 2007
Kevin K. Deutschland. Kicking Records 2009
Kevin K. & Texas Terri. Firestorm. Beast Records 2010
Kevin K. Joey And Me. Realkat Records 2011
Kevin K. Tramp Stamp. Realkat Records 2012
Kevin K & The Real Kool Kats. Allies. Wanda Records 2013
Kevin K. How to Become a Successful Loser. Dog Ear Publishing 2010
Kevin K. The Successful Loser DVD 2010
BE BOP / MONTEREAU / 06 – 12 – 13
THE JALLIES
Tel un sous-marin s'extirpant de la fosse des Philippines j'émerge peu à peu des abysses du sommeil. Tout va bien, les Jallies chantonnent dans la cuisine. Ady passe le café, Céline beurre les biscottes, et Vaness les recouvre de confiture. A la réflexion je me demande comment elles sont arrivées dans la maison. Hier soir, ou plutôt tôt ce matin, quand je suis rentré, la seule présence féminine c'était Salsa, la chienne fidèle, qui m'attendait sur le canapé. Entre nous soit dit, je trouve qu'elles en mettent du temps pour préparer mon modeste petit déjeuner, seraient-elles en train de dynamiter mon idéal féminin de la parfaite ménagère ? Comme les filles sont cruelles !
« Capitaine, remontée réussie ! » Je refais surface, je reprends mes esprits. Mes rêves les plus fous se brisent sur le dur récif récalcitrant de la réalité de la vie. Non, ce ne sont pas les Jallies, en chair ( miam-miam ) et en os ( Ouah ! Ouah ! ) qui s'affairent dans la kitchenette mais le CD-réveille-matin attentif à son office de bourreau qui à midi pile a lancé la lecture du premier disque des Jallies. Mais reprenons notre histoire par le début.
EPISODES RATES
La teuf-teuf file sur Montereau. L'a pas intérêt à tomber en panne si elle ne veut pas finir chez le ferrailleur. Par ma faute, ennuis de santé, j'ai loupé la soirée du mercredi 04 décembre au Balajo, avec les deux sax en prime et Mister Jull en special-guest pour un rappel, et celle de la veille, le 05 à cause des horaires du boulot, à L'Excuse à Longjumeau, avec un client qui a exhibé son appendice caudal devant nos trois tourterelles. Une invitation à un voyage à Cythère que Baudelaire aurait qualifiée de culottée, voire de déculottée.

Alors ce soir, pas question que la mécanique ambulante me prive de ma soirée Be Bop ! L'anniversaire de notre rencontre – snif-snif d'émotion – justement au Be Bop, Le premier décembre 2012 ( voir notre livraison 121 du 06 / 12 / 2012 ) ! Mister B s'est invité dès que j'ai annoncé le programme, très vite rejoint par le grand Phil – que mon petit neveu surnomme le Géant Vert – manifestement attiré par nos compte-rendus alléchants.
Devant le Be Bop, l'on tombe sur Julio et quelques clients, cigarettes au bec et bière à la main. Nos trois donzelles ne sont pas là, se font une beauté – comme si elles en avaient besoin ! - heureusement que le seul élément masculin assure.
Le pub se remplit. Beaucoup d'amis et de connaissances – Montereau c'est le fief des Jallies, le nid d'où les oiselles ont pris leur essor. Ce soir, c'est un peu le retour au pays natal. En un an, nos hirondelles ont beaucoup voyagé, elles nous ramènent, de leurs industrieuses circonvolutions, tout spécialement pour nous, un cadeau de choix, leur tout premier CD.
Difficile de se frayer un chemin jusqu'au comptoir, l'arrière-salle comme les loges contigües de devant bruissent de monde et de conversations. Nous sommes rejoints par Mumu et Billy. L'est temps de passer aux choses sérieuses.
PART 0NE

Z'ont relégué Julio au fond, au piquet contre sa contrebasse. Ne font plus attention à lui. Elles, elles se pavanent ( comme des infantes ) par devant, et lui le pauvre il marne tout seul dans son coin. Ne font appel à lui que lorsqu'elles ont besoin d'un petit solo de derrière les fagots. Lorsque les applaudissements nourris éclatent pour saluer ses chorus elles condescendent à citer son nom, pour mieux le renvoyer illico dans l'anonymat de son boulot de galérien.

Ne peut tout de même pas se plaindre de ses garde-chiourme. Trouvera difficilement plus ravissantes. Ady en marinière à rayure rouge à décolleté carré – elle nous a habitué à davantage d'échancrure, nous savons bien que l'hiver approche mais pourquoi cacher les premières pentes neigeuses de ces féminins atours où nous aimions glisser de subreptices regards – Céline foulard corsaire, parée pour l'abordage, tout à l'heure sur sa strat toute blanche elle nous régalera d'une reprise de Jimmy Hendrix, une expérience réussie, et piou-piou Vaness sur sa caisse claire elle mène la cavalcade, énergie débordante et gouaille de moineau des rues, toutes deux vêtues à dominante rouge, sang de swing.

S'amusent comme des petites folles. Des collégiennes en folie lâchée dans un magasin de fringues avec crédit illimité. Ca s'échange les instruments comme l'on se dépanne d'un rouge à lèvres. Et ça papote, et ça s'encourage, et ça se soutient, et ça se lance de petites vacheries, des génisseries, amicales. L'on se croirait dans un groupe de copines chez le coiffeur. Quand je pense à Julio qui supporte cela toute la journée, au fond je n'envie pas son sort. Souffre le martyre, porte sa croix à trois branches.

Heureusement parfois elles condescendent à se taire, elles n'ouvrent plus la bouche que pour chanter. Et là tout de suite, vous leur pardonnez tout. C'est l'extase, le nirvana et le paradis en même temps. En trois morceaux elles ont conquis le Géant Vert qui n'achète que des disques de cantatrices classiques. Lui font le coup nietzschéen de l'inversion des valeurs. Ne sera plus jamais comme avant dans le choix de ses goûts et couleurs.

Des voix virevoltantes, d'une légèreté incroyable, ne se posent jamais sur les syllabes, descendent et montent les escaliers en trombe sans aucun arrêt sur les paliers. Ce soir, le côté swing domine, elles invitent Jérôme à les rejoindre avec sa trompette plus jazz que d'habitude, un peu à la Satchmo, mi-aboiement, mi-miaulement – les trois félines en pleine jungle jonglent avec les mots et les sonorités.

Parfois Ady nous ramène sur des terres beaucoup plus rock elle crie blues, alors Vaness accentue la raucité de sa voix et Céline accentue le tempo. C'est qu'elles nous menaceraient presque, en tout cas elles nous avertissent que ces bottes sont faites pour marcher et que l'on a intérêt à filer droit. Pas rassurés on zieute leurs escarpins rouges – deux larmes sanglantes enchâssées sur de roses orteils – et l'on applaudit encore plus fort, des fois qu'elles mettraient leurs menaces à exécution.

Font défiler leur répertoire habituel. Reprises et créations. Le Géant Vert reconnaît Be Bop A Lula, depuis le temps que je m'escrime à le rééduquer, Mister B condescent à lui signifier quelques progrès. Elles ont du mal à quitter la scène, un dernier morceau, puis un deuxième, puis un quatrième, elles auraient passé tous leur hits en une seule fois mais elles se rappellent à temps que le public est aussi venu pour toucher de près le dernier né, leur premier bébé dont elles viennent de porter la gestation à terme.
PART TWO

Si elles continuent comme cela en cinq concerts elles vont épuiser le stock. Faudra penser à une réédition. Les mini-galettes s'envolent comme des hosties le jour du jugement dernier. A la réflexion je ne garantis pas la justesse théologique de cette comparaison, mais je peux affirmer qu'elles n'arrêtent pas de gribouiller de petites gourmandises sur les pochettes que les fans impatients leur tendent. Julio est rappelé à l'ordre, prend trop de place, qu'il se contente de sa ration réglementaire de case qui lui est chichement allouée, les filles, bavardes comme des pies, ont la plume extensive.

Se sentent trop bien. Ne veulent plus nous quitter. Après le deuxième rappel, après un set marathon, et que pris de pitié en voyant leurs visages fatigués l'on consent la mort dans l'âme à les laisser partir – nous ne sommes pas des tortionnaires – Vaness est déçue, elle nous demande pourquoi on n'exige pas quatre morceaux de plus, et hop c'est reparti pour un grand tour.

Elles reçoivent du renfort, Jérôme – c'est le frère de Julio qui fait ce qu'il peut pour soutenir moralement le galérien dans son calvaire – vient de nouveau aboyer avec sa trompette magique, on lui colle le micro sur sa sourdine pour mieux l'entendre et enfin Alain du groupe jazz local Swimgum ( voir KR'TNT 150 du 25 - 06 - 2013 ) à qui Céline refile sa guitare sans préavis. Il a le swing mais on lui demande surtout de donner toute la gomme, car l'on est dans un morceau foutrement rock'n'roll. Partira en déclarant d'un air fataliste : « J'ai fait ce que j'ai pu, ce n'est pas ma musique ! ». L'aura tout de même donné une leçon à bien des garagistes, l'a su s'adapter, un simple détour par une ossature blues et il s'est retrouvé aussi à l'aise qu'un barracudas dans l'eau vive d'une rivière en folie. L'a su tirer son épingle du jeu avec la vélocité d'un jeune punk, un solo dévastateur et un train d'enfer. Ce n'est qu'un jazzeux, mais total respect, de la première à la dernière note.

Je vous rassure, nos trois pipelettes ne se sont pas contentées de faire bosser les mecs au black. Z'ont trempé aussi leurs chemisiers. Comme des grandes. En forme. En verve. Les morceaux se suivent dans leurs diversités et se ressemblent par l'énergie dont elles les revisitent. Un Fujiyama Mama explosif – Julio en profite pour nous l'annoncer sur un mode nippo-karaté hilarant style le cri-qui-tue qui impose le silence à ses trois female-partners pour au moins six dixièmes de seconde, ce qui est un véritable exploit.

Un Rehab d'Andy Winehouse particulièrement réussi, un Shout, Giggles and Shout de Gene Vincent à décoiffer la tour Eiffel de ses antennes radio – avec le Crazy Legs, ce sera trois titres du Screamin Kid dans cette seule soirée, ces demoiselles me nourrissent au petit lait – un Whole Lotta Shakin' Goin' Home à mettre le feu au piano de Jerry Lou, un Burnette brûlant, et quelques autres pépites dont je tairai les noms pour ne pas vous rendre trop jaloux. Fallait venir les gars, de la vieille garde rockabilly n'y avait que de rares éléments – les meilleurs certes – le confluent de la Seine et de l'Yonne, c'est un peu paumé je vous l'accorde, mais vous n'auriez pas perdu votre soirée. Mais n'oubliez pas que les Jallies remettent le couvert au local des Loners, à Lagny-sur-Marne, le vendredi 13 décembre.

AUTOGRAPHES

Pauvres Jallies, si elles pensaient se désaltérer tranquilles afin de laisser retomber l'excitation euphorique du show, c'est raté. Les demandes d'autographes pleuvent de partout, à chacune son stylo, et tous au boulot, même Julio qui se fait enguirlander ( c'est bientôt Noël ) lorsqu'il monopolise le feutre – il y en a plusieurs, mais c'est surtout du sien dont elles ont besoin. L'on sent que c'est parti pour la nuit, mais le patron – hyper sympa – se doit de fermer son établissement aux heures municipales réglementaires. Pousse la clientèle assoiffée dehors. Ces demoiselles ne perdent pas le nord. Elles viennent rappeler à Julien qui s'est attardé à discuter avec nous sur la terrasse, qu'il a le matos à ranger. So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star ?

( Très belles photos prises sur le facebook des Jallies )
Damie Chad.
BOPPIN'SWING / GIRL BAND / THE JALLIES.
THE JALLIES / CHARLESTON SWING / I LOVE HIM SO / REHAB / SWING DES HANCHES / YOU'BETTER BE GOOD / SHAVE YOUR PUSSY / QUEEN OF ROCK'N'ROLL
Ady : chant, guitare lead / Vaness : chant, caisse claire / Céline : chant, caisse claire, guitare / Julio : contre-basse
the jallies@gmail.com
Un truc de filles. Qui se la jouent modeste. ( Rouerie typiquement féminine. Comme je suis affreuse ce matin. Mais tu es folle, tu es magnifique ). Pas de photo couleur pleine pochette, du noir et blanc, plutôt un nuancier de gris et des images format timbre-postes. Même qu'elles ont mis Julio en premier, en haut et à gauche. Le malheureux, elles l'ont entraîné dans un salon de coiffure. L'est sagement assis dans la position du gars accablé dont l'épouse a exigé qu'il attende une demi-journée devant la cabine d'essayage qu'elles en aient terminé. C'est pour bientôt chéri, plus que douze robes et trente deux T-shirts à enfiler.

Pour la couleur, car il y a de la couleur – pas bêtes les guêpes – faut tout de même un effet de contraste pour faire ressortir la douceur de leur teint et leurs jolis minois. Elles ont choisi, non pas le bleu de Klein ( trop viril ) mais le rose Barbie. Je n'exagère pas, sortez la galette de sa pochette. Le disque ressemble à ces poudriers des panoplies de fées que l'on offre aux petites filles. Tout rose, avec juste la marque, The Jallies, au lettrage élégant, l'on ne voit que cela, mais l'on dirait que ce fut tracé par une main pressée et hasardeuse. Les titres en rose rejetés sur la bordure extérieure blanche. Côté petites filles perverses, pas sages du tout. Notes de pochettes réduites au minimum. Le monde existe-t-il indépendamment de la présence de nos trois libellules ?
Finaudes les mouches, elles ont tout compris. Huit titres, mais une seule reprise. Pas n'importe laquelle. Rehab d'Amy Winehouse. Manière de mettre la barre tout en haut. L'original d'Amy étant si parfait. Nécessité de se démarquer, d'exposer sa différence swing-rock, et de symboliquement marquer que malgré sa fraîcheur, son alerte vivacité, son goût prononcé pour une vie heureuse, les Jallies n'oublient rien des meurtrissures de l'existence, des blessures secrètes que l'on cache sous un sourire.
Ce qui nous donne sept titres originaux. Beaucoup de groupes rockabilly actuels devraient méditer cet exemple. Eux qui souvent remplissent leurs plages de reprises au détriment d'un véritable effort de création. A court terme c'est plus facile, le fan se retrouve en terrain connu, mais sur le long terme, les Jallies ont choisi la bonne piste. Le public préfèrera toujours l'original à la copie. D'autant plus que la plupart recherchent non pas à proposer une re-création bouleversante mais s'ingénient à recopier un son mythique original, en fin de compte inimitable.
Enregistré à la maison, avec un parti-pris simple et efficace. Les voix en avant, l'accompagnement en arrière. Il n'y a que sur les deux morceaux les plus rock'n'roll : You'd Better Be Good et Queen Of Rock'n'roll, que la balance est plus équilibrée. Faut dire que l'orchestration de es deux titres moins swing et de facture très Buddy Holly l'exigeait. Avec l'organe d'Ady encore davantage rentre-dedans sur la reine du rock'n'roll, et une guitare qui sonne beaucoup plus moderne.
N'ont pas hésité non plus à renverser un autre tabou. Swing des Hanches est écrit en français, sans que cela ne jure avec les autres titres en anglais. Peut-être le morceau le plus réussi de ce mini-album, vous attire l'oreille, je remarque que c'est le même phénomène lors des concerts. Recueille toujours des applaudissements nourris. Preuve que, avec ses harmonies gitanes, il chatouille un près l'inconscient national culturel.
La contrebasse de Julio apporte un son brut, très roots car il est le seul instrument qui propulse le rythme, ce qui est dans la logique des choses puisque l'on n'a pas octroyé à la caisse claire puissance de frappe décisive que lors des concerts. Trois voix féminines qui étrangement me font davantage penser dans la manière de phraser les mots par-dessus la musique, et non en essayant de rester trop fidèle à un rythme, à Franck Sinatra qu'aux reines historiques du swing vocal. Cette manière de recomposer le chant, en courtes unités rythmiques indépendantes, et non pas en un note à note pointilliste est vraisemblablement dû à une influence plus ou moins instinctive, plus ou moins culturelle, de notre oreille accoutumée par notre environnement musical à un découpage sémantique rock, tel qu'il a été initié dans la musique populaire américaine lorsque le chant a peu à peu pris le pas sur l'instrument. Le passage du jazz au rock, pour rester simple.
Maintenant laissez-vous bercer par nos trois tigresses. Chacune possède son style, rockab-blues par Ady, raucité sauvage chez Vaneess, souveraineté jazzistique chez Céline. Pas du tout interchangeables, mais qui se chevauchent dans la plus grande harmonie. Disque de présentation, au départ de plusieurs pistes possibles, mais terriblement cohérent par son intégrité, par son unicité.
Un groupe de filles qui fait la nique aux garçons. Même pas deux ans que le groupe s'est formé, et ils ( pas elles car avec Julio, le masculin l'emporte toujourrs sur le féminin ) ont déjà défriché un bon bout de terrain. Du feeling, du savoir-faire et de l'intelligence. Des concerts ovationnés, un premier disque réussi, qui crée une différence et assure une nouvelle étape, les Jallies nous ravissent.
Un groupe prometteur. A suivre. A ne pas lâcher, ni de l'oeil, ni de l'oreille.
Un collector dans les semaines qui suivront.
Damie Chad.
UNE HISTOIRE DU ROCK
POUR LES ADOS
EDDARD GARCIA & EVELYNE PIEILLER
( AU DIABLE VAUVERT / Avril 2013 )
Publié avec le concours de la Région Île de France. Quand on lit cela sur la quatrième de couverture, ça commence à craindre. Le rock n'a rien à gagner à s'institutionnaliser. Surtout qu'ils n'y vont pas de main morte, la couverture copie la pochette de Never Mind The Bollocks des Sex Pistols.
J'ai trouvé ce livre en librairie vendu au prix annoncé en librairie, 15 Euros. L'est aussi distribué gratuitement par l'Association Zebrock lors de ses diverses manifestations. Elle marche en cheville avec l'Education Nationale. Elle offre aux élèves ( collégiens ou lycéens ) quelques conférences gratuites sur l'histoire du rock et en fin de cycle elle les emmène voir un concert ( toujours gratuit ) agrémenté d'une rencontre avec les musicos au programme. Sur Provins, l'année dernière, les gamins ont eu droit aux Fatals Picards. Ils auraient tout de même pu leur proposer un groupe de rock'n'roll, et pas un ersatz simili.
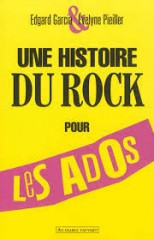
Edgard Garcia est le président de Zebrock qui existe depuis vingt ans. L'on sent la niche écologique de survie. Evelyne Pieiller collabore au Monde Diplomatique et à La Quinzaine Littéraire. Tout cela dans le giron d'une région dirigée par les socialistes au pouvoir... Façon rébellion rock, on fait mieux.
Le texte est de gauche. Politiquement correcte. Tellement qu'il en oublie de parler... du rock and roll. S'étend sur les conditions sociales, analyse les ruptures sociétales, nous dresse un bilan de l'évolution du monde depuis les soixante dernières années. Mais pour la musique elle-même, y a pas res. Quant aux artistes, quand ils ont écopé de quatre lignes, vous pouvez vous estimer heureux, ce sont des privilégiés.
Plus on avance in the book, plus les repères deviennent flous. Les trois premières décennies sont les mieux traitées. L'Histoire a déjà établi un premier classement et clarifié quelque peu les principales avenues. Les trente dernières années se contentent de nommer l'apparente écume des choses. L'on commente les goûts du public, l'on suit les modes successives, l'on se perd dans la pop la plus édulcorée.
Comme l'on est en France, tous les chapitres se terminent systématiquement en queue effilochée de comète ( pas celle d'Haley ) : Pendant ce temps-là en France... pas de quoi pavoiser. Le genre de truc qui vous donne envie de vous expatrier.

M'étonnerait que la simple lecture de ce bouquin incite les ados à se précipiter sur internet pour visionner des vidéos et se livrer à quelques recherches personnelles. Le rock hâtivement étiqueté leur apparaîtra comme une musique morte, à laisser reposer en paix sur les étagères du musée des has been. Ce n'est pas que c'est nul, c'est que c'est ennuyant. A en mourir. Avant d'avoir atteint sa majorité.
Le médiocre est l'ennemi du mal.
Damie Chad.
JOHNNY HALLYDAY A VINGT ANS
L'IDOLE DES JEUNES
CORINNE FRANCOIS-DENEVE
( Au Diable Vauvert / Avril 2013 )
Gustave Flaubert, Marcel Proust, Jean Genet, Jean-Jacques Rousseau, Albert Camus, que du lourd. Voici une collection sérieuse. Oui, mais il ne faut pas exagérer, ce n'est pas avec de telles vieilles barbes ( des plus respectables ) que l'on inoculera le goût de lire à toute une jeunesse rétive... L'on commence par les caresser dans le sens du poil nos petits jeunes, pas de textes originaux de référence d'un abord trop difficile, mais des bios, oui mais l'on coupe bien avant la fin, l'on n'ira guère plus loin que l'entrée dans l'âge adulte. Symboliquement le curseur sera mis sur vingt ans ( Ah ! ne me dites pas que c'est le plus bel âge de la vie ! ). Ensuite l'on cherchera des titres gros porteurs, Marilyn Monroe, plus belle fille qu'elle tu meurs, mais comme il faut travailler le lectorat au corps et au coeur l'on jettera son dévolu sur Johnny Hallyday. Très peuple, ça !
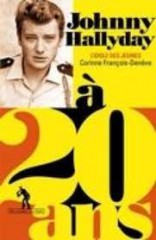
Comme rédactrice l'on optera pour une prof de fac – Versailles, on reste tout de même dans les beaux quartiers – une polygraphe touche à tout, l'a même ouvert un facebook pour annoncer la parution de son livre, mais chassez le naturel, il revient au galop, depuis elle ne parle plus que des dernières pièces de théâtre qu'elle a vues, culcultureuse jusqu'au bout du clavier. Etrange de voir toute cette intelligentsia nomemclaturée se regrouper autour du personnage de Johnny. Faire feu de tout bois, occuper toutes les places, être partout où il y a de l'argent à ramasser, nos élites ne reculent devant rien, prêtes à se prostituer avec l'ennemi pour paraître dans le vent, à la pointe du progrès médiatique. C'est Johnny qui doit bien rigoler. Passez muscade, cela m'enchante.
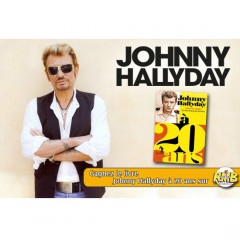
L'a fait son travail avec l'honnêteté de l'universitaire qui compile, sans toujours les citer toutes, ses sources. Le rock ce n'est pas son fort à la petite dame. Pour le début, elle est parfaite. Tout ce qui est affaire de famille, elle s'y donne à fond, le père et la mère indignes – elle s'abstient de toute charge morale - Mme Mar, Desta, Lee Hallyday, elle démêle et expose la tragédie familiale avec clarté, ensuite elle raconte tout ce que le monde sait. Elle suit la carrière en mouvement de l'artiste en jeune hound dog mais elle oublie – décidément ce doit être un topique du Diable Vauvert voir l'article ci-dessus – le rock'n'roll. Johnny aurait pu être l'introducteur hexagonnal de la rumba japonaise dans l'hexagone que l'écriture du livre n'en serait pas changée.

Le livre se termine sur le suicide de Johnny le dix septembre 1966. Faut bien mourir un peu si l'on veut survivre à sa jeunesse. A cette époque-là, Johnny n'intéressait pas les gens du même statut intellectuel que Corinne François-Denève, les dérangeait, les bousculait – ils sentaient bien qu'à terme il remettait en cause l'aura ( Laura ! Il y a tant de... ) prestigieuse de leur éminente position sociale - mais l'était considéré comme moins que rien. C'est par la suite qu'il s'est imposé. Les a eus à l'usure. Alors pour rattraper les cinquante années de rabe qu'est censé ne pas couvrir le livre, l'on a droit à une rapide chronologie qui s'achève en 2013. Pour la discographie, on n'a jamais dû lui apprendre à l'Ecole Normale Supérieure, comment l'on faisait chez les rockers, car elle nous livre l'ombre syphilitique d'un squelette rachitique.

Et tout ça, Au Diable Vauvert. L'appellation est nervalienne en diable, mais l'on est si loin de l'esprit de Gérard. Laissons-là nos chimères.
Rock and roll Récupération.
Damie Chad.
23:03 | Lien permanent | Commentaires (0)


