20/12/2013
KR'TNT ! ¤ 153. JALLIES / FRED NEIL / LITTLE BOB / PAUL PECHENART/ CHRISTIAN LAURELLA
KR'TNT ! ¤ 168
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
19 / 12 / 2013
|
JALLIES / FRED NEIL / LITTLE BOB / PAUL PECHENART / CHRISTIAN LAURELLA |
LOCAL DES LONERS / LAGNY SUR MARNE
13-12-12 / THE JALLIES
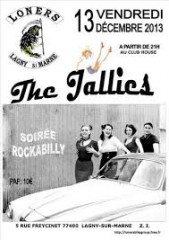
Vous croyiez en avoir fini avec ces demoiselles, et bien non ! Voici qu'elles investissent le local des Loners. Pas tout à fait au hasard, puisque le groupe s'est formé lors d'une fête chez nos bikers voici près de deux ans. Une idée soulevée par Ady qui se concrétisa très vite... Nous on aime bien le local des Loners – pas l'architecture, l'accueil chaleureux que l'on y reçoit – et l'on adore les Jallies, deux raisons plus que nécessaires et suffisantes pour passer prendre Mumu et Billy dans la boutique de fringues ( sur-mesure rock ) de Billy et de foncer comme des cabourgs sur la route de Lagny-sur-Marne. En plus on commence à connaître, une seule petite erreur – léger détour de cinq minutes autour d'un pâté de maisons – et la teuf-teuf mobile se gare comme une fleur au 5, rue Freycinet. Plus tard dans la soirée, l'on compatira avec ces malheureux qui ont tournoyé durant deux heures avant de s'arrêter par un de coup de chance inespérée devant les tonneaux en feu allumés par les loners pour signaler les festivités.
Comme l'Histoire aime bien bégayer ( voir la livraison 167 ), la première personne sur qui l'on tombe sera Julio qui tire flegmatiquement sur un mégot devant l'entrée. Vous l'avez deviné, les galinettes sont dans les coulisses en train d'enfiler leur tenue de bal... A l'intérieur l'on retrouve Celia, amie des Jallies, qui nous raconte ses trois mois passés en Irlande, à errer de pub en pub, de concert en concert. N'a qu'une envie, d'y retourner le plus tôt possible. Beaucoup plus de pluie que dans la Brie, mais de la musique partout. Un pays de rêve. De la bonne bière, en plus. Du mauvais chômage, aussi. Note ô combien discordante !
WE ARE THE JALLIES

Annoncent fièrement le premier morceau. Ce sont bien elles. Vaness a emprunté une des robes bleues d'Ady, ressemblent toutes les deux, avec leurs yeux pétillants de malice, à deux jeunes lycéennes échappées d'un pensionnat en folie afin de commettre les mille bêtises de la vie, l'une après l'autre, méthodiquement, à vider jusqu'à la dernière goutte la coupe de la joie de vivre. Ne comptez pas sur Céline pour donner un semblant de sérieux à la formation, en grande forme Céline, chante à gorge déployée et fait de grands gestes comme Avalokitesvara la déesse aux mille bras. Pendant que les miss pérorent, Julio discute avec sa contrebasse, la seule nana du groupe qui condescend à lui adresser la parole sans lui sortir une méchanceté. Notons que ce soir, elles lui feront l'aumône de lui tendre le micro pour qu'il puisse pousser la tyrolienne ( pas plus de neuf secondes, il ne faut pas exagérer ) sur le final du Whole Lotta.
Hound Dog, tiens l'on dirait un disque avec une erreur de curseur, le 45 tours en 33, ça patine ramollo dans la choucroute, et vroum ! le chien méchant arrache la chaîne qui le retenait au mur de la maison, et se lance à votre poursuite, gare à vos fesses la meute des chiennes hurlantes est après vous, et vous allez sentir si c'est du play back ! Ca se termine sous une pluie d'applaudissement, les Jallies savent mener la chasse. Un peu de Charleston Swing pour rappeler qu'elles sont aussi un groupe de swing. Rockabilettes, certes mais avec cette touche de bop-swing qui n'appartient qu'à elles.

Money Honey, une version que je qualifierais plus noire que d'habitude, plus proche des Drifters que de Presley. C'est que l'air de rien, elles travaillent leurs morceaux à la maison. Des filles sérieuses, qui modifient et améliorent leurs devoirs. Les mêmes plats, mais en changeant la sauce elles initient d'autres saveurs. Elles peaufinent, elles rééquilibrent, elles transmuent. Le même récital qu'au Be Bop, la semaine précédente, mais coloré autrement. Ne nous lassent pas.
Johnny's Got a Boom Boom. Julio nous donne une leçon de contrebasse. Tout à l'heure, lors du deuxième set discrètement il entourera un de ses doigts de sparadrap. Ne m'étonne guère vu la fureur avec laquelle il étripe les cordes, et relâchées, au lieu de geindre elles explosent en grosses cloques sonores qui structurent toute l'armature du morceau. Au chant, Ady nous offre une splendide version du titre d'Imelda May. Justesse de la voix, et appropriation personnelle par cette manière d'écraser la texture des lyrics en cris de rage. Ne s'arrête pas en si bon chemin elle enchaîne sur A Train Kept A Rollin, pas dans l'esprit de la version swing originale de Tiny Bradshaw mais en suivant les rails de la furia dévastatrice de Johnny Burnette.

Un boogie et un remue-ménage-méninge à la Jerry Lou pour nous faire regretter l'interlude qui sépare les deux parties et les Jallies descendent de scène. Ady a si bien su imiter les camelots des anciens temps pour annoncer le disque – une véritable medecine woman - qu'elles passeront leur temps à autographier leur petite merveille.
CRACKER JACK

Gourmandise caramélisée pour ouvrir le deuxième set. Très vite Vaness passe les balais à Céline - qui en époussette un peu violemment la caisse claire - et s'empare du micro. Un Fujiyama Mama à vous enlever le pyjama et un Crazy Legs à vous couper les jambes. Voix de tigresse, altérée de sang. L'a délaissé la batterie, mais ça marche à la baguette, que dis-je à la trique. Et pendant qu'elle feule les deux copines font les innocentes, voix suave des choeurs, piège diabolique de sirènes odysséennes qui vous tentent de vous amadouer pour mieux vous croquer par la suite.
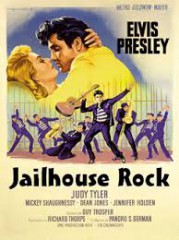
Jailhouse rock et Movin on, deux classiques du rock ne peuvent vous faire de mal. A prendre entre les dents servis chaud et à toute vitesse. L'on reprend souffle, nous le public, parce que le Good Bye Bessie Mae, ce doit-être une pétaudière à chanter, toutes ces voix qui s'entremêlent à n'en plus finir, doit pas falloir mélanger les pelotes. Elles ressortent du labyrinthe, toutes souriantes. Elles ont vaincu le minotaure, mais le corps à corps avec le monstre a dû leur donner des idées.
Des désirs aussi. L'on descend d'un cran. Je ne parle pas de la qualité musicale, mais de la localisation géographique. L'on se dirige vers les membres inférieurs. Un Swing des Hanches parce qu'en son temps Elvis fut baptisé the pelvis, mais l'on ne s'attarde pas, il est temps de passer à la chose sérieuse. Cours d'anglais, c'est Ady qui se charge des explications et de la traduction en langue gauloise – Shave Your Pussy, dédié aux garçons tourbillonnants que sont les Spuny boys – toutes les filles connaissent ce conseil de beauté, d'une manière très euphonique signifie Rase ta chatte. No shockin ! Personnellement j'adore les animaux. Aux approbations qui fusent de la salle, doit y avoir un congrès de la SPA dans le secteur de Lagny-sur-Marne. Une véritable pussy riot émeute. N'en déplaise à tous les Poutine de la terre.

Nos trois minettes sont sur un toit brûlant. Straycats Strut qui suit n'arrange pas la situation. A tour de rôle elles miaulent avec désespoir, elles appellent le matou à rayures en rut, elles nous pondent une de ces abominations rock qui plus tard, le jour funèbre du jugement dernier, leur vaudra les flammes de l'enfer. Mais pourquoi Dieu a-t-il placé le sex si près du rock'n'roll ? Sans aucun doute pour que l'on s'amuse davantage.
Et l'assistance exulte. Ce soir elles sont vraiment The Queen(s) of Rock'n'roll. La soirée s'achève sur un Jump, Giggles and Shouts d'anthologie.
AFTER SHAVE

Encore des autographes à apposer sur les disques. Sont crevées et flapies nos gélinettes, mais Billy décide de leur apprendre à danser le rock, préfèreraient écluser quelques verres de rouge ou de bière en toute tranquillité, mais non, faut qu'elles s'y mettent. Reconnaissent qu'il a de sacrés talents de professeur le Billy. Avec lui tout est facile. Durant le set, s'est chargé de toutes les demoiselles timides qui n'osaient pas. Sont reparties enchantées, les guide si bien qu'elles ont l'impression de savoir danser depuis toujours. Bil l'yllusionniste !
La soirée s'achève. Céline joue au roadie. Elle range son matos. Pluie au-dehors. Elle a enlevé son bandana de corsaire et relâché ses cheveux sous un bonnet de laine blanche. Qu'est-ce qu'elle est belle ainsi, parmi la corolle ondulée de sa chevelure auburn ! Bises à tout le monde. Les routes dégoulinantes d'eau froide et la nuit ouatée de brouillard nous attendent.
Damie Chad.
AUX SOURCES DU NEIL

Oui, Fred Neil tient du fleuve. Par le côté majestueux et intemporel de sa musique. On aurait tort de vouloir l’enfermer dans la fameuse catégorie des folkeux. Il est hors cadre. Il s’accompagne d’une guitare, c’est vrai, comme Nick Drake, Roy Harper, Jimi Hendrix ou Marc Bolan. S’il fallait le situer en quelques mots, on pourrait dire de lui qu’il a une voix à la Johnny Cash et qu’il chante des mélodies ensorcelantes.
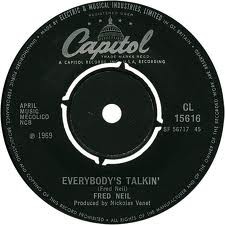
Il est surtout connu pour trois chansons, reprises par des grosses stars des sixties : Nilsson fit une reprise de «Everybody’s Talkin’» pour la bande originale de «Midnight Cowboy», le Jefferson Airplane reprenait «Other Side Of This Life» sur scène et Tim Buckley fit une reprise inspirée d’un morceau qui l’était déjà énormément, «The Dolphins», ces fameux dauphins pour lesquels Fred Neil avouait une passion. Des gens comme David Crosby, Gram Parsons, Stephen Stills et John Sebastian le vénéraient. Stills et Crosby le considéraient comme un immense chanteur - oh man could he sing ! Le futur Lovin’ Spoonful John Sebastian jouait de l’harmo sur «Bleeker And MacDougal», l’album phare de Fred Neil paru sur Elektra en 1965. On trouve aussi sur cet album un certain Felix Pappalardi à la basse mexicaine. Que de beau monde autour du petit Fred...

En s’électrifiant encore davantage, Fred Neil aurait pu faire un malheur aux États-Unis, mais ça ne l’intéressait pas. Il laissait ça aux Byrds et à Dylan. Il fuyait les feux de la rampe. Il ne s’intéressait qu’au blues, «the real blues» - celui de Josh White et de Leadbelly - et accessoirement à l’héro. Il fut l’un des chanteurs phares de la scène new-yorkaise du début des sixties, celle qu’on appelait la scène de Greenwich Village. Une photo le montre sur scène avec Karen Dalton et un jeune Bob Dylan fraîchement arrivé du Minnesota. Fred Neil jouait dans les clubs de Greenwich Village pour quelques dollars. Il s’accompagnait d’une douze cordes et embarquait son public dans un univers de balades magiques. Sur «Bleeker And MacDougal», on en trouve une douzaine, pas moins. Il attaque avec le Bleeker qui donne son titre à l’album, un gros groove débraillé et il installe immédiatement une notion de profondeur et de chaleur, une réelle proximité. Fred chante qu’il veut rentrer à la maison - «I wanna go home». «Blues On The Ceiling» tient du miracle : c’est encore un groove au parfum indiciblement jazzy. Une filet de fumée opiacée effleure la peau - «I’ll never get off this blues alive». Avec «Little Bit Of Rain» on monte encore d’un cran dans le vertige sensoriel. La pureté de cette mélodie frappe tant qu’on pense immédiatement à «Pale Blue Eyes» du Velvet. On y surprend des accents similaires, des profondeurs émotionnelles d’une rare beauté. Fred Neil laisse flotter sa mélodie - timbre flotté à l’excès chaud. La parenté avec Johnny Cash apparaît clairement dans «Other Side Of This Life». Il nous refait Folsom. C’est quasiment le même son - mais sans le tagadac - la même ampleur et la même pente. «Mississipi Train» est une petite merveille d’americana bluesy bardée d’harmo. Fred Neil nous bourre ça de classe hargneuse. Pareil pour «Travellin’ Shoes», tapé à la Dylan, sur une fabuleuse mélodie descendante, et John Sebastian souffle comme un fou dans son harmo. C’est absolument exaltant, embarqué comme pas deux, gratté à l’os, mélodiquement parfait - «My travellin’ shoes !» C’est le morceau de folk-rock idéal, bourré d’énergie et de classe vocale. Puis on ira de grosse surprise en grosse surprise jusqu’à la fin de cet album hors compétition. «The Water Is Wide» est une belle bluette diantrement inspirée, chaude, embarquante, et comme l’indique le titre, vaste comme un océan. Profondeur et vibrato restent les deux constantes de Fred Neil, bercing blues boy de rêve. Et si on aime le blues joué en picking, alors on se régalera avec «Yonder Comes The Blues». Fred Neil écrivit «Candy Man» pour Roy Orbison et ça devint un tube. C’est une belle pièce montée sur des accords à la Bobbie Gentry - «C’mon babe let me take you by the hand.» C’est une fois de plus gratté sec et dévoyé à l’harmo. Fred pousse des coups de baryton comme Ike Turner. «Gone Again» frappe par l’ampleur du ton - «Can you hear the whistle - on on on - on that lonesome train !» Retour au shuffle mythique du lonesome train des blues de base - «I’d loved to stick around/ But you know I’ve got to go again.» Et ça tourne à l’hypnotisme avec l’harmo qui file dans le fond - «I love you baby/ But you’ve got to understand right now !»

Avant d’arriver à New York avec sa guitare, Fred Neil traînait dans le Deep South avec son père qui vendait des juke-box. Au Texas, il fréquentait Roy Orbison et Buddy Holly. Il chantait dans une troupe de gospel et il a ensuite bricolé quelques trucs avec Bobby Darin. À Greenwich Village, il s’est vite taillé une grosse réputation de star underground et de junkie. Crosby, Stills & Nash envisagèrent d’appeler leur groupe The Sons Of Neil. Jac Holzman - patron d’Elektra - ne renouvellera pas le contrat de Fred Neil après «Bleeker And MacDougal» parce qu’en tant que junkie, Fred était parfaitement ingérable. Mais c’est à Paul Rothchild, producteur attitré d’Elektra que revient la palme de la dent dure : «J’ai eu le malheur de produire Fred Neil. C’était un auteur-compositeur brillant mais aussi une véritable ordure. Il fut un précurseur chez les artistes camés, la première épave rock. On planifiait des séances d’enregistrement, et il ne venait pas. C’est pourtant le mec qui a composé ‘Candy Man’, un tube de Roy Orbison. Le jour où il a composé ce hit, il est allé au Brill Building le vendre à vingt producteurs différents et chaque fois il empochait cinquante dollars. Ce n’est pas quelqu’un de bien. Il allait chez Izzy Young - qui dirigeait le Folk Center à Greenwich Village - et lui disait : ‘Izzy, j’ai un concert ce soir et je n’ai pas de guitare.’ Et Izzy lui répondait : ‘Freddie, tu m’as déjà emprunté une vingtaine de guitares, mais je t’aime bien, voilà une autre douze cordes.’ Et Freddie allait au club complètement défoncé - il était tout le temps complètement défoncé - j’ai pu le constater à bien des occasions - il n’arrivait pas à accorder sa guitare, alors il la fracassait sur scène. Cette guitare ne lui appartenait pas.»
Ironie du sort, ce n’est pas Fred Neil qui ira au ballon pour possession de drogue, mais Paul Rothchild qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. Il aura même une veine de pendu, parce que son boss Jac Holzman lui redonnera son poste de producteur à sa sortie du ballon.

Viré d’Elektra ? Fred Neil s’en bat les coquillettes. On lui déroule le tapis rouge chez Capitol. Il enregistre neuf chansons vite fait pour un premier album, mais le producteur lui en réclame une dixième. Fred rechigne. Le producteur l’enferme dans les toilettes : «Tu sortiras quand tu auras fini ta chanson». Fred se marre. Il se fait probablement un shoot vite fait et dix minutes plus tard, il ressort avec «Everybody’s Talkin’». Le producteur est subjugué par la qualité du morceau. On passe au studio. Fred enregistre ça en une seule prise. Le producteur lui dit que ce serait mieux si on musclait le tempo. Fred refuse et se casse. Il en a marre. Tout ce cirque ne l’intéresse pas. C’est Nilsson qui musclera le tempo et qui tirera les marrons du feu avec ce hit planétaire et qui par la même occasion deviendra une star.

Le premier album de Fred Neil sur Capitol s’intitule «Fred Neil». Pochette noire avec un portait en noir et blanc, très sobre. Comme Bleeker, ce disque hante les oreilles. Fred démarre avec «The Dolphins», du gros balladif doux et tendu, visité par la grâce d’un solo de guitare sibyllin. Il va chercher ses intonations au plus profond d’un gosier parcheminé, comme le fait Johnny Cash. Fascinante entrée en matière. Tout Tim Buckley vient de là. Rebelote avec «I’ve Got A Secret», balladif doucement visité par des accents country. Fred Neil va chercher sa mélodie très loin dans l’espace d’une vision unique. C’est la bande-son idéale pour traverser des pays étrangers en voiture. Les paysages défilent admirablement bien. Il fait monter son shake sugaree très haut et redescend doucement dans le velouté. La chose est littéralement pourrie de feeling. Al Wilson - Canned Heat - joue de l’harmo sur «That’s The Bag I’m In», un groove bluesy très imposant. Peter Childs claque un solo tordu et imparable à l’acoustique. On retrouve le timbre mûr de Fred Neil sur «Badi Da». Beauté pure, chaleur et mélodie ensorcelante. On revient au groove océanique avec «Faretheewell». La mélodie se déroule sous nos yeux ronds et lance mille petites langues de beauté orientale. Fred Neil fait geindre ses syllabes argentées et le son vibre au creux d’une paume d’ouate qui s’évapore aussitôt. C’est une poursuite insensée du frisson, parmi les notes de guitare en suspension et la chaleur d’une haleine. On se heurte une fois de plus à la suprématie de la mélodie. «Everybody’s Talkin’», c’est tout simplement un coup de génie. On trouve encore une autre merveille sur cet album. Il s’agit de «Green Rocky Road», un country-rock élégant, bardé de gimmicks fouillés. Derrière, on s’active sur les manches des guitares sèches, ça grouille de son, et c’est le meilleur son d’Amérique. On entend ces guitares pluridisciplinaires en avance sur leur temps. Ils grattent comme des malades et Fred fait la loco.

Un autre album de Fred Neil vaut le détour : «Other Side Of This Life», sorti aussi sur Capitol, avec une face enregistrée live et l’autre face bourrée de fonds de tiroirs. Dès le premier morceau, on réalise que Fred live, c’est encore mieux que Fred en studio. Il attaque au feeling pur et bat sa puissante mélodie seigneuriale sur le manche de sa guitare. Il est tellement bon qu’il éclate de rire à la fin du morceau. Pour lui, c’est un jeu d’enfant que d’être un petit génie. Quand on écoute «Roll On Rosie», on voit tout de suite que tout Ritchie Heavens vient de là. En direct. Le côté salubre et incantatoire. Il nous balance ensuite une version de «The Dolphins» qui est en réalité une véritable bénédiction mélodique. Fred et son collègue Monte Dunn font scintiller les notes de guitare. Comme Dennis Wilson, Fred recherche le groove océanique à l’état le plus pur. Versions somptueuses et plus soft de «That’s The Bag I’m In» et de «Sweet Cocaine». Il faut voir comme ça balance. Et derrière ça joue en solo en continu, comme dans certains morceaux de Sister Rosetta Tharpe ou de Mighty Baby. On retrouve avec plaisir «Everybody’s Talkin’», l’archétype de la mélodie parfaite, véritable machine à remonter le temps, retour à l’enchantement du film et au monde mythique des deux paumés de Brooklyn, Rico Rizzo et Joe Buck. Sur l’autre face, Fred se retrouve accompagné d’un orchestre. «Come Back Baby» vire carrément jazz et tout le monde semble rivaliser de feeling dans le studio. Et on retrouve une version de «Badi Da» étirée au soleil d’Orient. La version croche et on s’émerveille. Puis Gram Parsons chante «Ya Don’t Miss You Water» avec Neil et ça vire carrément country. Impossible de faire autrement, avec Gram Parsons.

Fred Neil n’eut jamais l’intention de faire carrière. Il finit par se lasser de Greenwich Village et des chausse-trappes de la vie de bohème et il mit les voiles, comme voulait tant le faire Rico Rizzo. Il alla s’installer au soleil, loin des manipulateurs du show-business et des mauvaises langues comme ce persifleur de Paul Rothchild. Direction Coconut Grove et Key West, en Floride - terre d’adoption d’Iggy, de Kevin K et de bien d’autres héros. Des gens comme Ben Vaughn ont essayé de faire revenir Fred en studio, mais ça ne l’intéressait pas. Fred proposait qu’on enregistre Karen Dalton à sa place. C’est à David Crosby que revient l’insigne honneur d’enfoncer le clou : «C’était un mec incroyablement doué qui n’avait rien à voir avec l’industrie du disque. Plus ça devenait commercial et moins ça intéressait Freddie. Alors, il a fini par disparaître.»

Bleeker fait partie de la série des cadeaux royaux. Du pur John Ives - my old mate. Ce disque fait désormais partie des hanteurs du château. Nous en discutions, l’autre soir au téléphone. Nous épluchions les morceaux un par un, confrontant nos point de vue de possédés éméchés et John Ives déclara : «C’est un disque que tu peux me faire écouter vingt fois de suite, hic, je ne te demanderai jamais de le changer !»
Signé : Cazengler, vi-Neil junkie
Fred Neil. Bleeker & MacDougal. Sundazed Records 2001
Fred Neil. Fred Neil. Capitol Records 1967
Fred Neil. Other Side Of This Life. Capitol Records 1970
Mick Houghton. Becoming Elektra. Jawbone Books 2010
STORIES OF LITTLE BOB
HISTOIRES POUR ROBERTO
( Krakoën / Avril 2013 )
PREFACE DE LITTLE BOB.
LUC BARANGER. MARION CHEMIN. THIERRY CRIFO. DOMINIQUE DELAHAYE. JEANNE DESAUBRY. SERGUEI DOUNOVETZ. ALAIN FEYDRI. DENIS FLAGEUL. PASCAL JAHOUET. LAURENT JEZEQUEL. STEPHANE LE CARRE. JEAN-NOËL LEVAVASSEUR. JEAN-LUC MANET. OLIVIER MARTINELLI. PIERRE MIKAÏLOFF. MATHIAS MOREAU. MAX OBIONE. STEPHANE PAJOT. GILLES POUSSIN. JEAN-BERNARD POUY. FREDERIC PRILLEUX. SYLVIE ROUCH. VANESSA SIMON CATELIN. BRUNO SOURDIN.
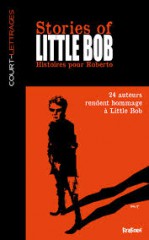
On ne change pas une formule qui gagne. La nouvelle mouture des Editions Krakoën ne s’est pas contentée de ressortir Stories of The Dogs ( voir KR'TNT 155 du 12-09- 13 ), lui ont donné un petit frère jumeau, Stories of Little Bob ( les rockers apprécieront le jeu de mots ), maquette de couverture similaire, même principe de composition, un panel d’auteurs offrant une nouvelle censée être en phase avec l’univers de l’artiste. On n’a pas repris les mêmes mais presque, l’on a pris la peine de multiplier par quatre la participation de la gent féminine, et cette fois-ci les textes ne sont pas classés par l’ordre alphabétique du patronyme des écrivains mais placés selon la chronologie de sortie de chacun des albums de Little Bob que l’histoire racontée est censée évoquer.
A mon humble avis ce recueil est mieux réussi que le précédent. Davantage axé sur la personnalité de Little Bob que ne fut celui dédié à Dominique Laboubée. Peut-être est-ce dû au personnage de Roberto Piazza tout aussi authentique que le guitariste des Dogs mais d’un abord moins lointain, plus sympathiquement proche de vous. Et puis les auteurs ont aussi fait l’effort de coller un peu plus aux thèmes évoqués par les morceaux de notre rocker national.
Vous les laisse découvrir. Noir et sang, mais on varie les plaisirs, de la serial killeresse à la science-fiction style blade runner, de la dénonciation sociale aux rebelles festoyances des jeunesses modernes, c’est notre monde qui passe en ces vingt quatre courts récits, de la préhistoire robertienne à notre no future programmé. Etrange comme en sept ans d'écart entre la composition des deux recueils l’on s’est écarté des poncifs mythiques rock and rolliens pour rentrer dans la peau de notre présent éclaté. Comme s’il était devenu plus difficile de vire dans la dimension de ses propres rêves.
C’est un peu ce que Little Bob nous dit à sa manière dans sa brève préface. Trace sa route de plus en plus loin des autoroutes du show biz. S’enfonce dans les tunnels de l’Underground. Auto-production, pour mieux survivre sans avoir à se renier. Leçon d’un guerrier du rock and roll à méditer.
Damie Chad.
PAUL PECHENART
UNE GROSSE BOULE DE FEU
( Camion Blanc / Octobre 2013 )
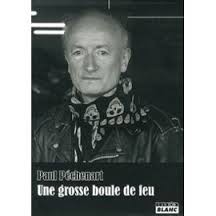
Great Balls Of Fire ! Avec un titre de cet acabit, sûr que ça va déménager sec. J'ai pris le bouquin les yeux fermés ( pas tout à fait, la caissière avait un de ces sourires ! ). Et puis Paul Péchenart, ce n'est pas n'importe qui. Fut le guitariste des Dogs. L'était là au tout début, les deux premières années, de ce que l'on pourrait appeler la formation initiale, bien avant l'enregistrement du premier disque. Et tout ce qui suivit, une vie consacrée à la musique... Doit en avoir des anecdotes truculentes à raconter, me voyais déjà entraîné dans les coulisses du rock and roll...
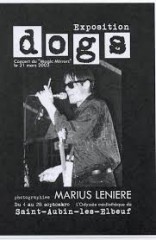
Erreur sur toutes les lignes. Les Dogs ne lèvent pas une seule fois la patte de tout le bouquin. Aucun autre groupe non plus. Heureusement que de temps en temps l'auteur nous parle de la présence rassurante de sa guitare, sans quoi vous pourriez penser qu'il exerce les nobles professions de garçon coiffeur, de courtier en assurance, voire de plombier. Mais sans Watergate, car Paul Péchenart, ne se fait pas mousser, ne se cache pas sous la légende dorée du rebelle adoré, ne se planque pas derrière la mythologie des oripeaux rock. Ne tire pas la couverture. Se met à nu.
Je comprends votre incompréhension. Quoi ! un livre écrit par un rocker, publié dans une maison d'éditions qui a publié près de trois cents ouvrages qui explorent avec méthodicité et sérieux les continents engloutis du rock depuis presque vingt ans et qui ne parle pas de rock 'n'roll ! Aurait-on donné le feu vert du bon à tirer à l'impression, en toute confiance sans avoir jeté un seul regard sur le texte ? Se moque-t-on du monde ? Quel est donc cet ovni qui s'est ne s'est pas posé sur la bonne planète ?

Pas d'affolement. La rock machine fonctionne comme le fameux moteur d'Aristote. Fout tout en branle, propulse le mouvement, mais si vous soulevez le capot, vous hoquetez de surprise, vous vous attendez à trouver le super carburateur en train de trépigner, mais non, il ne fonctionne pas, il ne marche pas, n'est même pas alimenté en essence. Le coeur du moteur, ne bouge pas d'une soupape, ce qui produit le mouvement est d'une immobilité absolue. C'est difficile d'imaginer une Harley qui filoche sur la Highway sans que ne ronronne à plein régime la mécanique sacrée, mais c'est ainsi. Aristote dixit. Si vous n'avez pas envie de vous replonger dans La Métaphysique du maître d'Alexandre le Grand ( un sacré rocker Hellène ) pensez à la formation d'un ouragan. Dévaste tout sur son passage, balaie les maisons comme de vulgaires miettes de pains, arrache les arbres comme des fétus de paille, mais si vous avez la chance de pénétrer en son centre, vous êtes surpris, silence absolu, pouvez vous poser sur une chaise longue et siroter un petit sky tout en fumant un des merveilleux cigares de Jerry Lou. Tout ça à l'oeil.
Paul Péchenart ne raconte ni les concerts incandescents, ni les longues tournées harassantes, ni les beuveries avec les copains. No fun. No drugs. No sex. No rock'n'roll. Ne fait pas visiter la devanture. Les paillettes, le glam et tout le bataclan, faudra vous en passer. L'enlève le perfecto, et le foulard à tête de mort. Directement à l'essentiel. Ce n'est plus le rocker qui fait étalage de ses frasques. Mais l'animal humain qui se dévoile. Attention, aucun strip tease déplacé. Effeuille les mots, mais ne dénude qu'une nudité intérieure. Pas de révélations fracassantes, pas de posture m'as-tu vu, pas de populisme psychanalytique.
Doucement mais sûrement. Faut attendre le dernier mot de la dernière page du dernier chapitre, pour avoir la clef de l'énigme. A part qu'il n'y a aucun mystère, et que la serrure n'était pas verrouillée. Le tout est d'oser pousser la porte. Même pas peur, le méchant loup n'est pas derrière, il y a longtemps qu'il vous a dévoré le coeur, mais ce n'est pas parce qu'il s'est enfui de sa cellule que le prisonnier est libre. La prison vous suit partout. Paul Péchenart n'a pas ménagé sa peine. Un demi-siècle à s'attaquer à l'huisserie avec le chalumeau de sa guitare rock. Sans succès. Inutile de passe en force. L'on peut exploser les gongs à la dynamite punk, vous ne ferez qu'écailler la peinture.
D'où Elvis Presley, d'où Gene Vincent, d'où Jerry Lee Lewis – je cite ces trois-là mais la liste est longue – tiraient-ils leur force ? De leur voix, de leurs virtuosité, de leur art ? Non tout cela n'est que le résultat, la conséquence de quelque chose de beaucoup plus intérieur. Les optimistes affirmeront qu'ils n'ont fait que transcender leur joie de vivre, l'insolente vigueur de leur jeunesse. Just for fun. Serai davantage pessimiste. De leur solitude, avancerai-je. Inhérente à la condition humaine. Chacun se débat avec ses propres spectres. Histoire intime. Partagée par tous, mais vécue individuellement. Certains s'en sortent plus ou moins bien. Les fantômes sont plus ou moins consistants.

Paul Péchenart a dû se battre contre de drôles de monstres. L'ont agressé, lui ont sauté dessus alors qu'il ne s'y attendait pas. Les avait pris pour des êtres inoffensifs. Peut-être en fait étaient-ils déjà en lui depuis le jour de sa naissance, voire de sa conception. Peut-être appelons-nous agression tout ce qui nous arrive. Les bonnes choses comme les plus mauvaises. N'accusons pas les autres. Un seul coupable, nous. Si la lame s'enfonce en nous, c'est que nous sommes trop mous, trop faibles. Nous ne sommes pas assez fort, et nous transmuons cela, en auto-culpabilisation. Pire, c'est armé de ce seul bouclier que nous marchons à la rencontre du monde. Piètre protection, il est facile de se jouer de nous. Contre nous, à tous les coups l'on gagne.
Avec nous aussi. Le bonheur se rit de nous. Nous accompagne un bout de chemin, s'enfuit au milieu du gué, là où les pierres sont glissantes, nous laisse en plan sans préavis. Paul Péchenart ne collectionne pas les groupies croustillantes. Du mal à établir le contact. N'est pas le mâle conquérant qui n'a qu'à claquer les doigts pour que la poulette se glisse dans ses draps. Lui échoit le rôle du chevalier servant. Fidèle mais mal récompensé. L'en souffre, ce qui ne les empêche pas de sulfater grave.
Mais il faut vivre. Paul Péchenart tient le compte de ses stratégies de survie, de ses chemins de traverse qui ne le mènent jamais exactement où il voudrait se rendre mais qui le rapprochent du but fixé. Mais quand il avance de deux pas, l'horizon recule de trois. Ne se décourage pas. S'obstiner ou périr en route, sur le bord du chemin. Etroit, très étroit. Symboliquement, il est incapable d'écrire son journal, sur son ordinateur ou sur une page blanche, se contente du petit format de l'écran de son portable. Comme s'il envoyait des SMS amicaux à des connaissances. Mais en fait il ne s'adresse qu'à lui-même et ne tient pas à jauger du regard l'ampleur du désastre. Goutte à goutte. Le poison passe mieux.
Agit au final aussi comme un antidote. La publication en est une preuve. Peu de monde est capable d'une telle intégrité. Je ne parle pas des rockers qui se doivent d'assurer un minimum d'image afin de ne pas décevoir leur fan. Mais de ceux qui font profession d'écriture. Le roman moderne est embourbé dans un narcissisme déplaisant. L'on y met en scène, ses défauts, ses travers, ses échecs. C'est devenu la norme. Les bobos racontent leurs bobos. Les mêmes que les vôtres, du moins ce que vous consentez à avouer. Paul Péchenart ne triche pas. Ne se contente pas de souligner ses imperfections trop humaines. Ne se met pas à votre niveau. Ne vous tend pas un miroir qui reflète une image acceptable de votre personnalité. L'enlève toutes ses écailles protectrices, déchausse ses crocs pointus et abandonne ses griffes acérées. Le crocodile rock ne se présente pas comme un cruel saurien. L'avoue qu'il ne vaut rien. Que tout cela n'est que de l'apparence. Une baudruche qu'il vide consciencieusement de son air. Vide l'enveloppe du poupon gonflable auquel nous essayons de ressembler. Paul Péchenart préfère s'approcher de sa réalité.
Et au final, il finit par s'accepter, par se retrouver. Tel qu'en lui-même, sa faiblesse se mue en son intégrité. Le livre se clôt sur la reconnaissance de soi-même. Le soleil se lève et illumine toutes les blessures.
Nombre d'amateurs de rock risquent d'être surpris et même déçus par cet ouvrage. Ne retrouveront pas ce qu'ils cherchent. L'imagerie rock'n'roll n'est pas au rendez-vous. N'incruste pas la carapace de la tortue de diamants ou de pierres précieuses multicolores. Paul Péchenart nous parle d'une gosse boule de feu. Mais intérieure, qui ne brille pas comme un feu d'artifice. Lumière froide qui glace l'esprit et brûle l'âme comme des radiations atomiques. Le mal des ardents. Réservé à ceux qui n'hésitent pas à entrer dans la chambre froide de la pulsation vitale de la vie.
Un beau livre.
Damie Chad.
TOURNEE GENERALE
CHRISTIAN LAURELLA
( Editions du Layeur / 2006 )
Vous ne connaissez pas Christian Laurella, bandes d'ignares. Rassurez-vous, moi non plus. C'est un batteur et un percu de jazz. Ne me demandez pas s'il tape bien, je n'en sais fichtre rien. Un mec modeste, en tout cas. Dans son livre il ne parle pas de lui, même si tout repose sur ses épaules. Parle de ses expériences, vingt ans à occuper le poste de tour manager. D'artistes de jazz en tournée en France et en Europe. De grosses pointures. Des cadors, pas du menu fretin.

Le boulot n'est pas facile, grèves d'avions, bus en retard, voitures en pannes, chambres d'hôtels non retenues. Le genre de galère qui arrive à tout le monde, mais quand vous êtes responsables d'un groupe d'hôtes choisis, c'est plus embêtant. Surtout que vous risquez d'en être de votre poche. Alors vous croisez les doigts et vous essayez de naviguer au mieux. Le client possède son carré d'as magique dans sa poche. Le contrat qui stipule ceci ou cela. Avec le couperet du refus de jouer si vous n'honorez pas vos engagements. Plus l'obligation de payer le cachet si vous êtes en votre tort.
Mais il y a encore plus dur que les clauses écrites noir sur blanc. Ce sont les artistes. De grands musiciens, des pros, ils assurent la musique mais question relations humaines, ce n'est pas toujours le top. Donnez du pouvoir à un individu, il y a de fortes chances pour qu'il en profite. Caprices et colères sans cause se succèdent sans trêve. Tout le monde n'est pas ainsi, mais l'ensemble du bouquin sonne un peu triste.
Nos jazzmen ne sont pas des rockers. Pas de groupies hurlantes dans les couloirs, pas de de fêtes, pas d'élans. Ce ne sont pas des groupes, mais des musiciens réunis pour une tournée. Après qui, bye bye au revoir et à la prochaine. Tout semble aseptisé, trop propre comme ces chambres d'hôtel quatre étoiles sans âme. Le confort et la frime. Et puis rien.
Les deux meilleures séquences du bouquin sont celles réservées à Chet Baker et Jaco Pastorius. La détresse et la folie les humanise. Baker qui fixe un cachet unique pour ses concerts, pas très élevé alors que selon les festivals ou selon les organisateurs il pourrait souvent demander davantage. Veut bien gagner sa vie, mais une fois, le gîte, le couvert et la dope assurés, il n'en exige pas plus. Fixe lui-même le rapport marchand de son existence, ne monte pas dans les surenchères, ne laisse à personne d'autre le droit de coter son prix d'achat. Une manière de court-circuiter le système en l'empêchant de faire trop d'argent sur son dos. Même si l'on vous laisse négocier un pourcentage avantageux. Une démarche à méditer.

Chet finira mal. Par la fenêtre de son hôtel. Mais sans doute a-t-il choisi. Pastorius réduit à l'état de sans-abri sera battu à mort. Les clubs de jazz new-yorkais refusent de le laisser entrer. Sa vie et sa musique plongent dans le chaos. Il s'est rendu-compte de l'inanité des conventions humaines. Lorsque Christian Laurella gère sa tournée, il en est encore au stade du refus et du scandale. Il refuse de jouer tant que le grand patron ne sera pas descendu de Paris car il a une discussion extrêmement importante à avoir avec lui. Quand le taulier se radine, il baisse son pantalon et déclare qu'il avait besoin de lui montrer son cul. Bouffonnerie métaphysique, l'avait nécessité de tenir un langage de vérité à tout le cirque de la hiérarchie sociale. La folie ou la mort comme ultime porte de sortie de notre monde. L'artiste endosse le clownesque costume déchiré du pitoyable Auguste. Le jazz vécu comme une traversée des apparences. Ce qui importe c'est de tuer la marionnette humaine. Le pantin de chair et d'os gonflé de suffisance que nous sommes. Rien à voir avec la dignité dont fait preuve un Ahmad Jamal. Certains recherchent la tranquillité d'esprit, la clarté, l'adéquation totale entre la musique, leur intériorité et l'extériorité du monde. Parviennent à l'extase apollinienne. Ahmad Jamal se rapproche de dieu et de la musique classique. D'autres comme Pastorius préfèrent la voix de la main gauche, celle du blues de Robert Johnson, diabolique et dionysiaque. Plus près du rock nd roll.
Damie Chad.
00:23 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.