24/10/2013
KR'TNT ! ¤ 160. CHRIS WILSON / RON ASHETON / JEFFREY LEE PIERCE / CHRONIQUES VULVEUSES
KR'TNT ! ¤ 160
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
23 / 10 / 2013
|
CHRIS WILSON / RON ASHETON / JEFFREY LEE PIERCE CHRONIQUES VULVEUSES ( V, VI, VII ) |
CHRIS WILSON CASSE LA BARRACUDA
( + CONCERT : HONFLEUR
BATOLUNE – 12 / 10 13 )
Parmi les fans des Groovies de la première heure, l'album «Shake Some Action» causa pas mal de ravages. Le remplacement de Roy Loney par Chris Wilson provoqua même de sacrées allergies. Il faut dire qu'avec quatre albums magistraux («Sneakers» «Supersnazz», «Teenage Head» et «Flamingo»), les Groovies roulaient dans le peloton de tête de nos héros, suivis de Captain Beefheart, des Stooges, de Charlie Feathers, du Velvet, des Dolls, de Jerry Lee, du Jimi Hendrix Experience et de quelques centaines d'autres.

À la différence des autres groupes de la scène de San Francisco, les Groovies swinguaient comme des malades. Quand j'ai acheté «Sneakers» à l'Open Market de la rue des Lombards, je m'attendais à entendre du proto-punk, à cause des histoires de crans d'arrêt que racontait Yves Adrien dans sa rubrique «Trash». Fatale méprise ! Les Groovies grenouillaient dans un registre bien plus intéressant. Avec le premier morceau («Golden Clouds»), les Groovies nous embarquaient dans un monde effarant de légèreté et d'entrain, de fun et d'allant. Ils jouaient une good time music jouissive, allègre et éclairée de chorus éclatants. Et sur la face B, on tombait sur l'extraordinaire «I'm Drowning», doté d'un beat serré et de parties de guitare lumineuses, une sorte de boogie porté aux nues. Roy Loney n'était pas encore le snarler qu'il allait devenir ensuite. Les Groovies évoluaient dans un monde de finesse et d'élégance. Ils proposaient des chansons soignées et inspirées. Le second album «Supersnazz» bénéficiait d'une production abusive, dont se plaindra plus tard Roy Loney. Sur «Love Have Mercy», Roy se mettait enfin en colère. Danny Mihm embarquait «The First One's Free» dans un swing sauvage et on retrouvait la veine de «Sneakers», avec cet incroyable entrain, ce fun cartoonesque, ces bouquets d'harmonies vocales suprêmes, sans oublier les sexy ways, la voyoucratie potache et la louis-jordanisation des esprits. Les Groovies renouaient aussi d'une certaine façon avec le son des années vingt, ouh-la-la ouh-la, comme s'il jouaient dans le salon de Francis Scott Fitzgerald par une chaude nuit d'été. Mais ils savaient aussi galvaniser une reprise, en tapant dans le répertoire d'Eddie Cochran, par exemple : on se régalait de leur vaillante version de «Somethin' Else». Roy Loney composait des chansons étranges («Brushfire»), mais toujours intéressantes. On assistait au retour en puissance du swing dans «Bam Balam», compo de Roy fraîche comme un gardon, colorée, fouillée, inspirée et traversée par un solo de clarinette léger comme une libellule. Ils fermaient le bal avec un magistral clin d'œil à Brian Wilson, «Around The Corner», une chanson dégoulinante de rosée, bourrée d'harmonies vocales, de gimmicks juteux et de swing Mihmien. Luminescence irisée et ampleur azuréenne. Curieusement, chaque fois que je réécoute ce disque, il évoque systématiquement le souvenir des jours heureux.

Au dos de la pochette de «Flamingo», Kama Sutra donnait le conseil suivant : «Play that record real loud». Le lycéen bête et discipliné que j'étais suivait évidemment ce conseil à la lettre, histoire de re-déterrer la hache de guerre et reprendre le combat contre une autorité parentale despotique. Dès les premières mesures, «Coming After Me» sonnait comme le classique garage définitif. Le snarl de Roy devint le modèle absolu, même si les refrains redevenaient joyeux - manie groovy. Avec ce coup de snarl, Roy devint la méga-star de l'underground. Les Groovies revenaient au jug-band sound avec «Sweet Roll Me On Down» et parvenaient à faire oublier les tragiques faiblesses de la face B.

Les Groovies atteignirent le sommet de leur art avec «Teenage Head», un album qui, dit-on, rendit les Stones malades de jalousie. Jim Dickinson pianotait sur «High Flying Baby», une pièce de choix montée sur un gros riff sec. «City Lights» sonnait exactement comme «You Got The Silver», que chantait Keith Richards sur «Let It Bleed». Les Groovies voulaient tellement sonner comme les Stones qu'ils réalisaient une sorte d'osmose subconsciente. Sur la face B, on tombait sur le monster-hit des Groovies, «Teenage Head», qui devint l'hymne de toute une génération, avec son riffage teigneux à la Bo Diddley et son chant bien pouilleux. Puis ils retrouvaient la veine des deux premiers albums avec «Evil Hearted Ada» - presque rockab - et «Doctor Boogie». C'était tout simplement parfait, si on savait apprécier le boogie. Il bouclaient leur bazar avec un hommage à toutes les soiffardes, «Whiskey Woman», et il fallait attendre le second couplet pour voir le morceau décoller. Ça pouvait sembler long, mais il fallait parfois savoir prendre son mal en patience. Souvenez-vous du gigantesque hydravion d'Howard Hugues qu'on voit dans «Aviator» de Scorsese : il mettait un temps fou à décoller, mais une fois en l'air, tout le monde criait au génie. Pareil pour les Groovies. Et là, c'mon, les Groovies sonnaient la charge, Roy tentait d'arracher le morceau du sol, mais c'est Danny Mihm qui s'y collait en doublant le beat et tout le monde s'engouffrait dans le tourbillon magique.

Victime d'un manque tragique de succès commercial, les Groovies subirent une première mue. Roy Loney, Tim Lynch et Danny Mihm sortirent des rangs, remplacés par Chris Wilson, James Ferrell et Dave Wright. Cyril Jordan noua une relation d'amitié avec Dave Edmunds et enregistra des démos fantastiques qui sortirent sur Bomp! Et puis un beau jour, en passant devant la vitrine du disquaire, je suis tombé en arrêt devant la pochette de l'album «Shake Some Action». What a pochette ! Nos cinq Groovies costumés et cravatés comme des gangsters de l'East End, photographiés en compagnie d'une Jaguar. On attendait TOUT de cet album. On savait que Greg Shaw avait accompagné les Groovies à Rockfield, au Pays de Galles, chez Dave Edmunds. «Shake Some Action» - le morceau qui donnait son titre à l'album - sonnait comme un standard et rassurait les fans de la première heure. C'était même la grosse excitation. Mais après, ça se gâtait sérieusement. On tombait dans la beatlemania des origines et on ne comprenait pas l'intérêt de ce retour en arrière. Quand on posait la question à Roy, lui non plus ne comprenait pas l'intérêt de cet album : «Oh, eight Beatles tracks and two Byrds !» Ce n'était pas sa tasse de thé non plus. Pire encore : l'album parut en 1977, et le bide fut d'autant plus retentissant qu'une vague d'albums géniaux envahissait les vitrines des disquaires (Damned, Richard Hell, Heartbreakers, Ramones and co.) Sur cet album plombé, «St Louis Blues» (l'un des premiers blues connus de l'histoire du blues, datant de 1914 et composé par W.C. Handy) sonnait comme un classique de Chuck Berry, mais les reprises de Chuck qu'enregistrait Dave Edmunds sur ses albums solo étaient bien meilleures. «I'll Cry Alone», «Misery» et «Please Please Girl» ne valaient pas un clou. Le passage de la stonesy à la beatlemania ne leur réussissait pas. Ça ressemblait même à un suicide artistique. Sur la face B, introduit par de glorieux arpèges, «You Tore Me Down» tentait de sauver l'album, mais en vain. On se consolait à l'époque avec les fantastiques 45 tours parus sur Bomp! Il existait un fossé infranchissable entre la fulgurante reprise de «Him Or Me» et ce «Teenage Confidential» merdique qu'on trouve sur l'album. Où était donc passé le génie des Groovies ?

La vraie entrée en lice de Chris Wilson se fait avec l'album «Now». On y entend des hommages aux Byrds et un «Up & Downs» composé par Terry Melcher pour Paul Revere & The Raiders, chanté à la voix de nez et monté sur un bon beat. «Take Me Back» est une fabuleuse rengaine nostalgique des années «où les yeux des filles brillaient encore». Par contre, ils se vautrent sur la reprise de «Reminiscing» (King Curtis). Ils n'ont ni l'éclat de Buddy Holly ni son saxophone. Par contre, «Yeah My Baby» restera l'un des grands classiques des Groovies, avec le fascinant travail des guitares et la chaleur des chœurs, un son unique au monde, et dans «Don't Put Me On», Cyril Jordan prend l'un des solos les plus classieux de l'histoire du rock.

Le groupe enregistre «Jumpin' In The Night» avant de se disloquer. Cet album est une mine d'or. Étonnamment, Chris Wilson y révèle un vrai talent de caméléon, puisqu'il sonne tour à tour comme John Lennon («Next One Crying», digne de l'Album Blanc, ça sent le hanté, chant du nez type «Happiness Is A Warm Gun» - Excellente surprise), comme Bob Dylan (fantastique reprise du «Absolutely Sweet Marie», où sa voix de nez fait des ravages - reprise exemplaire et enrichie de gimmicks groovy) et comme Jagger (reprise magistrale du «19th Nervous Breakdown» - jolie preuve d'amour fidèle de la part des Groovies - reprise considérablement enrichie de gimmicks et de chœurs). Avec cet album, les Groovies renouent enfin avec leur son légendaire. «You're My Wonderful One» renoue avec le swing magique des débuts, reprise d'un hit Tamla de Marvin Gaye. Et puis on tombe aussi sur cette pure perle groovy qu'est «Jumpin' In The Night», salement chantée par Chris Wilson et dotée d'un lourd parfum stonien. Cet album est bourré de morceaux gorgés de son, comme si les Groovies s'étaient dédouanés de la production trop stricte de Dave Edmunds pour retrouver leur espace vital et faire le gros dos. Ils sont tellement en forme qu'ils bouclent l'album avec un morceau swingué comme au bon vieux temps, «In The USA», qu'on écoute en claquant des doigts. Raffiné et bourré de chœurs chauds.
Malgré ces deux bons albums, les Groovies vont disparaître, comme si le diable avait tiré la chasse. Il faudra attendre trente ans pour entendre parler d'une possible reformation.
Chacun est parti bricoler dans son coin : Roy Loney avec les Phantom Movers, Cyril Jordan avec Magic Christian, Tim Lynch et Danny Mihm avec les Hot Knives. Chris Wilson a suivi son petit bonhomme de chemin. Il existe en France un noyau dur de fans qui le suivent à la trace et qui entretiennent avec lui une relation privilégiée, et c'est grâce à ce noyau que Chris peut enregistrer et se produire sur scène. Mine de rien, Chris Wilson bénéficie maintenant du statut de rocker culte jadis attribué par nous autres les gaulois à Gene Vincent et à Vince Taylor.
Après la fin des Groovies, Chris Wilson entreprit sa petite traversée du désert.
Il réapparut en 83-84 sur deux albums des Barracudas («Mean Time» et «Endeavour To Persevere») et franchement, ce n'est pas une période très appétissante. Il manquait aux Barracudas l'étincelle qui fait les grands groupes. Le team Gluck/Wills ne parvenait pas à pondre de bonnes chansons. Personne à Londres n'avait vraiment besoin d'une nouvelle resucée des Byrds. Que foutait Chris Wilson dans ce groupe, d'autant qu'il y avait déjà un chanteur ? Jeremy Gluck voulait aller vers un son plus musclé, Chris Wilson et Robin Wills voulaient rester dans le jingle-jangle des Rickenbackers. D'où le split final. Gluck avait raison, car leur version du «Barracuda» (le nom du groupe venait de là) des Standells est la seule chose intéressante trouvée dans les deux albums où joue Chris Wilson. La power-pop édulcorée des Barracudas a très mal vieilli. Les disques sont éprouvants.

Après le split des Barracudas, Chris Wilson enregistra un album solo, «Random Centuries». Il interprétait toutes ses chansons en s'accompagnant à la guitare acoustique et démarrait avec une étonnante reprise de «You've Got To Hide Your Love Away» des Beatles. Il saluait aussi la mémoire des marins d'antan avec «Sweet Thames Flow Softly».
Chris Wilson adore les chants de marins, comme on a pu le constater avec «Back On The Barbary Coast», paru deux ans plus tard. «Fifteen men on a dead man's chest/ Yo ho ho and a bottle of rum !» Chris et ses frères de la côte - James Ferrel, Danny Mihm et Mike Wilhelm - trinquaient à la santé du diable dans «The Derelict». Ils entonnaient cette chanson de pirates avec ferveur et nous donnaient à savourer un pur moment de mythologie. Ces diables enchaînaient logiquement avec «Sympathy For The Devil» et en livraient une reprise fumante. Membre fondateur des Edwardian LSD cowboys les Charlatans, Mike Wilhelm grattait sa grosse guitare. Danny Mihm battait le mammouth-beat et Chris Wilson remontait extrêmement haut dans l'estime de ses fans. D'autant qu'une autre perle se nichait sur l'album : «This Is London», fabuleuse nostalgie du Londres d'une certaine époque - «waltzing on/ still not home» - une pièce bien enlevée et diablement inspirée.
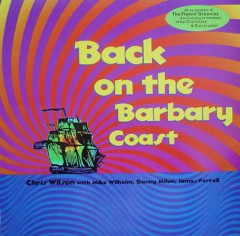
Ces deux albums solo de Chris Wilson parurent sur Marilyn, petit label indépendant créé par un amateur éclairé nommé Patrick Boissel. Pour se rapprocher au plus près de son modèle Bomp!, Boissel s'était installé en Californie, avait épousé Suzy Shaw et fait évoluer son label qui devint Alive, l'un des labels phares de notre époque.
C'est grâce à lui et à Suzy Shaw que parut en 1992 un album curieux de Kim Fowley enregistré live à Berlin, «White Negroes In Deutschaland». Kim y présentait son ami Chris Wilson - «fellow-survivor who went from old friend to my Keith Richards with NO WARNING» (Un survivant comme moi et un vieil ami qui est devenu mon Keith Richards sans prévenir). Kim dit aussi qu'il a fait ce disque «pour la seule joie de paraître stupide en public, pour rester non commercial, bien garage, Monsieur Mauvais Goût/Qui S'y Croit à un niveau horrible». Dans «Third World Girl», il demande à l'armée américaine de rentrer au bercail - «American Army, go home and clean up our cities !» C'est le même message que délivre Eric Burdon sur son dernier album. Puis Kim revient à sa passion pour les éclairs de génie - «Sometimes I hear the guitar of Arthur Lee !» Et puis il soigne sa réputation d'empereur du trash avec «Rockin' in The Balkans», il pète dans le micro - «Serbs ! Slovacs ! Muslims ! You'll die in your sleep ! Prout ! Prout !» - il est mort de rire - «Slavia ! Before the flood !»
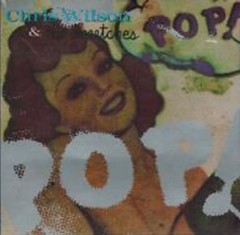
Nouvelle tentative de redécollage en 1993 avec un mini-album. Chris Wilson l'enregistre avec les Sneetches et se livre à son sport favori : la power-pop. Sur ce disque, tout n'est qu'arpèges écarlates et basslines offensives. Chris Wilson est aussi hanté par les Byrds que par les Stones et les Beatles. Il reprend «Goin' Back» de Goffin' and King qu'il fait sonner comme un hit des Byrds.
Puis, pendant quinze ans, Chris Wilson met ses fans au régime sec : rien à béqueter.
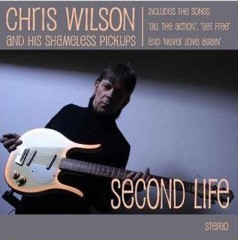
Les pauvres fans réduits à l'état de fantômes squelettiques devront attendre 2008 pour se réalimenter avec «Second Life», un bel album privé de label. Chris y réveille les vieux démons de l'Action («All The Action») et du Shake («Shake That Feeling»), histoire d'imprimer la marque de ses dents dans l'histoire du rock. L'ami Chris chante affreusement bien sa pièce de power-pop têtue, histoire de rappeler à ceux qui auraient une fâcheuse tendance à le sous-estimer qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Il poursuit son festival avec «Sweet Decent», une compo traînante, ambitieuse et judicieusement cuivrée. Il chante dans l'intervalle et prend ses couplets sous la jupe. Avec «Rise», il tape dans l'americana de haut vol, il navigue à bonne altitude et je vous prie de croire que ça vaut largement le Ryan Adams de l'album «Gold». Surprenant, de la part d'un Chris en crise. Puissant et démonstratif, on aura compris que Chris ne connaît pas la crise. Il revient à sa fascination pour Dylan avec «Under The Power Lines», un morceau digne de l'album «Highway 61», ultra-convainquant et son guitariste va même jusqu'à singer Mike Bloomfield. Il poursuit son pèlerinage dylanesque avec une reprise de «Visions Of Johanna». Il chante tellement du nez qu'on se demande s'il ne s'y met pas une pince à linge. Cette histoire va très loin, parce qu'on croit vraiment entendre Dylan.

Les fans reprennent du poil de la bête car un autre album solo sort en 2010 : «Love Over Money», tout un programme. Cette fois, de nombreux frères de la côte sont venus participer aux libations : Roy Loney, Matthew Fisher, Mike Wilhelm, James Ferrell et le vieux bassiste légendaire des Groovies, George Alexander. Cet album n'en finit pas de surprendre, tellement les compos accrochent bien. Il démarre très fort avec «Way Too Fast», big pop blast, une pièce de power-pop d'allure souveraine chantée à la voix de nez, fuselée et chaude, avec un son aussi plein qu'un Polonais qui vient de toucher la paye du vendredi soir. Il prend «Can't Let Go» de très haut, un peu à la Doug Sahm et s'offre des couches de guitares riches et protéinées. Il bascule ensuite dans le psyché crépusculaire, avec «Bad Dreams» et livre une impressionnante pièce aussi hantée qu'un manoir écossais. Mike Wilhelm l'accompagne sur sa grosse guitare. Ça sonnerait presque comme du Mark Lanegan. À un moment, Chris appuie sur le champignon de la glotte et il se met à arracher terriblement. Il chante, fouetté par des vents de guitares intenses. Magnifique chorus de guitare, morceau stupéfiant. L'esprit de David Crosby semble régner sur la chose. Encore plus somptueux : «Cold Dark Night». Chris se permet toutes les largesses avec la grandeur. Il se dégage de ce morceau une atmosphère pesante et déterminante. Il continuera de surprendre en imitant Shane McGowan dans «Poor Law Blues», petite facétie dylanesque colorée au banjo. Roy Loney donne un coup de main à Chris sur «Gambling Man». Retour aux Groovies avec ce boogie blast. James Ferrell fait lui aussi partie de l'aventure. Pus jus groovy. La chose en elle-même n'a aucun intérêt mais elle réchauffera le cœur malade des vieux fans des Groovies. Sur «Fading Away», on entend bien les belles nappes d'orgue de Matthew Fisher. C'est d'ailleurs le seul intérêt du morceau. La grande pop hisse ses voiles, mais il manque l'essentiel : la monstruosité des atmosphères d'Arletty. Et puis le refrain semble digne des Herman Hermits. Dommage. Avec «Semaphore Signal», Chris revient au crépusculaire et à son chouchou Dylan. Et puis en attaquant «Love Over Money», il s'engage sur la voie des géants, jadis ouverte par Procol Harum avec «Humburg» et «Cerdes». C'est un genre difficile. Solide et beau. Romantique, forcément.
Toujours sur sa lancée et bien accompagné, Chris enregistrait l'an passé un album live en France, «Slow Death Live». On ne pouvait pas rêver titre d'album plus explicite. Il ouvrait le bal avec une belle reprise du «Child Of The Moon» des Stones, un pur régal pour tous les nostalgiques des sixties. Les choses sérieuses commençaient avec «The House Of Blue Lights», un morceau chargé de toute la puissance des ténèbres et monté sur un drumbeat faramineux, un rock à la Chuck illuminé par le guitariste actuel des Panther Burns, Grégoire Garrigues. Avec ses deux derniers albums, Chris Wilson avait montré qu'il pouvait faire des miracles. Ça se précisait avec ce nouvel album. Par contre, il commettait l'erreur de reprendre «Grammar of Misery», un vieux morceau des Barracudas. Les morceaux faibles ne pardonnent pas. Sur «A Shot Of Rhythm & Blues», Chris s'arrachait la glotte. Avec cette nouvelle mouture du vieux classique joué et rejoué par les Groovies, Chris cherchait à revenir dans le haut de gamme, d'où il n'aurait jamais dû redescendre. Chris et ses amis chauffaient le morceau à blanc et Grégoire Garrigues y balançait un solo alambiqué et éclatant de vérité à l'ancienne. Pour Chris Wilson, ce fut l'occasion de montrer qu'il était autre chose qu'un vestige. Il retapait dans le dur avec «It's Cold Outside», un hit sixties pur jus qu'il chantait d'une voix sucrée. Chris Wilson montrait une fois de plus l'étendue de sa force : il pouvait passer des Byrds et des Stones aux sucres d'orge.

Les fans doivent maintenant friser l'indigestion, puisque «Flamin' Groovy», le nouvel album de Chris Wilson, vient de sortir. Encore un disque farci de Action et de Shake, histoire de réveiller de vieux démons. George Alexander et Cyril Jordan participent à l'aventure. Chris ouvre le bal avec «All The Action», un morceau de power-pop éclairée, rempli à ras-bord de cette grosse bouillasse d'accords clairs. Chris chante avec une voix de rock star vénérable. Il semble renouer avec le souvenir de cette ancienne beauté fragile qu'on trouvait chez les Groovies. Cyril le héros a composé le morceau suivant, «She Satisfies». Un nommé Anthony Clark joue le solo. Il faut attendre «Shake That Feeling» pour renouer avec l'intérêt. Cette fois, Cyril joue. Le morceau est orienté hit. Chris le chante puissamment et on pense instinctivement à Steve Miller. C'est dire l'excellence de la chose. Chris Wilson sait monter dans les épiphénomènes atmosphériques, il chante avec cette grande puissance hagarde qui est l'apanage des anciens combattants, il arrache la beauté des parois du piton rocheux et on voit les arpèges onduler des hanches comme si les Byrds de 1964 traînaient encore dans les parages. Curieusement, il reprend deux morceaux de l'album «Love Over Money», «Bad Dreams» et «Semaphore Signals» - mêmes traitements à la Lanegan pour l'un et à la Dylan pour l'autre - et revient aux Stones avec «Down To The Wire», un morceau claqué d'accords. Chris y rajoute sa touche. Sur «Sweet Anna», Cyril vient jouer un solo proprement fabuleux. On repasse à la power-pop avec «Feel Your Love», approche byrdsienne, mais avec en plus des bananes dans les culottes. «Can't Let Go» sonne comme un classique dès l'intro. C'est embarqué à fond de train. Voilà ce qu'on pourrait appeler de la power-pop têtue comme un breton.

Quand on parle du loup, il apparaît, dit-on. Une fois de plus, ça se vérifie. Chris Wilson était en France les 11 et 12 octobre derniers, avec ses amis les Barracudas, pour deux concerts, l'un au Gibus et l'autre à Honfleur. C'était l'occasion rêvée de retrouver les ruelles tordues et le vieux bassin d'Honfleur, qui siècle après siècle, semblent conserver un charme intact. Marcher dans Honfleur, ce n'est pas seulement changer d'époque et renouer avec une réelle douceur de vivre déambulatoire. C'est aussi humer le même air qu'Erik Satie et Alphonse Allais, deux puissants héros qui surent élever l'ironie au rang d'art suprême. Deux grands chevaliers de l'Ordre du Rire de Cristal qui fracassèrent bien des murailles et qui sabrèrent - quatre chacun - les huit têtes de l'hydre. À Honfleur, tout est bon. La Météor, la frite, et même les Barracudas sont bons. Pour la première fois, on réussit à les supporter pendant quatre-vingt dix minutes. Ils jouent pour un public de fans de la première heure. Moyenne d'âge cinquante ans. Chris Wilson semble rajeunir, tellement l'air d'Honfleur est bénéfique. Plus aucune trace de cheveux grisonnants. Il gratte sa demi-caisse noire avec les déhanchements d'une danseuse de bouge égyptien. On l'entend à peine, mais ce n'est pas si grave. Perché sur mon épaule, l'esprit d'Erik Satie caquette comme quinze cacatoès, trouvant les Barracudas dada. J'acquiesce, coco ! Cuda dada ! Robin Wills joue trois fois plus fort que son collègue Wilson. Il ventripote et turlupine la power-pop de sa jeunesse envolée. Il est marrant et fait le doué, à son âge. Court sur pattes et fort en gueule. Comparativement, il émane de Chris Wilson une certaine classe, un destin qu'il traîne depuis son passage dans les mythiques Loose Gravel. Il porte un costume en tissu laineux, une chemise à motifs imprimés et des lunettes de rock star modeste. Il disparaîtrait presque derrière son énorme guitare noire. Le chanteur fait toujours aussi mauvaise impression. Jeremy Gluck porte une atroce casquette américaine, ondule comme une grande asperge empotée et chante comme une casserole. Sur l'épaule, l'esprit d'Erik fait le malin : «La glotte du Gluck gode !» J'okète, coco. Pas de pitié pour les Gluckards boiteux. Ils n'ont qu'à laisser chanter Chris Wilson. Il faut attendre un bon moment avant de l'entendre prendre le chant et en plus on ne l'entend pas bien. Pourtant il ne semble pas s'être arsouillé le donjon. Vers la fin du set, les compères font monter sur scène David Buckley, le premier bassiste du groupe, qui a manifestement une fière allure, mais qu'on n'autorise pas à jouer de la basse. Il fait les chœurs au micro de Robin Wills qui passe son temps à réprimer des fous rires. On ne perd pas une miette du jeu frénétique de Chris Wislon, dont les doigts dansent la jigue sur le manche de sa guitare. Il gratte pas mal de cordes à vide et les réattaque avec une soudaine frénésie. Le groupe envoie ses gros classiques d'antan, et puis soudain arrive en vol plané une version ca-tas-tro-phique de «Teenage Head», justement, le morceau auquel personne ne touche, de peur de se couvrir de ridicule. Visiblement, les Barracudas ne craignent pas le ridicule. Ho la la, pas du tout. Ils l'affrontent même avec des mâchoires carrées et des poitrines bombées. Chris Wilson laisse faire. De toute façon, il n'est qu'une pièce rapportée. Le malheureux Jeremy Gluck se retrouve dans le rôle du crapaud de La Fontaine. «Croâ Croâ !» fait l'esprit d'Erik sur l'épaule, «Titi Gluck Teenage Tinette !» Ils vont clouer le destin de leur fin de set comme une chouette sur la porte d'une église avec du mauvais surf et monter encore dans les échelons de l'insupportabilité des choses avec une horrible mouture de «Slow Death» en rappel, comme si ces mecs-là qui sont restés moyens toute leur vie se prenaient pour les Flamin' Groovies. «Sus au fion du sous-surf !» s'agite l'esprit d'Erik, «Saloupiauds ! Ça slodèffe pas bézef chez les sergents-chefs !»
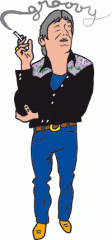
Échoués sur le trottoir, nous palabrâmes des heures puis nous nous fondîmes dans l'épaisseur des brumes, la tête remplie d'échos chantants de Rickenbackers et d'images de gens aux mines réjouies. Peu avant de sombrer dans le néant, j'entendis claquer les ailes de l'esprit d'Erik, envolé en quête d'un coin quelconque.
Signé : Cazengler, adorateur du Chris en croix
Barracudas. Batolune. Honfleur. 12 octobre 2013
Flamin' Groovies. Shake Some Action. Sire 1976
Flamin' Groovies. Now. Sire 1978
Flamin' Groovies. Jumpin' In The Night. Sire 1979
Barracudas. Mean Time. Closer 1983
Barracudas. Endeavour To Persevere. Closer 1984
Chris Wilson. Random Centuries. Marylin 1991
Kim Fowley. White Negroes in Deutschland - Featuring Chris Wilson and his Dawg Guitar. Marylin 1992
Chris Wilson. Back On The Barbary Coast. Marylin 1993
Chris Wilson & the Sneetches. Marylin 1993
Chris Wilson & his Shameless Pickups. Second Life. 2008
Chris Wilson. Love Over Money. Rock Paradise Records 2010
Chris Wilson. Slow Death Live. APC 2012
Chris Wilson. It's Flamin' Groovy ! Twenty Stone Blatt 2013
VOIR RON ET MOURIR
Par cette belle matinée d’août, je faisais quelques emplettes chez Gibert et en passant devant l’étalage du rayon DVD, une paire de grosses pompes noires attira mon attention. Tiens donc, le fameux concert donné par Iggy & the Stooges en hommage à Ron Asheton.
Le gros avantage que donne le DVD, c’est de pouvoir jeter un œil sur les concerts auxquels on ne pouvait pas assister. Comme par exemple ce concert donné à Ann Arbor en avril 2011. Ann Arbor, Michigan, ce n’est pas vraiment la porte à côté. Mais attention, le DVD ne vaut guère mieux qu’une roue de secours. Jamais il ne restituera l’ambiance d’un concert. Au mieux, il jouera le rôle d’un documentaire disons historique. Et quand on a de la chance, on nous refourgue en prime quelques interviews dans les bonus.
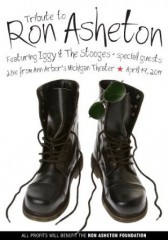
Pour aller regarder ce genre de tribute, il faut vraiment être fan des Stooges. Et les Stooges sans Ron Asheton, ça ne veut plus dire grand chose. D’ailleurs, c’est exactement l’effet que produit ce documentaire. Le pauvre James Williamson occupe la place qu’a laissée Ron en mourant et comme on s’en doutait, Williamson ne fait pas le poids. Mais alors pas du tout. Rien d’étonnant à ce qu’il fasse la gueule pendant tout le concert.
Quand on parle de Williamson autour d’une table, on tombe toujours sur le même os : Raw Power. Les défenseurs de Williamson n’ont que ce mot là à la bouche : Raw Power ! Raw Power ! Ils courent partout en caquetant Raw Power ! Raw Power ! Mais cet album n’est rien sans Ron Asheton à la basse. Le riffage de Williamson ne tient que parce qu’il est épaulé par les monstrueuses basslines mélodico-pulsatives de Ron Asheton. Lorsque j’ai écouté l’album à sa parution, j’ai coupé tous les aigus pour essayer de bien capter ce que Ron jouait à la basse, et ce n’était pas simple, parce que la production de Bowie l’avait déjà à moitié aplati. Et je me disais en entendant le raffut derrière qu’Iggy avait bien de la chance d’avoir le copain Ron dans les parages à Londres, parce que sans lui, l’album ne valait pas un clou, si on le comparait à «Fun House». C’est une évidence tellement puissante qu’elle peut aveugler.
Henry Rollins a le grand honneur de présenter ce spectacle. En Europe, on ne connaît pas la vraie spécialité d’Henry Rollins qui est le spoken word, c’est-à-dire l’improvisation orale à partir d’un thème. Il fait ça depuis longtemps aux États-Unis. Il prend en quelque sorte le relais de Lenny Bruce. Pour mettre la soirée sur orbite, il rend un hommage improvisé aux Stooges d’environ vingt minutes. Sa diction est claire, donc, même si on ne parle pas l’Anglais couramment, on comprend l’essentiel. Ce mec est puissant, au propre comme au figuré, car il parvient à susciter une réelle émotion. Le frangin Scott vient lire un texte écrit sur un bout de papier et remercie Ron d’avoir rendu réels les rock’n’roll dreams.
Henry Rollins indique que Katleen, la sœur de Ron et de Scott, se trouve dans les coulisses, mais elle ne veut pas paraître sur scène.
Katleen, Ron et Scott : l’une des familles les plus mythiques de l’histoire du rock américain. S’il fallait réinventer le jeu des sept familles, on choisirait les Asheton, les Wilson, les Burnette, les Ramones, les McDonald (Redd Kross), les Winter et les Perkins.
La présence d’Henry Rollins dans ce genre d’événement est plus que légitime. Même s’il vient de la scène hardcore californienne, il a toujours chanté bien haut les louanges des Stooges, de la même façon qu’il a monté un label éditeur pour publier les textes de Jeffrey Lee Pierce et de Roky Erickson. Dans son speech, il indique que le choix de Mike Watt comme bassiste est le meilleur choix, mais il oublie de préciser que ce choix fut fait à l’origine par J.Mascis, à l’époque où il avait monté le Stooges Project avec les frères Asheton et des chanteurs occasionnels. Quelques temps plus tard, Iggy fit main basse sur le Project.
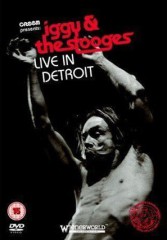
Henry Rollins garde le micro pour chanter «I Got A Right», première stoogerie de la soirée. James Williamson, Scott et Mike Watt l’accompagnent. Avec la distance fatale que crée le DVD, on voit que tout cela est devenu une affaire de vieux. «I Got A Right», ça marchait en 1977, mais maintenant, c’est embarrassant. Mike Watt porte des lunettes de vue et joue les jambes écartées en faisant ses grimaces de catcheur de fête foraine. Williamson prend un solo tuberculeux et tire une gueule de charcutier acariâtre, et pour aggraver les choses, Henry Rollins force trop sa voix. Le moins pire des quatre, c’est Scott. Il porte une casquette et des lunettes noires, ce qui lui donne un faux air de Jean-Marie, le mec qu’on voit tous les matins devant une mousse au bar du PMU. Ce n’est pas Panic in Detroit, mais Gros Malaise in Ann Arbor. Les papys font du punk.
J’allais arrêter le carnage pour aller faire un tour en ville, quand soudain, Iggy a surgi, cavalant sur scène comme un cabri ivre de liberté. Et là on change de registre. Beaucoup de gens haïssent Iggy Pop aujourd’hui parce qu’il fait de la pub. Mais ces médisances restent des propos de pauvres malheureux qui n’ont jamais rien fait d’intéressant dans leur vie et qui ont le plus souvent un pois chiche à la place du cerveau. La grande différence qui existe entre Iggy Pop et eux, c’est qu’Iggy Pop a chanté dans les Stooges. Ceux que je connais et qui crachent sur Iggy écoutent encore les mauvais albums de John Cale et font des petits boulots de manœuvre, en parfaite osmose avec leur médiocrité. Pendant ce temps, Iggy roule en Ferrari dans les rues de Miami.
Celui qu’on surnommait autrefois l’Iguane arrive en sautant partout, comme Larry Collins. Mais il a soixante balais, pas huit comme Larry. Il rajeunit la soirée d’un seul coup. Et paf, on se tape une version de «Raw Power» qui confirme tout le mal qu’on en pensait : catastrophique. Le riffage de Williamson est plat comme une planche à pain, et comme on n’entend pas ce que fait le père Watt, on s’apitoie. Williamson doit bien le sentir, puisque son visage se ferme encore plus. Il doit se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère. Il est beaucoup moins appétissant que le junkie dangereux entré dans la légende des Stooges en 1970. Il est d’autant plus mal à l’aise que son putsch a laissé des séquelles dans l’histoire des Stooges. Il avait quand même réussi à faire virer Ron qui était le membre fondateur et l’âme des Stooges.
Par contre, Iggy Pop s’en sort bien. (On a deux héros qui vieillissent admirablement bien : Iggy et Dutronc.)
Iggy parvient miraculeusement à redresser la crédibilité de «Search And Destroy», l’hymne punk par excellence. Le problème avec les Stooges, c’est qu’on espère encore que ça va continuer longtemps. Dans une récente interview accordée à Classic Rock, Iggy annonce qu’il va faire un break d’un an, pour ne pas se faire bouffer par la popularité grandissante du groupe. Il indique aussi qu’il va cesser de se jeter dans la foule, car à chaque fois, il se blesse et, passé un certain âge, la récupération devient difficile.
Le problème de ce début de concert, c’est qu’il n’est pas très représentatif de l’art de Ron. Ils tapent dans le troisième album et à la limite, c’est insultant pour la mémoire de Ron qui, faut-il le rappeler, ne jouait que les morceaux des deux premiers albums, quand les Stooges se sont reformés autour de lui. On assiste à pas mal de versions ratées jusqu’à «Open Up And Bleed» où on retrouve le croon qui faisait la force d’Iggy, cette voix chaude et profonde aux accents pervers. Il semblait souvent chanter à contre-courant du son, comme s’il remontait un torrent. Il s’assoit au bord de la scène et dit à une fille d’une voix de tombeur qu’elle est jolie. You are very pretty.... But Your Pretty Face Is Going To Hell ! Sur «Wanna Be Your Dog», Papy Williamson gratte ses trois accords avec le mi grave à vide. On a ajouté un orchestre à cordes et curieusement ça marche. Surtout sur «Dirt» qui du coup sonne comme du Marvin Gaye. Sans doute une idée à Iggy.
Le groupe revient sur scène avec un nouveau guitariste, et là, ça change tout : Deniz Tek attaque le riff de «TV Eye» sur sa Strato blanche avec une telle ferveur qu’on croit rêver. Pour «Loose», même chose, now look out ! Iggy renoue avec sa chère délinquance juvénile. Il se jette au sol, rampe comme au bon vieux temps. Les Stooges auraient dû prendre Deniz Tek, évidemment.
Si on veut revenir aux choses sérieuses, il existe un document spectaculaire sur Ron Asheton, le fameux DVD «Live In Detroit» paru en 2004. Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de voir les Stooges reformés autour de Ron sur scène, c’est le seul moyen de voir jouer cet immense guitariste. Sur ce DVD, il y a deux choses : le concert live, mais aussi un autre concert donné par Iggy et les deux frères Asheton chez un disquaire new-yorkais, où ils jouent avec un tout petit son et c’est tout simplement le document qu’il faut voir. La caméra est posée près de Ron et on le voit jouer tous les classiques des Stooges en laid-back, assis sur un tabouret de bar et branché sur un petit ampli de répète. Ça produit le même effet que de voir Jeffery Lee Pierce jouer «Purple Haze» tout seul sur sa Strato, chez lui, dans le film d’Henri-Jean Debon, «Hardtimes Killing Floor Blues».
Et si on veut voir l’un des plus grands guitaristes de rock dans le feu de l’action, alors, retour sur scène, à Detroit, pour «Down In The Street», faces shine, real O mind et Ron balance sa purée comme au bon vieux temps. En les voyant jouer sur scène, l’évidence nous saute à la figure : les Stooges étaient uniques au monde. Il n’avaient qu’une seule dette, celle du beat de «1969» envers Bo Diddley. Mais pour le reste, ça leur appartenait. Et sans Ron, pas de Stooges. Regardez comment il joue «1969» : deux accords wha-whatés en intro et riffage sur place, puis, à la sortie du couplet chant, solo fulgurant. Éclair de génie. Le modèle absolu.
Quand on les voit attaquer «Wanna Be Your Dog», on comprend que le pauvre Mike Watt doit endurer un véritable supplice : se retrouver sur scène avec les frères Asheton et Iggy Pop, en gros, le rêve de tous les musiciens américains.
Avec «TV Eye», Ron retrouve son trône de roi du riff. Il met le feu à Detroit, exactement de la même façon que Wayne Kramer le fait dans «Motor City Is Burning». Ron sort un riff ultra-agressif avec un son ultra-saturé. Il est l’un des guitaristes les plus copiés, mais aucun de ceux qui ont cherché à l’imiter n’ont pu l’égaler. On le voit, morceau après morceau, incroyablement concentré, au pied de ses deux colonnes Marshall.
Faut-il rappeler que Ron Asheton ne s’est jamais remis de son éviction des Stooges ? Il ne vivait que pour le groupe et il était le seul dans cette petite communauté à ne pas prendre de drogues dures. Parce qu’il veillait sur son petit frère Scott qui lui se shootait comme un malade.
En règle générale, les reformations de groupes célèbres puent un peu. Mais celle des Stooges fait exception. Ces mecs là remontent sur scène comme si on était encore en 1970, avec la même énergie, le même son et le même état d’esprit.
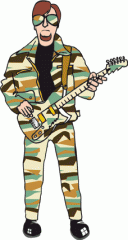
On voit Ron prendre un solo sur «1970» et générer une nouvelle marée de lave sonique. En comparaison, Williamson est sec comme une pipe en bois. Ron joue la fusion avec Steve McKay. Les Stooges furent le seul groupe capable de monter une telle mayonnaise. Après ça, on ne pouvait plus dire d’eux que c’était un groupe à trois accords. Ils avaient ouvert une sacrée voie. À la grande différence des groupes de prog anglais, ils donnaient à leurs ambitions musicales une vraie allure et de la puissance. Un seul groupe anglais pouvait approcher ce genre de chaos superbe : Van Der Graaf Generator. La version de «Little Doll» est une merveille de groove primitif. Voilà un morceau qu’on ne prenait pas vraiment au sérieux sur le premier album et qui reprend sur scène toute sa dimension vénéneuse.
C’est sans doute à ça qu’on reconnaît les géants : on en parle au présent.
Signé : Cat Zengler, qui préfère les Ron aux carrés
Tribute To Ron Asheton. DVD MDV 2013
Iggy & The Stooges. Live In Detroit. DVD 2004
JEFFREY LEE PIERCE
AUX SOURCES DU GUN CLUB
MARC SASTRE
( les fondeurs de briques / 2013 )
C'était il y a longtemps, ma maman faisait de la couture et je ne sais quelle lubie lui avait traversé la tête, à rebours de ses habitudes elle avait allumé en plein après-midi la télé qui passait une émission des plus oiseuses. Genre la ménagère de plus de quarante ans. Peut-être y avait-il un fou furieux à la programmation, ou alors ils avaient mélangé les cassettes à la régie finale. Une séquence des plus insipides s'achevait et je m'apprêtais à regagner ma chambre lorsque subitement sur l'écran a commencé à se balader dans une rue une blondasse un peu enveloppée. Je subodorai une calamité sur les régimes amaigrissants. Ben, non, au fur et à mesure que la donzelle se rapprochait de la caméra, fallait se rendre l'évidence. C'était un homme. Un vrai, avec un regard de serial killer et des cheveux décolorés au moins à l'ammoniaque pur. Non seulement vous n'auriez jamais laissé votre petite soeur se marier avec lui, mais question de sécurité vous auriez enfermé votre grand-mère dans le placard.

Fallait tendre l'oreille pour entendre la musique en fond sonore, mais avec la voix off qui s'est calée dessus elle est devenue inaudible. C'est à ce moment que ma mère s'est permis quelques commentaires sur la paire de chaussettes ( même pas noires ) qu'elle entreprenait de ravauder. J'ai tout de même saisi l'essentiel, l'individu se nommait Jeffrey Lee Pierce et on le présentait comme le successeur de Jim Morrison. Au niveau chant je n'en savais rien, mais question dégaine charismatique, ce n'était pas faux. Respirait pas la force tranquille, plutôt la puissance inquiétante. Vous imaginez la suite, la procure des disques et tout le bataclan. M'avais suffi de le voir déambuler dans une rue de Los Angeles le long d'une séquence TV de trois minutes pour sentir que c'était un grand. Magie du rock'n'roll.
LES FONDEURS DE BRIQUE

J'ai un faible pour ces gars-là. Je ne les connais pas, mais, atal ! déjà ils sont de Toulouse – toute ma jeunesse, un point positif donc – ont sorti, traduit en notre douce langue françoise, l'année dernière, Le Pays où Naquit le Blues d'Alan Lomax, que nous avons chroniqué dans notre livraison 119 du 22 / 11 / 12, et hier lundi matin m'avertissent par mail qu'ils mettent en vente un bouquin consacré à Jeffrey Lee Pierce, je réponds illico et miracle ce mardi matin le livre est dans ma boîte avec en plus un marque-page et un pin's à l'effigie de Jeffrey. Je vous le dis, il en faut peu pour rendre un rocker heureux.
Ne vendent pas que des livres sur le rock, faites un tour sur leur catalogue, c'est rempli de curiosités qui vous mettent l'eau à la bouche. Âmes sensibles abstenez-vous, ont l'air d'être, entre autres, des aficionados de corridas.
MARC SASTRE

C'est l'auteur. Pas un tâcheron qui s'est attelé à une monographie rock parce qu'il faut bien survivre dans ce monde de brutes libérales. Non un fan. Ne pas confondre avec un supporter stupide. Le rock, c'est comme les scuds. Ca vous arrive dessus sans crier gare et ça vous détruit de fond en comble. Après faut vous reconstruire, en intégrant dans votre personnalité l'alien qui vous grignote le cerveau. Pas facile, faut apprendre à maîtriser. Mais dès lors la force est en vous.
En plus, nous avons de la chance. C'est un écrivain. Un vrai qui écrit autant pour mieux cerner son sujet que pour se comprendre lui-même. Pas une bio aux détails croustillants, mais une réflexion sur l'histoire et l'essence du rock. L'est porté par son propos. Le style et le flux, il y a des tas de passages que j'aurais bien aimés avoir écrit moi-même. Ce Marc Sastre, en écriture il ne porte pas la marque du désastre.

Ne le connaissais pas. L'a pourtant publié aux Editions Clapas où a longtemps officié l'ami Christophe Liron, maître es cuirs. L'a écrit plusieurs recueils de poèmes, trop peu d'extraits sont visibles, mais ils révèlent une démarche originale, très rare en la création contemporaine.
GUN CLUB
Vous ne confondrez pas avec Guns and Roses. Ce n'est pas la même chose. Au niveau métaphysique. Ne sont pas sur la même longueur d'onde êtrale. Pas le même niveau de conscience. Les Gun Clubs ce sont ces milices d'honnêtes et vertueux citoyens qui se sont développées aux Etats-Unis à la charnière des années 70-80. S'entraînaient au tir et patrouillaient dans la rue pour porter secours à la veuve et aux orphelins. Ma pauvre dame, faut bien se défendre contre toutes ces racailles ( souvent colorées ) qui traînent dans notre quartier d'habitude si tranquille. Les Gun Clubs, ça vous avait un petit relent de fascisme un peu trop fort pour les odorats délicats qui rêvent de libertés individuelles. S'appeler Gun Club, c'était au pays de l'oncle Sam une manière de tirer un peu trop fort sur la corde de la dérision. Sur celle de la provocation, aussi.
Après la tornade punk, le rock semblait être arrivé au bout de son chemin. Difficile de faire mieux dans la violence et la révolte. Et peut-être encore plus difficile de faire pire. Nous autres européens nous savons qu'après les Destruktivs Commandos Dada, s'est levée l'efflorescence subluminale surréaliste. Oui mais les Ricains, c'est un peuple un peu inculte. Au lieu d'aller de l'avant, ils se sont retournés en arrière, vers leurs racines. Gun Club se forme en ces années de doutes et de recherches. Jeffrey Lee Pierce figure centrale et ressourçante du Gun Club est peut-être plus à même que ses acolytes à trouver la sortie du labyrinthe.
L'est un peu plus intello que la moyenne, est encore ado qu'il écrit des chroniques dans Slash, n'est pas pour cela un véritable poète, plutôt un sensitif qui cherche et trouve. Esprit ouvert il commence par se remettre en cause, lui l'amateur de reggae laisse de côté la Jamaïque et ses rastas, d'abord parce qu'il n'aime pas les bondieuseries, ensuite parce qu'il resserre l'aire de ses recherches à l'essentiel du terroir musical américain. Le delta, les Appalaches et les quartiers noirs des grandes villes. Tiercé dans l'ordre, le blues, la country et le jazz. L'on a oublié l'outsider. A fait la course en tête, mais l'a été disqualifié au dernier moment.

Les punks avaient volé leur uniforme aux rockers. Se croyaient plus forts qu'eux parce qu'ils avaient ajouté des clous sur leurs perfectos, mais très vite ils s'aperçoivent que leur musique n'aura connu qu'une courte période de gloire. En trois ans tout est rentré dans l'ordre et la pop reprend le dessus. L'Histoire se répète. Aux USA, l'on a déjà tourné le film à la fin des années cinquante, quand on a passé l'éponge effaceuse sur les pionniers. Tellement bien, qu'on les a oubliés et que l'on va se tourner vers la seconde génération – en fait c'est la même que la première, un peu comme chez nous quand on établit une coupure épistémologique entre les Grands Romantiques et les Petits – celle à qui l'on va attribuer l'appellation de rockabilly.
C'est le chaînon manquant qui permet le retour aux trois grands courants, le blues, le country, le jazz, tout en se réclamant du quatrième, le rock. Marc Sastre saisit parfaitement ce retour du pendule en arrière. Insiste beaucoup sur l'ambivalence de Kid Congo Powers qui passe naturellement du Gun Club aux Cramps... Les Cramps que l'on présente comme les pères de ce rockabilly survitaminé, mâtiné de fièvre garage, que l'on nommera bientôt en Angleterre psychobilly. C'est en cette même époque qu'éclatent aussi les noms de Tav Falco and The Panther Burns ( voir livraison 144 du 18 mai 2013 )...
BLUES

Mais sur son premier disque Fire of love ( 1981 ) Jeffrey Lee Pierce descend deux étages plus bas. Saute à pieds joints dans le blues. Blues, mais pas transcription. Le Gun Club du côté des guitares ce n'est pas la virtuosité de Clapton, ni la restitution stonienne appliquée. Ne s'emberlificotent pas dans le respect des douze mesures, Jeffrey et ses potes ne sont pas des archéologues qui vous tracent au millimètre près des maquettes en trois D de monuments qui ont disparu depuis vingt siècles. Eux, ce qu'ils recherchent c'est l'expérience du bluesman et l'esprit du blues. N'usent pas de papier calque, cherchent le balancement hypnotique de Skip James et la colère rentrée, toute de violence explosive, de Robert Jonhson. Sont aux sources du delta.
Le blues comme une descente aux enfers. Rien à voir non plus avec le feeling d'Eric Burdon. Celui-ci officiait dans l'optimisme des sixties. L'on redécouvrait le blues comme Christophe Colomb l'Amérique. Vingt ans plus tard, le Gun Club est dans les eaux boueuses du Mississipi, dans la merde jusqu'au cou.
COUNTRY

Après le blues, ce sera au country de passer à la moulinette du Gun Club sur Miami ( 1982 ). La même démarche, à coups de serpes. L'on enlève tout ce qui est superfétatoire. Tout ce qui est joli, tout ce qui vous tire les larmes des yeux. L'on n'est pas ici pour s'apitoyer sur soi-même. Le monde de la country est aussi dur que celui du blues. Fermez les poings, hurlez au-dedans de vous, si cela doit vous soulager, essayez de résister et de vous en sortir vivant. Jeffrey ne pose pas sa voix, il perce et vrille. Touche le fond de la musique populaire américaine. Troue le plancher, mais n'obstrue pas la voie d'eau.
JAZZ

Avec The Las Vegas Story, Jeffrey passe le rubicon du rocker. Vient de démantibuler le country et voici qu'il se réclame du jazz. Une musique spécifiquement noire pour un auditeur américain moyen. Le blues est sombre, mais l'on peut s'y retrouver. Tout le monde a un jour ou l'autre broyé du noir, mais le jazz avec ses suites interminables d'accords stériles qui ne s'arrêtent jamais, c'est un peu le supplice de Tantale. Dès que l'on croit pouvoir se mettre quelque chose sous la dent, le truc vous échappe et vous avez beau courir après, vous ne le rattraperez jamais.
Mais là Jeffrey outrepasse la mesure. Car il y a jazz et jazz. Le premier a été policé dès les années vingt par les musiciens classiques européens, ils ont mis de l'ordre dans le tohu-bohu, ils ont établi des lignes d'accords et dégagé des espaces pour la mélodie. L'on présente comme une victoire culturelle des noirs le fait que Stravinsky ou Ravel ait transposé quelques mesures de blues et quelques syncopes de jazz dans leurs opus, oeuvre de colonisateurs qui a servi avant tout à domestiquer l'impulsion libre des big bands... Mais Jeffrey ne s'intéresse point à ce jazz abâtardi. C'est la New Thing qui l'inspire, cette improvisation totale qui retire ses propres cadres harmoniques dans le moment même où elle les propose comme possibilité d'écoute aléatoire. La musique perd sa clarté, elle se confond avec le bruit. Future Noise Music.
UNE VIE ROCK'N'ROLL
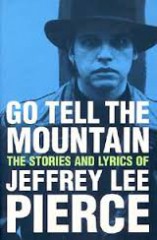
Trois disques qui sont autant pierre d'achoppement que de fondation. C'est beaucoup trop pour un même homme Beaucoup trop pour l'Amérique surtout. Jeffrey ne supporte pas l'ambiance ultra-conservatrice de la société reaganienne qui se droitise de plus en plus. Il trouvera de plus en plus refuge en Europe. Spécialement en France. Tout à l'honneur de notre pays qui a su forger les légendes d'un Johnny Thunders ou d'un Gene Vincent.

Le Gun Cub devient un groupe à géométrie variable. Splitte souvent pour mieux renaître de ses cendres. Jeffrey se met à la gratte et se révèle un guitariste hors pair. Jeffrey n'est pas facile à vivre et même difficile à suivre. En musique comme dans son existence. Trop d'alcool, trop d'excès, trop de drogues, mais surtout beaucoup trop d'alcool. Sur scène, d'un soir sur l'autre, ce peut-être la Bérézina comme l'apothéose... Le public a tendance à se raréfier. Jeffrey ne le ménage pas. Il déteste se répéter. Chaque nouveau disque devient trop différent du précédent pour fidéliser un noyau conséquent de fans. Les amateurs de rock sont comme les autres, n'aiment guère que l'on remette en cause leurs habitudes et leurs conforts d'écoute.

Les affaires de coeur tournent à l'aigre, mais c'est le foie qui bat de l'aile. Aurait besoin d'une greffe. Vu ses revenus, il sait qu'il ne peut y compter. Décèdera fin mars 1996. Quitte un monde qui n'est plus fait pour lui. L'after-punk n'a pas eu davantage de futur que le punk.

Ce beau livre de Marc Sastre tombe à pic pour ranimer la flamme du souvenir de Jeffrey Lee Pierce qui commence à vaciller. Le Gun Club reste l'un des groupes météores des années quatre-vingt. Ne bénéficie pas de cette aura hiératique et permanente qui entoure les Doors et Jim Morrison. Sans doute à cause de l'unité musicale rassurante que l'on peut trouver dans l'oeuvre de Roi Lézard. Jeffrey est survenu dans un monde de plus grande turbulence, et son legs est en quelque sorte déchiré et éparpillé dans ses différents efforts pour en colmater les brèches de plus en plus nombreuses et de plus en plus larges. Merci à Marc Sastre d'avoir évoqué avec tant de précision et de perspicacité la complexe personnalité chatoyante et de cet immense artiste.
Jeffrey Lee Pierce, un des noms essentiels de la galaxie rock.
Damie Chad.
CHRONIQUES VULVEUSES
( Pour les quatre premiers épisodes se reporter aux livraisons 154 à 157, comme l'on est gentil pour rattraper le temps perdu l'on vous refile trois épisodes. )
CINQUIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
18
Je ne pus retenir un cri de surprise. Enfin, j'avais devant moi – je les voyais de visu de mes yeux voyeurs – les fameuses vulves dues à la malfaisance de Claudius de Cap Blanc. Je tiens à le préciser, malgré leur immobilisme hiératique les bulbes claudiusiennes ne disent ni non, ni oui. Elles se contentent de faire signe. Les mains gantées de rouge, allègrement disposées à leur droite et à leur gauche sont autant d'encouragements à nous abîmer en la profondeur d'une réflexion philosophique sans fin. J'en étais là en ma contemplation théorétique et plus je m'enfonçais dans mon sujet plus j'en venais à me demander si je n'étais pas comme l'astronaute de 2001 Odyssée de l'espace en partance vers la limite externe de l'Univers, qui tout en s'approchant du point le plus éloigné de notre monde intergalactique est en même temps en train d'effectuer le retour vers les terres du milieu de l'origine centro-sphériale...
Ce sont les trémolos liturgiques de la voix de Marie qui me tirèrent de ma rêverie métaphysique :
« Damie, je vous en supplie, dites-moi quelque chose, vous qui êtes un poëte, ayez les mots définitifs de condamnation sans appel de ces horreurs sans nom qui rabaissent la femme, que dis-je l'Amoureuse, à n'être que le trou de l'évier du désir ! »
Tout comme l'orateur enflammé qui ponctue son discours en tapant avec la plus grande violence de son poing persuasif le bois de la tribune depuis laquelle il prononce son exhortation, elle infligea une traction avant des plus douloureuses sur mon sexe qu'elle tenait sans y prendre garde, comme par hasard, dans sa main gauche. Ce qui eut pour effet mécanique, mais désastreux, de m'occasionner une érection éléphantasiesque qui dut néfastement influer sur ma réponse.
« Voyez-vous Marie, si j'étais au bord extrêmif de l'univers, et si par hasard de mon sexe tendu j'en touchai du gland vainqueur la membrane extrême, que se passerait-il ? Mon sexe rebondirait-il en arrière comme la boule du billard qui ricoche sur le bord et retourne dans la direction de la queue qui la poussa, ou bien mon vit victorieux s'introduirait-il dans la virginité d'un nouvel espace par lui enfanté ? Pour sa part au sixième siècle avant l'ère du petit Jésus, le grec Aristarque répondait à cette question que... »
19
Hélas, je n'eus pas le loisir de continuer plus avant ma méditation à haute voix. Alors que je m'attendais à ce que la sagesse d'Aristarque appelât chez Marie à un sursaut de ses plus hautes facultés intellectuelles et que nous nous engageassions tous deux en un dialogue socratique de grande tempérance et de docte sagesse, il n'en fut rien. Ce fut la bête hideuse, l'instinct primordial, la femelle primale, qui se déchaîna en elle.
Poussant un feulement de lionne dépitée, elle m'entraîna – toujours sans lâcher ma laisse charnelle - dans la teuf-teuf mobile dont elle fit rugir le moteur comme le réacteur d'un avion Rafale ( de fabrication française ). Nous ne mîmes même pas dix-sept secondes pour parcourir les quatre kilomètres qui nous séparaient de son refuge pour artistes résidentiels. La teuf-teuf y battit tous ses records.
20
Pas moi. Traîné par mon appendice caudal, elle me jeta – nu comme un ver de terre – sur les draps de satin bleu de son lit à baldaquin. Je n'eus pas le temps de reprendre souffle, déjà elle arrachait sa grosse culotte et j'entrevis en un spasme d'horreur l'épaisse toison de son pubis dont les poils se dressaient telles les vipères sur la tête de Gorgone peinte par Caravage ( 1571 – 1610 ). J'essayai de m'échapper mais elle m'immobilisa la tête et les vertèbres cervicales entre ses seins aussi solide que les mâchoires d'un étau en acier trempé suédois.
« Ah ! Monsieur cherchait à faire le malin, à m'éblouir par de fallacieuses digressions philosophiques, tout cela pour cacher une appétence dépravée pour les sales vulves exhibitionnistes de Claudius, eh, bien je vais te montrer moi, ce que c'est qu'une vulve en vérité ! »
Et elle appuya son bas-ventre sur mes testicules écrasées, je tentais de résister, mais toute ma dignité fut aspirée dans le couloir de la (petite) mort, j'eus l'impression qu'elle me vidait de toute ma substance vitale, semence, sang, lymphe, tripes et boyaux compris,... elle recommença au moins quinze fois, son vagin vagissant m'assourdissait, je ne savais plus où j'étais, je faillis m'évanouir...
Ce fut Molossa qui me sauva. Dans sa sagesse de chienne, elle dut juger que l'agent 009891 était en position délicate, elle planta ses crocs dans le gras du mollet droit de Marie qui relâcha son étreinte, j'en profitai pour sauter hors de ma couche funèbre, et récupérant au passage mon jean et mon perfecto, je pris la fuite sans demander mon reste.
21
J'avais arrêté la teuf-teuf sur la place centrale du patelin. Je vidai deux fiasques de sky sans que l'alcool n'agît comme un remontant. Quoique tout flagada, je m'extirpai de la voiture pour me rendre au café voisin et y écluser au moins douze quadruple scotchs. Mais à peine hors du véhicule mes forces me trahirent, je retombai à genoux, la tête posée, sur le siège avant. J'en profitai pour remercier Molossa en lui caressant les oreilles.
Elle ne les entendit donc pas, et moi je ne les vis donc pas survenir, mais je sentis leurs poignes solides qui me soulevèrent par les épaules. A leurs uniformes bleu-marine je reconnus les gendarmes.
« Nous présumons Monsieur Damie Chad, ayez le bon sens de nous suivre sans tergiverser. N'aggravez pas votre cas, nous vous arrêtons pour intelligence supérieure avec l'Ennemi intérieur, plus viol et voies de faits sur demoiselle post-pubère. Tout ce que vous n'avouerez pas pourra être retenu contre vous. »
Et nous voici partis pour la gendarmerie. Entouré d'une escouade de douze pandores, il était inutile de songer à m'enfuir. Molossa suivait le groupe, la queue en berne. Moi aussi. ( A suivre )
FIN DU CINQUIEME EPISODE
CHRONIQUES VULVEUSES
SIXIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
22
M'avaient attaché au radiateur et les coups pleuvaient comme giboulées au mois de mars. Je serrais les dents et n'ouvrais la bouche que pour leur cracher dessus. Au bout de cinq heures le brigadier-chef ressemblait à Johnny Rotten en 77 en concert avec les Sex Pistols dans la banlieue de Birmigham. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vague ressemblance avec cette figure morale et charismatique du punk avait passablement l'air de l'énerver. Quant à l'Adjudant-chef qui me balançait en rigolant des coups de dictionnaire sur le crâne, l'était carrément plus Vicious que Sid.
Les autres commençaient à avoir mal aux poings et à leur cartilages. Quant aux coups de pied dans les ouilles, je ne les sentais même pas tant Marie me les avait rétrécies. J'étais comme le roseau qui ne plie pas, j'étais comme le chêne qui ne rompt pas. Mais même si je prenais mon mal en patience, je commençais à trouver le temps long. Je suis bon garçon et dans la vie en règle générale je respecte les gardiens de la paix. Par contre je n'aime pas que l'on maltraite les animaux. C'est mon côté Brigitte Bardot. Aussi, quand l'Adjudant-chef excédé envoya un coup de pied à Molossa qui dormait sous son bureau, z'ont très vite compris que ça allait barder.
Je n'aurais pas dû. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Pris d'une subite colère, d'un coup sec j'ai arraché le radiateur du chauffage central et l'ai bazardé sur la tête d'un sous-fifre qui eut la malheureuse idée de pousser la porte pour demander s'il pouvait lui aussi venir jouer au punching ball. Ensuite ce fut comme si vous regardiez en même temps, La Fureur du Dragon et Le Jeu de la Mort de Bruce Lee sur le même écran. Je n'en tire aucune gloire car tous les agents du SSRR reçoivent une formation de Close-Combat et de Jiu-Jitsu appropriée aux missions les plus dangereuses.
Je m'amusai comme un fou, j'avais emprisonné l'Adjudant-Chef dans la lunette des WC et m'apprêtais à lui faire avaler les pages roses du Petit Larousse lorsque Molossa – c'est fou comme les cabots sont rancuniers – en profita pour lui mordre les fesses et lui arracher son pantalon. L'est vrai qu'avec son ovale de WC qui lui immobilisait les bras et son slip jaune par-devant et marron par-derrière, notre représentant de la loi prêtait à rire.
Malheureusement l'Adjudant-Chef n'avait pas le sens de l'humour, de sa main il se saisit de son arme réglementaire et la pointa sur Molossa. Déjà son doigt caressait avec une volupté sadique la détente.
« Fini la plaisanterie, écuma-t-il, Monsieur Chad prenez une chaise et un stylo, et écrivez exactement ce que je vous dicte : « Moi, soussigné Damie Chad, reconnais faire partie de l'Organisation Terroriste de la Conjuration Vulvaire et avoue m'être livré à des actes introductifs inqualifiables sur le corps non-consentant d'une demoiselle post-pubère. » Bien, vous avez signé ?
-
J'ai signé, répondis-je d'une voix blanche
-
Parfait, je puis maintenant abattre cette bête enragée selon l'article C2689 – WW 8236 – Alinéa 2 du Code Civil. »
Il abaissa son pistolet, vérifia en clignant de l'oeil que Molossa était dans sa ligne de mire et...
23
Son portable sonna. Par un réflexe pavlovien, mais salutaire, il le porta à son oreille :
« Nom de Dieu, on ne peut jamais être tranquille dans ce foutu pays, c'est encore toi Ursule qui n'arrives pas à ouvrir le bocal de cornichons, ah ! C'est vous Monsieur le Procureur, Bonjour Monsieur le Procureur, Mes respects Monsieur le Procureur, qu'on vous emmène les prévenus tout de suite, bien sûr Monsieur le Procureur, je vous annonce une bonne nouvelle, Monsieur Chad a signé ses aveux, le chien n'a rien dit alors je proposai de l'abattre sans autre forme de procès, ah! Il faut vous le porter aussi, tout de suite Monsieur le Procureur, mes respects Monsieur le Procureur, bonne soirée Monsieur le Procureur, si je peux me permettre je vous prierai de transmettre mes respectueuses salutations à Madame votre épouse, Merci Monsieur le Procureur ! »
24
Le Proc avait bien fait les choses, assiettes de petits gâteaux – une pour moi et une pour Molossa - café chaud pour mézigue et eau fraîche pour la chienne. Pour le remercier, aussitôt bue aussitôt pissée sur le coin gauche du tapis. Il ne fit aucune réflexion. L'était manifestement gêné aux entournures. L'avait chiffonné ma déposition et jetée d'un geste excédé dans la corbeille à papiers.
« Laissons-là, ces fadaises. N'en veuillez pas à nos forces de l'ordre. L'important est leur obéissance sans faille aux directives venues d'en haut. Même si parfois elles se meuvent avec la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaines. Que voulez-vous, il en faut pour toutes les nuances intellectuelles. Pour mieux me faire comprendre je vous demanderai de tirer les lourds rideaux de brocart qui masquent les fenêtres et d'ouvrir les battants, le double-vitrage a un peu trop tendance à nous couper des cris de la rue, si bien décrits par Marcel Proust. Pour ma part j'éteindrai la lumière, mais je vous en prie, sans trop vous faire remarquer, regardez, et écoutez la voix mélodieuse des masses populaires ! »
25
Je suivis l'indication, et caché dans les double rideaux je risquai un oeil dans la rue. Elle grouillait de monde. Une foule coléreuse battait le goudron. Les gens brandissaient des pancartes exigeant la condamnation à mort de Damie Chad et de son chien. Sur l'air des lampions l'on me menaçait de pendaison et l'on me promettait la guillotine. Invectives et cris de haine s'entrecroisaient. Je n'en croyais ni mes yeux, ni mes oreilles. J'avoue qu'une désagréable sensation de peur s'installa au creux de mon ventre. Je refermai doucement la fenêtre et pris soin de ne laisser aucune fente à la jonction des deux rideaux.
Je me retournai vers le proc. Avait changé de contenance. L'était littéralement écroulé de rire sur son bureau. Il en meuglait de joie et hennissait encore plus fort chaque fois qu'une larme coulait de ses yeux facétieux. Il hoquetait et en bavait sur son buvard, se tordait sur son siège et finit allongé sur le tapis, le nez dans l'urine de Molossa en poussant des ricanements de hyènes hystériques.
« Hi ! Hi ! Hi ! Viol de demoiselle post-pubère, excusez-moi, mais c'est la première fois en quarante ans de carrière que j'imagine une telle qualification, une véritable trouvaille poétique opératoire, et la population qui manifeste pour que l'on punisse un pédophile qui s'est attaqué à une rombière de cinquante balais ! Jamais je n'aurais tant ri de la bêtise universelle ! »
Soudainement son visage redevint grave et sérieux.
« Agent 00 9891, je tiens à vous préciser que nous en savons beaucoup plus que vous !
-
Sur quoi au juste ? questionnai-je intrigué
-
Mais sur vous, évidemment ! »
Je ne cachai pas mon étonnement.
« Vous savez, dit-il, c'est une longue histoire...
FIN DU SIXIEME EPISODE
CHRONIQUES VULVEUSES
SEPTIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
26
« D'abord, Agent 009891, ne me prenez pas pour un charlot. Pour mettre les choses à leur véritable niveau, Aristarque de Samos n'a pas vécu au cinquième siècle, mais au troisième, vous lui attribuez de plus une théorie qui n'est pas la sienne, mais ne perdons pas de temps à discuter sur l'avancée de la science mathématique grecque post-aristotélicienne, tenez Vous connaissez ceci ? »
Et il tira du tiroir central de son bureau un objet métallique qu'il me lança avec une habileté diabolique dans les mains. Si je connaissais ! Jusqu'alors je n'en avais vu de ce rang-là qu'en photo, mais je reconnus l'objet au toucher. J'avais, caché sous le tapis de la teuf-teuf mobile, exactement le même ( en simple fer-blanc non-chromé alors que le sien était en platine )... la plaque d'identification des agents secrets français en action ! Lorsque je la retournai je restai confondu. Numéro : 008 ! Le Proc était un gros calibre ! Jamais dans mes rêves les plus fous d'espion breveté je n'aurais espéré frayé avec un gibier d'une telle envergure. Le haut du panier, à qui l'on réservait les affaires d'Etat les plus redoutables.
Je suis un peu mauvais joueur et décidai de contre-attaquer sur le champ. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de river son clou à une huile essentielle du renseignement :
« Cher agent 008, ne confondriez-vous pas Aristarque de Samos avec Aristarque de Samothrace...
-
Minuscule agent 009891, vous ne posez pas la bonne question, vous feriez mieux de vous demander comment je peux connaître point par point vos consternantes divagations sur Aristarque devant Marie, alors qu'à cet instant j'étais à plusieurs kilomètres de là, dans mon bureau.
-
Elémentaire cher Watson, un de vos agents aura subrepticement placé un micro dans mon perfecto et...
-
Cher Con Andouille ( j'appréciai modérément le jeu de mots ) vous ne vous êtes même pas aperçu que depuis que vous êtes sorti le bureau du Chef du SSRR, nous ne vous avons pas lâché d'une semelle. Vous ne vous servez jamais de vos rétros, quand vous conduisez ? Alors maintenant un conseil, prenez votre pisseuse sous le bras, et filez à l'anglaise, votre teuf-teuf est garée dans la cour de derrière, essayez de sortir du patelin sans que la populace vous aperçoive, sinon je ne donne pas cher de votre peau. Allez, rompez ! Ah j'oubliai, Hawkwind n'utilise pas un tromboscope, mais un troboscope. »
Je descendais, la rage au ventre, les escaliers que j'entendais encore le rire chevalin de l'agent 008. Devait encore être allongé sur le tapis la tête enfouie dans la flaque de pipi de Molossa.
27
L'en avait trop dit. L'illumination ! J'ai roulé toute la nuit à tombeau ouvert, l'oeil fixé sur les rétros. Me fallait du renfort. A huit heures tapantes j'arrêtais la teuf-teuf devant 48 rue Mallarmé, ( Paris 17° )siège du SSRR. Je sursautai, l'on avait refait la façade. A la place de l'entrée discrète s'étalait la devanture d'un magasin de fringues. Sur les vitrines s'étalaient en lettres géantes le mot SOLDES. Deux employées à la cinquantaine bien tassée étaient en train d'ouvrir les portes.
« Pardon mesdames, c'est un nouveau commerce ?
-
Vous plaisantez ! L'on voit bien que vous n'êtes pas du quartier, regardez sur la vitre, Since 1927, il y a presque un siècle que la boutique est ouverte. Ma grand-mère y travaillait déjà toute jeunette.
-
Et les bureaux au deuxième étage ?
-
C'est le service comptabilité, il est fermé pour huit jours, l'on repeint, c'était un peu vieillot, tenez voici les ouvriers qui arrivent avec leurs camionnettes. »
J'arrivai trop tard. Les Services Secrets du Rock and Roll avaient été liquidés. Je frissonnai en imaginant le chef dans son cercueil, dans une tombe anonyme d'un cimetière de province. J'étais le dernier des survivants et sans doute en haut-lieu n'escomptait-on pas trop me voir vieillir paisiblement. D'ailleurs deux voitures noires aux vitres opaques manoeuvraient pour se garer derrière le camion de l'entreprise de peinture.
J'allais me défiler, mais Molossa me sauva encore une fois la vie.
« Ne partez pas Monsieur, entrez, votre adorable petit chien vous a précédé. C'est fou comme il es chou. L'a déjà dévoré le sandwich de ma collègue, et j'ai une tranche de pâté dans mon sac qu'il adorera, j'en suis sûre ! »
Au même instant une trentaine de clientes excitées s'engouffrèrent dans le local et prirent d'assaut les portemanteaux et les gondoles – j'avais oublié c'étaient les Soldes - tandis que je me réfugiai, dans une cabine d'essayage.
28
Bonnes affaires en perspectives. Une masse informe de deux cents nénettes surexcitées bataillaient sur le trottoir, agglutinées devant l'entrée. Z'avaient garé leurs voitures n'importe où, empêchant tout démarrage les limousines noires. De toutes les façons dans la cohue personne ne remarqua la jeune fille en robe tailleur pseudo-Chanel, affublé d'une réplique chinoise d'un vaste sac Vuitton maladroitement juchée sur des escarpins à talons rouges de vingt cinq centimètres. Pour se donner du courage elle fredonnait High Heel Sneakers de Jerry Lee Lewis. Les dieux du rock étaient avec moi. Ils suscitèrent une éclaircie devant la teuf-teuf lorsque je démarrai en trombe. Mes poursuivants n'eurent pas cette chance, un malheureux bouchon dont ils ne purent s'extirper leur enleva tout espoir d'accomplir leur mission létale.
29
Je pris un itinéraire bis. En route je m'arrêtai dans un garage pour faire repeindre en orange fluo-flash la teuf-teuf. Méconnaissable. A minuit j'entrai dans le Mas d'Azil. Je garai la teuf-teuf dans un endroit paumé – exactement sous le dolmen du patelin, une curiosité touristique à laquelle vu le roncier qui l'entourait aucun autochtone ne rendait jamais visite. Je me saisis de mon Uzi et de mon Glock, Molossa aiguisa ses crocs sur un silex, et nous partîmes dans la nuit aussi sombres que les ombres de la mort. L'heure du grand nettoyage et des révélations finales avait sonné.
FIN DU SEPTIEME EPISODE
23:50 | Lien permanent | Commentaires (0)
17/10/2013
KR'TNT ! ¤ 158. BARRENCE WITHFIELD / JACKIE LOMAX / PETE TOWNSHEND / ROD STEWART
KR'TNT ! ¤ 159
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
17 / 10 / 2013
|
BARRENCE WHITFIELD & THE SAVAGES JACKIE LOMAX ( + UNDERTAKERS ) PETE TOwNSHEND ( + WHO ) ROD STEWART ( + JEFF BECK'S GROUP ) |
La romance de Barrence
Que peut-on raconter sur Barrence Whitfield ? Il ne se roule pas par terre, il ne met pas le feu à sa guitare. D'ailleurs il n'a pas de guitare. Et il chante des classiques obscurs qu'on ne reconnaît pas forcément du premier coup. On pourrait croire qu'il n'y a rien à dire. Et pourtant, sur scène, le set de Barrence Whitfield & the Savages est devenu l'un des plus excitants du moment.

Figurez-vous qu'ils trônaient en tête d'affiche du festival Béthune Rétro, en août 2012. Ils jouaient donc le samedi soir, sur la grande scène. Manque de chance, il pleuvait par intermittence. On ouvrait des parapluies. On fermait des parapluies. On rouvrait des parapluies. Sur scène, Barrence mettait le paquet, un peu à la manière d'un boxeur. Comme s'il devait arracher la victoire à la force de ses poings. Il se démenait avec un courage remarquable. Pas facile de convaincre un public du samedi soir à Béthune. Surtout quand on propose ce que personne d'autre n'ose (ou ne sait) proposer : un mélange de rockabilly, de r'n'b et de jump blues.

Le guitariste des Savages n'est autre que Peter Greenberg, l'ancien guitariste de Lyres et de DMZ, figure légendaire du garage bostonique. Greenberg est un petit bonhomme qui ne la ramène pas. Sur scène, il semblait même en baver, non seulement à cause du rythme insensé de certains morceaux, de leur complexité, mais aussi parce qu'il était seul sur scène à jouer de la guitare, alors que pour ce genre de répertoire, il vaut mieux prévoir large avec deux ou trois guitares. Le travail en rythmique est déjà énorme, il faut en plus placer des gimmicks et quelques solos, et ça devient vite de la haute voltige. Peter Greenberg tirait la langue. Il montrait tous les signes d'une intense concentration. Mais un ancien DMZ, ça assure bien. Il était à bonne école, derrière Mono Man. Greenberg n'était pas le seul à en baver des ronds de chapeau. De l'autre côté de la scène, le bassiste Phil Lenker n'avait pas non plus le temps de souffler. Il jouait des lignes de basse ahurissantes de vélocité, et on se demandait comment il parvenait à tenir une cadence aussi infernale. Essayez de patater une corde de basse en allers et retours à toute vitesse pendant trois minutes et en restant régulier. Vous verrez que c'est extrêmement pénible. Il faut réussir à maîtriser la tension nerveuse et espérer ne pas être surpris par une crampe. On ne perd pas trop de vitesse quand on se cale bien sur la batterie. La seule difficulté, c'est d'arriver à tenir la distance. À la fin de certains morceaux, Phil Lenker secouait la main pour rétablir la circulation du sang. Le seul bassiste que j'ai vu jouer en allers et retours à une vitesse insensée sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse et ce, pendant tout un set, c'est Bob Venum, à l'époque où il jouait encore de la basse dans les BellRays (Tony Fate était alors le guitariste du groupe). Non seulement Bob Venum patatait comme une machine automatique devenue folle, mais en plus il sautait en l'air et plaçait des chœurs dans un micro. Chaque fois que je suis allé voir jouer les BellRays, je me suis mis du côté de Bob Venum, pour l'observer. Car il faisait tout le spectacle à lui seul. Comme certains joueurs de tennis, il avait l'avant-bras droit beaucoup plus développé que l'autre. Maintenant, c'est fini, puisque Tony Fate a quitté le groupe. Bob Venum joue de la guitare et il a recruté un bassiste beaucoup moins spectaculaire.

Alors que Barrence Whitfield sortait le grand jeu, qu'il sautait dans tous les coins, qu'il hurlait comme un démon et qu'il irradiait autant d'énergie qu'une bombe atomique, les deux malheureux sidemen installés de chaque côté de la scène se cramponnaient à leurs manches. On peut dire qu'ils furent héroïques.
Le set de composait de morceaux tirés de plusieurs albums. Barrence attaquait avec une invraisemblable reprise de «Rambling Rose», qui fut jadis le hors-d'œuvre favori du MC5. Rob Tyner le prenait ultra-perché, mais à côté de Barrence, il n'est plus qu'un enfant de cœur anorexique. Invraisemblable reprise, oui, car hurlée de bout en bout, de la première à la dernière seconde. S'il est bien une chose que sait faire Barrence Whitfield, c'est hurler. Il bat tous les records, y compris ceux de Little Richard, de Wilson Pickett et d'Antonin Artaud.
Et là, on touche au cœur du problème. Barrence Whitfield n'est rien d'autre qu'une sorte de fabuleux caméléon. Il dispose de la glotte la plus musclée du monde. Il peut grimper plus haut que Little Richard ou Wilson Pickett. Parmi les victimes de son écrasante supériorité, on trouve aussi des bêtes comme Don Convay, Esquerita, Otis Redding, Screamin' Jay Hawkins, Solomon Burke, et la liste ne s'arrête pas là. Car, il préfère s'attaquer aux plus obscurs, et ceux-là, on peut dire qu'ils pullulent dans l'histoire du rock et du r'n'b américain qui va des années 40 à la fin des années 60. Il suffit simplement de jeter un coup d'œil dans le catalogue Excello.

Dans son avant-dernier album, «Savage Kings», il aligne une collection de reprises triées sur le volet. Par exemple «Just Moved In», d'un obscur rockab nommé Orangie Ray Hubbard, originaire de Cincinnati (où se trouvait aussi le fameux label King Records, que Barrence salue au dos de la pochette). Il fait aussi une somptueuse reprise du «It's Mighty Crazy» de Lightnin' Slim, l'un des artistes les plus féroces du label Excello, véritable figure légendaire du blues électrique de la fin des années cinquante, qui influença notamment Buddy Guy. Comme le swing ne lui fait pas peur, Barrence tape dans «Barefoot Susie» de Waymon Brown, classique du jump blues datant d'une époque où les grands artistes noirs étaient coiffés comme des blancs et accompagnés par des big-bands survoltés. La reprise swingue comme le «Baby Face» de Little Richard. Sans Barrence, personne n'aurait entendu parler de ce morceau. Waymon Brown lui doit donc une fière chandelle (du même type de celles que Jessie Mae Hemphill et RL Burnside doivent à Tav Falco - et du même type que celles qu'Hasil Adkins et The Phantom doivent à Lux Interior). Il reprend aussi le fabuleux «Black Girl» de Lee Moses, jadis paru sur King Records. Barrence le fait sonner garage, comme un morceau des Seeds. Pour «You Told A Lie», il sort sa panoplie Screamin' Jay Hawkins, et il s'en sort avec les honneurs, car Screamin' Jay avait du génie.
«Willie Meehan» est une solide pièce garage racontant l'histoire du boxeur américain des années 20. Sur scène, il tape dans la plupart de ces morceaux, autant dire que le set est sacrément consistant. On ne s'ennuie pas une seconde. La variété des genres donne un peu de relief à l'ensemble. Rien n'est plus ennuyeux qu'un set homogène.

Sur le premier album de Barrence Whitfield and the Savages, celui qu'on appelle la marmite, datant de 1984, on trouve des choses intéressantes, comme par exemple «Walking With Barrence», une pièce de boogie torride. On sent que Barrence a du chien et qu'il finit toujours par l'emporter. Sa principale qualité, hormis le punch, doit être la ténacité. Son boogie finit par coller à la peau, comme celui de John Lee Hooker. D'autres morceaux moins bons suivent, mais qu'attendions-nous ? Du cannibalisme, à cause de la pochette ? On a tendance à toujours attendre l'impossible de ces artistes noirs hors normes, comme Screamin' Jay Hawkins, Jimmy Reed, Slim Harpo ou Howlin' Wolf. À tel point qu'on ne supporte pas de tomber sur des morceaux plus faibles, quand on écoute leurs albums. Pour avoir quasiment grandi avec les disques de Little Richard (entre autres), je peux m'aventurer à dire qu'il faut savoir prendre le temps d'explorer méthodiquement l'œuvre d'un artiste, surtout lorsqu'elle s'étale sur plusieurs décennies, et là, non seulement une sorte de cohérence apparaît, mais des morceaux qu'on croyait ordinaires retrouvent leur éclat et se révèlent sous leur vrai jour. Un exemple avec Sly Stone, dont certains morceaux semblaient anodins à une époque (oh la petite pop, berk) et qui, à l'occasion d'une vraie réécoute, nous sautent à la gueule («Family Affair», par exemple, qui est un véritable coup de génie).
Des choses qui semblent ordinaires (pour ne pas dire ennuyeuses) au premier abord - comme «Mama Get The Hammer» - peuvent aussi prendre une toute autre résonance sur scène. Avec «Fat Mama», Barrence fait son Esquerita. L'une des reprises les plus fabuleuses de Barrence Whitfield est celle du «Go Ahead And Burn» de Bobby Moore & the Rhythm Aces, une excitante petite pièce d'exotica swinguée jusqu'à la racine des notes, juteuse et frite dans le swing le plus gras. Barrence y flirte avec le génie vaudou.
Pour un premier album, ce fut une réussite spectaculaire. Peter Greenberg jouait déjà dans le groupe. «Georgia Slop» est un sacré clin d'œil à Bo Diddley, farci de clap-hands. Les Savages s'énervent, ils vrillent leur fantastique exubérance à grands coups de sax. On tient là une fournaise intense, furieuse et sincère. On sent que Barrence ne vit que pour le jive le plus radical. Quand on entend «Miss Shake It», on croit que c'est du Little Richard. Il va lui aussi to the East et to the West, alors amen, la messe est dite. Barrence commet parfois l'erreur de piétiner des plate-bandes ultra piétinées, le même genre d'erreur commise cent et mille fois en leur temps par des groupes comme Crazy Cavan. On reprend la même structure et on colle des nouveaux textes dessus, les autres ils n'y verront que du feu. Tu parles si on n'y voit que du feu. Barrence s'enfonce dans l'erreur avec un «King Kong» monté sur la carcasse de «Tutti Frutti». Du coup, il perd des suffrages. Heureusement que l'album s'achève sur un bon morceau, «Ship Sailed At Six», dans lequel Peter Greenberg fait un magistral numéro de strumming. Voilà ce qu'on appelle un morceau sacrément vendeur, mais ces fous accélèrent et ça se finit en eau de boudin, dans les pleurs et les cris. Décidément, ces gens ne font preuve d'aucune tenue. De vrais sauvages.
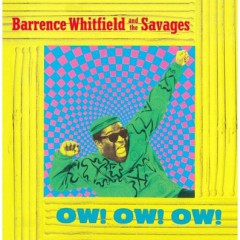
«Ow Ow Ow» est un album qui date aussi des débuts (1987). Barrence y fait son Little Richard avec «Rockin' The Mule». Il y fait son Mick Collins avec «Runnin' And Hidin'». L'une des pièces de résistance de cet album s'appelle «Madhouse», un heavy blues composé par Milton Reder, le guitariste du groupe, à l'époque. L'autre s'intitule «Girl From Outer Space». Barrence y fait son échappé de l'asile. Il chante tout le morceau en hurlant, comme dans sa version de «Rambling Rose». Très peu de gens savent hurler de bout en bout. Belle pièce de boogaloo spatial.

Et puis on trouve des albums parus sur New Rose, le label français qui à la fin des années quatre-vingt récupérait les artistes légendaires recrachés par le système. Là, on peut citer des noms : Bruce Joyner, Chris Bailey, Jeffrey Lee Pierce, Tav Falco, Sky Saxon, Chris Spedding, Brian James, Alex Chilton, Roky Erickson, Robert Gordon, Arthur Lee et des tas d'autres moins connus. Par la force des choses, le label finit par acquérir une réputation légendaire. Un album live - «Live/Emulsed» - n'apportera rien de neuf dans l'approche de Barrence, mais il donnera une idée de la cohésion du groupe sur scène. Comme dans la version studio, il hurle son histoire de Girl from Outer Space de bout en bout, et avec «Big Mamou», Barrence rappelle son attachement à la culture jump blues, ce qui nous renvoie directement aux cartes postales de la Nouvelle Orléans et à Congo Square. Un autre album paru sur New Rose s'appelle «Let's Lose It». Il a pour particularité d'être produit par Jim Dickinson, et là, on tend l'oreille. Hélas, la plupart des morceaux sont cousus de fil blanc. Sur «Under My Nose», Barrence finit par got-got-got-gotter comme Otis Redding. Le morceau qui donne tout son sel à cette aventure est «Let's Lose It». Barrence y fait le méchant, il frôle la délinquance, il fait dérailler son morceau à coups de cris lubriques. Recommandé le matin au petit déjeuner. C'est un coup à mordre son chien. Ou à arracher la queue du chat. Barrence fait aussi son Wilson Pickett sur «For A Good Time», des borborygmes à la Screamin' Jay sur «My Mublin' Baby» et frise le Smokey Robinson sur «Signs Of A Struggle». Que demande le peuple ?
Il existe très peu de littérature sur Barrence Whitfield. Pas de livres, quasiment pas d'articles dans la presse rock (ce qui ne surprendra personne, d'ailleurs). L'homme semble préférer la discrétion au rond du projecteur, ce qui l'honore. Barrence Whitfield fait partie des artistes qui n'existent qu'à travers leur musique. Le samedi après-midi, nous l'avions aperçu assis au stand de Lenox, lors du festival Béthune Rétro, l'été dernier. Il écoutait des 45 t sur un petit électrophone à piles et il n'avait absolument aucune envie d'engager la conversation.

On ne devient pas forcément inconditionnel en écoutant ses disques. Par contre, on risque fort de le devenir après l'avoir vu sur scène. Mais il faut le voir jouer dans une petite salle. La grande scène de Béthune dispersait le souffle des Savages. Par contre, l'autre soir, dans la petite salle de la Flèche d'Or, ils retrouvaient tout leur punch. Peter Greenberg claquait ses accords comme une brute, toujours aussi concentré et extrêmement tendu. Phil Lenker patatait sur sa basse et fournissait les feelings r'n'b ou rockab à la demande. Derrière, Andy Jody battait le beurre comme un dieu, il jetait tout son corps dans la bataille et frappait avec une insistance qui détournait parfois les regards de Barrence. Tom Quartulli cuivrait l'ensemble avec un tact de vieux crocodile et Barrence ruisselait de sueur et de feeling, il estomaquait et fascinait, il hurlait et boxait l'air brûlant, il screamait à s'en étourdir et endiablait l'ambiance, il électrisait les cervelles et pulsait son r'n'b avec une autorité qu'on ne voit pour ainsi dire jamais. Barrence Whitfield redevenait le showman légendaire qu'on connaissait, il mixait la soul et le garage, le rockab et le voodoo avec une énergie hallucinante et encore une fois, s'il vous plaît, allez le voir dans une petite salle. Il va vous dynamiter les cinq sens et vous réconcilier avec les concerts de rock. Ils ont battu avec «The Corner Man» les records de férocité garage jusque-là détenus par les Dirtbombs. Avec «Blackjack», ils nous ont redonné une idée de ce que peut apporter - en termes de régal - un jump-blues bien intentionné. Ils ont joué pratiquement tous les morceaux du nouvel album - «Dig Thy Savage Soul» - et ont littéralement blowé le roof, comme aiment à dire les Anglais - on assiste rarement à des shows d'une telle intensité, aucun déchet, des morceaux inspirés et enchaînés les uns après les autres, une section rythmique effarante de punch et de présence, un guitariste garage qui joue des thèmes de r'n'b avec une gourmandise non feinte et un chanteur dont le talent crée la légende dans l'instant même - à part Mick Collins, je ne vois pas un seul blackos capable d'aligner avec autant de classe une telle ribambelle de hits et de hurler «Rambling Rose» en fin de set. Barrence Whitfield donne tout simplement le concert de rock idéal. Que peut-on attendre d'autre d'un concert ? On ne voit pas. Sacré Barrence, puissant, fin et carnassier, le voilà qui court après les gens qui se dirigent vers la sortie pour leur dire qu'il va faire un second rappel. Come back ! Baby come back !
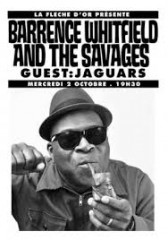
Son nouvel album sort sur Bloodshot Records. Comme ceux d'Andre Williams. Curieuse coïncidence, mon cher Watson. Autant le dire tout de suite : cet album est énorme. Bien sûr, il résonne différemment lorsqu'on a encore la tête remplie des clameurs du concert, mais on peut affirmer sans trop craindre les ravages de la subjectivité purulente que c'est son meilleur album. Il présente toutes les qualités requises : la densité du son et la qualité des morceaux. Pas un seul déchet, peut-être ici et là une petite concession aux vieux standards du rock'n'roll, mais rien de bien méchant. Peter Greenberg a produit ce disque et ça se sent. «The Corner Man» ouvre le bal. Cette pièce de garage furieuse et brutale ravira tous les fans des Dirtbombs. Un solo de sax suivi d'un solo de Peter Greenberg vrillent le morceau en plein cœur. Barrence et ses Savages tapent aussi dans le heavy blues avec des choses comme «My Baby Didn't Come Home» et «Show Me Baby». Barrence rend hommage au pianiste et comédien américain Oscar Levant dans «Oscar Levant». Sur scène, il expliquait que cet illustre inconnu jouait dans «Un Américain A Paris» de Vincente Minnelli. Il revient aussi à Bobby Hebb (connu pour avoir composé «Sunny» et pour avoir tourné aux USA avec les Beatles) en reprenant «Bread», un r'n'b d'un classicisme irréprochable, digne de ce qu'on entend dans «The Commitments». Barrence nous sert là l'une de ses spécialités, une reprise de r'n'b pur jus, très haut de gamme et fabuleusement bien interprétée. «Hangman's Token» est une compo de Peter Greenberg et c'est non seulement riffé rockab mais aussi stupéfiant de vélocité. Andy Jody fournit le pounding derrière. Cette fois, les Savages sonnent comme des Gories dépenaillés. Bel exploit, quand même. La chose va même plus loin : on sent le morceau taillé sur mesure et je peux bien avouer que j'ai encore rarement vu un tel coup de maître. Ça va en effarer plus d'un. Évidemment, Peter Greenberg profite du trouble levé dans les esprits pour placer un killer solo qui ajoutera encore un peu de zizanie. Morceau alarmant, banzaï, tora tora, beat ribouldingue, voix à la rhubarbe, Barrence barrit, il embarque sa falaise de marbre au sommet de l'Everest. Franchement, c'est à se damner pour l'éternité. Ils s'amusent à balancer un pur rockab avec «Daddy's Gone To Bed», histoire de rigoler. Un vrai racket, comme dirait un journaliste anglais. La face B ne vous lâchera pas. Inutile de vouloir vous sauver. Ce disque fait partie de ceux qu'on ne peut pas interrompre. Impossible. Après la petite rasade de jump blues («Blackjack»), ils s'amusent à sonner comme Chuck Berry («Hey Little Girl») puis Barrence tape à nouveau dans les trésors de Lee Moses avec une reprise de «I'm Sad About It», du deep soul screamé à la folie et qui donne des frissons. Il ferme la marche de cet album avec une reprise de Jerry McCain, vieux punkster du blues des fifties qui fut l'une des cerises posées au sommet du mythique gâteau Excello. On ne peut pas imaginer meilleur vivier qu'Excello. Barrence poivre et sale sa reprise de «Turn Your Damper Down» à outrance.

Avec cet album, Barrence Whitfield & the Savages entrent dans la cour des très grands. Ils ont eu le culot de mélanger les genres et le bon dieu les récompense en faisant d'eux les rois du rocky garage-soul et de la pétarade. Et comme la justice divine est bien faite, la concurrence n'existe même pas. Si vous souhaitez goûter au vrai truc, c'est là.
Signé : Cazengler, l'em-barrencé
Barrence Whitfield & the Savages. La Flèche d'Or. Paris XXe. 2 octobre 2013.
Barrence Whitfield & the Savages. ST. Fan Club 1984 et 1989
Barrence Whitfield & the Savages. Ow ! Ow ! Ow ! Rounder Records 1987
Barrence Whitfield & the Savages. Live. Emulsified. New Rose 1988
Barrence Whitfield & the Savages. Let's Lose It. New Rose 1990
Barrence Whitfield & the Savages. Savage Kings. Munster 2011
Barrence Whitfield & the Savages. Dig Thy Savage Soul. Bloodshot Records 2013
OLD ENGLAND
Un Lomax de classe
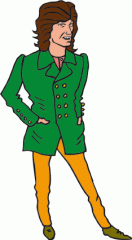
Sans George Harrison, on aurait sans doute jamais entendu parler de Jackie Lomax, un petit gars originaire de Liverpool. George le fit signer sur Apple en 1969 et produisit son premier album solo, «Is This What You Want». Le fait qu'ils fussent tous les deux originaires du même patelin a sans doute facilité les choses. Mais George Harrison avait surtout flairé le talent fou de Jackie Lomax et sans doute compris qu'ils naviguaient tous les deux au même niveau. Jackie Lomax savait en effet composer des chansons extrêmement consistantes (il composait déjà pour Apple - Gallagher & Lyle et Pete Ham & Tom Evans de Badfinger faisaient aussi partie du staff des compositeurs payés par Apple pour écrire des chansons) et comme il disposait d'une vraie voix, il pouvait aussi les interpréter. Et donc devenir une usine à tubes solides, comme l'étaient déjà ses amis les Beatles.

Les amateurs de rock anglais savent que la scène de Liverpool se distingue du reste de la scène anglaise par une sorte de particularisme. Disons un sens mélodique particulier couplé à une énergie et à une certaine fraîcheur de ton. Dans les livres d'histoire, on appelle ça le Merseybeat. Gerry & The Pacemakers, Cilla Black et les Beatles ont initié ce particularisme. D'autres groupes comme les Boo Radleys, Lee Mavers & The La's, les Zutons, Clinic et Edgar Jones & The Joneses ont repris le flambeau au cours des décennies suivantes, chacun à sa manière.
L'album «Is This What You Want» sorti en 1969 sur Apple est probablement l'un des meilleurs albums de rock anglais des sixties. Douze titres dont six pures merveilles. Pal mal pour un début. Le morceau qui donne son titre à l'album sonne comme l'immense «I'm The Walrus» des Beatles, mais Jackie Lomax explore déjà d'autres possibilités et développe la toxicité d'un brouet pourtant épais. Là-dedans germe le mélange de soul, d'harmonies vocales et de psyché liverpuldienne qui va caractériser son style flamboyant, au fil des albums suivants. Dire que Jackie était le chouchou des Beatles n'a rien d'exagéré. Trois d'entre eux l'accompagnent sur ce disque : Paul, George et Ringo. Ce n'est pas tout. George lui offre en prime une compo de premier choix, «Sour Milk Sea». On sent immédiatement la patte du maître. (N'oublions pas qu'à la même époque les Beatles enregistrent l'Album Blanc). C'est de la grande, très grande pop anglaise et Jackie pose sa voix sur un fourbi d'excellence sur-vitaminée. «Sunset» tient aussi l'auditeur en haleine. On voit un break pianoté jazz (Nicky Hopkins) briser les reins de cette jolie pièce violonnée. On peut déjà parler de Lomax sound. Sur la face B, l'ami Lomax nous sert avec «Little Yellow Pills» l'une de ses grandes spécialités : un r'n'b chauffé à blanc. On y découvre un vrai white nigger du calibre de Chris Farlowe ou de Mike Harrison. Jackie travaille son truc au corps, le besogne jusqu'à l'orgasme hermaphrodite. Voilà un archétype de soul à l'anglaise. Avec «Take My Word», il embarque l'auditeur imprudent encore plus loin, dans une sorte de slow-rock à méandres. C'est admirablement bien charpenté, bien chanté et finement teinté de soul. Joris-Karl Huysmans écrivit «A Rebours» à la fin du XIXe siècle, une époque où existaient encore les esthètes. Son héros des Esseintes, excentrique lymphatique et fortuné, passe ses jours et ses nuits à se gaver de livres rares et d'essences subtiles, de mets capiteux et d'eaux fortes d'Odilon Redon. Des Esseintes se serait sans nul doute enivré des effluves boisées de «Take My Word».
Jackie Lomax revient au r'n'b à la Spencer Davis Group avec «The Eagle Laughs At You», puissant tout autant que pulsé, emmené à la force du drive, quand soudain hey ! il tire l'over-drive et, en prime, c'est copieusement cuivré. Le festival se poursuit avec «You Got Me Thinking», un truc puissant bardé de guitares claires, de boisseaux de chœurs et de cuivres, avec, comme toujours, un Lomax de classe pour chapeauter l'ensemble. On sent qu'on atteint une sorte de limite de saturation. On est au maximum de ce qu'on peut attendre du rock anglais : densité suffocante des arrangements que viennent zébrer des éclairs de guitare, puissance du chant qui ne repose pas sur le hurlement, mais sur le posé de la voix, comme chez Jerry Lee. En effet, Jackie et Jerry Lee naviguent au même niveau. Même vision et même classe. Comme chez Jerry Lee, rien n'est laissé au hasard sur ce disque et c'est exactement ce qui soûle l'auditeur. Tant de qualité irrite la cervelle. La moindre chanson de Jackie Lomax pue l'inspiration à des kilomètres à la ronde. Il ne chante que des vraies chansons. Elles teintent à l'oreille et touchent l'intellect, comme un doigt humide et chaud. Avec ce premier album solo, Jackie Lomax se hisse directement au niveau des grands chanteurs (Jerry Lee Lewis) et des grands compositeurs (Burt Bacharach).
L'ami Lomax fait partie des artistes qu'on ne perd pas de vue. D'autant qu'il présente l'une de ces qualités qu'on apprécie tout particulièrement : la discrétion. Tout au long de sa «carrière», Jackie Lomax est resté d'une discrétion exemplaire. Aucune trace de m'as-tu-vu chez lui. Pourtant, le mec est beau. Il aurait pu ramener sa fraise comme tant d'autres. Pas question. Pour vivre, l'ami Lomax travaillait dans un restaurant.
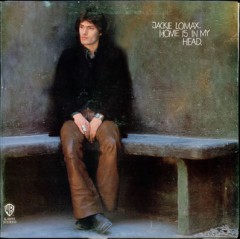
Il enregistre son second album solo aux États-Unis. «Home Is In My Head» est sans doute un album moins puissant que le précédent, mais il réserve son lot d'agréables surprises. Pochette à l'image de l'artiste, l'anti-rock star par excellence. À peine quelques bijoux et un pantalon de cuir brun. Côté son, on se retrouve dans le haut de gamme. Gros groove des enfers avec «Give All You've Got». Jackie a derrière lui une grosse équipe d'effarants groovers new-yorkais, et on se tape une belle dose de rock soul au bon tempo, un peu lourd et bien senti. Il tape ensuite dans le registre du folk-rock de la frontière, un peu dans l'esprit de l'impressionnant «I Hung My Head» de Johnny Cash. Même force narrative - «Une douzaine de types de l'Arkansas/ Ont juré de me ramener/ Dans le bureau du juge de paix/ Ils suivent ma trace». Évidemment, l'histoire finit mal. Avec ce genre de folk-rock, on s'éloigne de Liverpool, mais justement, la grande force de Jackie Lomax est de pouvoir chevaucher à son aise dans ce genre d'histoire violente avec la crédibilité qu'on accorde à Johnny Cash ou au David Crosby de «Cowboy Movie». Il persévère dans la veine folk-rock groovy avec des morceaux fabuleux comme «Or So It Seems» ou «Home Is In My Head». Chez lui, tout est pourri de feeling jusqu'à la racine du son. Il revient au r'n'b sur «She Took Me Higher», avec sa voix savamment posée et son goût prononcé pour la chaleur blanche. Il connaît toutes les arcanes du feeling et en cultive les affres. Il reste attaché à son indéfectible idée de l'excellence. Chacune de ses chansons flatte l'intellect de l'auditeur, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. On revient une fois de plus au Lomax de classe avec «Higher Ground», brillante pièce de r'n'b serrée et desserrée à la fois, bien rebondie et lancée vers l'avant, reposant sur une ligne de basse élégante et droite, à l'image du géant de Liverpool. Impressionnant. «Helluva Woman» bascule dans la good time music haut de gamme, salement décontractée et orchestrée de main de maître. Le morceau est tellement bon qu'on y sent un Jackie Lomax profondément heureux.
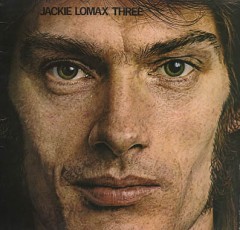
Ces deux albums constituent le sommet de la «carrière» de l'ami Lomax. Avec «Three», enregistré en 1971 aux États-Unis, il va légèrement s'étioler. «No Reason» reste une sorte de classique r'n'b, bien cuivré et bien sonné. Puis on va le voir prendre petit à petit la direction du groove pur. «Time Will Tell You» est une chanson agréable et bien balancée, chantée d'une voix colorée, mais que dire d'autre ? Il subit aussi l'influence du funk, avec un morceau comme «Hellfire Night-Crier». Un Lomax de classe qui n'intéressera que les amateurs de white niggers américanisés, comme Van Morrison. On reste dans le spectre poli et bien monté qui flirte en permanence avec le classicisme. On s'éloigne toujours plus du Apple sound qu'on adorait. Dans «Lost», il fait appel à l'esprit du gospel et aux trompettes de jazz. Effarant. Son «Roll On» sonne comme une perle de juke plein de jus de jute, monté sur des débris de carcasse rock, mais traité avec une exquise suavité et soudainement endiablé dans le cortex du cartel. Ce Jackie-là n'en finit plus de déboîter sans mettre son clignotant et de dévoiler ses charmes. L'épice Lomax entête. «Let The Play Begin» s'impose comme un nouveau brouet incestueux de beauté pop et d'inventivité structurelle, ce qu'on appellerait en d'autres termes la pop des jours heureux, un peu dans le style de ce que faisait Todd Rundgren sur «Something Anything». Raffinement et haut de gamme sont toujours les deux mamelles du Lomax de classe. Solidement ancré dans l'excellence, le fouillé des compos étonne encore. Retour au r'n'b brûlant et bien drivé avec «Fever's Got Me Burnin'». Voilà un groove majestueux vraiment digne des Temptations et qui entre dans les ouvertures humides comme un pieu vibrant de désir. L'ami Lomax surpasse toute conjecture. Il place son art très haut dans les niveaux d'expectative et maintient l'intérêt tout au long du processus. Allez donc trouver ça ailleurs. Avec «Last Time Home», il se lance dans la chanson océanique et se perd dans le poudroiement de l'horizon, comme le fait Dennis Wilson dans «Ocean».

Il va encore enregistrer deux albums dans les années soixante-dix, «Livin' For Lovin'» et «Did You Ever Have That Feeling» et s'enfoncer toujours plus loin dans le groove ouaté, dans une sorte de philly soul qui le coupera un temps de ses vieux fans. En écoutant ces grooves ensoleillés dignes de Stevie Wonder, on comprend que ces deux albums se soient vite retrouvés dans les bacs à soldes.

On cherche désespérément l'Anglais de Liverpool dans le groove funky de «Put Some Rhythm In Your Blues». L'ami Lomax noircit sa voix à outrance et rivalise de charme avec Smokey Robinson. Il prend «On The Road To Be Free» dans le gras de la glotte et donne une interprétation très sensible de la chose, mais on bâille aux corneilles. Comme si l'immensité avait disparu, remplacée par des draps de satin. On craint pour l'ami Lomax, car sa musique ne peut plus plaire à tout le monde. Il s'enfonce toujours plus loin dans la soul chic avec l'album «Did You Ever Have That Feeling» qu'on attendait comme un messie, avec une pochette dessinée par Klaus Voorman, et on nourrissait l'espoir de le voir revenir aux choses sérieuses. Mais l'ami Lomax se fout des choses sérieuses et plus encore des expectatives. Il va là où le mène son feeling. Libre à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. Il est impressionnant de nonchalance sur des morceaux comme «Part Of My Life», fantastique déclaration d'amour à sa compagne, et revient l'espace d'un morceau au r'n'b de sa jeunesse avec une énormité digne de James Brown, ««I Don't Wanna Live With You», l'un de ces r'n'b salés et tenaces qui ne lâchent plus leur victime.
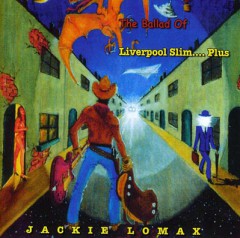
Il faudra attendre trente ans pour voir ressurgir l'ami Lomax dans les bacs des disquaires. «The Ballad Of Liverpool Slim» date en effet de 2001. Pourquoi Livepool Slim ? Il se fait appeler ainsi lorsqu'il participe aux championnats de billard. On retrouve Mark Andes sur cet album, l'ancien bassman de Spirit et de Jo Jo Gunne, qu'on voit traîner aujourd'hui dans les parages d'Alejandro Escovedo et de Ian MacLagan qui est basé à Austin. «The Ballad Of Liverpool Slim» est un album plutôt miraculeux. On y retrouve le Lomax qui nous fascinait tant jadis et cette voix chaude vibrante de feeling. Les deux premiers morceaux sont comme on s'y attendait des grooves énormes. Ensorcellement garanti. On sent derrière l'ami Lomax la présence d'une grosse équipe. «There's A Woman In It Somewhere» atteint l'un de ces niveaux du groove que l'on peine à imaginer. L'ami Lomax chante d'une voix verte et presque voilée, en demi-teinte, avec ces finesses infinitésimales qu'on ne retrouve que chez de grands artistes comme Smokey Robinson. Retour au génie pur avec «Spark Yourself». Oh cette attaque au chant ! L'ami Lomax nous ressert son énorme boogie qui tient du prodige, tellement l'équilibre reste parfait entre le balancement des hanches et la volonté d'envolée omniprésente, et puis on retrouve ces changements de niveaux qui déroutent et émerveillent. L'ami Lomax reste dans le haut de gamme et même dans le hors compétition. David Bowie n'est jamais allé aussi loin dans l'excellence. Il y a dans la voix de l'ami Lomax cette affirmation qui le distancie de tous les autres. Il nous fait le coup du heavy blues avec «Baby Slow Down». Décidément, l'ami Lomax est trop fort, car voilà qu'il multiplie les violentes montées de taux de sucre. On aurait bien aimé entendre ça à Caen en 1966. Le heavy blues de l'ami Lomax fait rêver, on se régale du ballet de ses épiphénomènes d'un autre monde, subitement éclairants. Il traite son slow-blues avec une exigence qui laisse coi. Il nous emmène à la cave à la seule force de la voix. Fascinant. «Blues In The Blood» est aussi puissant. Esprit, ton, tout y est. Voilà bien l'artiste complet. Il sait tout faire, très bien et mieux que les autres. Comment décrire cette prodigieuse aisance ?
On croit bien connaître l'animal, en ayant écouté ses six albums. Grave erreur. On a vu réapparaître récemment des choses fabuleuses datant du début de sa «carrière».
En Grande-Bretagne, ce sont toujours les mêmes qui vont déterrer les trésors : RPM et Ace/Big Beat. Sur l'île du capitaine Flint, Big Beat a retrouvé un coffre qui contenait les enregistrements des Undertakers. Ça vaut tout l'or du monde.
Jackie Lomax commença à chanter et à jouer de la basse dans ce groupe de Liverpool qui s'appelait les Undertakers, c'est-à-dire les croque-morts. Big Beat proposait en 1996 une compile des 45 tours Pye enregistrés par le groupe et les sempiternelles démos inédites. La version démente de «(Do The) Mashed Potatoes» qui ouvre le bal date de 1963. Pure folie. Les Liverpuldiens tapent dans le dur et Jackie hurle comme un noir de l'Alabama poursuivi par un escadron de cavaliers du Klu Klux Klan brandissant des torches. Les Undertakers proposent aussi une version honorable de «Money» que le jeune Jackie interprète avec beaucoup de maturité. Ils font un carton avec leur reprise bien cuivrée de «Stupidity». Jackie la prend bien sous la jupe, avec des pointes de fièvre dans la voix. Puis on tombe sur une sacrée monstruosité : «If You Don't Come Back», bardée de chœurs dévastateurs. Jackie chante dans l'écho du temps et bon dieu, mais c'est bien sûr ! On réalise subitement qu'il fait partie des plus grands chanteurs d'Angleterre - if you don't come baa-a-a-ack - c'est bourré de soul au point que c'en devient indécent. Et ça file comme ça jusqu'au bout, avec des morceaux plombés, chargés de toute la puissance des ténèbres - «I Need Your Lovin'» - des trucs dévastateurs boumbidamdoomés dans la viande - «Tell Me What You're Gonna Do» - vrillés par des solos trash-punk prématurés - «Irresistible You» - ralentis à la puissance de la démence du sax aventureux et dévorant - sublime reprise du «Hey Hey Hey Hey» de Little Richard - vitriolés en plein visage par du killer-solo punk antédiluvien - «You're So Fine And Sweet» - emmenés en enfer - reprise du «Watch Your Step» de Robert Parker - et ils nous feront même le coup fumant du proto-punk d'airain avec «I Feel In Love (For The Very First Time In My Life)».
RPM remit le couvert en 2010 en proposant des trucs introuvables de Jackie Lomax. Ce disque névralgique (chez RPM, tout est quasiment névralgique, attention à votre porte-monnaie, madame la ménagère) permet de reconstituer le mystérieux itinéraire de Jackie Lomax - très mal documenté en France - après l'épisode Undertakers.
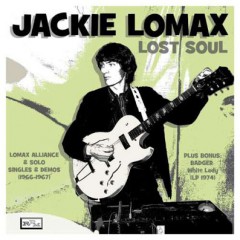
Quatre singles chez Pye, après quoi les Undertakers décidèrent d'aller tenter leur chance aux États-Unis. Ça tourna en eau de boudin, et Jackie se retrouva seul à New York avec le batteur Bugs Pemberton. Ils jouaient dans un cover-band des Beatles nommé Lost Souls qui passa petit à petit au r'n'b et qui devint Lomax Alliance. On trouvait dans ce groupe nos deux anglais de Liverpool et deux new-yorkais : le bassman Tom Caccetta et le guitariste John Cannon. Quand les Beatles débarquèrent à New York en 1966 pour donner leur légendaire concert au Shea Stadium, Jackie retrouva ses vieux copains et traîna avec eux à l'hôtel après le concert. Brian Epstein proposa à Jackie de devenir le manager de Lomax Alliance. Il voulait que le groupe rentre à Londres pour enregistrer un premier album. Epstein était sûr que le groupe allait casser la baraque. Les séances commencèrent comme prévu mais il y eut un petit problème : Brian Epstein cassa sa pipe, ce qui mit fin au projet. Ce sont les morceaux de cet album mort-né que les compères Phil King et Tony Barber ont réussi à dénicher pour les coller sur le disque 1 de leur compile RPM. L'épisode Lomax Alliance se déroulait en 1967, juste avant la création d'Apple Records.
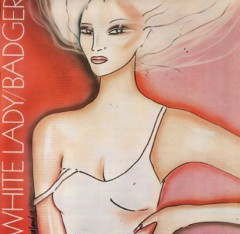
Et quand on écoute les démos de Lomax Alliance, on frémit. Elles frisent tout simplement la perfection. Nos quatre prétendants au trône sortent une version de «Who Do You Love» absolument démente, invraisemblable d'élasticité spongéiforme qui vient se couler sous la peau, montée sur un groove de basse puissant des reins, et éclatée au chant par l'ami Lomax. «Try As You May» qui suit est un morceau de pop bien brave, entraînante et fiable. On peut compter dessus. En Belgique, on appelle ça de la solide pop admirable. «The Golden Lion» sonne comme un hit dès l'intro et cette belle pièce d'ambiance entraîne le badaud dans la rue de Lappe - viens mon amour dit la belle dans l'ombre d'une voix de lionne traînante et sépulcrale. Dans «You Better Get Goin' Now», l'ami Lomax chante comme un dieu du r'n'b et avec «Hey Taxi», on retombe dans l'explosif frichti sixties californien foutraque et sans collier - hey taxi ! Violence et pur jus avec «Enter Into My World», du vrai garage qui rougit sous les claques. L'ami Lomax et ses collègues savent aussi sortir du chapeau une pop tirée à quatre épingles («Do You Think It's Time») et ces brutes reviennent au r'n'b dévastateur avec l'énorme «Sweeter Than Honey». Infernal et surprenant, l'ami Lomax possède tous les secrets du timbre. Il époustouffle. Ahan Ahan ! On grimpe encore dans les couches supérieures de l'overdose jouissive avec «Front Page Model», un vrai hit mortel claqué au détour de l'accord, digne de Sam The Sham, qui envoie de gros coups de basse dans le cul de la rombière - avance ma vache, je te tiens par la barbichette. Merveilleux hit sixties pointé à la rythmique, et rendu fou sur la fin par une descente de guitare. Il faut entendre Jackie l'anti-frimeur par excellence balancer son jerk sur fond de glimcka-glinckaglinck byrdsien. C'est du niveau de «So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star». Attention, ce morceau déteint. Des nappes d'orgue emportent la bouche de «Take Me Away». Beat des enfers comme seuls les Anglais peuvent en beater sur «Honey Machine». L'ami Lomax est un génie de pierre. Celui qui le renversera n'est pas encore né. Et ça continue avec deux autres hits tutélaires, «Guenine Imitation» - chanté très perché, à tomber du haut des falaises de marbre, monstrueux de prestance, comme un truc qui danserait sur un nuage avec des semelles de plomb - et «One Minute Woman» - puissant du collier et d'une beauté troublante. Avec un disque pareil, Jackie et sa Lomax Alliance allaient bouffer le monde et devenir des superstars. Mais le destin cruel au visage grimaçant en décida autrement. L'ami Lomax allait devoir continuer à errer le long des routes, un peu comme Colin Blunstone, et assumer son rôle d'oublié prestigieux. Il rentra donc à New York et en 1974, soit trois ans après avoir enregistré ses trois albums solo, on lui proposa un job dans Badger, un groupe monté par l'ex-clavier de Yes, Tony Kaye, et Kim Gardner (qui avait joué dans les Birds avec Ronnie Wood, puis dans Creation). Ils enregistrèrent un album sur Epic, «White Lady» et ce sont les morceaux de cet album qu'on retrouve sur le disk 2 de la compile RPM. L'ami Lomax accepta d'entrer dans le projet à condition que ce disque fût produit par Allen Toussaint. La seconde particularité de ce disque se trouve dans les crédits. Badger n'avait pas de chansons. L'ami Lomax dut fournir toutes les chansons de l'album.
Et quelles chansons ! Porté par les chœurs et les nappes d'orgue, «A Dream Of You» est un morceau qui rompt immédiatement avec le rock anglais traditionnel. L'ami Lomax nous propose tout bêtement un groove paradisiaque, infiniment supérieur à tout ce qu'on connaît du rock. Voix si belle et si radieuse... La beauté de son feeling nous pénètre l'esprit, ça vole très haut, le chant darde dans l'immaculée conception des chœurs. On sent une sorte d'universalité qu'on ne retrouve que dans certains morceaux du mythique «A Wizard A True Star» de Todd Rundgren : même façon d'ouvrir l'espace. Rappelons que Todd Rungren était lui aussi un amateur éclairé de soul-music. Avec «Everybody Nobody», on retrouve ce groove new orleans classique de classe infernale. Sur «Listen To Me», Allen Toussaint joue du piano et Bryn Haworth - l'imparable guitariste des Fleur de Lys - joue de la slide. On tombe un peu plus loin sur une sorte de miracle musical : «White Lady». On suivrait ce groove cabossé jusqu'en enfer - «It's so hard to say no to a white lady» - et Jeff Beck (invité par Kim Gardner qui avait fait partie d'un embryon de Jeff Beck Group) vient placer un solo d'antholo que relaie l'ami ludique jusqu'à la lie. Aw, Jackie Lomax... Il chante avec un détachement qui finirait par faire peur, tellement il est bon, et on sent bien qu'il reste derrière, discret comme une ombre, fondu dans l'écran noir de nos nuits blêmes. Jeff revient - démon Beck tout bec et ongles, sanglé de frais - puis l'ami Lomax déjà mort dans la mare, oui car comme George poignardé chez lui, il est déjà loin, il chante avec de l'avance, avec cette compréhension des choses qui fait qu'on n'attache plus la moindre importance à la vie sur terre, ce détachement qui permet de tendre vers l'universalisme - l'ami Lomax et George ont tout compris, l'intelligence, le lait - sour milk sea - pendant que Jeff triture ses cordes, ultime soldat du bataillon décimé par les mitrailleuses lourdes au chemin des dames blanches - entendez-vous ces rafales dans le silence assourdissant de l'indifférence spectrale ? Aw, Jackie Lomax...
Un morceau comme «Be With You» aurait très bien pu se retrouver sur l'Album Blanc. C'est le même esprit. C'est du niveau d'un truc comme «Happiness Is A Warm Gun». Énorme de désinvolture. Ça baigne dans un jus de soul bouillonnant, parfumé, trompetté, complètement sidérant. C'est une horreur de classe soudoyante, de résurgence des ténèbres, de puissance saumâtre. Ça pulse à un niveau rare. Allen Toussaint jette ses poudres. Le festival se poursuit avec «Lord Who Give Me Life», un monstrueux r'n'b balayé par des rafales de shuffle, beaucoup trop élaboré pour un public anglais, d'où le flop (et on ne parle même pas du public français, victime de son légendaire décalage à la fois temporel et culturel). Avec «One More Dream To Hold», l'ami Lomax nous embarque pour Cythère. On navigue à travers une monstrueuse mélasse symphonique teintée aux mariachis, dans la démence des méandres et des clapotis irisés. Et puis le courant finira bien par emporter les réfractaires.
L'album de Badger est donc passé à l'as, victime de sa qualité.
On papotait tranquillement, l'autre soir. À l'autre bout du fil, mon vieux complice Jean-Yves évoquait le second album de l'ami Lomax («Home Is In My Head») dont il gardait un souvenir très lumineux. Alors évidemment, nous avions vu tous les deux sur internet des photos récentes de l'ami Lomax prises aux États-Unis. Lui et Buffalo Bill se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, il portait un chapeau de feutre clair, des cheveux longs et gris passés derrières les oreilles, une moustache bien fournie et une barbichette. Ses sourcils eux aussi très fournis étaient ceux d'un diable. Et pour rigoler, Jean-Yves me rappelait que j'avais ramené de Londres dans les années soixante-dix une chemise comparable à celle que portait l'ami Lomax, une chemise de cow-boy d'opérette, ornée de ce grand plastron sur la poitrine qu'on fermait par des boutons de chaque côté. Comme je n'avais aucun souvenir de la chose, je fis une recherche le lendemain matin et tombai directement sur une page du Los Angeles Times : «Jackie Lomax dies at 69». Nous avions évoqué le souvenir de ce mec que nous admirions depuis quarante ans sans savoir qu'il s'était éclipsé.

D'après le Los Angeles Times, Jackie Lomax était revenu à Liverpool pour assister au mariage de l'une de ses trois filles. Il se serait éteint dans son sommeil. L'ami Lomax avait donc entrepris son voyage vers l'au-delà le 15 septembre 2013 dans la plus parfaite discrétion. Un modèle de cohérence.
Signé : Cazengler, qui préfère Lomax à l'omelette.
Jackie Lomax. Is This What You Want ? Apple 1969
Jackie Lomax. Home Is In My Head. Warner Brothers 1971
Jackie Lomax. Three. Warner Brothers 1971
Jackie Lomax. Livin' For Lovin'. Capitol Records 1976
Jackie Lomax. Did You Ever Have That Feeling ? Capitol Records1977
Jackie Lomax. Lost Soul (Lomax Alliance + Badger - White Lady). RPM Records 2010
The Undertakers Featuring Jackie Lomax. Unhearthed. Big Beat Records 1996
Jackie Lomax. The Ballad Of Liverpool Slim. 7th Street Songs 2004
WHO I AM
PETE TOWNSHEND
( Traduction : Laura Sanchon Seeger & Vincent Guilly )
( MICHEL JALON / Mars 2013 / 528 pp )
De tous les british rockers de la deuxième génération Pete Townshend s’est toujours trimballé une notoire réputation d’intellectuel. Sa parole a eu longtemps valeur d’évangile. L’était le plus à même de comprendre et d’analyser le phénomène pop, tout ça pour avoir déclaré dans une des ses plus célèbres compositions que les gens parlaient mal de sa génération. People talkin’ back about my ge-ge--genaration, tel l’expectorait Roger Daltrey dans son micro. L’on aurait pu refiler la couronne à Mick Jagger et son I can’t get no satisfaction qui philosophiquement puise dans le même tonneau des constatations amères des adolescents trop vite montés en graines, mais le jaguar était un peu trop cynique pour jouer le rôle du grand écrivain qui vous a compris. Ray Davis des Kinks aurait pu prétendre à une telle notoriété mais on lui avait déjà collé sur le dos le titre de poète ( presque maudit ) et cet excès d’honneur aurait paru superfétatoire.
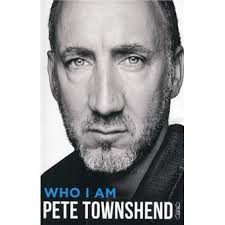
Tout cela pour dire que nous ne sommes pas surpris que la septantaine se profilant à l’horizon le leader des Who se soit laissé aller à se pencher sur son passé pour faire le point sur son existence. Certes nous ne sommes point dupes, à l’origine c’est un contrat avec quelques milliers de dollars à la clef, même que le livre s’est trouvé sur les gondoles des magasins à côté de ceux de Rod Stewart et de Ronnie Wood, l’on solde les souvenirs avant que les nombreuses cohortes des fans de la première heure ne partent à la retraite avec un pouvoir d’achat en chute libre. A tondre les moutons que ce soit au moins quand ils ont encore de la laine sur le dos. Quant au message ultime adressé aux jeunes générations qui s‘en foutent comme de l'an quarante, la bouteille à la mer chère à Alfred de Vigny, vous me permettrez d’y croire autant qu’au Père Noël.
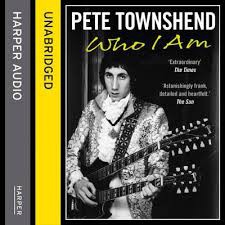
CONSIDERATIONS DIVERSES
Pour ceux qui n’aiment pas lire, une bonne nouvelle. Amateurs de rock and roll, rassurez-vous, il vous suffira d’abandonner le bouquin à la deux centième page. Ce n’est pas que les trois cents dernières soient inintéressantes, même que l’on sent que c’est l’écriture de celles-ci qui ont le plus importé à Pete Townshend et qu’il n’a rédigé la partie introductive que parce qu’elle était nécessaire à la compréhension de ce qui se joue dans les deux dernières parties de l'ouvrage.

Mais expliquons-nous. Il en est parfois des rockers comme des grands sportifs. Me citez pas B. B. King qui à plus de quatre-vingt berges court les concerts comme d’autres le marathon de New York. Passé trente-cinq ans, l’âge se fait sentir. Les Who n’iront pas plus loin. Pete Townshend ne fignole pas, classe même le Who’s Next sur la pente descendante du groupe. Pourtant z’en vendront des millions, à l’époque ce trente-trois les classe tout en haut du panthéon du rock. Peux témoigner que l’on ne pouvait rentrer dans la chambre d’un copain ou d’une copine sans apercevoir la divine galette au monolithe latrinesque trôner à proximité de la platine sur la pile des disques préférés. Mais pour lui tout est déjà joué. Ce qui n’est pas faux. Mais il est temps de faire entrer l’icône subliminale des années sixties, sans qui le ver ne se serait pas incrusté dans le fruit. Roulement de tambours, please mister Keith Moon. This is Herr Doktor Sigmund Freud.

NARCISSE 1
Entre par la porte de derrière. Celle de la petite enfance. Comme toute autobiographie qui se respecte notre auteur commence par le début, la rencontre de ses parents. Une histoire d’amour. Ca se profile bien, mais ça continue mal. Il n’y a pas d’amour heureux nous a prévenu Aragon. Mme Townshend a la cuisse légère. Comme l’éléphante dans un magasin de porcelaine elle trompe son mari. Papa Townshend ne sera pas le premier cocu de l’Histoire, aussi nous ne le plaindrons pas. D’autant plus que l’épouse volage rentrera au bercail et que l’on ajoutera vite un petit frère à la couvée, car il est très connu que plus on est de fous, plus on rit.
Lourde hérédité familiale. Le père joue de la clarinette et du saxophone, orchestre de la RAF, fera partie des Squadronaires, orchestre swing jazz à gogo réputé in the United Kingdom, et enregistrera un disque en 1956, chez Parlophone sous la houlette de Norrie Paramor, Unchained Melody, la mère abandonnera ses prétentions de chanteuse pour s’occuper de son amant et de son fils… Certes elle gardera le premier quelques temps mais se dépêchera de refiler son Pete chéri à sa mère…
Toutes les grands-mères ne sont pas d’aimantes mamies. Pete Townshend est élevé à la spartiate. L’enfant n’est pas heureux mais tout cela ne serait qu’un mauvais souvenir diffus s’il n’y avait pas eu la scène fondatrice. Quoi au juste ? Townshend n’est pas très précis dans ses allégations. Il semblerait qu’un ( ou plusieurs ? ) amant de sa mère-grand se soit tant soit peu épanché sur ( ne dit pas dans ) son corps de môme pédophilisé.
Ce n’est pas moi, c’est lui. Pete Townshend ne s’en remettra jamais. C’est-ce qu’il assure. Expliquera toute sa vie à partir de cette initiation non désirée refoulée dans les ténèbres de l’inconscient. Faudra des années pour que cela remonte à la surface et qu’il prenne totalement conscience de la catastrophe enfouie dans les sables mouvants de sa mémoire refermée sur l’originelle obscurité.
NARCISSE 2

Dès lors tout devient clair comme de l’eau de source. Si la musique des Who fut si violente, c’est qu’elle était en partie une tentative Townshendienne de briser le miroir menteur des glauques étangs faussement dormants… Townshend est un modeste, ne se pavane pas comme un coq de basse-cour. De quatorze à vingt et un ans, l’a des problèmes avec les filles. Le contraire d’un Casanova, elles préfèrent toujours les copains, lui faudra du temps pour acquérir assurance et savoir-faire. Mais il possède l’explication miracle : tout cela parce que tout petit il a subi la chose horrible…
De même son addiction pour l’alcool. Fera tout pour s’en débarrasser, docteurs, traitements, psy, alcooliques anonymes… évidemment si après plusieurs années d’arrêt il revient à la bouteille, vous devinez le pourquoi de la fatale rechute… Ne soyez point comme moi sceptique, ne dites pas que l’âge venant, ses enfants ayant grandi, son épouse chérie vieillissant, il a envie de revivre sa jeunesse de rocker déjanté accro à tous les excitants de la terre fertile en jeunes femmes affriolantes…
L’a sa grille de lecture qu’il applique systématiquement à tous ses échecs. Sont plus nombreux que ses réussites. C’est que très vite son existence se heurte à une difficulté insurmontable. Comment continuer à être Pete Townshend lorsque les Who ne sont plus ? De temps en temps l’on ressort les soldats de la boîte, l’on remplace ceux qui sont morts par des musiciens aguerris et roule la machine, l’on repart pour une tournée. Plutôt pour quelques millions de dollars. Avec plus ou moins de bonheur. Parfois les fans sont déçus. Parfois non.
NARCISSE 3

Keith Moon a eu raison. C’était un sage. Même s’il n’en n’avait pas l’apparence. Est mort avant de vieillir. Est mort avant de se survivre. Townshend était trop accroché à lui-même pour finir ainsi. Ne s’est pas mal débrouillé. Les royalties certes, mais aussi un bon job, un peu comme directeur de collection, dans une maison d’édition et puis il a épuisé la formule. Nous, lamentables froggies devant l’éternel, avons été épargnés par toutes les resucées de Tommy et de Quadrophenia que le brave Pete s’est escrimé à refourguer aux braves Tommies et aux fiers Ricains. Z’en ont bouffé et rebouffé, avec orchestre symphonique, en version films et en adaptation télé, en comédies musicales et en je ne sais plus trop quoi d’innommable… Traficote le texte, supprime des morceaux, en rajoute, adapte, réadapte, n’oublie jamais de préciser les sommes pharamineuses que cela lui rapporte. Le rocker est devenu un personnage public, fait partie de l’establishment, de la gentry, people talkin bad de sa récuperated generation…
Soigne son égo. Petite carrière solo. Est tout fier quand il arrive à vendre 25 000 albums que plus personne n’écoute. Heureusement que lui s’écoute parler. Donne dans la charity business. Chante gratuitement pour les bonnes causes. N’y a plus un gaminos qui meure de faim dans le monde sans qu’un quarteron de vieux rockers en pré-retraite ne se sentent pousser des ailes d’ange dans le dos.
LE RETOUR DU BÂTON
Très tôt Townshend à la recherche de sons nouveaux pour les Who s’est penché sur les progrès techniques apportées par l’ingénierie du son. Se passionne pour le mellotron, ancêtre des synthétiseurs, se confectionne at home des consoles d’enregistrement à deux, quatre, huit, seize, trente-deux pistes, se focalise avant Eno et Robert Fripp pour les boucles sonores… Du câblage électrique il saute à l’électronique, le voici devant les ordinateurs, s’enthousiasme très vite pour les progrès du Net. Tout neuf, tout beau, fait joujou avec, ne fait guère preuve d’esprit critique. Que la toile soit un formidable outil de communication il y souscrit la bouche en cœur, qu’elle soit dans le même temps un réseau de surveillance et de flicage ne semble guère lui effleurer l’esprit. Faudra qu’il soit victime de ces douteuses pratiques pour réaliser que cette technologie est une monstrueuse aragne sans pitié.

Se fait prendre comme un bleu. Lui qui voulait jouer au chevalier blanc. Sur un site du FBI destiné à piéger les pédophiles qui achèteront les images proposées à la vente. Nous dit qu’il essayait de mesurer de visu l’ampleur de la mercantile criminologie liée à ces honteuses et horribles pratiques sexuelles. Bref son nom se trouvera sur une liste de cinq mille grata personna qui ont approché ce genre de sites. S’en suivra une campagne de presse à son encontre dont il aura du mal à se dégager.
Expliquera que lui-même ayant été victime de tels agissements il tentait de mesurer l’ampleur du phénomène pour mieux le combattre. Tout symbole étant réversible, rétrospectivement l’on peut se demander, si l’affaire ayant été classée par la justice, cette autobiographie n’a pas été rédigée dans le but de se fournir un alibi rétroactif inattaquable. Un peu comme Raymond Abellio qui s’accuse dans un de ses romans, par personnages interposés, d’avoir mis au point la notion de Structure Absolue, non pour démontrer, l’ambivalence métapolitique du jeu des forces politiques de Gauche et de Droite mais pour intimement se dédouaner moralement du meurtre de sa femme. C’est fou comme les rockers - êtres dépourvus de tout sens moral - peuvent avoir l’esprit perspicace mal placé. De toutes les manières ce n’est pas ce qui entamera la chatoyante estime que nous portons au fabuleux guitariste des Who.
THE WHO

Les Who selon Pete Townshend. Est-il utile de le préciser ! L’histoire est racontée par un seul des bouts de la quadruple lorgnette. Remarquez que le deuxième mot du titre c’est bien « je » et pas « nous ». Pour une fois que quelqu’un énonce clairement qu’il parle en toute subjectivité, l’on ne va pas se plaindre. Une enfance comme tant d’autres avec les copains qui se termine en 1957 à l’écoute de Rock Around The Clock. Une très bonne manière de mettre les pendules à l’heure. Ensuite ce sera Elvis, auquel il n’accroche pas vraiment, psychologiquement ça s’explique, Presley et Love Me Tender c’est surtout l’idole des filles sur qui il n’arrive pas à mettre le grappin.
Joue de l’harmonica depuis un petit moment mais commence à guigner sur les guitares, toutefois il donnera son premier concert au lycée au banjo avec son groupe de copains les Confederates avec déjà John Entwistle… à la trompette. Ce n’était pas du rock mais du jazz and jive… Nos petits ados grandissent, se disputent mais se retrouvent toujours. Townshend s’est acheté une guitare tchécoslovaque qu’il finit par électrifier. Un ancien élève viré tourne autour du lycée, il en impose avec ses étroits pantalons et sa banane gominée de teddy boy. Retenez son nom, il s’appelle Roger Daltrey. Il est bientôt le leader incontesté des Detours dans lequel on retrouve John Entwistle. Puis quelques mois plus tard Pete Townshend.
DETOURS ARTISTIQUES
C’est l’intello de la bande. Entre en 1962 à l’ Ecole d’Art d’Ealing, pendant que les autres bossent en usines ou glandent… Dichotimiques aspirations, rocker ou artiste plasticien, il faut choisir. Finira par opter pour la musique à quelques mois de passer son diplôme. C’est que les évènements se sont précipités. Les Détours se rapprochent du mouvement Mod en pleine émergence. Quittent définitivement leurs racines jazz en descendant plus avant dans le blues de Jimmy Reed, Howlin’ Wolf, Little Walter et Bo Diddley. Sont devenus des amateurs de Rhythm and Blues. Ne sont pas les seuls à prendre ce chemin. Progressent si vite qu’en décembre 63 ils passent en première partie des Rolling Stones, Keith Richards est particulièrement en forme ce jour-là, il fait de grands moulinets avec sa main droite avant de toucher les cordes de sa guitare. Gimmick d’un soir qu’il abandonnera très vite. Mais Pete Townshend adoptera la posture. En février 64, les Detours changeront de nom : deviennent les Who. Pas sympas du tout ils vireront Doug leur batteur au profit d’un petit nouveau qui tape comme un dieu : Keith Moon.
FLOTTEMENTS
Ne suffit pas de bien jouer, faut se démarquer des autres, et prévoir sinon un plan de carrière au moins préparer un pronunciamento rock. Passons rapidement sur la petite erreur d’aiguillage : changer de nom et devenir les High Numbers pour coller encore plus à la mythologie mod était une erreur stratégique qui sera vite réparée. S’adresser à un groupe particulier c’est s’aliéner tout le reste de la jeunesse. Beatles, Stones, Kinks, sont au-dessus de ces clivages amoindrissants, visent l’audience la plus large possible. C’est la musique qui fera la plus grande différence qui effectuera le plus grand ralliement. Redeviendront vite les Who, mais cet intermède n’aura aucunement entravé leurs progrès.
MUSIC 1

Ce qui différencie les Who des autres groupes de l’époque, c’est que contrairement à l’illusion qu’ils produisent, nos quatre mousquetaires ne cherchent pas à jouer ensemble. Le groupe est sous tension et sans cohésion. Prenons le cas du dernier arrivé. Keith Moon, le gars que l’on a pris en stop alors que la 2 Chevaux brinqueballait joyeusement sur la route. Un batteur fou, n’était pas là depuis deux jours qu’il a adapté un moteur de Ferrari sur le coucou. John Entwistle aurait pu la trouver mauvaise. Qu’est-ce que c’est cet énergumène qui ne tient pas compte des sacro-saintes lignes de basse ? Tape du début à la fin à trois cents kilomètres heures sans se soucier le moins du monde d’entamer le fameux dialogue basse-batterie, ne lui laisse même pas un espace pour s’immiscer dans les subtilités rythmiques.
Remarquez qu’il a raison le Keith de croquer la lune à lui tout seul. C’est qu’Entwistle la batterie il s’en moque comme de sa première trompette. L’a mieux à faire. Ne quitte pas Tonwnshend de l’oreille. Ont engagé depuis des mois un duel fratricide. La règle est d’une simplicité absolue. Ce n’est pas mon papa qui est plus fort que le tien, mais mon ampli fait plus de bruit que le tien. Tu mets à sept, je pousse à huit, tu montes à neuf je grimpe à dix. Quand on est tous les deux à fond, l’on se dépêche d’amener un engin plus volumineux et plus bruyant. La querelle se termine à coups de baffles. Les Who finiront par jouer entre deux murs d’enceintes aussi haut que les fortifications de Carcassone. Ca sonne et ça casse les carcasses.

N’empêche qu’ils ont chacun leur style. Entwistle c’est le pur flegme britannique à l’état brut. Dommage qu’il faille bouger les doigts pour faire sonner la basse, l’on devine que s’il suffisait d’appuyer une fois pour toute sur un bouton, il resterait immobile sans ciller d’un millimètre durant tout le concert. Townshend est en constante évolution. Le gamin colérique et hyper actif à qui l’on a oublié de donner son médicament. Ce n’est pas de sa faute. A force d’écouter le Dust My Broom d’Howlin Wolf, l’a compris que si la guitare d’Hubert Sumlin vous foudroyait ce n’était pas parce que Sumlin était un virtuose mais parce qu’il attaquait ses cordes avec une violence inégalée jusqu’à lors. D’où les sauts incessants et les moulinets à la chaîne. On ne caresse pas, on ne gratouille pas, on cogne, on slappe avec une fureur sauvage. Evidemment ça ne suffit jamais, alors l’on recherche le larsen, on frotte la guitare contre les amplis, et l’on finit par la casser, contre le plancher, contre le plafond.

N’en faut pas plus pour donner des idées de meurtre à l’autre macaque qui grimace derrière ses caisses. Lance ses baguettes en l’air, bazarde ces futs à coups de pompes, s’amuse comme un mongolien atteint de delirium tremens. Ce qui n’est rien comparé au chanteur qui avec ses chemises à longues franges vous refait le coup de la chute de l’ange tombé sur notre stérile planète et qui pousse, dans son micro qu’il fait tournoyer comme une fronde catapultaire des hurlements de chimpanzés en rut, afin d’annoncer aux cieux muets la disparition des dinosaures.

Mais ce n’est pas tout. Il existe des dissensions encore plus perverse. Les Who c’est chacun pour soi et le plus mauvais gagne mais il existe aussi des alliances secrètes. Ce pourrait être une cacaphonie sans nom, mais ça ne l’est pas. Si Entwistle et Townshend sont des géants qui forgent l’arme ultime de Zeus à grands coups d’arcs électriques, Daltrey et Moon ne sont pas les larrons que l’on croit. N’en ratent pas une pour faire la foire, mais à la vérité ces deux faiseurs de souk, ces soukers inégalables, sont de vrais enfants de chœur. Sont des amateurs de rock surf. Adorent les douces harmonies. Les mélodies qui défilent à toute allure certes, mais dans un paysage où tout n’est que luxe, calme et volupté.
MUSIC 2

Ce qui explique l’attrait qu’exerce la musique des Who sur nombre de ses auditeurs. L’on pourrait parler d’extrême sauvagerie mélodique. Fait mal aux oreilles mais vous fournit l’ouate pour soigner les acouphènes qu’elle engendre. Mais Townshend se défend de toute gratuité dans cette inflation sans fin de stridences électriques. En ces années soixante le souvenir d’Hiroshima est encore présent. Toute une jeunesse européenne déboussolée par une guerre mondiale qu’elle n’a pas vécue mais dont les dommages collatéraux dans la psyché des parents sont encore visibles se dépêche de vivre avant d’être anéantie par la bombe atomique. Pete Townshend termine sa première partie - de loin la plus exaltante - sur la préparation du Live at Leeds. Est très fier de ce disque. Vous lui préfèrerez la version CD qui triple la set list originale. L’a raison, c’est bien le premier disque de hard rock jamais enregistré. Le premier œuf de tyrannosaurus rex qui ait éclos en notre monde après tant de millénaires d’attente…

Mais avant cette originelle galette pré-métal, il y eut Tommy. Tommy, c’est avant tout Townshend. Pas le Townshend qui devient le premier client de Marshall et qui conseille Jimmy Hendrix quant au choix de ses amplis… Non, l’autre, l’introverti, l’intello, qui se trimballe ses complexes pédophiliques comme des queues ( inconscientes ) de casseroles attachées à ses grolles. Pour Townshend il n’y a pas de doute, c’est sa pierre philosophale. Un peu pâteuse, un peu pathos, un peu pas trop, à mon goût de rocker sous-développé qui préfère les lyrics de Summertimes Blues et de Shakin’All Over par lesquels débute le Live à Leeds à toute la fumeuse phraséologie du plus grand de tous les opéra-rock jamais créés depuis. Reconnais que ce fut un drôle d’aérolithe tombé dans le monde du rock. Encore plus commenté que le Sergent Pepper Lonely Heart Club’s Band des Beatles. C’est dire le tabac ( et la fumée ) occasionné par cette aventure musicale.
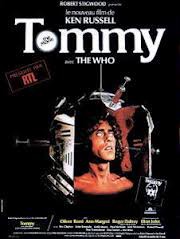
Ne l’ai pas réécouté depuis trente ans. J’ai bien peur que ça ait vieilli. Un peu comme Pete Townshend dont le livre nous livre les affres d’un héros bien trop fatigué pour la hargne rock and roll qu’il avait su nous instiller en sa fastueuse jeunesse. Ce Who I Am finit par ressembler à la fiche du Who Is Who du citoyen upper class Pete Townshend. Vaut peut-être mieux en rire qu’en pleurer.
Damie Chad.
ROD STEWART / L'AUTOBIOGRAPHIE
Traduction de Pascal Loubet
( MICHEL LAFON / Mai 2013 )
J'ai vécu quatre ans dans une station de ski ( je ne vois pas pourquoi il y n'y aurait que Roderick James Stewart qui aurait le droit de rédiger son autobiographie ). Je me suis jamais risqué sur les pistes vertigineusement enneigées, elles sentaient à mon goût un peu trop le sapin. N'ai pas dépassé d'un centimètre la limite tutélaire des terrasses des cafés. Pourquoi serai-je allé plus loin ? Dans mon bar préféré – c'était itou chez les autres - la clientèle n'arrêtait pas de glisser des pièces dans le juke-box. C'était quinze fois d'affilée Da Ya Think I'm sexy de Rod Stewart, suivi de quinze fois d'affilée Blondes Have More Fun de Rod Steward. De temps en temps, trois ou quatre fois par jour j'arrivai à glisser une obole afin de passer Les Animals, le premier simple issu de leur première réunification en 1976. Je vous demande ce que j'aurais pu espérer de plus beau pour mon existence que d'être bercée des heures entières par la voix de Rod Steward et d'Eric Burdon.

ROD LE MODESTE
Faut avoir lu l'autobio de Pete Twonshend pour goûter à sa juste valeur le regard que Rod Stewart pose sur sa vie. Qui serait plutôt un long fleuve tumultueux. N'est pas un névropathe pour deux shillings, le Rod. Ne se prend pas la tête sur ses problèmes d'enfant durant cinq cents pages. Ce n'est pas avec lui que les psychanalystes feront fortune. S'accepte tel qu'il est, pas le genre de gars qui en rajoute. Démolit les légendes sur laquelle les médias ont assis sa réputation, est un adepte de l'auto-dérision qui ne prend jamais les autres et lui-même tout-à-fait au sérieux. Qui essaie de ne pas être dupe de lui-même.
Ne le canonisez pas non plus. Dit aussi assez de conneries pour que l'on puisse lui tirer à boulets rouges dessus. Ne résiste jamais à la tentation de se mettre à nu. Non, mesdames, c'est juste une métaphore. L'a des goûts de petit garçon et de beauf breveté. N'hésite pas à arrêter le récit pour consacrer un chapitre entier à ses goût déplorablement attendus – les Lamborghini , le football, les maquettes de modèles réduits de trains... si vous attendez qu'il vous explique La Critique de la Raison Pure d'Emmanuel Kant, j'ai bien peur qu'il kannot, ou alors faudra sortir le canot de sauvetage et ramer dur...
POOR HAPPY CHILD !
Naît en 1945 – un peu comme une bombe à retardement de la dernière guerre car le plus petit de ses frères a tout de même dix ans de plus que lui. La famille n'a pas le sou mais est unie. Le père préfère le foot à tout le reste, serait fier que son petit dernier devienne une star internationale du ballon rond. L'on a beaucoup glosé sur la carrière ratée de Rod à cause d'une mauvaise blessure ou de toute autre raison attentatoire... l'avoue sans fausse honte le Rod, n'était pas un joueur dans l'âme, un ardent supporter oui. C'est en vieillissant que la passion foot le rattrapera, mais nous n'en sommes pas encore là.
Par contre, il commet une faute que nous ne lui pardonnerons pas. A quatorze ans son frère l'emmène voir Bill Haley. Les portes du rock'n'roll s'ouvrent devant lui, il les referme avec politesse. Ca ne lui déplaît pas, mais ce n'est pas la révélation. Persiste dans son erreur, la claque musicale lui viendra l'année suivante en écoutant un disque de... Bob Dylan. Rod le folkleux est né. Poussera le vice jusqu'à remonter le courant à sa source et il se fera beatnick. Refuse de se laver, enfile des oripeaux crasseux, se balade avec une guitare sur le dos et s'en va faire la manche en France... Pas de rock, mais le sexe pointe le bout de son nez, pour trouver des filles un peu ouvertes il commence à fréquenter les festivals de jazz. C'est ainsi que le blues et puis le rhythm and blues entrent dans sa vie... D'ailleurs il s'achète un harmonica pour se mettre au diapason de cette musique... Du jour au lendemain il a changé de look, sera désormais Rod the Mod, vestes cintrées, plis au pantalon, tignasse artistique. Vient de trouver sa marque de fabrique.
LONG JOHN BALDRY

L'est en train de massacrer un morceau de Howlin' Wolf ou de Muddy Waters en attendant le train lorsque Long John Baldry s'arrête devant lui et l'engage dans sa nouvelle formation... en formation. C'est la chance de sa vie. Long John Baldry c'est une des racines essentielles de la renaissance blues anglaise, l'était aux côtés d'Alexis Korner et de Cyril Davies au tout début, mais il va surtout apprendre le métier à Rod.
En douceur. Long John ne charge pas la mule. Le petit jeunot n'est pas bombardé principal soliste du jour au lendemain, commencera par un morceau, puis deux, puis un autre par ci par là. Idéal pour se mettre en voix sans se déchirer le larynx. Entre deux morceaux il écoute Long John et prend ses leçons sur le vif. Gratuit et tout bénéfice. En plus ils est plus que bien payé, bien plus que son prolo de père, et il tourne pratiquement tous les soirs. Car la formation de Long John Baldy est apprécié par les groupes de connaisseurs qui commencent à se former dans Londres et tout autour de la capitale.

Le monde est petit et celui du blues anglais n'en est qu'une infime parcelle. En quelques mois Stewart rencontre tout ceux qui deviendront les piliers du british rock. Voit pour la première fois les Stones qui jouent... sagement assis sur des chaises. En ces premiers temps le blues était une chose trop sérieuse pour être mise entre les mains de rockers trémoussifs. Cela viendra vite. Déjà les Yardbirds et les Pretty Thing poussent sur l'électricité un petit peu plus fort que la normale.
STEAMPACKET
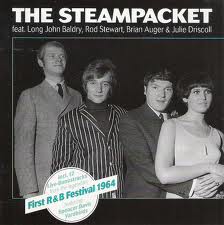
Pour être un précurseur Long John Baldry se voit vite dépassé. Vedette un jour, hasbeen le lendemain. C'est la dure loi du rock. Mais Long John n'a aucune envie de passer pour le cave de service. Fonde ce qui sera plus tard présenté comme le premier supergroupe. Met le paquet pour Steampacket, ne serait-ce qu'au niveau des chanteurs, trois d'un coup, Long John, Rod Stewart et une voix féminine, Julie Driscoll reléguée ( en principe ) dans les choeurs. Mon oeil, la Jool ne se prive pas pour faire jeu égal avec les garçons et leur disputer les plus belles reprises. C'est d'ailleurs le point faible du groupe, beaucoup d'emprunts et peu de créations. Avec un deuxième talon d'Achille, car si Steampacket n'obtient pas le même nombre de contrats que la formation précédente, le groupe compte un peu trop de musiciens pour être économiquement viable. Faut dégraisser, Rod sera débarqué. Abandonné sur les rivages d'Angleterre pendant que le restant de l'équipage cingle vers la France. Où il naufragera au bout d'un mois de galères et d'alcool.
En la perfide Albion Rod n'en est pas pour autant privé de fortifiants alcoolisés. S'adonne à la bouteille sans en devenir esclave et réalise de plus en plus que la place de chanteur est une sinécure sans égale, puisque sur scène les filles n'ont d'yeux que pour lui... Laissera pas passer la moindre proposition...
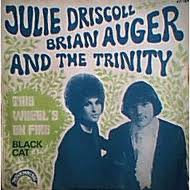
L'on ne peut quitter Steampackett sans se rappeler ce que Jullie Driscoll et l'organiste Brian Auger apporteront au rock anglais dès 1967...
JEFF BECK'S GROUP

Rod est tout aussi vernis que ses boots. Ne se retrouve pas dans une bonne formation qui fait de l'oseille. Mais à la pointe extrême de la nouveauté rock. Dans le laboratoire expérimental en avance sur son temps. L'on dit, et Rod dans ses mémoires accrédite la légende, que c'est en assistant aux répétitions de la formation de Jeff Beck que Jimmy Page a l'intuition de l'idée de ce qui deviendra l'heavyesque formule musicale de Led Zeppelin...

De toutes les manières Beck était un génie trop libre dans sa tête pour se plier aux exigences de la rentabilité commerciale d'un supergroupe. Une fois les basses du heavy metal jetées sur les sillons de deux trente-trois, l'envie le démangea d'aller ailleurs... N'était pas non plus aidé par son mauvais caractère. Un maître, mais pas pliant. Pas pervers mais un peu narcisso tout de même. Ne s'apercevait même pas qu'il descendait dans des hôtels plus cherros que le reste de son groupe. L'avait une limousine avec chauffeur à dispo, tandis que les autres prenaient le taxi...
Le combo n'était pas constitué de manchots, Rod y retrouve Mick Waller le batteur de Steampacket et devient très vite l'ami pour toujours du bassiste Ron Wood au destin stonien que personne n'ignore. Quand on aura ajouté que le pianiste Nikki Hopkins sera sur de nombreuses tournées et enregistrements des Rolling quelques années plus tard, l'on aura une idée du potentiel du groupe...
L'aventure durera deux ans, mais Rod y gagnera une crédibilité rock'n'roll inaliénable. Pourra par la suite tout se permettre, on lui pardonnera tout, même d'enregistrer du disco, le fameux Da Ya Think I'm Sexy, par exemple... Beck enseignera à Stewart ce qu'il y a de plus précieux chez l'être humain, la liberté. Sur scène dès que Rod manifeste l'envie de piquer une gueulante, la guitare de Beck se met en sourdine et Rod pousse à volonté sa tyrolienne enrouée, prend le temps qu'il veut, deux minutes ou dix. A le droit de tout essayer, sans avoir eu auparavant à plaider sa cause.
Même si avec Jeff, Rod visite la grande Amérique mythique, dans la vie de tous les jours Beck n'est guère un grand rigolard, Ronnie et Rod se tirent alors que groupe vient de signer pour un festival pourri dans un bled inconnu. Un truc infâme qui s'appelle Woodstock...
THE FACES

N'en perdent pas la face pour autant. Retour à la case départ en Angleterre. Ronnie trouve du boulot chez les Faces, n'ayant rien à faire Rod assiste aux répétitions. Le reste du groupe le regarde de travers. Depuis que Steve Marriott a quitté les Small Faces pour fonder Humble Pie, les musicos se méfient des chanteurs... prennent les filles, la gloire et se tirent ramasser l'oseille ailleurs. Faudra plusieurs mois pour que Ronnie Lane, Kenney Jones et Ian McLagan acceptent de reprendre un soliste.
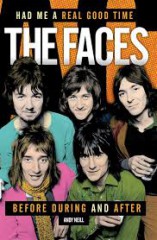
Plus qu'une aventure musicale, les Faces furent une aventure amicale. Les meilleures années de Rod, rock and roll à fond la caisse, des tournées de six mois, des hôtels saccagés, des filles nues dans toutes les chambres, de la coco en barre et de l'alcool à flots. Des soirées de beuveries à se tordre de rire, des virées d'enfer entre copains assoiffés, un niveau intellectuel digne des supporters en goguettes d'une équipe de foot. L'on s'amuse à péter dans les micros et à se promener à poil dans les backstages. A mourir de rire. L'on gaspille le fric avant de l'avoir gagné, on rigole comme des tordus. Le bon temps. Qui ne dure qu'un temps. Cinq ans.

EVERY PICTURE

Ronnie Lane a raison de se faire du souci. C'est qu'entre temps Rod a commencé à enregistrer pour son propre compte. Succès d'estime avec Gasoline Alley dès 1970, mais en 1971 Rod décroche le pompon avec Every Picture Tells a Story. L'a enfin trouvé la cinquième dimension : l'a compris qu'il fallait écrire des compos originales qui sonnassent mieux qu'une reprise. Ce sera Maggie May. L'a jeté toute sa gourme dans ce morceau, ce qui est assez normal puisqu'il y évoque la perte de son pucelage. Pour l'auditeur l'on a surtout l'impression d'une fellation chaque fois que l'on entend Rod ouvrir la bouche, ah cette voix de gorge orgasmique où l'on s'enfonce sans fin... Un chef d'oeuvre absolu. Pour le reste les chansons n'arrivent pas à la culotte de Maggie mais la voix de Rod supplée à tous les manquements. Un véritable pompier qui jette de l'huile sur le feu. Et tout cela ce n'est rien encore. Le meilleur du disque c'est l'intro. Trente secondes de pur bonheur. Une idée de Rod, la mandoline de Ray Jackson du groupe Lindisfarne qui vous emporte dans un moyen-âge électrique. Pas insensé quand on se rappelle les folkleuses racines de Stewart, mais après les avalanches du Jeff Beck's Group, Rod prit son monde à contrepied. Un peu de culture pour les rockers. En plus le disque sonne beaucoup plus soul que rock. Un mélange incandescent, classé numéro 1 des charts singles en Angleterre et en Amérique, mais aussi number one des charts album en Amérique et en Angleterre. Personne n'a depuis réussi à aligner ces quatre chevaux en même temps en tête des hits.
ET Z'APRES ?

Ben ça continue. La vie de Rod devient un tourbillon. Encore plus de cocaïne ( mais de la pure ), encore plus de filles ( de préférence blondes ), encore plus de concerts ( remplis à ras bord ), encore plus de maisons ( manoirs princiers ), encore plus de voitures ( sa marque préférée ), encore plus de football ( un terrain à la maison ), encore plus de tableaux ( cent trente toiles préraphaélites ), encore plus d'encore plus. Quand on a vendu près de cent cinquante millions de disques, l'on peut voir la vie en grand.

Avoue qu'il a une chance folle, lui le petit prolo londonien à qui le monde s'est offert sans trop de mal. Ne cherche pas l'excuse du génie ou de la prédestination. Ne boude pas son plaisir, et ne nous donne pas la liste de ses oeuvres de charité. Tant que ça durera, il affirme qu'il sera heureux. Mais qu'il regrettera si ça devait cesser. Avec les vingt-deux millions de disques vendus ces cinq dernières années, il ne se fait pas vraiment de souci.

Parle de moins en moins de musique au fur et à mesure qu'il vieillit, raconte ses histoires de cul et de coeur, sans fausse honte et tout en restant très gentleman avec ses compagnes successives. Ne se décrit pas comme un Don Juan mais assume sa lâcheté affective. Pas un bon vivant, mais quelqu'un qui a su vivre bien. Ne regrette rien, ne nous la joue pas en père la morale qui a tout compris.
Admet qu'il a eu l'existence la plus agréable qui aurait pu lui échoir, celle de rock star. L'est dommage que pour le public rock il est maintenant davantage une star de l'upper class qu'un rocker en rébellion. En est totalement conscient et se moque de lui qui a dix-huit ans se réclamait de l'ultra-gauche. N'a pas l'impression d'avoir tourné sa veste, mais de n'avoir pas été en ses jeunes années tout à fait conscient de ce à quoi il aspirait. Fier de ses origines populaires il n'a l'impression ni de s'être renié, ni d'avoir trahi sa classe. Ne s'est pas vendu, mais s'est laissé acheter. Et il n'en éprouve aucune honte. Vous pouvez en pleurer, lui en rit à gorge déployée. Profitez-en pour jouir de sa voix. Le rauque sirop éraillé de la rue rock.
Damie Chad.
21:33 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/10/2013
KR'TNT ! ¤ 158. ERVIN TRAVIS / MEMPHIS SPECIAL / JACK RABBIT SLIM / DAVE DAVIES / CARL AND THE RHYTHM ALL STARS
KR'TNT ! ¤ 158
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
10 / 10 / 2013
|
ERvIN TRAVIS / MEMPHIS SPECIAL / JACK RABBIT SLIM / DAVE DAVIES CARL AND THE RHYTHM ALL STARS |
|
Non le Cat Zengler et Damie Cat ne se sont pas absentés durant dix jours pour couvrir un concert rockabilly en Corée du Nord, beaucoup plus prosaïquement l'ami Damie et son ordinateur ont tout deux nécessité quelques opérations de replâtrage urgentes, mais comme tout semble être de nouveau d'aplomb, Keep Rockin' Till Next Time... ...Du coup, le temps a manqué pour la Chronique Vulveuse V, mais elle ne saurait tarder... |
SAINT-MAXIMIN / 27 – 09 – 2013
BAR SAINT-VINCENT
ERVIN TRAVIS & THE NEW VIRGINIANS

Ca dégoise dans l’Oise, passé Chantilly la teuf-teuf hante de noirs chemins ombreux, dans le halo cotonneux des phares la silhouette d’un sanglier aussi monumentale qu’un bison se profile sur le bord de la route, l’on serre les fesses ( et l’on perd la face ), mais la monstruosité dédaigneuse ne nous accorde pas un seul regard. Nous n’émergeons des âges farouches que lorsque l’enseigne lumineuse du Saint-Vincent troue la nuit.
Ici tout n’est que clameur, luxure et volupté. Une soirée de rockers pour ceux qui ne comprendraient pas la poésie. Le Saint-Vincent, son bar, sa pièce intermédiaire de dégustation, sa salle de concert, sa cour latérale, vous connaissez, c’est bien la sixième fois que l’on vous y emmène. L’on ne présente plus, à peine dirai-je que je sacrifie au rite du sandwich maison, pain moelleux, cornichons aussi craquants que des nichons sur la plage d’Arcachon, camembert gouteux… Pas la peine d’en faire tout un fromage, nous sommes ici pour Ervin Travis. Que nous n’avons pas revu depuis son mémorable concert au Billy Bob’s, chez l’oncle Picsou Disney ( voir notre livraison 64, du 15 - 09 - 2011 ).
SET ONE
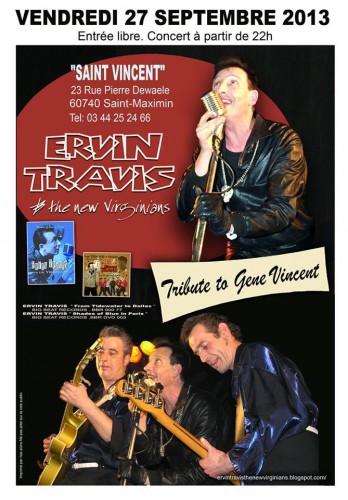
Les musicos s’installent, Fred derrière ses drums, Gilles à la basse, Phil à la guitare, des vieux briscards qui écument le french rockabilly depuis le revival des années quatre-vingt, et un petit jeune, Damien, en poste derrière son piano électrique Roland. Débutent par un instrumental de belle facture et prometteur quant à la cohérence du groupe.
De cuir noir habillé Ervin s’empare du micro, contre lequel il s’arque comme un contrefort de nef romane, les yeux levés vers le ciel, sa voix résonne et en quelques secondes nous sommes très loin emportés en un autre temps, un autre lieu, une autre époque, ce n’est pas le spectre de Gégène sorti de sa tombe qui vient nous tirer en arrière par les cheveux du souvenir, mais la présence hommagiale d’Ervin Travis qui remet en scène le souvenir de Gene Vincent. Ne parlez pas de copie mais d’évocation. Travis n’imite pas l’Inimitable, il ouvre une fenêtre, celle à jamais cassée sur la pochette de The Day the World Turned Blue, et chacun peut se risquer à jeter un regard ou à fermer les yeux pour ne pas voir. Car l’on ne voit que ce qui est profondément ancré au-dedans de nous. Si seulement vous pouviez vous voir tel qu’en vous-même aujourd’hui !

En aucune seconde Ervin n’est Gene Vincent. Ce serait porter un fantôme bien trop lourd pour ses épaules de fan. Mais il est servi par une tessiture vocale si proche de celle du kid de Norfolk que vous ne pouvez vous empêcher de sursauter. Il suffit que vous ayez quitté Ervin du regard pour vous intéresser par exemple à l’adorable minois d’une photographe pour que l’attaque d’un phrasé vous cloue au pilori de l’illusion ressemblante. L’espace d’une seconde ce n’est plus Ervin qui chante mais Gene qui vous interpelle.
C’est un exercice - au sens latin de combat - qui n’est pas sans fièvre nostalgique. Est-ce un hasard si les titres qui me reviennent en mémoire sont parmi les plus mélancoliques du répertoire de Gene, Mister Loneliness, You’ll never walk alone qui fut d’abord salué par un silence recueilli de plusieurs secondes avant que n’éclatent les applaudissements nourris et Over The Rainbow, qui reste peut-être l’émerveillement pathétique le plus profond de la discographie de Gene, le moment où l’Artiste dépasse le Rocker.

Rangez votre mouchoir. N’y a pas eu que des instants miraculeux d’émotion pure, le rock and roll c’est aussi l’insouciance de l’adolescence, cette joie de vivre au-delà des règlements de la triste existence formatée des adultes. Du moins ceux qui ont remisé leurs rêves au placard des illusions perdues. Et pour cela vous pouvez compter sur Damien. D’abord il y a la présence de son pumpin’ piano qui tout de suite donne une autre couleur à toutes les versions de Gene, quelque part nous sommes assez loin des Blue Caps originels - même si l’on n’oublie pas les galops de Clifton Bruce Simmons sur Rocky Road Blues par exemple - répétons-le, Ervin et les New Virginians ne copient pas, ils s’inspirent ou plutôt ils nous inspirent. Mais ensuite c’est la justesse des chœurs de Damien qui nous chavire le cœur, à lui tout seul il est le digne représentant de tous les clappers boys de Gene. Même débordement, même frénésie, même mise en scène vocale, même s’il reste gestuellement coincé par son clavier qui lui dévore les doigts.
SET TWO

Un petit Gégène pour nous mettre en train, mais dès le second morceau Ervin annonce que pour répondre à la demande expresse d’une fan durant l’entracte, il va interpréter un morceau d’Elvis, (You’re The ) Devil in Disguise. Le temps de s’assurer que Philippe Fessard a bien le morceau en tête et c’est parti pour trois minutes de bonheur. La salle reprend en chœur mais faut surtout écouter Damien qui fait la contre-voix sur le refrain, You Look Like An Angel, You Walk Like An Angel, You Talk Like An Angel, il vous minaude cela avec le velouté d’un cantador mexican, les doigts pleins de bagouzes, la mine croustillante et l’œil salace à faire mouiller les culottes de toute l’assistance féminine. Un moment impayable, avec la voix d’Ervin qui chavire tout.
Du coup Ervwin lâche la bride à Damien qui se lance dans un petit Little Richard à dégommer une compagnie de CRS, finit debout sur son tabouret, tout en martelant comme un fou furieux les touches noires et blanches de son dentier à musique. N’oublions pas l’admiration que Gene portait au petit Richard.

Deuxième set encore plus enlevé que le premier avec une version dantesque de Baby Blue. La guitare de Philippe Fessard pleure et rugit en même tant - Baby Blue est un titre magique dans le répertoire de Gene, c’est un morceau qui synthétise tout le passé originel du rock dans son ensemencement blues tout en préfigurant l’évolution du hard rock tel qu’il fut défini une dizaine d’années plus tard - moment d’émotion intense avec Fred qui frappe un tempo somptueux.
Le set se terminera sur un morceau culte parmi les fans français de Gene, I'm goin’ Home ( To See My Baby ) qu’Ervin interprète à merveille. Toutefois je retiendrai cette version de I Got A Baby en laquelle Gene croyait beaucoup pour relancer sa carrière trop vite en déclin aux States, mais que les radios boudèrent n’appréciant guère l’indépendance d’esprit de ce jeune chien fou de rocker… Un morceau transgressif car Gene y plie l’enthousiasme noir du gospel à l’impitoyable rythmique du rock and roll, une pépite qui demande du souffle et de la maîtrise vocale et dont Ervin ressuscitera la vélocité existentielle.
FIN DE PARTIE
Trop beau, trop fort pour partir tout de suite. Avec Mister B l’on s’assoit à la table d’un grand escogriffe - bel homme et forte personnalité au nez busqué et aux cheveux bouclés - qui durant Say Mama m’a glissé à l’oreille en rigolant que même Sylvie Vartan l’avait reprise… l’on a visé juste, l’a vu trois fois Gene Vincent entre 1962 et 1964 - comme quoi il y a toujours des privilégiés en ce bas monde - ce qui nous fait une excellente entrée en matière lorsque Ervin s’assoit à notre table et nous raconte qu’il n’a jamais vu son idole. Parle de sa rencontre à huit ans avec les disques de Gene et de sa vie dans les quartiers chauds de Lyon, et le regard de Gene en filigrane sur son vécu, l’empêchant de verser dans les erreurs qui ne pardonnent pas et qui engloutissent irrémédiablement une vie.
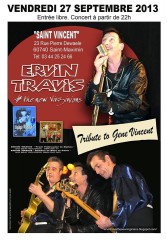
Ervin possède une vision assez noire du rock de notre époque. Déteste aussi cette dernière qui n’est que faux-semblants et tissus de mensonges qui ne cachent même plus la brutalité sanglante d’un monde dont rien n’arrive plus à marquer la sordide réalité… Le rock a été annexé par les fils de la bourgeoisie, il lui semble très éloigné de la rage primordiale qui habita la première génération des rockers issus des couches populaires les plus démunies de l’Amérique, desquelles Gene fut un des représentants les plus emblématiques… Qu’un deuxième Gene Vincent - pas une réplique mais un Artiste d’une sensibilité équivalente - puisse apparaître de nos jours lui paraît impossible, l’espèce humaine phagocytée par la globalisation rampante des plus lâches médiocrités ne pourra plus jamais engendrer des êtres de cette dimension…
Heureusement qu’il existe des Ervin Travis qui s’adonnent à ce devoir de mémoire des temps révolus pour toujours.
Damie Chad.
BOURRON MARLOTTE / 28 - 09 - 2013
LE MARINGO
MEMPHIS SPECIAL / ERWIN TRAVIS

L’on a tellement apprécié vendredi soir Erwin et ses New Virginians, qu’avec Mister B, l’on a remis le couvert le samedi. De plus c’est chez nous dans le 77, alors autant en profiter. « T’as le nom du café ? » m’a prudemment demandé Mister B, « Bien sûr que non, mais ne t’inquiète pas Bourron Marlotte c’est un village encore plus petit qu’un bouton de culotte ! » ai-je répondu fort imprudemment. C’est devant le panneau de Ville de Bourron Marlotte que nous avons fait grise mine. Je vous mentionne pas la pluie diluvienne qui se met à tomber sans crier gare. Bourron Marlotte, contrairement à mes prévisions, ce n’est pas un hameau boueux mais la banlieue résidentielle de Fontainebleau. Les artères en sont interminables, bordées de demeures cossues, pour les meilleures construites dix-neuvième siècle, ça pue davantage la bourgeoisie méritante que ça ne fleure bon le purin campagnard… Je me renseigne dans une auberge pas du tout espagnole, mais à la note que je subodore aussi lourde qu’un cuirassé, continuez jusqu’au bout, tournez à gauche et suivez la rue durant au moins trois kilomètres, ce doit être au Martingo, ils font parfois venir des musiciens de ce genre-là, je sens une pointe ( persillée ) de mépris dans la voix…
Dix minutes plus tard, alors que nous passons au ralenti devant un restaurant Mister B s’exclame « C’est ici, j’ai entrevu par la port ouverte Ervin assis ! » Avec la musique qui s’échappe du resto, j’avais déjà deviné. L’on gare la teuf-teuf et l’on entre au pas de couse sous les trombes d’eau. Sauvés !

Grande salle avec bar, mais peu de monde, Memphis Special - tiens ce sont les musiciens d’Ervin - fait un boucan d’enfer avec le son qui rebondit sur le carrelage comme des balles de ping-pong. L’on dit bonjour, l’on nous installe des tables, l’on grimace devant le menu à quarante-cinq euros par tête de pipe - nous nous contenterons d’un simple hors d’œuvre ( fort copieux ) et l’on hume l’ambiance. Rien à voir avec le Saint Vincent de la veille, les bikers sont remplacés par des convives d’un niveau social plus élevé, dégustent dans la salle supérieure et très peu se dérangeront pour regarder les musiciens. Aux mines pincées que certains tirent lorsqu’ils traversent la salle pour rejoindre leur berline, l’on devine qu’ils appartiennent à un monde dans lequel les serviettes hygiéniques ne se mélangent pas aux torchons brûlants. Mais délaissons nos préventions sociologiques pour écouter Memphis Special.
MEMPHIS SPECIAL
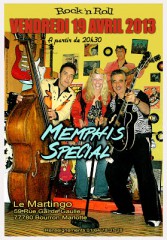
Rectifions un erreur, ce sont bien les musiciens d’Ervin qui dr temps en temps se lancent dans un instrumental succulent mais avec une dame en plus. Zabelle, puisque vous voulez tout savoir. Cheveux blonds et port de reine, et puis surtout une voix, à vous donner le frisson. Ample, froide et chaleureuse à la fois, une voix de maîtresse femme qui ne s’en laisse pas compter, ni par les hommes, ni par la vie. Entre Edith Piaf et les années soixante. Un curieux mélange qui sonne bien.

Ne fait pas que chanter, tricote aussi de l’accordéon et nous aurons droit à un morceau d’obédience cajun, mâtinée d’un relent de balajo, avec accompagnement électrique adéquat. Du véritable french zydeco populaire, tel qu’on en a jamais fait en France, à notre humble connaissance. En théorie vous pouvez ne pas aimer, en pratique vous ne resterez pas indifférent.
Chante aussi un slow, Philippe Fessard nous apprend qu’il fut enregistré en 1959, et l’on y reconnaît tous les tics - qui étaient alors le comble prisé de la modernité - de tous les morceaux lents des années soixante inspirés par les Platters et le son si neuf ( à l’époque ) des glissandos des guitares électriques. Aucune revendication passéiste chez Zabelle, l’on sent qu’elle chante avec naturel, ce qu’elle aime, et qu’elle a toujours aimé. Avec tant d’assurance et de simplicité, que sa prestation ne saurait être accusée de ringardise. Du maintien et de la franchise, être ce que l’on est, sans se renier en se mettant au goût éphémère du jour, reste la chose la plus difficile au monde.

L’est sûr que le combo enrobe son chant d’une orchestration des plus efficaces et des moins répétitives qui mettent tous ses morceaux en valeur. Damien en profite pour dévoiler une nouvelle corde de son arc-en-ciel musical en utilisant aussi un harmonica. Le set s’arrête trop vite. L’on aurait bien cédé encore au charme de la voix de Zabelle mais c’est de notre faute si nous sommes arrivés en retard.
SET ONE

Un premier set sensiblement égal à celui de la veille. Je ne vais pas vous répéter le laïus, tout au plus ajouterai-je quelques détails pour noter le perfectionnisme d’Ervin, cette manière de dire merci en français avec cet inimitable accent anglais de Gene et la brièveté de ces deux syllabes qui trahissaient paradoxalement la timidité, la gêne de Gene, son mal-être existentiel lorsqu’il était hors de son chant et qu’il n’avait qu’une hâte celle d’y retourner comme le poisson exilé sur le rivage qui n’a d’autre désir que de retrouver l’eau salvatrice de tous ces maux. Ervin n’abuse pas du jeu de scène par-dessus le micro, qui reste l’apanage de Vincent, effectué avec tant de prestance, que l’on se demande comment il fait pour ne pas s’emmêler les piceaux et revenir à sa position de semi-stabilité antérieure. Peut-être ne le répète-t-il pas à satiété par respect pour Gene qui surmontait et sublimait ainsi par ces pirouettes acrobatiques le handicap et la souffrance physique d’une jambe aux os broyés.

Peut-être faudrait-il prêter davantage d’attention au jeu de Philippe Fessard. D’une précision extrême, d’un régal gouteux. Change souvent de guitare, la blanche, la noire, la rouge - toutes les couleurs de l’alchimie - afin de mieux respecter toutes les nuances, mais que ce soit sur Fender ou sur Gretsch l’on n’entend que du bleu tellement à chaque fois ça sonne juste. Le son et le geste, l’a tout médité, l’a tout réfléchi, l’a tout réinventé et s’est tout approprié. Pourrait donner des leçons à plus d’un, un sacré musicien et l’on sent qu’il ne nous dispense qu’une maigre portion de son talent.

Je regarde Gil, à l’inverse de Phil scrupuleusement attentionné à son cordage, le regard de Gil Tournon est partout sauf sur sa basse. Phil joue avec son cerveau et Gil avec son corps. Ressent d’abord le rythme et c’est sa chair et ses os qui le traduisent, ses doigts sont comme des sismographes qui transcrivent les commotions de la terre. L’est habité par un daimon socratique et inspirateur. Comment peut-il construire une assise - le mot évoque la rigidité des fondations - rythmique sur un tel swing corporel ? Semble jouer d’instinct, comme sous le coup d’une dictée, d’une poussée intérieure, ce qui ne signifie pas qu’il ne procède pas aussi d’une profonde connaissance des arcanes du rock and roll. Un jeu terriblement inventif, alors que le set est constitué de reprises sacralisées par la mythologie rock.

La scène étant moins exiguë qu’au Saint Vincent je puis profiter de Fred dont la veille je n’ ai entrevu la veille que la blanche crinière léonine. C’est qu’un batteur ça se regarde peut-être plus que ça ne s’écoute. L’on juge par le son, mais l’on comprend par le geste. Un métier indéniable, mais une frappe que je qualifierai de décisionnelle. Sûre d’elle, d’une volonté quasi-impériale, lance la charge, la bascule et la bouscule à volonté, d’une simple inflexion latérale. Sait aussi résoudre les problèmes, au moindre désajustement de ses collègues il opère la soudure la plus adéquate qui soit. Avec une telle aisance que cela apparaît comme une évidence déconcertante. En voici un qui ne ne se prend pas pour une boîte à rythme en libre autonomie, l’a le souci transcendant de l’unité du groupe dont il est le garant.
SET TWO

Ervin et ses Virginiens innovent. Un What d’I Say pour commencer, le Devil de Presley immédiatement recyclé - toujours Damien qui se prend pour un mariachi toltèque - et Ervin embraye méchamment sur deux hits de Cochran avec un Somethin’ Else d’anthologie. Vous tape dans les octaves cochranesques à vous méprendre. Véritable caméléon vocal.
Pas un seul morceau de Gégène à l’horizon. Travis se met au diapason de son tout dernier CD, Something Else, The Best Of 50’ Rock ’n’ Roll dans lequel il démontre qu’il n’est pas un fan exclusif de Gene Vincent. Montre aussi qu’il n’est pas tout à fait manchot quand on lui colle un manche électrique dans les mains.

Le bar s’est rempli, de jeunes femmes qui ont laissé leurs maris ( peut-être leurs amants, mais tout autant ennuyeux ) devant leurs assiettes pleines, des jeunes qui sont entrés attirés par le bruit et qui n’en reviennent pas d’une telle explosion énergétique, plus tous les magnifiques loosers décavés, surgis l’on ne sait comment de la nuit, que le rock attire aussi sûrement que la lampe du jardin les phalènes… Chaude ambiance, jusqu’au garçon du bar qui troque son allure cérémonieuse aux « Monsieur désire… » contre des hurlements de joie et d’encouragement aux musiciens.
Buddy Holly, Jerry Lou, Little Richard tous les ancêtres tutélaires y passent un par un et Damien devient littéralement fou debout sur le clavier de son Roland qui continue à lancer ses trilles vagabondes à la volée. Un grand moment de joie furieuse et collective.
SET THREE
C’était si bien qu’après un intervalle d’à peine dix minutes Erwin et ses quatre mousquetaires rempilent pour un dernier set. Un top Gene, aux petits oignons, avec un Baby Blue encore plus mélodramatique que la veille, un I Got A Baby insurpassable, et un Goin’Home qui n’aurait jamais dû s’achever.

Trente péquins dans un troquet au bout d’un monde qui n’est pas le leur et la magie du rock and roll qui explose sans prévenir. Un chanteur et des musiciens qui se sont donnés sans compter, et une communion exemplaire avec un public à la base disparate mais fondu par la force de la musique en une fraternité certes éphémère, mais qui fait partie de ces instants dont on aime à se souvenir lorsque l’existence devient amère.
Les musicos auront du mal à ranger leur matériel tant ils sont assaillis de questions et de demandes. Je discute avec Serge - encore un de ces favorisés qui ont eu la chance de voir Gene en public, et qui a rejoint Ervin et l’aide à organiser ses tournées, tant le souvenir du Screamin’ Kid reste éblouissant et pousse tous ceux qui ont de près ou de loin été brûlés par cet astéroïde du rock and roll à se battre pour en perpétuer la souveraine présence parmi nous. Parce que les rêves des hommes, que l’on se transmet de génération en génération, sont tout aussi mortels que les hommes. Gloire à Gene.
Damie Chad.
LE COUP DU LAPIN
DE JACK RABBIT SLIM
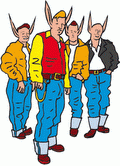
Effectivement, leur reprise des Kinks faisait mauvais effet. On ne comprenait pas qu'un groupe de rockab pur et dur comme Jack Rabbit Slim pût balancer une version salement garage de «I Need You». Ah ça oui, on se perdait en conjectures. Que venait faire cette reprise garage dans un festival rockab ? Cherchaient-ils un moyen de brouiller les pistes ? Ou au contraire, cherchaient-ils à jeter des ponts entre des genres si souvent séparés par les sectarismes et qui pourtant plongent leurs racines dans le même terreau : la rébellion. Bob Butfoy malmenait une Gretsch et ses bras couverts de tatouages ne laissaient planer aucun doute quant à sa crédibilité de pur rockab anglais. Pourtant, ce jour-là, les puristes proférèrent un jugement sans appel : comme les Anglais mélangeaient les genres, ils perdaient toute leur crédibilité. Le clairsemé du public ne faisait que renforcer la violence de la sentence.
Exécution d'un groupe en place publique.
La scène se déroulait en août 2012 à Béthune, ville jadis rendue célèbre par son bourreau. Pour prendre un raccourci, nous passâmes devant la scène pour aller rejoindre la terrasse d'un marchand de boustifaille et je crus voir dans le regard de Bob Butfoy, l'espace d'une fraction de seconde, un mélange de mépris et de déception. Un peu comme s'il se disait : «Comment ces fucking frenchies osent-ils passer devant nous sans s'arrêter ?»
Intrigué par cet épisode un peu brutal, je décidai de mener l'enquête. Je me souvenais d'avoir vu un vinyle à pochette jaune de Jack Rabbit Slim chez Born Bad, mais j'avais fait passer d'autre priorités. Évidemment, le jour où je vins spécialement pour le récupérer, il avait disparu et ça paraissait compliqué d'en rapatrier une autre copie. Label anglais et tirage confidentiel... Aucun espoir, mon vieux. Pour dénicher les albums de Jack Rabbit Slim à Paris, il faut avoir une veine de pendu.
Lenox n'avait que leur avant-dernier album, «Hairdos & Heartaches» et même pas en vinyle, en CD. L'album date de 2009 et c'est là-dessus qu'on trouve la fameuse reprise des Kinks qui leur valut l'excommunication. Quand on écoute ce disque, on en garde des impressions mitigées. Sur la pochette, on voit qu'ils restent fidèles au vrai look rockab, mais on se souvient que les groupes anglais n'ont jamais vraiment su contribuer à la légende dorée du rockabilly. Les groupes adulés par les Teds anglais allaient plus vers le rock'n'roll et mis à part quelques rares exceptions, ça tournait un peu en rond. Si l'on met de côté cette perle de rockab vaudou qu'est «Monkey And The Baboon», Crazy Cavan n'a jamais fait d'étincelles. Tous ces groupes tournaient en rond et s'épuisaient à recycler «Long Tall Sally». Bob Butfoy et Jack Rabbit Slim n'échappent malheureusement pas à ce travers, mais leurs disques réservent de bonnes surprises, ce qui nous dédommage largement d'avoir consacré du temps à leur recherche.

Comme par exemple «Hairdos & Heartaches», le titre qui donne son titre à l'album et qui ouvre le bal : on se retrouve en présence d'une balade pop d'envergure supérieure boppée au slap. Admirable, très british dans l'esprit. On assiste à la rencontre de la pop éclairée et du bop. Démarche audacieuse et réussie. On pourrait dire d'elle «belle balade», comme on dit d'un acteur qu'il a une «belle gueule». On retombe là sur cette manie très anglaise de choisir un hit pour le premier morceau. Par contre, on sera surpris par le morceau suivant, «Shake-Rag», car il sonne comme un vieux coucou des Yardbirds. Même si le bop reste élastique, le mélange ne plaira pas à tout le monde. La vieille impression béthunienne se confirme : Paul Butfoy et ses collègues cherchent à jeter des ponts entre les genres, et à ce stade des opérations, on ne peut faire qu'une seule chose : les encourager et leur souhaiter bon courage, tellement l'entreprise semble périlleuse.
Peut-être redoutent-ils la routine du rockab, cette grande tueuse d'albums. Peut-être cherchent-ils à créer une sorte de modernité. Personne n'est encore allé dans le garage boppé. Mais il n'est pas certain que ça puisse fonctionner. Simplement à cause de la grande différence entre les beats. Ils sont incompatibles.
Avec «The Gift», Bob va droit sur Buddy Holly. Le mélange du bop et du buddysme fonctionne mieux. Voilà un morceau lourd de conséquences qui avance tout seul sur fond de stomp de bop stromboli. Bob jette un nouveau pont par dessus les abîmes en attaquant «Skin», une pièce de pur garage. Audace ou tentative de suicide artistique ? Impossible de trancher. Mais il a son petit moment Gene Vincent et soudain la lumière se fait : essaie-t-il de reprendre les choses là où Gene les avait laissées, avec la rumeur d'une possible alliance avec les Flamin' Groovies ?
Avec «21st Century Betty Page» ils sonnent carrément comme les Cramps, mais ce n'est pas une raison pour les enfoncer. Ces mecs-là enregistrent des disques pendant que d'autres regardent la télévision. Heureusement, ils finissent leur album avec un hit planétaire, «High In Mighty», la balade de tous les espoirs, jouée sur des arpèges et chantée d'une voix à la Morrissey. Troublant. On se croirait sur un album des Smith. Sauf que la chanson est bonne. On rougirait presque en entendant ça.
Voilà le grand paradoxe de Jack Rabbit Slim : ils pondent des hits par inadvertance. Là où on les attend, ils nous déçoivent et là où on ne les attend pas, ils nous surprennent.
Ironie du sort, c'est dans les bacs de Beast, alors que je cherchais du garage, que je vais trouver deux vinyles de Jack Rabbit Slim, «Sleaze A Billy» (la fameuse pochette jaune repérée chez Born Bad) et un album encore plus ancien, «Sin-Uendo», parus tous les deux en 2008.

On voit tout de suite qu'entre ces deux vinyles de 2008 et l'album Hairdos de 2009, le groupe a subi de profondes transformations, ce qui explique sans doute le virage garage. Deux des membres originaux, le guitariste Tom Hayes et le contrebassiste Nick Linton Smith ont disparu, remplacés par Darren Lice à la guitare et Landon Filer à la basse.
«Sin-Uendo» n'est pas l'album du siècle. Avec leurs premiers morceaux, nos amis anglais sonnent de manière très classique et même un peu passe-partout : le genre de rockab qu'on a déjà entendu des milliers de fois. Quatre ou cinq trucs insignifiants plus tard, on tombe fort heureusement sur une pépite boogaloo : «Gypsy Curse». Le genre de morceau capable de sauver à la fois un album et une réputation. Bob chante ça avec des coups de menton. L'ambiance vaudou aurait beaucoup plu à Lux Interior. «Gypsy Curse» revêt la parure d'un hit culte. C'est vraiment plein d'espoir qu'on lance la face B, et dès le second morceau, on reprend ce qu'il faut bien appeler une claque. Après une intro orientale, Nick Linton Smith slappe sauvagement «Voodoo Slide». On renoue aussitôt avec le son du rockab de rêve. Jim Hayes joue tout au bottleneck, porté par une rythmique irréprochable, un snap-clicotac de première main. D'autres surprises guettent l'amateur. Comme par exemple «Gas Tanks & Bellies», une jolie pièce embarquée par un slap tendu et une ligne de guitare fantôme assez belle, située quelque part dans la troisième dimension. Effet garanti. Finesse extrême. Subtilité délicieuse. Après le solo, la ligne de guitare revient, comme un insecte métallique inoffensif. Avec seulement trois morceaux, ils sauvent leur disque. Ce groupe finit par impressionner, car, par certains aspects, ils sont complètement originaux.

Vers la fin, ils se vautrent avec une reprise du «Whistle Baist» des Collins Kids qui, comme chacun le sait, restent intouchables.
Les premiers morceaux de l'album «Sleaze A Billy» nous replongent dans la routine des mauvais disques rockab, ceux dont il ne faut attendre aucune surprise. Ils font partie des groupes qui s'épuisent encore à reproduire le tagada de Johnny Cash, alors que franchement, ça ne présente plus aucun intérêt. Toujours la même erreur : le repompage éhonté de Folsom qu'on a entendu tellement de fois qu'on n'éprouve même plus de plaisir à écouter la version originale. Sur les morceaux plus rapides, on retrouve ce vieux défaut du rockab revival : l'agilité banalisée. Par contre, dès qu'ils sortent des sentiers battus, les Jack Rabbit Slim sont de fameux clients. «Kitten With A Whip» part sur une intro jungle et se poursuit avec des accords en creux. Une fois encore, on se retrouve avec un morceau remarquable d'inventivité. Le riffage disparaît et réapparaît. Il revient toujours en crabe. Voilà le prototype du morceau qui frappe pour tuer, comme dirait George Foreman. Un morceau accrocheur comme une maladie tropicale, dans le registre exotico-menaçant, une pure perle, dans la veine du fameux «Monkey And The Baboon» de Crazy Cavan.
Ils versent une belle contribution au mythe rockab avec «Bop Attack», joliment boppé en rond. Même si ça manque un peu de folie, on savoure le o bien rond du bop.
La face B s'ouvre avec une belle fournaise intitulée «Black Dog», boppée à l'avant, riffée dans le fond et maladivement gimmickée. Solide et pointu comme le nez de Cyrano. La batteur Paul Sanders se prend pour Jean Gabin quand il conduit sa loco. Dès qu'ils tapent dans ce genre de burnetterie, les Rabbit redeviennent bons. Et en prime, ils nous tartinent tout ça d'harmonica. Comme l'ail, ce genre de morceau fait circuler le sang.
Encore plus intéressant : Bob revient sur sa fixation Gene Vincent avec «A Devil's Heart», digne de la période «Bird Doggin'», mais pour une raison évidente, ça ne marche pas. On appréciera la finesse du travail guitaristique de Tom Hayes sur «Queen Bee» et ils terminent sur une étrangeté baudelairienne, une reprise du «Cars» de Gary Numan. Reprise très inspirée et suivie d'effets. Un truc comme ça dans les parages et on se relève la nuit pour le réécouter, tellement ça intrigue. Mais tout de même pas de nature à réveiller les morts. N'exagérons pas.

Leur dernier album s'appelle «The Emperor's Clothes». Il ramène lui aussi son lot de bonnes surprises et notamment un gros hit garage, «Speed Of Love». Bob Butfoy enfonce son clou, mais il va se faire des ennemis. Et Darren Lince en profite pour balancer un solo glougloutant à la Dave Davies. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence : l'un des plus jolis clones de Johnny Burnette balance un garage dévastateur. Ils auront du mal à vendre ça. Ils persévèrent dans le parjure, mais de manière infiniment respectable. Ils reviennent au slap avec «In Rust We Trust», vertigineuse trombe de slap de fête foraine, oh ça tournoie comme lorsqu'on a sifflé deux litres de Monbazillac. Sur «Relentless Heart», ils se prennent pour Canned Heat. Par contre, toute la folie rockab coule dans les veines de «Devil Doll». On sent le pouls de toute la puissance rockab des ténèbres et les neurones ondulent comme les macaronis dans l'écumoire du père Mordicus. Pas d'échappatoire, c'est la meute qui saute à la gueule du cerf. Même si c'est du rock'n'roll, «Come Back Baby» dépasse les bornes du jeu des Mille Bornes. C'est chanté à fond de gosier et incendié par un de ces solos mortels qu'on achète en Serbie.
Petite cerise sur le gâteau : leur label Western Star vend un DVD intitulé «Jack Rabbit Slim - Jet Lag, Junk Food & JD». On y voit plein de choses intéressantes, et notamment Rockin' Ronny Weiser éplucher ses factures dans son bureau. Soudain, il entend Jack Rabbit Slim, alors il grimpe sur son bureau et se met à danser, puis il plonge et se roule par terre. On voit aussi Bob Butfoy porter un T-shirt Sonics, Darren Lince jouer du Wes Montgomery, Alan Wilson parler de son label Western Star Records. On voit aussi pas mal d'images spectaculaires du groupe sur scène, et notamment dans les prestigieux festivals rockab espagnols. Et Bob de conclure : «We want to be a cross between rockabilly and popular music.» On l'aura compris.
Finalement, je me suis beaucoup amusé à mener l'enquête car elle m'aura permis de découvrir un groupe attachant qui se bat avec ses démons et qui réussit à pondre ici et là des morceaux d'anthologie.
Signé : Cat Zengler, le Maigret du pauvre
Jack Rabbit Slim. Sin-uendo. Crazy Love Records 2008
Jack Rabbit Slim. Sleaze-A-Billy. Crazy Love Records 2008
Jack Rabbit Slim. Hairdos & Heartaches. Western Star Records 2009
Jack Rabbit Slim. The Emperor's Clothes. Western Star Records 2011
Jack Rabbit Slim. Jet Lag, Junk Food & JD. Western Star DVD 2010
Sur l'illustration, de gauche à droite : Nick Linton Smith, Bob Butfoy, Paul Saunders et Tom Hayes.
Le cas Dave est encore chaud
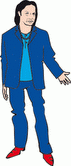
Il court il court le furet. Ce mois-ci, on le voit partout. Il s'agit de Dave Davies, le petit frère de Ray. Dave Davies, le légendaire guitariste des Kinks. LE guitariste anglais par excellence. On ouvre le numéro de Classic Rock du mois de juillet et paf, on tombe directement sur lui. Un journaliste anglais pas très futé écrit dans son chapô : « Il ne tape plus sur son frère, et il y a des tas d'autres choses dont l'ancien Kink aime bien parler.» Dave répond aux questions stupides du journaliste. Se met-il toujours en colère, comme dans le temps ? Dave répond que la colère peut être utile, car elle permet d'aiguiser la pensée. On a invité Ray Davies à chanter pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres, cet été. Pourquoi Dave n'a-t-il pas été invité ? Il répond que de toute façon il aurait refusé d'y participer. Il n'est pas très coubertain. Malin comme un renard, le journaliste pousse Dave vers la question fatale : et la reformation des Kinks ? Bof. Dave n'exclut pas cette possibilité. Puis, profitant d'une question indiscrète sur le montant de ses royalties, il aborde l'un de ses thèmes de prédilection : l'anti-matérialisme. Pour ça, on lui accorde généreusement trois lignes. Quelques pages plus loin, on octroie princièrement trois doubles à Dio, une ancienne vedette du hard-rock qui n'a strictement rien à dire.
Dans le numéro de Mojo du mois de Juillet, Dave répond à des questions un tout petit peu moins stupides. Il se décrit comme métaphysicien, musicien et inventeur. Il rappelle qu'il haïssait profondément l'école et qu'il a toujours refusé de faire ce qu'on lui imposait. Pour lui ne comptaient que la musique et la peinture. Quand il ne joue pas d'un instrument, il pratique la méditation tantrique et le yoga. Il avoue qu'il adore prendre des cuites, mais il ajoute qu'on parvient quasiment au même résultat en méditant. Pourtant, c'est vrai, il aime bien siffler une pinte et aller voir jouer Arsenal avec ses fils et ses amis.

Dans Shindig, on le reçoit avec plus d'égards. On lui accorde une belle double. Le ton y est beaucoup plus respectueux. Fan transi et Kinkomaniak averti, Vic Templar commence par lui demander des nouvelles de sa santé, car n'oublions pas que Dave Davies a bien failli casser sa pipe en 2004, suite à une crise cardiaque. Il dût réapprendre à jouer de la guitare, car l'attaque l'avait complètement ratatiné. Quand Vic lui demande quel est l'artiste qu'il admire le plus dans le monde du rock, Dave répond Chuck Berry, «cause to me he kicked the whole shebang off in the first fucking place » (parce que pour moi, c'est lui qui a tout démarré). Quand Vic lui demande de confier un secret aux lecteurs de Shindig, Dave raconte qu'étant gamin, il se débarrassait discrètement des assiettes de mouton qu'on lui servait à table. La viande morte et les abats lui faisaient horreur. Il se fit prendre et comme punition, il reçut trois coups de trique sur la main. Alors il jura qu'il n'apprendrait plus rien à l'école et qu'il ne mangerait plus jamais de viande.

Si Dave surgit dans tous les canards, la raison en est fort simple : son nouvel album solo vient de sortir. Il s'appelle «I Will Be Me». La pochette épatera plus d'esthète. Dave y apparaît dans un camaïeu de tons bleus (son regard, ses vêtements, son collier et le fond photographique) en compagnie du haut d'un manche de Telecaster. À 66 ans, il reste très séduisant. Il a l'allure d'une rock star qui vieillit bien et du coup, ça donne une pochette classique, comme le furent celles des premiers albums des Stones et du Jimi Hendrix Experience, pour ne citer que les exemples les plus pratiques.
Ce disque nous vole dans les plumes. Dave Davies renoue avec le gros son, qui est sa marque de fabrique. Il revient à sa veine d'antan, celle de «You Really Got Me», l'un des hits fondateurs de l'histoire du rock. Des journalistes mal informés ont longtemps prétendu que Jimmy Page y jouait le solo de guitare. Grave erreur, mon pauvre Watson, Jimmy Page explique lui-même qu'il assistait effectivement à la session d'enregistrement, mais il ne joua ce jour-là que de la rythmique. Dave joua ce solo qui allait frapper l'imagination d'une grande majorité de guitaristes anglais. Le seul qui eut assez de talent et de punch pour en faire une reprise digne de ce nom, ce fut bien sûr Jesse Hector, pour le premier single des Hammersmith Gorillas.
Tous les gens qui se sont entichés des Kinks en 1964 et en 1965 - l'époque bénie où on trouvait leurs EPs 4 titres dans les bacs du Monoprix de quartier - savent que Dave Davies est l'inventeur du rock anglais, celui qu'on joue en quelques accords et qui donnera naissance à la culture garage (et accessoirement au hard-rock). Bien sûr, d'autres groupes jouaient du rock en Angleterre, mais pas exactement de la même façon que Dave Davies. Transis d'amour pour Bo Diddley et Chuck Berry, les Stones et les Pretty Things claquaient un son plus rootsy. Les Who allumaient des mèches et dévoyaient le rock. Les Troggs bétonnaient une esthétique plus rustique.
Les Kinks se distinguaient de tous les autres groupes. Ils portaient des chemises à jabots, Ray Davies incarnait le dandysme de George Brummell et son frère Dave inventait le power-chord.
Avec les deux premiers morceaux de son nouvel album, Dave Davies remet toutes les pendules à l'heure. Il n'a rien perdu de son énergie et de sa classe. «Little Green Amp» et «Livin' In The Past» éclatent comme des orages de distorse. On retrouve la puissance qui nous affolait au temps de «All Day And All Of The Night» et cette façon de claquer l'accord avec un dixième de seconde de décalage. Et puis cette façon de placer des notes éclairs qui s'en viennent lézarder le background sonore. À eux seuls, ces deux premiers morceaux nous récompensent d'avoir rapatrié l'album. Dave Davies réactive la magie des Kinks pour «Midnight In LA». Il y évoque sa nostalgie de Londres - London City is so far away - et réussit le prodige de croiser les genres - nostalgie mélancolique à la Ray Davies et gros rock bien calé sur ses fesses. Puissance et subtilité furent certainement les deux mamelles de la kinkologie. Il revient aux power-chords avec «Erotic Neurotic» - «my baby's erotic/ She's really exotic/ A little bit neurotic» - et tisse une relation ambiguë avec une belle basse bien ronde. Avec ce disque, on sent qu'on navigue à vue, à un très haut niveau. Dave sait aussi composer des choses extrêmement ambitieuses comme «You Can Break My Heart». Il sait emmener ses admirateurs au long de méandres interminables et leur faire humer des vents mélodiques inusités. Cette longue compo traversée d'éclairs de guitare en dit long sur l'audacieuse vitalité de Dave Davies. Pour «Remember Me», Dave invite les Jayhawks à l'accompagner. Mais le dandy londonien pointe le bout du nez et raffine cette chanson qui menaçait de virer country. Dave s'y conduit comme le Lord anglais capturé par les Cheyennes dans «Un Homme Nommé Cheval». Chris Spedding vient donner un coup de main à Dave pour faire sauter «Côte Du Rhône (I Will Be Me)» comme un gros pétard de fin de disque.
Dave Davies enregistre des albums solo depuis trente ans. Tous les albums ne sont pas du même niveau, loin de là, mais ils présentent tous une particularité : Dave Davies y prêche l'amour du prochain, l'anti-matérialisme - donc le travail sur soi - et l'espérance d'un monde meilleur. Exactement comme l'aurait fait Gandhi, s'il avait dû utiliser des outils de communication de notre époque. Rappelons que John Lennon et Dylan ont su toucher bien plus de gens que n'en toucheront jamais les politicards véreux qui hantent les écrans des téléviseurs. La musique est devenue grâce à Dylan et à Lennon le vecteur universel par excellence. Dave Davies l'a très bien compris et s'il enregistre des disques solo depuis trente ans, c'est uniquement pour passer des messages.

Il enregistre AFL1-3603 en 1980 et se fait une tête de code barre. C'est lui qui joue tous les instruments, comme le firent Todd Rundgren et Dave Edmunds avant lui. Il profite du studio Konk k'ont konstruit les Kinks pour assurer leur indépendance artistique. Kasiment tous les morceaux kontiennent des messages. Dans «Nothin' More To Lose», il attaque dans le dur : «Quitte cette maison/ Arrête de regarder la télé/ Tu veux une bonne nouvelle ?/ Il existe un autre monde/ Tu peux le voir/ Sans politique/ Ni religion.» Le message a l'air ku-kul komme ça, mais komme la musique est bonne, ça passe tout seul. Dave n'oublie pas d'ajouter les brassées de heavy guitars dont il a le secret. Le discours de Dave Davies fonctionne exactement comme celui de Gandhi : il s'installe dans le temps et on finit par dresser l'oreille, car au fond, ce qu'il dit est juste. Il ne se contente pas de dénoncer les travers du monde moderne, il propose d'autres façons de réfléchir. Sur cet album, il va commencer à vouloir sonner comme Queen, en fabriquant tout seul dans son koin du rock symphonique à la konk. Un vrai gosse. Mais il garde ses réflexes de glamster anglais pour des morceaux comme «Move Over» qu'il stompe à la bonne franquette. Il s'en prend au carcan du monde moderne : «L'homme n'a pas créé la loi/ Ni les gouvernements/ Les gros concepts nous abrutissent/ Pose-toi la question/ Et ne laisse personne/ T'empêcher de faire ce que tu veux faire.» Avec «See The Beast», Dave se met en colère et envoie ses power-chords briser les couilles des consciencieux : «C'est trop tard, les politiciens ne pourront plus te sauver/ C'est drôle que tu ne voies pas le rêve.» Avec «Imagination's Real», il fait l'apologie de l'imagination. Il propose tout simplement de fuir le réel et indique une sorte de vrai chemin. Chez lui, aucun texte de chanson ne végète dans la neutralité helvétique. Il redouble d'espérance dans «In You I Believe» et refait du Queen à la Konk. Ce disque est spectaculaire, à bien des égards.

«Glamour» paraît un an après et au vu de la pochette, on s'attend à du rock décadent. Dave semble sortir d'un salon fitzgéraldien. C'est mal connaître l'animal. Il revient à sa quête de sens, et de façon assez spectaculaire, car il sait composer en balançant de gros accords, certainement les plus gros accords d'Angleterre. Il pose «This Is The Only Way» sur un gros drumbeat à la Konk et il boucle l'affaire avec l'un de ces petits solos hargneux dont il a le secret. Rebelote avec «Glamour», monté lui aussi sur un énorme stomp. Dave chante très haut et sa guitare sonne très gras. En l'écoutant, on réalise plus nettement qu'il fut le véritable fer de lance des Kinks. Avec «World Of Your Own», il revient à l'apologie de la quête de sens. Dans «Too Serious», il dénonce le sérieux de la vie. Il donne à sa chanson une énorme consistance et embarque sa fin de morceau dans un solo effarant. Il n'en finit plus de montrer qu'il est l'un des plus grands guitaristes de rock anglais. Il revient au heavy rock symphonique avec «The Channel» et dans «Eastern Eyes», il fait rêver l'auditeur : «Je vois dans mon esprit/ Mon histoire spirituelle/ L'Egypte m'appelle/ Mais je dois transformer mon passé».

Avec ses disques à la Konk, Dave Davies est devenu au fil des années un client sérieux, l'un de ceux que l'on suit assidûment, comme Chuck Prophet ou Kim Salmon. «Chosen People» sort deux ans plus tard avec une pochette qui pourrait inspirer des craintes, à cause de son symbolisme à deux sous, mais comme c'est Dave, on se sent en sécurité. Il fait avec «Charity» une fière apologie de la charité. Il se met à chanter très haut, comme Freddy Mercury. Il allie puissance du son et montées au chant, ce qui ne manquera pas d'impressionner les badauds. Avec «Love Gets You», on croirait entendre les Beatles ou les Byrds, c'est dire si Dave tape dans le dur. Avec «Danger Zone», il nous met en garde : «On vit dans une zone dangereuse !» Dave propose d'en sortir - «check it out» - et frise le hard. Il dénonce quasiment dans tous ses morceaux le monde de dingue dans lequel on vit. Dans «Freedom Lies», il chante très haut et il joue une mélodie très pure. Il s'éloigne de l'esprit des Kinks et recherche son indépendance. Admirable. Il revient au heavy rock avec «Matter Of Decision», mais le morceau est ruiné par des ponts de la rivière Kwai à la Konk. Il se fâche, sort le gros son comme d'autres sortent leur artillerie et part en solo. Flamboyant ! Encore une Queenerie à la Konk avec «Chosen People», mais il dit des choses captivantes : «Nous sommes les élus/ Nous sommes les Anciens Professeurs/ Nous connaissons les secrets de la Nature.» Il prêche dans le désert, mais d'autres - plus célèbres - l'ont fait avant lui, n'est-il pas vrai ?

Vingt ans séparent «Chosen People» de «Bug». Dans «Bug», Dave bouillonne d'énergie, il délivre de grosses dégelées d'accords mortels : «On entend des discours de menteurs partout/ Je ne crois pas un mot de ce qu'ils racontent/ Dans les actualités.» Il met tout le monde en garde et le message passe d'autant mieux qu'il le sert sur un tapis de grosses brassées d'accords. Grosses guitares toujours pour «I Ain't Over», rock classique à l'anglaise, très stonesy et le festival continue avec «The Lie», fabuleux morceau qu'il monte en épingle à la sortie de tournants dramatiques. On retrouve l'incroyable puissance de ses compositions, ces morceaux qui accrochent, surchargés de guitares disparates. «The Lie» sonne comme l'un des classiques du siècle. «But no one without true love will ever win.» Du pur gandhisme. Dave continue de jouer comme un dieu dans «Let Me Be», joli couplet chanté à la va-vite et solo pernicieux. «Gonna stick to my dream/ Gonna blow that world away» - Dave y va. Il envoie un solo de roquet. Il le balance comme s'il balançait un pavé dans la gueule d'un pasteur pédophile. Fantastique Dave, puissant et heavy, quasiment glam. Avec «Displaced Personne», il révèle un peu mieux son génie du son, avec une distorse max up to it, un son dragon d'une heavyness ravageuse. Il assume ses tentations heavy merveilleusement bien. Pluie d'astéroïdes. Dave le bienveillant sourit dans le chaos, et il balance un solo complètement allumé. Dans ce disque, l'intensité dépasse les bornes. «Flowers In The Rain» sonne comme un classique des Kinks. Dans «Why», on voit rougir les forges du géant de la montagne.
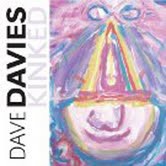
Plus on avance dans le temps, plus les disques de Dave Davies gagnent en force et en pertinence. Le phénomène se raréfie tellement qu'il est bon de le signaler. On se prend «Kinked» en pleine poire. L'album s'ouvre sur un hommage fabuleux à John Lennon, «Unfinished Business», qui sonne comme «I'm The Walrus», c'est d'un poignant qui ne court pas les rues, bardé de beaux accords dignes des Beatles - «we all come together» - Oh le message est clair - «wipe away all the tears/ And build a better world around you.» Dave ne cesse de répéter que tout commence par soi-même. Avec «Fortis Green», il rameute les trompettes de la renommée et la fanfare à la Konk pour balancer une pure giclée de Kinky sound, décadente et effarante. On assiste à la sortie dominicale du dandy. Avec «Give Me Love», il sort l'une des balades du siècle - «give me peace on earth» - c'est une reprise de George Harrison hallucinante de beauté marmoréenne. Dave y joue de la guitare comme un fou de dieu. Son audace le conduit loin. Le Dave des Kinks joue cette radieuse chanson avec une puissance de seigneur des anneaux du bien qui va bien. Il interprète une chanson de son frère Ray («Too Munch On My Mind») avec toute la puissance du prêcheur dans le désert. Aucun disque de Dave Davies ne peut laisser indifférent. Il s'arrange toujours pour piquer la curiosité au vif. «When The Wind Blows» n'a l'air de rien, comme ça. On se dit tiens, une balade de plus et puis, mince, il passe son message d'alerte - «When the wind blows/ Many leaves/ Will fall.» C'mon Dave ! Il nous tisonne le brasero avec «God In My Brain», une monstruosité emplie de la puissance des ténèbres, stompée et chantée à gorge déployée. Finalement, on peut affirmer que Dave Davies pond pas mal de hits, mais ils passent quasiment tous à la trappe.

Son avant-dernier album s'appelle «Fractured Mindz». Il renferme lui aussi son lot de grosses surprises et de power-chords ravageurs. Il appelle les gens à rejoindre son armée spirituelle pour faire la révolution, celle qui sauvera le genre humain. Il passe aux choses sérieuses avec «Free Me» et se met en pétard. Sans le nommer, il s'en prend à Tony Blair. Tout le monde se souvient de la guerre menée par les pays les plus riches du monde (USA, Grande-Bretagne) contre un malheureux pays du tiers monde (l'Irak). Une honte pour l'Occident. Dave dénonce comme un dingue, mais avec la démence d'un dingue du do. On l'entend passer ses accords avec les micro-silences qui ont fait le charme des hits des Kinks. Solo vrillé. Dave devient dingue - «Free me from the government/ What kind of man can take us to war/ Blood murder for OIL/ What kind of creed satisfies such a greed/ He's rotten to the core (Débarassez-moi de ce gouvernement/ C'est quoi ce genre d'homme qui va assassiner les gens pour du pétrole/ Comment peut-on être aussi cupide/ Il est pourri jusqu'à l'os). Dave Davies fait partie des rares rockers qui se sont élevés contre la guerre en Irak. Avec «Come To The River», il nous fait une petite démonstration de heavy blues, mais avec lui ça prend la tournure d'un coup de génie. Il dégouline de feeling, il dépasse les bornes, il fait sans le vouloir une démonstration de force qui aurait beaucoup impressionné Muddy Waters. Puis il gave «Giving» d'accords gras et lourds. Et on tombe ensuite sur une nouvelle merveille paranormale : «Remember Who You Are», une jolie pop-song embarquée au vent d'Ouest, une balade digne des échappées enchantées de Todd Rundgren. Il revient à son terrain de prédilection, les power-chords, pour «The Waiting Hours», mélange de mélasse et de riffage kinkskique, étonnant, exotique. Voilà ce qu'on pourrait appeler l'effluve de Dave Davies. Il sort les machines pour «Rock Siva» et pilonne à outrance, ça nous badaboume dans le bulbe, on entre dans un monde de déviance sonique, on suit le divin Marquis Dave dans son délire de machines, on dansera jusqu'à l'aube, jusqu'à la crise cardiaque - the major stroke - il fait durer le plaisir jusqu'aux heures pâles, on savoure tous les instants de cette aventure davique. Avec «Fractured Mindz», il ré-expérimente à outrance et c'est là où il devient fascinant. Puissant et dru, riffé avec génie, «God In My Brain» nous explose dans le cerveau et on pousse ensuite un vrai soupir de soulagement, car c'est la fin du disque.

Dave composait des chansons, au temps des Kinks, mais Ray conservait une sorte de priorité. Du coup, un album intitulé «The Album That Never Was» est sorti dans les années quatre-vingt, et on y entend des classiques composés par Dave, dont le fameux «Death Of A Clown». On remarque très vite une chose : le son sur cet album est plus musclé que sur ceux des Kinks. Il faut attendre «Creepin' Jean» pour tressaillir. Dave nous sort de sa manche un psyché dérangeant admirablement interprété, du swinging London pur jus. Même chose avec «Mindless Child Of Motherhood», du psyché davique très fruité, incroyablement vertueux et frais comme un gardon. On écoute Dave chanter et on sent bien qu'il a reçu des dieux le don de l'éternelle jeunesse. Le chef d'œuvre de Dave Davies pourrait bien être «This Man He Weeps Tonight», une chanson inclassable, ultra-instrumentée, pleine comme un œuf et mélodiquement sérieuse, d'un excellent niveau composital. C'est un brouet farci d'harmonies vocales. On sent chez lui une froide volonté de grandiloquence. Il recherche l'éclat de la vibration. Il s'étoffe de lumière et devient le parangon qui va peut-être sauver l'empire du déclin.
Signé : Cazengler, qui préfère Dave Davies à la coupe Davis
Dave Davies. AFL1-3603. RCA 1980
Dave Davies. Glamour. RCA 1981
Dave Davies. Chosen People. Warner Brothers 1983
Dave Davies. The Album That Never Was. PRT Records 1987
Dave Davies. Bug. Angel Air Records 2004
Dave Davies. Kinked. Koch Records 2006
Dave Davies. Fractured Minz. Koch Records 2007
Dave Davies. I Will Be Me. Purple Pyramid records 2013
LAGNY-SUR-MARNE
LOCAL DES LONERS / 04 - 10 - 2013
CARL AND THE RHYTHM ALL STARS

La Zone Industrielle de Lagny-sur-Marne est aussi vaste que le Sahara mais encore plus mystérieuse, le GPS lui-même en perd les pédales, trop de giratoires qui ne débouchent que sur des ronds-points aux multiples sorties, là-haut le satellite ne parvient plus à les compter, comme quoi notre société de surveillance n’est pas tout-à-fait au point ( rond ). Il reste des interstices dans lesquels l’individu a encore la possibilité de se glisser… pour combien de temps ? C’est la teuf-teuf qui prend les choses en pneu, et nous sommes émerveillés de son flair, en moins de trois minutes elle avise une concentration de voitures particulières inopinée un vendredi soir en une zone réservée aux véhicules industriels. Blousons de cuir à l’horizon, paddock de Harleys en exposition, nous sommes bien devant le local des Loners.
Se mouchent pas avec la manche, les Loners. Quand on dit local, ne pensez pas à une baraque à frites à moitié pourrie reconvertie en garage à trottinettes à moteur. Mirez plutôt le bâtiment, en béton précontrain, sur trois étages, du solide, de l’inébranlable, carrément une ancienne usine. Les Loners ne nous feront l’honneur que du rez-de-chaussée, cuisine sur la gauche - à l’origine ce devait être le local des gardiens car il est bien connu que les ouvriers qui travaillent ont droit en compensation de leur petite paye à une grosse surveillance - il y mijote un chili con carne dont trois jours après Mister B n’en finit pas de se lécher les doigts.

La salle du concert longue mais un peu étroite, la scène est au fond surélevée d’une quarantaine de centimètres, mais avant de l’atteindre ne vous privez pas d’une halte au bar central, avec le whisky à deux euros vous vous rincez l’estomac jusqu’aux amygdales pour pas cher.
Les boys sont déjà en place. L’on ne peut pas parler d’une balance, d’abord il n’ y a pas de retours, et ils sont surtout occuper à chasser le larsen qui joue au chat et à la souris entre l’ampli de droite et celui de gauche. Technique éprouvée mais toute artisanale, ils orientent en les poussant d’une main experte les baffles un peu plus à babord, un peu moins à tribord. Entre deux essais plus ou moins fructueux ils se lancent dans des quarante secondes plein pot qui donnent envie à tout le monde que ça commence au plus vite. Eux compris, car ils désirent en découdre au plus tôt, et quand l’orga leur propose de prendre leur repas, ils répondent qu’ils vont d’abord donner leur premier set.
PLEIN POT
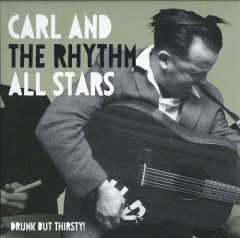
Carl - un grand gaillard au centre, rythmique et vocal, à trois centimètres de ses fesses - c’est utile pour avertir discrètement d’une tape amicale sur le fût le batteur qu’il doit envoyer la sauce au contraire couper les gaz - donc vous l’avez deviné derrière c’est Pedro le drummer. Pour le moment il use d’un balai dans sa menotte gauche et d’une véritable baguette de bois dur dans sa poigne droite, passera le show écroulé de rire, à lancer l’intro du morceau suivant alors que ses trois acolytes essaient de prendre quelques secondes de répit pour s’essuyer le visage, s’accorder ou avaler de travers une gorgée de bière. Pas un rigolo pour autant, abat un sacré boulot, une frappe peu orthodoxe mais d’une efficacité redoutable.

Derrière sa strat Claude est un véritable stratège du riff. Vous en sert plus que vous ne pouvez en entendre. Un jeu rapide et serré qui laisse peu de place aux divagations sentimentales. Pète le feu et le son. Avec Pedro qui termine ses breaks toujours plus vite que son ombre, l’a un sacré travail de colmatage à opérer le Claude pour que l’ensemble reste cohérent. N’y voyez pas malice, s’amusent comme des fous à se surprendre, à se pousser dans des retranchements ignorés.
Tout le contraire de Thibaud, l’accompagne Ruby Ann aux States me dit-on, cela pour donner une idée du calibre du monsieur. Le gars qui arrive systématiquement tous les matins en retard pour prendre son train. Vous rigolez de son air ahuri, et il pique un sprint si rapide qu’il dépasse la loco et arrive avant elle à la station suivante. Ne sait jamais le morceau qui va être attaqué. Les autres non plus, mais ce sont eux qui choisissent un titre de la set-list, ou un truc qu’ils aiment beaucoup, ou un extrait du dernier CD, le pauvre contrebassiste est obligé d’attendre que ça démarre pour chopper le tempo. Mais une fois qu’il l’a ses doigts se jettent dans une super gymnastique, pas du genre à tirer les mèches de cheveux, plaque des à-coups à vous briser la carotide.

Avec Carl and the Rhythm All Stars, c’est facile à résumer. Ca casse et ça passe. Pas le temps de se retourner pour voir l’herbe du rockabilly qui ne repousse pas là où le combo galope. Pas plutôt commencé que le morceau est déjà terminé. Sont spécialisés dans les fins abruptes, Pedro vous ponctue la fin de la partie en plein riff et instantanément les trois autres sont au garde-à-vous prêt à se lancer dans un nouveau canter.
Pas étonnant que le nom du groupe commence par Carl, car en fait c’est lui qui mène la sarabande. A la Charlie Feather, je ne prends pas le temps de respirer et je m’époumone à plein gosier. Et il y prend du plaisir. Autant que les trois autres réunis. Du genre poussez-moi que je fasse un malheur. Une dernière qu’il dit. Une heure de set, qui s’en plaindrait ? Carl, qui en rajoute un morceau, un petit dernier, suivis de dix autres. Plus encore deux ou trois autres pour ne pas se quitter comme des voleurs, et puis quand on aime on ne compte pas. Et les trois autres perdreaux qui l’air de rien lui soufflent encore un nouveau titre à l’oreille. Faut aller manger, oui mais avant on s’offre un hors d’œuvre, une version à rallonge de La Bamba, la répète quinze mille fois « Yo no soy marinero, soy capitan ». Le public en raffole.

POT PLEIN
Z’ont mangé rapidement car ils ont passé l’entracte à discuter dehors, Carl avoue qu’il collectionne les disques, les originaux et que lorsqu’il s’intéresse à un quidam il lui faut l’intégrale avec les inédits, les versions live et les pistes ignorées, un passionné, qui s’intéresse aussi aux fringues. Modestement sans se vanter il reconnaît qu’il s’y connaît en rockabilly.
Ne sont pas remontés sur scène que déjà ils foncent à tout berzingue dans leur premier morceau. Un répertoire qui fouille dans les recoins les plus méconnus du rockab, ne donnent pas dans les standards. Carl présente certaines de ses compositions. Des filles qui l’ont aimé et qui l’ont quitté. Ca n’a pas l’air de lui filer le bourdon. Se rappelle les bons côtés du début. Ca vous lui fiche une pêche d’enfer. L'a dû rayer le mot blues de son dictionnaire.

En tout cas des filles il y en a de plus en plus devant la scène et elles vous mènent un ramdam de tous les diables. Finiront même par monter sur le plateau pour agiter les maracas. Carl vous descend des rockab à la pelle comme d’autres des rafales de pastis dans les bars de Marseille, increvable, insubmersible. Dans son dico l’a aussi rayé les mots lenteurs et doucement. Par contre accélération et précipitation doivent être ses préférés. Si par malheur l’idée saugrenue de reprendre souffle parvenait à se former dans son cerveau, comptez sur son batteur et son guitaro pour lui faire la morale. Le rockab c’est jamais au-dessous de cent soixante sur l’autoroute mais à contre-sens. Et c’est reparti pour dix tours de super-huit.

Finira par descendre de scène pour s’allumer une clope et sortir prendre le frais. Ce qui n’empêche pas les boys de pilonner un instrumental pendant que les filles de plus en plus excitées, se mettent à hurler « Eric ! Eric ! » sur l’air des lampions. Comment résister à un tel chant de sirènes ! Et le dénommé Eric cède au désir des groupies. Beau gars, avec ses trois anneaux qui encerclent le bas de son oreille, ses favoris blonds et sa casquette à la Marlon Brando. S’empare du micro et c’est parti pour deux super morceaux, belle voix riche en harmonique, très expressive. L’aurait pu rester une heure de plus, mais très modestement il s’éclipse sous les clameurs chaleureuses du public. En fait c’est le chanteur d'un groupe dont je vous reparlerai bientôt. Carlito des King Bakers Combo s’en vient taper le bœuf tant qu’il est chaud, sur la batterie pour un unique morceau.

Mais voici que Carl revient, le combo lui impose le Midnight Train de Burnette, et c’est juste après que ça déraille. Sur sa batterie Pedro démarre la triste binarité de ce que nous appellerons pour ne fâcher personne une chanson populaire portugaise. Bon sang ne saurait mentir dit-on, que l’on soit fier de ses origines je puis le comprendre encore ne faut-il pas céder aux emballements claniques… la séquence devient longuette avec toute une partie du public en extase pré-nationaliste, l’on se croirait dans un match de foot avec Carlito qui brandit le drapeau portugais au-dessus de Carl manifestement ravi. Chacun a maintenant le droit de s’emparer du micro et de performer un couplet d’une interminable scie lusitanienne… A la fin Carlito en profitera pour vociférer des insultes au nom de la Madona… Tempérament latin ? Certes, mais que je trouve totalement déplacé en queue de concert rockabilly. D’ailleurs, comme par hasard l’orchestre pose un point final à la séance.

RETOUR
Sommes mi-figue, mi-raisin avec Mister B. Un bon combo, mais à la limite le premier set nous aurait suffi. Le deuxième s’est fini en pipi de cat, et n’a rien apporté de bien positif au rockabilly. Je n’aime guère que l’esprit de la rébellion rock s’égare dans les impasses proto-nationalisantes. Bonne soirée tout de même et l’accueil des Loners mérite ses trois étoiles. Le premier novembre nous y retrouverons les Spuny Boys. Un futur tourbillon de bon augure.
Damie Chad.
( Photos prises sur le facebook des artistes plus ou moins en rapport avec les concerts chroniqués )
23:36 | Lien permanent | Commentaires (0)


