26/09/2013
KR'TNT ! ¤ 157. NIKKY SUDDEN/ JALLIES / WILD GONERS / SURE-CAN ROCK / TEXAS STEVE / REVEREND HORTON HEAT / LAS VARGAS
KR'TNT ! ¤ 157
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
26 / 09 / 2013
|
NIKKI SUDDEN ( + MAX DECHARNé ) / JALLIES / WILD GONERS / SURE-CAN ROCK / TEXAS STEVE / REVEREND HORTON HEAT / CHRONIQUE VULVEUSE ( IV ) |
La mort soudaine
de Nikki Sudden
L'embêtant avec Nikki Sudden, c'est l'affect. Il fait partie des grands rockers anglais auxquels on se sent profondément attaché. Et quand on apprend leur disparition, on pleure.

Un petit label anglais nommé Easy Action et spécialisé dans l'underground de choc vient de publier un coffret Nikki Sudden posthume contenant six CD. Le titre ? «The Boy From Nowhere Who Fell Out Of The Sky». Un ami de Nikki nommé Carlton P Sandercock a passé ses nuits à farfouiller dans les tonnes d'archives laissées par Nikki. Le but du jeu : proposer une sélection. Wow ! Comme le précise Max Décharné dans le livret accompagnant le coffret, Nikki enregistrait et gardait TOUT : les idées, les répètes, les concerts, les émissions de radio. Il laisse donc derrière lui un véritable Himalaya de bandes dans lequel la petite souris Sandercock est allée fureter, sans la moindre idée de ce qu'aurait pu souhaiter Nikki. La publication de ce coffret est un événement de taille, même quand on possède déjà beaucoup d'albums. Sandercock réussit l'exploit de proposer un raccourci sonique à travers une œuvre tentaculaire. Il est en effet allé fouiller dans un parcours sans faute long de trente ans.
Qui mieux que Max Décharné pouvait évoquer le souvenir de Nikki ? D'ailleurs, revoyez la dédicace qui se trouve au début de sa petite bible rockab (A Rocket In My Pocket/The Hipster's Guide to Rockabilly Music) : «For Nikki Sudden, who sang the Teenage boogie on a saturday night, and was telling me nearly twenty-five years ago to write something about Charlie Feathers. Rest in peace old friend». (Pour Nikki Sudden, qui chantait le teenage boogie du samedi soir et qui me disait il y a presque vingt-cinq ans d'écrire quelque chose sur Charlie Feathers. Repose en paix, mon vieux camarade.)

L'affect règne sans partage sur ce récit. Max Décharné évoque si bien le personnage de Nikki qu'on le sent quasiment présent. On parle ici de la magie du rock anglais, telle qu'elle a pu s'incarner chez les Kinks, les Small Faces, Marc Bolan ou Syd Barrett. Max Décharné nous parle de panache et de guitares stoniennes, de fière allure et de glam, d'une certaine vision du rock et d'absolue pureté. Comme Lux Interior, Tav Falco ou Jeffrey Lee Pierce, Nikki n'a jamais dévié sa route d'un seul centimètre. Il a su tout au long de son parcours terrestre rester fidèle à une certaine idée du rock anglais. En pur dandy, il cachait bien son jeu. Mais ceux qui l'ont écouté depuis le début ne s'y trompaient pas. Ce mec avait un talent fou et une passion dévorante pour les gros accords bien claqués, même si les balades pullulent dans son œuvre. Sa réserve naturelle donnait de lui l'image d'un personnage doux et serein, l'anti-star par excellence. Ses foulards de soie à la Keith Richards et son chapeau clac à la Marc Bolan semblaient être ses seules extravagances. On le savait amateur de champagne et de nuits blanches. Il fut l'un de ces héros de l'underground britannique jamais menacés par le succès. Nikki fut en quelque sorte le Pauvre Lélian du rock anglais, un gentil poète que tout le monde connaissait et que tout le monde aimait bien.
Pour entrer dans un coffret comme celui-là, il faut prévoir du temps. Au moins autant de temps que pour lire l'un des pavés de Peter Guralnick. En plus des six CD annoncés, Easy Action vous en offre un septième entièrement acoustique et intitulé «Still Full Of Shocks» (illustré par un superbe portrait de Nikki signé Paul Caton). Puis on découvre au fond de la petite boî-boîte un numéro spécial du fanzine WANWTTS (What A Nice Way To Turn Seventeen) qui propose un texte de Nikki narrant une séance d'enregistrement avec Tetsu et Ian MacLagan. Alors, on réagit comme un gosse qui s'attaque à la découverte de son cadeau de Noël, on inspecte avec une sorte de fébrilité infantile les moindres détails de tous les objets, on lit attentivement le livret (en plus du très beau texte de Max Décharné, on y trouve une interview de John A Rivers, l'ami et producteur de Nikki depuis les Swell Maps jusqu'à la fin, et une interview de Peter Buck (le guitariste de REM qui traite Nikki de parfait gentleman). Et bien évidemment, on examine les sept dos de pochettes où grouillent les informations.
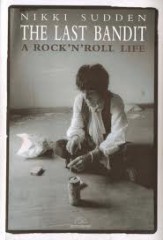
Max Décharné fait allusion à l'autobiographie de Nikki, «The Last Bandit/A Rock'n'Roll Life», qui ne fut jamais réellement commercialisée, excepté une version italienne. Un vrai mystère. L'ouvrage en version anglaise est toujours indisponible, en dépit d'une forte demande. En attendant de pouvoir mettre le grappin dessus, on peut se contenter des textes de ses chansons, généralement très autobiographiques, comme par exemple cette pure merveille qu'est «Green Shield Stamps», tirée du dernier album de Nikki («The Truth Doesn't Matter») et que Sandercock a retenue pour le disk 2 du coffret : Nikki Sudden y chante son enfance, la découverte du glam et ses premières tentatives de monter un groupe avec son frère Epic (What else could we do ? - Que pouvait-on faire d'autre ? - À part monter un groupe). Attention, cette balade provoque autant d'émotion que les grands hits sixties de Bob Dylan.
Grandeur et magie des souvenirs d'enfance. Il semble parfois qu'une vie se résume à ça et que la suite ne revêt jamais la moindre importance.

Les deux premiers disks du coffret proposent donc des choix de morceaux tirés soit de singles, soit d'albums des Swell Maps, des Jacobites ou de Nikki solo. Le disk 1 couvre la période 1977-1989 et le disk 2 celle qui va de 1991 à 2005, c'est-à-dire jusqu'à la fin des haricots. Et là, attention, c'est du double concentré non pas de tomate, mais de rock anglais délicieusement gratiné.
Nikki monta les Swell Maps en 1977 avec son petit frère Epic. Ils réussirent à mixer l'hypnotisme du rock allemand de type Can avec la grandeur juvénilement baroque du glam anglais. Démarche particulièrement osée. Mais quand on écoute «Let's Build A Car», on voit immédiatement que les deux frères savaient taper dans le mille. Dès l'intro, ce morceau d'anthologie sonne comme un classique, wham bam, tempo solide, bien énervé et bardé d'accords têtus. En construisant leur teuf-teuf, ils cassaient la baraque.
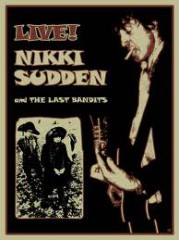
On tombe ensuite sur une balade fantastique, «Channel Steamer», une pièce de belle pop éclairée de l'intérieur par de fabuleux accords scintillants, toujours montés sur un tempo dru, soutenu et tendu à l'excès. Justement, ce contraste cavalcade/accords lucioles fait la force du morceau. Une voix féminine se mêle à celle du grand Nikki qui chante du nez avec application.
Avec les Jacobites et Dave Kusworth (cool clone de Keef) Nikki va s'adonner au culte des Stones. «Big Store» est l'épaisse balade par excellence, typique de l'ère jacobitique. Rien de très novateur chez les Jacobites, mais on se régalait de ce gros fourbi d'accords anglais, de cette vasouille électrique parcourue de lignes de basse extravagantes. Nikki nous proposait alors du grand art fiévreux. Lui et ses amis donnaient l'impression de s'amuser dans le fog et le vasouillard finissait par générer de la puissance, du plaintif princier, des éclats de dandysme. Une silhouette émergeait de ce brouillard électrique : dents de lapin et chapeau de perlinpinpin.
Le problème avec ce genre de disk est qu'on frise rapidement l'overdose. Sandercock veut notre peau ? On en arrive à se poser la question. Un disk aussi dense, ce n'est pas humain, comme disent les membres d'équipage dans «Alien».
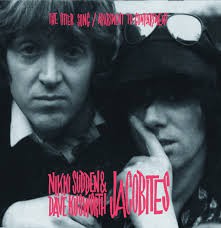
Crac, on tombe sur un truc qui s'appelle «Pin Your Heart», une nouvelle pièce de pop inspirée et visitée de l'intérieur par ces accords lumineux dont Nikki détenait le secret. Ce démon connaissait toutes les ficelles. Pour lui, les mots pop et génie restaient indissociables. Les micro-radiations émises par ses accords titillaient nos pauvres bulbes rachidiens. «When The Rain Comes» produit encore plus de dégâts épidermiques. Ce morceau est tout simplement monstrueux d'élégance poussive. Nikki fabriquait ce qu'on pourrait appeler des hits percutés. Il maîtrisait l'art secret du riffage descendant et savait tresser des pagailles d'accords sévères. Il était devenu le grand spécialiste des solutions avantageuses et parfois explosives, d'autant plus explosives qu'elles semblaient impromptues. Et on retombe sur cette monstruosité qu'est «Great Pharaoh», tirée de l'album «Groove». Hit subliminal destiné à hanter l'inconscient collectif. Voilà une pièce de vrai rock anglais : pleine comme un œuf et allumée. Une perle noire de la mer rouge, brillant d'un éclat lunaire dans la paume de l'Henri de Monfreid de l'underground. En d'autres termes, du speed noir dans l'écrin rouge du rock anglais. Nikki se glisse dans la loco. Il prend les commandes nasales de cette alchimie d'accords mercuriaux et se plait à provoquer des petits incidents dans le stream rythmique. En 1989, il disparaissait déjà dans les limbes, emporté par les vents mauvais levés sur sa guitare.
On se plaint de la densité du disk 1. Horreur et damnation ! Le disk 2 guette l'amateur comme le vautour perché au sommet du cactus. Le jeu va consister à ressortir vivant de cette nouvelle épreuve. Rarement, dans une vie d'amateur, on aura l'occasion d'écouter un disque aussi dangereux pour l'équilibre mental. On passe du double concentré au triple concentré apocalyptique. Franchement, personne ne vous oblige à écouter ce disk 2. Conseil d'ami, refermez le coffret pendant qu'il est encore temps et penchez-vous sur un cas plus charitable.

Mais si par malheur, vous décidez de braver le danger, alors voilà ce qui vous attend. Savez-vous ce qu'est une balade rouillée ? Non ? Alors écoutez «Whiskey Priest», morceau amené par une intro de guitare monstrueuse. Une de plus. Ce chef d'œuvre d'anticipation oxydée est monté sur un concept imparable : le génie du son. C'est électrisé à la folie. Râpeux, dense, équipé d'une palanquée d'accords sorciers et doté d'un final de boisseaux d'accords éblouissant. On tombe un peu plus loin sur une autre énormité tirée de l'album «Egyptian Roads», «Love Nest». On retrouve ce cocktail capiteux d'accords fouillés et sévères, et comme un oisillon dont la tête sort du nid, Nikki piaille l'orgasme, plaçant des ohhh et ses no-no-no dans le creux de hoquets libidineux. Une basse ronde embarque cette valse ohhhh/no-no-no impudique, à coups de reins puissants et dans la fièvre pulsative.
Tiré de l'album «God Save Us Poor Sinners», «Wishing Well» est un morceau digne des plus grands hits de l'histoire du rock anglais. Baladif et finement teinté d'orgue, ce morceau offre la combinaison idéale d'émotion et d'accords. «Cloak Of Virtue» renoue avec les grandes heures de la power-pop anglaise. Nikki tape dans le dur avec cette pièce hallucinante de classe et de verdeur, il entre dans le lard du cut avec son kit de canines. La chose se veut aussi grandiose que démente. Nikki, puissant sorcier, dieu du feu et des guitares travaillées, tendu jusqu'à la mort, yeah, comme il dit juste avant un gros solo enrhubé et plein de morve distordue et ça dégouline encore et encore. Nikki savait emmener les gens très loin en mer. Avec «So Many Girls», il dame le pion aux Stones. Nikki solaire nous frappe du sceau de ses intros et nous balance le hit que les Stones ont toujours rêvé d'écrire. On entre là dans l'âme du rock anglais pur et dur. Ça bat du tambour, on voit filer cette énormité cavalante qui ploie sous des tonnes de distorse. Le solo éclate au soleil de l'Égypte antique, comme dans un film de Kenneth Anger. Les rayons dardent dans tous les coins. C'est là que Nikki embarque généralement les imprudents. Pas de retour possible.
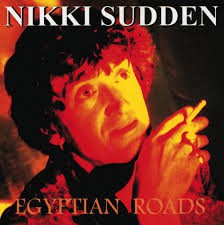
Entendrez-vous des trucs de cet acabit ailleurs ? Of course, no.
«House Of Cards» est le prototype du morceau trop beau pour être vrai. Voilà une chose si puissante, si musculeuse, si admirable qu'on refuse de croire qu'elle existe. Comme le désormais mythique «Green Shield Stamps», «Empire Blues» sort aussi du dernier album de Nikki (The Truth Doesn't Matter - très chaudement recommandé). Voilà encore du stonesy à la sauce Sudden : l'éclat des Stones et toute la vélocité keefique, mais avec une autre voix, celle de Nikki, le transgresseur de mythes, l'homme à la voix de nez, le ressusciteur de légendes, le réinventeur des Stones, de Dylan et de l'extase. Nikki Sudden œuvrait au plus haut niveau de la hiérarchie du rock anglais mythique, ne l'oublions pas.
Bonne nouvelle : le disk 3 («Old New, Lonesome and Blue») est plus tempéré. Ouf ! Sandercock propose un choix de morceaux issus de toutes les époques. Ce brave disk regorge de balades. La seule chose qu'on pourrait reprocher à notre kiki est son goût immodéré de la balade et donc une certaine forme de romantisme pleurnichard. Mais attention, tout de même : on croit souvent entendre des chansons affreusement mélancoliques évoquant des chagrins d'amour. Il s'agit plus sûrement de chansons dédiées à son frère Epic, tragiquement disparu en 1997. Nikki ne s'est paraît-il jamais remis de la mort de son frère. D'ailleurs, comment peut-on survivre à la mort d'un frère, quand on en a qu'un ?

L'autre grande particularité de Nikki Sudden fut sa propension à multiplier les collaborations. Le disk 3 illustre cet aspect en proposant une série d'enregistrements collaboratifs avec des gens connus comme Dimi Dero, Peter Buck, Max Décharné, Mike Scott (Waterboys) et d'autres moins connus comme DM Bob (héros Crypt) et les Creeping Candies, basés à Berlin, où s'était installé Nikki pour les dix dernières années de sa vie. Justement la version de «In Your Life» enregistrée avec les Creeping Candies nous met tout de suite l'eau à la bouche. Cette belle version sonne comme un hit destroy oh-mon-noï-noï saucissonné par une nappe d'orgue révolutionnaire. Cela donne un environnement surréel traversé par des soucoupes volantes et des grandes roues de fête foraine. Ambiance garantie, comme disent les rabatteurs. Avec DM Bob, héros cryptien du primitivisme expatrié, Nikki enregistre un superbe «Laudanum Blues» qu'on imagine levé comme un verre à la mémoire d'Artaud le Momo. Cette supercherie nikkitique s'étale évidemment dans une ambiance spectrale.
Max Décharné et Nikki enregistraient parfois des morceaux tous les deux. Max pianotait et Nikki grattait sa guitare. Alors voilà un témoignage de ces temps bénis : «Something About You», une pièce grattée et radieuse, qu'ils gavent de feeling comme on gave une oie. Max joue ses gammes au fond de la pièce dans une ambiance fabuleusement évanescente. Le disk 3 est rempli de témoignages de cette espèce.
Quand il va enregistrer des trucs chez ses copains de REM à Athens, en Georgie, le son s'enrichit de banjos et de violons. Le résultat est toujours aussi inspiré. Sur «Little Venice», Nikki chevauche le gros tempo avec une aisance sidérante. Pièce de rock stonesy en diable, élégante et pleine de vie, dont la pointe bien durcie vise tous les avenirs du monde. Comme à son habitude, Nikki remplit le morceau de guitares à ras-bord.
Avec les trois autres disques, Sandercock met la paquet sur le baladif mélodique. On va friser une autre overdose, celle du grattage de guitare acoustique. Mais au milieu de cette débauche de romances éthérées se nichent quelques précieuses pièces de rock nikkitique, comme par exemple «The Jewellery Quarter», grosse ballade dodue montée sur une structure ultra-saturée et enregistrée avec des amis tchèques. On renoue avec son élégante manière de s'absenter avant un solo, lorsqu'il lâche un Oh-ohh bien senti. Si on aime sentir la puissance sous la peau du rock, il faut écouter ce genre de truc qui frise la perfection. On aura même droit en prime à un solo de sax jeté dans la fournaise et qui semble pousser le morceau dans ses retranchements. On sent rouler les vagues d'un océan hugolien. On sent rugir une sorte d'Etna sonique capable de crever le ciel. Nikki Sudden connaît les arcanes du subterfuge pulvérisateur. Dans «All My Sinking Ships», embarqué par le vent mauvais du matraquage d'accords, il prend le dernier couplet en Français, histoire de rappeler qu'il a vécu ici à une époque. «J'avais seulement 17 ans...» Monté sur le balancement d'accords habituel, «No Broken Hearts» tend vers le sublime. Nikki y porte le sceau du prince. Encore une balade digne du Dylan de la grande époque. Il y circule un énorme flux émotionnel hors du commun et c'est peut-être là le signe distinctif le plus marquant de l'art de Nikki Sudden.
Avec l'ami Max, il balance un «Sea Dog Blues» punky, chanté à perdre haleine, bien accroché au cou du beat. Dave Kusworth rejoint Nikki pour «Gold Painted Nails». On retrouve la grosse équipe jacobitique, l'un des trésors cachés de l'histoire du rock anglais, faut-il le rappeler ? Voilà un morceau efficace et fabuleusement agité qui dégage bien les bronches. On entend dans le background des accords cariés et comme à son habitude, Nikki déroule les couplets avec une hauteur distinctive. On note au passage la pureté du son de basse, d'un caoutchouteux incroyable. La vitalité de ce morceau fait rêver. On se délecte de ce gros fouillis à l'anglaise où tous les instruments gigotent. Voilà ce qu'il faut bien appeler un classique de la subversion carabinée, comme dirait Noël Godin.
Le disk 5 s'appelle «The Dark Ends And The Dives». Avec «Looking At You», Nikki lâche les chiens. Il pratique une sorte de riffage désosseur. «Oh !» Il semble toujours surpris au carrefour de ses couplets. On ne s'en lasse pas. Il réussit à faire passer ses petits Oh et ses petits Ah pour de la candeur. Nikki Sudden est l'artiste vivant par excellence.
Avec «Don't Look Back», il renoue avec le glam et les accords hoquetés. On retrouve là tout ce qu'on adorait dans le gros glam anglais : le son plein d'accords gras, de belles lignes de basse baladeuses. C'est riffé à la Bolan, sur un tempo soigneusement retenu, avec un petit break en suspension, un solo classique. On est en Angleterre les amis, et c'est comme ça que ça se danse, là-bas. Pour «Wooden Floor», Nikki nous propose un modèle de baladif descendant. Son «Aeroplane Blues» sonne comme un cut des Cramps, ce qui va en dérouter plus d'un. Avec «Stay Bruised», ce coquin de Nikki nous embarque une fois de plus dans la magie bleue de son art baladif.
Mais quand on écoute les paroles de ses chansons, on sent qu'il reste très en deçà d'auteurs comme Dylan ou Nick Cave. À quelques exceptions près, les textes de Nikki sont très basiques, et donc relativement faciles à comprendre. Il ne cherche pas à ensorceler par le texte, il se contente d'organiser des ambiances de rêve. L'épidermique plutôt que l'intellect.
Un peu plus loin se trouve une pièce énorme, «Take Me Back Home», gros boogie rock démolisseur et bardé d'accords glam. Take me honey ha ha ! C'est le Nikki qu'on préfère, celui qui va réveiller les morts dans les tranchées. C'mon walk in my shoes, Walk down the street et la boucle est bouclée.
Le disk 6 et le disk cadeau («Still Full Of Shocks») sont destinés aux amateurs de balades acoustiques. C'est bourré de grati-grato et de belles mélopées plaintives. On retrouve ses solides lampées d'accords pépères («When Angels Die») et de belles pâmoisons emmenées à toute berzingue («In Your Life»), où il geint divinement : How much I love you, How much I care, Ahhhh. «Marcella» sort aussi du lot avec son pianotis, son solo à la ramasse et sa dégoulinade de mandoline. Morceau épais en diable.

C'est au grand Georges qu'on doit le plus bel hommage à Nikki : «Oui, mais Ô grand jamais son trou dans l'eau n'se r'fermera. Cent ans après, coquin de sort, il manquera encore.»
Signé : Cazengler, niqué par Nikki
Nikki Sudden. The Boy from Nowhere Who Fell Out Of The Sky. Coffret 6 disques Easy Action 2013.
PARMAIN / 21 – 09 – 13
SALLE JEAN SARMENT
TATOO CUSTOM FESTIVAL

Sont peu oisifs dans l'Oise. Sont toujours en train d'organiser des festivals. De country, de vieilles voitures, de rock'n'roll, ne compte plus le nombre de fois où la teuf-teuf mobile navigue en pleines forêts domaniales ou sur les crêtes de collines verdoyantes. Ce coup-ci elle fait un peu la gueule lorsque l'on arrive à Parmain. Non et non je ne vais pas lui faire repeindre la carrosserie en peau de léopard pour qu'elle se voit attribuer le premier prix de la voiture rockabilly de Seine & Marne. Alors quand elle voit le lot de vintages américaines stationnées devant sur plusieurs centaines de mètres devant la salle Jean Sarment, elle boude et refuse de se ranger à côté d'une impressionnante collection de hot-rods. Mais en fait elle partage mes goûts, de toutes les belles mécaniques astiquées elle préfère la vieille ID pourrave qui a dû rester trente ans au fond d'un poulailler. Vraisemblablement le modèle qui se transformait à l'époque en ambulance grand luxe et qui aurait bien besoin d'un séjour à l'hôpital pour ravalement esthétique. Ben non, ses heureux propriétaires se sont contentés d'inscrire sur la portière avant Wild Goners et il faut reconnaître que ça vous a un de ces airs Rock'n'roll Sauvage des plus appropriés. Quand l'emballage correspond au contenu, c'est bon signe.

N'y a pas que des toto-mobiles, toute la gamme Harley est là et que je me la bichonne, et que je me la ripoline, et que je me l'enrubanne, et que je me la turbune, des bikers à la douzaine comparent leurs souveraines montures. Peu de Triumphs, qui pour moi est la moto rock par excellence, mais ceci est un avis personnel qui ne fait pas l'unanimité. Inutile de vous cotiser pour m'en offrir une, depuis dix ans que je l'ai je n'ai encore jamais lavé le pare-brise de la teuf-teuf. Je ne partage point les coutumes des customers.
Connais pas l'architecte de la salle Jean Sarment, mais ce ne devait pas être le gars obsédé par la sécurité, la porte d'entrée est aussi étroite que la bouche d'aération d'une fourmilière. A l'intérieur les aiguilleurs s'affairent. Pas du tout une expo de vieilles locos en état de marche. Ici tout est tatoo. Pas du tout tabou, mais très totem. Des corps à moitié nus sont allongés sur les tables et les bourreaux sont à leur poste. De loin l'on se croirait à un congrès de médecine douce, mais ici les acupuncteurs sont armés de véritables aérographes et ils vous trouent la peau en couleur. Le tatouage c'est un peu comme le suicide – il y en a de beaux et d'autres ratés – mais une fois que vous avez franchi le pas fatidique, l'est impossible de revenir en arrière. A la vie et à la mort. C'est une opinion somme toute égotiste, et je reconnais à tout un chacun le droit de se transformer en gravure vivante. En plus transporter ses propres estampes japonaises sur soi permet probablement de montrer l'intégralité de sa collection séance tenante, sans avoir à proposer un ultérieur rendez-vous aléatoire. Faut battre le sexe quand il est chaud.
AUTRES CONSIDERATIONS
Les Jallies passent en début d'après-midi à quinze heures, bien trop tôt surtout que les concerts ne reprendront pas avant vingt heures trente. Un grand trou tout de même. Je sais bien qu'il faut faire vivre le petit commerce – disques spécialisés et chiffons divers ( et d'autres saisons ) mais je suis de ceux qui pensent que l'économie ne doit pas primer sur l'artistique... En plus une petite heure supplémentaire allouée d'entrée à Blue Cat, le disc-jokey, ne l'aurait pas gêné. Vous verrez pourquoi tout à l'heure.

Pas assez de monde au concert des Jallies, premièrement parce que la foule commencera à affluer lorsqu'elles auront terminé, deuxièmement parce que le public visé est celui, familial qui vient avec les enfants pour admirer les grosses voitures... L'on a d'ailleurs concocté un billet d'entrée à cinq euros pour drainer ces visiteurs curieux mais pas spécialement amateurs de rock'n'roll. Rentreront pour le repas à la maison et se vautreront devant la télé après le miam-miam, car les concerts du soir ne feront pas non plus le plein qu'ils auraient mérités...
THE JAILLIES

Sont sur scène depuis dix minutes lorsque j'arrive – je remarque qu'elles ne m'ont pas attendu – et tout de suite les gambettes de Vanessa. Que voulez-vous, ce sont les Jallies, mais aussi des femmes. Ont d'abord fait les emplettes. Robe entre bleu marine et noir coque de bateau pour Ady, derrière sa Gretsch ça lui file un petit air sérieux de capitaine prêt à ordonner la manoeuvre sur la passerelle. Vaness, l'insupportable moussaillon au sourire irrésistible a enfilé un short, la lumière des projos joue aux ombres chinoises sur ses jambes gainées de transparence. Un flux de reflets chatoyants à vous faire oublier qu'elle chante. Et plutôt bien avec son timbre de voix oblitéré d'une raucité des plus sensuelles.

Céline a gardé sa tenue de pirate préférée – aussi à l'aise sur la vaste scène que le Capitaine Flint en plein abordage entre les pointes des sabres et des boulets de canon. N'hésitera pas à préparer sur sa fender un poisson rouge à la Hendrix. A la sauce Jallies certes, mais encore faut-il que ça passe sans que ça casse, car elles adorent reprendre des monuments et les relooker à leur manière, sans prêter à rire et à sourire. Nos jeunes filles construisent un son distinctif qui leur appartient en propre. Et cela se remarque aussi sur leurs morceaux originaux qui possèdent eux aussi leur petite musique pour parler comme Céline, pas la corsaire, l'autre, celui du Bout de la Nuit et du Pont de Londres.

Une pensée pour le pauvre galérien, Julien au quatrième arrière-plan enchaîné à sa contrebasse qui à la moindre velléité d'expression se verra renvoyer à fond de cale par ses gardes-chiourmes au coeur aussi dur que l'étrave d'un destroyer. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas accès à la parole qu'il ne s'exprime pas, pour se venger il nous fera sur Johnny Gots a Boom-Boom d'Imelda l'Irlandaise, un accompagnement tonitruant d'une violence extrême. Le swing et le punch servis sur le même plateau, une frappe avec victimes collatérales innombrables, une série de déflagrations volcaniques comme l'on n'en entendra pas la moitié d'une le reste de la soirée, qui je vous l'assure ne fut pas servie par des manchots du manche. Même les parturients sur leur table de torture – à qui les maîtres tatoueurs recommandent une immobilité absolue – n'ont pu s'empêcher de battre des mains pour témoigner de leur auditive satisfaction.

Je les plains. Comment rester immobile lorsque Ady pousse ses hurlements de louve solitaire, les soirs de pleine lune, je ne sais pas pourquoi mais Johnny Burnette a l'air de particulièrement l'exciter. Heureusement qu'il est mort le grand Johnny car j'aurais peur pour lui si vivant il était tombé entre les pattes carnassières d'Ady. Vous le déchiquèterait en cinq sept. En grande forme Ady, elle nous a balancé un Swing des Hanches grand luxe, pardon de grande luxation.

Ca commence à chauffer salement lorsque l'on sent du tirage sur la montée de scène. C'est Blue Cat qui est pressé de passer ses disques. Bref – je recommande au lecteur de bien mesurer la justesse de cette expression que beaucoup de gratte-papiers emploient à tort et à travers, car ici ce n'est pas du tout le cas – le set sera écourté. L'on allait accéder au sommet de la montagne et il faut redescendre à la maison pour battre les oeufs en neige. Et en plus on est privé de dessert.
LA VENGEANCE
Sortent de scène, sous les applaudissements, mais puisque l'on ne les veut pas dedans elles iront dehors. M'attarde un peu pour visiter les caisses d'Hichem, je ne vous dis pas ce que j'y ai trouvé car vous viendriez me cambrioler à mon domicile. Une curiosité tout de même, pour Mister B qui n'a pas pu m'accompagner, un truc étrange venu d'ailleurs ( du Danemark, sans autre indication ) un picture-disc en noir et blanc d'Eddie Cochran en une matière indéterminée, carton ou plastique, va falloir procéder à des analyses. En existe toute une série sur quelques grands pionniers du rock.

Bref ( vous remarquerez qu'ici l'auteur emploie cette expression sans qu'elle soit expressément motivée par la logique du récit ) je sors confier mes petits trésors à la teuf-teuf lorsque mon regard est attiré par un grand attroupement de plusieurs centaines de personnes. Impossible de savoir ce qui se passe. Je joue des coudes et je parviens non sans mal à me rapprocher du coeur du mystère. Y a encore une cohorte de photographes et de vidéastes qui s'interposent, je franchis ce dernier barrage pour, miracle ! apercevoir nos Jallies sur leur char de triomphe. Un gros pick up qu'elles occupent avec caisse claire, contrebasse et Julien ( au fond, pour qu'il n'apparaisse pas beaucoup sur les photos ).

Voudraient bien redescendre, mais la foule l'interdit. Des stars menacées par l'émeute. Alors a capela, sans électricité elles entonnent deux morceaux, le premier dans un silence religieux et le second très vite repris par l'assistance. Mais ne s'en sortiront pas encore. Toute la population mâle présente décide d'avoir sa photo personnelle sur le pick up avec les Jallies. Des fous furieux qui n'ont pas assez réfléchi au sort peu envieux de contrebassiste qui les attendrait si affinités musicales se présentaient... La séance portrait dure si longtemps que je les abandonne à leur triste sort. M'en vais visiter un stand de wild records. Si vous tenez à l'affection de votre banquier, vous éviterez.
Dedans, dans la salle désertée, sur la sono, Blue Cat continue de passer ses disques.
THE WILD GONERS

Les Wild Goners sont sur scène. L'on n'attend plus qu'eux, c'est que Blue Cat a encore un disque à balancer. Condescend enfin à descendre de derrière son pupitre pour laisser les garçons sauvages se livrer à leurs turpitudes favorites. Et habituelles, car on nous le répètera plusieurs fois au micro, fêtent leur vingt ans d'existence. Contents d'être arrivés jusque là, malgré une interruption de cinq longues années, mais pas plus fiers pour cela.
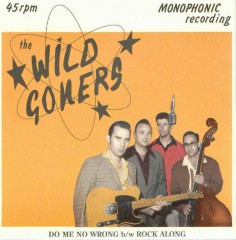
C'est un plus l'expérience, ont traîné leur rock sur toutes les scènes européennes, ont joué avec Billy Lee Riley, ce qui vous classe un homme définitivement - dans le haut du panier - se préparent à partir en tournée aux States, mais si la pêche – très juteuse – est encore dégoulinante, les chevaux grisonnent et comme l'avouera en grimaçant Olivier « Dans vingt ans, je ne sais pas si nous serons encore là ».

A part ça, on ne peut pas dire que ce soit un grand bavard Olivier, quand il parle, donne plutôt dans la concision, il ôte le médiator de sa bouche, dit « Merci ! » aux fans qui exultent de joie, et il lance le morceau suivant à toute allure. Sont disposés en carré parfait. Freddy à la guitare et David à la batterie. Les deux autres ne leur posent pas trop de souci. Ne se quittent pas des yeux et chacun regarde l'autre pour voir s'il peut relever le défi du genre si tu peux faire plus vite et plus fort, ne te gêne pas. Et je vous jure que le sagouin ne chôme pas pour pousser la mise en avant. A eux deux ils abattent un boulot monstrueux.

Bétonnent dur. Une guitare à la Cochran et une batterie qui s'introduit de force dans les interstices pourtant très étroits. Un peu monotone au bout d'une heure, mais terriblement efficace. Ne tombent jamais dans le haché menu des groupes Ted, car ils ont compris que le secret ultime du rythme résidait dans la non fragmentation du flux combiné de leurs deux énergies combinées.

Du coup, l'autre partie de l'équipe carracole sur l'imprenable chemin de garde. N'ont pas terminé trois morceaux que déjà Laurent est couché à terre comme s'il était tombé de sa contrebasse. Ce n'est pas un accident, mais une volonté délibérée d'augmenter la pression. Tisse des dentelles et des filets de protection avec les cordes de sa basse. Ce qui permettra à Laurent de se rappeler dans la deuxième partie du set, qu'en plus du mur du son qu'il n'arrête pas de construire, il a le droit lui aussi de tricoter quelques enjolivements du meilleur aloi.
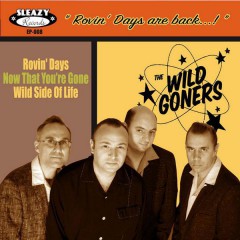
J'en parle en dernier, mais ce n'est parce qu'il en fait moins que ses trois congénères. Serais même tenter d'affirmer qu'il bosse deux fois plus que les autres dromadaires. Car il chante et il tient la rythmique. La guitare quasi à hauteur d'épaule. L'utilise comme un allume-gaz. Plutôt d'un allume-mèche parce qu'il se sert de sa voix comme d'un chalumeau. Voire d'un lance-flamme. Pyromane et pas du tout pompier. C'est le chant qui propulse le groupe, le tire en avant et le projette au loin.

L'est tellement pressé de chanter que lorsqu'il essaie de présenter ou de dédicacer un morceau, il bouffe si fort la moitié de ses mots que l'on n'a pas fini de réaliser ce qu'il a voulu dire qu'il a déjà expédié la moitié des lyrics du titre promis. Heureusement que le public connaît la discographie du groupe, car beaucoup reprennent en coeur en trépignant sur scène. Manifestement beaucoup les suivent et se sont déplacés pour les Wild Goners. Avec raison, car le groupe assure un maximum. Du métier, et mieux que tout : du plaisir de jouer. Vingt ans, pas question de les laisser s'égayer dans la nature, va falloir leur infliger la double peine.
Sortent sous les acclamations.
SURE-CAN ROCK
Peu de monde les connaît dans la salle. Blue Cat n'a pas l'air d'avoir pris le temps de regarder sur You Tube, voire, must du must, de lire la chronique de Cat Zengler de la livraison N° 154 de KR'TNT du 05 – 09 – 2013. Montent sur scène pour la balance. Inutile d'étudier les cours de la bourse sur le Figaro pour tuer le temps. Ces anglais ont une vision redoutablement simplificatrice de l'équilibrage sonore, douze secondes pour la basse – celle des Wild Goners – un seul mot pour régler la situation : « Higher ! », pour le suivant l'en faudra dix-huit c'est qu'il y a une double charge de travail, faut monter le potentiomètre de la rythmique et de la voix, en plus il renseignera du même coup pour la batterie, faut envoyer un peu plus de jus dans les retours de la guitar et de l'up-right, quant au guitariste l'a l'air de s'en foutre comme du premier ukulélé en matière plastique que sa vieille grand-mère lui avait offert pour ses quatre ans et demi, ne touche même pas à son instru, se contente d'un signe excédé de la main, comme s'il était nécessaire de se lancer dans une conférence de presse pour comprendre qu'il faut aussi augmenter le volume sonore !

J'ai oublié de dire que pour opérer cet assemblage de haute précision décibélimétrique ils ont ordonné à Blue cat d'éteindre son infernal tourne-disque. S'est exécuté la mort dans l'âme. De temps en temps spasmodiquement son bras se tend vers une pochette mais par un effort inouï de volonté il parvient à réfréner son désir inextinguible. Les Sure-Can Rock sont prêts à donner l'assaut. Scott accroupi dans la batterie ( celle des Goners ) comme un guerrier apache descendu de cheval pour mieux voir le bataillon des tuniques bleues qui s'enfonce dans le défilé de la mort, Jeff prêt à enfourcher la contrebasse étalon afin d'apporter la bonne nouvelle au Conseil de guerre, Boz qui regarde le manche de sa guitare comme s'il s'agissait d'une winchester à répétitions, et le grand chef, Wild Jack, le petit doigt sur le mi de la guitare prêt à donner l'assaut. Sourires mauvais aux lèvres. Et de un, et de deux et... Blue Cat profite de ce que personne ne le regarde pour lancer sa platine. Wild Jack le scrute incrédule, des lueurs de scalp doivent danser dans ses pupilles puisqu'un organisateur accourt sur scène et fait signe que Blue Cat a encore deux disques, uniquement deux, à passer. Mais le grand Sachem refuse catégoriquement et pour ne pas se lancer dans un discours inutile, il frappe la première note du set qui retentit comme un coup de feu annonciateur de grande furie.

Et alors ? Fureur rouge, folie noire, et terreur blanche se sont donnés rendez-vous sur scène. Les dieux sont descendus parmi nous et nous avons connu la splendeur des carnages gratuits. Un coup, un seul, sur le tambour des Goners et la panoplie s'est désarticulée en son entier, les peaux aussi inclinées que le Titanic deux minutes avant d'être aspiré dans les abysses de l'Okeanos. Le danger ne traumatise pas Dave, remonte la quincaillerie d'une main pendant que l'autre il alimente la galopade.

Souvenez-vous qu'il existe deux sortes d'anglais. Ceux qui tricotent de la layette pour les petits-enfants de la Reine tout en dégustant a delicious cup of tea at five ô clock, puis les autres qui eux se contentent de rocker comme des diables rouges around the clock. Les sociologues auront tendance à classer Wild Jack dans la deuxième catégorie. « You know I walk the line ? Johnny Cash ! » Tu parles si on connaît Johnny Cash, et vlang il nous offre sa version de la plus célèbre chanson de Johnny Cash, Folsom Prison Blues. En force. Peux jurer que trois minutes après il ne reste plus une seule pierre du pénitencier. L'a foutu par terre, l'a libéré les taulards, l'a égorgé les pigs. Les Sure-Can Rock ne font pas de prisonniers !

Nous refait le coup avec Gene Vicent deux morceaux plus tard : « You like Gene Vincent ? » le genre d'évidence qui ne se pose pas. C'est le moment de ne pas lâcher des yeux la guitare de Boz Boorer. Prend le défi gallupien avec flegme. A ce moment-là du show je puis vous assurer que je joue à moitié aussi bien de la gratte que Boz. Je ne plaisante pas, je peux vous le montrer sur une partoche. Parce que Mister Boorer, il a une manière toute particulière de malmener sa chérie. Vous cisaille un solo de vingt secondes aussi coupant que du Gallopin' Clif , puis après il lève les mains – c'est exactement à ce moment-là que je suis aussi bon que lui – et durant vingt secondes il ne fout plus rien. N'en profite même pas pour se commander un café au bar. Et vloumg il vous remet un carton en pleine gueule qui vous crispaille les amygdales et la carotide. Ce doit être un intermittent du spectacle. Et teigneux avec ça dans son costume de préparateur de pharmacie. De mauvaise humeur, désagréable, c'est lui qui concocté la potion qui a tué tous les chats du quartier. Le flippé, à la mauvaise gueule. Oui, mais il envoie grave. En discontinu. De toutes les manières vous ne supporteriez pas le cent pour cent.

Suis un peu surpris quand il ordonne à Wild Jack de ramener sa rythmique au clou. Faut dire qu'il l'a salement malmenée, n'a plus que quatre cordes et qu'ils se débrouilleront aussi mieux. Le grand Jack a l'air plutôt content, s'empare du micro et continue son tour de chant sans regret. N'en ai pas pour autant eu l'impression que le Boz il touchait davantage ses cordes, mais il intervient si systématiquement au moment exact où vous avez besoin de lui qu'il se fait moins attendre que désirer.

Sinon, ça filoche de tous les côtés, Scott finira pratiquement à quatre pattes pour récupérer sa grosse caisse qui se barre en douce, mais nous le répétons ce n'est pas pour si peu qu'il faudra noter une baisse de la qualité sonore de sa frappe, Jeff slappe dans son coin, sans désemparer, turbine électrique sans a-coup d'une rageuse régularité confondante.

Et Wild Wild Jack qui porte le groupe sur ses épaules de montagnard et sa voix de stentor. Une heure d'incandescence incomparable. Du sang, de la sueur et des larmes. De joie. Le rock and roll comme on l'aime, hound and hot, servi bouillant. Epoustoufflant.
TEXAS STEVE AND THE TORNADOS
Après les français et les anglais, voici les américains. Préjugé favorable. C'est chez eux que le rock a été inventé. Quatre grands gaillards sont sur scène, ont déjà démarré alors qu'au micro l'orga annonce qu'ils commenceront après les démonstrations de motos, dehors. Même position que les deux groupes différents, le chanteur à la rythmique devant, le batteur dans son axe derrière, la lead guitare sur notre droite, et la contre basse sur notre gauche. Le carré parfait qui se profile sur son angle.

Les trois premiers morceaux ne sont guère convaincants, je ne sais si cela provient de la sono ou des cordes vocales du chanteur qui ne sont pas assez chaudes, mais la voix est en totale disharmonie avec le background musical qui fait un peu purée. Les choses vont s'arranger très vite et une chose est sûre, ce sont de sacrés musiciens. Sur sa lead Matt Pavlocic vous festonne des ciselures les mieux venues, l'est tout jeune et l'on sent qu'il a encore de la marge pour progresser. Un gars à suivre. Penché sur sa basse, protégé par sa barbe, Pat Kowslski a davantage le look d'un étudiant que d'un rockabilly man, mais il est sûr qu'il sait se débrouiller. Matt Pavlovcic s'en tire plus que bien avec sa batterie qui s'éloigne de lui à chaque fois qu'il tape dessus. Z'ont un son.

Mais pas l'image. Steve Horsik chante bien et gratte bien. Mais il est statique comme un plant de maïs que le vent ne balance pas. De bons élèves, des premiers de la classe. Copie impeccable, sans une rature. Mais après le débraillé génial des Sure Can Rock, il manque toute une dimension. Les british ils nous ont dessiné des pare-choc de cadillacs roses dans les marges et des poitrines de bimbo rebondies dans le coin des pages, et c'est nettement plus excitant. Avec Texas Steve and His Tornados la magie du rock'n'roll s'est éclipsée. Même les Wild Goners nationaux issus de Bourges s'en sont mieux tirés que ces surdoués de ricains.
Auraient dû passer en lever de rideaux. Le public se raréfie. Je l'avoue à ma grande honte, je l'imite. Au bout d'une heure, ne voyant rien venir, je mets les bouts... Je crois pas que que le vent ait commencé à se lever et la tempête à se déchaîner après mon départ...
Damie Chad
PS : Blue Cat a tout de même une sacrée compilation de bons morceaux.
PS : on a pris les photos sur les facbook des artistes, les plus belles sont de EDonald Duck.
LES HITS DE HORTON HEAT
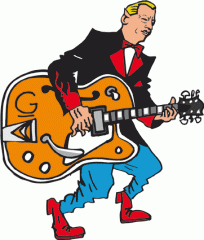
-- Alors, vous avez accompli votre devoir dominical ?
-- Hein ? Quoi ? Quel devoir dominical ?
-- Voyons, vous le savez bien... Tout bon chrétien doit verser l'obole au Révérend !
-- Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire d'obole ?
-- Oh, c'est très simple. Pour ne pas aller en enfer, vous devez verser l'obole. Et pour ça, pas besoin d'aller à l'église. Il vous suffit simplement de vous rendre chez votre disquaire et d'acheter le nouvel album du Révérend, «25 To Life». Pensez au salut de votre âme...
-- Ha bon d'accord !
Attention, il s'agit tout de même d'une grosse obole. Ceux qui voudront la version vinyle de «25 To Life» devront lâcher un peu moins de quarante euros. Même chose pour le petit coffret CD. Par les temps qui courent, ça s'appelle un suicide économique. Mais il arrive qu'on échappe à la mort quand on se suicide.
Incapables de trancher, certains voudront les deux, le vinyle et le coffret CD. Les deux sont bien, voilà le problème.
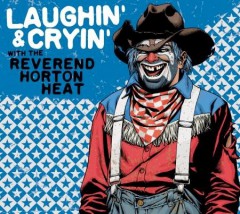
Le Révérend fête ses 25 ans de «carrière» au service du rockabilly qui est, comme chacun le sait, une preuve de l'existence de Dieu (certains diraient du diable, mais on ne va pas entrer dans la polémique aujourd'hui). Vous en aurez pour vos quarante euros, vous serez même particulièrement gâté : «25 To Life» est un double album live enregistré au Fillmore, accompagné du DVD du même concert et d'un livre somptueux d'une cinquantaine de pages retraçant l'histoire du trio. Voilà un ouvrage bourré à craquer de photos du saint homme et de ses apôtres. On démarre avec une série d'images envoûtantes en noir et blanc, dignes des grands portraits de Miles Davis ou de John Coltrane. S'ensuit une série d'images en couleur, plus classiques et plus anciennes. Certaines datent des débuts du Révérend, époque à laquelle il portait encore une casquette et des oripeaux du folklore hardcore. Le Révérend s'est heureusement débarrassé de ces tenues vulgaires. Puis on tombe sur une impressionnante série de reproductions d'affiches de concerts qui sont, comme chacun le sait, de véritables œuvres d'art moderne. Dynamiques, colorées et graphiquement parfaites, elles sont à notre époque ce qu'étaient à la Belle Époque les affiches dessinées par Toulouse-Lautrec : la pure expression de la modernité. Flammes des enfers, crânes, customs, cornes du diable, guitares Gretsch, dés, boules de billard, bouteilles d'alcool, tout l'attirail du sulfureux Révérend est là. On tient dans les mains un vrai livre d'art. À vous de choisir entre le petit format étriqué du boîtier CD et le divin format du vinyle. Choix cornélien... Le coffret CD propose en plus un CD Best Of du Révérend qui fait un peu double emploi avec la fantastique set-list du concert. Le plus simple, c'est encore d'acheter le vinyle et de voler le coffret CD. Votre disquaire n'ira jamais suspecter un fervent pratiquant.

Ce qui fait la force du livre, c'est le texte d'introduction, écrit de la main du saint homme. Voilà une véritable déclaration d'intention, digne du texte que rédigea Lux Interior pour «How To Make A Monster». Vous n'avez encore jamais vu une profession de foi ? C'est l'occasion rêvée. Il raconte qu'à 13 ans, il allait acheter ses disques chez Ashley en vélo. Il rentrait chez lui, tenant le guidon d'une main et des albums de Sonny Boy Williamson et de Buddy Guy sous l'autre bras. Il les usait jusqu'à la corde en apprenant à jouer les solos sur sa guitare. Tout à l'oreille. Il recommençait encore et encore jusqu'à ce que ce fût parfait. Le Révérend avoue humblement qu'il en a bavé, en 25 ans de «carrière». En cours de chemin, des copains et des copines l'ont abandonné, lui reprochant de s'être lancé sur une mauvaise piste. Le pauvre Révérend a croisé un sacré paquet de toquards, comme ces journalistes américains qui n'avaient jamais entendu parler du rockabilly et qui demandaient pourquoi Jimbo jouait sur un violoncelle. Il raconte comment, à une certaine époque, les gens se moquaient du rockabilly. Aujourd'hui, ils ne mouftent plus («People used to laugh at rockabilly. They don't laugh anymore»). Le Révérend a remis les pendules à l'heure. Des journalistes l'ont démoli, mais il est toujours là et pour lui, c'est une victoire. C'est bien le mot qu'il emploie : victory. Tous les amateurs de rockabilly devraient lire cette édifiante confession. Elle donne la chair de poule.
Comme Lux, le Révérend ira jusqu'au bout, il ne vendra jamais son cul. Il propagera la sainte parole jusqu'à la fin des temps.

On peut lire et relire son texte, mais le mieux, c'est encore de le voir jouer. En attendant de le revoir un jour monter sur scène, tous les fidèles devront se contenter du DVD. C'est mieux que rien, comme disait le capitaine à ce matelot qui boudait son biscuit grouillant de vers. Par chance, le concert est filmé par des professionnels. Ils ont touillé ça aux petits oignons. Ils nous restituent le set dans son intégralité. Il ne manque pas une seule goutte de sueur. En vérité, je vous le dis, frères de la côte, le saint homme joue au salon, rien que pour vous.
Il démarre son set avec «Bullet». Wouah ! Le Révérend porte une chemise de cow-boy noire à sur-piqûres blanches et un gros pantalon noir. Il envoie un gimmick menaçant et plaque des dégelées d'accords jazzy sur sa belle Gretsch orange. Jimbo slappe comme un psychopathe. Un instru pour la mise en bouche, pas mal. Derrière, Paul Simmons, chevelu comme un Californien, bat le beurre. En trois minutes, la messe est dite. Apprentis sorciers, n'en perdez pas une miette. Pendant tout le set, le Révérend va donner des petites démonstrations de virtuosité, mais sans la ramener (et sans faire les horribles grimaces qu'on voit apparaître sur les trognes de certains frimeurs qu'on ne nommera pas ici. Ne gaspillons pas la place).
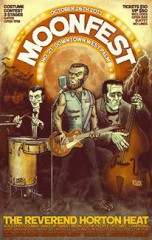
Il enchaîne avec «I'm Mad» et écrase le champignon. Le Révérend peut foncer à deux cent à l'heure et hurler comme Little Richard, ça ne lui pose aucun problème. I'm maaaaaaaad !!!! Il balance un solo de sorcière entortillé d'entrelacements inconnus. Il foudroie et hurle de plus belle. Il ne se roule pas par terre, mais on voit bien qu'il en crève d'envie.
Le film du concert est entrelardé de petites séquences d'interviews. Entre chaque morceau, on voit le Révérend, Jimbo et Paul papoter, assis tous les trois, bien sages, derrière une table. Ils portent des T-shirts noirs et s'abstiennent de faire rouler leurs gros biscotos. Pas la moindre trace de frime, ici. Nous ne sommes pas chez les Clash.
La version de «Big Little Baby» est bardée d'incursions fatales. Dans ce heavy blues qu'est «Loaded Gun», le Révérend raconte comment il se retrouve seul après avoir perdu sa petite famille à cause de l'alcool. Il se retrouve seul avec une Coronna dans une main, un verre de Gin dans l'autre et un 38 chargé (loaded gun) dans la poche. Situation désespérément banale, certes, mais il faut voir l'indécente qualité de l'interprétation.
Ce mec est tout simplement admirable, avec sa tête de menuisier des années trente à la retraite, bien peigné, la peau brillante, et à qui on donnerait le bon dieu sans confession.

«400 Bucks» est l'un des hits du siècle, annoncé par un gimmick de guitare imparable. Si on veut se faire une idée de la puissance biblique du Révérend, c'est le moment ou jamais. Il raconte qu'il file 400 dollars à sa copine pour qu'elle s'achète une bagnole. Mais cette salope retombe dans les bras d'un ex et le Révérend réalise qu'il vient de se faire pigeonner. Fou de rage, il se met à beugler : «Forty bucks, forty bucks/And you don't give a fuck/About my forty bucks !» L'animal fait rimer buck (dollar) avec fuck (fuck) ! C'est l'un des refrains les plus hystériques (et les plus tordants) de l'histoire du rock. Mêmes frissons qu'avec «Bird Doggin'», et c'est peu dire. Dans «The Devil's Chasing Me», le Révérend envoie un solo de jazz à faire blêmir Wes Montgomery. Il grimpe sur la contrebasse de Jimbo toujours occupé à slapper comme un psychopathe. Mais ce n'est pas fini : Jimbo lance sa contrebasse en l'air, à plusieurs mètres de hauteur, et il la rattrape ! On n'avait encore jamais vu ça. Encore plus cinglé que Krist Novoselic, le Croate de Nirvana, qui lui aussi envoyait sa basse très haut pour essayer de la rattraper, au risque de sa vie.

Les classiques s'enfilent tout seuls comme des perles, ils n'ont besoin de personne en Harley Davidson. «Martini Time» est une véritable pétaudière, ça swingue à mort. La mort, tiens, parlons-en ! Dans «Death Metal Guys», le Révérend raconte une histoire singulièrement morbide. Second couplet : il rappelle que Jerry Lee a buté son bassiste d'un coup de 38. Puis il prétend que les fans de death metal (s'ils avaient assisté à la scène) auraient dévoré le cerveau du mort. Chute du couplet : et les gens disent que Jerry Lee est un type malsain ! Guilleret, le Révérend envoie ensuite un refrain qui pourrait sonner comme un hymne : «I'm a rocka, I'm a rocka, I'm a rockabilly guy/And I don't eat brains, like death metal guys» (et je ne dévore pas les cervelles, comme le font les fans de death metal). Comme chez Lemmy, les textes du Révérend sont toujours soignés, drôles et lourds de sens. Justement, le Révérend chante parfois dans le même registre que Lemmy (invité dans le film), du haut d'une glotte flapie. «Spend A Night In The Box», c'est du swing pur jus. Les amateurs de western swing risquent l'overdose avec un shoot pareil. Le Révérend plie les genoux en jouant une intro d'orfèvre. Il retrouve le secret du son de Bill Haley & the Comets, puis il transforme l'exercice de style en pétaudière. «Galaxy 500», c'est l'enfer sur la terre. Une mélodie pop montée sur un V8 à 56 soupapes. Pop customisée, comme dirait le garagiste du coin de la rue. «Yeaaaaahhhh !» glapit le Révérend sous une pluie de notes. Les siennes. Hallucinant ! Il faut le voir pour le croire. C'est autre chose que de transformer l'eau en vin.
Lors d'un petit break, le Révérend avoue qu'il se croit maudit, parce qu'il n'a jamais eu de tube. Par conséquent, «No big stardom», comme il le dit si bien. Pourtant, nombre de ses morceaux sonnent comme des hits planétaires. Ce disque est bardé de preuves accablantes.

Et puis, on le voit bouger sur scène. Par le trimballement de sa carcasse, le Révérend incarne une sorte d'héritage hillibilly, rustique et appliqué à la fois. Admirez la sûreté de ses pas de danse et la courbure du cou lorsqu'il s'applique à jouer un solo. Vous serez ému en le voyant de dos, avec le cuir de la bandoulière passée sur l'épaule. Son côté artisan. Puis il rallume la chaudière de la locomotive avec «Indigo Friends» et un riff incendiaire qu'on dirait tout droit sorti du «Cold Turkey» de John Lennon. Ce morceau qui pue le garage est une véritable bombe atomique. C'est slappé jusqu'à l'os, pas le beau slap élastique qu'on entend chez Lew Williams, bien sûr, mais le slap de Jimbo, névrotique et jusqu'au-boutiste. Le Révérend rompt le charme à coups d'incursions jazzy. Dans «Psychobilly Freakout», il joue tout à l'arrache. Derrière, c'est battu à la diable, et on voit déferler des vagues successives de pure folie rockab. Il faut le voir gratter ses deux notes, avec l'aplomb d'un métronome, comme dans «Big Red Rocket» qui ferme le bal.
À la fin du show, vous vous retrouverez comme un con, assis au bord du canapé, les yeux ronds de stupeur et la bouche ouverte. C'est vrai, on ne croise pas tous les jours des artistes de ce calibre. Encore moins des rockabs de cet acabit.
En confiant le salut de votre âme au Révérend, vous ferez une excellente affaire. Croyez-moi, vous dormirez sur vos deux oreilles. Vous n'entendrez même plus les ronflements de la copine qui a bu trop de pinard. Non seulement, le saint homme reviendra jouer dans votre salon aussi souvent que vous le souhaiterez, mais il viendra en plus la nuit visiter vos rêves. Certains jours, vous serez surpris de vous réveiller aspergé d'eau bénite. Au dernier jour de votre vie, vous connaîtrez l'extase du swing divin et on vous entendra encore claquer des doigts, longtemps après la fermeture du cercueil.
Signé : Cazengler, grenouille de bénitier
The Reverend Horton Heat. 25 To Life. YepRock Records 2013
CHRONIQUES VULVEUSES
QUATRIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
14
Je refermais en toute hâte mon carnet secret mais c'était trop tard l'inopportune – c'était un personnage féminin comme me le révéla sa voix froufroutante – avait déjà dépassé la porte avant, et je n'eus vue que sur sa croupe départementale largement avenante car elle s'était penchée vers le sol pour caresser Molossa qui ayant sauté par la vitre arrière faisait son numéro de cabote en mal d'affection « Oh! Le joli chien-chien qui veut une caresse, la prochaine fois je t'apporterai un gros nonoss ! » Et Molossa émit un jappement de joie tandis que l'accorte personne continuait son chemin sans se retourner. Molossa me rejoignit dans l'habitacle de la teuf-teuf, à la manière dont elle ouvrait sa gueule je compris que cette rencontre n'était pas anodine. « Méfiance ! » semblait-elle me dire, et elle posa sur moi des yeux scrutateurs comme si déjà elle envisageait de me protéger d'un imminent péril.
Je me remis à la rédaction de mes notes.
15
CARNET PERSONNEL
D'ANALYSE PSYCHOLOGIQUE
DE L'AGENT 009891
Visite du premier étage : pour un esprit peu aguerri aux subtilités des analyses métapolitiques, le contenu de ce deuxième niveau s'inscrit dans la suite logique du premier. Même méthodologie, même présentation d'inventions soi-disant oubliées, perdues ou retrouvées. Mais le ton change. Beaucoup plus acide, ironique, et idéologique. La véritable nature de C. C. B. se révèle ici dans toute sa noirceur. Jusqu'alors nous avions rencontré un savant attentif au seul progrès des sciences pratiques, nous sommes désormais confrontés à un esprit corrosif en butte avec les grands idéaux de l'Humanité, ne tenant compte d'aucune des valeurs morales de la Société. Voici un scientifique qui profite de son travail pour mettre à terre la grande sagesse des Nations, il ne respecte rien, ni la sainte loi du travail, ni la nécessité sacrée de l'exploitation économique de l'homme par l'homme. Dénigre tout et se rit de tout. Dans le premier niveau C.C.B. évoque un monde baigné de compréhension, pour employer une métaphore musicale nous nageons dans l'optimisme raisonné du gospel. Mais au deuxième étage notre hôte déchaîne l'hydre noire de l'Anarchie dans un orage de dé-construction punk. Mais ceci n'est rien face à l'état régressif de barbarie pré-néolithique auquel il nous convie au deuxième étage de son Affabuloscope.
Troisième niveau :
16
J'ai compris trop tard pourquoi Molossa n'avait pas aboyé. N'ai eu que le temps de remettre mon carnet dans la poche intérieure de mon Perfecto. « Mon chienchien adoré, regarde ce que je t'apporte, un gros nonoss à moële avec plein de gras autour ! » et sans plus de gêne tout en s'asseyant à ma droite elle jeta sur la banquette arrière un truc aussi gros qu'un cuissot de dromadaire que Molossa entrepris illico de déchirer à belles dents.
« Excusez-moi, cher Monsieur de m'introduire ainsi en votre voiture, mais tout à l'heure quand je vous ai entraperçu courbé sur votre manuscrit, j'ai tout de suite compris que vous étiez un artiste. Un véritable Artiste, pas comme ce barbouilleur de Claudius de Cap Blanc, non un écrivain, peut-être le Marcel Proust du vingt et unième siècle. Alors mon coeur a parlé, j'ai trouvé la situation si romantique, j'ai tout de suite compris que votre génie n'a pas encore été reconnu par nos contemporains, que vous n'avez pas pu payer votre loyer, et que vous vous êtes retrouvé seul au monde, avec votre adorable petite peluche vivante, que peut-être vous n'aviez plus rien à manger, et que vous étiez en train de coucher vos dernières volontés sur le papier avant de vous tuer, vous et votre chien, mais non, vous n'avez plus besoin de mettre ce funeste projet à exécution, puisque vous avez rencontré un ange sur votre chemin.
-
Euh, Madame...
-
Mad'moiselle, s'il vous plaît !
-
Euh, Mad'moiselle...
-
Appelez-moi Marie
-
Euh, Marie je...
-
Et vous cher Artiste, quel est votre petit nom ?
-
Damie, je...
-
Oh, Damie c'est charmant, pas du tout comme cet ignoble prénom de Claudius, très moyen-âgeux, n'est-ce pas ? Vous savez que vous avez une chance extraordinaire, moi je recueille les artistes perdus dans ma maison, je ferai une exception pour votre canidé bien entendu, j'ai déjà prévu de vous donner la chambre bleue, celle juste à côté de la mienne, vous serez comme un coq en pâte, mon cher Damiou !
-
Je...
-
Non, ne me remerciez pas, vous ne savez pas ce que je ferai pour l'amour de l'art ! Tenez Damiou, laissez-moi la place au volant, nous arriverons plus vite au refuge. »
Pendant qu'elle descendit de voiture et que je me glissai sur le siège du mort j'eus le temps d'admirer ses cent-vingt kilos de taille fine et ses cheveux broussailleux de jeune fille un peu trop mûre. Les ressorts de la teuf-teuf gémirent lorsqu'elle laissa tomber son popotin mais déjà elle démarrait en trombe. Il me sembla entendre rire Molossa dans mon dos.
16
L'on remonta la rue principale à plus de cent-soixante kilomètres heures, dans les tournants je m'accrochais si fort à la portière pour ne pas m'affaler contre le corps adipeux de Marie que je n'arrivais plus à penser. Nous pénétrâmes dans la grotte toujours à la même allure vertigineuse et ce ne fut qu'à la sortie qu'elle donna un coup de frein phénoménal qui nous fit quitter la voie goudronnée. Au grand dam de touristes qui sagement installés à des tables de bistrot dégustaient une glace à la vanille, nous nous arrêtâmes à quelques centimètres de leurs chaises, face à la maisonnette reconvertie en minuscule boutique à souvenirs.
Marie me regarda droit dans les yeux, sa main posée sur la fermeture éclair de mon Jean :
« Damiou, une ultime épreuve avant d'accéder au refuge des poètes perdus, je veux d'abord savoir si vous en êtes digne, si vous êtes un homme. Je vais vous emmener devant l'Innommable, l'Horreur absolue. Vous avez encore le droit de refuser, mais dès que nous aurions tourné le coin de cette façade, il sera trop tard, et je pourrai être sûre de vos capacités viriles si vous parvenez à rester droit et stoïque, devant ce désolant spectacle, je vous en prie fermez les yeux et donnez-moi la main, je vais vous y conduire. Beaucoup ont échoué mais une force inconnue me pousse à croire que vous, vous réussirez.
17
Marie referma sa poigne de geôlière sur ma menotte et m'emmena en quelques enjambées derrière la maisonnette. Je l'entendis chuchoter comme dans un cauchemar : « Damiou, quand je dirai stop vous ouvrirez les yeux et vous verrez. » Sa main glissa vers ma braguette et j'entendis le signal fatidique : « Stop ! »
J'écarquillai les yeux et ne put retenir un cri de surprise. ( A suivre )
FIN DU QUATRIEME EPISODE
23:44 | Lien permanent | Commentaires (0)
19/09/2013
KR'TNT ! ¤ 156. JERRY LEE LEWIS / JOOK / PIERRE LATTES /
KR'TNT ! ¤ 156
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
19 / 09 / 2013
|
JERRY LEE LEWIS + NICK TOSHES / JOOK / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE |
GENERAL JERRY LEE
UNE EMBELLIE POUR JERRY LEE
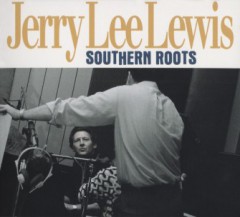
Oh la bonne surprise ! Ce mois-ci, nos amis les gros nounours de Bear Family rééditent «Southern Roots», l'un des albums les plus spectaculaires de Jerry Lee, enregistré et produit en 1973 par Huey P. Meaux. Les sessions eurent lieu pendant trois jours au Sugar Hill Studio que l'ami Meaux possédait à Houston, et au Trans-Maximus Studio, situé à Memphis.
Voilà ce qu'il faut bien appeler un disque légendaire. Carl Perkins, Tony Joe White, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Al Johnson et les Memphis Horns accompagnaient Jerry Lee, autant dire la crème de la crème des musiciens de Memphis. Huey P. Meaux jouait le rôle qui lui allait le mieux : celui de la cerise sur le gâteau.
L'ami Meaux était un producteur réputé et un authentique découvreur de talents. Il travaillait dans le bas du Texas, du côté de Port Arthur, tout près de la frontière avec la Louisiane, dans une région qu'on appelait le Triangle d'Or. Dans les parages, ça grouillait de talents. Johnny et Edgar Winter, George Jones et The Big Bopper sont du coin. Huey P. Meaux entama une carrière de coiffeur, puis de disc-jockey. Puis il apprit le business en se faisant rouler par un promoteur véreux nommé Bill Hall. L'ami Meaux commençait à fabriquer des disques à succès et Hall empochait les bénéfices en s'appropriant les crédits. Il profitait de la naïveté du jeune Meaux. Il faut dire que Huey P. Meaux avait reçu un don des dieux : à partir d'une bonne chanson, il savait choisir le bon interprète et trouver le bon son. Et grâce à l'épisode Bill Hall, il apprit rapidement à vendre ses disques, en graissant la patte des animateurs de radios locales.
Dans «New York New York», le jazzman Robert de Niro explique son équation à Liza Minelli : 1, music, 2, money, 3, love (qu'il propose de modifier si elle l'épouse en passant love en 2). Huey P. Meaux avait lui aussi son équation : 1, la chanson, 2, la production, 3, la promotion et 4, le chanteur. «The song makes the singer and the production. Promotion makes all of it.» (C'est la chanson qui fait le chanteur et la production. Et sans la promotion, on a quoi ? Rien). En accumulant les disques d'or, l'ami Meaux a fini par se tailler une réputation de découvreur et de producteur haut de gamme. C'est grâce à lui que «Tighteen Up» d'Archie Bell & the Drells (produit par Skipper Lee Frazier) devint un hit mondial : Meaux employa les gros moyens et le fit sortir sur Atlantic qui disposait d'un vrai réseau de distribution. Il produisit les disques de grands artistes locaux comme B.J. Thomas, Freddy Fender, Barbara Lynn et d'artistes moins connus comme Orville Nash («Nashing Around», ce fascinant album dont j'ai déjà parlé ailleurs) et The Hombres («Let It Out», classique garage tex-mex des sixties).
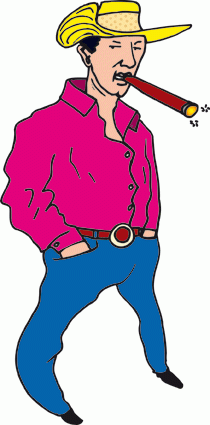
Il avait repéré les frères Winter. Il chercha à les lancer, mais à l'époque, on craignait encore les albinos dans cette région du Texas. Huey P. Meaux comptait parmi ses amis Shelby Singleton alors chez Mercury (c'est là que le contact se fit avec Jerry Lee) et Jerry Wexler (Atlantic), producteur haut de gamme lui aussi. Il rendit le tex-mex sound célèbre dans le monde entier en lançant la carrière du Sir Douglas Quintet. «She's About A Mover» devint un hit mondial. Il entretenait d'ailleurs une relation privilégiée avec Doug Sahm et Augie Meyers qu'il considérait comme ses enfants («I raised those boys» - je les ai élevés). Tex-mex toujours avec le hit de Freddy Fender, «Before The Next Teardrop Falls» qui atteignit les sommets des charts américains en 1975. Le morceau était connu comme le loup blanc dans les circuits country, mais la production de Huey P. Meaux fit toute la différence.
Mais pour beaucoup de gens, Huey P. Meaux sentait le soufre. Il sortait en effet du ballon. Comme Chuck Berry avant lui, on l'avait accusé d'avoir traversé une frontière d'État en compagnie d'une mineure. Il s'était rendu à Nashville, Tennessee, pour assister à une convention de disc-jokeys et une demoiselle de quinze ans l'accompagnait. Il fut poursuivi par les autorités locales et tomba sous le coup du Mann Act, une vieille loi ultra-répressive complètement dépassée qui fut conçue à une époque pour persécuter les noirs qui fréquentaient des blanches. À sa grande surprise, Huey prit en 1968 trois ans de ballon dans la barbe. (Notons qu'en arrivant au terme de son mandat présidentiel, en 1981, Jimmy Carter le blanchira.)
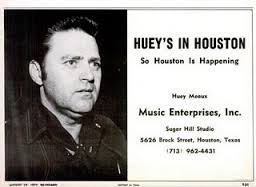
Jerry Lee et Huey avaient au moins trois points communs : ils étaient nés tous les deux en Louisiane, ils ne cachaient pas leur goût très prononcé pour les filles très jeunes et ils alimentaient avec le plus grand soin leurs réputations respectives de wild men. Enfermer le Crazy Cajun et le Killer ensemble dans un studio, ça relevait tout simplement du coup de génie.
D'autant que la carrière de Jerry Lee était une fois de plus au point mort, comme le rappelle Hank Davis dans le texte qui accompagne la réédition de «Southern Roots» : «Like Charlie Rich of the era, Jerry could do many things, and do them well. There was just no way to 'niche' him» (Comme Charlie Rich à la même époque, Jerry pouvait faire des tas de choses et les faire bien. Mais il n'y avait pas de créneau pour lui.) Chez Mercury, il était même question de le virer. Ces connards ne savaient plus comment le vendre : vieux rocker sur le retour ? Chanteur de gospel ? Star de la country ? Jerry Lee devait bien se marrer, entre deux rasades de Southern Comfort. Il était tout cela à la fois et même beaucoup plus encore. Mercury lui accorda généreusement un sursis d'un an. Et par miracle, un ponte de Mercury nommé Charlie Fach, fit appel à Huey P. Meaux pour produire l'album censé relancer les ventes.
La réputation de producteur légendaire l'emporta sur celle plus embarrassante du taulard mêlé à une affaire de mœurs. Fach partit du principe que Huey et Jerry Lee étaient tous les deux au point mort et qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Fach demanda à Huey s'il se sentait capable de produire un démon comme Jerry Lee, à quoi Huey répondit : «I said 'Sure. I understand him'». Le pari de Fach mériterait d'entrer dans les livres d'histoire. Comme le dit Hank Davis : «Separately, Meaux and Lewis each spelled trouble in a big way and could be impossible to work with. Together? God knows what would happen. The results could be an utter disaster or a stroke of genius.» (Séparément, Meaux et Lewis étaient ingérables et ça pouvait même devenir impossible de travailleur avec eux. Ensemble ? Dieu seul savait ce qui pouvait se produire. Ça pouvait très bien se solder par un désastre ou au contraire par un coup de génie.)
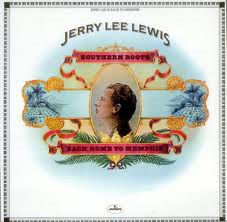
Et là, on entre dans un épisode de rêve. En studio, Huey et Jerry Lee s'amusent comme des fous. Meaux et Lewis ? Terminé ! Ils se surnomment Boudreau et Thibodeaux, les Bouvard et Pécuchet du rock cajun. Ils font le job à leur manière, de telle sorte qu'ils frôlent le désastre commercial, car bien évidemment, aucun des titres de cet album n'a les qualités requises pour aller parader au sommet des charts. Et pour corser l'affaire, Jerry Lee ouvre le bal des maudits avec «Meat Man», reprise musclée, bardée de chœurs et de cuivres, d'un vieux standard de Mack Vickery. Le Killer s'en donne à cœur joie : «I been down to Macon, Georgia/ I ate the furs off a Georgia peach/ Plucked me a chicken in Memphis/ Mama, I still got feathers in my teeth» (À Macon en Georgie/ J'ai bouffé le cul d'une pêche de Georgie/ Je me suis fait une poule à Memphis/ J'en ai encore des poils plein les dents.) C'était une véritable provocation. Du grand art killerique. Et derrière, Huey devait se pâmer de rire.
D'ailleurs, Huey travaille avec Jerry Lee comme le fera Rick Rubin trente ans plus tard avec le Johnny Cash finissant : il lui fait des propositions de chansons. «Polk Salad Annie» ? Jerry Lee hésite. «Danse Kolinda» (repris par Gene Vincent dans son avant-dernier album - Huey lui chantonne l'air de ce classique cajun) ? Non, ce n'est pas sa tasse de thé. Huey le branche aussi sur Creedance. «Ah Creedance ! Cliiiiirwater !» Jerry Lee est complètement rond. Huey propose et Jerry s'esclaffe. On peut entendre cette conversation en fin de disque. Les gros nounours de Bear ont eu la délicatesse de nous caler six minutes de bavardage en fin de face 4. Fascinant.

Jerry Lee et ses amis tapent dans des gros classiques. Par exemple, le fameux «When A Man Loves A Woman» de Percy Sledge dont Jerry Lee fait de la chair à saucisse, car il ne connaît pas les paroles. Hank Davis a l'air de dire que certains morceaux sont improvisés en studio et que Jerry Lee se cale sur les musiciens. Alors, il transforme effectivement les paroles et fait en gros ce qu'il a fait toute sa vie : il s'approprie le morceau. Il se glisse dans les paroles - when Jerry Lee loves a woman - il transforme le slow super-frotteur du gros Percy en sermon héroïque - oh Lord - et le génie pentecôtiste de Jerry Lee s'abat sur nous pauvres pécheurs. Il sort du contexte romantique voulu par Percy Sledge pour venir nous expliquer en long en large et en travers que l'amour, c'est d'abord une partie de pugilat, et il en connaît un rayon, là-dessus, on a déjà vu Myra avec un cocard - elle l'avait pas volée, la beigne, ce'te traînée qui couchait avec les autres dès qu'j'avais le dos tourné. On n'en revient pas d'entendre le Killer asséner ses vérités avec une assurance qui le place automatiquement au-dessus de tout soupçon. Il alourdit la note en balançant un solo de piano complètement déjanté et derrière, les copains cuivrent l'ensemble à la folie. Il souffle sur ces deux premiers morceaux un vent de liberté incroyable. Huey P. Meaux donne enfin de l'air à Jerry Lee qui vient de passer des années pénibles à subir l'orthodoxie de Jerry Kennedy, le producteur maison de Mercury. Avec le pote Huey, il peut retourner faire le con dans les bastringues du bord du fleuve. Huey et lui ne craignent rien ni personne.
Puis il tape dans un autre classique soul : «Hold On I'm Coming», qui rendit Sam & Dave célèbres dans le monde entier. Jerry Lee le prend sur un tempo relâché, très propice aux fantaisies vocales. Derrière, ça groove et ça cuivre comme au paradis, les filles pulsent des chœurs de rêve et on voit éclater le génie de Jerry Lee - Give it to me baby - il fait un numéro de charme en plein cœur du morceau, il jette tout son poids dans la balance, on n'avait pas entendu ça depuis sa version de «My Cheating Heart» au Star Club de Hambourg et il en rajoute - here I am I'm a hillibilly cat - et il embraye sur le numéro de scansion on pourrait dire habituel - comin'-comin'-come - et finit en poussant son grognement de fauve. On va attaquer le quatrième morceau et on ressent déjà une sorte de saturation. Jerry Lee explore toutes les nuances de son registre et de sa folie. C'est la foire à la saucisse. On hallucine. Jerry Lee est partout, sur la terre comme au ciel, et paf, il attaque «Just A Little Bit», il chante avec des coups de menton, il fait ce qu'il veut, il attaque des solos de piano, il shake a whole lotta goin' on, il chevauche le groove cuivré en tagadant ses touches de clavier - the killer wants a little bit - gimme a little bit of your love aouuuuhhhh - il nous balade - little bit of your love ah ah ! Sa version de «Born To Be A Loser» est à tomber. Stupéfiant : Jerry Lee s'avoue vaincu - Maybe I took a little bit too much for granted/ When I fell in love with you/ But the Killer can't help it/ baby I thought you loved me too» (Peut-être que je me suis fourré le doigt dans l'œil/ Quand je suis tombé amoureux de toi/ Mais le Killer ne peut pas s'en empêcher/ Je croyais que tu m'aimais aussi). Jerry Lee retourne évidemment la situation à son avantage - «Oh! Lord, I feel a little strange, baby/ Since you walked away from me/ Why in the world, woman/ Did you ever leave rockin' Jerry Lee.» (Je me sens drôle, poulette/ Depuis que tu m'as quitté/ Je ne comprendrai jamais pourquoi/ Tu as quitté un rocker comme Jerry Lee.) Ce mec a réussi à bâtir une légende très tôt dans sa vie. Et pendant tout le restant de sa vie, il a su l'alimenter. Pas mal, non ? Surtout que son cirque dure depuis cinquante ans. Tout le monde finira bien par admettre que Jerry Lee est le meilleur.
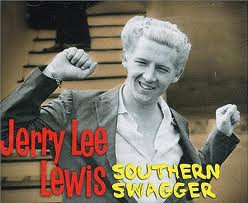
Voilà qu'il tape ensuite dans «Blueberry Hill». Il sucre that sweet melody et en fait un morceau de rêve. Il le flanque d'accords de piano inconnus et livre à l'auditeur ébahi une version visitée par la grâce. Derrière, les copains montent les cuivres en mayonnaise, comme s'ils se croyaient dans une revue musicale à Broadway. Comme dirait Beaudelaire, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
L'idée de la reprise suivante vient très certainement de l'ami Meaux, car il s'agit d'un morceau de Doug Sahm, «Revolutionary Man». Jerry Lee se jette à corps perdu dans la tornade tex-mex et l'enflamme. Texas tornado ! Il embarque le morceau à la force du poignet. Nouvelle manifestation de son tempérament de meneur génial. Il a une façon bien à lui d'emmener un morceau et de le tirer vers le haut. Souvenez-vous de son album de duos avec les célébrités du rock («The Last Man Standing») : il ne fait que ça, tirer les gens et les chansons vers le haut - les Neil Young, les Jagger, les Rod Stewart, les John Fogerty, les Keith Richards, les Delaney Bramlett, les Don Henley, les Ringo Starr, on ne parle même pas de cette crêpe de Springsteen - il les traîne tous derrière lui et leur montre au passage comment on pose une voix - car tout est là. Il ne s'agit pas de miauler en tortillant du cul, il s'agit d'affirmer son timbre et éventuellement de plaquer quelques accords de piano originaux. De très nombreux artistes ont déjà ré-interprété le vieux hit de Fats Domino, mais je mets quiconque au défi de me trouver une version qui soit meilleure ou plus inspirée que celle enregistrée par Jerry Lee à Memphis en 1973. Et si j'osais, je dirais que ça vaut pour toutes les reprises de Jerry Lee.

Le problème, quand on démarre dans la vie avec Jerry Lee, c'est qu'on ne sait plus faire la part des choses. Oh, c'est sûr, Elvis chantait comme un dieu. Carl Perkins jouait et composait lui aussi comme un dieu. Little Richard mettait le feu dans les chaumières et dans les pantalons. Gene Vincent transformait notre vision du monde. Eddie et Vince Taylor nous aveuglaient avec leur talent et leur classe. Charlie Feathers symbolisait l'intégrité. Fats Domino nous donnait presque envie de grossir et de porter des bagues en diamant et Chuck Berry était devenu, mine de rien, le plus grand poète des temps modernes. Mais Jerry Lee, c'est encore un cran au dessus. Nettement au-dessus. Il est ce qu'on pourrait appeler l'essence même du rock, et ça va loin, puisqu'il allume son briquet pour y mettre le feu.
Avec Jerry Lee, on peut même déconner avec les métaphores.
La dernière fois que je l'ai vu jouer (au Zénith du Parc de la Villette, pris en sandwich entre Linda Gail et Chuck Berry), il semblait un peu calmé, mais il posait sa voix et on sentait bien que Chuck Berry allait avoir des problèmes, en passant après lui. C'est une vieille histoire de rivalité illustrée par les anecdotes que tout le monde connaît. Même chose qu'avec Jesse Hector, il vaut mieux éviter de monter sur scène APRÈS Jerry Lee. Le Killer ne fout plus le souk comme au bon vieux temps, mais son set est tellement haut de gamme qu'on ne peut jamais espérer mieux, après lui. Ce soir-là, Chuck Berry avait appelé du renfort. Un jeune guitariste black était venu muscler le son, et Chuck passait tous ses hits à la sauce heavy. On n'avait encore jamais vu Chuck jouer avec un son aussi lourd. Mais Jerry Lee s'était imposé par la pureté de ses interprétations. Il avait fait son festival habituel de vocalises et de pianotis virtuoses. On attendait sa reprise de Charlie Rich, «Don't Put No Headstone On My grave» et je peux vous dire que les frissons étaient au rendez-vous. Même ralenti par son grand âge, Jerry Lee reste le Killer et personne ne lui arrive à la cheville. Lors d'un concert précédent au Bataclan (2004), il avait réussi à rallumer le feu dans les cervelles de ses fans en dégageant son tabouret de pianiste d'un violent coup de talon pour attaquer ses deux classiques mortels de fin de set, Whole Lotta et Great Balls. Soixante-dix balais. Qui dit mieux ?

Bien entendu, la réédition de «Southern Roots» avec le son original est une bénédiction.
Le premier disque propose les neuf titres parus en 1974. Le second disque propose le reste des morceaux enregistrés qu'on croyait perdus et que les gros nounours de Bear ont fini par dénicher. Pour les fans de Jerry Lee, c'est le Père Noël, comme on dit.
Jerry Lee attaque la face 3 avec une version hallucinante de «Silver Threads Among The Gold» qu'il embarque à coups d'accords de piano. Derrière, ça violonne à outrance et ça fourmille d'instrumentations. Typical Meaux. Jerry Lee bat tous les records d'émotivité à sensation - Yes my darling/ You will be/ Will be always the only heart to me - Jerry Lee se sent tellement bien qu'il pianote comme un pacha - Yes mama you'll always be - et il laisse sa voix dérailler comme un train. On se tape ensuite la version rapide de «Hold On I'm Coming», et il se glisse dans la chanson, comme un serpent mal intentionné - Oooh hold on Jerry Lee's comin' - et il reprend les choses en main, baby - Never have to worry/ Because Jerry Lee's here ! Et il repart en impro - You know what I need ?/ I need your love - ça ne mange pas de pain, c'est pas compliqué et c'est assez explicite, et il embarque son monde dans un délire salace - yeah yeah mama - soutenu par les chœurs des blackettes qui poussent des reins comme des petites chattes en chaleur. Il devait faire pas loin de 60° dans le studio. Encore une fois, on ne trouvera pas ça ailleurs. Pas la peine de se fatiguer à chercher.
Jerry Lee revient à la balade avec une bluette country pleine de générosité. Dans «Take Your Time», il demande à une ex de prendre son temps. Il lui répète d'une voix fêlée par l'émotion qu'il n'est pas pressé - I don't mind/ I'll be fine/ Take your time - il scande tout ça d'une voix mouillée par le génie et il enchaîne avec un solo de piano entièrement libéré de toute contrainte morale ou esthétique, comme si les automatismes psychiques de la pensée reprenaient le pouvoir, comme on disait à la cour du dictateur Breton - As soon as you say/ I'll try again/ Take your time Woman/ The Killer don't mind - et toujours dans l'ombre, la silhouette du personnage de légende, l'immense Killer qui nous accompagné tout au long de notre vie et qui espérons-le finira par nous enterrer, tous autant que nous sommes.
S'ensuit une reprise infernale de Charlie Daniels «All Over Hell And Half Of Georgia» martelée comme «High Heel Sneakers» où Jerry Lee avoue humblement qu'il est aussi allé foutre le souk en Georgie - I've been raising hell in Georgia - pour ça, on peut lui faire confiance - c'est autrement plus intéressant que la vision georgienne de Ray Charles - et il fait monter ses woooh yeah ! comme des petites crises d'épilepsie - tout le jus de Jerry Lee passe dans ce morceau - dans les autres aussi, bien sûr, mais dans celui-ci en particulier. Il retourne farfouiller dans la veine nostalgique avec «I Sure Miss These Good Old Times». Il chante ça avec la désinvolture d'un égal des dieux, étalé dans une banquette de nuages quelque part au dessus de l'Olympe, un glass de bourbon dans la main droite et un havane dans l'autre main - I sure miss the good old times/ That we used to have.
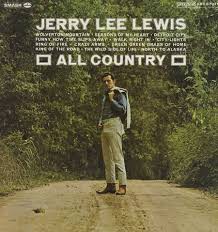
Dans l'avenir, les spécialistes gloseront sur la diction magique de Jerry Lee Lewis et sur sa prodigieuse faculté d'improvisation. Et puis il reste encore à écouter une face entière. Vous y trouverez des perles du même acabit, comme «Honey Hush». Méfiez-vous quand même de ce disque. Son écoute monte directement au cerveau.
Signé : Cazengler, qui boit le Jerry jusqu'à la lie
Jerry Lee Lewis. Southern Roots. The Original Sessions. Bear Family 2013
JERRY LEE LEWIS : 1935 - 1981
HELLFIRE
NICK TOSCHES
Préface de GREIL MARCUS
( Allia / 2008 )
Greil Marcus nous met en garde dans son introduction publiée en 1989, ceci n’est pas une biographie de Jerry Lee Lewis. Ca y ressemble comme deux gouttes d’eau, des faits, des dates, des anecdotes, des analyses, des mises en perspective, mais si vous cherchez le 100 % Bio, faudra vous faire une raison, ce n’est pas qu’on y consomme trop d’alcool et qu’on y fume trop de cigares pour mériter l’appellation contrôlée. Vous êtes simplement dans un des classiques de la littérature américaine, affirme Marcus. Ni plus, ni moins. Pouvez difficilement faire meilleur compliment à un bouquin. Et en plus vous vous devez de lui donner raison. Ca se lit comme un roman. Du Faulkner, palmiers sauvages, bruits et fureurs. Personnage hors du commun. Vieux Sud Profond.
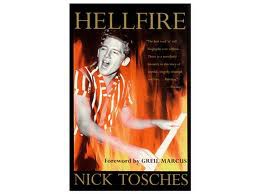
Faut dire que Jerry Lee Lewis y met du sien. Sa vie est une tragédie shakespearienne, pas étonnant qu’il ait accepté en 1968 d’interpréter sur scène à Los Angeles le rôle de Iago dans l’opéra-rock Catch My Soul inspiré d’Othello selon une idée de Jack Good. Mais peut-être convient-il de commencer par le commencement.
FAMILY LIFE
La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour tout le monde. Surtout pour ceux qui naissent dans une famille de tarés. Ce dernier mot ne procède pas d’un jugement moral mais d’un simple décryptage sociologique. La pauvreté et la misère intellectuelle ne sont guère des facteurs d’épanouissement personnel positifs. Dans la bourgade perdue de Ferriday en Louisiane, les petits blancs essaient de faire de leur mieux. Survivent en plantant et en récoltant du coton. Toute relation avec la main d’œuvre noire d’origine servile sera rejetée. Une année bonne, l’autre non, cela ne dépend pas du soleil mais du cours des matières premières… Heureusement l’oncle est assez riche pour monter une distillerie clandestine de whisky. Elmo le père de Jerry écopera de quelques mois de prison…
N’y a pas que l’alcool dans la vie. Y a aussi les femmes et la musique. Pour les premières on les prend toutes jeunettes. A peine réglées, c’est réglé. Il est bien connu que les pauvres copulent comme des lapins. A peine avez-vous dégoté une petite que votre frère s’intéresse à sa sœur. Pas besoin d’aller chercher bien loin ce que l’on a côté de soi. Côté arbre généalogique c’est aussi labyrinthique que la famille impériale des empereurs de la Rome Antique, l’on est facilement le neveu de son cousin et l’oncle de son frère. L’on dit que cette consanguinité favorise l’idiotie. Mais aussi le génie. Quoi qu’il en soi dans la famille Lewis, sur la même génération trois cousins deviendront célèbres : Jerry Lou, Mickey Gilley et Jimmy Lee Swagart. Deux pionniers du rock renommés et un prédicateur célèbre, beau score.

Pour la musique, ça ne s’explique pas, c’est familial, c’est dans les gènes. L’on tripote volontiers le violon le soir à la veillée. Des chaumières, n’ont ni l’eau courante, ni l’électricité. La guitare aussi, mais Jerry Lee ne peut apercevoir un piano sans s’y jeter dessus. Elmo y sacrifiera ses économies. Remarquez que Dieu le lui rendra au centuple. Car il faut faire le détour par la religion pour comprendre la musique diabolique de Jerry Lee Lewis.
Les Lewis n’étaient pas des bigots de la pire espèce. Mais lorsque deux représentantes des Assemblées de Dieu s’en viennent créer une église à Ferriday, la famille met la main dans l’engrenage. Faut dire à leur décharge que ces pentecôtistes jusqu’au boutistes proposent des après-midi réjouissantes. Certes ils condamnent l’alcool, le sexe, le boogie woogie - programme que vous admettrez peu rock and roll - mais entre deux prières, deux hymnes, deux confessions ou engagements à voix haute avec un peu de chance l’on peut assister à des grands moments de folie collective, le saint esprit descend parmi l’assemblée et chacun se met à parler en une langue étrangère qu‘il n'a jamais pratiquée auparavant. Les plus avancés caressent des crotales et se font des infusions de strychnine pour prouver qu‘ils sont sous la protection directe de Dieu.
THE OTHER SIDE
L’embêtant c’est que si Dieu en personne s’en vient régulièrement visiter la petite bourgade de Ferriday, il faut convenir par simple déduction que le Diable ne doit pas être bien loin et qu’il suffit de soulever les jupes des filles pour trouver le trou dans lequel il niche. Ne prenez pas non plus l’ignominieux Satan pour un simple obsédé sexuel, se coule aussi dans les bouteilles d’alcool et sautille de toutes ses forces dans le rythme du profane boogie woogie.

A treize ans Jerry Lee commence à connaître d’une façon biblique ses petites copines, mais n’avait pas dix ans qu’un vieillard noir l’a mis en garde alors qu’il tentait de s’approcher d’un peu trop près d’un juke joint. Lui a raconté l’histoire du pacte que Robert Jonhson avait passé avec le Diable… Jerry fera son choix en toute connaissance de cause, l’aura toute sa vie des coups de nostalgie mystique pour la pureté divine - quelques minutes, pas plus - mais il sait qu’il est né pour emprunter le chemin qui mène tout droit en enfer. A quinze ans il entrera comme pensionnaire dans une école religieuse. Fait le mur tous les soirs, et se finit par être viré pour avoir donné sur l’harmonium de l’office une version très boogie woogie du cantique prévu…
AVANT LE SOLEIL
Jerry s’est appris à jouer du piano tout seul. Méthode ultra simpliste. Ecouter un morceau et tenter de le reproduire. Cela lui prendra plusieurs années. Mais une fois que le principe est acquis l’on commence à tourner en rond dans la décalcomanie auditive. Alors on se lance des paris un peu gratuits ; je le jouerai plus fort et plus vite que l’original. Jerry martèle son piano, il crée son style, une main pour pomper et une autre pour arroser. Puis un pied pour les aigus et tout autre partie de corps pour improviser. Pour la voix, c’est directement à l’abordage, Jerry Lee Lewis n’interprète pas, il ne respecte pas les intentions de ses prédécesseurs, il prend possession des lieux, fait tomber les murs et rajoute des cloisons là où personne n’en mettrait. Dieu ou le Diable il s’en fout, il est le Grand Architecte qui revoit les plans de l’Enfer.
Petit prodige sort dans le monde pour grandir. Ne parade pas, il expérimente, il écoute, il essaie, il mémorise, il bâtit à neuf. Mineur il s’en va jouer dans les boîtes à nègres, l’est un des rares blancs que l’on accepte, n’existent que deux races : ceux qui savent taper sur un piano et ceux qui ne savent pas. L’est pour tout ce qui bouge dans les bouges et tout ce qui déborde dans les bordels. En ses débuts souvent on lui demandera le nom du musicien noir qui joue du piano dans son disque.
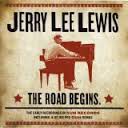
Question country son père l’a élevé au son de Jimmy Rodgers, et tout seul comme un grand à la radio il a su discerner la splendeur d’Hank Williams. Ne lui reste plus qu’à inventer le rock and roll. L’a grandi, l’est déjà renommé autour de Ferriday et lorsque Mickey Gilley l’encourage à partir auditionner à Memphis chez ce gars qui a enregistré Elvis Presley, il promet qu’il ira vers ce nouveau soleil.
SUNNY TIME
Sam Phillips n’est pas là quand Elmo et son fils prodige débarquent dans les studios Sun. C’est Jack Clement qui le reçoit et l’écoute. Le petit est doué, sait tout jouer, mais il lui redemande de revenir avec des compos originales. A la maison il écrira non sans quelques difficultés End of the Road mais quand il reviendra Jack Clement préfèrera sa version endiablée du hit de Ray Price, Crazy Arms.
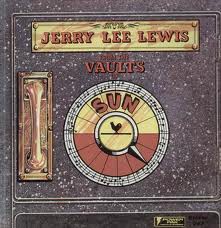
Ensuite l’histoire se répète. Ca c’était passé de la même manière avec Elvis. Sam Phillips a l’intuition fulgurante qu’il faut tout de suite envoyer l’acétate à Dewey Phillips qui le passe illico presto sur sa radio. Et le miracle recommence, les auditeurs en folie bloquent le standard… Un second Presley est né. Non un meilleur Presley, car avec des titres comme Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Great Balls of Fire, High School Confidential, Jerry Lee montre qu’il est plus sauvage que le kid de Tupelo. Et si l’on veut être juste, il n’y a que sur Jailhouse Rock que Presley parviendra à produire un morceau aussi incandescent que Jerry Lee. Ce qui n’enlève rien au prestige et au savoir faire d’Elvis. Presley ne pousse pas les murs, il les repeint, remeuble les chambres, et habite l’appartement qu’il vient de reloocker en grand seigneur avec cette feinte nonchalance, cette grâce de guépard alangui, tel un aristocrate qui s’amuse à s’ennuyer dans son château familial...
STORMY DAYS
Jerry Lee se voit comme l’anti-Presley. Le King est déjà enfermé dans Graceland, vit en toute discrétion derrière les grilles de sa si bourgeoise propriété, s’éloigne du monde et de la scène. Jerry Lee met le feu partout où il passe. Touche dix mille dollars par set et n’arrête pas de tourner. Elvis sera the good guy, respectueux de la loi, ami des autorités et de la police. Jerry Lou, Jerry fou, refuse de faire profil bas. Violent, vindicatif, fanfaron, il ne sait pas se taire et agit comme si le monde était à ses pieds.

Au micro, comme dans la vie. S’est déjà marié deux fois lorsqu’il tombe amoureux de sa cousine Myra. Elle n’a que douze ans, et à treize ans ils mettent la famille devant le fait accompli d’un mariage en douce… Pour le voyage de noces ce sera la tournée en Angleterre, car Lewis veut conquérir le monde. Ne faut jamais tendre le bâton pour se faire battre. En la perfide Albion comme en Amérique, l’intellingentsia médiatique et les autorités étatiques l’on ne prise guère cette musique hooliganesque qu’est le rock ‘n’ roll, le triomphe inattendu de ces gamins quasi illettrés qui sont portés au pinacle par de tout jeunes gens issus des classes populaires ( et par conséquence peu cultivés ) suscite bien des rancœurs et des jalousies. L’on ne supporte pas cette musique simpliste mais on comprend qu’elle fait appel aux désirs refoulés des corps adolescents en attente de libres voluptés… Aussi quand Jerry Lee présente à la presse sa cousine de treize balais comme son épouse devant dieu et les hommes, c’est le hallali.

Campagne de presse sans précédent envers le voyou pédophile. Ce qu’il y a de terrible dans cette affaire, ce n’est pas le déchaînement du vieux monde à l’encontre de nos deux anges sauvages, c’est que le public qui attendait Jerry Lou comme le messie va se laisser retourner comme une vulgaire crêpe au beurre mou. Bonjour les rockers, l’on ne peut pas dire que l’esprit de rébellion régnait dans vos cerveaux confits de moraline visqueuse. Nous sommes en 57, dire que les sixties seront l’ère de la libération sexuelle ! Jerry Lou et Myra auront essuyé les plâtres de la bêtise rétrograde. Remarquez dernièrement j’ai entendu des fans de rockabilly s’en prendre à Johnny Cash sous prétexte qu’il a aussi chanté pour des violeurs d’enfants à San Quentin.
Sur ce coup-là, la grande Amérique se révèlera aussi étroitement frigide que sa mémé England. La tournée britannique annulée, Jerry Lee n’est pas descendu de l’avion qu’il a compris que le cauchemar ne fait que commencer. Mêmes journalistes haineux et même campagne de presse à travers tous les états. Carrière brisée. Conjuration du silence aux alentours de sa personne.
THE KILLERS GOES ON
Plus d’un se serait laissé couler. Jerry Lee fait front. Repart à zéro. Petits clubs par petits clubs. Cachets à cinq cents dollars. Le fils, âgé de trois ans, que lui a donné Myrha se noie dans la piscine de sa villa. Jerry Lee accuse le coup. Peut-être se met-il à boire plus sec que d’habitude et à avaler davantage de pilules. Mais peut-être est-ce une illusion. Côté discographique quelques rares succès d’estime, mais les titres ne montent pas au hit parade. Fin 1 963, Lewis finit son contrat chez Sun et signe chez Smash, filiale de Mercury. Sans plus de chance. Ironie du destin, c’est encore en Europe que l’on se souvient encore de lui et que le public voit en sa personne une des personnalités du rock les plus authentiques et des plus essentielles.

C’est en 68 alors que chez Smash l’on s’apprête à ne pas reconduire son contrat que l’aigle Jerry Lee prend son nouvel essor. Surgit de là où on ne l’attendait pas. Le rocker est dans un autre lieu, in another time, change de registre, le winner rocker s’est transformé en looser Countryman. Une voix chargée de désespoir et de bestiale auto-ironie, l’a rejeté autant de fumée que la cheminée d’un cargo déglingué et but assez de whisky pour couler le rafiot rouillé à trois mille mètres de profondeur. Mais il n’y a pas d’erreur sur le nom du capitaine qui tient la barre. Au-dessous et au-dessus du volcan.
LE PHENIX
L’embellie ne durera pas dix ans. Jerry est en haut de tous les classements. Puis il en disparaît mais il s’installe pour toujours dans l’imaginaire américain. Accentue sa morgue et son mordant. N’est reconnaissant de rien à personne. A creusé sa tombe tout seul et en est ressorti vivant tout seul. N’est pas le genre de gars qui aime qu’on lui tende la main. Si ce n’est pour la mordre.

S’est séparé de Myra, a enterré son second fils. Mais il survit. Sex, drugs and rock ‘n’roll, il connaît. Ne sait faire que cela. Le monde change, les jeunes portent les cheveux longs et écoutent des musiques par trop pâteuses. Mais pas Jerry Lee. Reste ce qu’il a toujours été. Se fout de tout. Gagne des centaines de milliers de dollars. Puis ce sera la période des vaches maigres. Mais il s’en fout. Ne change pas ses habitudes. Dépense son argent par la fenêtre mais ne paye jamais ses factures. Les plaintes s’accumulent, les objurgations des juges se font plus pressantes. Il s’en fout. Conduit perpétuellement en état d’ivresse. Tire au revolver sur tout ce qui bouge et ne rate pas souvent sa cible. S’en fout toujours. La justice vient chez lui saisir ses avoirs et en remplit huit semi-remorques. Peu lui chaut. Il est au-dessus de tout cela. Ses compagnes l’accusent de cruauté mentale. Cela le laisse plus froid que le sang d’un crotale.
Jerry Lee Lewis ne reconnaît plus le monde qui vit autour de lui. Est loin de toutes ces simagrées. Reste enfermé en lui-même. Alcool, fumées, pills. Jerry a survécut à tout. Il est immortel. Tel le phénix, il peut être réduit en cendres mais il renaîtra. Immortel.

La preuve c’est que Nick Toshes a fini son livre voici plus de trente ans et qu’il na pas jugé bon de rajouter d’inutiles addenda. Jerry Lee Lewis est toujours là. Tel qu’en lui-même. Immortel. Le dieu vivant du rock ‘n’ roll.
Damie Chad
JOOK - BOX
On parle souvent du mystère de Toutankhamon. Mais beaucoup moins du mystère Jook. Comment un groupe aussi brillant a-t-il pu sombrer dans l'oubli ? Quand les ethnorockologues du quatrième millénaire se pencheront sur la question, ils s'arracheront les cheveux.
Jook est un groupe glam anglais qui enregistra cinq singles sur RCA, entre 1972 et 1974. Ces quatre brillants glamsters auraient pu éclipser Marc Bolan et renvoyer Mott The Hoople en seconde division. En effet, Ian 'Ralf' Kimmet composait des tubes et chantait à la perfection. Mélodiquement parlant, il naviguait au même niveau que Ronnie Lane. Il avait ressemblé une équipe de choc : Trevor White (guitare), Ian Hampton (basse), et surtout Chris Townson (batterie) et John Hewlett (manager), respectivement ex-batteur et ex-bassman de John's Children. Ce n'est pas tout. On comptait parmi les admirateurs de Jook le célèbre producteur Mickie Most et les quatre fantastiques glamsters de Sweet.

Comme tous les rockers anglais des seventies, les quatre Jook portaient les cheveux longs. Un beau jour, Ian Kimmet décréta qu'il fallait choisir un look et ils optèrent pour un look Mod ultra (über-mod), cheveux taillés courts, bretelles et pompes de boxeur, un look qui attira évidemment la faune skin à leurs concerts. Comme Jesse Hector, ils eurent le culot d'opter pour un look à la fois décalé et flashy. Et comme Jesse Hector, ils jouaient un rock très en avance sur leur époque.
Dans les années soixante-dix, je lisais chaque semaine les trois canards anglais de référence (Sounds, NME et Melody Maker) et bien entendu, Slade, Bolan et Mott accaparaient toute la place. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu un seul article sur Jook. C'est par une compile parue en 2003 (soit trente ans après la bataille) que je suis tombé par hasard sur le pot aux roses. «Glitter From The Litter Bin» proposait deux titres de Jook, «Alright With Me» et «King Kapp», deux morceaux de glam-rock absolument parfaits, avec des gros riffs bien ronds et bien gras, enjoués et rudement bien articulés, deux purs joyaux de l'empire du glam. Dès l'intro, «Alright With Me» sonnait comme ce que les Anglais appellent «an instant classic». «King Kapp» était une glam-song bricolée en l'honneur d'Andy Capp, l'un des héros de Ian Kimmet et de son copain Trevor.
Pas mal, pour un groupe trouvé dans la poubelle du glam. Un an plus tard sortait sur RPM une autre compile glam fatidique : «Glitterbest».
RPM est certainement le label de réédition le plus pointu d'Angleterre. Pas étonnant, car deux personnages de renom animent ce prestigieux label : Tony Barber, ancien bassman des Buzzcocks et Phil King, ancien bassman de The Jesus and Mary Chain. Passionnés de glam, ils farfouillent dans les poubelles à la recherche de pépites. Et dans le gros tas de pépites qu'ils baptisent Junk Shop Glam, on trouve Jook. (Et pas seulement Jook - sur «Glitterbest», on retrouve trois fois Jesse Hector, dans des formations différentes : Hammersmith Gorillas («You Really Got Me»), Helter Skelter («I Need You») et Crushed Butler («High School Dropout»).
Deux morceaux de Jook figurent sur «Glitterbest» : tout d'abord «Aggravation Place». Une mélodie chant hors du commun emmène cette monumentale compo signée Kimmet. On y voit apparaître clairement le cousinage avec Ronnie Lane. Kimmet a bardé son hit glam de grosses parties de guitares juteuses. Ça pue l'Angleterre à dix kilomètres à la ronde. On sent cette énergie qui n'appartient qu'aux glamsters de pure souche. L'autre merveille nichée sur «Glitterbest», c'est «Crazy Kids», un hit signé Trevor White, ensorcelant et tendu à l'extrême, qui aurait dû logiquement finir en tête des charts. Trevor White a le cran de Bowie et il sonne comme Mick Ronson. Alors on ne comprend pas. Pourquoi retrouve-t-on ce hit dans une poubelle ?

Le manager John Hewlett n'avait peut-être pas la carrure de Chris Stamp et de Kit Lambert qui géraient la carrière des Who. Simon Napier-Bell n'avait pas su non plus tirer John's Children vers le sommet, alors que le groupe disposait un vrai potentiel. (D'ailleurs, dans ses mémoires - «BlackVinyl White Powder», Napier-Bell ne s'attarde pas trop sur John's Children, un groupe qu'il ne prenait pas au sérieux, il s'intéressait davantage à Bolan qu'il fit entrer dans John's Children comme guitariste et compositeur, après avoir viré le pauvre Geoff McClelland - et en faisant la chèvre, Bolan massacra au passage quelques morceaux).
Un an après «Glitterbest», Tony Barber et Phil King sortaient enfin sur RPM les œuvres complètes de Jook sous le titre «Different Class». Un texte superbe de Mark A. Johnson accompagnait le CD. Ce travail compilatoire rassemble les cinq singles magiques et des inédits. Quelle pétaudière ! On se retrouve une fois de plus avec un objet sidéral entre les pattes : deux spécialistes du glam anglais ont rassemblé les pièces d'un puzzle mythique. Petite cerise sur le gâteau : les photos de Jook sont signées Gered Mankowitz, le mec qui a photographié les Stones à Primrose Hill, par un petit matin de novembre 1966, pour la pochette de «Between The Buttons».
«Different Class» ouvre le bal de cette compile et on se retrouve avec une belle énormité taraudée par un solo de guitare dément. Tout y est. L'élégance des basslines, l'épaisseur du son des power-chords, et l'incroyable arrogance des textes : «Frankie, Pete and Mohair Sam suss out the local yobs, when we come to dance, we can't take a chance of being hit by a rival mob !» (Quand on sort, Frankie, Pete et Mohair Sam vont faire du repérage, car quand on va danser, on ne prend pas le risque de se faire casser la gueule par une bande rivale). Fin de morceau en folie.
Et voilà qu'ils tapent dans «Watch Your Step», le fabuleux standard r'n'b de Robert Parker que reprenaient les Move pour boucler leur set. Le solo de Trevor White est une pièce d'anthologie abracadabrante. Avec Jook, on voit l'éventail des possibilités s'élargir de morceau en morceau. Ils ont la même puissance de feu que les Birds, le premier groupe de Ronnie Wood. Le son de Jook reste d'une incroyable densité : rebondi, musculaire, moelleux et hardi. Sacrément accrocheur. Avec cette reprise musclée, on se retrouve au cœur de la culture Mod. Leur version se révèle aussi mortelle que la morsure du black Mamba. Avis aux amateurs. Puis «Bish Bash Bosh» nous cueille au menton : glam pur jus, fin et musclé, amené en douceur et salement percutant. On pourrait qualifier ce hit de mètre-étalon du glam. Just perfect, comme dirait John Peel. Petites guitares délicates, renvois rythmiques assourdis, clap-hands distingués par intermittence, voix perchées, gros riffs, petits doigtés en fond de décor, c'est le glam-anthem parfait, rond, coloré, anglais jusqu'au bout des ongles, d'une authenticité indiscutable.
«Oo Oo Rudi» ? Justement, parlons-en. C'est carrément un hymne ! Un stomper des Terraces parfait, qui sent bon le foot, la pale ale et le glam à chaussettes blanches, emmené par le gros jeu directeur de Trevor White, dans l'esprit des bombes sucrées de Sweet et des embarquements pour Cythère de Mud. On sent bien que les Sex Pistols viennent de là. On ne comprend pas que «Oo Oo Rudi» n'ait pas été caracoler en tête des charts anglais. «Everything I Do» nous tombe sur le coin de la gueule, comme ça, alors qu'on a rien demandé. C'est encore une compo de genius Kimmet. God ! Quelle allure. Ce mec avance avec une assurance qui laisse coi. Il collectionne tous les réflexes du desperado, il n'avance qu'à pas sûrs avec cette élégance nonchalante qui n'appartient qu'à des mecs comme lui. Keith Abbingdon a remplacé Trevor White, aussi le son change, mais le morceau reste d'une classe insolente. «Cooch» est une nouvelle merveille glam dégoulinante de feeling. «I don't wanna couch with you/ I wanna drink I wanna dance/ Come on darling couch with me tonight !» Il faut voir comment Kimmet envoie son chant et comment ce fou de Trevor White triture ses cordes. Ses phrasés n'en finissent plus d'accrocher. C'est du rock électrique absolument parfait, du rock gras, rapide, fervent, hurlé, bien coiffé, incroyablement flashy, qui roule des hanches dans son pantalon blanc.
«La La Girls» est encore l'un de ces hits planétaires retenus à la frontière. Franchement, les mecs de RCA étaient de gros débiles. Ils n'ont absolument rien compris au génie de Jook. Le morceau est arrosé d'une sauce à la Trevor White, moitié arpèges, moitié accords charismatiques, et la mélodie balaye TOUT sur son passage. Que d'enthousiasme dans ce morceau flamboyant ! Le morceau est pourri de refrains monstrueux. Au plan mélodique, c'est tellement inventif qu'on en a le souffle coupé. On peut même aller jusqu'à dire que c'est un modèle de refrain à l'anglaise, du niveau de ce que les Beatles faisaient dans «Baby You Can Drive My Car». Dans la softie «Do What You Can», Ian Kimmet sonne exactement comme Ronnie Lane. Quelle ampleur ! Quel son ! Mais quel son ! On en pleurerait. Jook avait toutes les cartes en main : le son, les compos, la fraîcheur, les guitares, et soudain, Trevor White transperce le morceau avec l'un de ces solos qui frappent les mémoires pour l'éternité. Stupéfiant. Ian Kimmet envoie «That's Time» avec une mâle assurance. La guitare de son ami Trevor se perche sur son épaule, comme un perroquet. Le tempo est lourd, comme un temps d'orage. On s'éponge le front. Tout le génie de Jook jaillit à intervalles réguliers. Quel choc, quel bonheur, et quelle belle revanche : Jook jaillit !
«Mohair Sam» est un classique de Charlie Rich. Attention à Charlie Rich ! On lui doit déjà le fabuleux «Don't Put No Headstone On My Grave» que Jerry Lee envoie rituellement paître au firmament. Jook transforme «Mohair Sam» non pas en chair à saucisse mais en groove fatal. «Moving In The Right Direction» part en trombe. Il pleut des trombes d'accords colossaux et Ian Kimmet s'ouvre comme Moïse un passage à travers l'immensité liquide. Morceau solide et typique d'un groupe anglais visité par la grâce. Avec sa grosse guitare, Trevor White charpente à lui seul tout l'édifice. Signé Gallagher and Lyle, «City And Suburban Blues» est un joli boogie qui rappelle les standards de Dave Edmunds. Petit ricochet d'accords majeurs et solo magnifique de Trevor White, tout en élévation et si kinetic. On atteint les sommets du glam. Jook forever, devrait-on dire. Reprise de Jimmy Reed avec «Shame Shame Shame». Jook fracasse tout, c'est grave. Ils vont trop loin. Bon d'accord, c'est encore un boogie, mais quand-même ! On les sent raunchy, agressifs et gentils en même temps. On attend impatiemment le solo de Trevor White. Ah ! il arrive. Il lâche encore une giclée dégoûtante, il fait son Jeff Beck, il surgit là où on ne l'attend pas. Et pour finir, «Jook's On You» s'abat sur la France comme un fléau biblique. On pourrait qualifier ça de puissante démonstration de supériorité autonome, puisqu'elle sonne comme un classique des Who. Absolument spectaculaire de vérité détourienne.
Sing Sing, petit label new-yorkais spécialisé dans les rééditions de disques cultes, vient de faire paraître «Jook Rule». Ce double album propose exactement les mêmes titres que la compile RPM (épuisée) (plus le précieux texte de Mark A. Johnson, dans son intégralité, et les photos de Mankowitz). Cet objet est bien entendu destiné aux amateurs de beaux vinyles.
Ce sont les Sparks qui vont détruire Jook. Lorsque les frères Mael débarquent à Londres pour relancer leur carrière, il embauchent d'abord Martin Gordon et deux autres musiciens anglais. Comme Gordon est trop brillant, les frères Mael le virent. Devenu manager des Sparks, John Hewlett propose d'engager Trevor White et Ian Hampton, ce qui signe l'arrêt de mort de Jook. Ian Kimmet ne s'en relèvera pas. Il finira comme producteur chez Bearsville, alors qu'il aurait pu devenir l'une des plus grandes stars du rock anglais. Les voies du rock sont impénétrables.
Signé : Cazengler, qui siffle un Jack à la santé de Jook
Glitter From The Litter Bin. 20 Junk Shop Glam Rarities From The 1970s. Sanctuary Records 2003
Glitterbest. UK Glam With Attitude 1971-1976. RPM 2004
Jook. Different Class. RPM 2005
Jook. Jook Rule. Sing Sing Records 2013
Sur l'illustration, de gauche à droite : Trevor White, Ian 'Ralf' Kimmet, Ian Hampton et Chris Townson
ABOUT PIERRE LATTES
Peu de choses sur Pierre Lattès sur le Net. J'ai commencé ma lecture sur Gonzaï pour m'apercevoir que le bel et long article n'était qu'une resucée d'un ancien topo datant de 2006 auquel le peu de monde qui a évoqué la mémoire de ce pionnier des ondes médiatiques s'est référé. Ce n'est pas un reproche, l'on fait avec ce que l'on a. Moi-même n'y ayant la semaine dernière consacré que quelques lignes hâtives.
Alors pour alimenter le maigrelet ruisseau des sources avaricieuses je me permettrai d'apporter une modeste contribution de témoin pas du tout privilégié. Dans la plupart des articles, l'affaire est colportée sous forme de légende – car pour des professionnels de la com il est difficile d'y croire, qui serait assez fou pour se faire virer d'un poste de présentateur d'Europe 1 ! – Pierre Lattès aurait été limogé de la célèbre radio, pour avoir refusé de passer un disque de Mireille Mathieu sur l'antenne. Je n'aime guère Mireille Mathieu mais je pense en cette occurrence pouvoir protester de son innocence, et livrer à la postérité vengeresse le nom de la véritable coupable.
Mai 68 signa la fin d'une époque. Les médias avaient intérêt à se mettre au goût du jour s'ils voulaient garder leur jeune auditorat. Autres temps, autre moeurs, à Europe 1, l'on n'hésita pas à faire hara kiri à l'émission phare de la jeunesse française. Exit Salut Les Copains. Par la grande porte, car dans un dernier feu d'artifice on la rallongea d'une demi-heure tout en modernisant son nom en Super SLC. C'était reculer pour mieux sauter. A la rentrée de septembre l'on eut un droit à un nouvel objet radiophonique que les amateurs de rock identifièrent très vite : Périphéric.
Sam Bernett et Pierre Lattès – ce dernier proprement viré de France Inter pour avoir programmé un peu trop de musique séditieuse – étaient aux commandes. Le principe de la nouvelle émission était d'une merveilleuse simplicité : uniquement de la bonne musique. Venue d'Amérique et d'Angleterre. Pour les Français, seuls Hallyday et Mitchel avaient reçu leur laisser-passer.

En plus, les auditeurs avaient le droit d'intervenir sur l'antenne. Vouliez-vous un renseignement sur tel ou tel groupe ou sur le dernier disque de... il suffisait de demander et nos deux compères en profitaient pour vous refiler des informations de première main ou pour vous raconter petit morceau par petit morceau l'histoire du rock'n'roll et de la pop music...
Ce bonheur pur dura deux mois. La catastrophe arriva sans crier gare. Mais d'une voix criarde. Il y eut une pub, et après la pub - sans annonce, sans rien qui eût pu nous prévenir – un disque de Sheila. L'enfer à l'état brut. Et tout de suite après la voix d'un auditeur colériquement épouvanté qui du fond de son angoisse voulait comprendre : Pourquoi Sheila ? Droit au but et sans fioritures. Et la voix embarrassée de l'animateur – était-ce Pierre ou Sam ? - qui expliquait que l'émission ne retenait pas assez de monde et que les annonceurs publicitaires n'étaient pas contents et menaçaient de retirer leurs billes et que donc... Quelques jours plus tard Périphéric disparaissait de l'antenne. Sans commentaire. Par la petite porte.
Pour moi vous ne m'enlèverez pas de la tête que la manoeuvre ( comme dit Philippe ) était aussi cousue de fil blanc qu'un faire part de décès est bordé de noir. Lattès et Bernett avertissaient leurs auditeurs par cette séquence téléguidée soigneusement mise en scène qu'il était des frontières de la médiocrité musicale qu'ils ne condescendraient jamais à franchir...
Entendu de mes propres oreilles. Voilà d'après moi l'origine de la légende de Pierre Lattès viré d'Europe 1 pour avoir refusé de passer un disque de Mireille Mathieu. Le plus détestable en cette histoire c'est qu'elle traduit une réalité sociale des plus tristes : l'inexistence en la France de 1968 d'un public rock assez étendu pour motiver une émission spécialisée sur une heure de grande écoute. Les combats de Pierre Lattès n'étaient jamais gagnés d'avance.
Damie Chad.
FEUILLETON HEBDOMADAIRE
CHRONIQUES VULVEUSES
TROISIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire. Tous les faits rapportés dans cette oeuvre à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et des gendarmes sont là pour en apporter la preuve définitive.
9
Minuit l'heure du crime. La nuit est enfin tombée. Le Mas d'Azil repose enfin dans le silence nécessaire aux grands moments des scènes les plus angoissantes des films d'action. J'ai rabattu les sièges arrières de la teuf-teuf mobile et nous sommes, Molossa and me, tous deux couchés à même le plancher sous la couverture de camouflage en imitation de peau de panthère, la marque distinctive des agents de la section Rockabilly du SSRR.
Pour le passant innocent, la teuf-teuf mobile offre le profil coutumier d'une banale voiture de touriste stationnée à proximité d'un banal gîte rural, mais non il s'agit d'un poste d'observation stratégiquement choisi en contre-haut de l'infernal repaire de Claudius de Cap Blanc. Sous la couverture sans un bruit Molossa me passe un à un les rouleaux de papier hygiénique qu'elle retire sans bruit d'un sac en plastique.
10
Nous n'avons pas eu un mal de chien à récupérer à Foix, la capitale administrative de l'Ariège - un véritable trou à rats, un immonde lacis de venelles entremêlées au bas du célèbre Château ( celui que l'on visite toujours deux fois ) - le matériel nécessaire à notre équipée nocturne. Partis un peu trop rapidement de Paris, nous avions oublié de nous munir de l'indispensable Mallette de Combat et de Survie du Parfait Agent en action, aussi avons-nous dû nous débrouiller avec les moyens du bord et ceux récoltés chez l'autochtone.
La chance sourit aux audacieux. Au détours d'une ruelle suis tombé sur L'Ivre Lire une vaste bouquinerie de cinq cents mètres carrés aux rayons surchargés de bouquins. Z'avaient même la traduction par l'ami Cat Zengler de Saga of Hawkwind de Carol Clerk, pour vous dire qu'ils étaient super achalandés, et pendant que Molossa opérait une stratégique diversion faisant la belle et une petite flaque de pipi juste à côté d'un client qui rouspéta si fort qu'elle dut lui déchirer le bas du pantalon pour le remettre à sa place, je subtilisai sous mon Tee-Shirt Ghost Highway ce que je ne m'imaginais pas me procurer si vite : le Pif Gadget N° 512.
11
Molossa me donna le scotch et le miroir de poupée que je cassai en trois. Un jeu d'enfant, n'y avait qu'à suivre les instructions pour monter le gadget : un véritable périscope de sous-marin tous terrains. Déjà le rectangle blafard des bâtiments du repaire de Claudius de Cap Blanc s'imprimait sur la rétine de mes yeux aux aguets. J'ai longuement inspecté les environs. Aucune lumière, personne. L'heure était enfin venue de quitter notre pelure tavelée de protection rapprochée de pénétrer dans l'antre maudit du maître de la conjuration vulvaire.
Deux ombres plus obscures que le crime et plus silencieuses que la mort se glissèrent dans l'encre noire de la nuit. Molossa, pattes de velours et truffe au vent, devant en éclaireur et moi à quelques mètres en tirailleur, la clef ( universelle )de contact de la teuf-teuf mobile à la main. L'ai enfoncée ( la clef pas la teuf-teuf ) dans la serrure et en un tour de main nous étions à l'intérieur, prêt à nous lancer dans les plus fructueuses investigations.
12
CARNET PERSONNEL
D'ANALYSE PSYCHOLOGIQUE
DE L'AGENT 009891

Après notre visite de l'antre de Claudius de Cap Blanc je suis maintenant à même de tracer le portrait psychologique de l'individu. N'ayant encore jamais rencontré de visu le susnommé Claudius, je puis avancer que cette analyse d'une finesse exemplaire ne sera en rien freinée par des scories subjectives, je fais d'évidence allusion au terrible Syndrome de Stockholm. Combien d'agents en mission se sont fait retourner comme de vulgaires crêpes au beurre dans dans la poêle à frire d'une trop longue fréquentation avec l'Ennemi qu'ils étaient chargés de neutraliser !
Autant le décréter tout de suite Claudius de Cap Blanc est un homme dangereux. Extrêmement dangereux, car doué d'une intelligence radicale, d'une capacité de travail bien au-dessus de la moyenne humaine, et d'une efficacité dissimulative sans égal.
Il ne nous étonne pas que durant des lustres il ait pu évoluer en toute impunité dans la tranquille commune du Mas d'Azil. Pensons que voici une dizaine d'années le Conseil Municipal lui a remis en mains propres une vaste friche industrielle d'à-peu près trois mille mètres carrés. L'a bien trompé son monde avec son projet d'Affabulascope, car c'est sous ce nom clownesque qu'il a développé ses funestes activités. L'on a dû croire avoir affaire à un rigolo inoffensif, à un Marcel Duchamp du pauvre, alors que comme le bûcheron de la Fontaine, la municipalité recueillait et réchauffait en son sein protecteur un serpent venimeux, une des plus hautes figures du terrorisme psycho-culturel international.
Une visite méthodique de l'Affabuloscope nous permet de dresser ce constat. Nous allons reprendre point par point les résultats de nos observations en nous appuyant sur la structure même de cet Affabuloscope qui s'étend sur trois étages qui correspondent de fait à trois degrés exponentiels de nocivité.
Visite du rez-de-chaussée : il doit être impossible de dresser le compte des touristes qui sont ressortis de la visite de l'Affabuloscope en étant persuadés d'être en présence de l'oeuvre du Léonard de Vinci du vingtième siècle. Mais à contrario de son illustre devancier C. C. B. ne camoufle point ses découvertes dans des carnets secrets dans lesquels le génial rital écrivait à l'envers le résultat de ses inventions. C. C. B. ne boustréphédonne pas. Dévoile tout, montre tout, expose tout. Pour mieux guider votre compréhension il met à votre disposition de nombreuses notes écrites en lettres capitales d'une lisibilité parfaite qui situe le sujet dans son environnement historique, social, scientifique et épistémologique. Pour vous aider à mieux comprendre vous avez droit à une reconstitution ou à une maquette et la plupart du temps à l'objet original lui-même que C. C. B. a parfois exhumé d'un vieux grenier...
Ce sont-là de singulières machines à usages multiples. Pour exemple je ne citerai que cette Fenêtre Portative à roulettes que vous emportez partout avec vous pour jeter un coup d'oeil au paysage à chaque fois que vous en éprouvez l'envie sans être contraint de rester chez vous afin de l'apercevoir depuis la baie vitrée de votre salle à manger. L'on dit que si Christophe Colomb a découvert l'Amérique c'est grâce à cette fenêtre portative qui lui permettait – alors qu'il était perdu au milieu des flots toujours recommencés de l'océan – de regarder dans quel endroit précis la Santa Maria se trouvait.
Doit y avoir près de trois cents objets dans cette immense salle. Tous trahissent le sérieux des études menées par C. C. B., un infatigable chercheur, un extraordinaire fouineur, vous ne savez si vous devez admirer d'abord son souci pointilleux du détail, ou sa scrupuleuse méthodicité, il avoue volontiers ses incertitudes ou son ignorance. Vous ne pouvez que rester admiratif de ses commentaires qui parfois remettent en cause des plages entières du savoir académique, tel qu'il peut être exposé dans les revues les plus prestigieuses comme le Bulletin des Mathématiques Appliquées de Princeton.
Mais il est temps de passer au deuxième niveau.
13
J'abordai la deuxième partie de ma notule lorsque Molossa donna l'alerte. Une silhouette se rapprochait de la teuf-teuf mobile. ( A suivre ).
FIN DU TROISIEME EPISODE
23:26 | Lien permanent | Commentaires (0)
12/09/2013
KR'TNT ! ¤ 155. CHROME CRANKS / JALLIES / DOGS / BOB LUMAN / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE
KR'TNT ! ¤ 155
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
12 / 09 / 2013
|
CHROME CRANKS / JAILLIES / DOGS / BOB LUMAN / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE ( II ) |
PARIS / POINT EPHEMERE / 03 – 09 – 2013
THE CHROMES CRANKS
LES CHROME CRANKS ONT DU CRAN
Quand on vous pose la question : «Quels sont les plus grands hurleurs de l'histoire du rock ?», vous répondez immédiatement Little Richard et Wilson Pickett. Puis, après quelques secondes de réflexion, vous ajouterez sans doute les noms de Frank Black, de Jeffrey Lee Pierce et de Gerry Roslie. Et les plus pointus iront chercher des noms comme ceux de Bobby Hocko (Swamp Rats) ou Chetley Cheetah Weise (Quadrajets, Immortal Lee County Killers).
Mais si on voulait rétablir une sorte de vérité historique, le titre de champion du monde toutes catégories du scream reviendrait à Peter Aaron, figure de proue des Chrome Cranks, ce groupe-vaisseau fantôme qui hante les Sargasses de nos imaginaires depuis vingt ans.

Le groupe semble en effet sortir de l'un des contes les plus sombres d'Edgar Poe. Il se dégage d'eux une sorte de majesté vermoulue qu'on ne retrouve qu'à bord des vaisseaux abandonnés, lorsque dans l'épaisseur des ténèbres, les craquements du bois se mêlent aux hurlements du vent. Ce groupe détient l'indicible pouvoir de hanter à la fois les épidermes et les consciences. Mais ces gens-là ne recourent pas aux petits stratagèmes utilisés par les grands méchants loups du gothique, oh la la, pas du tout. Les Chrome Cranks sont issus d'une lignée urbaine purement new-yorkaise qui remonte au Velvet Underground, à William Burroughs et aux Fugs et qui élève le trash au niveau d'un art suprême. Ils croisent la prodigieuse agressivité du chaos urbain new-yorkais avec l'énergie diabolique de Howlin' Wolf et l'intelligence sulfureuse d'Ambrose Bierce. Ils donnent à la culture trash ses lettres de noblesse, la rendant enfin audible après l'insupportable barbarie sonique issue des scènes hardcore de Washington D.C. et de Los Angeles.
L'aventure commença dans les années quatre-vingt dix par une petite photo publiée dans la rubrique «On» du New Musical Express. Pour les groupes débutants, cette rubrique constituait une sorte de tremplin fatidique. On y qualifiait les Chrome Cranks de stoogiens, alors, il n'en fallut pas davantage. Cap sur le rayon import des deux ou trois disquaires parisiens capables de proposer ça et wham bam, thank you pas mam mais On, ce fut une sorte de jackpot. (J'ajoute que la rubrique «On» du NME fut tout le temps de sa durée une référence absolue.)

J'ai d'abord eu dans les pattes le second album des Cranks paru sur Crypt, «Dead Cool», et ce fut un choc comme on en ressent peu dans une vie d'amateur. Là dessus, cinq morceaux relèvent du pur génie : «Desperate Friend» - enfoncé au pilon, monté sur un riff massif d'une autre époque, de type «Gloria» des Them, glorieux mélange de garage d'Irlande du Nord, de sauvagerie à la Howlin' Wolf et de majesté crampsy - «Way Out Lover» - la bombe du siècle, un champignon atomique de basse fuzz qui dilate le bulbe, pièce imbattable, oh ya ya, balayée par des vagues fuzzo-subliminales, et Peter Aaron hurle à la vie comme à la mort, spectaculaire et vertigineux, c'est battu à la forge derrière, non, il n'existe aucun équivalent sur le marché - «Bloodshot Eye» - pièce purement stoogienne de type «Down In The Street», riff de rue qui s'enfonce dans la pénombre - «Nightmare In Pink» - mètre-étalon du trash-punk new-yorkais, pure giclée de jus, magnifique de délabrement mongoloïde, dynamitée à chaque instant - et l'immense «Shine It On», rien au dessus, tendu dans la chair du punk-rock, irradié par l'ampleur du scream, porté par la clameur de l'insanité, au-delà de toutes les normes, au-delà de TOUT, explosion de toute la pulsion sexuelle du rock. Le morceau le plus hurlé de l'histoire du rock, monté en épingle et explosé au sommet du riff. Qui peut égaler ce screamer fou ? Personne. Cette déflagration sonique surpasse celle des Stooges. Eh oui, on ne croyait pas ça possible et c'est arrivé près de chez vous, une balle dans l'oreille, shine it oooon yeahhhh, l'inaccessible étoile du trash. On prend feu en écoutant ça. Comme si on rôtissait en enfer et qu'on avouait, avec une certaine morgue, adorer ça.

Les Chrome Cranks vont enchaîner trois autres albums remplis à ras-bord de classiques : «Chrome Cranks», puis «Love In Exile», et «Hot Blonde Cocktail». Avec le morceau qui donne son titre à l'album «Hot Blonde Cocktail», Peter Aaron nous plonge dans l'ivresse de la folie. Couplets posés et refrains échappés de l'asile. Personne n'est allé aussi loin que lui dans l'arrachage de barrières de sécurité, à part Antonin Artaud. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer Artaud à notre époque. Il aurait adoré les amplis Marshall et les Fender Jaguar, les flaques de bière sur la scène et les traces de sang sur le tablier de la guitare. Il aurait hurlé son ventre de poudre ténue et le sexe du bas de son âme qui monte en triangle enflammé. Il n'aurait pas engagé Marthe Robert ni Jacques Prevel, mais Bob Bert à la batterie, William Weber à la guitare et certainement Jerry Teel à la basse. Peter Aaron se serait incliné devant le maître et aurait accepté de voir son orchestre le quitter. Sur Hot Blonde, on trouve aussi ce vieux classique des Cranks, «Lost Time Blues», fuzzy et riffé comme un classique des sixties, solidement arrimé et secoué de petites explosions intraveineuses - et le screamer le plus ardent du XXe siècle invente le trash éternel, celui qui va marquer les mémoires au fer rouge. Tout l'esprit du rock ultime se trouve piégé dans cette pièce crampsy et maudite. Au-delà, il n'y a plus rien, comme dirait Léo Ferré.

Le groupe a tenu dix ans. C'est un record, pour une pétaudière à huit pattes. Puis vint le split. En 1996, paraissait «Diabolical Boogie», un double album proposant les singles, les démos et les raretés. Peter Aaron profitait de l'occasion pour écrire un texte d'introduction digne de celui proposé par Lux Intérior dans «How To Make A Monster». Ce texte magistral s'intitule «Cordes cassées, rêves brisés (et des crachats)». En voici le début : «Ce n'est pas un texte de présentation, c'est un exorcisme. Pour moi, en tous les cas. Oh je sais que ça peut sembler pathétique. Je veux dire, les Chrome Cranks n'étaient rien d'autre qu'un groupe de rock en plus. Mais c'était MON groupe. Être dans un groupe, c'est comme être marié. Quand un groupe s'arrête, comme le font la plupart des groupes, c'est dans la grande majorité des cas pour les mêmes raisons que celles qui détruisent un mariage : la jalousie, l'absence de communication, l'arrogance et parfois des abus de substances. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça oui, on a eu tout ça dans les Chrome Cranks, et à la puissance dix. Moi-même, je peux plaider coupable pour au moins deux des raisons citées (mais pas la dernière, à moins que vous ne considériez la caféine et la nicotine comme des drogues). J'aurais bien aimé pouvoir comprendre tout ça à l'époque, mais... Toujours pareil, blah blah blah, à quoi bon ?» Il rend ensuite hommage à ses amis Jerry Teel, Bob Bert et William Weber : «En observant le line-up classique des Chrome Cranks depuis mon promontoire du XXIe siècle, je vois un ensemble de choses qui permettent de distinguer le groupe de la scène garage classique et «rétro» à laquelle on nous rattachait. On avait des atouts comme par exemple les lignes des basse néandertaliennes de Jerry, ou la distorse de dingue et l'insupportable volume sonore que je sortais de mon ampli. C'est la frappe extrêmement brutale de Bob qui emmenait le groupe, et il frappait toujours comme un malade, que ce soit sur scène ou en studio. Et comme je suis un fervent amateur de rock depuis trente ans, je peux vous dire en vous regardant dans le blanc des yeux qu'il existe peu de guitaristes du niveau de William G. Weber. Ce mec anormalement doué peut jouer dans n'importe quel style et il joue bien mieux que n'importe quel guitariste de la scène new-yorkaise des années 90 - et même encore aujourd'hui - et bizarrement, personne n'a pensé à enregistrer ce guitariste de génie. Oh, n'oublions pas ce screamer fou qu'on entend sur les vieux morceaux rassemblés sur cet album, je suppose qu'il fait lui aussi partie des atouts. Peut-être n'étions-nous pas le groupe le plus original de l'histoire du rock, mais on y croyait dur comme fer et on a vraiment essayé de rester aussi inventifs qu'on le pouvait, tout en restant dans la cadre que William et moi avions pré-défini au départ. En règle générale, les journalistes appréciaient beaucoup les Cranks.»

Véritable fatras hystérique, «Diabolical Boogie» dégueule de fuzz et de scream de partout. Avec les Chrome Cranks, on est sûr d'aller de blast en blast. C'est écrit, comme dirait Léon Bloy, le grand punkster de l'Avant-siècle. Sur quel autre disque peut-on trouver un tel shoot de trash-blues toxique ? Aucun. L'objet reste unique au monde. Dès le premier morceau, «Love And Sound», les Chrome Cranks nous plongent la tête dans leur chaudron, c'est trashé dans l'âme, yah-yah ! Et Peter Aaron hurle comme un beau damné, il explose de trashitude céleste, il est l'empereur du trash derrière lequel l'herbe ne repousse pas, il bat tous les records de hurlements de Sainte-Anne, il hurle comme s'il voulait conjurer tous les démons de la création («The Big Rip-Off»), atmosphères plombées et rafales de scream, telle est leur recette, on a l'impression de voir un morceau en putréfaction, ou des organismes incandescents, succession de couplets hurlés dans la nuit glacée («Sacred Soul»), Bob Bert cogne dans tous les coins, solos outranciers et écarts de voix impardonnables («Street Waves», reprise de Pere Ubu). «Pin-Tied» est un clin d'œil au swamp-blues. Les alligators de Screamin' Jay Hawkins et de Roky Erickson se pavanent dans la mélasse sonique. Les Chrome Cranks sonnent parfois comme ces pauvres tarés de Birthday Party. Ils prennent le parti-pris de l'épaisseur du non-retour. C'est une abomination. Peter Aaron vient hurler par là-dessus. On retrouve l'atmosphère des Scientists, les ambiances irrespirables, les moustiques, les sangsues, les Seminoles, les flèches et les cadavres qui flottent. La musique tournoie sur des accords séculaires. Et puis ce «Red Dress», d'une rare violence, embarqué au scream et viandé à coups d'accords stoogiens, pur génie trash, sommet de la vraie jute et screamé jusqu'à la racine du son primal, comme s'ils ouvraient une voie vers une nouvelle sorte de folie libératrice. Une folie de la modernité, telle que la concevait certainement Artaud. Stoogerie encore avec «Collision Blues», mais les élèves dépassent les maîtres, Peter Aaron pose une voix à la Iggy sur un beat rebondi et ça devient rapidement effrayant de collusion collutoire, puis ça jaillit et ça explose dans le magma des enfers rouges d'un cerveau en contusion, yah yah yah ! celui de Peter Aaron. Ils semblent encore s'enfoncer dans le chaos avec cette version de «Burn Baby Burn», drumbeat dément, l'une des intros du siècle, beat plombé, menaçant, l'empire du binaire de la mort noire, et Peter Aaron fait le loup derrière. Les guitares se fondent dans la fournaise. La voix de Peter sort du fond de la crypte. Le beat enfonce les clous. Bob bat le beat des dieux viking. Peter Aaron sonne comme Lux Interior. La pression est terrible. Et soudain, ça se met en route, ça tourne garage, mais garage en feu, c'est hallucinant de barbarie sonique, qui va aller chercher des enfers pareils, à part les Chrome Cranks ? On entend les pas traînants des guerriers ivres de carnage dans les rues de la ville en feu, c'est agité de violents spasmes de riffage sixties. Dans «Come In And Come On», Peter Aaron hurle comme Dracula - Scream Dracula Scream - et William Weber arrose le chaos de jus de bottleneck. Ça sent la friture. Nouvelle version du blues des catacombes, «Lost Time Blues», Peter Aaron fait son bouc émissaire des enfers, c'est dingue ce qu'il peut bien hurler. Dingue, vraiment dingue. Tout est là, dans le néant du scream. On tombe ensuite sur une version live de «Draghouse» : une sauvagerie sans équivalence dans toute l'histoire du rock. Un métro lancé dans la nuit, sans but ni conducteur. Ce truc sonne comme un cauchemar de la révolution industrielle. Une charge de la brigade légère glorieuse et héroïque, une épiphanie des clones du fourbi définitif, du Lovecraft fondu déversé dans l'œil d'Absalon, ça hurle comme sur les croix des hérétiques, à l'époque où l'on fouillait les chairs au fer rouge et où l'on faisait issir les moelles. Ils font même une reprise de «Little Johnny Jewel», le premier single de Television : la reprise du siècle, n'ayons pas peur des mots. Hantée. Esprit es-tu là ? Et puis pour finir, un glam du diable avec la reprise de «The Slider» de TRex. Chaos technique. On sort de ce disque complètement sonné, en maudissant le ciel. Trop éprouvant pour les nerfs, surtout quand on les sait fragiles. Mais si le radicalisme sied à votre tempérament, alors c'est l'orgasme intellectuel garanti, la commotion sidérale. Ça peut même aller jusqu'à la révélation.
Les Chrome Cranks, c'est en effet le groupe parfait. Ils disposent de tous les éléments de choix : le son, le look, les compos, l'esprit, la démesure, le goût du chaos et une certaine «wasted elegance».
Puis, pendant dix ans, aucune nouvelle de Peter et de ses amis. Rien. Pour les admirateurs du groupe, ça semblait incompréhensible. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi les Chrome Cranks vendent-ils moins de disques que Blur ou Radiohead ? Comment lutter contre une telle injustice ?

Et puis le miracle est venu d'un label indépendant du pays basque espagnol, Bang Records. Entre 2009 et 2013, trois nouveaux albums des Chrome Cranks sont parus sur cet audacieux petit label (qui réédite aussi le Gun Club et les Scientists - il n'y a pas de hasard, Balthasar). «The Murder Of Time» est une compilation, par contre, «Ain't No Lies In Blood», c'est bel et bien l'album de reformation du groupe. C'est toujours aussi hanté, aussi pilonné, les Cranks appliquent les mêmes vieilles recettes apocalyptiques, multipliant les violentes montées en température. Dans une reprise de Roger McGuinn, «Lover Of The Bayou», William Weber déverse des déluges de notes et Bob Bert démultiplie à l'infini les doublements de redoublements. Ils sont encore plus enragés qu'avant. Sur «Rubber Rat», ils virent jazzy, avec un son musclé, vaillant et déterminé. Jerry Teel y joue une ligne de basse souple et élastique. Avec «Star To Star», ils renouent avec le grand art abyssal, dans une ambiance ténébreuse et dangereusement électrisée. «Broken Hearted King» est monté sur une structure bombastique ultra-puissante, un beat de surmenage valvulaire agité de pulsations animales. Encore un morceau mauvais et hérissé. Et Bob bat comme une bête. Toujours ces purées fumantes de distorse et de chant hurlé, comme au temps béni de «Doll On A Dress» et de l'immoral «Dirty Son (Lie Down/Fade Out)».

«Moon In The Mountain» vient de paraître. Cet objet original propose une face en 33 tours et une face en 45 tours. Je recommande la face 33 tours. On y retrouve des morceaux anciens enregistrés pour une radio anglaise, et notamment «Wrong Number» qui vous cueille au menton avec son pilon de grosse caisse, ses couplets vomis et ses cisailleries de guitare. Du velours pour les tympans. Sauvagerie démente ou démence de la menthe, olé ! Merci Bang ! On retrouve ensuite «2:35» avec ses accords martyrs et ses virulences à répétition, «Backdoor Maniac» et ses dynamiques perverses et ses vibrillonnages de scream, ils appuient dessus comme sur une boule de pus, ça gicle ça hurle et ça cavale, yaaah yaaah comme dirait Peter. Bel hommage à Wolf avec «We're Goin' Down», même uh-uuuuh, avec des down qui pleuvent comme vache qui pisse et ça se termine avec un «Down So Low» qui bascule dans une biscaille épaisse et drue. Tout y est. On appelle ça un fantastique album de rock.
Comme Peter est un hyper-actif, il mène un projet parallèle, Avondale Airforce, en compagnie d'un nommé Stanton Warren. Cette fois, ça sort sur Beast, le petit label rennais qui monte. On se retrouve avec un album fascinant et complètement différent de ce que fait Peter avec les Cranks. Il travaille sur des riffs basiques et répétitifs et laisse partir les guitares en différé. L'une part en solo languide et l'autre barbouille un fond de bouillie impavide et jugulée à l'extrême. Tous les morceaux sont des drug-songs maladivement belles comme «Touch My Mind». Il monte aussi des grooves binaires dignes des Cramps, comme dans «Five Seconds». Ce mec est brillant. Shine It On. Il va chercher des sons de réverb vinaigrée bien étudiés. «Stare At The Sun» est une pièce expérimentale hallucinogène de peu de foi et sifflée sur le tard, comme pour mieux envoûter l'auditeur imprudent. Il termine avec «Come To Terms», une balade en demi-teinte doublée d'une scie de distorse. Il joue un solo liquide en continu et place un chant de tuberculeux languide à la Syd Barrett. Encore une fois, le seul mot qui vienne à la bouche, c'est : révélation.

Inutile d'aller chercher des adjectifs pour dire à quel point on était tous contents de revoir les Chrome Cranks sur scène à Paris, au Point Éphémère, par une belle soirée d'été indien. Avec un petit effort d'imagination, on pouvait entendre l'océan clapoter dans le bassin du canal et les mouettes couiner tout autour. Cui-cui-cui ! Comme les pingouins mais aussi comme les péronnelles qui bavachaient aux alentours. William Weber a pris un peu de poids, Bob Bert porte des lunettes et deux mèches blanches ornent son front, Jerry Teel porte une barbichette et un petit chapeau, comme sur les pochettes des albums de son groupe Chicken Snake. Par contre Peter Aaron n'a pas vieilli. Il garde exactement la même allure qu'avant. Stupéfiant. On pourrait le croire vampire, si on se laissait aller à rêvasser. On éprouve une certaine émotion à les voir s'installer sur scène. Les Chrome Cranks sont des héros invulnérables, ne l'oublions pas. Et crack ! Ils envoient la purée sans aucune formalité, on entend battre le gros laminoir des forges du Creusot, bah-boum, bah-boum, et Peter se met à hurler comme un damné, yaaaah-yaaaah. William fuzz-man Weber joue assis. Jerry Teel promène son regard d'aigle sur le public et claque ses grosses basslines binaires et bien épaisses. Bob Bert bat comme Thor. Ses sticks s'abattent comme des marteaux. L'hypnotisme des Chrome Cranks, c'est lui. Crank it up, Bob ! Tambour de guerre ou pilon de forge, bah-boum, bah-boum, c'est au choix. Ils passent une série de classiques à la moulinette, «Nightmare In Pink», «Hot Blonde Cocktail», «Draghouse» et quelques morceaux du dernier album comme «Rubber Rat» et «Star To Star». Ils reviennent jouer deux morceaux en rappel dont le défenestrant «Way Out Lover» qui fait valser pas mal de têtes. Peter Aaron dégouline de partout. Pour lui, le compte est bon.

Edgar Poe nous cueillit en fin de soirée. Retour sur Rouen impossible. Les deux tunnels et les accès A86 fermés. Alors nous nous mîmes à errer pendant des heures, de banlieue en banlieue, nauséeux et hagards, révoltés et ivres de fatigue, comme si le trash des Chrome Cranks prenait enfin tout son sens.
Signé : Cazengler, encore un qui ne change pas de chromerie
The Chrome Cranks. Point Ephémère. Paris Xe. 3 septembre 2013
The Chrome Cranks. Chrome Cranks. PCP Entertainment 1994
The Chrome Cranks. Dead Cool. Crypt Records 1994
The Chrome Cranks. Love In Exile. PCP Entertainment 1996
The Chrome Cranks. Hot Blonde Cocktail. Konkurrent 1996
The Chrome Cranks. Live In Exile. Au Go Go 1997
The Chrome Cranks. Oily Cranks (Early Rare Material). Atavistic 1997
The Chrome Cranks. Diabolical Boogie. Atavistic 2006
The Chrome Cranks. The Murder Of Time (1993-1996). Bang Records 2009
The Chrome Cranks. Ain't No Lies In Blood. Bang Records 2012
The Chrome Cranks. Moon In The Mountain. Bang Records 2013
Avondale Airforce. Avondale Airforce. Beast Records 2012
Sur l'illustration, de gauche à droite : Bob Bert, Willam Weber, Peter Aaron et Jerry Teel.
THOURY FEROTTES / AU THOURY
/ 07 -09 - 2013 / THE JALLIES
Ce n'est pas dans la jungle birmane, mais juste à côté. Quelque part, pas très loin du confluent de la Seine et de l'Yonne, en un de ces endroits perdus où la main de l'Homme n'a jamais mis le pied, si peu fréquenté que les Ponts-et-chaussées se sont abstenus de le signaler par des panneaux indicateurs à moins de deux kilomètres à la ronde. Peut-être vous demandez-vous ce que je fais dans cette obscure campagne perdue au milieu de nullepart alors que guidé par les mille feux de Disney, je pourrais me diriger en toute tranquillité vers le festival rock du Billy Bop's afin d'admirer les Obscuritones. D'autant plus que dans sa pénultième chronique ( livraison 153 du 29 aôut dernier ) le Cat Zengler nous a mis l'eau à la bouche avec leurs trois minettes aguichantes à souhait, dont deux qui se servent de leur tambourin comme d'un volant, un truc dont la teuf-teuf mobile me rabat les oreilles depuis quinze jours.
Oui, mais moi je suis fidèle en amour – j'enlève les nombreuses exceptions qui confirment cette règle intangible – et pourquoi courir après trois donzelles anglaises qui ne baragouinent pas un seul mot de français quand je sais que je vais être accueilli par trois minois souriants les plus réjouissifs de la Seine & Marne. C'est que ce soir les Jallies font leur concert de reprise, le premier de la saison, après ces interminables mois d'été durant lesquels nous avons été privés de leur lumineuse présence.

Apparemment, suis pas le seul à courir au rendez-vous, la rue principale du village – il y en a tout de même deux – est encombrée de voitures. Suis obligé de me garer chez l'habitant dans une cour intérieure. De la lumière fuse de l'entrée du Thoury, une maison avec porte et fenêtres transformée en café. Z'ont rajouté un mini marabout par devant pour abriter tout le monde. Ambiance sympa, familiale et plutôt jeune. Consos pas chères et assez de viande dans mon sandwich pour nourrir la chienne toute une semaine.

Julios est là, tout heureux d'être un instant débarrassé de ses trois harpies qui se changent. L'est tellement soulagé qu'il a même un sourire pour m'annoncer la mauvaise nouvelle du futur CD qui prend du retard à cause de la pochette. Surprise, les trois grâces surgissent de la cuisine et tout le monde se précipite pour une bise... Vous fais grâce des retrouvailles. L'on devrait leur interdire de partir en vacances.
Au Thoury, ils ne font pas les choses à moitié, ils ont dégagé l'équivalent de deux pièces de telle manière que le groupe ait un peu d'espace, de même que la foule qui se presse devant les stars.
PREMIER SET
C'est parti. We are the Jallies qu'elles chantent avec cette perverse candeur qui les caractérise. On le sait, alors en profite pour les zieuter de près. Toutes souriantes et pétillantes. Ceux ou celles qui vous raconteront qu'ils se sont avant tout intéressés à la Gretsch d'Ady sont des menteurs ou des menteuses. Car Ady Blue arbore un de ces décolletés mirifiques, que nous qualifierons d'estival, une échancrure à fondre la banquise ! Et lorsqu'elle entonne Be Bop a Lula elle y met tant de fougue et de foudre que l'on sent que c'est parti pour une bonne soirée.
Le piou-piou blond qui tape comme une délurée sur sa caisse claire, c'est Vanessa, l'a ébouriffé ses cheveux qui frimoussent autour de son minois comme une couronne d'or. Espiègle et taquine, la mignonnette pétille comme les bulles d'un champagne millésimé. Contraste parfait avec la raucité de sa voix.

Suis devant en plein milieu – le meilleur endroit pour l'acoustique de la salle – à égale distance des deux miss, la brune vénéneuse et la blonde boppante, juste en face de Céline. Qui me subjugue. L'a jeté sa robe rouge aux orties, lui a préféré un jean corsaire et un foulard de pirate savamment noué sur sa tête. Trois fois rien, mais d'un chic inimaginable. Sveltesse de gabier virevoltant sur les haubans. Frégate de combat qui file trente noeuds, prête à l'abordage, elle caracole sur les partitions, se moquant de toutes les difficultés.
Elles nous en mettent plein la vue pour pas un rond – aurais-je oublié qu'aucun droit d'entrée n'était exigée – par bonheur il y en a un par derrière qui bosse. Ne s'est pas fait une crête à l'iroquois lui, n'a pas emprunté le boa de sa grand-mère, lui – a simplement emmené son outil de travail, et il stakanovise comme un malade, de toutes les manières peut pas faire grand-chose d'autre, les trois chipies - du genre tais-toi et travaille - lui ont chipé son micro et il n'a plus qu'à plancher sur le bois de sa contrebasse, pourrait aussi se pendre de désespoir à ses cordes qu'elles ne s'en rendraient pas compte. Mais l'on sent bien qu'il y trouve son paradis à fréquenter ces trois Cruella d'Enfer.
Nous aussi. Leur faut encore une victime supplémentaire. Voici qu'elles appellent Jérôme sur scène. Troisième fois qu'il apparaît dans nos chroniques. Le pauvre sait ce qui l'attend. Hurle qu'il n'a pas le temps et se précipite vers le bar car l'alcool aide à oublier les situations les plus terribles. Bonnes filles elles lui laissent le temps d'un morceau pour boire le verre du condamné. Mais nul n'échappe à son destin, et le voici de nouveau rappelé à l'ordre. Le relèguent tout de suite au fond, à côté de Julien. Ce n'est pas parce qu'il joue de la trompette qu'il faudrait qu'il se la pète un peu trop.

Elles en rajoutent un peu. Juste une. Une copine, avec un adorable sourire – quatre filles maintenant sur scène – et la nouvelle venue qui fait les choeurs. Belle voix, très rhythm and blues, du punch et de l'ampleur contenus. S'éclipse sous les applaudissements, avec Jérôme qui n'a pas démérité. L'on comprend pourquoi Imelda May a un trompettiste dans son band, tout compte fait cet instrument souligne le côté swing du rockabilly.
Et le show continue. De la petite bière. L'on sent qu'ils sont contents de se retrouver et de s'amuser ensemble. Particulièrement sur leurs propres créations. Retrouvent leurs marques sans coups fourrés. Se glissent dans leur musique avec délectation et le public en est le premier bénéficiaire.
ENTRACTE

Discussions à tout rompre devant le café car dedans officie, coupe rasta et paumes virevoltantes, un virtuose du djembé. Sait ne pas être ennuyeux sur son instrument, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'amateurs. Captive toute une partie du public.
DEUXIEME SET
Nouvelle recrue. Thémis, un peu impressionnée de sa propre audace au début, l'est vrai qu'elle est bien jeune du haut de sa dizaine d'années et qu'elle esquisse quelques mouvements de danse avec timidité. Nos trois furies l'accueillent – elle détient l'insigne privilège de ne pas être un garçon – avec une telle délicate attention qu'elle finira par s'enhardir jusqu'à reprendre les choeurs au micro sur Whole Lotta Shakin' goin' on. Une future clapper girl. Bon sang ne saurait mentir.
Ne nous laissons pas distraire. Nos trois Jallies sont en forme. Ady a quelque peu évolué dans son jeu de guitare, nous propose un son légèrement moins clair et un peu plus appuyé, une veine bleue de blues noir qui bat sous la peau blanche du rockab-swing. Quand elle chante, elle saisit les morceaux à pleines dents comme un chien enragé qui ne veut plus lâcher le gigot qu'il vient de voler. Muddy Waters criera-t-on dans le public et à son sourire l'on comprend qu'Ady aime patauger dans les eaux boueuses du blues.

Du côté noir de la force les Jallies nous offriront un classique de Hank Snow – chantre du country – mais annoncé selon la version de Ray Charles. Un des plus forts moments de la soirée, qui n'en a pas manqué. Faudra se souvenir aussi dans la série rural blues redynamisé de la version de Goin'up to the country, la partie de l'harmonica remplacée avec brio et imagination par la trompette de Jérôme. Un plaisir rare.
Les filles ne pensent qu'à ça – je pense qu'il s'agit de la recette de la sauce à la béchamel – nous annonce Céline et elles s'aventurent dans une interprétation particulièrement leste et enlevée de Shave Your Pussy – en l'honneur des Spunyboys qui ont l'air d'avoir marqué l'esprit de ces demoiselles.
Un set classique, avec deux pépites de Gene Vincent chères à mon coeur, mais vitesse grand V, un tourbillon endiablé de rythme et de bonne humeur. Julios qui s'escrime sur sa contrebasse par derrière et les trois belles par devant qui vous enfilent des perles de rockab à en-veux-tu, en-voilà. Vous font perdre la tête, mais elles maintiennent le cap au nord les trois sirènes toutes pimpantes qui bondissent sur les vagues de notre bonheur.
Ne doivent pas avoir de maire dans le village, car personne ne vient s'entremettre pour dire que les musicos font trop de bruit, pourtant les fenêtres sont ouvertes, et les Jallies font leurs derniers rappels pépères ( je n'ose pas dire mémères ), épuisées mais aussi heureuses que nous.
Gros succès.
END OF THE ROAD
La Société veille. Un voisin compatissant vient à temps nous apprendre que la maréchaussée tend un guet-apens alcoolémique à la sortie du village. Citoyens, dormez sur vos deux oreilles, le rockabilly ne passera pas ! Pour sûr on est tous partis du côté où ils ne nous attendaient pas.
Damie Chad.
DOGS !
TOO MUCH CLASS...
DOGS, L'HISTOIRE
CATHERINE LABOUBEE
( Avril 2013 / www.la belle saison.fr )
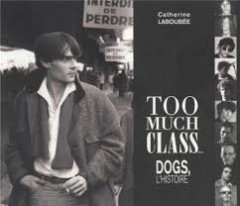
Longtemps j'ai connu les Dogs avant même de les avoir entendus. Savais qu'ils existaient et cela réchauffait le coeur. Des groupes de rock, les étagères de ma chambre en était pleines, pour la plupart britons et amerlocs. En 1974 les Dogs n'avaient même pas encore enregistré un disque, gîtaient à Rouen à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, mais ils avaient l'incomparable mérite d'être français. Ce n'est pas que je fusse particulièrement nationaliste mais à l'époque en 1974, accrocher un wagon à la loco Variations était un enjeu problématique. Pour ceux qui ne le sauraient pas les Variations jouèrent en première partie des New York Dolls aux Etats-Unis... Bien sûr après 1968 l'on avait assisté à un renouveau rock en douce France, mais enfin quand on consentait à enlever le sonotone de l'indulgence franchouillarde des groupes comme Triangle et Ange étaient loin du compte... Elèves appliqués mais peu brillants. Leur manquait l'essentiel ce que possédaient les Dogs, l'esprit rock.
Leur faire-part d'existence je l'ai reçu comme tout le monde, par Rock & Folk, le premier envoi de Philippe Manoeuvre à la revue que vingt ans plus tard il dirigera. Assez convaincant pour lui faire confiance les oreilles vides. Incroyable mais vrai, il existait donc de par chez nous un gang de provinciaux qui s'inscrivaient dans le sillon des Stooges, des New York Dolls, de Doctor Feelgood, saut qualitatif sans précédent de tout jeunes gens se branchaient directement et sans équivoque sur la planète électrique qui orientait nos rêves les plus furieux.
Et puis la vie a suivi son cours. La mort aussi. N'ai jamais eu la chance d'assister à un concert des Dogs, les disques, les articles, les notules qui faisaient régulièrement le point sur le devenir du groupe dans les revues idoines, oui. Jusqu'à ce jour de 2002 où la radio a annoncé la disparition prématurée de Dominique aux States. Coup d'oeil malicieux du destin six ans plus tard Petit Pois des Variations décèdera aussi aux USA...
Il y a quelques années de cela j'avais remarqué dans Rock & Rolk la courte bafouille de Catherine Laboubée demandant à toutes les personnes qui avaient rencontré ou croisé son Dominique de lui envoyer leur témoignage afin de travailler à une bio de son frère... Là encore le temps a passé, et quel plaisir d'apprendre encore une fois dans R & F que le livre était enfin en vente... Bel objet rectangulaire, dominantes de photos en blanc et noir qui collent à l'esthétique du combo, documents rares, belle écriture, un objet hommagial composé avec ferveur.
LA CAT’ HERINE

Pas vraiment une passionnée de rock. C'est Mais la petite soeur a admiré le grand frérot cela se sent. C’est elle qui se chargera de la paperasse du groupe. Secrétaire de direction et pesez bien le sens des deux mots. Son truc à elle, il est en plumes mais de celles que l'on applique sur les feuilles de papier. Historienne qui s'est spécialisée dans les bios savantes comme celles des parents de Charles le Téméraire ( qui finit mangé par les howlin' wolwes ) mais aussi des contemporains, plus humbles, qui ne veulent pas quitter cette vallée de larmes sans laisser, en ultime témoignage à leur proches, la relation de leur vie à transmettre aux petit-enfants et plus si continuation génétique...
S'est aperçue un jour que de s'occuper des inconnus c'était bien mais que l'existence de son propre frère et des Dogs n'interpellaient plus beaucoup de monde. Les rééditions de disques se faisant rares, hormis des groupes de fanatiques, et la région natale de Rouen, la saga des Dogs est désormais en passe d'être versée dans la colonne pertes et profits du rock'n'roll français. Aussi a-t-elle pris son bâton de pèlerin afin de ranimer la flamme du souvenir...
NAISSANCE
Pour une fois les chats accouchèrent d'un chien. Parents pharmacien et toubib, Dominique est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Avait tous les atouts pour finir jeune cadre dynamique. Ne se départit jamais d'une certaine nonchalance attentive, d'une aisance naturelle, d'une discrétion injonctive à entraîner les autres dans son sillage. Le reste d'une éducation bourgeoise – le gros mot qui fait peur - assumée. Une grande maison de vacances au bord de la mer à Saint-Valery-en-Caux, des parents compréhensifs qui laissent porte ouverte – la table et le lit aussi – aux copains et qui n'exigeront pas de leur fils qu'au sortir de ses vingt ans il renonce à ses rêve d'adolescent et songe à se préparer un avenir sérieux... Dominique s'inscrira en licence de lettres, mais même s'il est attiré par la littérature symboliste, sa vraie vie est ailleurs. Dans la musique. Dans le rock'n'roll.
1973 – 1975 / UN GROUPE DE ROCK
La meute des chiens se rassemble très tôt. De tout jeunes chiots qui s’en vont jouer dans le grand jeu de quilles du rock’n’roll. En 1973, en France et à Rouen, ils ne gênent personne. Lubies de gamins qui leur passera avant que ça ne reprenne à d’autres. Même Rimbaud l’a dit, l’on n’est pas sérieux lorsque l’on a dix-sept ans. Ou même seize. Sont quatre, Michel Gross l’ami d’enfance qui délaissera la guitare pour la batterie, François Camuzeaux le parisien en vacances surnommé Zox à la basse qui en 1974 ramène de la Capitale un pote à lui qui sait jouer de la guitare ( tout de même ! ) Paul Péchenart. Dominique Laboubée le grand catalyseur d’énergie. Ce début à trois puis cette conjonction à quatre se retrouvera par la suite dans l’histoire des Dogs. Il est difficile d’échapper à son karma comme disent les hindoux.
Un groupe de rock sans influence, ça n’existe pas. Même Elvis s’est inspiré de Roy Hamilton. Les Dogs ont déjà en ces jeunes temps du rock’n’roll l’oreille dans le rétro. Branchés sur les sixties, les Kinks et le Velvet Underground, plus un groupe américain californien qui eut à l’époque pour le réveil des consciences rock autant d’importance que Dr Feelgood quelques années après eux, les légendaires Flamin’ Groovies. Dans un premier temps les Groovies remontèrent aux pionniers pour saisir l’essence rebelle du rock originel. Mais dans un deuxième ils se convertirent au son anglais, moins de rugosité, moins de violence brute, ou du moins une brutalité sous contrôle, mais une intelligence esthétique du moindre morceau repris ou original. Un cheminement à l’encontre du tout rentre dedans des Stooges et des New York Doll. Le plus anglais des groupes français de rock est une étiquette qui colle encore aux Dogs.

En deux ans les Dogs vont sortir de leur anonymat provincial. Suivent la route rectiligne du rock français empruntée par des milliers de groupes à cette époque qui mène de la sortie du lycée au Golf Drouot. A part qu’ils sont meilleurs que la moyenne, que leurs prestations leur amènent ce premier agrégat de fans sans lequel toute future carrière est inenvisageable pour un combo venu de nulle part. Bénéficient aussi d’un entourage régional positif, l’ouverture en de Mélodies Massacre à Rouen même. Minuscule boutique de disques tenue par Lionnel Hermani branché sur les courants les plus marginaux du rock’n’roll, imports anglais et américains, rares et introuvables. Et puis l’exemple tutélaire de Little Bob Story, le groupe havais de combat rock par excellence.
Le bouche à oreille fonctionne à plein. Encre faut-il savoir résister aux sirènes. Dominique Laboubée n’entend ni brûler les étapes, ni perdre le contrôle de sa création. Les parisiens Zox et Paul, quittent le groupe début 1976, sont récupérés par Larry Martins Factory qui bénéficia grâce à l’entregent de son leader Larry Martin ( rien que le nom du groupe en dit long sur son égo ) d’une bonne programmation radio et d’une belle couverture médiatique, mais qui disparut plus vite qu’il ne l’espérait. C’était ce que l’on appelle un groupe de faiseurs, des gens assez doués pour donner l’illusion aux non-initiés, mais trop peu authentiques pour séduire les connaisseurs.
1976 – 1980 : UN GROUPE DIFFERENT
Le groupe qui vient d’imploser lèche ses blessures. Un copain du lycée Hugues Urvoy de Portzampac – un nom lautréamontesque par excellence – s’installe à la basse. L’année suivante ce sera Jean-Yves Garin qui viendra seconder Laboubée à la basse. Période cruciale pour le groupe qui enregistrera pratiquement en auto production ses deux premiers 45 tours – trois morceaux sur le premier, cinq sur le deuxième, décidément les Dogs trouvent toujours le petit truc pour se distinguer – et pour le rock en général puisque nous sommes dans les années de la grande explosion punk.

Les Dogs ne cèderont pas aux vertiges du punk. Ne jettent pas le bébé du rock avec le tsunami pistolien. Même si les chiens filent un sacré coup de main aux Olivensteins – que nous qualifierons de joyeux plante-merde urticants alliant le vieux fonds d’indiscipline gauloise à la virulence punkoïde -, ils s’accrochent à leurs valeurs. Resteront par exemple fidèles à leurs covers de Gene Vincent, ce qui les inscrit indéfectiblement dans l’historicité du rock’n’roll français.
En 1979, ils signent chez Philips et enregistrent leur premier album, non sans mal – le producteur ne voyant pas plus loin au niveau musical que Michel Sardou ! – Different. Un disque différent qui ne cède pas à la mode du concassage british-punk, mais qui délibérément sonne comme très sixties garage et qui s’offre le luxe d’une pochette de Jean-Baptiste Mondino, photographe rock mode un peu surfait à mon avis, car incapable d’une véritable création. Un artisan mais pas un artiste.
Téléphone bénéficiera lui aussi d’une pochette Mondino, mais ce qui différencie Different de Téléphone, ce sont les accents sur les E. Les Dogs utilisent la langue naturelle du rock. Celle de Shakespeare. Bye bye Molière. Un choix idéologique qui pèsera très lourd dans la diffusion de leur musique en douce France.

Chez Phonogram, filère de Philips, l’on tique un peu sur cette volonté de chanter en français. Walkin’ Shadows sera bien enregistré en anglais mais après moultes tractations le 33 tours sera accompagné d’un simple qui proposera deux titres en français. L’on aura coupé la poire en deux mais Phonogram ne renouvellera pas le contrat. L’on imagine la trombine des grands responsables quant l’on compare les chiffres de vente des Dogs avec ceux de Trust, de Téléphone et de Bijou, qui tous les trois rockent en bon vieux françois… Quant au contenu du disque plus sombre et plus teigneux, ce n’est pas là un argument qui puisse attendrir un décideur…
1981-1989 : LA DECENNIE PRODIGIEUSE
Ne croyez pas aux miracles. Les Dogs capitalisent leurs dix années de galère passées. Nombreuses tournées en France mais aussi en Europe qui attirent du monde. Pourront enregistrer pratiquement un trente-trois tours chaque année, seront couverts d’éloges par les revues spécialisées, mais resteront toujours pour le grand public des marginaux. Ne font pas dans la recherche du consensus mou.

Leur premier album chez Epic / CBS, celui que l’on cite toujours comme une référence absolue du rock français, affirme dès son titre sa différence. Too Much Class for the Neighbourhood, trop classe pour le voisinage, ça sonne comme une claque, cela aurait pu être compris comme une déclaration de guerre. Avec ces six mots – très politiquement incorrect – il y avait de quoi alimenter une campagne de de haine et de dénigrement systématiques. Mais non cela passa comme une lettre à la poste. Tous ceux qui n’aimaient pas les Dogs s’inclinèrent devant cette évidence. Le groupe était à part et malgré de nombreux changements de personnel – l’on remarquera la venue du futur Tony Truant membre émérite des Wampas – l’aura de la formation était trop prégnante pour ne pas arrêter la moindre critique à son encontre. Les Dogs bénéficièrent toujours d’un total respect dans le milieu rock.
Les tournées et les disques s’enchaînent par la suite. Sur leur quatrième album Legendary Lovers ce sera la reprise du Bird Doggin’ de Gene Vincent. Rien que pour cela l’on se doit d’aimer les Dogs. S’en tirent très bien sinon qu’à leur place j’aurais beaucoup plus accentué les lignes de basse, ce fabuleux morceau de Gene Vincent étant construit sur le contraste d’une basse très grave et d’une guitare suraiguë. La Rickenbaker de Dominique offre bien une solution pour exalter les pleurs souverains produits par Al Casey, mais rien n’a été rajouté à la noirceur des profondeurs. L’ouverture et la reprise finale n’ont par contre rien à envier à celle de Gene. L’on en trouvera sur You Tube plusieurs versions live plus ou moins réussies. Pour mémoire nous rappellerons que Noël Deschamps en a aussi offert une adaptation française qui n’est pas à dédaigner, et ce dès 1967.

De 1884 à 1987 les Dogs sont approchés par une des figures essentielles du rock français, Marc Zermati le créateur légendaire du label Skydog, et pièce essentielle de la diffusion du punk en nos contrées retardataires. Les albums se suivent, Shout, More, More, More and A million Ways of Killing Time chez New Rose. Tout semble marcher comme sur des roulettes mais en fait le groupe patauge en ce que l’on pourrait appeler une dépression. Plus de vingt ans que les Dogs courent après les lampadaires du succès… sans succès. Si ce n’est d’estime. Un peu comme quand une fille déclare : “ Je t’aime… bien, tu sais”, et vous comprenez que c’est râpé pour vous.
Comme par hasard en 1987, Hugues quitte le groupe et en 1989, c’est Michel, l’ami, le Mimi de toujours qui s’en va. Entre ces deux dates Dominique a composé Tomber sous le charme pour une jeune égérie de Rouen, Louise Féron. Son 45 se vendra mieux que les disques des Dogs… Le groupe navigue à vue.
1990 – 1999 : DECENNIE DECADENCE
Seuls les empires entrent en décadence et certains historiens assurent que ce sont des années de fastes artistiques. Cherchez l’erreur : les Dogs enregistrent avec John Cale, le violon Trafalgar de White Heat, White Ligth du Velvet Underground pour le futur album de Louise Féron.
Les nouvelles du front sont mauvaises. Le rock se meurt. Les goûts du public sont à l’image des reculades sociales du pays, ils ne se modernisent pas, ils régressent. Cette décennie peu fabuleuse sera celle de l’émergence triomphatrice du rap pour les milieux populaires et le public rock qui se réduit comme une peau de chagrin change le fusil d’épaule. Le rock alternatif prend la relève. Se présente comme un mouvement festif anarchisant ouvert à toutes les musiques du monde. C’est un rock qui a perdu son ancrage originel, il ignore les pionniers et se détourne du blues décidément peu joyeux.

Les Dogs sont redevenus un trio qui durera jusqu’en 1996. Sont partout et nulle part. Sur tous les Tributes élevés à la gloire de la génération punk perdue… Bye bye Johnny Thunders. Sur scène, ils sèment des graines. Nombreux qui les verront en ces époques de reflux rock en garderont le souvenir impérissable d’un groupe qui brûle ses dernières cartouches avec une classe folle. Le rock meurt mais ne se rend pas.
Dominique s’intéresse à deux groupes locaux de par chez lui, Césium et Chainsaw. En octobre 98 et 99 sortent les Volumes I et II de 4 For a Kind qui réalimentent le buzz autour du groupe. La traversée de la mer des Sargasses est terminée.
2000 – 2002 : THE END, BEAUTIFULL FRIEND
Et la roue tourne, le rock redevient à la mode via les Libertines… Les Dogs ont pratiquement trente ans dans le buffet. Question longévité ils sont les Rolling Stones français. La télé se souvient de leur existence. Le titre du double live sorti en août 2001 est à entendre comme un bilan prémonitoire : Short, Fast and Tight. La reconnaissance arrive de tout côté mais il se fait tard dans le jour du monde des Dogs. La mort survient comme l’esprit, sur des pattes de colombes. Au moment où l’on s’y attend le moins, au moment où on a le moins besoin d’elle.
Les Dogs ont tourné un peu partout en France, même dans la perfide Albion avec Dr Feelgood, mais voici que le rêve américain se concrétise. Les voici partis pour dix dates aux USA, le pays du rock’n’roll. Premier concert le 25 septembre 2002, au Lucky Dog Music Hall de Worceter. Dominique Laboubée s’écroule à la fin du premier morceau Death Lane. Simple malaise ? Non, cancer foudroyant. Maintenu en coma artificiel il décèdera le neuf octobre. Le groupe accomplira la tournée sans lui, selon sa volonté…
DOMINIQUE

Si un maître sans son chien n’est plus un maître, les Dogs sans Dominique Laboubée ne sont plus les Dogs. L’histoire s’arrêta là. Catherine n’a pas la force de quitter son frère si vite. Suivent quelques pages de témoignages qui s’attardent non plus sur le musicien mais sur l’homme. Attentionné, simple, disponible et généreux sont les mots qui reviennent le plus souvent…Avant de refermer le livre nous avons encore droit à quelques lyrics. Dominique était musicien et homme de lettres. Important words disait Gene Vincent.
Un beau bouquin. Je ne parle pas des photos – les plus élégantes sont en noir et blanc – mais du travail fourni par la soeurette pour amalgamer les témoignages et les articles découpés dans la presse d’époque. Le livre n’aborde pas l’aspect musical des Dogs. Catherine insistera à plusieurs reprises, elle n’est pas spécialisée es rock’n’roll et refuse de se risquer sur un tel terrain. Rassurez-vous à part un morceau de Bo Diddley attribué à Gene Vincent elle ne commet pas d’erreurs et ses analyses ne sont pas dépourvues de sagacité.
Dominique Laboubée est mort à quarante cinq ans. Assez vieux pour avoir vécu beaucoup de ses rêves, trop jeune pour les avoir tous accomplis. Les Dogs sont en train de devenir le groupe culte du rock’n’roll français. S’imposent sans bruit, leur aura n’en finira pas de grandir dans les années à venir. Un groupe qui a su percer sans appui de la grande presse nationale, n’ont jamais misé sur le scandale pour s’imposer. Point trop de groupies, une accoutumance modérée aux produits, en contre partie aucun affichage de moraline, mais un maximum de rock’n’roll. Les Dogs nous ont laissé un os que nous rongerons toujours.
Damie Chad.
STORIES OF THE DOGS
HISTOIRE POUR DOMINIQUE
( Avril 2013 / Nouvelles Editions KRAKOEN )
22 AUTEURS RENDENT HOMMAGE AUX DOGS
LUC BARANGER / JOSE-LOUIS BOCQUET / THIERRY CRIFO / ALAIN FEYDRI / DENIS FLAGEUL / GEKKO HOPPMAN / JEAN-NOËL LEVAVASSEUR / JEAN-LUC MANET / PIERRE MIKAÏLOFF / MATHIAS MOREAU / MAX OBIONE / JEAN-HUGUES OPPEL / MICHEL PELé / GILLES POUSSIN / JEAN-BERNARD POUY / FREDERIC PRILLEUX / PATRICK RAYNAL / EMMANUEL RIMBERT / ANNELISE ROUX / ROMAIN SLOCOMBE / ERIC TANDY / MARC VILLARD
Réédition d'un livre paru en 2006 et réédité trois fois aux Editions Krakoen. Un projet sympathique. Une espèce de coopérative littéraire initiée par Max Obione qui regroupe des auteurs amateurs de nouvelles et romans noirs. L'idée de base était d'en finir avec l'angoisse de l'écrivain face à la solitude du compte d'auteur. De l'auto-prod au multi-prod. Mais la réalité économique étant ce qu'elle est Krakoen a été confiée à Gilles Guillon et est devenue Nouvelles Editions Krakoen. NLK s'inscrira-t-elle longtemps dans le sillon libertaire de Krakoen ?... Quant à Max Obione il s'en est allé fonder SKA EDITIONS, exclusivement sur le net. A la noirceur du polar de sa première ligne éditoriale il a rajouté le rose érotique, vend ses e-books à des prix compétitifs comme 1 euro.
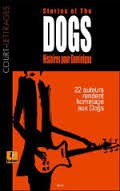
L’idée de départ est toute simple, que chaque auteur s’empare d’un titre d’un des morceaux des Dogs à partir duquel il nous livrera sa vision dogsienne, non pas des Dogs, ou de Dominique Laboubée, mais du monde. Un monde selon les Dogs certes, mais sans limitation territoriale trop limitée. Une moyenne d’une dizaine de pages par participant. Classement par ordre alphabétique pour éviter tous les conflits de préséance qui pourraient surgir.
N’allons pas les chroniquer une par une, mais en élire quelques unes. Comme les rockers sont des gens courtois envers les dames nous évoquerons tout d’abord Mon cœur bat encore d’Annelise Roux la seule fille de la bande. Ne fait de cadeau aux rockers. Les belles idoles morflent un max. Se ruinent la santé à coups de drogues, d’alcools, d’abus divers. Se conduisent comme des enfants gâtés et finissent en adultes pourris. Le pire ce n’est pas le public qui aime cela. Tout le monde adore les films d’horreur. Annelise pensent à la gent féminine qui fait partie de l’entourage intime des vedettes. Les partenaires, les copines, les mères, les sœurs qui supportent tout avec la patience de la Madone. Se contentent pas de prier les mains jointes. Saintes peut-être mais y touchent très gravos. Le rock est-il un monstre froid qui broie ses proies sans rémission ? En tout cas elle évoque le drame antique, inventé dans ces temps bénis où l’on n’avait pas encore inventé la rédemption christique.
Une petite préférence toute personnelle pour Death Lane d’Alain Feydri, pas un hasard, l’a rédigé les monographies des Kinks, des Cramps et des Flamin’ Groovies, univers dogsien par excellence. Vous laisse deviner ce que Charly fera de son premier disque des Dogs. Vous donne un indice, vous serez déjà mort que l’on lira encore Les Fleurs du Mal.
Je terminerai – c’est aussi la dernière du recueil - par un auteur que l’on a déjà rencontré, Marc Villard lorsque nous avons chroniqué Sharon Tate ne verra pas Altamont ( livraison 49 du 22 / 04 / 11 ) et La vie d’artiste ( livraison 51 ), Back from nowhere, un trip adolescence voie sans issue, glauque à souhait, au-delà de la mort. Mais c’est Max Obione qui remportera la couronne funéraire avec Poisonned Town il joue une histoire parallèle au plus près de la mort de Dominique.
Vous en reste une bonne vingtaine à découvrir. Belles, mais acérées. Mais au fait quelle était la couleur noire des Dogs ?
Damie Chad.
LUMAN POWER
Kilgore, 1955. C'est là, dans ce bled texan, que le jeune Bob voit Elvis sur scène pour la première fois. Pouf ! Il trouve sa vocation. Il décide qu'il fera le métier de rock'n'roller, comme Elvis. Quand on cherche sa vocation, il vaut mieux tomber sur Elvis que sur Sœur Sourire, pas vrai ? Enfin, ce n'est qu'un avis personnel.

Et hop, roulez jeunesse ! Il part de zéro : il faut apprendre des chansons, quelques accords de guitare, trouver des copains pour monter un orchestre, trouver un local de répète puis des engagements pour jouer en public. On croit que c'est facile de monter un groupe de rock. Ho mais pas du tout ! Même ceux qui n'ont pas fait l'armée appellent ça le parcours du combattant. Énormément de travail, d'espoirs et d'énergie investis pour le plus souvent un résultat lamentable. Le principe nietzschéen de la sélection naturelle s'applique dans le petit monde du rock avec plus de violence que dans n'importe quel autre domaine.
Pendant tout le début de sa carrière météorique, Bob Luman aura beaucoup de chance. Mais beaucoup moins ensuite.
L'un des meilleurs potes de Bob s'appelle Mac Curtis. Le pote Mac a pris des tours d'avance puisqu'il est déjà signé chez King Records, le label légendaire de Syd Nathan sur lequel on trouvera Charlie Feathers, James Brown et des dizaines d'autres grands pontes du rockabilly et du r'n'b. Mac et Bob jouent un peu ensemble au Texas. Mais chacun doit suivre sa voie.

Puis Bob rencontre James Burton, un petit branleur de quinze ans qui joue de la guitare. On fait un groupe, môme ? Oh yes Bob ! James Kirkland les accompagne à la stand-up bass. Et hop, tournées au Texas, renommée grandissante et un impresario les envoie enregistrer chez un pote à lui, en Californie. Les Texans débarquent dans le prestigieux studio d'Imperial Records, à Los Angeles, pour enregistrer quatre titres.

Pas de doute, Bob allait conquérir le monde. Pourquoi ? Parce qu'il avait du génie rockab. Il faut l'entendre pincer sa voix sur «Whenever You're Ready». Il faut l'entendre glapir sans prévenir dans «Red Cadillac And A Black Moustache». Mais il avait surtout derrière lui le meilleur orchestre de rockab des États-Unis, avec les deux James aux manettes.
Et c'est là, à Los Angeles que la chance va le quitter. Ricky Nelson passait dans les bureaux du label et quand il entendit le barouf qui filtrait à travers la porte du studio, il demanda la permission d'aller voir les musiciens. Il fut tellement impressionné par la vitalité des deux James qu'il leur proposa de venir jouer dans l'émission de télé hebdomadaire de ses parents, Harriett et Ozzy. Le père de Ricky manœuvra ensuite habilement pour faire un pont d'or aux deux James qui du coup sont restés en Californie. Ils devinrent donc le backing-band de Ricky Nelson. Ozzy avait une fois de plus gâté son fils. Et pour couronner le tout, les frères Burnette, fraîchement débarqués à Hollywood, refourguaient des hits à Ricky. Mais ceci est une autre histoire.

Le pauvre Bob est rentré tout seul au Texas. Sa carrière venait de prendre du plomb dans l'aile. À partir de là, il s'éteindra petit à petit, passant du statut de légende rockab à celui moins enviable de chanteur de variétés chiant comme la pluie. Un vrai désastre. Le tout bien imbibé d'alcool, comme on l'imagine. D'ailleurs, le foie du pauvre Bob finira en bouillie.
Quand on connaît les disques de la période enchantée (1956-1957), on sent l'énorme potentiel du groupe qu'il avait monté. Pour Bob, le destin fut particulièrement cruel. Mais il sut rester aimable et les gens l'admiraient pour ça. Pour lui, ça semblait normal que ses collègues aillent tenter leur chance à Hollywood. James Burton tentera de se faire pardonner en revenant jouer de temps en temps avec le pauvre Bob, mais le mal était fait.
Trouver un nouveau guitariste pour remplacer James Burton ? Non, vous rigolez ? Ce n'est pas possible. Eh bien si. Roy Buchanan aura le privilège d'accompagner Bob lors de quelques séances d'enregistrement.

Justement, le seul moyen d'y voir clair dans cette sombre histoire, c'est d'investir dans le coffret Bear Family «Let's Think About Living» qui couvre les années 1955 à 1967. Richard Weize et ses amis ont tout passé au peigne fin. On peut écouter tous les morceaux enregistrés par Bob dans l'ordre chronologique. Chaque séance d'enregistrement est bien documentée. Quand on admire un artiste, on ne peut guère espérer mieux. Et je ne parle même pas de la qualité du son. Incomparable. Si on écoute ça au casque, on grimpe directement au septième ciel.
Ce coffret ne fait que confirmer ce qu'on savait : seul le disk 1 est bon. L'écoute des trois autres fait hélas bâiller d'ennui. N'oublions pas que la vague rockab telle qu'on la vénère n'a duré que deux ans aux États-Unis. Par la suite, les artistes se sont ringardisés ou sont passés à la country. L'arrivée de la beatlemania fut pour beaucoup d'entre eux le coup de grâce. Jerry Lee dut aller mettre le Star Club de Hambourg à feu et à sang pour relancer sa carrière.

Sur le disk 1 se trouvent quelques morceaux datant de 1956 comme «Hello Baby», où l'on entend James Burton s'énerver et faire péter des séries d'arpèges texans qui ont dû faire baver d'envie Hank Marvin. Puis on l'entend jouer en cocotte. James Kirkland fait des prodiges sur des morceaux comme «Jumping With The Shadows» ou «The Creep». Si on aime bien entendre de belles lignes de basse voyageuses, alors il faut écouter ces deux fascinantes splendeurs d'un autre temps.
En 1957, les Texans passent à la vitesse supérieure, avec des morceaux comme «All Night Long» où l'on entend James Burton jouer les virtuoses au fond du studio. Il s'amuse à bricoler une cavalcade hallucinante, un truc à faire baver d'envie Adrian Gurvitz.
Violente montée en température avec «Wild Eyed Woman». Derrière Bob, on peut dire que ça joue. Burton pique sa crise. On se retrouve avec un mid-tempo slappé à convenance, un de ces heavy blues dont les Texans ont le secret. Burton prend une saleté de solo punkish, un truc à faire baver d'envie Jesse Hector. Affolant ! Burton nous fait l'effet d'un véritable voyou du manche. Jusqu'à la fin du morceau, il en rajoute. On se demande comment Bob s'y est pris pour le calmer, à la fin du morceau.

La version de «Red Cadillac And A Black Moustache» qui date de mars 1957 est forcément la huitième merveille du monde. Pur génie et je pèse mes mots. La version de Warren Smith est bonne, mais elle n'atteint pas la cheville de celle de Bob qui est swinguée à outrance et derrière, ce démon de Burton envoie la purée. On ne peut pas rêver d'une version plus spectaculaire.
Le film Carnival Rock date aussi de 1957. On le doit à Roger Corman, personnage légendaire du cinéma de série B américain. Justement, le film démarre avec Bob et les deux James. On est aussitôt effaré par la classe de James Kirkland, par sa façon de tenir le manche de sa stand-up. Il est carrément reptilien. Il fait corps avec le slap. Il faut voir ce film rien que pour le numéro de James Kirkland. Trois couples dansent. L'intrigue du film brille par son inconsistance, comme c'est souvent la cas dans les films de série B tournés à l'époque. Mais ça nous donne le privilège de voir Bob interpréter deux morceaux, «This Is The Night» et «All Night Long», accompagné par les deux James.
On peut réentendre «This Is The Night» sur le disk 1 et c'est wild, comme dirait Oscar ! Le morceau est littéralement hanté par le jeu de James Burton, tout en montées subites de température. Ça baigne dans une liqueur de notes infâmante. Burton ? Un vrai diable. Et le slap de Kirkland ? Une bénédiction. Aucun équivalent dans toute l'histoire du rockab. «The Creep» fut ré-enregistré lors de la session Carnival Rock et c'est probablement la perle qui cache le tas d'or : voilà une chose slappée jusqu'à l'absurde, un instru wildissime qui a dû faire baver d'envie Jet Harris.
La dernière session d'enregistrement de Bob avec les deux James date d'octobre 1957. Ce sera le chant du cygne de la sauvagerie, en ce qui concerne le pauvre Bob. «Whenever You're Ready» est cette belle pièce de swing vrillée dans l'os par un solo enragé de James Burton et qui une fois encore frise le pur génie. Dans «Your Love», Burton redevient fou dans le studio, fou de virtuosité, fou de feeling, il frôle l'apoplexie en permanence, il bat tous les records du monde de picking. On commence à réaliser que le pauvre Bob n'aura en fait servi que de faire-valoir à James Burton. Personne n'avait encore entendu un solo aussi dément. On comprend mieux pourquoi Burton a fini par jouer avec Elvis.
On trouve à la suite deux versions d'un même morceau : «Make Up Your Mind Baby» : la version normale et la version wild (wild one, est-il précisé). Eh bien, écoutez la wild one et vous allez voir trente six chandelles. Bob attaque ensuite une reprise de «Red Hot» qui comme on l'imagine bat tous les records de fournaise rockab. Comme à son habitude, Burton en rajoute. Avec «Guitar Picker», on tombe sur un invité de marque : Eddie Cochran.
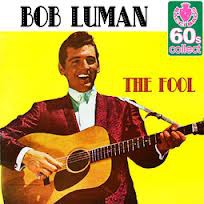
Avec les trois autres disks, les choses se compliquent. Bob va tomber dans les pattes de producteurs qui vont le transformer en crooner à la petite semaine. On entre là dans la pire époque du rock américain, celle de la variété frelatée. Mais Bob sauve les meubles, car il dispose d'un bel atout : sa voix. C'est en 1959 que Roy Buchanan commence à accompagner Bob. On se réveille un court instant avec un morceau comme «Loretta». Le père Roy joue comme un dieu. On le retrouve dans «Buttercup». Roy y va de bon cœur. Bob semble enfin reprendre goût à la vie. C'est quasiment le seul morceau punchy de l'année 1959. On sent à l'écoute des deux disques suivants que les années 60, 61 et 62 durent être un vrai calvaire pour le pauvre Bob. On lui faisait chanter de la variète sucrée et bien mièvre, des horreurs à l'eau de rose complètement insipides, de la petite pop malencontreuse et des slows super-frotteurs. Même un poids lourd de la compo comme John D. Loudermilk ne parvenait pas à relancer la carrière du pauvre Bob.
À plusieurs reprises, il se prend pour Johnny Cash. Il tape aussi dans Lee Hazlewood avec une reprise de «The Fool» et réussit son coup, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de mièvrerie. Il chante un truc terrible avec Sue Thompson, la reine des pipes sucrées : «Too Hot To Dance». En 63, Bob semble coulé. Artistiquement, il n'a plus rien à dire. Il fait des disques pour rombières en bigoudis. En 64, on lui fait chanter du country-rock. Trop tôt. Il faut attendre 1966 pour redresser l'oreille. Et là, grosse surprise, Huey P. Meaux reprend la carrière de Bob en main. Ouf ! «The Best Years Of My Wife» est du pur rock tex-mex, digne des grandes heures du Sir Douglas Quintet. On sent tout de suite un retour de la substance. «So Happy For You» est monté sur un fond de guitares sauvages. Merveilleuse ambiance et fantastique énergie. Un vrai retour de manivelle. On croit rêver. N'oublions pas que le Crazy Cajun est un grand sorcier. Mais un producteur merdique nommé Wesley Rose repasse derrière et nettoie le son des enregistrements. C'est foutu. Ce connard va couler Bob définitivement. Voilà le fin mot de l'histoire. Wesley Rose replonge le pauvre Bob dans une mer de guimauve. Il le condamne à patauger dans la mélasse de la médiocrité.
Pas de chance, mon pauvre Bob. Sorti de la nuit du bayou, tel un Zorro sonique, Huey P. Meaux avait réussi à te sauver, l'espace de deux morceaux. Puis Bear, sorti de la nuit allemande, tel un baron de Munchausen supersonique, a réussi à arracher tes deux fabuleux swamp-rocks aux mâchoires de l'oubli grimaçant. Enfin, Damie Chad, sorti de la nuit des bloggers, tel un bopping cat héroïque, permet que l'info circule sur internet.
Pauvre Bob, on te devait bien ça.
Signé : Cat Zengler, lumanitaire.
Bob Luman. «Let's Think About Living» - His recordings 1955 à 1967 - Coffret 4 CD au format LP. Livre de 100 pages au grand format, magnifique, bourré de photos plein pot du pauvre Bob. Bear Family.
ROCK & FOLK N° 552. ( Août 2013 )
L’ont sorti en avance. Voulaient prendre des vacances. On les comprend. Mais j’aurais préféré ne pas savoir. Deux mauvaises nouvelles. En toutes petites lettres dans la rubrique condoléances qui égrène chaque mois le nom des disparus : Bobby Blue Bland. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais l’un des plus grands chanteurs de rhythm and blues, entre BB King dont il fut fut l’homme à tout faire et Otis Redding. Vous ai déjà causé une fois de sa version de Saint James Infirmary. On espère un article de fond dans le numéro de rentrée.

Un article sur les Dogs pour saluer le livre de la sœur de Dominique Laboubée, attendu. Mais la double-page consacrée à Pierre Lattès parti ce premier juin, me fait encore plus mal au cœur. Pour toute une génération Pierre Lattès fut l’Initiateur. Officiait sur France Inter dans le Pop Club l’émission de José Arthur. Avait l’œil sur la programmation, et était responsable de la séquence rock et de de la séquence blues. C’est là où en 1966 l’on a tout appris… En 1967 il crée Bouton Rouge, la première émission consacrée au rock sur la TV; a été vite supprimée après mai 68... Dans les années 80, il participe à l’éclosion des radio-libres mais retire ses billes lorsque les grands groupes de communication rachètent les fréquences…

L’article d’Olivier Cachin laisse entendre une fin désespérée, celle d’un homme blessé, laissé sur le bas-côté de la route, sa musique et sa personne ayant été évincées des média.
Pour finir sur une note moins triste, les quatre concerts de Johnny pour fêter ses soixante-dix ans. Et le dernier très rock ‘n’ roll, très pionniers hommagial, avec la participation de Brian Setzer, et la promesse d’une tournée des vingt salles mythiques des States…
Damie Chad.
FEUILLETON HEBDOMADAIRE
CHRONIQUES VULVEUSES
DEUXIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire.
Tous les faits rapportés dans cette oeuvre narrative à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et de gendarmerie sont là pour en apporter la preuve définitive.
4
Nous – tous les trois, la fidèle teuf-teuf mobile, Molossa ma compagne, et votre serviteur, avons roulé toute la nuit à tombeau ouvert. Pour nous tenir en éveil nous avons passé en boucle un enregistrement pirate des Jallies, leur phénoménal Shave Your Pussy, qui me semblait de circonstance. Au petit matin blême nous arrivâmes enfin dans la paisible bourgade du Mas d'Azil.
Molossa qui dormait les quatre pattes en l'air sur la banquette arrière se réveilla brutalement et à la manière dont elle remuait la queue, je compris qu'un relent de vulve conjurante, indiscernable à toute narine humaine, avait chatouillé sa truffe aguerrie. Je levai le pied gauche ( celui de l'accélérateur ) et les sens aux aguets j'inspectai les environs. Rien de bien phénoménal, une longue rue sans prétention bordée de maisons basses. Je traversai le village de part en part lorsqu'Elle apparut à l'horizon.
5

Un éperon rocheux coupait l'horizon. La teuf-teuf s'en approchait quand brusquement au détour du tournant nous L'aperçûmes, prête à nous avaler. La fameuse grotte du Mas d'Azil, célèbre depuis le néolithique ! Une vulve parfaite, l'abyssal trou génital par excellence, géante, Victor Hugo l'aurait qualifiée de bouche d'ombre, mais il était trop tard pour faire demi-tour, et la teuf-teuf s'engagea sans faillir dans la fente abyssale. Enorme, à droite la rivière aux remoux étourdissants, au milieu la route à deux voies par laquelle nous nous enfoncions dans le tunnel sinueux, à gauche l'on avait construit un large bâtiment bétonné afin d'accueillir les touristes.
C'est alors que les yeux me sont sortis de la tête. Je m'attendais à tout sauf à cela. Sur le coup, je le confesse à ma grand honte, j'en ai oublié ma mission. J'ai cru que je devenais fou, que j'étais victime d'un AVC foudroyant, mais non, je l'ai reconnu tout de suite, avec ces rayures noires et blanches concentriques. Le tromboscope d'Hauwkind ! Restait plus qu'à mettre les amplis et les guitares devant. Une chance inespérée, être en mission commandée et tomber sur un concert d'Hawkind !

Je savais que le groupe était en tournée mais de là à les retouver au fin fond de l'Ariège, ça m'a foutu un choc, me fallait vite trouver la date et l'heure précise du concert. Plus de quarante ans que je ne les avais pas vus, à l'époque - en 1974 - avec Lemmy Kilmister le futur fondateur de Motörhead et leur tromboscope spiralé blanc et noir qui tournait, tournait, tournait, indéfiniment, à vous faire vomir votre petit déjeuner, tripes et boyaux compris, en trois minutes. Un régal.
Me fallait une affiche illico ! La teuf-teuf est sortie de la grotte en trombe et l'on est retourné au village inspecter les murs, une fois, deux fois, trois fois, rien ! On a scruté à s'en décrocher les orbites En désespoir de cause, je me suis arrêté et ai appelé le Service Archive sur mon portable.
6
“ Ici agent 009891.
-
Vous recevons cinq sur cinq.
-
Besoin de savoir la date du concert d'Hawkind au Mas d'Azil, rappelez-moi tout de suite !”
N'aie même pas eu le temps de me saisir de mon sky dans la boîte à gant :
“ Agent 009891, aucun concert d'Hawkind prévu au Mas d'Azil !
-
Quoi ?
-
Sont actuellement en tournée au Canada, peux vous filer les dates !
-
Non pas la peine, par contre j'aimerais savoir pourquoi leur tromboscope se trouve dans la grotte !”
Une douce fragrance de Coronado N° 4 s'est subitement insinuée dans l'habitacle de la Teuf-teuf, et une nouvelle – toutefois reconnaissable entre mille - voix s'est emparée de la ligne :
“ Ecoutez-moi bien agent 009891, il n'y a pas dix minutes j'avais le ministre au bout du fil, vous savez ce qu'il m'a dit le ministre ?
-
Oui, euh, non Chef...
-
Je vous le répète texto : l'en a ras-le-cul de la vulve ! Alors vos histoires de tromboscope, vous pouvez vous les mettre où je pense !
-
Oui chef !
-
N'oubliez que vous êtes payé pour neutraliser le sieur Claudius de Cap Blanc, le plus vite possible, exécution immédiate.
-
Tout de suite chef !
-
Attendez douze secondes les archives ont un dernier renseignement à vous communiquer !
-
Agent 009891, votre tromboscope ce n'est pas un tromboscope, mais une oeuvre d'art contemporain, côté culture vous êtes déficient !”
Et la communication a été coupée.
7
Lourd silence. Molossa a agité sa queue de droite à gauche, signe de grande perplexité. Nous n'avons pas besoin de parler, nous nous comprenons à demi-aboiement. Certes j'avais totalement déraillé avec Hawkind, mais nous partagions tous les deux une même intuition. C'est le propre des agents chevronnés, sans cesse sur le terrain, de développer un sixième sens auquel seuls les plus fins limiers de la sûreté nationale peuvent atteindre. Malgré ses énormes capacités décisionnelles un Chef rivé à son bureau vingt quatre heures et demie par jour est en quelque sorte déconnecté de la subtilité analytique toute subjective de l'agent en mission. L'imminence du danger, la proximité quotidienne du péril, repousse les limites du cerveau humain, l'on arrive à savoir avant même de savoir.
Apparemment nous étions très loin de la Conjuration de la Vulve, mais il y avait un rapport ( rien de sexuel, rassurez-vous ) entre la vulve et le tromboscope. Difficile encore de le définir, mais l'instinct a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'affaire était à coup sûr plus complexe qu'il n'y paraissait. Comme on dit au FLNC, quand la situation se tend, ça se corse !
En attendant j'avais besoin de quelques informations suplémentaires. J'aurais pu rappeler le Service Archive, mais je n'aime pas que l'on me traite de déficient culturel. Me débrouillerai seul comme un grand. Comme le loup solitaire qui surgit de la nuit et dont les mâchoires se referment sur la gorge de sa proie pantelante ! J'étais un affranchi, un free lance, un franc-tireur, au-dessus des lois et du droit. Molossa a remarqué la lueur des commandos de la mort qui dansait dans ma pupille. Si Claudius de Cap Blanc avait vu sa queue qui remuait de gauche à droite, il aurait eu peur.
8
N'ai même pas eu besoin de tourner la clé de contact, la teuf-teuf mobile a pris la direction de Foix ( préfecture de l'Ariège, 9885 habitants ), désormais rien ne nous arrêterait plus. ( A suivre )
FIN DU DEUXIEME EPISODE
22:28 | Lien permanent | Commentaires (0)


