09/06/2021
KR'TNT ! 514 : EL CRAMPED / BETTE SMITH / PHIL SPECTOR / MOJO BLUES / PAIGE ANDERSON / TWO RUNNER / MARIE DESJARDINS / JAYNE MANSFIELD /
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME
LIVRAISON 514
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR'TNT KR'TNT
10 / 06 / 2021
|
EL CRAMPED / BETTE SMITH PHIL SPECTOR / MOJO BLUES PAIGE ANDERSON / TWO RUNNER MARIE DESJARDINS / JAYNE MANSFIELD |
TEXTES + PHOTOS SUR : http://chroniquesdepourpre.hautetfort.com/
*
Une terrible histoire. Prenez-en de la graine. N'oubliez jamais que vos actes vous engagent bien plus que vous ne le croyiez. Ecoutez la lamentable ( et néanmoins mirifique ) histoire survenue à ces deux personnages. Deux chevaliers à la triste figure engrangés dans une incroyable aventure, n'ont pas eu la chance de Hank Williams qui a dit I saw the light, et il s'est endormi paisiblement sur la banquette arrière de sa voiture, pendant qu'il dormait les anges sont descendus du ciel, et ont emporté son âme pure ( malt whisky ) devant le trône du Seigneur, pas de chance pour nos deux héros, eux ils n'ont pas vu la Light, ils ont aperçu le Lux. C'est-là qu'il faut rechercher la cause de tous leur malheur. Commençons par les identifier. Le premier se nomme Professor Von Bee, s'auréoler du titre de Professor n'est pas innocent, souvenons-nous que le seul professeur dont le nom ait traversé les siècles reste celui du Professor Frankeinstein et encore son blaze lui a-t-il été volé par le monstre qu'il avait engendré, des chercheurs autorisés affirment que sa maman lui a donné ce ridicule prénom de Von Bee parce que la radio diffusait I'm a King Bee de Slim Harpo ou des Rollings Stones ( les avis divergent ) alors que dans un dernier spasme de jouissance la petite graine fut plantée. Le deuxième n'a pas de nom, tout jeune il a pris l'habitude de signer ses crimes ( c'est un infatigable Serial ) par le pseudonyme de The Loser, l'endort la méfiance par ce surnom de perdant magnifique. L'on dit ( mais l' on raconte tellement de choses ) que depuis des années sur un des meilleurs blogues rock de la planète il embaume deux ou trois victimes systématiquement tous les mercredis matins ( les psychologues assurent qu'il a développé cette mauvaise habitude parce tout petit il haïssait ce jour funeste durant lequel il était privé d'école ), la police est sur ses traces mais il brouille les pistes en apposant au bas de ses méfaits un nom différent à chaque fois.
Bref un soir où ils s'ennuyaient, ne sachant pas quoi faire, ils ont décidé d'établir une liste. Une liste alphabétique à proposé le sinistre Loser. Pourquoi pas a répondu el Professor, une liste des bienfaiteurs de l'Humanité serait une bonne action, tiens une liste de professeurs a-t-il ajouté, par exemple à la lettre E, je verrais bien le Professeur Einstein. Vous l'avez deviné le Loser n'était pas d'accord, juste pour enquiquiner son copain, le ton est monté, se sont bagarrés, la scène se passait dans un café, z'ont tout cassé, au bout d'une heure ne restait plus qu'une ruine, le comptoir fracassé, la vitrine en éclats, les chaises plantées dans le mur, les lustres vacillants, j'abrège ma description, de fait ne subsistait de parfaitement intact, dans le jukebox éventré, qu'un seul objet, un single des Cramps ( Surfing bird / The way I walk, si vous voulez tout savoir ), sont tombés dans les bras l'un de l'autre, c'était un signe du destin et peut-être même des Dieux de l'Olympe, le sort en avait décidé pour eux, ils s'embrassèrent et jurèrent qu'ils n'auraient pas de repos tant qu'ils n'auraient pas réalisé une liste dont le mot de ralliement s'imposait : Cramps !
Faut être honnête, nos deux mauvais sujets y ont passé des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, et des années et des années. L'ouvrage progressait, à tel point qu'il n'a pas tardé à arriver sur la table non pas de travail mais de désir de Kr'tnt ! votre blogue préféré, et la chronique de la liste crampsique qui entre temps était devenu Le Petit ( 516 pages ) Abécédaire de la CRAMPOLOGIE publié chez Camion Blanc a été rédigé – vous connaissez mon sérieux – par moi même l'Agent Chad du Service Secret du Rock'n'roll, dans notre livraison 300 ( vous ne trouverez pas plus spartiate ) du 27 octobre 2016.
Je m'étais rendu compte de l'arnaque, mais je n'ai rien dit, ils avaient très gentiment et systématiquement caché un billet de 500 euros entre les pages de leur envoi, n'empêche que l'œil de leur méfait était dans la tombe de leur conscience et les regardait. Je peux aujourd'hui révéler l'étendue de leur ignominie, ce n'est pas qu'il y a prescription, c'est qu'il y a réparation. Tout le bouquin regorge de documents des plus précis, sauf à la lettre E. Cette lettre ésotérique que les Grecs avaient placée sur le fronton du temple de Delphes, et qui vous commandait de vous souvenir que vous n'étiez qu'un homme que vous n'étiez pas comme les Dieux qui eux ont le droit de mentir, en toute impunité. Souvenez-vous que cette histoire débute à la lettre E d'Einstein... Z'ont cherché sur toute la planète, z'ont rempli toutes les occurrences alphabétiques sauf la E ! Alors en désespoir de cause, ils ont inventé un bobard, la formation d'un groupe nommé El Cramped ( pages 71 à 82 ), des photos foutaises des fausses promesses, bref depuis cinq longues années personne ne croyait à l'existence de ce fameux El Cramped... Et voici que ce matin, arrive enfin la preuve irréfutable :
EL CRAMPED
A TRIBUTE TO THE MAD GENIUS
OF
LUX INTERIOR
( Trash Wax 049 / 2021 )
Un disque, un vrai, en vinyle 180 grammes avec pochette cartonnée et en couleur, pas un misérable single, pas une grenouille d' Ep cinq cuts qui veut se faire passer pour un bœuf albumique, non un vrai 33 tours, aussi Royal que le fils de Louis XIII puisqu'il arbore en quartiers de noblesse quatorze titres.
Pour ceux qui n'ont jamais eu la visite intérieure du Lux suprême dans leur âme ravagée par le conformisme du consensus mou et doux voici quelques rapides explications complémentaires. Cela a débuté il y a longtemps au début du dernier quart du siècle précédent, dans l'ère primale que les géologues ont depuis appelée l'effondrement crétinoïde-punkitoésidal, certains individus ont brutalement été victimes de régressions psychiques aberrantes, au lieu de suivre la marche en avant du progrès humain, ils ont stupidement tourné le dos à cet adorable univers aseptisé qui ne veut que notre bonheur vers lequel l'Humanité se dirigeait à grands pas... z'ont adopté des signes d'atrophie esthétique inquiétants, au lieu de se jeter sur le dernier coffret de Mozart ils se sont entichés de disques ratés de rockabilly notoirement joués par des schizophrènes asthmatiques et hoquetant, au lieu de regarder les grands classiques du cinéma ils ont collectionné les cassettes d'histoires de morts-vivants, au lieu de visiter les musées ils se sont entichés d'images insanes qu'ils arrachaient dans les horribles pages de vieux fanzines qu'ils s'ingéniaient à dénicher dans les stocks moisis de brocanteurs sales, hirsutes et avinés. Un recul civilisationnel auquel les invasions barbares n'arrivent pas à la cheville. Des nietzschéens fous qui ont pratiqué le renversement des valeurs immortelles... Les Cramps furent en quelque sorte les leaders du grand démembrement, ils étaient conduit par un génie fou ( souriez, dieu merci, il est mort ) qui se faisait appeler Lumière Interieure, et honte et scandale, c'est pour rendre hommage ce grand désaxé congénital que le Professor Von Bee et le sombre Loser ont décidé de vouer leur vie. Priez pour nous !
Abstenez-vous d'accorder ne serait-ce qu'un seul regard soupçonneux à cette horreur sans nom, qui se voudrait une pochette mais qui n'est qu'une icône étronale malfaisante due au pinceau malade du Loser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a au fond de la poubelle de votre âme. Certains lisent votre avenir dans le marc de café, le Loser soulève le couvercle et vous montre les monstres putréfiants qui grouillent au fond de votre cervelle, vous dévoile le peuple infâme et informe qui ronge vos neurones. Epargnez-vous cette représentation de vous-même en ce monstre verdâtre à mine de vampire nauséeux, cette créature déguisée en belle espionne ne la regardez pas dans les yeux, elle n'est qu'une préfiguration de la baudelairienne charogne pantelante que deviendra votre corps après votre mort, quittez ce sourire de DRH qui va vous mettre au chômage pour le restant de votre vie, n'oubliez pas que les Dieux incas ne portent pas de lunettes noires et essayez d'échapper au rayon désintégrateur qui darde vers vous, mais vous regardez, ce fond de poubelle qui vous ressemble tant et qui vous happe, plongez-y dedans, rejoignez vos phantasmes, tant pis pour vous, vous ne ressortirez jamais de ce vortex. Le couvercle se referme sur vous. Vous êtes pris. A votre propre piège. Le Loser est un adepte de la ligne claire, et de la mine sombre.
Ne vous prend pas en traître. Vous avertit de ce qui vous attend. Dans le cadre extérieur il a piqué des mots volés aux titres que vous entendrez. Pour ceux qui ne savent pas lire, il a ajouté des petits dessins évocateurs. Un véritable ami de l'espèce humaine, ce Loser ! Un peu crâneur tout de même.
The wrecking crew, ou aussi les Enfants perdus du Capitaine Flint :The Professor Von Bee : vocals ( on ne présente plus ) / Sylvie : drums ( mesdames les féministes, ne les félicitez pas pour leur effort vers la parité, simplement une citation historiale, pour rappeler que les deux premières moissonneuses-batteuses des Cramps étaient du genre sexe faible / Kid Karim : guitare ( un pauvre gamin qu'ils ont racolé en lui faisant croire qu'il allait devenir une rock'n'roll star ) / The Loser : bass ( on ne présente plus ).
L'instant fatidique de sortir le disque de sa pochette est venu, c'est un peu comme si vous tiriez par la queue un mamba noir de son sommeil, l'est enveloppé dans une pochette papier aussi sombre que le trou du cul du diable, surprise ce qui apparaît est maintenant un merveilleux vinyle couleur d'empyrée, un bleu irrémédiable, sûr un pur azur mallarméen dont la sereine ironie accable belle indolemment notre âme impuissante...
Saddle up a buzz buzz : de la malhonnêteté incarnée, se vantent au dos de la pochette d 'avoir fauché tout ce qu'ils ont pu de licks et de riffs dans quatre ou cinq morceaux des Cramps – c'est ce que l'on appelle chez les gens bien des citations hommagiales, et chez les prolos un pot pourri ( jusqu'au trognon ), une entrée en fanfare qui vous réveillerait un mort, ( mollo sur le bouton si vos habitez près d'un cimetière ), la basse du Loser entame illico la marche des crapauds, cahin-caha, attrapez-moi et léchez la matière visqueuse et pustuleuse de mon dos, la Sylvie use, abuse et obuse d'une lessiveuse tintamarresque, une espèce de zigouigoui sonore infâme et Dieu merci c'est terminé. Missa est. Garbageman : pour le frétillement insidieux de queue de crotale qui ouvre l'interprétation des Cramps c'est raté, par contre la batterie imitation du bruit de couvercles de poubelles que l'on laisse retomber sur le ciment du trottoir ce que Marcel Proust jugeait intolérable c'est gagné, ensuite El Professor prend la relève, cette espèce de récitation hallucinatoire de Lux c'est pour lui, nous la sabote à l'orthopédique, ce n'est pas beau comme du Verlaine mais tout le monde ( musicos et auditeurs ) lui emboîte le pas, finira bien par s'arrêter dans un rade bien crade. Nacked girl falling down the stairs : pour l'écoute de ce morceau l'on change de Marcel, odeur de femelle certes, mais cela sent aussi un peu son Duchamp, évidemment ils ont cassé Le Grand Verre, croyaient que c'était un aquarium dans lequel el maestro avait oublié de mettre les poissons. Le Kid c'est à croire qu'il voyait pour la première fois une femme nue descendre un escalier – faut avouer que le vocal del Professor vous émulse la cervelle, rappelle le Colonel Parker quand il n'était que Capitaine et qu'il attirait à l'entrée du cirque les clients au porte-voix – le kid ça l'émoustille éruptif, masturbe son manche un peu épileptiquement, est-ce Sylvie au fond qui pousse ses petits cris de scie égoïne, je ne sais pas, mais l'ensemble est parfait pour faire monter l'adrénaline et la mayonnaise. Ultra twist : Ah ! Ah ! l'insouciance innocente des sixties et la ligne claire de la guitare des Shells, lorsque les Cramps s'en sont emparés, z'ont un peu barbouillé par-dessus, z'ont dessiné des moustaches rouges à la Joconde et refait le portrait au couteau, pardon au cran d'arrêt, du coup le Professor n'a pas jugé bon de remettre au placard sa voix de bateleur de province, le Karim vous fait de ces vrillés de moustiques comme s'il pilotait un spitfire à réaction, le Loser vous broie le brou de noix sur le fond et la douce Sylvie tape comme si elle s'était évadée de l'asile. Des ultraïstes cubisto-sémiographistes. I walked all night : ne faut pas prendre les Cramps pour des faux fous, savent respecter l'esprit malsain, exemple ce morceau tout joyeux des Embers ils ne le maltraitent pas, z'y rajoutent le sourire doucereux de la fausse ironie, Los Crampedos résolvent le problème, appliquent la solution du cunis lingus à la langue de serpent, est-ce pour cela que Sylvie frappe comme un requin complètement marteau et que les boys virevoltent et minaudent comme des papillons, ces sphinx à la tête de mort qui butinent uniquement les fleurs des cimetières, because Eros et Thanatos sont des mots qui vont si bien ensemble. Primitive : y avait comme des traces gluantes de sperme à la fin de l'original des Groupies, les Cramps ne pouvaient que s'y jeter dessus, z'en ont donné une version plus luxuriante et luxurieuse, le Lux s'avance sur la pointe des pieds dans la jungle des désirs, minaude et miaule et feule comme un tigre de Birmanie El Cramped partage quelque peu cette discrétion, une bave glaireuse coule sur le menton del Professor, Sylvie modère la portée de ses coups, elle a compris qu'il ne fallait pas de bruit, Karim se perd dans des arabesques alambiquées, la basse laser del Loser fulgure de minuscules crachats sur ses talons hauts, l'on sent bien qu'ils aimeraient bien faire durer au moins une demi-heure ce moment d'attente délicieux encore plus jouissif que la délivrance abrupte de la jouissance. Fissure of Rolando : ( pour ceux qui ont raté leur première année de médecine car au lieu d'aller en amphi suivre les cours ils passaient leur temps à copuler avec les cadavres de la morgue nous rappelons qu'il s'agit de ce sillon central qui sépare les deux hémisphères du cerveau, évidemment ceux qui n 'en possèdent qu'un seul ont du mal à entrevoir de quoi l'on cause ), terminent la face A en beauté, un titre qui se déroule comme une bobine de cinéma à grande vitesse, Sylvie à la frappe métrogoldewynmayernomique, el Professor qui nique la panique, le Loser pousse Karim dans les cordes, El Cramped sonne à la manière de la cloche du Titanic annonçant l'imminence du naufrage, grand spectacle auditif. Mean machine : j'ai toujours surnommé ce morceau des Cramps, tire-la-langue, pour ce petit gimmick de guitare qui se moque de vous et qui déstabilise la grosse et emphatique voix effroyable de Lux, z'ont compris chez El Cramped, c'est une collection de langues de fourmiliers qu'ils tirent aussi efficaces qu'un lot de trompettes héroïco-comiques, du coup El Professor perd son sérieux, la rythmique à l'unisson folâtre dans les bois, z'en font une version Doctor Folamour qui emporte la conviction. Drugs train : l'est parfait en chef de gare El Professor, l'est sûr que l'on aimerait voyager dans ce convoi pas du tout funèbre, l'on s'y amuse follement, parfaitement imité ce chuintement de shuffle terminal, je vais sûrement recevoir des tonnes de lettres d'insultes … j'ai l'impression que les élèves ont surpassé le maître. Green door : La version des Cramps est bien plus tubéreuse que celle de Jim Lowe, el Professor est parfait, ressemble au maître d'hôtel qui de sa voix onctueuse vous refusera toujours de vous ouvrir la porte de la salle de bain dans laquelle s'ébat la belle syrène que vous avez à peine entraperçue la veille. Rocket in my pocket : un classique du rockabilly ( 1958 )de Jimmy Lloyd aka Jimmi Logsdon, les Cramps se sont rués sur cette grenade sexuelle qu'ils ont même enregistrée live ( parce que l'amour en studio cuisine reste quand on y songe assez aseptisé ) par deux fois, El Cramped tire leur crampe par deux fois mais en un seul embrasement, étrangement c'est Sylvie qui se précipite la première et les guys la suivent en ce qu'il faut bien reconnaître être un joyeux bordel, ou un foutraque fourre-tout. Nous leur décernons l'ordre de la toison d'or. Goo goo muck : les Cramps se sont toujours vautrés dans le stupre et l'opprobre, même que Lux retrouve des intonations cochranesques, ce genre d'exercice doit inspirer la horde crampsique, la guitare de Karim flamboie, la basse du Loser louvoie d'une façon perverse, Sylvie vous botte les fesses y el Professor Von debout s'applique comme le meilleur élève de sa classe. Ce coup-ci nous leur offrirons un séjour en thalassothérapie au fond d'un bayou vaseux peuplé d'alligators, ils l'ont amplifiquement mérité. Miniskirt blues : n'ai jamais compris comment une mini-jupe pouvait refiler le blues, je remarque d'ailleurs que les Cramps ça leur a plutôt filé la banane, quant au Professor je ne vous dis pas, bande comme un onagre qui jute du vinaigre vitriolé, le Karim on ne le retient pas file des coups de guitare -butoir dans tous les trous de souris qui passent, le Loser insidieux et ronronnant pousse au crime, n'y a que Sylvie qui fasse le job sans débordement, au moins elle saura que chez El Cramped ce sont les hommes qui portent la mini-jupe. Lonesome town : Le Lux vous fait sa voix d'homme des cavernes mal réveillé qui s'aperçoit que sa hyène favorite l'a quitté pendant la nuit, El Professor ne rate pas le numéro de la grande larmoyance, le Loser essuie les larmes qui déferlent sur sa basse, la Sylvie vous tape le glas aglagla, la guitare de Karim pique une crise de nerf désespérée, el Professor chiale un petit coup et vous sortez votre mouchoir pour éponger vos yeux humides. Les rockers sont ainsi, en apparence de sombres brutes, passez-leur le slow de l'été, ils pleurent comme des madeleines.
Certains opteront pour la première face davantage tape-à-l'œil au beurre noir, d'autres éliront la musicalité sonore de la deuxième, beaucoup resteront dans l'indécision, mourront de faim et de soif sur place, tant pis pour eux, c'est si évident qu'il faut préférer les deux. Ce qu'il y a de sûr c'est que le Loser et El Professor sont désormais réhabilités au tribunal du rock'n'roll, ils ont coché toutes les cases de l'Abécédaire, signez la pétition pour que leur soit offert la chaire de Crampologie au Collège de France. Pour une fois qu'un Professor aura mis en pratique ce dont il cause...
Damie Chad.
P. S. : Au dos de la pochette, El professor rappelle que Lonesome Town de Ricky Nelson a été aussi adapté par Richard Anthony et Françoise Hardy, sous le titre La rue des cœurs perdus, Hardy l'a aussi enregistrée en anglais ( c'est une intellectuelle qui désespère même les singes ), la meilleure adaptation en la langue de Pierre Louÿs reste celle de Johnny Hallyday en 1996 sous le titre La ville des âmes en peine.
L’avenir du rock - Cette bête de Bette
Le pandemic et l’avenir du rock sont assis à la terrasse d’une brasserie. Sournois et vénal, le pandemic ne rate pas une seule occasion d’insulter l’avenir du rock :
— Je vais te baiser la gueule en beauté ! Sans concerts, t’es mal barré, pauvre con d’avenir du rock !
— Tu crois m’impressionner avec tes petites menaces à la mormoille ?
— Même si les concerts repartent, j’obligerai les gens à porter des masques ! Tu vois un peu la gueule des rockers avec des masques ? Ha ha ha ha !
— Je viens de te le dire, tes conneries ne m’impressionnent pas.
— En plus, je vais faire souffler les rockers dans le ballon, avant et après les concerts, ha ha ha ha ! Terminé, l’avenir du rock, tout le monde descend !
— C’est là où tu te plantes, mon pauvre pandemic. Ce n’est pas parce que tu as empuanti les medias - qui d’ailleurs puaient déjà pas mal - et que tu as plongé les populations dans la stupeur - ça n’était pas très compliqué - que tu as gagné. Tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’au coude, pauvre connard de pandemic. Tu veux savoir pourquoi tu as perdu la partie ?
— J’espère que tu ne vas pas me sortir la litanie des vaccins...
— Je ne te croyais pas aussi con. La réponse, c’est une petite blackette nommée Bette Smith.
Remontons si vous le voulez bien à l’an de grâce 2017. L’un de ces canards anglais qu’on dévore chaque mois disait le plus grand bien d’une certaine Bette Smith. En tête de chronique figurait la pochette de l’album. Même à la taille d’une vignette, on voyait bien que Bette Smith avait fière allure, avec sa belle afro. Elle avait des faux airs de Candi Staton. Son album s’appelait Jetlagger et paraissait sur l’excellent label Big Legal Mess, qui est une filiale de Fat Possum. Big afro, Big Legal Mess, cinq étoiles : il n’y eut aucune hésitation. Dévoré de curiosité, rongé de fièvres, nous rapatriâmes ce mystérieux album.
Dès «I Will Feed You», on est tombé sous le charme de cette Soul Sister et sa fascinante présence vocale. Elle tapait dans une heavy Soul de magie pure. D’une pesanteur superbe, sa Soul-psych frisait l’hendrixité des choses. Mais qui rôdait derrière ce son ? Jimbo Mathus, évidemment ! Oh mais aussi Matt Patton, le bassman des Dexateens, légende de l’underground alabamien. Cette bête de Bette développait la même puissance que l’«Hey Joe» de 1968. Splendeur ténébreuse ! Avec «Flying Sweet Angel Of Joy», elle tapait dans le gospel batch. Sa Soul sonnait comme une déflagration neuronale, elle inoculait la peste noire à la peau blanche, elle était aussi farcie de gospel qu’une dinde de Noël. Cette fantastique shouteuse inventait carrément le gospel psychout so far out. Elle revenait à des choses plus classiques avec le morceau titre, comme si elle voulait accorder un répit à sa troupe. Du coup, elle redevenait prévisible. Mais elle allait retrouver l’assise de sa véracité avec «I Found Love». C’est là que toutes les puissances du Big Legal Mess System se jetaient dans la bataille. On assistait alors à une stupéfiante course à l’échalote, doublée d’une épique partie de bassmatic signée Matt Patton. Cet album était tout simplement la révélation de l’an de grâce 2017. Avec «Manchild», Bette flirtait avec un rockalama à la Merry Clayton. Elle shoutait sa Soul de rock à la glotte fêlée et au guttural primitif. Cette petite Soul Sister enfilait les surprises comme d’autres enfilent la voisine de palier. Et puis, comme Napoléon, l’album entrait dans son déclin, avec une série de cuts ratés comme «Shackle & Chain», procession branlante de traîne-savates, ou encore «Morning Bench», vieille soupe de boogie Soul. Elle terminait avec un «City In The Sky» claqué au petit riff d’orgue, qu’elle travaillait au corps, comme savent si bien le faire les grandes Soul Sisters.
Bette revint nous sonner les cloches l’an passé, avec un deuxième album, The Good The Bad And The Bette, paru sur Ruf, le label de blues allemand de Thomas Ruf. On retrouvait sur l’album Jimbo Mathus et Matt Patton, mais aussi Luther Dickinson et Patterson Hood, d’autres poids lourds de l’underground local (Patterson et Matt Patton jouent dans les Drive-By Truckers et Luther, fils de Jim, dans les North Mississippi Allstars - dont la tournée européenne vient d’être annulée, merci enfoiré de pandemic). Avec ce fantastique album, l’avenir du rock pouvait dormir sur ses deux oreilles. Bette démarrait avec un vieux shoot de heavy Soul, «Fistfull Of Dollars», qu’elle prenait d’une voix de délinquante, avec tout le gusto du ghetto, et derrière, les petits blancs jouaient comme des démons échappés des bréviaires, le tout arrosé d’arrangements de trompettes demented. Bette Paracelse fondait la Soul et le rock dans son athanor. Mais elle nous réservait des coups plus terribles encore, comme cet «I Felt It Too», véritable coup de génie, le cut sonnait comme de la heavy Stonesy pachydermique, on n’avait encore jamais entendu ça, même sur les albums de Merry Clayton. Plus loin, elle se permettait une nouvelle outrance : réinventer le genre avec «Pine Belt Blues», nouveau shoot de Stonesy revue et corrigée, un shoot bardé de toute la heavyness du monde, contre-claqué de tout le black power du heavy Southern rock et le diable sait que le Southern rock peut être heavy, demandez aux frères Robinson, ils sauront vous le dire. Cette bête de Bette était complètement déchaînée, jamais un adjectif n’aurait pu sonner aussi juste. Elle cassait encore la baraque avec «I’m A Sinner», soutenue par une énorme présence guitaristique, Jimbo, Luther ? Elle tapait dans le dur, la mémère, elle avait du tenant et de l’aboutissant. On savait que Luther jouait sur «Sighs & Wonders», car il était crédité sur la pochette. «Human» retombait en plein boom de big heavy Southern rock. On n’avait pas entendu de Southern rock aussi bon depuis des lustres, c’est-à-dire depuis les grands albums des Drive-by Truckers et des Black Crowes. Franchement, cet album fonctionnait comme un extraordinaire exutoire de Soul-rock power.
— Qu’est-ce que t’as, pandemic, t’es tout blanc !
Signé : Cazengler, Bette comme ses pieds
Bette Smith. Jetlagger. Big Legal Mess Records 2017
Bette Smith. The Good The Bad And The Bette. Ruf Records 2020
Spectorculaire
- Part Three - The fall
Bon, la chute de Totor est quand même pas mal. Elle passe par John Lennon, George Harrison, Dion, Leonard Cohen et quelques autres jolis coups. Elle passe aussi hélas par les guns et quelques déraillements. Après le flop de River Deep, il se retire complètement du business et traîne avec des mecs assez hauts en couleurs : Gerry Goffin, Dennis Hopper et Peter Fonda. Totor porte du cuir et roule en Harley. Gerry conduit une BSA. Ils partent tous les deux en virée dans les Santa Monica Mountains. Ils roulent sans savoir où ils vont. Peter Fonda roule aussi en Harley, il porte des casques militaires, il ne vit de qu’acide et de vitamines, c’est un proche des Byrds et de Terry Melcher.
Dennis Hopper branche Totor sur le cinéma et tente de l’entraîner dans un projet de film, The Last Movie. Hopper apprécie énormément Totor, d’ailleurs, il rétablit des vérités : «Phil a été formidable avec Lenny Bruce. Il l’a beaucoup aidé. C’est un truc que le gens ne voyaient chez Phil, on le considérait comme un monstre, mais il était le plus généreux des mecs, the kindest guy.» On voit Totor dans Easy Rider. Il joue le rôle du drugdealer dans sa Rolls. Fonda : «On voulait Phil parce qu’on savait qu’on aurait sa Rolls à l’œil. Il avait vraiment la gueule du rôle.»
En un an, le music biz a changé du tout au tout. Le Wall of Sound est devenu obsolète et les girl-groups appartiennent à l’histoire. Il n’y a plus de place pour un mec comme Totor. Il n’a que 27 ans mais il n’a déjà plus d’âge. Il passe des périodes entières enfermé chez lui dans la pénombre à visionner ses old Hollywood movies, avec Edward G. Robinson, James Cagney, Laurel & Hardy, Harold Lloyd, son film préféré étant Citizen Kane. Comme Spector, nous dit Brown, Welles était un prodige - il avait tourné Citizen Kane à l’âge de 26 ans - il était un génie qui refusait de se compromettre et qui voulait plier le monde à sa vision. Quand Totor prend la parole, c’est pour dire ses quatre vérités : «Je ferai toujours un bon disque et il sera meilleur que toute cette merde qu’on entend aujourd’hui. Ils ne savent pas enregistrer. Ils ne savent rien de la profondeur, rien du son, rien de la technique, rien about slowing down.» Il a raison de parler ainsi, Totor, car depuis River Deep et Lovin’ Feelin’, on n’a jamais rien entendu d’aussi puissamment parfait.
Quand Mick Brown réussit enfin à rencontrer Totor chez lui pour une interview, ça donne des pages extraordinaires. Totor avoue qu’il n’a pas fait tout ça pour de l’argent - That wasn’t part of the game plan - Maniaque ? - Let the art speak for itself. If the art is maniacal, then I’m maniacal - Il fait une pause et embraye sur Orson Welles : «Orson Welles a passé toute sa vie à chercher de l’argent, parce qu’il n’en a jamais eu. Il a fini par peser 200 kg et par faire des wine commercials. Il n’est jamais devenu le génie qu’il aurait dû être parce qu’il n’a jamais su ce qu’il voulait faire. On l’a vu en playboy, en movie star, il aurait pu être sénateur. Il ne savait pas ce qu’il voulait être. Moi je savais exactement ce que je voulais être. I let the art speak for itself.» On entre avec Brown dans l’esprit de Totor qui poursuit : «Je manufacturais des disques, je les publiais et je les composais. L’arrivée des Beatles est un truc qui m’intéressait, intellectuellement. Je faisais encore mon truc quand les Beatles occupaient les cinq premières places des charts. L’ échec commercial du Christmas Album m’a dévasté. Mais ce ne fut pas aussi douloureux que l’assassinat de Kennedy (...) Puis il y a eu la folk music, Peter Paul and all that shit, Joan Baez... Dylan, je comprenais, parce qu’il était unique, mais il y avait tous ces horribles groupes de folk au Troubadour, et quand la disco est arrivée, whoah... J’étais dépassé. Quand je ne comprend pas un truc, ça devient confus dans ma tête.» Cette interview est le cœur battant de cet excellent book qu’est le Bown book. Et puis arrive la confession définitive : «Vous finissez par apprendre à mettre les choses en perspective. Ces disques furent le plus grand amour de ma vie, quand je les faisais. Je ne vivais que pour eux. C’est pourquoi je n’ai jamais pu avoir de relation durable avec personne. Les disques étaient toute ma vie, ils étaient plus important que tout. Alors, maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils ne signifient plus grand chose.»
Pourtant, sa magie semble être restée intacte. Un jour Ahmet Ertegun amène Otis Redding chez Totor, qui pour rendre hommage à son vieux mentor, s’assoit au piano et joue des choses qu’Ertegun avait composées. Ertegun : «Otis was blown away. Il connaissait certaines chansons, mais il ne savait pas qui les avait composées.» Puis Ertegun suggéra d’aller faire un tour en ville, Esther Phillips se produisait dans un club du quartier black de Watts - Otis and Esther sang duets together for hours. Phil jouait du piano, et il les accompagnait au chant. Ça a duré jusqu’à 5 h du matin. Two of my all-time favorite singers, Otis, Esther, and Phil on piano. It was one of the greatest evenings of my life. Autre moment magique dont parle Dan Kessel, le fils de Barney Kessel, un peu plus loin, dans le Brown book. Totor emmène les frères Kessel voir Elvis à Vegas et bien sûr ça se termine dans le backstage - C’était très intense, the full Phil trip and the full Elvis trip. Ils savaient tous les deux qui ils étaient, ils se reniflaient comme deux panthères, il y avait un respect mutuel. It was definitively one of these moments - Et Dan Kessel ajoute : «Phil était beaucoup trop rock and roll pour la plupart des gens, même ceux qui se prenaient pour des soit-disant rock and rollers. Les gens ne savent pas qui est Phil, à quel point il peut être marrant. Ils ne peuvent pas le suivre, trop d’énergie, trop d’esprit, trop de personnalité, alors ils disent qu’il est cinglé. Jamais je n’ai vu en lui quelqu’un de cinglé.»
C’est Larry Levine, devenu producteur chez A&M, qui remet Totor dans le circuit. Aux yeux de Jerry Moss, il n’est pas normal qu’un type aussi génial que Totor soit sorti du circuit depuis trois ans. Alors il lui donne les clés du label et lui dit : «Tu enregistres qui tu veux !». Totor revient à ses premières amours, the black voice, et fait comme il l’a toujours fait, il déniche un groupe complètement inconnu. Il s’intéresse de près aux Checkmates Ltd et à ses deux chanteurs noirs, Bobby Stevens et Sonny Charles qui, comme David Ruffin et Eddie Kendricks dans les Temptations, alternent les lead vocals. Dans son book, Williams dit le plus grand bien de The Checkmates Ltd Live At Caesar’s Palace, paru avant l’arrivée de Totor dans les parages. Williams jongle avec les formules phenomenal pace, tremendous atmosphere, supersonic medley et il met le coup de grâce en insinuant de Stevens et Charles chantent Lovin’ Feelin’ mieux que les Righteous. Williams n’a pas tout à fait tort : Live At Caesar’s Palace est un très bel album. Ces mecs font un medley-chair à saucisse de tous les grands hits de la Soul et Sonny Charles stabilise ensuite l’album avec une fantastique cover du mighty «Sunny» de Bobby Hebb. Ce fabuleux Soul Brother swingue ça au snap. Charles et Stevens sont excellents, on les voit duetter comme Sam & Dave dans «A Quitter Never Wins» et pouf, les voilà qu’ils s’attaquent à Lovin’ Feelin’. Ils négocient bien la montée et la foule claque des mains, alors c’est dans la poche, baby baby I need your love ! En B, ils rendent hommage à Joe Tex avec «Show Me» et à Sam & Dave avec «Hold On I’m Comin’». Ça se termine en festin Motown avec «Baby I Need Your Lovin’», mais c’est surtout un hommage à Otis avec tout le raw de Gotta Gotta dont est capable Bobby Stevens.
Totor accepte de produire «Black Pearl» pour les Checkmates. Williams compare les exploits de Sonny Charles à ceux de Tina dans River Deep - C’est typique de la façon dont Spector peut obtenir une performance exceptionnelle d’un artiste qui n’est pas très connu - Williams rend un bel hommage au flair de Totor. Mais l’album Love Is All We Have To Give paru en 1969 subit le sort des albums des Righteous. Derrière le hit, c’est morne plaine. Mais Bobby Charles et Bobby Stevens se battent pour entrer dans la légende. Ils rendent hommage à Totor avec une belle cover de «Spanish Harlem». Pour l’occasion, Totor ramène une trompette mariachi et Sonny Charles chante au sucre black. Et voilà «Black Pearl», composé par Totor et Toni Wine. Ça sonne un brin Motown, mais ce n’est pas au niveau des grandes compos d’antan. Puis ça commence à tourner en rond avec «I Keep Forgettin’». Totor ne peut pas surmonter River Deep. En fait, cet album documente le dernier spasme d’un visionnaire, avec deux chanteurs exceptionnels. Quant à la B, on l’oublie, c’est Hair et ça ne vaut pas un clou.
Totor se retire vite fait du plan Checkmates, car il craint de retomber dans les embrouilles de type Righteous Brothers. Il ne finit d’ailleurs pas l’album, qu’il confie aux bons soins de Perry Botkin Jr.
En 1970, les Beatles sont en panne avec Let It Be. Ils ne sont pas contents du travail de Glyn Johns et de George Martin. Allen Klein qui s’occupe d’eux leur suggère le faire intervenir un sauveur nommé Phil Spector. Dans les pattes de Totor, l’album prend une certaine allure, il faut bien l’admettre. Surtout «Get Back». Les gens ne savant pas forcément que «Get Back» est spectorisé. Et pourtant, le génie du son, le voilà. C’est du Totor pur. S’il ne faut garder qu’un hit de 1970, c’est «Get Back». Totor préfigure tout l’a-venir et notamment Dave Edmunds. Si «Get Back» - comme d’ailleurs «My Sweet Lord» ou encore «Instant karma» - a explosé les radios, à l’époque, ce n’est pas un hasard, Balthazar. Dès «The Two Of Us» qui ouvre le bal d’A, Totor plombe la beatlemania pour son plus grand bien. Comme il le fera un peu plus tard avec les Ramones, il veille à conserver la spécificité de leur son. C’est extrêmement intelligent de sa part. Il amène juste de la matière dans le son. Lennon se radine avec un hit mélodique, «Across The Universe». Dans les pattes de Totor, ça devient de la beatlemania évolutive. Totor ramène des chœurs superbes, il aime le beau, ça crève les yeux. George fait un grand bond en avant avec «I Me Mine». Totor lui charge bien la barcasse. Belle surprise en B avec «I’ve Got A Feeling», une heavy beatlemania animée d’une réelle volonté d’en découdre. Les Beatles cherchent à renouer avec «Helter Skelter». Puis Totor orchestre à outrance «The Long And Winding Road», ce qui débecte McCartney. Il est furieux parce qu’on ne l’a pas prévenu. Un mois avant la parution de Let It Be, McCartney sort son premier album solo et annonce qu’il quitte les Beatles. Il va faire un blocage sur Let It Be et n’aura de cesse de vouloir ressortir l’album déspectorisé, ce qu’il parviendra à faire avec Let It Be Naked. Pauvre cloche. Bien sûr, les critiques se rangent du côté de McCartney pour taper sur Totor. La presse lâche ses chiens - How Spector ruined the Beatles - Les Anglais ne supportaient pas qu’un Américain puisse gérer les Beatles. Mais comme le dit Brown, l’album fit un carton aux États-Unis, se vendant en deux jours à deux millions d’exemplaires - merci monsieur Totor - et déboulant à la première place des charts US. Un peu plus tard, la même année, l’album reçut un Grammy que McCartney n’hésita pas à aller récupérer.
Il n’empêche que Totor s’entend bien avec John, George and Ringo. Pas Paul qui ne supporte ni Klein ni Totor. Mais Totor s’en bat l’œil. Et c’est là que sa carrière de genius redémarre, avec les albums de John et de George. Quand il produit All Things Must Pass, le triple album de George Harrison, Totor utilise sa recette habituelle : la crue du groove avec un nombre considérable de guitares qui jouent à l’unisson, ce qui donne au cut sa substance et ses ailes. Ce sont les mecs de Badfinger qui grattent les grattes sur «Isn’t It A Pity». Billy Preston n’aimait pas le Wall of Sound, il trouvait que ça allait bien avec les Ronettes, mais pas avec les Beatles. Mais curieusement il trouvait que ça collait bien avec le stuff de George. Cet album va faire de George une star, par dessus les têtes de Lennon et McCartney. Avec l’aide inestimable de Totor, George créait le premier new rock idiom des seventies.
C’est vrai qu’All Things Must Pass vaut le déplacement. Belle boîte et dedans trois albums et un poster de Gorges qu’on a tous mis au mur à l’époque. Et très vite «My Sweet Lord» éclate, encore un hit intemporel, on est une fois de plus projeté en pleine spectorisation des choses, on sent l’afflux de pression des chœurs, c’est quand même quelque chose. Encore du big sound avec «Wah Wah» et tout le power des Beatles en filigrane. Cette conjonction de deux courants primordiaux (Totor + Beatles) est unique dans l’histoire du rock. Totor ramène des coups de slide dans le Wall. George finit l’A avec une version one d’«Isn’t It A Pity», un balladif mélodiquement pur et du son à n’en plus finir. En B, George reprend l’«If Not For You» de Dylan et dans sa bouche, ça tourne au prodige de délicatesse. On est un plein rêve d’équation : the song + le son + la voix = Totor forever. Bon tous les cuts ne sont pas renversants, mais quand ça décolle, ça monte très haut. George nous comble de ses bienfaits et de sa douceur mythique avec «Run Of The Mill», alors Totor ramène des trompettes dans le Mill. Le deuxième disk baisse d’un ton. George compose tout, mais ça ne marche pas systématiquement, même s’il reste charmant. Avec «Ballad Of Sir Francis Crisp (Let It Roll)», George tire les fils avec une infinie patience et un talent fou. Il dispose du même sens d’attaque magique que Lennon. Totor ramène son Wall pour «Awaiting On You All». On retrouve enfin les résonances de basse et l’architecture des chœurs et des percus qui font la hauteur du Wall. Et alors wow ! En D, «Art Of Dying» peine à jouir, malgré le Wall. La compo ne convainc guère, malgré l’embarquement au bassmatic et les trompettes mariachi. C’est avec le version two d’«Isn’t It A Pity» que George trouve la voie de la rédemption et nous l’illumination. Avec cette merveille, il nous enlace la cervelle pour l’embraser. Quant au troisième disk, on l’oublie.
Totor flashe en particulier sur l’une des compos de George, «Try Some Buy Some». Elle devait figurer sur All Things Must Pass, mais Totor voulait la garder pour Ronnie. Ce qu’il désirait le plus au monde, c’était refaire un hit inter-galactique avec Ronnie et c’est Try Some. Il la fait venir à Londres, mais Try Some est loin de «Be My Baby», George a composé un hymne qui rejette le matérialisme, un truc que Ronnie ne pouvait même pas comprendre, nous dit Brown. Totor fait de cette chanson plaisante un smash épouvantable, il l’orchestre et l’arrange, 40 violons autant de mandolines, some great blocks of sound qui s’articulent les uns sur les autres, mais c’est un nouvel échec commercial. Totor est scié, complètement scié. Ce Try Some va rester out of print pendant 40 ans, jusqu’à la sortie d’un Best Of d’Apple Records.
On trouve aussi ce Try Some sur un The Very Best Of Ronnie Spector. C’est l’occasion de vérifier la vieille théorie de Totor : pas de compo = pas de magie. La moitié des cuts de ce Very best retombent à plat, car pas de compo. Par contre, tous ceux que Totor supervise sont des hits intemporels, et avec le recul on comprend à quel point Ronnie devait tout à Totor. Si elle chaloupe si bien des reins dans «Do I Love You», c’est grâce à Totor, et Ronnie s’empale sur un sexe pop imaginaire, oh oh oh, ces petites new-yorkaises métisses étaient folles de sexe, et c’est ce qu’elles célébraient. Le «You Baby» de Spector/Mann/Weil n’en finit plus de briller au firmament. Totor fait le maximum pour que Ronnie jouisse en chantant et «Baby I Love You» sonne toujours comme le plus gros hit des sixties, c’est la pop au sommet de son art, suivie de près par «Walking In The Rain» et son développement spectorculaire. Seul Totor pouvait aménager de telles avancées, et Ronnie se contente de chanter cette merveille écroulée de beauté. C’est encore Totor qui met Ronnie en orbite sur «Be My Baby». S’il n’y a pas le Wall et les castagnettes, il n’y a rien. Et puis voilà le cut du grand retour imaginé par Totor et George Harrison : «Try Some Buy Some». On peut se limiter à n’écouter que cette merveille. C’est très anglais, forcément, et Totor ramène des mandolines. Il bâtit un Wall pour elle et ça tourne inexorablement à la magie. Ce Try Some en dit long sur le flair de Totor. Il sait que c’est l’un des hits du siècle, ça s’entend my friend, on sent monter la marée du Wall, Totor envoie ses mandolines, c’est assez diabolique en fait, et il sucre son Wall avec le sucre de Ronnie. Quand on y pense, Ronnie/George/Bowie, quelle belle filiation. Et puis après, tout s’écroule. On voit la pauvre Ronnie se vautrer avec les Asbury Jukes, puis le E Street Band. Sans Wall, Ronnie est à poil. Elle fait aussi une reprise de «You Can’t Put Your Arms Around A Memory» et un «All I Want» avec Keef. Mais c’est avec une reprise du «Farewell To A Sex Symbol» qu’elle sauve les meubles. C’est la rencontre de Ronnie avec l’univers de Luc Berger et Plamondon, mais c’est aussi celui de Diane Dufresne. Au premier abord, Ronnie passe pour une new-yorkaise qui ne comprend rien et qui est larguée sans son Totor, mais elle s’accroche et devient magnifique, justement parce qu’elle n’est qu’une petite greluche de rien du tout, alors elle se bat avec la chanson, elle remonte le courant des Canadiens et elle fait sa Dufresne. Elle honore le génie des légendes québécoises - Let me go/ let me die - Elle est stupéfiante de réalisme soviétique - I love you - Elle entre dans la légende de Diane Dufresne qui elle aussi chantait cette merveille - Un jour je dirai bye bye/ Bye bye ma jeunesse/ Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolor/ J’ai raté ma vie et je ne veux pas rater ma sortie/ Laissez-moi partir/ Laissez-moi mourir avant de vieillir.
Mais alors, où est passé le Try Some enregistré avec George ? Il se trouve sur Living In The Material World. En fait George enregistre cet album un peu plus tard, en 1973 et conserve l’orchestration de Totor pour son Try Some. C’est comme on l’a dit un hit magique. Si Bowie le reprend un peu plus tard, ce n’est pas un hasard. On assiste là à un phénomène rare qui s’appelle la mélodie suspensive. Ne va pas croire que c’est une drug song, non, il s’agit de spiritualité. On en veut un peu à George de ne pas composer plus de merveilles de cet acabit, car en vérité, le reste de l’album n’est vraiment pas jojo. Dans le gatefold, George a dressé une grande table sur la pelouse de son domaine et il y reçoit ses amis Gary Wright, Nicky Hopkins, Ringo, Klaus Voorman et Jim Keltner. À part Try Some, aucune compo de l’album ne marche. On s’ennuie avec la petite pop de «Don’t Let Me Wait Too Long» et le morceau titre. Totor brille par son absence.
Totor et John Lennon deviennent potes et hop on fait des hits : «Instant Karma», etc. Et hop, il produit le premier album solo de John Lennon, l’excellent John Lennon/Plastic Ono Band paru en 1970. On voit tout de suite que Totor respecte la modernité de ton de Lennon. Il plonge «I Found Out» dans le muddy, c’est admirable et l’association des deux génies porte ses fruits. Lennon impose le respect avec «Working Class Hero» qu’on a peut-être trop entendu à la radio et Totor donne une extraordinaire profondeur aux accords de piano d’«Isolation». Lennon a un don pour twister sa mélodie, il peut aller swinger un swagger à la pointe de la glotte. Totor n’en finit plus d’aménager du deepy deep. C’est un prodige car il fait à la fois du Lennon et du Totor. Retour à l’ambiance «Cold Turkey» avec «Well Well Well». Totor fait battre le tambour des galères - Well well well/ Oh well - C’est niaqué dans la moelle du beat et Lennon pique une crise extraordinaire. Il screame son Cold Turkey. L’autre stand-out track de l’album est bien sûr «God», une grande déclaration d’I don’t believe. Alors il énumère tout ce qu’il don’t believe : Hitler, Jesus, Kennedy, Buddha, Yoga, kings, Elvis, Beatles et il termine avec un just believe in me. Et il ajoute que le dream is over. Le message est clair - I was the walrus/ But now I’m John.
Klaus Voorman observe Totor en studio : «Tout le monde dit que ce mec est cinglé, mais pas du tout, c’est un mec tranquille, très intelligent et qui a de l’humour. Il s’entendait en plus très bien avec Yoko. Il lui parlait et lui racontait des blagues.» John et Totor ont en outre une passion pour le early rock’n’roll, Sun et Chuck Berry. Totor dit de John qu’il est le frère qu’il n’a jamais eu.
L’année suivante, il produit Imagine. Un docu très bien foutu nous montre Lennon et Yoko dans leur beau château de Tittenhurst Park, au moment des sessions d’enregistrement de l’album. Totor apparaît avec ses lunettes noires et son costume trois pièces, on voit aussi George, Klaus Voorman, Nicky Hopkins et d’autres gens. Lennon chante le morceau titre assis à son piano blanc. Près de lui se tient Yoko qui ne dit rien. Bon, «Imagine» reste «Imagine», Totor lui donne de la profondeur, c’est deepy deep, mais il respecte l’esprit de Lennon. Il applique à nouveau sa formule : mélodie + voix + prod = win à tous les coups - I hope you’ll join us - Totor aménage tout l’espace nécessaire à cette mélodie tectonique. L’autre merveille de l’album c’est bien sûr «Jealous Guy». Lennon la pianote sous couvert d’orchestrations latentes - I’m sorry that I made you cry - Bon certaines chansons restent à la traîne, mais God que de son. On entend les accords de «Cold Turkey» dans «It’s So Hard», mais ce heavy boogie ne décolle pas. Par contre, «Gimme Some Truth» tape bien dans ce heavy beat qui va si bien à Lennon. C’est assez Walrus, yes gimme some truth - «I Don’t Wanna Be A Soldier» sent bon la dope. Lennon et Totor s’offrent un beau délire et le Wall refait surface dans «How Do You Sleep». Brown nous dit que Totor fait d’Imagine l’album le plus parfait et le plus commercial que Lennon ait jamais enregistré. Étant donné que certaines chansons touchent le cœur et inspirent de l’espoir, Brown pense qu’Imagine fut Spector’s finest accomplishment as a producer.
Bizarrement, le Some Time In New York City de John & Yoko fut longtemps considéré comme un album raté. C’est tout le contraire, Lennon et Totor y font de l’avant-garde. Mais c’est Yoko qui rafle la mise dans cette affaire avec «We’re All Water». Elle chante au sucre avec un côté pré-pubère asiatique, elle pousse des petits cris expérimentaux en pleine craze de sax. Elle est vraiment marrante. En tous les cas elle fait le show et explose les concepts quand ça lui chante. Elle sait pousser à la roue et du coup ça tourne au dada jive. C’est encore elle qui chante «Sisters O Sisters», un joli pied de nez au Brill. Elle ressort son sucre pré-pubère asiatique et ça tourne à la révélation. Ce démon de Totor fait du Brill avec Yoko ! Wow, il fallait oser ! On entend encore Yoko dans «Born In A Prison». Ses tonalités sont très spéciales. Lennon a raison de pousser Yoko en avant, elle fait de l’Ono beatlemaniaque, elle chante dans l’entre-deux avec naïveté et ça devient fascinant. Et Lennon dans tout ça ? Oh, il fait pas mal de politique («Woman Is The Nigger Of The World», «Attica State») et c’est on s’en doute superbement produit. Totor fait son job. Lennon casse bien la baraque avec «New York City». Même énergie que dans «Back In The USSR», on retrouve le fantastic Lennon drive. L’album se révèle extrêmement dense. Encore une belle énormité avec «Sunday Bloody Sunday». Puis Lennon demande la libération de John Sinclair dans «John Sinclair» - It ain’t fair/ John Sinclair/ You gotta set him free - Il obtiendra d’ailleurs gain de cause. Comme c’est un double album, la fête continue et on tombe sur une fantastique version de «Cold Turkey» bien chargé de gras double. Lennon sait ce qu’il fait - One thing I’m sure/ I need to be free - Live c’est excellent, Lennon fournit tout le fourniment - Thirty-six hours/ Rolling in pain/ Praying to someone/ Free me again - Il pousse ses ahhh, il pousse ses ohhh, il pousse sa dégénérescence liverpuldienne, voilà le real Lennon, mais il ne pousse pas les screams qu’on entend sur le single, dommage. Et puis voilà le coup de génie : «Don’t Worry Kyoto». Yoko se met à gueuler, mais elle gueule dans l’épaisseur du son. Elle chante à la glotte déchirée et il se passe un truc encore pire que «Cold Turkey», elle génère de la folie, mais de la vraie folie, celle du free, ça brûle de free, et Yoko n’en finit plus d’allumer cette merveille, elle Yokotte comme une dératée et cette fois ça marche au delà de toutes les espérances du cap de Bonne Espérance. Puis Lennon fait quelques cuts avec les Mothers et tout le Fillmore reprend Scumbag en chœur. Mais l’album est une échec commercial et Lennon va bouder pendant un an.
C’est John qui entraîne Totor dans la boisson. Pour imiter son idole, Totor essaye de suivre, mais il ne tient pas l’alcool. Deux verres dans le pif et il devient Mr Hyde, et s’en prend aux gens - He would turn on people and be horrible - Totor sort son flingue pour tirer dans le plafond et il fout un peu la trouille aux gens qui sont avec lui en studio. Pendant l’enregistrement de Rock’n’Roll, Lennon et Totor boivent comme des trous. C’est le chaos lors des sessions. Harry Nilsson fait partie de la fête. Lennon est incontrôlable. Totor et son garde du corps sont parfois obligés de le virer du studio. Quand ils l’attachent, c’est parce Lennon devient suicidaire, alors il traite Totor de Jew bastard. En studio, Totor est tellement pété qu’il passe son temps à provoquer des bagarres. Ils enregistrent une douzaine de cuts, dont «Be My Baby» et «To Know Her Is To Love Her», mais Lennon ne va en garder que 5 pour Rock’n’Roll. C’est avec «You Can’t Catch Me» que Totor renoue avec ce que Lennon appelle the primal magic of rock’n’roll. Totor ressort le son d’«Instant Karma» pour catcher «You Can’t Catch Me». Il existe une belle entente entre Lennon et le Wall. On peut parler de version magique. Même chose pour la version de «Sweet Little Sixteen». Le Wall fait des merveilles et Lennon chante divinement. «Peggy Sue» en B est sans doute la cover la plus nerveuse du lot. C’est pulsé au beurre. On se régale aussi du big bass sound dans «Be Bop A Lula». Et Totor retrouve ses racines à deux reprises : «Stand By Me» et «Bring It On Home To Me». Il est en plein dans son domaine, la Soul de ses débuts. Mais les relations s’enveniment entre Lennon et Totor. Les avocats sont entrés dans la danse.
Il y a deux épisodes marrants qui suivent le chaos des Rock’n’Roll sessions. Totor jouait dans le control room avec Mal Evans, le roadie des Beatles. Ils jouaient à se mettre des claques et soudain, Totor s’énerve et dit «attends tu vas voir», il sort son flingue et le coup part tout seul. Il n’avait même pas mis le cran de sûreté. Le lendemain Mal Evan vient retrouver John et May Pang, la remplaçante de Yoko, dans un restau. Il sort une balle de sa poche. Here’s the bullet from last night. Lennon ne comprend pas : What bullet ? Tout le monde croyait que Totor tirait à blanc. Ben non. L’autre truc poilant se passe un peu plus tard, au mois de décembre, au tribunal, lors de la procédure de divorce avec Ronnie. Lennon et May Pang accompagnent Totor. Pendant l’audience, Totor s’énerve et insulte tout le monde. Excédé, le juge lui dit que s’il ne se calme pas, il va aller au trou. Totor paye un poids lourd du barreau pour le défendre et le poids lourd se lève pour déclarer : «Vous devez comprendre que Monsieur Spector est un génie, et il vous faut parfois vous adapter.» À quoi le juge rétorque : «Bon, dites à votre génie de la fermer.» Très embarrassés, Lennon et May Pang quittent la salle. Le sort du Rock’n’Roll album est alors scellé.
Et alors, où sont passées les choses qui ne sont pas sur Rock’n’Roll ? On les trouve sur Menlove Ave., une espèce de compile parue en 1986, grâce à Yoko. On y trouve notamment une belle cover de «Since My Baby Left Me» - Okay okay this is it John - Alors John chante le big heavy shuffle du Record Plant avec des chœurs énormes. Totor sait ce qu’il fait. On retrouve le Wall sur «Here We Go Again». Trompettes à volonté et volonté de Yoko, ça donne du Wall posthume. On trouve aussi une version de «To Know Her Is To Love Her», un vieux coucou de Totor. Lennon va y chercher l’exercice de la fonction. Lennon + Totor = du gros bouzin. Les cuts produits par Lennon sont nettement moins présents. On perd le muddy du mono. Lennon semble respirer sur «Rock And Roll People», un cut qui n’a strictement aucun intérêt. D’autres cuts ne marchent pas, notamment le «Old Dirty Road» co-écrit avec Nilsson. Dès que Totor n’est plus là, ça plante. Lennon siffle comme un lad de Liverpool dans «Nobody Loves You (When You’re Down And Out)». Le fait qu’il siffle n’est pas hasard, il s’agit de John Lennon, after all. Justement, voilà la récompense : un «Bless You» joué aux accords magiques. Lennon est capable de créer une magie énorme, il joue au doux du smooth avec les accords les plus doux du monde.
Mick Brown nous sort un autre épisode désopilant, l’épisode David Geffen. Un mec qui se débrouille pas trop mal, puisqu’il s’occupe de Crosby Stills & Nash et de Joni Mitchell. Il devient l’amant de Cher après qu’elle se soit séparée de Bono. Geffen manage aussi Laura Nyro, et quand Totor lui demande s’il peut la produire, Geffen l’envoie promener. Puis Geffen commet l’irréparable : il récupère les vieux bureaux de Phillies sur Sunset Strip. Totor hait Geffen parce qu’il n’a aucun talent musical. Son seul talent est de savoir se rendre indispensable auprès de gens extrêmement créatifs. Geffen est donc une sorte de business king, alors que Totor est le real genius on the music side. Geffen demande à Totor de bosser sur une session de Cher et dans le control room il comment le deuxième irréparable : il fait des suggestions à Totor sur ce qu’il devrait faire. Totor se tourne lentement vers lui et boum, lui fout son poing dans la gueule. Geffen va au tapis - Get out of there, you stupid faggot!.
Mo Ostin tente de relancer la carrière de Dion et il met Totor sur le coup. C’est une bonne idée, car comme John Lennon, Dion cherche à retrouver ses racines. Ils viennent en outre du même coin, du South Bronx. À la fin des années cinquante, Totor connaissait son premier succès avec les Teddy Bears, alors que Dion & the Belmonts étaient dans les charts with the doo-wop hits. En 1975, Dion et Totor entrent en studio pour enregistrer l’album Born To Be With You. Totor mise surtout sur le morceau titre, un vieux hit des Chordettes qu’il transforme en mini-symphonie, avec un baion rhythm très ralenti, welcome to the de profundis, mais ça ne marche pas, même si Dion fout le paquet au chant. Alors Totor ramène un gros mélopif très orchestré, «Make The Woman Love Me», co-écrit avec Barry Mann et Cynthia Weil. C’est l’équipe de Lovin’ Feelin’. Totor tente de faire du sur-mesure pour Dion qui est un mélancolique néphrétique, le contraire du comique frénétique. Dion ramène tout un tas de pathos dans le Wall qui est déjà bien pathologique. Puis il se prend pour le Dylan de l’âge d’or avec «Your Own Back Yard». Il n’a pas besoin de Totor pour ça. C’est tellement arrosé d’orgue Hammond qu’on s’exclame : «Oh les belles nappes !». Totor tente de sauver l’A avec «(He’s Got) The Whole World In His Hand» et l’orchestration prend des proportions spectorculaires. Une fois plus, la profondeur du son nous subjugue. Mais c’est en B que se joue le destin de cet album qui du coup devient mythique. «Only You Know» est un coup de génie signé Goffin/Spector. On a tout de suite la belle pâte de son. Il faut au Wall des voix et des chansons, c’est le hit faramineux de l’équation parfaite : the song + the voice + the prod. Dion ramène à la suite «New York City Song», un balladif urbain presque californien, à force d’harmonies vocales. Nom de Dion, comme c’est beau ! Dion a du fion d’avoir le team Goffin/Spector pour lui écrire des hits comme «In And Out The Shadows». C’est tout de suite puissant. Pas aussi présent qu’«Only You Know», mais spectorish quand même, doté de tout le saint-frusquin : beauté intrinsèque, mélasse la violons dans la matière du Wall et vertiges orchestraux. Totor est un génie inventif, il a eu raison d’inventer le Wall, car c’est l’essence même de la grande pop américaine. On a là un stupéfiant espace de son. On tombe systématiquement sous le charme. On sent encore la patte du maître dans le «Good Lovin’ Man» de fin, un gospel de Broadway dévoré par les basses.
Mais Totor arriva en session avec un cubi de Manischewitz, un vin de dessert liquoreux, qu’il descend méthodiquement - Phil could be a lovable drunk, mais il était le plus souvent un horrible poivrot - Stan Ross qui bossait avec Totor pendant les sessions ne l’avait encore jamais vu dans cet état - The worst wine you could drink, drinking it by the bottle - Dion sent que Totor lui manque de respect. Nino Tempo lui dit que le mieux est d’en parler directement à Totor - Dis lui que tu es un artiste respecté et que tu veux être considéré comme tel. Alors Phil l’écoute et répond : Okay you cocksucking motherfuckers... and Mr. DiMucci - Dion dira plus tard qu’il avait l’impression que Totor avait une peur bleue de l’échec - Cette légende de producteur de génie lui mettait une pression terrible, il devait en permanence se surpasser - Les mecs de Warner Bros furent moins charitable que Dion. Ils demandaient où était passée l’énergie, où était la vie, ce qui rendit Toto furieux - What’s wrong with these fucking people? Phil Spector ne fait pas des disques pour les record executives, il EST the record executive. Vous devez être complètement cons pour passer un deal avec Phil Spector et penser qu’il ne fera pas un Phil Spector record - Il faudra attendre vingt ans nous dit Brown pour qu’une nouvelle génération de musiciens et de critiques voient en Born To Be With You the Spector’s forgetten masterpiece. Eh oui, un masterpiece de plus.
Dans l’interview qu’il donne à Mick Brown, Totor salue Dion : «I did Dion parce qu’il était le king of doo-wop et j’ai grandi en écoutant sa musique. Je voulais qu’il soit le prochain Bobby Darin qui était mon meilleur ami. Je n’ai pas passé assez de temps avec Dion, comme j’aurais dû le faire, parce qu’au fond ça ne m’intéressait pas. J’étais en plein déclin, et je me tenais prêt à dégager.»
Quand Marty Machat propose à Totor de produire Leonard Cohen, ça donne un sacré résultat. Mais les critiques sont aussi sceptiques que des fosses, ils trouvent le mélange Totor/Leonard incongru. Pendant les sessions, Totor et Leonard picolent ensemble, ils picolent pour de vrai, et les guns refont vite surface. C’est l’époque où Totor s’est mis à boire comme un trou et il ne sait plus ce qu’il fait. Il va dans des restaurants provoquer les gens et file aussitôt gerber dans les gogues. Il commande des homards qu’il ne mange même pas. Après coup, Leonard accusera Totor de lui avoir coupé les guts - Je pense qu’au dernier moment, Phil ne pouvait pas résister à l’envie de m’annihiler. Je crois qu’il ne tolère pas la présence d’autres fantômes dans ses ténèbres - Mais c’est un album qu’il faut écouter. Il s’appelle Death Of A Ladies’ Man et paraît en 1977. Pas vraiment l’année idéale pour sortir un album ambitieux. Il n’empêche que Death Of A Ladies’ Man fascine. Notamment «Memories», un cut d’une grandeur explosive - Now you cannot see/ My naked body - Leonard emmène ce chef-d’œuvre. «Don’t Go There With Your Hard On» est plus funky. On entend des chœurs de filles d’une incroyable vulgarité. La grosse compo de l’album est le morceau titre de fin de non-recevoir. Totor fait de ce heavy balladif un vrai pâté de pathos. Il lève une tempête au fond du Gold Star. C’est complètement fascinant. Comment les critiques ont-ils osé couler cette merveille ? - I guess you so for nothing/ If you really want to go for that - Il est essentiel de savoir que tout est signé Spector/Cohen. Avec «Fingerprints», Totor va sur la country. Fantastique démonstration de force spectorienne. Du son dans la country ! Tout est beau sur cet album, comme ce «True Love Leave No Trace» d’ouverture de bal - Like arrows with no targets - Leonard sonne comme un dragueur et Totor fournit une prod languide. Totor est très fort, car il réussit à entraîner Leonard dans son monde de pop de juke. «Iodine» en est le parfait exemple. Leonard se fait baiser en beauté. Le voilà dans la pop de juke, mais une pop de juke bien orchestrée. Il faut avoir entendu ça, car c’est encore un artefact du Totor power. «Paper Thin Hotel», c’est l’histoire des murs d’hôtel si fins qu’on entend les voisins baiser à côté. Leonard prend sa voix grave pour se plaindre. Il essaye aussi de renverser la tendance pour sortir de la pop de Brill et remonter vers le pathos, il ramène des gravités - I heard that love was out of my control - et ça finit par devenir énorme, Leonard mâche ses mots dans le désespoir le plus noir et fait une sacrée prestation. Il chante dans le clair-obscur du génie spectorish.
Mais les sessions sont encore plus chaotiques que celles de Rock’n’Roll. Totor est tellement pété qu’il tombe dans les pommes. C’est Larry Levine qui le relève pour l’installer dans son fauteuil et le réveiller. Et parfois nous dit Leonard, Phil était là pour enregistrer the brillant take, the moment of genius. Mais la boozy camaraderie entre Leonard et Totor dégénère assez vite. Ils se chamaillent sur tout, les tempos, les structures, les arrangements, tout. Leonard se retrouve dans le rôle du sideman et il fait de son mieux pour éviter que ça ne se détériore encore. David Kessel observe Leonard - It gave Leonard a chance to perfect his Shaolin priesthood stuff and become one in the universe - Ah la rigolade ! Mais Leonard n’en démord pas, et il n’est pas le seul : il pense que Spector n’est pas seulement excentrique, mais plutôt sérieusement perturbé - Dans l’état où il se trouvait, qui était post-Wagnerian, I would say Hitlerian, on pouvait dire que ça sentait la poudre. La musique était devenue secondaire, tout le monde était armé, tout le monde était pété ou sous l’emprise d’une drogue, et vous glissiez sur des balles, et vous mordiez dans un canon en croquant votre hamburger. Il y avait des guns partout - Évidemment, les critiques se sont jetés sur l’album pour le mettre en pièces, accusant Spector d’avoir réduit en bouillie la sensibilité poétique de Leonard Cohen à coups d’arrangements grotesques et de production excessive. Mais nous dit Brown, une fois de plus, les critiques n’avaient rien compris.
L’un des plus beaux portraits du disturbed Totor est celui que fait Ahmet Ertegun à la fin du Brown book : «Ce petit mec gaulé comme une crevette allait trouver des armoires à glace pour leur dire ‘me touche pas ou t’es mort !’. Il parlait comme un gros dur, but it was all bullshit. Je n’ai jamais senti aucun danger venant de lui. Le seul danger, c’était d’être avec lui, mais ça ne venait jamais de lui. Ça fait partie de la mystique du personnage. Phil ne ressemble pas aux autres gens.»
Le Dion et le Leonard Cohen ne se vendent pas. Échecs commerciaux, nous dit Brown, mais échecs intéressants. La musique qui dominait alors les charts américains ne représentait rien aux yeux de Totor - the Californian singer-songwriters musings des Eagles et de Jackson Browne, le stadium rock débilitant de Journey et de Kansas, et la disco.
Le dernier gros coup de Totor, c’est les Ramones. Dan et David Kessel, les fils de Barney Kessel, emmènent Totor voir jouer les Ramones au Whisky A Go Go. Ils lui expliquent que le punk est le nouveau son à la mode. Totor va trouver les Ramones backstage et leur propose de faire un grand album avec lui. En fait Totor a flashé sur la voix de Joey Ramone qui est une sorte de Ronnie au masculin. Il veut faire un album solo de Joey Ramone. Les trois autres Ramones ne l’intéressent pas. Il fait venir Jim Keltner et Barry Goldberg. Marky, Dee Dee et Johnny ne font pas le poids. Et Totor promet de conserver l’esprit des Ramones. Ça va même plus loin car End Of The Century est une bombe. Rien que pour «Danny Says» qui sonne comme un hit du Brill avec sa belle montée de jus de juke. Joey insiste pour reprendre «Baby I Love You» qui du coup fait l’ouverture du bal de B. Wow ! On est frappé par l’énormité de l’attaque. Joey = Ronnie. Même swagger. Totor orchestre différemment, il syncope les violons et ça devient stupéfiant. C’est là qu’on mesure son génie visionnaire. Il en fait une valse hésitation, une samba viennoise de l’insoutenable légèreté de l’être. Johnny Ramone dira après coup que c’est le pire cut des Ramones, mais en même ce fut leur seul Top Ten single. L’autre cover magistrale de l’album est celle de «Chinese Rocks», enfin cover si on veut, car Dee Dee en est l’auteur. On a là l’un des meilleurs tempos pulsatifs de tous les temps. Totor se fend d’une belle prod sur ce brut de punk new-yorkais qu’est «The Return Of Jacky & Judy». Non seulement c’est battu à la sourde, mais le son atteint son summum. Peut-on imaginer mieux ? Non. Avec «This Ain’t Havana», l’énergie des Ramones semble sanctifiée, plus étoffée, notamment le pulsatif du beat. Ce ne sont quasiment que des cuts de batteur. Le meilleur exemple est «Rock N Roll High School», embarqué par une locomotive, c’est battu sec à la volée de bois vert, puis ils embarquent «All The Way» à la bravado. Ils sont brillants et savent rester sur la brèche. Totor a respecté son contrat. Il avait en plus passé beaucoup plus de temps sur cet album des Ramones que sur le Dion ou le Leonard. David Kessel : «I think he was concious of leaving a rock and roll legacy.»
End Of The Century ne monte qu’en 44e place des charts, mais il se vend plus que les précédents. Après coup, les Ramones s’en prennent violemment à Totor et zyva que Totor il nous menace avec son flingue et zyva que Totor il nous empêche de sortir de chez lui, ils l’accusent de tous les maux, sauf Joey bien sûr qui en travaillant avec son idole a obtenu tout ce qu’il espérait - Sure he’s difficult and yeah it was hell, he’s not the nicest guy in the world but you just accept what he is to work with him - Magnifique Joey Ramone ! Et il ajoute plus loin : «What he did with the opening chords of Rock’n’Roll High School is like Strawberry Fields, the way it fuses into the drums.» Alors évidemment, on parlait plus à l’époque du gun de Totor que des merveilles contenues sur cet album. Et quelles merveilles ! C’est pendant ces sessions interminables que Larry Levine s’est chopé une crise cardiaque. Totor amena aux Ramones une dynamique et une clarté de son dont ils n’avaient même pas idée.
Après la mort brutale de John, Yoko demande à Totor de venir produire son album Season Of Glass. Pochette macabre, puisqu’on y voit les lunettes que portait John le jour où il s’est fait buter devant le Dakota. Comme on l’a vu dans Sometime In New York City, Yoko chante avec finesse et émotion. Elle chante «Even When You’re Far Away» au petit filet de voix, une voix qui ballote sur l’océan comme une barque, c’est très curieux. Chaque chanson a ses qualités, comme ce «Nobody See Me Like You Do» qui arrive à la suite. Elle chante avec une certaine générosité de ton. Encore une fois, ça reste spécial et très pur et on comprend que Totor puisse s’y intéresser. Elle fait encore un petit coup d’éclat avec «Toyboat», une merveille translucide qui finit par aller se perdre avec le reste de l’album dans l’ombilic des limbes.
Totor tente un dernier coup avec Starsailor, un groupe anglais qu’apprécie sa fille Nicole. Mais dès que Totor commence à bricoler un son, les mecs de Starsailor rechignent. Ils trouvent que tous leurs cuts sonnent pareil, que Totor fait un Totor album, pas un Starsailor album, alors ils disent stop. Ils font une réunion et décident de virer Totor à l’unanimité. Ils désignent le bassiste James Stelfox comme porte-parole. Brown fournit une autre version : ce serait le manager du groupe et le mec du label qui auraient convoqué Totor pour lui dire stop, à quoi Totor aurait répondu : «You’ve got big balls.» Eh oui, on ne vire pas le plus grand producteur du monde. Donc fuck it. Pas la peine d’aller écouter Starsailor. Totor serait rentré à Los Angeles le cœur brisé.
Dans sa vie, il n’a jamais pardonné à ceux qui lui tournaient le dos ou qui le trahissaient, mais il s’est toujours rappelé de ceux qui l’avaient aidé. Pendant les dernières années de sa vie, Alan Freed qui était ruiné a survécu grâce au support financier de Totor. Quand Ike Turner fut envoyé au trou pour une sombre affaire de coke, Totor est allé lui rendre visite et lui apporter un support financier. À la fin des années 70, Darlene Love faisait des ménages pour vivre. Mais elle ne s’en sortait pas, alors elle demanda à Totor de l’aider à payer son loyer, ce qu’il fit pendant un an, le temps qu’elle se remette à flot. Merci à Mick Brown de nous rappeler tout ça.
Histoire de finir en beauté. Voilà ce que sort Totor à l’inestimable Mister Brown : «Black music is our American culture.» Et Elvis, lui demande Mick Brown, vous l’avez rencontré en 1958, n’est-ce pas ? «Sure... Et en 1960. J’ai travaillé sur son album, alors qu’il revenait de l’armée. Peu de gens le savent. Elvis was terrific, wonderful.»
Tout le monde connaît la fin de l’histoire. Pas terrible. Mick Brown conclut en disant qu’à la fin, Totor a perdu ce à quoi il tenait le plus : sa réputation et par conséquent sa legacy. Après cette catastrophe, «By My Baby» ne signifiait plus rien aux yeux des gens, ni même Lovin’ Feelin’ qui fut pourtant la chanson la plus diffusée sur les radios américaines. Il n’existe pas dans l’histoire du rock de plus grande tragédie que celle de la chute de Phil Spector.
Signé : Cazengler, Phil Pécor
Checkmates Ltd. Live At Caesar’s Palace. Capitol Records 1967
Sonny Charles & The Checkmates Ltd. Love Is All We Have To Give. A&M Records 1969
George Harrison. All Things Must Pass. Apple Records 1970
George Harrison. Living In A Material World. Apple Records 1973
Ronnie Spector. The Very Best. Sony Music 2015
Beatles. Let It Be. Apple Records 1970
John Lennon/Plastic Ono Band. Apple Records 1970
John Lennon. Imagine. Apple Records 1971
John Lennon/Yoko Ono. Some Time In New York City. Apple Records 1972
John Lennon. Rock’n’Roll. Apple Records 1975
Dion. Born To Be With You. Phil Spector Records 1975
Leonard Cohen. Death Of A Ladies’ Man. Columbia 1977
Ramones. End Of The Century. Sire 1980
Yoko Ono. Season Of Glass. Geffen Records 1981
John Lennon. Menlove Ave. EMI 1986
Mark Ribowsky. He’s a Rebel: The Truth About Phil Spector – Rock and Roll’s Legendary Madman. Da Capo Press
Richard Williams. Phil Spector: Out Of His Head. Omnibus Press 2003
Mick Brown. Tearing Down the Wall of Sound: The Rise And Fall Of Phil Spector. Bloomsbury Publishing 2007
Got my Mojo working - Part Two
Mojo colle sur la couve de son dernier numéro une étrange compile : The Black Keys present The Hill Country Blues. Ah on peut dire qu’ils sont gonflés ces deux là ! Bon d’accord, Black Keys est un nom qui fait vendre, mais de là à se faire passer pour les chantres d’une légende aussi pure que celle du North Mississippi Hill Country Blues, il y a tout de même un pas qu’ils n’ont pas hésité à franchir. Ils ne sont plus à ça près. Admettons que ce soit Mojo qui leur demande de compiler, mais ça aurait eu plus de sens de demander à Jimbo Mathus ou à Luther Dickinson de s’en charger, car ce sont eux les chantres réels de cette culture. Enfin les chantres blancs. Le fin du fin eut été de confier la besogne à Cedric Burnside. Mais Cedric Burnside ne vend pas. On en est là, aujourd’hui : les vrais chantres n’ont pas voix aux chapitre. Et Cedric Burnisde ne figure même pas sur la compile ! Ni Otha Turner, alors t’as qu’à voir !
— T’as vu c’est dingue qui z’aient osé se mettre sur la pochette, les deux Black Keys. Y zont même mis deux de leurs cuts à eux à la fin d’la compile, comme s’ils se croyaient au même niveau que Jessie Mae Hemphill ou Junior Kimbrough. Sont drôlement culottés, ces deux-là !
— T’as raison, poto, mais ça aurait pu être pire ! Imagine que Mojo y zaient demandé à Slosh ou à Stong de compiler ! Tu vois un peu le bordel ? Y sont tellement chtarbés qui zauraient rajouté BB King dans l’Hill Country Blues !
— Ah putain, les canards y font n’importe quoi, maintenant, c’est dingue, on peut plus les tenir !
— Plains toi pas, car t’as quand même la crème de la crème sur cette compile. C’est bien pour les ceusses qui connaissent pas. T’es pas non plus obligé de reluquer la pochette.
Il a raison l’asticot de dire ça, car quand Junior Kimbrough attaque «Meet Me In The City», ils nous embarque aussitôt dans son monde puissant et chaleureux. Pur genius de derrière les fagots des collines. La qualité du son fait baver. Il est dans l’hypno et la grâce en même temps. Par quel prodige, on ne saura jamais, mais c’est exactement ça, un mélange indicible de tout ce qu’on aime dans le blues et le rock. Alors tu danses et tu fais gaffe de bien danser au milieu des blacks du juke-joint. L’autre grand tenant de l’aboutissant est bien sûr RL Burnside, l’excellent Rural qui fascina tant Tav, et le voilà avec «Going Away Baby». Il ramène lui aussi des trucs de derrière les fagots des collines, mais des trucs que peu de gens peuvent comprendre, car comme le disait si justement Dickinson à propos d’Otha Turner, leur son relève d’un art antique. Rural joue son art au touffu et c’est brillant, les accords électriques croassent dans la matière du son puis il attaque au chant d’une voix de vieux canard. L’intention ne trompe pas. Rural gratte ses poux, porté par un beat de dérapade, c’est énorme, complètement décousu, pur génie de cabane, pur génie de fils d’esclave. C’est sans doute pour ça qu’on ne supporte pas de voir des blancs se faire mousser sur le dos des pauvres nègres. Cette mentalité ne disparaîtra donc jamais ? Puis voici le troisième larron, l’incontrôlable T-Model Ford que ces pauvres cloches dans leur commentaire résument à des anecdotes. Mais le «Cut You Loose» de T-Model Ford est bien meilleur que tout ce que ne feront jamais les petits blancs. T-Model Ford est le plus enragé de tous, c’est un bonheur que de l’entendre gratter sa gratte noire de metaller. Il faut voir comme c’est tapé derrière, let me go ! On monte encore d’un cran avec Jessie Mae Hemphill et son «Go Back To Your Used To Be», encore un modèle pour Tav Falco, elle joue avec l’écho du diable. Leur père à tous s’appelle Mississippi Fred McDowell qui a fini pompiste d’une station service à Como, Mississippi. Le vieux Fred claque et joue en même temps, il joue dans l’Africanité, bien décalé du bulbique - Lawd I love my baby - Et puis après on arrive dans les sujets qui fâchent avec Jimmy Duck Holmes. Il faut dire que Dan Auerbach a produit son dernier album, Cypress Grove, ce qui explique la présence de Duck sur cette compile. Mais si on écoute cet album, promotionné sur le nom des Black Keys, on aura une drôle de surprise.
Comme c’est produit par Auerbach, on a du son. Tout ce que produit Auerbach a du son. On en oublie même le nom des artistes. On ne se souvient plus que du nom d’Auerbach. Sur la pochette, ils ont écrit en gros : «produit par Dan Auerbach». Robert Finley ? Leo Bud Welch ? Marcus King ? Jimmy Duck Holmes ? Merci Auerbach ! Grâce à Dan Auerbach on peut écouter sans risque le nouvel album de Jimmy Duck Holmes, Cypress Grove, car il a du son. Blague à part, c’est vrai qu’il y a du son. Quand on a produit les Buffalo Killers ou Brimstone Howl, on sait forcément ramener du son. Donc Auerbach en ramène dans le «Hard Times» d’ouverture de bal, un blues primitif. On entend même couiner les cordes. Il faut voir la batterie entrer dans le riff de «Catfish Blues». Welcome in the deep blue sea. La guitare entre dans la danse à la sature. La guitare d’Auerbach, bien sûr. Comme sur l’album de Robert Finley, Auerbach n’en finit plus de ramener sa fraise. Il profite de «Goin’ Away Baby» pour injecter du psyché, avec une arrogance intolérable. Comment ose-t-il ? C’est le même problème que sur les albums de Mavis Staples «produits» par Jeff Tweedy. Mavis finit par chanter du rock de blanc qui en plus n’est pas bon et par miracle, elle a fini par virer Tweedy. Sur son pauvre album, Duck revient à Muddy avec «Rock Me». Puis il descend à la cave avec «Little Red Rooster» et en fait une belle cover. Il rend ensuite hommage à Skip James avec «Devil Got My Woman» et avec «All Nite Long», on croirait entendre John Lee Hooker. Même voix, même ambiance. Mais cet épouvantable m’as-tu-vu d’Auerbach en fait trop. Il flingue aussi l’excellent «Gonna Get Old Someday». C’est assez désolant. Encore une histoire de vieux black exploité par un blanc. Pauvre Duck. On ne le connaît que par Auerbach.
Parmi les autres blackos présents sur la compile du Hill Country Blues, voici Paul Wines Jones dont on dit ailleurs grand bien des trois albums. Il joue dans les règles du lard fumé et à la suite, James Cotton ramone son «Cotton Chop Bues» à la super crade - Ain’t rise no more cotton - Early Sun blues, rien à voir avec le Hill Country Blues. On croise aussi le vieux Leo Bud Welch avec un écho trop moderne pour être honnête. Rien à voir non plus avec le Hill Country Blues. Cette compile finit par ressembler à un fourre-tout. Heureusement, Jessie Mae Hemphill revient avec «My Daddy’s Blues» monté sur la foi d’un gimmick toxique, le sien, elle vise la transe africaine et Junior Kimbrough nous ramène dans le désert du Mali. Son gratté reste gracieux, appuyé sur un drone saharien. Et bien sûr, si on écoute les deux cuts des Black Keys qui referment la marche, on verra pourquoi ça ne va pas. Ils sont complètement à côté, ce qui d’une certaine façon nous rassure. Il faut quand même être assez gonflé pour aller se mettre en queue d’une compile aussi chargée d’histoire. Auerchach est une sorte de Lucien de Rubempré affamé de reconnaissance, dévoré d’ambition, mais on ne se fait pas du blé sur le dos des blackos, c’est une règle de base.
Signé : Cazengler, Hill Country Bouse
The Black Keys present The Hill Country Blues. Mojo # 332 - July 2021
*
Le country fonctionne un peu comme le baseball, le sport typiquement américain, lorsque vous y jouez, les statistiques sont à vos côtés et vous observent, de fait vous ne jouez pas à l'instant T contre une équipe ennemie particulière mais contre tous les joueurs qui depuis deux siècles ont pratiqué ce jeu, z'avez intérêt à assurer si vous tenez à inscrire votre nom sur les tablettes de l'immortalité. Ainsi si Stan Jones même s'il en l'auteur n'est pas le créateur de ( Ghost ) Riders in the sky. L'a repris l'air d'une vieille complainte de la guerre civile, When Johnny comes marching home, par contre cette histoire de cavaliers fantômes poursuivant dans les nuages le troupeau du Diable correspond à son goût immodéré depuis l'enfance pour les contes fantastiques. Il aimait à en écrire et à en raconter à des auditoires de copains d'école et de travail. Etrange personnalité que celle de Stan Jones ( 1914 – 1963 ), il nous plaît de voir en lui un Edgar Poe qui aurait été cowboy. Stan Jones fit mille métiers et écrivit deux cents chansons, il rencontra John Ford qui incorpora sa musique dans deux de ses films et lui offrit un petit rôle. Stan Jones écrivit le morceau en juin 1948, et l'enregistra toujours en 1948 avec The Death Valley Rangers, je qualifierai sa version de filmique dans la lignée des productions de Gene Autry, vous préfèrerez la version ( février 1949 ) de Burt Ives ( 1909 – 1995 ), dépouillée et pour ainsi dire vocale, si vous aimez les belles voix graves privilégiez celle barytonesque de Vaughn Monroe ( 1911 – 1973 ), manque un peu de punch mais qui insiste sur l'aspect mélodramatique... Il en existe des centaines de version, les rockers se sentiront obligés d'écouter celle des Shadows – ne vaut pas, et de loin, Apache – et bien entendu celle de Johnny Cash, celle de Willie Nelson, celle de... jusqu'à peu, j'aurais été incapable de dire celle que je préférais, cela dépendait de mes humeurs jusqu'à ce que j'entende celle de :
PAIGE ANDERSON
RIDERS IN THE SKY
Vous ne trouverez pas plus pure, j'ai cherché, les outlaws en révolte contre la variétarisation nashvillienne de la country dans les seventies devaient être armés de pistolets à bouchons quand vous entendez la version de Paige, pour avoir vécu grâce à ma fille près des équidés pendant vingt ans, je certifie, la cadence du galop des chevaux est parfaitement imitée dans ses contre-temps les plus subtils par les notes grêles du banjo, Paige est seule, simplement assise sur une chaise, sa salopette, ses bottes à lacets auxquelles elle semble particulièrement attachée qui lui caressent les genoux, l'accompagnement banjoïque est prodigieux, vaut toutes les bandes-sons des orchestres de génériques ou de scènes chocs de bien des westerns, il n'exprime pas, il l'est la solitude du guy face à sa vision dantesque, ce cliquètement de grésil sur un toit de tôle équivaut à l'horreur absolue de la course infernale ... ô cette voix de Paige, qui claque comme des coups de fouets, qui monte subitement ou qui traîne lentement telle une ravine perdue, une symphonie de nuances frustres et évocatoires, des élans sauvages et une mélancolie souveraine, un serpent sur un tapis de mousse, et quand elle s'infléchit et s'étire en yodel aigu nasillant de cowboys elle vous perce le cœur et vous vous dites que ça vaut le coup de quitter cette vallée de larmes sur ce timbre fêlé d'ange descendu du ciel rien que pour vous. Normal, c'est Paige Anderson qui chante. Non, une artiste. Au sens fort de ce mot.
Cette vidéo, postée le 7 mai 2020, est visible sur le FB de Foxymoore, ainsi que les deux suivantes que nous chroniquons.
FOXYMOORE
PAIGE ANDERSON / DAVIA PRASHNER
WILD DREAM
( postée le 30 mars 2020 )
Rien à voir avec un enregistrement studio. Paige et Davia sont en route pour Los Angeles lorsqu'elles s'arrêtent en un endroit désertique pour chanter. Au loin la Sierra Nevada, le vent souffle et vient parfois se mêler à la voix de Paige en jean, elle s'accompagne à la guitare, à ses côtés Davia en robe blanche et au violon, l'ensemble n'est pas sans évoquer Aimee et Paige de la Fearless Thin. Une composition de Paige, une chanson mélancolique, l'archet de Davia mélancolise, les filles ne chantent pas, elles soulèvent les mots par a-coups, comme quand vous arrachez à petites saccades la bande d'un pansement qui colle à la peau et qui s'est incrustée dans le sang séché d'une blessure récente... Paige ralentit sa voix et le violon ses arpèges, poignant et ensorcelant...
A NEW SONG...
( postée le 26 novembre 2019 )
Chouette une nouvelle chanson de Paige Anderso, un aigle se lève dans votre cœur et monte vers le ciel étoilé, co-écrite avec Berg Z et Joe Keefe, vous ne demandez qu'à écouter, c'est oublier que les filles sont parfois cruelles, ne vous en font écouter que 59 secondes, l'on devrait les dénoncer à l'ONU et les faire passer en jugement pour comportement inhumain et cruauté mentale envers la population mondiale, surtout que dès les premières notes vous reconnaissez l'intro de Burn It to the ground de Two Runner que nous avons chroniqué dans notre livraison 512 du 27 / 05 / 2021 ! Davia à la guitare debout et Paige assise sur un rocher au banjo et au vocal soutenue au refrain. Sont au bord d'une rivière enjambée très haut par une passerelle sur laquelle se déplacent les paisibles silhouettes de promeneurs. Nous souhaitons que le son soit monté jusqu'à eux. Cette interprétation très roots est différente et aussi magnifique que celle de Two runner, le timbre rauque de Paige s'harmonise à merveille avec le paysage. Peut-être est-elle – je ne dirais pas plus joyeuse – moins plaintive, davantage affirmée et revendiquée, plus fière et moins mélodramatique que celle de Two Runner. Qui du coup demande à être réécoutée.
BURN IT TO THE GROUND
TWO RUNNER
Nous l'avions chroniquée voici quinze jours selon la force émotionnelle qui alors nous avait assailli. Nous en avions pratiquement oublié, à ne suivre des yeux que la silhouette de Paige, de la considérer en ce qu'elle est aussi, un artefact, une production vidéo, super huit, un scénario, une mise en scène, un film agrémenté d'une splendide bande-son. Pour en juger par vous-même je vous recommanderai de l'écouter aussi sans la regarder. Pour goûter la voix de Paige, plus flexible mais portée par un doux ressentiment à l'encontre du monde. Se regarde un peu comme ces albums destinés aux enfants dans lesquels les images explicitent le texte, Paige sur sa moto, Paige au bord d'un torrent, Paige en ville, un feu qui brûle, un oiseau de proie qui vole, un taureau impassible, des illustrations naïves pour faire entendre que les mots ne sont que les métaphores de vos sentiments, la voix de Paige qui appuie doucement, qui traîne, le banjo qui clapote et l'accompagnement qui va de l'avant, par rafales, qui emporte les miasmes et les éparpille au loin, des paroles sombres à la manière des élégies de Tibulle et fièrement violentes, les draps poisseux d'un cauchemar que l'on essaie de rejeter au loin, les cendres et les flammes, ces troncs d'arbres et ces branches dépouillées de feuilles, ou au contraire dans leur opulence virgilienne, ne sont pas sans évoquer les bosquets arcadiens que l'on retrouve sur les anciennes vidéos qui racontent la première carrière de Paige avec ses sœurs et son frère, ce sourire énigmatique de celle qui a traversé des cercles de haine et qui se pose, en robe blanche, dans la voiture verdoyante et réconciliée, une fée qui domine désormais son royaume...
Damie Chad.
POLNARETERNEL
SA POUPEE QUI FAIT NON A 55 ANS
MARIE DESJARDINS
C'est ce qui gêne, pas la poupée, ses cinquante-cinq balais, trop beaucoup. Elle n'a pas vieilli d'un pli, nous assure Marie Desjardins, sûr qu'avec la fontaine de jouvence à portée de la main, Jimmy Page et John Paul Jones dans le studio, vous reculez la date limite de péremption. Donc la poupée est toujours aussi jolie et tentante, le problème c'est que les cinquante-cinq plumeaux, nous on les a usés sur les planchers pourris de notre existence. De quoi pleurer des larmes de sang. Pas facile de se consoler, même si l'on pense que voici deux millénaires et demi Aristote a décrété que toute chose est corruptible, l'énonciation de cette véritable vérité vraie gravée dans le marbre de l'éternité n'est guère encourageante. Bref tout compte fait on n'a pas envie de lire cet article, paru dans Le Mag Profession Spectacle. Oui mais voilà il est signé Marie Desjardins, c'est difficile de résister, elle a du style notre syrène, Merlin n'a-t-il pas cédé à la fée Viviane...
Les choses et les êtres sont ce qu'ils sont. Quoi, qui, au juste ? Nous ne le saurons jamais. Tout au plus énonçons-nous quelques approximations. Le saurions-nous exactement que nous serions peut-être déçus. En fait les choses et les êtres sont ce que nous voulons qu'elles et qu'ils soient. A ce hiatus près que très souvent nous ne nous interrogeons point sur nos attendus et encore moins sur l'origine de ceux-ci. Par peur de nous trahir, ou par désœuvrement. Remarquons la grande amplitude entre ses deux motifs, le premier touche à nos intimités les plus subjectives et le deuxième à notre profond désintérêt vis-à-vis de ces parties du réel qui ne retiennent que très parcimonieusement notre attention, voire pas du tout.
Perso je n'ai jamais été fan de Michel Polnareff, pas au point d'éprouver le réflexe de tourner systématiquement le bouton de la radio dès qu'il était diffusé, un artiste que j'ai entendu souvent, que j'ai écouté parfois, mais dont je ne me suis jamais procuré un disque. Un fond sonore, agréable, sympathique, mais dont l'absence ne nuit en rien. Soyons honnête, je ne garde en mémoire que trois titres, Sous quelle étoile suis-je né ? ( sur le deuxième super 45 T qui a succédé à La poupée qui fait non, cette dernière un peu trop inspirée de Buddy Holly à mon avis ), Holydays ( pour le background musical ) et un autre qui m'a longtemps horripilé pour lors de sa sortie le retrouver systématiquement sur les ondes chaque fois que j'ouvrais le transistor. Pour en terminer, cela fait un demi-siècle que j'entends dire que son album Polnareff 's est son meilleur, je ne m'y suis jamais attelé, il faut dire qu'en 1971, pour les amateurs de rock, il sortait outre-Manche et outre-Atlantique, tellement d'autres disques excitants... poussaient comme des champignons toutes les semaines... Et puis il y avait dès le début ses faraudes déclarations de guerre, répétées à plusieurs reprises, selon lesquelles il n'y avait que lui en France qui était capable de chanter du rock'n'roll et qu'il allait enregistrer un disque de classiques de vieux rocks et que l'on allait voir ce qu'on allait voir... ça fait cinquante cinq ans que l'on a encore rien entendu. Les rockers ne pardonnent et n'oublient jamais !
Marie Desjardins n'est pas aussi sévère que moi. Tout au plus en mettant la focale sur quelques adjectifs de son dernier paragraphe parviendrait-on à faire croire aux lecteurs naïfs que certains aspects de la personnalité du chanteur l'agacent un tantinet. Rien de grave. Qui n'a pas ses petits défauts !
Son article est assez court. Il ne résume en rien la longue carrière de l'artiste. Si vous voulez tout savoir sur Polnareff, cliquez sur Wikipédia. Soyez perspicace, quand vous lisez Portrait de l'artiste en jeune chien de Dylan Thomas vous comprenez que l'important ce n'est pas le poëte dont vous tenez l'ouvrage autobiographique entre les mains mais ce chien en lequel il se rêve métaphoriquement. C'est donc le rêve de Marie Desjardins que vous devez tenter de saisir. Il va de soi que Marie Desjardins ne rêve pas de Michel Polnareff. Elle n'écrit pas avec un cœur d'artichaut de midinette. Elle n'est pas la groupie du pianiste. Elle use d'un stratagème que nous qualifierons de nervalien.
Certains critiques vous diront que l'instant fondamental de la ronde enfantine sur laquelle Gérard de Nerval a bâti son œuvre ne s'est jamais déroulé. Qu'elle est une pure invention. Quelle incompréhension consternante. Que la scène originelle relève de la réalité ou de l'imaginaire importe peu. Ce qui compte c'est la bulle de cristal poétique que Nerval a insufflée dans le monde à partir de de ce noyau germinatif initial.
De Michel Polnareff, Marie Desjardins ne détache que quelques éclats, les plus révélateurs, non pas en eux-mêmes, mais selon elle. Car les choses et les êtres ne sont que ce que l'on veut qu'elles ou qu'ils soient. On les ente de notre propre greffon autant qu'elles ou qu'ils nous hantent. Rien n'est donné mais tout est offert. L'on ne prend pas tout. L'on fait son choix, l'on trie. Ce qui nous arrange. L'on dévore en prédateur les quartiers que l'on juge royaux et on laisse aux fourmis les bas morceaux. Soyons clairs quant aux êtres, on en fait nos choses.
Ainsi Marie Desjardins nous brosse un portrait de Michel Polnareff en quelque sorte idéel, qui corresponde à l'idée qu'elle se fait de la manière dont on se doit se situer dans le monde. L'apparence physique de Michel, c'est ce que l'on voit en premier, pas celui qui s'est survécu à lui-même, qui s'est épaissi, qui roule une crinière de lion de pacotille sur des épaules de gladiateur, mais le jeune homme fragile, blond et hâve, à l'allure christique, celui qui chantait comme s'il intercédait auprès de la Madone, celui qui est en manque, de tout ce que vous voulez, surtout d'être plus intensément au plus près de sa propre plénitude, que dans ses chansons il symbolise par l'absence ou la présence inatteignable de '' Marilou, Marie, Rosie, Juliette, Georgina, Ophélie'', c'est cette béance qui émeut Marie Desjardins, ce n'est pas qu'elle aimerait être l'élue qui la comblerait, c'est que le Polnareff qu'elle héroïse c'est ce vide, cette vacuité déchirante, sur laquelle elle tisse son rêve... de Paul(nareff ) et Viriginie, ceux qui ont lu ce chef-d'œuvre absolu qu'est le roman Ellesmere de Marie Desjardins comprendront la littéraire et romantique présence de Bernardin de Saint-Pierre qu'elle cite dans l'article, ces implications troubadouriennes du vécu que l'on retrouve par exemple dans les ultimes Notes d'Inconnaissance de Joe Bousquet...
Marie Desjardins nous rappelle que l'on n'écrit pas sur X ou sur Y, mais de soi, et encore de soi, selon des protocoles secrets qui n'appartiennent qu'à nous, assez transparents toutefois pour que les lecteurs aiment à s'attarder en ces bosquets secrets et invisibles sans trop savoir pour quoi, pour qui, afin que leurs errements sans fin en croisent sans le savoir d'autres... Que les amateurs de rock ne s'y méprennent pas être fan de X ou Y, c'est un peu sonner, et n'être jamais entendu, sinon par soi-même, tel Roland à Roncevaux, l'oli-fan-tasme de ses désespoirs secrets.
A tout hasard indicatif, le troisième des trois morceaux de Polnareff que j'ai gardés en mémoire, dont je n'ai pas donné le titre, qui m'a longtemps agacé, jusqu'à ce jour où... s 'intitule Gloria.
Damie Chad.
SWEET JAYNE MANSFIELD
J'aurais le droit de me plaindre. Mon facétieux réveil s'est décidé à sonner une heure plus tôt que d'habitude. Ben, non je suis heureux, je peux en témoigner, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le monde peut-être pas, n'exagérons rien, un tout-petit morceau, un fragment minuscule, ce n'est déjà pas mal. C'est même prodigieux quand il s'agit d'une infime parcelle du savoir rock. Imaginez-moi, les yeux éteints devant mon café brûlant, à la radio y a trois zigues qui discutent d'une bande dessinée, une biographie de Jayne Mansfield, une fille adorable dont seuls se souviennent aujourd'hui les royalistes – elle est morte comme Marie-Antoinette, décapitée. Essayez d'en faire autant au lieu de démarrer au quart de tour et de médire de l'Action Française. Je reprends ma phrase inachevée certes les royalistes mais aussi les Rockers. L'a joué dans La Blonde et Moi, film dans lequel apparaissent Gene Vincent et Eddie Cochran. Les trois zigotos évoquent le film mais aucun d'entre eux ne cite mes idoles. Je regrette les temps royaux, en cette époque bénie, pour un tel crime de lèse-rock'n'roll, une simple lettre de cachet et hop on les envoyait à la Bastille. Blablatent encore un peu, une fille intelligente que l'on a confinée dans des rôles de ravissante idiote, elle a tout de même tourné avec Raoul Walch, un bon point de plus, dans ses films quand elle devait chanter elle était doublée ce qui était particulièrement stupide parce qu'elle avait un beau brin de voix et... elle a même enregistré un disque avec Jimi Hendrix ! Ça je ne le savais pas, ou je l'ai oublié, ou je ne l'ai pas mémorisé, malgré tous les films et tous les livres que j'ai vus ou lus sur Jimi, le détail qui tue, qui vous aplatit comme une bouse de vache qui gâte et gâche le bonheur dans le pré, vous pouvez écouter cela sur YT : Suey / I need you everyday + le générique du film. On apprend tous les jours.
Damie Chad.
Sweet Jayne Mansfield : Jean-Michel Dupont / Baldazani ( Glénat - sortie 12 / 05 / 2021 )
09:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : el cramped, bette smith, phil spector, mojo blues, paige anderson, two runner, maeie desjardins, jayne mansfield
13/12/2016
KR'TNT ! ¤ 307 : PIXIES / EL CRAMPED / CULTURE LUTTE / NO HIT MAKERS / RUST / ROCK'N'BONES / LES CHAMPIONS / PRESIDENT ROSKO / POGO CAR CRASH CONTOL / SIDNEY BECHET /
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 307
A ROCKLIT PRODUCTION
15 / 12 / 2016
|
PIXIES / EL CRAMPED / CULTURE LUTTE / NO HIT MAKERS / RUST ROCK'N'BONES / LES CHAMPIONS / PRESIDENT ROSKO POGO CAR CASH CONTROL SYDNEY BECHET |
Have you seen the little
Pixies crawling in the dirt ?
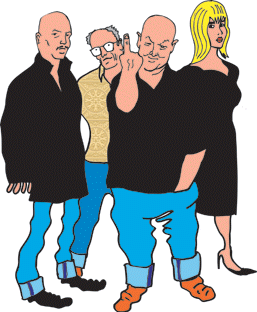
En apparence, les Pixies n’ont pas vraiment de lien direct avec les Beatles qui, rappelez-vous, nous chantaient «Piggies» sur l’Album Blanc. Il s’agissait d’un subtil hommage aux petits cochons qui se vautrent dans la bouillasse. Mais si on y regarde de plus près, le parallèle devient vite évident. Prenons justement l’Album Blanc comme point de repère. Les Pixies sont à l’image des Beatles de l’Album Blanc : divers, c’est-à-dire pop, rock et surtout novateurs, parfois exotiques, toujours fascinants, parfois diablement raunchy, mélodiques et surtout capables de miracles. Pour ceux qui ont grandi en écoutant l’Album Blanc, le souvenir des moments d’écoute quasi-religieuse reste très présent. Avec les Pixies, c’est exactement la même chose. Leur reprise de «Head On» vaut bien le carnage d’«Helter Skelter». La magie de «Letter To Memphis» vaut bien celle de «Why My Guitar Gently Weeps». On se pelotonnait à l’époque dans le confort de ce double album magique, de la même façon qu’on se pelotonnait dans les années 90 dans le confort de Trompe Le Monde. Car c’est l’un des chefs-d’œuvre absolus de l’histoire du rock.

On ne compte pas moins de quatre coup de génie sur cet album, notamment cette version vertigineuse du «Head On» des Mary Chain. Le gros donne libre cours à sa folie - I’ll take myself to the dirty part of town/ Where all my troubles can’t be found - et s’en va valser dans les orties. Tous ceux qui ont joué «Head On» dans un groupe ont vite laissé tomber la version originale des Mary Chain - trop balloche - pour revenir à celle-ci, à condition bien sûr de disposer du chanteur qui allait avec. S’ensuit un «U-Mass» aussi fatal - Oh kiss the sky/ Oh kiss my ass - joué au stomp pixique, qui est l’une des spécialités du gros - It’s educational ! - On ne se rendait pas compte à l’époque comme le gros nous gâtait. C’est souvent comme ça, quand on traverse une tranche de vie heureuse, on ne sait pas mesurer la chance qu’on a. Et puis bien sûr, on finit par tomber sur «Letter To Memphis» qui reste certainement l’un des sommets de l’art pixique. On y vit en direct une descente dans l’enfer du paradis des guitares de rêve. C’est une aubaine inégalable. Frank Black devient ici une sorte de visionnaire du rock comme le fut Dylan en 1965, et le trying to get to you se fond dans l’épiderme du cortex qu’aiguillonnent encore les tortillettes de Joey Santiago. On a là du pur génie sonique. Le gros nous embarque au-delà des modes, au-delà du temps et des choses. Comme savait si bien le faire John Lennon. On a encore des merveilles à savourer sur ce disque, comme «Palace Of The Brine», hit admirable d’I saw the crawling of the famous family et les infra-sons gorgent la peau de frissons. Le gros nous saccage «Planet Of Sound» à coups de riffs vengeurs et nous chante ça à la niaque des cavernes. En B, on tombe dans les bras de «Bird Dreams Of The Olympus Mons», une belle pop de caractère, comme tendue vers l’horizon. Mais avec le gros, ça se déploie et ça tourne au vertige. Et puis on a ce «Space» amené aussi comme un hit avec son Jeffrey with one f, et ça vire au classique dans l’instant. Le gros n’en finit plus d’emmener sa horde à l’assaut des hit-parades. Quand on écoute «Distance Equals Rate Times Time», on sent bien l’absolutiste, le tenace qui ne cédera jamais à la médiocrité. Il reste encore un cut magique sur cet album, «Motorway To Roswell» qui sonne d’emblée comme un hit planétaire - Last night he coundn’t make it/ he tried hard but he couldn’t make it - Le gros fait un hit d’un aveu d’impuissance et bascule dans le grandiose. On entend tout simplement chanter un géant radieux.

Trompe Le Monde fut leur dernier album, et Come On Pilgrim le premier. Mis à part «Caribou», on s’y ennuie comme un rat mort. Le gros chante son Caribou à la dégueulade angélique. Jon Dolan : «Le chant de Francis dans ‘Caribou’ est la meilleure punk rock physical comedy depuis Johnny Rotten.». Toutes les caractéristiques de son génie s’y bousculent déjà au portillon. En réalité, Come On Pilgrim fut un mini-album tiré d’une démo intitulée The Purple Tape enregistrée à Fort Apache. Paul Kolderie affirme que tous les grands hits des Pixies existaient déjà à cette époque : «Subbacultcha», «Dig For Fire» et «Here Comes Your Man» que Frank et les autres appelaient le Tom Petty song, car trop poppy. C’est en écoutant The Purple Tape qu’Ivo Watts-Russell, le boss de 4AD à Londres, craqua pour les Pixies et qu’il les signa sur son label. C’est donc un Anglais qui mesura aussitôt le potentiel du gros. Les labels américains n’avaient rien compris, à l’époque.
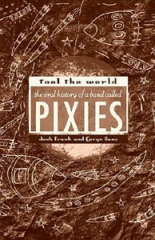
Dans leur recueil de témoignages intitulé Fool The World - The Oral History Of A Band Called Pixies, Josh Frank & Caryn Ganz vont même très loin en affirmant que les Pixies sont le groupe quintessentiel de l’époque et que leur son à base de hurlements, de textes surréalistes, d’alternances de calme et de tempête, de guitare surf, de délicates basslines et de pilonnage de caisse claire est tout simplement resté inégalé. Sans les Pixies, pas de Nirvana. James Iha, le guitariste des Smashing Pumkins, ajoute que Nirvana et les Pixies avaient en commun ce goût de la demented pop, mais Nirvana était beaucoup plus commercial que les Pixies. Il faut savoir que le gros avait une sainte horreur des vidéos commerciales et qu’il refusait de mimer le chant devant une caméra. No way !
Tout le monde sait que Buñuel le fascinait. Mais David Lynch aussi. L’art libre de Frank Black ne sort pas de nulle part, et surtout pas de la cuisse de Jupiter. Il cite David Lynch comme l’une de ses principales influences : «Il te montre quelque chose, sans avoir à l’expliquer.». Tanya Donelly raconte qu’une nuit à Berlin, le gros n’avait pas envie de dormir. Alors, il lui fit une proposition : «Roulons dans Berlin toute la nuit en écoutant ‘The Passenger’ d’Iggy.». Ce qu’ils firent. «The Passenger» over and over and over again. Tanya fut enchantée : «It was just a really nice night !»

C’est avec «Where Is My Mind» qu’il attaque son set au Zénith de la porte de Pantin, par ce beau soir de novembre. Revoir les Pixies sur scène, c’est un peu comme aller au cirque quand on est gosse : on sait d’avance qu’on va bien s’amuser et qu’on va bien se régaler.

Adulte, on sait qu’on va voir un génie à l’œuvre, un gentil géant descendu de sa montagne pour nous faire passer une bonne soirée. Les concerts des Pixies ont toujours été des concerts exceptionnels, au moins autant que ceux des Stooges et du Velvet. Les Pixies font partie des groupes qui atteignent le sommet de ce qu’on pourrait appeler l’art rock, ce singulier mélange d’invention, de puissance, de son et de mélodie.

Frank Black a toujours su diversifier ses chansons et créer de l’émotion. L’amie qui m’accompagnait ce soir-là ne connaissait pas très bien les Pixies, et pourtant, elle a dansé pendant presque deux heures, comme ballottée par une marée de son. Frank Black remue les esprits et les corps, et lorsqu’il hurle, il crée une sorte d’osmose cathartique à laquelle personne ne peut se soustraire. Avec le temps, son art atteint de nouveaux sommets. On pense à un capharnaüm grandiose imaginé par Piranese, on pense à une tour de Babel dressée dans le monde moderne par ce Breughel du rock qu’est Frank Black On le sait depuis longtemps, cet homme ne se connaît pas de limites, et il nous offre ce sentiment d’infinitude en partage. Il a créé son monde pour le partager avec nous, comme s’il cuisinait un gâteau extraordinaire et qu’il nous conviait à venir le déguster. Chez lui, on se sent en sécurité. On va même chez lui les yeux fermés.

Dans l’univers de Frank Black, il n’existe pas la moindre petite trace de médiocrité. Il veille à ce que tout reste bien baudelairien, au sens du calme, du luxe, de la volupté, et du scream. Sur scène, il enfile tous ses hits comme des perles, les «Break My Body», les «Gouge Away», les «Monkey Gone To Heaven» et là, juste à côté de nous pauvres pêcheurs, deux filles dansent mollement et entrent en transe, avec les yeux blancs, et puis «Caribou» justement, un véritable enchantement, la magie de gros se répand sur Paris qui redevient l’espace de deux minutes la ville lumière, et «Wave of Mutilation» que tout le monde semble connaître par cœur, et «Tame», hurlé à la vie à la mort, et bien sûr l’immensément immense «Debaser» et tout autour jaillissent des chiens/ andalou/sia, et puis voilà l’it’s educational de «U-Mass» qui nous tombe sur la tête comme le ciel au temps des Gaulois. Ah ça ne finira donc jamais, comme disait Moloudji au temps de l’album communard ? Ils reviennent pour deux titres, le «Vamos» des débuts, et nous envoient rôtir en enfer avec «Into The White».

Le deuxième album des Pixies parut en 1988. Bientôt trente ans ! Il s’appelait Surfer Rosa. Ivo Watts-Russell recommanda Steve Albini pour produire l’album. Mais il se trouve qu’Albini n’aimait pas la musique des Pixies. Il était à l’époque une sorte de radicaliste au crâne rasé, amateur de hardcore, de Pistols et de Ramones. Mais il trouvait Kim Deal très douée et le gros assez unique. Dès «Bone Machine», les Pixies donnaient libre cours à leur groove têtu. On avait même l’impression que l’affreux Frank Black tordait le bras de son groove pour le faire grimacer. Il poussait des petits cris de hyène andalouse. C’est dingue ce qu’à l’époque il pouvait adorer Buñuel. Et ça virait à l’excellence, avec ce chant à deux voix. Bienvenue au twisted world des Pixies ! Les compos du gros ont une sacrée particularité : elles sonnent souvent dès les premières mesures comme des hits. Exemple : «Break My Body», monté sur un riff impérieux. Le gros a l’art et la manière d’allumer un hit comme on allume un spliff. L’autre bombe de l’A, c’est bien sûr le «Gigantic» que chante Kim Deal, «Gigantic» d’autant plus énorme qu’elle chante ça à l’ingénue édulcorée et que Joey Santiago y place un spectaculaire solo ambiancier. En B, on tombe tout de suite sur l’un des grands hits pixiques, «Where Is My Mind», une traînarderie insidieuse. Le gros s’amuse à torturer la fille des muses, il lui fait subir les pires outrages sur fond de beat bass-drum très ralenti. Au travers de ces morceaux, les Pixies bâtissent un nouveau monde.

Les hits pullulent sur Doolilttle qui parut l’année suivante. Coup de génie d’entrée de jeu avec «Debaser», hit universel. Ce qui fait sa grandeur, c’est le décalage entre la folie du gros - chien andalousia - et la pureté du thème mélodique. Le gros fut le seul à l’époque à réussir un coup pareil. Le festival se poursuit avec «Tame», un savant mélange de démence dans la partance et de beat poppy. La force du gros, c’est de savoir ouvrir un abîme et de s’y jeter avec tout son orchestre. S’ensuit «Wave Of Mutilation», un autre hit universel monté sur un thème glorieux et pulsé comme il se doit. Kim Deal joue une bassline de rêve et le gros chante à l’éclat du temps. Fucking genius ! À l’époque, on appelait ça de la pop indé, mais c’est probablement ce qui s’est fait de mieux depuis l’âge d’or des Beatles. Il reste encore un hit puissant et bien martelé sur cette face : «Monkey Gone To Heaven». On y assiste à une magnifique progression vers le firmament. Rien ne pouvait alors résister aux Pixies. On trouve d’autres hits, de l’autre côté, comme «Crackety Jones», ou un «Gouge Away» chanté une nouvelle fois au bord de l’abîme, mais la démesure de l’A fait défaut.

Avec les Pixies, on s’habitue vite aux coups de génie. Bossanova qui parut un an plus tard en proposait au moins trois, à commencer par «Rock Music» qui bat tous les records d’insanité. Il faut entendre le gros hurler comme un porc - My brain ! - C’est un pur chef-d’œuvre d’insanité pulsative. En B, se niche l’effarant «Down To The Well», écarlate de puissance, oh qui dira l’immensité du don ? Qui dira la démesure du scream par delà les frontières du réel, qui dira la puissance du gros et la portée de sa vision ? Il achève son hit à coups de screamadelica. Tout aussi énorme, voilà «The Happening», joué au heavy beat sur une progression bien lourde. Voilà un joli poids jeté dans la balance du rock sempiternel. «Hang Wire» sonne aussi comme un hit profond et généreux qui s’adresse à la terre entière. Ces albums révèlent une profonde humanité, une épaisseur de la chair, à l’image du gros. «Velouria» sonne comme un hit pop. Comme ceux des Beatles, ce hit entre dans l’inconscient collectif. Le monde entier connaît l’air de «Velouria». Le gros amène aussi «Is She Weird» au beat de la menace. Grâce à la basse de Kim Deal, on a une profondeur de son extraordinaire. Le gros met ses dynamiques en route pour mieux broyer le cortex du contexte. Voilà la grande force des popsters de haut vol : il savent imposer un thème pour qu’il sonne comme un hit. Même chose avec «All Over The World», doté de la même puissance mélodique. Si ce n’est pas un hit, alors qu’est-ce que c’est ? Le gros finit l’album avec «Havalina» qui est le chant du paradis. Celui qu’on entend lorsqu’on meurt enfin.
Dans la presse anglaise, un nommé Mat Snow qualifia les Pixies de maîtres de l’incongruité calculée. Et Ian Gittins dans feu le Melody Maker affirmait bien haut que les Pixies étaient le meilleur groupe de la planète. Here we go !
Oh et puis vint le split. Le gros vira Kim Deal qui, pétée, avait raconté des conneries dans une interview. Le gros annonça la fin du groupe par fax : «Je ne voulais pas de confrontation avec les autres. Je ne voulais pas qu’on discute de ça dans une réunion. Je n’étais pas heureux dans ce groupe et je l’ai quitté.». En fait, il fit bien d’arrêter le groupe à temps. Comme dirait J. Mascis : «J’imagine qu’on peut rester dans une groupe jusqu’au bout et, comme les Ramones, tous mourir d’un petit cancer.»

On n’y croyait plus, et pourtant le miracle a fini par s’accomplir : les Pixies sont retournés ensemble en studio pour y enregistrer un nouvel album, l’excellentissime Indie Cindy. Deux cuts sortent du lot, «Blue Eyed Hexe» et «Andro Queen». Hexe parce que ça sonne tout de suite comme une extravagance riffale à la «U-Mass», avec en prime des paroles aventureuses. Le gros nous fait même un couplet entier à la hurlette, comme au temps béni du concert à l’Olympia, quand il passait la tête sous le micro pour hurler comme un goret qu’on tire par les oreilles pour le hisser jusqu’au croc. Andro parce que joué à la reverb magique - Have you ever seen Andro Queen/ Wandering all for her ruby - Voilà ce dont est capable cet immense poète surréaliste qu’est Frank Black. Il perpétue une essence perdue depuis l’éviction d’Artaud du Groupe Surréaliste. Ce cut est joué aux infra-basses dans une extraordinaire tension poétique. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Les bons cuts pullulent sur ce double album qui se joue en 45 tours. Le gros retape dans sa belle veine mélodique avec «What Goes Boom» et provoque quelques belles montées de fièvre - Grace in her face - C’est l’un des songwriters les plus doués d’Amérique. On reste dans l’excellence mélodique pour «Greens And Blues» qu’il chante d’une voix apaisée, presque duveteuse. Mais cette fois, il laisse la démesure au vestiaire. Retour aux vieux accents colériques pour le morceau titre - Indie Cindy be in love with me/ I beg for you to carry me - On retrouve la belle colère de «Subbacultcha». Puis on l’entend enflammer la fin de «Bagboy», un cut joué au bass-drum de hip hop et on tombe en bout de B sur une autre merveille, un «Silver Snail» en trois dimensions : poétique, dramatique et mélodique - I could sleep with a loaded gun/ In a room with a lightbulb sun - Pure magie qui vaut bien le «Happiness Is A Warm Gun» de John Lennon, n’est-il pas vrai ? Il faut hélas bien se rendre à l’évidence : tous les cuts sont bons sur ce disque. On est une fois encore confronté à un problème d’une extrême densité. Trop d’oxygène, comme dans les textes de Picabia. Écoutez la belle pop lumineuse de «Ring The Bell» ou encore celle de «Snakes». Tout ce qu’il compose passionne profondément. Il finit cet album éprouvant pour les sens avec «Jaime Bravo», une mélodie fusionnelle qui flirte dangereusement avec le firmament. Mais chez le gros, c’est une spécialité.
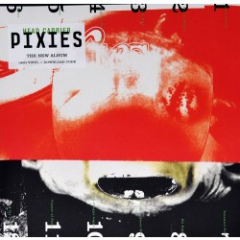
Et pouf, voilà que tombe du ciel Head Carrier, un nouvel album des Pixies. C’est inespéré. Pourquoi inespéré ? Parce qu’on y trouve deux nouvelles preuves de l’existence de Dieu : «Bel Esprit» et «All I Think About Now» chanté par Paz Lenchantin, la petite brune qui a remplacé Kim Deal. Les Pixies ont joué ces deux merveilles au Zénith, et je vous prie de croire que les frissons nombreux étaient au rendez-vous. Sur «Bel Esprit», le gros partage le chant avec Paz. Ils renouent avec l’ambiance magique de «Letter To Memphis». Joey crée l’ambiance avec son titillement mélodique et le gros suinte le chant qui en réalité est un chef d’œuvre d’auto-dérision - He’s not much of a bel esprit/ She can’t seem to understand him/ A bit more like a chimpanzeee - Et il ajoute, stoïque - That’s the way of this man - Oui, il faut le prendre comme il est, pas très bien dégrossi. On reste dans la magie pure avec «All I Think About Now». Paz chante au filet de voix comme Kim - If I could go to the begin/ ing/ I would be another way - Devant un tel chef d’œuvre de délicatesse mélodique, on pense bien sûr à John Lennon qui après avoir composé des merveilles comme «Dear Prudence» ou «Sexie Sadie» était capable de revenir quelques années plus tard avec «Jealous Guy». C’est la raison pour laquelle il faut suivre le gros à la trace. C’est l’un des derniers artistes capable de faire des miracles, en Occident. Et quand on entend un truc comme «All I Think About Now» dans la fosse du Zénith, on pense bien sûr à un miracle. Le reste de l’album se tient à un très bon niveau pixique, ne serait-ce que par le morceau titre qui fait l’ouverture, monté sur un heavy beat finement teinté d’harmonies à la Roswell. Quel magnifique chanteur que ce gros lard. Encore typique de l’attaque pixique, voici «Classic Masher». On y voit le gros affronter la mélodie comme il sait si bien le faire. Il envoie sa chanson papillonner par dessus les toits, avec la grâce d’un Paul Verlaine du rock moderne, suprêmement dopé à la fantastica. Puis il revient à sa chère folie dévastatrice dans «Ball’s Back». On retrouve cette hurlette vacharde qu’on aime tant. Wow, quel merveilleux mécontent, quelle belle boule de pus colérique ! Le gros fait ce qu’il veut du rock, depuis toujours, et sans produire le moindre effort, comme le souligne Bowie dans Gouge. «Talent» glisse tout seul, comme huilé, c’est un rock oblong qui file à travers les étoiles. Ils terminent cet album fascinant avec «All The Saints» monté sur une merveilleuse bassline dodue et bien douce. Paz sait jouer, c’est une bath du bassmatic.
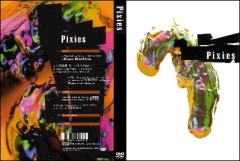
Les fans des Pixies sont gâtés : il existe un DVD paru en 2004 qui propose un concert des early Pixies à Londres et Gouge, un documentaire racontant leur histoire. Le concert vaut bien sûr le détour, car Frank Black est encore très jeune, il a tous ses cheveux et porte un T-shirt trempé de sueur. Kim chante en rigolant et Joey joue sur une Les Paul en or. Ils sont tout simplement fascinants, car ils ont déjà les chansons. Dès «Levitate Me», les cuts se mettent à sonner comme des hymnes et «Caribou» vire à la magie pure. Le moment le plus intense de ce vieux concert est certainement celui du cut de Kim, «Gigantic». Elle est poignante, et ça marche à tous les coups. Chaque fois qu’elle attaquait «Gigantic» en concert, le public chantait avec elle. Puis le gros revient faire des siennes avec «In Heaven». L’ancienne définition de la puissance était la suivante : se tenir au coin d’une rue et n’attendre personne. La nouvelle : Frank Black chantant «In Heaven». Et ils terminent avec un hommage mythique aux Beatles, avec «Wild Honey Pie», comme par hasard. Frank Black : «‘Wild Honey Pie’ n’est pas ‘Hey Jude’ ni ‘Revolution’, c’est juste un truc bizarre qu’ils ont enregistré un jour sur une cassette.». C’est une façon de dire qu’il aime bien travailler ainsi. Sur ce DVD on voit aussi un docu intitulé On The Road, mais il ne s’y passe rien de très intéressant. C’est Gouge qui emporte la palme, car les Pixies et des gens comme Bowie, Tim Wheeler, les mecs de Blur et de Radiohead, Bono et PJ Harvey racontent l’histoire de ce groupe hors du temps - A band incredibly clever - Oui incroyablement intelligent, tout est dit ! PJ avoue que Surfer Rosa est son album préféré, elle se dit fascinée par Charles, c’est-à-dire le gros, à travers les paroles qu’il écrit. Et Bowie n’en finit plus de rendre hommage au génie des Pixies - It’s done so effortlessly - Il a tout compris, les Pixies ne font aucun effort, c’est dans leur nature d’être géniaux, et il ajoute : One of the strongest songs I’ve heard is «Debaser» - et il conclut avec un dernier hommage au gros : On stage, he’s a mass of screaming flesh - Nouvelle définition de la puissance.
Bowie ne croit pas si bien dire, car le gros écrit ses paroles sur une nappe en papier cinq minutes avant de les enregistrer : «Des fois c’est bon, des fois c’est pas bon. That’s just the nature of that songwriting.»
Signé : Cazengler, pixé de la ruche
Pixies. Zénith. Paris XIXe. 23 novembre 2016
Pixies. Come On Pilgrim. 4AD 1987
Pixies. Surfer Rosa. 4AD 1988
Pixies. Doolilttle. 4AD 1989
Pixies. Bossanova. 4AD 1990
Pixies. Trompe Le Monde. 4AD 1991
Pixies. Indie City. Pixiesmusic 2014
Pixies. Head Carrier. Pixiesmusic 2016
Josh Frank & Caryn Ganz. Fool The World - The Oral History Of A Band Called Pixies. Virgin Books 2008
Pixies. DVD 2004
Viva El Cramped

La scène se déroule en 2037, dans l’une des loges du Budokan, à Tokyo. Au terme de vingt ans de tournées dans le monde entier, El Cramped, célèbre cover-band des Cramps, y donnait son concert d’adieu. Ah c’est sûr, le Professor et le Loser ont pris un sacré coup de vieux, mais ils n’ont rien perdu de leur manie de vouloir s’amuser coûte que coûte. Ils sifflent une dernière bouteille au goulot avant d’aller coucher au panier.
— À la vôtre, Professor !
— C’est dommage qu’on arrête le groupe, Loser, on s’amusait drôlement bien...
— Oui, c’est vrai, mais regardez-vous, Professor, vous ressemblez au Père Noël, maintenant, et moi aussi d’ailleurs. On a vraiment l’air cons tous les deux avec nos grandes barbes blanches ! Même si on aime bien Lux et jouer les vieux cuts des Cramps, je crois qu’il faut se faire une raison et lâcher l’affaire... Mais n’ayons aucun regret, car si vous y réfléchissez bien, vous constaterez que nous n’avons que des bons souvenirs !
— Ça paraît logique, Loser, puisque nous n’avons joué que dans des Lux Lives. Ça nous a comme qui dirait immunisé contre la médiocrité. No sell out ! Ahhh quand j’y repense, qu’est-ce que j’ai pu adorer notre premier Lux Lives à Glasgow ! Putain, les boîtes de bière qui volaient partout, les mecs nous balançaient des chaises, vous vous souvenez comment j’ai failli prendre une brique en pleine gueule ? Yurk !
— C’était chaud mais quelle rigolade ! Ah les Écossais y savent faire la fête !
— Et la hache qui s’est plantée dans l’ampli basse, comme au concert de Suicide ! On se serait cru dans un western, quand les Indiens attaquent Fort Navajo !
— Vous avez raison Professor, c’est l’un de nos meilleurs souvenirs !
— Sean m’avait prévenu : s’ils sont contents, ils vont lancer des haches ! C’est comme ça à Glasgow. Et il avait ajouté : essaye de ne pas te trouver dans la trajectoire ! ha ha ha !
— Franchement, Professor, je préfère voir arriver une hache plutôt que d’entendre hurler toutes ces dingues de Japonaises ! Elle m’ont pété les oreilles, enfin ce qu’il en reste !
— J’aime bien ces gamines japonaises en uniformes, elles me font penser à la collégienne-killer de choc de Kill Bill. Puisqu’on parle de chair fraîche, vous souvenez-vous de ces belles gonzesses à poil qui dansaient au premier rang, au Lux Lives de Miami, sur la plage ? J’avais même pas besoin de leur faire l’article en leur chantant Naked Girl, ha ha ha ! Dommage que le vieux Marcel n’ait pas pu voir ça !
— Vous saviez que Duchamp avait du mal à pisser ?
— C’est pour ça qu’il a exposé un urinoir ?
— Oui, il adorait uriner sur le rat nu d’Uranus !
— Revenons aux choses sérieuses, Loser ! Vous souvenez-vous du Lux Lives qu’on a fait à Munich, et de ce mec qui nous a balancé des tas de têtes de chat ?
— Ah votre copain Michael ! Lui au moins, il avait tout compris ! Crampologue averti, teenage tiger éternel, aussi goo-goo que vous, Professor. Quelle rigolade ! Si seulement la SPA avait pu voir ça, oh la tronche qu’ils auraient tiré, les béni-oui-oui !
— Et le Lux Lives de Boston, Loser ! Quand on a tout cassé sur scène, la basse, la Gretsch, tout y est passé, un concert fabuleux ! Franchement digne des Who en 1966 !
— Et vous savez qui a ramassé les morceaux ?
— Yep ! Kogar ! Il a même fait plusieurs voyages pour tout récupérer, y compris le pied de micro que j’ai réussi à tordre en huit, ce que Lux n’avait jamais réussi à faire. Oh et puis le Lux Lives de Bangui ! Vous vous souvenez, ce dingue de blackos qui l’organisait m’avait offert un boa constricteur et me l’avait installé autour du cou, là comme ça, splouch ! Il m’a confondu avec Alice Cooper, cet abruti ! Pendant tout le début du set, ce putain de boa n’a pas bougé, et en plein New Kind Of Kick il a commencé à me serrer le kiki ! Yurk ! Méchante saloperie ! Il a bien failli m’étrangler ! Ahhh la vache ! Je ne pouvais plus m’en débarrasser ! Et personne n’est venu à mon secours ! Personne n’a bougé le petit doigt ! Ah elle est belle la solidarité dans les groupes ! On peut crever et tout le monde s’en bat les couilles, hein ?
— Mais il fallait bien continuer à jouer, Professor ! Mais vous étiez fantastique, car c’est la seule fois où vous avez vraiment hurlé kiiiiiiiiiiiiick et que vous vous êtes roulé par terre ! Vous sembliez vraiment possédé par le voodoo des Cramps ! C’était absolument fa-bu-leux ! C’est un guide de brousse présent au concert qui vous a sauvé la vie. Il a sorti sa machette de l’étui et tranché la tête du boa d’un seul coup. Tchak ! Le concert devait l’intéresser et il voulait sans doute voir la fin.
— C’est vrai qu’un tribute aux Cramps doit sortir de l’ordinaire, Loser, au fond, vous avez raison. Ce n’est pas la même chose qu’un tribute à Stong, hein ? Oh et le Lux Lives de Madrid que mon vieux pote Lindsay avait organisé ! Vous vous en souvenez Loser ? On était tous déguisés en minotaures, encore une de vos idées à la con, on a failli crever sous ces grosses têtes de carnaval !
— C’était un double hommage à Picasso et à Fellini. Vous verrez un minotaure en chair et en os dans le Satyricon. J’ai toujours pensé que Lux naviguait au même niveau que Picasso et Fellini. Au commencement, ces gens-là ont une vision, Professor, et sans vision, on ne va pas très loin.
— Bon, vous n’allez pas me refaire votre Raymond la Science à l’heure qu’il est, après un concert au Budokan ! Vous me fatiguez. Oh mince ! La bouteille est vide, Loser !
— Attendez, je crois qu’il en reste une dans mon sac... Vous vous souvenez du premier Lux Lives qu’on a fait, Professor ?
— Attendez voir... Où c’était déjà... J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien...
— Faut manger du poisson, Professor ! Notre premier Lux Lives, figurez-vous que c’était à Évreux, dans la ville où vous viviez, en ce temps-là... Vous vous rappelez la petite maison, avec le portail de traviole...

— Ahhhh oui ! On avait joué dans une salle toute neuve ! Ouiiii, vous avez raison, ça me revient tout à coup, une petite salle encaissée, bien dimensionnée, sans doute dessinée par un architecte... Ah oui, quelle rigolade ! Avec toute une ribambelle de groupes qui passaient avant nous ! Ahhh oui...
— Les groupes étaient contents de jouer, rappelez-vous, c’était plutôt bon esprit. Et comme nous montions sur scène pour la première fois, on avait joué la sécurité avec une set-list ultra-courte...
— On démarrait avec «I’m Cramped», puis «Goo Goo Muck», si mes souvenirs sont bons...
— Exact, on avait aussi des trucs comme «Human Fly», «Naked Girl» et des choix à vous, Professor, «Walked All Nite», «Lonesome Town» et «Get In Your Pants». On finissait avec «New Kind Of Kick» et «Can’t Find My Mind».
— Ah on peut dire que depuis, la set-list a bien évolué ! On a dû jouer tout ce que les Cramps ont joué en leur temps !
— Et dans tout ce tas de hits, lequel est votre préféré, Professor ?
— «Ain’t Nothing But A Gorehound !»
— Vous vous foutez encore de ma gueule ? Parfois, vous avez parfois un humour dévastateur, Professor. Comme le jour où vous m’annonciez que vous aviez transmis une photo de répète à un torchon local.
— Et vous, Loser... What’s the loser’s fave ?
— Depuis la première fois où je l’ai entendu, c’est «Garbage Man» avec son petit bruit de moteur à l’intro et cette manière infiniment subtile de rendre hommage à cet art suprême qu’est le rockabilly. Et puis «Human Fly» bien sûr, car c’est du Wolf schtroumphé à la fuzz. On vendrait son père et sa mère pour un son comme celui-là. En ce temps-là, les Cramps créaient un monde.
— Pour revenir au premier Lux Lives, vous ne paraissiez pas bien concentré, ce soir-là, Loser...
— Outta my mind on a saturday night !
— Sauf que là, c’était un vendredi, mon pauvre Loser !
— Ah vous adorez couper les cheveux en quatre ! Mais au fond, vous avez raison, il faut savoir rester précis en toute chose...
— Vous ne l’étiez pas sur «I’m Cramped», en tous les cas !
— Comme dit Will Carruthers dans son livre, j’avais l’impression de jouer avec trois mains gauches. Fantastique ! Ça permet de faire plein de choses qu’on ne fait pas habituellement, mais à un moment donné, on ne sait plus quelle est la vraie main.
— Quelqu’un m’avait dit à l’époque qu’il vous avait vu repartir d’un pas hésitant et qu’en cherchant votre bagnole, vous étiez tombé dans l’Iton.
— Aucun souvenir. Ah si, attendez voir, une scène me revient : trois ou quatre mecs absolument extraordinaires qui sont restés pour discuter et boire un dernier coup sur le trottoir, devant la salle. Ils avaient bien aimé le trash d’El Cramped. Celui qui portait du cuir noir et des chaînes était encore plus défoncé que moi. Tellement défoncé qu’il nous proposait d’aller boire un coup chez lui et de faire tourner sa copine.
Signé : Cazengler le loser
El Cramped. Lux Lives In Evreux #1 (27). 9 décembre 20
MONTREUIL / LA COMEDIA
SURIMI PARTY / 09 – 12 – 16
CULTURE LUTTE / NO HIT MAKERS
RUST / ROCK 'N' BONES

Ne vois-tu rien venir, petite teuf-teuf d'amour ? Que nenni, my dear Damie, ni route, ni bas-côté, ne serait-il pas plus prudent de retourner ? Teuf-teuf, tu le sais, un rocker n'a pas le droit de reculer quand il part en concert, tel un spartiate au combat de l'antique Hellade ! Entre parenthèses, je ne suis pas fier de moi, la brume Seins-et-Marnaise est un fléau plus redoutable qu'un album de Genesis, mais en contrepartie le blues végétatif de la terre plate et infinie ne peut vous atteindre. Z'ont eu beau de ne plus être à côté de la plaque paire ou impaire, et lever cette gesticulation écologique pour le weekend, les autorités nationales ont raté leur coup, peu de monde devant le centre commercial où je gare sans difficulté la voiture, les consommateurs désargentés sont restés terrés chez eux. J'aie une pensée émue pour toutes les multinationales qui n'auront pas fait les bénéfices escomptés des achats de Noël. Pour un peu j'en pleurerai. Des larmes de crocodile.
Retour à Montreuil. A la Comédia, pas divine, mais presque. Le paradis des rockers. Surimi Party sur deux jours, Vendredi et samedi. En mon âme et conscience, après avoir longuement pesé le pour et le contre des deux programmation, j'ai opté lors d'une interminable traversée intérieure des douloureuses et cruelles affres de l'incertitude, pour le samedi. Pas du tout, le choix s'est imposé de lui-même, en moins d'une seconde, aucune hésitation, les No Hit Makers sont en ville !
CULTURE LUTTE

L'est des semi-minutes qui résument tout un projet. N'ont pas encore commencé, l'on vient de tester en un tour de main les instrus un par un, quand la sono, demande une vue d'ensemble. Se regardent comme embarrassés, mais J-hell dissipe cet instant de doute après avoir jeté un coup d'oeil à la set-list – une espèce de rouleau d'un bon mètre de long qui gît à terre comme le serpent tentateur de la Genèse, au pied du fameux pommier de la connaissance du Bien et du Mal. Ce sera Police, juste l'intro. Assez pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas en présence d'un groupe de folkleux acoustiques, une giclée de sève qui tombe sur vous comme les pavés sur les rangs des CRS au joli mois de mai. Eux la pomme pourrie du Mal, ils l'ont identifiée, l'est suspendue du mauvais côté des barricades policières et mentales qui triquent et étriquent nos existences de paisibles citoyens. Devenus enragés. Bref, le Police de Culture Lutte ce n'est pas le J'ai Embrassé un Flic des imbéciles.

Nous le font savoir très fort. Charge de batterie de pOOp, molotovs de guitare de Loïc, et enfonçage des lignes de la basse de Heil Nönö. Bien en place, cohésif et superbement bien envoyé, le tout magnifié par J-hell au micro. Encore un qui déchire les slogans de la révolte. L'a adopté, par rapport à nous sur le devant de la scène, la position de profil, peut-être pour être face à la majorité du public massé, vu l'implantation des lieux, sur la largeur de l'estrade. Se définissent en tant que Trash de pneu, un peu à l'image de ces traces noir-anar de pneumatiques qui empiètent sur toutes les parties interdites des chaussées. Pas une fusion, sont à l'endroit le plus dangereux du carrefour où se croisent les sentiers perdus du rock'n'roll, du trash, du hardcore, du punk, tous ces courants jusqu'au-boutistes du rock qui refusent de respecter les panneaux de limitation de vitesse. Superbe prestation de J-hell, s'appuie sur les braises qu'alimentent ses compagnons derrière lui, leur souffle dessus de sa voix puissante, se courbe et recule au début de chaque morceau, comme s'il rentrait en lui-même avant de faire cracher le lance-flamme, des mouvements de bras étonnants qu'il allonge comme s'il cherchait un appui sur l'air afin de propulser avec encore une plus grande violence ses lyrics de feu.
Un set impeccable qui paraît bien court, dommage que le public ne sera pas encore au complet lors de leur passage, s'est privé d'une des deux meilleures parts du gâteau amphétaminé de la soirée.
NO HIT MAKERS

No Hit Makers, un de mes groupes préférés de la mouvance rockabilly actuelle. Les puristes leur reprocheront leurs accointances psychobilly. Querelles d'initiés qui refusent de mettre un seul pied hors de leur chapelle. Mais c'est vraisemblablement cette ouverture qui leur permet de faire un tabac au milieu de cette programmation hardcore. Une leçon de savoir-faire. La différence entre le rockabilly et le rock de toute énergétique brutalité professée par les autres groupes de la soirée, est facile à définir pour ceux qui auraient envie d'y participer. Ce n'est pas une superficielle question d'instrument, comme la contrebasse de Lardi imposant sa masse volumineuse à l'entrée de la réponse. L'énergie est commune. La même hargne, la même urgence à la faire mousser dès les premières secondes. Mais le rockabilly ne vous bourre pas le mou par la soudaine et irréversible implantation d'un unique instrument chargé de vectoriser tout le reste de l'instrumentation sur la véhémence de son implantation souveraine dans une coulée de lave sonore. L'essence rockabilly réside en une intrication empreinte d'une plus grande subtilité, le jeu se joue au minimum à deux et l'idéal est que chacun y assume son rôle à part égale. Dans le hardcore, c'est un peu toujours la même passe qui revient, la trapéziste s'est élancé dans les airs et vous êtes sûr que là-haut son partenaire la réceptionne d'une prise solide. Accrochage sans défaut. Parfaitement bien huilé. En rockab, vous vivez, pour ceux qui savent entendre, des moments d'angoisse. La trapéziste vole au-devant de son partenaire qui tend des bras accueillants et salvateurs... qui refuseront la prise salvatrice. La loi de la gravité entraîne notre ballerine céleste vers la terre, l'est quasi certain qu'il ne lui reste plus qu'à s'écraser sur le sol. Tout est foutu. On l'a dans le Q de l'angoisse. Mais voici qu'au moment que l'on n'attend plus, un doigt se glisse sous la bretelle du soutien-gorge de la miss et lui influe le retour d'équilibre énergisant dont elle avait besoin pour rejoindre son perchoir. Sauvetage non dépourvu d'un discret et envahissant parfum d'érotisme qui crayonne exactement cette ligne de démarcation qui sépare l'essence du rock de l'appuyé pornographique du blues. Distinction affirmée qui explique que les No Hit Makers se définissent aussi comme un groupe de rockin'blues.
Et cela les No Hit Makers le mettent en pratique dans la majorité de leurs morceaux. Une rythmique d'ensemble qui filoche à cinq mille noeuds et soudain la brisure. Tout s'arrête, accident funéraire d'infinie perdition. Mais c'est Vincent qui relance la machine, deux notes de Gretsch, dans la seule fraction de seconde qui précède le naufrage inéluctable déjà programmé dans la tête du spectateur, et hop la truite arc-en-ciel du rockab rebondit de ses mille luisances diaprées par le soleil et le combo repart dans le vif du courant. Ou alors c'est Jerôme qui bat de deux coups de caisse claire le rappel décisif qui vous rejette sur la crête de la vague. Faut entendre le murmure de plaisir qui monte de la foule massée devant la scène. Le soulagement de l'extase comblée. Non pas la catharsis finale du dégonflement cessatif du désir mais l'acmé de sa complétude jouissive.

Lardi descend ses deux mains jointes le long de son manche. Masturbe sa basse me théorisera un spectateur enthousiasmé par ce lien éminemment érotique qui traduit gestuellement l'osmose parfaite qui devrait exister entre l'instrumentiste et son instrument. Je lui laisse la responsabilité de sa vision. Le désir est trop souvent une projection individuelle qui rend difficile toute analyse objectale. L'est une autre marque de fabrique des No Hit Makers. Rajoutent un plus à leur rythmique effrénée. Pas le swing, mais quelque chose qu'il est plus difficile d'entremêler aux rythmes des balancements binaires ou ternaires. Le serpent d'une mélodie qui glisse entre les branches épineuses sans jamais s'écorcher la peau. La mélodie, un fin collier de perles prêt à se briser au moindre heurt, c'est Eric au chant qui se charge de ce reptile de verre. Faut un timbre d'or pour cette délicate tâche, pas question d'amoindrir ou d'adoucir, voire d'affadir la sauce, au contraire cette note sucrée est destinée avant tout à faire ressortir les aigreurs du rock and roll. Une voix tour à tour pleine ou nasale qui rampe et qui crampse, flexible, qui se coule autant dans la moindre des anfractuosités qu'elle épouse la forme des protubérances les plus aiguisées.
Un set impeccable qui emporta l'adhésion de la salle mais surtout des quatre prestations de cette soirée, la plus accomplie. Ne font peut-être pas des hits, mais quoi qu'ils touchent lui font subir des transmutations alchimiques de rêve. Un Frenzy à faire sortir Screamin' James Hawkins de sa tombe, un Long Black Shiny Car rutilant qui vous permet de comprendre pourquoi la petite amie de Mike Page l'a laissé tomber comme une vieille chaussette au profit de l'heureux propriétaire de cette bagnole que les Makers pilotent comme un hot Rod on the evil Road et une vingtaine d'autres merveilles du même tonneau.
RUST

L'on dirait une vitrine de Noël pour enfants turbulents qui cassent tout ce qu'on leur offre et qui chourrent dans les rayons interdits tout ce qui leur plaît sans rien demander à personne car dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Deux guitaristes, un très grand au visage tout embroussaillé de poils à droite, à la guitare un peu noisy, l'autre chétif au caillou largement déserté à gauche, aussi à la guitare davantage riffeur, au milieu Marine placide et discrète, genre rousse incendiaire à la basse, à ses côtés Rachel, un bisped à l'indéniable présence scénique, micro en main, langue bien sortie de la poche du silence, charismatique, et au fond, au centre le batteur. C'est lui qui tient le groupe. Avec ses épaules carrées et sa frappe solide il est à la fois la base et le moteur du groupe. En retrait mais essentiel. Irremplaçable. L'est la proue de la frégate qui trace le sillon et emmène l'assaut. D'une efficacité sans bornes.

Des punks mais pas des nihilisto-destroys à mort avec des chiens enragés prêts à vous mordre à la moindre caresse. Défendent des causes nobles et sans appel. Rachel les énumère sans discours, sont un groupe tendance dit-elle non sans humour. Vaudrait mieux dire tendancieux. Conjugue véganisme, incestophobie et féminisme. Deux compositions personnelles qui ne jurent pas avec leurs reprises des Hives, des Pixies, de 999, de Billy Idol... une manne pour le public qui reprend en cheour. Rust est manifestement bien aimé, connu et apprécié de tous, contraindront Rachel et ses sbires à un rappel alors que l'heure fatidique approche et qu'il reste encore un groupe à passer.
Devant la scène, beaucoup de garçons gondolent leurs corps à la manière des tôles ondulées des abris de jardin. Sûr que Rachel a un ascendant. Dont elle ne joue nullement d'ailleurs. Un set bien enlevé, de mieux en mieux en place au fur et à mesure de son déroulement, qui déclenche la ferveur partisane de l'assistance. Rien de nouveau, mais le soleil qui réchauffe et vous fortifie l'âme.
ROCK 'N' BONES

Apparemment le clou de la soirée. L'on n'attend qu'eux. Attaquent dès que la scène est dégagée. Des costauds. Une fille parmi eux, Nath à la basse, deux guitares, Paddy à la batterie. Riko au micro. Arbore une crête à faire crever de jalousie une colonie de porc-épics. Les indianologues affirment que ces pics de cheveux dressés tout droit figuraient pour les indiens la représentation de silhouettes de bisons se profilant sur l'horizon de la verte prairie... Peut-être, mais les Rock'n'Bones pourchassent d'autres gibiers. Appartiennent à la mouvance des Antifas et le font savoir autrement. Leurs titres le proclament sans ambages, A Wind of Revolt, General Strike, Engagé, et pour ne pas se tromper de cible The Real Enemy. Une meute punk prête à toute émeute. Si je vous racontais que leur set s'assimilait à la cérémonie zen du thé, ce serait un mensonge. Là encore c'est la batterie de Paddy qui emporte le tout, les autres embrayant aussi sec, mais très ramassés et étroitement compactés autour de ce monstrueux galop initial. Riko ne screame guère, micro en main il assène les lyrics avec force vigueur et rude rigueur. Sont un peu atteints du complexe Ramones, des morceaux courts, très courts, expédiés les uns à la suite des autres, comme une vedette qui jette méthodiquement ses grenades sous-marines afin de torpiller les idées incapacitantes qui paralysent en catimini votre cerveau. Pas de temps à perdre. Les titres se suivent et se ressemblent, engendrent une certaine monotonie, notre esprit se prend à rêver de changement, mais non à chaque fois c'est le retour du duplicata à l'identique qui revient. Ont la pêche qu'ils vous écrasent sans ménagement sur la trogne, prenez-vous cela en pleine poire, idéal pour vous plonger en une rogne salutaire ! Comment le set aurait-il évolué, sont tout justes arrivés à la moitié de leur set-list lorsque Riko remercie tout le monde et nous annonce que c'est le dernier morceau. Et en effet à la surprise générale, ils entreprennent de quitter la scène non sans ranger les guitares dans leur étuis. Amplis débranchés, pogos terminés, rien ne va plus dans le monde du rock and roll. Nous avaient prévenus dès le début. Le fachisme est partout. Même dans les règlements qui interdisent de faire trop de bruit dans les parties surimiennes. Pas de regrets, la lutte continue.

( Photos : FB : Constance Ludès )
Damie Chad.
FRENCH SIXTIES
Apache, sans doute la plus grande victoire des tribus indiennes remportée sur notre territoire. Par procuration. Sous forme phantasmatique. Tout cela par la faute de quatre ombres menées par la diabolique et anglaise guitare d'Hank Marvin. En France, ce fut une véritable commotion. Un son nouveau venu d'ailleurs. L'électricité transformée en esthétique. Certes Johnny Hallyday, Dick Rivers qui exhibaient ses Chats Sauvages en liberté sans grille de protection, Eddy Mitchell qui enfilaient ses Chaussettes Noires encore plus puantes que nos camemberts, monopolisaient le devant de la scène, fascinaient les foules, mais c'était si neuf, si troublant, que les oreilles n'en croyaient pas leurs yeux, derrière eux y avaient des musicos qui proposaient quelque chose d'inhabituel. Le rock balbutiait de par chez nous et des milliers d'adolescents s'achetèrent illico une Eko – les plus chanceux s'en adjugeaient une dans les loteries des fêtes foraines - et s'escrimaient à reproduire l'inimitable. Ce fut la grande vogue des groupes instrumentaux. Les maisons de disques ne laissèrent pas passer la poule aux oeufs d'or. Lui arrachèrent jusqu'aux plumes du croupion. C'était aussi une manière de recycler les musiciens anonymes de studio en stars, et puis faut l'avouer aussi des gars capables de chanter rock en notre langue en 1962 y en avait moins que les doigts d'une main. Surtout qu'avec ce diable de Vince Taylor qui vous coulait les bielles en anglais, vous étiez hors-circuit avant d'ouvrir la bouche...
Histoire ancienne. Rien ne se démode plus vite que la mode. Y eut des dizaines de groupes qui accédèrent au studio. Trop, sans doute. Des guitaristes à la pelle mais peu d'expérimentateurs. On interprétait un morceau – plus ou moins bien – parfois l'on avait une idée originale, vite recopiée par les voisins, mais l'on pensait, que l'on sache ou pas lire la musique, encore sous forme de partition, l'on n'avait pas la démarche globale de construire un son. Cinquante ans après, l'est facile de compatir sur ces malheureux, ils enchantèrent en leur temps bien des adolescents et préparèrent les pistes d'atterrissage de la réception des premiers groupes de l'invasion british, furent des pionniers, au sens plein du terme.
Sur les brocantes vous exhumez sans trop de mal d'anciens EP au prix dérisoire d'un euro et le vendeur vous remercie de le débarrasser de ces rossignols qui encombrent depuis dix ans ses cageots...
LES CHAMPIONS
Bel Air : 221192
LA LONGUE MARCHE / 1647 METRES G. O.
1293 METRES G. O. / RENDEZ-VOUS AU GOLF DROUOT

Furent d'abord un groupe vocal formé autour de Willy Lewis transfuge des Chats Sauvages et de l'injustement oublié Jaky Chane ( échappé du château des Fantômes ) au chant, mais en 1963 une nouvelle mouture du groupe, devenu et resté célèbre en tant que combo instrumental regroupe Claude Ciari à la guitare solo, Alain Santamaria à la guitare d'accompagnement, Yvan Ouazana à la batterie, et Benoît Kaufman à la basse. Enregistreront pas moins de onze 45 tours et un vingt-cinq centimètres dix titres. Ont leur titre de gloire inscrit en lettres d'or sur le fronton du rock'n'roll puisqu'ils accompagnèrent Gene Vincent en 1962 au Théâtre de l'Etoile. Furent aussi aux côtés de Vince Taylor et de Danyel Gérard. Le groupe s'éteindra aux abords de l'année 1965. Une page de l'histoire du rock qui se tourne. Définitivement. La mer de l'oubli a englouti l'antique raffut de ces rafiots. L'est bon de plonger sur les lieux de ces surfin naufrage. D'en ramener pépites et pacotilles.
La longue marche : du tout doux du tout lent, pour ballade romantique au bord de la plage. Des gouttes d'eau qui ruissellent sur le dos de la donzelle. Pas de mélancolie vous l'oublierez aussitôt les vacances finies. Pseudo nostalgique. L' « original » français est d'Eddy Mitchell. Vous pouvez mourir tranquille si vous ne l'avez jamais entendu. Par contre le son de ce vieux sillon sonne étonnement bien. 1647 mètres G. O. : beaucoup mieux, un groove bien balancé à la batterie, magistralement repris par Claude Ciari, on regrettera les deux interventions des choeurs qui dénaturent un peu l'ensemble. Nous l'apparenterons à de la triche, ouïr les poissons rouges des guitares qui tournent en rond dans le bocal instrumental n'est pas obligatoirement ennuyant. Rappelons que 1647 go était la longueur d'onde d'Europe 1, la station de radio qui fut un des vecteurs d'introduction du rock and roll en France. 1293 mètres G. O. : L'on passe à la station concurrente : Radio-Luxembourg. Introduction à la batterie plus tribale cette fois-ci et la guitare qui filoche comme une Floride sur le macadam, l'on amuse par deux fois l'auditeur par des claquements de main Rendez-vous au Golf Drouot : ça commence bien mais ça se poursuit par un riff passepartout vaguement parfumé de relents jazzy. Ciari essaie de nous faire comprendre qu'il n'est pas une brelle, mais on l'avait déjà intuité. Un titre ô combien emblématiquement frenchy rock, mais qui diffuse une vieille musique.
Damie Chad.
PRESIDENT ROSKO
FRENCH CONNECTION / C. B. WRAPPER
Magnet 1981. Diffusé par Polydor
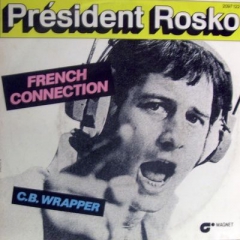
Me suis rappelé en écrivant la chro sur le 45 tour des Champions que j'avais récupéré ce single – à vue de nez une dizaine d'années – chez Emmaüs. L'avais pris d'office. Ne savais même pas qu'il L'avait enregistré. J'en avais remis l'audition jusqu'à aujourd'hui. M'y suis risqué pour vous. Ne me remerciez pas, c'est inutile. Il est temps de parfaire votre éducation politique. L'année électorale s'approche, s'il vous plaît ne me fendez pas le coeur en me faisant part de votre choix. Quel qu'il soit, il sera mauvais. La France n'a eu qu'un seul président digne de ce nom. S'est exfiltré de lui-même de notre pays en plein milieu des évènements de Mai 1968. L'aurait pris pris peur. Notre citoyen américain n'était pas habitué à ces grands soubresauts populaires et tumultueux des gentils froggies... Venait d'un milieu amerloque aisé et artistique. N'aurait pas supporté la remise en cause des privilèges. En 1790, de nombreux nobles français choisirent l'immigration en terre étrangère, lui il s'exila en son propre pays.
L'avait déjà déchu de statut lorsque Radio Luxembourg lui confia les rênes de sa nouvelle émission censée attirer les adolescents, tous les jours hors week end de seize heures trente à dix-huit heures. Sur Radio Caroline, la fameuse pirate, l'était Emperor Rosco, mais en notre pays de moeurs farouchement républicaines il consentit à s'octroyer le titre de Président Rosko. Le seul Président à qui j'ai jamais consenti à prêter allégeance, fallait lever la main droite devant le transistor et répéter tout fort après lui je jure de n'avoir pour président et pour seul Président que le Président Rosko. A ma connaissance l'unique seul chef d'état qui ne prélevait pas d'impôt et qui vous déversait le contenu de la corne d'abondance du rock and roll sans compter. Minimax c'était un maximum de titres anglais et américains, pour les français tapait beaucoup dans le plus électrique de nos rockers, Ronnie Bird. L'avait l'art et la manière de vous infuser le rock and roll et le rhythm and blues le Président Rosko, un accent à couper au sabre d'abordage, un débit à faire pâlir de honte les flots boueux de l'Amazone, des jingles criards à vous tailler les oreilles en pointe toutes les trois minutes, bref un grand moment quotidien de fébrilité rock and rollienne. N'est même pas resté deux ans en place, mais après lui, la radio française est devenue une morne plaine... L'existe une autre version de son départ plus glamour que nous préférons de loin, l'aurait été remercié quod corrumpet juventum, certains officiels mettant en relation les houleuses fièvres de son émission avec les turbulences effrénées des constructeurs de barricades dans les rues de notre capitale...
Donc ce disque sur Magnet. Une compagnie dont le catalogue comporte des artistes comme Alvin Stardust, Chris Rea, Silver Convention et Matchbox. Si vous ne l'avez pas, inutile de vous défenestrer, ce n'est pas du rock and roll. De la musique de boîte, un bon bon groove, des choeurs féminins à la voix prometteuses d'affriolantes cabrioles, et le flew du President sans défaut, suffirait qu'il ralentisse un peu et s'amuse à syncoper les syllabes pour être un des premiers rappers. Deux titres interchangeables que je n'écouterai plus jamais. Aujourd'hui l'Emperor président devrait écrire ses mémoires. Sous le nom de Mike Prescott l'a tourné dans le milieu discographique français notamment chez Barclay au milieu des années soixante... Je l'avais écouté voici quatre ans, sur sa radio internet, l'avait inversé sa formule – ou je suis mal tombé – c'était un minimum de music et un maximum de blabla à toute blinde totalement incompréhensible pour moi petit frenchie... L'avait encore encore la frite. Même si par chez nous ses carottes étaient cuites depuis longtemps...
Un personnage du rock français dont peu ( je suis très optimiste ) se souviennent lorsque je l'évoque au hasard de conversations informelles...
Damie Chad.
POGO CAR CRASH CONTROL
Quand on a un bon groupe en vue faut en parler. N'ai pas eu besoin de chercher bien loin – sur leur FB pour visionner leur dernier clip – et seulement quelques clics pour retrouver la trace de leur premier dérapage discographique. C'est un album CD collectif qui regroupe douze groupes. Sortie en septembre 2014.
LA PEPINIERE 2014 : DIAMOND FIZZ ( Release ) / POGO CAR CRASH CONTROL ( A quoi ça sert ) / CENTRAL STATION ( This morning ) / PSYCHEDELIC GROOVE ( Take off to the unknow ) / BALTO PARRANDA (Paper maze ) / OK ( Sharks ) / ITHAK ( Totem ) SOUL FAKERS ( Explore ) / STRICKAZ ( Devolution ) / JET BANANA ( Kelly ) / THE JONBORROWS ( Club 59 ) / THE EARL GREY ( The Faith ).

De qualité, bien enregistré. Propre, net sans bavure. Une aubaine pour des artistes qui cherchent à se faire remarquer, dans l'ensemble se sont rués dessus comme la gale sur la tonsure d'un moine syphilitique. En ont profité et mis les rallonges à la table de ce banquet des mendiants, Z'ont choisi les titres les plus longs de leur répertoire, Ithak est celui qui a tiré le plus sur l'élastique, dépasse les six minutes. Ne sont que deux à ne pas atteindre les trois minutes, Jet Banana avec la dénommée Kelly qui ne doit pas être bien grande, et nos Pogo avec leur 2' 35''. L'est sûr que si ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine d'insister et de perdre son temps. Faut être en accord avec ses préceptes philosophiques. J'ai tout écouté du début à la fin. Scrupuleusement, vous connaissez l'honnêteté des rockers qui n'aiment que le rock. Comme par hasard les deux meilleurs titres sont les plus courts. Nous rajouterons les Jonborrows qui tirent leur épingle du jeu. Balancent bien et le chanteur a une belle voix. Au moment où j'écris ces lignes sont en concert à Meaux avec les Wahshington Dead Cats. Nous les croiserons un de ces jours. Me suis remis deux ou trois splits de Kelly Banana avant de me tourner vers les Pogo.
A QUOI ÇA SERT ?
Sont en deuxième piste. Font l'effet de l'aspic sur le sein de Cléopâtre. L'instant crucial. Un larsen pour commencer et un autre cinq secondes après pour vous trancher la gorge. Et tout de suite l'assaut des guitares. Plus tard elles s'emballent comme un gigantesque hachoir mécanique. C'est comme l'Enfer de Dante, laissez vos espérances devant la porte d'entrée. Dans le porte-parapluie. Puisqu'il paraît que l'humour est la politesse du désespoir. Dedans ça machette dur. Une demi-seconde de repos et c'est la chute finale. Bref mais intense. Tiens, vous êtes encore vivant ? C'est sûrement une erreur. Vous n'avez pas su répondre à la question subsidiaire que les paroles klaxonnent. Pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien ? Ah ! vous n'avez pas compris. Vous voulez rentrer chez vous vous mettre au chaud. Ce n'est pas grave. Tenez prenez ce bouquin, Oui-Oui et la Voiture Jaune, il vous aidera à vous endormir. A l'impossible nul n'est tenu. Le rock and roll, ça se mérite.
PAROLES M'ASSOMMENT

Vais pas vous raconter le clip. Une véritable histoire avec un début, un milieu et une fin. Vous êtes assez grand pour le regarder par vous même ( F.B. des artistes ou You Tube ). Ce n'est pas le sujet qui est intéressant, c'est la mise en scène. L'esprit. Les Pogo Car Crash Control sont intelligents. Ont pigé que le rock est un art total. Au miroir d'un opéra wagnérien. Les images, bien sûr. Les fixes et celles qui bougent. Le rock, c'est beaucoup plus subtil que trois guitares qui hurlent. Faut mettre en scène. Pas tout à fait la même chose qu'être sur scène. Ne rien laisser au hasard, les affiches, les pochettes, les clips. Les trailers. Il y a ceux qui n'y pensent pas. Tant pis pour eux. Sont comme les trous sans le gruyère. Ceux qui se trompent, donnent dans l'esthétisme, la futilité du beau. Enfin ceux plus rares qui sont motivés par une esthétique. Pas facile, ça se construit. Faut la penser, la mettre au point. Faut savoir s'entourer. Exemple Baptiste Groazil pour la pochette. Les références sont nécessaires, doivent être là mais en profondeur. Les Dieux qui dorment sont ceux qui portent les projets les plus dangereux. Ne s'agit pas de jacasser, mais de signifier. Un minimum de moyens, un peu de savoir faire, de l'idée, pas des idées à l'épate patate, à la mord-moi-le-noeud de ma cravate tous les dimanches matins. Un profilage. Surtout si vous avez choisi comme les Pogo la coïncidence des contraires, hard trash and bad laugh, z'avez intérêt à ce que l'humour prenne la teinte du masque de la mort rouge d'Edgar Poe, mais version grotesque néronien. Léger décalage. En dents de scie. Coupante. Et aussi un but. Toute action doit être téléologique. Sachez inverser les signes, deuxième exemple, le clip de Paroles m'assomment vous repasse les plats du cinoche muet. Vous êtes tout fier, vous avez trouvé cela tout seul, oui mais il se paie votre tête. Un joyau d'or pur. A bon entendeur salut.
Damie Chad.
SIDNEY BECHET MON PERE
DANIEL-SYDNEY BECHET
EDITIONS ALPHEE – JEAN-PAUL BERTRAND
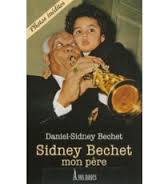
Le fils qui rend hommage à son père. N'élude pas ses difficultés. A très peu connu son géniteur. Avait avait à peine cinq ans quand il est mort. L'a dû se fier et se défier des témoignages de ceux qui l'ont fréquenté, parfois admiratifs, parfois rongés par l'envie et la jalousie. L'a aussi interrogé les proches, sa mère qui n'avait point la fibre maternelle et s'en est tout de suite débarrassé ( gouvernante, pensions, famille ), et Jacqueline l'ancienne femme de Sydney qui l'a aimé... N'en est pas resté haineux pour autant. A su faire la part du respect et de l'affection. Créole, l'a reçu dans son sang la méfiance instinctive de ceux qui refusent de voir le monde, tout en blanc, ou tout en noir. Un détail qui ne trompe. Est devenu musicien de jazz. Batteur, remarquez que si Kenny Clarke était venu à la maison et m'avait refilé un coup de baguette magique, moi aussi je... Joue aussi du piano. S'est adonné à plusieurs styles de musique, l'a accompagné de grosses pointures, n'a pas dédaigné les musiques subalternes style, fusion, variétoche et même hard rock...

Sidney Bechet nous l'avons à peine encontré dans KR'TNT ! incidemment lorsqu'il est venu d'Amérique en 1925, avec Joséphine Baker ( Kr'tnt ! 123 du 20 / 12 / 12 ) pour la fameuse Revue Nègre. Aussi dans la biographie de Moustache ( Kr'tnt ! 262 du 30 / 12 / 15 ) qui raconte en de trop épisodiques pages les premières pérégrinations vers le succès de l'artiste. L'a aussi joué avec Mezz Mezzrow ( voir Kr'tnt ! 106 du 12 / 07 /12 ). Mais pour le plus passionnant, la première partie de sa vie, aux Etats-Unis, les documents font défaut. Daniel recopie de longs extraits de l'autobiographie de son père, Treat It Gentle, traduit en Français sous le titre de La Musique c'est ma Vie parue à La Table Ronde en 1977.
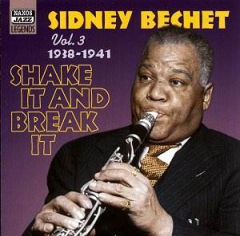
Sidney n'y raconte pas simplement sa vie. L'inscrit dans la saga de l'esclavage noir. Erige son grand-père en personnage mythique, esclave qui tous les dimanches battaient le tambour et menait la danse sur Congo Square ( Kr'tnt ! 143 du 09 / 05 / 13 ). Une histoire mélodramatique et romantique qui finira mal. Accusé par son maître d'avoir violé sa fille, il sera poignardé par un ami qui tenait à recevoir la prime promise. Qui ne lui fut pas remise.
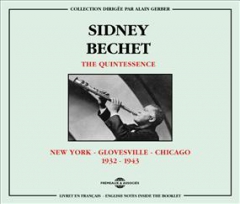
Histoire peut-être inventée mais nécessaire à l'histoire de la naissance du jazz entreprise au travers de sa biographie par Sidney. Une invention qui ainsi ne sort pas de la famille. C'est des tambourinades d'Omar le grand-père qui renouait avec le legs rythmique africain que naîtra le ragtime, cet entrecroisement de rythmes de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexifiés. C'est ensuite que s'installe la grande dichotomie, le succès des musiciens blancs qui récupèrent cette musique rebaptisée Dixieland et qui en retirent beaucoup d'argent, l'insécurité matérielles des créateurs noirs qui voient à chaque nouvelle avancée leurs trouvailles leur échapper. Bechet se définit plutôt comme un musicien de blues, mais qu'il adapte à sa clarinette et plus tard à son saxophone ténor. A treize ans, l'est déjà reconnu comme un sujet des plus intéressants. En 1924, le voici en Angleterre dans l'Orchestre de Duke Ellington, sera expulsé pour participation à une bagarre. Dans son livre Bechet se présente comme enfant d'une famille pauvre, créole et responsable. Pas question de traîner avec les voyous du quartier dans la Nouvelle-Orléans. L'était peut-être sage comme une image, mais à la fin de son second séjour en Europe, sera mis en prison pour onze mois, par chez nous, pour avoir réglé un différent avec Mike McKendrick, qui s'était mis à marcher un eu trop sur ses plate-bandes musicales, à coups de revolver en pleine rue... Daniel est formel, son père ne sortait jamais sans son revolver... Ce trait de caractère n'est pas sans évoquer la violence qu'entretenaient entre eux les joueurs de blues dans le Delta.

Reviendra en France en 1949. Y résidera jusqu'à la fin. L'a trouvé toute une brochette de jeunes artistes plein d'enthousiasme à qui il délivrera bien des connaissances. Pas très patient, si vous ne comprenez pas ce qu'il vous explique, il vous montre en vous prenant l'instrument des mains. Une seule fois, ne supporte pas les esprits obtus. Les orchestres de Claude Luter et d'André Réwéliotty seront ses plus fidèles accompagnateurs. Petite Fleurs et Les Oignons lui permettent d'accéder à un succès mondial que les Etats-Unis lui auraient refusé d'acquérir. Z'étaient un de trop, son caractère tempétueux et les circonstances ont fait que ce fut à Louis Armstrong que fut dévolu le titre emblématique de représentant du jazz, aux States et puis dans le monde entier. En manifesta une sourde rancoeur. Le fils n'hésite pas à le classer parmi les quatre fondateurs du jazz avec King Oliver, Jelly Roll Morton et Louis Amrstrong. Insiste sur ses talents de découvreurs, a su s'entourer de musicien destinés à devenir célèbre notamment Kenny Clarke et Max Roach. Comme par hasard l'a toujours préféré les pianistes et les batteurs à tous les souffleurs... L'on n'est jamais mieux ensemble que lorsqu'on est le seul de son espèce.
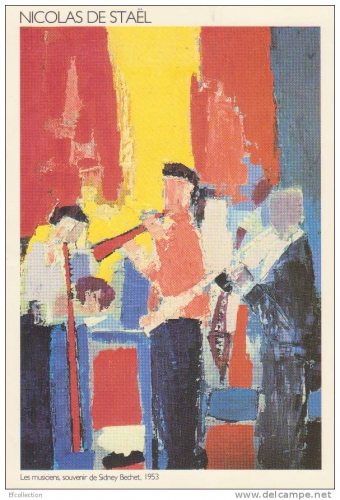
L'est un peu passé de mode. Sa figure d'apparence joviale et bonhomme qu'on lui prêta en France, ses frasques et son mariage carnavalesque sous forme d'un défilé monstre, ont aujourd'hui par un étrange retournement d'image quelque peu désacralisé l'icône. Les souvenirs de Moustache n'ont pas aidé à le monter sur un piédestal... On lui reproche parfois son succès européen, trop populaire pour être honnête. L'on en a conclu à un coupable laisser-aller vers la facilité. Daniel explique que la prolifération des groupes de style New Orleans ont codifié les saveurs exubérantes de ce premier jazz par trop séminal. L'est devenu une musique corsetée, froide, morte qui ne donne surtout pas à l'auditeur l'envie d'explorer les fiévreuses éminences des enregistrements originels. Sidney Bechet est mort en 1959. Son oeuvre est à redécouvrir, notamment ses compostions pour ballet qui n'aboutirent pas.
Damie Chad.
Private P.S. : le tableau de Staël est pour Léa & Patrick.


