28/10/2015
KR'TNT ! ¤ 253 : JIM JONES / TONY MARLOW / JAKE CALYPSO / GOLF-DROUOT / LES MAÎTRES DU MONDE / CRIMSON PEAK
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 253
A ROCK LIT PRODUCTION
29 / 10 / 2015
|
JIM JONES & THE RIGHTEOUS MIND / TONY MARLOW / JAKE CALYPSO GOLF DROUOT / LES MAÎTRES DU MONDE CRIMSON PEAK |
L'OUVRE-BOÎTE / BEAUVAIS / 25 – 09 – 2015
JIM JONES & THE RIGHTEOUS MIND
LORD JIM
Non, Jim Jones ne navigue pas à bord du Patna. Non, il ne transporte pas des pèlerins musulmans à travers l’océan indien. Non, après la collision, il ne quitte pas le navire à bord de l’unique chaloupe. Mais non, Jim Jones n’est pas ce lâche qui abandonne les pèlerins dans le vieux rafiot en train de couler. Non Jim Jones ne comparaîtra pas devant un tribunal pour ce forfait, pas plus qu’il n’entrera au service de la Far East Co pour transporter des armes à travers la jungle du Patusan. Jim Jones est un aventurier, certes, mais d’une toute autre trempe.
Pour saluer le retour de ce fantastique aventurier, l’Ouvre-Boîte de Beauvais offrait un concert gratuit. Il y avait si peu de monde qu’on s’est posé la question : avec une entrée payante, aurions-nous vu encore moins de monde ?

Jim Jones vient de couler son Patna (the Jim Jones Revue) pour reprendre le large à bord d’un esquif flambant neuf, the Righteous Mind. Dès le premier cut, on sent la prise au vent, la maniabilité, une nouvelle souplesse du son et une fantastique allure. Jim Jones gratte une antique demi-caisse et sort un son qui vaut tous les sons du monde. Dès le lever de rideau, il installe un climat propice aux dérives de la raison, et il maintient son cap avec la poigne d’un vétéran de toutes les guerres.
Changement de cap radical. Plus de Bamalama Little Richard et donc plus d’Henri Herbert, ce maniaque du boogie qui sonnait comme une impasse. Pour remodeler son destin musical, Jim Jones a enrôlé Matt Millership, un pianiste coiffé comme Bryan Gregory, qui peut jazzer le groove et pulser de belles nappes de soul shuffle. Matt Millership est l’antidote exact d’Henri Herbert. Là où Herbert parasitait l’équilibre scénique de la Revue en débordant d’exhibitionnisme, Millership instaure une atmosphère de recueillement propice au heavy lounge dont s’entiche désormais Jim Jones. Sur scène, Millership ressemble à un spectre, tassé derrière un orgue enveloppé de tissu noir. Mais attention, il n’a absolument rien d’anecdotique. Il n’est pas là pour jouer les monstres de fête foraine. Millership tient son rang, comme Jim Jones.

Le seul survivant de la Revue, c’est le bassman Gavin Jay, toujours haut et maigre, toujours chapeauté de noir et penché sur une Rickenbacker dont il joue à bouts de bras. Gavin Jay semble être le lieutenant fidèle, celui qui partage les secrets de Lord Jim, celui qui le suivrait jusqu’en enfer, à travers la jungle du Patusan. Mais qui serait assez fou pour refuser de suivre un héros pareil jusqu’en enfer ? Personne évidemment ! Le fait que Gavin Jay sache aussi jouer de la stand-up à l’archer explique peut-être son maintien dans les effectifs. Comme Jim Jones recherche cette insondable profondeur chère à Joseph Conrad - ce fameux cœur des ténèbres dont il a rempli ses récits - le son d’une contrebasse jouée à l’archer devient l’instrument idéal. Jim Jones y trouve les possibilités orchestrales infinies et du coup, la fièvre jaune entre dans la danse. Attention, Jim Jones reste Jim Jones, un farouche rocker anglais. En assombrissant son univers sonique, il ne se rapproche pas, comme on serait tenté de le croire, de l’aride Nick Cave des Bad Seeds ou de ce sémaphore abandonné qu’est devenu Van Morrison. Il se rapprocherait plutôt de Lee Hazlewood et des Walker Brothers - that lounge kind of sound dans lequel il injecte un solide shoot de blast. Jim Jones recrée son monde avec un souffle qui n’en finira plus d’épater la galerie. S’il cite Serge Gainsbourg dans une interview, ce n’est pas non plus par hasard, Balthazar. On a peut-être aujourd’hui l’occasion de découvrir la vraie stature de Jim Jones. Black Moses ou The Revue laissaient présager d’une certaine ampleur. Aujourd’hui, avec The Righteous Mind set, on ne risque plus de se perdre en conjectures. Ce mec navigue au même niveau que David Bowie, Scott Walker ou Chris Bailey.

Mais attention, ce n’est pas tout. Jim Jones fait entrer une nouvelle composante dans son son : la pedal-steel guitar. On voit ce mec assis à gauche de la scène, presque retiré dans l’ombre, une sorte Johnny Burnette à gros bras et coiffé comme un greaser, sérieux comme un pape et complètement absorbé par son jeu. Il est assis comme Millership et semble avoir récupéré le mauvais rôle. Rien n’est pire en effet que de devoir rester assis sur scène quand on voit les autres sauter dans tous les coins à l’occasion de violentes bourrasques soniques. Mais heureusement, il profite de certains morceaux pour attraper sa belle Gretsch rouge et doubler Jim Jones sur certains cuts particulièrement endiablés, comme cet extraordinaire «Base Is Loaded» où les deux solistes croisent leurs phrasés avec une stupéfiante pugnacité. Cet intrépide guitariste s’appelle Malcolm Troon et on se régale de le voir venir au bord de la scène pour trépigner comme un étalon sauvage. Quelle énergie ! Jim Jones semble avoir déniché la perle rare, car Malcolm Troon est lui aussi un brillant musicien. Il ne joue pas sur sa pedal-steel comme ces vieux ringards de la country asexuée, non, pas du tout, il sort de sa petite machine à tricoter un son d’intrigue et d’aventure qui s’en vient lécher les confins d’un exotisme auquel Jim Jones aspire au moins autant que Joseph Conrad.
Accompagné par cette fière équipe, Jim Jones bâtit une sorte d’univers musical entièrement neuf, plus sombre et plus lourd. Il vise une sorte de tribal qu’il pimente de Nashville sound et de psychédélisme extraverti. Et bien sûr, il amène les chansons qui vont avec.

Sur scène, il ne reprend aucun des titres de son album précédent «The Savage Heart», qui annonçait une nouvelle direction, grâce ou à cause de certains morceaux plus mélancoliques. Sans vouloir être méchant, on peut bien avouer s’être ennuyé à l’écoute de ce disque. Par contre, le nouveau set se compose de morceaux tout neufs, et quels morceaux ! Jim Jones attaque avec «Aldecide», un rumble digne de l’ancien temps, bien rampant et dans lequel le solo de guitare fait autorité. On ne discute pas plus son autorité qu’on ne discute celle d’un capitaine. Jim Jones n’a rien perdu de la niaque du temps des Hypnotics. Ce sont ses racines, comme il l’indiquera plus tard lors de la petite papoterie d’après concert. Et la température du set monte d’un coup dès le second cut, «Til It’s All Gone», une sorte de blues-gospel infesté de fuzz black-mosique. Ils jettent un peu d’huile sur le feu en attaquant «Boil Yer Blood», bien tribal dans l’esprit, serré au kiki du beat, chanté avec force et traversé par des vieux relents de gimmicks descendants en provenance directe des seventies. Puis le groupe va commencer à s’agiter sérieusement avec un «No Fool» brutal, comme frappé à coups de beat et chanté au guttural de la désespérance - I love you with all my heart/ Why don’t you feel the same - Et de cet épouvantable fatras se dégage une sorte de grandeur, celle de la perdition et de la rédemption impossible. Oui, Jim Jones nous racle tout ça du fond de la gorge. Il ne fait pas semblant. Avec «Save My Life», il croone comme un homme au destin brisé et s’enveloppe du suaire le plus noir qui soit. Jim Jones chante et fixe les gens dans le public. On glosera jusqu’à la fin des temps sur la force de sa présence scénique. Il enchaîne avec un «100 Miles From The Sure» qui renvoie directement aux eaux troubles de la psychedelia anglaise, puisque le cut s’étend comme la mare paisible d’un entrechat sorti de l’imagination larvaire d’un Syd Barrett. C’est là que Gavin Jay et Malcolm Troon créent de l’enchantement à base de sonorités à la fois perverses et paradisiaques. Ce qui nous renvoie au paradoxe de la tentation et donc au péché originel.
Et plus loin, ils vont taper dans le vieux chain-gang stomp de bas étage avec «Hold Up», qu’ils prennent a capella et aux maracas, réclamant au passage le participation du public. «Dream» sonne comme un vieux standard pétrificateur de Black Moses, mais avec la bravada de l’innocence retrouvée. En rappel ils vont enchaîner trois stormers, un genre dans lequel Jim Jones a de tous temps excellé, et voilà le travail.
Signé : Cazengler, aka Jim le jaune
Jim Jones & The Righteous Mind. L’ouvre-Boîte. Beauvais. 25 septembre 2015
24 – 10 – 2015
LE 3 B / TROYES
TONY MARLOW TRIO
Un trio à Troyes. C'est de bonne guerre. Avec Marlow, l'on est sûr que ce ne sera pas du chamallow ! La teuf-teuf filoche, elle ricoche de toutes ses encoches sur la péloche goudronnée. Connaît la route du 3 B ( Bar Béatrice Berlot ) les phares fermés, m'y dépose frais comme une rose ( de Provins ) en quatre-vingt minutes. N'a pas battu son record, ni usé ses freins à disques. Pas la foule des grands soirs. Cela me désole. Mouvement un peu général, je remarque que depuis la rentrée les salles ne font pas le plein, l'oeuf est à moitié cuit, trop mollet et pas assez dur, les temps sont difficiles pour les rockers ( et les autres ) quand tombent au vent mauvais de l'automne les feuilles d'imposition... oui mais il y a la qualité, Christophe, Tony, Duduche et tous les autres, plus les rockeuses blondes, plus les jerkeuses châtaigne, plus les brunes strolleuses, un joli camaïeux de cheveux... Le trio en est au dessert au fond de la salle, salutations, embrassades, discussions, le trio enlevé trié sur le volet peut s'envoler et commencer. A l'heure, et ils ne vont pas économiser la mortadelle, trois sets d'enfer, mais ne brûlons pas les étapes.
CONCERT

Ont adopté la position offensive du tricorne napoléonien – celle qui permit à l'Empereur d'enfoncer par trois fois les Autrichiens - au centre Gilou Slap mais décalé sur notre gauche, Tony Marlow tout devant, et Steph relégué tout au fond avec sa batterie. Gilou sanglé dans sa chemise léopard, Tony dans sa large casaque zèbre, et Steph qui fournit l'ardoise teinte de sa batterie pour figurer le paysage rockeux de cette jungle en folie. Peut-être sont-ils déjà en train de jouer, mais moi je n'écoute pas. Je regarde. J'admire. N'y a que les courtes oreilles qui croient que le rock est avant tout une musique. Certes ce n'est pas faux, mais c'est à peine le un pour cent de sa totalité. Je n'ose dire de sa tonalité. C'est pour cela que je ne quitte pas des yeux Steph qui officie sur ses peaux tendues. Certes il fait un boucan de tous les diables, vous avez le palpitant qui se sépare de son aorte chaque fois qu'il envoie un coup, et je peux vous jurer qu'il ne s'en prive pas. Ne restez fixés ni sur ses biceps ni sur ses avant-bras et n'essayez pas de deviner l'instant précis où il azimute ses cymbales. Montez plus haut. Zieutez juste le visage. Je laisse aux filles nous dire combien il est beau. Elles sont plus douées que moi pour ce genre d'exercice. Dans un film, n'y a pas que le physique de l'acteur, l'on est d'abord emporté par le synopsis et le scénario. Et sur la figure de Steph, c'est toute l'attitude du rock and roll qui défile. Accessoirement Steph joue de la batterie, mais c'est sur ses joues que tout se passe. Il interprète, il mime, il signifie, il raconte, il épouse chaque donnée d'un morceau. Dans la sauvagerie du rock, ce qui fait la différence, c'est l'intonation, le phrasé d'un Jerry Lee Lewis qui traîne un millième de seconde de trop sur une syllabe, ou cette manière de faire hoqueter le silence qui vous étrille au plus profond la veine cave, cette subtile variation qui arrive à point nommé à l'endroit exact où le génie impose sa présence, c'est cela le rock que le fan ressent et traduit par exemple en levant ou abaissant une main fort à propos. Ces moments d'extase, ces instants d'attente, vous les lisez sur le visage de Steph, il vous les traduit souverainement par la flexion des méplats, ses lèvres se retroussent, son nez se tend, ses yeux s'écarquillent, ses sourcils se haussent vers le ciel, l'est tour à tour effarement, folie, stress, joie, explosion, tous les sentiments inhumains d'innocence primale et animale que transcrit le rock défilent sur sa figure. Boniments muets des Peintures de Victor Ségalen retranscrites sous forme de commentaires figuratifs du bateleur.
Mais peut-être aimeriez-vous que l'on vous remette un peu de son. Le triolet maléfique possède ce qu'il vous faut. Gilou, si le diminutif est tout doux, ce soir ( comme toutes les fois qu'il est sur scène ) l'esprit du guépard est en lui. N'est plus qu'une griffe qui s'acharne sur les cordes de la contrebasse. Pas vraiment neuve, elle a beaucoup souffert dans sa vie. Lui tire dessus sans pitié, ne la plaignez pas car elle chante comme une cantatrice dont la voix domine les cent-vingt musiciens de l'orchestre dans la fosse aux lions. Quand on y réfléchit une upright bass ce n'est pas beaucoup plus haut qu'une autruche, tant s'active le Gilou qu'il lui file l'ampleur du gosier d'une baleine bleue. Le swing en plus. Toute la différence. Ne tire pas pas une corde pour créer un bruit de fond mais pour passer le mur du son. Lui trifouille le ventre avec le sérieux d'un chirurgien incisif qui vous étire tripes et boyaux pour le seul plaisir de s'assurer que vous êtes en bonne santé. Superbe médicamentation qui vous ragaillardit en trois mesures. Donne dans le sauvage, le meurtre, le sang, le gore, sourire carnassier, feeling d'acier. C'est simple, avec ses quatre maigres ficelles, fait autant de bruit que Steph avec tout son kit. Pour la section rythmique vous irez voir ailleurs, ici c'est l'atelier de rétamage et d'estampage.

Vous vous inquiétez pour le chanteur. Vous vous demandez comment il placera sa voix dans le tumulte. Sans problème. Naturellement, comme s'il était tout seul à chantonner la Traviata dans un champ de pâquerettes. L'en a vu d'autres le Tony. Vous voulez vous amuser les gars, alors allons-y. Et il démarre sa fender mentholée comme s'il s'apprêtait à battre le record du tour du quartier du Ace Café. Celui de Brigthon, à cause du baston. Pour le chant, vous offre les trois options, l'anglais pour le répertoire des classiques, le français, signe de courage dans le milieu rockabilly où la langue nationale et maternelle se doit d'être celle avec laquelle on cause du côté des Appalaches, et spécialité du chef, le Corse, qui ma foi sonne à merveille. En fait je soupçonne que celle qu'il préfère, c'est son imitation d'une Triumph en montée de gomme, par laquelle il aime terminer ses morceaux. Sacré rider, l'enchaîne les titres à toute vitesse, infatigable. Tape dans tout son répertoire, clin d'oeil aux Rockin'RebelS le groupe rockabilly des années 80, quelques reprises uppercutées de Johnny Kids – à l'heure où vous lisez cette kronic le pacha Marlow sera en train avec ses deux âmes damnées en train de d'enregistrer le tome II de K'ptain Kidd – les incontournables du rockab, un très beau Rawhide sans oublier Victor Leeds, l'ami perdu...
Un premier set très long. Ce qui n'empêche pas qu'il était trop court. Montée en puissance continue. Qui permet de juger du niveau de connivence des artistes. En rajoutent toujours à la fin des morceaux, c'est un peu à la l'on va voir qui aura le dernier mot. Un deuxième set un peu court. Mais un temps de sidération. Steph qui se lance dans un solo. Pas long, mais d'une puissance et d'une force incroyables. Aucun bavardage. De la frappe pure. Une démonstration de géométrie dans l'espace. La quintessence du rock en deux minutes. Une brièveté d'une densité stupéfiante. Vous croyez que l'on vous a servi l'eau de vie des familles, la dive bouteille que l'on sort pour les mariages et les enterrements, manière de se remettre des émotions de la journée. Ce n'était que le début de la tournée. C'est autour de Gilou de nous faire tâter d'une vieille prune de la prochaine guerre nucléaire. Vous en verse un fond de verre, pas plus de trois doigts, une mort subite, une corde hurlante, un brame de cerf amoureux qu'il éructe de sa big mama comme les boulets des canons d'Austerlitz qui brisèrent la glace du lac gelé. Et Tony qui nous montre ce qu'il sait faire. L'a des petits instrumentaux clairs comme des cristaux de diamant, car quand il entrouvre l'armoire à poisons, quand il vous bichonne de grandes cuillères trouées d'absinthe, c'est always on the rocks ! Aussi nocifs que les Martini qui servaient de petit-déjeuner à Gene Vincent.

Plus tard des gens mal intentionnés vous assureront qu'il y eut un troisième set. Faites semblant de les croire. Pour ne pas les peiner. J'y étais, ce soir-là, du vingt-quatre octobre de l'an de disgrâce 2015, je jure sur l'honneur qu'il n'y eut pas de troisième set. L'avait pourtant bien commencé, au triple galop, une charge de cosaques sur la redoute de Borodino, du classique quoi. Un dernier barouf avant de se glisser sous la couette. Gilou avait pris sa basse électrique, Steph pétaradait dans son coin, et en maître d'oeuvre de la soirée Tony annonça le dernier morceau. La classe de Charlie Chaplin s'inclinant devant les spectateurs dans La Comtesse de Hong Kong, son dernier film. Oui mais il y avait une dernière bobine, un truc de ouf, que vous n'avez sans doute jamais vu, le King Kong du Rock and Roll s'est échappé. Et impossible de le rattraper et de le fourrer dans sa cage. Trois quart d'heures de folie pure, les musicos possédés par le démon du rock implorant qu'on leur donne encore et encore des titres. L'a fallu que Béatrice se sacrifie qu'elle se jetât les bras en croix au milieu des danseuses échevelées pour implorer que la sarabande cesse avant que ces messieurs de la police n'interviennent. Heureusement qu'ils connaissent très bien Duduche – c'est lui qui nous le révéla - ce qui nous permit un dernier Whole Lotta Shakin' goin' on meurtier. Killer oblige.
Une soirée qui vous réconcilie avec la vie. Y aurait des tas d'anecdotes à raconter, Gilou et sa fière dégaine de guerrier cheyenne relayant Tony au chant pour un seul morceau, l'ambiance amicale, la frénésie, les rires, la complicité entre Tony et ses acolytes, et le public. Du rock. Et rien d'autre.
Damie Chad.
( Photos FB : Heather Van Taylor )
Une idée toute bête a surgi dans mon cerveau. Pendant que je vadrouillais à Strasbourg, Tony Marlow et Jake Calypso se retrouvaient chez Gibert Jeune pour un show case de présentation du dernier CD de Calypso. Rencontre de guitares au sommet ! Et je n'y étais pas, alors pour fêter nos deux hérocks à notre manière, nous les avons mis dans la même livraison de KR'TNT !
DOWNTOWN MEMPHIS
JAKE CALYPSO
AND HIS RED HOT
TURN ME LOOSE / TO LOVE AWAY / DOWNTOWN MEMPHIS / TROUBLE BOUND / I'M A REAL COOL CAT / BE MINE BABY / PLANS OF LOVE / YOU KILLING ME / WHEN THE PRETTY GIRL BOP.
From EP session : BABE, BABE, BABY / BLUE MOON OF KENTUCKY / LOVIN' HEART / THAT'S ALL RIGHT /
Bonus Track : JIMMY's TALKING.
Vocal : JAKE CALYPSO / Lead Guitar + bv : CHRISTOPHE GILLET / Drums : THIERRY SELLIER / Upright Bass + bv : GUILLAUME DURIEUX /
Enregistré les 7 / 04 / 15 et le 24 Mai 14 pour the EP Session : SUN STUDIO, 706, Union Avenue, MEMPHIS – TENNESSEE.
APR CD 36 : Chickens Records / Rock Paradise
Distribution : Rue Stendhal et Records Freight
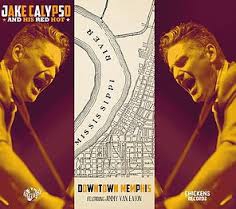
De temps en temps les rockers s'offrent une petite friandise. Jake Calypso n'a pas hésité à s'emparer de la plus grosse tranche de l'apple pie. Un truc à faire déglutir de jalousie tous les rochers de la terre. Quelques semaines du printemps avant-dernier, et puis une récidive l'année suivante, in the real south à courir on the blues trail – l'a même assisté à l'un des derniers concerts de B. B. King qui interpréta pas mal de... Hank Williams – et un must dont chacun rêve toutes les nuits de sa vie : deux sessions d'enregistrement chez Sun. L'en a rapporté un single de deux titres paru dès le printemps 2015 et maintenant ce CD qui arrive dans les bacs. L'ai même aperçu à la Fnac de Strasbourg qui n'est pas pourtant des mieux loties question rock et roll...
C'est ici que les Athéniens s'atteignirent, l'enjeu était d'importance, l'on ne met pas impunément ses pas dans les traces des semelles d'Elvis. La ligne blanche à ne pas dépasser est d'une simplicité extraordinaire : à la copie l'on préfère toujours l'original. Je l'imagine le petit frenchy venu du Nord, dans le saint des saints du pure south rock and roll avec son lourd passif de french rockab mâtiné de garage, ses soupçons de psycho, ses errements punchy punky, faudra être hommagial certes, mais surtout sans se renier. Pas d'hésitation, nous montre tout de suite dès le premier morceau Turn me loose ce qu'il sait faire. Dès les premières mesures, l'on est surpris, ce pourrait être de l'Elvis, la voix, les guitares, le son, la rythmique, tout y est, l'on se croirait en 1954. Mais chassez le naturel, il revient au galop. C'est derrière que la chasse s'organise. Malin, Jake Calypso, laisse les copains faire le boulot. Sans cœur pour les chœurs qui jouent aux dogs hounder de chasse. Des courants, pas d'arrêt. N'ont pas les Jordanaires comme ligne de mire - ils n'arriveront qu'en 56 chez RCA - alors dans le little studio c'est un infect tournoiement, sont sur les talons de Calypso et lui mordillent même les mollets, mais le Jake parvient à garder son avance jusqu'à la fin. Guillaume Durieux chauffe à mort avec la big mama qui gratte comme un vieux phono usé et qui bouffe les soli de guitare. Magnifique chasse à courre. To love away maintenant se la joue cowboy solitaire qui yodelle tout seul sous la lune, pour un peu vous ferait pleurer dans la chapelle, les rockers sont des grands romantiques, se promène avec le cœur mangé par les mites du chagrin. La face douce du pelvis. Downtown Memphis Rick Steff au piano qui honkytone à qui mieux mieux un peu à la Jerry Lee, ça bastonne comme dans un bastringue du fin fond de la ville, l'on est descendu du Mystery Train et l'on ne se prend pas pour un demi-sel. Trouble Bound Johnny Van Eaton sur les drums, ambiance saloon, un solo de guitare à la Buddy Holly, puis des mistouflettes beaucoup plus modernes à la suite, très belle partie vocale, du pur country avec les pleurs du blues. I'm a real cool cat pas la peine de sortir votre mouchoir le vrai chat cool ne se la coule pas douce, bope comme un vieux rocker des années cinquante, plus authentique qu'une véritable imitation. Be mine baby suffit qu'une fille se pointe pour que le chaton lui mange dans la main, on a l'impression que derrière les musicos se moquent de lui, personne ne parvient à rester sérieux jusqu'au bout. Fait trop de chichis avec la voix pour que l'on y croie. Une splendeur. Plans of love encore plus tendre, lui fait tous les plans B de la drague, toujours les mêmes, mais qui marchent encore, l'on ne sait pas pourquoi. You killing me décidément c'est une prémonition de l'Elvis sucré des années soixante et même du Johnny Burnette des mêmes millésimes - s'offre un trip teenage sixteen jusqu'au bout, avec les voix derrière qui soulignent les passages émouvants. Emballeur numéro 1. When the pretty girl bop pas de panique il y a quand même des filles que les déclarations langoureuses ne réchauffent point. Les boppin girls sont vraiment beaucoup plus excitantes, la guitare mord les lèvres désirantes, et la basse glisse comme une culotte qui descend d'une croupe rebondie. Babe, Babe, Baby et celle qui arrive n'est pas pire que la précédente, les émoustille tous, l'on est au cœur de l'action sur la banquette d'une cadillac rose, vite fait, bien fait. Satisfaction sur toute la ligne. Blue moon of Kentucky, c'est bien connu au Kentucky tout est bleu, de bas en haut, de l'herbe à la lune, la nuit même les cats sont bleuâtres, retour à la campagne, le cowboy roucoule, l'a retrouvé le grand air. Bondit et rebondit de tous les côtés comme sur un matelas herbeux à ressorts. Lovin heart le meilleur des cadeaux de Noël, un coeur aimant. Sergio Panigada nous envoie des œillades de velours sur sa pedal ( dans la choucroute de l'amour ) steel guitar, nous sommes dans le cœur fondant de l'hypocrisie amoureuse, mais s'il faut en passer par là... That's allright l'incontournable, une version qui aide à comprendre l'essence du projet, ne pas reprendre l'Elvis confirmé, s'arrêter sur sa première incarnation, l'hillbilly cat, le chat des collines, encore mal dégrossi, le minet qui a perdu ses dents de lait mais tout timide devant les chatounettes, le sexe entre deux chaises, ne sait pas quel rôle prendre, garçon attentionné ou voyou blasé. Dans sa tête de plouc branché des collines ( qui habite en ville ) se souvient de ses ancêtres mythiques, les vachers transformés en cowboys par le miracle du cinéma. Un country qu'il suffit de gratter de l'ongle – comme un médiator sur une guitare – pour sentir le blues souterrain d'un autre monde interdit qui affleure. Elvis avant qu'il ne se transforme en l'idole du quartier, puis de la ville, puis de l'Amérique, puis du monde... Un Elvis adolescent qui rêve de devenir un jour ce qu'il sera, et dont il ignore tout.
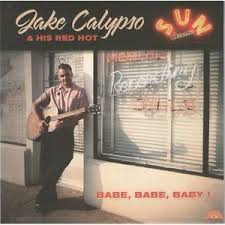
Jimmy'sTalking finie la musique, c'est Jimmy Van Eaton qui raconte ses souvenirs sur ses enregistrements, dans les fifties, avec Billy Lee Riley, Johnny Cash, Charlie Rich, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, et les autres... rappelons que vous retrouverez le drummin' de Jimmy Van Eaton sur une flopée de hits de rockabilly du genre Flyin' Saucers Rock'n'roll. Si vous connaissez mieux, téléphonez à Jerry Lee qui tient Van Eaton en très haute estime et qui le qualifie de batteur créatif...

On ne se lasse pas d'écouter Downtown Memphis. Une réussite. Du hillbilly revisited. Sans faire semblant d'oublier les cinquante ans qui ont suivi. Tant chez Jake Calypso que chez Thierry Tillier, Christophe Gillet, et Guillaume Durrieux l'on sent une intelligence et une compréhension instinctives du rock. Un disque que nous qualifierons de... créatif. ( Merci Jerry Lou. ). D'ailleurs Mister B me l'a volé.
Damie Chad.
GOLF DROUOT
LE TEMPLE DU ROCK
HENRI LEPROUX
( Robert Laffont / 1982 )
Manquait à ma collection. L'avais eu entre les mains au temps de sa sortie. La copine Joëlle avait même interviewé Henry et Colette Leproux lors de sa sortie pour son émission de nuit sur Radio Médiaval de Provins. Z'étaient tout contents que l'on s'intéressât à eux. Les trouva blessés devant l'indifférence générale – hormis le milieu rock – quant à la fermeture de l'établissement mythique, au soir du 22 novembre 1981. Rien à voir avec le ramdam médiatique – nostalgie surjouée - que suscita la pose d'une plaque commémorative le 24 février 2014. Plus de trente années avaient été nécessaires pour que les autorités - qui ne daignèrent à l'époque lever le petit doigt pour que le Golf puisse continuer à vivre - changeassent la guitare d'épaule... Malade, Henri Leproux qui devait s'éclipser de ce bas monde le 12 juin de cette triste année n'était même pas présent, les petites ironies de la vie si chères à Thomas Hardy.
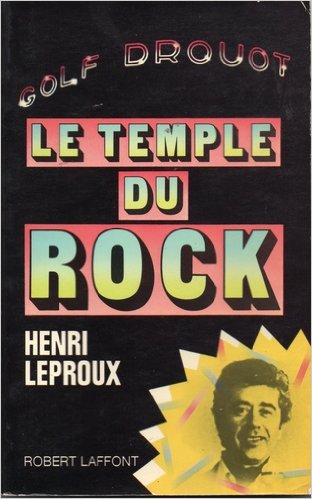
Reste des milliers de souvenirs dans la tête des gens – ceux qui l'ont fréquenté comme ceux qui n'y ont jamais mis le pied, c'est ainsi que l'on prend conscience de la force d'un mythe – des photos, un Face Book ( Golf Drouot, Groupe Fermé ), et le livre d'Henri Leproux rédigé au lendemain de la fin de l'aventure.
Leproux a beau s'en défendre à plusieurs reprises l'on y sent, malgré un optimisme forcé, du genre échange bon cœur contre mauvaise fortune, une pointe acérée et ulcérée d'amertume. Le sentiment que les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû, comme si on lui avait coupé toute une partie de sa vie. Un beau film dont la dernière bobine aurait été jetée à la poubelle par des rustres. Serait trop facile de leur pardonner sous prétexte qu'ils n'auraient pas su ce qu'ils faisaient.

Commence par parler de lui à la première personne. Né en 1928, milieu populaire, accomplit son rêve de finir barman au Lido, place de choix qu'il abandonne et échange pour celle moins glorieuse du Golf miniature Drouot. Un truc pas très folichon, à la limite du dépôt de bilan, l'on y organise des thés-parties pour les rombières huppées du tout-Paris. Oui mais il y a les yeux de Colette la caissière. Henri préfèrerait une clientèle plus jeune. L'a une idée neuve qui lui grignote le cerveau depuis quelques semaines que faute de merle sa patronne, Mme Perdrix, en désespoir de caisse vide, lui laissera mettre à l'essai. Faut dire que la mise de fonds est minime, un luxueux jukebox gracieusement fourni par les Etablissements Wurtltzer, quelques microsillons un peu rythmés et du coca à un franc la conso. Bientôt ce fut la clientèle qui se chargea d'approvisionner le mange-disques avec des galettes directement importées des USA récupérés auprès des GI's des bases de l'Otan sises autour de la capitale.

Pas grand-chose. Mais nous sommes en 1955 et aucun point de ralliement spécifiquement ouvert aux jeunes du Paris intramuros populaire n'existe encore. Le succès de Leproux ce n'est pas d'avoir dégoté une nouvelle clientèle c'est de comprendre que ceux qui montent les escaliers du Golf ne sont que les premiers représentants d'une nouvelle génération. Etendard rock and roll en avant. Bill Haley, Elvis Presley et toute la clique. La guerre est finie, la jeunesse veut s'amuser. Ceux qui fréquentent le Golf ne sont pas des anges. Proviennent des bandes des alentours. L'a dû falloir du doigté pour gérer ces nouveaux arrivants, blousons noirs et rebelles sans cause durent accepter une certaine discipline, une tenue correcte, et laisser la violence dans la rue. Oui mais en échange, il y avait les filles, la musique, la danse, le rire et une ambiance décontractée. Entre jeunes, loin des adultes. Et puis cette admiration sans borne pour les idoles américaines que l'on rêve d'imiter... Long Chris, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Moustique et bien d'autres proviennent de là. Y ont trouvé leurs premiers encouragements, leurs premiers supporters, leurs premiers fans... Leproux ne dit plus « je » mais « nous ». Parle au nom de tous. A compris que le phénomène qui est en train de se cristalliser est bien plus large que le minuscule Golf, qu'il en fut peut-être le révélateur mais pas le maître d'œuvre. Après l'éclosion de Johnny – l'on sent qu'il reste, de par son talent, son dynamisme et son caractère, le préféré de Leproux qui l'a beaucoup aidé, conseillé et guidé – les sarcasmes anti-rock s'apaisent, les maisons de disques considèrent la Golf comme le vivier de leurs futurs bénéfices...

L'histoire aurait pu finir là. Mais il n'en fut rien. Le rock ne s'est pas arrêté en 1964. Le génie du Golf, d'Henri et de son public, fut de suivre le mouvement, la course folle d'un style musical turgescent et foisonnant. David Bowie, les Stones, les Who et une multitude d'autres pointures vinrent au Golf. Les groupes français en perpétuelles métamorphoses y reçurent un accueil qui fut pour beaucoup le pont culminant de leurs carrière et pour quelques uns leur véritable entrée dans le métier. Plus de six mille groupes participèrent au célèbre tremplin du vendredi soir qui vit passer la crème du rock français.

La musique changeait. La jeunesse aussi. Les strips des jeunes filles n'étaient plus à la mode, les drogues douces et dures remplacèrent les premières héroïnes. Dans les années 70, la jeunesse est en même temps beaucoup plus libre et davantage perdue que celle des early sixties. Le rock and roll n'est plus une utopie, devient la musique de fond d'une génération, fait partie du paysage, n'est plus une solution à part entière. Cette désillusion est marquée pour toute une génération par un retour au rock and roll originel. Le dimanche après-midi regroupe les rockers qui formeront la nouvelle génération rockabilly des années 80, celle des Rockin'Rebels de Tony Marlow pour ne citer qu'un exemple.
Mais c'est déjà la fin. Le Golf ferme ses portes pour une triste histoire de contrat de vente d'immeuble... Leproux se rappelle les années folles, les concerts, les tournées d'été aux quatre coins de l'été, les disques Golf-Drouot, les émissions télé, une vie sur des chapeaux de roue ardents, et le clap de fin brutal, inattendu. Un couperet de guillotine.

Le Golf aurait pu survivre. Que serait-il devenu ? Parfois il vaut mieux finir avec une balle dans le coeur que sur une chaise roulante dans un hospice pour croulants en état de dégénérescence avancée. Cette fermeture prématurée a peut-être évité au Golf, le pire : son institutionnalisation, sa stérilisation, la visite obligatoire des cars de papy-boomers managérisée par Radio-Nostalgie. Et peut-être le summum rose de la déchéance, de nouvelles jeunesses auraient pu le considérer comme le club de la ringardisation absolue, l'endroit par excellence à éviter pour écouter de la musique qui bouge. Le Golf est mort au début des années quatre-vingt qui sont aussi celles du début de la marginalisation de la musique rock qui n'évite pas le piège de l'auto-enfermement dans son propre passé. L'escargot qui s'enclot dans sa coquille protectrice perd tout contact avec la vivacité créatrice du monde. L'est des évènements d'apparence terriblement circonstancielle qui s'inscrivent dans l'absolue logique signifiante d'assises invisibles qui régissent le réel d'une façon inéluctable et dont nous demeurons la plupart du temps complètement dupes et ignorants. Quoi qu'il en soit, le Golf Drouot restera une des pages fondatrices et des plus glorieuses du rock français.
Damie Chad.
( photos : Golfdrouot 2000 )
Cette kronic sur le Golf Drouot arrive à point nommé pour rééditer cette page du mensuel littéraire Alexandre ( 1995 – 2000 ) consacrée à un de ces groupes dont on attend d'ici peu la réédition de leur unique enregistrement. Pour faire le lien avec le Golf Drouot, nous rappellerons que Pitorre ( lead guitar ) et Manu ( charte graphique ) firent partie d'Olaf ( single 10 sur Oxygène ) qui remporta le Tremplin, devant Starshooter qui ce soir-là shootèrent à côté de leur plan de carrière promotionnel, et qui le prirent très mal.
LES MAÎTRES DU MONDE
Rock'n'Roll ou Rien. Années 80. La marée rosâtre du conformisme libéral noie toutes les velléités contestataires. Seuls résistent à l'ignominie ceux qui ont trempé sept fois leur âme révoltée dans les flots glacés de la déferlante nauséeuse.
Pamiers. Ariège ( 09 ). 18 août 1985. Soir de lune rousse. Au Broadway. Regroupement opératoire des Maîtres du Monde. Quatre. Plus près des cavaliers de l'apocalypse que des mousquetaires. Deux filles, deux garçons. Michèle : basse et décomposition. Germaine : batterie. Pitorre : guitare et composition. Manu : chant. Le combat est toujours le même : l'être contre le néant. L'irréductible fracture qui depuis des siècles oppose les poëtes aux animalcules, les cancres et les cacous capables de vous réciter par cœur la discographie complète de Gene Vincent ou de Led Zeppelin aux cadres dynamiques passionnés d'aftershave et de jazz. En d'autres termes les magnifiques et les flamboyants contre les rascleux et les médiocres. Les maîtres et les ilotes.
Le premier concert fut épique. En pleine campagne, sous la pluie, le groupe sur une charrette tractée par six chevaux noirs qui s'emballèrent lorsque les paysans du coin tirèrent à la chevrotine pour rétablir le silence nécessaire à la stabulation libre des bovins, le public cavalant derrière afin de ne pas perdre une miette de l'aventure, le tout s'achevant par une plantureuse charge de CRS...
La suite fut du même acabit. Désastreuse et mirifique à souhait. Les Maîtres du Monde n'avaient pas leur pareil pour vider, en deux morceaux, des salles de cinq cents personnes ou pour transformer en arènes chaotiques des rassemblements de trois mille individus brutalement dépossédés de leur réserve habituelle et initiés sur un rythme binaire et chamanique au délirium tremens...
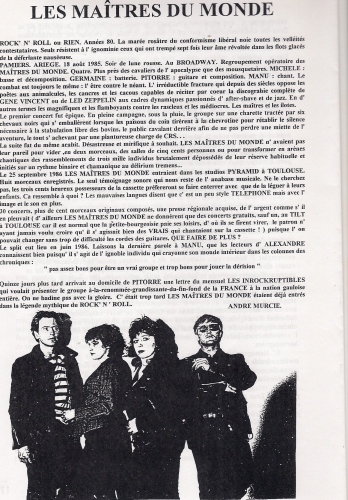
Le 25 septembre 1986 les Maîtres du Monde entraient dans les studios Pyramid à Toulouse. Huit morceaux enregistrés. Le seul témoignage qui nous reste de l'anabase musicale. Ne le cherchez pas, les trois cents heureux possesseurs de la cassette préfèreront se faire enterrer avec que de la léguer à leurs enfants. Ça ressemble à quoi ? Les mauvaises langues disent que c'est un peu le style Téléphone mais avec l'image et le son en plus.
Trente concerts, plus de cent morceaux originaux composés, une presse régionale acquise, de l'argent comme s'il en pleuvait - d'ailleurs les Maîtres du Monde ne donnèrent que des concerts gratuits, sauf un, au Tilt à Toulouse, car il est normal que la petite-bourgeoisie paie ses loisirs, d'où ils se firent virer, le patron n'ayant jamais voulu croire qu'il s'agissait bien des vrais qui chantaient sur la cassette puisqu'ils étaient capables de changer sans trop de difficulté les cordes des guitares ! Que faire de plus ?
Le split eut lieu en juin 1986. Laissons la dernière parole à Manu, que les lecteurs d'Alexandre connaissent bien puisqu'il s'agit de l'ignoble individu qui crayonne son mode intérieur dans les colonnes des chroniques :
« pas assez bons pour être un vrai groupe et trop bons pour jouer la dérision »
Quinze jours plus tard arrivait au domicile de Pitorre une lettre du mensuel Les Inrockruptibles qui voulait présenter le groupe à-la-renommée-grandissante-du-fin-fond de la France à la nation gauloise entière. On ne badine pas avec la gloire. C'était trop tard les Maîtres du Monde étaient déjà entrés dans la légende mythique du Rock'n'Roll.
In Alexandre N° 12 / Novembre 1996.
CRIMSON PEAK
GUILLERMO DEL TORO
( 2015 )

Des années que je zieute au hasard du net la programmation de La Laiterie de Strasbourg. Justement me voici dans la capitale de l'Alsace. Ce mercredi 21 octobre, deux groupes prévus : Blackalicious et F.R.E.E.Z. Inconnus au bataillon. Même pas un mot d'explication. Je subodore un truc de musique électro. Quand j'apprends que c'est du rap américain pour les premiers et du rapoétique local pour les deuxièmes, c'est sur l'avis annonçant l'annulation du concert... Heureusement j'ai un parachute de secours.
Crimson Peak. Tiens m'étais-je dit, un film sur King Crimson, normal, ils viennent de se reformer pour deux concerts à Paris, ils activent la promo à mort. Erreur sur toute la ligne. Cela n'a rien à voir avec le Roi Pourpre plutôt avec Le Masque de la Mort Rouge d'Edgar Poe si l'on veut rester dans la famille des violets profonds.
Pas rock pour un demi-dollar mais gothique à mort. Du gothique flamboyant, avec lugubre château en ruines, riche héritière innocente, fantômes à vous faire déprogrammer votre prochain voyage en Ecosse, jeune héros romantique trop beau et trop étrange pour ne pas se douter que sa pâleur maladive ne relève d'un passé très sombre, des mares de sang et l'inquiétante présence d'une argile trop symboliquement rouge pour être honnête. Du sexe, de l'amour, des innocents pervertis, des crimes, des cercueils, une rasade de mort et quelques rafales de peur.
Le film possède d'autres atouts, mal reçu aux Etats-Unis – les méchants y sont manifestement trop sympathiques - interdit en Chine – qui n'est plus rouge depuis si longtemps - et un stylistique parti pris esthétisant qui force l'admiration. Avec en plus cette présence de la machine, pratiquement subsidiaire dans le scénario si l'on se laisse emporter par le feu de l'intrigue. Machinerie des découvertes scientifiques et du déploiement de l'investissement capitalistique de l'argent, The Crimson Peak est aussi la fable de la vieille Europe asservie par l'Amérique, de l'Aristocratie déchue mise au pas par la Bourgeoisie. L'oeuvre nous paraît malgré sa happy end grand public beaucoup plus proche du pessimisme d'un roman comme le Château des Carpates de Jules Verne ou de la pierre tombale qui recouvre son tombeau, commandée par l'écrivain lui-même. Guillermo del Toro nous a appris avec Le Labyrinthe de Pan que le Rêve et l'Imaginaire sont aussi traversés par la réalité agissante du Politique. Ce Crimson Peak est bien la romance phantasmée d'une crise sanglante. Au sens grec du mot Krisis qui signifie séparation. Les accouchements, quels qu'ils soient, se font toujours dans la douleur. Avec le temps cette dernière subsiste dans de fantomatiques souvenirs évanescents et le sang sèche si vite en entrant dans l'Histoire que c'en est fantastique.
Damie Chad.
19/10/2015
KR'TNT ! ¤ 252 : DAN KROHA / MIDNIGHT SCAVENGERS / HOT CHIKENS / RAW POWER / JEAN-FRANCOIS JACQ
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 252
A ROCK LIT PRODUCTION
22 / 10 / 2015
|
DAN KROHA / MIDNIGHT SCAVENGERS / HOT CHIKENS / RAW POWER / JEAN-FRANCOIS JACK |
|
AVIS AUX LECTEURS Nous avons mis cette 252° livraison de KR'TNT en avance dès ce lundi. Ceci pour les esprits distraits qui n'auraient pas lu notre 251 ° édition. Nous profitons de l'occasion pour corriger une erreur dans notre 251. L'article de Tony Marlow sur Johnny Meeks et Jerry Merritt est paru dans le N° 346 de Jukebox Magazine et non dans le 246. Keep Rockin' Till Next Time ! |
28 – 09 – 2015
LA MECANIQUE ONDULATOIRE / PARIS XI
DAN KROHA
KROHA KROHA
Pour qui était-on à la Méca ce soir-là ? Pour le Kroha rythmeur de Gories ? Pour le Kroha stripper de Doll Rods ? Pour le Kroha Kroha du gibet de Montfaucon ? Pour le Kroha d’acou d’Angels Watching ? Pour le Kroha pas Croate de Detroit ? Pour le Kroha banana de Copacabana ? Pour le Kroha bandeur fou de Plaster Casters ? Pour le Kroha koala au cacao ? Pour le Kroha de cheville tordue et d’Abordage ? Pour le Kroha d’Hey-Hey-Hey We’re The Gories ? Tout bien réfléchi, on devait être là pour tous ces Kroha-là.
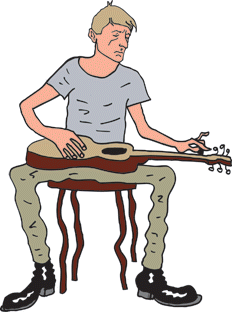
Un petit noyau de fans s’agglutinait au pied d’une scène anormalement déserte. Ce dénuement sentait le manque de moyens, pour ne pas dire la misère. Danny Kroha ne disposait en tout et pour tout que d’une vieille chaise, d’une guitare pas très fraîche et d’une set-list chiffonnée posée au sol. Il portait des biker boots en bon état, une chemise et un jean dans les tons gris clair relativement propres. Tout en lui exhalait l’aigre odeur de la précarité. Il inspirait ce profond respect qu’inspirent bien malgré eux ceux que le destin écrabouille et réduit à l’extrême pauvreté. Ah si seulement il avait pensé à poser un gobelet au bord de la scène, on lui aurait volontiers donné la pièce ! Même s’il paraissait en bonne santé et qu’il affichait une mine resplendissante, celle de l’étudiant américain à l’accent gras qui ne manque de rien, on ne pouvait pas s’empêcher de se faire du souci pour lui. Assis sur sa chaise, il semblait très absorbé. Il attaqua un set composé de blues acoustique, de gospel et de hillbilly particulièrement primitif, celui des habitants des cabanes croulantes typiques du Sud des États-Unis. On pense bien sûr à ces misérables métayers blancs que photographia Walker Evans en Alabama lors de la grande dépression des années trente. Ce Kroha-là cherchait surtout à montrer qu’il assumait la dureté de cette condition. Il communiquait très peu avec le public. Quelque chose de profondément touchant se dégageait du personnage. Il montrait aussi un certain courage, surtout lorsqu’il entonnait ses chants de gospel d’une voix forte. Au premier rang, une jeune femme pleurait, sans doute bouleversée par l’immense beauté de cette désespérance.

De cut en cut, ce Kroha-là semblait développer une sorte de grandeur expressive, même si en même temps il luttait pour éviter toute forme de dérive vers la démesure, ce qui est souvent le risque avec le gospel. Il luttait pour créer un climat et en même temps il veillait à le verrouiller, car il le voulait résolument austère, à l’image de sa condition et de celle des gens dont il relatait les histoires. Par moments, il atteignait à une sorte de grandeur fascinante. Eh oui, l’austérité peut parfois fasciner, ce qu’avait très bien compris Grant Wood lorsqu’il peignit American Gothic. Wood profita d’ailleurs de l’occasion pour transformer ce miroir aux alouettes qu’on appelle encore American dream en American nightmare.

À travers ses reprises de chants traditionnels, ce Kroha-là évoquait un monde qui n’en finira plus de nous échapper. Pourquoi ? Parce que nous avons été élevés dans une autre culture et engraissés sociologiquement parlant d’une toute autre pâtée. Les Français d’une certaine époque ont bouffé du de Gaulle pimenté de ratonnades, du Giscard à la sauce Bokassa, du Simca et du Guy Lux intérieur, du Sheilo et du Ringa à gogo, alors que Danny Kroha nous parle d’un monde de gens à la peau noire maintenus dans la misère et dans la peur, et nourris de boll wevill, de prêches de pasteurs évangélistes, de diddley bow et de la poussière des routes. Et surtout des anges du paradis, que les vieilles civilisations occidentales ont depuis longtemps chassés comme des malpropres, sous prétexte de progrès social. Et elles ont eu raison, ces vieilles civilisations occidentales ! Si elles disposaient d’une main au bout d’un bras, on irait la serrer chaleureusement pour dire merci. Les populations noires d’Amérique considéraient probablement la religion des blancs comme un refuge, ou tout au moins un bon ersatz de leurs croyances animistes, mais les populations blanches du vieux continent ont depuis longtemps rejeté cette institution religieuse qui au fil des siècles s’est défaussée du concept originel de la charité chrétienne pour s’adonner à tous les vices, à toutes les corruptions et à tous les excès de barbarie.

Alors bien sûr, cette musique traditionnelle attire les esprits curieux comme la lampe attire les papillons de nuit. On parle ici d’une espèce de curiosité intellectuelle, mais certainement pas de frisson épidermique, car le country blues primitif est d’une aridité exemplaire, contrairement au rockabilly primitif qui peut envoyer au tapis dès le premier round. Deux choses jouent cependant en faveur du country blues des origines. Le fait que cette musique soit difficile d’accès peut la rendre plus attirante. Il en va du blues comme des femmes. Celles qui commencent par se refuser se révèlent souvent par la suite les plus ardentes. Et la deuxième chose, c’est que ce blues extrêmement aride nous plonge le museau dans notre bêtise, ce fameux sectarisme qui depuis cinquante ans ronge le petit peuple rock comme une lèpre. À quoi sert la culture rock ? Mais à s’ouvrir au monde, comme toute autre forme de culture. Sinon ça n’a aucun sens. Profitons de l’occasion pour rappeler que nous devons absolument tout aux passeurs, à des gens comme Lux Interior ou Mick Farren, comme Sam Phillips ou Brian Jones, comme Tav Falco ou John Hammond, comme Kim Fowley ou Jeffrey Lee Pierce. Ce Kroha-là fait partie de ces gens-là. Il nous fait par exemple découvrir Frank Hutchinson à travers «Cannonball Blues», un extraordinaire blues traditionnel issu des temps les plus reculés. Hutchinson qui était un mineur établi dans les années trente en Virginie fut le premier musicien blanc à enregistrer du blues. Il composa surtout le fameux «Stagger Lee» que tout le monde ou presque allait reprendre. On retrouve bien sûr «Cannonball Blues» sur l’album solo de ce Kroha-là, «Angels Watching Over Me». Dans ses notes de commentaire, Dan précise qu’Hutchinson est l’un de ses all time favorites. Ce blues hanté rappelle bien sûr ceux du grand Robert Pete Williams, ce nègre à tête de saurien qui fascina tant Captain Beefheart.

Sur sa chaise, ce Kroha-là rendit aussi des hommages chaleureux à Charlie Patton et au pauvre vieux Son House qui en son temps grattait son dobro avec une violence terrible. En reprenant «Run Little Children», on voyait bien que ce Kroha-là recherchait l’hypnotisme du North Mississippi Hill Country Blues. C’était à la fois magnifique et taillé pour la route. Il n’en finissait plus de taper dans l’Americana des vieux pasteurs de l’Avant-siècle. Il revenait inlassablement à son cher gospel des cabanes et braillait «Holy Ghost Don’t Leave Me» d’une voix forte qui s’en allait résonner sous la voûte en pierre de la petite cave. Ce Kroha-là semblait assis parmi les peaux de castor, loin des églises inféodées au Vatican. Il réussissait le prodige de recréer l’atmosphère d’un bivouac de mineurs établi au bord d’un ruisseau de montagne. Les accents de sa voix forte charriaient l’écho du temps. Comme John Hammond avant lui, il tapa de bon cœur dans «John Henry». Il fallait le voir se battre avec l’insondable âpreté du primitivisme. Quelle admirable confrontation ! Ah mais quelle empoignade ! Il nous travaillait ça au corps à la manière de Son House et frappait ses cordes à la diable. Ce Kroha-là joua aussi pas mal de morceaux en slide, avec la guitare posée sur le genoux. Dommage qu’il n’ait pas pensé à apporter son banjo, car sur l’album des Anges, il en joue sur plusieurs cuts, à commencer par l’effervescent «Rowdy Blues». On l’y entend gratter son vieux banjo en peau de phoque d’Alaska. Oh, il faut voir comme il tape dans le dur du vermoulu de 1892, mais sa voix est nettement plus claire que celle de Bukka White. Ce Kroha-là travaille essentiellement la résonance. Il veille méticuleusement au grain du séculaire. Il nous gratouille aussi «I Want To Live So God Can Use Me» au diddley bow et au petit banjo vertueux. On l’entend aussi chatouiller le dulcimer dans «Walking Boss». Il en fait une fantastique pièce d’exaction concomitante boostée à l’hypnotisme blafard. Il reprend aussi le «You Got To Move» de Fred McDowell rendu célèbre par les Stones sur Sticky. Mais ce Kroha-là l’entreprend à la bonne franquette pour se rapprocher au mieux de la version originale. Il rend ensuite hommage à Dock Boggs, un banjo-man du blues complètement inconnu de nos services. Franchement, ce Kroha-là semble prendre un malin plaisir à saluer des gens terriblement obscurs ! Retour au gospel batch avec «Before This Time Another Year». Ce Kroha-là s’y comporte en troubadour de l’impossible. Il va bien plus loin que John Hammond, car il chante ça de l’intérieur du menton. Puis il réexpédie Blind Lemon Jefferson au firmament avec «Jack O Diamonds». Animal on est mal, comme dirait Gérard Manset. Quel beau disque !
Signé : Cazengler le Krohagnon
Dan Kroha. La Mécanique Ondulatoire. Paris XIe. 28 septembre 2015
Danny Kroha. Angels Watching Over Me. Third Man Records 2015
10 - 10 - 2015
HAPPY BAR / LE HAVRE ( 76 )
MIDNIGHT SCAVENGERS
THE MIDNIGHT HOUR
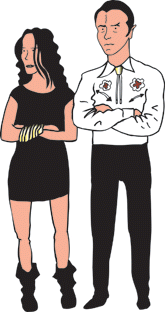
Quoi ? Les Midnight qui ? Ah les Midnight Scavengers ? Oh un groupe australien ? Hein ? Au Havre dans un bar ? De quoi ? Des histoires de Ghost Town et de péché ? Ah bon ? Avec une fille à la guitare ? What ? Faut les voir sur You-Tube ? Quoi ? Ils sont en tournée en Europe ? Ah bon ? Ils pourraient signer sur Closer ?
Pas de chance, le même soir à Rouen on avait les Hot Chicken en concert. Pas facile de prendre une décision. Pire que le Choix de Sophie. Prendre le risque d’aller bâiller aux corneilles devant une énième resucée de Birthday Party, un groupe qu’on a toujours franchement détesté, ou savourer la crème de bop des Hot Chicken à deux pas d’ici ?
Mais au fond, que serait la vie sans cette bonne vieille prise de risques ? On perd, on gagne, et puis voilà. En tous les cas, c’est une façon comme une autre de rester en vie.

Le concert avait lieu à l’Happy Bar, un endroit situé sur les quais. On entre, on tombe sur un bar et sur le côté se trouve une salle riquiqui, comme à l’Escale. Le groupe occupe la moitié de la surface au sol. Très peu de monde, comme souvent dans ces concerts havrais. Curieusement, les gens ne semblent plus vouloir s’intéresser à cette scène qu’il faut bien qualifier d’underground de l’underground. Dommage, car les Midnight Scavengers valent sacrément le détour. On a là un groupe solide, bien en place et qui en prime propose des compos déterminantes. Ils chantent la plupart du temps à deux voix. Ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, Blanche, un couple de Detroit qui faillit bien décrocher la timbale dans les années 2004-2007, avec un impressionnant mélange de Southern Gothic, de garage et de country déliquescente. Pourquoi Dan John Miller et sa femme Tracee Mae ne sont-ils pas devenus énormes ? Allez savoir ! L’infernal Jack Lawrence qu’on retrouve dans les mighty Greenhornes jouait aussi dans ce groupe qui disposait de tout l’attirail nécessaire pour créer l’événement. Il se pourrait bien que les Midnight Scavengers réussissent là où Blanche a échoué.

Car les Australiens disposent eux aussi de tout l’attirail nécessaire. Ce petit concert sans prétention fut une sorte de révélation. Et le diable sait si on adore les révélations ! Ces quatre Australiens de Melbourne savent créer des climats. Pour eux, c’est un jeu d’enfant que d’embarquer un public. Le groupe fonctionne sur deux pôles. Le +, c’est le pôle assis, le pôle mélodique et aussi le pôle du cap. Il s’appelle Dimitri Kucharzewski, Français installé à Melbourne, vêtu d’une chemise western blanche et installé derrière un piano électrique, présence sombre et voix bien posée, une voix bien à lui, qui ne doit rien à personne et surtout pas à Nick Cave auquel on serait tenté de le comparer. Non, il chante plus haut, il hante et il déraille quand il veut. Le pôle -, c’est le pôle debout, le pôle sauvage et féminin, le pôle grungy des crises de palu de distorse. Elle s’appelle Johanna Brockman, pur rock’n’roll animal, véritable graine de star, petite brune timide et en même temps blasteuse de haut rang. Elle porte des tas de bracelets, une petite robe noire et des bas filés. Elle chante d’une voix forte et rejoint Dimitri à l’unisson. Pour ceux qui se souviennent des leçons de physique, les deux pôles créent un courant électrique, ce fameux éclair jaune qu’on voit courir dans le laboratoire du docteur Frankenstein. La musique des Midnight Scavengers, c’est ce flux d’électrons, cet éclair jaune permanent. Cette fantastique dynamique électrise «Legitimate Desire», un cut qui sonne comme une cavalcade épique. Dans un monde normal, «Legitimate Desire» serait en passe de devenir un hit planétaire. Quand ils dépotent ça à l’Happy Bar, on peut bien dire que les colonnes du temple tremblent ! Et Johanna ressasse inlassablement le thème du cut avant de plonger le groupe dans la fournaise d’un solo de bouillasse à la distorse. «Legitimate Desire» est l’un de ces hits têtus qui rendent fou, qui frappent aux tempes, qui remontent à la surface du temps. Ah il faut voir cette diablesse poser son thème sur le beat sec et parfait du petit batteur aux cheveux noirs de jais. Quelle fantastique allure ! Ce groupe peut enfin jeter la lumière sur cet underground de l’underground si riche de bons groupes et que les medias ignorent par manque de curiosité, ou par incurie, on ne sait pas. Il est évident que ces Australiens vont sortir la vieille Europe de sa torpeur. Et c’est chanté à deux voix, comme porté au pinacle ! Et derrière, l’homme au chapeau joue ses lignes de basse avec l’efficacité d’un vétéran de toutes les guerres. On est à la fois content de voir ce groupe dans un bar minuscule, et triste pour eux, car franchement, ils sont de taille à remplir des grosses salles.

Ils ont un autre morceau très ambitieux, «Good As Sin». Ils l’ouvrent avec un chant de réparties. Elle sort une voix mûre et il rétorque d’une voix ferme, un brin nasillarde. Elle passe un solo en note à note et soudain le tempo s’emballe et c’est la violente embardée d’un embarquement pour Cythère. Tout le monde à bord ! Par leur bouillon d’énergie, ils font grimper la chose au sommet d’un Everest et Johanna joue des gimmicks fonciers qui enfoncent les poternes des badernes avec une niaque qu’on n’avait plus revue depuis les grandes heures du «Blue Line Swinger» de Yo La Tengo. Ils sont terrifiants de drive. Ils déploient des trésors de pop imparable. Ils tapent dans l’excellence d’un beat pop défiant toute concurrence et c’est monté sur le drive d’un chapeau-man qui ne paie pas de mine mais qui joue comme une bête. Ses lignes de basse croisent dans le lagon comme un requin alors qu’autour de lui charge la Brigade Légère. On voit rarement des épisodes aussi intenses. Pour ceux qui auront la chance de choper l’album, c’est l’un des dix hits qu’on y trouve. L’autre monstruosité du set s’appelle «Sweet Soft Pearls», un cut qu’on croit d’abord suspendu, puis qui plonge dans un absolu de son, mais un son plein à la Mary Chain, une overdose de son terrible et sans retour possible. Il s’agit là d’une motherly atmosphère d’hallucination territoriale bien amenée aux raindrops et au chant d’augure lugubre complètement implosé. Et cette diablesse de Johanna rentre là-dedans au note à note, eh oui, elle va chercher des notes magiques et elle en claque même à vide, elle joue ça au tatata de fil terrible. C’est du pur jus de Grasshopper, elle renoue avec la magie des solos de «Deserter’s Song», qui en 2008 ont infesté l’Elysée Montmartre. On se gave aussi du fameux «Ghost Town» d’obédience gothique. Dimitri plonge dans le gothique spectral et induit un bel échange à deux voix. Et comme pour les autres cuts, ils font vite monter la température, ils stupéfient par leur maîtrise de l’unisson et ça explose littéralement au retour de couplet. En voilà deux qui savent maîtriser les orgasmes, car ils repartent de plus belle. Ils fouaillent l’atmo et Dimitri lâche un jive de jazz dans l’épaisseur du groove alors que Johanna gratte ses power-chords de Jaguar à la ramasse de bas filés. Ils s’intériorisent complètement dans leur son et leurs retours de couplets ne pardonnent pas - Keep shaking till the sun - Écoutez aussi sur l’album «Old River» et sa merveilleuse ambiance plombée au stoner gothique d’apocalypse. Ils amènent ça comme la rivière sans retour, glacée de son grandiose. On dirait même qu’ils chantent dans la crypte du néant. Mais là, ils se condamnent à la glaciation éternelle. On se réchauffe avec «Remember Me», un country-rock chanté à deux voix et soudain Johanna part en virée. C’est du pur jus, ils renouent avec l’art sacré de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

Curieusement, chacun de leurs morceaux accroche. Chacun d’eux semble gonflé de toute la puissance du diable. Ils jouent aussi deux ou trois cuts garage, comme «Run On», et c’est Dimitri qui drive the beast. Même chose pour «Two Legged Rat», que Johanna attaque au grunge de jag, doublé par un drive puisant de Jeff Hooker, alias chapeau-man - Oh no ! Dimitri se bat avec les démons, c’est accablant de mortiférisme et Johanna claque les accords les plus violents d’Australie. Ils ne lâchent rien ! On a là une pétaudière, mais ça ne suffit pas, car Dimitri tire ça vers le haut, il a encore cette énergie. On n’a pas idée.
Signé : Cazengler, midnight remblais
Midnight Scavengers. Happy Bar. Le Havre (76). 10 octobre 2015
Midnight Scavengers. Midnight Scavengers. Kasumuen 2015
17 / 10 / 2015 – COUILLY-PONT-AUX DAMES
LOCAL METALLIC MACHINES
HOT CHIKENS

La teuf-teuf ronronne comme un cou-cou suisse. Bercé par le ronronnement régulier de la machine, mon esprit s'évade vers les hautes sphères de la méditation philosophique. Démarche hautement platonicienne qui entrevoit toute connaissance comme un érotologie infinie tendue vers le désir de son accomplissement. En réalité je peste contre les fonctionnaires de la DDE. Nous sommes à trois kilomètres de Couilly-Pont-Aux-Dames et nous n'avons encore rencontré aucun panneau arborant fièrement le nom si jouissif de cette localité. Perso, je l'imagine calligraphié sous différentes formes, en bâtonnets sucre d'orgie romaine, en rébus vent Dubout Albert, en idéogrammes chinois suggestifs, en haiculs japonais poétiques, cette saine lecture vous obligerait à modérer votre vitesse bien mieux que ces radars qui réfrènent vos élans. Evidemment ce serait moins rentable pour l'Etat. En attendant le mieux à faire c'est d'arrêter d'appuyer sur le champignon hallucinogène. Vincent. Car tous les chemins mènent à Rock, me dis-je. Et ce soir, ce n'est ni aile ni cuisse de poulette grillée au menu, mais du Hot Chikens torride à dévorer, bien chaud et bien saignant.
Retour au local Metallic Machines. Cheval de fer, cheval d'acier. Accueil convivial et sympathique. Une sacrée brochette d'amateurs de rock and roll. De nouvelles têtes aussi. Qui sont manifestement venues par ouï-dire – cet autre nom de la renommée – et qui ne savent pas dans quelle fournaise elles ont posé le pied.
CONCERT
Pour le moment c'est tranquille. Thierry Sellier attend placidement derrière sa batterie. Kit grenat minimal, mais costume marron du dernier chic anglais, gros noeud de cravate du dimanche, la french touch. Hervé Loison– vaste veste noire qui cache une chemise rouge sang, caresse gentiment son micro. Le public s'agglutine. Comme à la messe quand le prêtre a déclaré qu'au lieu de l'hostie traditionnelle il distribuerait des choco BN. Jamais deux cent trois. L'en manque juste un. Le guitariste – dont l'absence se remarque très vite dans un groupe de rock. Mais Christophe Gillet se fait attendre. Trente secondes passent, assemblée rieuse. Aux grands maux, les grands remèdes. Sans prévenir, Hervé avale le cromi, d'un seul coup, le coince au fond de ses amygdales et lance le cri de ralliement, l'appel au secours, le borborygme guttural si particulier du poulet vivant que la ménagère enfourne dans le four brûlant. Comme par magie Christophe apparaît, à grands pas il fend la foule, tenant entre ses mains le précieux graal d'un gobelet de cervoise rempli à ras bord. Je ne sais si c'est en l'honneur du patelin, mais le haut de sa chemise est divisée en petits carrés noirs et blancs, un damier idéal pour jouer aux dames. Ceint sa guitare yin, blanche à pickguard noir, la yang noire à pickguard blanc restera toute la soirée à côté de lui sans qu'il s'en serve une seule fois. N'aura pas le temps. J'insiste un peu sur le début parce qu'après les images se télescopent dans la tête des témoins. Je parle des rares survivants qui ont su garder dans le brainstorming musical qui a suivi quelques rares parcelles de neurones mémoiriels en état de marche. Le temps qu'Hervé s'empare de sa big mama et. Un peu de patience. Me faudrait être Victor Hugo et vous composer un poème de trois cents alexandrins pour vous la décrire. Elle le mérite. Une véritable veuve noire. Ne pleurez pas pour son mari. C'est elle la morte. L'a dû faire toutes les guerres du rockabilly. Plus celles du psycho. Plus celles du punk. Imaginez une longue caisse aussi funèbre qu'un cercueil, au contour rehaussé d'un filet blanc. Mais en sale état. Fendue en plusieurs endroits. Vu les entailles, ce doit être à coups de hache lors d'abordages particulièrement mouvementés, par une houle de force 10, comme l'on prévient dans le bulletin de la météo marine. L'est tatouée d'inscriptions au blanco qui doivent remémorer de hauts faits d'armes prestigieux. Ou à venir, car l'on y déchiffre sans difficulté la date d'anniversaire des quarante ans de la mort du Hillbilly Cat. Toutefois contemplant l'état des dégâts, Hervé compatissant laisse tomber une sombre prophétie empreinte d'une immense sagesse : « M'étonnerait qu'elle soit encore là en 2017 ! ».

La question qui ne se pose pas. Vous aimez Gene Vincent ? Autant demander à un chat s'il aime les souris. Ce soir les Hot Chikens seront terriblement rock. Gene Vincent, Johnny Burnette, Little Richard. Que des reprises. Oui mais à la sauce Hot Chikens. La recette est simple. Vous croyez connaître. Vous allez les découvrir. Sont trois mais ne se partagent pas le travail. La règle est simple, je fais tout le boulot, et quand j'ai terminé je recommence. Au fond, au milieu, derrière ses lunettes, Christian ricane. Ses baguettes ricochent sur la caisse claire et immanquablement elles finissent par se jeter sur les cymbales. Pas à cinq balles la paire. C'est la section cuivre des Hot Chickens, pas de vent mais le tonnerre avec les éclairs qui fusent. Ça ne rutile pas dans le futile. Des vibrations qui vous fusillent le tympan, mais vous n'avez pas le temps de devenir sourd, la grosse caisse est là pour vous déboucher les oreilles. Thierry se marre, hilare du début à la fin du concert. S'amuse comme un gamin qui lance des pétards le soir du quatorze juillet. Ce qu'il y a de terrible avec lui, c'est que quand vous croyez être au bout du break et déjà sur le générique de fin, il vous repasse la séquence en accéléré, des fois que vous auriez tout compris et manière de vous donner un autre aperçu de la réalité du monde.

L'on aurait envie de le plaindre, mais il en s'en sort comme un roi. C'est quoi un bon guitariste ? C'est un gars comme Christophe. Un peu comme le Dupin d'Edgar Poe, qui vous résout les intrigues les plus mystérieuses, celle de la Lettre Volée, celle du Double Assassinat de la Rue Morgue, sans quitter son bureau. Méthode efficace. Une difficulté, un plan. Une deuxième difficulté, deux plans au choix. Et ainsi jusqu'à plus soif. Suite exponentielle. Lui il choisit la résolution qui vous semblerait la plus hasardeuse. S'en moque. Est sûr de lui. L'a de la marge. Pas le genre de gars à vous resservir les solutions toutes faites de Cliff Gallup, sur I Flipped, par exemple. Non, possède ses propres clefs. Qui s'adaptent aux serrures les plus étroites. Vous réalise deux ou trois petites performances par morceau. Comme si de rien n'était. Des évidences qui vous laissent coi. Qui vous laissent quoi ? Vos doigts pour pleurer.
Faut les voir ces deux oiseaux de bonheur. Les ai particulièrement appréciés sur les deux morceaux les plus erratiques de Little Richard, True Fine Mama et Rip It Up, deux calamités, deux fils du Nyarlathotep, le dieu du kaos rampant cher à Lovecraft, deux bordels généralisés qui s'effondrent de tous les côtés, faut le génie du Petit Richard pour ramener les débris à la maison, et vous les recoller comme neufs à la sécotine atomique. Vrai qu'Hervé les aide, à la voix et à la contrebasse. L'a l'intelligence des morceaux dans sa cabosse, sûr qu'il sait rouler sa bosse, mais sans Thierry la terreur souriante qui casse, qui fragmente, qui pile, qui brise, qui éparpille la vaisselle et Christophe qui classe méthodiquement les tessons sur l'étagère comme s'il était le Conservateur en Chef du département des Antiquités du Louvre, que ferait-il ?

Je laisse la question sans réponse car c'est Hervé qui nous pose la sienne. Aurions-nous besoin d'une pause, le temps de nous ravitailler au bar, ou préférerions-nous rajouter tout de suite à cette heure et demie de tonitruance monstrueuse une deuxième section d'une heure trente ? Précision, pas un truc à la bis repetita placent. Non, un fuckin rockin set de tous les diables. La réponse est unanime : deuxième rasade de concentré de hot dose de rock and roll illico presto subito expresso bongo.
C'est vrai que Monsieur Loison a été très sage jusqu'à maintenant. L'a juste porté le set sur ses épaules, et avec les deux cadors à ses côtés l'ensemble doit être particulièrement lourd. Mais enfin, il n'a fait que son devoir de rocker. Tirer sur les cordes de la big Mama comme s'il voulait arracher les poils du pubis à sa fiancée pour qu'elle paraisse encore plus nue, et s'adonner à de copulations orales avec son micro poisseux, tout en éructant ses volcaniques lyrics destructeurs. Va falloir maintenant entrer dans le vif du sujet.

L'est temps de s'intéresser à l'autre face du rock and roll. La noire, celle de l'origine. Le blues. Une autre particularité d'Hervé Loison, préfère le Delta au Chicagoan. Pas de panique je n'ai pas dit que l'on allait verser de souffreteuses larmes amères sur le bois d'une guitare sèche. A l'humidification pleurnicheuse, notre chanteur préfère l'électrification ravageuse. D'ailleurs il jette sa contrebasse à terre et s'empare d'une basse électrique. Priez pour elle. Pour nous aussi. L'esprit du vaudou est sur nous. Tous les crotales du Delta sont parmi nous. Loison est à terre. N'est plus lui-même, l'est le Baron de ce Samedi soir. La force est avec lui. Il est le crachat et l'exaspération, la rage et la folie, le blues de la glaise à la puissance mille, il miaule dans son harmonica, feule, grogne, craquète, aboie, berseker chamanique de la transe totale, n'est plus que le réceptacle de forces animales qui le dépassent. Qui nous envahissent. Se vautre sur sa contrebasse comme un reptile lubrique, agonise sur les planches, l'on se précipite pour lui faire ingurgiter des verres et des verres de sky, il est nous et nous sommes lui, se relève pour un vincenal Baby Blue que toute la salle reprend en choeur, nous appelle pour qu'on soit ses clappers boys sur un dantesque Five Feet of Lovin, et puis satyre dionysiaque infatigable il ameute toute la gent femelle – qui succombe sans hésitation - à le rejoindre sur scène, l'est là, pantelant, torse dénudé, Orphée parmi les ménades, micro, chant et harmonica en bouche, son pied slidant sur la basse aux mains de la blonde Béatrice, et puis se relève, lui arrache la guitare et la fracasse sauvagement sur le rebord de la scène. Ce n'est pas fini, se jette comme une victime expiatoire dans nos bras levés et nous le promenons bien haut comme l'image de notre folie au travers des deux pièces du local. Eric des Crazy Dogs se charge de la contrebasse pour les derniers morceaux. Encore une longue psalmodie incantatoire aux esprits totémiques de la terre du blues, qu'il voudrait finale, mais qu'il devra réitérer en guise de rappel. Intercalé l'on aura une gâterie, un Rumble, dumble, scrumble pas du tout humble sur la guitare pétaradante de Christophe Gillet. Merci les Hot Chikens. Ce soir la houle du rock and roll et la goule du blues ont fusionné.

APRES CONCERT

C'est fini, mais tout le monde restera là plus d'une heure, devant la scène à discuter avec les trois riffeurs du diable. Regards radieux et éberlués de ceux qui viennent d'assister pour la première fois à ce rite catharsique qu'est un véritable concert de rock and roll. Se pressent autour de la valise à disques. Ont envie d'emporter chez eux, chez elles, un éclat de cet instant, un témoignage de ce qu'ils ont touché à une autre dimension. Gonna Have Some Fun Tonight comme aimait à le répéter Mister Penniman.
Damie Chad.
P.S. : mention spéciale à Mister B qui profite de l'occasion pour tenter le riff de Maybe Baby du sacré compagnon Holly Buddy ( les Chikens Chauds, nous ont offert deux extraordinaires Rave On et Oh ! Boy ! ) sur la Big Mama d'Hervé.
( Photos sur FB Sonia Amandine Couronne et Christophe Banjac )
RAW POWER
UNE HISTOIRE DU PUNK AMERICAIN
STAN CUESTA
( Castor Astral / Octobre 2015 )
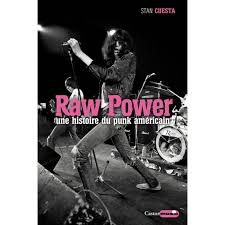
Ce n'est pas bien gros, vous le dévorez en une soirée. A peine cent cinquante pages petit format, on a rajouté une chronologie et un index – le genre de truc indispensable – et l'interview de Lenny Kaye - c'est un peu le chouchou de notre cicerone - in-extenso alors qu'il est abondamment cité dans le corps du récit. Mais c'est un must. Comment Stan Cuesta a-t-il réussi l'impossible : tout dire en ne rapportant que l'essentiel ? Un bouquin d'une limpidité extraordinaire, clair comme de l'eau de rock. Buvez à cette source vous aurez l'impression de devenir intelligent.
Stan Cuesta pose une seule question : qu'est-ce que le punk ? Et contrairement à ce à quoi l'on s'attend d'habitude, il donne la réponse, la bonne. Celle que vous ignoriez. Votre cerveau vous a déjà fourni une fiche : mouvement musical d'une extrême violence naît en Angleterre. Tsseu ! Tsseu ! Appel discret du pied les gars, le sous-titre c'est bien punk américain, alors les Pistolets du Sexe que vous vous apprêtiez à dégainer, rentrez-les dans votre braguette. Sortez les rames et souquez ferme, direction America the great.
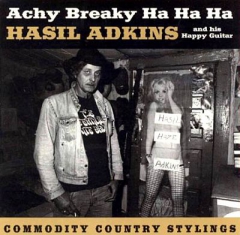
Inutile de vous arrêtez à New York, le départ est donné in the South, et dans un temps beaucoup plus lointain que vous ne l'espériez. Car le punk en tant que lui-même, Stan Cuesta il s'en moque autant que de son premier bretzel au beurre de chèvre naine cuit à la vapeur, lui ce qui le motive, c'est l'esprit du punk. Hautement plus difficile à entrevoir. Enfin pas vraiment, selon lui le punk est né aux doux temps du rockabilly. Tous ces jeunes qui du jour au lendemain se sont lancés dans la musique comme on se jette de la fenêtre du troisième étage, sans réfléchir, just for fun, certains sont même parvenus à enregistrer un éphémère, un single, qui a fait quarante-cinq tours sur le pick up de la gloriole avant de disparaître à jamais. N'y a plus que les collectionneurs fous qui recherchent ce genre de pépites ( nuggets in the Lenny Kaye translation ) aujourd'hui. Pas si déments que cela car parfois ce sont de véritables perles. En souvenir et en hommage à cette génération perdue, le livre est dédié au plus dangereusement dingue de tous. Un des rares qui a persévéré dans l''erreur jusqu'à sa mort : Hasil Adkins, le saint patron du punk !

Le FBI n'a pas dormi longtemps sur ses oreilles. Z'avaient réussi à juguler le rock sauvage des pionniers, l'on aurait pu croire que la marmaille américaine oublierait rapidement leurs idoles hurlantes. Avec le sirop vaporeux que leur desservait la TV, les stratèges de la sécurité intérieure avaient cru s'être débarrassés de cette improbable nichée de monstres. Il n'en fut rien. Pire que les têtes de l'Herne. Les combos rock se sont mis à proliférer. Partout. Mathématiquement l'équation était facile à résoudre : un garage ( et le Dieu de la Sainte Bible sait combien les américains étaient, in the fifties and in the sixties, entichés des grosses bagnoles ) abritait obligatoirement un groupe de rock. Ce fut l'époque bénie des garage-bands. Des gamins qui ne savaient pas jouer mais qui avaient compris que cela vous posait un max devant les filles. Il y en eut des dizaines de milliers. Tous aussi mauvais les uns que les autres. Mais ô combien jouissifs ! Un déluge sonore ! Un peu chaotique pour le rythme, ce n'étaient pas des experts, ça batifolait dans les entournures, tout comme Louie Louie l'hymne garage par excellence, une zidouille cahotique, une galette infâme qui confine au génie pur. Nous sommes en 1964, et tout le monde écoute les Kingsmen.
LES AÎNES PRESTIGIEUX

Certains sont meilleurs que d'autres. Peut-être un peu plus persévérants. Ou alors tombent pile à l'endroit adéquat. Ce fut le cas du Velvet Underground. Qui eut la chance d'être pris en charge par Andy Warhol. Ce n'était pas qu'Andy possédât des idées nouvelles sur l'avenir du rock and roll. Du moment que le Velvet fît un scandaleux boucan de tous les diables lors de ses soirées publiques ou privées, il n'en demandait pas plus. Mais ce faisant il fit un merveilleux cadeau au rock and roll. De par sa caution, cette musique de prolétaires recevait ses lettres de noblesse. Le rock devenait Arty. Avait changé d'étage en montant les escaliers de la Factory. Le Velvet s'engouffra dans la brèche. Commença par renvoyer la belle Nico. Un charme vénéneux notre starlette qui flirtait déjà avec le statut du has-been, mais le groupe avait compris qu'il fallait du rentre-dedans. Ce fut la folie noire, la descente aux enfers, White Light, White Heat, l'album incandescent. Le dérèglement de tous les sons. La suite s'effilocha, le violon meurtrier de John Cale prenant trop de place, Lou Reed le vira et le Velvet Underground joua beaucoup plus sur son côté velours que sur son aspect souterrain très dostoïevskien.

Inutile de verser d'amères larmes, la relève était assurée. Non plus à New York ( trop bobo avant l'heure ) mais à Detroit. Le MC 5, genre cocktail molotov. Des diatribes incendiaires contre la guerre au Vietnam, une préférence marquée pour la révolution – très politisé, le MC 5. Mais ce n'était qu'un trompe l'oeil. Le MC 5 fut le premier groupe qui s'arma de guitares électriques. Les Stones avaient donné le la, l'année précédente avec cette fuzz box qui remplissait les sillons de Satisfaction d'un incroyable dégueulis de guitare, mais les MC 5 changèrent le fuzzil d'épaule, avant eux l'on n'avait jamais entendu cette jamborée de guitares à fond la caisse plate, rugissantes comme un moteur de tronçonneuse. Vous étiez sonnés comme un boxeur dans les cordes. Le premier disque des MC 5 est une déclaration de guerre.

Difficile de faire mieux. Alors les Stooges firent aussi bien, mais différemment. A première oreille, aussi frappés que le MC 5, mais à la deuxième écoute plus subtils. Je sais qu'il peut paraître primesautier de vanter la subtilité tsunamienne de Fun House. Mais Iggy et ses camarades n'avaient pas bavardé avec John Cale pour rien. Les Stooges c'est le MC 5 plus une gousse de Musique. Avec un M majuscule s'il vous plaît, cette musique classique qui est passée par les orgies sonores des tentatives phoniques du futurisme, et qui s'est accoquinée avec une pulsation jazz, entendue non pas comme une habileté concertante de musiciens doués, mais comme l'expression métaphysique de dépassement des frontières humaines, A Love Suprême à la Coltrane.
NEW YORK

Retour à la capitale artistique. Ne s'y passe rien. Les sixties sont terminées. Les seventies démarrent mal. Calme plat. N'exagérons pas. Les Rolling Stones américains sont en répétition. Pour bien marquer leur appartenance se sont appelés les New York Dolls. Au MC 5, ils ont emprunté les guitares. Aux autres ils n'ont rien pris. C'est le public et les journalistes qui vont les habiller. Eux, qui adorent les sapes et l'épate se sont déguisés en filles. Maquillés à outrance. Sans le vouloir ils percutent les intellects endormis, sont considérés comme des passeurs vers une modernité trans encore dans les limbes. Ces rockers sont des artistes visionnaires. Ce sont les proto-punk, les premiers punk, une musique sauvage avec un arrière-fond plus ou moins philosophico-nébuleux.
Le grand public américain ne les snobera même pas. Ne les connaît même pas. C'est un anglais qui comprend la hype avant tout le monde. Malcolm McLaren se dépêche de rentrer en la perfide Albion, vite, vite, il fonde un groupe sur le modèle de nos new yorkaises poupées. L'histoire des Sex Pistols est connue. Mais McLaren n'était pas revenu les mains vides in London. N'avait pas regardé que les Dolls. Toute une scène se mettait en place in the big apple.
ENFIN LES PUNKS !
Ouf, ils arrivent, les vrais de vrais, ceux qui bénéficient de l'appellation authentique. Tous ceux que nous venons de voir ne sont que des prémonitions. Et attention pas du rosbeef en tranches assemblées in the old England, non de la bosse de bison véritablement native. Quand on n'en a jamais mangé, le goût surprend toujours. Le punk américain est étrange. C'est comme les champignons, vous les trouvez dans les endroits les plus incongrus et les saveurs sont multiples.

Y a ceux qui correspondent aux poncifs comme deux gouttes d'eau. Les Heartbreakers qui ne sont que la suite logique des Dolls qui ont splitté. D'ailleurs ils sonnent comme les Dolls mais en mieux. Plus électriques, plus brillants, plus rapides, plus rock que tous les autres. Les punks anglais ne rateront pas un de leurs concerts lors de leur venue en vieille Europe. Ils sont les maîtres et les autres les élèves. De pâles épigones.

Dans la série, plus punk que moi tu es déjà mort, voici les Ramones. Jouent vite et fort. Aucun mérite, ne savent pas faire autre chose. Oui mais ils ont l'énergie. A revendre et il leur en faut pour leur parti-pris minimaliste. Blousons noirs et jeans troués, nous sommes loin des oripeaux et des colifichets des Dolls. Pour la musique, des morceaux de moins d'une minute avec des paroles bâtie sur le même modèle. Plus tard ils s'embourgeoiseront, ils atteindront les cent vingt secondes et perdront un peu de la flamme de leurs débuts.
On ne les attendait pas, mais font partie de la mouvance punk depuis le début. Ce sont les anti-Ramones des musiques raffinées et une superbe minette blonde au milieu. Blondie, ne donne pas dans le côté rustauds des cités. Sont des artistes, des vrais. Et en cela, si près de l'essence du punk américain mais déjà estampillés de l'appellation New wawe.

Le punk américain, c'est en même temps et les guitares qui hurlent et l'attention soutenue à la poésie. Patti Smith sera l'anti-Blondie, elle est brune et a des poils sous les bras. Mais n'a rien à voir avec un camionneur. Une sensibilité de poète, elle écrit, elle récite ses textes, elle est prête à toutes les dérives musicales, elle sait très bien s'entourer, d'Alain Lanier du Blue Öyster Cult, de Fred Sonic Smith du MC 5, de Tom Verlaine, de Lenny Kaye et de Richard Hell. Elle aime le rock qui déjante et Arthur Rimbaud, elle établit au travers de sa personne le lien avec les générations hippie and beat d'Alain Ginsberg
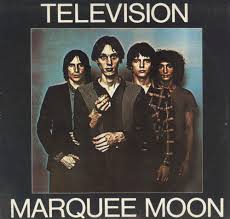
Mais c'est sans doute avec Richard Hell que le punk américain touche à sa plus grande extension. Chanteur, compositeur, écrivain, acteur, fera partie de Television, des Voidoids et des Heartbreakers. Pourrait être considéré comme l'idéologue du punk, mais qui n'aurait jamais prononcé une seule généralité, adonné aux actes et aux expériences. Les épingles double, les T-shirts déchirés du punk, c'est lui. Des inventions davantage suscitées par les aléas de la vie que par l'envie de choquer.
BEFORE AND AGAIN

Stan Cuesta en passe un plein paniers d'oeufs cassés en revue : Suicide, Modern Lovers, Dictators, Rockets From the Tombs, Seeds, Fugs, Talking Heads, Pere Ubu, Devo, le punk se mord la queue et s'éloigne de lui-même, se perd, se renie, se redécouvre... Pour tout comprendre, pour ne pas céder au chaos, suffit de suivre notre auteur, tire les fils et tisse des généalogies très signifiantes. Pour notre part nous finirons sur deux emblèmes : les Cramps en tant que retour foutraque au rockabilly, et X comme ouverture à tous les horizons passés et futurs du rock and roll. Le yang et le yin. L'oeuf et la mayonnaise. L'abominable et l'homme des neiges éternelles.
Damie Chad.
HEURT LIMITE
RECIT INCANTATOIRE
JEAN-FRANCOIS JACQ
( L'Harmattan / 1997 )

Jean-François Jack n'est pas un inconnu pour les fidèles lecteurs de KR'TNT ! L'est l'auteur du super beau livre Bijou, Vie Mort et Résurrection d'un Groupe Passion. Preuve que c'est un homme de goût. Quoiqu'il ait consacré un autre de ses ouvrages Le Soleil Noir du Rock Français à Olivier Caudron chanteur du groupe Lil Drop que pour ma part je rangerais dans le rayon variété... L'a une belle plume et j'avais alors ( livraison 145 du 15 / 05 / 14 ) promis de farfouiller quelque peu dans sa bibliographie. Donc acte.
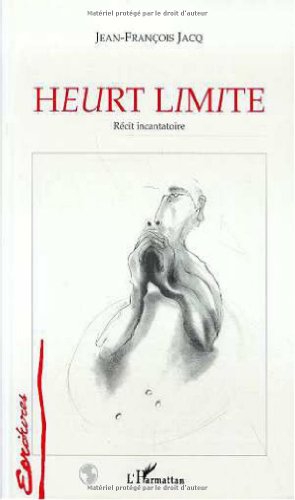
C'est l'histoire d'un homme qui court. Vers le centre de sa vie. Vous le suivez, ou plutôt il vous emporte sur son passage. Imaginez un film dont la caméra s'occuperait uniquement de l'acteur. Filmé au plus près. Pour les décors, vous vous débrouillerez comme vous pourrez. Sont absents. Invisibles. Le réalisateur opère seul. A supprimé tout ce qui est secondaire dans une vie. Les lieux, les évènements, les noms, les personnes. Une histoire sans comparses. Tout se passe dans la tête. Le cerveau fait office de filtre et de bouchon. Empêche le monde de rentrer, et le moi de se diluer dans le spectacle de l'univers. Aucun risque de vous ennuyer, le corps est mal bâti, mais la tête est bien pleine. D'une blessure sanguinolente, qui suppure indéfiniment. Notre arrivée au monde n'est pas une partie du plaisir. Nous arrivons ici-bas dans un flot visqueux de liquides amniotiques, de souffrances, de sang et de merde. Les individus normaux s'en détachent au plus vite. D'autres sont comme les poussins maladroits qui ne parviennent pas à se séparer de la coquille brisée qui leur reste collée sur la tête. C'est ainsi, le monde est peuplée d'injustices et pour certains la plus grande d'entre elles résident dans le simple fait de vivre.
Donc un homme qui rentre au plus profond de lui-même. Ne parlez pas d'introspection artistique. Aucune pose masochiste, aucun penchant décadentiste dans ce qui n'est pas une démarche, mais une course folle vers la mort. Parfois la vie est si dure qu'il vaut mieux chercher refuge dans le seul bunker délabré qui s'offre à nous : nous-mêmes, notre esprit, notre âme – appelez cela comme vous voulez – même si notre refuge est percé comme une passoire, comme un coffre-fort, comme une vieille durite pétée. S'arrêter, se fixer, équivaudrait à mourir. Cette fuite en avant en soi-même n'est pas un choix mais une obligation êtrale. Pas question de jeter l'ancre. Une seule solution laisser filer l'encre sur le papier. L'unique échappatoire est là, comme une artère tranchée qui pisse de tout son sang. Ecriture rouge pour une existence noire.

L'a pas trouvé le bonheur en débarquant dans notre monde Jean François Jacq. N'est pas le seul, il y en eut d'autre avant lui, et des plus prestigieux qui se sont fadés les chiennes hécatiennes de la maladie, de la souffrance, et les morsures de la plus cruelle de la meute impitoyable, cette dangereuse inaptitude à vivre qui vous pousse dans les derniers retranchements de votre corps. Ont des noms qui sonnent comme des défis, l'Antonin Artaud du Pèse-Nerf ou l'Arthur Rimbaud d'Une Saison en Enfer. C'est dire combien l'écriture est rabotée jusqu'à l'os, qu'entre la membrane du rêve et la matière osseuse il ne reste rien, ni la peau, ni la chair. Vraiment pas de veines. Et pourtant cette absence qui fait si mal.
Pour l'itinéraire nous lâcherons les grands mots, la maladie, l'enfermement, l'hôpital, la mort, le sexe, l'errance, la rue, l'alcool, la solitude. Beau tableau, de quoi noircir la page blanche du vide infini. Les situations se répètent, pas d'issue au labyrinthe, obligé de tourner – non pas en rond, ce serait trop facile – mais en spirale, jusqu'à vriller la paroi de l'isolement et parvenir à disjoindre les panneaux de votre finitude. Attention danger : s'extirper de la misère métaphysique de l'Homme pour se colleter à la déréliction du monde n'est pas non plus une solution merveilleuse. A croire que les deux tares congénitales de l'ère conjuguent leurs efforts pour vous persuader qu'au-dedans comme au-dehors il n'y a pas davantage de joie, rien de mieux à espérer. C'est ainsi que l'on devient fou, mais c'est l'ultime claustrale self-made-man enclosure que Jean-François aura refusée. S'est battu pour sortir de ce tourbillon fatal, se cramponner à une planche de salut, un débris du naufrage généralisé de la vie. Est parvenu à se hisser sur un frêle radeau, n'imaginez rien de rose, la main secourable qui se tend vers vous pour vous hisser hors de l'abîme juste deux secondes avant l'engloutissement. Non la seule personne qu'il ait trouvée, c'est lui-même. Il faut compter sur ses propres faiblesses. Difficile, mais ne pariez que sur vous-même.
Une chambre à soi, juste pour recomposer le puzzle de la scène initiale, je ne vous la raconte pas, à peine le début, dans un cimetière. L'on est près de Marthe et l'Enragé de Jean de Boschère. Lisez, vous comprenez pourquoi le Boschère a passé le reste de sa vie à écrire sur la beauté des fleurs et le chant des oiseaux. Quand l'humain est trop humain, vaut mieux aller voir ailleurs. Pour Jean-François Jacq, le salut viendra du noir. Désormais il noircira les pages. Trouve enfin une béquille hors de soi qui lui permet de se tenir droit. N'en est pas pour autant un handicapé de l'existence, c'est un miroir sur lequel il s'appuie. Se penche dessus et l'image de lui-même qu'il y entrevoit n'est pas tendre. Sombre figures de mots aux éclats aussi perçants que des éclats de verre ensanglantés. D'ailleurs le livre suivant se nommera Hémorragie à l'Errance. De la suite dans les idées, sang unique. Voir chronique ci-dessous pour ceux qui aiment la littérature.
Un livre poésie, dénué de toute anecdote. Respect infini devant la beauté de l'écriture et cette démarche qui ne triche pas avec le réel. Tauromachique, mais le toréador qui porte les estocades est aussi le taureau
Damie Chad.
HEMORRAGIE
A L'ERRANCE
genèse
JEAN-FRANCOIS JACQ
( L'Harmattan / 2012 )
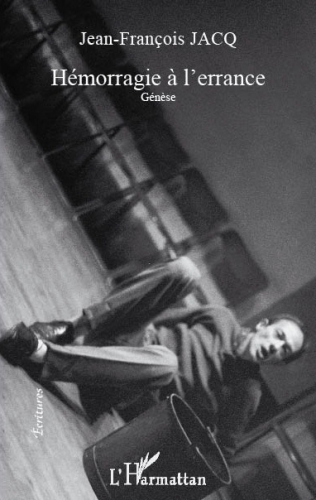
Des histoires qui ne s'achèvent jamais. Quand bien même seraient-elles terminées depuis très longtemps. Obsédantes. Des fantômes qui vous hantent. Reprendre la piste, remettre ses pas dans ses propres pas s'avère une nécessité. Pour mieux mesurer l'écart effectué, pour mieux s'assurer que l'on ne cauchemarde pas, que l'on a bien suivi de telles pistes. Hémorragie à l'Errance raconte la même histoire que Heurt-Limite. Sous un angle d'autodéfense différent. L'est des choses qui sont difficiles à dire, alors dans un premier temps l'on utilise l'ouate et le scalpel de la poésie. On coupe à même les chairs, l'on empêche le sang de couler avec un gros tampon de coton. L'on a rien d'autre. L'on évite la gangrène, la pourriture, l'anéantissement. L'on se sert de mots qui dévoilent et qui voilent en même temps. L'on en dit le maximum en essayant d'en proférer le minimum. L'on se berce de paroles, l'on chante sur les plaies comme le vol du corbeau sur les eaux du déluge. Cela nettoie et cela soulage. Mais l'hémorragie, l'hémorage se remet à suinter. Jusqu'au jour où l'on a le courage de reprendre le mal à sa racine. L'on n'explore plus les mots, l'on se contente de nommer et de dénombrer les séquences du réel par leur véritable nom. Regard aigu sur la blessure intarissable.
Jean-François Jacq se raconte. Tout. Pas de zone d'ombre. Une enfance, pire que sans amour. D'indifférence. Tout de suite, le puits de la solitude. N'en sortira plus jamais. Tentera plusieurs fois de remonter vers la margelle et l'air libre. Toujours quelqu'un, toujours un enchevêtrement de situations, toujours une attention maladroite, qui vous renvoie croupir dans l'eau stagnante de l'agonie solitaire. La souris blanche empêtrée dans le laboratoire de la vie. Dans le jeu de l'oie de l'existence, tombe systématiquement sur les mauvaises cases. Les seuls qui pourraient l'aider sont englués exactement dans le même itinéraire. Le plus affreux ce n'est ni le viol, ni la faim, ni l'asile, ni les trahisons, c'est la pierre tombale de la déréliction que vous refermez sur vous. Zombie de misère parmi les vivants qui se détournent de vous et cadavre en voie de glaciation éternelle à l'intérieur. Vous n'êtes plus rien. Votre langue se paralyse. Votre pensée s'éteint comme une flambée de cheminée que l'on laisse agoniser le soir, par crainte d'un incendie la nuit. Auto-mutilation de la parole et auto-mutilation de la poésie, de l'acte de faire, de la tentation de vivre. Mourir est même une tâche insurmontable. L'on reste en vie car décéder demanderait trop d'effort. Ce n'est pas la solitude qui vous enserre, c'est vous, qui vous glissez dans son sarcophage le plus étroit. Vous êtes momie, mais pas celle du pharaon. Vous êtes l'heautontimoroumenos baudelairien. Le romantisme et la pause en moins. Un couloir en cul-de-sac, plus moyen d'avancer, ni de reculer, ni de jouer au passe-muraille. Heureusement que vous avez perdu la notion d'auto-culpabilité et cette manie si humaine de vous apitoyer sur votre sort. C'est que vous avez égaré votre propre destin. Pouvez retourner tel un égrégore de vous-même sur les lieux de votre vie, il y a longtemps que vous n'y êtes plus, depuis cet incertain moment où vous n'avez plus habité chez vous. Soyons précis, dans votre tête. Vous êtes votre propre alien.

Reste l'errance. Plus d'itinéraire. Simplement marcher car il ne vous reste rien d'autre à faire. Plus de territoire. Déjà plus un être humain, et presque plus un animal. Vous avez encore quelques tactiques de survie. Mais en voie d'amenuisement. Vous ne pouvez plus compter sur vous même. Vous ne passez pas le relais aux autres, car vous êtes sempiternellement en partance de vous-même. Faut que ce soient les autres qui vous arrêtent. Vous indiquent la voie de sortie. Un mal de chien à les reconnaître. Vous vous rapprochez d'eux mais prenez la fuite dès qu'ils s'approchent de vous. La main tendue, vous n'avez ni la force de la prendre, ni celle de la mordre. Au bout de la solitude, il n'y a que l'autre. Mais c'est à vous de vous apprivoiser à lui. Le chemin se parcourt toujours seul. Et le plus difficile est de continuer à avancer quand il disparaît.
Jean-François Jacq trouvera l'issue de secours. En fait non pas une porte de sortie, mais un vaste portail d'entrée. Celui qui le restitue dans son identité d'homme, le bipède collectif par excellence. Suffit que l'on s'adresse à vous. Poste restante. Le récif solitaire qui a survécu à la tempête. Que la vague ne submerge plus, mais embrasse.
A lire. Pour ceux qui douteraient qu'il existât une littérature qui ne soit pas d'insignifiance.
Damie Chad.
22:54 | Lien permanent | Commentaires (0)
14/10/2015
KR'TNT ! ¤ 251 : BIG BOSS MAN + BONGOLIAN / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / JAMES DEAN / JOHNNY MEEKS / JERRY MERRITT / BLACK AND RED
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 251
A ROCK LIT PRODUCTION
15 / 10 / 2015
|
BIG BOSS MAN + MONGOLIAN L'ARAIGNEE AU PLAFOND / JAMES DEAN JOHNNY MEEKS / JERRY MERRITT BLACK AND RED |
16 -05 - 2015 / BOURGES ( 18 )
THE WILD'N'CRAZY ROCK'N'ROLL FESTIVAL
THE BINGOLIAN

Le big boss de Big Boss Man s’appelle Nasser Bouzida, alias The Bongolian. Pour lui la vie est belle. Il rebâtit l’empire de la Club Scene du London Mod Jazz. Son étendard claque au vent, là-haut, dans l’azur irisé d’un ciel psychédélique. Boss Bouzida a l’étoffe d’une superstar, telles qu’on les concevait en 1964, à l’âge d’or du mighty Swingin’ London. Il se fait tailler ses costumes chez un bespoker de Savile Row et joue le Mod Jazz dans les night-clubs de Soho. Comment est-il parvenu à régner sur Londres ? En imposant sa vision d’un son. Quatre albums explosifs illustrent cette charmante déboulade. Et deux fidèles lieutenants l’encadrent : le stand-up man Scott Milsom et le guitar hero Trevor Harding. Voilà le gang le plus redoutable qu’on ait vu arpenter les rues de Londres depuis les Kay Twins.

Pour tous les amateurs de shuffle, de swing, de groove, de snap et de jerk, Big Boss Man est le groupe de rêve. Il suffit de mettre le nez dans leur premier album «Humanize». On plonge dès l’intro dans un jus épais de shuffle, de rumble de basse et de percus polymorphes. Boss Bouzida mène son bouzin comme un cake. Il fait swinguer Londres et donc toute la planète. Puis il passe Louie Louie dans la moulinette latino et ça devient «Big Boss Man» : on atteint alors la groovitude céleste : on voit la copine onduler des hanches en mini mauve, sous l’œil stroboscopique du cyclope Benson et de son collègue Hedges. Ces mecs ont le diable dans le corps. Il manient la vicissitude avec virtuosité. Ils nous noient dans le lagon vert du groove. Avec les cuts suivants, ils secouent la Tour de Londres et bombardent Piccadilly. Avec «Don’t You Tell My Missus», l’énergie jaillit comme l’eau d’une fontaine de Brocéliande. Voilà un cut qui enfonce les clous et qui ne traîne pas en chemin, un cut qui n’est pas du genre à batifoler dans Hyde Park, parmi les hippies déclassés. En face B, on les verra même taper dans le groove californien, histoire de générer quelques coquettes ambivalences. Plus loin, ils se lancent dans le groove sexy avec «Out Of Time». Il recréent cette ambiance douce et tiède qu’on ne trouve que dans le creux de l’épaule d’un ange du paradis. Boss Bouzida se tape ça et là de sacrés envols de percus et les vagues de shuffle n’en finissent plus de nous ramener au large. Inutile de lutter. Son courant est beaucoup trop puissant.

«Winner» sort deux ans plus tard. Pour pouvoir écouter ces albums, il faut évidemment les commander en Angleterre. Les labels Moddish comme Blow Up ou Detour ne sont quasiment pas distribués en France. «Winner» figure lui aussi parmi les énormités de la galerie des Monstres à la Foire du Swing. On savourera «Complicated Lady» pour son fort parfum de groove pressé. On croirait entendre la rumba du casino de Macao. Boss Bouzida fait tout le spectacle derrière ses bongos. Il chante ensuite une fabuleuse franchouillerie exotique, «Tu As Caché Mon Talent Ma Chérie» et passe comme si de rien n’était au garage avec «Reach Out». Et là ils s’offrent le luxe de sortir un son de type early Kinks. Ils s’y montrent incroyablement vivaces et rendent un hommage spectaculaire à Dave Davies. On revient au groove de shuffle avec «Oh My Gawd», classieux comme ce n’est pas permis. Ça sent bon le complet en Prince de Galles et le mocassin en daim clair. C’est en face B qu’on trouve le plus beau shuffle d’orgue du monde : «Boogaloo». Bon, d’accord, j’exagère un peu. Disons qu’il s’agit de la huitième merveille du monde car il faut entendre cette somptueuse bassline signée Scott Milsom. Ce délice de groove évoque la profiterole qui se noie dans un océan de crème anglaise. Ces mecs ont du génie. Si tu veux jerker devant ta stéréo, camarade, écoute «Boogaloo». Puis ils sautent sur l’instro d’anticipation avec «Fever Special» et la Jaguar Type E s’enfonce dans la foggy motion. Bien sûr, ils surpiquent tout ça de fuzz guitar. Et la fête se poursuit avec «Everybody Boogaloo» complètement secoué du cocotier et chaviré à l’orgue Hammond, comme au bon vieux temps de Graham Bond et de Brian Auger. On revient au cœur de Londres en 1964 avec «The Hawk» et ce disque n’en finit plus d’épater la galerie.

Sur la pochette de «Full English Beat Breakfast», on voit l’assiette de breakfast traditionnel : deux grosses saucisses et trois rondelles de tomates grillées, des petites tranches de bacon frit, des fayots dans leur jus, un toast coupé en deux dans le sens de la diagonale et un œuf sur le plat. C’est vrai qu’après avoir avalé ça, on est en forme pour la journée. Et on se retrouve une fois de plus avec un album explosif dans les pattes. Ils attaquent avec «Triumph Of The Olympian», un instro joyeux bourré de vitamines de toutes les couleurs. Ils enchaînent avec «Beat Breakfast», un beat têtu comme un âne qui rappelle un peu les grooves impérieux du grand Jimmy Smith. La chose tourne même à la furibarderie, à la fois vorace, velue et coupante comme le fil d’un rasoir. Mais ce n’est rien à côté de «Black Eye», où le groove chevauche une belle basse betterave rebondie. On appelle ça un son de rêve, avec dans un coin de l’oreille un xylo et des percus infectées de métabolisme récurrent. C’est à la fois dirigiste et incroyablement élégant, juteux et radieux. Un phare dans la nuit des Mods. Décidément, Big Boss Man fait mouche à tous les coup : une fois de plus, tout l’album est bon. On aura exactement le même problème dans un magasin de bonbons : dans quel bocal va-t-on piocher ? Nos amis basculent dans l’easy listening avec «Full Brazilian» puis ils traitent «C’est Moi» à la Dutronc. S’ensuit une gros morceau de groove au chocolat : «Clown Face», dégoulinant de crème de fuzz et incroyable de réinvention pulsative. Boss Bouzida reste tonique en permanence. On trouvera encore deux ou trois bombes en face B et notamment «Pies And Pastiche», digne des grandes heures de Jimmy Smith et tempéré aux petites percus vénérables. On a là un shuffle d’orgue chaud doublé d’un jeu de guitare spectral. Terrifiant ! Le son de Big Boss Man vaut tout le vintage du monde. C’est Scott Milsom qui embarque «Vampyros Twist» à la basse. Voilà encore une énormité profilée et judicieusement garnie de pianotis. Scott Milsom est un bassman hors normes. Il joue vite et bien. Un cut comme «Slap Head’s Demise» pourrait même faire danser James Bond, un homme qui ne danse jamais. Et on replonge dans le jus d’anticipation maximale avec «The Bloater», un cut qui bat tous les records de tonicité. Scott Milsom joue comme un démon. Avec ces gens-là, on louvoie dans les Sargasses du bonheur.
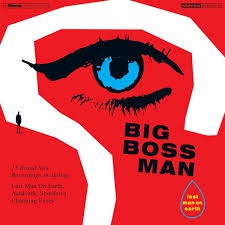
Leur quatrième album, «Last Man On Earth», paraissait l’an dernier. Curieusement, cet album semble beaucoup plus calme que les précédents. L’aspect nuits folles des clubs de Londres disparaît au profit d’un groove plus artistique, comme si au lieu d’avaler des uppers, Nass et ses collègues têtaient des bouteilles de soda. «Aardvark» sonne comme ces cuts qu’on entend dans les salons dansants. Trevor Harding gratte sa Vox 12 cordes dans la lumière que déverse un grand bow window. Une princesse nommé Princess Freesia vient chanter sur le morceau titre de l’album. Elle se prélasse sur la crête du groove et illustre à merveille les langueurs de l’aube naissante, pendant que Nass joue de majestueux retours d’orgue. En face B, on retombe sur un nouvel hommage à Jimmy Smith, « The Bear» et ils nous re-snobbent avec «Le Dernier Homme Sur terre» - Dis bonjour/ Dis bonjour au dernier homme sur terre - Et puis, histoire de rappeler qu’ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils balancent un vieux coup de garage Moddish avec «Shot Down» et la reverb ricoche sur les façades de Wardour Street.

Big Boss Man passait après les Gories, le samedi soir, au Cosmic Trip. Il devait être une heure du matin et le public venait de subir l’assaut du sonic blast des Gories. Normalement personne n’aurait osé monter sur scène après un tel déferlement. Mais Big Boss Man proposait un son tellement différent de celui des Gories que ça semblait jouable. On vit un Nass en maillot rayé venir faire ses réglages des micro. Trevor Harding vint lui aussi accorder sa Jaguar. Il portait un costume d’une élégance irréprochable et des petites mèches lui léchaient les joues. Ça faisait une éternité qu’on avait pas revu un vrai dandy anglais. Pendant les réglages, on vit que Scott Milsom avait les bras couverts de tatouages, mais quand il revint pour le set, il portait une chemise boutonnée aux poignets. Nass avait noué une écharpe de marque autour du coup et chaussé des lunettes noires. Un gros batteur black au crâne rasé jouait de l’autre côté de la scène. Et quand cette équipe se mit en route, ce fut tout simplement comme si on grimpait à bord de la fameuse machine à remonter le temps : ils nous ramenaient directement au cœur du bon vieux Swingin’ London. Nasser Bouzida semblait vivre le meilleur moment de sa vie. Tout en lui n’était que grâce et exubérance, swing et contorsions, il rayonnait, il éclatait de rire, il noyait le son du groupe sous de belles nappes de shuffle et sa section rythmique jouait un groove bespoke. Scott Milsom dansait d’une pied sur l’autre et Trevor Harding ne quittait pas Nass des yeux. Même si la plupart des morceaux étaient des instros, ils dégageaient tellement de bonne énergie qu’ils s’imposèrent. Il fallait en profiter car nous avions là sous les yeux la crème de la crème de la Club Scene londonienne. Mais - car il y a un mais - Big Boss Man est avant toute chose un groupe de club. Sur une grande scène, leur impact se disperse un peu. Il faut sentir le vent du shuffle dans les cheveux, comme on sent les basses du reggae - celles qui, lorsque l’ampli basse est à fond, secouent les jambes du pantalon.

Nasser Bouzida joue aussi des bongos. D’où The Bongolian. Ah on peut dire qu’il ne chôme pas, le bougre. Il existe quatre albums du Bongolian qui s’entrecroisent avec ceux de Big Boss Man et qui sortent aussi sur Blow Up, label fatal. «The Bongolian» date de 2002. Il y joue de tous les instruments et se limite à des instros, mais quels intros ! Spaced out latin soul ! On se régale de l’atmosphère merveilleusement xylophonique de «Merve Play Vibes», puis du groove de basse qui porte «Bongohead». C’est même une sorte de levain de pâte à groove tirée à quatre épingles. Attention ! Une véritable monstruosité se niche en face B : «The Shakles Of Ramm». The Bongolian y bat tous les records de vélocité bongoloïde. Il joue sur un farfouillis de nappes d’orgues intègres et crée de nouveaux espaces intersidéraux dans l’univers Moddish. L’idéal serait bien sûr de revêtir un costume en mohair pour écouter ça convenablement. Beware ! Nasser Bouzida est un véritable sorcier du son, car la bassline qu’il joue file sous la surface du shuffle. Il excelle en tout, c’est un mec du niveau de Todd Rundgren et de Nick Soloman, il sait jouer une bassline dynamique et y aménager des entrées et des sorties. Chez lui, tout est soigné et finement arrangé. Et c’est précisément là qu’on commence à le prendre très au sérieux. Quand on entend le «16 Valve-News Reel» qui boucle l’album, on croirait presque entendre les percus de Santana à Woodstock. The Bongolian joue comme dix. C’est un master of reality, un puissant bretteur, un seigneur des annales, un pulseur d’orangeries et un pieux pénultième.
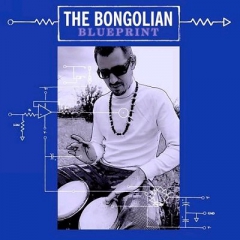
The Bongolian continue de s’amuser comme un petit fou sur «Blueprint» paru en 2005. Contrairement aux habitudes, il est en photo sur la pochette. Il joue de tous les instruments et chaque morceau accroche comme une sangsue. On le suspecte de nourrir une sainte horreur de la routine. Il nous fait un progressif du diable avec «Badger Burgess», bien intraveineux, à la fois sirupeux et lymphatique, et bien buté du frontal. Avec «Sad Curtis», il redevient le prince des grooves d’Arabie et il monte son «House Of Voodoo» sur un sacré groove de basse. Quelle monstruosité ! Il gronde de menace raffinée. Pour chaque morceau, il crée les conditions d’un petit monde vivant et original. «The Hoodwink» n’est rien d’autre en fait qu’un magnifique groove des profondeurs de Ploumardel. C’est joli et rebondi, inclassable, spacieux et spécifique à la fois. Il nous sort ensuite de sa manche un drive monstrueux pour «Psyché Yamm». C’est monté à la basse vertueuse et ça tourne au drive de la démence dogmatique. Il est évident que Bongoman est un continent à deux pattes. Son «Victoria Park» tourne au groove de la taupe sidérale, et on aimerait que ça dure la nuit entière. Il enchaîne avec le merveilleux tagada de «Soul Caravan», qu’il farcit de shuffle intense. Il nous joue ça aux baguettes. Quelle blague ! Voilà encore un cut bardé d’énergie ! Tout ce qu’il enregistre vaut le détour.
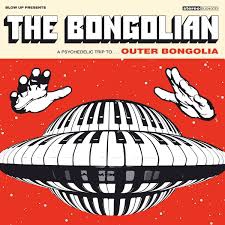
On trouve aussi quelques coups de Trafalgar sur «Outer Bongolia» paru en 2007, et notamment «Rock Me», bombardé au stomp de jazz et speedé aux bongos voodoo de transe et voilà que ça hihante dans le groove de la puissance séculaire. De toute évidence, c’est l’instro du siècle. Les choses prennent une tournure encore plus effarante avec «All Aboard». Il tape là dans le grandiose, il va chercher des mélodies d’une profondeur ineffable et crée les conditions de l’extra-ordinaire. Ce n’est pas un hasard si ce disque s’appelle «Outer Bongolia». On peut dire que ça voyage dans tous les azimuts. On retrouve le bassman de génie dans «The Gospel According To The Bongolian». Pour les amateurs de vrai son, c’est une bénédiction. Ça tourne à la débauche, les nappes d’orge s’inspirent des visions spectrales de Victor Hugo à Guernesey. Terrible pièce de drive shufflé jusqu’à la nausée. The Bongolian est une vraie bête de Gévaudan. Les autres cuts de l’album sont tous des petites merveilles d’espaces sonores habilement sculptés, comme ce «Talking Synth» d’ouverture, enrichi au pianotage extrapolé. Il revient à son domaine de prédilection, le groove, pour «Feel It» et il nous bongote d’entrée de jeu «The Champion». Ce mec dégouline d’énergie et d’idées. Rien n’est jamais gratuit sur ses disques. On s’épate de «Bongo Mango», pure merveille d’exotica - Evereybody ! - Et il envoie rouler un shuffle de rêve. Nouveau coup de génie avec «Marimba Down At The Hare». Il ramène pour l’occasion le son du divin vieux marimba du Magic Band et il étend son empire sur le Mod-jazz des clubs de Londres.

On retrouve sensiblement le même souffle sur «Bongos For Beatnicks» paru en 2011. Il attaque par un vrai drive de jazz avec «The Riviera Affair», tendu à l’extrême et beau comme un demi-dieu fellinien. Il nous propose tout simplement un fantastique voyage à travers son espace spatio-temporel et nous propulse à coups de rafales de basse et de bongos. «Moscow Queen» n’est rien d’autre qu’un festival de bass-mastikation extraverti. The Bongolian traverse les frontières des genres à une vitesse supersonique. Son truc ? Le groove inlassable, comme on le voit avec «Give It To Me». Une chose est sûre : ce mec continuera de groover jusqu’à la fin des temps. C’est en face B que se nichent les hits, à commencer par «Jackies Half Nelson» qu’il chante à la traînarde de Sibérie, sur une fabuleuse élongation de groove drivé par la basse. Sur «Lauren’s The Clockmaker» et «The Ballad of Lily Kensington», il déverse des nappes de shuffle dignes de celles de Jimmy Smith. On reste dans le groove affable et familier pour «Pretty Bertie». Forcément admirable car bongolien. Nasser Bouzida est avec Billy Childish, Graham Day et Knox l’un des derniers héros du rock anglais. Il n’en finit plus d’honorer la mémoire de Graham Bond et de Jimmy Smith. Il revient au pur jive de xylo-jazz avec «Doktor Of Eastern Promise», une énormité qui pue l’anticipation à dix kilomètres à la ronde. Il boucle cet album effarant avec un «Tortoise Walk» rampant et beau comme un voile noir à peine clos sous lequel ruisselle une touffe de noir Jésus.

L’ex madame Day, Fay Hallam, s’est s’acoquinée en 2012 avec The Bongolian pour enregistrer «Lost In Sound». Elle y compose tous les titres, chante et joue de l’orgue. The Bongolian s’occupe des percus. Ce disque est bourré de bon jerk et de grosse soul. On trouve un hit faramineux en face A : «Get Off The Bus», une pièce d’extravaganza noyée d’orgue. C’est d’une puissance assez rare et traversé par des lignes de basse infernales. Pour le final, Fay grimpe très haut. Les grosses poissecailles sont en face B. Sur «Gathering», Fay va chercher des ultrasons bucoliques à la Laura Nyro. Ce mélopique entêté finit par convaincre et elle le finit à coups de tambourin. Dans «Alive», elle s’exclame : «You know it’s good to be alive !» C’est vrai que c’est parfois bon d’être en vie. On ressent cela certains jours de printemps. Fay fait monter ses pinacles d’harmoniques et rejoint des hauteurs dignes de celles jadis fréquentées par Jackie DeShannon. «Shallow Moon» est un bossa beat dressé vers l’avenir, un véritable élixir de good time music. Fay et The Bongolian savent swinguer la bossa nova. Et ils bouclent avec une pop Mod de très haut rang, «Lost In Sound», embarquée à la voix et reprise à la nappe. Ça sonne comme un classique du Brill Building. Fay va chercher des accents assez bas. Elle a raison, car ça lui permet ensuite de grimper très haut dans les étoiles. Elle adore tout ce qui explose au firmament. La plupart de ses chansons sont des petits hits planétaires, mais fort peu de gens le savent.
Signé : Cazengler, the mongolian
Cosmic Trip Festival. The Wild’n’Crazy Rock’n’Roll Festival. Bourges (18). 16 mai 2015.

Big Boss Man. Humanize. Blow Up 2000
Big Boss Man. Winner. Blow Up 2005
Big Boss Man. Full English Beat Breakfast. Blow Up 2009
Big Boss Man. Last Man On Earth. Blow Up 2014
Bongolian. The Bongolian. Blow Up 2002
Bongolian. Blueprint. Blow Up 2005
Bongolian. Outer Bongolia. Blow Up 2007
Bongolian. Bongos For Beatnicks. Blow Up 2011
Fay Hallam & the Bongolian. Lost In Sound. Blow Up 2012

10 / 10 / 2015 - PROVINS
LA ROSERAIE
L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Malade comme un chien, rhume, typhus, choléra, peste bubonique et autre joyeusetés m'ont assailli toute la semaine. Même pas pu aller la veille au New Morning voir Little Bob, c'est dire la gravité de mon cas. Mais ce soir je me dirige d'un pas pas vraiment alerte vers la Roseraie de Provins. Vous l'ignoriez sans doute mais la bonne ville de Provins s'enorgueillit depuis des siècles de ses roses. C'est que Provins est à la rose ce que Christophe Colomb fut à l'Amérique. C'est en ses nobles remparts que Thibaut de Champagne ramena à sa châtelaine ( qui l'attendait avec grande impatience en ses longues poulaines ) au retour de sa croisade en Terre Sainte, une fleur, la célestielle rose de Damas. Pas bête, le Thibaut IV qui s'y connaissait en gentes dames, rien de mieux qu'un bouquet de fleurs hâtivement cueillies en un champ en friche pour se faire pardonner une longue absence. Je présuppose que l'épouse passablement énervée dut jeter la rose par la croisée dans les douves du château où par un miracle horticole sans précédent elle prospéra tant et si bien que déjà au seizième siècle Shakespeare en cause dans sa plus célèbre pièce. Thibault qui ne s'était point lavé et qui sentait le musc des moricaudes qu'il avait dû serrer un peu trop sauvagement contre lui, se retrouva jeté hors de la chambre conjugale, le visage labouré par les ongles de sa tendre moitié. D'où le vénérable proverbe qui traversa les âges selon lequel il n'est point de rose sans épines.

A la fin du siècle précédent, la Roseraie de Provins n'était qu'une immense touffeur impénétrable de buissons entremêlés. L'on raconte que dans les halliers les plus reculés, autour d'un étrange autel de pierres ouvragées aux alentours des minuits de lunes blafarde se déroulaient d'étranges cérémonies de reviviscence P.I.A.I. Je ne saurais en dire davantage sur ces initiales. Les initiés savent déjà, les autres chercheront. La lecture de la traduction par Philippe Pissier de Magick d'Aleister Crowley ( voir KR'TNT 162 du 07 / 11 / 2013 ) vous apportera-t-elle quelque secours ? Toujours est-il qu'à l'orée de notre millénaire, l'endroit fut racheté, grillagé, défriché, ratissé et planté de rosiers de tous les coins du monde. Devint un lieu touristique inscrit dans l'itinéraire obligatoire du patrimoine de la France médiévale. Mais il en est des roseraies de France et Navarre comme des concerts de rock and roll. Les bénéfices se font sur le merchandising, disques, t-shirts, écharpes, livres, statuettes plastifiées... La Roseraie de Provins a donc emménagé dans un vieux corps de ferme, deux vastes salles dans lesquelles s'entassent habituellement toute l'hétéroclite production artistique de la région. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, d'ailleurs on n'a jamais retrouvé la chatte elle-même. Trêve de bavardage, j'entends les premières mesures d'une douce musique...
L'ARAIGNEE AU PLAFOND

Waooh ! Je n'en reviens pas, le bric à brac a disparu. L'a du falloir trois semi-remorques pour emmener le tout à la déchetterie. Plus straight, vous ne trouverez pas. Transformé en salon de thé ! Les tables à nappes, les chaises blanches en fer forgé, occupées par de vieilles dames tirées à quatre épingles ( pas du tout punk ), chignons blancs et petits doigts levés, et au fond l'Araignée sagement alignée comme des bibelots de nacre sur une étagère, Mildred au milieu juchée sur une chaise haute, toute proprette dans sa robe noire à petit col blanc, l'on se croirait face à l'orchestre de chambre de la Royal Academy de Nottingham, sauf que, sauf que, ce n'est pas une suite de Purcell qui nous est interprétée mais le Summer In The City des Lovin' Spoonful. Ce qui change tout.

Ne faut pas se fier aux apparences. Surtout avec ces maudites bestioles que sont les araignées. Un premier détail choquant : ce ne sont pas des théières que convoient sur leurs plateaux l'essaim de demoiselles agrémentées d'un t-shirt – devinez la couleur – rose – vous êtes très forts - mais des pintes de bières de toutes les teintes, je comprends pourquoi on a rajouté de vastes auvents sur les côtés, tous les soiffards du pays y sont attablés devant de redoutables stouts. Et puis cette foule qui n'en finit pas d'entrer et de se masser devant l'orchestre. Une flopée d'adolescents qui ne sont pas venus pour jouer les cariatides de l'Erechtéion.

Walk like an Egyptian, le titre pharaonique des Bangles est suivi d'une Bombe Humaine, symphonisée à mort, beaucoup plus mortelle que la version rabâchée et sans âme des Insus, lors de leurs dernière pseudo-reformation. C'est un peu la marque de morsure de l'Araignée au Plafond, se jette sur un morceau et vous en changent la physionomie en l'emmaillotant d'un coton tissé d'un fil de coton qu'ils sont les seuls à sécréter. Peuvent tout se permettre, ont le personnel pour. Ne suivent pas la politique économique du moment qui en est à la compression salariale. A chaque apparition, ils sont de plus en plus nombreux. Ce coup-ci, c'est Zina, s'agite auprès d'une paire de congas presque aussi haut qu'elle. Elle fait de l'interventionnisme percutant, une fois au tambourin, une fois sur une espèce de xylophone électronique, une fois sur l'on ne sait pas trop quoi. Mais toujours à bon escient. La petite futée qui parvient à se faire remarquer avec trois fois rien. L'est comme le moustique qui s'en vient vibrionner autour de votre oreille, mais sans cesse en mesure et avec délicatesse. Je vous parie que la prochaine fois elle emmènera son violoncelle et qu'elle le fera meugler comme vache dans le pré, et que ce sera aussi beau qu'une Bucolique de Virgile.

Sont tellement nombreuses les Araignées qu'elles sont partout : la grand-mère virevolte tout autour, elle régit l'image – une caméra à la main, le grand-père n'a pas de sonotone, règle le son sur le pupitre aux multiples boutons ( qui ne sont pas de rose ) la mère est à la basse, avec la couvée qui jacasse autour, elle pourrait s'inquiéter, elle sourit et tout rentre dans l'ordre par miracle. Le père – une barbe bleue de méchant au bout du menton, dirige son monde au doigt et à l'oeil, sans jamais élever la voix, l'a sa guitare qui lui sert d'exutoire. Tous les oeufs de la couvée ne leur appartiennent pas, adoptent aussi les copains des enfants et les voisins. Des sax et des trompettes comme s'il en pleuvait, un orgue, une batterie, et flûte ! j'allais oublier la flûtiste, et Mildred qui entre deux vocalises appuyées se saisit de sa traversière pour reprendre son souffle. Nombreux, mais toujours occupés. L'on ne chôme pas chez les araignées, sans cesse un fil à démêler ou à entoiler ou à couper aux ciseaux.

Chez les tarentules, il y en a une qui se débrouille pour vous refiler la tarentelle. Pas besoin de la chercher bien loin. L'est pas au plafond, mais collée à sa chaise et penchée sur le micro. La seule qui soit capable d'enchaîner un morceau de ce mendigot d'Iggy avec le Sud de Nino Ferrer. Et dans les deux cas, on croirait du made in Mildred. Des yeux pétillants de malice de petite fille qui prépare un mauvais coup, et hop elle ose un Osez Joséphine que Bashung lui-même n'aurait jamais osé. Et rehop, elle à l'incarnat ivoirin de dame aux camélias elle vous noircit un Bad de Mickaël Jackson à vous faire pâlir d'envie. Le truc de trop qui rend les lycéens fous et la soirée part en folie live. C'est comme une lave de corps humains qui ondoie et roule devant la scène, tour à tour, couchés, debout, à genoux, pétrifiés en d'étranges moonwalk séléniens, danse de fous, qui ne s'arrêtera plus de la soirée. Mildred enfin descendue de son perchoir les provoque, tel un torero qui s'en vient caresser d'une main taquine et distraite le mufle d'un taureau furieux. Les a domptés, viendraient lui manger dans la menotte. L'en fait ce qu'elle en veut. Un peu de flûte traversière pour leur faire traverser les rapides d'un fleuve en furie, et de sa voix elle relance la cavalcade à peine le rivage atteint. Puissante, Mildred, sa voix enfle démesurément, l'en rajoute un petit peu à chaque montée chromatique comme si elle disposait d'une réserve infinie. Vous pensez qu'elle a atteint le maximum de sa plénitude, mais non elle peut encore moduler plus fort. A la fin du second set elle se plaindra de n'avoir plus de voix, pour tout de suite après hausser encore le ton, et au trente-deuxième morceau final, elle en adjoindra trois de plus pour le plaisir de s'entendre envoûter encore une fois de plus la salle et se régaler les yeux des trémoussements spasmodiques du dernier groupe de danseurs en transe rythmique.

Folie par devant, folie par derrière, les troix sax jouent les chiens en colère et se perdent en aboiement sans fin, les trompettes roucoulent comme des dinosaures en rut, et le père pris d'un délirium tremens subit pose sa guitare à plats et la bourre de coups de poings comme s'il s'acharnait sur le corps déjà mort de son ennemi. Méfiez-vous des araignées, ce sont des tueuses. Une soirée familiale qu'ils avaient annoncée. Redoutables exemples de fébrilités épileptiques pour notre saine jeunesse. Jusqu'à la Mamy à côté de moi qui sur sa chaise roulante se serait bien levé pour la farandole finale qui est allée se perdre l'on ne sait où. L'Araignée Au Plafond n'a pas usurpé sa réputation de délire festif. Le prochain concert est prévu à Bray sur Seine pour fêter la saint Zombie, de la prochaine nuit de la citrouille qui fout la trouille.
Une soirée fort récréative. Pas du tout à l'eau de rose.

Damie Chad
LE PLAN M.
Il y a des gens qui me font rire. Se croient au-dessus des vicissitudes de la vie sous prétexte qu'ils ont leur plan B. Se croient malins. Je les regarde avec commisération. Moi, je vois plus loin. Onze coups d'avance. J'ai mon plan M. M comme Marlow. Tony pour les intimes. Un truc diabolique, d'une terrible efficacité. Pas cher, qui ne nécessite que quatre objets que tout un chacun qui se respecte un tantinet possède à coup sûr. Je sens que j'en ai trop dit. Comme ce soir je suis en veine de confidence je vous explique. Premièrement un téléphone. Pour appeler Tony afin qu'il vienne à la maison. Deuxièmement une collection complète de disques de Gene Vincent. Ça c'est l'appât, le piège, et le leurre – puisque vous mentez effrontément en lui affirmant que vous possédez un inédit. Troisièmement, un magnum de sky, juste parce que vous êtes bon et que Marlow le mérite. Quatrièmement une clef, avec laquelle vous enfermez Marlow dans une pièce sans fenêtre. C'est tout, vous suffit d'attendre quelques heures. Sans regret. Vous, cela fait un mois, trente longs jours interminable, que vous espérez la suite obligatoire. Faut qu'il aille jusqu'au bout le Marlow. Pas question qu'il continue à faire son marlouf. L'est assez intelligent pour comprendre qu'on ne le laissera ressortir, qu'une fois qu'il aura glissé les feuillets attendus sous la porte.
Hier après-midi, j'étais fin prêt. J'avais tout préparé. Je m'apprêtais à composer le numéro de Tony lorsque mon regard tomba sur la couverture du dernier numéro ( 346 ) de Jukebox Magazine. Mille pompons de Fantômette ! J'étais devancé sur toute la ligne. Sur toutes les lignes. L'avait déjà rédigé son article. L'avait intuitivement saisi que s'il ne se dépêchait pas d'écrire un petit-chef d'œuvre sur Johnny Meeks et Jerry Merrit, toute la confrérie rocker ne le lui pardonnerait jamais et était prête à toutes les extrémités pour l'obtenir.
JOHNNY MEEKS

Ses derniers mois, sa fille avait fait savoir qu'on pouvait lui écrire, que son père était sensible à ces mots d'amitié émanant d'inconnus, mais qu'il ne répondrait pas faute d'énergie. Sans doute est-il doux lorsque l'on s'approche du terme de sa vie de savoir qu'une fois parti vous continuerez à vivre, dans l'esprit de ces amis anonymes dont vous avez transformé l'existence. La mauvaise nouvelle est tombée, ce 15 juillet, Johnny Meeks a déserté notre vallée de larmes. Et de franche rigolade, car il ne faut pas exagérer non plus. Comme beaucoup, j'ai connu Johnny Meeks sans savoir qu'il existait. Il y avait cette guitare sur Baby Blue. Mais c'était normal. J'étais jeune alors. Que le plus grand chanteur de rock and roll ait bénéficié de musiciens hors pairs me semblait relever de l'ordre naturel des choses. Me posais pas de question. C'était Gene Vincent. Une évidence, un nom magique qui expliquait tout. Qui annulait même le besoin de toute information complémentaire.

Les renseignements sont arrivés. Fractionnés. Disparates. Lambeaux par lambeaux. L'est bientôt clairement apparu que les Blue Caps ne furent pas un groupe monolithique. Nombreux changements de personnel. Puis l'a fallu se résoudre à rendre à trois César les trois dollars d'or qui leur revenaient. Ces dernières années, l'on a beaucoup insisté sur Cliff Gallup dont Tony Marlow analysa avec tant de finesse le style dans le numéro 345 de Jukebox ( voir Kr'tnt ! 245 du 04 / 09 / 15 ). Oui mais après Cliff, il y eut Johnny. En théorie, relève impossible. Cliff, le génie à l'état pur. Trente-six chandelles, et puis s'en va. Vous ne ferez jamais mieux. Johnny ne s'y est pas trompé. L'a fait à la Johnny Meeks. Cliff, c'est le maître, le surdoué un peu irritant. Vous voulez du rock, en voici, en voilà. C'est bon, je m'en vais jouer mon country vieillot dans mon coin, surtout ne venez pas me déranger. Le vénérable guide zen qui se retire sur sa montagne. Et l'élève Johnny qui s'en vient. Un touche à tout de génie. Filez-lui un instrument entre les mains et il se débrouillera avec. Mais faut être franc. Un gars qui a déserté les bancs de l'Académie de jazz, pour faire l'école buissonnièrock. Le Cliff on a l'impression qu'il a inventé le rock, le Johnny, il est né avec et dedans. La différence entre les deux : le Cliff, il regarde où il met les doigts, réfléchit un dixième de seconde avant de les poser sur les cordes. Johnny n'a pas cette retenue, fonce tête baissée, rock on ! Le Cliff c'est la guitare rock et Johnny la guitare rock and roll. Les deux faces grecques de la divinité, Cliff l'Apollinien et Johnny le Dionysiaque. Meeks portrait du guitariste en jeune chien fou au milieu d'un jeu de quilles. Un pas de plus vers la modernité. N'est pas devenu le guitariste de Gene Vincent par hasard. Le rock and roll comme art de vivre. Avec Johnny Meeks, le rock and roll de Gene Vincent semble s'accélérer.
JERRY MERRITT

Quatorze petits morceaux et Gene délaisse les Etats-Unis pour l'Europe. Un son nouveau. Plus brillant. Etincelant. Flashy. Une espèce de prémonition du futur parcours discographique de Vincent, un son que je qualifierai d'anglais, de britannique avant l'heure. Du vernis et du clinquant. Mais qui ne craquèle pas et qui perdure. L'existe une continuité entre Johnny et Jerry, et même une logique moderniste entre les deux qui indique les choix esthétiques de Gene Vincent quant à l'avenir du rock and roll. Vincent n'a jamais été un passéiste. Pur, mais pas puriste. Plus attentif qu'on ne le pense à la transformation évolutive de cette musique dont il fut l'un des pères fondateurs. Toute l'aisance de Merritt apparaît dans ce Mitchiko From Tokyo qui n'est qu'une parodie de Be Bop A Lula. Une japonaiserie mais pas du tout une japoniaiserie. Un bibelot jaune dont l'exotisme risque d'en lasser plus d'un, mais bourré d'humour, de finesse et d'auto-dérision, autant chez le chanteur que chez le guitariste, ce qui en dit long sur la complicité qui les unissait. Ce Crazy Times de par son organicité constitutive, enregistré en 1959, peut être considéré comme le premier concept-album avant l'heure. Jerry Merritt a su donner à ses douze morceaux une unité de ton peu commune. Les opus des cinq premiers trente-trois tours de Vincent, sont des collections de titres, posés les uns à côté des autres mais sans réelle unité. Chacun d'eux est une merveille à part entière, mais ils ne communiquent pas entre eux. Me suis toujours demandé quelle avait pu être la part de Ken Nelson dans cette sonorité de guitare si pétillante, si giclante, sur ce sixième album made in USA, tellement différent des précédents. Les studios Capitol n'étaient pas des bunkers refermés sur eux-mêmes, imperméables à l'air des temps nouveaux. Jerry Lee Merritt n'était pas obsédé par une obsession vintage. La nostalgie du paradis perdu si chère aux rockers n'est venue que beaucoup plus tard. L'était dans la vie qui va de l'avant.
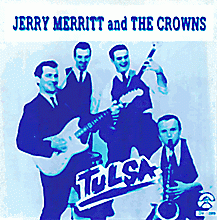
Sont maintenant tous les trois partis. Est-ce que là-haut, Gene les a incorporés d'office dans ses Casquettes Bleues interstellaires ? J'aimerais entendre comment ils s'y prennent. Je ne suis pas non plus vraiment pressé, j'ai tout mon temps. Pour les détails biographiques, les carrières particulières, le matos, l'analyse du jeu, je vous laisse entre les mains de Tony Marlow. S'y entend beaucoup mieux que moi.
Damie Chad.
LIFE
ANTON CORBIJN
( sortie : septembre 2015 )
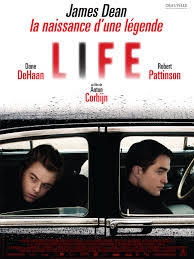
J'y suis alléun peu à reculons, Anton Cornbijn est surtout un photographe connu pour son travail dans le milieu rock et notamment la réalisation des pochettes de Dépêche Mode, qui n'est pas tout à fait mon groupe de rock préféré. Je pressens comme un manque affectif entre nous deux. Il attaque ainsi ce pseudo biopic de James Dean selon un angle de visée très photographique puisqu'il retrace la rencontre de James Dean avec Dennis Stock le photographe qui rendit l'acteur célèbre grâce à son reportage publié à l'époque dans le magazine Life.
N'ai jamais été très accroché par James Dean. J'ai d'abord connu le mythe. Avant de rencontrer l'acteur. Très déçu. M'attendais à mieux. Devais avoir vingt ans quand j'ai pu voir pour la première fois, La Fureur de Vivre, le film culte de l'adolescence rock and roll. Devais être trop vieux, j'attendais mes déchirements de minaud de treize ans et voici que ce grand garçon dans son blouson rouge m'est apparu trop adulte – un comble ! - dans ses aspirations. Me racontait une vieille histoire en laquelle je ne pouvais me reconnaître – nous étions au début des années 70, et le monde avait changé. Deux années auparavant, j'étais tombé par hasard devant la télévision sur A l'Est d'Eden, cette histoire de salades bloquées dans un train ne m'avait point touché. Je me doute bien que mon résumé risque de peiner les deanophiles, mais comme disent les psychologues, je rapporte mon ressenti. Quant à son troisième opus majeur, Géant, j'ai été du début à la fin subjugué par … Rock Hudson, qui à mon humble avis y compose un personnage beaucoup plus psychologiquement aguerri que le rôle tenu par James Dean. Je reconnais que ce dernier est desservi par les nécessités du scénario.
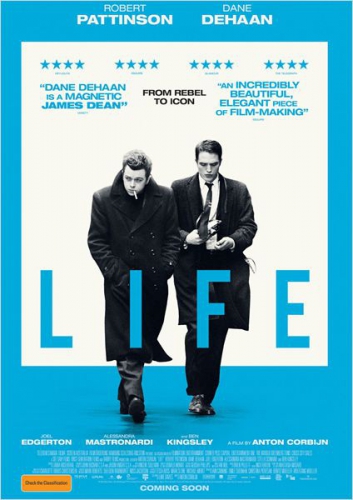
Donc quinze jours de la vie de James Dean fidèlement reconstitué. En fait l'on n'en sait rien, disons une approche possible de la personnalité de James Dean, des journées cruciales, la première d'A l'Est D'Eden est prévu dans les jours qui viennent et la Warner décide de prendre en mains la carrière de James, l'est choisi par Nicholas Ray pour être l'acteur principal de Rebel Whithout A Cause. Evidemment c'est donnant, donnant. Une carrière de star en devenir assurée mais en contrepartie faut se farder tout l'aspect promotionnel de la firme. Tout autre serait fou de joie. Mais pas Jimmy, veut bien la première place sur l'écran, mais pas les attendus qui marchent de pair. L'os rempli de moelle substantielle mais pas la chaîne de la niche qui en dépend. Artiste oui, homme sandwich de la compagnie, non. Drôle de dilemme pour Jimmy, deux pas en avant vers la friandise convoitée mais un troisième en arrière car il tient à l'essentiel, sa liberté. Le cul entre deux chaises pour parler un peu prosaïquement. N'est pas encore prêt à payer le prix exigé, mais la tentation est grande.
Du coup, l'est mal dans sa peau le Jimmy, gêné aux entournures. Faut qu'il retienne les mots qui lui viennent naturellement à la bouche. D'où ces débuts de phrases inachevées qu'il se hâte de remplacer par une autre, tout en étant dans l'incapacité élocutoire de voiler le temps de silence nécessaire à sa réflexion. Une, deux, trois secondes à peine, mais lourdes de sens, si significatives que l'interlocuteur est en droit d'émettre un doute. Dit-il ce qu'il pense vraiment ? Est-il un si mauvais hypocrite qu'il ne peut donner le change ? En plus c'est un malin, joue de sa présence au monde incertaine, de son aura maladroite, avec tant de talent que l'on peut le croire détenteur d'une profondeur intellectuelle au-dessus de la moyenne. Ce qui n'est pas faux, se sert souvent de citations lues dans les livres pour enrober ses dérobades. Ce qu'il y a de terrible avec Jimmy, c'est qu'il compose sa sincérité. Parle un peu par parabole psychologique. C'est à vous de décrypter. Vous envoie sur les roses mais donne l'impression de garder les épines pour lui. Un garçon gentil, assez masochiste pour s'infliger à lui-même le mal qu'il aimerait vous faire.
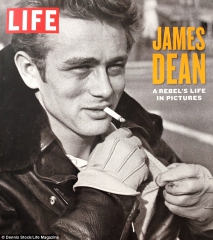
Dans le film, Dennis Stock est un peu son miroir. Mais l'image est inversée. Tous deux ont besoin de l'autre. A l'orée d'une carrière l'on a souvent besoin d'un marchepied. Quand on a des scrupules moraux, l'on aimerait s'en passer. Mais ici le service sera mutuel et réciproque. Je t'apporte ce que tu me donnes. Relation à deux. Manière délicate d'évoquer la bi-sexualité de Jimmy sans que rien ne soit explicitement affirmé.
Lorsque l'on ne se sent pas bien à l'intérieur de soi, ne restent que la fuite en avant, que la fuite en arrière. La Warner ou la famille. Life nous montre le retour de Jimmy chez lui, dans le cocon familial, ce pilier moral du conservatisme américain. Indiana, la ferme, les chevaux, les vaches et les cochons. La nature. Mais apprivoisée. L'oncle, la tante, les grands-parents, tous ceux qui l'aiment, mais tout ce qu'il a fui, cette étroitesse d'esprit, cette gentillesse insupportable qui vous emprisonne et vous rapetisse. Un refuge émasculateur, un lot de consolation après la mort de la mère aimante...
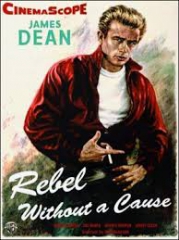
Retour à la grande ville. Dennis Stock a compris la leçon de la vie, rentre dans le rang, sa célébrité démarre, celle de Jimmy aussi. Mais comme c'est le héros du film, Mister Dean peut se permettre un dernier coup de nez à la Warner. Combien de temps ce genre de facétie aurait-il duré ? La mort de Jimmy est peut-être survenue à temps pour éviter une dramatique fin de carrière. Nombreuses sont les étoiles du firmament, mais celles qui ont filé personne n'en tient le compte...
Mon avis personnel sur le film : mitigé, l'aurait dû être tourné dans les années cinquante, au temps de l'âge d'or du cinéma américain, certain que l'ensemble aurait été plus costaud. Notre modernité cinématographique est un peu chiche, du travail bien léché, mais il manque une touche de démesure. Pour l'acteur Dane Dehaan qui joue le rôle de James Dean, je m'en remets aux copines ( majorité de filles dans la salle ) qui dans l'unanimité n'ont pas été séduites par son sex-appeal. Ont tellement dénigré sa façon de jouer, que Mistrer B. and I nous sentions, par comparaison, à chacune de leurs acerbes remarques, sur ses grosses lunettes de myope, sur sa marche de crabe bancal, sur son accent traînant, croître notre profil de séducteurs. Un film qui vous rend beau, ne saurait être tout à fait mauvais.
Damie Chad.
BLACK AND RED
AHMED SHAWKI
LES MOUVEMENTS NOIRS
ET LA GAUCHE AMERICAINE
1850 – 2010
( Syllepse ( paris ) & M EDITEURS ( QUEBEC )
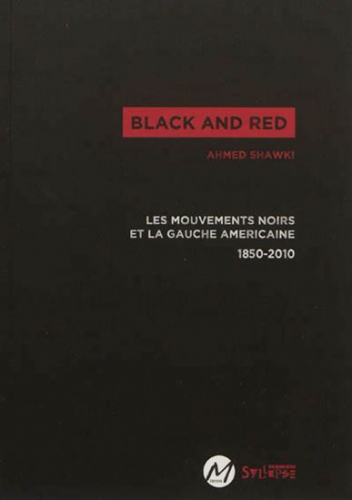
Black and Red, non il ne s'agit pas des deux faces de Tyrany and Mutation du second album du Blue Öyster Cult, mais de quelque chose de beaucoup plus roots, beaucoup plus blues. Un parfait supplément à l'Histoire des Black Panthers de la semaine dernière. Mais avec en plus tout le début, et un bon morceau de la suite. S'arrête juste à temps – quoique déjà il ne soit pas tendre avec lui dans l'introduction de la réédition - quelques mois avant l'élection de Barack Obama. Une sempiternelle histoire des noirs in the USA soupirerez-vous, oui mais cette fois coordonnée avec la colère des blancs, quand ils se fâchent tout rouge, et qu'ils tentent eux aussi de se libérer de leurs chaînes. Peut-être moins visibles que celles de Perchman, mais tout aussi douloureuses.
Fais l'impasse sur l'arrachement originel à la terre africaine. Les satanés autochtones d'Amérique mirent tant de mauvaise volonté à travailler dans les mines qu'ils décédèrent d'une manière si rapidement irresponsable qu'il fallut songer à les remplacer par le fameux bois d'ébène. Dont de nombreuses cargaisons furent déchargées afin d'aider au ramassage du coton dans les grandes plantations du Sud. Ce qui ne favorisait guère l'affaire du Nord, qui faisait grise mine devant cet or noir quasiment gratuit qui permettait au Sud de vivre en quasi autarcie économique. Avait assez de capitaux pour acheter au Nord industriel les machines nécessaires à son agriculture mais aussi des ribambelles d'esclaves qui, si leur sort perdurait, ne seraient jamais des adeptes de la consommation de masse. Le Nord avait aussi besoin d'une main d'œuvre un peu plus qualifiée et davantage libre de ses mouvements - afin de se déplacer de bassins d'embauche en nouveaux chantiers - que les serviles analphabètes attachés à leur plantation. L'abolition de l'esclavage, présentée comme une généreuse idée humanitaire n'était, pour employer une expression contemporaine, qu'une variable d'ajustement au développement continuel des conditions de l'exploitation.
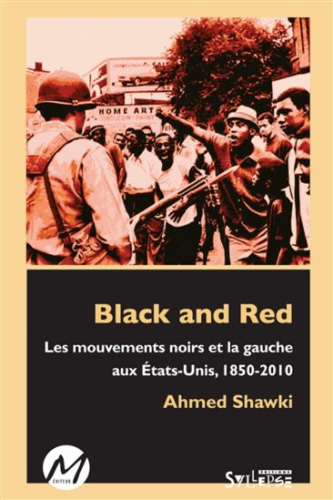
Pour une fois que le déploiement de celles-ci pouvaient se parer de plumes vertueuses l'on n'allait pas s'en priver ! Les noirs ne s'y trompèrent pas. Sentirent très vite que leur avenir avait toutes les chances de ne point s'éclaircir avant très longtemps. C'est ainsi que naquit dans les consciences de l'élite noire le désir de quitter le plus vite possible ce continent qui les avait si mal accueillis. Le retour en Afrique fut une option qui fut longtemps privilégiée chez les intellectuels noirs. Quelques décennies plus tard, l'échec de ce projet devenant patent – les pays africains sous-développés étant les premiers opposés à cet exode – l'idée de retour se transforma en la naissance d'un nationalisme culturel et politique noir. Incidemment s'y adjoignit – pour mieux signifier la rupture et la différence avec l'exploiteur blanc de religion chrétienne – l'adoption d'un islamisme fortement revendiqué.
Nous ne nous attarderons point sur la guerre de Sécession – de par chez nous évènementiellement connue – pour nous attarder sur les trente années de la période suivante, celle de la Reconstruction. Celle du Sud abîmé par la guerre civile. Souvent on la résume à l'adoption des lois dites de Jim Crow qui présidèrent à la mise en place de la ségrégation. Nous avons ainsi tendance à confondre la conséquence avec le déroulement des faits. Il s'en fallut de peu pour que le résultat soit tout autre. L'on a tendance à penser que les petits blancs, les rednecks, étaient naturellement racistes. De nombreuses luttes à travers les états du Sud, virent les petits fermiers blancs faire alliance politique avec les métayers noirs à qui les gros planteurs louaient – contre la moitié de leur production - la terre de leur plantation. Beaucoup se rendaient compte que leur difficultés ne provenaient ni de leurs voisins blancs, ni de leurs voisins noirs, mais des riches propriétaires et des gros négociants qui les endettaient en leur achetant leur production à bas prix. Nous sommes loin de la France et de l'Allemagne mais les idées socialistes véhiculées par les exilés de ces deux pays européens étaient assez lumineuses pour aider à comprendre le monde. Les aristocrates terriens du Sud virent poindre le danger. Ce sont eux qui surent opérer la division entre ces prolétaires des deux races en accusant les uns de ramasser le coton des autres. Achetèrent les journaux ( et les journalistes ) pour répandre leur funeste division. Comme les idées ont parfois la vie dure, ils créèrent le Klu Klux Klan, leur branche armée destinée à éliminer les nègres récalcitrants et à permettre à la colère des petits blancs de s'exprimer lors de collectives séances de lynchages... Au bout de trente ans, l'ordre était en fait rétabli dans le Sud...

La ségrégation sudiste était mal vu par le Nord. Une condamnation morale ne vous coûte rien. En plus dans la série faites ce que je dis et point ce que je fais, le Nord aurait pu donner des leçons d'hypocrisie au Sud. Dans les villes industrielles du Nord, la ségrégation n'existait pas, mais les noirs et les blancs n'habitaient pas dans les mêmes quartiers, ne fréquentaient pas les mêmes commerces, ni les mêmes écoles. Le melting pot n'était pas très mélangé. Développement séparé, rien n'était formellement interdit, mais les préséances étaient scrupuleusement observées...
Il y eut un âge d'or. Après 1917, la révolution russe et la naissance du Parti Communiste américain. Celui-ci soutint la cause noire. Prenait la suite du mouvement anarcho-syndicaliste des Wooblies à qui leur refus de cautionner l'engagement des USA dans la guerre de 14-18 fut fatal ( voir KR'TNT ! 114 / 18 / 10 / 2012 ). Les noirs furent considérés par le PC non plus selon la couleur de leur peau mais en tant que partie du prolétariat. Ouvriers noirs et blancs, tous unis contre la bourgeoisie. Dans les sphères gouvernementales l'on s'inquiéta de cette union des plus dangereuses. Mais ce fut Staline en personne qui rompit le processus. Devant la montée de l'extrême-droite européenne, il changea de tactique : au slogan de classe contre classe il substitua celui de l'union avec les forces démocratiques bourgeoises, front uni contre le fascisme. Aux States, le soutien aux luttes des noirs fut sacrifié au profit des yeux doux à l'encontre de la société capitaliste et libérale. Le PC américain y perdit la confiance de ses couches populaires, ainsi amoindri, il fut pratiquement réduit à néant par le général MacArthy qui parvint, aux froids lendemains de la guerre, par ses redoutables procès à casser l'ossature politique du parti.
Nous en venons aux premières marches non-violentes menées par Martin Luther King, son élimination physique et la naissance du Black Panther Party au sujet duquel nous renvoyons à notre article de la semaine précédente. Les quarante années qui suivirent l'élimination des Panthères n'incite guère Ahmed Shawki à l'optimisme. Une véritable dichotomie s'opère dans la communauté noire : une bourgeoisie aisée, voire huppée, totalement intégrée à intelligentsia blanche et de larges masses vivant dans la précarité et la pauvreté, ayant convenu que l'intégration ne se fera jamais et qu'il vaut mieux se réfugier dans un capitalisme sauvage basé sur le trafic ( drogues, blanchiment d'argent... ).

La survie politique des noirs se résume à sa participation aux élections municipales et présidentielles. De nombreuses grandes villes industrielles sont dirigées par des maires noirs, qui dans leur immense majorité se rallient une fois élus à une vision très peu sociale du management de leur cité, faisant alliance avec les forces les plus réactionnaires pour assurer leur réélection. Quant à l'engagement d'Obama en faveur de ses condisciples, il est un exemple mirobolant de ce que l'on pourrait appeler la politique de non-intervention. Ce qui n'est guère surprenant si l'on suit – et le livre le permet à merveille – l'évolution des partis Démocrate et Républicain au cours des âges. Le parti de l'Âne étant celui du Sud s'opposant à l'Eléphant nordiste abolitionniste. Les noirs et les pauvres n'ont rien à attendre de ces deux forces politiques qui au-delà de leurs rideaux de fumée idéologiques ont été de tous temps les vecteurs de l'emprise capitalistique sur la plus grande démocratie du monde.
Ahmed Shawki est le rédacteur en chef de l'International Socialist Rewiew, vieille revue née en 1900 qui fut tour à tour marxiste, trotskiste et qui aujourd'hui analyse la naissance d'une nouvelle gauche radicale, notamment en Europe... Pas vraiment musicale, mais le blues et le rock and roll sont dans leur essence des musiques populaires issues des classes les plus défavorisées...
Damie Chad.
17:02 | Lien permanent | Commentaires (0)


