19/10/2015
KR'TNT ! ¤ 252 : DAN KROHA / MIDNIGHT SCAVENGERS / HOT CHIKENS / RAW POWER / JEAN-FRANCOIS JACQ
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 252
A ROCK LIT PRODUCTION
22 / 10 / 2015
|
DAN KROHA / MIDNIGHT SCAVENGERS / HOT CHIKENS / RAW POWER / JEAN-FRANCOIS JACK |
|
AVIS AUX LECTEURS Nous avons mis cette 252° livraison de KR'TNT en avance dès ce lundi. Ceci pour les esprits distraits qui n'auraient pas lu notre 251 ° édition. Nous profitons de l'occasion pour corriger une erreur dans notre 251. L'article de Tony Marlow sur Johnny Meeks et Jerry Merritt est paru dans le N° 346 de Jukebox Magazine et non dans le 246. Keep Rockin' Till Next Time ! |
28 – 09 – 2015
LA MECANIQUE ONDULATOIRE / PARIS XI
DAN KROHA
KROHA KROHA
Pour qui était-on à la Méca ce soir-là ? Pour le Kroha rythmeur de Gories ? Pour le Kroha stripper de Doll Rods ? Pour le Kroha Kroha du gibet de Montfaucon ? Pour le Kroha d’acou d’Angels Watching ? Pour le Kroha pas Croate de Detroit ? Pour le Kroha banana de Copacabana ? Pour le Kroha bandeur fou de Plaster Casters ? Pour le Kroha koala au cacao ? Pour le Kroha de cheville tordue et d’Abordage ? Pour le Kroha d’Hey-Hey-Hey We’re The Gories ? Tout bien réfléchi, on devait être là pour tous ces Kroha-là.
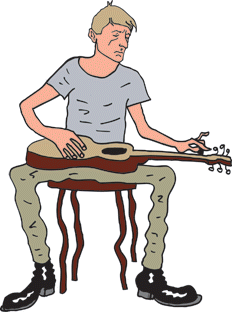
Un petit noyau de fans s’agglutinait au pied d’une scène anormalement déserte. Ce dénuement sentait le manque de moyens, pour ne pas dire la misère. Danny Kroha ne disposait en tout et pour tout que d’une vieille chaise, d’une guitare pas très fraîche et d’une set-list chiffonnée posée au sol. Il portait des biker boots en bon état, une chemise et un jean dans les tons gris clair relativement propres. Tout en lui exhalait l’aigre odeur de la précarité. Il inspirait ce profond respect qu’inspirent bien malgré eux ceux que le destin écrabouille et réduit à l’extrême pauvreté. Ah si seulement il avait pensé à poser un gobelet au bord de la scène, on lui aurait volontiers donné la pièce ! Même s’il paraissait en bonne santé et qu’il affichait une mine resplendissante, celle de l’étudiant américain à l’accent gras qui ne manque de rien, on ne pouvait pas s’empêcher de se faire du souci pour lui. Assis sur sa chaise, il semblait très absorbé. Il attaqua un set composé de blues acoustique, de gospel et de hillbilly particulièrement primitif, celui des habitants des cabanes croulantes typiques du Sud des États-Unis. On pense bien sûr à ces misérables métayers blancs que photographia Walker Evans en Alabama lors de la grande dépression des années trente. Ce Kroha-là cherchait surtout à montrer qu’il assumait la dureté de cette condition. Il communiquait très peu avec le public. Quelque chose de profondément touchant se dégageait du personnage. Il montrait aussi un certain courage, surtout lorsqu’il entonnait ses chants de gospel d’une voix forte. Au premier rang, une jeune femme pleurait, sans doute bouleversée par l’immense beauté de cette désespérance.

De cut en cut, ce Kroha-là semblait développer une sorte de grandeur expressive, même si en même temps il luttait pour éviter toute forme de dérive vers la démesure, ce qui est souvent le risque avec le gospel. Il luttait pour créer un climat et en même temps il veillait à le verrouiller, car il le voulait résolument austère, à l’image de sa condition et de celle des gens dont il relatait les histoires. Par moments, il atteignait à une sorte de grandeur fascinante. Eh oui, l’austérité peut parfois fasciner, ce qu’avait très bien compris Grant Wood lorsqu’il peignit American Gothic. Wood profita d’ailleurs de l’occasion pour transformer ce miroir aux alouettes qu’on appelle encore American dream en American nightmare.

À travers ses reprises de chants traditionnels, ce Kroha-là évoquait un monde qui n’en finira plus de nous échapper. Pourquoi ? Parce que nous avons été élevés dans une autre culture et engraissés sociologiquement parlant d’une toute autre pâtée. Les Français d’une certaine époque ont bouffé du de Gaulle pimenté de ratonnades, du Giscard à la sauce Bokassa, du Simca et du Guy Lux intérieur, du Sheilo et du Ringa à gogo, alors que Danny Kroha nous parle d’un monde de gens à la peau noire maintenus dans la misère et dans la peur, et nourris de boll wevill, de prêches de pasteurs évangélistes, de diddley bow et de la poussière des routes. Et surtout des anges du paradis, que les vieilles civilisations occidentales ont depuis longtemps chassés comme des malpropres, sous prétexte de progrès social. Et elles ont eu raison, ces vieilles civilisations occidentales ! Si elles disposaient d’une main au bout d’un bras, on irait la serrer chaleureusement pour dire merci. Les populations noires d’Amérique considéraient probablement la religion des blancs comme un refuge, ou tout au moins un bon ersatz de leurs croyances animistes, mais les populations blanches du vieux continent ont depuis longtemps rejeté cette institution religieuse qui au fil des siècles s’est défaussée du concept originel de la charité chrétienne pour s’adonner à tous les vices, à toutes les corruptions et à tous les excès de barbarie.

Alors bien sûr, cette musique traditionnelle attire les esprits curieux comme la lampe attire les papillons de nuit. On parle ici d’une espèce de curiosité intellectuelle, mais certainement pas de frisson épidermique, car le country blues primitif est d’une aridité exemplaire, contrairement au rockabilly primitif qui peut envoyer au tapis dès le premier round. Deux choses jouent cependant en faveur du country blues des origines. Le fait que cette musique soit difficile d’accès peut la rendre plus attirante. Il en va du blues comme des femmes. Celles qui commencent par se refuser se révèlent souvent par la suite les plus ardentes. Et la deuxième chose, c’est que ce blues extrêmement aride nous plonge le museau dans notre bêtise, ce fameux sectarisme qui depuis cinquante ans ronge le petit peuple rock comme une lèpre. À quoi sert la culture rock ? Mais à s’ouvrir au monde, comme toute autre forme de culture. Sinon ça n’a aucun sens. Profitons de l’occasion pour rappeler que nous devons absolument tout aux passeurs, à des gens comme Lux Interior ou Mick Farren, comme Sam Phillips ou Brian Jones, comme Tav Falco ou John Hammond, comme Kim Fowley ou Jeffrey Lee Pierce. Ce Kroha-là fait partie de ces gens-là. Il nous fait par exemple découvrir Frank Hutchinson à travers «Cannonball Blues», un extraordinaire blues traditionnel issu des temps les plus reculés. Hutchinson qui était un mineur établi dans les années trente en Virginie fut le premier musicien blanc à enregistrer du blues. Il composa surtout le fameux «Stagger Lee» que tout le monde ou presque allait reprendre. On retrouve bien sûr «Cannonball Blues» sur l’album solo de ce Kroha-là, «Angels Watching Over Me». Dans ses notes de commentaire, Dan précise qu’Hutchinson est l’un de ses all time favorites. Ce blues hanté rappelle bien sûr ceux du grand Robert Pete Williams, ce nègre à tête de saurien qui fascina tant Captain Beefheart.

Sur sa chaise, ce Kroha-là rendit aussi des hommages chaleureux à Charlie Patton et au pauvre vieux Son House qui en son temps grattait son dobro avec une violence terrible. En reprenant «Run Little Children», on voyait bien que ce Kroha-là recherchait l’hypnotisme du North Mississippi Hill Country Blues. C’était à la fois magnifique et taillé pour la route. Il n’en finissait plus de taper dans l’Americana des vieux pasteurs de l’Avant-siècle. Il revenait inlassablement à son cher gospel des cabanes et braillait «Holy Ghost Don’t Leave Me» d’une voix forte qui s’en allait résonner sous la voûte en pierre de la petite cave. Ce Kroha-là semblait assis parmi les peaux de castor, loin des églises inféodées au Vatican. Il réussissait le prodige de recréer l’atmosphère d’un bivouac de mineurs établi au bord d’un ruisseau de montagne. Les accents de sa voix forte charriaient l’écho du temps. Comme John Hammond avant lui, il tapa de bon cœur dans «John Henry». Il fallait le voir se battre avec l’insondable âpreté du primitivisme. Quelle admirable confrontation ! Ah mais quelle empoignade ! Il nous travaillait ça au corps à la manière de Son House et frappait ses cordes à la diable. Ce Kroha-là joua aussi pas mal de morceaux en slide, avec la guitare posée sur le genoux. Dommage qu’il n’ait pas pensé à apporter son banjo, car sur l’album des Anges, il en joue sur plusieurs cuts, à commencer par l’effervescent «Rowdy Blues». On l’y entend gratter son vieux banjo en peau de phoque d’Alaska. Oh, il faut voir comme il tape dans le dur du vermoulu de 1892, mais sa voix est nettement plus claire que celle de Bukka White. Ce Kroha-là travaille essentiellement la résonance. Il veille méticuleusement au grain du séculaire. Il nous gratouille aussi «I Want To Live So God Can Use Me» au diddley bow et au petit banjo vertueux. On l’entend aussi chatouiller le dulcimer dans «Walking Boss». Il en fait une fantastique pièce d’exaction concomitante boostée à l’hypnotisme blafard. Il reprend aussi le «You Got To Move» de Fred McDowell rendu célèbre par les Stones sur Sticky. Mais ce Kroha-là l’entreprend à la bonne franquette pour se rapprocher au mieux de la version originale. Il rend ensuite hommage à Dock Boggs, un banjo-man du blues complètement inconnu de nos services. Franchement, ce Kroha-là semble prendre un malin plaisir à saluer des gens terriblement obscurs ! Retour au gospel batch avec «Before This Time Another Year». Ce Kroha-là s’y comporte en troubadour de l’impossible. Il va bien plus loin que John Hammond, car il chante ça de l’intérieur du menton. Puis il réexpédie Blind Lemon Jefferson au firmament avec «Jack O Diamonds». Animal on est mal, comme dirait Gérard Manset. Quel beau disque !
Signé : Cazengler le Krohagnon
Dan Kroha. La Mécanique Ondulatoire. Paris XIe. 28 septembre 2015
Danny Kroha. Angels Watching Over Me. Third Man Records 2015
10 - 10 - 2015
HAPPY BAR / LE HAVRE ( 76 )
MIDNIGHT SCAVENGERS
THE MIDNIGHT HOUR
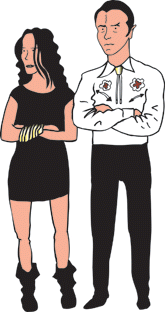
Quoi ? Les Midnight qui ? Ah les Midnight Scavengers ? Oh un groupe australien ? Hein ? Au Havre dans un bar ? De quoi ? Des histoires de Ghost Town et de péché ? Ah bon ? Avec une fille à la guitare ? What ? Faut les voir sur You-Tube ? Quoi ? Ils sont en tournée en Europe ? Ah bon ? Ils pourraient signer sur Closer ?
Pas de chance, le même soir à Rouen on avait les Hot Chicken en concert. Pas facile de prendre une décision. Pire que le Choix de Sophie. Prendre le risque d’aller bâiller aux corneilles devant une énième resucée de Birthday Party, un groupe qu’on a toujours franchement détesté, ou savourer la crème de bop des Hot Chicken à deux pas d’ici ?
Mais au fond, que serait la vie sans cette bonne vieille prise de risques ? On perd, on gagne, et puis voilà. En tous les cas, c’est une façon comme une autre de rester en vie.

Le concert avait lieu à l’Happy Bar, un endroit situé sur les quais. On entre, on tombe sur un bar et sur le côté se trouve une salle riquiqui, comme à l’Escale. Le groupe occupe la moitié de la surface au sol. Très peu de monde, comme souvent dans ces concerts havrais. Curieusement, les gens ne semblent plus vouloir s’intéresser à cette scène qu’il faut bien qualifier d’underground de l’underground. Dommage, car les Midnight Scavengers valent sacrément le détour. On a là un groupe solide, bien en place et qui en prime propose des compos déterminantes. Ils chantent la plupart du temps à deux voix. Ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, Blanche, un couple de Detroit qui faillit bien décrocher la timbale dans les années 2004-2007, avec un impressionnant mélange de Southern Gothic, de garage et de country déliquescente. Pourquoi Dan John Miller et sa femme Tracee Mae ne sont-ils pas devenus énormes ? Allez savoir ! L’infernal Jack Lawrence qu’on retrouve dans les mighty Greenhornes jouait aussi dans ce groupe qui disposait de tout l’attirail nécessaire pour créer l’événement. Il se pourrait bien que les Midnight Scavengers réussissent là où Blanche a échoué.

Car les Australiens disposent eux aussi de tout l’attirail nécessaire. Ce petit concert sans prétention fut une sorte de révélation. Et le diable sait si on adore les révélations ! Ces quatre Australiens de Melbourne savent créer des climats. Pour eux, c’est un jeu d’enfant que d’embarquer un public. Le groupe fonctionne sur deux pôles. Le +, c’est le pôle assis, le pôle mélodique et aussi le pôle du cap. Il s’appelle Dimitri Kucharzewski, Français installé à Melbourne, vêtu d’une chemise western blanche et installé derrière un piano électrique, présence sombre et voix bien posée, une voix bien à lui, qui ne doit rien à personne et surtout pas à Nick Cave auquel on serait tenté de le comparer. Non, il chante plus haut, il hante et il déraille quand il veut. Le pôle -, c’est le pôle debout, le pôle sauvage et féminin, le pôle grungy des crises de palu de distorse. Elle s’appelle Johanna Brockman, pur rock’n’roll animal, véritable graine de star, petite brune timide et en même temps blasteuse de haut rang. Elle porte des tas de bracelets, une petite robe noire et des bas filés. Elle chante d’une voix forte et rejoint Dimitri à l’unisson. Pour ceux qui se souviennent des leçons de physique, les deux pôles créent un courant électrique, ce fameux éclair jaune qu’on voit courir dans le laboratoire du docteur Frankenstein. La musique des Midnight Scavengers, c’est ce flux d’électrons, cet éclair jaune permanent. Cette fantastique dynamique électrise «Legitimate Desire», un cut qui sonne comme une cavalcade épique. Dans un monde normal, «Legitimate Desire» serait en passe de devenir un hit planétaire. Quand ils dépotent ça à l’Happy Bar, on peut bien dire que les colonnes du temple tremblent ! Et Johanna ressasse inlassablement le thème du cut avant de plonger le groupe dans la fournaise d’un solo de bouillasse à la distorse. «Legitimate Desire» est l’un de ces hits têtus qui rendent fou, qui frappent aux tempes, qui remontent à la surface du temps. Ah il faut voir cette diablesse poser son thème sur le beat sec et parfait du petit batteur aux cheveux noirs de jais. Quelle fantastique allure ! Ce groupe peut enfin jeter la lumière sur cet underground de l’underground si riche de bons groupes et que les medias ignorent par manque de curiosité, ou par incurie, on ne sait pas. Il est évident que ces Australiens vont sortir la vieille Europe de sa torpeur. Et c’est chanté à deux voix, comme porté au pinacle ! Et derrière, l’homme au chapeau joue ses lignes de basse avec l’efficacité d’un vétéran de toutes les guerres. On est à la fois content de voir ce groupe dans un bar minuscule, et triste pour eux, car franchement, ils sont de taille à remplir des grosses salles.

Ils ont un autre morceau très ambitieux, «Good As Sin». Ils l’ouvrent avec un chant de réparties. Elle sort une voix mûre et il rétorque d’une voix ferme, un brin nasillarde. Elle passe un solo en note à note et soudain le tempo s’emballe et c’est la violente embardée d’un embarquement pour Cythère. Tout le monde à bord ! Par leur bouillon d’énergie, ils font grimper la chose au sommet d’un Everest et Johanna joue des gimmicks fonciers qui enfoncent les poternes des badernes avec une niaque qu’on n’avait plus revue depuis les grandes heures du «Blue Line Swinger» de Yo La Tengo. Ils sont terrifiants de drive. Ils déploient des trésors de pop imparable. Ils tapent dans l’excellence d’un beat pop défiant toute concurrence et c’est monté sur le drive d’un chapeau-man qui ne paie pas de mine mais qui joue comme une bête. Ses lignes de basse croisent dans le lagon comme un requin alors qu’autour de lui charge la Brigade Légère. On voit rarement des épisodes aussi intenses. Pour ceux qui auront la chance de choper l’album, c’est l’un des dix hits qu’on y trouve. L’autre monstruosité du set s’appelle «Sweet Soft Pearls», un cut qu’on croit d’abord suspendu, puis qui plonge dans un absolu de son, mais un son plein à la Mary Chain, une overdose de son terrible et sans retour possible. Il s’agit là d’une motherly atmosphère d’hallucination territoriale bien amenée aux raindrops et au chant d’augure lugubre complètement implosé. Et cette diablesse de Johanna rentre là-dedans au note à note, eh oui, elle va chercher des notes magiques et elle en claque même à vide, elle joue ça au tatata de fil terrible. C’est du pur jus de Grasshopper, elle renoue avec la magie des solos de «Deserter’s Song», qui en 2008 ont infesté l’Elysée Montmartre. On se gave aussi du fameux «Ghost Town» d’obédience gothique. Dimitri plonge dans le gothique spectral et induit un bel échange à deux voix. Et comme pour les autres cuts, ils font vite monter la température, ils stupéfient par leur maîtrise de l’unisson et ça explose littéralement au retour de couplet. En voilà deux qui savent maîtriser les orgasmes, car ils repartent de plus belle. Ils fouaillent l’atmo et Dimitri lâche un jive de jazz dans l’épaisseur du groove alors que Johanna gratte ses power-chords de Jaguar à la ramasse de bas filés. Ils s’intériorisent complètement dans leur son et leurs retours de couplets ne pardonnent pas - Keep shaking till the sun - Écoutez aussi sur l’album «Old River» et sa merveilleuse ambiance plombée au stoner gothique d’apocalypse. Ils amènent ça comme la rivière sans retour, glacée de son grandiose. On dirait même qu’ils chantent dans la crypte du néant. Mais là, ils se condamnent à la glaciation éternelle. On se réchauffe avec «Remember Me», un country-rock chanté à deux voix et soudain Johanna part en virée. C’est du pur jus, ils renouent avec l’art sacré de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

Curieusement, chacun de leurs morceaux accroche. Chacun d’eux semble gonflé de toute la puissance du diable. Ils jouent aussi deux ou trois cuts garage, comme «Run On», et c’est Dimitri qui drive the beast. Même chose pour «Two Legged Rat», que Johanna attaque au grunge de jag, doublé par un drive puisant de Jeff Hooker, alias chapeau-man - Oh no ! Dimitri se bat avec les démons, c’est accablant de mortiférisme et Johanna claque les accords les plus violents d’Australie. Ils ne lâchent rien ! On a là une pétaudière, mais ça ne suffit pas, car Dimitri tire ça vers le haut, il a encore cette énergie. On n’a pas idée.
Signé : Cazengler, midnight remblais
Midnight Scavengers. Happy Bar. Le Havre (76). 10 octobre 2015
Midnight Scavengers. Midnight Scavengers. Kasumuen 2015
17 / 10 / 2015 – COUILLY-PONT-AUX DAMES
LOCAL METALLIC MACHINES
HOT CHIKENS

La teuf-teuf ronronne comme un cou-cou suisse. Bercé par le ronronnement régulier de la machine, mon esprit s'évade vers les hautes sphères de la méditation philosophique. Démarche hautement platonicienne qui entrevoit toute connaissance comme un érotologie infinie tendue vers le désir de son accomplissement. En réalité je peste contre les fonctionnaires de la DDE. Nous sommes à trois kilomètres de Couilly-Pont-Aux-Dames et nous n'avons encore rencontré aucun panneau arborant fièrement le nom si jouissif de cette localité. Perso, je l'imagine calligraphié sous différentes formes, en bâtonnets sucre d'orgie romaine, en rébus vent Dubout Albert, en idéogrammes chinois suggestifs, en haiculs japonais poétiques, cette saine lecture vous obligerait à modérer votre vitesse bien mieux que ces radars qui réfrènent vos élans. Evidemment ce serait moins rentable pour l'Etat. En attendant le mieux à faire c'est d'arrêter d'appuyer sur le champignon hallucinogène. Vincent. Car tous les chemins mènent à Rock, me dis-je. Et ce soir, ce n'est ni aile ni cuisse de poulette grillée au menu, mais du Hot Chikens torride à dévorer, bien chaud et bien saignant.
Retour au local Metallic Machines. Cheval de fer, cheval d'acier. Accueil convivial et sympathique. Une sacrée brochette d'amateurs de rock and roll. De nouvelles têtes aussi. Qui sont manifestement venues par ouï-dire – cet autre nom de la renommée – et qui ne savent pas dans quelle fournaise elles ont posé le pied.
CONCERT
Pour le moment c'est tranquille. Thierry Sellier attend placidement derrière sa batterie. Kit grenat minimal, mais costume marron du dernier chic anglais, gros noeud de cravate du dimanche, la french touch. Hervé Loison– vaste veste noire qui cache une chemise rouge sang, caresse gentiment son micro. Le public s'agglutine. Comme à la messe quand le prêtre a déclaré qu'au lieu de l'hostie traditionnelle il distribuerait des choco BN. Jamais deux cent trois. L'en manque juste un. Le guitariste – dont l'absence se remarque très vite dans un groupe de rock. Mais Christophe Gillet se fait attendre. Trente secondes passent, assemblée rieuse. Aux grands maux, les grands remèdes. Sans prévenir, Hervé avale le cromi, d'un seul coup, le coince au fond de ses amygdales et lance le cri de ralliement, l'appel au secours, le borborygme guttural si particulier du poulet vivant que la ménagère enfourne dans le four brûlant. Comme par magie Christophe apparaît, à grands pas il fend la foule, tenant entre ses mains le précieux graal d'un gobelet de cervoise rempli à ras bord. Je ne sais si c'est en l'honneur du patelin, mais le haut de sa chemise est divisée en petits carrés noirs et blancs, un damier idéal pour jouer aux dames. Ceint sa guitare yin, blanche à pickguard noir, la yang noire à pickguard blanc restera toute la soirée à côté de lui sans qu'il s'en serve une seule fois. N'aura pas le temps. J'insiste un peu sur le début parce qu'après les images se télescopent dans la tête des témoins. Je parle des rares survivants qui ont su garder dans le brainstorming musical qui a suivi quelques rares parcelles de neurones mémoiriels en état de marche. Le temps qu'Hervé s'empare de sa big mama et. Un peu de patience. Me faudrait être Victor Hugo et vous composer un poème de trois cents alexandrins pour vous la décrire. Elle le mérite. Une véritable veuve noire. Ne pleurez pas pour son mari. C'est elle la morte. L'a dû faire toutes les guerres du rockabilly. Plus celles du psycho. Plus celles du punk. Imaginez une longue caisse aussi funèbre qu'un cercueil, au contour rehaussé d'un filet blanc. Mais en sale état. Fendue en plusieurs endroits. Vu les entailles, ce doit être à coups de hache lors d'abordages particulièrement mouvementés, par une houle de force 10, comme l'on prévient dans le bulletin de la météo marine. L'est tatouée d'inscriptions au blanco qui doivent remémorer de hauts faits d'armes prestigieux. Ou à venir, car l'on y déchiffre sans difficulté la date d'anniversaire des quarante ans de la mort du Hillbilly Cat. Toutefois contemplant l'état des dégâts, Hervé compatissant laisse tomber une sombre prophétie empreinte d'une immense sagesse : « M'étonnerait qu'elle soit encore là en 2017 ! ».

La question qui ne se pose pas. Vous aimez Gene Vincent ? Autant demander à un chat s'il aime les souris. Ce soir les Hot Chikens seront terriblement rock. Gene Vincent, Johnny Burnette, Little Richard. Que des reprises. Oui mais à la sauce Hot Chikens. La recette est simple. Vous croyez connaître. Vous allez les découvrir. Sont trois mais ne se partagent pas le travail. La règle est simple, je fais tout le boulot, et quand j'ai terminé je recommence. Au fond, au milieu, derrière ses lunettes, Christian ricane. Ses baguettes ricochent sur la caisse claire et immanquablement elles finissent par se jeter sur les cymbales. Pas à cinq balles la paire. C'est la section cuivre des Hot Chickens, pas de vent mais le tonnerre avec les éclairs qui fusent. Ça ne rutile pas dans le futile. Des vibrations qui vous fusillent le tympan, mais vous n'avez pas le temps de devenir sourd, la grosse caisse est là pour vous déboucher les oreilles. Thierry se marre, hilare du début à la fin du concert. S'amuse comme un gamin qui lance des pétards le soir du quatorze juillet. Ce qu'il y a de terrible avec lui, c'est que quand vous croyez être au bout du break et déjà sur le générique de fin, il vous repasse la séquence en accéléré, des fois que vous auriez tout compris et manière de vous donner un autre aperçu de la réalité du monde.

L'on aurait envie de le plaindre, mais il en s'en sort comme un roi. C'est quoi un bon guitariste ? C'est un gars comme Christophe. Un peu comme le Dupin d'Edgar Poe, qui vous résout les intrigues les plus mystérieuses, celle de la Lettre Volée, celle du Double Assassinat de la Rue Morgue, sans quitter son bureau. Méthode efficace. Une difficulté, un plan. Une deuxième difficulté, deux plans au choix. Et ainsi jusqu'à plus soif. Suite exponentielle. Lui il choisit la résolution qui vous semblerait la plus hasardeuse. S'en moque. Est sûr de lui. L'a de la marge. Pas le genre de gars à vous resservir les solutions toutes faites de Cliff Gallup, sur I Flipped, par exemple. Non, possède ses propres clefs. Qui s'adaptent aux serrures les plus étroites. Vous réalise deux ou trois petites performances par morceau. Comme si de rien n'était. Des évidences qui vous laissent coi. Qui vous laissent quoi ? Vos doigts pour pleurer.
Faut les voir ces deux oiseaux de bonheur. Les ai particulièrement appréciés sur les deux morceaux les plus erratiques de Little Richard, True Fine Mama et Rip It Up, deux calamités, deux fils du Nyarlathotep, le dieu du kaos rampant cher à Lovecraft, deux bordels généralisés qui s'effondrent de tous les côtés, faut le génie du Petit Richard pour ramener les débris à la maison, et vous les recoller comme neufs à la sécotine atomique. Vrai qu'Hervé les aide, à la voix et à la contrebasse. L'a l'intelligence des morceaux dans sa cabosse, sûr qu'il sait rouler sa bosse, mais sans Thierry la terreur souriante qui casse, qui fragmente, qui pile, qui brise, qui éparpille la vaisselle et Christophe qui classe méthodiquement les tessons sur l'étagère comme s'il était le Conservateur en Chef du département des Antiquités du Louvre, que ferait-il ?

Je laisse la question sans réponse car c'est Hervé qui nous pose la sienne. Aurions-nous besoin d'une pause, le temps de nous ravitailler au bar, ou préférerions-nous rajouter tout de suite à cette heure et demie de tonitruance monstrueuse une deuxième section d'une heure trente ? Précision, pas un truc à la bis repetita placent. Non, un fuckin rockin set de tous les diables. La réponse est unanime : deuxième rasade de concentré de hot dose de rock and roll illico presto subito expresso bongo.
C'est vrai que Monsieur Loison a été très sage jusqu'à maintenant. L'a juste porté le set sur ses épaules, et avec les deux cadors à ses côtés l'ensemble doit être particulièrement lourd. Mais enfin, il n'a fait que son devoir de rocker. Tirer sur les cordes de la big Mama comme s'il voulait arracher les poils du pubis à sa fiancée pour qu'elle paraisse encore plus nue, et s'adonner à de copulations orales avec son micro poisseux, tout en éructant ses volcaniques lyrics destructeurs. Va falloir maintenant entrer dans le vif du sujet.

L'est temps de s'intéresser à l'autre face du rock and roll. La noire, celle de l'origine. Le blues. Une autre particularité d'Hervé Loison, préfère le Delta au Chicagoan. Pas de panique je n'ai pas dit que l'on allait verser de souffreteuses larmes amères sur le bois d'une guitare sèche. A l'humidification pleurnicheuse, notre chanteur préfère l'électrification ravageuse. D'ailleurs il jette sa contrebasse à terre et s'empare d'une basse électrique. Priez pour elle. Pour nous aussi. L'esprit du vaudou est sur nous. Tous les crotales du Delta sont parmi nous. Loison est à terre. N'est plus lui-même, l'est le Baron de ce Samedi soir. La force est avec lui. Il est le crachat et l'exaspération, la rage et la folie, le blues de la glaise à la puissance mille, il miaule dans son harmonica, feule, grogne, craquète, aboie, berseker chamanique de la transe totale, n'est plus que le réceptacle de forces animales qui le dépassent. Qui nous envahissent. Se vautre sur sa contrebasse comme un reptile lubrique, agonise sur les planches, l'on se précipite pour lui faire ingurgiter des verres et des verres de sky, il est nous et nous sommes lui, se relève pour un vincenal Baby Blue que toute la salle reprend en choeur, nous appelle pour qu'on soit ses clappers boys sur un dantesque Five Feet of Lovin, et puis satyre dionysiaque infatigable il ameute toute la gent femelle – qui succombe sans hésitation - à le rejoindre sur scène, l'est là, pantelant, torse dénudé, Orphée parmi les ménades, micro, chant et harmonica en bouche, son pied slidant sur la basse aux mains de la blonde Béatrice, et puis se relève, lui arrache la guitare et la fracasse sauvagement sur le rebord de la scène. Ce n'est pas fini, se jette comme une victime expiatoire dans nos bras levés et nous le promenons bien haut comme l'image de notre folie au travers des deux pièces du local. Eric des Crazy Dogs se charge de la contrebasse pour les derniers morceaux. Encore une longue psalmodie incantatoire aux esprits totémiques de la terre du blues, qu'il voudrait finale, mais qu'il devra réitérer en guise de rappel. Intercalé l'on aura une gâterie, un Rumble, dumble, scrumble pas du tout humble sur la guitare pétaradante de Christophe Gillet. Merci les Hot Chikens. Ce soir la houle du rock and roll et la goule du blues ont fusionné.

APRES CONCERT

C'est fini, mais tout le monde restera là plus d'une heure, devant la scène à discuter avec les trois riffeurs du diable. Regards radieux et éberlués de ceux qui viennent d'assister pour la première fois à ce rite catharsique qu'est un véritable concert de rock and roll. Se pressent autour de la valise à disques. Ont envie d'emporter chez eux, chez elles, un éclat de cet instant, un témoignage de ce qu'ils ont touché à une autre dimension. Gonna Have Some Fun Tonight comme aimait à le répéter Mister Penniman.
Damie Chad.
P.S. : mention spéciale à Mister B qui profite de l'occasion pour tenter le riff de Maybe Baby du sacré compagnon Holly Buddy ( les Chikens Chauds, nous ont offert deux extraordinaires Rave On et Oh ! Boy ! ) sur la Big Mama d'Hervé.
( Photos sur FB Sonia Amandine Couronne et Christophe Banjac )
RAW POWER
UNE HISTOIRE DU PUNK AMERICAIN
STAN CUESTA
( Castor Astral / Octobre 2015 )
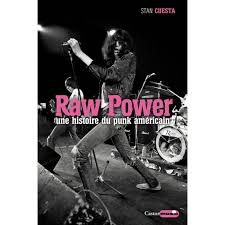
Ce n'est pas bien gros, vous le dévorez en une soirée. A peine cent cinquante pages petit format, on a rajouté une chronologie et un index – le genre de truc indispensable – et l'interview de Lenny Kaye - c'est un peu le chouchou de notre cicerone - in-extenso alors qu'il est abondamment cité dans le corps du récit. Mais c'est un must. Comment Stan Cuesta a-t-il réussi l'impossible : tout dire en ne rapportant que l'essentiel ? Un bouquin d'une limpidité extraordinaire, clair comme de l'eau de rock. Buvez à cette source vous aurez l'impression de devenir intelligent.
Stan Cuesta pose une seule question : qu'est-ce que le punk ? Et contrairement à ce à quoi l'on s'attend d'habitude, il donne la réponse, la bonne. Celle que vous ignoriez. Votre cerveau vous a déjà fourni une fiche : mouvement musical d'une extrême violence naît en Angleterre. Tsseu ! Tsseu ! Appel discret du pied les gars, le sous-titre c'est bien punk américain, alors les Pistolets du Sexe que vous vous apprêtiez à dégainer, rentrez-les dans votre braguette. Sortez les rames et souquez ferme, direction America the great.
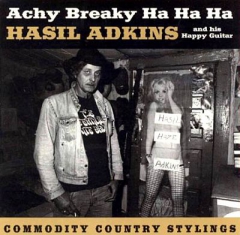
Inutile de vous arrêtez à New York, le départ est donné in the South, et dans un temps beaucoup plus lointain que vous ne l'espériez. Car le punk en tant que lui-même, Stan Cuesta il s'en moque autant que de son premier bretzel au beurre de chèvre naine cuit à la vapeur, lui ce qui le motive, c'est l'esprit du punk. Hautement plus difficile à entrevoir. Enfin pas vraiment, selon lui le punk est né aux doux temps du rockabilly. Tous ces jeunes qui du jour au lendemain se sont lancés dans la musique comme on se jette de la fenêtre du troisième étage, sans réfléchir, just for fun, certains sont même parvenus à enregistrer un éphémère, un single, qui a fait quarante-cinq tours sur le pick up de la gloriole avant de disparaître à jamais. N'y a plus que les collectionneurs fous qui recherchent ce genre de pépites ( nuggets in the Lenny Kaye translation ) aujourd'hui. Pas si déments que cela car parfois ce sont de véritables perles. En souvenir et en hommage à cette génération perdue, le livre est dédié au plus dangereusement dingue de tous. Un des rares qui a persévéré dans l''erreur jusqu'à sa mort : Hasil Adkins, le saint patron du punk !

Le FBI n'a pas dormi longtemps sur ses oreilles. Z'avaient réussi à juguler le rock sauvage des pionniers, l'on aurait pu croire que la marmaille américaine oublierait rapidement leurs idoles hurlantes. Avec le sirop vaporeux que leur desservait la TV, les stratèges de la sécurité intérieure avaient cru s'être débarrassés de cette improbable nichée de monstres. Il n'en fut rien. Pire que les têtes de l'Herne. Les combos rock se sont mis à proliférer. Partout. Mathématiquement l'équation était facile à résoudre : un garage ( et le Dieu de la Sainte Bible sait combien les américains étaient, in the fifties and in the sixties, entichés des grosses bagnoles ) abritait obligatoirement un groupe de rock. Ce fut l'époque bénie des garage-bands. Des gamins qui ne savaient pas jouer mais qui avaient compris que cela vous posait un max devant les filles. Il y en eut des dizaines de milliers. Tous aussi mauvais les uns que les autres. Mais ô combien jouissifs ! Un déluge sonore ! Un peu chaotique pour le rythme, ce n'étaient pas des experts, ça batifolait dans les entournures, tout comme Louie Louie l'hymne garage par excellence, une zidouille cahotique, une galette infâme qui confine au génie pur. Nous sommes en 1964, et tout le monde écoute les Kingsmen.
LES AÎNES PRESTIGIEUX

Certains sont meilleurs que d'autres. Peut-être un peu plus persévérants. Ou alors tombent pile à l'endroit adéquat. Ce fut le cas du Velvet Underground. Qui eut la chance d'être pris en charge par Andy Warhol. Ce n'était pas qu'Andy possédât des idées nouvelles sur l'avenir du rock and roll. Du moment que le Velvet fît un scandaleux boucan de tous les diables lors de ses soirées publiques ou privées, il n'en demandait pas plus. Mais ce faisant il fit un merveilleux cadeau au rock and roll. De par sa caution, cette musique de prolétaires recevait ses lettres de noblesse. Le rock devenait Arty. Avait changé d'étage en montant les escaliers de la Factory. Le Velvet s'engouffra dans la brèche. Commença par renvoyer la belle Nico. Un charme vénéneux notre starlette qui flirtait déjà avec le statut du has-been, mais le groupe avait compris qu'il fallait du rentre-dedans. Ce fut la folie noire, la descente aux enfers, White Light, White Heat, l'album incandescent. Le dérèglement de tous les sons. La suite s'effilocha, le violon meurtrier de John Cale prenant trop de place, Lou Reed le vira et le Velvet Underground joua beaucoup plus sur son côté velours que sur son aspect souterrain très dostoïevskien.

Inutile de verser d'amères larmes, la relève était assurée. Non plus à New York ( trop bobo avant l'heure ) mais à Detroit. Le MC 5, genre cocktail molotov. Des diatribes incendiaires contre la guerre au Vietnam, une préférence marquée pour la révolution – très politisé, le MC 5. Mais ce n'était qu'un trompe l'oeil. Le MC 5 fut le premier groupe qui s'arma de guitares électriques. Les Stones avaient donné le la, l'année précédente avec cette fuzz box qui remplissait les sillons de Satisfaction d'un incroyable dégueulis de guitare, mais les MC 5 changèrent le fuzzil d'épaule, avant eux l'on n'avait jamais entendu cette jamborée de guitares à fond la caisse plate, rugissantes comme un moteur de tronçonneuse. Vous étiez sonnés comme un boxeur dans les cordes. Le premier disque des MC 5 est une déclaration de guerre.

Difficile de faire mieux. Alors les Stooges firent aussi bien, mais différemment. A première oreille, aussi frappés que le MC 5, mais à la deuxième écoute plus subtils. Je sais qu'il peut paraître primesautier de vanter la subtilité tsunamienne de Fun House. Mais Iggy et ses camarades n'avaient pas bavardé avec John Cale pour rien. Les Stooges c'est le MC 5 plus une gousse de Musique. Avec un M majuscule s'il vous plaît, cette musique classique qui est passée par les orgies sonores des tentatives phoniques du futurisme, et qui s'est accoquinée avec une pulsation jazz, entendue non pas comme une habileté concertante de musiciens doués, mais comme l'expression métaphysique de dépassement des frontières humaines, A Love Suprême à la Coltrane.
NEW YORK

Retour à la capitale artistique. Ne s'y passe rien. Les sixties sont terminées. Les seventies démarrent mal. Calme plat. N'exagérons pas. Les Rolling Stones américains sont en répétition. Pour bien marquer leur appartenance se sont appelés les New York Dolls. Au MC 5, ils ont emprunté les guitares. Aux autres ils n'ont rien pris. C'est le public et les journalistes qui vont les habiller. Eux, qui adorent les sapes et l'épate se sont déguisés en filles. Maquillés à outrance. Sans le vouloir ils percutent les intellects endormis, sont considérés comme des passeurs vers une modernité trans encore dans les limbes. Ces rockers sont des artistes visionnaires. Ce sont les proto-punk, les premiers punk, une musique sauvage avec un arrière-fond plus ou moins philosophico-nébuleux.
Le grand public américain ne les snobera même pas. Ne les connaît même pas. C'est un anglais qui comprend la hype avant tout le monde. Malcolm McLaren se dépêche de rentrer en la perfide Albion, vite, vite, il fonde un groupe sur le modèle de nos new yorkaises poupées. L'histoire des Sex Pistols est connue. Mais McLaren n'était pas revenu les mains vides in London. N'avait pas regardé que les Dolls. Toute une scène se mettait en place in the big apple.
ENFIN LES PUNKS !
Ouf, ils arrivent, les vrais de vrais, ceux qui bénéficient de l'appellation authentique. Tous ceux que nous venons de voir ne sont que des prémonitions. Et attention pas du rosbeef en tranches assemblées in the old England, non de la bosse de bison véritablement native. Quand on n'en a jamais mangé, le goût surprend toujours. Le punk américain est étrange. C'est comme les champignons, vous les trouvez dans les endroits les plus incongrus et les saveurs sont multiples.

Y a ceux qui correspondent aux poncifs comme deux gouttes d'eau. Les Heartbreakers qui ne sont que la suite logique des Dolls qui ont splitté. D'ailleurs ils sonnent comme les Dolls mais en mieux. Plus électriques, plus brillants, plus rapides, plus rock que tous les autres. Les punks anglais ne rateront pas un de leurs concerts lors de leur venue en vieille Europe. Ils sont les maîtres et les autres les élèves. De pâles épigones.

Dans la série, plus punk que moi tu es déjà mort, voici les Ramones. Jouent vite et fort. Aucun mérite, ne savent pas faire autre chose. Oui mais ils ont l'énergie. A revendre et il leur en faut pour leur parti-pris minimaliste. Blousons noirs et jeans troués, nous sommes loin des oripeaux et des colifichets des Dolls. Pour la musique, des morceaux de moins d'une minute avec des paroles bâtie sur le même modèle. Plus tard ils s'embourgeoiseront, ils atteindront les cent vingt secondes et perdront un peu de la flamme de leurs débuts.
On ne les attendait pas, mais font partie de la mouvance punk depuis le début. Ce sont les anti-Ramones des musiques raffinées et une superbe minette blonde au milieu. Blondie, ne donne pas dans le côté rustauds des cités. Sont des artistes, des vrais. Et en cela, si près de l'essence du punk américain mais déjà estampillés de l'appellation New wawe.

Le punk américain, c'est en même temps et les guitares qui hurlent et l'attention soutenue à la poésie. Patti Smith sera l'anti-Blondie, elle est brune et a des poils sous les bras. Mais n'a rien à voir avec un camionneur. Une sensibilité de poète, elle écrit, elle récite ses textes, elle est prête à toutes les dérives musicales, elle sait très bien s'entourer, d'Alain Lanier du Blue Öyster Cult, de Fred Sonic Smith du MC 5, de Tom Verlaine, de Lenny Kaye et de Richard Hell. Elle aime le rock qui déjante et Arthur Rimbaud, elle établit au travers de sa personne le lien avec les générations hippie and beat d'Alain Ginsberg
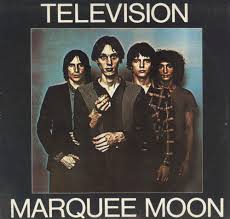
Mais c'est sans doute avec Richard Hell que le punk américain touche à sa plus grande extension. Chanteur, compositeur, écrivain, acteur, fera partie de Television, des Voidoids et des Heartbreakers. Pourrait être considéré comme l'idéologue du punk, mais qui n'aurait jamais prononcé une seule généralité, adonné aux actes et aux expériences. Les épingles double, les T-shirts déchirés du punk, c'est lui. Des inventions davantage suscitées par les aléas de la vie que par l'envie de choquer.
BEFORE AND AGAIN

Stan Cuesta en passe un plein paniers d'oeufs cassés en revue : Suicide, Modern Lovers, Dictators, Rockets From the Tombs, Seeds, Fugs, Talking Heads, Pere Ubu, Devo, le punk se mord la queue et s'éloigne de lui-même, se perd, se renie, se redécouvre... Pour tout comprendre, pour ne pas céder au chaos, suffit de suivre notre auteur, tire les fils et tisse des généalogies très signifiantes. Pour notre part nous finirons sur deux emblèmes : les Cramps en tant que retour foutraque au rockabilly, et X comme ouverture à tous les horizons passés et futurs du rock and roll. Le yang et le yin. L'oeuf et la mayonnaise. L'abominable et l'homme des neiges éternelles.
Damie Chad.
HEURT LIMITE
RECIT INCANTATOIRE
JEAN-FRANCOIS JACQ
( L'Harmattan / 1997 )

Jean-François Jack n'est pas un inconnu pour les fidèles lecteurs de KR'TNT ! L'est l'auteur du super beau livre Bijou, Vie Mort et Résurrection d'un Groupe Passion. Preuve que c'est un homme de goût. Quoiqu'il ait consacré un autre de ses ouvrages Le Soleil Noir du Rock Français à Olivier Caudron chanteur du groupe Lil Drop que pour ma part je rangerais dans le rayon variété... L'a une belle plume et j'avais alors ( livraison 145 du 15 / 05 / 14 ) promis de farfouiller quelque peu dans sa bibliographie. Donc acte.
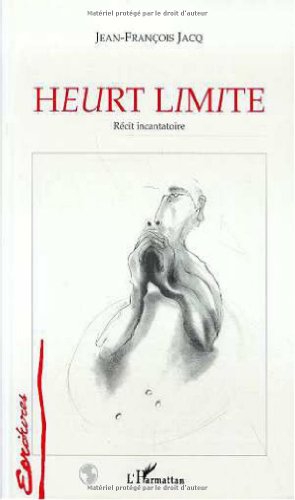
C'est l'histoire d'un homme qui court. Vers le centre de sa vie. Vous le suivez, ou plutôt il vous emporte sur son passage. Imaginez un film dont la caméra s'occuperait uniquement de l'acteur. Filmé au plus près. Pour les décors, vous vous débrouillerez comme vous pourrez. Sont absents. Invisibles. Le réalisateur opère seul. A supprimé tout ce qui est secondaire dans une vie. Les lieux, les évènements, les noms, les personnes. Une histoire sans comparses. Tout se passe dans la tête. Le cerveau fait office de filtre et de bouchon. Empêche le monde de rentrer, et le moi de se diluer dans le spectacle de l'univers. Aucun risque de vous ennuyer, le corps est mal bâti, mais la tête est bien pleine. D'une blessure sanguinolente, qui suppure indéfiniment. Notre arrivée au monde n'est pas une partie du plaisir. Nous arrivons ici-bas dans un flot visqueux de liquides amniotiques, de souffrances, de sang et de merde. Les individus normaux s'en détachent au plus vite. D'autres sont comme les poussins maladroits qui ne parviennent pas à se séparer de la coquille brisée qui leur reste collée sur la tête. C'est ainsi, le monde est peuplée d'injustices et pour certains la plus grande d'entre elles résident dans le simple fait de vivre.
Donc un homme qui rentre au plus profond de lui-même. Ne parlez pas d'introspection artistique. Aucune pose masochiste, aucun penchant décadentiste dans ce qui n'est pas une démarche, mais une course folle vers la mort. Parfois la vie est si dure qu'il vaut mieux chercher refuge dans le seul bunker délabré qui s'offre à nous : nous-mêmes, notre esprit, notre âme – appelez cela comme vous voulez – même si notre refuge est percé comme une passoire, comme un coffre-fort, comme une vieille durite pétée. S'arrêter, se fixer, équivaudrait à mourir. Cette fuite en avant en soi-même n'est pas un choix mais une obligation êtrale. Pas question de jeter l'ancre. Une seule solution laisser filer l'encre sur le papier. L'unique échappatoire est là, comme une artère tranchée qui pisse de tout son sang. Ecriture rouge pour une existence noire.

L'a pas trouvé le bonheur en débarquant dans notre monde Jean François Jacq. N'est pas le seul, il y en eut d'autre avant lui, et des plus prestigieux qui se sont fadés les chiennes hécatiennes de la maladie, de la souffrance, et les morsures de la plus cruelle de la meute impitoyable, cette dangereuse inaptitude à vivre qui vous pousse dans les derniers retranchements de votre corps. Ont des noms qui sonnent comme des défis, l'Antonin Artaud du Pèse-Nerf ou l'Arthur Rimbaud d'Une Saison en Enfer. C'est dire combien l'écriture est rabotée jusqu'à l'os, qu'entre la membrane du rêve et la matière osseuse il ne reste rien, ni la peau, ni la chair. Vraiment pas de veines. Et pourtant cette absence qui fait si mal.
Pour l'itinéraire nous lâcherons les grands mots, la maladie, l'enfermement, l'hôpital, la mort, le sexe, l'errance, la rue, l'alcool, la solitude. Beau tableau, de quoi noircir la page blanche du vide infini. Les situations se répètent, pas d'issue au labyrinthe, obligé de tourner – non pas en rond, ce serait trop facile – mais en spirale, jusqu'à vriller la paroi de l'isolement et parvenir à disjoindre les panneaux de votre finitude. Attention danger : s'extirper de la misère métaphysique de l'Homme pour se colleter à la déréliction du monde n'est pas non plus une solution merveilleuse. A croire que les deux tares congénitales de l'ère conjuguent leurs efforts pour vous persuader qu'au-dedans comme au-dehors il n'y a pas davantage de joie, rien de mieux à espérer. C'est ainsi que l'on devient fou, mais c'est l'ultime claustrale self-made-man enclosure que Jean-François aura refusée. S'est battu pour sortir de ce tourbillon fatal, se cramponner à une planche de salut, un débris du naufrage généralisé de la vie. Est parvenu à se hisser sur un frêle radeau, n'imaginez rien de rose, la main secourable qui se tend vers vous pour vous hisser hors de l'abîme juste deux secondes avant l'engloutissement. Non la seule personne qu'il ait trouvée, c'est lui-même. Il faut compter sur ses propres faiblesses. Difficile, mais ne pariez que sur vous-même.
Une chambre à soi, juste pour recomposer le puzzle de la scène initiale, je ne vous la raconte pas, à peine le début, dans un cimetière. L'on est près de Marthe et l'Enragé de Jean de Boschère. Lisez, vous comprenez pourquoi le Boschère a passé le reste de sa vie à écrire sur la beauté des fleurs et le chant des oiseaux. Quand l'humain est trop humain, vaut mieux aller voir ailleurs. Pour Jean-François Jacq, le salut viendra du noir. Désormais il noircira les pages. Trouve enfin une béquille hors de soi qui lui permet de se tenir droit. N'en est pas pour autant un handicapé de l'existence, c'est un miroir sur lequel il s'appuie. Se penche dessus et l'image de lui-même qu'il y entrevoit n'est pas tendre. Sombre figures de mots aux éclats aussi perçants que des éclats de verre ensanglantés. D'ailleurs le livre suivant se nommera Hémorragie à l'Errance. De la suite dans les idées, sang unique. Voir chronique ci-dessous pour ceux qui aiment la littérature.
Un livre poésie, dénué de toute anecdote. Respect infini devant la beauté de l'écriture et cette démarche qui ne triche pas avec le réel. Tauromachique, mais le toréador qui porte les estocades est aussi le taureau
Damie Chad.
HEMORRAGIE
A L'ERRANCE
genèse
JEAN-FRANCOIS JACQ
( L'Harmattan / 2012 )
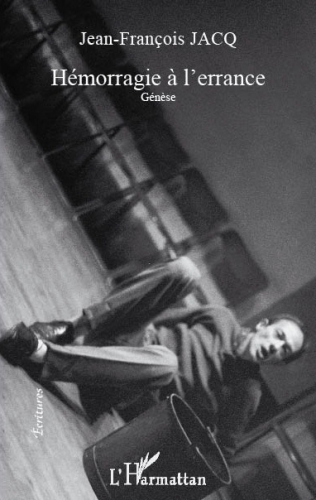
Des histoires qui ne s'achèvent jamais. Quand bien même seraient-elles terminées depuis très longtemps. Obsédantes. Des fantômes qui vous hantent. Reprendre la piste, remettre ses pas dans ses propres pas s'avère une nécessité. Pour mieux mesurer l'écart effectué, pour mieux s'assurer que l'on ne cauchemarde pas, que l'on a bien suivi de telles pistes. Hémorragie à l'Errance raconte la même histoire que Heurt-Limite. Sous un angle d'autodéfense différent. L'est des choses qui sont difficiles à dire, alors dans un premier temps l'on utilise l'ouate et le scalpel de la poésie. On coupe à même les chairs, l'on empêche le sang de couler avec un gros tampon de coton. L'on a rien d'autre. L'on évite la gangrène, la pourriture, l'anéantissement. L'on se sert de mots qui dévoilent et qui voilent en même temps. L'on en dit le maximum en essayant d'en proférer le minimum. L'on se berce de paroles, l'on chante sur les plaies comme le vol du corbeau sur les eaux du déluge. Cela nettoie et cela soulage. Mais l'hémorragie, l'hémorage se remet à suinter. Jusqu'au jour où l'on a le courage de reprendre le mal à sa racine. L'on n'explore plus les mots, l'on se contente de nommer et de dénombrer les séquences du réel par leur véritable nom. Regard aigu sur la blessure intarissable.
Jean-François Jacq se raconte. Tout. Pas de zone d'ombre. Une enfance, pire que sans amour. D'indifférence. Tout de suite, le puits de la solitude. N'en sortira plus jamais. Tentera plusieurs fois de remonter vers la margelle et l'air libre. Toujours quelqu'un, toujours un enchevêtrement de situations, toujours une attention maladroite, qui vous renvoie croupir dans l'eau stagnante de l'agonie solitaire. La souris blanche empêtrée dans le laboratoire de la vie. Dans le jeu de l'oie de l'existence, tombe systématiquement sur les mauvaises cases. Les seuls qui pourraient l'aider sont englués exactement dans le même itinéraire. Le plus affreux ce n'est ni le viol, ni la faim, ni l'asile, ni les trahisons, c'est la pierre tombale de la déréliction que vous refermez sur vous. Zombie de misère parmi les vivants qui se détournent de vous et cadavre en voie de glaciation éternelle à l'intérieur. Vous n'êtes plus rien. Votre langue se paralyse. Votre pensée s'éteint comme une flambée de cheminée que l'on laisse agoniser le soir, par crainte d'un incendie la nuit. Auto-mutilation de la parole et auto-mutilation de la poésie, de l'acte de faire, de la tentation de vivre. Mourir est même une tâche insurmontable. L'on reste en vie car décéder demanderait trop d'effort. Ce n'est pas la solitude qui vous enserre, c'est vous, qui vous glissez dans son sarcophage le plus étroit. Vous êtes momie, mais pas celle du pharaon. Vous êtes l'heautontimoroumenos baudelairien. Le romantisme et la pause en moins. Un couloir en cul-de-sac, plus moyen d'avancer, ni de reculer, ni de jouer au passe-muraille. Heureusement que vous avez perdu la notion d'auto-culpabilité et cette manie si humaine de vous apitoyer sur votre sort. C'est que vous avez égaré votre propre destin. Pouvez retourner tel un égrégore de vous-même sur les lieux de votre vie, il y a longtemps que vous n'y êtes plus, depuis cet incertain moment où vous n'avez plus habité chez vous. Soyons précis, dans votre tête. Vous êtes votre propre alien.

Reste l'errance. Plus d'itinéraire. Simplement marcher car il ne vous reste rien d'autre à faire. Plus de territoire. Déjà plus un être humain, et presque plus un animal. Vous avez encore quelques tactiques de survie. Mais en voie d'amenuisement. Vous ne pouvez plus compter sur vous même. Vous ne passez pas le relais aux autres, car vous êtes sempiternellement en partance de vous-même. Faut que ce soient les autres qui vous arrêtent. Vous indiquent la voie de sortie. Un mal de chien à les reconnaître. Vous vous rapprochez d'eux mais prenez la fuite dès qu'ils s'approchent de vous. La main tendue, vous n'avez ni la force de la prendre, ni celle de la mordre. Au bout de la solitude, il n'y a que l'autre. Mais c'est à vous de vous apprivoiser à lui. Le chemin se parcourt toujours seul. Et le plus difficile est de continuer à avancer quand il disparaît.
Jean-François Jacq trouvera l'issue de secours. En fait non pas une porte de sortie, mais un vaste portail d'entrée. Celui qui le restitue dans son identité d'homme, le bipède collectif par excellence. Suffit que l'on s'adresse à vous. Poste restante. Le récif solitaire qui a survécu à la tempête. Que la vague ne submerge plus, mais embrasse.
A lire. Pour ceux qui douteraient qu'il existât une littérature qui ne soit pas d'insignifiance.
Damie Chad.
22:54 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.