28/01/2015
KR'TNT ! ¤ 220. ERVIN TRAVIS / JERRY LEE LEWIS / BOBBY KEYS / HOT CHICKENS / K'PTAIN KIDD / OL' BRY / POETE APACHE
KR'TNT ! ¤ 220
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
29 / 01 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / JERRY LEE LEWIS / BOBBY KEYS / HOT CHICKENS / K'PTAIN KIDD / OL' BRY / POETE APACHE |
|
ERVIN TRAVIS Mauvaise nouvelle ce matin. Ervin Travis ne va pas bien. Se bat depuis plusieurs années avec la maladie de Lyme. Une saloperie pas encore jugulée par la médecine. Le voici maintenant dans l'incapacité de travailler et de poursuivre sa carrière. Autant dire que moralement et financièrement il a besoin de nous. Vous trouverez sur le facebook : Lyme – Solidarité Ervin Travis tous les renseignements nécessaires. Nous comptons sur votre soutien et sur votre solidarité active. Rockers, fans et musiciens, sauront se montrer généreux, nous en sommes sûrs. N'oublions pas tout ce qu'Ervin Travis a réalisé pour maintenir vivant la présence de Gene Vincent en notre pays. Courage, Ervin ! Damie Chad. |
JERRY LEE DER
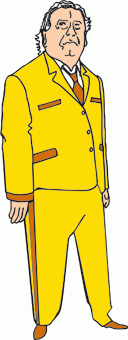
On le disait foutu.
— Paraît qu’y circule sur un fauteuil roulant. Il est cuit aux patates !
— Paraît même qu’on l’a vidé comme une volaille. Y l’en a plus pour très longtemps...
— De toute façon, avec la vie qu’il a mené et tout ce qu’il s’est enfilé dans l’cornet, c’est un miracle qu’y soit encore là. Y doit avoir une drôle de constitution ! Y vont sûrement l’conserver dans un bocal !
— T’as vu les photos sur Internet ? Y l’est pas jojo !
— Ah ouais, ça commence à craindre...
— Y l’a les yeux humides, c’est pas bon signe. Tu vas voir, ça va s’terminer comme l’autre facho de Franco, là, y vont l’brancher pour le maintenir en vie artificielle et faire encore du blé sur son dos...

Jerry Lee cuit aux patates ? Jerry Lee branché ? Ah Ah Ah ! Non mais vous rigolez ? Il a 80 balais et il fait l’actualité à lui tout seul avec deux albums stupéfiants, «Rock & Roll Time» et «The Buddy Knox Sessions». Vous en connaissez beaucoup des gens qui sortent deux albums stupéfiants à 80 balais ? Du coup, c’est une actualité qui balaye toutes les autres, car Jerry Lee, pour pas mal de gens, ça touche un peu au religieux. Ce fut aussi le cas pour Elvis, bien sûr, mais c’est peut-être plus marqué en ce qui concerne Jerry Lee. Sans doute parce qu’il a su rester fidèle à sa légende de hellraiser toute sa vie. S’il est un homme qui au vingtième siècle a vraiment su incarner l’essence même du rock’n’roll qui est la sauvagerie, c’est bien l’immense Jerry Lee Lewis. Avec lui, on entre dans le domaine du sacré, de l’intouchable et de la démesure. Jerry Lee serait-il le dernier grand héros américain ? C’est fort probable. En tous les cas, une chose est sûre : il est depuis soixante ans le dieu d’une génération d’indécrottables rockés du bulbe.

Petit retour aux années cinquante. Jerry Lee et Chuck Berry s’étaient retrouvés tous les deux à l’affiche d’un concert. Chuck était tête d’affiche et s’apprêtait à monter sur scène APRÈS Jerry Lee. Comment le Killer lava-t-il cet affront ? Il mit le feu à son piano, sortit de scène et en croisant Chuck dans la coulisse, il le mit au défi :
— Now beat this !
Vas-y, essaye de faire mieux ! Évidemment, PERSONNE n’a jamais pu rivaliser avec Jerry Lee. Little Richard et Chuck Berry ont bien tenté de lui ravir son titre de champion, mais en vain. Jerry Lee avait quelque chose en lui que les autres n’avaient pas : le jerrylisme, cette façon de démonter la gueule des classiques du rock et de gronder comme le cerbère des enfers, cette façon de plier les chansons à sa volonté sans produire le moindre effort, cette arrogance dégoulinante de génie, cette extraordinaire science de l’élévation qui distingue les purs rockers, cette facilité à dominer le monde en grimpant sur un piano. Et puis cette voix qui couvre tous les aspects de la beauté mélodique et de la rage, la vraie, celle que combattit Pasteur.

L’un de ses plus grands exploits date de la Fête de l’Huma, en 1973. Nous étions trois lycéens partis en pèlerinage. Le parc de la Courneuve était pour nous la terre sainte car Jerry Lee et Chuck Berry étaient à l’affiche. Cette fois, Chuck passait en premier. Il attaqua son set dans l’après-midi, accompagné par le bassiste et le batteur d’Osibisa, un groupe africain basé à Londres qui bénéficiait à l’aube des seventies d’une petite notoriété. Les blackos avaient joué un peu avant et on avait bien bâillé aux corneilles. On vit arriver Chuck sur scène et on sentit nos petits cœurs battre la chamade. Il portait un pantalon rouge et sa chemise bariolée. Il fit un morceau, deux morceaux et au commencement du troisième morceau, on vit un barbu débarquer sur scène, par l’arrière. Il portait un Stetson, des Ray-Ban noires, un col roulé blanc aux manches retroussées et il fumait le cigare. Il vira le batteur d’Osibisa aussi sec et prit sa place. Une rumeur courait dans le public. C’est Jerry Lee ! Au lieu de battre la mesure du standard que Chuck attaquait à la guitare, Jerry Lee se mit à faire le con et à jouer n’importe quoi. Il semblait un peu pété. Il jeta ses baguettes en l’air et le temps sembla s’arrêter. Son numéro ressemblait à du sabotage. Excédé, Chuck posa sa Gibson rouge sur le bord de l’estrade et quitta la scène. La foule se mit à beugler. Puis tout alla très vite. Dans la minute, un véritable déluge de projectiles s’abattit sur la scène. On n’avait encore jamais vu un truc pareil. Sur scène, deux mecs essayaient de tirer Jerry Lee pour le mettre à l’abri, mais ce démon leur résistait et il continuait de provoquer la foule. Soudain, il y eut un mouvement de panique générale. La foule assise se leva comme un seul homme. Sauve qui peut les rats ! Dans ce cas là, on détale. D’autant plus vite qu’on se croit poursuivi. Ça courait dans tous les sens. On marchait sur des gens qui n’avaient pas réussi à se lever. On est tous allés se réfugier dans les stands installés aux alentours de la grande scène. Évidement, on n’a jamais retrouvé nos sacs et nos blousons. Il régnait dans les allées une sorte de chaos, comme si une bataille venait de se dérouler. Des gens affolés continuaient de circuler dans tous les sens, à la recherche d’autres personnes. On ne s’est revus tous les trois que beaucoup plus tard dans la soirée. Un vrai miracle ! Je croyais vraiment que j’allais devoir rentrer seul en stop. On voyait des ambulances traverser péniblement les allées pour emmener ce qu’on imaginait être des blessés. Les rumeurs les plus folles circulaient. Un gang de bikers installé au pied de la scène aurait paraît-il chargé la foule à l’arme blanche, comme au moyen-âge. Ce fut probablement le plus beau concert de Jerry Lee. L’apocalypse selon Saint-Jerry Lee ! Celle de Saint-Jean en comparaison n’était que de la roupie de sansonnet.
Jerry Lee avait tout simplement réussi à exploser la bible.
— Now beat this !
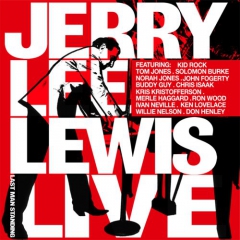
L’un des spectacles les plus fascinants qu’il ait pu donner fut celui de septembre 2006 à New York. Il existe aujourd’hui sous la forme d’un DVD intitulé «Last Man Standing». La parenté de cette superbe expression revient à Kris Kristofferson, le cowboy rescapé des Portes Du Paradis. Dans une bribe d’interview, il dit sa vénération pour Jerry Lee, «one of my heroes for a long time». Un bon conseil : si vous n’avez pas encore vu ce film, empruntez-le à votre voisin rockab.

Au moment où se déroule ce spectacle, Jerry Lee a 70 ans, mais il n’y a absolument rien de vieux chez lui. Il a les cheveux gris clair, et alors ? Ça commence à barder avec «Chantilly Lace» - yeah baby that’s what I like - Il racle son clavier comme s’il avait 20 ans. À cet âge-là, normalement, on commence à sucrer les fraises. Pas Jerry Lee. Comme l’organisateur du spectacle a imaginé une suite de duos, Jerry Lee reçoit des invités - comme sur le disque du même nom - Tous ces prestigieux invités sont censés chanter en duo avec le Killer, mais chaque fois ça se transforme en leçon de chant et de maintien. L’ensemble est assez hilarant. Le carnage commence avec Tom Jones qui se teint les cheveux comme un vieux gigolpince et qui ose chanter «Green Green Grass Of Home» en duo avec Jerry Lee. C’est à se pâmer de rire. Le pauvre Tom Jones qui n’a jamais été autre chose qu’un (bon) chanteur de variété chante beaucoup trop perché et Jerry Lee lui montre charitablement le bon niveau émotionnel. Tom Jones apparaît comme un chanteur trop superficiel, un faiseur, un papillonneur, un boulimique de gloriole, alors que Jerry Lee, par son intonation, reste idéalement terre à terre. Le candidat suivant s’appelle Solomon Burke. On l’a transporté dans son fauteuil en bois sculpté. Jerry Lee lui montre le premier couplet de «Who Will The Next Fool Be» et King Solomon se voit contraint de sortir le grand jeu. Il va chercher en lui toute la puissance de sa blackitude et de sa légende de star du Brill pour pouvoir rivaliser avec Jerry Lee à coups de oh no no. On assiste là à un combat quasi-mythologique de géants. Solomon Burke est avec Willie Nelson le seul qui réussira à ne pas se faire aplatir comme une crêpe par Jerry Lee. Une pauvre fille nommée Norah Jones vient chanter «Crazy Arms» et «Your Cheatin’ Heart» avec Jerry Lee. La pauvrette prend un couplet au chant et évidemment tout s’écroule. En coulisse, Norah déclare : «Wow ! He’s still around and he sings better naow !» Évidemment qu’il est toujours là et évidemment qu’il chante de mieux en mieux ! On n’a pas besoin d’elle pour le savoir. Buddy Guy tente de tenir tête à Jerry Lee dans «Hadacol Boogie», mais c’est Jerry Lee qui aplatit les têtes de rivets et qui enfonce les clous. Bim ! Bam ! Le pauvre Chris Isaak tente à son tour de s’imposer, mais sa voix chuinte lamentablement. C’est à ce genre d’exercice qu’on peut mesurer les écarts qui séparent les différents artistes. D’un côté, il y a en gros Jerry Lee, Elvis, Wolf et Aretha, et de l’autre côté tous les autres, avec des talents divers et variés. Ronnie Wood joue de la guitare sur scène et on se demande vraiment ce qu’il vient faire là avec sa coiffure sixties et son son sixties. Il semble d’autant plus décalé que Kenny Lovelace, assis derrière Jerry Lee, joue avec une classe éblouissante. Ah c’est sûr, avec tous ces guignols, Jerry Lee n’en finit pas de se fendre la pipe, on le voit bien. Encore une belle gâterie avec une version fantastique de «Lewis Boogie» - Do-the boo-gie woo-gie e-ve-ry day ! - Belle leçon de diction. En compagnie de Willie Nelson et de ses deux nattes, Jerry Lee nous emmène au paradis de la country : version magique de «Jambalya». Kenny Lovelace nous explique un peu plus loin qu’il joue avec Jerry Lee depuis quarante ans. Et on assiste au vieux coup de Jarnac, le moment qu’on attend chaque fois qu’on voit Jerry Lee sur scène : «Whole Lotta Shakin’ Going On» qu’il chauffe à blanc, puis qu’il refroidit légèrement - ease it baby - et qu’il relance au guttural en se levant et en filant un joli coup de talon dans le tabouret.
Jerry Lee venait tout simplement d’exploser une jolie brochette de stars et un tabouret.
— Now beat this !
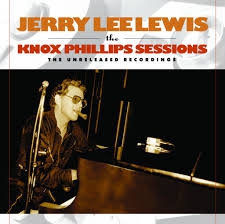
Dans les années soixante-dix, Jerry Lee était sous contrat chez Mercury et comme il enregistrait des albums de country à Nashville, il s’emmerdait comme un rat mort (dixit Choron). On tentait de le domestiquer pour mieux le vendre - Domesticity is for losers, not for the killer ! - Alors, il revenait à Memphis et appelait Knox, le fils de Sam, en pleine nuit pour lui dire : «Meet me at the studio, I wanna cut». Évidemment, Knox accourait. Jerry Lee ne garait pas sa Rolls dans l’allée devant le studio, mais sur les buissons fleuris de la pelouse. Et quand ils faisaient une pause, ils allaient boire un verre dans l’un de ces clubs de strip-tease ouverts toute la nuit. Dès que Jerry Lee entrait dans le club, les filles s’agglutinaient autour de lui et le club reprenait vie. Parmi les musiciens qui l’accompagnaient lors de ces sessions légendaires, se trouvaient Kenny Lovelace (cousin de Knox) et Mack Vickery, un vétéran du rockab que Jerry Lee avait la bonne. Et Knox ajoute que si Jerry Lee adorait revenir au Sam Phillips Recording Service Inc. (le second, celui qui fut ouvert en 1960), c’était surtout pour le son. Knox explique que son père avait conçu et construit de ses mains les chambres d’écho. Jerry Lee adorait s’installer dans la salle de contrôle pour y entendre le son plein de sa voix et de son piano, ce qu’il n’avait pas évidemment pas à Nashville. Au commencement du monde, il y avait Sam Phillips, ne l’oublions pas. Et Knox ajoute que son père lui avait appris une chose fondamentale :
— Si tu veux qu’un génie se laisse aller, tu dois créer les conditions pour ça !
C’est exactement ce qu’on entend dans ces sessions inédites. Jerry Lee attaque avec «Bad Bad Leroy Brown» et le baddest badass de Memphis, c’est lui. Jerry Lee chante ça d’une voix altérée par les excès. Ce vieux classique est une ode aux boîtes de nuit et Jerry Lee l’explose comme on explose un crapaud avec un pétard - Have you seen these knots on my bald head ? - C’est de la magie pure et la fête continue avec «Ragged But Right», le boogie des temps anciens et il passe à la country féérique avec «Room Full Of Roses». Pareil, il l’explose et la colle au plafond, ah quelle rigolade ! Si toute la country sonnait comme ça, on en boufferait, c’est sûr. Ce démon claque des accords de piano à contre-courant - Gimme some fiddle son ! - On sent qu’il se transfigure et qu’il devient dingue. Avec «Johnny B Goode», les colonnes du temple ondulent et soudain c’est l’enfer sur la terre ! Il déclenche cette nouvelle apocalypse au piano. Le toit du studio saute, forcément, car Jerry Lee rentre dans le lard du rock’n’roll. C’est lui Foutraque 1er, le roi des cinglés. Puis il attaque une belle compo de Mack Vickery, «That Kind Of Fool» et si on n’est pas encore tombé de sa chaise, alors on va pouvoir le faire grâce à «Harbor Lights» - We cut this song now. You’re ready ? - C’est horrible de puissance dévastatrice. Jerry Lee file à la surface du son comme un requin à la surface de l’eau. Il atteint un niveau de démence géniale qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Et en plus, il grogne comme à Hambourg. Retour à l’église pour «Pass Me Not O Gentle Savior». Mais le poor sinner broute des mottes en ricanant. Il va au gospel comme d’autres vont aux putes. C’est l’appel des racines de Ferriday et il déconstruit tout l’art gospellique au piano. Le diable est entré à l’église - Oh Jesus please don’t pass me by - Puis il sort un vieux coucou qui date du ragtime, «Music Music Music/Canadian Sunset» et pour l’occasion, il devient un lion, mais un lion complètement dingue, pas celui qu’on voit au zoo. Il devient ignoble de génie et il mène son bal tout seul avec une inventivité sidérante. Pas la peine de remonter sur la chaise, car voilà «Lovin’ Cajun Style» de Huey P. Meaux, l’absolue merveille, et Jerry Lee re-dévaste tout - Oh babe you’re driving me wild on the cajun style - Il fait sa grosse Bertha. Jamais un groupe de garage n’aura cette puissance de feu - When the pretty girls twist on the banks of the bayou - C’est simple, il rentre dans le rock’n’roll comme dans du beurre.
Non seulement Jerry Lee explose le rock’n’roll, le gospel et l’église, mais il explose aussi la pelouse de Sam Phillips.
— Now beat this !

Jerry Lee vient d’enregistrer un nouvel album : «Rock & Roll Time» et deux photos accompagnent cette pétaudière. La première montre Jerry Lee bambin encadré par ses parents Elmo et Mamie. Elmo a une prestance de mafioso et Mamie n’est pas non plus du genre à rigoler. La seconde photo nous montre Jerry Lee adulte devant un micro sur lequel son verre de whisky est posé en équilibre. La plupart des morceaux sont enregistrés au Memphis House Of Blues avec Kenny Lovelace, Jim Keltner et une ribambelle d’autres musiciens. Jerry Lee attaque le morceau titre de l’album à l’édentée. On s’attend un peu à le voir décliner et à s’essouffler, mais non, au contraire. Hé hé hé, il est plié de rire à la fin du morceau. Puis il fracasse un bon vieux «Little Queenie», histoire d’envoyer un message cordial à son copain Chuck et là attention, car ça va commencer à chauffer pour vos matricules. Voilà le heavy romp de «Stepchild», un cut de Bob Dylan. Jim Keltner tape ça bien lourd et au bout de deux couplets, Jerry Lee lance l’assaut - Play guthar son ! - Franchement, tous les garage-bands de Detroit et d’ailleurs devraient écouter ça et prendre des notes. Il tape ensuite dans Dave Batholomew avec «Sick & Tired», c’est secoué aux percus et gratté au tape-cul de Memphis. On croit rêver alors on se pince. Mais non, c’est la réalité. Jerry Lee a derrière lui un orchestre terrible. On sent bien qu’il jubile autant qu’un crocodile qui vient de choper une antilope. Jerry Lee chauffe son boogie comme il l’a fait toute sa vie et il n’est pas genre à appliquer une vieille recette, oh non pas du tout, il y prend un plaisir infini, ça se sent. Son boogie reste incroyablement inspiré et unique au monde. Pour redonner un petit coup de jeune au vieux «Bright Lights Big City», il part en tyrolienne. Il chante ça avec une désinvolture qui en dit long sur l’ampleur de son génie. Jerry Lee est à la musique moderne ce que Gandhi fut à l’intelligence humaine, une nature supérieure qui n’aura vécu toute sa vie que dans la quête d’un absolu, et chez Jerry Lee, cet absolu se matérialise par une chanson et un piano. C’est la modestie de cet absolu qui fait toute la grandeur du personnage, on l’aura bien compris. Joli coup de chapeau à Johnny Cash avec «Folsom Prison Blues» et il chante ça encore plus à l’édentée. On croirait entendre beugler un pirate. Jerry Lee, c’est le Long John Silver du rock, il sait ramer les boulets pour couler les vaisseaux ennemis. Il en profite pour se rajouter un petit couplet - and play rock & roll for Jerry Lee yeah - On savoure chaque seconde de ce disque car avec Jerry Lee on sait qu’on se trouve encore dans l’époque magique. On tremble à l’idée qu’elle ne s’arrête un jour. Mais il nous rassure en ricanant, à la fin du cut. Hé hé ! Sans doute est-ce sa façon de nous dire : «Don’t worry les gars, je suis encore là !»
Deux horreurs suivent. La première s’appelle «Mississippi Kid», un vieux boogie du Sud que Jerry Lee prend du menton. C’est le même topo qu’au Star Club, il nous refait le coup de «Money». Il stompe le cut à la folie et claque des glissés de clavier ici et là - Oh don’t you feel it papa - Il relance ses troupes - Guthar ! - Et la cambuse explose. La seconde horreur s’appelle «Blues Like Midnight», il en fait un heavy blues killerique. Jerry Lee arrive encore à soigner sa diction. On croirait entendre le copain du PMU, c’est un délice, il a la voix bien pâteuse du mec qui vient de siffler un Muscadet à huit heures du matin. Jerry Lee est devenu une sorte de pneu increvable. Il passe partout. C’est avec «Here Comes That Rainbow Again» qu’on revient aux évidences. Ce qui le distingue des autres chanteurs, c’est le posé de la voix. Même s’il chante une rengaine insipide, il va s’arranger pour en faire une œuvre d’art. Et il boucle cette fantastique équipée avec un nouveau clin d’œil au vieux Chuck, une reprise somptueuse de «Promised Land». L’intro est un modèle : attaque sèche au piano et Keltner embraye dans la mesure. Jerry Lee ne traîne pas. Il file à travers l’espace et le temps. Et il connaît tous les textes de ces chansons par cœur. Il jette une nouvelle fois tout son poids dans la balance. Et c’est plus fort que lui, il faut qu’il explose les balances.
Signé : Cazengler, complètement démo-Lee
Jerry Lee Lewis. The Knox Phillips Sessions. Saguaro Road Records 2014
Jerry Lee Lewis. Rock & Roll Time. Vanguard Records 2014
Jerry Lee Lewis Live. Last Man Standing. Jim Gable. DVD 2007
BYE BYE BOBBY

À dix ans, Bobby connaissait Buddy. Bobby se souvient d’avoir vu jouer Buddy à Slaton, Texas, sans savoir qui était Buddy. C’était juste avant les Crickets : « Il jouait pour l’inauguration d’une station-service, à deux pas de la maison de mon grand-père.» Bobby se souvient surtout du bassiste - It would’ve been Don Guess, I guess - qui jouait sur une stand-up avec des cordes de toutes les couleurs et des pansements aux doigts - He was just slappin’ the bass, man ! - Mais ce n’est pas tout ! Bobby avait une tante Leora qui vivait à Lubbock et qui tenait un salon de thé devinez où... Mais dans la rue où habitaient les parents de Buddy, bien sûr !
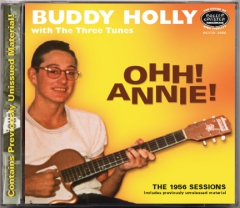
Comment appelle-t-on une telle enfance ? Une enfance de rêve. On aurait tous bien aimé grandir dans le quartier où traînait Buddy Holly.
Bobby Keys va faire comme beaucoup de kids américains de sa génération : il va s’habiller en rose et noir, se faire une belle banane, porter du cuir, durcir son langage et conduire des grosses bagnoles. À douze ans, il voit «Blackboard Jungle» au Lindsay Theater de Lubbock. Il ne jure plus que par Bill Haley & His Comets. Il est dingue de James Dean. Un beau jour, il s’achète un pantalon blanc, une chemise de golfeur décorée d’un pingouin et il décide de devenir saxophoniste. Il a pris King Curtis pour modèle. Il s’acharne à vouloir jouer comme lui, mais il se coince la langue dans l’anche du sax. Heureusement, Levon Helm qu’il rencontrera un peu plus tard va lui conseiller d’écouter Little Walter et de jouer comme un harmoniciste. C’est ainsi que Bobby va trouver son style, en waltérisant sa fascination pour King Curtis.

Bobby en veut et très vite, il entre dans le tourbillon des tournées. Il accompagne Buddy Knox et Bobby Vee qui sillonnent tous les États d’Amérique. Pour tenir le rythme, il fait comme les autres musiciens, il s’envoie des tas de bennies dans le cornet - la fameuse benzedrine dont les routiers américains faisaient une consommation industrielle, afin de rester éveillés 24 heures sur 24 au volant de leurs poids lourds - Cette consommation abusive de bennies pouvait rendre les gens agressifs et développer de belles belligérances. Comme les groupes voyageaient entassés dans des bagnoles pour aller d’un concert à l’autre, l’atmosphère était, comme le rappelle Bobby, le plus souvent très tendue. Mais au fond, Bobby et ses camarades ne vivaient que pour ça - get drunk, go to a whorehouse and buy a sackful of bennies - se soûler, aller aux putes et acheter un gros sac de bennies. C’est le sex, drugs & rock’n’roll des fifties.
Bobby Keys va s’abonner à ce régime.
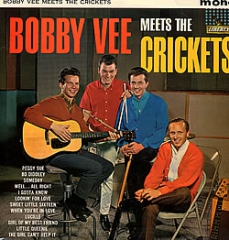
C’est en 1964, au Teenage World’s Fair de San Antonio que Bobby rencontra les Stones pour la première fois. Ils étaient à l’affiche de la Foire avec Bobby Vee et George Jones. Bobby faisait partie du groupe qui accompagnait Bobby Vee. Brian Jones et Keith Richards occupaient la chambre voisine de celle de Bobby au Ramada Inn de San Antonio. Il s’agissait de la première tournée américaine des Stones. Ils venaient d’enregistrer «Not Fade Away». Oh ! Un hit de Buddy ? Drôle de coïncidence, car Bobby connaissait Buddy. En plus, Brian Jones jouait lui aussi du saxophone. Alors le contact se fit le plus naturellement du monde. «Brian Jones jouait du sax alto, mais pas très bien. Il était aussi guitariste et excellent harmoniciste.» Ils devinrent amis, Brian et lui, tout simplement parce que Bobby connaissait Buddy. C’est aussi bête que ça. Pas besoin d’avoir fait polytechnique pour devenir le copain des Stones.

C’est là en juin 1964 que le destin de Bobby se joua, mais il ne le savait pas encore. Il nota cependant quelque chose chez Keith qui était encore à cette époque très en retrait. Il lui dit ceci :
— Il y a dans ton regard la détermination qu’il y avait dans le regard de Buddy - Holly knew he was gonna make it !
Après ce petit épisode charmant, chacun repartit de son côté. Bobby s’installa à Tulsa puis à Los Angeles, chez Leon Russell. Pour les Texans et les Okies débarqués en Californie, Leon était le modèle absolu : «Il avait une Cadillac noire, une maison nichée dans les collines et équipée d’un studio - Studio City - et des tas de filles, le jour comme la nuit.» Bobby vécut là avec Gary Gilmore, Jesse Ed Davis, JJ Cale et le LSD. Il croisa pas mal d’autres personnages intéressants, du genre Delaney Bramlett (avec lequel il enregistra et tourna), Jim Morrison (avec lequel il fit une consommation industrielle de Tequila) et Janis Joplin (avec laquelle il fit aussi une consommation industrielle de Southern Comfort - that syrupy shit she used to drink).

Puis Bobby passa aux choses TRÈS sérieuses avec Mad Dog & Englishmen, cette fabuleuse tournée américaine orchestrée par Leon Russell. Le film de Pierre Adidge en donne un petit aperçu. On a là de l’émotion à l’état pur et l’occasion de revoir l’un des plus grands shouters de l’histoire du rock. Devant la caméra, Bobby ouvre une bouteille de Tequila pour arroser l’arrivée de la troupe en ville. Puis on le voit fumer la pipe alors que la troupe, animée par Leon Russell, chante un gospel a capella. Le premier extrait de concert, c’est «Delta Lady». On y voit Joe danser au beat et créer les conditions de l’apocalypse. Pire encore : Bobby danse le twist en soufflant dans son sax. Stupéfiant ! Quel bonheur ce devait être pour lui d’accompagner un géant comme Joe. Franchement, les plans de Mad Dog & Englishmen sur scène constituent la huitième merveille du monde. On voit Leon Russell danser comme une pute et jouer de la guitare comme un crac. Pour cette tournée, il avait monté un orchestre de surdoués : Jim Keltner et Jim Gordon derrière les fûts, l’incroyable Carl Raddle à la basse, une quinzaine de choristes fabuleux et Chris Stainton en appoint aux claviers. Dans un autre plan, on voit Bobby au volant d’une voiture. Il roule dans Dallas sous la pluie et montre à Joe assis à l’arrière l’endroit où Kennedy se fit descendre - three shots from here here and here - Et ça repart de plus belle sur scène avec une version démente de «The Letter» où Bobby place un solo de sax in-fer-nal. Et on atteint bien évidemment une sorte de nirvana émotionnel avec «With A Little Help From My Friends», à cause de l’extraordinaire chorale qui soutient Joe dans son fantastique numéro de screamer.
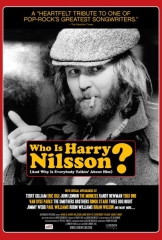
En fait, la vie de Bobby Keys est un fantastique voyage au cœur de l’histoire du rock. Il a vécu les deux grandes époques fatidiques, celle des fifties américaines et celle des seventies anglaises et il s’est débrouillé pour jouer avec quelques grands artistes de son temps : Joe Cocker, les Stones, John Lennon et Harry Nilsson. Mais son côté texan remonte souvent à la surface du récit et on note chez lui un goût prononcé pour les anecdotes hilarantes. À une époque, Bobby baptisa son sax Elmer. Comme on lui demandait d’enregistrer son sax lorsqu’il prenait un avion, alors il prenait un billet pour Elmer et l’installait dans le fauteuil voisin du sien. L’hôtesse le grondait gentiment en lui rappelant que ce n’était pas autorisé par le règlement, alors Bobby lui montrait le billet d’Elmer. Et bien sûr, quand arrivait l’heure du repas, il exigeait qu’on serve à Elmer une assiette de bœuf Bourguignon et un verre de vin rouge - If they were gonna make me pay, they were gonna feed my horn - À sa façon, Bobby frisait le Moonisme.
Il raconte aussi comment il s’est retrouvé un jour coincé en studio avec cette garce de Yoko Ono. La Japonaise ne pouvait pas encadrer le Texan et le Texan le lui rendait bien, mais comme il était pote avec John, il écrasait sa banane. Yoko voyait en Bobby une sorte de demeuré, un pauvre type qui ne savait même pas lire une partition. Yoko enregistrait une pièce avant-gardiste et elle avait besoin d’un sax. Elle s’adressa à Bobby :
— Tu vas faire la grenouille !
— Quoi ?
Alors Bobby ferma toutes les touches du sax et souffla une note basse - Hoooooonk, low A-flat, man - Les sourcils de Yoko s’arquèrent très haut, ses yeux clignotèrent et elle s’écria :
— C’est elle ! C’est ma grenouille !
Tous ceux qui se souviennent de sa prestation dans le Rock’n’Roll Circus des Stones savent de quoi elle est capable.
L’anecdote la plus hilarante est certainement celle qui concerne Bill Wyman. En tournée, chacun dans les Stones avait ses petites manies : Keith voulait une table de billard, Mick voulait du Dom Pérignon et pas une autre marque, et Bill voulait une vraie table de ping-pong, avec des raquettes et des balles. Mais personne ne voulait jouer avec lui.
Encore plus tordant, c’est l’anecdote du concert des Stones au Madison Square Garden en 72, où on célébra aussi l’anniversaire de Jagger. Les Stones avaient commandé des tonnes de tartes à la meringue. On avait prévu une gigantesque bataille de tartes et Bobby raconte, hilare, que Stevie Wonder fut bombardé à outrance - completely hammered - Le pauvre malheureux - the poor bastard - ne pouvait pas les éviter parce que bien sûr il ne pouvait pas les voir venir. Il devint en un rien de temps une montagne de meringue. Puis des petits malins commencèrent à viser les flics du cordon de sécurité. Ceux-ci bien sûr ne bronchèrent pas.

Effectivement, Bobby Keys va connaître la gloire en jouant avec les Stones. On l’entend dans pas mal de classiques, du genre «Brown Sugar» ou «Can’t You Hear Me Knocking». Il entre dans le saint des saints car il forme avec Jim Price la section de cuivres des Stones. Il s’installe à Londres et vit dans un premier temps chez Jagger, mais ça ne se passe pas très bien, car Jagger le fait passer devant ses amis pour une bête de foire : «Oh, voici mon ami texan ! C’est une grande gueule. Si vous restez un peu, vous le verrez se soûler et il dira des choses marrantes. Il va même certainement vomir, ne le perdez pas de vue !» Mais avec Keith, c’est autre chose. Bobby parle d’une vraie complicité et il va même jusqu’à dire que Keith est un type si bien qu’il aurait pu être texan. En plus, ils sont nés le même jour. Ils sont donc tous les deux des sagittaires et comme le dit si bien Keith, «le fait d’être mi-homme mi-cheval leur donne le droit de chier dans la rue». Les deux moments culminants de cette équipée sont le séjour à la villa Nellcôte et la tournée américaine de 72. Il parle de cette tournée comme d’une période paradisiaque. Ce fut pour lui la plus grande tournée de rock de tous les temps : «Il y avait des gens comme la Princesse Lee Radziwill, Truman Capote et Terry Southern qui voyageaient avec nous.» Comme les épouses n’avaient pas été invitées, il y avait des femmes dans tous les coins - just beautiful women everywhere - Bobby ne jouait du sax que depuis dix ans et il se retrouvait dans le plus grand groupe de rock du monde ! Quelle ascension vertigineuse ! Les Stones et lui étaient encore très jeunes. Ils n’avaient pas encore atteint les trente ans - sauf Bill et Charlie - et donc on pouvait parler d’une réussite spectaculaire. Il faut voir le film de Robert Frank, «Cocksucker Blues», qui documente bien cette tournée. On y voit les Stones à leur apogée et la mythologie fonctionne à plein régime. Scène magique que celle où l’on voit Keith se faire pomponner en salle de maquillage. Rappelons qu’à cette époque, il exerça une énorme influence sur pas mal de gosses, partout dans le monde. Tous les petits bruns et toutes les petites brunes rêvaient de ressembler à Keith Richards. Les petits blonds et les petites blondes se prenaient déjà pour Brian Jones. Keith et Brian ont inventé le look du rock moderne, comme Elvis avait inventé avant eux le look du rock tout court. Pendant cette tournée historique, Keith et Bobby voyageaient ensemble. Bobby adore rappeler qu’en arrivant dans un nouvel hôtel, il avait pour coutume d’arroser l’événement en ouvrant une bouteille de Jack avec Keith. Tous les membres de la tournée étaient entièrement libres, chacun pouvait se taper autant de groupies et de drogues que nécessaire, mais il fallait être impérativement à l’heure sur scène. Même dans les conditions du chaos, les Stones savaient rester extrêmement professionnels.
Bobby vivait alors comme dans un rêve. Il avait pour amis Keith, Ringo, John et George et il palpait les gros billets. Jusqu’au moment où il décida de décrocher de l’héro et pour ça, il dut quitter les Stones. Keith se mit soudain en colère : «Keys ! Personne ne quitte les Rolling Stones ! Personne !» Bobby parvint à décrocher. Il revint s’installer à Los Angeles, loin de Londres et des Stones. Il tomba alors dans un autre tourbillon qui était celui des nuits alcoolisées, car il fréquentait la triplette de la mort : John Lennon, Harry Nilsson et Keith Moon. Lennon baptisa cette période «The lost week-end», un week-end qui dura en réalité un an. Bobby se lia principalement avec Harry Nilsson qui devint son compagnon de boisson : «On se décrivait comme étant incroyablement charmants, très élégants, et capables de prendre d’importantes décisions.» Bobby raconte que Nilsson était capable d’écrire une chanson à partir d’un petit rien et même de monter des fictions, comme ça au débotté. Quand John Lennon fut abattu devant le Dakota, le drame traumatisa Nilsson. Il passa le restant de sa vie à militer pour l’interdiction de la vente libre d’armes à feu. Pour des prunes, évidemment. Afin de boucler le chapitre de cette amitié, Bobby explique que son pote Harry Nilsson mourut dans son sommeil en janvier 1994. Il embrassa sa femme, lui dit qu’il l’aimait et s’endormit définitivement.
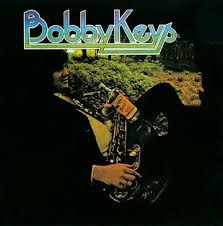
Curieusement, Bobby n’évoque pas l’enregistrement de son album solo dans ses mémoires. On le voit sur la pochette assis contre un arbre avec son sax et une bouteille de Tequila. L’album n’est pas vraiment destiné au grand public, car il s’agit d’une série d’instros à cheval sur le jazz, le funk et le r’n’b. Jim Gordon bat le beurre et produit. Il règne sur ce disque une fantastique ambiance de black-out groovital. Bobby et ses amis jamment le groove du jive et on ne s’ennuie pas un seul instant, à condition bien sûr de bien aimer King Curtis et Junior Walker. «Smokefoot» est frotté à l’ail des percus et «Bootleg» jazzouille dans les harmonies de la confrérie. Le son de Bobby reste allègre et vivace, passionnant et coloré. Il génère morceau après morceau une sorte de foisonnement ivre de santé jugulaire, une sorte de Texas jive cuivré jusqu’à l’os. Il emmène «Key West» au groove coin coin et se livre à toutes sortes d’exactions intermédiaires. On se régale de ce disque régalien. Tout y est ultra-oxygéné. Et quand Bobby se met en pétard, il peut chauffer comme Junior Walker, dans les lueurs de la ville en feu.
Le dernier grand épisode dont Bobby fut particulièrement fier (au même titre que Mac qui fit lui aussi partie de l’aventure) est celui des New Barbarians, un projet imaginé par Keith et Ronnie Wood. Le groupe fit salle comble au Madison Square Garden sans même avoir enregistré un seul disque, ce qui constituait une première dans une histoire du rock pourtant riche en records de toutes sortes. Et Bobby termine son récit en se vantant - et il a bien raison - d’être le seul à être revenu jouer dans les Stones après les avoir quittés. Il savait que son départ les avait mis en rogne, mais au fond, il savait aussi qu’il reviendrait un jour. Jagger fut le seul à ne jamais lui pardonner, mais Bobby s’en battait les bourgounioules, car son pote, c’était Keith.
Signé : Cazengler, alias Louison Bobby
Disparu le 2 décembre 2014
Bobby Keys. Bobby Keys. Warner Bros. Records 1972
Bobby Keys. Every Night’s A Saturday Night. Counterpoint 2012
Joe Cocker - Mad Dogs & Englishmen. Pierre Adidge. DVD 2005
23 / 01 / 2015 – TROYES
LES 3 B / HOT CHICKENS
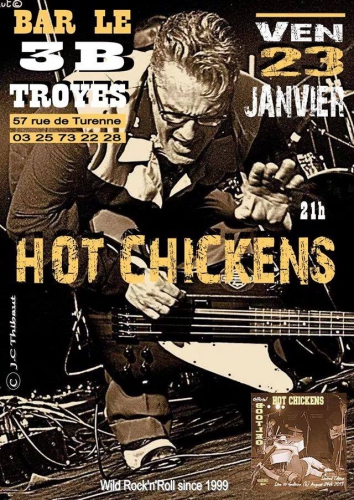
Tel un vieux loup de mer s'apprêtant à aborder les quarantièmes rugissants je scrute le bulletin météo, brrr ! Rien de bien réjouissant ! Pluie verglaçante à partir de minuit sur la Seine & Marne ! Un truc qui vous engage à rester chez vous les pieds au coin du feu à relire La Chartreuse de Parme. Ou alors les Cent Vingt Jours de Sodome du divin Marquis, si vous êtes d'humeur moins mélancolique. Le retour du concert risque d'être rocambolesque côté carambolage, j'imagine la teuf-teuf transformée en épave, couchée sur le flanc et agonisant dans son dernier tournant dans la nuit plus noire que la mort.
Mais l'appel du rock and roll – The Call Of The Wild, pour paraphraser Jack London - est le plus fort. Voilà pourquoi l'on s'est retrouvé à deux ( me and mister B ) à Troyes. La teuf-teuf avale ses cents kilomètres comme une cuillère de sirop d'huile de vidange anti-toussive et nous déniche ( sans se donner un mal de chien ) une place juste devant les 3 B. Non, ça ne veut pas dire, Bosser, Boulonner, Buriner. Un café pas tout à fait comme les autres. Un antre étroit encombré de bikers et de rockers. Densité au mètre carré de blousons et cuirs noirs trois mille cinq cent quarante deux fois plus élevée que la moyenne nationale, départements d'outre-mer compris. Fait plutôt froid dehors, mais ce soir dedans l'on sert de la fricassée de poulet brûlant. Du véritable southern fried. Vous comprenez pourquoi l'on a pris tous les risques, exactement le genre de truc qui vous met en appétit. Romain Gary n'aurait pas manqué de l'intituler La Promesse de l'Aube ( 10 ).
PRECISIONS
Pour les lecteurs distraits - qui sautent des épisodes ou qui lisent en diagonale – oui la semaine dernière dans notre 219° livraison nous avons déjà croisé lors de Rockers Kulture 2015, Christophe Gilet, Hervé Loison, et Thierry Sellier, trois tristes sires qui sèment sans répit la terreur dans nos paisibles contrées en se faisant appeler Jake Calypso. Et cette soirée aux 3 B, ce sont bien toujours Thierry Sellier, Hervé Loison et Christophe Gilet, les trois mêmes bandidos, qui sous le nom de Hot Chickens sévissent dans nos douces campagnes provinciales, depuis déjà longtemps.
Deux formations, un même orchestre. Mais pas interchangeables. Hot Chikens serait plus rock and roll et Jake Calypso davantage roots. La ligne de partage n'est pas toujours évidente, surtout dans la fièvre des concerts, ainsi les auditeurs les plus heureux auront déjà eu le double privilège d'entendre Hot Chikens jouer des morceaux de Jake Calypso et Jake Calypso interpréter des titres de Hot Chikens. Tout le monde a compris ? De toutes les manières Jake a dit que l'important était de ne pas faire de chiqué pour prendre son pied chaussé de daim bleu.
HOT CHICKENS / FIRST SET
Espace confiné. Beaucoup de monde qui se presse contre les murs mais les Hot Chikens ouvrent les portes du paradis du rock and roll en grand et vous font atteindre le nirvana en trois minutes. L'extase tout de suite, mais après il est interdit de redescendre. Ce n'est pas grave parce que nul n'en éprouve l'envie. L'est sûr que lorsque – ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres - l'on vous ravage le cerveau avec Rave On de Buddy Holly, vous rayez votre nom de la liste des démissionnaires.
Serrés comme des harengs en caque, à trente centimètres des musiciens, parfait pour prendre la grande claque. Vous n'êtes plus un spectateur, vous faites partie intégrante du show. Pour un peu vous risqueriez de comprendre tout à l'envers, trois malheureux poulets pré-rôtis encerclés par une horde de renards affamés qui clignent de l'oeil. C'est le contraire, trois loups aux babines sanglantes qui s'apprêtent à faire un carnage au milieu du troupeau de moutons.

Un élément essentiel : Thierry Sellier, un kit minimal de batterie, caisses grosse et claire, un tom, deux cymbales. Ça lui suffit amplement pour se faire entendre. Bourre le train, pousse les deux autres. Souvent entre deux morceaux, pour combler les intervalles, il vous lance une tambourinade à arrêter net de stupeur une charge d'éléphants. Puis il revient à un tempo plus humain, et lance le bébé avec l'eau du bain et le savon. C'est que les deux autres ostrogoths, il faut les nourrir grave, faut leur servir la béchamel brûlante à plein gosier. S'emballe sur les cymbales, tamponne sur son tom comme dans un duel à Tombstone, quant à la claire elle encaisse des uppercuts très sombres.

Un élément essentiel : Christophe Gilet, belle tunique à damier mais ne perdez pas de temps à jouer au go ( go. go cat ! ) dessus. Matez plutôt son ampli, l'a-t-il trafiqué ? Je n'en sais rien mais il en sort de superbes sonorités, très électriques. L'alimente la bête avec ses doigts, agile le Gilet, toujours un riff de rab pour vous vriller la tête. Ça vous traverse la chair comme une chignole de dentiste, mais vous fait un bien énorme entre les deux oreilles, vous découpe le cortex en tranches sanguinolentes. C'est ainsi que l'on aime le rock, interminablement saignant.

Un élément essentiel : Hervé Loison, qui n'est pas venu les mains vides. Guitare basse en bandoulière. N'en joue pas, il grabuge gras. Avec les deux tueurs à ses trousses qui le talonnent de près, ne lui reste qu'une seule chance de survie. Toute la gomme sur toutes les gammes. Pas le temps de demander le programme, entre dans la danse dès que ça démarre. Le genre de gars qui ne pleure pas quand le bus ne s'arrête pas à l'abri-bus, court après et entre de force par la fenêtre arrière.
Train d'enfer. La denrée de base. La feuille de salade que l'on glisse sous l'aileron de requin. A la différence près qu'ils nous le servent vivant et les crocs aiguisés en avant. Du vrai requ' in' roll. C'est un peu la faute à Hervé. Un véritable Loison de bonheur. Le rock and roll basse énergie, il en méprise toutes les prises. L'est exclusivement branché sur la haute tension. Certains chantent du rock and roll, lui il le glapit comme le renard du désert, il le ricane comme une hyène affamée, il le féroce comme un rhino, il le brame comme un cerf en rut, toute la ménagerie y passe, pousse même la tyrolienne de Tarzan quand il se balance de liane en liane. Un seul truc qu'il ne fait pas, ne triche pas comme l'autruche. Nous refile le grand frisson.

Le jungle beat pépère – fais durer Thierry pendant que je reprends souffle - il ne connaît pas, l'arrache le tambour de la panoplie et s'en va explorer le café qui est long comme un jour sans sexe. S'en vient apporter la bonne parole du rock and roll aux lointaines peuplades qui n'ont pas accès à la scène. Et Thierry le suit, tout sourire, maintenant de ses baguettes de foudre une cadence infernale, toute l'assistance entre en transe en répétant spasmodiquement le mantra magique Hey ! Bo Diddley ! Si fort que Christophe resté près de son amplificateur est obligé de tendre une oreille pour deviner le moment exact où il doit tronçonner le riff torride.

N'ayez crainte, ce n'est pas près d'être terminé. La set-list est aussi longue que La Légende Des Siècles du vieil Hugo. Celui qui tonnait depuis l'exil. Longtemps qu'Hervé n'a pas vu sa grand-mère. Respecte les ancêtres. Jette sa basse sur le plancher et court chercher la vioque. Elle n'est pas loin, et question ambiance ce sera toujours meilleur qu'à l'hospice. L'est un peu décatie - avec un tel petit-fils, la vie n'a pas dû être toujours rose – d'ailleurs il l'a repeinte en rouge mat, qui tire un peu sur le marron, l'aurait pu choisir une teinte un peu plus suave, mais on lui pardonne, après tout il n'est pas peintre. C'est reparti pour un tour.
Que du bon. Du Johnny Burnette, du Gene Vincent, du Little Richard. Si vous trouvez mieux, envoyez-moi l'adresse de votre crèmerie. Slappin'Loison a sans cesse un nouveau classique à rajouter. Partisan du set à rallonges, et les deux complices derrière qui ne disent jamais non. Nous propose, à regret, un petit quart d'heure de pose. Juste le temps de nous humecter le gosier.
DEUXIEME SET
Le pire est toujours certain. Vous serez priés de ne pas confondre ce qui s'est passé dans le premier set avec ce qui va suivre. Dites-vous que vous êtes comme les trois singes qui n'ont rien vu, rien lu, rien entendu. Certes ce sont les mêmes acteurs, Thierry Sellier, Christophe Gillet, Hervé Loison, je répète les trois noms pour que vous les évitiez soigneusement si vous voyiez par hasard leurs noms écrit sur une affiche. Mais après tout vous êtes grands et responsables. Si vous tenez à vous torpiller une durite, à ne plus savoir comment vous vous appelez, c'est votre droit le plus absolu. Pour vous rassurer toutefois, prenez exemple sur moi, j'ai survécu. Preuve que c'est possible. De justesse, mais enfin je suis vivant.

Y avait déjà eu des signes avant-coureurs dans le premier set. Des prémonitions qu'il fallait savoir entrevoir. Mais peut-on aller à l'encontre de la nature ? Les 3 B, c'est sympa, l'accueil est cordial, les consos à des prix abordables et le public choisi parmi les amateurs de rock. Mais c'est un peu étroit et plutôt bas du plafond. En temps normal, c'est parfait. Mais lâcher les Hot Chickens dans un lieu si convivial, c'est un peu comme si un régiment de blindés faisait des manœuvres dans votre deux pièces-cuisine.
Et les Hot Chickens étaient en pleine forme. N'ont pas l'habitude de battre le fer tant qu'il chaud, au contraire, le replongent dans la fournaise jusqu'à ce qu'il devienne liquide et coule comme du white lightning mordoré au venin de vipère au fond de votre estomac. Le truc qui vous plombe à vous faire sauter les plombs. Quatre-vingt dix minutes de Hot Chicken Rock and Roll parfumé au TNT. Chaque titre comme un bijou atomique. Une rivière de diamants irradiants.

Que voulez-vous savoir ? Loison sautant de table en table ? Gilet qui déchaîne sur sa gratte écumante ? Sellier et ses percussions tomahawks ? Le public qui reprend en coeur ? Les plus excités qui chantent a cappella à côté du micro ? Qui miment les musicos et le chanteur, comme chez eux devant la glace. Et Angélique, la douce, la blonde et innocente Angélique dans son beau bustier bleu qui se retrouve d'autorité, à jouer de la old mama toute la fin du concert, Hervé parti ailleurs, en safari, à l'extrême bout du comptoir, en balade sur les mains des fans surexcités. Ca bouge et ça remue et ça jerke de tous les côtés. Des flashs dans la tête, Loison qui sautille sur sa contrebasse couchée à terre, puis à son tour rampant, soufflant dans son harmonica tout en pinçant deux cordes de sa basse gisant elle aussi sur le carrelage. Les hymnes de Gene Vincent de Pink Thunderbird à Say Mama exaltés jusqu'au zénith de leur puissance. Une pincée de Jerry Lee Lewis, un comprimé de speed-killer ne peut pas faire de mal ! Un final de dix minutes, tout le monde qui hurle et roucoule tour à tour, Hervé qui mène le choeur de tous ces cacatoès époumonés et subjugués.

Vous regrettez de ne pas être venus ? Vous savez il n'y a pas que le rock dans la vie. Les Hot Chickens nous le rappellent. Le bâtard possède un père indigne. Porte un nom : le blues. Et les Hot nous en auront déchiré quelques uns. Sellier qui nous tape les douze démesures comme le fantôme de minuit qui vient réclamer son dû dans Lady Macbeth, Christophe qui déglingue les riffs, en en rajoutant chaque fois un de plus pour l'interminable rocky road blues de l'énergie du désespoir, et l'harmonica d'Hervé qui sanglote des grelots de fiel. Ultra électrique mais authentique. Du grand art. Un merveilleux concert. De fureur festive.
RETOUR
Le temps de dire au revoir et de remercier Phil Fifi pour cette extraordinaire soirée. Attention on reviendra, car les 3B ont une programmation alléchante pour les semaines à venir. Et l'on s'arrache. Quatre heures du matin, la teuf-teuf éteint ses phares devant la maison. Neuf heures du matin, j'ouvre un oeil ( le bon ), la route et le paysage sont recouverts de neige. La preuve, irréversible, que les Dieux de l'Olympe protègent les rockers.
Damie Chad
( Photos fb de Jean-François Chasles )
K'PTAIN KIDD / FEELIN'
FEELIN' / I CAN TELL / GROWL / LINDA LU / I'LL NEVER GET OVER YOU / SHAKIN ' ALL OVER / WEEP MORE, MY BABY / DOCTOR FEELGOOD / LONGIN' LIPS / PLEAQE DON'T BRING ME DOWN / I JUST WANNA MAKE LOVE TO YOU / PLEASE DON'T TOUCH / K'PTAIN KIDD / LE DIABLE EN PERSONNE.
TONY MARLOW : guitar, Vocals / GILLES TOURNON : Basss, Backing Vocals / STEPHANE MOUFLIER : Drums, Backing Vocals / + LUCAS Trouble : Organ on Le Diable En Personne.
Enregistré and Mixed on October 2014 at The Kaiser Studio by Lucas Trouble.
ROCK PARADISE / ROCKERS KULTURE

On l'attendait, nous en avaient parlé chez les Loners avant leur prestation, nous en ont donné un avant-goût au sixième Rockers Kulture avec leur set de killers-heroes voici 15 jours et maintenant l'artefact comme jargonnent les archéologues est devant nous, magnétique. Magnifiquement mis en scène. Pour une fois un dos de pochette peut rivaliser avec la vitrine de devant ! L'intérieur est aussi à la hauteur, n'ont pas bricolé, ont demandé à un véritable artiste de prendre le design sabre d'abordage au clair, Eric Martin s'en est tiré avec les honneur de la guerre.
Feelin'. Affirmatif, ils l'ont le feeling. Petit défaut, l'est tellement bien enlevé ce morceau avec ces vagues de guitares qui viennent s'abattre sur vous comme sur les falaises de Douvre que vous risquez de ne jamais aller plus loin sur le disque. Trop bon cette voix de Tony comme l'écume sur les crêtes de l'océan. Quant aux soubassements de basse de Gilles Tournon à la base des lames, faites-y gaffe pourraient vous emporter à jamais. Pas la peine de ré-enclencher une seizième fois le curseur sur la première plage, la deuxième I Can tell vaut aussi le détour, ah ce petit solo si typically british, vous risquez d'en mordre votre chien, à peine deux minutes trente secondes mais c'est si bien en place, si bien proportionné que l'on n'y prête plus attention, l'on nage en plein bonheur, l'on est bien comme dans une capsule spatiale en partance pour les confins de l'univers, car il est des dimensions où le temps s'abolit. Growl ! Le bonheur est de courte durée sur cette terre ! La bête est sur vos talons et elle court méchamment plus vite que vous ; surtout ne vous retournez plus, une meute de longues-dents comme les appelait Rahan vous a pris en chasse, pour la ligne d'arrivée franchie en vainqueur c'est trop tard, un dernier grondement de fureur de Tony Marlow et vous êtes déchiquetés sine die. Remarquez que la prochaine bestiole qui vient ne vaut pas mieux. Mignonne, jolie, Linda Lu, tout ce que vous voulez, elle ne va pas moins vous couper le coeur en deux et les trois forcenés l'aident un peu, un vocal qui file et des instrus qui cavalent à toute blinde, essayez de faire bonne figure avec cela. Et cette voix emphatique pour annoncer le drame et la musique qui chavire pour se moquer de vous. I'll Never Get Over You. L'on accentue la taquinerie. Un petit côté très sixties, frisottis et insouciance. Ça pourrait faire un super slow, nos trois flibustiers vous le descendent grand largue. Pas question de traîner un limaçon sur le dance-floor. Vite fait, bien fait, c'est ainsi qu'on emballe les filles et le rock and roll, sinon c'est du temps perdu et vous n'arrivez à rien. Pour sûr vous avez besoin d'un remontant. Le voici, un petit Shakin All Over, l'hymne kiddien par excellence, l'épreuve de compétence absolue. S'en sortent comme des cadors, ah ! Stéphane Mouflier vous ouvre une bouteille de champagne à chaque battement, de temps en temps il casse quelques bouteilles, mais en dans l'ensemble ça fuse en douceur et la guitare de Tony vous empile de ces couches de miel, c'est Tournon qui rajoute le piment de Cayenne avec sa basse, vous emporte la gueule et tout le reste avec, mais qu'est-ce que c'est bon ! Qu'est-ce que c'est bien. ! Weep No More, My Baby. Pas la peine d'en chialer de bonheur dans les mouchoirs. Jouent les mecs sympas, les blancs chevaliers qui viennent au secours de la belle orpheline. Pour un peu on oublierait que c'est eux qui l'ont lâchement abandonnée. Les sixties au grand coeur. Les gros hypocrites qui ne pensent qu'à batifoler ailleurs surs leurs pétaradantes guitares. La preuve sont allés jouer au docteur. Une sommité en la matière, ce bon vieux Doctor Feelgood, des vicelards comme lui qui vous refilent d'étranges pilules il n'y en a pas deux, en tout cas le médoc a produit son effet, nous recrachent un bon vieux rhythm'n'blues des familles, cabossé de derrière les fagots, un truc de trucker qui brinqueballe dans la poussière à couper aux couteaux sur la piste oubliée du Convoi de Sam Peckinpah. Longin' Lips. Je veux bien, mais parfois les gerces ont des lèvres coupantes comme des rasoirs, faut être un pro pour ne pas y perdre les bijoux de famille. Sont des as. Gèrent l'affaire sans problème. Please Don't Bring Me Down. Genre de marins en goguette descendus de la goélette qui n'ont pas envie de laisser tomber le morceau de chair f raîche. I Just Wanna Love To You. Directjy from my sex to your sex. En prise directe. N'y vont pas par quatre chemins. Ca pulse de tous les côtés. La guitare qui ramone, les drums qui appuient, la basse qui pousse, hardi les gars à la manœuvre et la voix du capitaine insinuante comme jamais. L'est vrai que toutes les voies du Seigneur ne sont pas impénétrables. Please Don't Touch, décidément en forme, jouent les vierges effarouchées. Sont excités comme des tigres, faut entendre comme ça barzingue dans les tous les coins. Ne se retiennent plus. Même que le drummer ne parvient pas à arrêter le morceau. C'est tellement bien envoyé qu'il leur faut une piste d'aérodrome long-courrier pour stopper le tintouin. K'ptain Kidd, fini la collection des tubes de Johnny, nous propose un morceau hommagial, mi-chant de marins au cabestan et mi-tempête dans les voiles que l'on hisse encore plus haut pour profiter du souffle du diable. Et comme l'on est trop bien pour se quitter, un ultime cadeau, une version de Shakin' All Over, en français. Le Diable En Personne. Pas des matelots d'eau douce qui vous refilent la traduction en surimpression, re-recording, z'ont refait le morceau, un orgue en plus au catalogue, ça change la donne. Il y a longtemps qu'on les a remisés au garage les pianos électriques, mais en les années soixante ils étaient de toutes les aventures, souvenez-vous des Animals, de Brian Auger et de quelques autres...

Avec leurs reprises de Johnny Kidd Tony Marlow et son band nous ont refilé un concept-disc. De haute qualité. Avec unité de ton et d'amplitude. Un groupe qui joue ensemble. Indissociables. Une performance. Pouvez réécouter les 45 tours originaux et vinyl de Johnny Kidd ( c'est que j'ai fait ), le K'ptain Kidd, il ne copie pas, il ne reproduit pas à l'identique, l'imprime sa marque, trace sa route, vous avez le son du vingt et unième siècle, respectueux mais pas servile. Une lecture différente. Trouve son île au trésor tout seul, mais il partage les coffres remplies de sequins avec nous.
Encore un épisode à rajouter à l'interminable légende de la piraterie rock and roll !
Damie Chad.
THE OL' BRY / BOPPIN' N' SHAKIN
BOPPIN' N' SHAKIN' / Mr BOOGIE / WHEN I WAS WITH YOU / I FOUND A GIRL / I NEED MY BABY / AM I BLUE / MY PAIN / BOB'S BUBBLE / IF YOU WERE MINE / BAILA COMMINGO / I'M GOING HOME / FOR SO LONG / DO IT WILD
DIEGO : Lead Guitare / EDDIE : Vocal, Guitare / MARCELLO : Batterie / REMY : Sasophone / THIERRY : Contrebasse.
BLR STUDIO / ROCKERS KULTURE / ROCK PARADISE 35 / ( RUE STENDHAL )
Nous avaient tellement bluffé au sixième Rockers Kulture que l'on était pressé de rentrer à la maison pour écouter le deuxième marmot de la couvée des Ol Bry. De toutes les manières l'on avait acheté le CD avant le début de la soirée. Par principe. Un groupe à surveiller comme le lait sur le feu. L'on ne sait jamais par où ils vont passer. Mais au moins, on peut garder l'esprit tranquille, l'est sûr que ça va déborder.
Encore un bel objet. De plus en plus de groupes comprennent qu'un CD ou un disque de rock and roll doit être conçu en tant qu'art total. Félicitations à Wild Child Sophie pour la pochette cartonnée, c'est très beau, très réussi. Splendide couleur de fond, un mélange de bleu grisé d'ardoise, une teinte unique qui vous arrache l'oeil tout en vous caressant la prunelle. Et puis cet équilibre incroyable dans le dessin figurines et le lettrage.

Boppin 'n' Shakin' : pétillant et scintillant, Eddie au chant et magistral qui mène la danse. Mine de rien, il instille une sacrée urgence dans le morceau tout en laissant au reste de la bande le temps de voler tour à tour de leurs propres ailes. Le sax de Rémi aboie pour qu'on ouvre la porte à Mr Boogie. Et tout le monde accourt en shuffle pour accueillir le bonhomme de braise dignement, l'on se dandine à qui mieux-mieux, l'on ne s'arrête pas en si bon chemin, c'est la ronde des musicos qui farandole. Changement de ton, brisure de rythme , When I was With You, nostalgie swing, c'est terminé mais l'on ne ne va pas en faire un drame non plus. Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. Que disais-je ! I Found A Girl, on n'a pas attendu longtemps, la vie est belle, ça sautille de partout, des attaques de saxo à la Little Richard, mais la guitare de Diego Suarez apporte une légèreté insolente, qui n'est pas dénuée d'humour qu'accentuent les claquements de mains et le vocal d'Eddie qui s'amuse à s'auto-parodier. Attention l'on redevient sérieux, I Need My Baby, l'on appuie là où la douleur est la plus sourde, l'on se rapproche du blues, même si l'on garde encore son énergie pour galvaniser les âmes en détresse. La musique emplit le paysage, Eddie revient plus pour rajouter une couche. Am I Blue, un des deux seuls morceaux non originaux de l'album. Du blues l'on repasse au boogie, un sax qui pousse en avant mais un refrain un peu languissant. Ce n'était qu'un faux semblant. Déprime totale sur My Pain, la guitare qui pleure comme quand la gondole de Venise coule dans le grand canal. Eddie chante comme Eddie Cochran sur I Have Lately Told ThaT I Love You. Les rockers sont de grands sentimentaux. Ne se tire toutefois pas une balle dans la tête, revient au boogie Swing sur Bob's Bubble, ça remue du bulbe comme dans les années quarante. Joie à tous les étages sur If You Were Mine, on prend vingt ans d'un coup mais on rajeunit d'autant, sixties joy, sur la fin du morceau Eddie se permet de chanter comme Elvis, ce n'est pas qu'il faut oser. C'est qu'il faut y parvenir sans être ridicule, en mettant ce minuscule décalage distancié qui montre que l'on n'est pas dupe de soi-même et que l'on sait s'amuser. Avec un ibérique dans l'équipe l'Espagne devait bien pousser sa faena dans l'arène. Refrain en langue de Cervantés sur Baila Commingo, et pour le reste c'est une véritable auberge espagnole dans laquelle chacun emmène son plat préféré, un tempo de jazz, une folie de swing, un soupçon d'Appalaches, les mille facettes de la musique populaire d'Amérique. I'm Going Home, la seconde reprise, de Gene Vincent. Ce morceau est toujours une fête dans les concerts des Ol Bry, l'orchestre ne rate pas son interprétation, Savent prendre aux tripes. For So long, plus crooner que moi tu meurs. Wap ! Doo Wap ! et un petit relent brésilien dans la guitare de Diego Parada Suarez, rupture de ton et soulignage des choeurs, et une bulle de chewing gum américain pour donner du goût et le style décontracté. Do It Wild après cette petite croisière en territoires contigus l'on revient dans le country natal, celui qui se mue très vite en rockabilly lorsque l'on accélère la chevillette. Ce n'est pas sur la pochette mais il y a une ultime gâterie Baby ! Oh Baby ! Une berceuse sixties pour que vous fassiez de beaux rêves qui parfois se changent pour quelques secondes en balade cow-boy et l'on revient au bercail.
Ce n'est pas un disque cent pour cent rock and roll, mais cent pour cent qualiteux. L'on y retrouve toute la musique américaine blues, swing, jazz, crooner, rockabilly, un panorama visité avec doigté et intelligence. Faut prêter l'oreille, car tout est dans la nuance. Le Thierry Gazel et le Marcello sur la batterie ils ont dû marner pour s'enquiller tous ces miroitements infinis de rythmes clignotants. Z'ont tous dû prendre un plaisir de dingue à l'enregistrer, chaque musicien a pu apporter sa pierre à l'édifice, faut le réécouter une fois au moins pour chacun des instruments, les interventions étonnantes ou pleine d'humour ne manquent pas.
Un disque à posséder. Mais vous l'avez déjà.
Damie Chad.
GUILLAUME STAELENS
ITINERAIRE D'UN POETE APACHE
( Viviane Hamy / 2013 )

Roman. A reçu le Prix du Roman Métis des Lycéens 2014. N'est pas sans analogie avec Alphabet City d'Eleanor Henderson ( voir KR'TNT 202 du 25 / 09 / 14 ), traite un peu de la même génération, celle qui est née au début des années 70. A la différence près que Guillaume Staelens parle du dehors d'une Amérique, telle que nous la mythifions. Un livre à cheval sur deux mondes, l'Europe et les Etats-Unis. L'ancien et le moderne. Le vieux et le jeune. C'est pour cela que l'on a dû lui décerner le prix du roman métis, pas pour le sang mêlé de son héros. Car Apache il l'est doublement, de moitié réelle lymphe apache – tribu des Nez-percés - et métaphoriquement parlant, de ces apaches français qui furent les mauvais garçons de Paris, les voyous.
Serait plutôt un voyant. Un Rimbaud américain. Pas un écrivain, un dessinateur qui vit une existence très différente de par son milieu et son implantation géographico-historiale de l'Arthur de Charleville-Mézières, cher à Patti Smith. De laquelle il écoute les disques. Connaîtra une vie dont la parabole épouse la forme de la destinée de Rimbaud. Ecoute Patti Smith mais ne fait pas partie de la punk generation. Né en 1973, il s'inscrit très logiquement dans la suivante, la grunge generation, celle qui écoute Nirvana dans les nineties.
Un élève doué. Sa mère séparée de son riche mari blanc ne lui passe rien. Ne s'est pas enfuie de sa réserve pour que son fils y retourne. Et lui le cul entre deux chaises dans une bonne école de bourges blancs que lui paie le paternel. Mal dans sa peau, trop rouge aux entournures. S'inscrira à l'université section d'anthropologie. Mais il rêve d'une autre vie, moins convenue, moins entée dans le système.
Initiations. Artistique et sexuelle. Zone chez les copines, glande un max. Ecoute des centaines de CD de rock. Quitte la fac, voyage : Vancouver, San Francisco, New York, Seatle. Tombe dans la drogue. Douce puis dure. Sa copine se prend pour Verlaine et lui tire dessus. Ne quitte plus les feuilletons idiots de la télé. La prime jeunesse s'achève. Faut bosser. Sa licence d'anthropologie lui permet de trouver un boulot en Amérique du Sud. Fait le tampon entre la société et les indiens surexploités qui récoltent les betteraves.
Laisse tomber le dessin. Ne se préoccupe plus de la survie des planches qu'il a abandonnées à ses amies. Commence à prendre conscience du monde. De l'exploitation capitaliste de la planète. Ne veut pas devenir un produit de consommation de masse. Ni consommateur, ni consommé. N'est plus dans la déglingue. Tombe amoureux. Envie de se stabiliser avec sa dernière compagne. De fonder une famille, de faire un bambino. Trouve un sens à sa vie. Ses idées ressemblent de plus en plus aux éditos du Monde Diplo. Décide de mettre ses pensées en pratique. Ne rêve pas de la révolution future. Se contente de soutenir les régimes qui s'essaient à des politiques de rupture.
Pour ramasser un max de fric, consent à aider Chavez en transportant en douce des armes destinées à soutenir les nouvelles politiques en sous-main. Marionnette des services secrets. Le premier convoi se passe assez bien. Le deuxième beaucoup plus mal. Revient avec une jambe en moins. Rien n'arrêtera la gangrène. Meurt au même âge qu'Arthur Rimbaud d'une similaire infection généralisée.
Le livre s'arrête là. This is the end my beautiful friend. Encore une des nombreuses métamorphoses du père Rimbe. Plus un mystique sauvage selon Paul Claudel, mais un Rimbaud alter mondialiste. Signe impavide de la décadence de l'Occident. Meurt à temps dans le bouquin. Commençait à tresser des dithyrambes à Barack Obama... Se met le bâton de dynamite dans l'oeil jusque dans la rotule.
Un beau titre. C'est la fin qui est décevante. Les dix ans qu'il passe sans écouter du rock. Devient terriblement ennuyeux. L'on ne devrait pas vieillir. Faudra penser à l'interdire.
Damie Chad.
19:53 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/01/2015
KR'TNT ! ¤ 219. ROCKERS KULTURE 2015 / VASELINES / MA RAINEY
KR'TNT ! ¤ 219
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
22 / 01 / 2015
|
ROCKERS KULTURE 2015 VASELINES / GERTRUDE MA RAINEY |
ROCKERS KULTURE 2015
NEW MORNING - 16 / 01 / 15
P'TIT ROCKEUR TRIO / NIGHT CATS / MISS JACK
NELSON CARRERA / HOT SLAP TRIO / HAYEN
CRASHMEN / WILD ORCHIDS / K'TAIN KIDD
BLUE TEARS TRIO / JAKE CALYPSO /
WHEEL CAPS / OL' BRY

Petit voyage sans histoire. Nous ne répèterons pas l'erreur de l'année dernière où nous avions tourné durant trois quart d'heure pour trouver une place de stationnement. Du coup nous avions raté le Blue Tears Trio. On laisse la teuf-teuf à l'entrée de Paris et l'on emprunte le métropolitain. Tout baigne - surtout nous, avec la dantesque giboulée qui nous coiffe le museau sur le boulevard de Stasbourg, quand je pense que certains dépensent leur argent pour un abonnement piscine - l'on a une heure d'avance. Le temps de saluer les vieilles connaissances, d'inspecter le stand de Rock Paradise et déjà Tony Marlow, le maître d'oeuvre de la soirée, présente le premier groupe. J'en oublierai de revenir feuilleter ( et acheter, mais ce ce n'est que partie remise ) le bouquin Vikings & Panthers sur les bandes des années 1980 avec les photos d'époque de Gilles Elie Cohen et les textes de Jean-William Thoury et Pascal Szulc, le tout sous l'égide de Jimmy Pantera et de Serious Publishing.
P'TIT ROCKEUR TRIO

Première surprise du chef. N'étaient pas prévus mais nous sont offerts sur le plateau. Sont tout jeunes. Pas des maternelles. La vingtaine. Parfait : le rockabilly a besoin de sang neuf, d'être un peu bousculé sur ses arrières. Rien que la cravate rouge-clown et l'espèce de choucroute moutonnière sur la tête d'Aramis le batteur– un fameux mousquetaire – vous indiquent que la banane des puristes risque de se dresser sur leur crâne. Ce ne sera pas le cas, seront accueillis par de sérieux applaudissements. Le public nombreux a su se montrer ouvert et respectueux de toute forme d'expression.
Débutent par le Shakin' All Over de Johnny Kidd – lequel sera à l'honneur plusieurs fois tout le long de cette soirée – très électrique avec un étrange solo et une fin des plus brutales, une relecture, comme l'on dit qui essaie d'explorer les coins ignorés. P'tit Rockeur est sous son chapeau, à la guitare et au chant. Voix puissante et timbre comme légèrement compressé, pas du tout désagréable. Ne font que trois p'tits tours et s'en vont. Nous laissent un p'tit goût de revenez-y, vous retrouverez ces trois jeunes parisiens sur la compilation The French Rockabilly Scene # 6 et encore plus sur leur EP Hey Baby ! Sorti au mois de novembre.
NIGHT'S CATS

Deuxième surprise, Tony nous gâte. Les chats de la nuit se sont glissés en douce sur la scène. Contrastes saisissant avec les p'tits minous précédents. De sérieux matous qui écument les bars et les manifestations de Normandie depuis une quinzaine d'années. Z'ont le son. Celui de Carl Perkins dans les studios Sun. Puissant et superbement mis en place. Laurent nous domine de son imposante stature, chante juste. Je ne veux pas dire qu'il ne chante pas faux, mais qu'il sait poser sa voix avec cette impitoyable justesse qui est un des secrets du rockabilly, ce ne sont pas les musiciens qui accompagnent le vocaliste mais le chanteur qui par ses inflexions les met en vedette. Tour à tour – miam-miam le jeu de Guillaume sur sa contrebasse – mais aussi tous ensemble. C'est cette alchimie dont l'acquisition est une oeuvre de longue patience qui vous propulse le son du groupe au creux de l'estomac et vous transforme en punchy-billy consentant. Les chats de la nuits ne se déplacent pas à tâtons, impeccable piétinement du drummin' de Jérôme capable de n'importe quelle cavalcade sur les toits les plus pentus et les plus obliques, quant à la guitare de Christian il vaudrait mieux que vous ne l'entendiez pas, cela vous éviterait d'être jaloux de son savoir-faire. Lorsque les Night's Cats finissent leur trop court passage et ferment leurs pupilles resplendissantes nous avons l'impression que la lumière s'éloigne. Marée d'applaudissements.
MISS JACK

La troisième surprise, l'était pourtant invitée, mais sur Paris peu de gens connaissaient. Trois briscards qui ne sont pas tombés de la dernière neige. Frédéric aux drums, Rémy à la basse et Eric à la lead. Assurent comme des bêtes. C'est qu'ils ont une lionne chevronnée qui surveille la harde. Chasse en tête. Longiligne. A première vue un peu grande duduche, mais en fait une véritable duchesse. Un maximum d'humour et des tonnes de talent. N'a pas la langue dans sa poche. En deux minutes nous a mis dans celle de son jean. La revolver, celle qui tire plus vite que son ombre. L'a un grand amour dans sa vie. The female Gene Vincent. La petite copine d'Elvis Presley. Miss Wanda Jackson, la grande dame du rockabilly.
Se réclamer de Miss Wanda, c'est facile. C'est quand on passe à la pratique qu'il faut dégommer grave. C'est que la petite Wanda l'avait un sacré coffre et une énergie aussi inépuisable qu'une éruption volcanique. Fuji' Mama incendiaire. Pas de quoi faire peur à Miss Jack, l'éventrice du rockabilly. Dès qu'elle ouvre sa bouche c'est un torrent impétueux qui en sort. Nous interprète cela comme si c'était de la petite bière. Des chansonnettes sucrées pour midinettes. Nous délivre quatre torpilles qui prend la salle sous la ligne de flottaison. Touchés, coulés, au coeur. Finit sur un Rock Me Baby dévastateur. Quitte la scène parce qu'il le faut bien, mais l'avait encore assez de souffle pour une quinzaine d'autres. Vient de Normandie. Doit avoir du sauvage sang viking dans les veines.
HOT SLAP TRIO

Encore des normands. Z'ont dû louer un drakkar communautaire pour débarquer en force. Faut se méfier, au moyen-âge, ces barbares du nord sont arrivé jusqu'à Byzance. Les Hot Slap Viennent de Rouen, le pays de notre Cat Zengler, les a d'ailleurs rapidement chroniqués dans la précédente livraison de KR'TNT ! ( la deux-cent dix-huitième ), faut donc ouvrir les oreilles car le Zengler man, il ne se déplace pas pour les caramels mous.
Figure de proue de la scène locale qu'il avait écrit notre Chat Cinglé préféré. Un jeune jarl – s'appelle Martin - à la lead et deux vétérans pour le reste de l'équipage. Pas nombreux, mais font partie de commandos chargés de sauter sur le navire ennemi. D'abord vous remarquez Mathieu, avec sa banane aussi massive qu'une tête de cachalot, file de vilains coups de nageoires sur sa contrebasse. Doit y avoir une armature renforcée en tungstène à l'intérieur. Car le Mathieu il slappe à mort. Dans la série hotez-vous de là que je slappe à fond, il distribue les baffes et les claques à en faire péter les cordages. Slappe mais ne salopège pas le boulot. C'est qu'il na pas intérêt à laisser moisir les fromages dans le frigidaire avec Freddy le berseker fou derrière sa batterie. Je n'ai pas de preuve, mais je le soupçonne de pousser le baromètre sur le rouge, vers avis de tempête. A moins que ce ne soit Martin qui catapulte la farandole sur sa moulinette. J'hésite à désigner le coupable, mais à la vague d'applaudissement qu'ils récoltent, le public les plébiscite sans appel.
NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS

Il y a des jours où vous recevez une leçon. Quelqu'un se charge de vous mettre les poings sur le i grec de groggy. Vous ne vous en plaignez pas, car vous l'avez mérité. Vous l'avez bien cherché, vous ne demandiez que cela. Ce soir c'est Nelson Carrera qui se charge de jouer le maître d'école. N'est pas venu tout seul. L'a emmené quelques punchers de hauts niveaux. D'abord l'a rajouté Red Denis à la batterie. De la triche presque comme si vous preniez d'office Cassius Clay dans votre équipe. Des Scoundrels il a gardé Jorge à la contrebasse, Raph étant indisponible il a pris Thierry Crédaro à la lead. C'est un peu comme si vous disiez que vous ne choisissez pas le meilleur pour ne pas mettre toutes les chances de votre côté et que vous le remplaciez par un aussi meilleur. En plus Steve Rydell vient pimenter la sauce avec sa guitare sur un morceau ! De quoi nous plaindrions-nous !

Donc un combo de choc. A côté de soi, ça aide. Nelson est à la rythmique et au chant. Ce n'est pas du rockabilly. C'est un rêve. Une harmonie suprême. Le genre de truc que les anges là-haut doivent chanter là-haut dans l'empyrée autour du trône d'Eddie Cochran. La simplicité même. L'aisance. L'évidence. Survole. Vous emmène au nirvana du rockabilly. Economie des moyens et perfection absolue. Un ravissement. Rien à redire. Rien à regretter. Rien à rajouter. L'équilibre. La grande classe. Naturelle. Total respect. Ne me demandez pas ce que c'est que le rockabilly, ce vendredi soir 16 janvier 2015, c'était Nelson Carrera, un artiste touché par la grâce. Pas de mots pour la ferveur des applaudissements. Emotions et remerciements.
HAYLEN

Que se passe-t-il ? Les roadies s'affairent pour installer le matériel du groupe suivant, mais Red Denis joue à la montagne inamovible, refuse de quitter son tabouret. Et voici que Tony Marlow, vient brancher sa guitare. Sont rejoints par le contrebassiste Andrew Mazingue. L'on comprend vite pourquoi, dès qu'apparaît Haylen. Vous n'avez même pas le temps de contempler la beauté de sa gente personne qu'elle entonne le premier morceau. L'est encore à cinquante centimètres du micro que déjà l'on entend sa voix sculpturale. Ce que l'on appelle un don des Dieux. Une lyre d'airain comme disait Victor Hugo. Le genre d'organe auprès duquel vous vous sentez tout rabougris avec votre filet de larynx asthmatique.
N'ont pas répété, mais avec Red et Tony ce n'est pas grave, Andrew est le contrebassiste attitré de la belle Haylen Namvarazad qui nous verse de fortes rasades d'alcool vocales. Facile d'emporter l'adhésion d'une salle lorsque l'on est aussi douée. Même si sa voix est davantage adaptée à un registre beaucoup plus groove and soul. Un métier indéniable, avec Andrew à sa dévotion qui se lance dans de beaux soli. La reine triomphe et se retire aussi vite qu'elle est venue. Une performeuse qui peut risquer une incursion dans le vieux rockab des familles sans avoir à rougir.
CRASHMEN

Alerte rouge. Pour petits bonshommes verts. Un vaisseau spatial d'origine inconnue s'est écrasée sur la planète rockabilly. Pas d'inquiétude à avoir, la provenance de ce mystérieux astronef commence à être cernée. Manifestement bricolé dans une zone de Garage, à partir d'éléments importés du hard rock and roll à la AC / DC, plus quelques pointes de métal fuselé avec tout de même de fortes empreintes rockabilly, notamment une contrebasse d'origine contrôlée.
Trois sur scène. Ne sont pas perdus. L'on comprend tout de suite qu'ils ont l'habitude de rouler leur bosse. Je le répète, confiner le rockabilly dans des espaces trop limités n'est pas la meilleure façon de le perpétuer. L'embaumement est une opérativité post-mortem. L'est bon que de jeunes pousses s'essayent à de nouveaux mélanges. Les Crashmen en sont la preuve vivante. Sont vigoureusement applaudis. Le post-néo-rockab a encore de beaux jours devant lui. L'avenir appartient aux audacieux.
WILD ORCHIDS

Les Suisses ne gardent pas tous leurs trésors dans leurs coffre-forts. En laissent parfois sortir un de leurs montagnes. Ce n'est pas l'Heidie de alpages, mais les Orchidées Sauvages. Dans la famille Wild Orchids vous me donnerez Didier le père à la lead guitar, sa digne épouse Iris qui tient la rythmique avec sa petite dernière Margot à ses côtés, et je prendrais aussi les deux très jeunes filles, Maurine et sa basse, Morgane et ses drums. Ce n'est pas la Carter Family, mais l'esprit y est. Le genre de formation qui laisse présager le meilleur comme le pire. L'on fait confiance à Tony, s'il les a intégrées à sa compilation, c'est qu'ils doivent jouer avec un peu plus de sérieux que des marmottes qui se dorent la pilule au soleil.
L'a raison le Marlow. Dès la première plongée dans l'intro, l'on sent que l'on n'est pas chez les blaireaux. La guitare de Didier est l'arbre roi autour duquel s'accrochent et rayonnent toutes les branches. Belle voix et riffs incisifs, l'est méchamment secondé par le reste de la famille. Morgane m'étonne – on ne la voit guère derrière la silhouette paternelle – mais elle déploie sur ses tambours une énergie communicative, derrière ses grosses lunettes roses qui lui mangent le visage Maurine ne quitte pas le jeu de son père d'une demi-seconde. Me surprend pas ses interventions frappées d'un bon sens musical étonnant. Comme toujours c'est la mère qui vient rappeler qui commande, These Boots Are Made For Walkin' – le seul hymne féministe international connu de toute la planète – vient-elle nous asséner d'une voix très rhythm and blues de chat écorché. Les Wild Orchids – bien nommées, rares comme les orchidées des plus hautes cimes et sauvages comme le rockabilly le plus chaud – remportent un franc succès.
Non je ne l'ai pas oubliée. Elle ne chante pas et ne joue d'aucun instrument. C'est Margot, la clapper girl la plus émouvante qui m'ait été donné de voir. Des gestes d'une gracilité extrême, exécuté avec le sérieux authentique de l'enfance. Peut-être la personne la plus impliquée de toute la soirée.
K'PTAIN KIDD

Fini les moussaillons. Un inquiétant trois-mât barque se profile à l'horizon. Etamine rouge d'ultime danger et Jolly Roger noir à tête de mort flottent en haut du mât d'artimon. Encore un trio, mais celui-là est un habitué des mers du Sud. Deux forbans au cabestan, et ce marlou de Marlow sur la dunette. Vous l'avez reconnu c'est le fantôme de Johnny Kidd qui revient régler un vieux compte soudainement interrompu par un brusque naufrage voici plus de quarante ans sur les brisants acérés des côtes anglaises. Ce jour-là le rock anglais avait perdu un de ses meilleurs capitaines.
La hargne et la classe. Faut une hardiesse folle pour virer lof sur lof entre les récifs. Etoc et rock. Le goulet est étroit et la moindre hésitation court à la catastrophe. Reprendre Johnny Kidd, ne jouer que du Johnny Kidd, faut être fol. Ne s'agit pas d'un simple hommage. D'une belle image derrière laquelle on se faufilerait en douce. K'ptain Kidd ne donne pas dans les resucées. Fraye une route inconnue, d'annonce nouvelle comme disait Mallarmé.

Vingt minutes plein vent. Faut les voir tous les trois. Stéphane Mouflier dans l'entrepont qui bourre sa batterie et qui fait feu sans rémission. Mitraille le pont ennemi de sequins d'or. C'est lui qui force et emporte le passage. Gilles Tournon tire sur les écoutes de sa basse comme un forcené. Engouffre le maximum de vent dans ses voiles. C'est lui qui propulse et fournit l'élan nécessaire. Tony Marlow a empoigné la roue de la lead guitare. Se joue des courants. Navigue au plus près. Maîtrise impérieuse et impériale. Ca passe et ça ne casse pas. Le kraken qui surgit de la mer et disparaît à l'horizon. Foudroyants.
N'ont pas faits de prisonniers. Ont razzié tous les enthousiasmes. Ont tout donné et on a tout pris. Grandiose.
BLUE TEARS TRIO
Si vous croyez que le groupe qui a suivi a versé d'amères larmes bleues de désespoir, vous faites erreur. Magie rouge de cette soirée, tous les groupes se sont donnés à fond, chacun réalisant le miracle de faire oublier celui qui l'a précédé et d'être dans une si immédiate présence qu'il oblitérait la possibilité de l'existence du suivant.

Encore des normands. N'ont pas démenti leur réputation. Trois coups de slap de Didier et nous sommes transportés au coeur du pure rockabilly. Trio d'enfer. Entente phénoménale. Trois métronomes en folie. Difficile d'en regarder un sans avoir les yeux qui louchent sur les deux autres. Vous aimeriez savoir leur secret. Comme le furet qui court et qui passe de main en main sans se faire prendre. Blue Tears, tir tendu. Ne jouent pas du rockabilly. Ils sont le rockabilly. Hors de scène comme vous et moi ou le palmipède de Baudelaire, mais dessus investi d'une mission intérieure. En service commandé d'une force dont ils se sentent les activistes. Ce n'est pas parce que la contrebasse d'Aimé vous mire d'un oeil marrant qu'ils sont là pour rigoler. Didier est à la Gretsch mais plus que son jeu de guitare sans appel c'est sa voix qui charrie des tonnes d'émotions contenues, l'atmosphère en devient presque insupportable, menaçante. Dramatique. C'est Franck qui se charge de dissiper cette turpitude d'alligator qui chasse dans les marais. Fait tout le bruit possible pour éloigner la bête sournoise. Qui reprend sa faction dès la fin du break. Blue Tears, un jeu de cache-cache dans les eaux troubles du vieux Sud. Tension et électricité. Un très beau set. Comme une âme perdue qui s'en vient frapper à la porte des vivants. Le public ne s'y est pas trompé, la chaleur des applaudissements comme un merci.
JAKE CALYPSO

N'est pas sur scène que les appareils photos s'en donnent déjà à coeur joie. Avec Jake Calypso l'on rapportera le cliché ad hoc. Celui que vous montrerez à vos petits enfants, fièrement en disant, moi j'y étais. Avec le gars Lypso, la folie dionysiaque est à portée de la main. Maintenant cinq morceaux pour grimper tout en haut, c'est un peu court. Pour de simples mortels oui. Pour Jake Calypso, ce n'est pas un problème. Entouré de ses comparses de toujours, l'est prêt à vous attraper la lune et à vous l'offrir. Alors ce soir avec le renfort de Gilles Tournon, encore une fois ce sera du tout cuit. L'est décidément dans tous les mauvais coups le Gilles. A peine tiré sain et sauf de la déferlante K'ptain Kidd s'embarque pour les quarantièmes rugissants de Calypso. Doit avoir l'estomac solidement accroché, et par-dessus tout aimer les grands tangages. L'a pris son joujou préféré, la contrebasse, va subir un sale quart d'heure la big mama, lui tirera sur les cordes comme un damné, c'est que Christophe et Thierry ils n'ont jamais appris à jouer doucement. C'est un truc qui manque à leur culture musicale. L'on reconnaît qu'avec la jacquerie de Jake, l'on n'a pas le temps de cueillir les coquelicots dans les champs de blé.

L'arrière grand-père de Thierry Sellier devait battre la charge à Austerlitz, à la façon dont il artille sec sur sa caisse claire, lui a transmis le virus dans le sang, quant à Christophe il vous jette des enfilades de riffs comme d'autres épandent des bombes sur leurs frères humains. Et devant les trois sagouins qui vous fracturent les portes du rockabilly à coups de pieds de biche, Jake Calypso nous fait visiter les studios SUN à Memphis. Tennessee. A sa manière. Accélérée. Un tantinet infidèle si l'on est un orthodoxe partisan des préceptes de Sam Phillips. Mais ô combien jouissif ! N'est déjà plus sur scène. Navigue sur les mains du public, quelque part dans la salle. Une tornade en promenade. L'on en voudrait encore. Mais non faut arrêter le train sur une voie de garage. Il se fait tard et il reste encore deux groupes à passer. Je n'aime pas qu'on m'enlève ma part de gâteau alors que je n'ai eu le temps que de gober la cerise. Avant de rendre l'antenne, dernier message, l'intervention de Rémy – le saxo des Ol' Bry – plus les quatre fous furieux, sonnent encore plus fort que Springsteen...
WHEEL CAPS

L'affaire se corse. Démarrent sur les chapeaux de roue. Le dernier trio avant la route. The old rockab road. Celle que l'on ne se lasse pas d'emprunter. Des gars solides, casquette et contrebasse, lunettes et guitare, station debout et caisse claire. Pas besoin d'autres ingrédients. L'on aurait pu croire que le soufflé allait retomber. Il n'en fut rien. La fatigue commençait à se faire sentir dans la salle. Dès la moitié du premier morceau ils avaient rallumé la flamme. Et la mèche explosive du rockabilly. Venus de si loin pour rappeler les lois du genre. Une rigueur sans défaut. Pas la quadrature aventureuse du cercle mais carrés. Aux angles droits. Impeccabilité. Cette assurance tranquille qui en impose. On les aurait encore écoutés pendant longtemps. Une simplicité qui séduit par son honnêteté. Longs applaudissements. Les Wheel Caps ont fait mieux que remporter un succès d'estime. Ils ont séduit une assistance de connaisseurs.
THE OL'BRY

La tâche la plus ingrate. Passer après tous les autres et finir le boulot. Délicat et difficile. Entre voiture-balai et Dust my broom. Ou vous fatiguez. Ou vous triomphez. Les Ol Bry vont encore faire mieux. Vont nous surprendre. Sont comme le serpent qui change de peau tout en restant davantage reptile à chaque mue. Nous ont habitués à leurs métamorphoses. Flirtant avec le Doo Wop à leurs débuts, se rapprochant du pur rockab, par la suite, et maintenant ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Sont tous là, silencieux. Diego et sa guitare, Marcello et ses fûts, Thierry et sa contrebasse, Rémy et son saxophone, en demi-cercle, Eddie sa grosse acoustique blanche au niveau du cœur, au centre comme le moyeu de la roue du char solaire.

Subtil. Tout dans la nuance. Le grain de la voix d'Eddie inimitable, et tout le reste. Le léger haussement d'épaule, la légère inclinaison à droite, la hanche qui se casse, le sourire ravageur dans le coin, rien de gratuit, tout à chaque fois souligné par un lick de guitare, un plonk de batterie, un aboiement de saxo, un soupir de contrebasse. Un combo de rockab qui s'amuserait à accompagner Sinatra, qui jouerait, sans s'enfler de vantardise, au big band. Et le public qui entre dans le jeu et en raffole. Deux morceaux, deux joyaux, et reviennent vite à un rock and roll plus traditionnel avec toutefois la rythmique d'Eddie très en avant. Là où les autres travaillent le rythme, les Ol' Bry bossent le son. Sont toujours en avance par rapport à eux-mêmes. Sont pour l'extension du domaine du rockabilly. Explorent et annexent. Et puis s'en vont butiner ailleurs. Des têtes chercheuses. Un des groupes les plus originaux du mouvement rockab, qui n'en fait qu'à sa tête, qui ose les flirts interdits tout en sachant rester lui-même. Evolue sans se dévaluer. C'est la fin. Il faut rendre la salle. A la clameur de déception qui monte de la foule regroupée au bas de la scène, Tony Marlow arrache une petite prolongation...

CUVEE 6
Un Rockers Kulture exceptionnel. Qualité des intervenants et le monde au rendez-vous. Un super-merci à tous les groupes qui ont su se surpasser et pousser à chaque fois le bouchon un peu plus loin. Et surtout cette ambiance chaleureuse et mutuellement respectueuse. Un petit salut spécial aux Rookers du Havre, et à tous... Au fait Tony, pour la septième édition...

Damie Chad.
( Photos prises sur le FB de Edonald Duck )
LA MAROQUINERIE / PARIS XX / 18 – 11 – 2014
VASELINES
BE CAREFUL WITH THAT AXE EUGENE

Contrairement à ce qu’indique le titre, Eugene ne sort pas d’«Ummagumma», il sort d’Écosse. Il sort même du culte d’Écosse, à défaut de sortir de la cuisse de Jupiter. C’est un vaillant vétéran de l’indie scène des années de vaches maigres.
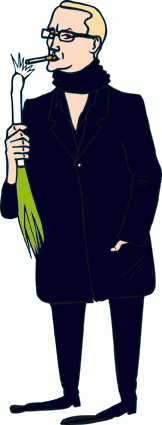
Eugene Kelly monta en effet les Vaselines avec sa copine Frances McKee en 1986. Ils enregistrèrent quelques singles de pop traînarde vaguement inspirée du Velvet et des Modern Lovers. Mais leur principale inspiration était bien sûr Stephen Pastel qui avec sa copine Agi pratiquait déjà ce genre d’exercice de chant dégingandé à deux voix. Stephen Pastel chantait d’une voix chaude et profonde, alors qu’Agi restait sur le registre de l’ingénue libertine highlandaise. Tous les groupes écossais se réclamaient du charmant Pastel : les Mary Chain, bien sûr, mais aussi Primal Scream, BMX Bandits et Belle & Sebastian. Eugene et Frances poussaient leur bouchon un peu plus loin puisqu’ils ambitionnaient aussi de sonner comme Lee Hazlewood & Nancy Sinatra.

Mais les Vaselines doivent surtout leur réputation internationale à Kurt Cobain. Dans une interview, Eugene avoue qu’il ne sait pas comment ses disques ont pu arriver jusqu’à Olympia, à l’autre bout des États-Unis, dans l’état de Washington, et fasciner à ce point les gens de Nirvana. Toujours est-il que Kurt clamait sur tous les toits que les Vaselines étaient son groupe préféré, et il étaya ses dires en incluant deux reprises des Vaselines dans l’album «Insecticide» : «Molly’s Lips» et «Son of A Gun», plus une troisième lors du fameux Unplugged MTV.

On trouve facilement les choses des Vaselines aujourd’hui. Il existe une bonne compile datant des années 90, «All The Stuff And More». Plus récemment, SubPop a publié un triple album contenant les deux EPs, l’album «Dum Dum» et deux concerts enregistrés live.
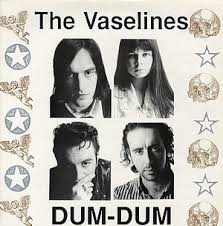
Ce qui permet de bien faire le tour du phénomène. Et de se rendre compte qu’Eugene Kelly était diablement en avance sur son époque. Car quelle claque ! Quel coup de Jarnac ! Il suffit simplement d’écouter «Son Of A Gun» pour comprendre qu’il se passe quelque chose de très spécial chez eux. Ils chantent leur truc au duo de voix ingénues de petites canailles irresponsables et c’est drumbeaté au bombast d’Écosse. Fraîcheur garantie. Sur la face B du premier disque, on tombe sur «Dying For It» qui annonce le génie guitaristique d’Eugene Kelly. Il descend tout droit de l’art des fuites glougloutées de Lou Reed. Son son court comme le furet. Eugene joue au loin. Il domine l’Europe entière depuis son nid d’aigle des Highlands. Il ne craint pas le vertige. Il joue des solos spatio-temporels. Le son qu’il sort dans «Teenage Superstars» annonce l’Eugenius à venir. Il sort une merveilleuse fricassée de notes de guitare grillées vives. C’est toute la white light et toute la white heat du Velvet qui s’échappe de ce cut - I don’t care - C’est alarmant de supériorité - Leave me alone - Ce mec avait alors tout compris, car tout est dans le son. Il place même un final éblouissant de type «Out Demons Out» et Frances n’en peut plus de trépigner ce hit underground absolument magistral. Le disque 2 s’ouvre sur «Sex Sux (Amen)», une grosse pop jouée à la guitare grasse et au beat tatapoum. On se retrouve aussitôt au cœur du problème. Eugene fait swinguer les Highlands et toute la carlingue. Il sort un son de folie qui perce des tunnels dans les ténèbres. Quel blast ! Et ça continue avec «Slushy», joliment chanté à deux voix sur canapé de bouillie distordue. Eugene avait bien intégré l’enseignement du Velvet. Il savait manier les mélodies cacochymes au touillage de son graveleux. C’est à ça qu’on reconnaît les géants du rock. «Bitch» est tout aussi admirable d’ingénuité perverse. Eugene semble jouer du bottleneck de lépreux assis dans un nid de frelons. On a là une merveilleuse ambiance décatie. Leur gros hit des années antérieures va sans doute rester «Dum Dum» - I’m a real dum-dum I even left my mom/ Cause I get on my knees and I do what I please - merveilleuse pièce de garage vaselinien, sèche et jouée au tambourin - I’m a real dum-dum I’m a son of a gun/ I was born to run but I wanted to walk - C’est l’archétype du hit garage bien foutu, même niveau que «Waiting For The Man». Encore une fabuleuse fuite de distorse éperdue dans «Hairy» (Poilu - on découvre au fur et à mesure qu’Eugene est obsédé par les pussies). Il n’existe rien d’aussi inspiré qu’un vieux cut des Vaselines. Ils perpétuent l’art sacré du Velvet, avec un chant transfigurateur étalé sur canapé de bouillasse suprême. «Lovecraft» est un trépidant cut garage littéraire, une vraie partie de beat en l’air avec un redémarrage en côte. Eugene sait rester innovant, quoi qu’il arrive. Et puis «Let’s Get Ugly» préfigure les blanches giclées d’Eugenius.

Oui car c’est dans Eugenius qu’Eugene déploya ses ailes. Après le split des Vaselines, il monta Captain America et enregistra un «Flame On» qui sentait bon les incendies de forêt. Mais comme le nom de Captain America appartenait déjà à Marvel Comics, Eugene dut rebaptiser son groupe Eugenius. Et que trouve-t-on dans Eugenius ? Genius, bien sûr. L’album «Oomalama» paru en 1992 est une véritable bombe, l’un des meilleurs albums de rock anglo-écossais avec le «Bandwagonesque» de Teenage Fanclub. Le morceau titre qui ouvre les festivités est une sorte de grosse épopée de distorse traversée d’alertes rouges. Le cut stupéfie. Pire, il embrase les plaines fertiles de l’imaginaire mésopotamique. Eugene optimise le grain du son à outrance. Il va là où personne ne va. Son goût de l’aventure le préserve des risques d’arthrose. Avec «One’s Too Many», le génie d’Eugene rue dans les brancards. L’animal tortille son hit à la note féroce et bien grasse. Il s’auto-harcèle avec une incroyable ténacité de guerrier mohawk. Il tire ses notes lumineuses et brode fiévreusement son gimmickage. Voilà ce qu’il faut bien appeler un cut monstrueux. Peu de gens savent sortir un tel son. Encore un hit extravagant avec «Bed In», embarqué comme du Teenage des origines. C’est une fantastique pièce de power-pop sub-sonique bourrée d’énergie et d’éclat du jour. Elle génère la flamboyance d’un son qu’on croyait perdu et qui hante toujours nos esprits. La chose s’étend dans le temps avec un solo d’une effarante liquidité. On retrouve le vieux laid-back eugenique dans «Down On Me» - Turn on the light/Down on me - Voilà un psyché d’allure royale, une fête pour les sens, au sens rimbaldien de la chose. «Oomalama» sonne véritablement comme l’album de rock idéal. Mais attention, ce n’est pas fini car la face B s’ouvre sur «Flame On», lancé à la note d’allumage comme «Born To Lose» des Heartbreakers. Puis ça pilonne. Voilà encore un hit mid-tempique d’allure martiale. Eugene et ses amis jouent avec une grâce infinie, le morceau fuit comme l’aileron du requin à la surface bleu émeraude du lagon. C’est enroulé au solo gras, voilà encore une vraie déclaration d’intention. Ils torchent ensuite «Here I Go» vite fait au gimmick ingrat avec un chant d’aplomb acre. C’est une fois de plus extrêmement bien soutenu. Eugene et ses amis savent brouter un beat et poivrer un gimmick. «I’m The Sun» sonne comme de la power-pop heureuse et ils explorent les grands espaces mélodiques avec «Buttermilk». L’imparabilité des choses, voilà leur secret. Ils terminent cet album somptueux avec un «Bye Bye» circonstancié. On a toujours ce son hanté par la beauté allégorique. Ils sont grandioses, élevés, inspirés. On ne comprend pas qu’Eugenius n’ait pas explosé comme Nirvana. D’ailleurs, Eugene les cite dans les remerciements, ainsi que deux autres grosses équipes de l’époque, Midway Still et Jacob’s Mouse.
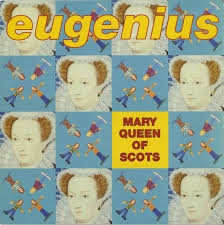
«Mary Queen Of Scots» fut le second et dernier album d’Eugenius. Il est malheureusement un peu moins présent que le précédent. «Pebble/Shoe» dispose d’un son plein comme un Polonais un jour de paie. Eugene sait très bien ce qu’il fait. Il traite d’égal à égal avec les dieux du groove écossais. Quand il attaque «On The Breeze», on sent bien qu’il a toujours en lui la rage de vaincre. Il n’est pas du genre à faire demi-tour. «Mary Queen Of Scots» est une pure insurrection. Eugene se livre à son sport favori qui est de pulser le gros son. Il joue donc une power-pop de rêve, indiscutable car tirée de profondes convictions royalistes. Avec «Easter Bunny», il passe au pur Teenage : même inventivité du son et même esprit conquérant. On sent une nette persévérance, chez lui. Eugene sait agencer les conditions d’un hit poundé. Il faut aussi absolument écouter le solo liquide qu’il joue dans «Tongue Rock». Le genius d’Eugenius éclate dans «Home Sick». Et ça continue comme ça jusqu’à la fin du disque, avec un «Fake Digit» explosé à coups de chorus de guitare et «Love Bread And Beers», puissant comme un taureau des hautes plaines et magnifié par des dynamiques de fond de studio.

Son album solo «Man Alive» paru en 2003 fut un peu décevant. On tenait Eugene pour le guitariste écossais le plus saignant du Commonwealth mais il s’était calmé. Par contre, on retrouve dans le premier cut de l’album «I’m Done With Drugs» son sens aigu de la mélodie bien tempérée, même si les guitares sonnent plus comme celles des Byrds. Il a même quasiment le même son que le Brian Jonestown Massacre, cette façon de claquer l’accord et de laisser filer le I-I-I. Comme Kim Fowley, Eugene commente ses chansons d’un style lapidaire. Pour «I’m Done With Drugs», il raconte que l’amour peut tout guérir. Ça commence mal. «Older Faster» sonne dès l’intro comme un morceau des Pogues. Non seulement Eugene allume sa clope avec un poireau, mais il prend en plus des distances avec son ancienne vie. On est aux antipodes de l’inventivité des Vaselines. Avec «Stop The Press», Eugene déclenche enfin une avalanche de purée. Il retrouve ses marques. Il envoie un chorus splendide, déployé, onctueux qui coule sur les doigts. Belle rumba que ce «Ride The Dream Comet». Il est certain que si Johnny Cash avait entendu «She Wears My Ring», il aurait demandé à Rick Rubin la permission d’en faire une reprise. Johnny Cash adorait tous ces trucs-là, les cercueils, les cadavres, les destins broyés. Avec «The Healing Power Of Firecracking», il tralalate comme au bon vieux temps des Vaselines. À la vérité, on s’attendait avec ce disque à une horreur de distorse et à des violences de bas de manche, à des accords de grosse Bertha et à un terrible carnage de feedback. Long Gone John le pirate nous a tous bien possédés. Visiblement, Eugene s’est rangé des voitures. Les Écossais, dit-on, aiment à surprendre. Il faut se souvenir que Mary Stuart osa ramener des catholiques dans une région verrouillée par les protestants. Ça ne lui a pas porté chance que de vouloir jouer les empêcheuses de tourner en rond.

Eugene et Frances ont reconstitué les Vaselines en 2009 pour une tournée et un album intitulé «Sex With An X» qui hélas ne tient pas vraiment ses promesses. On retrouve quelques vagues influences du Velvet dans la petite pop frippée du couple. Ils chantent «Such A Fool» à l’unisson. Il faut attendre la face B pour trouver un peu de consistance. «Poison Pen» est une petite pièce bien haineuse, dans la veine du vieux «I Hate You» de Kim Fowley. Eugene part en solo et retrouve sa niaque d’antan - I can rely on you to always let me down/ And I’ll trust you to never be around - la chose s’adresse à Lucifer, bien évidemment - Yes Lucifer, I fell for you - Le hit de l’album est un pied de nez aux années 80, «I Hate The 80’s» - It was all duran duran you want the truth ?/ Well this is it/ I hate the 80’s cause the 80’s were shit - Beau règlement de comptes. Et dans «Mouth To Mouth», il demande à une fille de lui faire du bouche à bouche, prétextant une urgence. Fière allure poppy, certes, mais il n’y a pas de quoi se relever la nuit. Il boucle l’album avec «Exit The Vaselines» qui fait le pendant à «Enter The Vaselines». Franchement, sans le pendant, que deviendrions-nous ?

L’album «V For Vaselines» qui vient de paraître sonne comme une renaissance. Eugene et Frances attaquent avec «High Tide Low Tide», une belle pop élancée. On retrouve la grande énergie et le cran des cocos d’Écosse. Ils décuplent leur puissance de passages d’accords. Eugene renoue avec l’Eugenius overdrive. Oh le genius d’Eugenius ! Eugene ne se gêne pas. Eugene fait geindre ses gênes. Eugene se veut radical et il passe haut la main. Avec «The Lonely LP», ils reviennent aux vieux mirages pop des eighties. Ils enchaînent avec un «Inky Lies» sacrément bien balancé et on tombe ensuite nez à nez avec un petit prodige pop qui s’appelle «Crazy Lady». Pop de rêve. Voilà ce qu’on pourrait appeler un violent retour de manivelle dans les dents des dieux de la pop de base. Incroyable comme c’est inspiré. Ils renouent avec la béatitude du Brill. Ils font de la pure pâte de Brill aussi brisée qu’un Sacre du Printemps. Franchement, c’est comme si on voyait Igor Stravinsky en smoking blanc twister sur le bacon d’un palais monégasque. Eugene prend le pas sur Frances - Goodbye crazy lady I’m over you - et certains retours d’accords sont dignes des Stooges. Ils poursuivent cette fantastique épopée au pays de la pop avec «Single Spies», pièce de pure pop élégiaque.
— Superbe album, ah je vous le dis comme je le pense, madame Dupin !
— Oh mais je suis bien d’accord avec vous, madame Letellier ! Croyez bien que cet album enchante les matinées que je passe à pomponner notre charmante bonbonnière du rez-de-chaussée ! Voyez-vous, j’ai conservé une âme de jeune amazone romantique et les voix conjuguées d’Eugene et de Frances me touchent, autant que me touchaient les poèmes translucides qu’écrivait Mademoiselle Lucie Delarue Mardrus. J’ai même parfois l’impression de me retrouver, si précoce et si écervelée, au Temple de l’Amitié de Nathalie Clifford-Barney. Ah comme il m’en souvient...
— Avez-vous remarqué ce morceau, «One Last Year»... Il paraît si musculeux qu’on devine le roulement des masses viriles sous la peau. Comme ça m’émerveille ! Pas vous ?
— Oh oui, et d’ailleurs, voyez comme le solo descend aux enfers ! Car les marches, oh oui, car les marches, si noires et si glissantes !
— Mais voyez-vous, je suis encore plus éblouie par «False Heaven». J’ai franchement l’impression d’entendre un morceau conquérant et de voir entrer un Empereur dans Rome suivi de tous ses esclaves. Entendez-vous cette clameur : «Talking bout my love ! Talkin’ bout my love !». Il semble que toute la populace de Rome chante en chœur avec l’empereur Eugene !

— Puis-je vous avouer un secret ? Figurez-vous madame Letellier que j’ai un petit faible pour «Number One Crush». J’adooore cette éclate à l’intro mortelle de la mortadelle ! Ce cher Eugene embarque son trip de cut à la mode de Caen. J’irais bien jusqu’à qualifier sa classe d’impondérable, voyez-vous.
Et madame Dupin se met à danser sur place et à chanter : «Being with you kills my IQ !»
— Mais vous m’insultez ! Sale mégère ! Tenez ! Prenez ça !
Et paf, madame Letellier balance un coup de sac à main en pleine poire de la malheureuse madame Dupin qui vacille et qui s’écroule à la renverse, assommée net.
Depuis que deux vauriens l’ont agressée dans la rue, madame Letellier a lesté son sac à main d’une antique semelle de fer à repasser en fonte.

Sur la scène de la Maroquinerie, Frances n’avait pas de sac à main. Elle portait un blouson de cuir noir à franges et une robe assez moulante en tissu imprimé à dominante bleue. Frances semblait plutôt bien conservée et elle amusait un public de fans en lançant des petites remarques ironiques censés égayer l’atmosphère, du style «J’accepte les garçons, mais pas en dessous de vingt ans». Ses longs cheveux blonds taillés en frange sur le front encadraient un visage avenant et souriant. Son petit nez pointu semblait humer l’air comme le museau d’une musaraigne. Eugene avait contrecarré les ravages du vieillissement en se rasant le crâne et il arborait une fière allure taras-boulbique largement matelassée de légende indie. Pour mieux vaseliner son personnage, il portait un T-shirt noir décoré d’un massif Jolly Roger mais ceux qui le connaissaient savaient qu’il recourait à sa passion pour l’auto-dérision. Eugene en pirate, c’est la même chose que d’allumer une clope avec un poireau et d’avoir six doigts à la main droite. Trois jeunes recrues les accompagnaient sur scène et à les voir, on les sentait fortement investis et prêts à mourir pour leur patrie. Quand on parle des Vaselines, on parle bien sûr d’un groupe culte. En fait, il fallut un certain temps pour réaliser qu’Eugene Kelly se trouvait là en chair et en os sous nos yeux globuleux. C’est la même chose que de se retrouver face à Roky Erickson ou à Athur Lee, il faut un peu de temps pour vraiment réaliser ce qui se passe. Ces gens-là ne sont pas n’importe qui. Tout au long de leur set plaisant, Eugene et Frances vont s’envoyer des petites vannes et faire rire les quelques Anglais présents dans la salle. Ils vont jouer des morceaux tirés des deux derniers albums et notamment le fameux «I Hate The 80’s» et enchaîner leur ribambelle de petites chansons poppy et pimpantes. C’est vrai que dans leur son traînent tous les vieux souvenirs des Pastels et de Belle & Sebastian. C’est vrai que leurs chansons se tiennent admirablement et on comprend mieux que ce groupe ait pu traverser toutes ces décennies et réussir à remplir une salle parisienne, trente ans après leur petite heure de gloriole underground. Frances chantait «Monsterpussy» en rigolant. Pas facile pour une fille de chanter un tel truc. On reconnaît là l’art pervers d’Eugene qui, s’il se prenait au sérieux, pourrait parfois passer pour un Marquis de Sade écossais. Même remarque à propos de «Molly’s Lips» - Kiss kiss Molly’s Lips - Bon nombre d’entre nous se demandent encore sur quelles lèvres louche Eugene. Ils repassent tous leurs vieux hits à la casserole et notamment «Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam», «Sex Sun (Amen)», «Lovecraft», «Son Of A Gun» et l’irrépressible «Dum Dum», couronnement d’une anti-carrière. À les voir jouer, on comprend mieux que Kurt Cobain ait pu flasher outrancièrement sur ce couple. Eugene Kelly savait écrire des chansons et inventer un univers. Alors bien sûr, il ne pouvait qu’attirer les universalistes.

Signé : Cazengler le vaseux
Vaselines. La Maroquinerie. Paris XXe. 18 novembre 2014
Vaselines. All The Stuff And More. Avalanche 1992
Vaselines. Enter The Vaselines. SubPop 2009
Eugenius. Ooomalama. Paperhouse Records 1992
Eugene Kelly. Man Alive. Sympathy For The Record Industry 2003
Eugenius. Mary Queen Of Scots. Wounded Bird Records 2008
Vaselines. Sex With An X. SubPop 2010
Vaselines. V For Vaselines. Rosary Music 2014
GERTRUDE « MA » RAINEY
BAD LUCK BLUES / BO-WEAVIL BLUES / BARREL HOUSE BLUES / THOSE ALL NIGHT LONG / MOONSHINE BLUES / LAST MINUTE BLUES / SOUTHERN BLUES / WALKING BLUES / LOST WANDERING BLUES / DREAM BLUES / HONEY, WHERE YOU BEEN SO LONG ? / YA DA DO / THOSE DOGS OF MINE / LUCKY ROAD BLUES.
BYG 529 078.
Volume 28 de la série Archive Of Jazz

Nous lui devons C.C. Rider. Rien que pour cela elle mérite le panthéon des rockers reconnaissants. L'est née en 1886 en Georgie, a commencé à chanter dès l'âge de quatorze ans, des chansons populaires et du vaudeville, n'est venue au blues que par hasard, en ayant entendu une chanteuse anonyme chanter du blues à Saint-Louis ( Missouri, la ville de Chuck Berry, immortalisée par la première partition de blues de W. C. Handy ), elle devient l'interprète la plus connue de cette « nouvelle » musique que Paramount lui demande d'enregistrer dès 1923. Sa carrière discographique sera balayée dès 1929 par la grande dépression, le crack boursier, cette crise d'auto-régulation du capitalisme sur le dos des plus pauvres... En 1933 elle quitte le métier, et prend une semi-retraite de directrice de théâtres. Décède en 1939.
Possède un autre titre de gloire, c'est elle qui lancera la carrière de Bessie Smith en la faisant entrer dès 1912 dans les Rabbit Foot Minstrels. Comme quoi les élèves dépassent souvent la maîtresse. Enregistra aussi avec Louis Armstrong.
Cet enregistrement, de la même série que celui d'Ida Cox et de Sara Martin que nous chroniquions dans notre 218° livraison, n'est pas sans similitude avec ce dernier. Déjà, nous remarquons sur beaucoup de morceaux la même présence du cornet de Tommy Ladnier. Paradoxalement Ma Rainey présente davantage d'inflexions blues dans sa voix alors que son art s'apparente davantage à la musique de variété – ce mot ici dénué de toutes connotations péjoratives. Vous préfèrerez les titres sur lesquels vous retrouverez le banjo de Miles Pruitt, sonnent beaucoup plus roots, la parenté avec le Delta devient évidente. L'on n'a plus l'impression de deux mondes différents. Le tout peut-être amplifié par la rusticité des moyens d'enregistrement que la notice ( en anglais ) accuse d'être les plus mauvais des twenties... L'est vrai que ça craque pas mal et que parfois la voix s'éloigne comme si l'on repoussait par mégarde le micro. Sur les plages où le cornet caracole un peu trop sa cornette, il semble que les musiciens n'aient pas compris qu'ils accompagnaient une artiste de blues, ça sautille comme du jazz de virtuoses qui étaleraient leurs ronds de jambes. Faut dépasser, s'extraire de ce brillant superfétatoire, pour se laisser capter par la voix envoûtante. Sait chanter, c'est le moins que l'on puisse dire ! Même si vous ne pas pigez pas ce qu'elle raconte, vous comprenez avec quelle virtuosité elle vous campe un décor, vous brosse une situation en trois lignes et vous dépeint un drame en quatre vers. Une interprétation hyper-expressive des lyrics qui n'est pas sans analogie avec la manière dont Chaplin mettait en scène à la même époque les misères du monde. Fut une grande vedette en son temps. La première égérie du public noir. Un jalon essentiel pour l'essor du blues.
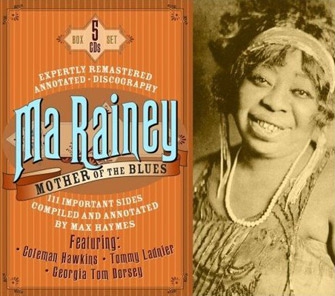
Les amateurs d'Elvis ne manqueront pas d'écouter Dream Blues. Je ne sais si l'hillbilly cat connaissait mais l'on ne peut pas ne pas penser à It's Now Or Never, origine italienne, banjo et guitare ne se privent pas d'y poser leurs bottes...
Damie Chad.
15:55 | Lien permanent | Commentaires (0)
14/01/2015
KR'TNT ! ¤ 218. RIKKHA / HOT SLAP / IAN McLAGAN / SCORES / PULSE LAG / JUDGE / IDA COX / SARA MARTIN / VULVES A BARREAUX
KR'TNT ! ¤ 218
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
15 / 01 / 2015
|
RIKKHA ( + HOT SLAP ) / IAN McLAGAN ( + SMALL FACES + FACE and OTHERS ) / SCORES / JUDGE / PULSE LAG IDA COX / SARA MARTIN / VULVES A BARREAUX / |
Le Trois Pièces. Rouen (76). 24 / 10 / 14
Rikkha
UN RIKKHA SINON RIEN
C’est exactement ce que je répondis au barman qui me demandait ce que je voulais boire. Et pour la bonne forme, j’ajoutai :
— Double et sans glaçons, s’il te plaît !
J’étais tranquille j’étais peinard, accoudé au comptoir, quand un type est arrivé et a posé un cahier ouvert sur le tabouret voisin. On pouvait y lire une liste de morceaux et ce qui attira mon attention, ce fut le dernier titre de la liste : «I Wanna Be Your Dog».
— Oh, c’est un joli morceau, fis-je en direction du type qui se tenait tout près.
Il portait une casquette de gavroche, un perfecto et il arborait un sourire extrêmement communicatif. Il indiqua qu’il y avait d’autres morceaux intéressants dans la set-list.
— Ça ? Fis-je en désignant «Personal Jesus» ?
— Oui, mais c’est la version de Johnny Cash, pas la version originale. Il y a aussi ce morceau, c’est Nirvana.
— Ah pas mal, vous avez un rayon d’action plutôt élargi. Mais vous êtes qui ?
— On est Rikkha, le groupe qui joue ce soir.

Comme j’avais vaguement entendu dire qu’il s’agissait d’un groupe de glam avec une «chanteuse provocatrice», je lui répondis :
— Ah, vous êtes un groupe de glam ?
— Mmmm, non, ce n’est pas vraiment ça. Je dirais plutôt qu’on fait du garage.
Puis il expliqua que le groupe était basé à Belleville et qu’il marchait vraiment bien en Californie. Il me présenta la petite brune qui l’accompagnait au bar.
— Salut, je suis Marylin, la bassiste du groupe !
Ils étaient tous les deux éminemment sympathiques.
— Désolé, je suis venu pour voir les Hop Slap qui jouent en première partie. Mais du coup je vais peut-être rester pour vous voir jouer.

Joli set des Hot Slap, emmenés par un chanteur guitariste jeune et plutôt brillant, parfaitement à l’aise sur les échappées en solo entre deux riffs classiques. L’élégance de son jeu tape à l’œil. Pas besoin d’être guitariste pour comprendre que ce petit mec est fabuleusement doué. C’est battu bien sec et soutenu au slap par Dédé qui ne vit que pour le slap. Il rigole en permanence, tellement il est heureux d’être sur scène, exactement comme Steve Diggle des Buzzcocks. Le trio joue un set de reprises sans prétention, uniquement des morceaux connus, mais justement, c’est ce qui fait leur force et leur fraîcheur, on claque des doigts en permanence. Ils enfilent les classiques comme des perles, ceux d’Eddie Cochran et de Carl Perkins. Attention à leur reprise de «Matchbox», une monstruosité primitive que Dédé jouait déjà dans une mouture précédente du groupe. Ils joueront à la soirée Rockers Kulture du 16 janvier, comme d’ailleurs les Blue Tears, l’autre figure de proue de la petite scène rockab locale.

Je remontai au bar pour une séance de réhydratation et fus surpris de trouver l’endroit plein comme un œuf. Visiblement, Rikkha jouissait d’une énorme réputation. Comment allait-on faire entrer toute cette foule dans la petite cave où se produisent les groupes ? Je pris mon courage à deux mains et redescendis les marches gluantes du minuscule escalier taillé dans la pierre. En bas, nous avions ce qu’il faut bien appeler une étuve. Le gaillard rencontré au bar était déjà sur scène, affublé d’un Stetson et d’un pantalon de cuir noir. Il tenait une guitare blanche, mais comme on ne pouvait pas approcher du premier rang, je ne pus vérifier qu’il s’agissait d’une Mosrite. Marylin se tenait de l’autre côté de la scène campée devant un ampli basse plus haut qu’elle et derrière était assis un batteur noir au look de jazzman, du genre vétéran qui aurait très bien pu accompagner Chet Baker. Et au beau milieu de la scène se tenait une grande femme brune vêtue d’un étrange costume de majorette. Elle posait sur la foule un regard extrêmement bienveillant. Et Rikkha prit très vite sa vitesse de croisière et se mit à chauffer une salle comble qui n’avait vraiment pas besoin de ça. Cette femme d’une classe insolente chantait merveilleusement juste. Elle savait poser sa voix en affichant un sourire permanent. Une présence extraordinaire ! Soudain, on fit le rapprochement avec Queen Adreena, car le travail que faisait le guitariste bellevillois pour cette impressionnante chanteuse ressemblait à s’y méprendre à celui que fit en son temps Crispin Grey pour Katie Jane Garside, et qui consistait à tailler pour une chanteuse hors normes un écrin sur mesure. Ils rendirent un hommage spectaculaire aux Cramps avec une morceau intitulé «My Baby’s Got The Devil». Était-ce la chaleur qui dilatait les cervelles, toujours est-il que la pression des harangues du public devint intolérable. Derrière, des mecs certainement plus avinés que je ne l’étais criaient «À poil !» en permanence, à tel point que la chanteuse les invita à se déshabiller sur le champ, pour essayer d’avoir la paix. Chou blanc. Ils remirent ça de plus belle. C’est là que je pris la décision de l’arrachage, comme on dit dans les opérations de commando. J’eus un mal fou à regagner la rue, tellement la foule était dense. Jamais les gens qui assistaient aux concerts de Queen Adreena ne se sont comportés ainsi, et pourtant, cette folle géniale de Katie Jane a fini plus d’un set à poil, sans qu’on ne lui eut rien demandé.

Voilà, ce sont les limites du principe cavistique. L’ambiance peut être géniale ou détestable, il suffit d’un rien pour que ça bascule d’un côté ou de l’autre. L’ultra-condensé peut démultiplier l’impact d’un groupe ou au contraire le ruiner. Il se peut très bien que Rikkha se soit accommodé de ces gauloiseries, mais c’est dommage, car ils méritaient de jouer dans de meilleures conditions.

Je fus profondément intrigué par ce groupe atypique. Une rapide enquête sur le net me permit de découvrir que le gaillard de Belleville s’appelait Seb le Bison et la chanteuse Juliette Dragon. Vu l’épaisseur des personnages et leur côté théâtral (au sens du Théâtre de la Cruauté dont parle Tav Falco quand il évoque les débuts des Cramps), il ne pouvait s’agir que d’un fantastique clin d’œil mythologique à Lux Interior & Ivy Poison. Il ne restait plus qu’à dénicher les disques. Quelques jours plus tard, j’étais de retour à Paris pour un concert et comme il restait du temps avant le début du set, je fis un raid éclair chez un disquaire. Je sortis d’une pile de maxis les deux mini-LPs de Rikkha, «Kitten On Wheels» et «Covers». Wow !

Eh oui, les albums sont excellents. C’est exactement ce que je redoutais. On retrouve «My Baby’s Got The Devil» sur «Kitten On Wheels», crampsy en diable, doté du meilleur beat des catacombes et dégoulinant d’un jus d’inspiration verdâtre. Essayez de sonner comme les Cramps, vous verrez, ce n’est pas si facile. Chez Rikkha, pas de problème, on dirait même qu’ils ont fait ça toute leur vie. On trouve deux autres merveilles sidérantes sur ce mini-LP au look de papier peint : le morceau titre et «Burlesqu(e) Blues». Fantastique énormité cavalante que ce «Kitten On Wheels», c’est là que Juliette Dragon miaule, comme elle le fit pendant le concert. Le cut est brillant, doté d’un bel entrain. Rikkha vous mettra du baume au cœur car on sent une démarche originale et c’est là tout ce qu’on doit attendre d’un groupe de rock français. Kitten est monté sur un beat impeccable et on sent chez eux un goût prononcé pour la grosse allure. Ces gens-là savent pulser un aéroplane, comme dirait Alex Chilton. «Burlesqu(e) Blues» est un enchantement. Voilà une belle giclée d’atmosphère traînarde menée au petit fouettage de peaux. Il règne dans cet instro une sacrée ambiance d’anticipation. Pas de doute, non seulement ces gens-là sont doués, mais ils sont aussi affamés de modernité.
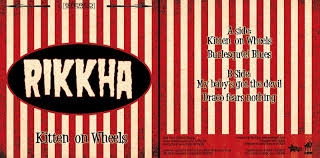
Beau choix de reprises pour «Covers» et notamment le fameux «Personal Jesus» sur lequel Juliette Dragon pousse des cris. Ils tentent de prendre la reprise à l’insidieuse, mais on reste trop attaché à la version de Johnny Cash. S’ensuit la reprise de Nirvana, «About A Girl», qu’ils chantent à deux voix, avec une belle dose d’exaspération. Et là, ça devient admirable de punkitude. Ils ont un gros son et une vision claire de ce que doit être une reprise de ce calibre. On entend derrière un beau martellement d’unijambiste de bas-fonds digne d’Eugene Sue, oui, car le son gronde sous la terre comme une menace. Juliette Dragon bat tous les records d’exaspération et flirte avec le génie. Quel panache ! Du coup, ce mini-LP devient particulièrement excitant. Ils tapent en face B dans Charlie Feathers - via les Cramps - avec une reprise de «I Can’t Hardly Stand It». Ils nous font la scie des Cramps, et une fois de plus, c’est admirable de justesse. Juliette Dragon enfonce bien son coin dans l’angle du vieux rockab pour le plier à sa volonté. D’évidence, ils sont hantés par les fièvres de l’inspiration. Nouveau coup de génie avec la reprise du «Chick Habbits» d’April March qui rendait en son temps hommage à Serge Gainsbourg. La version de Rikkha est habilement enlevée. Juliette Dragon chante comme une petite dévergondée qui gère très mal le virage de l’adolescence et Seb le Bison fait planer son solo comme une menace d’acier noir sur la ville. Et c’est sacrément bien battu. On assiste pétrifié au retour de la menace d’ailes déployées là-bas, dans le fond du crépuscule olivâtre. Wow, baby, quelle stupeur ! On est à la fois chez Tarentino et chez Blake & Mortimer. Ils bouclent leur affaire avec un hommage à Link Wray. «Genocide» sonne comme une nouvelle menace. Elle plane au dessus de la ville qui est vide, car tous les habitants se sont enfuis, gagnés par l’épouvante.

Puis on découvre qu’il existe aussi un album, paru l’an dernier : «Nuit Fatale». Commandez-le directement sur le site de Rikkha et Seb le Bison joindra à l’envoi une jolie carte postale. Vous le verrez photographié au pied de la colline d’Hollywood en compagnie de Juliette Dragon. L’album est un peu moins dense en qualité que les deux mini-LP, mais il y a tout de même de quoi s’occuper les deux oreilles et alimenter cette mythologie naissante. Juliette Dragon chante le morceau titre en Français et on revient très vite au garage avec «Pretty Girl», plus garagiste que le roi. Seb le Bison chante du menton et Juliette Dragon vole à son secours. On se croirait dans un film d’action kitsch, mais avec du très gros son. Puis Juliette attaque «Lullaby» d’une voix de femme très mûre et elle enchaîne avec un fantastique hommage aux femmes qui s’intitule «Les Femmes» - Belles de jour belles de nuit des trottoirs des faubourgs - la chose est extrêmement bien écrite, ça sonne comme un vieux hit de Juliette Gréco - Les femmes sont belles ! - et c’est accompagné de jolis cris d’à-propos. Voilà où se niche l’ampleur de Rikkha. En face B, on retrouve le même genre de cocktail entêtant, avec un «Road Movie» porté par un beau beat garage dévoré de distorse, un «Spank Me» dans lequel Juliette Dragon fait sa racoleuse, bien encadrée par le son et le jeu fin des baguettes du grand Funk Aphobia. Puis ils orientalisent l’ambiance avec un «Libre» au chat perché. Un calibre se balade dans le texte. Très belle pièce que ce «Shemale» chanté très laid-back derrière un mur du son. Seb le Bison monte des structures pontées ambitieuses. C’est probablement le hit de l’album, car très insidieux et imparable côté son, inspiré jusqu’à l’os du genou. Souvenez-vous de ce qui disait Eole à ses augures : le souffle vaut tout l’or du monde.
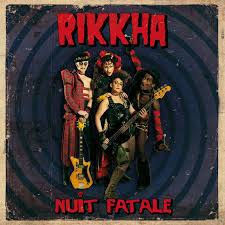
Signé : Cazengler, ric et rikkha
Rikkha. Le Trois Pièces. Rouen (76). 24 octobre 2014
Rikkha. Kitten On Wheels. Idaiyan 2010
Rikkha. Covers. Le Bison 2011
Rikkha. Nuit Fatale. Le Bison/Idayian 2013
McLagan à être connu
(Part one)
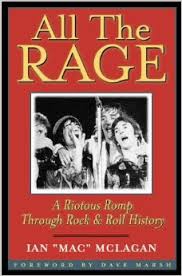
Puisque Mac vient d’avoir l’indélicatesse de casser sa pipe, profitons de l’occasion pour évoquer ses talents d’écrivain. Son recueil de mémoires est un chef-d’œuvre qui rivalise de grandeur épique avec «Give The Anarchist A Cigarette» (Mick Farren) et «The Dark Stuff» (Nick Kent). «All The Rage» est très certainement l’un des meilleurs ouvrages consacrés à l’histoire du rock anglais. Mac y raconte sa vie de gnome avec un talent fou. L’amorce de son récit relève du coup de génie : il évoque l’odeur du bois verni de l’orgue Hammond. On le sait, les odeurs sont de véritables machines à remonter le temps. Avec un naturel confondant, il nous raconte l’arrivée chez lui de son premier orgue Hammond, prêté pour deux semaines à l’essai par le marchand d’instruments du quartier : «Ils vinrent installer avec beaucoup de précautions un orgue Hammond L101 en noyer tout neuf. Il y avait aussi un banc en noyer vernis comme l’orgue, une notice explicative, des câbles de connexion et une énorme cabine Leslie 147 qui remplissait toute la pièce. Vous auriez vu ma bouille !» Les parents de Mac sont affreusement pauvres, mais au bout des deux semaines, ils décident de conserver l’orgue Hammond et de contracter un emprunt pour en financer l’acquisition. Ils ont bien vu que le petit Mac était dingue de l’instrument, alors il n’était pas question de le lui retirer. Mac bénéficia donc de l’immense privilège d’avoir pour parents des êtres bienveillants.
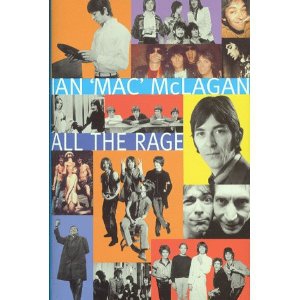
Les vies des rockers s’apparentent le plus souvent à des contes, et tout particulièrement celle de Ian McLagan. Dans son cas, on peut même parler d’un véritable conte de fée.
Comme par enchantement - pluie d’étoiles à la Walt Disney - il se trouve au bon endroit au bon moment, puisqu’il voit les Stones sur scène en 1963. Pour lui, c’est déjà le plus grand groupe de rock du monde : «Brian Jones et Keith Richards étaient assis sur des tabourets de chaque côté de Mick Jagger qui gesticulait au dessus de nos têtes. Keith jouait des gimmicks et Brian jouait au bottleneck. Ian Stewart qu’on appelait Stu jouait du piano et on ne l’entendait pas. Mais quand ça se calmait un peu côté guitares, on l’entendait jouer ses accords de blues, ce qui donnait à leur son un petit côté Chicago blues. Sur la basse bizarre qu’il avait construite, Bill Wyman sortait un son pouet-pouet qui caracolait dans l’écho du plafond, bien soutenu par le drumming ferroviaire de Charlie Watts.» Mac fit aussi à cette époque la connaissance de son futur pote Rod the Mod, qui était alors le chanteur du groupe de Cyril Davies, Blues Incorporated : «Davies fit venir sur scène un Mod maigrichon qui avait un gros nez et une coiffure bouffante. Il portait un costume à trois boutons et des boots à talons hauts. Je le voyais pour la première fois et il se mit à secouer la tête, à chanter et à hurler - c’était un peu trop aigu pour mes oreilles, mais je dois bien reconnaître que ce mec avait une sacrée voix.»

Toute sa vie, Mac a eu la chance de pouvoir rencontrer ses idoles. Alors qu’il jouait de l’orgue dans les Muleskinners (son premier groupe), il accompagna Howlin’ Wolf alors en tournée anglaise ! «C’était un énorme bonhomme. Quand il entra par la porte, vêtu d’un manteau en tweed qui lui descendait jusqu’aux chevilles, il semblait boucher la lumière. C’était lui, le légendaire Howlin’ Wolf de Chicago ! Derrière lui, Hubert souriait.» Sur le sujet Wolf, Mac se montre délicieusement intarissable : «C’était un régal de jouer avec Wolf. Sur scène, il foutait la trouille aux gens. Il se penchait sur le public et hurlait comme un loup. Il n’y avait rien de plus excitant que de jouer ‘Smokestack Lightning’ avec lui. Il rugissait en chantant. Personne ne pouvait chanter comme Wolf. Mais il pouvait aussi chanter d’une voix douce. Il savait aussi souffler dans un harmo.»
Très vite Mac commence à injecter ici et là les expressions qui font la substantifique moelle de son récit. Il parle le slang des Mods et balance des expressions rageuses du type : «It wasn’t unusual to play two shows in one night then considering that the audience were high as kites anyway, pills being all the rage.» (Il nous arrivait fréquemment de jouer deux fois dans la soirée. Les gens étaient complètement allumés car ils gobaient des tas de pilules). Cette langue est celle de l’énergie. C’est l’overdrive qu’on tire au tableau de bord d’une Triumph TR4 et qui fait bondir la carlingue.

Mac se souvient très bien du coup de fil qui a changé sa vie : «C’était le premier novembre 1965 et le téléphone sonna à 10 h du matin :
— Hounslow 7353 !
— Is Ian McLagan at home ?
L’homme qui parlait à l’autre bout du fil avait un gros accent gras de Manchester.
— Er, yes.
— This is Don Arden. I’d like to talk to him about a job !»
Don Arden fila rendez-vous à Mac le jour même, mais à 18 h, mais il ne donna aucune précision sur le job en question. Donc gros suspense. Mac imaginait que Don Arden allait lui proposer un poste d’organiste dans l’un des groupes de son écurie. Les Nashville Teens ? Wow ! Il n’osait même pas en rêver. Alors, pour tromper l’attente, il alla se sustenter dans un pub : «While I wolfed down the crisps and sipped my beer - Alors que je morphalais les chips et que je sifflais ma bière, j’essayais de comprendre ce qui m’arrivait.»
Don Arden lui proposa tout simplement de remplacer Jimmy Winston dans les Small Faces, car il correspondait beaucoup mieux, d’un strict point de vue physiologique, aux trois autres compères. Cette crapule de Don Arden mit à la disposition des Small Faces une Jaguar et Bill Corbett, un chauffeur chargé de les conduire aux concerts et surtout de ramasser les recettes des ventes de billets : «La première année, on a joué absolument partout dans le Royaume-Uni. On voyageait dans la Jag Mark 10 pilotée par Bill Corbett.» Mac évoque avec nostalgie les souvenirs de cette tourbillonnante première année : «Pendant que Bill Corbett nous conduisait à l’hôtel, on parlait des disques qu’on aimait bien et des influences qu’on avait en commun, Muddy Waters, Booker T. & The MG’s, Ray Charles, Tamla Motown et toute l’écurie Stax. On savait qu’on allait bien s’entendre. On trimballait des tonnes de singles, mais ceux qu’on écoutait le plus étaient ‘Tracks Of My Tears’ de Smokey Robinson & The Miracles, ‘Hideway’ de Freddie King, ‘Green Onions’ de Booker T et ‘Rescue Me’ de Fontella Bass.»
Comme les Small Faces étaient essentiellement un gang de gamins, il existait un rite initiatique d’admission : «Deux jours après mon arrivée dans le groupe, Steve qui était assis à l’avant de la Jaguar me demanda l’air de rien si je voulais fumer. Je lui dis oui et il me tendit un immense spliff à trois feuilles. J’en tirai quelques taffes et c’est là que je fus officiellement admis dans les Small Faces.» C’est vrai qu’à l’époque, tout le monde fumait, même les profs dans les bahuts. «Comme on fumait du hash en permanence et qu’on avalait des quantités industrielles de pilules, on avait des problèmes de peau. On était devenus des espèces de branleurs boutonneux - spotty wimps - et nos lèvres étaient gercées. Sauf Kenney qui rentrait régulièrement chez lui manger un bon plat et qui dormait un peu plus que nous.» Eh oui, les Small Faces ne sont encore que des morpions.
Mac narre si bien ses aventures dans le Swingin’ London qu’on a l’impression de faire partie de la bande, notamment quand vient le moment d’aller faire une descente dans les boutiques de fringues de Carnaby Street. Oh les beaux Shetlands à torsades ! Ah les super liquettes à cols boutonnés ! Oh et ces mocassins blancs ! Ah ces beaux Levi-Strauss en velours côtelé de toutes les couleurs ! Pour mieux les amadouer, Don Arden leur avait ouvert un compte dans deux ou trois boutiques de fringues à la mode. Stevie ramassait des piles entières de liquettes et expliquait à Mac choqué par un tel sans gêne qu’il se remboursait ainsi de l’argent que Don Arden leur volait. Eh oui, Stevie Marriott n’était pas dupe de ce gluant paternalisme. Les Small Faces avaient des tubes dans les charts britanniques, ils vendaient des centaines de milliers de disques, ils jouaient à guichets fermés partout dans le Royaume-Uni, mais, curieusement, ils n’avaient pas un penny en poche. D’ailleurs, leurs parents s’en inquiétèrent. Pour les calmer le jeu, Don Arden les convoqua dans son bureau et leur plongea brutalement le museau dans la réalité :
— Bon alors, vous souhaitez vraiment que je distribue tout cet argent à vos garçons pour qu’ils aillent s’acheter des tas de drogues et qu’ils tournent mal, comme ces autres voyous, là, les Rolling Stones ?
— Oh non, monsieur Arden ! Vous devez absolument empêcher ça !
— Alors rassurez-vous et dormez sur vos deux oreilles, mes amis, car c’est ex-ac-te-ment ce que je fais ! Pas d’argent, pas de drogues, c’est enfantin, n’est-ce pas ? Oh, mais vous prendrez bien un petit cigare, mes amis... Attention ! On ne dit jamais non à Don Arden !
Don Arden veillait sur les Small Faces avec une sorte de paternalisme cupide, comme le rappelle Mac : «Kenney avait 16 ans, Steve 18 et Ronnie 19, et quand bien même j’avais 20 ans au moment où je rejoignis le groupe, Don Arden nous demandait de l’appeler Uncle Don, et donc il nous traitait comme des mômes.»

Malgré cet aspect déplaisant, le conte de fée se poursuit avec une rencontre magique, celle de David Crosby. C’est l’année où les Byrds débarquent pour leur première tournée anglaise. Ahuri, Mac découvre que les Californiens sont fans des Small Faces : «David Crosby qui portait une cape en daim était le Brian Jones du groupe, le mec gentil et charmant qui venait nous voir dans notre loge pour nous offrir quelque chose à fumer.
— On t’admire beaucoup, disait David en pointant son gros doigt sur moi.
— Quoi ? Moi ?
La grosse figure de Crosby semblait rayonner.
— Mais oui, pomme de terre ! Dans ‘Eight Miles High’ il y a une ligne qui te concerne, toi et les autres !»
Évidemment, Croz racontait des conneries, car la phrase - In places/ Small faces unbound - ne visait pas forcément le groupe.

Grâce à Mac, on voyage au cœur de l’histoire du rock anglais. Vous auriez souhaité approcher Ronnie Lane ? Rien de plus simple : «Plonk était mon pote. Marrant, comme surnom, Plonk, non ? La plupart des gens croient que ça vient du bruit qu’il faisait quand il jouait de la basse. D’autres croient qu’on le surnommait ainsi parce qu’il buvait du pinard. Mais non, rien à voir avec tout ça. Il avait une grosse queue, c’est tout !» Vous auriez souhaité passer une soirée avec Roy Orbison ? : «The Big O était un type charmant originaire de Wink, au Texas. Il avait survécu à des drames personnels épouvantables et pourtant il pouvait être extrêmement drôle. Un soir, dans un petit hôtel du Nord de l’Angleterre, on fit un concours à celui qui tenait le mieux l’alcool : on s’est tous retrouvés complètement rôtis sous la table, sauf lui.»

Une autre rencontre déterminante dans la vie du petit Mac : celle d’Andrew Loog Oldham qui «rachète» les Small Faces à Don Arden pour lancer son label Immediate : «Il semblait ne porter pour tout vêtement que son rictus de camé et ses lunettes à verres teintés. Il arriva un soir chez Ronnie qui habitait à Spear Mews dans une Rolls-Royce conduite par un chauffeur.» Oldham utilise grosso-modo les mêmes ficelles que Don Arden, mais il alloue aux Small Faces un crédit temps de studio illimité, ce qui est à l’époque considéré comme un véritable luxe. Grâce à ce crédit, les Small Faces vont développer un son et devenir l’un des trois meilleurs groupes anglais. Nous voilà donc au cœur de l’âge d’or des Small Faces et Mac nous raconte l’enregistrement de «Tin Soldier» : «Steve emprunta ma Fender Telecaster, parce qu’il voulait tirer la troisième corde pour l’intro et il ne pouvait pas faire ça sur sa Gretsch. Chaque fois que je réécoute ce morceau, j’en ai la chair de poule. Le numéro que fait Stevie au chant me fout à chaque coup des frissons, spécialement pendant le final. J’en ai les larmes aux yeux, tellement c’est puissant. Ce fut un big hit en décembre 67, numéro 9 dans les charts anglais.»
Et comme tous les autres groupes à succès de cette époque, les Small Faces s’embarquent pour une tournée down under, c’est-à-dire en Australie. «Les Australiens ont une curieuse façon de vous recevoir. Ils passent dans l’allée centrale de l’avion et vous aspergent la figure d’insecticide. Mais ça, ce n’était rien à côté de ce qui allait suivre. Un type était chargé de nous présenter aux journalistes :
— Voici les membres du groupe Small Faces, en provenance de la vieille Angleterre. Voici de gauche à droite Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenney Jones et Ian McLagan. Ian, est-il vrai que vous êtes un drogué ?
— Oh, fuck off, lui répondis-je calmement.»

Tout le monde sait que «Ogden’s Nut Gone Flake» est l’un des grands albums classiques du rock anglais. C’est même l’album des Small Faces qui s’est le mieux vendu et qui fut numéro un. Figurez-vous qu’à l’époque nos quatre héros n’ont jamais touché un penny sur les ventes de ce disque. «We were paid absolutely nothing !» Ils devront attendre 28 ans pour que Decca daigne leur verser les royalties qu’on leur devait. Entre le songwriting et le publishing, Mac estime qu’on leur devait de 10 à 15 millions de livres. Oh une bagatelle ! Mais cette histoire est d’une telle banalité... Les neuf dixièmes des musiciens anglais célèbres dans les sixties se sont fait plumer à vif. Comme dirait l’oncle Albert, on ne va tout de même pas les plaindre ! On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, ce serait trop facile !

L’un des grands copains du petit Mac, c’est bien évidemment Keith Moon, l’un des plus grands déconneurs de l’histoire des déconneurs. Dans son livre, Mac évoque quelques gags, histoire de nous rappeler à quel point Moony était un mec drôle : «Il avait une poupée gonflable, une vraie, avec un soutien-gorge et des bas résille. Il passa les jambes de la poupée par la fenêtre pour attirer l’attention des passants. Puis il glissa sa tête entre les cuisses gainées de résille et se mit à hurler dans un micro :
— Au secouuuurs ! Ahhh ! Au viol ! Lâche-moi ! criait-il d’une voix suraiguë.»

C’est parce qu’il est proche de Moony qu’il devient proche de Kim qui est alors Miss Moon. Blonde et mignonne, Kim est un ancien top model. Elle ne supporte plus les crises de jalousie de Moony et les coups qui vont avec. Alors, elle tombe amoureuse du petit Mac qui est amoureux d’elle. Ils ne se quitteront plus. Kim disparaîtra la première, huit ans avant Mac.

Comme dans tous les contes de fées, un épisode dramatique vient rompre le doux ronron. Un jour, Steve Marriott informe ses copains d’une décision qu’il vient de prendre : «Il était très calme. Il nous annonça qu’il montait un groupe avec Peter Frampton et que pour lui les Small Faces, c’était classé. Peter était dans la pièce et il était assez mal à l’aise. Pour ma part, j’étais anéanti. Mais ce fut dix mille fois pire pour Ronnie qui était son meilleur ami. En plus, ils composaient ensemble. On s’est regardés en silence. Il n’y avait rien à ajouter. Happy New Year and fuck you, Steve !» Et pour lutter contre la douleur qui revient l’oppresser à la seule évocation de ce souvenir, Mac ressort l’une de ses formules magiques : «We headed for the red-light district for a night of nis, nuf and reeb, or beer, fun and sin.» Pour noyer leur immense chagrin, ils sont allés ce soir-là dans le quartier des putes se livrer à tous les excès.
Car enfin, il s’agissait bien d’une trahison. Et c’est bien pire dans une relation d’amitié de ce type que dans une relation sentimentale avec une femme. Et c’est pour ça que tous les fans des Small Faces ont détesté cette pauvre crêpe de Frampton. Bon d’accord Humble Pie, mais ce n’est pas lui. Humble Pie, c’est Marriott.

Comment Mac et ses deux amis ont-ils réussi à survivre à un coup pareil ? En formant les Faces avec le copain Ronnie et le copain Rod the Mod. Ils se sont retrouvés comme par miracle entre gens de bonne compagnie : «Oh we were the boys for a drink all right, and that’s no error. A more convivial bunch you’re unlikely to meet !» Oui, ce sont des gens qui sont capables de picoler toute la nuit. Pas d’équipe plus conviviale que celle-ci ! Mac a le génie des formules. Il écrit comme il parle, son anglais roule en classe cockney. Quand il lâche une formule de ce calibre, on a chaque fois l’impression qu’il met le turbo, avec «Rolling Over» en bande son. Imbattable. Le petit Mac est un géant.

Et là, paf, nouvelle tranche d’histoire du rock anglais avec les Faces, du mythe à la pelle, des compos géniales de Plonk Lane et la voix de Rod The Mod ! Mais que pouvait-on espérer de mieux à ce moment-là ? «Les Small Faces étaient quatre mecs qui ne vivaient que pour la musique et pour s’amuser, et les Faces étaient cinq mecs qui fonctionnaient exactement de la même façon - for music and fun.» Mais là on entre dans un autre genre de délire, puisque cette fois l’argent coule à flots. Rod the Mod collectionnait les voitures de sport les plus chères au monde : «Il venait de signer un contrat solo avec Mercury, et il avait posé une condition : il voulait une Marcos, qui était en 1969 la voiture de sport la plus chère et la plus flashy.» Et du coup, les autres s’y mettent aussi. «Ronnie Lane qui ne s’intéressait pas aux bagnoles s’acheta une Mercedes 190 SL couleur argent, Woody s’offrit une Jaguar XK150 rouge de 1959. C’était un monstre qui n’avait pas d’embrayage synchro, aussi Woody devait-il faire un double-débrayage chaque fois qu’il voulait passer une vitesse, ce qui, même pour un pilote expérimenté, pouvait s’avérer délicat. Mais Woody s’en sortait plutôt bien. Kenney se paya une MG blanche et moi Triumph TR6 vert-gazon.» Keith Moon faisait lui aussi collection de voitures : «Pour s’amuser (il ne conduisait pas), il avait une Rolls-Royce couleur lilas pour les déplacements quotidiens et une autre Rolls pour les occasions plus prestigieuses. Il avait aussi une Cobra AC, une Ferrari, une Mercedes, un hot-rod Chrysler, un hovercraft et une camionnette de laitier décorée avec du papier peint.»
Le conte de fée se remet en route et on est vraiment content pour le petit Mac.

Alors bien sûr, il est intarissable sur la période fastueuse des Faces : «Ronnie pouffait comme un poisson-lune, il traversait la scène en tous sens, il faisait son Ronnie Lane Shuffle, jouait des basslines mélodiques sur lesquelles reposaient tous nos morceaux et chantait merveilleusement bien. Dans mon coin, je passais mon temps à embêter Kenney, à me frotter sur l’orgue Hammond, à claquer les touches du Stenway, à boire des verres et à fumer des Pall Mall. On était heureux. Voilà comment ça se passait. C’était la vraie vie - These were the days and this was the life !» Formule magique.

Mac réalise un autre rêve en rencontrant l’une de ses idoles, l’organiste Billy Preston : «Après une party on est retournés au Record Plant. Cette nuit-là, Billy Preston que l’idolâtrais s’y trouvait. Je possédais tous ses albums, depuis ‘The Most Exciting Organ Ever’ paru en 1964 sur lequel se trouvait le fantastique ‘Billy’s Bag’. Il avait accompagné Mahalia Jackson, Sam Cooke, Little Richard et Ray Charles. Il est certainement l’un des organistes les plus doués du monde.» Il explique aussi que Steve Marriott faillit jouer dans les Stones. «Le premier choix de Keith était Steve Marriott, mais ça ne pouvait pas marcher car il y aurait eu deux chanteurs dans les Stones et Steve n’aurait jamais accepté de rester à l’arrière-plan.» Et c’est par les Stones que le malheur revient, car ils vont mettre le grappin sur Woody et du coup Rod ne se sent plus : «Quand les Stones empruntèrent Woody, il devint atrocement opportuniste, il ne vivait que pour les scoops, il voulait avoir sa photo à la une des journaux, il voulait qu’on retire l’échelle aux autres parce que s’il fallait n’en sauver qu’un, ce devait être lui. Et ça recommençait. Une fois de plus, on se retrouvait le bec dans l’eau. Merry Christmas, Rod.»
Sentant le coup venir, Ronnie Lane avait anticipé en quittant les Faces pour monter Slim Chance et changer de mode de vie.

Eh oui, trahis, une fois de plus, et par Woody avalé tout cru par les Stones, et par Rod qui avait hypocritement mené sa carrière solo en parallèle de celle des Faces et qui avait su conserver pour sa pomme les meilleurs morceaux. Le conte de fée venait de reprendre un sacré coup sur la tête.
La vie reprend son cours, et à son tour Mac est avalé par les Stones qui ont besoin d’un mec aux claviers. Il devient un familier de Keith et rapporte une scène bien croustillante : «Keith sortit de la salle de bain et je vis qu’il s’était rafraîchi. Je lui dis :
— Blimey, tu as meilleure mine. Tu as pris une douche et tu as pu te raser ?
En guise de sourire, il fit une grimace malsaine.
— C’est l’effet que te fera un bon shoot d’héro, Mac, lâcha-t-il en croassant de rire.»

À une époque, Mac s’installa avec Kim dans la maison de Keith Moon située à Malibu, en Californie. Auparavant, cette maison avait appartenu à Levon Helm. Dans le piano de Levon Helm, Mac découvrit une énorme réserve de coke. Wow ! «Je ne pense pas que c’était la réserve de Keith Moon, car il n’était pas du genre à stocker les drogues. Un jour Woody lui donna un gramme de coke juste avant d’aller à une émission de radio. Keith éclata de rire, ouvrit le paquet et se versa la poudre sur le visage, grognant comme un porc et hurlant de rire.» Le voisin de Keith Moon n’était autre que Steve McQueen. «Steve McQueen n’était pas un voisin très communicatif, loin de là, d’autant que le court séjour de Keith l’avait complètement traumatisé. Il n’avait vraiment pas envie de fréquenter un autre musicien anglais.» Et là, Mac raconte comment Keith s’y est pris pour traumatiser le pauvre Steve McQueen : en sautant en moto par dessus sa clôture pour rééditer l’exploit de La Grande Évasion, ou en arrivant à l’improviste chez McQueen complètement soûl et à poil. Grâce à Moony, Mac n’a jamais pu faire la connaissance de Steve McQueen.
Cahin caha, le conte de fée se remet en route, car voilà que Mac se retrouve embrigadé dans l’un des projets les plus fascinants de l’histoire du rock, les New Barbarians, un groupe monté par Keith et Woody : «En plus de Bobby Keys et moi, ils enrôlèrent Zigaboo Modeliste, le batteur des Meters et Stanley Clarke à la basse. Cette formation semblait incongrue pour jouer un répertoire de rock, mais le projet fut une réussite.»
Évidemment, c’est l’époque où tout le monde sniffe de la coke et Mac n’est pas avare de détails : «On arrivait en studio quelques heures après l’heure fixée pour le rendez-vous, on papotait un peu, on sniffait deux ou trois lignes, on rigolait, on jouait un peu, on fumait un spliff, on sirotait un verre, on sniffait une autre ligne, on jouait un autre morceau jusqu’au moment où Keith en avait assez. De toute façon, on avait tout sniffé. Les jours devinrent des nuits et les nuits devinrent des jours. Au bout de quelques semaines à ce rythme, on est allés à Toronto en avion pour le premier concert.» «Bobby nous surprit tous car il avait acheté à un dealer colombien un sac de coke qui était de la taille d’un Big Mac. Mais ce n’était pas la coke habituelle, celle qu’on sniffe. C’était de la freebase mais comme on ne parvenait pas à la dissoudre dans l’eau, on a dû la fumer. Pour nous tous, c’était la première fois. On a fumé, on a joué et on a continué de fumer toute la nuit.» Sur le chapitre, Mac est intarissable : «On a eu du mal à décrocher de cette merde. Je pense que c’était encore pire que l’héro, parce qu’avec l’héro, on pouvait planer, mais avec la freebase, c’était beaucoup plus compliqué.»
Mac a fini par s’installer définitivement au Texas. Voici une petite anecdote concernant la tombe de Buddy Holly : «Bobby, Johnny et moi on a passé la matinée à chercher la tombe de Buddy dans le cimetière, mais on ne l’a jamais trouvée. Alors on est allés boire une bière chez Stubb. Au mur, il y avait un écriteau qui disait : ‘Ici on ne gueule pas et on parle poliment’. Ce qui est drôle, c’est que le juke-box était rempli de singles de Jimmy Reed, de Muddy Waters et d’Howling Wolf, des gens qui étaient d’une vulgarité sans nom.»

Mac aura l’occasion de revenir à Buddy Holly avec une autre idole à lui : Bob Dylan - qu’il aura d’ailleurs le privilège d’accompagner - «On se mit à parler de Buddy Holly et Bob me raconta qu’il le vit une fois sur scène quand il était très jeune. Comme je suis fan de Buddy, je lui demandai des détails.
— Oh il était complètement fascinant. On aurait dit qu’il avait un halo lumineux au dessus de la tête.»
Et comme dans tous les contes de fées, les gentils finissent par serrer la pince des méchants. Mac accepte de revoir Rod Stewart et de l’accompagner. Il profite des retrouvailles pour le chambrer gentiment : «On a passé une bonne soirée. C’était comme au bon vieux temps, sauf que cette fois, c’est lui qui a payé les verres.»
À la fin de son récit, Mac récupère l’orgue Hammond que cette crapule de Rod avait emplâtré, au moment de la dissolution des Faces. Et bien sûr, l’odeur du bois vernis lui rappelle quelque chose...
Signé : Cazengler, adepte de la pensée laganienne
Disparu le 3 décembre 2014
Ian ‘Mac’ McLagan. All The Rage. Pan Books 1998
TREMPLIN JEUNES TALENTS
DU FESTIVAL NOTOWN 15
10 / 01 / 15 – SALLE DES FETES DE NEMOURS
PULSE LAG / JUDGE / SCORES
Nemours mon amour de toujours. Gros mensonge, la teuf-teuf n'y a jamais les roues et l'herbe y repousse sans difficulté sur les bas côtés de la route. M'étonne pas que l'on y ait installé un Musée de la Préhistoire, à la largeur de la départementale, à ses virages limités à 30 kilomètres heure, elle doit au moins remonter à l'Epipaléolithique. L'en faut plus pour arrêter un rocker. Même pas peur de la pluie battante qui engorge les essuie-glaces.
Tout noir et tout désert. Une jeune dame encombrée de sacs et de deux féroces et frétillants molosses de vingt centimètres au garrot m'indique le chemin. Un seul espace éclairé dans la nuit sombre - le phare dans la tempête qui signale au navigateur solitaire un havre inespéré - ça fourmille de monde, de loin cela ressemble à la galerie marchande d'une grande surface. Mais non, c'est bien la Salle des Fêtes de Nemours.
Convivial. Un groupe d'enfants à l'étage qui termine un goûter, des familles attablées autour de tables de café, un bar improvisé qui sert du jus d'orange et de la bière en des gobelets de plastique et pas mal de jeunes qui discutent entre eux. D'accord ils sont vides mais les gradins aux sièges rutilants sont surprenants, avec devant un espace aussi grand qu'une aire d'autoroute, et une scène magistrale. De quoi accueillir une représentation du Ring de Wagner sans problème. Sont une dizaine d'instrumentistes à essayer une hypothétique balance dans laquelle une double-croche ne retrouverait pas sa portée, mais sortent au bout d'un quart d'heure visiblement satisfaits. L'on reconnaît les membres de Natural Respect ( voir KR'TNT 205 and 215 ) qui courent de tous les côtés à l'écoute de capricieux retours. Ne jouent pas ce soir, sont ici en tant que membres de l'Association MusiQafon qui patronne ce tremplin de jeunes talents.

LA SCALA
Pas de décrochage dans l'espace-temps, nous ne sommes pas dans le temple de l'art lyrique italien mais bien à Nemours. La Scala est une école de musique qui présente ses jeunes pousses. La salle s'est remplie de familles venues encourager les premières prestations scéniques de leurs rejetons. Je vous rassure pas de solo flûtes traversières joué de travers, ni de duos de violons violés par de pervers enthousiasmes juvéniles. Sont une douzaine de jeunes – filles et garçons mélangés - qui vont se succéder derrière batterie et guitares électriques. Ni Elvin Jones, ni Charlie Christian mais il faut un début à tout. Ils ont aussi deux chanteuses - une brune et un blonde – une très à l'aise dans son corps et l'autre beaucoup trop statique – mais toutes deux douées d'une belle voix. En solo, et puis ensemble sur le Come Together des Beatles, et surtout cette très belle version de Mustang Sally qui soulève l'enthousiasme de la salle. Léa au chant, et sa complice au choeur, l'orchestre par derrière jouant très funk. Prometteur.
JUDGE
Premier groupe du tremplin. Un petit laïus d'introduction à chaque nouveau concurrent n'aurait pas été superfétatoire. Ne sont pas encore installés qu'une cinquantaine de fans se pressent devant la scène. C'est le groupe local. Judge ! Bénéficie d'un fort avantage. Auront à peine terminé leur set que toute la cohorte d'admirateurs se déplacera d'un seul bloc vers le bar pour annoncer qu'ils votent pour eux. Puis le devoir accompli, très peu sportivement, ils s'évanouiront dans la nature, n'ayant même pas le savoir-vivre d'écouter les concurrents. Belle mentalité !
Vont essayer de faire du bruit. De l'esbroufe. Un chanteur qui bondit sur place comme s'il était monté sur ressort. Un peu démagogique. Sûr d'avoir gagné la partie avant d'avoir remporté la victoire. Produisent un sous-hard-punky sans imagination. En place, mais qui ne vous emporte pas. On ne les condamnera pas aux galères mais on aimerait les revoir sortir ce qu'ils ont dans le ventre face à de véritables enjeux. Judge partial.
PULSE LAG

Ne reste plus grand monde. Les familles qui accompagnaient les impétrants de la Scala se sont aussi retirées. Les Pulse Lag ont du souci à se faire dans cette assemblée raréfiée. Je ne donne pas cher de leur peau. En plus j'ai entendu dire que c'est un groupe de reggae. Vous connaissez mes préventions. Sont trois sur cette grande scène. Guitare, basse et chanteuse. Minimum vital de survie non garanti. Vont se battre comme des lions. Margot est au micro. Un naturel étonnant, détonnant. Longue chevelure bouclée et belle voix très rhythm and blues. Attire les regards. Et les oreilles. L'est comme chez elle. Pas une once apparente de trac. Aussi détendue que vous sur le sofa du salon. Ce qu'il y a de terrible c'est que lorsqu'elle ne chante pas, elle ne fait rien de précis, se retire au fond de la scène, esquisse quelques pas de danse devant Thomas le bassiste, mais ça suffit. N'a pas besoin d'en rajouter. Ce que l'on appelle une indéniable présence. De ces personnes qui n'ont qu'à paraître pour être l'être-là de leur présence au monde, dixit Heidegger.

C'est sur I Shot The Sheriff - mais quand est-ce que quelqu'un finira par le descendre d'une bonne balle entre les deux yeux ce satané marshall, qu'on en termine une fois pour toute avec son insupportable balancement mi-figue mi-raisin – que j'ai commencé à zieuter les musiciens. C'est qu'il devenait indubitable qu'ils travaillaient dur. Chacun dans son coin. Mais aux entrelacements qu'ils peaufinaient, l'était clair qu'ils pédalaient ferme. Et pas dans la choucroute. Ensemble. Pas besoin d'une section de cuivres pour donner l'impression d'un volume sonore. Une trame si serrée que d'abord j'ai eu l'impression qu'ils échangeaient leur rôle, Thomas le bassiste jouant en lead et Théo guitare se chargeant des bases de basse. Mais non, c'est simplement l'occupation illico de tout espace de silence laissé par n'importe lequel des deux complices et son comblement automatique par l'autre, qui produisait ce jeu serré à l'extrême, les cordes frappées si fort qu'elles résonnaient comme des tambours. Très funk, mais aussi très rock. Grâce à Théo. Ramassé sur sa gretsch, plus introverti mais qui réussit à impacter des notes très courtes mais dont la résonance se continue alors qu'il est déjà passé à la suivante. Le genre de ponctuation à la BB King, incisive mais maintenue, non dépourvue de lyrisme.

Entente entre les trois. Chaque fois que Margot reprend le micro, ils savent assurer le back-ground, fauves dans la cage mais les flancs nerveux. Et Margot qui évite de chanter dessus. Pose sa voix non pour dominer mais donner plus de force à la dentelle que ses deux acolytes tricotent. Les applaudissements sont de plus en plus nourris à chaque fin de morceau. Ont su captiver le public. De la belle ouvrage.

Sont de Fontainebleau. Après les frimeurs précédents, cela fait du bien se savoir qu'il existe encore de vrais musiciens. Un régal.
( Les photos prises sur le FB des artistes ne correspondent pas au concert )
SCORES

J'ai voté pour eux. Ils ont la puissance et le savoir-faire. Nous les avons déjà rencontrés Au Cri De La Betterave ( Voir KR'TNT ! 201 du 18 / 09 / 14 ), ont confirmé l'impression qu'ils nous avaient laissée. A tel point que lorsque le dernier morceau a été annoncé j'ai cru que c'était une plaisanterie. Sont passés comme un verre d'eau de feu. Une brûlure au fer rouge et puis plus rien. Dix-huit ans, un disque, une quarantaine de concerts, sont sur les rails, l'on sent une marge de progression et le désir de persévérer dans une si enthousiasmante aventure.
Utilisent le plateau. Benjamin se saisit du micro et le fait tournoyer à deux mains comme une hache d'abordage. Rideau diluvien de guitares et cascade de drumin'fou. C'est parti, comme un jet de flèches enflammées. Pas de temps calmes. I'm a hero. Sinon rien. L'on devient ce que l'on désire et nos cinq lascars ne nous lâcheront plus. Jusqu'au final éblouissant avec ce guitariste fou qui passe et repasse devant la haie d'honneur que le public forme devant la scène. N'oublie pas de monter dans les gradins avant de rejoindre sa place pour les dernières giboulées électriques.
Une attaque indienne. Une charge de cavalerie et puis le vide. This is the end. Tout le monde se regarde d'un air entendu. La pointure au-dessus. C'est ça le rock. Pas besoin de ronds de jambes. Des preuves et c'est tout. C'était un tremplin, et l'on a vu une fusée décoller...

( Photo concert au pub ADK / Photo balance : Nemours )
PERSPECTIVES
Pour les résultats une annonce micro nous apprend qu' « évidemment » Judge a gagné. L'affaire était entendue d'avance. Même sur les champs de course quand le résultat est connu avant le départ on s'y prend mieux. Judge est donc retenu pour le sixième festival Notown qui aura lieu au mois de septembre prochain, au même endroit... Ne reste plus à Scores qu'à remballer leur matériel et à repartir sagement vers Melun.
Soirée un peu décevante. Autant il nous semble important de chroniquer les jeunes groupes locaux car ils sont le futur de notre musique, autant faudrait-il jouer le jeu avec un minimum d'honnêteté » organisationnelle...
Y a quand même des choses qui réchauffent le coeur, la journaliste de L'Est Eclair du Gâtinais qui a assisté consciencieusement à toute la soirée, alors que d'habitude ses collègues se contentent de dix minutes symboliques de présence et de bâcler deux photos à toute vitesse, et ce groupe de jeunes étudiantes venues présenter et récolter des fonds pour le projet Ecodrom pour la perpétuation d'un camp de roms dans la ville de Montreuil. Le genre d'initiative qui ne fait pas l'unanimité parmi la population. C'est la loi, s'en prendre d'abord aux plus faibles, aux plus pauvres. C'est moins dangereux que de se confronter aux plus puissants, aux plus riches. Quoi qu'il en soit dans tous les cas adoptez l'attitude la plus nettement rock and roll !

Damie Chad.
IDA COX
IDACOX'S LAWDY LAWDY BLUES / MEAN PAPA TURN YOUR KEY / MISERY BLUES / BLUE KENTUCKY BLUES / LONESOME BLUES / LONG DISTANCE BLUES / COFFIN BLUES / RAMBLING BLUES / WORN DOWN DADY / YOU STOLE MY MAN /
SARA MARTIN
DEATH STING ME BLUES / MISTREATIN'MAN BLUES
BYG RECORDS / 529073

Volume 23 de la collection Archive Of Jazz mise en oeuvre dès 1968 par le french label Byg. Rappelons que Byg permit l'éclosion de tout un pan de la pop-music française en éditant les premiers disques d'Alice, d'Ame Son, de Alan Jack Civilization ( voir KR'TNT ! 214 du 23 / 12 / 14 ) et participa à la reconnaissance de la New Thing au travers de sa série Byg Actuel... Les amateurs de rock and roll n'oublieront pas que c'est Jean-Luc Young ( le Y de Byg ) qui fonda en 1974, en Angleterre, le label Charly responsable de multiples rééditions de rockabilly.
Archive Of Jazz est principalement consacrée au jazz. Celui du début, New Orleans, Armstrong, Sidney Bechett mais aussi King Oliver, Jelly Roll Morton, Johnny Dodds... ces toutes premières décennies où les frontières entre les genres étaient moins marquées qu'aujourd'hui. Blues, jazz, minstrel, dans les années vingt tout cela fusionnait en s'extirpant l'un de l'autre... Une époque d'une richesse musicale exceptionnelle, dont le souvenir est peu à peu recouvert par des montagnes tout aussi fastueuses de productions beaucoup plus récentes.
L'on se souvient de Bessie Smith mais presque plus d'Ida Cox. Peut-être parce que leur destin fut un peu similaire et que la postérité se débarrasse des doublons. Naît en 1896 ( ? ) dans une plantation du Tennessee, enfance pauvre, chante à l'église, tous les poncifs qui s'accumulent... A quatorze ans, elle est déjà sur la route avec the White and Clark's Black & Tan Minstrels – tournées de vaudeville – l'équivalent de nos opérettes - chants, danses, sketches - mais pas avec le même genre de musique – comportant notamment des numéros de Blackfaces ( voir KR'TNT ! 143 du 09 / 05 / 13 ), sera aussi engagée – tout comme Bessie – dans The Rabbit Foot Minstrels, la troupe la plus célèbre de ce type de spectacles. Dix années à courir la route et le cachet. Cela vous forge le caractère. Ida Cox apprendra à se défendre. Deviendra une des premières femmes noires maîtresse de son destin : financièrement indépendante et beaucoup plus libre que ses consœurs. Son troisième mariage avec Jesse Crump pianiste de son état lui permettra d'atteindre à un équilibre existentiel qui manqua à Bessie. Ida n'est pas seulement interprète elle écrit et compose de nombreux morceaux, parfois en compagnie de Jesse, plus tard dans les années trente ils monteront leur propre spectacle ce qui permettra à Ida de ne pas disparaître lorsque la mode des chanteuses de blues s'estompera. Elle cessera ses activités en 1945 non sans avoir entre temps enregistré avec Charlie Christian, Lionnel Hampton et Lester Young. La grande Dame se permettra même deux come back réussis... disparaîtra de ce monde cruel en 1967.

Le succès de Crazy Blues, premier titre de blues enregistré en 1920 par Mamie Smith, lança la carrière d'Ida Cox. Le label Paramount qui recherche sa poule noire aux oeufs d'or lui fera enregistré trente-neuf disques entre 1923 et 1929... ce trente-trois tours regroupe dix titres, des plus célèbres, des plus poignants.
Ce qui frappe dès les premières mesures c'est la fanfare de l'orchestration. L'on est loin de la pauvreté spartiate du delta. Fanfare épanouie des vents, cornet et clarinette vous nasillent dans les oreilles. C'est Ida qui calme le jeu, sa voix est une couleuvre indolente au rythme de laquelle les musiciens se courbent. En épousent le phrasé, savent la mettre en sourdine dès qu'elle apparaît, quelques trémolos pour prolonger ses suspensions, l'on a l'impression d'assister à l'éclosion de ce que l'on appellera plus tard le jazz en train de s'extraire du joyeux foutoir des rues de News Orleans. L'a une Ida derrière la tête, se place comme si elle était chargée des solis, les musicos relégués dans les marges, se contentant d'assurer le service derrière la table. Prenez le Lonesome Blues, l'incomparable clarinette de Johnny Dodds arrive sans cesse après, elle emplit les alvéoles de miel, mais ce faisant elle ne fait que suivre le mouvement, la reine bourdonne en avant, et plane au-dessus de la mêlée. Inaccessible. Il est indéniable que sur Long Distance Blues, les musiciens ne tiennent pas la distance malgré tous leurs efforts, Dodds essayant de la devancer en piquant des sprints fous de clarinette, Kaiser Marshall tentant de segmenter la piste de sa caisse claire, Lovin Austin installant des syncopes de piano bastringue dans chaque ligne droite, rien n'y fait, suffit que la diva Ida ouvre la bouche pour passer la ligne en vainqueur. Question blues, c'est un peu remue-ménage.
Coffin Blues ouvre la deuxième face, Jesse Crump est à l'orgue – cela s'impose pour un enterrement – et c'est Tommy Ladnier qui sonne la trompette du jugement dernier. Au phrasé d'Ida l'on comprend que l'heure est grave. A la place du macchabée dans le cercueil, je me lèverai de là et prendrait la poudre d'escampette. C'est d'ailleurs ce qu'ils font dans le morceau suivant, le Ramblin' Man se défile les jambes à son cou. Un saxo merveilleux dont on n'a pas conservé le nom sur You Stole My Man, mais Miss Cox reprend l'avantage sur le Death Sting Me The Blues, sa voix claironne et bêle, comme le mouton que l'on mène à l'abattoir. A vous glacer le sang.
SARA MARTIN
Deux morceaux de Sara Martin, une autre classic blues singer comme on les étiquette dans les encyclopédies, toujours le même trajet, naît dans le Kentucky en 1884, fait ses griffes dans le vaudeville, et enregistrement dès 1922, joue notamment avec Fats Waller et King Oliver, mais dès 1928 elle n'enregistre plus et au début des années trente elle abandonne le métier pour se reconvertir dans la gestion d'une maison de retraite. Elle se contente alors de chanter à l'occasion du gospel à l'Eglise. Les voies du dieu miséricordieux étant impénétrables elle s'effondre victime d'un accident vasculaire cérébral en 1955... C'est en 2014 – je rappelle que nous sommes tout juste en 2015 - qu'elle aura enfin droit à une pierre tombale digne de ce nom, et donc mémoriale, pour laquelle en sa cité natale et létale de Louisville fut ouverte une souscription. A la laquelle les citoyens de la ville ne durent contribuer que fort modestement, car il fallut un heureux concours de circonstances et une chaîne d'amitiés entre amateurs de blues et de jazz pour qu'elle puisse bénéficier d'une stèle au rancart dans une entreprise funéraire... Mieux vaut en rire, et relire Tandis Que J'Agonise de William Faulkner pour se remonter le moral. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais avec ces vieux chanteurs de blues, l'humour est souvent noir.
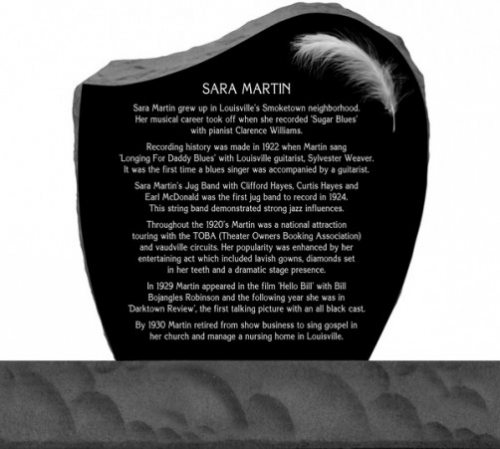
Sara Martin était une chanteuse expressive, son art est resté très proche de celui du vaudeville, grosse voix pour attirer l'attention du public, beaux costumes un peu exagérés pour faire sourire, et interprétations mélodramatiques pour toucher les cordes les plus sensibles des coeurs compatissants...

Même décor mais avec changement. Un vocal plus plein accompagné d'un cornet – celui de King Oliver – davantage théâtralisé, le tuba s'amuse comme un fou, l'on se croirait presque dans Pierre Et Le Loup. La musique n'est plus pensée comme un accompagnement mais comme un arrangement. L'on recherche l'effet. L'on cligne de l'oeil – au sens où l'entendait Nietzsche – vers l'auditeur. L'on a l'impression qu'une dizaine d'années séparent ces deux plages de celles d'Ida Cox tant l'enregistrement paraît plus au point, et la manière de chanter plus moderne. Accrochez-vous à la voix, laissez de côté les oripeaux des concertistes, indubitablement captivante mais impérieuse et sûre de son fait. C'est elle qui mène le jeu. C'est bien Madame qui chante le blues, avec un M doublement majuscule. Très beau contrepoint de piano – tellement discret que l'on n'entend plus que lui - de Clarence Williams, sur Mistreatin' Man Blues qui apporte la nostalgie, bien que rieuse, du blues. Nous dirions qu'en tant que chanteuse de blues Sara Martin est davantage chanteuse que bues.
DU BLUES
Comme l'on n'a pas l'habitude d'en entendre. En gestation dans la matrice jazz. D'avant l'apparition du rhythm and blues et du rock and roll. Comme un fleuve qui remonte vers sa source perdue. Une musique en osmose avec les vieux negro-spiritual, mais qui après avoir traversé les exaltations solaires de l'existence, rentre à pieds dans la grande douleur, l'immense tristesse indépassable du vouloir vivre shopenhauerien.
Damie Chad.
VULVES A BARREAUX
i
Jusqu'où pourrait vous mener votre amour immodéré du sexe féminin ? En prison. Réponse lapidaire qui vous en débouche un coin, mais c'est la vérité vraie comme disent les enfants. L'histoire se passe en 2015, en Ariège. Les lecteurs assidus de KR'TNT ! connaissent un peu l'histoire, nous y avons consacré plusieurs notules et un feuilleton de quatorze épisodes ( voir livraisons 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ). Nous résumons pour les nouveaux venus. Tout d'abord le malfrat : Claudius de Blanc Cap affabuloscopeur de profession ( individu dangereux par définition ) qui depuis sa centrale de production, sise en la riante vallée de la charmante bourgade du Mas d'Azil ( 09 ), reste en proie à une idée fixe. La vulve, élément typique de la morphologie féminine qu'il s'est mis à dessiner un peu partout et à objectiver sous forme de pierres vulvères. Que de tristes affidés se sont chargés de répandre aux quatre coins de la planète. Si vous cherchez bien, vous en trouverez sur la majorité des pays des cinq continents.

N'a pas eu de chance notre Claudius. N'a pas été lâchement assassiné de quelques rafales bien senties de kalachnikov en plein boulot dans son fameux Affabuloscope par un groupe d'islamistes ulcérés par ses publiques et insistantes représentations du deuxième ( ici rangé par ordre décroissantd'importance ) sexe. L'on se serait alors tous levés pour défendre la sacro-sainte liberté d'expression. Non les cellules dormantes des terroristes n'ont pas eu à se réveiller. Nos hommes politiques très vite relayés par notre justice nationale ont entrepris de faire taire ce dessinateur au burin un peu trop érectif.

Un jour ( dans un roman d'épouvante on aurait écrit « Par une sombre nuit assassine » ), notre Claudius – peut-être inspiré par son prénom césario-impérial – a donc franchi le rubis des cons. S'est permis de dessiner quelques signes valvuliens sur la grotte du Mas d'Azil. Ce n'était pas tout à fait idiot – rappelez-vous ce que Freud a écrit sur la caverne en tant que représentation symbolique des souterrains de velours, pour parler comme Lou Reed - tout le monde sait que déjà il y a trente mille ans les hommes préhistoriques s'amusaient à représenter la grande déesse par son attribut si caractéristique. Mais c'est là qu'il déclencha l'ire des autorités. Ce fut la goutte d'eau qui fut ressentie par les élites départementales comme un flot d'urine fétide.
Les érotologues peuvent aller se rhabiller. Malgré les apparences les dessins de Claudius ne frappaient pas sous la ceinture de chasteté. Cognaient là où ça fait mal. Au portefeuille. Voulaient simplement dénoncer la politique artistique du département qui dépensait des dizaines de milliers d'euros complaisamment versés à quelques Hartistes Hofficiels afin qu'ils créassent quelques pustules de non-art moderne contempourri officiel dans le célèbre et rocheux site préhistorique du Mas d'Azil.
On lui eût pardonné ses graffitis jugés pornographiques sur les galets de l'Arize, mais là il avait brisé un tabou, renversé un totem, raillé les Saints Elus qui nous gouvernent ! Eût-il conchié en séance plénière sur la table des délibérations démocratiques départementales qu'il n'aurait pas commis de crime plus irréparable. Il était temps de lui interdire l'innocente pratique de la représentation graphique.
Bref Claudius de Blanc Cap fut condamné le 13 août 2013 à plus de 6000 euros d'amende, à 60 heures de Travaux d'Intérêt Gsais-plus-quoi, plus une prime de deux mois de prison avec sursis. Les faits incriminés remontant au 19 juillet 2013, l'on peut juger de la célérité dont savent faire preuve les services de Gendarmerie et de Justice, dès que le respect de la liberté d'expression est en jeu.
Pour les 6000 et quelques euros d'amende, faudrait attendre que l'industrie de l'épandage de pierres vulvaires commençât à devenir une lucrative occupation... Pour les TIG, l'on proposa à Claudius de réaliser ses soixante heures de travaux gratis et réparateurs à la commune voisine de Les Bordes sur Arize. C'est ici que la réalité bascule dans l'effroyable, et que commence la séquence du mort vivant.
FERNAND ICRES

C'est le nom du mort vivant. Mort et bien mort, depuis l'an de grâce 1888. Un individu dument répertorié dans les annales de la poésie française. Fut un des animateurs du cabaret du Chat Noir d'Aristide Bruant, publia quelques livres notamment un recueil de poèmes étonnant, Les Fauves, dont je ne saurais que vous recommander la lecture, était ami avec Laurent Thailhade, Charles Cros et Maurice Rollinat, bref fit partie de ces troublions post-baudelairiens, de ces sans-classe du Parnasse, de ces jusqu'au-boutistes décadents, de ces proto-symbolistes, bref de ces groupes tant soit peu anarchisants, un peu oubliés aujourd'hui mais qui constituèrent une phalange non négligeable de la grande lyrique française, Arthur Rimbaud en fut un des membres les plus éminents. D'origine ariégeoise Fernand Icres s'en vint mourir de phtisie galopante en son natal département à l'âge de trente deux ans...
Claudius de Blanc Cap ne s'y est pas trompé. Ce poète oublié était un frère. La tombe de Fernand Icres ayant disparu, notre distingué vulvanophile prit la peine d'ériger, à ses frais, dans le cimetière des Bordes sur Arize une simple plaque granitique à son nom... Que se passa-t-il ? La commune des Bordes sur Arize était-elle la moins poétique de toute la France ? Toujours est-il que la stèle disparut... Comment voulez-vous que Claudius acceptât de travailler pour une municipalité qui ne respecte pas le souvenir des poètes ?
RETOUR A LA REALITE
L'attendait un peu d'ouverture d'esprit de la justice de son pays, cette France Terre des Arts, de liberté, de pensée et de création, dont on entend tant vanter les mérites ces derniers jours sur tous les médias. Il n'en fut rien. Bref devant son intransigeance poétique, il est question que sa condamnation en appel devienne effective. La commission devait se réunir le 7 janvier de cette année. Nous attendons sa décision. Nous sommes inquiets. Nous n'aimerions pas que nos institutions se fassent remarquer par une décision qui enverrait un créateur en prison. Cela ne serait pas digne. Un signe fâcheux, un précédent malheureux, que les contempteurs de la République ne sauraient manquer d'utiliser. Pour un peu on en viendrait à penser que notre régime quasi bananier se rapprocherait des théocraties ayathollesques. Affaire à suivre.
Damie Chad.
21:59 | Lien permanent | Commentaires (0)



