06/01/2016
KR'TNT ! ¤ 263 : LEMMY KILMISTER + MOTÖRHEAD / LEAVING PASSENGER / KLAUSTROPHOBIA / KLONE / ROB SHEFFIELD / ELVIS PRESLEY / BILLY LEE RILEY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 263
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
08 / 01 / 2016
LEMMY KILMISTER + MOTÖRHEAD
LEAVING PASSENGER / KLONE
KLAUSTROPHBIA / ROB SHEFFIELD
ELVIS PRESLEY / BILLY LEE RILEY
( + RAPPEL : Hayseed Dixie
Bloodshott Bill + Subway Cowboys )
LA SAINT-BARTHE-LEMMY
Avec la disparition de Lemmy, c’est une page d’histoire qui se tourne, celle d’un rock anglais sans concession. Lemmy et Mick Farren en étaient les figures les plus connues. Jamais on aurait vu ces deux là chanter «Miss You», «Heart Of Glass» ou «Because The Night» pour se faire du blé. Mick Farren a réussi à mourir sur scène, et Lemmy a bien failli réussir, lui aussi. En tous les cas, il aura piloté sa machine infernale jusqu’au bout.
Pas de chance, le concert du 15 novembre dernier fut annulé par la préfecture de Paris, à cause de l’attaque du Bataclan. Mais Lemmy avait déclaré qu’il voulait jouer et que la seule façon de réagir contre la peur était de monter sur scène. Ce vétéran de toutes le guerres avait hélas raison.
Il ne nous reste plus que les disques et un peu de littérature. Le conseil qu’on peut donner, c’est de lire les quelques livres existants sur Motörhead et notamment ceux dont les auteurs ont l’intelligence de s’effacer pour laisser la parole à Lemmy. C’est là qu’on mesure la hauteur du personnage. Les médias en ont fait une sorte de cro-magnon, mais Lemmy est avant toute chose un homme extraordinairement cultivé et un prodigieux auteur-compositeur. On a avec lui le même problème qu’avec Dylan : si on passe à côté des lyrics, on passe complètement à travers les chansons. Il faut malheureusement faire l’effort de comprendre ce qu’il raconte, car c’est dans da prose qu’il donne sa pleine mesure.
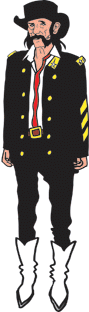
Dans ses interviews, Lemmy répète inlassablement qu’il joue du rock’n’roll et non du hard-rock. Même si on a parfois l’impression que certains morceaux flirtent avec le hard, Lemmy a toujours mis un point d’honneur à échapper aux mauvais amalgames en jouant du Motörhead, qui est une sorte de blast-rock galopant. Tous ceux qui le suivent depuis son premier single («White Line Fever») sur Stiff, ou même avant avec Hawkwind au temps béni de «Silver Machine», savent qu’il s’inscrit dans la filiation blues-rock de la scène anglaise.
On pourrait se contenter d’un seul album qui résume à lui seul la fulgurance de Motörhead. C’est bien sûr «No Sleep Till Hammersmith». Comme la plupart des grands groupes de rock, Motörhead était avant tout un groupe de scène. Comme les Stooges au moment de la reformation, Motörhead nous plongeait dans une atmosphère de fête païenne, dans un chaos d’énergies qui semblaient remonter du fond des âges.
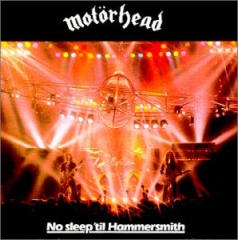
N’ayons pas peur des mots : «No Sleep Till Hammersmith» est probablement l’un des plus grands albums live de l’histoire du rock. Dès «Ace Of Spades», c’est l’enfer sur la terre. Littéralement. On entend arriver la cavalerie de la mort barbare. Dire qu’on adore Motörhead n’a rien d’exagéré. Ces gens-là ont une simili-dimension divine, ne serait-ce que par l’insolence de leur puissance magnanime. Ils tirent «Stay Clean» de l’album «Overkill» et Lemmy chante ça avec conviction. On baigne dans l’adorabilité de la puissance surhumaine et soudain Lemmy part en solo pour une séquence de démence absolue. Sur cet album, tout est spectaculairement bon. Le «Metropolis» qui suit est heavy à souhait. Même chose pour «The Hammer», monté sur un beat enfonceur de clous. Lemmy s’y arrache la glotte au sang. Quelle dégelée, ça claque et ça fouette, ça pète et ça pulse, ça dégage et ça déménage, ça pétarade et ça bombarde, ça tout ce qu’on veut. Ça casse la baraque, ça fout le feu aux poudres et ça défonce tout. Ça ne recule devant rien, ça déblaie les barricades et ça débouche les bronches. Ça écroule les immeubles et ça tue les mouches. Même chose avec «Iron Horse», une chanson en hommage aux Hell’s Angels - It’s called iron horse/ Born to lose - Puis on retrouve le fameux «No Class» et son riff du MC5. Voilà encore une partie de cavalcade effrénée. C’est à tomber avec grand-mère dans les orties. C’est même hallucinant de véracité ergonomique. Et pouf, ils enchaînent avec «Overkill», qui est une véritable abomination. Rien au-dessus de ça. Rien. Voilà la cut intense, carbonisé et tendu à mort par excellence. Insurpassable. Aucun power-trio ne peut rivaliser avec Motörhead. Ils sont foncièrement déstructurants. Ils cognent les neurones comme des boules de billard. Ils tournent à l’énergie rock ultime. Toi la limace, ne viens pas baver sur Motörhead. On trouve à la suite d’autres monstruosités du type «(We Are) The Road Crew», un cut hanté par les hurlements de Lautréamont, version dévastatrice et belle tranche de génie britannique. Ils enchaînent avec «Capricorn» et voilà «Bomber», gros tas d’accords brûlés, ultime et désarçonnant, une chose qui file à toute blinde et qui rougit comme la braise sur laquelle on souffle.
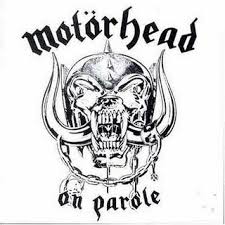
Et pourtant, ce n’était pas gagné. Il suffit d’écouter «On Parole» paru en 1979 pour voir que Lemmy a frôlé la catastrophe en s’acoquinant avec Larry Wallis qui était pourtant le leader des Pink Fairies. Ils font une bonne version de «Motörhead», infestée d’intrusions vénéneuses et Larry tente de créer la légende, comme il a su le faire en reprenant les Pink Fairies sous on aile. Mais les autres cuts de l’album sont un peu mous du genou. Même la version de «City Kids» qu’on trouve sur «Kings Of Oblivion» manque de panache. On comprend que Lemmy ait opté pour une autre formule. Il voulait quelque chose de plus hargneux. La version de «Leaving Here» qui se trouve sur cet album semble complètement retenue. On ne sent aucun abandon. Et Lemmy chante «Lost Johnny» à l’appliquée, accompagné par Larry à l’acou. N’importe quoi !
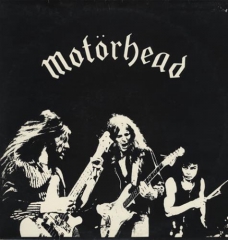
Heureusement, Lemmy rencontre Fast Eddie et c’est parti ! «Motörhead» sort sur Chiswick en 1977. Lemmy doit une fière chandelle à Ted Carroll. C’est aussi la première apparition de Snaggletooth, dessiné par Joe Petagno, et qu’on retrouvera sur quasiment toutes les pochettes d’albums. Lemmy voulait un personnage avec des cornes et un casque, une sorte de logo. Petagno mit les cornes dans le groin et ça donna Snaggletooth. Pour corser l’affaire, il rajouta un filet de bave, fit pendouiller une chaîne, une croix fer nazie et un crâne humain, et sur l’un des clous du casque, il grava une petite croix gammée, histoire de faire jaser dans les villages. Pendant presque quarante ans, on verra Snaggletooth faire des siennes sur les pochettes. Le morceau titre ouvre le bal des vampires. C’est du pur Hawkwind, bien emmené au pumping et Fast Eddie place un solo d’antho à Toto. C’est là qu’ils fondent le mythe. Mick Farren co-écrit «Lost Johnny» avec Lemmy, un cut solide comme l’enfer et riffé avec une belle brutalité. On sent au fil des morceaux que Fast Eddie déploie des ailes de grand guitariste. En B, il plante un décor de cocote pour «Keepers On The Road», un autre cut signé Mick Farren.
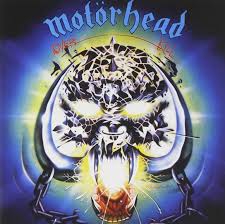
L’album suivant s’appelle «Overkill». Sur la pochette, le pauvre Snaggletooth implose comme une télévision. Survivra-t-il ? Il faudra attendre l’épisode suivant pour le savoir. En tous les cas, le groupe a trouvé son son. Ils attaquent avec le sur-puissant morceau titre, un cut idéal et extrême à la fois, digne encore une fois du MC5, doté de la même énergie, tendu à l’extrême, puissant et noble. Voilà ce qu’il faut bien appeler du rock de cartouchière. C’est chanté à la limite de l’épuisement. Fast Eddie joue comme un héros. Il sort des riffs soniqués du ciboulot et les pousse à l’extrême olympien. Ils sont dans l’orgie et restent imbattables à la course. Ils sont chromés et impérieux. Ils se payent le luxe de deux faux départs. Hallucinant ! C’est sur cet album que se niche l’immense «Capricorn», une pièce de trash rock d’épouvante, saturée d’humidité. On écrit ça un peu à la manière d’Henri Michaux, fasciné par les effets, affamé d’incongruité, perdu dans les limbes des équinoxes. Ce fringuant power-trio nous sort là un véritable fumet d’outre-tombe, et c’est à tomber. Lemmy mâche sa morve et il crache des horreurs. «No Class» est aussi monté sur un riff du MC5. Fast Eddie joue le rock de Detroit. Lemmy hurle comme le petit dernier de la famille des damnés de la terre. Ses verrues tremblent. La sueur ruisselle dans son sillon velu. Et Fast Eddie arrose tout au napalm. S’ensuit l’heavy romp de «Damage Case», un vrai stomp poivré au pilonnage intensif. C’est à la fois fabuleux, pointu et pompé. Ils ont vraiment de la puissance à revendre. Aucune chance de s’endormir en écoutant ça. Retour au big heavy sound des enfers avec «Metropolis». Voilà encore un monument de heavyness, suivi d’un autre classique hirsute, «Limb From Limb» ou Fast Eddie joue une fois de plus comme un dieu.

Comme si cela ne suffisait pas, ils sortent un deuxième album en 1979, «Bomber». Lemmy, Fast Eddie et Phil pilotent un bombardier sur le flanc duquel on a peint Snaggletooth, celui de la pochette Chiswick. On tremble pour Snaggletooth. Et s’il se ramassait un obus de DCA en pleine gueule ? «Bomber» pourrait bien être l’un des meilleurs albums studio de Motörhead, en tous les cas, il incarne bien l’âge d’or du groupe car on y entend Fast Eddie faire pas mal de ravages, notamment dans «Stone Dead Forever» qui démarre comme le «Love Song» des Damned. Fantastique prestation ! Fast Eddie restera l’un des plus grands guitaristes de rock anglais. Les cuts qui font la force de cet album sont les prodigieux heavy-blues de type «Lawman». Difficile de faire mieux dans le genre. L’important, lorsqu’on écoute Motörhead, c’est de prendre Lemmy très au sérieux. Sinon, ça ne marche pas. Il faut considérer que Lemmy chante à l’unisson du génie. «Sweet Revenge» est encore plus heavy, comme si cela était possible. Lemmy a su inventer de toutes pièces un véritable univers, avec Snag en tête, le cacochyme, les grosses guitares, la foi et le pâté de foie, le jusqu’au-boutisme des tournées, l’incarnation du rock’n’roll, la provocation nazillarde, le fun trash, les pipes à la chaîne, le m’as-tu-vu des rues - street tough - et l’héroïsme des briques rouges. C’est magnifique. On peut écouter les vingt-deux albums studio de Motörhead sans jamais craindre l’ennui. Incroyable mais vrai. On trouve d’autres monstruosités sur «Bomber», comme par exemple «All The Aces», sauvagement drumbeaté par Philthy Animal. Lemmy en profite pour régler ses comptes. Il ne prend pas de gants. Pire encore que Van Morrison dans «Big Time Operators». C’est magnifique de rage et de volume. Retour au blues-rock des enfers avec «Step Down». On y retrouve Fast Eddie le génie, le roi du festival, l’heavy Eddie God sans personne au-dessus. Eddie prend le cut au chant et fait wow ! C’est à se prosterner, tellement il en impose. Et bien sûr le morceau titre vaut tout l’or du monde, car on a là du punk pur digne des Damned et du MC5, monté sur un riff fabuleux. On pourrait même parler d’une forme de génie apocalyptique. Le riffage de Fast Eddie fonctionne comme le velours de l’estomac, c’est une bénédiction pour les tympans. Sans Fast Eddie, Motörhead ne pourrait pas décoller. Lemmy, oui, d’accord, mais avec Fast Eddie, c’est mieux.

Si vous cherchez Snaggletooth sur la pochette d’«Ace Of Spades», vous le trouverez épinglé sur le cuir d’un Philthy Animal déguisé en desperado. On trouve aussi Snag sur sa boucle de ceinturon. Lemmy et ses deux copains frisent un peu le ridicule, ainsi déguisés, mais bon, comme des gamins, ils adorent se déguiser. Ils attaquent avec un morceau échevelé, monté sur un riff d’Eddie le pyromane. Lemmy en profite pour avancer son meilleur guttural. Mais c’est Eddie qui fait le show, une fois de plus. Il est partout. On admire aussi le travail qu’il fait dans «Love Me Like A Reptile». Il nous barde ça de riffs de toutes les couleurs, de petits retours retors, de tortillettes infectes. Il n’a que deux bras et pourtant il joue comme dix. Il fait aussi des siennes dans cette fabuleuse tranche de heavy blues qu’est «Shoot You In The Back». lls finissent leur face avec un fantastique hommage à Vulcain, le dieu du beat martelé, avec «(We Are) The Road Crew». C’est stompé à la vie à la mort. De l’autre côté, nos trois amis développent la puissance d’une division de Panzers avec «Fire Fire». Motörhead invente là le son de l’avance inexorable, du mur de flammes, de l’enfoncement de la ligne Maginot et Eddie danse dans les flammes, il claque ses riffs fatals - Big black smoke/ Ain’t no joke ! - Autre merveille de heavyness, «The Chase Is Better Than The Catch». Ils stompent comme des brutes et ils bouclent avec «The Hammer» qui sonne comme «Ace Of Spades». Lemmy dérape dans le gras de sa voix chargée et relance des dynamiques épouvantables.
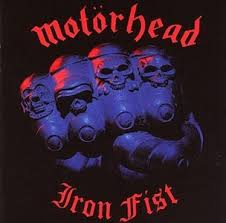
Snaggletooth brille par son absence sur la pochette d’«Iron Fist». Par contre, si on retourne la pochette, on le trouvera sous forme d’un moulage en plastique, avec ses chaînes, ses croix et son crâne. C’est fou ce qu’on s’attache à lui. Voilà un album sans surprise, rempli de grosses cavalcades, de guttural et de coups de suspensif signés Fast Eddie. Avec «Heart Of Stone», on a un pur blast de fournaise - Leave me alone/ Get off the phone/ I’ve got a heart of stone - On y entend Phil pousser des pointes de triplettes de grosse caisse. Lemmy dédie «Go To Hell» à ceux qui le dénigrent et il en rajoute avec «Loser» - I’m a loser/ That’s what they said - Lemmy adore régler ses comptes avec les cons - Now I got their women in my bed - On a là un classique du rock anglais. De l’autre côté, il évoque ses souvenirs du Canada et de cristal meth dans «America» - Lemmy et Mick Farren ont ça en commun : ils se sont fait virer de leurs groupes respectifs, Hawkwind et les Deviants, à la frontière du Canada - Et Fast Eddie continue d’enluminer les morceaux de lueurs incendiaires, comme c’est le cas dans «Shut It Down». Lemmy ressort les crocs dans «(Don’t Let Em) Grind Ya Down» - Sons of bitches/ Evil bastards - Et avec «(Don’t Need) Religion», il s’adonne à l’un de ses sports favoris, la trash-philosophie - I don’t need no Santas Claus !

Sur la pochette d’«Another Perfect Day», Snaggletooth s’est déguisé en mou de veau. C’est assez dégoûtant. Fast Eddie a réussi à se faire virer, à cause du disque enregistré par Lemmy en collaboration avec Wendy O Williams des Plasmatics. Lemmy a du répondant et il embauche Brian Robertson de Thin Lizzy, dit Robbo. Lemmy attaque avec une intro de basse monstrueuse. «Back At The Funny Farm» en bouche un coin ! Cette fois c’est Robbo le seigneur des anneaux qui joue de la guitare. On le retrouve sur «Shine». Il joue comme une belle brute raffinée, ce qui sied parfaitement au brasier. Robbo joue les effarants, il se comporte comme une sorte de génie multiplexe. Il touille bien la déconfiture. Sur «Dancing On Your Grave», les couplets sont du pur jus de Lemmy, gutturaux et prévisibles. Joli retour à la heavyness avec un «One Track Mind» qui ne doit absolument rien aux Heartbreakers. Robbo y prend un solo qui enfonce bien les clous dans les crânes. Lemmy étend encore son empire. Ils tapent ensuite le morceau titre et Robbo embarque Motörhead dans les étoiles. On voit rarement des guitaristes aussi prolifiques. Il est joyeux et gluant à la fois. Motörhead n’avait encore jamais eu un guitariste aussi jouissif. Il répercute les éclairs soniques à l’infini. On pourrait le suivre à la trace. «Got Mine» sonne comme un hit dès l’intro. C’est flamboyant et ça claque au vent. Robbo part bien en vrille. Nouvelle intro superbe de Lemmy pour «Die You Bastard». C’est même un véritable chef-d’œuvre, lorsqu’on s’intéresse aux intros de basse. Lemmy rote et ricane comme le diable, mais le morceau sonne mal, on croirait entendre jouer des hardeux poilus.

Snaggletooth fait la locomotive sur la pochette d’«Orgasmatron». Nouveau changement d’équipe : Philthy et Robbo dégagent, remplacés par Phil Campbell, Würzel et Pete Gill au beurre. Le cut qui croche, c’est «Claw», monté sur un riff qui court comme le furet. Magnifique et absolument éclairant. Pete Gill est un authentique batteur fou. Il sort un beat d’ultra speed-rock pur. Considérons que ce cut fait partie des joyaux de la Couronne d’Angleterre. Oui, car c’est de la pure folie, on voit bien qu’ils sont au bord de l’épuisement. Pareil pour «Mean Machine», ça stompe et ça riffe dans tous les coins. Par contre, «Ridin’ With the Driver» est trop rapide. Trop Motörhead. Le solo est trop vertigineux. Trop porté par le vent. Lemmy s’épuise. Retour aux énormités avec «Doctor Rock», un cut quasiment garage et ils enchaînent avec le morceau titre de l’album, une sorte de hit éternel complètement voodoo et franchement dément, monté sur un riff princier. Les forces des ténèbres y écrasent tout. Voilà le hit suprême de Motörhead, une nouvelle preuve l’existence d’un dieu nommé Lemmy.

Sur la pochette de «Rock ‘N’ Roll», Snaggletooth semble planer comme un ange de miséricorde au dessus d’un champ de bataille moyenâgeux. Non seulement il s’est laissé pousser des dents, mais il tire un langue aussi longue celle d’un bœuf. Philthy retrouve sa place dans l’équipe. Au moins avec ce titre d’album, les choses sont claires : Lemmy a toujours dit et redit aux journalistes qui ont la comprenette difficile qu’il ne jouait pas du hard, mais du rock’n’roll. Le morceau titre qui ouvre le bal de l’album est une belle déclaration d’intention. Lemmy reste égal à lui-même et il laisse défiler ses petits couplets à vide sur le drumbeat. Il enchaîne ça avec «Eat The Rich», belle flambée d’insurrection - C’mon sucker - Lemmy embarque son équipe sur les rails de l’enfer, en vrai Snag rougi par les flammes - C’mon bite my bone - Le tout sur un tempo bien lourd et incroyablement bon. Retour au pur jus de MC5 avec «Stone Deaf In The USA». Voilà bien un cut fidèle et puissant. C’est une fois de plus à tomber, aussi bien par la forme que par le fond. Ils passent quasiment au glam avec «Dogs» et une pluie d’accords quasiment syncopés. Le cut se veut très politique, très anti-américain. Lemmy prend parti. Il ne plaisante pas.

On s’en serait douté. Que peut porter Snaggletooth sur la pochette d’un album intitulé «1916» ? Un casque à pointe bien sûr ! On retrouve l’équipe de «Rock ‘N’ Roll». Ils attaquent avec «The One To Sing The Blues» monté sur un riff bien gras. Lemmy s’ancre définitivement dans le rock anglais à guitares. Dans «I’m So Bad» il multiplie des clichés et rappelle qu’il est un voyou. Par contre, «No Voices In The Sky» accroche par son refrain mélodique. Le cut sonne comme un hymne, c’est bardé d’accords sauvagement hachés et extrêmement british. Dommage que Lemmy n’aille pas plus souvent dans cette direction. Il y excellerait. Il nous gâte avec un longue fin glou-gloutée névrotiquement. C’est le hit de l’album. Il passe à la mad psychedelia avec «Nightmare/The Dreamtime», bardé d’accords sibyllins en lesquels tout est comme en un ange aussi subtil qu’harmonieux. C’est digne du Floyd de Syd Barrett, à la fois comique et sérieux, hanté par un solo psycho-heady rampant. Lemmy n’en finira plus de subjuguer les oies blanches. On y retrouve le grand Lem des acid trips. Il sait de quoi il parle. Avec «Angel City», il passe au pur rock’n’roll de Los Angeles. Il fait rimer ses textes à tous les coins de rues. La musique est ordinaire, ici, mais les textes sont d’une hallucinante concision. Lemmy s’installe au bord d’une piscine et ça fait mal. «Make My Day» est du pur Motörhead qui file tout droit, vrillé par un solo fatal et vicelard, fin comme un petit serpent jaune et qui semble se faufiler entre les gros paquets d’accords. Même chose pour «Shut You Down». On y retrouve ce son unique au monde, ce tout-droitisme exemplaire qui balaye tout sur son passage.

Snaggletooth ne porte plus de casque sur la pochette de «March Or Die». Il s’est transformé en Jolly Rodger, avec ses tibias croisés. C’est sur cet album que Mikkey Dee fait son apparition et le line-up va enfin se stabiliser autour de Phil Campbell et de Würzell. Ils ouvrent le bal avec «Stand» qui sonne comme un appel à la cohérence bombastique. Puis Lemmy rend un curieux hommage à Ted Nugent en reprenant son vieux «Cat Scratch Fever». Il profite de «Bad Religion» pour cracher dans l’œil de satan. Il adore ce genre de cut, il y règle ses comptes philosophiques. On se régale de son son de basse dans «Hellraiser». Jamais encore il n’a eu un son pareil. Mais les choses sérieuses se tapissent dans l’ombre, sur l’autre versant. À commencer par un «Asylum Choir» de fantastique ampleur - The sky, the sky is crushing you/ The walls, the walls are crushing you too - C’est l’un des hits de Motörhead, l’un de ces mid-tempos au beat épais dont Lemmy a le secret. Avec «Too Good To Be True», ils sortent quasiment le même son, mais avec une mélodie chant en plus. La fête continue avec «You Better Run», une sorte de heavy blues à la Muddy Waters - I’m iron and steel/ I’m bad to the bone/ For trouble honey don’t you come alone - Lemmy maîtrise l’art des lyrics percutants. Et puis voilà une nouvelle preuve de son génie : «March or Dïe». Lemmy nous sort le monologue intérieur du troupier - The day has come/ The day has come/ We march to Armageddon/ Hungry for war/ I see the hated enemy/ I see what I was taught to see - Oui, Lemmy s’est mis dans la peau du soudard qui marche vers le champ de bataille, avec l’abattage et la haine aveugle pour seules motivations. Stupéfiant !

Snaggletooth remet son casque sur la pochette de «Bastards». En plus, il a des ailes et deux dagues croisées sous lui. On entend Mikkey Dee sur-développer son drumming dans «Burner». Lemmy en profite, car un bon drumming sur-développé, ça permet de foncer dans la nuit. Dee a même le coup de pied épileptique. Ça va devenir une composante du nouveau son de Motörhead. Même surenchère dans «Death Or Glory». Mikkey Dee sur-pédale au beurre et les guitares duettent tellement dans la fournaise que Lemmy tousse son guttural. Il chante à fendre l’âme. Et voilà que Motörhead se met à faire du boogie avec «Born To Raise Hell». Franchement, on se croirait chez Mott The Hoople ! On retrouve en B le côté tape-dur du groupe avec «Bad Woman», pas trop rapide, touillé dans le brasier et servi avec une pointe de boogie anglais. Dans «Liar», Lemmy fait son cro-magnon pour faire peur à Tounga et au lion des cavernes. Nouvelle surprise avec «I’m Your Man» : ils tapent dans les riffs du «Walk Your Way» d’Aerosmith, ce qui n’est pas vraiment une riche idée. Ils terminent avec «Devils», cocoté limite du hard. Il faut rester prudent, car au dos de la pochette, les imbéciles de la maison de disques ont écrit : File under hard rock, au mépris de toutes les déclarations de Lemmy. Heureusement, le morceau est bon, on y entend de belles parties de guitare mélodiques. On reste dans la magie de Motörhead.
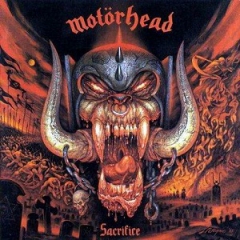
Sur la pochette de «Sacrifice», Snaggletooth revient planer au dessus d’un champ de bataille moyenâgeux. Il a perdu ses croix, mais il bave comme un âne en rut et il a une langue en forme de bite. On sent sur cet album une légère tendance au hard des cavernes. Dans le morceau titre qui fait l’ouverture, Mikkey Dee pousse le saccadé du beat à son extrême. Il tape un nombre incroyable de coups de pieds à la seconde. Il va si vite qu’on n’arrive pas à compter. Puis on retrouve le Motörhead qu’on aime bien dans «Sex & Death». Avec «War For War», Lemmy joue avec l’idée de la barbarie. Il recrée l’état d’esprit du soudard ivre de violence. On sent le poids des bottes cloutées en marche dans les tranchées tapissées d’entrailles fumantes. De l’autre côté, on tombe sur un «All Gone To Hell» ténébreux et chargé de menace. Tout y est lourd et métallique, à l’image d’une chenille de Panzer qui va vous écraser. Ils finissent cet album dur avec «Out Of The Sun» qui sonne comme un hit, puisque Lemmy amène une mélodie dans son refrain et ça devient éclatant.
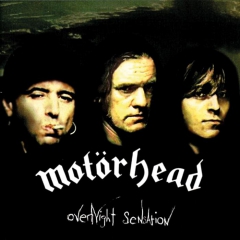
Pas de Snaggletooth sur la pochette d’«Overnight Sensation». On le retrouve cependant au dos, celui de Chiswick, un peu spectral. C’est la mouture définitive de Motörhead qui enregistre cet album en 1996 : Lemmy, Phil Campbell et Mikkey Dee. Würzell a jeté l’éponge. Ça blaste dans les brancards dès «Civil War», monstruosité d’une brutalité implacable, et c’est rien de le dire - The drumming of the civil war/ Outside your window - La ville en feu, l’apocalypse, quoi. Lemmy fait une belle intro de basse pour «I Don’t Believe A Word» et ça chante à deux voix, sauf que Phil chante mal. Lemmy pend les refrains de sa voix la plus barbare. Par contre, sur «Eat The Gun», c’est Mikkey Dee qui se taille la part du lion. C’est monstrueux de vélocité punkoïdale et Phil arrose ça d’un solo au napalm. Le hit du disque, c’est bien sûr le morceau titre. Lemmy y balance une intro de basse boueuse. Et là on assiste au démarrage du plus grand power-trio du monde. Voilà le grand art de Motörhead en plein blast : riff fatal, lignes de basse baladeuses et drumbeatage des clous dans les pattes des crucifiés, avec force et barbarie, Aïe aïe aïe ! Bam bam bam ! To drumbeat or not to drumbeat ! Et Phil part en vol plané de wha-wha, comme s’il n’avait plus rien dans le citron. Ah la brute. Encore un big bang motörheadien avec «Love Can’t Buy My Money», boueux en diable. On tombe plus loin sur «Them Not Me» une puissante pourriture cavalante, du pur jus de Micky Dee. Aucun groupe de rock ne peut descendre dans de telles profondeurs d’apocalypse. Alors, il faut entendre «Listen To Your Heart», car c’est de la belle pop anglaise. Incroyable ! Lem fait de la pop ! C’est une claque au museau des dieux ! Comment ose-t-il ? Quelle supériorité ! Car forcément, le cut est superbe.

Pour «Snake Bite Love», Snaggletooth se transforme évidemment en cobra colérique. En fait, la grosse surprise de cet album, c’est la photo du groupe qui se trouve au verso de la pochette. Qu’y voit-on ? Lemmy déguisé en Snaggletooth ? Non, mieux que ça : Lemmy rasé. Ce mec est très beau en réalité. Il a une vraie allure de rocker anglais et d’ailleurs, le «Love For Sale» qui ouvre la bal est à cette image, classique et bien en place, monté sur un beat qui se dresse fièrement vers l’avenir. «Dogs Of War» sonne comme du Motörhead vintage, bien emmené au guttu féroce de heavy dude et Mikkey Dee revient faire son festival de pied élastique dans «Take The Blame». Comment fait-il pour battre aussi sec ? On ne se saura jamais. Sauf si on lui demande. Mais l’inspiration brille par son absence sur cet album trop classique. Il refont du Mott avec «Don’t Lie To Me» et il faut attendre «Desperate For You» pour retrouver le fantastique déploiement des troupes de Motörhead et leur puissance de charge. C’est à la fois leur force et leur génie. Et l’album se termine heureusement en apocalypse avec «Better Off Dead». Leur puissance finit par émerveiller les plus blasés. Lemmy ne renonce jamais à pousser une petite pointe.

Équipé de sa faux, Snaggletooth participe au combat moyenâgeux, sur la pochette de «We Are Motörhead». Ouverture des hostilités avec un hallucinant «See Me Burning». Ce Mikkey Dee est beaucoup trop fort. En plus, Phil fait des siennes en balançant l’un de ces solos incendiaires qu’aurait adoré Néron. Nos trois héros n’ont jamais été aussi puissants. Ils jouent des cuts brûlés jusqu’à l’os. L’incroyable est qu’ils tapent plus loin dans le «God Save The Queen» des Pistols. Bien sûr, Lemmy ne parvient pas à chanter aussi bien que Johnny Rotten, mais le son est au rendez-vous, n’en doutez pas un seul instant. On se pourlèche les babines avec «Out To Lunch», car c’est aussi bien incendié. Et tellement énorme que ça dépasse nos facultés descriptives. Lemmy va au bout de sa voix et l’affreux Phil intervient bombastiquement. On retrouve du pur jus de Lem dans «(Wearing Your) Heart On Your Sleeve», on baigne dans la friture de l’épaisseur ultime et le voyage s’achève sur le morceau titre de l’album. Magnifique intro de basse du chef sur canapé ingénu monté à la blinde. Encore une merveille lemmique définitive.

Le Snaggletooth qui orne la pochette de «Hammered» est en or massif. C’est le snag d’origine, avec ses croix, sa bave, sa chaîne et son crâne qui pendouillent. Il a une allure d’insigne militaire, et comme c’est écrit en lettre gothiques au dessus et en dessous, on pense bien sûr à cette esthétique de l’armée allemande chère à Lemmy. On trouve quelques cuts seigneuriaux sur «Hammered», à commencer par «Voice Of The War», bien heavy. On sent qu’ils jouent avec le feu des classifications méthodistes. On passe aux choses sérieuses avec «Mine All Mine», monté sur un riff déterminant. On retrouve les lueurs du grand incendie urbain, les riffs palpitants, le solo de pur rock’n’roll conventionnel. Bien britannique dans l’esprit. Phil envoie ses belles giclées et on reste dans l’esprit lemmique pur. Retour au heavy shit de choc avec «Shut Your Mouth», un cut épais et lourd comme de la fonte liquide. Invraisemblable, Lemmy sonne comme un haut-fourneau, il a la résonance d’aplomb et de fumerolles des forges du Creusot. C’est à la fois furieux et bulldozérique. Ici le riff se bat à la masse d’arme - hey hey - Lemmy nage comme un poisson dans la fournaise liquide. Il se dresse comme le géant des enfers. Ah que deviendrions-nous sans lui ? C’est lui le héros des fleuves de lave. «Doctor Love» est un classic rock parfait doté d’une histoire parfaite - And she shakes me in my shoes - C’est monté sur un magnifique support cymbalique de Mikkey. Par contre, ils finissent l’album avec du grindcore speedo-concassique et ça devient insupportable. Avec «Serial Killer», Lemmy fout la trouille.

Pour «Inferno», Snaggletooth est à nouveau en guerre. Cette fois, ça se passe à notre époque avec de fantassins casqués et armées de fusils. Il semble que Snaggletooth ait reçu une ogive nucléaire en pleine gueule, car il se disloque. De belles perspectives attendent les visiteurs sur cet album. À commencer par «Terminal Show» dans lequel Lemmy prédit l’apocalypse en faisant rimer tous ses vers. La musique suit. Phil arrose «Killers» de solos toujours aussi rougeoyants. Et voilà «Suicide», épais comme pas deux, somptueux et grandiose, à l’image du grand Lem aux pieds de fonte. Une vraie boue de lave se répand à la surface de la terre et le géant Lem avance dans d’horrible clapotis. Quelle posture magnifique que celle de cet ogre à la moustache en crocs. Ouf ! Changement de rythme avec «In The Year Of The Wolf». Lemmy nous propose un groove boogaloo et un vrai film, puisqu’il nous embarque dans la nuit glacée - Tonight the food is you ha ha ha - Ils finissent cet album fumant avec «Wharehouse Blues» qui est un vrai blues. Un petit conseil : écoutez Phil Campbell plutôt que Clapton. Car on a là du génie à l’état pur.

Pauvre Snaggletooth ! Sur la pochette de «Kiss Of Death», il ressemble à un objet de brocante qui aurait pris de violents coups de sabre et qu’on aurait jeté dans un tas de couteaux et de cartouchières. Mais il bave toujours. Chez lui, c’est signe de bonne santé. Lemmy attaque avec «Sucker» - We gonna dance on your grave/ Sucker - Et c’est parti pour un tour de cavalcade effrénée. Lemmy règle les comptes de tous ses ennemis et lâche un cut d’une puissance irradiante. Dans «One Night Stand», il redit sa préférence pour les petites putes américaines et le love at first sight - I been a slut all my life/ Wish every night as a night stand - Pour lui, pas question de s’établir dans une relation. On se plait, on tire un coup et on passe à la suivante. Avec «Under The Gun», il joue la carte de la heavy rockalama. C’est un fantastique appel à la liberté - We all live under the sun/ But we don’t have to live under the gun - Il fait rimer sun et gun, pas mal hein ? En plus c’est gorgé de son. De l’autre côté, il refait son Mott avec «Christine» et on se régale un peu plus loin de «By My Baby», car il y brille des petits éclairs de génie - Outlaw Outlaw - C’est admirablement joué à la saccade motörisée. Le hit du disk se niche en fin de face : «Going Down» - In the name of rock’n’roll/ Fire the sky - Lemmy enfonce ses vieux clous - You can’t mess with Dr Rock/ So don’t you ever try ! - Et il nous achève avec un final hallucinant concassé au riff bancal.

Pour «Motörizer», Snaggletooth se retrouve coincé dans un écusson moyenâgeux, comme si Lemmy voulait enfin le voir anobli. On trouve quelques valeureuses énormités sur cet album, à commencer par «Runaround Man», monté sur un véritable mur du son. Voilà le vrai rock anglais, avec sa queue de solo dément. On a là un son plein comme un œuf. Aucun groupe ne sonnera jamais mieux que Motörhead. Lemmy propose plus loin une belle chanson sur la guerre, «When The Eagle Screams» et «Rock Out» file tout droit, sans discuter. Lem profite d’«One Short Life» pour nous asséner une fantastique leçon de morale. La puissance du groupe tient toute entière dans les textes - If you compromise your integrity/ You should drown in your own blood - On le croit sur parole, car c’est heavy comme l’enfer - No no curse upon my name/ No way I look at a bad guy - Il tient à son honneur - I live without dishonour/ I won’t have to die ashamed - Avec «Buried Alive», Lemmy se croit dans un film de Tarentino. Voilà du pur jus de Motörhead, chanté à l’arrache avec un beat dynamiteur. Mikkey Dee est un vrai con quand il parle mais il bat comme un dieu. Trop bien, même. C’est frappé sec. Hallucinant. Trop doué. Dans la vie, il faut savoir faire des compromis. Avec «English Rose», Lemmy s’épanche. Il faut bien qu’il s’épanche de temps à autre, car il ne peut pas passer sa vie à donner des leçons de morale, même si elles sont pertinentes. On se régalera de la brutalité machiavélique de «Back On The Chain». Lemmy se prend pour un délinquant, il demande à la police de ne pas tirer - We’re just kids with guns - Il parvient chaque fois à convaincre et à entraîner ses textes dans de vertigineuses dynamiques. Sous ses airs un peu frustres, Lemmy fait partie des très grands songwriters. On se gaussera du ridicule de «Heroes», on s’effarera de la vitesse de «This Time Is Right» et on se réconfortera dans les bras de «The Thousand Names Of God», monté sur la même vieille sauce. Ces trois-là ne débandent jamais. Ils adorent montrer qu’ils sont les plus forts, ce qui les rend parfois un peu grotesques. Trop c’est trop. Ginger Baker n’a pas ce défaut.
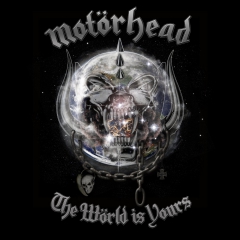
Sur la pochettte de «The Wörld Is Yours», Snaggletooth est une planète qui flotte dans le cosmos. Ce disque est infernal, comme tous les albums du groupe. Motörhead n’en finit plus de ferrailler. «Born To Lose» et «I Know How To Die» sont du pur jus de riffage drumbeaté et chanté à la glotte écarlate. Magnifique partie de batterie de Mikkey Dee sur «I Know How To Die» ! Lemmy a de la chance de l’avoir. Retour au bon vieux boogie avec «Get Back In The Line». C’est un pur album de rock anglais - We are the chosen ones - «Rock’n’roll Music» pue un peu la Stonesy car c’est riffé à la Keef, mais après tout pourquoi pas. «Brotherhood Of Man» frise le grindcore et la clameur des combats. On reste dans le vieux système lemmique, avec un album intense sans aucun déchet, à condition toutefois de bien aimer le bruit et la fureur. Rien de tel que de se faire sonner les cloches par Lemmy Kilmister.

«Aftershock» se passe après la guerre, une fois que tout le monde est mort. Il ne reste plus que Snaggletooth, bien cuirassé et patiné par le temps et les intempéries. Au dos de la pochette, on voit des véhicules militaires ensablés qui rappellent les images de la guerre en Irak. Cet album est probablement l’un des plus victorieux de Motörhead. Lemmy ouvre le feu avec un «Heartbreaker» chargé des pires menaces - Time to get us out of here/ No emotion only fear/ Say your last goodbye - En quelques mots, il crée une tension insupportable, celle de la terreur en temps de guerre. Lemmy scénarise la peur comme personne. Avec «Coup De Grace», il revient à ses vieilles histoires de marginal : si tu ne joues pas le jeu, tu seras rejeté. Puis avec «Lost Woman Blues», il sonne comme ZZ Top. On va de surprise en surprise puisqu’avec «End Of Time», il fait du psychobilly. Il sort exactement le même son que les Mad Sin et il envoie en prime des textes de révolte - Politics religion/ Rotten to the core - Et il prédit que ça se finira dans les ordures - Scratching throught garbage/ At the end of time - Il revient à ses chères confessions de foi avec «Do You Believe» et il redit son attachement au rock’n’roll - Put yout faith behind it/ And You won’t be go far wrong - Le seul moyen de ne pas te planter dans la vie, c’est de faire du rock’n’roll. Pour le prouver, il jette sa vie dans la balance. Encore une merveille en bout de face, «Death Machine» que Phil lèche au lance-flammes sonique. Quel fabuleux guitariste ! De l’autre côté, on plonge dans la meilleure heavyness d’Angleterre avec «Silence When You Speak To Me». Phil vient lécher la sortie du couplet et avec «Crying Shame», ils reviennent au boogie anglais. Ils refont du Mott, mais avec une énergie considérable. On a là du Motörhead d’ampleur joué aux accords de T Rex. En écoutant «Queen Of The Damned», on croirait entendre «Ace Of Spades», c’est dire si c’est bon ! Même beat, même énergie, même pétaudière. Pour «Keep Your Power Dry», Lemmy met sa basse bien en avant dans le mix et ils finissent en apothéose avec «Paralyzed», un cut littéralement incendiaire, au cœur duquel Lemmy hurle Out of time/ We can’t win ! Oui, la mort approche.

Snaggletooth se retrouve gravé dans une décoration militaire pour la pochette de «Bad Magic». Regardez-le bien, car c’est la dernière fois qu’il apparaît. On peut dire qu’on aura fait un sacré bout de chemin ensemble. Il faut aussi bien profiter de l’album car c’est le dernier. On aura du mal à l’accepter, tant on s’était habitué à aller chercher «le nouveau Motörhead» chez le marchand. C’était comme une routine, comme au temps des Cramps ou des Ramones. En tous les cas, l’album est solide. Lemmy lance «Victory Or Die» comme une attaque et distille ses textes chargés de toute l’horreur de la guerre. On retrouve le bon beat tendu motörisé dans «Thunder & Lightning», mais le beat se tend à se rompre. Dans «Shoot Out All Your Lights», Mikkey Dee refait le con avec sa pédale à ressorts. Lemmy lance un nouvel assaut - Fight fight/ We fight all light - Et Phil coule un petit solo aigre. Lemmy est toujours aussi fasciné par ce qui se passe dans la cervelle du soudard qu’on envoie raser une ville et ses habitants. Il revient ensuite à ses chères professions de foi avec «Electricity» - Electricity deep in your soul - Lemmy s’affirme, il l’aura fait toute sa vie. Il revient de l’autre côté à l’expression de la pure violence barbare, avec «Teach Them How To Bleed», monté sur un gros beat d’évocation guerrière. Il en rajoute une caisse avec «Tell Me Who To Kill», il n’en finit plus de vouloir dessouder dans tous les coins, et son fidèle lieutenant Phil riffe derrière comme un damné. Cette dernière face est noire comme la mort, le «Chocking On Your Screams» fout vraiment la trouille - We all came to watch you/ To watch you die - Lemmy raconte qu’il vient d’une autre planète pour nettoyer la nôtre. Et l’album se termine sur un coup de génie, ce qui n’a rien de surprenant, finalement.
Eh oui, Lemmy ne savait pas qu’il allait tirer sa révérence aussi vite, et donc, le dernier morceau de son ultime album est une sorte d’adieu, et pas n’importe quel adieu, puisqu’il s’agit d’une reprise de «Sympathy For The Devil». C’est une version hallucinante. Phil joue en vrille et il va même jusqu’à wha-whater. Lemmy chante différemment de Jagger, c’est sûr, mais ce texte lui va mieux, c’est même du sur-mesure, car Lemmy semble avoir été de tous les combats et surtout de toutes les diableries.
On se demande ce que Phil Campbell, Mikkey Dee et Snaggletooth vont devenir. C’est un monde qui s’écroule et qui disparaît, l’un des plus riches et des plus vitaux de l’histoire du rock. On essaiera de se consoler en revoyant notre vieux héros et sa gigantesque collection de dagues SS dans «Lemmy», le film que Wes Orshoski lui a consacré en 2010.
Signé : Cazengler, Amatörhead
Motörhead. Motörhead. Chiswick Records 1977
Motörhead. Bomber. Bronze Records 1979
Motörhead. Overkill. Bronze Records 1979
Motörhead. On Parole. United Artists Records 1979
Motörhead. Ace Of Spades. Bronze Records 1980
Motörhead. No Sleep Till Hammersmith. Bronze Records 1981
Motörhead. Iron Fist. Bronze Records 1982
Motörhead. Another Perfct Day. Bronze Records 1983
Motörhead. Orgasmatron. GWR Records 1986
Motörhead. Rock ‘N’ Roll. GWR Records 1987
Motörhead. 1916. Epic 1991
Motörhead. March Or Die. Epic 1992
Motörhead. Bastards. ZYX Music 1993
Motörhead. Sacrifice. Steamhammer 1995
Motörhead. Overnight Sensation. Steamhammer 1996
Motörhead. Snake Bite Love. Steamhammer 1998
Motörhead. We Are Motörhead. Steamhammer 2000
Motörhead. Hammered. Steamhammer 2002
Motörhead. Inferno. Steamhammer 2004
Motörhead. Kiss Of Death. Steamhammer 2006
Motörhead. Motörizer. Steamhammer 2008
Motörhead. The Wörld Is Yours. Motörhead Music 2010
Motörhead. Aftershock. Motörhead Music 2013
Motörhead. Bad Magic. Motörhead Music 2015
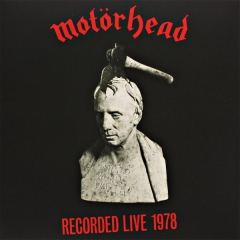
Motörhead. Recorded Live 1978. Ace Records 1983
BLOODSHOTT BILL & SUBWAY COWBOYS
Un petit mot de Will Drifter la voix orgiaque des Subway Cowboys : « je viens de lire le papier Bloodshott Bill. Si, si, il peut être le roi d'une soirée, et ce sont The Subway Cowboys qui vont faire sa première partie à la GAM de Creil le samedi 5 mars 2016! »
Vous avez compris le message : tout malheureux qui ne sera pas présent à Creil le 05 mars, sera condamné à errer éternellement dans les couloirs du métro sans jamais entendre ni Les Subway Cowboys, des honky tonkers de première classe comme l'on n'en fait plus, ni Bloodshott Bill à qui la semaine précédente notre Cat Zengler préféré a tressé de césariennes et rockabilliennes couronnes de laurier.
18 / 12 / 2015 / LE CHAUDRON
LE MEE-SUR-SEINE
KLONE / KLAUSTROPHOBIA
LEAVING PASSENGER
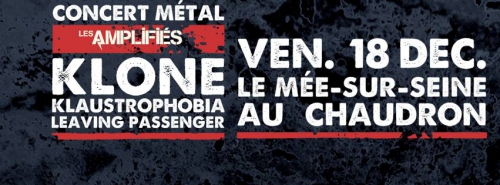
Je possède quelques défauts. Cette première phrase par pure coquetterie et hypocrite modestie. Un rocker est toujours parfait. Ainsi, au contraire de la plupart de mes tristes contemporains je puis me vanter d'une très rare qualité, je suis klaustrophile. Les claustrophobes me font horreur. Aussi n'ai-je pas hésité lorsque je me suis aperçu que Klaustrophobia passait au Mée-sur-Seine, ce vendredi soir. Jugez de mon héroïsme puisque sur la courte notice dévolue aux trois groupes, l'on citait Pink Floyd comme source d'inspiration pour Klone, la tête d'affiche.
Première fois que la teuf-teuf traînait ses pneus au Mée-sur-Seine. Joyeuse cité collée à Melun. Je précise : un labyrinthe infini de cités hachéméliques réservées aux couches populaires. Au moins l'on est sûr que ces hordes barbares n'envahiront pas le centre ville de la préfecture de la Seine & Marne. The rigth thing at the right place et les pauvres seront bien gardés. Je demande par deux fois mon chemin, une chose est certaine, le Chaudron est connu, et à voir les sourires qui illuminent les juvéniles figures, bénéficie d'une aura positive.

Pas très visible, un bâtiment parmi tant d'autres avec entrée latérale plutôt étroite. La partie réservée au concert est assez modeste, le Chaudron est aussi un centre d'activités variées et sociales. Salle d'accueil avec bar, et table vente de disques et T-shirts de Klone, descendez les escaliers pour accéder au Saint des Saints. Vaudrait mieux être nyctalope, aussi noir qu'un fond de chaudron culotté par soixante années de cuissons infernales, vous devez pouvoir y faire mariner deux cents personnes en position debout, pour le moment nous sommes une dizaine à errer lamentablement, quatre jeunes gens occupent la scène et semblent s'apprêter à faire la balance. Le temps de remonter inspecter la discographie de Klone me dis-je, et tout de go je me dirige vers les marches.
Un éclat de guitare retentit derrière mon dos, une jeune excitée se précipite vers l'entrée que je n'ai pas encore franchie : « Dépêchez-vous, ça commence ! » et Yuki – la chanteuse de Klaustrophobia – pénètre en force dans la salle entraînant dans son sillage toute une flopée de jeunes gens hirsutes, revêtus de ces T-shirts démoniaques qui font la joie des hard-rockers. Vingt heures pile, les Leaving Passengers ouvrent le bal.
LEAVING PASSENGER
Les passagers sont jeunes. Ceci n'est pas un reproche. Ce n'est pas obligatoire, mais dans le rock, malgré la vénération et la tendresse que l'on porte à certains vieux briscards, la fougue de la jeunesse reste une denrée de base indispensable. Quant à l'expérience contrairement à ce que prétend l'exigence des propositions d'embauche, vaut mieux l'avoir devant soi, que derrière. Le groupe s'est formé en 2014. Trio de base et Julien au micro.

Scream et Over & Over pour commencer. Bien en place. Musique forte et lente. Pas tout à fait du hard mélodique mais de l'appuyé qui vous pénètre la peau comme un tatouage interne. Chante bien Julien, à pleine voix et avec le volume de sons que produisent ses comparses, faut assurer. C'est que Vince à la batterie, PC à la guitare et Jumar à la guitare poussent fort dans son dos.
Lies On et Running Back, dans le public on apprécie de plus en plus, ça dodeline de la tête, les Passenger nous emportent sur leurs ailes. Du lourd qui vole. Majesté de l'albatros qui se laisse entraîner par les courants souverains.
Wid et IDC, mine de rien dans la carlingue l'on a ouvert le gros tuyau de kérosène, les Passenger prennent de la vitesse. Et tout le monde apprécie. Clap de fin brutale. Le voyage est terminé. On serait bien partis pour une autre croisière, mais non, même pas un rappel. La boîte de chocolat qui vous passe sous le nez et qui ne reviendra pas. Contentez-vous de votre mini-portion, et ne jouez pas les enfants gâtés et capricieux.
Nous ont laissé un bon goût de revenez-y, les Leaving Passenger, on espère les revoir sur une plus longue distance. Prometteurs.

L'association des Amplifiés qui a organisé le concert devrait revoir le découpage chronologique, ce soir trop frustrant. D'autant plus qu'à vingt-trois heures, tout sera terminé. Les nuits des Amplifiés sont-elles plus courtes que les nôtres ?
KLAUSTROPHOBIA
La guitare de Zivan nous maltraite les oreilles. Sur sa basse Alexis nous offre quelques roucoulades de brontosaures énamourés, à la batterie Mickaël attend placidement que les ébats sauvages aient besoin de renfort, mais bientôt n'y tenant plus il se jette dans la mêlée sans tarder. Avec les Klaustro vous n'avez pas besoin de sonotone. Oui mais il manque un petit quelque chose. Presque rien. On a l'avion, mais pas la bombe atomique qui marche avec. Impatience dans le public agglutiné sur le devant de la scène. D'ailleurs une voix stridente parvient à dominer le carnage sonore « Et Yuki ? ». C'est ainsi, l'Homme est un éternel insatisfait, offrez-lui une tempête, il quémande un ouragan. Un vrai, qui soulève sa maison, emporte le toit et éparpille les murs aux quatre coins de l'horizon.

Trois secondes d'attente et la dénommée Yuki bondit sur le micro. Dans son espèce de pull à grosse maille tout mouillé, elle ne doit pas dépasser les quarante kilos, la gringalète. Yeux noirs et cheveux noirs. Plumetés en queue de cheval. D'Attila, vous savez celui sous qui l'herbe ne repoussait pas, là où il avait posé ses sabots. Soyons clair, Yuki ne chante pas, elle glapit. Une espèce de meulement de trépan hideux qui s'efforcerait de vous forer la boîte crânienne. Un ricanement de hyène vorace qui serait en train de sucer les os de votre squelette. Une scie sauteuse qui vous découperait en tranches fines. Et tout de suite, malgré les avis contraires et les mises en garde des autorités médicales, vous vous sentez mieux. Ce n'est pas que vous étiez particulièrement malade avant, mais vous avez l'impression que les portes du paradis s'ouvrent en grand, juste pour vous. Douceur de miel et volupté extatique.
Bien sûr ce n'est qu'une impression. Du ressenti comme aiment à vous le préciser les psychiatres avant de vous envoyer à l'asile des lunatiques pour le restant de vos jours. C'est que le rock est une musique spécialement schizophrénique, côté jardin : sauvagerie des artistes, côté cour : ravissement du fan. Cent pour cent sado en amont et sang pour sang maso en aval. Yuki la grande prêtresse connaît les runes magiques, de quelques gestes démoniaques elle organise des pogos charivariques du meilleur cru. Sur ses injonction toute une jeunesse se rue sur elle-même, s'entremêle, sarabande et imbroglio dans tous les sens.

Remarquons que sur scène l'on ne reste pas inactifs, Zivan s'explique avec sa guitare, l'étrangle et la tord-boyaute jusqu'à ce qu'elle produise d'étranges borborygmes, Alexis nous raconte une messe noire sur sa basse rampante et lui fait réciter les litanies de Nyarlathotep, et Mickaël dompte et plombe sa batterie de coups de Jarnac et de Trafalgar. Le genre de pilonnage apocalyptique sur lequel Yuki virevolte avec l'empressement d'un ptérodactyle affamé. Panthère noire et chasseresse. Yeux de charbon et voix de braise. Péremptoire, lève la main et tout s'arrête, deux dixièmes de secondes avant qu'une nuée de gerfauts ne s'abattent sur vous pour vous rompre le cou.
Trois misérables quarts d'heure, mais un set de toute splendeur. Un moment d'éternité volé à l'enfer, promis à tous les rockers de ce bas monde empli de trop de médiocrité pour nous satisfaire. N'ayez crainte Klaustrophobia vous enferme dans le plus défenestrant des cauchemars. Klaustrophobia : meilleure sera la chute.
KLONE
Je ne m'en cache pas, pour moi le groupe de la soirée ce fut Klaustrophobia. Foutrement rock and roll. L'insolence de la jeunesse. Et la fougue foudre. Tout ce que j'aime, mais les rockers sont des âmes simples. Filez-leur du désherbant ou des amphétamines, pourvu que les bad vibrations soient assurées, ils sont heureux. Maintenant, je dois l'avouer Klone m'a scotché. Klonsthcé, touché, coulé. N'ayez crainte la mauvaise foi des rockers est insubmersible.

Sur les deux premiers morceaux, j'ai ricané. Après les giboulées de Klaustrophobia, ces deux trucs visqueux, une espèce de faux boogie prétentieux aussi pâteux qu'une plâtrée de nouilles, je rigolais. Pas swinguant. Swingluant. Moi qui ai vu Roger Waters et toute la clique en 1972, je trouvais cela très Bling Bling Floyd. Je ne sais pas ( et je ne crois pas ) qu'après les Klaustro ils aient éprouvé le besoin de bopper leur style pour ne pas trop déparer, mais quand ils ont abordé leur troisième opus, la donne a changé.
Cinq sur scène, Aldrick et Guillaume aux guitares, Florent aux drums, Jean-Etienne au chant, Yann au chant, et vraisemblablement Mathieu derrière à la console. La trentaine, plusieurs CD à leur actif, des tournées européennes, le Hellfest, une affaire qui tourne. De la bouteille. Pas à moitié vide, bien pleine.
Le hard est un serpent à deux têtes. Une fulgurante qui mord et pique, et l'autre qui compte sur ses anneaux pour vous étouffer avec lenteur. Métal et progressif. Parfois l'on dit rock et chiant. Klone joue dans la deuxième catégorie. Ont choisi la mauvaise tête de gondole. Oui, mais produit de luxe et biodégradable.
Klone est lent. Au galop des pur-sangs arabes il préfère la majesté des chevaux de parade. Lipizzan viennois, avec la forêt noire confite de cerises ( dans le gâteau ) et l'onctuosité de la crème chantilly. Klone a résolu la relativité einsteinienne du temps. Un morceau de cinq minutes ( montre en main ) de Klone est joué avec une telle lenteur qu'il en dure musicalement trois fois plus ( horloge intérieure en tête ). Mais psychologiquement parlant, il ne vous semblera pas excéder un rockabilly de cent dix secondes.

Klone c'est un orchestre. Avec un chanteur. Les uns bâtissent et dressent les murs. Et l'autre les couvre de fresques dantesques. Les uns envoûtent et l'autre ensorcèle. Vous tient au bout de sa voix. Attaché à ses cordes vocales. Pouvez plus vous en détacher. Fascinant. Aucune pose, aucun geste vaticinatoire, ne déclame pas, ne fait pas son cinéma. Ni muet, ni parlant. L'on se dit qu'il ne va pas tenir tout le concert. Non seulement il ne s'effondre pas, mais à la fin il nous donnera pas moins de trois rappels.
La voix nue. Et ne se prend pas pour un chanteur d'opéra qui barytonne à tue-tête, ni organe malencontreux de castrat, ni trilles volubiles de castafiore. Et pourtant derrière lui, on ne fait pas dans le mezzo-mezzo, la musique est d'une puissance redoutable. On ne peut pas dire que le tempo s'accélère mais il s'amplifie. L'on retrouve dans le parterre les mêmes bousculades qui ont accompagné le tumulte des Klaustro, comme si la charge cumulative de l'orchestre chargeait les protons des fans d'une énergie électrique insoutenable. Public conquis, Yann descend de scène et la foule se retire comme la mer d'Egypte au passage des Hébreux, haie d'honneur et de respect.

Klone subjugue. Sans aucune frime. Du feu mais pas les pompiers. Pas de solo à admirer, pas de prouesse instrumentale mise en avant, les musiciens sont ici au service de leur musique et non à celui de leur égo. Grandeur et simplicité. Pas de fanfaronnade, pas de pantalonnade. C'est beau comme un poème de Victor Hugo. Pas le Hugo romantique et frénétique, mais celui serein et implacable de la Légende des Siècles.
La salle est remplie de lycéens, pas obligatoirement les premiers de la classe, plutôt les énervés qui n'attendent rien du système, et tout le monde écoute avec ferveur ce qui n'empêche ni la fièvre ni le désir de s'éclater contre les vitres d'un monde trop étroit. Klone fait miroiter des étincellements qui réchauffent le sang ardent de l'imagination. Longue ovation finale.
RETOUR A LA MAISON
Minuit pile la Teuf-teuf me dépose à la maison. L'on ne s'est pas pressés. Les Amplifiés auraient tout de même pu rallonger le timing des deux premiers groupes... Je ne me suis pas beaucoup étendu sur les Leaving Passenger. Sans aucun doute parce que Klone a porté à la perfection le style dont ils commencent à maîtriser la première mise en équation.
Rencontré du beau monde, Phil qui prenait des photos et qui rédige des compte-rendus pour le site de hard Pavillon 666 ( sont une quarantaine dispatchés dans les six coins de l'hexagone ) et les membres de Fallen Eight chroniqués lors de leurs concerts aux 18 Marches... qui vont fermer car inaccessibles aux handicapés... Tous les prétextes sont mauvais pour museler le rock and roll. Pot de terre contre pot de taire.
L'EP de Klautrophobia est en retard, logique puisqu'il s'appelle Too Late, mais Fallen Eight organise une grande fête à l'Empreinte de Savigny le temple le vendredi 12 février avec Beast et Nakht... grandes réjouissances en perspective. Gardez le rockin' jusqu'à la prochaine fois.
Damie Chad.
( les superbes photos de Yuki, signées Lov sont d'un concert précédent )
BANDE ORIGINALE
ROB SHEFFIELD
( Le Livre de poche. 32091 / 2011 )
( Publié en 2007 aux USA )
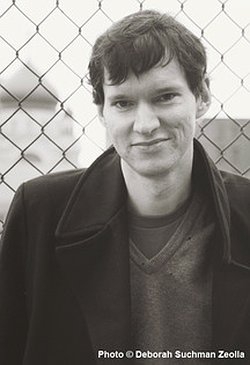
Rob Sheffield n'est pas un anonyme. L'est journaliste à Rolling Stone et a travaillé pour Spin et MTV. S'y connaît donc quelque peu en notre musique, même si son premier roman Bande Originale n'est pas à proprement parler un livre sur le rock and roll. Depuis l'en a écrit deux autres depuis aux titres moins engageants Talking To Girls with Duran Duran et Turn Around Bright Eyes : The Ritual of Love and Karaoke, mais comme nous le conseille Bo Diddley, You Can't Judge A Book Just Looking The Cover.
Deuxième livre d'un contributeur de Rolling Stone que nous chroniquons. Voir Un Long Silence in KR'TNT ! 48 du 15 / 04 / 2010. Mais que de différences entre le vécu de Mikal Gilmore et de Rob Sheffield ! Autant le premier évoquait la face sombre de l'Amérique, autant celui-ci participe de cet optimisme positiviste, ce simple bonheur de vivre, qui reste la vitrine la plus engageante de ce pays. Toutefois une histoire triste. A priori rien de spécialement rock and roll. Serait même tendance pop. Pourtant ce roman à l'instar d'Alphabet City d'Eleanor Henderson ( in KR'TNT ! 202 du 25 / 09 / 14 ) nous plonge dans l'amerloque quotidien d'une jeunesse à jamais touchée par le virus du rock and roll.

Rob Sheffield n'est pas un rebelle. Originaire de Boston, élevé dans un milieu catholique d'origine irlandaise, l'est un peu québlo dans son corps. Petit, il sert la messe en tant qu'enfant de choeur, plus grand il est étudiant à Charlostteville ( Virginie ). Le bon élève qui mettra du temps à se faire déniaiser par sa première copine... Une vie terne, inintéressante, sauvée par un amour immodéré pour le rock and roll. Et cette étrange manie d'enregistrer des quantités astronomiques de cassettes de ses morceaux préférés. Pour les écouter lui-même et les offrir à ses amis. Le plus étonnant de l'affaire reste que cette manière d'agir ne lui est point personnelle, elle est manifestement partagée par toute une génération. La K7 comme objet transactionnel de relation publique. Et plus, si affinités.
C'est par et grâce à la musique que Rob rencontre Renée. Nouvelle copine et bientôt épouse convolée en justes noces. Nos deux tourtereaux passent le plus clair de leur temps à enregistrer, se tapent des tapes à toutes les heures de la journée. Sinon ils mènent une vie de couple typique de l'américain moyen : bouffe grasse, I support my favorite base-ball team, promenades sans but en voiture, petits boulots, feuilletons et séries préférées on the TV, lecture de magazines, spécialement de couture pour la miss. Rien de bien affriolant. Même aux USA, tout le monde ne peut pas être serial killer ou agent secret de la CIA.

Dans son infinie clémence Dieu les a toutefois sauvés. Renée est DJ sur radio WTJV, et ils passent leurs soirées à assister aux concerts des groupes de rock locaux, produisent des articles pour des fanzines improbables, leur coup de maître sera une interview opérée par Renée des L 7 ( depuis que vous avez lu la chro de notre Cat Zengler préféré, in KR'TNT ! 256 du 19 / 11 / 15, vous n'ignorez rien de ces gentes damoiselles ). Tous deux se revendiquent de leur groupe préféré, Pavement.
Vivent le rock comme une donnée incontournable de leur quotidien. Un aliment de base. Indispensable et habituel. Ne lui attribuent aucune revendication provocatrice anti-sociale. Une attitude typiquement anglo-saxonne. Tant que l'on me laissera tranquille dans mon coin à écouter ce que j'aime, ce sera OK. Pas Corral. Ont bâti leur niche écologique de survie rock et n'en sortent point.
Restent les cassettes. Imaginez un film dont les images ne prennent sens que par la bande-son. Au début de chaque chapitre vous avez la photocopie de la set-list - Side A, Side B - qui se trouvait au dos des boîtiers. Qu'écoutent donc nos amoureux ? De tout. Et même mieux : tout. Du meilleur et du pire. De Dean Martin à Boy George. De Chuck Berry à Big Star. De Jerry Lou à Led Zeppelin. Plus les autres. Tous les autres. Leurs préférences vont au gros rock qui tâche, avec guitares sursaturées en avant. Beaucoup de groupes dont vous lirez le nom pour la première fois. Pas de jazz. Un peu de country. Du rock and roll, d'Elvis Presley à Pearl Jam. Sixties and seventies. Et les groupes de leur temps. Se définissent comme la génération grunge et s'adjugent le label punk. Pas les Pistols, ce que nous nommerions le post-punk, après X et Germ...
La romance pourrait durer longtemps, mais comme dans la première scène de Josey Wales Hors-la-loi, le bon dieu très méchant se dépêche de reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Une embolie fulgurante emporte Renée en moins d'une minute. Cinq ans de bonheur radiés d'un seul coup. La morte saison du chagrin commence... Rob Scheffield nous refait le coup de Love Story...
Ce n'est que dans les dernières pages du bouquin, à l'orée du troisième millénaire, alors qu'il tente de se construire une nouvelle existence, qu'il jette un regard rétrospectifs sur les nineties qui s'éloignent. La nostalgie est un des moteurs auxiliaires et essentiels du rock and roll. Le bon vieux temps de la jeunesse enfuie, le couplet est rabâché. L'époque était moins dure. Flottait un air de liberté qui a disparu avec le siècle. La société nouvelle s'opacifie. La condition féminine se standardise. Des femmes aussi extraordinaires que la Renée perdue ne possèdent plus un un même espace de liberté pour déployer leurs ailes. Ne le proclame pas ainsi mais le sous-entend fortement.
Gravissime. Mais ce n'est pas vraiment grave. Tant qu'il y aura du rock and roll, le rêve recommencera. Eternellement. Ils ont vu mourir l'idole de leur génération – Kurt Cobain – n'en ont pas été surpris, une sorte de non-évènement, tellement tout le monde l'attendait. Battait de l'aile depuis si longtemps que son suicide fut collectivement assumé. Quand votre groupe se nomme Nirvana, personne ne doute de votre vœu le plus cher. Pouvez franchir d'autres portes. Mais vous aurez beau faire, jamais vous ne passerez le seuil de votre deuil.
Rob est le veuf – l'inconsolé – el desdichado à la reine abolie. Il lui reste la tour du rock and roll. Indestructible. Le dernier refuge de la diagonale du fou. Une histoire d'amour triste comme un chien abandonné sur l'autoroute des vacances. Un des plus mélancoliques romans sur le rock and roll que je n'aie jamais lu.
Damie Chad.
ELVIS
LE HENANFF / CHANOINAT
( Jungle / Octobre 2015 )
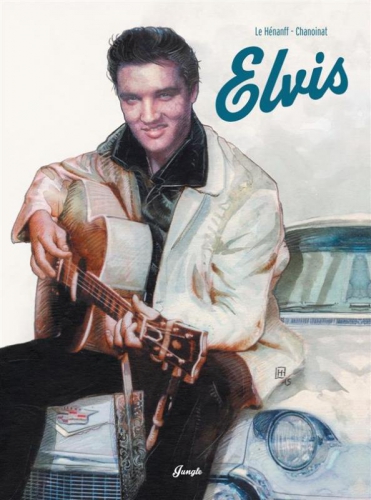
Etrange, aucun fan d'Elvis que je connaisse qui m'en ait parlé. L'est pourtant sorti depuis quatre mois. L'a fallu que ce soit le transistor qui me mette au courant. Pourtant c'est un grand format, du genre je ne passe pas inaperçu et je prends toute la place dans la vitrine. L e Henanff et Chanoinat, les amateurs de bandes dessinées connaissent ces deux corsaires. A eux deux, ils ont publié au moins une quarantaine d'albums. J'ai trouvé une bio de Chanoinat sur le net, un gars qui aime autant Marcel Proust qu'Eddie Cochran ne peut pas être tout à fait mauvais. L'a appris à écrire tout gamin en lisant Bob Morane – le genre de précepteur qui vous porte une ombre jaune sur le cerveau ad vitam aeternam - c'est donc lui qui s'est chargé du texte. C'est le Hénanff qui a dessiné. L'est aussi scénariste mais ses mots à lui, ce sont les couleurs. Un véritable peintre. Pas un rigolo.
Petit aparté. Toujours eu une tendresse particulière pour Mama Cass. J'aurais aimé qu'avec sa voix de fée elle vienne le soir me roucouler quelques berceuses à l'oreille pour m'endormir. Elle ne l'a jamais fait. Mais je ne lui en ai jamais voulu. Quand j'ai appris – ce devait être en juin dernier – que sortait une BD sur sa vie, me suis précipité. Hélas, douze fois hélas, on ne devrait pas dessiner quand on ne sait pas. L'ouvrage était d'une telle pauvreté graphique que je l'ai reposé, même que la libraire était d'accord, aussi effondrée que moi. J'avoue qu'avant d'avoir l'Elvis entre les mains, je craignais d'être déçu. Eh ! Bien non !
Si vous pensez apprendre quelque chose de neuf sur Elvis, passez votre chemin. Une simple biographie chronologique qui reprend les évènements - connus du monde entier – qui ont marqué la carrière du King. Chanoinat a su rester discret. Raconte vite et bien. Narration nerveuse. Un style sec et précis à la Mérimée, l'essentiel. Le nerf, ni la graisse, ni la chair. Pas de glamour, pas de scandale. Fait même l'impasse sur les terribles addictions finales de l'idole. Point pour en tracer un portrait propret et sans bavures, mais dans la sainte trilogie l'a fait le bon choix, sex and drugs c'est parfait, mais le plus important c'est tout de même le rock and roll. Et là vous en prenez plein les mirettes.

C'est que voyez-vous – et jamais je n'ai employé cette expression à si bon escient - il n'y a pas qu'Elvis Presley dans la vie. Et pour être plus précis, n'y avait pas que le hillbilly Cat dans les fifties. Alors il les convoque tous : Howlin' Wolf, BB King, Rufus Thomas, Arthur Crudup, Bill Monroe, Johnny Cash, Jerry Lou, Roy Orbison, Carl Perkins, Sonny Burgess, Billy Lee Riley, Charlie Feathers, Ronnie Self, Eddie Fontaine, Johnny Carroll, Ray Campi, Gene Vincent, Little Richard, Eddie Cochran, Chuck Berry, Ricky Nelson, Buddy Holly, Fats Domino, Johnny Burnette, Janis Martin, Wanda Jackson, cercle de craie et invocation diabolique, c'est Le Hénanff qui ressuscite les ombres et leur donne vie et couleurs. Un véritable portraitiste, les croque et c'est nous qui savourons. Une toile de maître pour chaque maître es rock and roll. De véritables images pieuses, inspirées à chaque fois de photos, d'affiches ou de pochettes de disques célèbres. Une re-création flamboyante. Pour un peu on en oublierait Elvis !
Mais non, l'est partout. Ses proches, famille, musiciens, Sam Phillips et le Colonel, et puis lui, le plus beau des félins, en scène, les micros, les attitudes, les filles qui hurlent, le tournage des films, les images défilent, pleine plages, des portraits de face, de profil, de haut, en contre-plongée, et des couleurs étonnantes, une dominante sombre mais avec des blancheurs, des douceurs et des teintes flashy-mat à vous brûler les yeux. Des turquoises de bleu, des roses opalescents, des bistres inconnus, des noirs irréductibles, des nuits maltées, des blancs de neige sale. Une symphonie cinématographique. Une beauté filmique qui reposerait sur le traitement énamouré des photographies de plateau.
Sait aussi disposer ses vignettes. Des mises en page qui décoiffent. Un art subtil du découpage. Un as des triptyques. Ne vous ennuie pas, vous surprend. L'arrive un moment où vous ne lisez plus, vous regardez, vous inspectez, vous étudiez, vous analysez. Vous êtes au musée et vous vous enfoncez dans le kaléidoscope mouvementé de la légende presleysienne.
A la fin de l'album, vous avez encore droit à un port-folio, des crayonnés, des prises de vue différentes, des fragments d'un autre montage, d'un autre découpage, d'une autre suggestion. Mais à la place de pénétrer dans la cuisine l'on aurait préféré que cet espace d'une quinzaine de pages ait été imparti au déploiement du scénario de base. Elvis l'aurait mérité. Tant d'épisodes auraient ainsi pu être évoqués. Tout ce qui concerne ses séjours en Californie pour prendre le premier exemple qui me passe par la tête.
Dans le genre de tentative Vie d'un rocker illustre, j'avais adoré le Gene Vincent de Rodolphe & Van Linthout mais l'on est encore dans quelque chose qui s'apparente à la bande dessinée classique. Une espèce de ligne claire électrifiée. Avec cet Elvis, nous sommes au-delà, au-del'art, s'apparente davantage à une oeuvre picturale qui par sa fluidité scripturale aurait intégré tous les codes du reportage de guerre. L'influence séminale de l'existence d'Elvis n'en finit pas de nous surprendre.
Un livre que tous les amoureux d'Elvis, et les passionnés de rock and roll se doivent de posséder.
Damie Chad.
BILLY LEE RILEY
FLYING SAUCERS ROCK AND ROLL
PEARLY LEE / GOT THE WATER BOILING / SWANEE ROCK AND ROLL / ROCK WITH ME BABY / OPEN THE DOOR RICHARD / RED HOT / FLYING SAUCERS ROCK'N'ROLL / I WANT YOU BABY / ROCK WITH ME BABY / COLLEGE MAN / THAT'S RIGHT / SEARCHIN' / ITCHY / NO NAME GIRL / WORKIN' ON THE RIVER / THUNDERBIRD / WOULDN'T YOU KNOW / LET'S TALK ABOUT US.
J'ai failli me faire assassiner. Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas cherché. J'ai le nom du coupable : Billy Lee Riley. L'a agi lâchement. Par procuration. C'est ma famille, le sang de mon sang, la chair de ma chair, qui voulait me trucider. J'étais en toute innocence en train de ré-appuyer, pour la quarante deux ou quarante troisième fois, avec l'émotion je ne sais plus, sur la touche repeat de mon lecteur CD lorsque je me suis vu assailli par une foule vociférante, menaçante et injurieuse. L'est tout de même étonnant qu'il existe encore en plein début du vingt et unième siècle des gens qui ne supportent pas Billy Lee Riley.
La matinée avait pourtant bien commencé. M'étais précipité chez Gérard mon bouquiniste préféré pour palier le manque absolu de nourriture sonore en mon habitation ariégeoise. En la contrée lointaine de l'Ariège, les seuls endroits où vous puissiez vous procurer de la musique potable, c'est uniquement sur les étalages des marchands de livres d'occasion. Doit y avoir trente ans que les ours et les loups ont dévoré le dernier disquaire.
Quand j'ai saisi le boîtier j'ai esquissé une moue de dépit. Zut ! Un reste des Génies du rock des Editions Atlas. Vous connaissez tous ces couvertures jaune-orangé qui souvent n'offrent que des compilations de titres mineurs ou ultra-connus d'artistes prestigieux, qui ne correspondent en rien aux présentations de la carrière de l'artiste sur le fascicule accompagnateur. Oui mais là, chez Atlas n'avaient rien dû trouver au rabais, se sont rabattus sur une licence Charly. Ils ont tapé vraisemblablement dans les albums de réédition The Legendary Sun Performers de 1977, le Sun Sound Special de 1979 et le double CD Red Hot de 1985 et peut-être pour ne pas trop se fatiguer dans le coffret de 3-CD paru en 1992, puisque la compil qui nous préoccupe est sorti en 1993.
Billy Lee Riley est une légende sonique. Et sunique. Fit partie de l'écurie Sun. Ne s'est pas contenté de chanter. L'a été un des piliers de l'équipe qui travaillait avec Jack Clement. Les deux lascars se connaissaient, avaient joué dans les Dixie Ramblers. L'avait tous les talents Billy, guitariste, pianiste, harmoniciste. On le retrouve en tant qu'accompagnateur sur de nombreux morceaux. Chez Sun et plus tard aussi, sera un session man recherché, de Dean Martin aux Beach Boys. L'on a coutume de s'apitoyer sur le sort de Billy. On accuse Sam Phillips, qui aurait préféré lancer la carrière de Jerry Lou et laissé volontairement de côté Lee Riley. Surtout en France où l'on adore les beautifull loosers.
Sam Phillips n'avait pas que des qualités. Ni les reins assez solides, ni l'entregent assez établi, pour pousser à la roue la dizaine des fous furieux de génie qui illuminaient son studio. Lui fallut faire son choix. Facile, un demi-siècle après de refaire l'histoire, qui pour Riley, qui pour Feathers, qui pour Warren Smith... L'on n'en parle peu mais entre Clement et Phillips malgré une confiance musicale et mutuelle de base devait s'opérer un partage des rôles. Dans l'âme du patron, Jack devait être le pôle propositionnel. Cherche et trouve-moi des petits gars qui balancent terrible comme je les aime, et moi Sam je serai le pivot optionnel, le boss qui décide en dernier ressort.
Maintenant à réécouter toute une journée ces enregistrements Sun de Billy, je comprends la préférence de Sam Phillips pour Jerry Lou. Je ne mets même pas en balance la qualité des deux artistes, l'est tout de même un aspect musical qui saute aux oreilles. Les petits hommes descendus de la soucoupe volante de Billy Lee Riley, z'ont beau s'être teints du plus vert le plus éclatant que vous puissiez trouver sur la planète rouge, ils ont l'âme aussi bleue que les noirs. Billy Lee Riley possède des racines bluesy trop facilement discernables. N'a pas trimé pour rien dans les plantations, ne s'est pas plus tard retrouvé chez Stax par hasard, n'a pas enregistré avec Wilson Pickett simplement parce qu'il était un bon musicien, l'a le feeling, la compréhension intuitive du blues. Ecoutez attentivement le phrasé de Billy dans Red Hot, n'est pas loin des arrachages sauvages à la Little Richard. Cette façon de dégobiller les lyrics en apnée totale, ces relances incroyables de couplets en accéléré. De l'équipe de Sun, l'est celui qui s'est débarrassé le plus rapidement, le plus facilement, le plus naturellement, de la coalescence country. Phillips n'était pas un adepte du western swing, recherchait un pêchon beaucoup plus urbain, cette rage rentrée qui habitait un Howlin' Wolf, c'est ce qu'il traquait chez les petits blancs. Maintenant fallait pas non plus exagérer. Fallait savoir rester sur la bonne rive du delta. Un pied à l'intérieur, mais pas les deux.
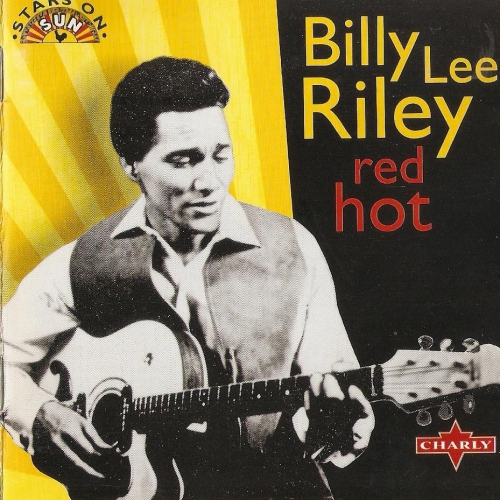
Si vous êtes encore en train de lire ce paragraphe c'est que vous êtes un brin ( je suis gentil ) stupides, puisque vous n'êtes pas en train d'écouter Pearly Lee de Billy Lee Riley. J'arrête là, je ne puis rien faire de plus pour assurer votre bonheur.
Damie Chad.
ERRATUM
Comme tout GSH, il m'arrive de commettre quelques erreurs. Rarement, je vous l'accorde. Mais par une fatale négligence j'ai glissé dans la chronique sur le concert d'Hayseed Dixie de notre Cat Zengler préféré, lors de notre 261° livraison, des photos inappropriées. Revoici donc cette chronique avec les bons clichés.
Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015
HAYSEED DIXIE
L'ACIDE DIXIT DES HAYSEED DIXIE

Gag ou pas gag ? Chacun voit midi à sa porte, comme on disait autrefois, au temps où sonnaient les cloches de Jouahandeau. Pour un amateur de blind dates, ce groupe américain est une bénédiction. Les Hayseed Dixie ne jouent que des reprises qu’ils entraînent le plus souvent dans la ronde infernale du plus beau hillbilly des Appalaches. Sur scène, ils font absolument tout ce qu’il faut pour qu’on ne les prenne pas au sérieux, mais en contrepartie ils jouent comme des diables. Il n’est pas besoin d’être musicien pour comprendre que ces quatre mecs sont de très grosses pointures, comme on dit chez les cordonniers.
À une autre époque, on avait découvert Th’ Legendary Shack Shakers à la Boule Noire, et ce soir-là, nous n’étions qu’une petite vingtaine de personnes rassemblées au pied de la scène pour admirer le numéro de cirque de JD Wilkes et de ses copains du Kentucky. Leur numéro consistait à slapper le fameux southern gothic dont on trouve les racines dans les romans de William Faulkner et d’Erskine Caldwell. Les Shakers allaient beaucoup plus loin que les groupes de country-punk, car ils dynamitaient leur son à coups d’harmo et de banjo. Ils dégageaient un souffle extraordinaire qui pouvait ressembler à celui de la liberté absolue, telle que l’ont vécue leurs ancêtres les pionniers. Ces gens qui s’installèrent dans des terres inconnues échappèrent définitivement aux lois de la société et purent inventer les leurs. Ils ne le savaient pas, mais leur objectif qui était de cultiver quelques arpents de terre et de vivre libre cousinait sérieusement avec ce que les piratologues appellent l’utopie.
Les quatre pitres d’Hayseed Dixie vivent à Jackson, dans le Tennessee. Le nom du groupe est une déformation phonétique d’AC/DC, un groupe qu’ils semblent priser puisqu’ils ont déjà enregistré un tribute à AC/DC. Ils terminaient d’ailleurs leur set du 106 avec «Highway To Hell», ce qui n’était pas forcément une bonne idée, car dans leur tas de reprises, ils avaient des choses plus intéressantes, comme par exemple une reprise du Rapsody de Queen assez extraordinaire. On s’imagine que Queen reste intouchable à cause du chant de Freddy Mercury, mais ces gens-là sont suffisamment doués pour en proposer une version spectaculaire. On reconnaissait au passage des cuts célèbres, comme «Ace Of Spades», ou «Watching The Detectives» de l’endivaire Costello. Au moins, l’avantage du blind date, c’est que ça amuse les gens. Comme ces jeux télévisés auxquels on participe sans le vouloir quand il faut composer des mots avec des lettres. Pendant ce temps, on ne fait pas de conneries.

Hayseed Dixie était au 106 dans le cadre des Nuits de l’Alligator, pris en sandwich entre le grand Bloodshot Bill et les vaillants Heavy Trash. Ils surent tirer leur épingle du jeu car ils faillirent voler la vedette à Heavy Trash, grâce à une reprise du thème de Délivrance. Et là on ne rigole plus, car on entre de plain pied dans cette mythologie réactivée jadis par Martin Boorman, celle d’un Deep South sauvage et désertique où rôdent encore des trappeurs édentés. Ces fantômes ne portent plus la fameuse coiffe en fourrure de Davy Crockett, mais des casquettes.

Tout l’univers malade jadis décrit par Faulkner rejaillit de façon spectaculaire dans ce film et tous ceux et celles qui l’ont vu en ont été marqué à jamais. Pas uniquement par les quelques scènes de violence, mais peut-être plus sûrement par cette rencontre dans une cabane au bord du fleuve entre un gosse dégénéré et un type civilisé qui voyant un banjo dans les mains du gosse tente de nouer un dialogue en jouant un thème sur sa guitare. Le gosse l’entend et le rejoue à l’oreille sur son banjo. Alors le civilisé joue une variante et le gosse la reprend immédiatement. C’est là que la magie se produit. Les deux instrumentistes accélèrent le tempo et ça donne «Banjo Duelling». Avec cette séquence, Boorman fait de l’universalisme, la science de tous les rêves impossibles de connexion entre les êtres.

Il semble que la musique soit le seul moyen d’établir cette connexion. Et quand les Hayseed Dixie attaquent ce thème devenu mythique, on ne peut que se prosterner. D’autant qu’ils sont quatre à pouvoir le jouer. Mais c’est Johnny Butten qui mène forcément le bal sur son banjo. Ça pourrait tourner au cliché, mais non, car c’est joué dans les règles de l’art. Et à part eux, qui est capable de jouer le thème de Délivrance ?

Même dans ses rêves les plus fous, Gram Parsons n’aurait jamais imaginé qu’une telle équipe puisse un jour incarner l’Americana. Le chanteur John Wheeler ressemble à un prof d’histoire-géo en vacances en club Med, Jake Byers qui joue sur une grosse basse acoustique se déguise en clown trash-metaller, Joe Hymas qui gratte une mandoline fait le hippie dans sa salopette et le seul qui ne semble pas faire le clown en se déguisant, c’est Johnny Butten avec son banjo et sa casquette de trappeur édenté. Leur set est un mélange assez explosif d’auto-dérision, de talent, d’énergie, de virtuosité et de wild americana.
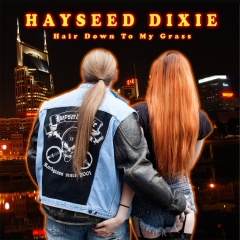
Ils profitaient de cette tournée pour faire la promo de leur nouvel album, «Hair Down To My Grass». Ils proposent une série de reprises pas toujours du meilleur goût, mais on les écoute pour se régaler des parties de banjo de l’ami Butten. Tout est emmené à l’énergie des Appalaches. Le problème est qu’ils reprennent des morceaux de groupes qu’on ne connaît pas forcément, comme Journey, Survivor, les Scorpions ou Pink Floyd. Mais partout règne une sorte d’excellence d’allant et ces quatre mecs astiquent leur beat avec une incroyable frénésie. On tombe sur un vieux coucou comme «The Final Countdown» qui incarne tout ce qu’on a pu détester dans les années 80, mais ils en font un truc nouveau, joué au violon gras de Stephane Grapelli et monté à la pompe manouche, alors ça devient intéressant, d’autant que l’ami Butten vient gratter son banjo du diable. Il joue terriblement vite et reste miraculeusement dans les clous d’une énergie dévoyée. On trouve aussi sur cet album une reprise salée de «We Are The Road Crew» de Motörhead. Banjo man y entreprend une cavalcade hallucinée. Le banjo, lorsqu’il est bien joué, donne toujours une image de la virtuosité excessive. Quand on demande à Johnny Butten d’où il sort sa virtuosité, il répond tout simplement qu’il a appris à jouer du banjo at the age of nine. Pour le «Comfortably Numb» du Pink Floyd, Banjo man refait un véritable festival et semble même crever le mur du son avec un indicible smash énergétique. Il sort le son de la vie, le banjo éclate dans le supersonic rocket-shout. Aucune guitare électrique ne peut rivaliser avec cette frénésie extravagante. Ils bouclent cet album avec «Don’t Fear The Reaper» du Blue Oyster Cult. C’est une fois de plus joué au violon gras et vrillé par un wild drive de banjo sauvage des Appalaches. Banjo man reprend le thème de l’huître qui se prenait pour les Byrds et l’emmène cavaler à travers les plaines du Wyoming et du Dakota tagada, au vent d’allure chargé de parfums sauvages, narines dilatées, énergie de la vie primitive, cavalcade insensée à travers les collines couvertes d’herbes hautes à perte de vue, yaooohh, le banjo bouillonne comme le sang dans les veines d’un homme libre.
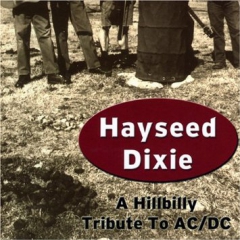
Cet album n’est que la partie visible de l’iceberg. Les Hayseed Dixie ont déjà enregistré une belle série d’albums et Banjo man vient tout juste de remplacer de frère de Joe Hymas, qui jouait bien, mais pas aussi vite que lui. On dit de Banjo man qu’il figure dans le livre Guinesss des records en tant que joueur de banjo le plus rapide du monde. Leur premier album fut un Tribute à AC/DC et même quand on n’apprécie pas vraiment le rock hurlé des Australiens, on écoute l’album des Hayseed avec un réel plaisir. John Wheeler s’impose comme un chanteur extraordinaire dès la première reprise qui est celle de «Highway To Hell». Ils transforment ensuite «You Shook Me All Night Long» en hit de cabane du Midwest. On se croirait dans «Les Portes du Paradis» de Cimino. Encore une belle mainmise avec «Dirty Deads Down Dirt Cheap». Wheeler chante comme un stentor avec un humour à fleur de peau, au milieu d’un véritable bombast d’instruments à cordes, le tout monté sur le tic tac de fond de la grosse basse acou. Il se peut que ce premier album reste leur meilleur album. Wheeler chante aussi «Hells Bells» à la force de la glotte, mais sans hurler, comme c’est le cas dans la version originale. Ils embarquent «Money Talks» au tourbillon des hillbillys. Ces mecs circulent dans les collines à train d’enfer et les solos d’acou sont d’une rare violence. John Wheeler va où le vent le porte. Nouvelle merveille avec «Have A Drink On Me», une petite aventure de bluegrass à la tabasse du beat. Ces mecs repartent inlassablement en patrouille. Ils ne craignent ni le diable, ni l’indien, ni les fauves, ni la mort. Voilà encore un cut fabuleusement fouillé aux violons et bardé de coups d’acou. Franchement on s’épate de tant d’énergie. Tous les groupes de rock devraient écouter cet album, car il renvoie une bonne image de ce que peut signifier le rock lorsqu’il est de bonne humeur. La version de «TNT» fera hennir les goths du coin de la rue, mais tant pis. Et ils repartent ventre à terre à coups d’acou. Avec «Back In Black», John Wheeler fait un vrai numéro de cirque - Yes I’m back, well I’m back/ You know I’m back/ I’m back in black - Ce mec fait ce qu’il veut au chant. Il monte où il veut. Il aménage ses propres paliers et soudain, il emprunte un pont jazzé au slap étrangement fantastique et il revient en envoyant des coups d’acou terribles. Leur énergie nous soûle. Avec «Big Balls», John Wheeler fait l’éloge de ses big balls - I got big balls, she got big balls - et sa voix puissante porte jusqu’à l’horizon.
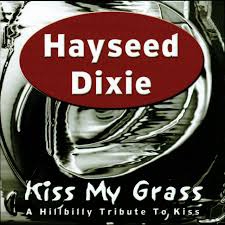
Après le Tribute à AC/DC, ils passent au Tribute à Kiss. Eh oui, ce sont des Américains, et le goût des Américains en matière de musique fait souvent l’objet de bien des moqueries. Quand on écoute «Calling Dr Love», on ne reconnaît pas forcément les clowns de Kiss, car banjo et mandoline mènent la danse. Le truc des Hayseed marche à tous les coups, quelque soit le navet choisi. Ils jouent avec une telle énergie qu’on en redemande. Ils vont même réussir à mettre de la pompe manouche dans «Let’s Put The X In Sex» et la Banjo man d’alors part en vrille. Il transforment aussi «Lick It Up» en rock gitan. On assiste à une belle étude de croisement avec le banjo de Délivrance et soudain, ça part. Banjo man devient fou. S’ensuit un «I Love It Loud» que John Wheeler chante à l’admirabilité des choses. Cet album est particulièrement amusant, car les Hayseed transforment les cuts de Kiss en belles bourrées auvergnates. C’est de bonne guerre.
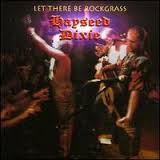
Leur fantastique reprise de «Ace Of Spades» se trouve sur l’album «Let There Be Rockgrass». Lemmy a dû jubiler en entendant ça. Banjo man joue à toute blinde. C’est le banjo du diable - The ace of spades ! The ace of spades ! - On y entend un effarant duel d’effarence entre le banjo et la mando. Ils sortent aussi une reprise de «Walk This Way» d’Aérosmith. Ils traitent le passage rap à la jew harp. Ils traquent le riff dans un coin et ils l’Appalachent sans pitié. Leur truc est sacrément bien ficelé. Autre reprise fumante, celle de «Centerfold» du J. Geils Band. Ce genre de groove leur va comme un gant. John Wheeler le bouffe tout cru, évidemment. L’autre grosse pièce de l’album est «Corn Liquor», emmené par une attaque de banjo démente. On sent la puissance du beat des Appalaches. Musicalement, le banjo reste aussi excitant qu’un bon drive de slap joué sur une stand-up.

Leur version des «Duelling Banjos» se trouve sur l’album «A Hot Piece of Grass». Pure magie. Quand ça part, ça part en vrille. Ils jouent ce classique imparable comme des démons. Tout est emmené à la vitesse de l’éclair. Attention, ce n’est pas tout. Ils sortent aussi une fantastique version du «Black Dog» de Led Zep. John Wheeler fait son Robert Plant superbement et le banjo illumine le vieux souvenir de Led Zep. Autre bonne surprise : la reprise du «War Pigs» de Black Sabbath. Ils passent Sab à la casserole bluegrass. Il y a chez les Hayseed une énergie autrement plus diabolique que celle d’Ozzy et de ses comparses. Banjo man plante au cœur de «War Pigs» un solo de banjo terrible. Ils proposent aussi une version insidieuse de «Whole Lotta Love». Au chant, John Wheeler est dessus, pas de problème. Quand on dispose d’une vraie voix, on peut taper dans ce genre de vieux coucou sans risque. On trouve aussi dans «Roses» une merveilleuse échappée de banjo exacerbée. Voilà encore un cut larger than life. Les amateurs de bluegrass se régaleront de «Blind Beggar Breakdown», entièrement cavalé au banjo ventre à terre et doté de tous les apanages de l’ardente vélocité.
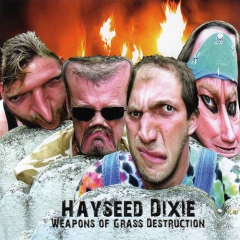
Ah il faut le voir pour le croire : une version du «Holiday In The Sun» des Pistols se niche sur l’album «Weapons Of Grass Destruction». Mais ils la ralentissent pour la rendre méconnaissable. Autre chef-d’œuvre iconoclaste : la reprise du «Strawberry Fields Forever» des Beatles. Décidément, ils ne reculent devant aucune expérience spirituelle. Ils prennent un tempo soutenu et ils utilisent des coups de banjo pour recréer les tons mauves de la vision psychédélique originelle. Leurs soudaines montées en température passent plutôt bien. En fait, ils adorent exploser les lieux communs du rock. Ils finissent d’allumer ce vieux coucou à coups de violon des Appalaches. Comme quoi, rien ne se perd, ni les choses, ni les âmes. L’autre gros coup de cet album est la reprise de «Down Down» des Status Quo. Ils renouent avec le boogie des seventies britanniques. Ils nagent dans l’eau glacée du temps comme des saumons d’Écosse. Et comme d’habitude, leur reprise se veut splendide d’énergie spécifique. Vu qu’ils tapaient dans les Beatles, ils se sentaient obligés de taper dans les Stones. Alors voilà qu’ils reprennent «Paint It Black». Oh, ils sont dessus, comme des sangsues sur les jambes du Capitaine Wyatt. Mais on se régalera surtout de «Hangover Breakdown», joué à la culbute de banjo et pulsé au crash-boum du double carburateur.

Histoire de dérouter encore plus les curieux, ils firent paraître en 2008 un album SANS reprises intitulé «No Covers». Curieusement, quand ils ne jouent plus de reprises, ça marche beaucoup moins bien. John Wheeler et ses amis composent des petits boogies insignifiants et tout rentre dans l’ordre. Avec «Born To Die In France», Wheeler raconte l’histoire de grand grand-daddy from the First World War. Et lorsqu’ils attaquent «You’ve Got Me All Wrong Baby», ils se prennent carrément pour un gang de power rock. Le pire c’est que ça marche. À force d’écouter les poids lourds du rock FM, ils se prennent eux-mêmes pour des poids lourds. Phénomène purement américain. Ils s’amusent comme des gosses, ne l’oublions jamais.

La belle version de «Bohemian Rhapsody» qu’ils jouent en concert se trouve sur l’album «Killer Grass» paru en 2010. John Wheeler lui shoote un énorme boost de rift dans le cul. Ils reviennent à Black Sabbath avec une fastueuse reprise de «Sabbath Bloody Sabbath» embarquée au banjo. Ça vaut tout l’or du monde. On y retrouve l’esprit enlevé, ce goût pour les cavalcades infernales au pied des Rocheuses, au temps où les amortisseurs n’existaient pas encore. Ils enchaînent avec une reprise de «Won’t Get Fooled Again». Le banjo imite l’intro de synthé et ça part sur un beat de basse acou. John Wheeler fait un véritable festival, il bouffe Daltrey tout cru. Comme le duc de Guise, il mène le combat à sa guise. Quand on entend le solo de banjo, on réalise soudain que ces gens-là ne sont pas du genre à s’embarrasser avec les détails. Mais la bonne surprise se trouve sur le deuxième disque de l’album qui est un DVD. On les voit faire le cons dans quelques clips rigolos, et le clou du spectacle, c’est la leçon dans banjo filmée dans le jardin. On y voit les deux frères Hymas jouer sur un banjo : l’un gratte les cordes et l’autre les pince. Puis, Jake Byers vient donner un cours de basse acou. On le voit jouer ses mesures de pompe à sec et c’est assez fascinant. Ce mec joue admirablement bien. John Wheeler vient ensuite pincer les cordes que gratte Byers. Et ils finissent à quatre, offrant le spectacle d’un hallucinant groupe de surdoués. On voit aussi Byers filmé dans la forêt pour un Tutorial : comment enterrer un body dans la forêt. On se croirait chez John Waters. Puis on revient à la magie pure avec un autre Tutorial : comment jouer «Duelling Banjos» avec un joueur de bongo africain. On se prosterne, comme devant l’apparition du prophète.
Signé : Cazengler, AC KC
Hayseed Dixie. Au 106, Rouen. 26 février 2015
Hayseed Dixie. A Hillbilly Tribute To AC/DC. Dualtone Records 2001
Hayseed Dixie. Kiss My Grass. A Hillbilly Tribute To Kiss.
Hayseed Dixie. Let There Be Rockgrass. Cooking Vinyl 2004
Hayseed Dixie. A Hot Piece Of Grass. Cooking Vinyl 2005
Hayseed Dixie. Weapons Of Grass Destruction. Cooking Vinyl 2007
Hayseed Dixie. No Covers. Cooking Vinyl 2008
Hayseed Dixie. Killer Grass. Cooking Vinyl 2010
Hayseed Dixie. Hair Down To My Grass. Hayseed Dixie Records 2015
De gauche à droite sur l’illustration : Joe Hymas, John Wheeler, Jake Byers et Johnny Butten.
22:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/01/2016
KR'TNT ! ¤ 262: HAMBOURG BEATLES / MOUSTACHE / MUMIA ABU-JAMAL
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 262
A ROCK LIT PRODUCTION
31 / 12 / 2015
|
BLOODSHOT BILL / HAMBOURG BEATLES MOUSTACHE / MUMIA ABU-JAMAL |
Au 106 / ROUEN / 26 – 02 – 2015
BLOODSHOT BILL
A BLOODSHOT OF RHYTHM & BLUES
Pauvre Bloodshot Bill ! Il semble condamné aux premières parties. Il partage le sort des acteurs de série B dont on connaît les visages mais pas les noms et qui passent leur vie à errer dans les ténèbres de l’underground cinéphilique. Bloodshot Bill arpente pour l’heure les ténèbres d’un autre underground, celui du rockabilly, et pourtant, il compte une belle pincée d’albums à son palmarès, ce qui n’est pas rien. Petite cerise sur le gâteau, Billy Miller et Miriam Linna lui font confiance puisque ses albums sortent en partie sur Norton Records, ce qui est gage de sérieux. Rien n’est plus prestigieux qu’un album sur Norton Records, le label de Bobby Fuller, d’Esquerita ou encore d’Hasil Adkins. Et c’est là que s’établit le lien, car Bloodshot Bill est lui aussi un one-man band, comme le bon vieux Haze des bois de Virginie. Billy et Miriam continuent de cultiver leur fascination pour ces hommes-orchestres sortis de nulle part et capables de remplir des faces entières d’albums de morceaux expressionnistes.
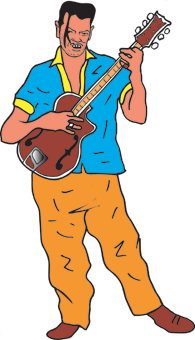
L’autre soir, Bloosdshot Bill faisait la première partie de la fameuse Nuit de l’Alligator. On le fit jouer dans un grand hall, tout seul avec une petite guitare de voyage. Bloodshot semblait avoir forci du corps et du menton. Il arborait un beau volume d’homme dans la force de l’âge, grand, fort et massif comme un bûcheron canadien mâtiné de guerrier Mohawk. Il dégageait un fort parfum d’exotisme. On devinait en lui l’esprit du coureur des bois, celui du métis des frontières, ces hommes à la peau halée et aux cheveux noirs de jais qui allaient, au mépris des alliances, de fort en fort, au temps de la guerre d’Indépendance déclarée par les pères de la Confédération américaine naissante contre la puissante Couronne d’Angleterre. Il se peut fort bien que Bloodshot ait croisé Hugo Pratt quelque part dans le Nord, du côté de Fort Wheeling. Attention, cet homme n’est pas n’importe qui. Il fait aujourd’hui de la musique avec toute l’intériorité sauvage d’un coureur des bois. C’est la raison pour laquelle une sorte de frénésie trahit parfois ses roucoulades.
Bloodshot reprit deux chansons de Charlie Feathers, ce qui éberlua les rares experts présents dans la salle. Et pour honorer la mémoire du vieux Charlie, il mit dans son chant toute la puissance de son intériorité. L’art de Bloodshot Bill est un art subtil. Il sait malaxer une syllabe pour la faire sonner et la lâche avec un brusque mouvement de la jambe. Il joue avec la musique des mots, passe du sourd au chantant avec des petits pointes de dérapage dans le yodel, mais tout est incroyablement intériorisé et tellement pur que les néophytes tombent sous le charme.
Prenons un exemple pour illustrer ce phénomène : l’opéra. Berk. Jusqu’au jour où on entend Maria Callas chanter «Casta Diva». Et ce n’est pas pour ça qu’on va s’intéresser à l’opéra. Simplement, cette femme chante si bien qu’il n’est pas possible de rester insensible. Le néophyte tombe sous le charme. Et ce soir-là, tous les néophytes qui se trouvaient rassemblés au bar sont certainement tombés sous le charme, car Bloodshot Bill chantait comme un dieu. Il nous réconciliait avec l’Americana des hillbillies, l’ancien son de l’Amérique des pionniers et des fermiers, des bandits et des marchands. Bloodshot accomplissait un véritable prodige en ramenant tout cet univers en Normandie. Quelle chance nous avions de voir jouer un artiste aussi fascinant !
Si on se pique d’aimer l’authenticité, alors il faut aller voir Bloodshot Bill sur scène. À sa façon et avec les moyens du bord - ridicules, faut-il le préciser ? - Bloodshot porte le flambeau, comme Charlie Feathers et les frères Burnette avant lui, comme les Wise Guyz, Carl & the Rhythm Allstars et Hipbone Slim aujourd’hui. Le rockab reste un art vivant grâce à tous ces gens-là.
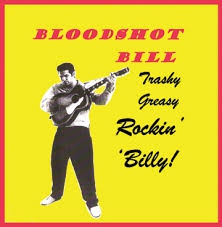
Fantastique album que ce «Trashy Greasy Rockin’ Billy» paru en 2006. Tous les cuts valent le détour. Bloodshot vous en donne pour votre argent. Il nasille bien et halète comme le loup de Tex Avery. Pour chanter un cut comme «I’ll Know», il faut avoir le diable dans le corps. Avec «Why’d Ya Have To Go & Leave Me», il sonne un brin crampsy. Il fait son gommeux des Batignolles. Pour chanter comme ça, il fut être un peu dérangé. On croirait même entendre Lux. Il passe à l’ultime violence de riffage avec «Hide N Seek». On n’avait encore jamais entendu un son riffique aussi sec et acide. Avec «Ring The Bell», Bloodshot devient le rockab le plus sauvage du monde. Il a récupéré tout Charlie et tout Johnny Burnette, tout le jus des rois du rockab et il restitue son héritage sous forme d’une belle explosion. Encore plus terrible : «Crazy Sound», solide, violent et envenimé. Ce mec est un démon, un sale vaurien aux semelles bardées de gadouille trash du Wisconsin. Pas de pire sauvagerie dans toute la longue histoire du hillbilly. Il reste installé sur les contreforts des Appalaches pour jouer «Yukon Buddy», pure pièce de country bop sidérante d’authenticité. Attention ! «Loosen Up» est complètement dévasté à la stand-up. C’est à nouveau la main poilue du trash qui s’abat sur la terre. Si on reste au milieu du chemin, on sera écrabouillé par la cavalcade. Terrible ! Voilà que déboule le trash de la mort ardente aux yeux jaunes. Sur «Loaded», Bloodshot continue son festival et comme Hasil Adkins, il va chercher la folie dans le fond des bois. Il finit cet album exceptionnel avec une fabuleuse horreur intitulée «Hey Norton», un vrai storm de Brill. Rien de plus démoniaque que cette fabuleuse exportation. Bienvenue au royaume du trash extrême.

Bloodshot attaque «All Messed Up» avec le bop des amphètes, «Pill Bop», admirable de surexcitation. Oh il ne chante pas, il ne peut pas. Quand on prend trop d’amphètes, on ne peut plus parler, on halète. Alors Bloodshot halète comme une bête en rut et devient fantastique d’expressionnisme. Il continue dans la même veine avec «Naughty Girl». Il fait bien la naughty girl, la vilaine salope. Bloodshot joue la comédie et ça marche. Il aime par dessus tout le vieux hillbilly qu’il prend à la bonne franquette. Cet album en est bardé. Il revient au rockab avec «The Moon Won’t Tell». Il ramène tout l’attirail : les flambées de fièvre, le nasal, le poivré et le bop. Ne manque que le slap. Petit défaut. Il attaque la face B avec un numéro de virtuose du cot-cot, «Treat Me Right», un bon boppy-boppah de cot-cot pee-pee-pee de basse-cour. Il est dans la véracité du phrasé rockab, tel que l’avait imaginé Charlie Feathers. Avec «Settle Down», Bloodshot montre qu’il adore haleter et foncer dans le tas. Puis il chante «300 More Miles» comme un vieux hillbilly édenté en salopette rapiécée, pipe coincée entre le nez et le menton. Puis il repart au nez pincé avec «Got Another Baby» et se proclame empereur du bop nasillard. Franchement, on se croirait sur un single Meteor.
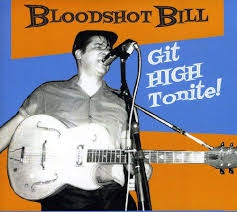
Les amateurs de bop se sont régalés avec «Git High Tonite». On sent le spécialiste, dès «Shick Shack». Bloodshot adore tototer son beat, il va même parfois jusqu’à siffler. En bon artisan du bop, il mâchouille bien sa matière vocale. Il renoue avec la grandeur du bop en prenant «Leave Me Alone» à la hussarde. Son beat semble foncer à travers la nuit des temps et en même temps, il éclate de verdeur. Il met une sacrée pression sur l’énervement, il passe ses hoquets avec une circonspection consternante, c’est un winner de la loose, un fantastique brasseur de brettage. S’ensuit un joli romp de rut rockab avec «Gee Whiz». Bill hurle à la lune avec une grosse pulsion artérielle. Puis il se lance dans un festival de vocalises déraillantes pour «Pretty Lil Miss». Bloodshot, c’est Hiccup 1er, le roi des collines du midwest of nowhere. Et voilà l’énormité que tout le monde attendait : «Outta The Rain», doté d’un son pur et d’une excellente pression de strumming. On a là la vraie sauvagerie américaine de l’âge d’or des salopettes et des guitares à deux sous commandées dans des catalogues. Bill est fort, il recrée tout cet univers de véracité pouilleuse. Il fait tout au chant mité de dingo des collines. Pour un peu, on pourrait le croire hanté. Retour au hiccup avec «Doin’ To Me». On ne se lasse pas de la classe tapageuse de Bloodshot Bill. Il fait le beat ferroviaire, c’est imparable. Ce mec est beaucoup trop fort pour notre époque. Pour «Whole Hearts Desire» et «Oh Honey Doll Baby Doll», il revient au beat crampsy. L’incroyable de la chose est qu’il sonne exactement comme Lux.
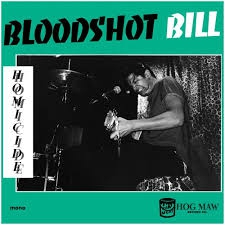
Il sort le mini-album «Homicide» en 2010. Il attaque en mâchant les syllabes de «Treasure Of Love». Il inspire tout le ruckus du rockab par les trous de nez et malaxe l’accent des Appalaches avec le stoïcisme d’un bison qui voit passer au loin sur la crête des collines une colonne de chasseurs Cheyennes. Avec «Tellin Ya Baby», Bloodshot va chercher le Charlie mais aussi le vilain killérique. Il sait couiner du nez comme une petite gouape de Wisconsin, le genre d’ado qui s’entraîne devant la glace de son armoire à jouer de la guitare sur sa raquette de badmington parce que ses parents ne sont pas assez intelligents pour penser à lui offrir une vraie guitare. Quand Bloodshot chante du nez, c’est surtout pour rendre hommage à son idole Eddie Cochran. Il passe à la country avec «You Don’t Owe Me A Thing» et sort son beau yodel à la mortadelle. En face B, on se régalera du morceau titre secoué au sableur et d’un «Gotta Go» gratouillé à la coolitude d’un feu de bois dans le Dakota tagaga.
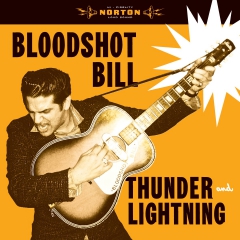
«Thunder And Lightning» sort sur Norton en 2011. Ouverture du bal avec «All The Time» que Bloodshot gratte sur sa vieille gratte au clair de lune du Montana. Il passe à la pompe manouche avec «Be Mine Tonight». Il gratte ça au bout du bout du temps, ça sent la vieille caisse fouettée au bord du chemin qui mène à Jackson, Tennessee. Puis il part à l’assaut rockab avec «Crazy Bout The Girl». C’est sacrément secoué du cocotier. Bloodshot s’y connaît en convulsions et il se livre à sa bonne pulsion cavaleuse, toutes narines pincées. On trouve le morceau titre en face B, straight et sec, bien secoué de la paillasse, ouh-ouhté avec un art consommé et claqué au gimmick de fuite en avant. Il retrouve son timbre de petite gouape du Midwest pour «Hang In There». Plus loin, «Stop» sonne comme un hit, classieux comme pas deux, un vrai bash de beat bardé de breaks battants, beau blast de bop. Pourtant, on dirait que Bloodhot a échangé sa stand-up contre un cran d’arrêt, car le slap fait cruellement défaut dans son son. On atteint un peu les limite du one-man-bandisme qu’on accuse à tort ou à raison d’appauvrir le son. Le son reste en effet très linéaire, et s’il ne se passe rien au chant, alors c’est cuit. Hasil Adkins s’en sortait bien parce qu’il savait faire le con.
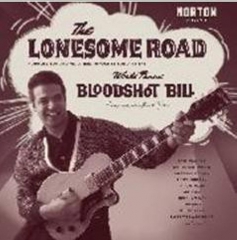
On reste chez Norton avec «The Lonesome Road» paru en 2013. Bloodshot remet en route son strumming épique et tout son petit bazar fifty en formica. Rien de nouveau sous le soleil jusqu’à «Lonely», vrai rockab classieux, joué au ralenti et rehaussé d’attaques décadentes. Bloodshot chante à la mode de Saint-Louis, d’une belle voix étoilée d’absinthe. S’ensuit un «Don’t Buy Me Baby» plus rugueux. Il sait jerker le slap, aucun doute là-dessus. L’autre bon cut de la face A n’est autre que «Sittin’ With You», bien emmené à coups de ehhhh de relance. L’édifice chancelle magnifiquement. De l’autre côté de la galette se niche un «Oh baby» chanté à coups d’épaule et monté sur un beau mid-tempo d’élégance suprême. On ne se lasse pas de la classe de Bill Building. Il crée de fantastiques ambiances, des balancements idéaux et rappelle par ses coups d’éclate le cas des cats du Kansas - Baby Oh ! Baby Ah ! - Le principal atout de Bloodshot Bill n’est autre que la nonchalance. Tout aussi exceptionnel voici «You Know Why». Bloodshot pose son chat perché sur un doux fouetté d’accords. Il atteint au fusionnel d’intensité détachée. Puis il s’éloigne en sifflant. Un petit coup de beat ferroviaire avec «Two Timer», bien allumé et parfaitement déterminé. Comme les frères Burnette, il adore choo-chooter. Quand on écoute «I Love Her Just The Same», on se demande pourquoi Bloodshot n’est pas en tête des charts. Car voilà un petit cut brûlant de fièvre et poussé dans ses retranchements par un Bloodshot fort en gueule et au nez pincé. Ses jolies poussées de fièvre se confrontent aux réalités. Il enchaîne avec un «Blue Days Black Nights» qui nous amène à nous demander s’il n’est pas meilleur sur les morceaux ralentis. Car quelle classe !

Son dernier album vient de sortir, toujours sur Norton. «Shook Shake» remontera le moral des troupes, pas de doute. Bloodshot attaque avec un solide romp de bop, «When My Baby Passes By». Il sonne comme un Hank Williams sur-excité - I coud’ die - Avec «We’ll Always Have Each Other», Bloodshot réinvente l’inréinventable. C’est plus fort que lui, il remalaxe à l’infini le vieux strumming des sous-bois de l’Arkansas. On goûte à l’excellence du nose-cutting avec «Come Inside» et il nasille à la folie son «Tear It Apart». Mais c’est en face B que se joue le destin de l’album. On retrouve enfin le bop des cats avec «Bloodshot». Ne manque que le slap. Il joue ça à la bonne ramasse de la rascasse. Tout ce que fait Bloodshot est bon mais se fond dans le fond du fond. Il a rajouté un peu de basse, mais elle est trop sourde, comme quand il joue de la stand-up avec Heavy Trash. On ne l’entend pas. Il chante «Baby Crazy» comme un vieux renard du désert de l’Arizona et on l’admire pour ça dans toute la contrée. Puis il amorce un retour au romp de rock avec un «Gone Gone Gone» bardé de clins d’yeux à Eddie et ça vire au miracle. Voilà le grand classique de Bloodshot Bill ! On trouvera encore deux merveilles en fin de face : «Gumboot Cloggeroo», chef-d’œuvre nasillard de fond de saloon du Kentucky, et «My Poor Heart Flips», une énorme pompe rockab amenée à train d’enfer, une authentique enfilade de perles.
Bloodshot n’est pas avare de cous d’éclat. Le dernier en date est son association avec Mark Sultan, fellow canadian et grand-maître du one-bandisme. Ensemble ils forment les mighty Ding Dongs, histoire de nous sonner les cloches. Leur premier album est sorti comme par hasard chez Norton et ce disque tient admirablement la route. Ils font un duo d’enfer sur «Come On Lil Dolly». Nasal 1er fait son grand retour et Mark Sultan lui fait de beaux renvois. Sultan tente même d’amener un peu de finesse dans cette débauche d’animalité. Ensemble, ils développent une fabuleuse dynamique. Et quand Mark Sultan prend le micro, ça donne une merveille comme «Until I Die», car il chante comme un charmeur fou. N’oublions pas que ce mec est hanté par le génie. Mark Sultan est l’un des géants de ce siècle. Encore une grosse série de cuts en face B, avec pour commencer «You Better Hide» : Mark Sultan renoue avec son rockab à la Sun et ça change tout. Il fait une merveilleuse exploitation du mythe et se montre digne des grands jukes d’antan. Autre coup de Trafalgar : «Military Mama», joué dans les règles de l’art rockab. Tout y est haché menu au cocotage de strumming avec des hiccups circonstanciés. Mark Sultan a même le toupet de chanter un faux Buddy, «Worried Man». Puis ils reviennent au pur trash bender avec «What’s That Sound», beau boogaloo de fête foraine et ils en profitent évidemment pour faire les cons.

En 2013, les compères enregistrent un deuxième album : «Rang Tang Ding Dong». On y trouve pas mal de belles choses, notamment un «Never Let You Go» digne des jukes d’Hambourg et d’ailleurs, magnifiquement breaké au slap, doté de l’excellence d’un son foutraque et d’une prestance de la balance. Même chose pour «Mama Bear», bien chanté du nez. Mark Sultan ramène avec «Stammer & Sin» ses rengaines de rues élévatrices de l’âme. Comme tous les géants du doo-wop qu’il admire tant, il perche ses ah-ah-ah sur un beau fil mélodique. En face B, on tombe sur «Phantom On The Hill», une jolie pièce d’exotica tendancieuse, encore plus ambitieuse que Lucien de Rubempré. Intense car chargée d’images et de climats douteux. Le hit de l’album s’appelle «Too Much Too Soon Too Fast». C’est un jump-rock chanté au cœur du swing avec une belle voix d’allant. Sacré Sultan, il chante au suave et au sabre, avec une diction voluptueuse. Ses mots se prélassent dans la chaleur des draps. Les deux compères reviennent à la sauvagerie avec «I Don’t Care». Bloodshot s’énerve pour de bon. Fini de rigoler. Il peut renverser une armoire d’un seul coup d’épaule. Et ça continue avec «The Dump», une merveilleuse parade de rockab chantée au dedans du menton et swinguée jusqu’à l’os du genou. Ils embarquent ça au meilleur strumming du Tennessee et Bloodshot chante comme Balami, le dieux des Juke-box.
Signé : Cazengler, chochotte Bill
Bloodshot Bill. Au 106, Rouen. 26 février 2015
Bloodshot Bill. Trashy Greasy Rockin’ Billy. Plying Saucer Records 2006
Bloodshot Bill. All Messed Up. Hog Maw Records 2007
Bloodshot Bill. Git High Tonite. Transistor 66 2009
Bloodshot Bill. Homicide. Hog Maw Records 2010
Bloodshot Bill. Thunder And Lightning. Norton Records 2011
Bloodshot Bill. The Lonesome Road. Norton Records 2013
Bloodshot Bill. Shook Shake. Norton Records 2014
The Ding-Dongs. The Ding-Dongs. Norton Records 2010
The Ding-Dongs. Rang Tang Ding Dong. Norton Records 2013
LES BEATLES A HAMBOURG
COMMENT TOUT A DEBUTE
SPENCER LEIGH
( Fetjaine Editions / 2011 )

Les Beatles eux-mêmes n’ont jamais trop insisté sur la longue période qu’ils passèrent à Hambourg. Des années de formation nécessaires, mais on a l’habitude de dater notre naissance du jour où nous nous extirpons avec plus ou moins de peine du ventre procréatif qui nous a hébergé faisant ainsi débuter notre existence à la fin de notre gestation. N’y a que les psychanalystes teintés d’ésotérisme qui font remonter nos névroses au monde utérin dans lequel nous avons baigné à l’état de larve fœtale. Et les Beatles ne devinrent pleinement les Beatles que lorsqu’ils eurent cassé la coquille de l’œuf du rock and roll dans lequel ils parvinrent au développement nécessaire à leur mutation auto-génétique.
Le bouquin s’achève très symboliquement après la sortie de Revolver. Le disque de la mutation, les Beatles sont devenus des trafiquants de studio. Font prendre un sacré virage au rock and roll qui quitte la route et se retrouve dans les décors. Pas gênés les Fab Four montent dans le taxi de la pop music, en descendront plus tard, une fois qu’ils ne se seront pas aperçus qu’ils ont pris un mauvais chemin… Autour de moi, j’entends nombre d’amis rockers fans de rockabilly qui tressent des couronnes de lauriers aux Beatles. Je leur réplique que je préfère les Stones, certes les pierres roulantes provenaient du blues - ce qui les a empêchées de se perdre définitivement - mais ce sont elles qui ont perpétué l’esprit rebel-rock. L’est toujours bon de rallumer les anciennes fausses querelles…
ENGLAND : ACTE 2
De toutes les manières les évènements sont beaucoup plus complexes que la réalité de laquelle ils participent. Avant les Beatles et la flopée de groupes qui se réclamèrent du Liverpool Beat, la vieille Angleterre avait connu sa première génération de rockers : Tommy Steele, Terry Dene, Cliff Richard, Billy Fury, Marty Wilde et bien d’autres… Effaçons tout et recommençons à zéro, la nouvelle génération venait de découvrir à son tour les Américains : Bill Haley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Eddie Cochran furent une révélation, in vivo. Remarquons que le roi Presley se fit représenter par des images mouvantes. Tant pis pour ceux qui avaient essuyé les plâtres, ne serviraient pas de modèles. A copier, autant pomper directement sur les originaux.

Petite embrouille très british au départ. En fait, les préposés aux gloires futures, partaient avec une case de retard. Z’en étaient encore au Skiffle alors que leurs prédécesseur avaient déjà squatté la case rock and roll. The Quarrymen de John Lennon, vite rejoint par McCartney et Harrisson, nétaient qu‘un groupe de skiffle.. Le skiffle britannique était en théorie un retour au blues d’avant l’électrification. Qui n’avait rien à voir avec le delta mais avec la crise économique de 1929 qui assécha les finances déjà plus que maigres des noirs américains décidés à faire carrière dans le blues. Incapables de s’acheter le moindre instrument, ils durent faire preuve d’ingéniosité et bricoler leurs charrues à partir de boîtes de cigares et de fils tendus… Un truc de misérables en quête de survie musicale qui frappa l’imagination des jeunes adolescents d’outre-Manche. Evidemment on trichait un peu, il y eut bien quelques puristes qui s’obstinèrent à suivre le glorieux exemple américain du do tit yourself du pauvre, mais devant la difficulté de la tâche la plupart finissaient par s’acheter une guitare à bas prix d’occasion.
L’influence du skiffle fut avant tout morale. L’on n’excuse pas un violoniste qui commet une fausse note sur un Sradivarius. L’on crie même au sacrilège. Mais un gars qui ne parvient pas à sortir un do rond et juteux de l’unique ficelle attaché au manche du balai familial, vous ne pouvez que l’encourager. Le skiffle désinhiba tous les apprentis du Royaume-Uni. L’on jouait mal, certes, mais c’était normal. Et ceux qui s’obstinèrent vainquirent tous les obstacles. Quelques uns - les plus doués - à force d’entêtement émérite finirent par devenir des instrumentistes de talent. Comme quoi le blé en mauvaise herbe peut produire de bonnes récoltes.
Quoique les Quarrymen aient sauté la première étape de la guitare fabriquée en dix leçons à partir d’une caisse de savon, leur aisance instrumentale naturelle ne faisait pas l’unanimité parmi le vivier des jeunes groupes nationaux. Evoluaient, s’assimilaient désormais aux rockers, n’étaient plus les Quarrymen mais les Silver Beatles. Nul n’étant prophète en son pays, s’en allèrent répandre la bonne parockle en Germany, n’étaient même pas les premiers à débarquer, et la triste vérité historique nous force à avouer que le public ne les attendait pas.
HAMBOURG BATTANT
Sur l’ensemble de l’Allemagne les hordes teutonnes ne mouftaient guère, fallait reconstruire le pays et l’on bossait tête baissée, la troisième guerre mondiale serait économique et celle-là il n’était pas question de la perdre. Silence dans les rangs et tout le monde au boulot. Les jeunes commençaient à trouver le temps long mais ils n’avaient pas encore le droit de parler à table. Hambourg fit exception. Ce ne fut pas de la faute des hambourgeois, mais des étrangers pour qui la ville était une escale obligée. Fallait bien des matériaux et des marchandises pour rééquiper le pays et tout cela était déchargé par les grues du port. Vous connaissez la devise des marins, une pinte dans chaque main, une pute dans chaque port. Des gens simples, à qui il ne faut pas en promettre. Vous commencez par tirer un coup, puis un deuxième, puis un troisième, premièrement ça coûte cher, deuxièmement vous risquez de caler si vous continuez ainsi de bordel en bordel. Faut faire durer le plaisir. Si vous n’étiez pas idiot, il y avait du fric à faire, la clientèle déambulait dans les rues, fallait savoir la retenir dès qu’elle rentrait dans un café. Les bars se transformèrent en boîte à striptease, rien de tel qu’un effeuillage un peu porno avant de consommer votre part de chair fraîche. Maintenant faut être franc, rien ne ressemble plus à une paire de nichons qu’un autre bustier dénudé. A force cela devient monotone. A la dixième attraction l’attention des spectateurs se relâchait, la parade fut vite trouvée, suffisait de faire alterner les demoiselles nues par des musiciens habillés. Nous le constatons amèrement, les marins ne sont pas mélomanes, les romances romantiques à l’eau de rose ne leur conviennent point, leur faut des morceaux moins tempérés, avec davantage de tempérament… En musique comme pour les nanas, ils aimaient bien les choses bien roulées, le rock and roll s’imposait. Le problème c’est qu’à l’époque le rock allemand… d’où la nécessité de faire venir des englishes…
Ce qui explique pourquoi un beau matin ( 17 août 1960 ) nos cinq gentlemen coachés par Allan Williams se retrouvèrent dans le quartier chaud d’Hambourg pour honorer leur premier contrat.
INDRA & KAISERKELLER
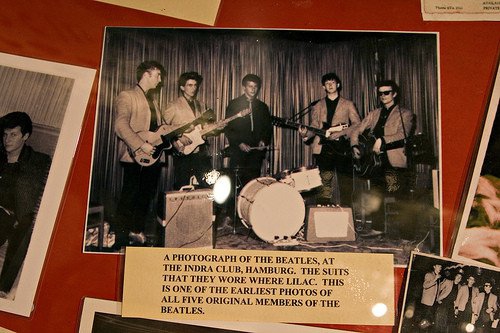
Vous pouvez recompter sur les doigts de la main, il étaient bien cinq, John, Paul, George, Pete Best ( batteur ), Stu Sutcliffe ( basse ), le taulier s’appelait Bruno Koschmider, pas spécialement un philanthrope, ni un militant du droit des travailleurs, logea le groupe dans un local, pas à poubelles mais presque, dans un cinéma, et le soir même nos cinq héros donnaient un premier set sur la scène de son établissement : l’Indra.

Une vie de forçats. Mais de rêve. Ne restèrent pas longtemps à l’Indra que Bruno Koschmider ferma pour ouvrir dès le début d’octobre le Kaiserkeller, nouvelle formule, deux groupes, Rory Storm and The Hurricanes, et les Beatles ( désargentés ), en alternance toutes les quatre-vingt-dix minutes, de huit heures du soir jusqu’aux deniers clients du bout de la nuit. C’était l’usine. A dix sept ans George gagnait exactement la même somme que son paternel. Mais c’était beaucoup plus excitant que la manufacture. Les Beatles apprirent beaucoup de choses. Premièrement à jouer du rock and roll. Z’étaient plutôt médiocres sur un plan strictement musical quand ils arrivèrent à Hambourg. Deux années plus tard, ils avaient acquis une expérience hors du commun qui leur permit de retour sur le sol natal de faire la différence. Mais ce fut surtout en ces années qu’ils se déniaisèrent. Physiquement et intellectuellement. Les filles n’étaient guère farouches. Beaucoup de prostituées, leur travail terminé, finissaient la nuit dans les clubs. Furent des initiatrices complaisantes et savantes. Plus les premières fans en quête de rapports privilégiés avec les musiciens. Mais ce ne fut pas là le plus important. Je ne parle pas même pas de l’accoutumance aux produits divers : cigarettes, alcools, pilules… adjuvants de base, réconforts autant physiques que moraux…

Pour la première fois nos fils de prolétaires furent confrontés à la jeunesse estudiantine. La rébellion instinctive du rock and roll entrait en contact avec le mal-être existentiel cultivé avec soin par une génération - souvent d’origine petite-bourgeoise - beaucoup mieux scolarisée. Lennon fut le plus réfractaire à cette intellectualité qui le bousculait peut-être plus profondément que ses acolytes. S’apercevait que ses attitudes provocatrices pouvaient s’articuler sur un fondement idéel, en lequel il ne s’était jamais risqué, beaucoup plus rationnel et profond que le simple plaisir de choquer les convenances sociales. Refusait de montrer qu’il était touché, mais quelques années plus tard il serait l’intello du groupe. Celui par qui les scandales arriveraient. En attendant ce fut Stu Sutcliffe qui passa le gué le premier. C’était un artiste, qui s’amouracha très vite d’une jolie étudiante Astrid Kirchhherr la petite copine de Klaus Woorman, graphiste. L’idylle ne déboucha pas sur un simple flirt. Stu ne rentrera pas en Angleterre avec ses camarades. Est revenu à ses premières amours, l’art pictural, et doit se marier avec Astrid… Astrid fut le premier photographe qui réalisa le premier shooting que nous qualifierons d’artistic-pro, ne se contenta pas de faire des photos, tenta de révéler l’esprit rock du groupe.
C’est que le groupe gagnait en maturité, peaufinait son image, cuir noir ( une idée d’Astrid ) ou blouson sombres, rencontrait du beau monde, Tony Sheridan guitariste hors-pair au caractère trempé qui ne fut pas sans hâter les tendances naturelles de John à l’affirmation péremptoire de sa personnalité, et nombre de musiciens dont un certain Ringo Starr qui battait la mesure chez les Hurricanes… Mais il fallut rentrer à la maison, Bruno Koschmider les renvoyant brutalement pour avoir tapé le bœuf un peu trop longtemps, avec Tony Sheridan dans un club rival, le Top Ten… durent mettre les voiles à toute vitesse car Koschmider révéla à la police que Paul n’était pas majeur et les accusait de tentative d’incendie du cinéma dans lequel il les logeait. Seul Stu reçut de la police l’autorisation de rester auprès de sa dulcinée.
RETOUR A LONDRES
Du jour au lendemain les Beatles avaient tout perdu. Leur job et leur public. Z’étaient devenus le groupe phare du port d’Hambourg, mais à Liverpool, ils n’étaient plus qu’un vague souvenir. McCartney abandonna la guitare rythmique pour remplacer Stu à la basse. Le quatuor phare des sixties prenait forme. Sur le moment cela ressemblait à un rétrécissement de leur envergure, mais dès les premiers concerts ils réalisèrent que leurs prestations faisaient la différence. Possédaient un métier que les autres n’avaient pas, et leur passage se limitant à trente minutes ils donnaient en cette misérable demi-heure toute l’énergie qu’ils dépensaient en Allemagne en quatre ou six heures presque ininterrompues chaque soirée.
COMEBACK IN HAMBURG

Mais on ne les avait pas oubliés en Allemagne. Le patron du Top Ten, Peter Eckhorn, les fit revenir, ils furent sur scène dès le 27 mars. Y retrouvèrent Tony Sheridan qui leur leur fit le plus beau des cadeaux : les prit comme groupe accompagnateur pour son prochain disque. Sorti en octobre 61, My Bonnie ne devint pas un classique du rock mais les Beatles avaient enfin tâté d’une gâterie dont ils ne se lasseraient plus : le studio. C’est en recherchant ce titre pour un client de sa boutique de disques que Brian Epstein entendit pour la première fois parler des Beatles. Ce qui tombait pile poil, puisque les Beatles étaient revenus en Angleterre depuis le mois de juillet. Désormais ils avaient un manager qui ne comptait pas que ses poulains cachetonnent à la petite semaine.

Epstein sentait le vent venir, leur fit abandonner la cuir noir pour adopter les costumes moins provoquant, la veste sans col ( une seconde intuition d’Astrid ) c'est plus cool, il y a déjà longtemps qu’ils avaient abandonné par étape successive la sacro-sainte banane du rocker pour des coupes de cheveux, plus longs, inspirées du groupe d’étudiants qui entouraient Astrid ( une véritable égérie ). Epstein les emmena, en janvier 62, à Londres pour une audition chez Decca qui y alla très mollo quant à l’intuition… et préféra signer un contrat avec Brian Pole et les Tremoloes… Lennon déclara que c’était la faute à Pete Best qui avait joué comme un pied…
STAR CLUB
Retour à Hambourg, mais pas à la case départ. Le Star Club est un nouveau rock and roll bar, mais son concepteur, Manfred Weissleder, ancien producteur de films érotiques, voit les choses en grand, des groupes oui, mais de qualité, et ayant déjà un certain renom. Pour le gala d’ouverture du 13 avril les Beatles sont sur l’affiche, et de grands noms leur succèderont, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, et Gene Vincent… Les Beatles côtoieront le Screamin' Kid durant leur séjour en avril-mai au Club. Il est dommage que l’on n’ait pas jugé bon d’inclure dans le livre les célèbres photos de nos quatre héros aux sourires admiratifs devant l’idole noire, à la patte folle, et l’autre pied, le fameux flyin' foot, sur le sentier d’une folie existentielle qu’ils ne comprendront jamais... Epstein laisse ses poulains au Star Club, mais pas en rade. Prépare le grand départ, et pendant que les quatre forçats font vibrer le public du Club, il peaufine un contrat chez EMI.
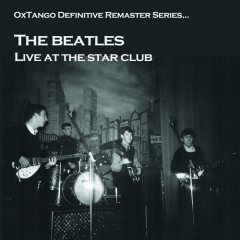
En juin Pete Best ne se montre guère meilleur que lors des enregistrements avec Tony Sheridan... dont Ringo Starr vient de lâcher la formation. Le 16 août 1962, Pete est renvoyé par Epstein… En octobre 1962, sort Love Me Do, la suite est connue… mais il leur reste quelques gigs à effectuer au Star Club dont ils s’acquitteront du 17 au 31 décembre 62.
C’est peut-être la dernière fois que les Beatles s’écouteront jouer sur scène. De retour en Angleterre, l’ère de la Beatlemania débute, les cris des filles sont si forts que l’on n’entend plus la musique. Trois ans plus tard les Beatles abandonneront les concerts devant l’impossibilité de pouvoir donner des prestations qui ne soient pas recouvertes par les hurlements des fans… Mais peut-être les deux mille heures de sets donnés en Allemagne les avaient-elles amplement dégoûtés du live …
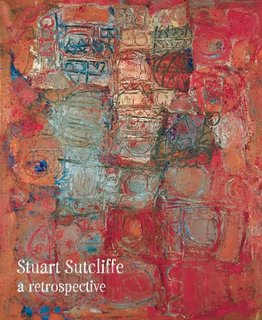
Une dernière pensée pour Stu Sutcliffe qui meurt brutalement à la suite de violentes migraines, l’avant- veille du retour des Scarabées en Allemagne au mois d’avril 62. Se destinait à la peinture, mais la route s’arrêta là, pour lui. L’on retrouve Klaus Woorman, ami d’Astrid, à l'oeuvre sur la pochette de Revolver et sur le trente-trois tours Rock’n’roll de John Lennon paru en 1975 sur lequel il joue de la basse. Mais ceci est une autre histoire.

Que vous aimiez ou non les Beatles, ce livre de Spencer Leigh est un chaînon indispensable pour la compréhension de la gestation du rock anglais.
Damie Chad.
TAMBOUR BATTANT
MOUSTACHE
( Julliard / 1975 )
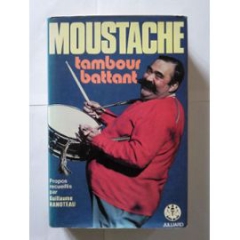
Faites comme moi, ne désespérez jamais de l’humanité, c‘est mon bouquiniste qui me voyant hésiter me l’a offert. Ne l’achetez pas, il n’en vaut pas la peine. Moustache n’est pas un rocker, son nom se rattache à l’histoire du jazz français. L’est tout un mouvement dans le rock français d’aujourd’hui qui prétend que la première génération du rock national fut celle qui précéda dans les années cinquante la déferlante Johnny Hallyday et la pléiade de groupes qui suivirent. Je ne partage guère ce sentiment. Avant d’être une musique, le rock est un état d’esprit, et dans les années cinquante en notre douce France, l’humeur de la jeunesse regroupée autour de Boris Vian, n’était pas à la révolte. Certes l’on voulait vivre à pleines dents et s’amuser, mais tout cela resta englué dans un vieux fond national très gaulois. Gaudriole et blagues de potaches pour les moins finauds, contrepèterie et humour vache noire pour les intellos. Rien de bien méchant. L’envie de choquer le bourgeois, de s’élever contre les institutions, mais pas de mordre pour faire mal. Moustache est l’exemple parfait de cette époque. N'y a qu'à écouter sa version chantée en français de St James Infirmary pour comprendre que le rire gras masque parfois une incompréhension profonde des phénomènes sur lesquels on surfe et n'est pas nécessairement le signe d'une intelligence supérieure et décalée qui ne se laisse pas mener par le bout du nez...
Un égo aussi gros que la paire de moustache et bedaine qu’il arborera très vite. Fils de grecs émigrés en France après la grande catastrophe. C’est ainsi que les Hellènes surnomment l’annexion de l’antique Ionie par les Turcs en 1927. Décide très vite de ne pas se confire dans la nostalgie d’un passé révolu et le christianisme puritain de ses parents. Premier à l’école et en conneries en tous genres. Jamais méchant, toujours rigolo. Genre farce et attrapes à tous les étages. Une prédisposition qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie, même s’il est encore loin de la cinquantaine lorsque Guillaume Hanoteau recueille ses propos.
Passe sans encombre la période de l’Occupation, à la Libération il n’a pas encore seize ans quand il s'aventure à fréquenter les boîtes de Saint Germain qui recommencent à ouvrir et à s’ouvrir au jazz. S’entraîne chez lui sur le marbre de la cheminée de sa chambre à marquer le rythme avec ses baguettes… Rencontres décisives, concert de Glenn Miller à l’Olympia, et de l’orchestre du Hot Club de France, le premier groupe de jazz de qualité d’avant-guerre avec Alex Combelle, Robert Mavounzy, André Hékian, Jerry Mengo et Loulou Gasté ( qui accueillera Elvis à Paris durant son service militaire )… C’est dans la cave du Lorientais qu’il entend pour la première fois Claude Luter et son orchestre dont il devient fan… Jusqu’au jour où l’inévitable se produit, le batteur absent il est sommé par ses camarades de le remplacer au pied levé…
Claude Luter est un puriste, revient au jazz New Orleans du début, refusant l’emploi de la charley puisque celle-ci n’est apparue qu’après l’invention du jazz, est obligé de se servir du glock, rudimentaire instrument qui permet de marquer le rythme… Moustache connaît une jeunesse de gai-luron, jazz, tabac, alcools, bonne bouffe, filles. N’est pas touché par la morosité des existentialistes. Tape une fois le bœuf avec Armstrong de passage à Paris qui s’en vient dire bonjour aux amateurs de jazz, mais le plus beau reste encore à venir, Sidney Bechett qui s’incorpore à l’orchestre et qui en devient l’âme et le patron officieux. Portrait d'un vieux nègre naïf et roublard qui ne plaisante jamais dès qu’il s’agit de musique.
Nous n’avons même pas parcouru cent pages que c’est la fin. L’en reste trois cents, Moustache possède son propre orchestre, fait sa saison de fêtes sur la côte d’azur avec Eddie Barclay et toute la faune de la gentry. Mais Moustache ne parle plus de musique. De blagues et de filles ( pour ne pas dire de cul )… Commence une carrière au cinéma, se marie fait des enfants, tient un restaurant, connaît du beau monde, devient un élément incontournable des noceurs franchouillards… A part huit lignes sur Mac Kak qu’il aura embauché dans son orchestre dont il décrit beaucoup plus l’humour froid et corrosif que ses exploits à la batterie, plus rien.
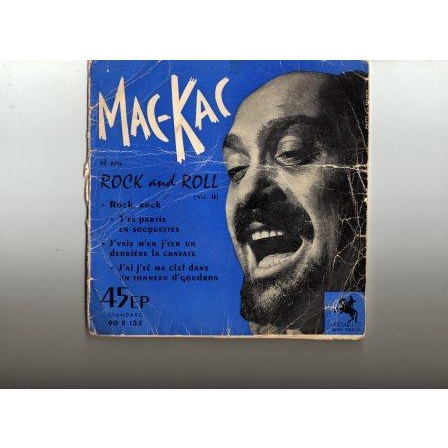
Question musique proclame son attachement à l’amour de sa jeunesse, s’écarte des condamnations théoriques du Be Bop par Hughes Panassié, ne crache pas sur le rhythm and blues et le rock and roll qu’il qualifie de musique simpliste, mais sans animosité. Si vous prenez votre pied avec et que vous réussissez à emballer les filles dessus, ne vous en voudra pas. Son grand succès fut d’ailleurs un morceau qu’il tient pour le premier rock français J’ai Jeté ma Clef dans un Tonneau de Goudron. Tout un programme. En écrivit quelques autres en collaboration avec Sacha Distel. Ne le dit pas mais le sous-entend fortement, mais enregistrée en 1958 - et déjà en 1956 par Mac Kak, qui du coup en devient le précurseur – c'est sa clef goudronnée qui aurait ouvert les portes du rock and roll français, quelques mois avant les pitreries du 45 tours d’Henry Cording Salvador, Boris Vian et Michel Legrand publiées en juillet 1956. Et puis revint à ses amours jazz.
Pour la petite histoire Mac Kak joua avec Lester Young le frère d'âme de Billie Holiday, ce qui du coup nous ramène au blues.
Damie Chad.
MUMIA ABU-JAMAL
EN DIRECT DU COULOIR DE LA MORT
( la découverte / 1999 )
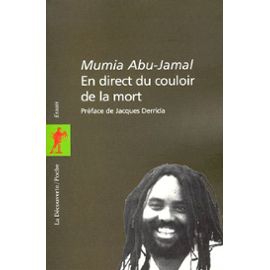
Un vieux bouquin. Toujours d'actualité. Mumia Abu-Jamal est encore en prison. Depuis maintenant trente cinq ans. Un bon bout de vie gommé pour l'éternité. Ce n'est pas le plus triste. Un individu de plus ou de moins sur cette terre, nous n'allons pas en faire une maladie. En plus, il n'est pas tout-à-fait comme nous. Un noir. Aux Etats-Unis, c'est mal vu. Surtout en Pensylvanie. Mais heureusement la police veille. La justice aussi. En plus les preuves sont indubitables. On l'a retrouvé inconscient, une balle dans la poitrine à côté d'un policier assassiné. Pas la peine de faire une analyse balistique de l'arme de Mumia, il est évident qu'il a tué le pauvre fonctionnaire qui venait d'arrêter la voiture de son frère. Quand il a commencé à se défendre, il a osé ne pas être d'accord avec le juge et le procureur. Donc on lui a interdit de parler. Et l'on a commis un avocat d'office qui ne ne connaissait pas le dossier. En plus pour qu'il puisse prouver son innocence, l'Etat lui avait octroyé une aide financière de 150 dollars. Certes le juge était impartial, même s'il était raciste. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer les nègres, l'Amérique est une terre de liberté de pensée.
Bref l'a été rondement condamné à mort. Ne criez pas à l'injustice. D'abord la justice américaine vous permet de faire appel sur appel. Cela peut durer très longtemps. Quinze, vingt ans. En attendant, l'on s'occupe de vous, l'on vous fourre dans la section spéciale des condamnés en attente de confirmation de leur sentence mortuaire. Ensuite ce Mumia Abu-Jamal, ce n'était pas un inconnu. Y avait longtemps que la police l'avait remarqué. Première manifestation à quatorze ans. L'avait fallu le calmer à coups de pieds dans la figure. La leçon n'a pas suffit. L'est devenu un adepte des Black Panthers. Quand les Panthères ont été déstabilisées et cassées par l'action du FBI, s'est entiché du Move, mouvement écologiste d'extrême gauche, est devenu journaliste, d'abord dans un journal, puis sur une radio. Dans les deux cas, un véritable fouille-merde, n'y avait pas une broutille qui tombait sur un afro-américain qu'il tendait complaisamment son micro à la soi-disant victime accablée par une injustice souveraine... On est quand même arrivé à le faire virer. C'était pour son bien. Un bon noir qui n'est pas mort ne doit pas être trop intelligent.
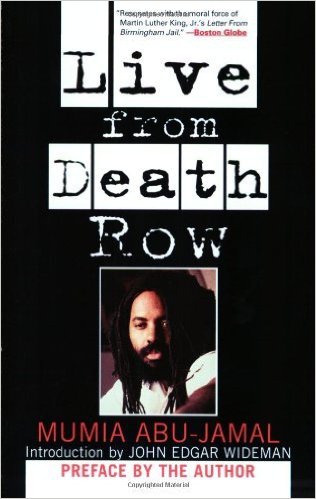
On croyait en avoir terminé avec lui. Mais non. Mumia Abu-Jamal était une voix radiophonique connue et respectée. La communauté noire s'est émue, l'a été rejointe par la race impie des intellos blancs et la mayonnaise est devenue internationale. Pétitions, lettres, sittings, manifestations en sa faveur se sont déroulés dans le monde. Création de comités de soutien dans beaucoup de pays... Depuis 2002, il n'est plus condamné à mort, mais la justice refuse toujours une révision de son procès, la lutte continue, pouvez aller sur le site de son comité de soutien pour vous informer et apporter votre aide...
Bon mais tout cela, c'est de la gnognotte. Un innocent noir en prison, c'est triste, mais ce n'est pas la peine d'en faire un fromage blanc. C'est la faute à pas de chance. Un pauvre gars qui s'est trouvé là où il ne fallait pas être au moment inadéquat et qui est tombé sur le mauvais juge. Un malheureux concours de circonstances. D'ailleurs c'est un peu ce que pense Mumia. Pas tout à fait comme je viens de le dire. Dès que la pression internationale s'est accrue et qu'il a eu droit à un stylo et à quelques feuilles de papier, il s'est mis à raconter son histoire. Enfin presque. Disons qu'il a rédigé En direct du couloir de la mort.
Avec un titre comme cela, l'on pouvait s'attendre au pire, aux pleurnicheries, aux apitoiements sans dignité, à une sempiternelle plainte infinie, sniff, sniff, agitez vos mouchoirs, au secours, aidez-moi de me sortir de ce trou à rats...
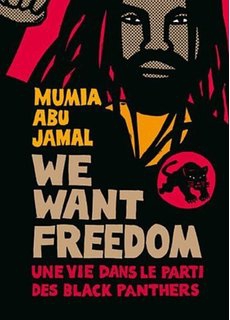
Mumia Abu-Jamial ne mange pas le pain de la déréliction. L'est un guerrier. Les coups, les souffrances, il les encaisse. Les garde pour lui. Son sort personnel ne l'intéresse que parce qu'il lui a octroyé une position privilégiée : celle du témoin qui parle de l'intérieur. Pas de place pour le sentimentalisme. N'écrit pas un roman. Réfléchit, analyse, déduit, les cas particuliers ne sont utiles que parce qu'ils permettent d'illustrer un raisonnement. Les chapitres sont courts, quelques pages, l'efficacité américaine. En plus enfermé vingt-deux heures sur vingt-quatre dans une cellule de huit mètres carrés, ça n'enrichit pas l'imagination...
Mumia Abu-Jamal démonte l'horreur pénitentiaire américaine. Une justice de classe. Qui enferme avant tout les pauvres et surtout les pauvres à la peau sombre. La prison comme traitement radical de la misère. Bien sûr que maintenir un individu en prison coûte cher. Mais vous oubliez que des milliers de juges, d'avocats, de fonctionnaires et de policiers se nourrissent directement sur la bête. Deux millions de prisonniers sur le territoire américain. L'Etat mais aussi le privé. Ce dernier n'agissant aucunement pour des raisons philanthropiques. Uniquement pour faire des bénéfices.
Supprimez les prisonniers et c'est le chômage pour des centaines de milliers de fonctionnaires. Abu-Jamal n'est pas tombé de la dernière pluie. Bien sûr que tous les détenus ne sont pas des anges. Ont commis crimes, meurtres, viols et autres atrocités. Mais une fois qu'ils sont pris dans la nasse, ils subissent des sévices qui sont aussi criminels que les actes qui les ont envoyés en prison. Passages à tabac, tortures, empoisonnements, exactions, vols, toujours impunis, toujours recommencés. Systématiquement couverts par les juges.
Mais cela n'est rien comparé à la déshumanisation systématique des individus, solitude, peu de contacts avec la famille et aucun attouchement physique ( excepté pour les tabassages ) avec tout autre prisonnier, avocats, parenté, impossible d'embrasser votre enfant... peu d'échappatoires hormis la télévision, le suicide, l'abrutissement médicamenteux, et la folie... Faut être un guerrier comme Abu-Jamal pour rester debout et refuser de se taire.
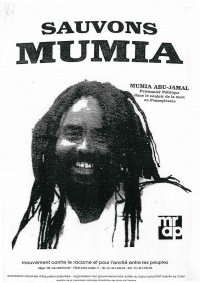
Les amateurs de blues ont toujours l'exemple de Parchman à la bouche. Le boulot était dur, la discipline sans pitié, mais ce n'était pas pire qu'aujourd'hui... Partout les mêmes causes produisent les mêmes effets. En Europe, en France se développe aussi une industrialisation de la prison. Sous prétexte de sécuriser les honnêtes citoyens l'on parque en prison les plus démunis et les couches inférieures de la popylation... Un carcan policier fachisant étend ses tentacules dans les sociétés dites démocratiques.
Du fond de sa cellule, à plusieurs milliers de kilomètres de sa prison, Mumia Abu-Jamal est beaucoup plus lucide que la plupart de nos contemporains, et vraisemblablement beaucoup plus libre dans sa tête que le troupeau lobotomisé de nos concitoyens qui se laissent manipuler avec la ferveur stupide du boeuf qui court vers l'abattoir. Encore que je n'ai jamais vu une vache folle de joie à l'idée de finir en steak haché. Alors que nombreux sont ceux qui se précipitent avec une fière componction républicaine dans les isoloirs pour élire les responsables de leur malheur...
Un livre noir. Un livre blues. A lire pour ne plus vivre idiot. Hyper rock and roll.
Damie Chad.
08:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bloodshot bill, hambourg beatles, moustache, mumia abu-jamal






