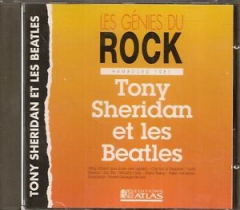25/01/2017
KR'TNT ! ¤ 313 : IGGY POP / WHEEL CAPS / GENE VINCENT / JOHN KING
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 313
A ROCKLIT PRODUCTION
26 / 01 / 2017
|
IGGY POP / WHEEL CAPS / GENE VINCENT / JOHN KING |
Pop art
Iggy Pop fait partie des rares rock stars capables de rendre une interview fascinante. Il partage ce privilège avec Keith Richards, Lemmy et John Lydon. Remontez aussi loin que vous le pourrez dans l’historique interviewal de ces quatre personnages et vous constaterez à quel point ils ont toujours su sonner juste. Iggy vient de donner à Gary Graff l’une de ces interviews dont il a le secret, et c’est tellement intense qu’on croit entendre filtrer le croon de sa voix. Dès que ce mec s’exprime, on sent le souffle de son intelligence. Comme ceux des trois autres cocos, ses interviews ne supportent pas le charcutage de la traduction. La parole d’un mec comme Iggy Pop est essentiellement une musique qu’il est impossible de corseter pour la restituer dans une autre langue. Par exemple, Iggy explique qu’il ne veut plus faire ce qu’on lui a demandé de faire lors de la dernière tournée : «Not something that’s going to put me in a room at the Apple store with a twenty-person camera crew and a fitted suit.» (Il ne veut plus jouer dans un Apple store en costard devant des caméras). C’est justement sa façon de dire les choses qui swingue. Il parle comme s’il improvisait les paroles d’une chanson. C’est exactement le même débit.

Et comme tous les gens de sa génération, Iggy se heurte désormais au problème de l’âge. Au printemps, il fêtera ses 70 ans. (Pour l’anecdote : dans le même numéro de Classic Rock, Chris Spedding annonce la reformation des Sharks. Il a 72 ans et il sait très bien que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps). Iggy estime qu’il lui faudra cinq ans pour finir son prochain album et il aura alors - what the hell what the hell - 75 ans. Il ajoute que d’ici là, il est fort possible que les albums aient disparu. C’est en tous les cas ce qui se profile à l’horizon.
Il est rentré épuisé de cette tournée Post Pop Depression - Yeah it was a toughter schedule than I’ve worked for many years. I thought I was gonna die - Iggy a cru qu’il allait y laisser sa peau. Désormais, il veut rester tranquille chez lui. Il envisage toutefois de travailler avec Don Was et un guitariste local du nom de Dr Lonnie Smith. Don lui dit «Let’s do a record with Lonnie Smith !», et Iggy lui répond : Okay if I don’t have to leave home ! So yeah, something like that.
Bien évidemment, la plus grosse partie de l’interview concerne cette fameuse tournée, et Iggy se montre généreux envers les gens qui l’accompagnaient. Il a sans doute fermé les yeux sur le côté atrocement frimeur de cette opération. Josh Homme et les autres se sont payés une sorte de crédibilité stoogy à bon compte, une faute de goût que n’auraient jamais pu commettre des gens comme David Bowie ou Alan Vega. Les photos de presse sont horriblement m’as-tu-vu et le film montre ces mecs en train de danser comme des coiffeurs sur «Lust For Life». What the hell what the hell, on est loin de Ron Asheton. On est loin de ce qui se passe à l’intérieur de la pochette de Fun House. Il n’est pas surprenant que ce dernier disque soit catastrophique. Pourtant Iggy se dit fier de cet album, même s’il a dû surmonter des différences - I’m East Coast and they’re West Coast - Il dit aussi que Josh est deux fois plus gros que lui, en corpulence, et qu’il a des tendances - He likes going arty but he’s a rock boy - (Dans la bouche d’Iggy, le mot arty peut avoir une consonance moqueuse, du genre il pète plus haut que son cul, mais au fond, c’est un rocker). Comme tous ces mecs sont principalement des surdoués, Iggy n’en finit plus de répéter qu’il a dû se mettre à leur niveau. Il raconte que le batteur Matt Helders (Artic Monkeys) chante mieux que lui et que Dean Fertita est un multi-instrumentiste mille fois meilleur que lui. Et là, on commence à se demander s’il n’est pas en train de se foutre de leur gueule. Ah il revient aussi sur l’idée des costards qui sortait du puissant cerveau de Josh Homme : comme on le voit dans le film du concert de l’Albert Hall, ils portent des jolis costards gris de businessmen. Iggy n’était pas chaud - Now I’m not the kind of guy who’s gonna fly coast to coast to meet a fashion designer. And I did - Voilà donc Iggy déguisé et il ajoute, avec un humour vengeur - So it was properly lit, proprely played, properly sung. I managed to do most of the show on key - Tout était parfait, bien éclairé, bien interprété et bien chanté, et je me suis arrangé pour essayer de chanter juste.
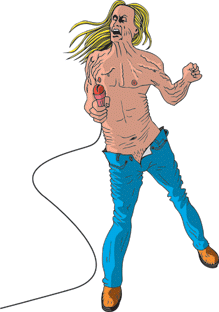
Bien sûr, si on lit entre les lignes, Iggy cède à son goût pour la dérision, ce qui peut sembler logique quand on sort d’un groupe comme les Stooges. Son cœur est ailleurs. Ron et Scott, c’est tout de même d’un autre niveau. Il évoque cette fin de parcours tragique - I wanted to finish up doing the job for the Stooges. And after Ron passed away, that involved resurrecting the second, Mark Two of the group with James - Ron casse sa pipe, alors il faut bien passer au Mark Two des Stooges avec James. Et paf, Scott tombe malade en pleine tournée. Iggy comprend ce que ça veut dire - There was no reason to go on once Scott passed away. So that was done - Une fois Scott mort, ça n’avait plus aucun sens de continuer. Heureusement, Iggy avait eu l’idée géniale de passer un coup de fil à son pote Jim Jarmush pour lui demander de faire un film sur les Stooges. C’était la dernière chose qu’il pouvait encore faire.
Après les Stooges, Iggy a su continuer de fasciner ses fans. On lui pardonnait plus facilement les mauvais albums qu’aux autres, peut-être parce qu’on se sentait incroyablement proche de lui. Cette relation relevait de l’affection. Exactement pareil qu’avec Gainsbarre. Si on buvait des grands verres de Ricard sans eau et qu’on fumait des Gitanes, c’était bien sûr en hommage à Gainsbarre. On cultivait alors un art de vivre et l’ivresse se voulait poétique. Sa disparition fut un tel choc émotionnel qu’on tremble à l’idée qu’Iggy disparaisse un jour. Impossible d’imaginer la vie sans Iggy Stooge.
Iggy Stooge ? L’homme qui a su réinventer le rock du XXe siècle.
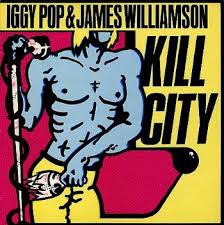
Après le naufrage des Stooges, Iggy traîne toujours avec Williamson. On ne l’aime pas, celui-là, mais il faut faire avec. Cette vipère de Williamson avait quand même réussi à virer les frères Asheton, c’est-à-dire l’âme des Stooges. On s’est retrouvés en 1977 avec un album Bomp qui sonnait comme une gueule de bois. Plus on l’écoutait et plus on se grattait la tête. Kill City essayait de nous réconcilier avec la légende des Stooges, mais on avait dans les pattes un album de pop. Oui, Pop faisait de la pop et ça interloquait le kéké. Des copains amputés du cerveau trouvaient ça bien. Dans «Beyond The Law», Iggy cherchait quand même à renouer avec la fusion de Fun House. Il faisait entrer un sax monté en haleine, mais le balladif dominait toute l’A et ça semblait parfaitement inconvenant. En B, il tapait dans le boogie rock des seventies avec «Consolation Prize». Il fallait attendre «Lucky Monkeys» pour trouver un peu de viande, et ce retour au punch, on le devait à Hunt & Tony Sales, l’une des meilleures sections rythmiques de tous les temps, et que Bowie allait d’ailleurs récupérer pour sa Tin Machine. Iggy semblait remonté en selle pour renouer avec la stoogy motion. Hey ! Il fallait voir comme ça prenait tournure !
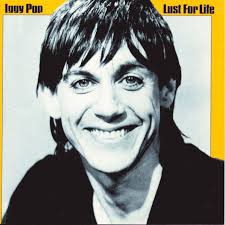
Débute alors la collaboration avec Bowie, et ça donne deux albums magiques : Lust For Life et The Idiot, parus en 1977 - Here comes Johnny Yen again/ With the liquor and drugs - C’est ainsi que démarre le fastueux Lust qui donne son titre à l’album. C’est tout simplement le vieil hymne des années noires de débauche et de désespoir - Well I’m just a modern guy - On en frissonne encore et on s’étonne même d’être toujours en vie. Ça et «Born To Lose» des Heartbreakers, c’était du poison à l’état le plus pur. Et bien sûr, on retrouvait Hunt et Tony Sales derrière. Iggy revenait aux Stooges avec son «Sixteen» - Sweet sixteen in leather boots - On connaissait toutes ces paroles par cœur, comme du temps de Let’s go down in my favorite place et de All across the USA, pas de problème. Toute la violence des Stooges coulait dans les veines de Sweet Sixteen. Et la fête continuait avec «Some Weird Sin». Quel héros ce fut, à l’époque. Son cooptage avec Bowie lui allait à merveille. Il finissait sa face avec «Tonight», du pur Bowie. Iggy faisait du mimétisme et on avait un fabuleux solo de Carlos Alomar. Et en B, on tombait sur ce coup de génie appelé «Success», l’extravagante démonstration de force d’un chanteur hors normes et hors du temps. Bowie chantait en backing. Quel délire ! - Here comes success over my hill/ Here comes my face/ It’s plain bizarre - Indépassable et décadent, drôle et puissant. Dans «Neighborhood Treat», Iggy chante aussi comme un dieu, c’est dingue ! Quelle extraordinaire ampleur ! Il finit avec le fabuleux stomp des frères Sales dans «Fall In Love With Me». C’est drivé au beat salace. Iggy chante à l’Iggy, la voix pleine d’animalité.
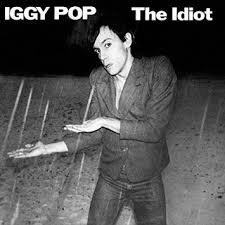
The Idiot ne vaut pas Lust, loin de là. Le son du Bowie post-glam y est beaucoup trop présent. Et ce dès le groove urbain de «Nightclubbing», vraiment crépusculaire, ou encore «Funtime», groove gothique typique de l’ambiance ultra-pourrie des années 80. On reste dans les ambiances chargées comme des mules avec «Baby». La patte de Bowie prédomine, mais on se régale du chant d’Iggy. Sa justesse de ton s’impose, même dans l’improbabilité de la menace et le glauquissime des ambiances louches. Pas plus Bowie que ce «China Girl». On sent l’imparable hit-maker, le fameux développeur d’espaces pop. C’est le hit parfait, et en plus, il est porté par ce chanteur hors du temps et hors des modes qu’est Iggy - My little China girl says/ Oh Jimmy just you/ Shut your mouth/ She says ssshhh - Et voilà qu’en B apparaissant les fameux «Dum Dum Boys», un groove traînard souligné à la wha-wha, avec encore une fois des lyrics de rêve - The first time I saw/ The dum dum boys/ I was fascinated/ They just stood in front/ At the old drug store.

On retrouve notre crooner préféré dans New Values qui sort deux ans plus tard. Le morceau titre est encore un hit d’Iggy, dotée d’une vraie tension. Il retape dans le concept de la modernité - I’m looking for new values but nothing comes my way - C’est d’une classe affolante, et c’est le hit de l’année 79. C’est joliment joué sous le manteau, avec un brin de clap-hands et une guitare qui se fait discrète. Avec «I’m Bored», Iggy revient à sa chère décadence. C’est un hymne à l’ennui - I’m sick/ I bore myself to sleep at night - Et il se prétend le chairman of the bored, malicieux clin d’œil. De l’autre côté se trouve l’édifiant «Five Foot One» monté sur le riff de New Values. C’est la même chose, mais avec du What the hell what the hell en plus - I wish life could be/ Sweddish magazine ! - On retrouve une troisième fois le riff de New Values dans «Billy Is A Runaway», mais ce n’est pas grave, car Slim Harpo et Elmore James faisaient la même chose, dès qu’ils tenaient un hit.
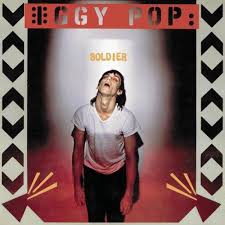
Pour Soldier, Iggy rassemble une drôle d’équipe. Glen Matlock joue et compose. Avec «Take Care Of Me», ils essayent de renouer avec la classe de «Success», mais ce n’est pas aussi réussi, loin de là. Alors ils sortent le gros son américain pour «Get Up And Get Out», avec un bel horizon urbain, une voix de veau au timbre argentin et du sax qui rôde dans les parages. Nouvelle tentative de «Success» avec «I’m A Conservative» et on retrouve tout l’humour d’Iggy. Il faut en effet se souvenir qu’Iggy est avant tout un mec infiniment drôle, il faut l’entendre marteler ses conneries - I like my beer I like my bread/ I love my girl I love my bread - Et en B, on tombe sur un coup de génie signé Iggy Pop : «Dog Food». Rien qu’avec ça, on est comblé, ce n’est même pas la peine d’écouter les autres titres de l’album - Dog food is good for you/ It makes you strong and clever too - C’est un pur chef d’œuvre de garage décadent.

Party est un pauvre album des années quatre-vingt. Ivan Kral joue sur cet album et dans le cut d’ouverture, «Please Be», on a un joli son de basse élastique. C’est très cuivré et la fin de couplet sonne comme celle de «Pretty Vacant». Il faut attendre «Houston Is Hot Tonight» pour trouver un peu de viande et retrouver l’allant d’Iggy, ce vieux jerkeur de beat. C’est encore pire de l’autre côté. On ne retient de cet album que la photo au dos de la pochette : Iggy plonge son regard candide dans le nôtre et on comprend soudain pourquoi toutes les filles à l’époque tombaient amoureuses de lui.
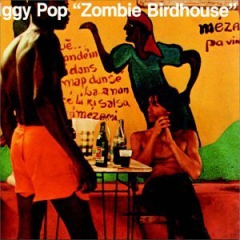
Pour la pochette de Zombie Birdhouse, il est assis dans une rue à Haïti. Comme il fait chaud, il est torse nu. Il boit un coca. Sur cet album, Clem Burke bat le beurre et Chris Stein joue de la basse. Avec «Run Like A Villain», Iggy s’en tire avec les honneurs. Tout est joué dans des ambiances de grooves bizarres, et à l’époque, ça nous semblait insupportable. «Life In Work» est un peu thibétain dans l’esprit. Iggy cherche une voie nouvelle, mais c’est douloureux. Il aimerait bien que ça ne soit qu’un jeu. De l’autre côté on tombe sur «Eat Or Be Eaten» - Eh miam miam - qui est sûrement le hit de l’album. On se réveille avec «Bulldozer». Iggy chante ça à l’interjectif en bon iguane qui se respecte, c’est-à-dire qui se laisse rôtir au soleil de Satan. Iggy sait exprimer la barbarie, pas de doute.

Malgré une très belle pochette, Blah-Blah-Blah est l’archétype de l’album raté. Iggy y fait du rock FM. Son «Real Wild Child» subit les ravages de l’époque. Cette production aseptisée est insupportable. On sent qu’Iggy est mal dans ses godasses. Il y a même un rock synthé atroce qui s’appelle «Fire Girl». En B, il essaye de retrouver l’éclat de «Lust For Life» avec le morceau titre, sur fond de bon beat tribal. Si on conserve l’album, c’est uniquement pour la pochette. Notre héros, comme dirait Houellebecque, y pose en playboy.

Après avoir fricoté avec Glen Matlock pour le résultat que l’on sait, Iggy fricote en 1988 avec un autre Pistol, Steve Jones, pour l’album Instinct. Rien que pour la pochette, ça reste l’un des albums préférés des fans d’Iggy. Il renoue avec son look stoogien et c’est l’époque d’un concert dément à l’Olympia, où il était accompagné par un trio de hardeux. Steve Jones cocote bien le «Cold Metal» d’intro. Il joue comme le métronome que l’on sait. Alors attention, les hits se nichent en B, à commencer par «Lowdown» qu’Iggy prend au baryton. Quel crooner fantastique ! Steve Jones joue ensuite le morceau titre à la grosse cocote, sur un vieux beat. Il sait qu’il se retrouve dans les meilleures conditions, puisqu’il accompagne un chanteur exceptionnel, comme au temps de Johnny Rotten. S’ensuit un fantastique «Tuff Baby» - I love you tuff baby - La veinarde ! C’est joué au gros riff de Jonesy. Il enrobe bien le chant avec son phrasé gras. Quel hit faramineux ! Il faut toujours faire confiance à Iggy. Retour de la vieille cocote de Jonesy dans «Squarehead» - But I ain’t gonna be no square head - Tu peux faire tout ce que tu veux baby, mais tu ne feras jamais de moi un beauf.

L’album Brick By Brick doit sa force à la pochette dessinée par Charles Burns. On ne peut pas dire que cet album soit bon, car il contient trop de déchets. C’est aussi l’époque où Iggy a de mauvaises fréquentations : les mecs de Guns n’Roses. Mais il sauve son disque grâce à trois pures énormités, à commencer par le fantastique «Butt Town». Iggy retrouve ses marques de rocker sur ce morceau ultra-joué. Eh oui, les malheureux Slash et McKagan se prennent pour les Stooges ! L’autre hit du disque c’est «Neon Forest», belle pièce d’awite et comme la plupart des compo d’Iggy, très autobiographique - It’s a miracle I haven’t fallen through any cracks - À la fois énorme et poppy - The life on display is trouble for sure/ The drugs that I took have made me insecure/ You can get a weird prize for being adored/ You can join the in crowd for being a whore/ Althrough you are lonely you wish for a fence - Fantastique intelligence ! Goddamned I wanted out ! - Le troisième gros cut de l’album s’appelle «Pussy Power», joué à l’épaisseur d’«Instinct», sauf que ce sont les clowns qui jouent, pas Steve Jones.

Par contre, American Caesar fait partie des meilleurs albums d’Iggy. Dès «Wild America», on plonge dans la bonne vieille fournaise d’Eric l’imprononçable, le guitariste qui accompagne Iggy à l’époque - One night out in LA/ I met a Mexicana - On se goinfre de ce genre de cut car Iggy y distille l’essence même du rock américain. Il finit ce classique en beauté. N’oublions pas qu’Iggy est l’un des grands finisseurs de cuts devant l’éternel. On retrouve ce diable d’Eric l’imprononçable dans «Plastic & Concrete». Il se balade dans tout le morceau avec un son bien gluant, puis avec «Fucking Alone», on retrouve l’immense Iggy crooner du désespoir. Il croone de plus belle sur «Highway Song». «Sickness» fait aussi partie des hits du disk, car c’est une véritable plongée dans le son et puis voilà le mirifique «Boogie Boy», chanté real wild, charbonné à la guitare, Iggy redevient le rocker définitif. Mais attention, car deux autres monstruosités suivent, à commencer par une version ultimate de «Louie Louie» - And now the news - Ça riffe et ça pianote et voilà que surgit soudain l’authentique horreur riffique - Oh oh baby - C’est la meilleure version de tous les temps - We’re gonna go now - La vraie racine du garage. Et puis voilà «Caesar», amené par des accords véreux - People of America - Iggy fait l’empereur avec une troublante véracité de ton - Throw them to the lions ! Throw them to the lions ha ha ha ha ! - Il fait jeter les Chrétiens aux lions. Tout dans ce classique néronien relève de l’intelligence supérieure.
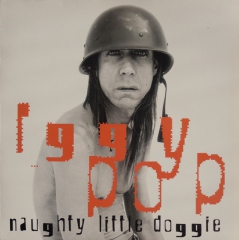
Décidément, les pochettes se suivent et ne se ressemblent pas. Celle d’American Caesar fascinait, mais celle de Naughty Little Doogie frise le ridicule. Dommage car au dos, on trouve un superbe portrait d’Iggy la clope au bec. Sur cet album, on retrouve l’équipe de chevelus qui fit merveille au fameux concert de l’Olympia - Kiss My Blood - et Eric Mesmerize qui fait des siennes dès «Pussy Walk» qu’Iggy prend au croon de la rue - The other day I was walking down 14th street/ It was a beautiful summer day - Encore du solide avec «Knucklehead», du pur Iggy de vieux renard à l’accent tranchant, psyché en diable, saturé de guitares. «Keep On Believing» est une compo foireuse, mais la fournaise est bien réelle. On assiste à une sorte de carnage sonique de groove de basse et de la wha-wha délinquante. On a le même problème avec «Heart Is Saved», une grosse machine insistante et sauvée par les grosses guitares.
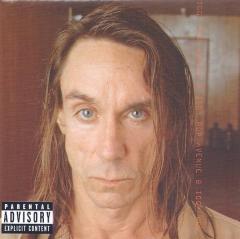
C’est Don Was qui produit Avenue B paru en 1999, avec sur la pochette un très beau portrait d’Iggy le héros. Avec le morceau titre, on retrouve le crooner considérable que l’on sait. Belle chanson aussi que ce «Miss Argentina», en tous les cas, c’est très écrit - She loves me Miss Argentina/ She loves to stay in bad/ And watch the movies play - Iggy renoue avec le génie en tapant une version ultra-violente de «Shakin’ All Over». Comme s’il ramenait la violence dans l’actualité, mais avec une puissance infernale. C’est reptilien, avec des couches d’effets. On sent bien la patte de Don Was. La surprise du disque s’appelle «Corruption». Iggy est capable d’exploser les charnières. On retrouve la folie des Stooges dans sa façon de hurler alors qu’il erre dans le tunnel qui mène à la salle des machines.
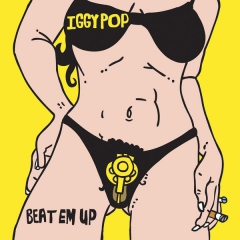
Beat Them Up arrive en 2001 avec une pochette illustrée et un peu ratée. On pourrait l’appeler l’album du son. Iggy l’attaque avec un pur blaster, «Mask». On pourrait qualifier ça de pétaudière de la patate maximale, ou même de mortelle randonnée. Encore plus stoogien que les Stooges. Tout est dans le rouge. C’est un véritable défi aux lois de la physique nucléaire. Iggy a choisi pour cet album le son pilonné d’indus barbare, comme s’il jouait avec Al Jourgensen. Ou encore le son de Killing Joke, mais en plus défenestrateur. Encore une grungerie explosive avec «Howl». Le guitariste s’appelle Whiters Kirst. Avec «Savior», on plonge dans un océan de son en fusion. Iggy adore nager dans l’acier liquide. Il a toujours eu des goûts exotiques. Ce cut est une merveilleuse élégie de la lave sonique. Iggy s’y laisse bercer. Coup de génie avec «Death Is Certain». Le solo liquide semble flotter au dessus des abîmes. C’est absolument grandiose. Iggy pousse des cris alors que la guitare couine et que rougeoient des brasiers étincelants. Pure folie ! Et tout ça va culminer avec «Ugliness» - Bruit de moteur - Ugly ! - Iggy hurle. Voilà le rock de Detroit. Il le prend comme au temps des Stooges. Iggy est le dernier grand rocker d’Amérique. Il perce toutes les lignes. Il chevauche toujours en tête. C’est un vrai chef de guerre. Il y a en lui quelque chose de purement impérial. Sa voix finit par lui échapper - They got the car the money house and all/ But ain’t got no motherfuckin’ balls - Terrifiant !

Paru en 2003, Skull Ring pourrait bien être l’un des meilleurs albums d’Iggy, car c’est une sorte de retour aux sources, c’est-à-dire aux Stooges. Le festival commence avec «Little Electric Chair». Iggy y pousse des cris de jouissance. Forcément, ce sont les frères Asheton qui l’accompagnent sur ce cut et ça claque des mains comme au bon vieux temps de «No Fun». On y retrouve cette façon unique de balancer un yeahhhh. Ron Asheton semble jouer son va-tout. On l’entend aussi partir en solo dans le morceau titre. On se croirait dans un film de Tarentino. C’est un cut frénétique, monté sur le riff ultime. Puis on retrouve les Stooges dans «Loser». Iggy dit qu’il ne peut plus continuer à vivre. Ron joue comme un démon, au gros son suspendu. Il prend un solo oblique qui entre dans le lard du cut comme dans du beurre. Par contre ce sont les Trolls qui accompagnent Iggy sur «Perverts In The Sun», une belle pièce de dementia à la Raw Power, puis sur «Whatever», une espèce de grosse pop épaisse chargée de bonnes doses de destruction massive. Iggy l’éclate aux cris d’orfraie. Il renoue avec le magistère définitif. Ce sont aussi les Trolls qui accompagnent Iggy sur «Blood On Your Cool», mais les ponts sont ratés.
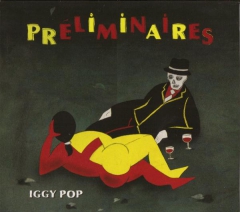
Avec Préliminaires, Iggy commence à taper dans le répertoire des grandes chansons françaises. Il sort son meilleur baryton pour «Les Feuilles Mortes», il swingue à la démesure et sort des trémolos de gras de glotte - Toâ tou m’aimey - Prévert/Kosma : imbattable. Il fait aussi du New Orleans («King Of The Dogs»), du heavy beat sacrément intense («Je Sais Que Tu Sais») et du groove urbain à la cocotte mortelle («Nice To Be Dead»). Il fait aussi du Houellebecq («A Machine For Loving») et du blues de cabane («He’s Dead She’s Alive») qu’il joue lui-même à la guitare, mais ça ne marche pas, même s’il fait son Wolf.
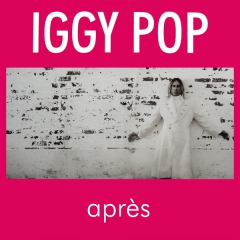
Pour l’album Après paru en 2012, Iggy revient aux chansons françaises, mais attention, il tape dans la crème de la crème. C’est le crooner qu’on entend ici. Il démarre avec le «Et Si Tu N’existais Pas» de Joe Dassin. Oui, il fait là ce qu’il sait faire de mieux : crooner. Pour chaque morceau, Iggy écrit un commentaire. Ici : «But it is still true that in life you meet special people who make it bereable to keep living.» (C’est vrai, dans la vie, il arrive qu’on rencontre des gens qui sachent donner des raisons de continuer à vivre). Bel écho à la chanson du grand Joe. Il tape ensuite dans «La Javanaise». On imagine le carnage. Iggy le prend au croon bien sourd - It is true that without love everything is fucked up but at the same time love is kind of a trick and maybe a problem - Il a une façon extrêmement élégante de nuancer les choses. Il sait que l’amour est indispensable mais que c’est aussi une source de problèmes insolubles. S’ensuit une version magique d’«Everybody’s Talkin’» et il se dit être une combinaison des deux personnages du film dont est tiré cette chanson de Fred Neil - The young stud and the old pimp - Propos incroyablement affectueux. Il profite aussi de l’occasion pour saluer Fred Neil qui vivait aussi à Miami, à deux pas de chez lui. De l’autre côté, il tape dans Brassens avec «Les Passantes», spectaculaire, et dans la magie avec «Syracuse» - The idea of finding love in the joys of the earth. So much more dependable than other people - Iggy est fasciné par la beauté de cette chanson. Il prend «Michelle» au solide groove de stand-up et boucle avec «Only The Lonely» pour rendre hommage à son chanteur préféré, Frank Sinatra. Il avoue avoir passé une grande partie de sa vie seul dans des cafés - This is a musical construction you just don’t hear right now. Ce genre de construction musicale n’existe plus, selon lui.
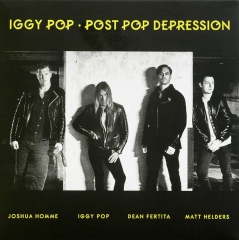
Alors justement voilà ce fameux dernier album, Post Pop Depression, amené par une campagne de presse pour le moins vulgaire. L’album est complètement raté, rempli de cuts de pop gothique qui rappellent les mauvais albums d’Iggy. Il croone, c’est vrai, mais sur des beats profondément antipathiques. «American Valhalla» sonne comme une nowhere song from nowhere land. On traite ici de la profonde inutilité des choses. De quoi disserter jusqu’à l’extinction des feux et des races. Avec «In The Lobby», le pauvre Iggy se perd dans un labyrinthe d’inutilité atroce. Le riff de «Sunday» vient tout droit de «Saturday Night Fever». En B, Iggy fait un joli portrait de vautour avec «Vulture». Ça vaut bien la Charogne de Charles Baudelaire et ça se termine en flamenco. Et puis tout à coup, voilà «Paraguay», le cut qui va sauver l’album du désastre. Iggy revient à sa chère dimension autobiographique et les choses reprennent du sens. Iggy dit qu’il va se tirer au Paraguay, parce qu’il ne peut plus supporter ce monde de dingues qu’est devenu le monde moderne - Just a bunch of people scared/ Everybody’s fucking scared/ Fear eats all the souls at one - Tout le monde a la trouille, la peur dévore toutes les âmes - I’m tired of it - Iggy en a marre de toutes ces conneries et il rêve d’un mode de vie plus simple, sans toutes ces connaissances - And I dream getting away/ To a new life where there’s not so much fucking knowledge - Il parle bien sûr de cette fucking technologie qui envahit les maisons et les vies privées - I don’t want of this information - Il ne veut plus de toutes ces informations qui ne servent à rien, qui aliènent les gens dans le monde entier. Fantastique ! On retrouve là grand Iggy de l’âge d’or.
Signé : Cazengler, Iguanodon empaillé
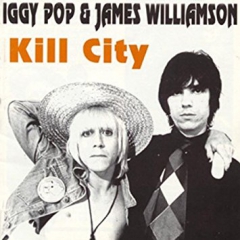
Iggy Pop & James Williamson. Kill City. Bomp! 1977
Iggy Pop. Lust For Life. RCA Victor 1977
Iggy Pop. The Idiot. RCA Victor 1977
Iggy Pop. New Values. Arista 1979
Iggy Pop. Soldier. Arista 1980
Iggy Pop. Party. Arista 1981
Iggy Pop. Zombie Birdhouse. Animal Records 1982
Iggy Pop. Blah-Blah-Blah. A&M Records 1986
Iggy Pop. Instinct. A&M Records 1988
Iggy Pop. Brick By Brick. Virgin America 1990
Iggy Pop. American Caesar. Virgin 1993
Iggy Pop. Naughty Little Doogie. Virgin 1996
Iggy Pop. Avenue B. Virgin 1999
Iggy Pop. Beat Them Up. Virgin 2001
Iggy Pop. Skull Ring. Virgin 2003
Iggy Pop. Préliminaires. Virgin 2009
Iggy Pop. Après. Le Rat Des Villes 2012
Iggy Pop. Post Pop Depression. Caroline 2013
Iggy Pop interview by Gary Graff. Classick Rock #231. January 2017
TROYES / 21 – 01 - 2017
LE 3 B
WHEEL CAPS
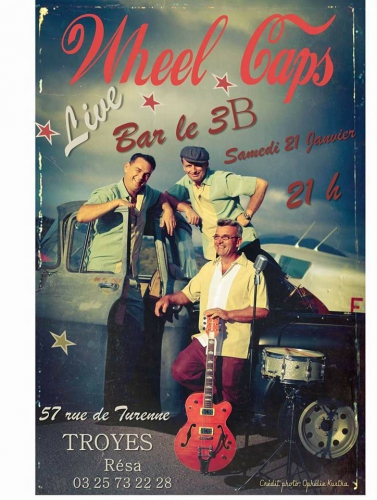
A demain qu'elle a dit Béatrice la patronne. A croire qu'à Troyes les gens se promènent en maillot de bain dans les rues ! Ici à Provins les ours polaires batifolent dans le jardin. J'hésite, mais la teuf-teuf-mobile a des étalons de course dans les pneus. Bien sûr qu'on y va, maugrée-t-elle, pour une fois qu'un combo de rockabilly se pare d'un nom intelligent qui veuille dire quelque chose ! Chapeaux de Roue, ça c'est aussi beau que de la titulature romaine. Que veux-tu les Wheel Caps sont la coqueluche des parkings, il est hors de question de rater un tel événement ! Cette satanée bagnole devine mes désirs les plus profonds, et nous voici au triple galop sur les routes blanches de givre mais au demeurant adhérentes. Et puis on ne mégote pas pour quatre-vingt kilomètres quand le groupe que l'on veut entendre vient du plus profond de la Corse. N'ont pas hésité à traverser la mer eux, rien que pour nous !
Fait bon et chaud dans le 3 B. Le troquet se remplit doucement et sûrement. Des habitués qui savent que les soirées ont la réputation d'être chaudes et quelques nouvelles têtes en attente de sensations fortes. Ne seront pas déçues.
WHEEL CAPS

Trois sur scène. Mais dès les trois premières secondes, l'on n'en entend que deux. Graves, très graves. Cette voix ! Cette guitare ! Les cordes du haut. Fermez les yeux, c'est du Johnny Cash, ouvrez-les c'est François Jandolo. Pas tout seul, trimballe dans sa voix tout le hillbilly des Apallaches. Le rockab, c'est un tiers de hillpilly, en arrière-fond, prêtez l'oreille, les cordes qui meuglent, la voix aussi grasse qu'un sillon de terre glaise, c'est souterrain et souverain, ça explose dans votre tête comme une odeur de foin coupé, un amoncellement d'épis de blé gorgés de soleil, une bouffée délirante d'énergie naturelle, pas pour rien qu'ils débutent par Get A Crazy. Le rockab c'est comme ça, ou c'est tout bon dès le tout début, ou il vaut mieux ne pas en parler. Pas de doute, Jandolo maîtrise. Sûr de lui, campé sur ses deux jambes, des yeux sans cesse aux aguets sous sa banane de renard argenté, l'on pressent que nous sommes en partance pour traquer le puma carnassier des rocky mountains. J'allais oublier ce son devant, pas vraiment une réverbe mais une résonance qui vous emprisonne en ses parois de vitre blindée.

Le hillbilly c'est bien. Mais à condition d'en sortir. Car le rockab, ce n'est pas qu'un tiers de guitare qui ronronne et puis s'affole, c'est aussi un tiers de crazy drive beat. En français nous traduirons par folie déjantée heureuse. Hey Mister Tucker ! Alain Perny se charge des sorties de route du bolide. Celles qui fauchent les spectateurs sur le bas-côté mais selon une courbe si parfaite que vous ne pouvez qu'applaudir. Vous ne pouvez pas le rater, debout derrière ses fût, pas le genre de gars qui se cache à l'affut, vous ne voyez que lui, l'a mis devant lui un micro aussi haut qu'un cou de dromadaire qui hausse la tête pour apercevoir la prochaine oasis, tape debout, dans la grande tradition des frappeurs de caisse claire, pour les feulements de traviole et les reptations accablantes, vous pouvez compter sur lui, un véritable be bop cat, sourire aux lèvres et baguettes stompantes. N'a pas de Perny de conduire mais marque les stops au centième de seconde près. Très importantes dans le rockab, ces brisures de rythmes, qui permettent les doubles reprises d'accentuation positive ou les bifurcations en épingles à cheveux.

Le dernier tiers, aussi nécessaire que la balle au fusil, la fièvre, toute de retenue explosive, la rébellion à fleur de peau, c'est Thierry Daime, un dominant qui surplombe sa contrebasse de bois ciré. Un vénérable engin aussi large qu'une armoire normande, normalement d'un tel monument ne devraient sortir que de lugubres grondements, mais Thierry vous la claque si fort qu'elle aboie, rageuse et swinguante, Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Pas des mièvreries pathétiques de roquet, non des glaviots de rage de mâtin décidé à vous emporter la fesse gauche, rien que pour le plaisir de vous voir boiter.
N'ont pas encore terminé leur deuxième morceau que les Wheels Caps ont gagné la partie. Vous servent le rockab de tradition, servi de main de maître selon une recette personnelle qui ouvre l'appétit. Mais dans la vie personne n'est à l'abri des surprises. Les Caps viennent de nous jeter un Rockin' & Flyin' galvanisant lorsque comme dans la grande tradition des westerns la porte du 3 B s'ouvre brutalement et déboule une horde hurlante d'individus qui fonce droit vers la scène. Serait-ce un remake de L'Impitoyable Revanche des Desperados ? Ah ! Les salauds ! Les enfoirés ! Les traîtres ! Jurons, interjections, embrassades, grandes claques dans le dos, bisous tout doux, sont une douzaine menés par PhiL et Arno des Ghost Highway qui sont venus faire coucou-la-surprise à leurs amis les Wheel Caps !

La soirée était bien partie mais l'arrivée inopinée des Ghost aura apporté un shoot d'adrénaline fort sympathique, un surplus de bulle dans le champagne du rockab. Si vous croyez que cette tapageuse entrée a interrompu le show, que nenni, les Wheels sont le seul groupe que j'ai vu fignoler leur morceau aussi à l'aise et au point que durant une séance d'enregistrement studio et tenir à tour de rôle une conversation des plus animées avec ces double-fêtes. Ce n'est pas qu'ils sont seulement doués, cette aisance d'exécution prouve avant tout leur compréhension intuitive et instinctive du rockab qui s'apparente à une bagarre au couteau. S'agit de suivre les règles, je ne suis pas là pour planter les copains, j'interviens à point nommé dans la musique, un ballet mortel, un peu d'avance, un soupçon de retard et c'est la catastrophe, l'équilibre du château de cartes est rompu, s'agit de se retirer sur la pointe des pieds pour laisser le passage ou au contraire d'intervenir abruptement pour s'engouffrer dans l'entrée du chemin dégagé. Une chorégraphie d'instruments qui se croisent sans jamais se télescoper. Un peu comme dans toutes les musiques objecterez-vous, oui mais il y a dans le rockabilly une sauvagerie innée et une rapidité d'exécution qui exigent une maîtrise sans faille.
Et tout le long de la soirée les Wheel Caps nous feront une démonstration éblouissante de leur virtuosité. Sans jamais se prendre au sérieux. Alain et François qui s'amusent à mimer les figures attendues, je tourne autour de ma basse et j'entrecroise mes jambes dans les tiennes pour faire croire que l'on pourrait tomber. Une autre règle, ne jamais tirer la couverture à soi, je ne m'étends pas dans les solo, ne suis pas là pour briller, mais pour éclairer, je montre ce que je sais faire en douze secondes et je me dépêche de laisser toute la place aux autres. Même pas le temps de recevoir des applaudissements que nous sommes déjà engagés en une autre structure qui nécessite toute l'attention. Alain se chargera du vocal sur Whenever You're Ready, sardonique et cassant, et Thierry exalté et effondré sur All Ican Do que la salle reprend en choeur. Le chant rockab relève de la comédie. Faut savoir être authentique tout en montrant que l'on joue un rôle. Pour Stray Cat Strut, tout le monde s'y met, guitare, contrebasse, batterie et l'assistance entière, nous miaulons à qui mieux-miaou aussi fort que dans la chatterie de la SPA. Le premier set se termine sur trois pépites, I got a Baby de Gene Vincent, gros boulot sur les choeurs, Rock Therapy la grande médication des rockers de Burnette aux Stray Cats, et une Pink Cadillac renversante de Sammy Masters.

L'excitation est à son comble lorsque commence le deuxième set. Pas des chacals, les Wheels, François nous a prévenu d'emblée, il y en aura un troisième. Difficile de choisir, se fondre dans la masse ondulante des agités qui s'adonnent à une danse de saint Guy envoûtante, ou suivre le jeu des Wheels. Pour moi, ce sera les Wheels, pas du tout guindés, plaisantent, échangent avec le public, rigolent, se moquent et dans le même temps nous délivrent un rockab impeccable, pas une faille, pas une hésitation, une interdépendance magnifique, François a beau changer de guitare, garde toujours cette netteté de profilage et de découpage qui trace les contours de chaque morceau avec une terrible précision. Idem pour sa voix qui ne faiblit pas, elle délimite et dessine les plans d'une scrupuleuse netteté. Un Ice Cold a vous donner des frissons de satisfaction dans le dos, un Completey Sweet cochranesque en diable, un Long Black Train à vous jeter sous les roues de contentement. Phil est appelé à la batterie. S'en tire avec aisance le sieur Phil, attitude indolente et rythme assuré.

Ambiance de plus en plus chaude. Ne me restent plus que des flashs. Musique électrique et public branché sur cent mille volts. Ça tourbillonne de tous les côtés. Le troisième set sera démentiel. Thierry couché sur sa contrebasse, François assis sur lui, Alain qui pilonne par derrière. Un Rip It Up à rallonge qui reprend feu juste au moment où l'on croit que c'est fini, un Tennessee Rock'n'roll le vieil hymne fédérateur rockab de Bobby Helms, un Twenty Flight Rock échevelé... Thierry sommé de nous faire couler des larmes de bonheur sur All I can do is Cry... François appelle Eric et lui refile le micro. L'orchestre n'attend plus que les ordres de Duduche qui se lance dans un Whole Lotta Shaking Goin' On de derrière les fagots et de belle facture, l'enchaîne comme un pro sur deux autres titres. Applaudissements nourris. This is the end. Oh non ! Déplorables gémissements dans la salle ! L'est tard, l'on a tiré les rideaux, il ne faudrait tout de même pas exagérer. Mais Béatrice la patronne a pitié de nous, un dernier morceau oui, mais si l'on promet d'être sages après. Nous oui, on a tenu nos promesses, les Wheels Caps non, Phil est appelé en renfort sur les fûts, et Arno est condamné à s'emparer du micro et des voix lui commandent le morceau : Matchbox ! Les Wheels démarent à fond et Arno nous sort le grand numéro, nous la joue chanteur de rock and roll, la pose et le glamour, descend les couplets avec délectation et un impayable accent américain, la star magnanime laisse ses musiciens s'adjuger des ponts aussi vertigineux que le viaduc de Millau, se fige dans des postures grandiloquentes, cabot et cabochard à souhait, brûle toutes les allumettes de la boîte. Bref c'est parti pour dix minutes de pure extravagance. Photos, embrassades finales. Un concert qui se termine sur les chapeaux de roue.

Les Wheel Caps nous ont séduits. De superbes musiciens. Une énergie inépuisable et une grande générosité. De pure rockabilly men. Avec encore un truc en plus. Des artistes chaleureux certes, mais avant tout des individus dignes du grand nom d'êtres humains.

Damie Chad.
( Photo : FB : Béatrice Berlot )
HEY MISTER TUCKER / WHEEL CAPS
GET A CRAZY FEELING / HEY MISTER TUCKER / LITTLE BIT MORE / WHENEVER YOU'RE READY / THE WHORRYIN' KIND / ICE COLD / CENTIPEDE / ALL I CAN DO IS CRY / JITTERBOP BABY / MY ONE DESIRE / ROCKIN' & FLYIN' / RIDING FOREVER / PINK CADILLAC / ZOMBIE SUNDAY
François Jandolo : lead vocal & guitar / Alain Perny : drums & Backing vocals / Thierry Dayme : double bass & backing vocals.
Enregistré par Jull Gretschy
Rock Paradise Records : RPRCD 41 / 2017
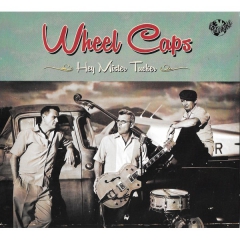
Get a Crazy Feeling : une grêlée de notes de départ qui hache les oreilles et la voix de Jandolo qui s'étend sur ce grésil avec l'indolence d'un serpent qui se chauffe au soleil, la batterie qui tamponne métronomiquement et la contrebasse qui vous offre ce léger décalé rythmique sec comme un vieux croûton de pain oublié au fond de la huche en lequel réside le secret de cette épaisseur sonique qui donne toute son ampleur à ce premier titre qui fleure bon la campagne. Hey Mister Tucker : un original, changement d'ambiance, les boys descendent en ville au volant d'une superbe Tucker 38, roulent à fond et partent en dérapages contrôlés, s'en donnent à coeur joie, l'accélérateur à fond, la voix qui chevauche la compression du moteur. Evitez de traverser la route lorsqu'ils déboulent. Little Bit More : c'est du Labeef pur boeuf, tout en finesse, le vocal qui tressaute, la guitare qui pique et repique, le bonheur de vivre et d'embrasser une fille. Vous reprendrez bien une bise et plus puisque affinités. Whenever You're Ready : Perny au vocal, les syllabes mutines qui traînent, les autres au wap doo wap, au wap doo caps, la guitare qui se paie deux petits sprints et la contrebasse de Thierry qui halète comme un athlète. The Worrying Kind : autant sur Little Bit More le chant évoquait le Temptation Baby de Vincent, ici c'est Cochran qui fournit le pattern et l'accompagnement électrique. Une réussite. Ice Cold : une démonstration de tout ce qu'il faut savoir faire si vous voulez jouer du rockabilly la voix pneumatique qui s'étire comme un chewing gum ou qui se rétracte comme un crotale et les parties fines d'entrecroisement des instruments qui se livrent à des carrousels de haute précision. Centipede : c'était trop beau sur le morceau précédent, alors ils recommencent, en oscillation entre mâchoire claquante et indolence traînante, les empilements de la batterie et le souffle de la contrebasse accentuent cette alliance des contraires, velours râpeux. All I Can Do Is Cry : le Thierry hit, vous fout de ces contreforts de contrebasse sur la rythmique à vous faire sauter le caisson, la batterie d'Alain qui monte les oeufs sur la neige du Kilimandjaro, la guitare de François qui rajoute du sucre acidulé et ce vocal à cheval entre le désespoir le plus noir et la plus fine ironie. Jitterbop Baby : du bop à en revendre, chant collectif, le lead vocal de François ne servant qu'à apporter cette respiration nécessaire au bon déroulement d'un rockab, et puis surtout ces passades d'instruments qui se répondent comme si leur vie en dépendait. My One Desire : dans la famille Burnette donnez-moi le frère Dorsey, procèdent par évaporations successives, chacun se paye la part du lion, l'on appuie et l'on lâche le morceau, le sec et le doux, le cru et le cuit, la guitare qui sonne et tout le reste qui persille en souplesse. De la belle ouvrage. Petit bijou. Rockin' & Flyin' : retour à Eddie, les racines country et l'envol rockab tout en délicatesse. La guitare qui perfore et le chant quasi collectif de cowboys autour du feu. Une petite merveille. Riding Forever : un original, cheval d'acier, roulent sans casque et à fond les gamelles, la voix qui goudronne, les intrus qui arrachent la gomme, ne respectent rien, poignée des gaz convulsive, la guitare s'envole comme l'ange de la mort. Pink Cadillac : ont fauché la tire de Sammy Masters en sont tout fiers, filochent sur le bitume et tricotent serré sur l'asphalte, si vite que François mange les mots et que la contrebasse hoquette sur les reprises mais Alain tient l'accélérateur au plancher, passent si vite que vous n'y voyez que du rose. Zombie Sunday : Diddley Beat, les zombies sont de retour et squattent votre tête douloureuse, tout s'emmêle, la guitare vous picore les méninges comme autrefois le vautour le foie de Prométhée, la rythmique bourdonne et frelonne dans vos synapses, ce qu'il y a de bien avec le rockabilly c'est que l'on adore ces suaves sauvageries.
Vous aimez le rockabilly ? ce disque est un must. Un trou béant dans votre collection. A écouter de toute urgence. Vous n'aimez pas, procurez-le vous, cela vous aidera à entrevoir le monstre en ses ébats et peut-être vous approcherez-vous de l'idée de la perfection. Merci les Wheel Caps. Chapeau, vous avez le droit de faire la roue !
Damie Chad.
THE LIFE AND TIMES
OF GENE VINCENT
56 -59
KENNETH vAN SHOOTEN
( Etit Production )

Tourné depuis une dizaine d'années, publié depuis le mois de février 2016, ce documentaire de cinquante-huit minutes fait depuis une dizaine de jours le mini-buzz chez les fans. Kenneth Van Schooten est surtout connu pour King of Punk dont il a repris les modalités pour cette présentation de Gene Vincent, un patchwork d'interviews de ceux qui furent parmi les principaux protagonistes de la saga tels les survivants bien souvent les membres issus de groupes légendaires, Ramones, Dead Boys, UK Subs...
Le film est destiné au public américain. L'épopée européenne de Gene est à peine évoquée, juste les images de Gene rentrant au pays après la mort d'Eddie Cochran... Un tel parti-pris est des plus compréhensibles. Pour le public américain, la France et l'Angleterre ne sont que des pays de seconde zone et l'Europe un vieux débris aussi respectable que votre grand-père que vous aimez bien, mais de là à passer tout votre dimanche avec lui... Ravalons notre fierté, pour les Amerloques, ce qui compte est born and made in the USA. L'est une autre raison que Johnny Meeks nous dévoile en quelques mots. Les Etats-Unis ont oublié Gene Vincent. De par chez nous il est une figure mythique mais dans les plaines du Nouveau Monde, il a disparu. Dites rock'n'roll et l'on vous cite les noms d'Elvis Presley, de Ricky Nelson, de Little Richard, et de bien d'autres, sauf de Gene Vincent. Et pourtant...
Longue séquence sur Be Bop A Lula. Normal, c'est le début, et aussi le seul déclic qui puisse faire surgir le nom de Gene dans les cervelles américaines. L'occasion de voir Joël Happel disc-jockey de WCMS la radio de Sheriff Tex Davies qui sera le manager de Gene pour un an mais qui empochera la moitié des droits du hit qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires. Une habitude solidement implantée dans les moeurs du showbizz outre-Atlantique. Ken Nelson bien sûr qui présida les séances d'enregistrement. Nous parle de la puissance des Blue Caps et de la pureté de leur son. On ne remerciera jamais assez Ken de n'avoir pas voulu interférer et ramener sa fraise dans le clafoutis, l'a apporté la maîtrise de la technique mais a laissé s'exprimer la créativité du groupe sans chercher à l'amender.
Très naturellement l'on en vient à l'évocation du style de Cliff Gallup. Mainte fois copié, jamais égalé, et hop une pierre en passant dans le jardin de Jeff Beck qui intervient à plusieurs reprises. Cliff qui invente l'ABC ( et tout le reste de l'alphabet ) de la guitare rock and roll et qui au bout d'un an s'en retourne à la maison jouer son petit country & western pépère. Nous sommes au coeur du problème. Chez Gene, la scène prend le pas sur le disque. Tournées épuisantes dans tout le pays, des milliers de kilomètres à parcourir, les musiciens sont vite lessivés. Rapidement ça tourne au défilé chez les Blue Caps, Bill Mack, Bobby Jones, Dude Kahn, remplacent peu à peu Willie Williams, Jack Neal et Dickie Harrell. Ce qui ne signifie pas une baisse de la qualité. Des recrues comme Paul Peek et Tommy Facenda sont même devenus des incontournables de l'anabase transgénique. Nul n'est irremplaçable, Johnny Meeks – merveilleux yeux bleus – hérite du fardeau le plus lourd, alors que Cliff Gallup procédait par plans successifs dument explorés, exposés et explosés de fond en comble, une espèce de dissection musicale qui permet de voir l'ossature, les organes et le cheminement de l'influx nerveux, Johnny Meeks ramasse le faisceau du son, le tresse et vous le sert tout de suite, pressé et électrique. La musique des Blue Caps s'en ressent, moins artiste, mais plus dure, davantage rentre-dedans. Jamais bourrine. Laisse la part au swing. Danse et pétille. La gesticulation des clapper-boys souligne les intonations de la voix de Gene. C'est ici que le montage du documentaire apporte un plus à des images cinématographiques et à des photos mille fois vues et revues par les fans. Donnent une idée de la folie dégagée par les prestations de Gene et de ses garçons qui étaient loin d'être des bleus. L'adjectif crazy revient à plusieurs reprises. Le bon temps, celui de la folie. Les yeux brillent à l'évocation des filles dans les hôtels. Ceux qui parlent sont des hommes âgés, beaucoup ont disparu au cours de la décennie suivante, mais l'on sent le regret de cette belle vie enfuie à jamais. Des trucs à vous tourner la tête. À se croire arrivés, ceux qui pensent à se reposer car les tournées sont harassantes et ceux qui trouvent d'autres propositions plus alléchantes. Oublient que l'on ne quitte pas une équipe qui gagne. Opèrent le mauvais choix. Tommy Facenda avoue qu'il n'a jamais été aussi heureux qu'à cette époque... Gene est au sommet de sa forme, pantalon rouge, chemise blanche finement brodée, veste léopard, veste zèbre, nous en propose de toutes les couleurs, participe à des films, tourne en Australie, tourne au Japon, l'est dans le maelström, sans plan de carrière lui reprocheraient les managers d'aujourd'hui. L'a un autre fou à ses côtés, Eddie Cochran... Dès novembre 1958 les Blue Caps ne sont plus là, Gene continue sur sa lancée, la fuite en avant, direction the old England. Peut-être pour cela que les USA l'ont oublié, inconsciemment lui reprochent-ils peut-être d'avoir déserté... Mais Gene va là où le tourbillon du rock'n'roll l'emporte...
Gene boit, mais n'est jamais soûl. Reste que la blessure à la jambe deviendra avec l'âge de plus en plus difficile à supporter. Des côtés tristes dans ce documentaire. Les séquences dans l'établissement de Country Earl dont l'orchestre The Circle E Ranch Boys fut le vivier de musiciens dans lequel Gene se servit sans vergogne. Scènes touchantes de reprises de vieux morceaux de Gene, stroll pathétique d'un quarteron d'aficionados déglingués. L'on ne devrait pas vieillir. A cette aune, Eddie a eu raison de partir si tôt...
Je ne sais si le documentaire a percuté le public américain. Je n'y crois guère. Le mieux serait peut-être qu'il donnât à un réalisateur le désir de réaliser un biopic sur Gene. Avec ces deux versants, tumultueux et crépusculaire, la vie de Gene se prêterait à une superbe évocation. Il est permis de rêver...
Les fans l'ont déjà vu. Ceux pour qui la figure de Gene n'évoque rien ou si peu, trouveront de quoi grignoter. Pas de sous-titrage.
Damie Chad.
GENE VINCENT
Rééditions Années 60 & 70
DANIEL DETHIOUX
JUKEBOX / 362 -Février 2017
Que du connu. L'article se donne à lire comme un complément au Numéro Jukebox Special Gene Vincent de 2011. Idéal pour les jeunes collectionneurs à la recherche de vieilles éditions françaises. Pour ceux de ma génération, il s'agit d'un souvenir au goût un peu saumâtre. Chouette, ces rééditions des années soixante-dix furent de magnifiques occasions de barrer sur la liste que l'on transportait toujours sur soi de nombreux titres qui nous faisaient défaut ! Mais cela venait trop tard. L'on eût préféré que Gene ait pu bénéficier quelque peu de l'argent dégagé par ce genre d'entreprise. Cela lui aurait sans aucun doute remonté le moral, l'aurait peut-être eu l'impression que la voie sans issue dans laquelle s'étaient engagés les derniers mois de son existence allait bientôt s'ouvrir et laisser entrevoir un nouvel envol. Le sort n'en a pas voulu. L'on peut évidemment chicaner sur les approximations des huit volumes de la série Gene Vincent Story parue chez EMI France, mais ce fut-là un apport musical et documentaire précieux. Même les anglais à l'époque en étaient jaloux. Evidemment il y eut aussi les deux Best of, le Memorial Album orange, la série les Pionniers du Rock, les MFP aux chouettes pochettes expressivement bariolées, le coffret quatre disques...mais tous les amateurs connaissent cela...

Damie Chad.
WHITE TRASH
JOHN KING
( Traduction : Clemence Sebag )
( Au Diable Vauvert / 2014 )
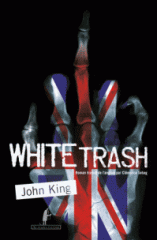
De loin, c'était la même couverture que Skinheads ( voir KR'TNT ! 297 du 06 / 10 / 2016 ), drapeau anglais sur la couverture, mais non, de John King oui, mais pas le même titre, White Trash, j'avais bien aimé le roman sur les Skinheads, mais cette saloperie blanche est beaucoup plus forte. Le même thème, mais traité à la puissance mille. Attention, l'auteur vous prend par la main, enfin vous envoie une blondinette qui joue à Eurydice pour vous emmener visiter les couloirs de l'Enfer. Amis rockers, je suis cool avec vous, vous permets de souffler avant la grande descente, dès les premières pages, la radio – pirate – diffuse Brand New Cadillac de Vince Taylor. Non nous ne sommes pas dans le swinging London des délicieuses sixties et ce n'est pas Radio-Caroline. Je suis gentil, flash back spécial dans les années cinquante, pas n'importe où, à l'Ace Cafe, Gene Vincent chante Race With The Devil, mais Charlie ne reviendra pas avant que le disque se soit arrêté, ni après non plus. Ainsi meurent les rockers... Mais l'intrigue se passe plus tard. Dans les nineties, le roman a été publié en 2002. On a mis du temps à le sortir par chez nous. Quel hasard ! Trop d'intelligence nuit à la santé publique.

John King nous égare quelque peu dans le premier chapitre. L'est en plein dans son sujet, mais parfois l'on vous met le nez dans le caca et vous ne réalisez pas dans quelle merdouille vous êtes. Donc Ruby, pas Baby mais blondinette. Vous la prenez en amitié tout de suite. Coupable de rien mais les flics à ses trousses. C'est elle qui court, les gros porcs la suivent en hélicoptère. N'a pas besoin de vous, parvient à les semer, se fond dans la foule. Plus forte qu'il n'y paraît. John King vous la présente comme une petite fille attardée, elle aime les gâteaux et les bonbons, capable de pleurer vingt ans après sur l'euthanasie de son gros chien, mais elle est plus courageuse que vous ne le croyez, et ne laissez pas échapper un seul détail. C'est monté comme un thriller. Sans en être un.
Ce coup-ci vous met le nez en plein dans la merde. Aucune scatologie. Ruby n'en mange pas, mais elle a les doigts dedans. Infirmière, mais partage aussi le boulot qu'en France on laisse aux filles de salle. Pas jojo. Z'avez intérêt à avoir l'estomac bien accroché. Le sang, le suint, le pus, la pisse, les matières fécales, les malades qui se vident. Faut leur tenir le braquemard pour qu'ils urinent, et extirper la crotte quand elle ne veut pas sortir. Peu ragoûtant. Le pire c'est que Ruby et ses copines ne se plaignent pas. Elles taffent dur, ne font pas semblant. Se soutiennent, s'entraident, se protègent, se marrent bien aussi. Assurent auprès des patients. Chacune selon sa personnalité, la chaudasse, la syndicaliste, la fataliste, et Ruby. Elle, c'est la championne de la positive attitude. Glaireuse formule qui ne recoupe pas ce que d'habitude on désigne par cette expression inventée pour que les humbles se satisfassent du peu qui leur est échu. Pas une imbécile Ruby, vous ne lui ferez pas prendre les vessies de la condition ouvrière pour les lanternes de l'acceptation béate. Peu égoïste, Ruby. Pense davantage aux autres qu'à sa modeste personne. Une véritable vision de classe. N'admet pas tout, n'excuse pas l'inexcusable mais refuse d'être dupe de la bonne conscience du travail personnel bien fait. La majorité des prolétaires agissent comme elle. Avec plus ou moins de réussite mais cela dépend surtout de vos possibilités. La vie est dure et le travail rare. Chômage et misère partout. Petits salaires. Deux ans qu'elle ne peut se payer de vacances, la copine revenue chez sa mère pour nourrir ses gosses, et celle qui fait des extras dans le salon de massages très spéciaux... Ni bien, ni mal. La survie économique. Point à la ligne. L'on n'en conserve pas moins sa dignité. L'important c'est de savoir ce que l'on fait, et d'assumer les raisons qui vous poussent à agir. Tout le monde n'y parvient pas. Alcool, drogue et violence. Beaucoup se laissent glisser dans l'ornière. La jeunesse paie un lourd tribut. Bagarres, viols, vols, Ruby n'excuse pas l'inexcusable mais admet le compréhensible, les coupables ne sont pas les seuls fautifs, le manque d'argent, les familles désunies, l'absence d'affection sont des cocktails explosifs. Dans cette Angleterre post-tatchérienne qui a réduit les syndicats à néant, toute défense collective appartient au passé. Régression sociale tous azimuts. Aucun espoir de changement ou d'amélioration. Vous ne pouvez compter que sur votre jugement, votre fierté. Ruby sourit, ses problèmes certes, mais aussi son réseau d'amis, s'est arrangée une existence qui lui permet de survivre dignement.

Vous l'ai présentée sous son meilleur jour. Mais ne vous bercez pas d'illusion. Retournez au titre. La saloperie blanche, c'est Ruby – normal qu'elle soit occupée à racler le cul des patients, elle est en dans son élément – c'est elle et ses copines, et ses voisins et les habitants de son quartier et ces skins à la tête rasée et ces chômeurs qui passent leur temps au bistrot, toute cette valetaille sous-cultivée, ces désoeuvrés qui s'empiffrent de sodas trop sucrés, de pain de mie pâteux, d'hamburgers graisseux, qui n'ouvrent jamais un livre, qui écoutent de la musique de nègres, qui se tortillent sur des danses dégénérées, qui sentent mauvais, mal sapés, mal coiffés, tatoués, bruyants, irascibles, bêtes et stupides.
Ne les condamnez pas. Oui ils sont ainsi. Peut-être pas tout à fait de leur faute. Pour la plupart mal-élevés, depuis leur petite enfance, vicieux et viciés dès le départ. Que voulez-vous que cela donne par la suite ! Et puis, chacun vit comme il l'entend. Abstenez-vous de juger et de condamner. Après tout chacun est libre. Et si ça leur plaît , de quel droit vous ne seriez pas d'accord ? Pour qui vous prenez-vous ? Cette liberté individuelle n'est-ce pas le fondement de la démocratie ? L'on ne s'est pas battu contre le facisme, l'on n'a pas combattu le communisme pour retomber dans leurs errements ! Le problème ne se pose pas ainsi. Chacun fait ce qui lui plaît, entendu, vive la liberté ! C'est au niveau économique que ça coince. Ces indigents, ces malappris, ces malotrus, ça coûte cher. Très cher. Trop cher. Ne vivent que sur les aides sociales, et quand ils sont au boulot ils rament un max.
J'arrête-là lecteur. Proposez vos solutions. Besoin d'une échelle pour franchir ce mur ? D'un tabouret pour résoudre la contradiction. Vous séchez lamentablement ! Vous êtes vraiment nuls. Vous aussi vous avez besoin que l'on vous mette le nez dans la bouse. Qu'entends-je ? Une bonne guerre ? Méfiez-vous les balles ne sont pas perdues tout le monde. Vous pourriez en être les premières victimes, l'extermination de masse est tout de même antidémocratique.

Bon, petites cervelles obstruées je vous souffle la solution. Pas difficile, tient en trois lettres : IVV ! Ne confondez pas avec l'IGV. IVV comme Interruption Volontaire de la Vie. Comment vous n'êtes pas volontaire ! Parfois je pense que j'ai affaire à des légions d'abrutis ! Mais personne n'est volontaire ! Vous possédez vraiment l'art de raisonner à l'envers. Le volontaire ce n'est pas celui qui ne veut plus vivre, c'est celui qui assure l'interruption. Une profession d'avenir. Pas de chômage à craindre. Le travail ne manquera pas. Et bien payé. Un corps d'élite, de fonctionnaires d'Etat formé à cette noble tâche.
Ah ! Déjà vous levez le doigt, vous êtes volontaire, mais nous n'avons pas besoin de sombres brutes, mais d'individus supérieurement intelligents, pourvu de tact, de doigté, de finesse. C'est qu'il ne s'agit pas de basses oeuvres. Rien à voir avec les pelotons d'exécution de la SS sur le front russe. Non, c'est un dialogue, une ouverture à l'autre, lui faire désirer sa disparition, comme nécessaire, sage, inéluctable.
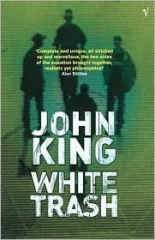
C'est un roman dites-vous. Non une métaphore. Présenté comme ceci, cela ressemble à 1984, mais non, vous n'y êtes pas, ouvrez les yeux, vous côtoyez cela tous les jours, mais vous ne savez pas voir. John King vous prend par la main. Tendrement, avec amour, avec la menotte de Ruby dans votre poigne solide, vous vous laisseriez mener jusqu'au bout du monde, nul besoin d'aller si loin, la réalité est tout prêt de vous. Apprenez à regarder autour de vous, le réel vous colle à la peau, souvenez-vous, c'est votre regard qui sculpte la vision, John King n'est pas un auteur de polar. Ne vous focalisez pas sur l'intrigue, oui c'est un roman mais c'est aussi et avant tout un ouvrage de réflexion, destiné à vous faire réfléchir sur le monde libéral dans lequel vous évoluez. Le plus beau, le plus incisif des livres politiques rédigés sur le sujet. Une analyse sans faille. La moindre fissure cache un gouffre. Méfiez-vous du moindre vernis. Attention, mon résumé est piégeux. Très piégeux. Facile à lire. Difficile à supporter. Humanité de la misère et misère de l'humanité.
Damie Chad.
( Photo : John King interviewé par des lycéennes. France )
13:44 | Lien permanent | Commentaires (0)
18/01/2017
KR'TNT ! ¤ 312 : LEMMY KILMISTER / BARNY AND THE RHYTM ALL STARS / TAQWACORE - PUNK MUSULMAN / JOHNNY HALLYDAY / ELVIS PRESLEY
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 312
A ROCKLIT PRODUCTION
19 / 01 / 2017
|
LEMMY KILMISTER BARNY AND THE RHYTHM ALL STARS TAQWACORE - PUNK MUSULMAN JOHNNY HALLYDAY / ELVIS PRESLEY / |
Lemmy some news
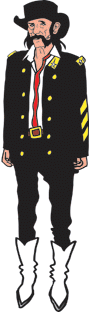
Miracle, nous avons des nouvelles de Lemmy qu’on croyait disparu. Disparu ? Ha ha ha ! Il suffit d’ouvrir ce petit punky paper anglais qui s’appelle Vive le Rock pour refaire un bout de chemin en compagnie du meilleur des hommes. Fast Eddie Clarke se souvient des premières fois où il vit Lemmy à Kensington Market. Incroyable ! Il s’en souvient comme si c’était hier.

Kensington Market ? Il fallait descendre à High Street Kensington et remonter jusqu’au 49, et là, on entrait au paradis, mais un paradis sur trois étages. On allait tous acheter nos boots à talons clairs et nos vestes en velours peau de pêche là-bas. Fantastique endroit, propice aux rencontres. C’est l’époque où Londres est la capitale de l’empire glam et où on n’écoute plus que les Dolls, Silverhead et Transformer.
Eddie connaît déjà Phil Taylor.
— Oh Eddie !
— Hey Phil, comment ça va-t-y ?
— Impec ! Dis-moi, mec, tu m’avais pas dit que t’avais une pelle ?
— Ben oui !
— Tu tombes à pic, mec, figure-toi que je cherche un guitareux !
— Ah bon ?
— Ben oui, on a enregistré un album avec Lem et Larry Wallis mais Larry a mis trop de guitares en re-re et si on veut jouer ça sur scène, ben faudra une deuxième pelle !
— Ben dis donc !
Phil étant Phil, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Eddie débarque à la répète et chope Lemmy :
— Hey Lem, on m’a dit de venir passer une audition pour la deuxième pelle !
— Non, sans blague !
Eddie se retrouve donc roadie. Il doit s’occuper de trimballer et d’installer la batterie de Phil et l’ampli de Lem. Mais il est content, car il est avec des gens du même monde : cheveux longs, blousons de cuir. À cette époque, c’est ainsi qu’on choisit son camp. Eddie est incapable de dissimuler sa fierté. Et en même temps, il en rigole encore :
— On est des hors-la-loi, on a les cheveux longs et on fume de la dope !
Voilà, c’est pas compliqué de jouer dans Motörhead.
Les flicards de Notting Hill connaissent bien Lemmy. Ils prennent un malin plaisir à le coincer régulièrement avec des familiarités du genre Hi Lem ! Eddie nomme les ennuis avec la loi des run-ins with the law. Motörhead les collectionne. Celui dont Eddie est le plus fier est celui qui s’est produit en Finlande ! Ah quelle rigolade ! C’est le plan classique, ils jouent dans un festival et détruisent tout le matériel. Les flics les arrêtent et les envoient au ballon pendant trois jours. Mais c’est un ballon finlandais construit au milieu de nulle part et personne ne parle anglais. Ils sont six, Lemmy, Phil et Eddie, plus trois road crew. Pendant 36 heures, on les enferme dans des cages individuelles et ils commencent à flipper pour de bon. Puis on les met ensemble. Phil claque des dents :
— Oh la la, Ed, tu sais pas c’qui était écrit au plafond de ma cellule ?
— Ben non !
— Avec son briquet, un mec avait écrit qu’ils peuvent t’enfermer là-dedans pendant 17 jours sans procès !
— Ben shit !
— Y vont jamais nous r’lâcher !
— Won’t they ?
Comme il fait nuit 24 h sur 24, impossible de savoir l’heure qu’il est.
Le manager de Motörhead s’appelle Zorro. Il arrive au galop dans la nuit finlandaise pour les délivrer. Il explique aux flics finlandais que Motörhead est un groupe à succès en Angleterre et qu’il doit passer à Top Of The Pops, ce qui est bien sûr un gros tas de bullshit. Les flics réclament du blé pour payer les dégâts, alors Zorro doit leur donner les 3500 $ de cachet du groupe. Parfait, ça couvre les dégâts et les frais d’hébergement. La police raccompagne la fine équipe de Pieds Nickelés jusqu’à l’avion. On les fait asseoir dans leurs sièges et on leur enlève les menottes. Ouf ! Dès que ces abrutis sont descendus de l’avion, toute la bande se met à faire la fête. Vive la liberté ! Mort aux vaches ! Ça picole à tout va, ça chante, ça danse et ça gueule, jusqu’au moment où le fucking pilote fait irruption dans la travée centrale :
— Si vous n’arrêtez pas immédiatement de faire les cons et de gueuler, j’avertis la police de Gatwick qui viendra vous cueillir !
— Hooola bijou, du calme !
Meanwhile back in London...
Slim Jim Phantom aime bien Lemmy, lui aussi. Il le connaît depuis l’été 80.
— C’est sans doute Pete Farndon ou Crazy Charlie qui nous a présentés, je ne me souviens plus très bien, j’ai la mémoire qui flanche. On a causé de rockabilly, on a fait plein de parties de machines à sous et on est allés boire des coups dans un pub de Gloucester Road, puis après on est allés dans un after-hour du genre Funny Farm. Quand le soleil s’est levé, on est allés chez Lem écouter plein de disques. Pas de question de dormir, avec un mec comme Lem.
Slim Jim ricane comme un vieux capitaine de flibuste.
— Avec Lem, chaque nuit était techniquement une wild night. Avec le temps, les nuits sont devenues un peu plus sereines mais elles sont quand même restées assez wild. Lem se comporte toujours de la même façon, rien ne change. Quand j’ai arrêté de faire le con et de passer mes nuits à faire la fête, notre amitié est restée intacte. C’est un sacré test, pas vrai ?
Quand Lem s’installe à Los Angeles, Slim Jim et lui sont voisins. Le hasard fait parfois bien les choses. L’arrière de l’immeuble où vit Slim Jim sur Doheny Drive fait face à l’immeuble où vit Lem sur Harratt Street. Ils sont à deux pas de Sunset Strip. Lemmy est un peu comme Slim Jim, il déteste le froid. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne roule pas en moto.
En guise de rideau, Lem a accroché un drapeau de pirate à sa fenêtre et quand Slim Jim descend promener son chien et qu’il passe sous sa fenêtre, il appelle Lem et ils discutent le bout de gras. Lem le fait souvent monter et ils regardent ensemble quelques conneries à la télé. Lem adore regarder la chaîne d’histoire ou la série Law & Order.
— Quand j’arrive chez Lem, je reste toujours beaucoup plus longtemps que prévu. J’adore ce mec, franchement. Je ne crois pas qu’on puisse voir un jour débarquer un nouveau Lem, car celui-là est le fruit d’une combinaison très spéciale : l’après-guerre en Angleterre, le rock’n’roll des pionniers, le british beat et les seventies londoniennes. Il est vraiment le fruit de ce mélange unique au monde. En plus, c’est un cat généreux et smart enveloppé dans une douille en acier.
Lem et Slim Jim ont monté un trio de rock’n’roll avec Danny B. Harvey, le fameux Headcat. Comme Slim Jim, Danny connaît Lem depuis 1980. À l’époque, Danny jouait dans Levi Dexter & the Ripchords, un combo de revival rockab. Lem venait les voir jouer au Dingwalls.
— J’ai appris à jouer «Motorhead Baby» de Johnny Guitar Watson pour le dédicacer à Lem, chaque fois qu’il venait nous voir. Lem est un vrai fan de rock’n’roll. On l’a vu aux premiers concerts des Stray Cats à Londres, à la même époque.
Danny est parfaitement incapable de maîtriser son admiration pour Lem :
— Il a une cervelle incroyable ! Il retient tout qu’il voit, tout ce qu’il entend et tout ce qu’il lit. Tout, tout, tout ! Il connaît des tonnes de paroles de chansons. Il connaît des tonnes d’accords et de lignes de basse, il sait exactement quand le tambourin va arriver, ce que va faire le batteur. Sa passion pour le rock’n’roll est restée celle d’un gosse, complètement pure et innocente. Quand la fille de Jerry Lee nous a présentés Lem et moi à son père en 2010, Lem lui a serré la pince et m’a gueulé dans l’oreille : «C’est le fucking killer !». Lem était en transe.
Danny adore se retrouver en studio avec Lem, ils jouent du vieux rock’n’roll et sifflent des tas de Jack & Cokes. Ils passent leur temps à jouer, à siffler des verres et à rigoler comme des bossus.
— Quand j’ai commencé à jouer dans un groupe, j’avais 13 ans et on reprenait des morceaux de Hawkwind. Je savais que Lem était leur bassman. C’est dingue de penser qu’on a fini par jouer ensemble. Eh oui, ça fait 16 ans qu’on fait Headcat avec Slim Jim et Lem. Ça fait un sacré bout de temps, pas vrai ? Mais le plus important, c’est que je suis extrêmement fier d’être devenu son pote. Il me paraît essentiel de rappeler que Lem est le plus honnête homme qu’il m’ait été donné de rencontrer. Il n’est jamais tombé dans les pièges du star-sytem. Chez lui, aucune trace d’égocentrisme, de goût pour les drames ni de complexe de supériorité. Lem est un mec qui a toujours su garder la tête sur les épaules. Figure-toi que le Lem de 2015, c’est exactement le même que celui de 1980, il est assis au bar, il fait un jeu vidéo, entouré de potes à lui, pas de garde corps, et quand un fan vient le saluer, tu verrais sa gueule ! Il est ravi !
Signé : Cazengler, Lemmiteux.
We are Motörhead. Vive le Rock #41. 2016/2017

13 / 01 / 2017 – TROYES
LE 3B
BARNY AND THE RYTHM ALL STARS

Cette fois-ci, ça devient sérieux. Les amis tentent de m'en dissuader. Funestes prédictions et avertissements funèbres ne cessent de pleuvoir. Pardon de neiger. A gros flocons. Jusqu'à des copains de copains qui m'adressent des messages alarmants. A les écouter la capitale de l'Aube sera dès ce vendredi soir ensevelie sous les névés. Je consulte les cartes météo avec le regard acéré de Surcouf matant désespérément l'horizon marin en vue d'un navire battant le pavillon anglois. D'après mes relevés, rien de grave à condition d'être de retour avant quatre heures du matin. Je consulte la teuf-teuf qui en rigole. Me révèle que sur les parkings ses congénères la surnomment le brise-glace de la Baltique. Alors pas d'hésitation, cap sur Troyes au plus vite.
Me voici au coeur de la forteresse locale du rockabilly. Pas mal de monde déjà. Mais comme disait Alphonse de Lamartine quand il manque l'orchestre les concerts de rock sont dépeuplés. Béatrice nous rassure. Sont sur l'autoroute du côté de Paris. N'y a plus qu'à patienter. Pas trop longtemps, car les voici et les Barny installent au plus vite leur barnum, ce qui permet d'assister au sound-check. Ne sont pas du genre approximatifs, point de tâtonnements à l'aveugle, en trois mini reprises vous sortent un son d'une limpidité absolue. La perfection existe donc en ce bas monde. Voudraient entamer le concert illico, mais Béatrice la patronne insiste pour qu'ils se restaurent d'abord. Pas de problème. Le bar et la sono qui diffuse de petites merveilles de la discographie rockab combleront sans difficulté notre attente. D'autant plus que les trois amuse-gueules de la balance laissent augurer un menu roboratif.
LA CLASSE ET LA CLAQUE
N'ont pas commencé depuis trente secondes que Barny s'est déjà jeté à genoux. Donne le ton, pas le temps de folâtrer en chemin. Dix minutes plus tard c'est une corde de sa rythmique qui a rendu l'âme, si vous croyez que cela ait ralenti la chevauchée, tant pis pour vous. Mais avant de parler de Barny attardons-nous sur les trois autres mousquetaires. Pas des perdreaux de l'année, étaient déjà avec Carl, et maintenant sont derrière le fils.

Claude Placet, grande taille mais talent encore plus grand. La guitare, la fait sonner méchant. A peine intervient-il que vos oreilles prennent la dégelée, l'est le Portos de la portée, l'a le style conquérant de celui qui à raison ne doute jamais, à sa gauche plus réservé, Renaud Lens, la sombre retenue d'Athos, genre de gars

qui ne cherche pas la noise mais évitez de passer trop près de lui, quand il se fâche il ne vous lâche plus, ce soir c'est la contrebasse qui prend, la pauvre, il la slappe à mort, un trois-ponts de quatre-vingt dix canons qui tire des bordées sans interruption, à chaque coup qu'il assène c'est comme si vous concassiez à la pelleteuse mille stravidarius d'un seul coup, on le verra peu ce soir, car la haute silhouette de Claude le cache, mais n'ayez crainte c'est Pedro Pena, le gars pas du tout à la peine, l'est aussi retors et perfide qu'Aramis, vous ne savez jamais où il va vous mener, à la baguette, le genre de gars qui allie l'éblouissance de l'efficacité et les circonvolutions de l'invention. Bref trois cadors. Dorés sur tranche. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas encore Barny. Ce sont les trois mêmes. Vous les ai présentés séparément. Une vue de l'esprit. Une abstraction stupide. Possèdent cette terrible carte biseautée qui a elle toute seule vaut une collection d'as dans la manche. Tout simple. Tout bête. Comment les autres musicos n'y ont-ils pas encore pensé ? Ne suffit pas d'être les meilleurs. Faut jouer ensemble. Et les All Stars du rythme, ils ne s'en privent pas. Une mécanique de précision. Enchaînent les plans à une vitesse folle, ont dû recevoir une formation spéciale, un entraînement pour devenir le premier combo de rockabilly destiné à être catapulté dans l'espace. Imparables. Invincibles. Si j'étais Barny, je n'aurais jamais osé. Les aurais laissé bosser tout seuls. D'ailleurs c'est ce qu'il fait au début du deuxième set. Et nous avons droit à un instrumental à déraciner les chênes. Une de ces fricassées qui vous rompt les os à coups de hachoirs non réfrigérés. Désolé de le rappeler, je ne ne suis pas Barny. J'aimerais bien mais ceci est une problématique peu intéressante.

Donc Barny dans la cage aux fauves. Tout jeune. Normalement devrait s'enfuir en courant. Mais non, ce n'est pas qu'il est aussi à l'aise que vous lorsque vous caressez un mignonitou petitou chatounou sur le canapé du salon, l'est comme un tigre altéré de sang dans la jungle sans merci. Faut le voir, il crache le vocal comme s'il voulait vous transpercer de ses dents, l'est partout à la fois, devant le micro, ou alors il danse entre ses trois congénères, le fou furieux descendu dans la fosse aux serpents, et sa guitare, certes il la déglingue à coups de griffes mais surtout il s'en sert comme d'un drapeau, l'est le porte-enseigne du rockabilly, le centurion qui tenait l'enseigne totémique de la légion en première ligne pour mieux exciter la convoitise des ennemis. L'a tout compris. D'instinct. Transmission paternelle et génie personnel. Les trois fous furieux ils jouent ensemble, non c'est une erreur de perceptive, style le bâton plongé dans l'eau qui vous semble brisé, sont quatre ensemble. Quel savoir-faire ! Ou plutôt de l'intuition. Le rockabilly de nos mousquetaires, c'est du sauvage. Pas le genre de mayonnaise avachie qui coule péniblement du tube, plutôt ces éruptions spermatiques de cachalots en rut. Quand c'est parti, vous n'avez plus le temps de réfléchir, z'avez intérêt à avoir branché le pilotage automatique, vous vous n'intervenez que pour appuyer sur l'accélérateur, et ensuite comme à la parade, attention les trois escogriffes vous préparent un alunissage sans douceur sur la face cachée de la lune, pas de problème, le capitaine Barny accentue la dérive de son équipage d'un haussement de guitare sur la gauche et vous avez l'impression que le monde s'écroule, pas le temps de larmoyer sur cette apocalypse, Captain' Barny vous induit le même haussement d'épaule, mais sur la droite cette fois, pour vous signifier le crash mooning sur la face brillante.

Guitare oriflamme portée à bout de bras au coeur ardent de la mêlée. Ils ont leur titres à la Young and Wild – tout un programme – ou alors ils piquent dans le répertoire des outlaws du rockabilly de Johnny Horton à Charlie Feathers. Mais l'on s'en moque. Ne vous laissent pas le temps de batifoler dans les arguties. Ce n'est pas qu'ils se débarrassent des morceaux comme vous éparpillez les moineaux d'un revers de la main irrité, au contraire ne bâclent pas le travail. Quand ils en tiennent un ne le laissent pas repartir sans en avoir exploiter toutes les facettes, chacun vous le triture à sa manière, chacun s'en donne à coeur joie, n'ont pas besoin d'une demi-heure, huit secondes chacun, mais à tour de rôle, vous l'assomment à la doubble bass, vous l'électrocutent à la lead, vos l'estabousillent à la batterie, mettent du coeur à l'ouvrage, et pour finir Barny vous l'éviscère avec les dents. Ah ! les chacals, vous émiettent le vieux rockab des familles sans sourciller. Le Barny est plus que pressé. Tellement que parfois il plaque sa guitare et continue au micro, pour jeter sa hargne encore plus fort. S'avance dans le public et tout le monde hurle comme une meute de loup à qui on offrirait la lune sur un plateau.

Ne vous font pas le paquet cadeau les Barny and The Rythm All Stars, vous refilent le poison directement en pleine main, vous bombardent au napalm et vous saupoudrent à l'agent orange. Du bop de fou. Frappez le sol du pied. A en faire surgir le spectre de la désolation. Barny et ses acolytes vous démantibulent le rockab, vous l'explosent et vous l'atomisent, pour qu'il retombe sur vous, un ravage diluvien, plus beau, plus dur, plus fort, plus électrique. Deux set, de toute beauté. Pas des plus longs. Mais une dose de cheval de course à chaque fois. A vous renverser. A vous moudre les os. Du métier mais pas de tricherie. Une aisance qui transcende tout. Barny se jette à terre dans le dernier stomp de l'enfer. Tombe lourdement, mais se relève sans baragouiner et mène la danse endiablée jusqu'au bout. D'abord le rockabilly. Ensuite sa petite personne. Le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à Carl qui s'est runaway in the sky. Plus qu'un concert. Une démonstration sans concession de ce à quoi un concert doit ressembler.
Damie Chad.
P.S. : retour sans problème. Les radiations émises ont empêché la neige de tomber.
( Photos : noir et blanc : FB : Sergio Kazh
couleur : FB : Béatrice Berlot )
PUNK YOU

Regarde ce que je t'ai trouvé ! J'adore les filles qui m'offrent des cadeaux. C'est un DVD sur le punk. Il m'a tout de même coûté un euro cinquante. Elle ne veut pas que la rembourse aussi en plus de lui dire merci ! J'inspecte l'objet, la silhouette d'une mosquée qui se profile au dos de la couverture, par Sheitan, du punk musulman ! Je connaissais ce bouquin paru chez Camion Blanc sur le rock à Téhéran, mais là j'avoue mon ignorance, apparemment cela se passe aux USA. Pour l'Iran-Rock j'avais visionné quelques vidéos, pas de quoi sauter au plafond. Résultat final moins que médiocre, mais abstenons-nous de critiquer, faire du rock sous la pression des Mollahs et dans le viseur de leur police politique, je ne sais pas si j'en aurais le courage. Bref, je ne demande qu'à voir. Car il s'agit d'un film. Et en plus on ne se moque pas du client, rempli de bonus, arrêtons de bavasser, ouvrons notre computer.
PUNK YOU
THE TAQWACORES
Réalisé par EYAD ZAHRA

Ne peut rien vous dire sur Eyad Zahra d'origine syrienne ce film sorti en 2007 est apparemment son plus célèbre fait d'arme. Pas le genre d'artefact filmique destiné à révolutionner l'art cinématographique... Zahra l'avoue dans une interview, n'était pas un grand fan du punk lorsqu'il s'est décidé à le réaliser, par contre l'on comprend que sa relation personnelle à l'islam a dû le motiver fortement. Le sujet est assez simple, un étudiant bon élève, d'origine arabo-musulmane, s'en vient louer une chambre en ville – nous sommes à Buffalo dans l'Etat de New York – afin de fuir l'ambiance un peu trop libre du campus universitaire. Mauvais choix, se retrouve en pleine communauté punk !
Rien à voir avec les ambiances débridées des squats parisiens des années quatre-vingt. Nous sommes au milieu de déchirés. On boit, on fume, on shite, on jure, mais grattez le perfecto clouté et la réalité est beaucoup plus contrastée. Nous ne sommes pas en présence de révoltés mais d'écartés. Certes ce sont eux qui ont fait le grand écart, qui se sont séparés de la Communauté des Croyants, mais ils souffrent de ce rejet. Essayent d'assumer les contradictions. Mener une vie dissolue tout en respectant les commandements du Coran. Pas évident. L'une ne quitte jamais sa burqa tout en professant un féminisme outrancier, l'autre arbore une magnifique crête. Ne sont pas tous à l'unisson. L'un ne supporte pas les impuretés de ses camarades et les autres s'adonnent à de théoriques dérives interprétatives du message du prophète... L'on comprend leur problématique, sont rongés par la mauvaise conscience, aspirent à vivre comme les jeunes américains de leur âge mais se heurtent à tous les interdits de leur religion qui leur ont été inculqués durant leur enfance et leur prime adolescence. Ne tournent pas leurs désirs vers une seule Mecque, à un niveau intime sont polarisés par l'Orient du sexe qu'ils ont du mal à pratiquer, et culturellement par l'Eldorado mythique de la Californie où sévissent des groupes punks musulmans. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Puisqu'ils ne peuvent aller à la montagne, ils décident de la faire venir, en organisant un festival punk dans leur maison...
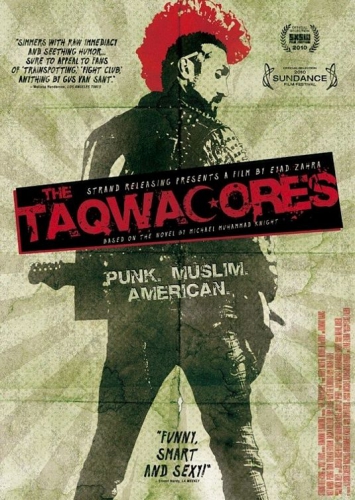
Quatre groupes punk californiens débarquent au domicile. Sont à leur image. Mais avec des options davantage cristallisées. Trois d'entre eux sont idéologiquement des plus virulents, mais le quatrième habillé tout de blanc professe un islam rigoriste. Préfèreront passer la nuit à se geler dans le bus que dans cette maison remplie de filles... La soirée suivante sera démentielle, groupes à fond, musiques sauvages, paroles au bord du sacrilège, public exalté, dansant et sautant partout, miss Burqa qui s'offre une fellation aux yeux de tous, en tout bien tout honneur puisqu'elle ne quitte pas sa noire tenue, excitation et frénésie à leur comble, trop de contradictions, bagarre générale, un mort. Notre étudiant sage qui s'est quelque peu dévergondé fait ses cartons pour rentrer dans sa très croyante famille. Clap de fin.
Résultat des opérations, ce n'est pas gagné d'avance. Le film laisse une impression bizarre. O. K. pour l'aspect punky-festif, mais ce qui ressort avant tout de toutes ces images c'est la prégnance de l'Islam sur les actes, les idées et le comportement de cette jeunesse. Ne parviennent pas à couper le cordon. Restent prisonnier de leur éducation, tout cela ressemble à une révolte d'adolescent, un mauvais passage, mais les bons fils qui ne prient plus que du bout des ablutions, et les petites filles coquines qui auront préservé leur hymen, tout ce petit monde a toutes les chances de réintégrer la normalité musulmane...
THE TAQWACORES
MICHAEL MUHAMMAD KNIGHT
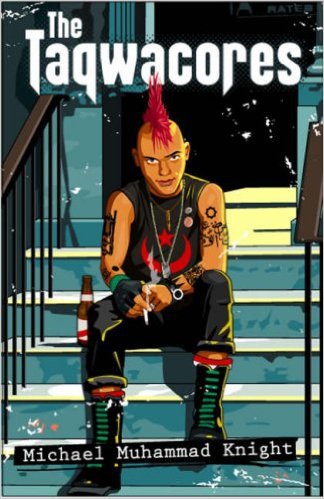
Après le film, le documentaire qui relate la naissance historiale de ce mouvement punk musulman aux Etats-Unis. Etrangement la musique n'est pas au départ de cette aventure. Tout débute par le livre Taqwacore – disponible en français aux éditions Babel – écrit par Michael Muhammad Knight. Le film de Eyad Zarah n'est que l'adaptation de son roman. Le document tourne autour de sa personne. Il est jeune, il est beau, il est ouvert, il est sympathique, il est intelligent, il est intellectuellement honnête, il ne cache rien. Il possède toutes les qualités. Mais je le trouve terriblement inquiétant.
Le film raconte l'histoire du livre. Nous avons droit dans les surplus à une lecture publique du roman, il est facile de s'apercevoir que certains dialogues sont des extraits pratiquement repris tel quels du bouquin. Fut reçu et lu par une fraction de la jeunesse arabo-musulmane américaine qui entrant en relation épistolaire avec l'auteur fut très surprise d'apprendre qu'il s'agissait d'une fiction. La déception fut de courte durée. Puisque cela n'existait pas, il suffisait de le créer, et des groupes de punk Taqwacore se formèrent illico. Michael Knight n'hésita pas à les rejoindre pour une mémorable tournée en bus au travers des Etats-Unis à la rencontre d'un public qui fut au rendez-vous.
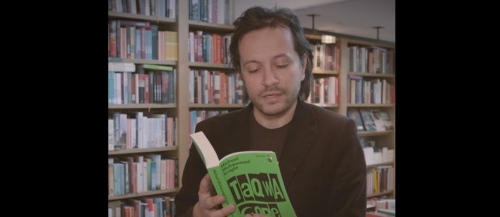
Musicalement l'islam-punk prôné par des groupes comme Dead Buthos ou Vote Hezbollah, se révéla être un mélange explosif de style Rude Boy, Oï, Skin, Riot Grrrls, avec tout de même peut-être, inidentifiable à l'oreille mais agissant comme le plus savoureux des répulsifs, une écorce de Straight Edge. Le rythme est rapide mais le son n'est pas amplifié à outrance et ce sont surtout les paroles qui sont explosives, revendiquent le droit de boire, de fumer, de baiser, la liberté d'expression et n'hésitent pas à dresser des portraits peu orthodoxes du prophète car tout le monde le sait, Mahomet était un punk dégénéré. Sex Pistols revisités en Anarchie dans le Califat. Cela nous fait rire, mais il faut le replacer dans le rigorisme intransigeant des Communautés musulmanes pour en goûter le sel et l'audace. Ce qui est sûr à voir les images des concerts c'est que la jeunesse musulmane – garçons et filles mêlés - apprécie.
Michael Muhammad Knight se raconte. Fils d'un suprématiste blanc et d'une mère pakistanaise qui s'enfuit de son mari ultra-violent avec son marmot de deux ans. Adolescent mal dans sa peau, Michael se convertit à l'Islam, et à dix-sept ans il fera un séjour de deux années au Pakistan pour approfondir sa foi. Mais le résultat obtenu ne fut pas celui escompté. Les rigueurs de l'Islam le dégoûtèrent. L'écriture de Taqwacore procède de cette déception. Mouvement de révolte et recherche d'un islam hardcore. Taqwa signifie extase, un peu ce que l'ésotérisme appelle la voie de la main gauche. La recherche de dieu au travers de l'ivresse dionysiaque. Dieu n'est-il pas le désir et le plaisir suprêmes ? Il n'est pas interdit de ressentir des relents de soufisme dans cette théologie no border. L'islam est traversé d'une foule de positions interprétatives divergentes. Une manière très ambigüe aussi de poser le problème autrement : plus islam que moi tu meurs.

La première mamelle du Taqwacore c'est la provocation. Je refuse le discours des imans, je suis mon propre iman, je fais ce que je veux. Personne ne me dit ce que je dois faire. Allez vous faire foutre. Michael Knight et ses sbires n'hésitent pas à se présenter en concert dans un immense congrès musulman des plus orthodoxes. Parole provocantes, chanteuse lesbienne qui harangue le public composé de jeunes filles sous voile et foulard qui reprennent les paroles en choeur. Se feront expulser... Ne sont pas les premiers musulmans américains qui ont élevé la voix, les voici donc à Detroit et à Harlem sur les traces de Malcom X et d'Elijah Mohammad et peut-être encore plus de Wallace Fard Muhammad le créateur de la Nation Of Islam que certains prenaient pour une incarnation du prophète si ce n'est pour Allah en personne... L'islam punk américain retrouve ainsi une inscription historiale des plus traditionnelles qui recoupe la lutte de libération des minorités opprimées...

Le deuxième pis de la vache, c'est l'islam. Avec ses compagnons de route musicale, les Kominas, Michael Knight retournent au Pakistan. S'aperçoivent vite que leurs concerts ne drainent que la minorité de la jeunesse issue des hautes familles friquées. Parviendront tout de même à donner une prestation publique qui attirera une assistance beaucoup plus populaire. Mais l'important se passe sur un autre plan. Le Pakistan est un pays de cocagne. Shit et beuh à consommer sans modération. L'excès entraîne la saturation. Le corps a ses limites, l'esprit aspire à un autre état. Michael Knight revient sur ses pas. Rend visite à la mosquée de ses dix-sept ans. L'on sent que s'opère dans sa tête un retour à un désir de spiritualité. L'islam ne laisse pas s'échapper ses fidèles comme cela... Le DVD n'en dit pas plus. Mais les livres qu'il a publiés depuis cette date le confirment.

S'est senti proche du mouvement des Five Percenters issus d'une scission de la Nation of Islam, apparus en 1964, une espèce de secte de revendication de la supériorité de l'Homme Noir qui dispense un enseignement basé sur un alphabet mathématique suprême qui a beaucoup influencé l'écriture des chanteurs hip hop. Ajoutez un voyage à la Mecque, l'utilisation de drogues, tout cela dans le but de concilier la tradition de l'Islam avec une vision beaucoup plus libératoire... Une mission impossible. L'anarchisme islamique nous semble une notion aussi antithétique que l'anarchisme chrétien. Certes vous pouvez le concevoir comme un escalier qui permet d'accéder à la liberté humaine. Mais n'en reste pas moins que l'escalator qui permet de s'éloigner de Dieu... aide toiut aussi mécaniquement aussi à y remonter. La sortie de secours qui vous autorise à courir vous abriter au moindre pépin. La religion est ce qui vous relie à Dieu. Sympa, vous vous sentez privilégié par cette union directe avec ce qui fait de mieux dans le monde. Dans le même temps, la religion est ce qui vous lie, vous attache, vous ligote comme un rôti qui ne va pas tarder à être mis au four en vue d'une assujettissante ingurgitation. Un punk qui se respecte commence par clouer le christ sur sa croix et par égorger le prophète. Au passage il en profite pour faire du boudin avec le bouddha et passer l'élohim au hachoir. I'm the god's serialkiller. Un chien sans son maître reste un chien. Mais un maître sans son chien n'est plus un chien. Choisissez lequel des deux vous voulez noyer. Ne venez pas vous plaindre après s'il vous mord ou s'il vous siffle, assumez ! Epargnez-nous aussi l'hypocrisie larmoyante de vos regrets.
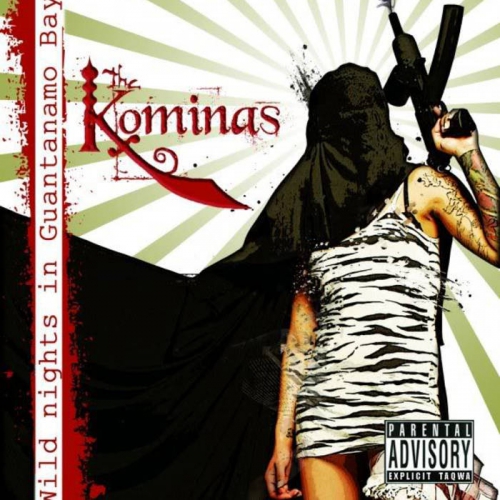
Mais à la réflexion le punk musulman n'est-il pas une attitude sacrément, terriblement et pleinement punk ? Punk à cent pour cent. A la manière de la croix gammée sur le blouson de Sid Vicious ou de cette étoile de David qu'arbore ce punk musulman dans le film. Ou alors une contre-façon monothéique de l'athéisme ? Je vous laisse seuls juges. Prenez vos responsabilité. Vous êtes grands. Débrouillez-vous. Rompez vos chaînes ou passez-les autour de votre cou. Cela vous regarde. Agissez à votre guise. N'attendez de moi, aucun conseil. Think it by yourself. C'est ainsi que débutent les plus grandes sagesses, les plus extravagantes folies, et les pire bêtises...
Damie Chad.
*
J'adore les petits marché de province. Parmi les stands de fruits et légumes se cache fréquemment un bouquiniste ou un marchand de disques. Sur Lambesc, je bisque, des étals de vêtements à gogo – les filles en sont gaga – des marchands de chaussures qui marchent à côté de leurs pompes, des gâteaux et des jouets pour les gosses, et rien pour moi qui ai conservé mon âme d'enfant ! L'injustice gouverne le monde. Pas entièrement, un revendeur de DVD d'occase. L'air jovial et sympa. Non les classiques du cinéma, ce n'est pas mon genre, moi c'est plutôt le rock'n'roll, fait la grimace, me présente Genesis, non il n'est pas bien riche, farfouille un peu dans son stock, l'on en profite pour discuter un max, l'est de la vieille école, a vu pas mal de concerts dans les années soixante, mais le voici pris d'une illumination subite, ah! Oui j'ai un truc que vous ne trouverez nulle part, un film de Reichenback, sur Johnny. Saperlipopette, ne ment pas, voilà des années que je n'aie aperçu le susdit boîtier.
FRANCOIS REICHENBACH

L'est passé à l'as de pique, le pauvre François. Façon de parler car il était l'illustre rejeton d'un famille plus que nantie. L'a quitté notre planète depuis bientôt un quart de siècle. Mais l'est aussi passé à l'as tout court. Lui qui fut une sommité en son temps a disparu des mémoires. N'accusons point nos contemporains, c'est en grande partie de sa faute. L'a partagé le lot des précurseurs. S'est intéressé sérieusement à des sujets qui sont devenus maintenant des tartes à la crème, du style les prisons aux Etats-Unis ou les rues de New York. A l'époque tout nouveau, tout beau. Ce genre de parti-pris conférait du respect. La caméra au poing en prise directe sur la réalité de la modernité. Il ne dénonçait pas, il lui suffisait de montrer. Mais s'est fourvoyé en des attitudes étranges. Ce fou de peinture et de musique classique, Rubinstein, Yehudi Menuhin était un esprit ouvert. S'intéressait aussi à la chanson populaire, Edith Piaf ce qui est pardonnable, Jean Cocteau lui-même donnait l'exemple, descendit d'un cran en s'attardant sur les jazzmen et déçut son monde en avouant des passions coupables pour les yé-yé et les chanteurs de rock'n'roll. Et pas qu'un peu. Pas pour honorer une commande lucrative. Caméra au poing, gâchait consciencieusement des kilomètres de pellicule. Le gars archivait méthodiquement. A l'époque il a vu et filmé pratiquement tout le monde, les anglais, les amerloques et les petits franzosen. A mon humble connaissance tout cela a disparu. Doit croupir et moisir dans des cartons. Ne reste que les sorties officielles, Sylvie Vartan, Vince Taylor et ce Johnny Hallyday sorti en 1971.
J'AI TOUT DONNE
JOHNNY HALLYDAY
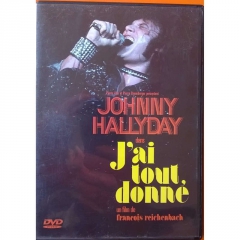
Johnny au meilleur de sa carrière. Le deuxième envol. En gros au milieu de sa décennie majeure 65-75. On ne devrait pas le dire mais en regardant l'on prend un sacré coup de poing de vieux dans la gueule. Tout le monde. Sauf Johnny. L'est tout beau. A l'acmé de la vie. Aborde la trentaine. Cheveux longs, blondeur, minceur du corps l'a tout pour plaire et séduire. Au passage l'on reconnaît des têtes connues, Rolling, Tommy Brown, Micky Jones, des pointures du rock français. Beaucoup de scène. Ce que la bête a toujours su faire de mieux. Une quarantaine de titres qui défilent, ce qui est un peu râlant, car nous n'avons droit qu'à des extraits, le montage habile n'esquive pas la sensation du pot-pourri. Vous laisse sur votre faim à chaque fois.
Séquence voyage aux Etats-Unis. Johnny parle. Des propos peu renversants. L'Amérique c'est sa vie. Les cow-boys, les bottes, les jeans, les indiens, les voitures, la moto. Ne nous livre que des évidences. En plus, il n'est guère bavard, notre Jojo. Plutôt du genre solitaire à ruminer ses rêves, en solitaire. Séquence émotion : téléphone avec Sylvie à David resté en France. Plutôt maladroit. J'espère que tu es sage. Original ! Pas très rock'n'roll !

Promenons-nous dans les back stages, beaucoup plus intéressant, l'adrénaline qui monte avant de rentrer en scène. Les changements de costumes entre deux morceaux, chaque geste autour de lui manifestement au point au centimètre près, la logistique est d'une précision effrayante, une mécanique parfaitement huilée. Fin de concert, Johnny couché par terre sans force, à bout, exténué, les traits crispés, livide, et puis le sourire qui réapparaît peu à peu, l'énergie qui renaît, le sourire amusé qui point sur sa face, l'animal a repris du poil de la bête. Séquence filles à l'hôtel. La caméra reste pudique et n'insiste pas. Quelques demoiselles qui montent et dévalent des escaliers sans bruit. Voilà, c'était Johnny. Plus rien à voir. Le titre n'est pas mensonger, Johnny a tout donné. Pas de tricherie. Mais le rocker c'est comme les jolies filles, ne peut vous offrir que ce qu'il a.

Au risque de décevoir les amateurs de Johnny je me dois de remettre les pendules à l'heure. La beauté du film ne tient pas à Johnny. En 1971, ce genre d'opus était rare. Aujourd'hui vous avez des centaines de DVD d'à peu près tous les chanteurs des soixante dernières années en circulation sur le net. Des officiels, des pirates, des rushes de particuliers. A l'époque les yeux étaient focalisés sur Johnny. Mais Reichenbach était trop intelligent pour ne pas regarder le phénomène avec un peu de distanciation. Johnny l'a toujours compris. Depuis un demi-siècle il le répète à chaque interview et à chaque concert. Lui n'existe que par son public. Reichenbach ne s'y trompe pas, les plus belles séquences sont celles où il tourne la caméra vers la foule des fans. Des milliers de jeunes, au bord du delirium tremens et en même temps très respectueux. La limousine ou le camion qui se fraie un chemin entre une haie d'honneur difficilement contenue par des policiers bon enfant, ça passe au centimètre près, mais ça ne casse pas. Il serait facile de submerger le véhicule, roule au pas, mais arrive sans encombre au pied de la scène ou parvient sans problème à franchir le le portail salvateur.
Le concert en lui-même. Le jeu du chat et la souris. Les filles qui montent sur scène pour embrasser l'idole. Les plus chanceuses s'enroulent autour de Johnny, se transforment en boas constricteurs, sont comme des sangsues, des ventouses, des pieuvres vampiriques, ne veulent plus le quitter. Faut trois costauds pour les détacher. Imperturbable Johnny ne lâche pas son micro et continue de chanter sans désemparer. Des garçons aussi, davantage de retenue virile, une petite tape sur l'épaule du chanteur leur suffit. Pour avoir assisté moi-même en 1972 à une semblable prestation je peux confirmer que le film n'en rajoute pas. J'ai vu de mes yeux dix fois pire, et n'ai jamais depuis assisté à une telle folie dans aucun des concerts auxquels j'ai participé depuis.

Ce sont-là les fans les plus exaltés. Certes, mais dans le reste de la salle, c'est encore plus troublant. Ça hurle, ça crie, ça gesticule, ça interpelle, ça tangue, mais ce n'est pas cela qui attire le regard. Ce sont les visages. Illuminés, transfigurés, on peut parler de ravissement au sens extatique et mystique de ce mot. Une expression de bonheur ineffable. Ne sont pas possédés. Sont dépossédés, donnent l'impression d'être sortis d'eux-mêmes, arrachés de la bulle chloroformique et de l'égotiste prison du Moi, sont en train de vivre une espèce d'émigration grégaire, un voyage collectif en astral. Ne vont pas loin, restent tout près d'eux-mêmes mais ils ont fait le pas décisif de la sortie hors de leur espace mental. N'en sont même pas conscients, la transe les a boostés de leurs corps comme le tire-bouchon qui arrache le bouchon du goulot de la bouteille.

Et le dieu-Johnny dans tout ça ? En parle très bien. Non il ne voit rien, il a vu trop de visages en dix ans de carrière pour qu'il puisse se souvenir de l'un d'eux en particulier. Sont comme des monades de Leibnitz interchangeables mais humaines. S'agitent en tout sens, des particules chauffées lancées dans une sarabande endiablée... Lui c'est le contraire. S'il ne voit rien, c'est qu'il possède ses gestes d'auto-défense et de survie. S'enferme en lui-même. Descend au plus profond d'une solitude glaciale. Il est le moteur immobile qui déchaîne la ronde folle des atomes. En ressort brisé. Signe les autographes à la chaîne, sans regarder. Ce n'est pas du mépris. Simplement la lassitude de celui qui revient de loin et qui a tout donné. Pour les autres, pour les fans, et peut-être encore plus pour lui. Atteint le plus profond de lui-même. Le point ultime où le phénix termine le processus d'auto-destruction qui le retranche définitivement du monde, le moment où la braise devient cendre, tout est consommé mais en ce même instant point l'originel envol de cette fabuleuse résurrection, ce principe d'incandescence maximale que parfois l'on nomme rock'n'roll.
Damie Chad.
DANS LA PEAU D'ELVIS
ISABELLE BONNET et RENAUD SAINT-CRICQ
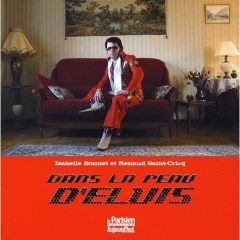
Joli petit-format carré édité par le Parisien / Aujourd'hui. Mais ça date d'hier. Et de toujours. Le King est immortel. Mais il est mort. Il y a trente ans. Le bouquin est paru en 2007. Ce n'est pas grave. L'a ressuscité, l'est partout. Des morts-vivants, d'une nouvelle race. On les appelle les sosies. Ont leur jour de fête à Memphis. Nous en avons plein en France. Surtout dans le Nord. Au pays des ch'tis. Le rock est une musique populaire. De prolétaires. Et rien n'est pire que l'humour auto-satisfait du petit-bourgeois confit en sa vaniteuse médiocrité. L'est facile d'en rigoler. Eux les clones ils assument. En toute simplicité. Pas évident d'écrire dessus. D'ailleurs nos deux deux auteurs n'en pondent pas un roman. Esquissent de rapides portraits, des crayonnés aurait dit Stéphane Mallarmé. Ont privilégié la photo, qui déborde sur la deuxième page. Dix-huit Elvis sur sur leurs dix-huit canapés. Faut trouver le ton juste. Eviter la méchanceté, le précis de sociologie aussi. L'histoire est toujours la même. Elvis leur est tombé dessus. Souvent quand ils étaient tout petits. Ne s'en sont jamais relevés. N'ont pas vraiment choisi. L'occasion, celle qui fait le larron. Les circonstances qui vous poussent aux fesses. Lorsque la vie quotidienne ne vaut rien, Elvis se révèle être l'ultime refuge. La porte de sortie. La bouée de sauvetage. Quelques prestations par ci par là, ça vous met du beurre dans les épinards, parfois ça paie le loyer, Chris Agullo en vit.

Sont des incarnations subsidiaires. Tout le temps dans leur tête et parfois sur scène. Certains ne vont guère plus loin que leur entourage immédiat. D'autres jamment régulièrement. Quelques uns procèdent par tournées. Ne faut pas rêver. Prennent leur pied sur scène, mais ne sont pas dupes du public. Quelquefois il se passe vraiment quelque chose. La nostalgie étreint le coeur des spectateurs. Mais ils ne doutent pas que l'assistance dans sa majorité s'en foute. Eux aussi. Vivent leur passion. Imaginez un christ masochiste qui trimballerait sa croix avec lui tous les week end parce qu'au fond le fait qu'on le cloue sur le bois lui procure un plaisir à nul autre pareil. Eux aussi ils traînent leur matériel. Perruque, maquillage, costumes. Ceux qui se prévalent d'une penderie pleine, qui se vantent de pouvoir couvrir toutes les époques du King, ceux qui les cousent eux-mêmes, ceux qui n'hésitent pas à lâcher trois mille euros pour une défroque commandée aux Etats-Unis, et ceux qui se contentent du rudimentaire déguisement fourni au vulgus pecum pour les festivités carnavalesques. L'habit ne fait pas le moine. Pour la voix, ils ne s'en vantent guère, deux ou trois insistent sur leur baryton, mais la plupart y vont à l'arrache, à l'énergie. Pour la musique, c'est internet qui fournit les play-back.
Sont des décalés. En ont pleinement conscience. Le mot rock revient plus d'une fois. Prononcé avec gourmandise. L'excuse suprême. Un peu collectionneurs, un peu fétichistes. Certains connaissent des milliers de détails de la vie du King, mais dans l'ensemble ce ne sont pas ce que l'on appelle des connaisseurs. Phantasment beaucoup. La réussite du King et leur propre vie. Mais pas en tant que deux réalités séparées. Opèrent le grand mix. Les proportions varient mais ils sont et eux-mêmes et un peu beaucoup Elvis à la folie. Mais leur Elvis à eux. Ce serait facile de jouer aux pim-pam-poum avec leur trombine. L'on sent une fragilité. Une fêlure. Isabelle Bonnet et Renaud Saint-Cricq la dévoilent. Sans ostentation. Ils ont le sourire et l'écriture pudiques. Journalistes de métier. Ne sont pas là pour déformer, salir ou louanger. Savent informer sans être infâmes. Trouvent le ton juste. La plume qui gratte mais qui n'envenime pas. Derrière ces Elvis, il y a des êtres humains, tout comme eux. Avec leurs grandeurs et leurs valeurs dérisoires si semblables à eux deux, et à nous tous. Se mettre dans la peau d'Elvis équivaut aussi à se déshabiller en public. Je est-il un autre comme l'affirmait Rimbaud ? Ce sont toujours les autres qui nous perdent. Nous ressemblons trop à nos rêves pour nous moquer de ceux des autres. De toutes les manières ils ne sont pas Elvis, ils sont Christian Gill, Eryl Prayer, Freddy Ley, Davy, Franck Danyel, Rick Cavan, Chris Agullo, Jessy Morgan, Marc Davisley, Teddy Boy, Chris Burlow, Phillipe Dubois, Jean-Marie Thomas, Richard Plonski, Jess Wade, Bill Looking, Wally, Tino Valentino. Respectez-les, ils ont le courage d'être ce que vous ne serez jamais. Même Julien Doré qui a écrit la préface a compris.
Damie Chad.
11/01/2017
KR'TNT ! ¤ 311 : OTIS SHOW / HOT CHICKENS / GILLES DALBIS / TONY SHERIDAN + BEATLES / WOODSTOCK / POPPY Z BRITE
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 311
A ROCKLIT PRODUCTION
12 / 01 / 2016
|
OTIS SHOW ( MUDIBU + OTIS REDDING ) HOT CHICKENS / GILLES DALBIS / TONY SHERIDAN + BEATLES / WOODSTOCK POPPY Z BRITTE |
L'Otis show est bien loti
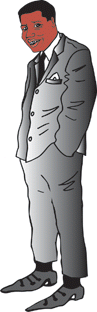
On se doutait bien que ces Anglais allaient faire un carton. Jeunes, sapés sur leur trente-et-un, orgue Hammond, section de cuivres, jazzbass et petite cerise sur le gâteau, un jeune chanteur black investi d’une sacrée mission : rallumer la flamme d’Otis. Quelle équipe et quel bon choix !

Bon choix de la part de l’organisateur qui les a repérés dans un club londonien, et bon choix de leur part, puisque le répertoire d’Otis compte quand même parmi les plus prestigieux de l’histoire de la Soul américaine. Le jeune chanteur black s’appelle Mudibu et il vient du Burundi. Il fait le show, pas de problème.

Ce mec est visité par la grâce : sa façon de danser, sa façon de poser sa voix, sa prestance naturelle, tout est absolument parfait. On a en plus de vraies chansons, des tubes complètement imparables, depuis «Mr Pitiful» jusqu’à «Fa Fa Fa» en passant par «Satisfaction», une reprise fantastique d’«A Change Is Gonna Come» et le grandiose final, l’immense «Try A Little Tenderness», l’un des hits les plus parfaits du XXe siècle. Ce sont eux qui bouclent les festivités du samedi au Vintage Weekender et Mudibu n’en finit plus d’exhorter le public a danser avec lui.

On voit rarement des sets d’une telle intensité. On pense bien sûr au set exceptionnel que donne encore Vigon au Méridien. Ou encore à Lee Fields, cette espèce de bombe atomique à deux pattes.

Voilà donc l’occasion rêvée de revisiter l’œuvre d’Otis. Le seul reproche qu’on pouvait lui adresser était sans doute d’être trop parfait, et trop collant dans ses slows frotteurs. Mais il reste néanmoins un géant de la Soul, au même titre que Wilson Pickett, Solomon Burke et Clarence Carter. De son vivant, le pauvre Otis n’a eu le temps de sortir que six albums, tous enregistrés chez Stax avec les surdoués habituels, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Al Jackson, Booker T. Jones et le trompettiste Wayne Jackson qui vient de mourir, Isaac Hayes, Charles Packy Axton, le fils d’Estelle Axton, co-fondatrice de Stax avec Jim Stewart, en gros, les musiciens qui ont le plus contribué à rendre la Soul légendaire.

Pain In My Heart est le premier album d’Otis paru en 1964. Deux hits s’y nichent : «I Need Your Lovin’» et «Security». Need Your Lovin’ sonne comme un boogie de soul, Otis le chauffe à coups de wow wow wow. Comme il est le seul sur terre à savoir chauffer ainsi un gros popotin, il se rend indispensable. C’est comme si on assistait à une procession de gros culs blacks sous la lune, mais quelle rigolade. Avec «Security», Otis fait danser la planète entière. Il gère sa soul avec une classe infernale, avec un délié qui en impose férocement. On aurait tendance à confondre «Security» avec le «Stupidity» de Solomon Burke. Otis le soul master ne lâche rien, il relance à coups de one more time. Il tape dans d’autres classiques, comme par exemple «Lucille» de Little Richard. Ne touche pas à ça, malheureux ! Il transforme «Louie Louie» en soul garage et le mambotte à la botte. Et puis, il met en route ce qui va devenir son fonds de commerce : le balladif chanté à l’éplorée. «These Arms Of Mine» est cousu de fil blanc comme neige et «Something Worrying Me» semble tiré à quatre épingles : Otis le chante à la continence de la suffisance.

On trouve un gros standard de r’n’b sur The Great Otis Redding Sings Soul Ballads paru l’année suivante : «Here In Your Heart». On se demande ce qu’il fout là, car l’album est essentiellement rempli de balladifs. Otis en profite pour gotta-gotter comme une bête. Mais pas mal de balladifs restent d’une pénibilité sans nom, comme par exemple «Chained And Bound» ou encore «For Your Precious Love» qui ouvre le bal de la B. On dirait qu’il passe son temps à pleurnicher. On a envie de lui dire : fuck, Otis, redresse-toi au lieu de te morfondre dans tes cuts à la con qui ne sont pas dignes d’un Soulman qui se respecte. Mais il insiste et «Come To Me» rampe comme une limace atroce. Heureusement, «Mr Pitiful» sauve l’honneur de cet album. La légende dit qu’on surnommait Otis Mr Pitiful à cause de son côté pleurnichard et Steve Cropper eut l’idée d’en faire une chanson. Duck Dunn y joue une bassline historique. Quel fabuleux backslider !

Paru la même année, Otis Blue est ans doute son album le plus connu. En tous les cas, on y retrouve trois de ses hits fondamentaux, à commencer par le fameux «Respect» que va reprendre Aretha. «Respect» est encore une pierre blanche dans la gueule de Dieu. Quelle merveille pulsatrice ! Ça hey-hey-heyte et ça grouille d’évolutions intestines. En B, il claque le beignet de «Shake». Otis adore ça, il jerke dans le foutraque de Stax. C’est d’une vitalité exceptionnelle. Et puis on trouve plus loin sa brillante version de «Satisfaction» dont Mudibu va se régaler sur la scène du Vintage. Otis l’explose et derrière, les mecs de Stax la chauffent à blanc. On trouve très peu de choses au-dessus d’un truc pareil. C’est tendu et cuivré à l’extrême. Et quand Otis s’énerve, c’est dingue ce qu’il est bon. Attention, ce disque réserve d’autres surprises extraordinaires, comme cette version de «Rock Me Baby» jouée au meilleur blues-rock de Memphis. Otis la chauffe à la criarde du marché de Naples, keep on rocking babe ! Encore un fantastique hommage à Sam Cooke avec une version de «Change Is Gonna Come». Otis la travaille au corps, c’est un teigneux. On sent sa vigueur prisonnière du petit costume serré en tergal. Ce n’est pas fini, car il tape aussi une version de rêve du «My Girl» de Smokey. Otis la travaille à la criarde plaintive et suintante, c’est spécial, âcre et hot, hip et apte. Il s’agit là sans nul doute de son meilleur album.

Encore un très bel album avec The Soul Album paru l’année suivante. Le pauvre Otis ne figure toujours pas sur la pochette. On y met des femmes à sa place. Si on aime le r’n’b gros popotin, alors on est gâté avec «It’s Growing». Ça se danse à sec, sur le beat. Otis épouse bien le serpent de la légende et son ami Steve gratte ça aux accords bien clairs. Quand on écoute «Nobody Knows You», on comprend à quoi sert Otis : à rapprocher les couples désireux d’être rapprochés. Otis incarne mieux que personne la fabuleuse frotterie des sixties, un temps où les ventres se frottaient dans la pénombre des caves surchauffées, pour le bonheur de tous. Otis a vraiment servi à ça, à rendre les ventres heureux. Les esprits, c’est autre chose. Mais il faut bien commencer par le commencement, n’est-il pas vrai ? Et ça continue en B avec «Good To Me». Comme Otis ne porte que des pantalons serrés, il est vite en émoi. Il sait que chez Stax, le beat gonfle dans l’air chaud. Mais ça ne l’empêche nullement d’en rajouter. Bel hommage à Slim Harpo avec une sulfureuse version de «Scratch My Back». C’est d’une sensualité extraordinaire. Du pur sexe - You know what to do ! - Il enchaîne avec un fantastique «Treat Me Right», joué au vieux boogie stomp de juke. C’est un hit, et pas des plus connus, hélas. Otis le ponctue comme un dieu. Il est dessus, il faut voir avec quelle hargne. Otis est un amour. On l’adore.

Il apparaît enfin sur la pochette de The Otis Redding Dictionary Of Soul paru la même année, mais déguisé en prof. Il a l’air d’un clown. Mais l’album n’est pas clownesque, loin de là. «Try A Little Tenderness» se trouve sur cet album, ce qui à l’époque justifiait largement l’emplette. Ce cut légendaire est une sorte d’apothéose de la Soul des sixties. C’est l’universalisme absolu. C’est là que s’exprime le génie d’Otis et ça part à la baguette d’Al Jackson, en bord de caisse. Otis semble joyeux, il mouille bien les syllabes de sa quête, on sent l’homme déterminé et les MGs se mettent en route, alors ça grimpe très vite en température, squeeze her, et Otis devient violent, un sale punk, you gotta too et ça explose, gotta gotta nah anh nah ! Après ça il ne reste plus qu’une seule chose à faire : aller se coucher. Oh, on peut quand même écouter sa belle version de «Day Tripper». Il en fait quelque chose d’infernal, il found out, c’est un monstre, un véritable démon des enfers de la Soul. Quelle leçon ! C’est «Fa Fa Fa Fa (Sad Song)» qui ouvre le bal de cet album et le cut sonne bien sûr comme un classique. Otis règne sans partage sur l’empire du popotin. Avec «I’m Sick Y’all», il passe au heavy groove et monte comme la marée. Il devient inexorable. Otis est vraiment un phénomène à part, une sorte de force tranquille, comme Wendy Rene. En B, il tape un fabuleux heavy blues, «Hawg For You». C’est une façon d’échapper aux deux diktats, celui du slow baveux et celui du beat gros popotin. Otis se révèle un bluesman extraordinaire. C’est là qu’il monte dans l’estime de ses fans, en surgissant là où on l’attend pas. Belle fin de non recevoir avec «Love Have Mercy», un autre hit de r’n’b. Otis remplit le dancefloor quand il veut. C’est un conquérant, un ami fidèle, un homme chaleureux, le meilleur des hommes.

En 1967, il enregistre King & Queen avec Carla Thomas. Alors attention, car une fois de plus, c’est un album indispensable. Il s’agit là d’un des albums les plus sensuels de l’histoire de la Soul. Ils attaquent avec une version torride de «Knock On Wood». Duck Dunn joue en bas de son manche pendant qu’Otis ta-ta-tate et que Carla fait sa chaudasse de voix fêlée. C’est absolument terrifiant de sensualité. Ils retapent dans le mille avec une version magique de «Tramp». Otis et Carla dansent le jerk et se frottent contre le pied de micro. Ils tapent ensuite dans l’intapable, c’est-à-dire «Tell It Like It Is» d’Aaron Neville, le slow super-frotteur par excellence. Otis en bave car il est serré dans son pantalon. Et Carla n’arrange rien, car elle sort sa meilleure voix de nympho. Il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Avec «Lovey Dovey», ils se tapent un bon blast de r’n’b. C’est inespéré, les voilà tous les deux lancés dans le meilleur beat popotin du monde. Encore un hit de juke en B avec «It Take Two». Carla l’attaque sans détour. Elle adore jerker dans sa mini-jupe, elle connaît les mecs de Stax, ils assurent bien et Otis ramène sa fraise très vite, dégoulinant de sueur. Ils rendent hommage à Sam Cooke avec une version hot de «Bring It On Home To Me». Tout sur cet album est prodigieusement inspiré. Ils terminent avec «Ooh Carla Ooh Otis», monté une fois encore au beat popotin, mais il s’agit là du meilleur beat de l’histoire du popotin. Ils sont tous les deux en émoi, Carla fait sa mijaurée, ça trompette dans tous les coins et Otis revient, tous instincts devant. Ce mec génère du sexe, c’est de sa faute.
Après la disparition tragique d’Otis en 1967, Steve Cropper prendra l’initiative de publier cinq albums posthumes et un live, histoire d’alimenter la légende d’Otis.

Rien de tel qu’un album live pour restituer la ferveur d’Otis. Live In Europe est du même niveau que le tribute show de Roubaix : un brouet d’excellence. Et pouf Otis démarre avec une version explosive de «Respect», bien cisaillée par le popotin de la rythmique. Les trompettes sonnent la charge, ça sent la peau noire dégoulinante de sueur, l’énergie vitale du grand peuple noir. C’est chaque fois une révélation divine, une douche écossaise, un choc d’élixir parégorique, un don du ciel, un coup du sort, une dégelée de pâté en gelée et Otis gotta-gotte comme un dingue. Ça repart de plus belle avec «Can’t Turn You Loose», encore plus popotiné du coccyx, c’est même une véritable pulsation du bas-ventre, Otis lâche sa purée à jets continus, il enfonce ses clous de giroffle dans le gigot du mythe de la Soul du Sud, c’est tendu à l’extrême, en vertu d’une science experte de l’hypertension, voilà le wild Stax System à l’œuvre, rien d’aussi hot que ce hit de hutte. Comme Mudibu, Otis reprend «My Girl» avec un immense respect et opère un beautiful retour sur le hey hey hey que tout le monde attend au virage. Retour à la barbarie avec «Shake». Exploser, c’est son truc, Otis ne vivait que pour ça. Et en B, une nouvelle déflagration se produit avec «Satisfaction», évidemment, l’hommage du peuple noir aux Stones, c’est d’une violence incroyable, celle d’un nègre qui se débat dans les chaînes de la soute, même chose avec «Day Tripper», Otis envoie les Beatles danser au paradis de la Soul, et là, on perd tous les repères, Otis explose tout, il dévore le hit d’une seule bouchée, c’est l’ogre noir shakespearien par excellence, le nègre rendu fou par la peur et qui creuse le bois des soutes avec ses dents pour s’évader du vaisseau négrier, Otis shake les chains avec l’énergie de la survie, il suit le mot d’ordre de Malcolm X : la violence est la seule réponse à la violence des blancs. Et puis on finit par tomber sur Tenderness. Otis est épuisé, bien sûr, et pourtant il va réussir à provoquer un dernier orgasme dans les pantalons des petits blancs dégénérés. Otis le géant s’élève doucement sur le fil mélodique d’une belle relation amoureuse, celle d’une homme noir pour une femme noire. Il chaloupe sa tenderness avec une grâce animale. Il entre en territoire humide avec l’aisance du bassin, il sait manœuvrer dans la baie humide d’une femme offerte. Voilà bien la plus belle chanson d’amour physique de tous les temps, et le tempo monte comme dans la réalité, il lime et elle s’émeut, la température monte encore et le public claque des mains, le plaisir arrive, il attend sa compagne, c’mon, gotta-gotta nah nah nah, tenderness yeah yeah, il lui tient les cheveux et il semble que le bonheur explose dans un bouquet final de yeah yeah. S’il faut écouter une version de Tenderness, c’est celle-ci.

Son plus grand hit, sorti sur l’album du même nom, The Dock Of The Bay, fut donc un hit posthume. Pas de chance. Pauvre Otis. Quand on pense au blé que les Thénardiers du disque ont pu se faire sur son dos ! Pour cet album, Steve Cropper a rassemblé des fonds de tiroirs pour le moins extraordinaires, comme cette version magistrale de «Don’t Mess With Cupid». Seul Otis sait marteler le r’n’b avec autant de violence. On a là la meilleure Soul du temps d’avant. Otis semblait même un peu trop doué. On se régalera aussi de «Let Me Come On Home», un fantastique groove du Deep South, joué aux guitares infectueuses. C’est une exception otissienne - Girl I love you honey - L’immense Otis recherchait la modernité, mais avec une vraie chaleur de ton. Et quand on écoute Sittin’, on pense évidemment à Blowfly qui avait transformé ce hit planétaire en Shittin’. En B se niche la version studio de «Tramp», ce vieux classique de Salut les Copains, cette émission de radio qu’on écoutait religieusement dans les années soixante. Encore un coup de maître avec «The Huckle Buck», joué à la good time music du Deep South. Otis y refait son numéro de popotin. Et il termine avec un «Ole Man Trouble» dégoulinant de feeling et gluant de cuivres.

On reste dans la veine posthume avec The Immortal Otis Redding paru aussi en 1968. Nous voilà de retour dans l’Otisserie de la Reine Pédauque. Le hit de cet album pourrait bien être «Hard To Handle», un r’n’b sauvage à la Otis. Il rappe bien son texte. Encore un joli classique avec «The Happy Song», chanté à la glotte fêlée. Bien qu’il soit mort et enterré, Otis reste un modèle du genre. Mais l’album propose surtout des balladifs plaintifs. Otis les chante à la sueur de son front. Comme Sisyphe, il pousse son rocher sur la pente d’une montagne. Avec ce disque, on sent une très nette baise d’intensité.

En 1968, l’Otisserie de la Reine Pédauque tournait à plein régime. In Person At The Whisky A Go Go se présentait comme une nouvelle invitation au voyage. Comment le fan de base pouvait-il résister à ça ? On y retrouvait de belles versions de «Can’t Turn You Loose», «Mr Pitiful», «Satisfaction», et c’est là où les charognards du disque sont malins, on trouvait en B une version de «Papa’s Got A Brand New Bag» qui n’existait pas sur les autres disques et qui à elle seule justifiait l’emplette. Otis y piétine les plate-bandes du grand James Brown. En a-t-il les moyens ? Quel en est l’intérêt ? Force est d’admettre que Mr Dynamite fait ça bien mieux. Otis s’épuise, il ne tient pas la distance, il got-it got-itte comme un dératé, mais ça ne va pas. Un sax vole à son secours. Ne touche pas à ça, malheureux !

L’année suivante paraît Love Man. Encore un album qui vaut le détour pour un titre en particulier : «Look At That Girl». Il s’agit là d’une sorte de mambo, une pièce de Soul magique. Otis la chauffe à l’énergie pure. Il redevient l’espace de trois minutes le géant de la légende, celui qui fascina tant Janis Joplin. En fait ce disque regorge de merveilles, à commencer par l’«I’m A Changed Man» d’ouverture, un beau groove tapageur. On y retrouve l’Otis impérial et combatif qu’on a tant admiré. Il finit son cut en insistant lourdement sur les nah nah nah, comme il sait si bien le faire. Tout aussi attachant, voici «(Your Love Has Lifted Me) Higher And Higher», softé à la basse alerte, dansant et plein d’avenir. Cette fois, la basse donne la respiration. Oh il faut aussi écouter le morceau titre qui est un fabuleux hit de juke - I’m a love man/ Call me a love man - Otis avait une qualité de Soul qui lui était propre. Le «Groovin’ Time» qui ouvre le bal de la B concasse bien le beat. On retrouve cette Soul ramassée sur elle-même, qui est un peu la marque de fabrique d’Otis. Encore du r’n’b de haute volée avec «Got To Get Myself Together» cuivré de frais. Otis nous ramène au cœur de l’empire de la Soul avec ce hit teigneux. Et puis avec «A Lover’s Question», on comprend qu’Otis ait voulu se battre jusqu’au bout. Il recherchait la clé de la Soul la plus frénétique et il y mettait toute son énergie.

Sur Tell The Truth, vous trouverez un autre coup de génie intitulé «I Got The Will», pris à l’angle d’une pop de Soul. Otis travaille toujours à la dure, mais cette fois, il le fait en mélodie. Il trouve enfin le moyen de sortir du popotin. D’autres très beaux cuts guettent l’imprudent visiteur, comme par exemple «Demonstration». Otis n’y cherche ni l’éclat ni l’esclandre, il veut juste gotta-gotter la mama. Avec «Out Of Sight», il tortille sa petite Soul des enfers. Otis ne renonce jamais et le côté rampant du cut vient de la petite guitare infectueuse de Steve Cropper. Puis il commence à s’énerver avec «Give Away None Of My Love». Il revient à sa chère vieille âpreté, puis il passe au boogie joyeux pour «Wholesale Love». Il vise l’unisson de la Soul à trompettes. Voilà encore un cut passionnant. On sent le chercheur à l’action. Otis sentait qu’il devait trouver une voie pour évoluer. Ce disque ressemble à un laboratoire. Et les résultats de ses recherches étaient réellement prometteurs. On n’ose même pas imaginer ce que des mecs comme lui ou comme Jimi Hendrix auraient produit s’ils avaient pu continuer à vivre. En B, on tombe sur un «Little Time» surchauffé et tenace, vraie perle de petite Soul exacerbée. Otis est comme ce boxeur qui ne veut pas se coucher, il va se battre jusqu’à la mort. Avec «Swinging On A String», il lutte jusqu’à son dernier souffle.
Signé : Cazengler, Otiste
Otis Show. Vintage Weekender. Roubaix (59). 12 novembre 2016
Otis Redding. Pain In My Heart. ATCO Records 1964
Otis Redding. The Great otis Redding Sings Soul Ballads. Volt 1965
Otis Redding. Otis Blue. Volt 1965
Otis Redding. The Soul Album. Volt 1966
Otis Redding. The Otis Redding Dictionary Of Soul. Volt 1966
Otis Redding & Carla Thomas. King & Queen. Stax 1967
Otis Redding. Live In Europe. Volt 1967
Otis Redding. The Dock Of The Bay. Volt 1967
Otis Redding. The Immortal Otis Redding. ATCO Records 1968
Otis Redding. In Person At The Whisky A Go Go. ATCO Records 1968
Otis Redding. Love Man. ATCO Records 1969
Otis Redding. Tell The Truth. ATCO Records 1970
TROYES / 06 – 01 – 2017
LE 3B
HOT CHICKENS
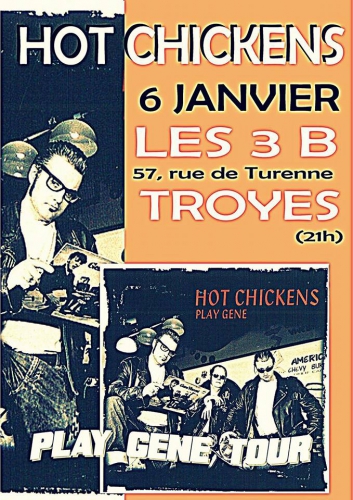
Pas question d'attendre que les poulets vous tombent tout rôtis dans la bouche. Mais il y a la grande offensive verglacée du Général Hiver prévue pour la nuit du retour par le communiqué d'alerte de la Météo Nationale. Brr and Grr ! Vision d'horreur de la teuf-teuf- mobile dérapant sur la route verglacée... J'étudie les prévisions avec soin, la route entre Provins et Troyes devrait être libre de toute froidure jusqu'au petit matin. Ce qui s'appelle jouer avec le feu. Bon, la dernière glaciation remontant à huit milliers d'années, l'on peut raisonnablement escompter que la suivante attendra bien un jour de plus. Mais il est des exigences impérieuses qui font fi des plus élémentaires et prudentiales conduites. Voici un mois que j'ai décidé de profiter du concert des Hot Chickens dans la bonne ville de Troyes pour ramener à la maison la réédition de CD Play Gene, avec la version de Bird Doggin'. Pourrait pleuvoir des icebergs que j'irais quand même.
Ce ne sont pas de sinistres et stupides prédictions météoriales qui seraient capables d'arrêter un rocker ! En plus, non d'une chaussette d'archiduchesse, chaussée aussi sèche que la vieille mue d'un crotale gisant depuis vingt ans dans le sable aride de la Vallée de la Mort ! La foule des grands jours au 3 B, plein comme un oeuf de crocodile. Toute cette noble assistance a eu raison de se déplacer car foutredieu et foutrevierge ( jurons préférés des moins cénobites ) quel concert !
FIRST SMACK

Gene à l'honneur ! I flipped et cette sale Race with the Devil, d'entrée de jeu, Christophe Gillet qui agite le damier de son sweat-shirt pour mettre le feu aux poudres, Thierry Sellier en chemise hawaï-aï-aïe qui se livre à des dérapages incontrôlés sur sa batterie et Hervé dans sa veste saumon rose bondissant dans les torrents qui encrasse le moteur de la contrebasse, le public répond au quart de tour, mais pas la mécanique qui n'en peut déjà plus après deux morceaux, Loison change la bougie du micro, rien à voir, la panne serait-elle sérieuse, la salle rit aussi jaune qu'un taxi new-yorkais, pas d'affolement, pas la peine d'en péter un, c'est le câble le coupable qui nous accable. Ordre et méthode, Hervé tire de derrière les amplis un imbroglio de fils et le secoue vertement pour en tirer le cordon salvateur qui consent à la refaire circuler la dive électricité sans laquelle le rocker recule d'un cran dans l'histoire de l'évolution des espèces en redevenant un misérable folkleux.

Skinny Jim et Jenny Jenny, pur jus cochranesque, Hervé module les nodules timbriques, la grosse voix, et la méchante, la vicieuse et la menaçante, la tragique et la clownique, un festival en deux fois trois minutes, le rock des pionniers réside dans l'intonation, Shakespeare drames et comédies en cent vingt secondes, du grand art, pas à la portée de tout le monde, faut d'abord capter l'esprit pour le restituer, surtout si à côté de vous, vous avez un Christophe

Gillet qui profite de la moindre de vos respirations pour envoyer une giclée de guitare, juste pour vous pousser dans vos retranchements.

Ce soir Thierry est facétieux, joue au cat qui se lave les oreilles avec sa patte, lui c'est avec la baguette qu'il fait mine de se peigner d'un geste ample et emphatique, pourquoi ne pas prendre le chemin le plus long puisque au final il arrive pile poil à la seconde pour baisser la barrière du passage à niveau juste à temps pour vous éviter d'être happé par le rapide de 10 h 15 en partance pour Lubbock. Rave on, de Buddy Holly, ce n'est pas de la rave have dans le potager du rock and roll, plutôt de la mauvaise herbe qui moutonne dans votre gorge, impossible d'entendre cette pépite, de Sonny West à l'origine, sans avoir envie de faire les choeurs par derrière, et toute la salle pousse des aums dignes d'anachorètes bouddhistes en transe vocale, je ne vais pas vous faire toute la set-list, d'abord vous la connaissez tellement que vous ne vous en souvenez plus, bien sûr Les Hot Chickens y joignent quelques compositions originales comme ce Downtown Memphis, je préfère voir et écouter.

Hervé qui jette sa veste, Hervé qui se vautre par terre, couché sur sa contrebasse, puis dessous – je vous en prie éloignez les enfants qu'ils n'assistent pas ce sexpectale – Christophe qui hurle le contrechant dans le micro, et puis se plante devant et vous envoie de ces soli style commandos de la mort qui vous détruisent les dernières parties de votre cerveau en marche et Thierry par derrière qui transforme sa grosse caisse en kolossal Bertha et qui vous arrose méchamment ( mais fort systématiquement ) d'obus dans le seul but d'effondrer vos cartilages et désamorcer les canaux par lequel passe votre influx nerveux.

Il y a un problème avec les Hot Chickens. C'est qu'ils ne savent pas mettre un terme aux ouragans qu'ils ont déclenchés. En une heure, ils vous ont donné la correction que vous méritez. Normalement l'arbitre devrait arrêter le combat. Mais ce diable de combo vous a transformé en victimes consentante. Vous file le double dessert, le plateau à fromages, le café, le digestif, la triple remorque et la petite gâterie finale. Et évidemment comme les enfants mal-élevés, gâtés et pourris jusqu'à l'os à moelle que êtes, vous trouvez cela normal, et tout à fait évident qu'Hervé vous propose de boire un verre parce qu'ils vont recommencer dans un quart d'heure.
SECOND SMACK

Finies les choses sérieuses. Serait temps de passe au crazy roll. Jusqu'à maintenant nous n'avons eu droit qu'à une innocente partie sur les plages de la baie de Baïes. Premières scènes insouciantes et souriantes. Soleil, amour et beauté. Nous abordons la deuxième partie du scénario. L'éruption du Vésuve, la mort de Pompéi, filmée en gros plans, la panique dans les rues, la foule qui hurle rattrapée par les torrents de lave sans pitié qui s'enroulent autour des corps comme des serpents de feu. Petit problème dans le casting, le volcan cruel ce sont les Chickens fous, et les figurants anonymes destinés à vous tordre de douleur c'est vous. La contrebasse d'Hervé a disparu, l'a récupéré une simple guitare qu'il tient comme une hache d'abordage. Tout à l'heure l'a déjà sorti ses harmonicas, mais le show débute d'abord par trois secousses telluriques, coup sur coup séquence Gene Vincent – Hervé totalement fou qui nous offre un Rocky Road Blues dévastateur, en position arquée, les yeux levés vers le ciel, la jambe passée par-dessus le micro – séquence Johnny Burnette – juste le temps que Christophe Gillet nous montre tout ce que nous ne saurons jamais faire avec une guitare - séquence Little Richard – Thierry Sellier nous dévoile un de ces secrets, baoum ! un coup de marteau je marque le temps, facile, c'est après ou plutôt exactement dans la même frappe, je drope vers le haut et j'insuffle l'énergie nécessaire pour que le rebond passe entre les poteaux, plus difficile.

Qui a eu dans le public l'idée géniale de réclamer un Bo Diddley, je ne sais pas, mais là le genre de proposition que le Hot ne saurait refuser, Thierry nous donne le tempo sauvage style lourdeur africaine d'un troupeau de rhinoféroces qui fonce sur vous et vous piétine allègrement just for fun, Christophe vous ménage de ces breaks de guitare façon dentition de tigre qui se referme sur votre jambe ( la droite ), mais vous n'avez que faire de ces innocentes bestioles, vous êtes une tribu de pygmées en transe au fond de la forêt équatoriale qui reprend en choeur la parole sacrée et envoutante du grand sorcier, Hey Bo Didley, un chant primitif pour aiguiser la colère des éléphants. Et puis au loin, retentit les douces fragrances d'un harmonica, oui c'est dans le public, et Hervé lui donne le micro et c'est parti pour un safari sauvage à la Animals.

Jusque là tout va bien. Vous ne savez plus très bien qui vous êtes mais vous avez encore la sensation d'être vivant. C'est sur True Fine Mama que votre monde bascule. Hervé se déleste de sa basse, nous fait un looping arrière sur la grosse caisse, avec les jambes en l'air et dont il ressort tout fier et ensanglanté, l'est devenu sorcier vaudou, nous fait répéter après lui des mantras diaboliques qui empêchent l'oxygénation de votre cervelle. Plus vite, plus fort, plus rapide tu meurs, et nous voici transformés en morts vivants, personne ne sait plus ce qu'il fait, ça danse par devant, ça ondule contre les murs, et ça hurle par derrière. Stop clap de fin. Plus d'une heure de folie collective. La récréation est terminée. C'est alors que surgit le mur d'incompréhension. Pas un mot, pas un cri. Tout le monde immobile en plein milieu d'un mouvement brutalement interrompu. Les Hot Chikens eux-mêmes ne comprennent plus. Subitement ils se rendent compte qu'ils ont cessé de jouer. Quelqu'un a arrêté l'appareil de projection. Serait-ce la fin du monde ? Le film coupé en plein épisode. Trop tôt, bien trop tôt. Trop bête. Et alors la machine se remet en branle pour une bonne demi-heure de folie. Vous reprendrez bien un peu d'épilepsie ? Elvis, Jerry Lou et Duduche impérial qui s'adjuge le micro pour That's All Righ Mama.

Un petit country issu de Father and Sons, d'Hervé dédié à ses petits-enfants pour redescendre sur terre et rentrer doucement dans notre chair d'être humain, nous anges déchus, mauvais mâles et femelles charnelles, qui étions si haut dans le ciel du rock and roll, poussés au cul par les rafales cinglantes de Mister Gillet, tamponnés par les bordées de mitraille de Mister Sellier, marchant sous l'égide des imprécations gospelliques de Mister Loison, presque arrivés aux portes du paradis.
Damie Chad.
P. S. : Retour route sèche.
( Photos : FB Christophe Banjac et Béatrice Berlot )
HOT CHICKENS
PLAY GENE
RACE WITH THE DEVIL / LOTTA LOVIN / BLUES STAY AWAY FROM ME / SAY MAMA / I FLIPPED / HOLD ME, HUG ME, ROCK ME / TEENAGE PARTNER / BLUE JEAN BOP / AIN'T THAT TOO MUCH / BABY BLUE / CRAZY LEGS / I'M GOING HOME / + STILL BOP ( 2002 ) + AIN'T THAT TOO MUCH ( 2012 ) / + RIGHT NOW / BIRD DOGGIN' / ROCKY ROAD BLUES / I'VE GOT MY EYES ON YOU / ( 15 / 11 / 2016 ).
15 / 11 / 2016 : Hervé Loison : chant / Christophe Gillet : guitare / Thierry Sellier : batterie / Fabice Mailly : Harmonica / Hubert Letombe : Basse + son

Longtemps j'me suis pieuté pas très tard. Va falloir attendre les gars j'ai décidé de réécrire à ma manière La Recherche du Temps Perdu du petit Marcel. Huit mille pages, vous parlez d'un boulot ! Ah ! vous jugez ma tentative condamnée d'avance à l'échec et me conseillez-vous d'arrêter au plus vite. Vous avez peut-être raison, je reviens à mon projet de chronique initial. Remarquez que c'est un peu le même genre de tentative prométhéenne, des fous furieux qui décident de donner leur version de quelques morceaux de Gene Vincent, il n'en manque pas. Le cristal sauvage de la voix de Gene, la guitare galopante de Cliff Gallup et les glissendi de Dickie Harrell, faut oser. C'est comme l'intro d'Albertine disparue, difficile de proposer et de proser aussi bien. Nous ne parlons pas de mieux. Pour Gene, prenons par exemple Crazy Legs de Jeff Beck à la guitare et Mike Sanchez au guitare, z'ont tout fait pour la reproduction à l'identique, pourtant voici plus de deux mille ans que les philosophes grecs nous avaient prévenus, le Même n'est qu'une incertaine figure mouvante de l'Autre projetée sur le mur de nos cavernes mentales. Alors si vous jugez ce disque à son modèle inspiratif vous risquez d'être déçus.
N'empêche que les Hot Chickens, doivent en être assez fiers, puisqu'ils rééditent. En rajoutent même une demi-ration pour vous faire comprendre qu'ils ne regrettent rien. En plus sont des récidivistes, n'avaient pas terminé leur opus qu'aussi sec ils avaient recommencé avec Johnny Burnette et Little Richard. Des gars qui n'hésitent pas à repeindre les statues vénérées de leurs idoles à leurs couleurs. Bonheur par qui le scandale arrive, est-il écrit dans l'Evangile du Diable. Pas besoin de s'agenouiller pour témoigner son respect hommagial. Alexandre le Grand n'a-t-il pas fait élever des colonnes pour borner et marquer son avancée sur les traces de Dionysos ?
Race with the Devil : plus près du mal vous ne trouvez pas, la descente cordique qui taille des marches dans les falaises de marbre et Loison qui exige des pizzicati au burin. Lotta Lovin : Le combo à fond et Hervé qui contient la charge pour mieux lancer l'attaque au grand galop. Attention les gars, c'est moi qui commande. Blues Stay Away from Me : pas de chance le blues n'écoute pas, le suit à la trace, lui colle à la peau. Comment transformer une chansonnette en truc poisseux. Zut, disait Moaravagine, en claudiquant sur une merde de chien, j'ai marché sur la face de dieu. Une petite vérole des plus sympathiques. Say Mama : un de ces titres que nous frenchies adorons plus que tous les autres peuples du monde. Les Chickens vous l'enlèvent comme les hussards la redoute de Borodino. I Flipped : Encore un truc nauséeux, genre cancer qui vous ronge le larynx, ce qui vous oblige à vous arracher des morceaux d'oesophage, juste pour survivre. Merci de l'ordonnance doctor Gene. Hervé chante comme un grand. Hold me, Hug me, Rock me : une interprétation somme toute pré-sixties en ses quinze premières secondes, ensuite c'est le charivari, vocal, guitares et choeurs lèvent les guiboles au plus haut comme les filles du Moulin Rouge. Pour stopper la prise on a certainement dû les arrêter à la chevrotine. Teenage Partner : adorable ballade post-nubile mais la petite garce s'est barrée, la chasse s'organise, la batterie entonne le chant de la nostalgie à coups de merlin. Blue Jean Bop : encore une romance à l'eau de rose en ces débuts, rassurez-vous les Hot n'ont pas oublié de rajouter les épines au bouquet. Plus ça pique et plus ça entre, plus c'est bon. Ain't that too Much : vachard, un régal vocal, ça monte et ça descend comme sur le grand huit de la mort, interminable, ne ressemble en rien à la version de Gene mais la plus proche de toute celles entendues à ce jour. Baby Blue : un must, le premier morceau de hard rock jamais enregistré, Hervé et ses Hot vous le déclinent comme à la scène, une espèce d'offertoire religieux païen, un hymne sacré qu'ils assènent comme le grand Thor sa philosophie à coups de marteau. Crazy Legs : une guirlande de guitares, la voix n'est qu'un jeu pour mettre le combo, qui ne rate pas l'occasion, en valeur. La plus géniale partie de jambes en l'air de l'histoire du rock and roll. I'm going Home : encore une des sucreries préférées des froggies. Précédé d'un brouillonnement de guitare qui bondit comme un isard qui dévale une montagne de rocher en rocher et Hervé qui saute sans parachute pour lui montrer le chemin. Still Bop : un original qui s'amuse à recopier le style du maître, ses tics et ses manières, et qui pour les paroles jongle avec les titres. Bien enlevé, ne jure en rien avec tout ce qui précède. Ain't That too Much : on prend la même et l'on ne recommence pas. C'est bon comme une barbe à papa à l'acide. En plus, une pointe de colorant interdit à la vente. Right Now : à toute vitesse la voix qui file, l'orchestre qui s'enfile dans la trouée et les choeurs qui surfilent le patchwork, en dix ans la voix d'Hervé en gagné en taquine flexibilité. Bird Doggin' : la moiteur des nuits vides et solitaires. Très beaux éclats d'harmonica, la basse qui gronde et la guitare qui strille, le genre de titre que l'on ne surpasse pas, Hervé suit Gene à la trace. Ne s'en écarte pas. Hommagial. Rocky Road Blues : tout le contraire, Hervé hoquette et le band pulse à mort. L'on mise sur la rapidité. Avec une affinité country plus marquée. Une réussite. I've Got my Eyes on You : une esthétique de la légèreté. La voix qui survole et l'accompagnement qui dévale, mais dans le pont l'orchestre alourdit la mise en rase-mottes pour définitivement s'envoler sous l'impulsion d'Hervé.
A écouter sans fin.
Damie Chad.
POEME POUR GILLES DALBIS
PATRICK GEFFROY YORFREG
( CONCERT à BEDARIEUX ( 34 )
EXPOSITION CLAUDE ABAD )

Il avance comme un chat autour de ces peaux de métal , et c'est un tigre de feu qui sort de son tambour ....
Il trempe ses doigts dans de l'eau bénite et son corps tout entier épouse une rivière ...
Dans son filet : des poissons harpes , des gongs soleils , une armée de guerriers Mayas ,
un Dieu cristal, des étoiles qui dansent , des pétales de tessons de bouteilles aux sons de stalagmites ,
une caravelle aux quatre mâts ;
Pint , pinta , macatumta , ticata toum ta ticata toum tacata dimi toum mitacatoumta ...
il ferme les yeux :
Anaconda royal , et glisse dans l'impossible voie , la voie royale, celle du sacre de l'improviste ....
On ouvre les portes du palais, ivre de matière sonore ...
il danse une Forlane à la vitesse de nos cœurs...
la fiancée du cymbalier en ombre sur le mur du centre d'art contemporain de Bédarieux ...
Son âme cathédrale rêve d'antique toccatas ....
ouvre un paradis de feu dans l'espace blanc d'une ville d'Occitanie,
lumière, lumière d'or , nos corps se tortillent , se dandinent, se tordent , s'élastiquent ,
se perdent, s'arc-boutent comme ils peuvent...et pourtant, et pourtant , rien
ne bouge dans le désert des barbares ,d'un bord à l'autre rien ne bouge , que la cascade timbalique
du haut de ses baguettes océane...
Car tout bouge au- dedans de soi , au- devant de vous , à la vie qui commence , caravelle au départ ,
en route vers le sublime , l'inouï , l'improbable , à l'extrême du monde de l'extrême-occident ,
à l'extrême limite de la gesticulation spasmodique de la main sur le fût :
syllabes de silences , hiéroglyphes de pattes d'oiseau dans la nuit fiévreuse de l'hiver...
Parfums d'éternité ...
IL offre une corbeille de fruits au royaume des oiseaux de nuit car il ignore le vertige des hauteurs ...
il est le vertige au ventre tambour .
A ces coups de gongs les montagnes noires de l'Espinouse reculent.
Partrick Geffroy Yorfreg ( Mars 2011 )
Magicien des temps modernes le percussionniste Gilles Dalbis montre la voie, la seule, celle qui lui ressemble . Il chante le monde à l'instant même qu'il le découvre, et le monde tremble et danse avec lui pour sa plus grande joie. Compositeur et concertiste, né en 1953 à Montpellier, Gilles Dalbis joue sa musique, et se consacre à la musique improvisée. Voir FB de l'artiste.
*
N'en ai pas fini avec mes aventures mirapiciennes. Ce coup-ci la scène se passe encore sur le marché du lundi, mais devant le camion du Gibus. La conversation est enflammée. Les passants s'en mêlent et rajoutent leurs kilos de sel. Le sujet est grave, Grandeur et Misère des Rolling Stones, tout cela devant un coffret de cinq 33 tours des Pierres qui roulent. Final repartirai avec un CD des Beatles. La vie est injuste. Mais c'était cela ou un trente-trois de Burt Blanca. Je ne sais pourquoi mais chaque fois que je chine à Mirepoix, tombe toujours sur des gravures de Burt. Devait y avoir un sacré fan-club dans le coin dans les années 60 !
Revenons-en à nos scarabées. Pas une pièce rare. Une réédition, des Editions Atlas ! La discographie du pauvre. Je spécifie, pas exactement nos plus célèbres coléoptères mais cela a été si souvent présenté comme le premier enregistrement des Beatles, en fait se contentaient d'accompagner Tony Sheridan.
TONY SHERIDAN ET LES BEATLES
WHY ( CAN'T YOU LOVE ME AGAIN ) / CRY FOR A SHADOW / LET'S DANCE / YA YA / WHAT'D I SAY / RUBY BABY / TAKE OUT SOME INDURANCE / SWEET GEORGIA BROWN
Ce n'est pas la première fois que les Beatles entraient en studio. Avaient déjà mis quinze morceaux en boîte lors de leur audition chez Decca le premier janvier 1962. Un coup pour rien, Brian Epstein ne parviendra pas à fléchir le refus de la maison de disques. Le groupe retourne à Hambourg, reprendre la galère des soirées interminables à jouer dans les clubs. Faute de grives l'on se contente de merles, la deuxième opportunité s'avère moins appétissante : sont choisis en tant que backin'group sous le nom de Beat Brothers par Tony Sheridan. Les enregistrements commenceront le 24 mai 1962. Beaucoup de flou sur l'attribution des pistes instrumentales enregistrées exactement par nos quatre compères, attention Ringo n'a pas encore remplacé Peter Best, prudemment Atlas reprend les titres du cd Charly, intitulé Tony Sheridan and the Beatles – Hambourg 1961. Il existe aussi quelques titres de Sheridan et des Beatles sur scène au Top Ten.
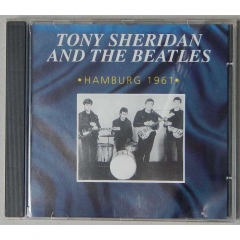
Sheridan est un des derniers pionniers du rock anglais. Fut submergé par la beatlemania. Fallut attendre sa mort en 2013 pour que Rock'n'Folk lui consacrât un bel article hommagial. A Hambourg l'était aussi reconnu pour sa dextérité de guitariste. Ironiquement sa gloire repose aujourd'hui sur ce groupe qui l'accompagna. Y avait aussi un saxo et un pianiste. La postérité est parfois cruelle. D'autant plus que ce qui ressort de ces huit titres ce n'est pas la folle originalité de l'accompagnement des Beatles – l'instrumental Cry for a Shadow démontre une telle maladresse par rapport à l'aisance des Shadows si malencontreusement évoqués - mais l'énergie déployée par Tony Sheridan. J'omets évidemment Why, une de ces bluettes typiquement fifty- chansonnettes. Certes Sheridan n'a pas le phrasé rock instinctivement américain d'un Cliff Richard mais il possède cette manière de lancer le morceau en trombe, cette façon si impétueuse de donner à chaque reprise du vocal ce coup de trampoline ascendant dont Lennon a su s'inspirer. A cette différence près que Lennon apprendra vite à flexibiliser son flow, comprenant que parfois il vaut mieux écraser la voix que chercher le passage en force à la Sheridan comme dans Ruby Baby. Tony réussit le mieux quand il essaie d'imiter le timbre Elvis sur Take Out Some Insane. Lui manque cette flexibilité harmonique que les Fab Four auront emprunté à Buddy Holly. Quant à sa version de Sweet Georgia Brown malgré son piano mi-boogie-mi-Jerry Lou, elle est l'exemple parfait de tout ce qui manque à un rock and roll qui aurait oublié ses racines noires. En juin de la même année, dans les studios d'EMI les Beatles essayaient de trouver du nouveau sur Love Me Do. Garderont tout de même le style de cette attaque vocale sheridanienne sur un tempo instrumental enlevé. Pour dépasser le maître, faut d'abord reconnaître et emprunter les meilleurs éléments de son savoir-faire.
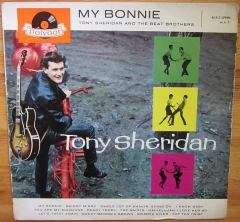
Damie Chad.
HÔTEL WOODSTOCK
ELLIOT TIBER
( Editions Alphée / Jean-Paul Bertrand - 2009 )
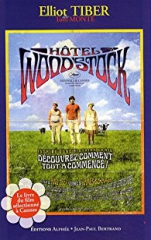
Ça m'a rappelé Plom-Plom. Ne cherchez pas, vous ne connaissez pas. L'était facile à trouver Plom Plom, au Café de la Poste, devant le comptoir. L'avait de la descente. C'était la moindre de ses qualités. Un taciturne. Prolo et plâtrier. Rien à voir avec l'intello du coin. Mais quand l'occasion s'y prêtait – une omelette aux champignons des prés cueillis sur la pelouse du terrain de foot municipal et une bouteille de vieux Bourgogne – il déployait une verve d'écrivain. Savait raconter, un peu à la manière de Swift et de Sterne, desquels il ignorait jusqu'à l'existence. Puisait ses anecdotes dans sa propre vie. Les sortait toute crues. Mais avec ce léger décalage, cette position oblique, cet infinitésimal soupçon d'exagération qui vous transmue les lourdeurs du réalisme socialiste en épopée burlesque. La Marine Nationale aurait dû l'embaucher pour remplir les coursives de ses navires de volontaires exaltés. L'avait ses classiques dont on ne se lassait jamais et qu'il répétait complaisamment avec ses minuscules variantes aussi acides que tout le sel de la mer. Pendant que le porte-avions fendait fièrement les flots tumultueux des Océans, Plom Plom fumait les cigares du capitaine à même la cabine du Pacha, autre classique, son plus grand fait d'arme, le déclenchement de l'alerte nucléaire nationale pour avoir par une innocente inadvertance bousculé l'orientation des antennes radars et radio du bâtiment subitement privé de ses précieuses esgourdes...
Idem pour Elliot Tiber. Je ne peux confirmer ses dires, réécrit sûrement l'histoire à son avantage, donne sa version des évènements que les principaux protagonistes ne confirment pas. Mais l'on s'en moque. Ne se prévaut nulle part d'une prétention d'historien. Nous conte sa vision à lui. D'une manière fort joliment troussée. Ce sont les plumes du croupion de l'autruche qui attirent le regard. S'est fait aider par Tom Monte. Célèbre aux Etats-Unis, le gars qui a pondu moult bouquins, juste pour vous apprendre à adopter la positive attitude celle qui vous permet d'éviter le cancer du sein ( ceci pour les dames ) ou du colon ( cela pour les messieurs ) avec tout le baratin écologique à la mode. L'en a vendu des millions, preuve qu'il savait s'y prendre pour entourlouper la crédulité des jeunes cadres dynamiques de l'american way of life.

Pour la partie strictement musicale du festival de Woodstock, je serais vite traité de plagiaire si je vous dressais la liste des artistes venus pousser la chansonnette sur la vaste scène. C'est qu'Elliot Tiber se contente de recopier le programme. Une demi-page, pas plus. Il y a bien quatre paragraphes sur la prestation de Richie Havens, mais il apparaît clairement pour qui l'a visionné qu'il a commenté les images du film et non rapporté le témoignage personnel de sa participation à l'évènement. De fait dans son bouquin il ne parle exclusivement que de lui. Pas du tout parce qu'il serait atteint d'une melonite aigüe, mais en tant que représentant lambda de sa génération, d'une époque. Aujourd'hui disparue. Point parce que cinquante ans se sont presque écoulés depuis mais parce que les mentalités ont changé. Pensez que la génération Woodstock qui aujourd'hui tourne autour de ses soixante-dix balais est la même qui a voté en masse pour Donald Trump... Rebelle un jour, mais pas toujours. Z'ont perdu leurs cheveux et leurs idées longues...
Elliot Tiber se raconte. L'est né en 1935 – la même année qu'Elvis Preslay et Gene Vincent. Dans une famille pauvre et juive, le père qui se crève au boulot et la mère dominatrice, très peu maternelle, rongée par une stupidité sans faille et une cupidité sans scrupule. Un portrait peu flatteur qui vire à la caricature. Ecrivez cela de nos jours et vous êtes immédiatement traité d'antisémite. En plus, Tibert aggrave son cas, ne manifeste aucun respect pour l'aspect religieux de la judéité. Dénonce l'hypocrisie de la religion sans complexe. La famille acquiert un motel dans la région de Béthel à cent trente kilomètres de New York, un coup de tête de la marâtre qui vire au désastre financier.
Mais Elliot à d'autres chats à fouetter. A commencer par lui-même. Son orientation sexuelle – l'initiation débute très tôt dès l'enfance dans les salles noires des cinémas – se précise, adepte d'une sexualité fortement teintée de masochisme. Homosexuelle, pour rajouter une deuxième couche. Une vie en marge qu'il cache à ses géniteurs. Comprend très vite son intérêt : bien travailler à l'école pour fuir son milieu étouffant. Y parvient, non sans difficulté. Devient artiste, décorateur d'intérieur, professeur d'art, vit à New York, rencontre Tennessee Williams, Truman Capote, Marlon Brando, Rock Hudson, tous pédés comme des phoques, comme des milliers d'autres anonymes, qui se cachent, qui baisent en tapimini, qui subissent injures et insultes quotidiennes, qui sont la proie des flics. N'hésite pas à comparer la situation des homosexuels à celle des noirs. Des parias, des citoyens de seconde zone.
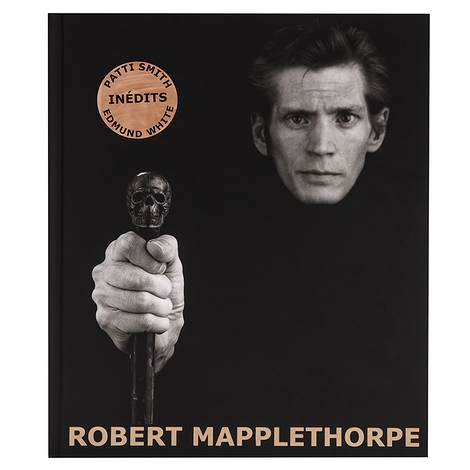
Apparition d'un personnage que nous avons croisé dans le Just Kids de Patti Smith. L'en dresse un portrait très différent, n'est plus ce jeune homme ultra-sensible des mémoires de la chanteuse, John Mapplethorpe est le photographe célèbre celui par qui le scandale arrive, ses photos trash sur les relations sexuelles des gays scandalisent et ouvrent de force les yeux de ceux qui refusent de voir. Mâle dominant qui soumet ses partenaires à de fortes émotions. Tibert théorise quelque peu cette violence des rapports, il la décrit comme une transcription libératoire des années passées à se cacher, à raser les murs, à faire profil bas pour ne pas se faire remarquer.

Woodstock oui, mais la fête commence par un autre événement auquel il assure avoir participé. L'intervention de la police dans la discothèque du Stonewall le 28 juin 1969. Mais cette fois les homos ne s'enfuient pas la queue entre les jambes, attaquent les flics, renversent leurs voitures en entonnant le slogan Gay Power ! Une chaude soirée, désormais rien ne sera plus comme avant, le carcan de l'hypocrisie sociale et puritaine prend un sacré coup dans l'aile.
La vie d'Elliot Tribert possède sa face cachée. Régulièrement le week end il rend visite à ses parents, les affaires marchent mal, le bon fils investit ses gains dans le motel à fonds perdu. Fait feu de tout bois, rajoute des chambres, creuse une piscine, un gouffre sans fond. Les pèquenauds du coin le nomment à la tête de ce qui chez nous s'appelle la Chambre du Commerce. L'on compte sur lui pour re-dynamiser les activités locales. L'en profite pour s'octroyer un permis pour son festival culturel qui n'attire personne à part une famélique troupe de théâtre et la demi-douzaine de groupes de rock locaux qui ne drainent aucun public...
C'est là que tout va basculer. Lorsqu'il apprend en lisant le journal que le Festival de Woodstock à quatre-vingt kilomètres de son bled se voit privé de son autorisation légale par une municipalité soucieuse de son électorat, le déclic se fait dans son esprit. Lui, il possède dans sa poche une véritable autorisation en bonne et due forme. Le quinze juillet 1969, il passe un coup de téléphone, très vite suivi par l'atterrissage d'un hélicoptère sur le terrain du motel...
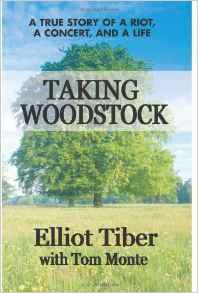
Trois jours de paix, d'amour et de musique. Et un mois de préparation. Au prix fort. Nous sommes dans les coulisses organisationnelles. Le motel criblé de dettes abrite jusqu'à cinq cents personnes. La fortune familiale est assurée. Mais ce n'est pas le plus important. Certes les organisateurs ne sont pas des philanthropes. Le rapport sur investissement sera fabuleux. Mais Elliott voit pour la première fois de près la puissance de l'argent. Michael Lang et son staff savent frapper aux bonnes portes et le dollar en liasse fait taire bien des oppositions...
Très vite des centaines puis des milliers de jeunes gens affluent, Woodstock ce n'est pas trois jours, mais un mois entier de fête incessante. Situation explosive, un rien suffirait à déclencher un mouvement de foule incontrôlable. Sont réunis des gens de toutes provenances, géographiques, ethniques, sociales, culturelles, mais rien se passe, si ce n'est cette idéologie à l'eau de rose de l'amour universel qui se répand sous ses formes les plus agréables, nudité, sexualité libre, shit et LSD en libre circulation. Les mauvais esprits dépités d'avoir raté évoqueront un baisodrome de cinq cent mille personnes à ciel ouvert. Plus doctement les sociologues parleront de libération des moeurs.

Elliot Tiber dresse son propre bilan. Sa mère égale à elle-même – jusqu'au jour de sa mort - qui entasse les billets tout en maudissant en son fort intérieur toute cette vermine de hippies si peu respectueuse des commandements de la Thora, son père qui prend un super pied à se retrouver au milieu de ce tohu-bohu organisationnel, les plus belles heures de sa vie, et la fierté de posséder un fils dont il accepte désormais l'homosexualité qui fut l'élément déclencheur du séisme... Woodstock aura permis à Tiber de se transformer intérieurement, de s'accepter pleinement et de s'imposer sereinement aux autres. L'est devenu un être libre dans sa tête. A acquis cette force tranquille que seule permet la réalisation de sa propre autonomie sur laquelle elle repose. Trouvera un compagnon, écrira des livres, voyagera, donnera des cours à l'université, participera à l'élaboration d'un film à succès, publiera en 2007 ce bouquin sous le titre de Taking Woodstock... une vie bien remplie dans cette vallée de joie qui se terminera voici peu, le trois août 2016.
Damie Chad.
SELF MADE MAN
POPPY Z BRITTE
( Editions Au Diable Vauvert / 2008 )

Z'ont un beau catalogue Au Diable Vauvert – la littérature en marge – l'est sûr que lorsque l'on se place sous l'égide de Gérard de Nerval, il est conseillé d'assurer un minimum – et puis il y a cette dernière nouvelle Elvis, Un Destin Grêle, comment voulez-vous qu'un amateur de rock and roll ne fasse l'acquisition d'un tel bouquin ! Un truc étrange, qui n'apprend rien sur le King. Une carrière parcourue à grands traits des premiers enregistrements chez Sun Records aux derniers concerts de l'obèse poussif qu'il était devenu. Un destin toutefois fabuleux, alors pourquoi le définir en tant que grêle ? Soyez plus attentif. L'est question d'une transsubstantiation. Non pas celle du Christ en hosties farineuses. Celle du python albinos entrevu dans le magasin à fringues zazoutesques de Beale Street. Dont la blancheur se retrouvera dans cette étrange matière blanchâtre qui occupait tout l'intérieur de l'intestin grêle du gars de Tupelo. Elvis victime d'une constipation ingestive métaphorique. Mais pas de beurre de cacahouète comme on s'y attendrait en toute logique. Une thèse étrange. Pas évidente à comprendre. Mais ce qui est le plus troublant dans cette proposition létale c'est la manière dont Poppy Z Britte nous la présente. Comme une évidence. Ne prend même pas la peine d'expliciter la signification du symbole. Le rebelle serait-il devenu un serpent qui ne piquait plus pour avoir trop renoncé à mordre ? Je vous laisse à vos méditations.
Ce premier paragraphe pour le rock. Remarquez, il y en a une seconde dans le recueil. Aborde le problème de la survie lorsque vous êtes au summum de votre carrière. Membre d'un des groupes de rock les plus prestigieux de la planète. Les Stones ont déjà résolu cette problématique. Mais pour les Kydds l'est question de ce que les imbéciles définiront comme une possession vampirique, alors qu'il s'agit en réalité d'une simple transmigration des âmes. Le christianisme évoque cela en parlant de la résurrection onanisante du Christ.
Oui mais pour le sexe faut être au moins deux pour que cela ne devienne point par trop monotone. Poppy Z. Brite, comme chacun de nous possède ses préférences. Est attirée par les graciles corps des jeunes asiatiques. Homosexuels, cela va de soi. Mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Les doux visages, les fines musculatures, c'est bien beau, mais en amour ce qui compte c'est la beauté intérieure de la personne. Mais quand vous ouvrez – souvent très brutalement – n'y a que la viande rouge à voir. La profession de boucher serait-elle celle qui permet le plus d'ouvertures sur des débouchés inquiétants ? Pas pour tout le monde.
Les premiers écrits de Poppy Z Brite parus dans la dernière décennie du siècle précédent scandalisèrent l'Amérique. Pas pour les horreurs qu'elle racontait. Cela faisait des années que les vampires, les serial killers, les antropophagistes amoureux, et autres pervers libidineux, batifolaient gaiement dans la littérature et les séries télévisées américaines. Le sang, le sexe, les drogues, le rock and roll, les déviances diverses, font partie du décor habituel des normalités d'outre-atlantique. Otez les oripeaux générationels mi-goth / mi-grunge de notre écrivaine et vous vous retrouvez en territoire gore des mieux connus.
Mais Poppy Z Brite apporta sa petite musique personnelle. Amorale. N'était pas du côté du mal. Surtout pas du côté du bien. L'était dans le mal. Le méchant criminel, elle vous le décrivait du dedans. Vous racontait sa démarche phantasmatico-individuelle qui présidait à ses errements prédateurs. Se livrait à ce Balzac appelait des Etudes Psychologiques. Les assassins sont parmi nous, fonctionnent comme ceci, comme cela. N'y peuvent rien, c'est ainsi. Sont comme vous, comme moi. Doués de leur propre sensibilité. Aussi naturel que le chat qui dépiaute les souris. Pas de quoi en faire un drame. Ni des traités de psychanalyse avancée. Plutôt des romans ou des nouvelles. Simplement parce que c'est plus flashy. Sade vous en raconte autant que papa Freud, mais avec le son et l'image en couleur en plus. Le poids des mots et le choc des images mentales. Suprématie de la littérature par rapport à l'écriture théorique à prétention scientifique.

Ne confondez pas le travail des spécialistes et des universitaires avec les rituels opératoires des sectes gnostiques qui se jouaient de la messe très chrétienne en la transformant en sacrifices foutriques et spermatiques. De saines lectures qui vous donnent tout de suite le goût de l'autre et du coeur à l'ouvrage. D'ailleurs Poppy Z Brite en personne a mis ses idées en pratique. A défaut de changer d'enveloppe charnelle, elle a transmigré de sexe. A aussi écrit une biographie semi-autorisée de Courtney Love.
Damie Chad.
11:05 | Lien permanent | Commentaires (0)