24/06/2015
KR'TNT ! ¤ 241. COSIMO MATASSA / GUS GUSTAFSON / JALLIES / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / ROLLING STONES / ERVIN TRAVIS NEWS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 241
A ROCK LIT PRODUCTION
25 / 06 / 2015
|
COSIMO MATASSA / JOHNNY GUSTAFSON JALLIES / L'ARAIGNEE AU PLAFOND ROLLING STONES / ERVIN TRAVIS NEWS |
|
ERVIN TRAVIS NEWS
Lyme - Solidarité Ervin Travis· 20 h Encore un nouveau traitement et des examens à effectuer Foie Estomac ... et encore des analyses de plus en plus insoutenables jusqu'à ce que l'on trouve le bon ! toute notre reconnaissance pour votre soutien
|
MATASSA LE METISSEUR

Nous n’irons pas par quatre chemins : Cosimo Matassa occupe dans l’histoire du rock le même rang que Sam Phillips. Pendant qu’à Memphis Sam Phillips enregistrait Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins et tous les autres, au J&M Studio de la Nouvelle Orleans, Comimo Matassa enregistrait Fats Domino, Little Richard, Lloyd Price et d’autres immenses artistes hélas moins connus. On peut parler d’un son Matassa comme on parle d’un son Sun. Chez Cosimo, on adorait le son du bastringue et les solos de sax. Et de la même façon que Sam Phillips, Cosimo Matassa n’avait absolument aucun problème avec les noirs. Il savait au contraire les apprécier.
Curieusement, Cosimo a cassé sa pipe le même jour que Johnny Gustafson, le 11 septembre dernier. The Blues Magazine est le seul magazine qui ait pensé à saluer sa mémoire en confiant une dizaine de pages à Paul Trynka.
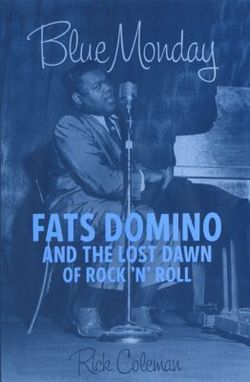
Tout comme Rick Coleman dans son livre sur les origines du rock américain («Blue Monday - Fats Domino And The Lost Dawn Of Rock ’n’ Roll»), Paul Trynka insiste sur l’aspect primitif du matériel dont disposait Cosimo pour enregistrer tous ces orchestres de rock foutraques : une table de mixage avec seulement quatre entrées de micros et une sortie. Comme il n’y avait pas d’air conditionné dans le studio et qu’il y faisait une chaleur à crever, Cosimo avait installé des ventilateurs pour souffler l’air froid de gros pains de glace. C’est lui qui enregistra Guitar Slim, l’un de héros de Jimi Hendrix. En effet, «The Things I Used To Do» de Guitar Slim est le premier disque enregistré avec une guitare en distorse (on peut l’entendre sur «The Cosimo Matassa Story Volume 1» : Guitar Slim joue en lousdé comme T-Bone Walker, il gratouille des trucs à la sauvette et tout le son d’Earl King vient de là). La principale qualité de Cosimo était son ouverture d’esprit. Il enregistra méticuleusement le son ultra-distordu de Guitar Slim qui ce jour-là était venu au studio vêtu d’un costume rouge, comme s’il allait monter sur scène. Cosimo adorait ça. Il adorait voir les artistes faite leur numéro. Pareil pour Fats qui arrivait en studio avec son valet, son chauffeur, une caisse de Whisky Teacher’s et deux kilos de pieds de cochon, un plat dont Fats raffolait et qu’il adorait partager avec les copains. D’ailleurs, lorsqu’il était en tournée, il transformait sa chambre d’hôtel en cuisine. Il emmenait toujours avec lui un réchaud et des pieds de cochons qu’il cuisinait après le concert pour les servir à ses copains musiciens dans sa chambre. Et pour Cosimo, Fats pouvait aussi être «a pain in the ass to record», car au beau milieu d’une prise, il lui arrivait de demander à Cosimo : «Est-ce que je sonne bien ?»
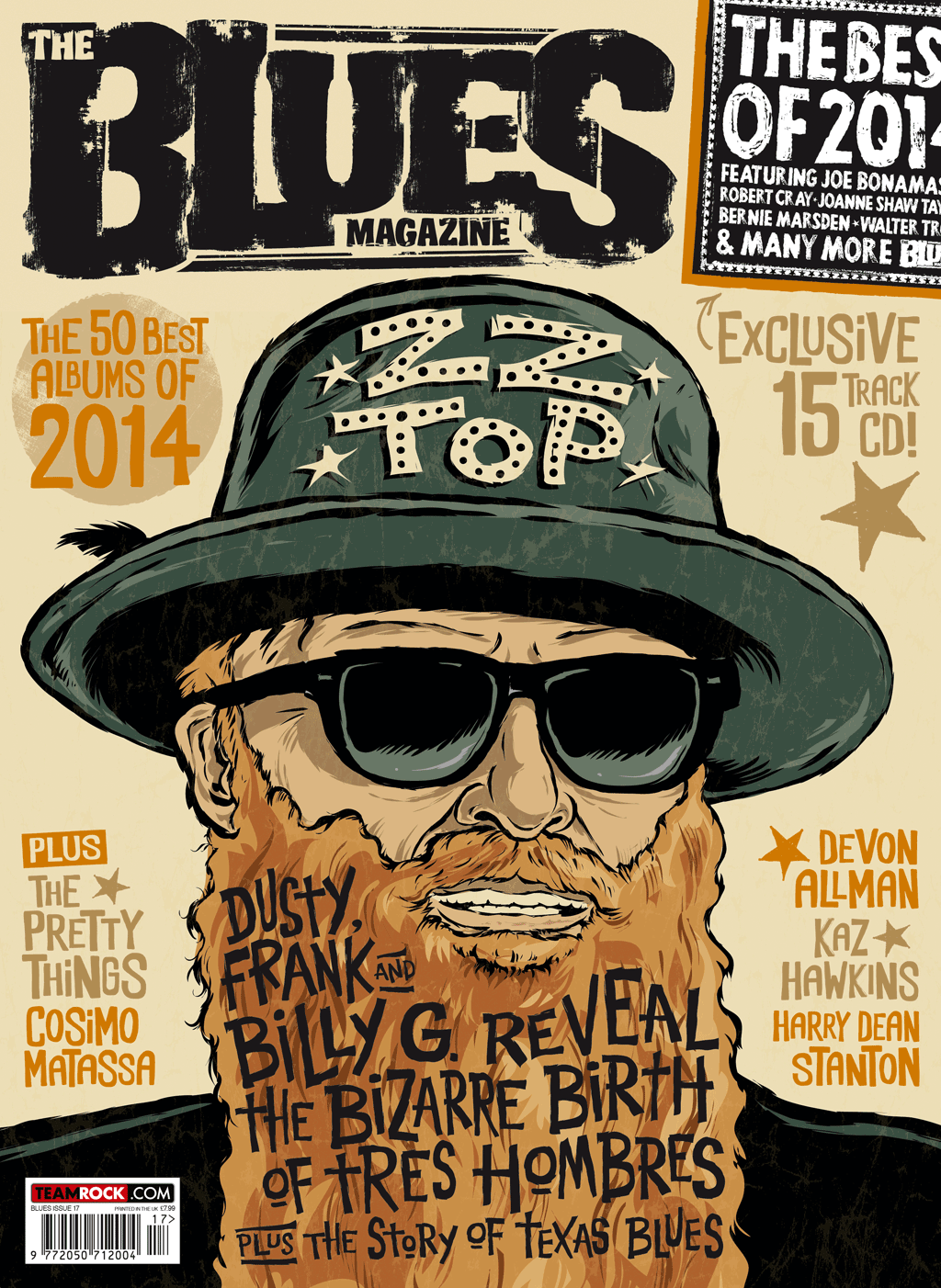
Tous les géants de la scène «black rock’n’roll» sont allés enregistrer chez Cosimo : Big Joe Turner, Little Richard, Fats Domino, Eddie Bo, Professor Longhair, Roy Brown, Dave Bartholomew, Slim Harpo, Elmore James, les Meters et des tas d’autres fabuleux artistes. Cosimo en était conscient : «I was lucky because I worked with some great great guys. My work was just to get them on tape.» C’est Cosimo qui enregistra le «Dust My Broom» définitif d’Elmore James. Il enregistrait aussi des cuts pour JD Miller, le boss d’Excello et Barbara Lynn pour Huey P. Meaux.
L’histoire de Cosimo ne pouvait se dérouler qu’à la Nouvelle Orleans où la tolérance envers les noirs était plus grande qu’ailleurs. Les musiciens noirs étaient traités comme des égaux par les rares blancs qui possédaient des studios. C’est aussi ce que rappelle Mac Rebennack dans ses mémoires, «Born Under A Hoodoo Moon».
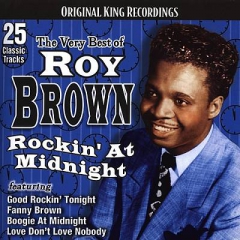
Cosimo enregistra son premier hit en 1947 avec Roy Brown, «Good Rocking Tonight», un cut que Wynonie Harris avait boudé. Roy Brown allait influencer BB King, Bobby Bland et surtout Elvis qui reprit «Good Rocking Tonight» en 1954, soit sept ans plus tard. Cosimo avait compris comment devait sonner un groupe de rock n’ roll. Eh oui, car à la fin des années quarante, il avait déjà enregistré des ribambelles de hits torrides avec Smiley Lewis et Dave Bartholomew, et ça allait continuer dans le début des années cinquante avec Lloyd Price, Huey Piano Smith et plus tard l’immense Earl King.

Tout le monde connaît l’histoire de Fats, petit pianiste timide découvert par Dave Bartholomew en 1949. C’est lui qui emmena Lew Chudd, boss du label Imperial, voir jouer Fats au Hideout et Chudd fut tellement impressionné qu’il signa Fats sur Imperial le soir-même. Fats eut son premier smash hit avec «The Fat Man». Après cet événement, tout le monde voulut enregistrer chez Cosimo, car il détenait le secret du son. Et Dave Bartholomew - comme Willie Dixon à Chicago - était de toutes les sessions. Pour le trio Fats/Cosimo/Bartholomew, les choses s’emballèrent car en 1956, ils n’avaient pas moins de 17 titres au Hot 100 du Billboard.
Pour Cosimo, le son de la batterie était essentiel. «Il y avait des tas de bons batteurs à la Nouvelle Orleans, des gens comme Earl Palmer qui pouvaient jouer n’importe quoi. Dans la plupart des sessions, c’est lui qui menait le bal.» L’autre secret de Cosimo était l’ambiance qui régnait dans son studio. On y faisait la fête - a party - surtout quand les sessions étaient supervisées par Dave Bartholomew ou Bumps Blackwell - qui amena un jour un certain Little Richard en quête de hit - Oui c’est Bumps qui organisa les enregistrements historiques de Little Richard chez Cosimo, avec le phénoménal house-band emmené par Lee Allen (tenor sax) et qui comprenait Alvin Taylor (barytone sax), Justin Adams (guitar), Frank Fields (bass) et bien sûr Earl Palmer au crash-bam boum.

Trynka raconte aussi comment Earl King, Professor Longhair (que Mac surnommait Fes), Mac Rebennack et «the crazed drummer» Smokey Johnson enregistrèrent «Big Chief», un hit qui allait donner naissance à un genre nouveau, le funk de la Nouvelle Orleans.
De la même façon que Sam Phillips, Cosimo monta Dover, un label destiné à lancer les gens qu’il admirait et qu’aucun autre label ne voulait signer. L’intemporel «Barefootin»» de Robert Parker est sorti sur Dover. Mais Cosimo eut moins de chance que Sam et Dover coula, à cause des distributeurs qui tardaient à payer. Dans l’affaire, Cosimo perdit tout, y compris son studio. Ce sont des gens qui l’admiraient comme Allen Toussaint et les Meters qui lui donnèrent de quoi vivre en le faisant travailler comme ingénieur du son. Mais Cosimo était brisé et il retourna travailler dans l’épicerie familiale ouverte par son père immigrant italien en 1924.
On le voyait encore rôder dans le quartier, à l’âge de 88 ans, «almost super-humanly positive». Il ne nourrissait aucune amertume sur le passé et il continuait de s’inquiéter du sort des musiciens qu’il avait tant admirés. On retrouve exactement la même chose chez Mac Rebennack, cette profonde humilité et ce souci des autres. Si Cosimo rêvait d’être riche, c’était surtout pour pouvoir payer les fantastiques musiciens qui venaient enregistrer dans son studio.

S’offrir les deux volumes de «The Cosimo Matassa Story» et l’antho «Cracking The Cosimo Code» récemment parue chez Ace, ça revient exactement à la même chose que de s’offrir les six coffrets des Singles Sun édités par Bear : c’est un chaudron qui risque de vous exploser à la gueule. «The Cosimo Matassa Story Volume 1» et «Gumbo Ya Ya - The Cosimo Matassa Story Volume 2» sont deux coffrets de quatre disques. On trouve sur chaque disque trente titres, et pas des titres à la mormoille. En gros, ça vous donne 240 hits de juke de la Nouvelle Orleans et des découvertes extraordinaires en pagaille. Le volume 1 est le plus rocky de deux. Little Richard et Fats figurent sur la pochette. Quant au volume 2, c’est tout simplement une merveille inexorable.

Fats est là avec «Reeling And Rocking» qu’il fracasse en le prenant au heavy beat. Il faut aussi voir la classe avec laquelle il prend «My Blue Heaven». Fats prend ça à pleines mains et chante d’une voix de maître. Sa grandeur consiste à dérouler à l’infini. Il chante «Don’t Blame It On Me» d’une voix fêlée, il est vrai que c’est toujours le même tempo, mais on l’écoute car Fats écrase tous les autres sous ses fesses. Au niveau swing, on peut dire que Fats reste imbattable. Pour preuve, son «I Can’t Go On», modèle de swing ultime. Personne ne peut rivaliser avec Fats et son orchestre - Rosalyn come back to me - Encore du pur swing avec «When My Dreamboat Comes Home». Ça part sans prévenir. Voilà une vraie pétaudière. Avis aux amateurs de pétaudières carabinées. «I’m Walking» est encore une preuve de l’existence d’un dieu du swing. Derrière Fats, Earl Palmer bat à la vie à la mort. On a là la combinaison de trois génies : celui de Fats, celui de Cosimo et celui de Dave Batholomew. Quand Fats attaque un slow blues comme «I Want To Walk To You», on recommande son âme à Dieu. Cosimo fabriquait un écho de rêve. On entend là une sorte de reverb insensée qui donne au cut de Fats un air proéminent et une profondeur irréelle. «My Girl Josephine» pourrait bien être l’emblème du shuffle cosimien. Chez Cosimo, ça chauffe et cet énorme artiste qu’est Fats bouffe tout. Son orchestre sonne comme une bande de damnés. Comme Dave Bartholomew, Fats prend «Let The Four Winds Blow» à bras le corps. On a l’impression que les murs bougent avec lui, c’est son côté magique. On retrouve une fois de plus ce swing incomparable. Qui saura dire la grandeur de Fats Domino, le roi du swing, l’homme qui après Elvis a vendu le plus de disques ? On parle ici de 65 millions de disques.
On entend aussi Mac Rebennack avec «Storm Warning» monté sur des vieux riffs connus. C’est un instro déterminé, mélange de Link Wray et de tout ce qu’on veut. Mais Mac se paye un solo de sax dévastateur, certainement l’un des plus violents de l’histoire.
Dans ses mémoires, Mac raconte qu’il voulut faire la peau de Lloyd Price. Il l’accusait de lui avoir volé un morceau. Par miracle, il n’a jamais réussi à le coincer. On retrouve l’ami Price ici avec «Woo Ho Ho», embarqué au piano et chanté au timbre de glotte blanchie - Please oh please - Ce black cherchait le swing maximaliste et un solo de sax ravageait la prairie. C’est Art Rupe, boss de Specialty, qui découvrit Lloyd Price, alors âgé de 17 ans. Specialty était un label basé à Los Angeles et Rupe était venu faire du repérage à la Nouvelle Orleans. Le premier cut de Lloyd Price pour Specialty fut «Lawdy Miss Clawdy», l’un des hits fondateurs du rock’n’roll. Enregistré bien sûr chez Cosimo sous la direction de Dave Bartholomew. Du coup, Art Rupe ouvrit un bureau à la Nouvelle Orleans. Il nomma Harold Battiste responsable de l’agence. Puis il racheta le contrat de Little Richard à Don Robey (Peacock Records) pour 600 dollars.

Art Rupe et Bumps Blackwell produisent «Tutti Frutti» en 1955. Little Richard ne connaît pas le sens du mot inhibition. Il est le plus sucré, le plus raunchy et le plus excité de toute la faune qui fréquente le studio de Cosimo. Tutti semble se situer à l’origine de tout et surtout de ce qui fait l’essence du rock’n’roll, la sauvagerie. Et dire que Comimo avait ça sous les yeux ! Et on ne parle même pas du solo de Lee Allen. En 18 mois, cette équipe infernale va mettre en boîte 14 hits planétaires. Tout le monde le sait, «Long Tall Sally», c’est l’enfer sur la terre. Chez Cosimo, les meubles tremblent. Ce cut est probablement le plus explosif de l’histoire du rock. Ses musiciens sont des fous furieux. Lee Allen balance son solo d’antho, comme d’ailleurs sur «Slippin’ And Slidin’». Par contre, «Rip It Up» est joué au drumbeat d’Earl Palmer. Soixante ans plus tard, ce classique sonne toujours merveilleusement bien. Une fois de plus, Lee Allen troue le cul du cut avec un solo incendiaire. Il trashe carrément tout au passage. On retrouve cette merveilleuse explosion d’exaction dans «Readdy Teddy». Lee Allen resouffle comme un diable. On comprend que Lou Reed ait été fasciné par ce saxophoniste. Seul Johnny Walker peut déclencher un tel incendie. En chantant «The Girl Can’t Help it», Little Richard ouvre un four capable d’avaler le monde. Mais on attend bien entendu le solo de Lee Allen que Little Richard introduit par un scream bien dévoyé. Chaque fois qu’on réécoute «Lucille», l’adrénaline monte au cerveau. C’est mécanique. Little Richard pouvait foncer, il avait derrière lui le meilleur orchestre du monde. Après le solo brûlant de Lee Allen, Little Richard repend le beat à pleines mains. Dans les deux volumes, on trouve aussi «Jenny Jenny» et bien sûr «Good Golly Miss Molly», la pétaudière suprême, le raunch de rêve, intense et légendaire, la racine vivante d’un rock qui nous fouille le bulbe depuis plus de cinquante ans.
Shirley & Lee figurent parmi les attractions principales du petit monde de Cosimo. Ils étaient si pauvres qu’ils supplièrent Cosimo de les laisser enregistrer un disque. Cosimo leur dit : «Revenez avec deux dollars et on fait le disque !» Ce sera leur premier single, «I’m Gone»/»Sweetheart». «Swseetheart» est troué par un gros solo de sax et ils font de «I’m Gone» un froti-frota torride. Lee arrive comme le sauveur. Quel duo merveilleux ! Shirley chante avec une voix de morpionne et Lee chante comme un vétéran de toutes les guerres. Mélange suprême. «Baby» est un cut explosif lui aussi troué au cul par un solo de sax dément. L’un de leurs plus gros hits s’appelle «Feel So Good» que Lee attaque princièrement et Shirley arrive dans la foulée avec sa petite niaque juvénile. Elle arrache tout et des gros blacks aux mains poilues font des wap-doo-wah au fond du studio de Cosimo. Il faut voir comme ça swingue ! Cosimo est aux anges, il a dans son studio les plus grands artistes de son époque. Autre hit suprême du duo : «Rockin’ With The Clock». Shirley chante derrière, portée par le rumble de la Nouvelle Orleans. Ils sont tous les deux investis du génie de la trépidation et réinventent l’art de shouter en duo. Comme les Collins Kids, ils développent une énergie spectaculaire.

Qui saura dire la classe d’Aaron Thibodeaux Walker, mieux connu sous le nom de T-Bone Walker ? Il suffit d’écouter «Got No Use». Une grande black vient chanter avec lui. T-Bone joue ses gimmicks insidieux et soudain un solo de sax vient tout balayer. Il lance aussi un «Long Distance Blues» avec un «Hello long distance !» digne de figurer dans les anthologies et il se met à jouer comme un dieu. Ce Texan avait un son exceptionnel et il pouvait jazzer comme Wes Montgomory.
Avec «Well I Done Get Over», non seulement Guitar Slim swingue comme un démon, mais il chante aussi avec des manières de prétendant au trône.
Professor Longhair est le père spirituel de Mac Rebennack. On l’entend chanter le fameux «Tipitina» que reprendra Mac sur «Dr John’s Gumbo», l’album qu’il a consacré aux personnages légendaires de la scène de la Nouvelle Orleans. En chantant son vieux cut, Fes s’égosille. Avec «Go To The Mardi Gras», Fes fait jouer les tambours africains. Personne ne peut rivaliser avec ça. Et Fes siffle, histoire de créer une distance - With your ticket in your hand/ You gonna go to New Orleans/ Et là tu verras the zooloo king/ And if you stay right there/ Tu verras aussi the zooloo Queen !
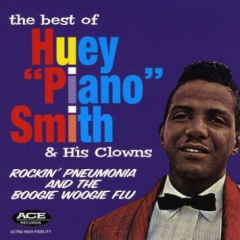
Comme Fes, Huey Piano Smith fait partie des grandes légendes de cette scène grouillante de vie. Son «Little Liza Jane» se fond dans la légende comme le bronze des canons ennemis dans la statuaire impériale. C’est énorme d’africanité et d’une richesse musicologique inestimable. Sa version de «Rockin Pneumonia & The Boogie Woogie Flu» mérite d’entrer dans les annales car Huey y hurle comme un beau diable. Rien d’aussi fulgurant au niveau swing que «Would You Believe Me If (I Have A Cold)». Avec «For Cryin Out Loud», Huey montre une supériorité certaine. Il domine le monde à sa façon qui est la bonne, sans vouloir écraser les autres. Huey fait son cirque avec ses Clowns chez un Cosimo éberlué qui n’en perd pas une miette.
Smiley Lewis chante tous ses cuts d’une voix incroyablement ancienne. Il semble sortir de la nuit des temps et il n’a aucune chance d’entrer dans la modernité. C’est l’un des personnages les plus étranges, pour ne pas dire inclassables, de cette scène. Il s’est fait du blé avec sa version de «Blue Monday». On trouve aussi son «Real Gone Lover», un fantastique jump-blues dévasté par la pétarade d’un solo de sax. C’est chez Smiley que Dave Edmunds est allé repêcher «I Hear You Knocking». On a là la version originale qui est énorme. On est aux origines d’un monde qui s’appelle le rock anglais. Il semble que Dave doive tout à Smiley. Avec «One Night», Smiley creuse son sillon. Il a la teneur d’une ténor d’opéra des champs. Sacré Smiley. Son «Mama Don’t Like Me» est fulgurant de swing - We like pop music/ We like blues music/ We like jump music !
Autre personnage-clé de cette scène, Pee Wee Clayton qu’on entend avec «You Know Yeah», gros blues rock des familles du Quartier Français. Il traite ça à la Lazy Lester, c’est-à-dire en boogie millésimé et balance un solo de punk, alors on cesse de rigoler. Ce mec claque sa gratte comme une brute. C’est un killer vermoulu. Sur «Runnin’ Wild», il balance un solo de dingo, et il le fait intentionnellement.
Edwin Joseph Bocage, mieux connu sous le nom d’Eddie Bo, vaut lui aussi le détour. Avec «I Got To Know», il sonne un peu comme Ray Charles. Non seulement ces mecs savent secouer le sableur, mais Cosimo sait capter toutes les nuances du son. Voilà le groove idéal pour des vacances au bord de la mer. Attention à «Lover & A Friend» que chante Eddie en duo avec Inez Cheatman : c’est un stomp monstrueux, un groove de génie pulsé au sloop de la Nouvelle Orleans. Inez est une bonne et leur truc frise la démence de la jukence. «Walk The Walk» fut certainement un gros hit à l’époque, car c’est chanté avec une telle classe qu’on en reste coi. Et ça swingue. Chez Cosimo, ça swingue dans tous les coins, jusqu’au cœur de la moindre molécule de matière. Il chante «Oh Oh» de ses deux dents de castor. Eddie Bo fait sa bête avec «I Love To Rock ‘n’ Roll». Il chante ça d’une voix d’ange déchu et c’est violemment bon - Clap your hands and move/ Don’t you be no square - et derrière Eddie ça claque des mains - Oh my God, même Cosimo claque des mains - Clap your hands and move - Eddie Bo !
On entend aussi pas mal d’instros de Lee Allen et notamment «Creole Alley» claqué au sax et à la guitte de dingo. Lee Allen semble toujours vouloir battre tous les records de puissance dans la présence. Ces musiciens étaient complètement barrés. On retrouvera Lee Allen plus tard avec les Stray Cats et les Blasters.
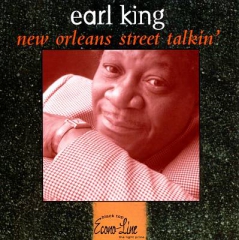
Voilà Earl King, chanteur, compositeur, arrangeur et fondateur d’un label, qui apprit la guitare pour imiter son héros Guitar Slim. Earl est un excité, comme on peut le voir avec «Can You Fly High». Il défonce tout. Il chante au scratch et arrive l’inévitable solo de sax infernal. Son cut vaut tous les hits de Wilson Pickett. Dans «Trick Bag», Earl King joue un joli riff insidieux. Pas étonnant que Mac Rebennack se soit prosterné devant ce guitariste doué d’une extrême finesse. On peut même aller jusqu’à le traiter d’inventeur. «Poor Sam» est un véritable killer kut, chanté et joué de façon démente. On pourrait même aller jusqu’à parler de génie punk des bas-fonds. Sacré Earl, il ne recule devant aucun excès. Il est le King de la Nouvelle Orleans, pas de doute. Son «Poor Sam», c’est à tomber. Alors on tombe. Ce monstre d’Earl King chante «Everybody’s Carried Away» au timbre altéré. Et hop, un gros solo de sax par là-dessus puis il balance son solo de punk. Le son monte comme la marée. Alors qu’Earl revient au chant, derrière lui, ça bruine incroyablement. Pur génie.
Auteur-compositeur, bandleader supreme, trompettiste, arrangeur de génie et producteur, Dave Batholomew savait tout faire. Issu d’une famille de coupeurs de canne, Dave Bartholomew fut considéré comme l’architecte du son New Orleans. De la même façon que Willie Dixon, Dave était une force de la nature et le principal interlocuteur des musiciens de session. Cosimo s’appuyait sur lui pour l’organisation des sessions. On l’entend dans les deux volumes, évidemment, notamment avec «Tra-La-La» et «Teejim». Il a dans la voix toute l’énergie du grand peuple noir. Avec «Stormy Weather» il se montre stupéfiant de bonne tenue. On sent comme chez Big Dix la force de la nature. Quand on entend «The Monkey Speaks His Mind», on voit bien que Dave Bartholomew sait chauffer un groove et qu’il sait balancer des solos de trompette extravagants. Encore plus effarant : «Four Winds», pur jive de juke, battu dans le fouillis du son et bardé de cuivres, hallucinant de musicalité. Franchement, Cosimo Matassa savait produire un enregistrement. Avec «Shrimp & Gumbo», Dave tape dans l’antillais et bat tous les records de véracité productiviste.

Ronnie Barron figure en bonne place dans les mémoires de Mac Rebennack. Harold Battiste et Mac tentèrent de lui refiler l’habit de Dr John Creux au milieu des sixties, mais c’est Mac qui finira par l’endosser. À la place, Barron créa son alter-ego, Rev Ether, et travailla pour Paul Butterfield, Tony Joe White, Ry Cooder, BB King et bien sûr Dr John. Avec «Did She Mention My Name», on découvre un fantastique chanteur.
Lee Dorsey fut l’un des plus gros vendeurs de disques de la scène New Orleans. Allen Toussaint produisait ses hits. Ils se vendaient comme des petits pains mais Lee Dorsey continuait de réparer des bagnoles dans son garage, car il se méfiait des mirages de la starisation. «Get Out Of My Life Woman» est une sorte de groove seigneurial. Quand Lee Dorsey chante, le temps s’arrête. Il est tout simplement l’un des héros de cette scène. Il chante d’autorité, tout le monde le sait. Il se situe au même niveau que Marvin, mais versant Nouvelle Orleans. Autre merveille : «Lottie Mo». Lee Dorsey, c’est un peu le dandy du groove. C’est le noir Drieu du Morand des morasses. Lee tartine ça sans toc. Quand Lee Dorsey a attaqué «Ya Ya», Cosimo a dû tomber de sa chaise. Oui, car c’est beaucoup trop bon. Lee enfonce son clou avec «Do Re Mi». Il chante ça avec une niaque suspendue.
Selon Mac Rebennack, Johnny Adams fut le plus grand soulman de la Nouvelle Orleans. On le surnommait The Tan Canary et on allait même jusqu’à dire aux États-Unis qu’il était l’une des plus grandes voix de son époque.
Art Neville est le fondateur des Meters. On le retrouve ici avec «Cha Dooky-Doo» qu’il joue à la claquette. Il chante un peu du nez et il met vite de l’ambiance dans la cambuse à Cosimo.
On appelait Aaron Neville The Voice. Il balance des groove de rêve. Son «Even Though» est un slowly but sureley, mais pas n’importe quel slowly. Aaron est un chanteur brillant, il travaille son son comme un orfèvre et ne semble vivre que pour l’émerveillement permanent. Les Meters deviendront par la suite les Neville Brothers, avec autour d’Art, Cyril, Charles et Aaron.
Frankie Ford restera dans l’histoire du rock grâce à «Sea Cruise», un hit d’abord enregistré par Huey Piano Smith. C’est l’enfer du son, encore pire que chez Little Richard. Robert Parker joue du sax là-dessus. Voilà bien le hit absolu, perclus de son et fouillé au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Frankie est timbré et c’est la raison pour laquelle on le vénère. Il est dans le génie interprétatif et productiviste, comme l’étaient les Coasters ou les Temptations. My God, sans Cosimo, tout cela n’aurait peut-être jamais existé. Une chose est certaine : ce son n’existe pas ailleurs. Tout vient d’un petit rital nommé Matassa. Nouvelle machine infernale avec «Roberta». On se retrouve une fois encore au cœur d’une scène exceptionnelle. Les chœurs frisent la démence, le beat reste imparable et Frankie Ford swingue comme un démon. Nous voilà grâce à lui au sommet de cet art qu’on appelle le rock’n’roll. On ne trouvera pas ailleurs un truc aussi secoué, aussi inspiré, aussi gorgé de son et de jus. Retour du démon avec «Alimony». Il aurait fallu faire empailler Frankie Ford, il était trop bon. Avec «What’s Going On», Frankie s’arrache la glotte. Ce screamer peut se montrer digne de Little Richard.
Autre grosse poissecaille de cette scène : Ernie K Doe. Avec «Mother-In-law» paru en 1961, il eut l’un des plus gros hits de la Nouvelle Orleans. Il passa ensuite les années soixante-dix et quatre-vingt dans un bain d’alcool, ce qui explique qu’il soit sorti des écrans radars. Il attaque «Mother-In-law» par en-dessous, épaulé par des chœurs terriblement duveteux. Ernie se prélasse dans l’ouate moite. Il extrapole son génie interprétatif. «A Certain Girl» est un vrai groove de juke bardé de chœurs terribles.

Et on entend aussi dans ces compiles somptueuses des chanteurs incroyablement doués comme James Wayne avec «Agreable Woman», Little Mr Midnight avec «Got A Brand New Baby» (qu’il chante d’une voix de castrat et derrière, c’est la pétaudière des vieux standards de Little Richard), Roy Baldhead Byrd avec «Rockin’ With Fes» (troué par un fabuleux solo de sax), Slim Saunders avec «Let’s Have Some Fun» et qui se perd littéralement pour Little Richard. Il swingue sous les jupes de l’orchestre et c’est d’un niveau qui dépasse les normes. Et puis sur le disk 2 du volume 1, on tombe sur Bobby Mitchell & The Toppers : «Sister Lucy». Attention, c’est une attaque de requins. Bobby chante comme un dieu. L’ambiance saxée embobine l’oreille. À partir de là, c’est foutu. Impossible d’échapper à la classe phénoménale de Bobby Mitchell. Même chose avec The Spiders et leur «21», une pure leçon de swing dans la démence de la partence, toujours le solo se sax troueur de cut et derrière ça claque des mains. Il règne dans le petit studio de Cosimo une ambiance surchauffée. Ces mecs jouent avec l’énergie du diable et ils cassent tout, les ventilateurs, les pains de glace, les chaises et les biscottes. Autre pure merveille : «Rich Woman» de Li’l Millet & His Creoles, un cut qui avance de travers, comme un crabe des cocotiers. Voilà un groove définitivement énorme et même renversant. C’est riffé aux trompettes avancées et Li’l Millet chante à l’édentée. Il raconte n’importe quoi, porté par une vague de groove magique. Roy Montrell chante «Ooh-Wow» avec un guttural des bas-fonds. Il sonne comme un gladiateur à l’agonie. Quel sacré pusher ! Par contre, son «Everywhere I Hear That Mellow Saxophone» coule comme du miel dans la vallée des plaisirs. On a aussi deux titres de l’incroyable Werly Fairburn, un rockab blanc arrivé chez Cosimo par hasard. Cosimo savait aussi enregistrer le slap, comme on peut le constater à l’écoute de «I’m A Fool About Your Love». Derrière Werly, un dingue joue des hillbilly licks au long et on re-salue au passage le génie productiviste de Cosimo Matassa. Dans le son, tout est incroyablement raffiné et bien fourni. Encore une pure merveille de hillbilly avec «All The Time» qui est slappé comme dans un rêve. Dans le son, tout est beau et comme mis en lumière : le piano, le slap, les riffs et le jeu au long. Une absolue merveille. Autre merveilleux inconnu : Oliver Morgan, avec «Who Shot The Lala», un gros groove des bas-fonds de la Nouvelle Orleans, un vrai groove de voyou rocailleux et gluant à souhait - Who shot the lala/ I don’t know - Même le solo est gluant. Voilà du punk-rock primitif. Ce veinard de Cosimo voyait ces gens-là jouer dans son studio. Oliver chantait et des filles lui répondaient ouuu yeah ! Avec «Play A Cornbread Song For Me And My Baby», Joe Haywood rivalise carrément de punch avec James Brown. Et forcément, son truc tourne à la monstruosité. Chanteur fantastique aussi que ce Bobby Charles. Il chante «Laura Lee» d’une voix un peu éteinte. Énorme hit que le «Rockin’ Behind The Iron Curtain» de Bobby Marchan. Voilà encore un beat pulsé à l’extrême et capable de faire sauter n’importe quel juke-box. Il faut aussi entendre «Just One More Chance» par Paul Gayten. Encore un fabuleux swinger qui chante d’une voix tannée et bien posée sur le sommet du pot de gumbo. Voilà qu’arrive un autre preux chevalier du swing : Diamond Joe qui avec «Moanin’ & Screamin’» monte au firmament voodoo pour l’éternité.

On sort de là à quatre pattes et poussant des cris étranges.
Signé : Cazengler, aka Cosimodo Matuvu
Disparu le 11 septembre 2014
The Cosimo Matassa Story. Volume 1. Proper Records 2007
Gumbo Ya Ya. The Cosimo Matassa Story. Volume 2. Mis 2012
Cracking The Cosimo Code - 60s New Orleans R&B And Soul. Ace Records 2014
Rick Coleman. Blue Monday. Fats Domino And The Lost Dawn Of Rock ’n’ Roll. Da Capo Press 2006
The Blues Magazine #17. November 2014. Big Chief par Paul Trynka.
GUS N'EST PAS UN GUGUSSE
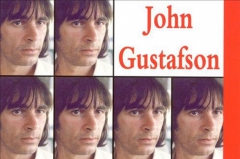
Prenons l’exemple de la vie de Johnny Gustafson qui est passé de vie à trépas en septembre dernier : sa vie résume plutôt bien l’histoire du rock anglais, puisqu’il a navigué dans bon nombre de groupes importants pendant quatre décennies. On commence par le Mersey Beat de Liverpool avec les Merseybeats et les Big Three, puis on passe au gros prog seventies avec Quatermass, et de là on saute dans la scène proto-hard avec Hard Stuff et l’hyper-mythique John Du Cann. Oh, ce n’est pas fini ! En 1973, Roxy qui n’a jamais eu de bassiste attitré cherchait quelqu’un pour enregistrer son troisième album, et hop, viens par là mon petit Gus. Un peu plus tard, Gus reformait les Pirates avec Mick Green. Rien qu’avec ces quelques groupes, on a une sorte de crème de la crème du rock anglais.
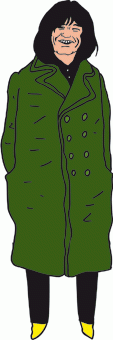
Comme les Beatles, les Big Three se situent à l’origine des temps. Gus, Johnny Hutchinson et Brian Griffiths voulaient se démarquer des autres groupes de Liverpool par la puissance du son - The Big Three payed rougher than anybody else - Gus : «There was more violence in the attack of our instruments and our drumming was loud and raucous.» Et ils insistent sur le «very raucous style of attack». Comme les Beatles, les Big Three sont managés par Brian Epstein et ils vont faire leurs classes au Star Club de Hamboug - They were already a wild rock’n’roll band and they simply got even wilder - Et ils enregistrent leur premier single sur Decca. Mais Brian Epstein essaie de transformer ces trois brutes en happy smiling pop performers. Il croyait même pouvoir les obliger à se déguiser en Beatles avec des petits costumes ridicules, mais les trois Big Three l’ont envoyé sur les roses. On disait alors de Brian Griffiths qu’il était le meilleur guitariste de Liverpool. Pour les témoins de l’époque, les Big Tree étaient out of this world. Ils étaient trois et sonnaient comme cinq. «Just a loud improvised jazz sort of sound !» Au fil des concerts, Gus devint une superstar à part entière car tout le monde le citait en référence. Plus tard, on a même comparé les Big Three à Cream, mais en entendant ça, Gus s’est marré : «On était un trio de hard rock, alors que Cream était un trio de blues with a fancy guitarist.» Finalement, Brian Epstein les vire en 1963 pour mauvaise conduite et c’est la fin du groupe. Hutch tente de continuer l’aventure avec d’autres musiciens, mais c’est cuit. Gus est récupéré par les Merseybeats qui tournent en Allemagne. Gus n’aime pas leur musique, mais il a besoin de blé.

Grâce à Edsel, on peut entendre Gus et ses deux copains sur «Cavern Stomp», une compile qui reprend les singles poppy et le fabuleux EP «Live At The Cavern». Le seul cut décent de la face A est «Cavern Stomp», face B du premier single Decca. Hutch chante comme un punk et bat ça sec. Quelle énormité cavaleuse ! Les grosses pièces se nichent en face B, et pour commencer quatre classiques enregistrés live dans le fameux smoking hole de Liverpool : «What’d I Say», version chauffée à blanc, «Don’t Start Running», beau beat typique des années de braise, «Zip A Dee Doo Dah», gros mid-tempo solidement soutenu au gimmick par Griff et «Realin’ And Rockin’», l’énormité que tout le monde attend au virage. Pour l’époque, les Big Three sortent un son d’une incroyable modernité. Comme dirait Gus, c’est du loud and raucous. Hutch bat dur et Gus fait rouler sa grosse bassline. Stupéfiant ! Mais c’est de la rigolade à côté de ce qui suit : «You’ve Got To Keep Her Under Hand». Voilà une monstruosité préhistorique, c’est le premier heavy rock d’Angleterre. Gus et ses copains sortent un vrai jus de pétaudière, ce qui pour l’époque - 1963 - semble complètement irréel.

Gus remonte les Big Three en 1973 avec Brian Griffiths, juste pour le fun. Ils enregistrent «Resurrection» avec Nigel Olsson au beurre. Gus y chante un étrange mélange de classiques du rock : «Rockin’ Robin», «Let It Rock», «Money» et «Dizzy Miss Lizzy». Il faut attendre «Just A Little Baby» pour trouver la viande. Gus chante ce rock comme un cut de soul et Brian Griffiths envoie une sorte de killer solo capable d’édifier les édifices. Tout ça sur fond de beat épais et de chœurs féminins. Plop ! L’oreille se dresse. Mais quelle est cette entourloupette ? La version de «Money» qui ouvre le bal de la face B préfigure la heavyness de Hard Stuff. Et les énormités arrivent. Pas n’importe quelles énormités : «All Of Me», pour commencer, jolie pièce de rock violent et bien contrebalancé aux drums. Brian Griffiths nous sabre ça au long cours. Il joue vraiment comme un punk. On ne comprend pas que ce trio ne soit pas devenu célèbre. Johnny Gustafson chante comme un beau diable et sa basse gronde sous le mix comme le dragon de Merlin sous la surface de la terre. Ça continue avec «Prince Of Love», grosse pièce de pop-rock âpre et lancinante. Gus tranche dans le lard du cut avec une belle aménité et Brian Griffiths balance l’un de ces solos complètement allumés dont il a le secret. Gus chante au chat perché et reste toujours remarquablement juste. D’ailleurs il finit ce bel album avec une version de «Lucille» digne de celle de Little Richard. En tant que bassiste chanteur, Johnny Gustafson aurait dû devenir aussi célèbre que Paul MacCartney.
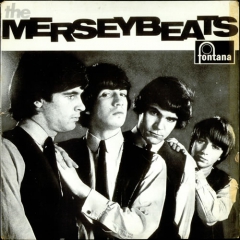
On connaît principalement les Merseybeats pour leur version de «Sorrow», bardée d’harmonies vocales invincibles. Johnny ne restera dans le groupe que quelques mois, le temps d’enregistrer quelques pièces fumantes comme ce «Milkman» embarqué à la bassline. Gus joue et ça s’entend ! Le hit parfait, avec ses clap-hands, ses harmonies vocales et cette terrible bassline têtue qui revient en boucle, à la folie. Autre gros coup de Jarnac : «Really Mystified» : pur garage. La basse de Johnny pousse le cut dans le dos et on tombe en arrêt sur un break de guitare punk. Et pouf ! Johnny envoie tout ça valser dans les orties. C’est une véritable dévastation - Yes ! Yes I am ! - Les Merseybeats se débrouillaient aussi très bien sans Johnny, comme on le constate à l’écoute de «Good Good Feeling» (complètement explosé aux clap-hads) ou encore «See Me Back» (pop énorme) et bien sûr «Jumpy Jonah», d’une exceptionnelle sauvagerie.

Quand Johnny Gustafson monte «Quatermass» en 1970, c’est pour créer un monde. Il s’entoure de Peter Robinson (claviers) et de Mick Underwood (beurre). Comme l’orgue dominait, on fit à l’époque le parallèle avec les Nice de Keith Emerson. Pour l’amateur de rock progressif, ce disque est un festin, car tout y est extrêmement travaillé, arrangé et sophistiqué. Et surtout solide. Gus chante au chat perché et il utilise sa voix comme un instrument. C’est dingue ce qu’il sait driver un cut à la basse. Il est omniprésent. Il draine tout le beat à lui seul. Le pire, c’est qu’il suscite un intérêt constant et il débouche sur un final éblouissant. Et paf, c’est là que s’établit un autre parallèle. Avec Jack Bruce. Même genre d’histoire et même appétit de modernité. Gus nous gâte avec une jolie pâte de blues cuit, «Post War Saturday Echo» et Peter Robinson nous la jazzifie généreusement. Franchement, tout est bon sur ce disque. Gus chante «Up On The Ground» au bord du précipice. Quelle dévissade ! C’est balayé au shuffle et ça devient prodigieusement entreprenant. Gus aménage de grosses accointances au coin du groove. Il claque son breaking bad pendant que Peter Robinson joue le jazz des jiveurs forcenés. Ça tourne à la violence sophistiquée, un genre nouveau. On comprend que les gens de Roxy aient louché sur Johnny Gustafson. Encore plus énervé : «Gemini», puis Gus passe au broutage de basse avec «Make Up Your Mind» qui sonne comme un hit freakbeat. Un vrai terminator de trigger. Et la fête se poursuit avec «What Was That» joué à la flûte de Pan sur le clavier du diable. Et comme si le premier coup ne suffisait pas, ils font une reprise de «Make Up Your Mind» encore plus violente que la première. Franchement Quatermass méritait sa une au Melody Maker. Ils concluent cette belle virée avec «Laughin’ Tackle», tout aussi exceptionnel, où un joli shuffle chasse sous le couvert.
Entre deux projets, Gus faisait le session man. Voici les épisodes les plus connus : quand Linsey de Paul entra en studio pour enregistrer son fameux «Sugar Me», qui vint l’aider ? Le chevalier Gus, évidemment, et Peter Robinson, son collègue dans Quatermass. Gus joua aussi sur le fatidique «Once Bitten Twice Shy» de Ian Hunter.

Ce brillant bassman et John Du Cann devaient bien finir par jouer ensemble, car leurs conceptions respectives du power trio concordaient parfaitement. Ils enregistrent «Bulletproof» en 1972. Cet album est considéré comme le Graal du rock hard britannique. On s’aperçoit bien vite que John Du Cann est un guitariste qui échappe aux lois de la physique : sur «Jay Time», il gratte ses cordes dans tous les sens, il gesticule et saute comme un cabri piqué par des guêpes. «Sinister Minister» arrive comme un missile et on se le prend en plein dans les gencives. Il se dégage de ce cut un vieux parfum boogie à la Mott The Hoople, mais John Du Cann corse l’affaire en triturant un effarant solo liquide. Aujourd’hui, on appelle ça un killer solo du diable vert. On reste dans le gras double avec «No Witch At All», ce gras de cochonnaille qu’apprécient les bons vivants barbus et ventripotents. Puis Paul Hammond nous stompe «Taken Alive», un boogie signé Gus qui adore Mott. John Du Cann rôde sous le boisseau avec ses horribles notes en suspension. C’est conçu dans la fumée de l’urgence du son et ça bat comme un cœur de ptérodactyle. Gus finit ça à la basse - baboum baboum - John Du Cann riffe impitoyablement «Time Gambler». Il plaque ses accords avec la foi du charbonnier. Il hache tout ça menu et Paul Hammond bat la cloche. Gus fait des merveilles à la basse. Hard Stuff s’inscrit dans la grande tradition des power trios instaurée par les Big Three. Riffé encore plus sec, voilà un «Millionaire» punkoïde, épais, vénéneux, sanglé serré et mené à l’assaut par l’ineffable John Du Cann. On nous gave d’infos sur Eric Clapton, mais jamais on ne cite le nom de John Du Cann, ce qui relève de la pire des injustices. Quand on connaît John Du Cann, on guette ses solos. On sait qu’il va partir systématiquement en vrille. Sacré John, il ne recule devant aucun excès. Il défonce les murailles. Il traverse le bâtiment d’Est en Ouest. Il faut voir la taille de ses sourcils. On sent bien la terre des Angles, these animal men, comme les appelait Jules César lors de l’invasion de l’île. En John Du Cann, on sent bien le sous-prolétariat de Whitechapel. Voilà un guitariste qui aime le gras et les tympans crevés. Il ne pouvait que bien s’entendre avec Gus. Il est inconcevable que «Millionaire» ne soit pas grimpé au sommet des charts anglais. Et ce n’est pas fini, car il reste «Monster In Paradise» où John Du Cann fait flamber la mythologie du power tio. Dans «The Provider Part One», John Du Cann plane en solo comme un biplan de la Luftwaffe, alors que Gus joue métal sur sa basse. On se croirait chez Miles Davis. Voilà encore un cut capable de dilater les orifices.

Leur second album «Bolex Dementia» n’est hélas pas aussi bon. Nos trois amis s’engluent dans le prog. Avec «Roll A Rocket», on constate que John Du Cann adore construire des ponts alambiqués qui non seulement ne mènent nulle part, mais qui en plus ne servent à rien. Par chance, nos trois amis reviennent au glam avec «Ragman» et jouent ça avec un réel aplomb. Ils nous font là du pur Roy Wood. Pour la petite histoire, c’est un accident de voiture qui a brisé la carrière de ce groupe appelé à devenir énorme, au moins en Angleterre. On trouve un autre glam de banlieue sur cet album : «Jumpin’ Thumpin’» que John Du Cann chante avec toute la latitude que lui confère son statut de guerrier invincible. Ils finissent avec le morceau titre qui se perd dans des circonvolutions. Amen.
Avant de s’appeler Hard Stuff, le groupe s’appelait Bullet. Le vaillant petit label britannique Angel Air a sorti les bandes d’un placard. On retrouve la violence riffique de John Du Cann dès le cut d’intro, «Doors Open», râpeux et drummé à la dure par l’implacable Paul Hammond. De vieux relents d’Atomic Rooster s’échappent du cut. John Du Cann joue sec et sévère. Pour ceux qui le connaissent, il reste l’indétrônable roi de la riffaillerie. On retrouve cette belle compo de Gus, «No Witch At All», présente sur le premier album de Hard Stuff, ainsi que d’autres merveilles comme «Millionaire», «Taken Alive» (qui sonne aussi comme un hit) et «Sinister Minister», un glam digne des stades. Rien qu’avec ces trois ou quatre titres, Bullet entrait dans la cour des grands. Dans «Entrance To Hell», on entend la belle basse de Gus chuinter. Encore un hit fondateur avec «Fortunes Told», gros rock travaillé au corps avec aménité, assez proche de ce que faisait Deep Purple dans «In Rock». John et Gus avaient le cul entre deux chaises : d’un côté le stomp et de l’autre le proto-hard. Mais ses départs en solos restent des modèles du genre. On retrouve aussi sur l’album de Bullet la sévère purée de «Time Gambler», avec son chant crochu, son riff agressif et la belle partie de basse du père Gus.

Gus commence à jouer dans Roxy en 1973, l’année où paraît «Stranded», troisième album du groupe - et pour les fans de la première heure, l’amorce du déclin - Ne cherchez pas Gus sur la pochette, il n’y figure pas, pas plus qu’il ne figurera sur les trois autres albums où on le crédite en tant que bassman. N’ayons pas peur des mots : «Stranded» est un album raté qu’on revend et qu’on rachète, histoire de vérifier qu’il est bien raté. On ouvre le gatefold, on voit les cinq Roxy traités à la saturation Psd. Gus n’y est pas, mais il s’en fout. Le seul cut sauvable de l’album est «Amazona» monté sur un beau groove de basse. Gus est poussé devant dans le mix. Phil Manzanera joue son solo dans la pampa et Gus lui procure un petit terreau propice aux notes épisodiques. Ils s’offrent tous les deux un fantastique redémarrage en côte. Si Roxy s’écroule comme un château de cartes avec ce troisième album, la raison en est simple : Eno vient de se faire virer.

«Country Life» peut être considéré comme le dernier album potable de Roxy Music. Ne serait-ce que pour ce cut énorme qu’est «The Thrill Of It All». Le pounding, eh bien c’est Gus qui l’envoie. Il a la chance de jouer avec ce magnifique batteur qu’est Paul Thompson. Gus joue de belles transitions hurlantes. Il est admirable, ô comment ! Phil Manzanera a beau jouer des envolées, c’est Gus le boss du cut, c’est lui qui coache le coup comme un crac. Gus nous gave de groove. Il bosse bien ses bedons de basse. C’est une bénédiction pour les tympans hypersensibles. Gus bombarde comme un vieux canonnier de la flibuste. On lui dit : Gus tu vas jouer ça, alors il sort ses triplettes fatales. Bryan Ferry a beau chanter comme un beau diable, c’est Gus qui gode comme un God. Il n’en finit plus de manager l’ampleur apocalyptique. Même chose avec «Three And Nine», il joue ses notes distinguées et si on se laisse aller, alors on n’entend plus que lui. Sur «Out Of The Blue», il joue un beau gimmick de devant-derrière. Il construit bien l’ambiance, c’est un être participatif. Tout le cut repose sur ses épaules. Finalement, tous les bons morceaux de cet album sont montés sur des grooves de basse : «Casanova» ou «Prairie Rose» roulent sur d’intrépides basslines. Pour un peu, on irait lui serrer la main pour le remercier d’avoir sauvé l’album.

Comme Gus est un mercenaire, il n’est pas dessiné au dos de la pochette de «Siren». On voit les cinq autres (Ferry, Thompson, Manzanera, Jobson et McKay) mais pas Gus ! Et pourtant, c’est lui qui sauve encore une fois cet album du désastre. Car il faut dire que le Roxy de 1974 décline dangereusement et vise la pop commerciale (comme Patti Smith et Blondie) et donc les fans de la première heure décrochent en masse. «Love Is The Drug» fut un énorme hit commercial aux États-Unis. Tout le morceau reposait sur la bassline métronomique de Gus. Dans le mix, il était devant, avec sa bassline tagada. La face A était d’une insignifiance terrible et il fallait attendre la face B pour se réveiller avec «She Sells», du Roxy gothique d’usage. Gus amenait une bassline décadenassée, mais comme Bryan Ferry, il savait aussi rester carré d’esprit. La pop narratrice de Ferry devenait vite ennuyeuse et l’absence de panache se faisait cruellement sentir. Il y avait un dernier spasme sur cet album avec «Both Ends Burning» et son atmosphère tendue et généreuse à la fois. Mais on sentait bien que la messe était dite pour ce groupe dont les deux premiers albums avaient été si brillants.

Si on écoutait l’album live «Viva» sorti la même année que «Siren», c’était uniquement parce que Gus jouait dessus. Mais il y a quatre bassistes crédités sur la pochette : Johnny, John Wetton, Rick Wills et Sal Maida. L’avantage de cet album est qu’on retrouve «Pyjamarama», immense classique du Roxy des débuts, vrai cut dandy qui devait figurer sur «For Your Pleasure», mais qui fut rejeté. «The Bogus Man» figure aussi sur la set-list, l’archétype hypnotic d’une époque fantastique, celle de «For Your Pleasure», ce fatidique deuxième album. Ils finissent avec l’imparable «Do The Strand» tiré aussi du deuxième album. On revoit encore les gens qui dansaient là-dessus, lorsqu’un DJ avisé le jouait dans un festival du début des années soixante-dix en Angleterre.
C’est en 1988 que Johnny, Mick Green et Les Sampson enregistrent «Live In Japan». Johnny qui adore le format power-trio a reformé les Pirates et il chante au chat perché, comme dans la reformation des Big Three. Ce disque donne l’occasion de réentendre ce fabuleux guitariste qu’est Mick Green, grand sabreur de goulots devant l’éternel. Il commence son festival dans «Ain’t Got No Money» et Johnny fait rouler sa bassline comme un vieux pro de Liverpool. Ce n’est pas compliqué : dans tous les morceaux, Mick Green place un solo inflammatoire. Ils font une version démente de «Lonesome Train». Ils jouent ça au riff sourd et développent la vélocité rockab. Mick Green allume la gueule d’un solo trash et aussitôt après ce coup de Jarnac, ils nous font un autre coup de Jarnac avec un «Money Honey» tellement saturé d’énergie que la basse de Gus pouette pouette. Il joue ses gammes pépères pendant que ce cinglé de Mick Green incendie le Reichstag. On attendait «Please Don’t Touch» au virage. Voilà le vieux hit de Johnny Kidd et son vieux maître d’équipage Mick Green le joue à la bonne arrache sur un beat rockab. Pire encore, avec «Honey Hush», Mick Green part en vrille, mais pas n’importe quelle vrille, celle du charpentier exacerbé et il multiplie les coups d’éclat à l’infini. Si vous cherchez un bon power trio, un conseil, retenez celui-ci. Ils tapent ensuite une superbe version raunchy de «Peggy Sue» et font chanter des milliers de Japonais sur «Shaking All Over». Dans les liner, Mick Green raconte qu’au Japon, on les considère comme des stars. Un jour, un jeune Jap arriva dans la loge avec une pile de disques sous chaque bras pour demander des signatures : TOUS ceux que Johnny avait enregistrés et TOUS ceux que lui, Mick Green avait enregistrés depuis l’âge de 18 ans, «and that included Englebert Humperdinck !»

Signé : Cazengler, le gustomisé
Disparu le 11 septembre 2014
The Big Three. Cavern Stomp. Edsel Records 1982
The Big Three. Resurrection. Polydor 1973
The Merseybeats. The Meseybeats. Fontana 1964
Quatermass. Harvest. 1970
Hard Stuff. Bulletproof. Purple 1972
Hard Stuff. Bolex Dementia. Purple 1973
Bullet. The Entrance To Hell. Angel Air Records 1992
Roxy Music. Stranded. Island Records 1973
Roxy Music. Country Life. Island Records 1974
Roxy Music. Siren. Island Records 1974
Roxy Music. Viva. Island Records 1974
Pirates. Live In Japan. Thunderbolt 2001
20 / 06 / 15 - DORMELLES / 77
FÊTE DE LA MUSIQUE
JALLIES

Les deux hémisphères du cerveau en ébullition toute la semaine. A droite, la Vaness, notre petite blondinette, le trésor de la prunelle de nos yeux, perdue toute seule au milieu des araignées et des serpents venimeux, dans les Indes lointaines, ô dieux tout puissants quand reviendra-t-elle, j'en aurais presque allumé une bougie à Ganesh, le maître des éléphants débonnaires pour qu'il nous la ramène au galop, j'avais sorti ma boîte d'allumettes et m'apprêtais à enflammer la mèche lorsque une nouvelle surprenante m'arrêta dans mon geste, de source sûre, sur le FB des Jallies, concert à Dormelles sans Vanessa avec... Du coup c'est la moitié gauche du cortex qui s'est mis à gamberger.
L'on en connaît des fous furieux, des insensés qui ont gravi l'Anapurna pieds nus, qui ont traversé la vallée de la mort sans boire une goutte d'eau, qui sont descendus nager dans la fosse aux crocodiles, qui se sont battus avec des anacondas de vingt-cinq mètres de long, si je voulais continuer la liste j'en pondrais vingt-cinq pages sans effort, mais là, l'annonce dépassait l'entendement. Jugez-en par vous-même, l'était écrit en toutes lettres qu'un certain Axel officierait au sein des Jallies en remplacement de Vanessa. Quelle présomption ! Comment un individu de sexe mâle – donc pourvu d'une intelligence supérieure par nature – osait-il se targuer d'une telle prétention ?
Le grand Phil lui-même en bafouillait, n'arrivait plus à reprendre son souffle, l'on a bondi dans sa voiture et l'on a filé darrache-pneu vers Dormelles.
DORMELLES
Tels les incorruptibles d'Eliot Ness s'apprêtant à arrêter Al Capone l'on a déboulé sur Dormelles sans préavis. Joli petit village juché sur une légère colline, perdu au milieu des champs, quelque part entre la campagne et le bout du monde. Le bled pommé que personne ne connaît. Les Dormellois sont une peuplade pacifique. Près de quatre cents personnes réunies devant l'auberge du village se livrent à une étrange activité : engloutissent des milliers de barquettes de frites odorantes tout en écoutant placidement l'Harmonie Municipale... Une étrange idée du bonheur, mais qui serait assez fol pour médire des us et coutumes de la Brie profonde ? D'autant plus que ces gens-là ont l'air d'avoir du goût puisque pour la deuxième partie de la soirée, ils ont choisi les Jallies.
Attention Monsieur le Maire s'empare du micro, je ne m'aventurerai pas à critiquer sa gestion, mais m'a paru d'une efficacité redoutable. Dix secondes pour remercier la fanfare et dix autres pour présenter les Jallies. Rares sont les leaders politiques qui résistent au plaisir de pérorer devant leurs administrés. C'est aussi un homme qui sait apprécier la beauté à sa juste valeur, reviendra vingt-cinq minutes plus tard pour disposer un fanal devant Céline et Leslie, afin que personne ne perde dans la nuit tombante la grâce des demoiselles aux corps diaphanes, désormais nimbés d'une douce lumière.

CONCERT

Z'ont installé un marabout pour que le combo soit à l'abri du vent et des caprices d'une pluvieuse météo. Céline et Leslie devant, les garçons derrière, Tom à gauche, Kross à droite et la curiosité du jour au centre. Ouf ! Sauvés ! C'est un rocker ! Axel, le batteur des One Dollar Quartet, se tient sagement derrière la caisse claire, restera à son poste toute la soirée, tous nos cauchemars s'évanouissent, point de grande folle à la perruque blonde qui s'en viendrait avec une voix de casserole imiter l'absente Vanessa. Ce qui serait plus que regrettable car Leslie et Céline vont assurer pour trois. Relèvent le défi avec brio. Point de jeu de triolet. Le set file à toute vitesse, se sont partagées les rôles, Leslie le rock, Céline le swing. Pas le mur de Berlin entre les deux pôles, s'entraident, l'une chante et l'autre s'affaire aux chœurs.
Les boys reçoivent du renfort. Tristan qui s'en vient les soutenir par deux fois à la guitare et Ludo de Eight Ball qui prend la contrebasse de Kross, le temps d'un morceau. Tom cisèle ses riffs, en douceur et profondeur, particulièrement moelleux ce soir. Superbe sur le Bessie Mae d'Hendrix. Une coulée de miel. Beaucoup de compos personnelles I love him so, Iwana be like you, You'd better be good, Tooka.. de l'or en barre, Céline exubérante, Kross déchaîné, les Jallies ne laissent pas reposer le moulin.

Les gens se sont levés et massés devant la scène, beaucoup d'enfants qui écoutent sagement et des fournées d'adultes comme attirés par le halo d'or d'énergie que le groupe diffuse. Stray Cat Strut et la foule se met à miauler à qui mieux-mieux. Johnny's got a boom boom, Leslie récolte applaudissements admiratifs, Céline emporte la mise sur Tooka, deux soeurs complices qui mettent l'assistance dans leur poche. Ça guinche de partout et ça balance terrible. Deux rappels plébiscités à grands renforts de cris, et c'est fini; malgré les protestations populaires... Un dernier remerciement à Axel sans qui le concert n'aurait pu avoir lieu...
FUITE
Sont tout excités les dormellois, ne savent plus quoi inventer pour que la fête continue. Le pire est l'ennemi du bien. Dans l'auberge, l'on allume la sono et l'on distribue les serviettes en papier. Chassez le naturel et le vieux fond franchouillard revient au galop. L'est temps pour nous de nous extraire de cette France profonde. Dormelles n'a eu que deux Jallies, mais méritait-il davantage ? Le maire a sauvé l'honneur de son village, fallait voir durant le set, la dévotion avec laquelle il alimentait en boisson, nos deux toute belles. Aux prochaines élections je voterai pour lui. A la réflexion non, plutôt pour les Jallies.
Damie Chad.
( Photos du Grand Phil. )
FÊTE DE LA MUSIQUE
21 / 06 / 15 – PROVINS
L'ARAIGNEE AU PLAFOND
Place Balzac. Nous sommes très honorés. Ce soir la ville de Provins s'offre son quart d'heure de folie. L'Araignée au plafond est de retour ! Ce n'est pas un groupe tout à fait comme les autres. Sont capables de tout. Surtout des pires délires. Osent tout et ne craignent rien. Un joyeux foutoir à vous faire devenir malthusien, pour la limitation des naissances et contre la multiplication des petits pains.

Au début n'étaient que deux, le père – une barbiche à la Metallica, très mauvais signe – la mère – discrète qui se cache derrière sa basse. Par la magie du saint-esprit ( ou d'autre chose ) se sont mis à proliférer. Deux garçons, une fille. Z'ont rameuté la grand-mère et les copains des enfants. L'appétit vient en mangeant. Sont maintenant onze sur scène. Trois sax, deux trompettes, une clarinette, batterie, orgue, guitare, basse, et flûte traversière. Nous les avons vus l'automne dernier ( voir KR'TNT 211 du 28 / 11 / 14 ) avec tout un orphéon aussi cuivré que les gisements d'El Teniente au Chili, l'arachnide est à géométrie variable. L'araignée met ses oeufs qui ne lui appartiennent pas dans tous les paniers. Nuits orientales ou soutien vectoriel à soirée Mickael Jackson, l'Araignée soutient tous les défis. Des fils pour tous les emplois. Ce soir, l'Araignée au plafond revient à ses premières amours, le rock and roll. Sous toutes ses formes.
JUMPIN' JACK FLASH
Jack l'éclair filant en intro, manière de donner le ton et de montrer que l'on n'est pas là pour s'amuser. Les cuivres s'en donnent à coeur joie, de la puissance sous le capot. Ça pulse comme un moteur de Ferrari. Encore faudrait-il un pilote dans l'avion. Accrochez sans faute vos ceintures, l'est au micro et glapit comme un renard qui se prépare à entrer dans le poulailler. C'est Mildred, toute belle dans sa tunique à rayures. L'a grandi depuis la dernière fête de la musique ( voir KR'TNT 195 du 26 / 06 / 14 ), s'est transformée en véritable rock shouter, a gagné en maturité. Le papillon sort de sa chrysalide.

C'est parti pour plus de deux heures et demie. L'Araignée ne fait pas de reprises, elle se les approprie. On dirait qu'elles ont été écrites spécialement pour elle. Superbe travail d'orchestration, sont nombreux mais chacun taffe à mort. Mildred plus que les autres, n'aura droit qu'à deux petites récréations de quelques minuscules minutes, sinon c'est elle qui mène l'incendie. Pyromane de première classe. A l'aise partout. Du slow sirupeux façon cool sixties aux plus infâmes barbaries punk. Motor Head, Iggy and the Stooge, Metallica, Ramones, nos troublions ne se mouchent pas dans du papier de soie, sont plutôt adeptes des plaques de métal chauffée au rouge pourpre rock and roll. Faut voir Bob qui arpente la scène avec sa guitare ovale comme s'il emportait un ballon de rugby derrière les poteaux. Sacré vents dans les toiles de l'Araignée.
Inoculent leur venin dans tout ce qu'ils touchent. Mickael Jackson rockpoliné à mort y retrouve ses racines blues. Mildred se joue de toutes les difficultés. Pourvu qu'elle continue, impossible de dire encore quel style elle choisira mais elle a de l'abattage, et de l'aisance. Elle ne plaque pas les mots, elle les arrache, les sort d'on ne sait où et les rejette avec dédain une fois qu'ils lui ont servi. C'est que derrière elle l'armada la pousse dans ses derniers retranchements, faut que la voix domine le tumulte et se fasse entendre. Des copains qui ont fait le tour des autres podiums me susurrent dans l'oreille que c'est ici le plus rock. Je le savais déjà. N'y a pourtant pas que des demi-cageots à roulettes cassées cette année sur le programme, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Ici, c'est l'esprit rock qui règne, c'est du foutraque, c'est du valdingue-moi dans les fourrés, c'est du rentre-dedans-ôte-toi de là, la caravane passe et l'herbe ne repousse pas dans tes oreilles. Un joyeux bordel, pas étonnant qu'ils reprennent du Pogues, c'est la même philosophie, tout ce qui entre fait ventre : filez lui du rock, du punk, du folk irlandais, du rythm and blues, du ragtime, l'Araignée n'est pas difficile. Elle crockque tout et vous le ressort sous forme de fil de soie élastico-indestructible. Le rock du recyclage de tous les courants, c'est l'Araignée au Plafond.
Voyage au pays de la musique populaire. Devant c'est la fête, l'école du Cirque tourbillonne, des gamins infatigables agitent des drapeaux, jonglent avec balles et massues, virevoltent sur des vélos à une roue. Passent un groupe de danseurs country, un peu étonnés par le rythme trépidant de la musique. L'est clair que déposer leurs pas millimétrés sur de telles rythmiques endiablées s'avèrent d'emblée difficile. Mais l'on ne résiste pas à jouer les pom-pom girls dans une telle ambiance, vont tout de même parvenir à nous trémousser une espèce de stroll de contorsionnistes déhanchés sur une fracassée punko-destroy du meilleur aloi. Mildred les fera applaudir. Toutefois, ils se retireront prudemment.
Parfois les saxophones rugissent comme la sirène des riverboats du Mississippi qui descendent vers la New Orleans et parfois Mildred se saisit de sa flûte traversière et nous avons droit à la grandiloquence orchestrale et lyrique du hard symphonique mais l'orage de feu ne se fait pas attendre et l'on repart pour une course échevelée so typically rocky ! Mildred a remis sa tunique à rayures, elle paraissait si jeune et presque fragile dans son ensemble noir. Presque trois heures ininterrompues que l'Araignée batifole sur le plafond de nos espérances. Le public est là, aussi nombreux et encore plus enthousiaste. Mais en ce bas monde tout a une fin même les concerts fleuves de L'Araignée. En cadeau d'adieu, Mildred nous refait Pat Semetary des Ramones. Le maxi combo roule à mort une dernière fois comme s'ils étaient poursuivis par une horde de morts-vivants affamés. La prochaine saison je vous parlerai un peu plus des musiciens. Jeunes et méritants. Un superbe soirée. Faut voir les visages heureux des spectateurs pour comprendre que quelque chose vient de se passer là.
Damie Chad.
THE ROLLING STONES
PHOTOBIOGRAPHIE 1962 – 2012
FRANCOIS PLASSAT / GETTY LMAGES
( FETJAINE / 2012 )

Toujours pareil. Suffit que je m'installe le samedi matin à la terrasse de mon café préféré avec mon paquet de crêpes au rhum pour que les copains se radinent par miracle. Mais ce matin, ne se sont pas contentés de se jeter sur mes rondelles au blé noir arhumatisées, m'ont aussi confisqué mon bouquin. Hi ! Hi ! Encore un livre sur les Stones, moi j'en ai une étagère, en plus t'as dû le payer cher, et c'est tous les mêmes. Je n'ai pas le temps de leur dire que j'ai l'ai eu tout neuf dans son emballage cellophane au tiers de son prix pour dix euros avec en prime une pièce de théâtre de Faulkner, que déjà ils sont dedans plongés jusqu'au cou. Impossible de déjeuner en paix, poussent des ah ! et des oh ! À croire qu'ils sont en train d'assister à une corrida, avec perfidie je les aiguille sur les quatre dernières pages, avec toutes les pochettes des albums par ordre chronologique, j'opère une coupe sur la bande son, une heure et demie à discutailler sur les mérites de celui-ci ou de celui-là...
Normal, c'est les Stones, on a vécu avec. Perso, je serais incapable de vous donner le premier titre des Rolling que j'ai entendu. Parfois j'ai l'impression qu'ils étaient dans un coin de la salle d'accouchement en train de répéter alors que je sortais du ventre de ma mère. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais je n'en suis pas certain. En auraient été capables. Les Stones ont été la bande son, la piste magnétique fond de rêve, pour toute une génération ( la mienne, la meilleure ). Je ne suis pas le seul à le penser, François Plassat aussi. Quoique dans un passé antérieur il ait commis deux livres dithyrambiques sur Paul McCartney et les Beatles, ce qui vous en conviendrez est une énorme faute de goût. Serait-ce un traître qui aurait flairé la bonne aubaine du jubilé de 2012 ? Ne t'inquiète pas coco, l'on en vendra un max aux gogos ! Se feront un plaisir d'ouvrir leur crapaud pour nous refiler leur flouze ! On lui pardonnera car c'est une démarche typiquement stonienne. Vous le mettre si bien, que vous en redemandez. Le summum de l'arnaque rock and roll. En tout cas, c'est rudement bien foutu, du texte et des photos, une bonne maquette et le story board que vous connaissez par coeur qui défile sous vos yeux hagards. Des commentaires sans rien qui dépasse mais situés dans le courant moyen de l'injuste milieu des évènements. Sympathie avec le devil mais pas un siège en permanence retenu dans le Woodo Lounge.

M'a fallu trois heures pour tout lire et regarder. Me reste toute ma vie pour y repenser. Un peu comme quand vous étiez petit, avant de vous endormir le soir vous demandiez à votre maman de vous raconter one more time L'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Vous saviez que la jolie chevrette y laisserait la peau, que le loup était méchant et cruel, mais vous y appreniez l'essentiel de la vie : la mort et la sensation de l'Inéluctable. Idem avec les Stones, un début fulgurant et une longue nuit ( encore inachevée ) de quarante ans. L'irrémissible déclin. Et d'un autre côté, vous avez beau assurer qu'ils sont aussi usés qu'une semelle de corde, ils sont toujours là, indiscutablement. Une caisse enregistreuse qui empoche les millions de dollars. Les Stones, c'est le Sol Invictus des rockers. Le signe inaltérable de la victoire du rock and roll. Ils sont le loup-garou et nous le capridé stupide. Mais l'on s'en fout, sont les seuls qui nous permettent de voir l'éclipse du soleil au lever des petits matins glauques de nos médiocres existences.
A la maison, j'ai vérifié la coquille. C'était mon cerveau qui déraillait. Ian Stewart – le sixième Stone - un mystère éminemment plus prometteur que le cinquième évangile - est bien mort en 1985. Trente ans qu'il a disparu, me semblait que c'était avant hier. Tant qu'on est à empiler les cercueils autant se débarrasser de celui de Brian Jones, le Billant Jaune, celui à qui Claudel n'aurait pas hésité à dédicacer son Tête d'or. S'est noyé dans sa piscine. S'y est-il jeté tout seul, ou ses potes l'auraient-ils poussé ? Dans les bons films l'on accuse de préférence les mauvais innocents. Si Romulus n'avait pas tué Rémus, que serait devenu Rome, sans cette offrande sanglante aux dieux de la puissance ?
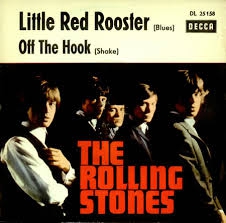
Autre couple. Bill Wyman. Charlie Watts. Dans le casting final, suis sûr que Bill a été choisi parce que accessoirement il jouait de la basse. Basique, sans se poser de question. Aucune imagination mais aussi régulier qu'un métronome. Le balancement monotone idéalement imperturbable pour que Charlie puisse décaler sa charley d'un presque temps de retard. Mais n'importe qui aurait pu le faire. Non, le Bill a été choisi pour sa sale gueule de figurant dont on s'arrange pour qu'il soit systématiquement dans les arrière-plans. Ne participe pas à l'action, mais il inquiète, parangon de laideur anglo-saxonne, mais c'est pour lui que les filles mouillent leur culotte, de peur mais elles ne s'en aperçoivent pas, croient que c'est pour le gigolo devant qui ondule du cul avec son micro-bite à la main. Le Bill s'est taillé après trente ans de bons et loyaux services, a pris sa retraite sans état d'âme, certains que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. L'est parti et personne ne l'a remarqué, toutefois depuis les cheveux de Charlie ont blanchi et de la bande des septuagénaires frétillants, c'est celui qui accuse le plus son âge.
Passons aux Twin Towers. Encore debout. L'une immobile comme un roc, toute fissurée, et l'autre se balançant comme un garçon coiffeur autour de son client. Le majordome et Monsieur Loyal. Le clown triste et l'Auguste péroreur. Le chevalier à la triste figure et le bateleur. L'un qui n'en pense pas moins et l'autre qui se vante de tout. L'un de drogue, l'autre de drague. Mais à chacun son métier. Entre les deux, celui qui fait des Ron de jambe en bois avec sa guitare, ne donne pas l'impression de jouer son propre rôle, se contente d'être ce qu'il est. Sur le jeu des échecs stoniens c'est bien lui le fou qui emprunte la diagonale du rire pour se moquer de lui-même. Et du bonheur de vivre une fabuleuse aventure.

Les pierres roulantes ont commencé par tout écraser sur leurs passages. Dégringolaient des collines du blues, ont continué sur les plaines fertiles du rock and roll et ont fini par s'ensabler sur les lagunes disparates d'un métissage de rythm and blues et de funk raboté. Maintenant elles tournent sur elles-mêmes indéfiniment. Inutiles, dérisoires, vertigineuses. Z'ont été des commandos de choc, ne sont plus que des caissières de supermarché. Un léger côté rétro à la dactylo-rock. Et pourtant les Stones, lugubres figures chatoyantes, capharnaüms ordonnés et chaos rampant perchés sur les arbres ( attention aux cocotiers ) du rêve ! Ils sont le fleuve qui roule des flots tumultueux et le barrage qui les retient et les emprisonne. Ils sont l'anneau et Gollum, les filles qui dansent, le tumulte du fleuve et l'or miraculeux. Qui scintille au fond et gît dans la vase nauséabonde.
Une vie remplie à ras bord. Ne peuvent pas dire qu'ils n'ont rien vécu. Un PIB ( Passé Intérieur Brut ) existentiel plus dodu que celui de la population de quatre départements français. Street fightin' men du bon côté de la barricade. Des nantis. Tout ce que je déteste. Fascinants. Une image de mauvais garçons opératoire. Ont su devenir la cible du Système tout en l'utilisant. Peut-être le groupe situationniste par excellence. Point d'appui glissant de la révolte. Bâtons merdeux pour qui se risque à essayer de les manipuler. Le gros caillou vous retombe sur les pieds dès que vous essayez de faire pression sur les leviers. Sont les maîtres du jeu. Sont les seuls qui posent les pions sur le listel. Façon que ça tranche dans le vif, et de jouer les deux faces en même temps. Côté blanc, côté noir. Le positif et le négatif, qui ne s'annulent point, mais qui se renforcent l'un l'autre.

The Greatest Group of Rock'n'roll on the Earth, c'était l'appellation incontrôlée de leurs premiers pirates, avec le serpent vert gothéen et à section carré qui alignait le labyrinthe univoque de ses anneaux sur toute la pochette. Une évidence à laquelle il était impossible de se soustraire. Quand on pense aux Blue Caps de Gene Vincent qui sont rentrés à la maison après un an de tournée réputée épuisante, l'on voit qu'avec les Stones le rock changeait d'échelle. Les Beatles eux-mêmes se sont dépêchés d'arrêter les frais sous prétexte qu'ils ne s'entendaient plus jouer, à cause des cris des filles. Il aurait pourtant été plus simple de couvrir les gynécologiques glapissements du public en achetant une sono un peu plus grosse. Cela tombe sous le sens, mais l'hypothèse n'a jamais été envisagée par les journalistes. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'aboyer trop fort.
C'est en cela que consiste la grandeur des Stones. N'ont pas continué jusqu'au bout. Ont dépassé le bout de la route depuis longtemps. Rien ne les a arrêtés. Peuvent changer une roue crevée de temps en temps. La halte peut s'éterniser, mais un jour ou l'autre on the road again. La vieille highway du blues, à fond la caisse. Pour la pureté, ne vous montrez pas exigeant. Du côté d'Elvis, ils ont préféré le costume du Colonel Parker. Rock and roll circus et rock and roll barnum. Les paillettes et la fanfare. Beaucoup de bruit et pas pour rien. Vous en prenez plein les mirettes pour beaucoup de ronds. C'est la vie, comme disait Johnny faut payer cash si tu veux être servi. En tous cas niveau attractions ils ne vous déçoivent pas. Le phallus géant du docteur Freud en version gonflable ( ça c'est gonflé ! ), et les numéros hasardeux se suivent et ne se ressemblent pas, sont tour à tour toutes les pièces de l'échiquier déchiqueté, les plus belles filles du monde et la galerie des monstres, les fil-de-féristes du riff et les prestidigitateur du swamp, mais le plus incroyable c'est la ménagerie, un seul animal, mais le plus terrible, le rescapé de la préhistoire, le dinosaurock, la bête la plus effrayante du disney-parc qu'est devenue notre planète. Du carton pâte, mais le prototype du développement durable. L'histoire sans fin et sans retour. Dès que les Stones sont sur scène, il y a comme un lézard dans votre existence. Pas la minuscule fêlure sur la façade de votre maison. Non, pas une broutille dans les lentilles. Le gouffre sous vos pieds. Pris au piège. Pauvre petite mouche sur le papier collant.

Contrairement à tous les autres groupes qui vingt ans après se réunissent une dernière fois pour se rappeler le bon vieux temps de leur gloire passée, les Stones ne se reforment pas. Ils se déforment. Tels qu'en eux-mêmes l'éternité les change. Une dimension burlesque du monument qui se gondole mais qui ne casse pas. Usés jusqu'à l'os mais d'une usure inusable. Vous n'en voulez plus, en voici encore, et vous l'ouvrez en grand. C'est ce qui vous rapproche d'eux. Vous terminerez comme eux. Vous crèverez la gueule ouverte. Insatiables. Insatisfactionnables.
Et comme vous êtes polis, vous n'oublierez pas de dire merci.

Damie Chad.
14:50 | Lien permanent | Commentaires (0)





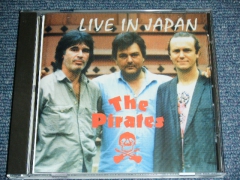

Les commentaires sont fermés.