01/07/2015
KR'TNT ! ¤ 242 : FLAMIN'GROOVIES / LIZARD QUEEN / NO HIT MAKERS / L'ARAIGNEE AU PLAFOND / LOREANN' / ERVIN TRAVIS NEWS
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 242
A ROCK LIT PRODUCTION
02 / 07 / 2015
|
FLAMIN' GROOVIES / LIZARD QUEEN NO HIT MAKERS / L'ARAIGNEE AU PLAFOND LORREAN' / ROCK COLLECTION ERVIN TRAVIS NEWS |
|
ERVIN TRAVIS NEWS
L'état de santé d'Ervin empire, examens sur examens et prise de sang sur prise de sang, on ne trouve pas ce qui se passe ! ( FB : Lyme – Solidarité Ervin Travis ) |
PARIS ( XIX ) / TRABENDO / 18 - 06 – 15
FLAMIN' GROOVIES
FLAMIN' GO !

Lorsqu’il vit Cyril Jordan arriver le premier sur scène pour tester le branchement de sa Dan Armstrong, il pensa à Orphan. Orphan où es-tu, maudite phantomisation ? Silence. Le temps se vit condamné à passer à l’imparfait. Orphan ne viendrait pas.

Quarante vertigineuses années après «Teenage Head», Cyril Jordan n’avait pas changé. Ou si peu. Lunettes à verres fumés, juste-au-corps dans les tons gris, jean noir moulant et boots Aniello. Tout cela sur ossature de rock-star. Jambes faiblement arquées. Walkin’ down the streets. Vieux parfum de protö-punkitude à demi éventé. Shake some... Huuummm, aurait ajouté Orphan.
Il continuait de fouiller les recoins d’ombre à la recherche d’un petite silhouette, celle d’Orphan qu’il avait déjà cru apercevoir, un soir de 2004 où Arthur Lee avait éclaboussé cette même salle de tout l’éclat de sa majesté. Ou encore un soir de 2006 où Barry Tashian avait recréé l’illusion des Remains, l’espace d’une goutte de temps tombée dans l’éternité. Cette silhouette constituait une sorte de talisman : elle transformait le plomb du Trabendo en or, comme au temps jadis où elle transformait les pages d’un magazine ordinaire en Növö Testament. Enveloppé d’une cape de mystère, Orphan le hantait, tel un Paracelse électrique ou pire encore, un Flamin’ Flamel des temps modernes. Fallait-il prier Dieu pour qu’il fisse paraître Orphan ? Ou fallait-il renoncer définitivement à l’attendre pour enfin devenir adulte ? - Half a boy and half a man/ I’m half at sea and half on land, oh my bye-bye.

Il vit les autres arriver. Un George Alexander si fin et si vieux qu’il pouvait passer derrière une affiche Supersnazz sans la décoller. Un Chris Wilson si gros qu’il pouvait déposer sa Telecaster bleue sur le promontoire de son estomac. Et tout rentra dans l’ordre au moment où Cyril Jordan attaqua «Feel A Whole Lot Better» des Byrds.

C’est là, en cet instant groovy très précis, qu’il prit place à bord du supersonic rocket-ship qu’on appelle aussi la machine à remonter le temps. Et dans la secousse d’une violente accélération, il fut catapulté à travers la poussière des ans jusqu’au sol humide d’un parking - Flamin’ go ! - Au cœur de la nuit, accroupi sur le parking d’une cité ouvrière, bidon et tuyau en plastique en mains - Son copain et lui n’avaient pas de quoi passer à la pompe, alors ils sifflaient dans les réservoirs de quoi alimenter la TR4 et rouler jusqu’à la côte où ils chassaient la louve chaque week-end - High flyin’ babies - Shoots d’essence et d’éther, avec pour seul bain de bouche une flasque de Ricard - Ce dandysme des pauvres avait pour bande-son l’album «Teenage Head» enregistré sur une cassette et qu’ils écoutaient en boucle pendant leurs virées délinquantes sur la côte normande. Orphan hantait à l’époque chaque recoin de son imaginaire. Il ne vivait que de Stooges et de Groovies, quand d’autres ne vivaient que d’amour et d’eau fraîche.

Sur scène, George Alexander jouait de la basse comme s’il avait encore vingt ans. Il réactivait son antique gestuelle de toréador et offrait à Cyril son frère de sang des lignes de basse aussi ronflantes que celles de l’âge d’or, une période lointaine qu’il faut situer entre «Teenage Head» et les singles Bomp. À l’autre bout de la scène, Chris Wilson s’évertuait à chasser le fantôme de Roy Loney. Tout alla bien jusqu’au moment où, comme la grenouille de La Fontaine voyant sur la berge se présenter un bœuf, il s’enfla si vite qu’il creva - I’m a monster/ Got a revved up teenage splaaaaaaaaaaash - Orphan l’aurait prédit, ce qui pouvait à l’extrême rigueur expliquer sa désertion.

En l’an 2000, lors d’un fabuleux interview-monologue, Orphan déclara : «J’ai fait ensuite un texte sur les Flamin’ Groovies et je n’ai plus pu écrire pendant quelques mois.»
Souvenez-vous, Orphan fut le premier à signaler l’existence des Groovies et il réserva cette exclusivité aux lecteurs de sa rubrique Trash.

De la même manière qu’Orphan, il avait lui aussi - et depuis longtemps - considéré les Groovies comme le tenant d’un aboutissant. On pouvait disserter à l’infini sur Kim Fowley, Brian Wilson, les Dolls ou Jerry Lee Lewis, mais pas sur les Groovies. Cyril Jordan échappait à toutes les machinations, à toutes les tentatives de détournement de son histoire. Il restait l’une des plus brillantes incarnations du rock anglo-américain des sixties. Ça devint flagrant avec la publication de «San Francisco Beat» dans Ugly Things - «Hello - welcome to the San Francisco beat. It’s 1967 and it’s been three years since the British Invasion and things are poppin’» - Épisode après épisode, dans un langage extraordinairement swinguant - à l’image du mirobolant mini-blaster «Sneakers» - il allait nous raconter dans le détail la genèse des Groovies et de la scène de San Francisco. Dans sa musique comme dans sa prose, Cyril Jordan veillait depuis l’origine des temps à se démarquer du commun des mortels. Il disposait pour cela d’un style et du fameux scalpel du mage cité en référence par Orphan.
De toute évidence, il y avait en Cyril Jordan quelque chose d’irrémédiablement groovy : «J’aimais bien les Who, mais quand j’ai vu Townshend casser des Gibson ES 335 l’une après l’autre, I thought to myself, Hey ! Ne casse pas cette guitare ! Give it to me !

En le voyant œuvrer sur scène, il comprit - comme Orphan bien longtemps avant lui - que cet homme adulte continuait de se conduire en fan de rock obsessionnel, exactement de la même façon que Greg Shaw ou Kim Fowley. Un soir, alors que les Stones étaient en transit à l’aéroport de San Francisco - ils attendaient l’avion qui devait les transporter ensuite en Australie - Cyril Jordan et ses copains réussirent à semer les membres du service d’ordre qui les poursuivaient et à entrer dans la salle d’attente pour V.I.P’s où se trouvaient les Stones - They weren’t pleased. Everyone, except Brian Jones. Brian was like that, a very friendly sort of person - C’est là que le gamin Cyril Jordan rencontra son idole - «Brian vient vers moi et me dit hello. Il aimait bien la veste en velours rouge que j’avais trouvée chez Town Squire. Lui, il portait un costume argenté avec un col Chesterfield. Je lui dis qu’il portait les fringues les plus cool de la planète !» - Wow ! Cyril Jordan ! Bien sûr, il claquait des doigts en écrivant ça ! Snap snap snap ! S’ensuivait une chute d’histoire enflammée : «Brian got the nickmane Prince Jones at the Monterey Pop Festival in 1967. He was the one that did all the networking. Just like the leader he was. He is missed every day. God bless you, Brian Jones - Anton Newcombe et Cyril Jordan : même combat ?

Cyril Jordan jouait sur sa Dan Armstrong avec une sorte de gourmandise perverse, celle d’un voyou entré dans une bijouterie et qui se sert - Ses solos coulaient comme des rivières de diamants dans un sac de sport. Il fermait les yeux et s’absorbait dans son art. Comme dans une séquence de Tex Avery, son visage s’illumina brutalement au moment où il attaqua «Slow Death» - que des gens réclamaient - bande-son idéale, s’il faut en choisir une le jour de sa mort. Cyril Jordan n’avait rien perdu de son éclat. Ça crevait l’œil. Celui du cyclope, bien sûr. Pauvre géant ! On l’entendit s’enfuir en hurlant alors que Cyril Jordan marmonnait sous le manteau ses vieux palabres rescapés des seventies - I called the preacher/ Holy holy - Tout cela revenait exactement au même, finalement. Le serpent du temps se mordait la queue. Orphan brillait par son absence et Cyril Jordan jouait comme un dieu, mais un petit dieu d’autel de montagne sur lequel viennent parfois se recueillir quelques mystiques égarés. Ses yeux pétillaient - I saw them flashing like airplane lights - au moment où la grosse machine des Groovies reprenait son envol, propulsée par l’implacable George Alexander. Mais le groupe semblait irrémédiablement coupé en deux. Chris Wilson jouait dans son coin et les deux anciens dans l’autre, affichant publiquement leur fantastique complicité de copains d’école. Snap snap snap.

Pendant que coulait à flot le ramshackle des Groovies, il émit secrètement une hypothèse : Cyril Jordan devait être à ce moment-là le plus heureux des hommes. Il savait pour l’avoir vécü que rien ne valait le plaisir de jouer sur scène avec ses meilleurs amis. Au hit-parade des plaisirs, ceux de la chair venaient aussitôt après. Jamais avant.

Lorsqu’ils se livrèrent au rituel des présentations, George Alexander mit une certaine emphase sur le «my friend» qui précédait le nom de Cyril Jordan. Les deux amis tissaient leur manteau de légende depuis quarante ans, et ce modeste hommage prit une tournure particulièrement émouvante, comme lorsqu’Iggy - autre héros Orphanien - présenta un Ron Asheton rescapé de l’oubli au public du Zénith, un peu plus loin dans le même parc.

Cyril Jordan fit une brève présentation de Frankie Lee Sims et embraya aussi sec sur le boogie magique de «Married Woman», nouvelle accélération spatio-temporelle, stomp des cités d’avant les cités, stomp des pas vers la rue des Lombards - «Sweet Punk était plutôt effondré sur le capot des voitures, rue des Lombards, en plein soleil, il avait une veste en cuir. Quand Mesrine est mort, il a remisé cette veste en cuir» - Stomp des jours sans foi ni loi, des coups d’overdrive et des objets prohibés au fond des poches - Don’t take a married woman, a honey babe - Stomp du basculement des vies dans le monde adulte - «There weren’t many of us with the velvet coats and long hair in the world at that time» (Cyril Jordan) - Stomp d’un temps filigrané par le génie d’Orphan qui honora un magazine rien qu’en lui cédant sa prose (Je chante le rock électrique - «texte quand même très scolaire au vu de l’électricité à laquelle il prétendait» - Y.A.) - Stomp d’un temps présent qu’il fallait négocier seconde après seconde avant que l’oubli ne l’avalât - Et le carrousel des Groovies s’emballa avec «Shake Some Action», l’emblème des temps révolus qui signa en 1976 la renaissance et la mort d’un groupe qu’une mauvaise réputation avait rendu célèbre dans le monde entier, de la même façon que «Bird Doggin’» avait signé la fin du règne de Gene Vincent.
Signé : Cazengler, flamingogo gaga
Flamin’ Groovies. Trabendo. Paris XIXe. 18 juin 2015
Ugly Things #36, 37, 38 et 39
L’interview d’Yves Adrien du 27 mars 2000, à la Coupole, parue dans Les Inrockuptibles
De gauche à droite sur l’illustration : Cyril Jordan, George Alexander, Victor Penalosa et Chris Wilson.
FONTAINEBLEAU
LE GLASGOW - 24 /05 / 2015
THE LIZARD QUEEN
On est arrivés à temps pour la balance. Il est des concerts dont on ne voudrait pas rater une miette. C'est que ce soir nous avons rendez-vous. Pas avec n'importe qui, avec Jim Morrison. And the Lizard Queen. C'était une soirée dans la Brie profonde, à la terrasse d'un café, Cindy de Sugar Foot Graceland était en train de parler de son projet, monter un groupe Tribute à Jim Morrison. Pas une idée en l'air. Les choses commençaient à se concrétiser. Cid, nous ne l'avions vue qu'une fois sur scène, trois minutes. L'avait rejoint les Jallies pour un morceau. Peu de temps, mais suffisamment pour qu'elle soit dans le collimateur, n'avait pas chanté, avait habité le morceau, de tout son être, la voix, le corps, une osmose parfaite.

Je n'aime pas spécialement les tribute-groups, même si le rock est une perpétuelle redite d'un répertoire mille fois pillé et refourgué, si souvent en douce dans le circuit, que l'on en arrive parfois à se méfier des originaux ! Oui, mais à ce que j'avais entrevu de Cid, je faisais confiance pour un minimum d'authenticité et de fièvre bleue. Quelques mois d'attente, et voici enfin l'occasion de découvrir les miroitantes écailles du lézard.
THE SOFT PARADE
Un groupe, c'est comme un regard de fille saisi au vol. Tout est dit, conclu et consommé dans les premiers instants. Le reste n'est que le déroulement existentiel de cette rencontre qui a déjà eu lieu, avant. Les Lizard Queen ont mis toutes les chances de leur côté, deux filles en première ligne. Les Doors, ne furent pas pour rien surnommés les Rolling Stones américains. Possédaient la même chose que le groupe à Brian, une marque de fabrique qui permettait de les identifier. Un son, le son. Ne confondez pas avec le son de chez Sun, ou celui des studios Stax, ou la purée à la framboise de la Motown, ce sont là des tarifs familiaux, distribués uniformément à tous les heureux élus acceptés par le grand manitou, directeur ou l'ingé du studio. De la tambouille communautaire. La marmite de l'Armée du Salut en quelque sorte. Pas besoin d'être un musicologue averti pour entendre que chez les Doors tout reposait sur l'orgue de Manzarek. L'avait écouté les Animals et en avait conclu, qu'il ne se contenterait pas d'accompagner son chanteur pour n'intervenir que dans les trente secondes du solo autorisé. Juste le contraire, aucune envie de se mettre au service del cantaor, au poète de placer sa voix et de bourdonner comme il le pourrait au milieu de la tempête organistique. Coup de chance Jim possédait un bel organe – les mauvaises langues disent deux – qu'il hissait sans problème au-dessus du mur du son élaboré par Ray. Manzarek n'a jamais servi la soupe à Morrison, c'était ce dernier qui venait bouffer dans son râtelier. Toute blonde, toute pâle, Léa enfonce deux touches de son clavier, et le son Doors vous saute à la figure, vous arrache les yeux et les oreilles, actionne de temps en temps son Korg, et la magie envoûtante des Portes vous enveloppe de ses nappes d'arpèges ruisselantes. Remontée vers les vieux harmoniums des congrégations d'esclaves, le rock plonge une de ses racines dans le gospel. Soul Kitchen, cuisine de l'âme, difficile d'être plus explicite. Se sont partagées les rôles. Léa reproduit le son des Doors, à la perfection, sourire aux lèvres, dans le frou-frou des volants de sa tunique, l'évidence du naturel. Tribute ne signifie pas copie conforme. L'on en est même loin. Dans sa longue robe orange qui moule son corps, Cid n'est pas Morrison, trop mince, trop féminine, pour prétendre évoquer l'épaisse silhouette du créateur de Seigneur et Nouvelles Créatures. Mais un même feu émane de sa personne. L'a intériorisé toute la violence de Jim Morrison, et c'est sa voix qui la ressuscite. Elle éructe et rugit, de tout son corps, traversée de stridences incendiaires, secouée de spasmes glapissants, elle est vestale et prêtresse d'un culte qu'elle rend tout d'abord à elle-même. Impressionnante. A trente centimètres d'elle la tablée d'une douzaine de grands garçons en goguettes venus pour écluser des chopes de bière géante, feront preuve tout le long des deux sets d'un grand respect à son égard.

« Hello, I love you, Won't you tell me your name », l'on change de registre, l'on passe de la musique sacrificielle du premier album à la sensualité excitante du rock basique. Les Doors ne sont pas gênés pour voler le riff au You Really Got Me des Kinks. L'occasion de s'attarder sur les garçons, Tristan – coucou le revoilou, l'a fait la semaine dernière un passage éclair à la guitare sur le concert des Jallies à Dormelles – est maintenant à la basse. Rappelons pour la petite histoire que les Doors ne possédaient pas de bassiste. Sans doute le poste le moins facile, le danger de se faire manger par les sonorités pompeuses de l'orgue est grand, peut-être est-ce pour cela que Tristan cale son jeu sur celui de Jul le batteur. Face à la tonitruance de l'orgue, la basse de Tristan va amener cette sensation de ruissellement, d'eau qui court, si manifeste sur le L.A. Woman par exemple. Jul le plus mal placé, relégué faute d'espace dans un coin vers lequel les filles doivent afin de l'apercevoir se tordre le cou, n'a donc pas cette place centrale de Densmore qui consolidait tout ce que Manzarek construisait. Les Doors furent un groupe particulièrement bruyant. N'empêche qu'en dernier recours c'est sur la rythmique que notre Cid campeodora s'appuie pour cloisonner les différentes séquences des morceaux.
Je ne vais pas vous recopier toute la set list, un très beau Love Street, un somptueux Not To Touch, The Earth and un 20th Century Fox entre granit et argile, et un My Wild Love pratiquement à capella qui conclut le set.
THE END

Non je n'ai pas oublié le guitariste. Chapeau noir planté d'une plume d'indien, la classe. Alex a assuré tout le premier round. Je me fais la remarque qu'il se débrouille mieux que bien, mais avec le second set la donne change. L'orgue n'est plus le roi de la fête. Les Doors furent aussi un grand groupe de blues, et qui dit blues sous-entend une certaine ruralité musicale. J'entends par là, un expressionnisme qui ne tend pas vers l'impudicité superfétatoire de l'orgue. Léa ne s'en roulera pas autant les pouces, mais jouera en quelque sorte en sourdine, laissant le champ libre au trio des garçons. Alex et sa guitare. Tricote méchant. Me suis rapproché pour le voir jouer. Très près de ses cordes. Enfin un guitariste qui se sert de son bigsby et pas à la petite semaine pour fleurdeliser une note toutes les quarante minutes. Prolonge le son, et joue par-dessus. La guitare miaule à qui mieux-mieux. Caresse du doigt la corde vers le haut, et puis retourne vers le bas. Relation d'amour, la porte à ses lèvres, l'embrasse comme le sexe d'une maîtresse, en extase, la cale derrière sa tête, la fait glisser le long de son dos, le tout sans ostentation, ne cherche pas le spectacle, plutôt l'intime expression kama sutrique d'une relation qui n'appartient qu'à lui et qu'à elle. Gestes, précis, sûrs et rapides. Un guitar héros, un guitar éros.
Break on Through en début de set comme pour accélérer la cadence. Cindy est dans l'appropriation. Visage inondé de sueur, robe collée à sa peau, et toujours cette énergie qui émane de son corps. Chaude ambiance, deux fois plus de spectateurs, deux fois plus de hurlements d'approbation à la fin de chaque morceau. Elle doit atteindre ce moment privilégié où l'on entre en transe, où l'on a l'impression qu'une force étrangère s'est installée en nous et a pris le commandement de nos actes, et que l'on assiste en un dédoublement intérieur à cet étrange phénomène de dépossession de soi pour être allé jusqu'au bout de soi. Il existe un yoga du diable et de la voix.
Back Door Man, le vieil hululement du loup hurleur, toute la puissance chamanique du blues. Nul besoin de féminiser les paroles. L'est des moments magiques où l'on n'est plus, ni homme, ni fille, mais simple présence animale au monde. Strange Days – le deuxième album des Doors eut cette différence radicale d'avec le premier que l'on retrouvera plus tard entre le deux et le trois de Led Zeppelin – c'est ainsi lorsque les portes sont ouvertes et que n'importe qui peut venir chez vous. Crystal Ships, vous aussi pouvez sortir de vous et entreprendre le grand voyage sur la nef des fous, la nef des folles. Prégnance de la poésie de Morrison, la poésie et le rock and roll sont des filtres qui agrandissent le monde. I looked at you,rêve d'innocence et chant d'expériences. Riders On the storm, nous nous acheminons vers la fin, la menace du monde est toujours là. Elle nous hante aussi sûrement que l'assassin qui fait de l'auto-stop pour arrêter votre vie. L. A. Woman, prenez le problème comme vous voulez, vous ne le résoudrez pas. Il n'y a de solution que finale. This is the end.
Etrange comme cette poésie aussi désespérée a pu engendrer tant de folie et d'enthousiasme dionysiaque. Quelques voix s'élèvent pour demander un rappel. Cindy se tourne vers le grand calicot avec lequel le grand écran qui sert à regarder les matchs de foot a été obturé. Le portrait de Jim Morisson et le titre de sa biographie en gros : Personne ne sortira d'ici vivant... Non dit-elle, il est trop tard. Et personne n'insiste.

L'on sort dans la rue en quête de fraîcheur. Dans le bar les grands garçons rendus à leur liberté, retrouvent leur insouciance, ils forment une chaîne en scandant « Le petit poney ! Le petit poney ! ». Il faut de tout pour faire un monde. La dure loi des contrastes.
LIZARD QUEEN
La reine lézard ne nous a pas déçus. Superbe concert. Alex April – j'ai voulu en savoir un peu plus sur lui – m'apprend qu'il a un autre groupe homonyme, un binôme guitare et batterie, un petit tour sur son FB m'a confirmé qu'il s'agit de quelqu'un d'originale envergure, dont nous reparlerons un de ces jours.
Damie Chad.
27 / 06 / 15 – TROYES
NO HIT MAKERS

Deux lignes sur le FB de Phil Fifi, No Hit Makers, ce soir à Troyes. Me renseigne sur le site municipal, wouah ! ( ce n'est pas mon chien ) soixante-dix concerts en moins de deux mois, d'accord, beaucoup de musique classique, et de tous les groupes au programme, à part les No Hit Makers, ce n'est guère pharamineux, mais nous saluons l'effort des édiles. Une heure plus tard la teuf-teuf nous dépose devant le 3B, mes prévisions étaient justes, un petit groupe de rockers finit de prendre l'apéro, et hop c'est parti pour la place de la mairie. Du coup, la patronne ferme le bar. Le rock d'abord, les affaires ensuite. Saine philosophie. Un petit coup de flip tout de même. Se serait-on trompé de date ? Trois bonnes soeurs en cornette, nous dépassent et filent droit vers la place de la mairie, puis deux autres, puis trois autres, et encore trois, tout un couvent en goguette. Serait-ce des admiratrices des No Hit Makers ? Billy résout l'énigme, il y a aussi un concert dans une église. Ouf !

Le cours de l'Hôtel de ville est vaste, bordé de restaurant aux terrasses remplies de convives, un manège à l'ancienne style chevaux de bois, et un podium à l'autre bout où s'affairent les No Hit Makers. La balance est expédiée en moins de cinq minutes, et dès le deuxième morceau l'espace devant le podium est couvert de monde. Comme quoi, il suffit de proposer pour que le rockabilly devienne une musique populaire.
SOLO, ONE SET

Gretsch électro-acoustique d'un bel orange pour Eric, lead singer, Gretsch cochranesque pour Vincent, Jérôme est aux drums, Larbi – particulièrement sage ce soir à la slapbass. Pas un de moins et inutile d'en avoir davantage. Les Makers annoncent la couleur tout de suite School of Rock'n'roll, de Gene Summer. Du rockabilly, mais revu et corrigé. D'abord le cliquetis incessant de la basse de Larbi, se débrouille – je ne sais comment – pour que le slap soit dans les aigus. Incessants, une perforatrice à oreilles. Jérôme se case dessus et emmène le rythme avec ses brisures et ses reprises, Vincent suit le mouvement, cordes grondantes, lâche de courtes pincées meurtrières, repart sur un tempo binaire pour à la moindre occasion dégainer et nous affaler quelques rafales bien pesées. La voix d'Eric amène une dimension lyrique, au moindre morceau. Un très beau timbre envoûtant. Un accent qui retrouve facilement les inflexions sudistes, ce léger tremblement en même temps, et nasillard, et très pur. Difficile à acquérir, abstenez-vous d'imiter le gosillement du canard pataud, tapez plutôt dans un doux roucoulement de la colombe. Terriblement sensible chez les morceaux originaux des No Hit comme The Doors of Heaven et Soldier of Peace. Envoyés en force, bondissants comme des torrents d'eau vive.

Pas le temps de vous attarder en vaines songeries, les titres défilent, la vague vous emporte, les No Hit Makers profilent une silhouette d'avion de chasse à tout ce qu'ils touchent. A peine parti que c'est déjà l'atterrissage, Eric hausse sa guitare, lève la jambe comme s'il commençait à dérouler un kata de karaté et la merveille s'arrête illico. Applaudissements, sourires, Vincent triture un peu de friture, le temps que le reste du groupe se remette en position de catapultage et hop c'est reparti, direction les étoiles.

Véritables montagnes russes avec le décrochement du coeur dans les descentes, Whatcha Gonna Do, The Train Kept a Rollin', You can Cry, vous avez autre chose à faire qu'à pleurer si vous avez raté le train, rattrapez-le dans votre Long Black Shiny Car, les No Hit vous promènent à toute vitesse. Z'ont gommé toute ce fond de tristesse et de nostalgie geignarde issue du country qui point son museau dans nombre de titres de pure rockabilly des origines. L'indolence rurale, l'immobilité reposante de la nature. S'est écoulé de l'eau le long des berges du Mississippi depuis ce temps-là, le rockabilly a subi les contrecoups de l'urbanisation, et de sa violence. Ce n'est pas sans raison que le groupe est souvent qualifié de néo-rockab. Une appellation passe-partout peut-être, mais à voir la chaleur avec laquelle le show est reçu par l'assistance, il est hors de doute que les No Hit Makers sont appréciés par les nombreux jeunes du public composite en tant que formation produisant une musique contemporaine et point du tout vintage. Accueil d'autant plus encourageant qu'Eric ne se prive point de faire allusion au passé prestigieux de cette musique.

Blind and deaf – dernier morceau sorti sur la compilation Four on Fur, All I can Do is Cry, Boogie Chillen, tous les trois raftés comme sur les chutes du Niagara, et Eric annonce la fin. Deux titres en rappel, et c'est le bout de la route. Trop rapide, une heure et demie qu'ils jouent doivent retourner dare-dare à Paris pour enregistrer aux aurores... Sont assiégés par le public qui demande des disques. Notamment un touriste américain de San-Francisco qui les prenait pour des compatriotes et qui n'en revient pas que l'on puisse jouer avec autant d'authenticité une telle musique en France. Difficile de trouver un meilleur compliment.

Damie Chad.
( Photos : FB de Christophe Banjac )
28 / 06 / 15 – PROVINS
L'ARAIGNEE AU PLAFOND
LOREANN'

La copine débarque à midi pile à la maison ultra-pressée comme une orange. Suis passée par le centre ville, dit-elle tout essoufflée : il y a L'Araignée au Plafond et Loreann' qui passent cette après-midi, à treize heures pile. Le genre de nouvelle qui vous met en rogne, viens de regarder le site municipal et ils n'annoncent rien. Faut faire vite, avec la sauvagerie d'un guerrier samouraï pourfendant en huit tranches son ennemi je découpe un melon en douze quartiers et hâte la cuisson d'un travers de porc, la nourriture de base des bluesmen du Delta en 1923, comme personne ne l'ignore. Et après ce frugal repas sans dessert ni café, nous fonçons vers la place Honoré de Balzac. Midi cinquante, nous sommes à quatre-vingt mètres du but lorsque nous entendons la voix de Mildred. Malédiction, ils n'ont même pas respecté l'horaire. Bonjour l'organisation, ils n'ont pas mis une seule affiche sur toute la ville et ignoré internet. Question communication, l'Union des Commerçants Provinois devrait prendre quelques cours, au lieu de passer son temps à maugréer sur les grandes surfaces qui s'en viennent brouter dans le pré carré de leur clientèle. A la régie son, ils ne possèdent même pas la liste des artistes qui devraient se succéder... Dommage, ils ont aménagé une plage de sable en face de la scène avec transats et parasols, les gamins squattent la grande fontaine, d'autres hantent la structure gonflable, le soleil brille, pour les énervés du shopping, stands à babioles et bijoux de fantaisie sont sagement alignés, n'y aura pas plus de deux cents visiteurs...
L'ARAIGNEE AU PLAFOND

L'on a raté les trois premiers morceaux, râlant. Surtout que Mildred est en forme. Dans son T-shirt Keith Richards elle arpente la scène en tout sens croisant et recroisant Bob – son heureux géniteur – qui balade un peu partout sa Vox – au format ovale revu et corrigé selon les critères du cubisme picassien – en grande forme le paternel, démangé par le démon du riff qui nous donnera dans quelques minutes un rumble démoniaque et tsunamique à ronger les racines des tilleuls de la place.

Bad, les cuivres sonnent la charge, pas du tout en porcelaine les trois sax, Louis à l'alto, Ruben qui ténorise et Jeff qui barytonne, de l'autre côté les trompettes de Mehdi et de Iann' tempêtent sur l'océan houleux qui déferle, et Typhaine rajoute la grêle note de sa clarinette, comme le grain de sel qui donne le goût à la mixture qui bouillonne dans la marmite du diable. Je préfère leur version à celle de Jackson, trop bien léchée, ici il y a la voix de Mildred qui bouscule tout, pas du tout mauvaise la frangine, mais l'on sent le caractère affirmé.

Il y a encore du monde derrière. On ne les voit pas, car ils sont après les deux sections à vent. Séverine, magnifique basse rutilante dans ses mains, pas besoin de remonter dans l'arbre généalogique de la famille jusqu'à la vingt-cinquième génération pour comprendre d'où provient la grâce de Mildred. Phil-Lou est à la batterie, le sens du rythme dans la peau, jamais en défaut, les gestes précis et convaincants, l'est encore jeune, attendez trois ans que ses muscles et sa force se soient affirmés et il y aura un sacré batteur sur le marché. Enlil est au piano. Discret mais indispensable. C'est le mystère de L'Araignée Au Plafond, sont assez nombreux pour créer un gros coassement cacophonique indescriptible, et l'écoute se révèle d'une extraordinaire limpidité. Aussi transparent et tranchant qu'un quatuor à cordes. Avec cette satanée aragne, l'oreille sait toujours où elle va. Un petit côté récré mais qui recrée. Comme ces filles qui s'habillent avec ce qu'elles trouvent dans le premier carton du dernier fripier des puces, qui vous endossent sans prévention un truc manifestement trop grand pour leur petite taille, et hop, tout de suite le vêtement vous prend un style inimitable - chien chic et patte folle - qui n'appartient qu'à elles.

Just A Girl, Mildred vous le répète si fort que c'en devient un brûlot féministe. Doucement les filles, suis juste un garçon. N'y suis pour rien. Simple question d'ADN. Zut et flûte traversière, c'est déjà fini, Jumpin' Jack Flash en terminator. Bob et Mildred descendent dans le public, superbe orchestration avec les cuivres qui derrière vous coulent des colonnes de bronze alors que le père et la fille papillonnent autour du lamparock à bronzette comme des arachnides fous. Au secours, nous ont inoculé une bonne dose de noir et profond venin du rock and roll ! Comme si nous en avions besoin !

( Photos : FB : L'Araignée Au Plafond )

LOREANN'
Le retour ! Rappelez-vous, nous lui avons consacré une dizaine de compte-rendus de concerts dans les cafés de Provins l'année précédente et la revoici toute pimpante, sa guitare sur le dos en train de monter les marches de la scène. C'est bien la même, mais quel changement, une assurance toute nouvelle, rien que dans les quelques mots d'auto-présentation l'on sent une maîtrise qu'elle n'avait pas encore acquise en octobre dernier.

Deuxième choc. La voix. C'est bien la même. Mais toute différente. Le même timbre, le même léger effeuillement verlainien, cette imperceptible fêlure qui fait que les gens s'arrêtent, et restent plantés devant l'estrade totalement fascinés. La même donc. Mais sortie, projetée en avant. Fallait se mettre à l'écoute et maintenant c'est elle qui vient à votre rencontre. N'a pas perdu une once de son charme ni la gamme de ses harmoniques, mais a gagné en présence. Pas de tintamarrance malvenue, pas de mégalophonie envahissante, la même eau pure mais un jet de source plus puissant.
Pour le répertoire c'est le même. En plus étendu. Chantera deux heures sans s'arrêter une seconde. A la sono, ils sont trop contents, jouent sur du velours et comme ils ignorent le nom de la prochaine prestation, ils sont aux anges, le genre de chanteuse qui envoûte le public. Pas de souci à se faire, n'y aura pas une seule protestation. Sur les transats sont capables de l'écouter jusqu'à la nuit tombante.
Dominante folk. Tape un peu dans tous les registres de Suzan Vega à Amy Winehouse. Mais tout est métamorphosé, chez Loreann' le rythme devient transitoire, il est là – et bien là – mais il ne fait que traverser le morceau, comme un pianotement adjacent qui apporte sa couleur pour mieux se teindre dans sa palette automnale. Note d'humour aussi qui transparaît davantage, portée dans la vivacité de la voix. Ce pauvre Jack de Ray Charles qui s'en va si piteusement hiter the road et se faire voir ailleurs, ce Laisse Tomber les Filles de Johnny tellement débarrassé de sa gangue yé-yé qu'il en devient tendrement ironique. Des mots susurrés si doucement que l'on n'en ressent plus l'acidité. Loreann a gagné en maturité, elle interprète, elle pose sa marque, prend un morceau et le façonne à sa volonté, plus emphatique sur El Condor Pasa de Simon and Garfunkel, surprenante sur I Put a Spell on You de Screamin' Jay Hawkins.

C'est que depuis six mois, Loreann' n'a pas arrêté, café, bars, rues, métro, a même tourné dans des cabarets parisiens, s'est frotté à tous les milieux, partout où le vent la mène, à Montreux dans quelques jours, à St Tropez cet été, toujours la même simplicité et ce désir de progresser. Commence à travailler d'arrache-pied à ses propres compositions, en attente de ce qui viendra, déjà à la croisée de bien de chemins ouverts.
Annonce sa dernière chanson dès qu'elle aperçoit un groupe de jeunes auprès de la sono qui veulent faire de la break-dance. Quitte la scène sur la pointe des pieds sous un tonnerre d'applaudissements. Lorean' retrouvée.
SUITE ET FIN
L'on se réfugie sur la terrasse ombragée d'un café. Richard, Philippe, Bruno, Beatriz, et Loreann' et cette calamité de groupe local qui se nomme Mafé qui s'en vient corner si désagréablement dans nos oreilles. Qu'avons-nous fait au bon dieu pour mériter cet effondrement qualitatif ?
Damie Chad.
ROCK COLLECTION
1950 – 2000
les objets cultes du rock
dom kiris
( FETJAINE / 2011 )
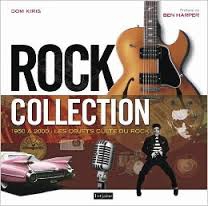
Le rock se penche sur son passé. Pas très bon signe. Quand on regarde en arrière c'est que l'on n'a plus trop de visibilité par devant. Ce genre de bouquin – vous avez une série similaire chaque mois dans Rolk & Folk - vous a un air suranné de brocante du dimanche matin. De quoi aviver la nostalgie du collectionneur qui se cache dans tout fan de base. Une véritable décharge publique le rock and roll, encombrée jusqu'à la gueule. Des strates empilées au-dessus des unes des autres comme la pâte du millefeuille ou les neuf Troie successives que les archéologues ont patiemment repérées et numérotées sur le site de la colline forteresse d'Hissarlik.

Dom Kiris nous sert de guide. N'est pas un néophyte en la matière, animateur sur Ouï FM – la station qui se proclame rock mais que je qualifierai, pour le peu de fois que je l'ai entendue, de pop – nous a déjà gratifiés d'un Guitares et Guitaristes de Légende qui traîne quelque part dans ma bibliothèque et dont je vous recauserai un jour. D'ailleurs, la majorité d'objets collectés et recensés par notre cicérockne appartiennent à cette denrée de base constamment en évolution que les musicos nomment le matos.
Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Principe organisationnel, qui semble facile à comprendre et à mettre en pratique, pourtant quand j'essaie d'appliquer cet antique proverbe teinté d'une sagesse ancestrale à mon bureau, je me retrouve en bout de course en face d'un amoncellement infâme et indéfinissable. Plaignez donc, notre pauvre Dom Kiris qui s'est chargé de faire rentrer cinquante ans d'objectivisation rock and roll en cinq misérables chapitres containers. Lorsque l'on entreprend une telle aventure, au début, l'on est tout feu tout flamme et tout semble facile. C'est après que les complications et la fatigue surviennent. La première partie est tirée au cordeau : Les années 1950, le rock and roll, rapide, clair et précis. De l'horlogerie suisse : ne manque pas une dent au moindre engrenage : Elvis, Martin Dreadnough, Gretsch, Gibson, les double bass, Sun, le revox, le wurlitzer, le shure, les bikers, le Perfecto, les Teddy Boys – présentés en leur début comme des adorateurs de Skiffle - les Cadillac, j'en passe, j'en saute, j'en oublie, c'est rangé, classé, étiqueté, comme la penderie de votre Tante Ursule. N'y a pas tout, mais l'essentiel est là.

Je ne voudrais pas dire du mal des fifties, mais si on réfléchit rapidement – erreur fatale et stupide – n'y avait pas grand chose, à se mettre sous la dent. Surtout en Europe. La société de consommation pointait le bout du museau mais n'avait pas encore fait son nid dans l'espace public. C'est dans les années 60 que ça se corse comme on dit du côté d'Ajaccio. C'est le moment d'opérer des choix draconiens : quatre fois plus de pages que pour la décennie précédente, mais l'on ressent les impasses en lisant l'intitulé : Les Hippies et le Psychédélisme. Gibson J-45, Dylan, Stratocaster, Hendrix, Rickenbacker, amplis, pédales, Fender, Hamond, Miles Davis, Neuman U47, Teppaz, vestes à Brandebourg, badges, Vespas, Acide, Jack Daniel's ( merci, vous pouvez remplir le verre jusqu'en haut )... Tout à l'air d'être là, surtout les trous du gruyère. Côté London, ça ne swingue pas beaucoup. Arrêtons de chichiter sur le shit, comme disent les babas cool, s'est attaqué à un gros morceau, l'en a ramené des portions importantes. S'il est impossible d'emporter le Parthénon en entier, l'on prendra soin de prélever les frises.
Toujours plus. Les années 70 : le Hard Rock et le Glam rock. Ribambelles de guitares, farandoles d'amplis et de boîtiers divers, consoles à 16, 24, 48, 96 pistes, des pianos qui perdent de plus en plus leur queue et qui se reproduisent par hormones de synthétiseurs, les vestes à franges, les vestes US Army, les chevelus et les androgynes, et plein d'autres trucs bizarroïdes que je vous laisse réinventer. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ? Vous refile le tuyau : zieutez la suite.
Les années 1980 : Le Punk et la New Wave. S'inspire du coucou, le Dom qui rit, place les oeufs du précédent dans la couvée suivante. Vous me direz qu'il faut bien remplir les tiroirs vides. Surtout quand ceux qui précèdent débordent d'effets. Pas grand chose in the no fabulous eighties, des guitares, des synthétiseurs numériques qui ont envie de remplacer nos demoiselles encordées, le walkman, des saxophones japonais, les lunettes noires, une ligne de cocaïne, une photo de Madona et une autre de Michael Jackson. L'est temps de passer à la case suivante.
Les années 1990 - 2000 : Le Grunge et le Trash Metal. Toujours des guitares, l'on insiste sur les électro-acoustiques, les DJ qui scratchent les vieux vinyls, la musique dématérialisée, les Converse, les skates et le zippo. L'en a marre, pressé de finir. L'a dû verser tout le reste directo à la poubelle. L'inventaire est terminé. Rien de transcendantal. Bien mis en page. Des notices explicatives rapides et pas mal tournées. Je n'ai pas mentionné la préface de Ben Harper, le touche à tout que je ne qualifierai point de génie - une mini-interview qui n'apporte aucune révélation fracassante.
Pas très enthousiasmant quand on y réfléchit. Une dent d'ivoire passée en collier autour de votre cou ne remplacera jamais le tigre à qui elle appartenait. Le bric à brac, la bimbeloterie des objets inanimés qui n'ont plus d'âme ressemblent à ces colifichets expiatoires que l'on trouve sur les pierres tombales des cimetières. Alfred de Musset avait raison, l'on ne sait jamais si nous marchons sur des cendres ou des semences. Espérons que cette dernière possibilité soit la plus probable.
Damie Chad.
16:24 | Lien permanent | Commentaires (0)




Les commentaires sont fermés.